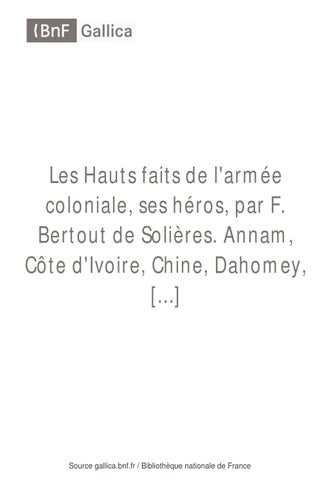Les Hauts faits de l'armée coloniale, ses héros, par F. Bertout de Solières. Annam, Côte d'Ivoire, Chine, Dahomey, [...]
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
Bertout de Solières, F.. Les Hauts faits de l'armée coloniale, ses héros, par F. Bertout de Solières. Annam, Côte d'Ivoire, Chine, Dahomey, Guyane, Madagascar, Maroc, Ouadaï, Sahara, Sénegal, Soudan, Tchad, Tonkin, Tunisie, etc.. 1912. 1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : - La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service. CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE 2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit : - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits. - des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation. 4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays. 6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978. 7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisationcommerciale@bnf.fr.
LES HAUTS FAITS DE
.1.n.T"RIJยก'TT.
«
A mon fils Raymond
comme exemple.
»
LES HAUTS FAITS DE
F. BERTOUT DE SOLIÈRRS
ANNAM, COTE D'IVOIRE,CHINE, DAHOMEY,GUYANE, MADAGASCAR MAROC, OUADAI, SAHARA, SÉNÉGAL, SOUDAN
TCHAD, TONKIN, TUNISIE ETC.
ROUEN J. GIRIEUD, IMPRIMEUR-ÉDITEUR 58, Rue des Carmes, 58
1912
Page 18, ligne 28.
:
Lire il fut capitaine au 17e de ligne et a pris sa retraite depuis. Maquard est lieutenant-colonel de territoriale. Page 35, ligne 21.
Lire : Albert de Colomb a été trésoricr-payeur, otc. Page 62, ligne 17.
:
Hautefeuille après avoir été capitaine de vaisseau et commandant de la marine en Algérie fut nommé contre-amiral. Il occupa alors un poste important auprès du prince de Monaco. Lire
!
Sursum coraa
Le domaine colonial de la France s'est, depuis la guerre franco-allemande, considérablement agrandi. Ce domaine tend, aujourd'hui, à redevenir ce qu'il était à une époque, déjà lointaine, où notre pavillon flottait sur toutes les mers, où notre domination s'étendait sur d'immenses pays. Des territoires considérables ont été conquis par nos troupes pendant cette période des sujets en nombre incalculable ont été placés sous notre protection. Le Tonkin, dont l'importance croissante compensera bientôt la perte de notre ancien empire des Indes, Madagascar, la perle noire, la grande île, déjà française sous Louis XIV; le Soudan et sa zone d'influence la Guinée le Dahomey et son hinterland la Côte d'Ivoire le Congo, etc., etc. C'est donc avec un légitime orgueil que la France peut contempler ce prodigieux accroissement. Une ombre cependant vient obscurcir ce consolant tableau le souvenir de ceux qui ne sont plus et qui ont donné leur sang pour obtenir le résultat auquel nous applaudissons. Comme chacun le sait, la conquête de nos nouvelles colonies, à part quelques rares exceptions, ne s'est pas opérée d'une façon toute pacifique. La poudre a parlé, et dans ces entreprises gigantesques des milliers de Français sont morts à la tâche. Ce sont ces braves, ces pionniers de la civilisation française, nobles enfants qui ont succombé au champ d'honneur, ce sont leurs camarades plus heureux qui les ont vaillamment secondés et qui ont survécu, ce sont enfin les dévouements, les héroïsmes obscurs ou inconnus qu'il convient de célébrer.
;
;
;
;; :
;
L'exemple de leur bravoure, de leur mort glorieuse ne doit pas être perdu il doit servir à exhorter les jeunes générations à suivre leurs ainées dans la voie entreprise, à donner sans compter, avec toutes leurs forces, leur jeunesse, leur vie même pour la grandeur, la prospérité et le beau renom de la France. C'est ce qu'un des vaillants parmi les Coloniaux, le capitaine Briquelot, écrivait quelques jours avant sa mort « Nous devons donner aux petits l'exemple du courage et de la ténacité, si nous voulons qu'ils marchent sur nos pas. L'exemple fait plus que toutes les leçons. » Rendre, en premier lieu, hommage aux nombreux héros de l'armée coloniale, cette armée dont tous les éléments bien vivaces n'attendent que le moment où ils seront réunis pour former un grand corps exalter leurs vertus, donner aux jeunes de salutaires leçons de sacrifice, d'abnégation et de patriotisme porter partout le culte du drapeau, voilà le but que nous nous sommes proposé en commençant cette étude. Nous ne ferons point de distinctions mathurins, bigors, marsouins, lignards, vitriers, joyeux, turcos ou zouzous, chacun aura sa place, car chacun en est digne. Dès qu'un soldat se donne à la France, à la Patrie, qu'il accomplit un acte méritoire, qu'il meurt glorieusement en combattant ou qu'il disparaît sans bruit assassiné traîtreusement dans un guet-apens, qu'il est blessé, arrosant de son sang les terres nouvelles qu'il conquiert à son pays, tout esprit de corps disparaît. Qu'importe alors s'il a sur l'épaule du jaune, du vert ou du rouge, s'il est coiffé du béret, du képi ou de la chéchia Ces subtiles distinctions, dont on ne peut nier la raison d'être, s'effacent cependant complètement pour ne plus laisser place qu'à une seule catégorie de soldats les fils de France dont la Mère-Patrie peut s'enorgueillir.
:
;
;
:
!
:
Dès lors, pour bien marquer l'égalité que nous attachons aux dangers courus, aux hauts faits cités, tout autant que pour ne pas fatiguer l'attention de nos bienveillants lecteurs, nous ne suivrons pas dans ces récits un ordre méthodique, géographique ou chronologique, nous les ferons se succéder au gré de nos souvenirs, allant du Tonkin au Soudan, de Madagascar à la Côte d'Ivoire, de Tahiti à la Guyane, de Francis Garnier à nos jours. Puissent ces nobles actions aider à propager dans les masses les idées de bravoure, d'héroïsme, d'abnégation, de dévouement et de sacrifice, nous nous estimerons alors heureux de notre modeste effort, car il ne faut pas oublier que, si la grandeur de la France exige que tous ses enfants ne vivent que pour elle, il y a des cas où sa dignité, son honneur commandent que des Français meurent pour la venger
!
LES HAUTS FAITS
lt'JlR}YlÉE
DE
'eOhOJ'lIJlliE
SÉNÉGAL
COMBAT DE
Dio (11 mai 1880)
Le capitaine Galliéni. — Le docteur Le laptot Saër.
Tautain.-
Ahmadou, sultan de Ségou, fils du célèbre prophète AIHadji-Omar, l'ancien ennemi de Faidherbe, avait établi sa puissance et son autorité sur des territoires considérables, confinant notre possession du Sénégal. En 1879, le colonel Brière de l'Isle, gouverneur de cette colonie, poursuivant la réalisation de ses projets de pénétration dans le Soudan, résolut d'entrer en relations avec le farouche almany et de lui envoyer une mission chargée de lui faire reconnaître notre domination ou tout, au moins, de lui faire signer un traité d'amitié. Une colonne comprenant 30 tirailleurs sénégalais et 10 spahis, 300 bêtes de somme, ânes et mulets, 100 conducteurs indigènes, fut organisée sous le commandement du capitaine d'infanterie de marine Galliéni (auj ourd'hui général de division, gouverneur de Madagascar). Leslieutenants Vallière et Piétri, envoyés en avant pour préparer les populations, devaient aussi explorer la route à suivre.
La mission quitta Médine, le 22 mars 1880, accompagnée des médecins de la marine Tautain et Bayol; elle atteignit sans encombre le village de Dio, situé à quelques journées de marche du Niger, mais il lui lut interdit d'y pénétrer (10 mai). Galliéni, inquiet, fit établir le camp à environ 600 mètres au delà du village et envoya examiner le terrain avec la plus grande attention. Les patrouilles ne virent rien de suspect; néanmoins, on veilla toute la nuit. Le lendemain, 11 mai, au.point dujour, la colonne fatiguée se remit néanmoins en marche 4 spahis formaient la pointe d'avant-garde, puis venait le capitaine, suivi du docteur Bayol et de la moitié des Le Général Galliéni. tirailleurs. Le convoi s'avançait ensuite; enfin l'arrière-garde, formée du restant des tirailleurs, était sous la direction du docteur Tautain. Un ruisseau très encaissé, aux rives escarpées couronnées d'une végétation luxuriante, de broussailles épaisses, vint lui barrer le chemin. L'avant-garde passa avec quelques difficultés et s'avança de plusieurs centaines de mètres, pendant que les mulets et les ânes franchissaient le ravin. A ce moment, les herbes s'agitent, les fourrés frémissent
:
et de toutes parts surgissent des Bambaras, poussant leur cri de guerre: Hou! hou! Une fusillade très vive s'engage, les noirs se ruent sur le convoi, tuant les animaux qui s'accumulent dans le lit du marigot, massacrant les conducteurs. Des pillards entraînent rapidement à l'abri les ânes qu'ils peuvent prendre et transportent aussi en un clin d'œil la plupart des bagages de la colonne. Pendant ce temps, le capitaine Galliéni attaqué furieusement se défend en désespéré il parvient même à gagner une légère éminence sur laquelle des ruines d'un village, vieux murs, levées de terre, lui permettent de se reconnaître et d'organiser une tentative'de résistance. L'arrière-garde, vigoureusement soutenue par les laptots, fait un feu d'enfer pour dégager le passage. Un laptot Saër, atteint de plusieurs blessures, ne pouvant se tenir debout, continue de tirer assis au bord du ravin, tranquillement, comme à l'exercice. Le docteur Tautain. entraîne enfin tout le monde à l'assaut pendant que Galliéni revient à son secours. « Sur l'autre bord, on entendait le clairon des tirailleurs qui s'avançaient. Profitant d'une éclaircie, l'interprète Alassane prend le docteur en croupe et suivis des combattants qui restaient valides, se précipitent au pas de charge sur les Bambaras. » Les deux troupes parviennent enfin à se rejoindre et se hâtent de regagner les ruines derrière lesquelles on transporte les blessés. Le jour commençant à baisser, pour sortir de cette position critique, le capitaine Galliéni se décide à en finir. Il rassemble tout son monde, installe les malades sur quelques mulets que l'on a pu rattraper, puis se fait jour à travers les ennemis, le révolver au poing. Les Bambaras, maintenus à distance, suivent la petite colonne et n'abandonnent la poursuite qu'à la nuit.
;
Pendant cette terrible journée, la mission avait eu 15 hommes tués, 16 blessés et 7 disparus; le convoi était entièrement dispersé ou volé. La nuit entière fut consacrée à la marche pour échapper à l'ennemi le lendemain, la petite troupe harassée arrivait à Bammakou où elle retrouvait les lieutenants Vallière et Piétri qui n'avaient pas été inquiétés. Poursuivant résolument sa route,Galliéni traverse le Niger et avec ses 50 hommes se dirige sur Ségou. Ahmadou prévenu de son arrivée, lui interdit d'avancer, et pendant près de dix mois, le retient presque prisonnier dans le village de Nango, à 40 kilomètres de sa capitale.
;
MADAGASCAR
DÉFENSE D'AMBIKY (5 et 6 octobre 1897)
Le capitaine Mazillier. — Morts du lieutenant Turquois et de l'adjudant Renaut. Le commandant Gérard, chef de la colonne dirigée, en 1897, sur le Menabé pour le pacifier, occupa le Betsiriry complètement évacué par les rebelles après l'affaire d'Anosymena. Un second combat, livré à Ambiky au roi indigène Toéra qui y fut tué, lui livra toute la vallée de la Tsiribihima et le Menabé central c'était un beau résultat. Les troupes furent alors obligées de s'éparpiller pour assurer l'occupation effective de la province et garnir suffisamment les nombreux postes qui venaient d'être créés pendant cette campagne. fn détachement du régiment colonial s'installa à Ambiky, sous le commandement du capitaine Mazillier, de la 4e compagnie, et commença les travaux nécessaires pour le mettre en état de défense. Le pays semblait tranquille, la population sakalave paraissait avoir accepté docilement ses nouveaux maîtres. Mais, il n'en était pas de même des nombreux Arabes et Hindous installés dans la province et dont le principal commerce, l'achat de l'or et des esclaves, était désormais anéanti. Ils intriguèrent et excitèrent les Sakalaves à se révolter; quelques chefs les écoutèrent et résolurent de surprendre les Français
;
dans leur tranquillité relative.
Tous nos petitspostes furent assaillis inopinément dans les premiers jours d'octobre. A Ambiky, des bandes comprenant environ un millier de fusils à tir rapide, commandées par le chef indigène Ingureza, se précipitent sur le fortin défendu seulement par une centaine d'hommes. Le 5, nos troupes réussissent à repousser les attaques réitérées de l'ennemi cinq fois le capitaine Mazillier est forcé de rallier sous son feu les Le Lieutenant Turquois. tirailleurs sénégalais de sa compagnie qui, emportés par leur ardeur, se laissaient entraîner, après chaque assaut, à poursuivre les Sakalaves au-delà des parapets qu'ils avaient à défendre. Le lieutenant du génie Turquois fait le coup de feu comme un soldat, son énergie, son sang-froid lui valent des félicitations du capitaine lorsqu'une balle vint le frapper en plein cœur. L'adjudant de la légion étrangère Renaut, le soldat d'infanterie de marine Piernot, sont tués dans la même journée. Le 6, l'attaque recommence furieuse dès. le point du jour. Epuisée par la lutte, décimée par les balles, la vaillante petite troupe française se défend en désespérée. Le capitaine Mazillier est blessé la pluie de fer continue, la position devient intenable. Réduits à cette triste extrémité, les tirailleurs sénégalais et les autres militaires évacuent le
;
;
poste sous la direction des sergents, font une trouée, et réussissent à gagner le port de Tsimanandrafosana, qui est protégé par le canon de quelques navires ancrés en rade. Ces deux journées nous coûtaient cher, mais grâce au sangfroid et à la brillante conduite du sergent-majorLandru, des sergents Vielle et Roguin, un désastre plus grand put être évité. Une colonne commandée par le colonel de Septans vint quelques jours plus tard mettre les rebelles à la raison, et reprendre possession du fortin. Aujourd'hui, le poste d'Ambiky a pris le nom de poste Turquois et celui voisin du port Ambiki le nom de poste Renaut les deux braves revivront ainsi sur les terres qu'ils ont arrosées de leùr sang. Dans cette attaque générale des postes du Ménabé, la France perdit encore le 7 octobre, à Ankalalobé, le lieutenant d'infanterie de marine Chambaud, et le 10, à Adamba, le lieutenant de tirailleurs algériens Randey nous en reparlerons. Le lieutenant Turquois (Gustave), dont nous venons de relater la mort, était né à Lyon le 10 juillet 1866. Engagé volontaire en 1885, après avoir passé ses examens pour l'Ecole Polytechnique, Turquois était entré à l'Ecole d'artillerie et du génie avec le n° 1, le 1er avril 1890, et il en était sorti l'année suivante, toujours major de promotion. Sous-lieutenant du génie au 1er régiment, lieutenant au 6e à Angers le 23 mars 1893, cet officier avait été désigné en 1896 pour faire partie de la 12e compagnie du 2e régiment du génie envoyé à Madagascar. la nouvelle Le23 octobre 1897, il était nommé capitaine de sa mort ne parvint que le lendemain au Ministère de la Guerre.
:
;
;
SOUDAN
PRISE DE KOUDIAN (18 février 1889)
Le sous-lieutenant Marchand
En 1888, Samory et Ahmadou qui n'avaient auparavant accepté la paix que dans l'intention de se refaire, s'entendirent à nouveau pour attaquer nos postes. Le village de Koudian, commandé par un lieutenant d'Ahmadou, Boukary, était le centre de toutes les intrigues, le refuge de tous les pillards de la région, Prévenu de ce qui se tramait contre nous, le commandant supérieur Archinard, chef d'escadron d'artillerie de marine résolut de tenter un coup de force et d'écraser les rebelles dans leur repaire; il organisa, dans le silence, une expédition. Parti le 15 février 1889 avec une colonne forte de 400 hommes, il paraît devant Koudian le 18 au matin, après avoir parcouru plus de 400 kilomètres. Une avant-garde, sous les ordres du capitaine Quiquandon, de l'infanterie de marine, était arrivée depuis deuxjours dans les environs, dans le but d'étudier la place et surtout de gêner les préparatifs de défense ce double but fut atteint. En effet, les gens de Koudian crurent que l'avant-garde allait les attaquer; ils se renfermèrent alors dans la citadelle, se contentant simplement de se garder étroitement et d'envoyer des défis aux Français. Toutes les nuits, les cris de «Allor'ou» (gens des créneaux, veillez! se faisaient entendre
:
)
presque continuellement montrant avec quelle terreur les sofas attendaient l'attaque. Lorsque la colonne arriva tout entière, alors ce fut de la consternation. Un premier obus de 80fut envoyé au centre de la ville, puis on attendit; rien ne bougeant, aucun parlementaire ne se présentant, le tir fut repris et dirigé également sur les murs du fortin. Malheureusement, les projectiles un peu petits ne produisaient presque aucun effet sur ces murs en pisé et enterre, on dut redoubler le feu. Le bombardement et le tir en brèche commencés à 6 heures du matin continuèrent jusqu'à deux heures du soir. A ce moment la brèche paraissant praticable,l'assautfut Le Commandant Marchand. ordonné les murailles se couvrirent aussitôt de nombreux défenseurs qui jusqu'alors étaient restés tapis dans la ville. La colonne d'assaut composée d'une compagnie de tirailleurs fut brillamment enlevée par ses chefs, le capitaine de Fromental et le sous-lieutenant Marchand, le futur héros de Fachoda; mais la prise de la brèche fut rude. Malgré l'élan, la vigueur des troupes, les sofas tiennent quand même, se faisant tuer sur place plutôt que de reculer; quelques tirail-
;
leurs ayant par bonheur pu réussir à couronner les créneaux voisins et à tirer dans l'intérieur de la ville, la débandade de l'ennemi commença et s'effectua rapidement. Le sous-lieutenant Marchand eut son casque traversé par une balle et fut blessé à la tête en pénétrant le premier dans Koudian;son audace et son courage furent très remarqués et lui valurent, d'ailleurs,une citation à l'ordre du jour. Dans le village, le combat continua encore quelques heures, les noirs se retirant de case en case, offrant une résistance désespérée.Vers quatre heures cependant le palais du gouverneur tombait entre nos mains, et tous les sofas étaient tués ou faits prisonniers. On compta chez euxplus de 300 morts.' De notre côté nous avions un tirailleur tué et trois autres blessés, quelques auxiliaires tués. Marchand reçut pour sa belle conduite la croix de la Légion d'honneur le 18 septembre suivant et passa lieutenant quelques mois après.
-'
TONKIN
PRISE DE
Y
SONTA
(16 décembre 1883)
Le lieutenant Maquard. — Le soldat Minaért. Les lignes de Phu-Sa ayant été emportées, le 14 décembre 1883, l'armée fit un mouvement en avant et légèrement tournant pour isoler Sontay du fleuve Daï, en prenant ses dispositions pour l'attaquer le lendemain. Le 16 décembre était un dimanche. Les troupes occupèrent, dès le matin, les positions assignées la veille. L'attaque principale devait se faire par la porte ouest de l'enceinte, située à l'extrémité d'un long saillant dominé par des hauteurs. Quoique minée, cette porte paraissait offrir les conditions les plus favorables des canons furent hissés sur les tertres environnants auprès de quelques pagodes qui y étaient construites. Les zouaves, trop éprouvés à l'attaque de Phu-Sa, furent laissés en arrière et remplacés, en première ligne, par la légion étrangère et les tirailleurs. Un feu très vif s'engage tout d'abord des deux côtés. L'ennemi cherche à prendre à revers notre position, mais ce mouvement tournant est arrêté par les 1er et 3e bataillons de tirailleurs algériens qui se portent en avant, au pas de course, soutenus par les canons-révolvers du Pluvier. A ce moment, on voit arriver sur le haut des remparts trois grands étendardsnoirs à lettres blanches; ce sont les propres drapeaux de Lui-Vinh-Phuoc qui semblent ainsi défier le com-
;
mandant en chef. On les balançe un instant au-dessus de la porte, puis ils sont plantés sur le sommet du mirador central. A la porte nord, le bataillon Chevalier, de l'infanterie de marine, se heurte à une résistance énergique et combat avec une persévérance et une bravoure remarquables. Du côté de l'ouest, le bataillon de la légion commence son mouvement vers midi il relève les deux bataillons de tirailleurs et, s'abritant derrière les talus qui coupent les rizières, il avance lentement. Les compagnies de tête, 3e et 4e, s'engagent sérieusement vers trois heures. Couvertes par le feu de l'artillerie, elles poursuivent leur mouvement jusqu'à 60 mètres de l'enceinte. L'ennemi se montre tenace, la mitraille tombe drue comme grêle nos troupes sont immobilisées. Vers cinq heures, le soleil baissant, on se décide à donner l'assaut quand même. L'artillerie cesse son feu, l'amiral Courbet lève son casque. A ce signal convenu, les commandements de « En avant » retentissent sur toute la ligne les clairons sonnent la charge et les soldats se précipitent sur les remparts aux cris de « Vive la France » Le moment est émotionnant. La légion étrangère, ayant à sa tête le commandantDonnier et le capitaine adjudant-major Mehl, court vers la porte murée. Le bataillon des marins, guidé par le commandant Laguerre, le lieutenant de vaisseau Couturier et l'enseigne Blondeau, se dirige vers la porte du nord, avec une compagnie d'infanterie de marine. « Des remparts on nous crible de balles, nous écrit un témoin oculaire. Une nuée de Chinois débouchent par la porte ouest et s'établissent audacieusement, à découvert, en dehors desfortifications ». La tête de colonne de la légion arrive enfin au pied des glacis, garnis de palanques et de chevaux de frise. Le feu
;
:
!
:
!
;
s'éteint alors dans la ville, les Chinois attendant les assaillants l'arme à l'épaule. Le capitaine Mehl, en tête d'un groupe
Le Lieutenant Maquard à Ja prise de Sontay.
-
de soldats dela légion, s'élance sur le glacis; de multiples explosions retentissent. Ce sont des bambous remplis de
poudre qui éclatent en faisant de nombreuses victimes parmi les braves qui cherchent à gagner les murailles. On s'ouvre un passage, la hache à la main, au travers des palissades tout le monde travaille avec ardeur. Le lieutenant Maquard parvient enfin à arracher un bambou à demibrisé et saute le premier, suivi de son ordonnance, le soldat Minaërt. Quelques pas en arrière, le capitaine Mehl tombe frappé d'une balle en plein cœur; le capitaine Lecomte et une soixantaine de légionnaires sont couchés sur le terrain. Le lieutenant Maquard et son ordonnance poursuivent leur course, franchissent le fossé et pénètrent dans la ville par une embrasure de canon. Les soldats de la légion, entraînés par cet exemple, ne tardent point à les suivre, chacun passant par où il peut. Pendant ce temps, on finit de briser la porte murée un tourbillon humain s'y engouffre, enfonçant les barricades, coupant les bambous, renversant tous les obstacles. Les étendards noirs sont jetés à bas et remplacés par le drapeau français. Il est exactement 5 heures 45. Malheureusement, notre succès nous coûtait cher nous avions 83 morts et 319 blessés. Cinq officiers tués les capitaines Cuny et Doucet, le lieutenant Clavet, de l'infanterie de marine, le capitaine Mehl, de la légion, et le capitaine Godinet, des tirailleurs. Le lieutenant Maquard, qui pénétra le premierdans Sontay, est né à Sivry-sur-Meuse. A Bac-Ninh, il entra encore le premier dans la citadelle et planta lui-même le drapeau sur la tour. La croix de la Légion d'honneur l'a récompensé de ces deux beaux faits d'armes; il est aujourd'hui capitaine au 17e de ligne. Le soldat Minaërt a été retraité il y a quelques années comme adjudant et chevalier de la Légion d'honneur.
;
;
; :
COTE D'IVOIRE
SURPRISE DE BOUNA (20
août 1897)
Le capitaine Braulot, le lieutenant Bunas, le sergent Miskiewicz.
Poursuivant le cours des opérations tentées par son prédécesseur, le commandant Caudrelier, de l'infanterie de marine, venait d'occuper le Gourounsi (1897), lorsque dans le but de compléter la jonction entre le Soudan et la Côte d'Ivoire, il envoya une légère colonne, sous le commandement du capitaine Braulot, prendre possession de Bouna, ville très importante, clef de toute la région de la Volta et du Comoë. Le capitaine Braulot connaissait parfaitement le pays, il l'avait à plusieurs reprises parcouru dans tous les sens. Il accompagnait Binger, lors de la réunion dela Commission de délimitation de la frontière anglo-françaisede la Côte d'Ivoire, et visitait tout le pays de Kong. En septembre 1892, chargé par le Sous-Secrétaire d'Etat aux Colonies d'effectuer un voyage d'exploration dans l'hinterland de cette contrée, pour essayer de rattacher nos deux possessions de la vallée du Comoë et du Dahomey, il remporta -les plus éclatants succès. On pouvait donc espérer que sa nouvelle mission recevrait entière satisfaction. Le 10 août 1897, le capitaine Braulot arrivait en vue de Bouna, solidement retranchée etfortifiée. Les sofas qui l'oc-
cupaient refusèrent de le laisser entrer et même de lui fournir quoi que ce soit pour la subsistance de sa troupe. Après avoir campé plusieurs jours aux portes de la ville, sans avoir pu décider les habitants à revenir à de meilleurs sentiments, le capitaine remonta vers le Nord, dans le Lobi, où il comptait trouver des vivres. Pendant la seconde étape, arrivée vers le village de Bouguié. la petite troupe française rencontra une colonne de 7 à 8.000 sofas, commandée par un desfils de notre ennemi irréductible Samory, Sara Tiéni Mori. Des pourparlers s'engagèrent, des cadeaux furent échangés, on se fit des visites, puis on tint palabre. Les deux chefs décidèrent alors qu'ils retourneraient ensemble à Bouna, dans laquelle Tiéni Mori se faisait fort de nous faire entrer avec lui. Le 19, la marche est reprise au Sud. Le capitaine français, qui marche en tête, a fait monter le fils de Samory sur un mulet et l'a placé à ses côtés les sofas marchent derrière le détachement de tirailleurs. Le 20, au matin, Sara Tiéni propose à Braulot de partir en avant avec lui afin d'essayer d'engager des négociations avec les habitants de Bouna. « Braulot, qui y consentit, part accompagné de son boy, de trois Foulbés et d'un clairon de ma compagnie, écrit le capitaine Bouland, des tirailleurs soudanais, qui l'avait quitté à Lakosso. A partir de ce moment, on ne voit plus ni le capitaine, ni Tiéni. On marche longtemps sans pause, le convoi s'allonge, ce qui s'est passé exactement ne se saura peut-être jamais. Voici la version donnée par les indigènes qui ont
;
:
survécu « A ce moment, il est à peu près dix heures, la colonne de sofas qui est derrière le détachement se rapproche, des hommes passent à droite et à gauche sous prétexte de faire serrer
;
les porteurs on aperçoit Bouna et on en voit sortir des bandes de soldats. « Tout à coup, deux coups de fusil partent de l'endroit probable où se trouvent Braulot et Sara Tiéni, suivis d'une sonnerie de trompe de guerre. « En un clin d'œil, le lieutenant Bunas, le sergent Miskiewicz, deux sergents et deux caporaux indigènes tombent frappés de coups de fusils les hommes qui ont l'arme à la bretelle sont assaillis chacun par quatre ou cinq sofas et désarmés C'était un véritable guet-apens l'attaque avait été si brusque que ceux qui en sont revenus peuvent à peine s'expliquer le fait. Pendant quelques minutes, tout a été si confus, que pour eux ils ont perdu le souvenir. Ils se sont trouvés seuls, tout à coup, entourés de morts et de blessés, sans armes, sans bagages, les porteurs ayant filé avec les gens de Samory. C'était une perte de 60fusils, 20.000 cartouches et 100 caisses de vivres On n'a jamais eu de nouvelles du capitaine Braulot; quelques-uns ont pensé qu'il pouvait être retenu captif, mais, d'après de récents renseignements, il n'est malheureusement que trop certain qu'il a été massacré, assassiné traitreusement comme ses Le Capitaine Braulot. vaillants soldats etqu'un martyr de plus est à inscrire à la suite de la liste déjà longue de ceux qui sont tombés pour la grandeur coloniale de la France. Honneur à ces braves Braulot, Bunas et Miskiewicz !
;
;
».
!
:
Le capitaine Braulot était un Africain de vieille date. Né à Nancy en 1861 et engagé volontaire à dix-huit ans, il entra à Saint-Maixent en 1885, après une première campagne au Sénégal. Il fitun séjour à Madagascar, de 1886 à 1888, comme sous-lieutenant, fut promu lieutenant le 7 septembre 1888 et capitaine en 1895. Le lieutenant Bunas, né à Cahors le 6 février 1864, s'était engagé à dix-neuf ans aux chasseurs à pied. Il fit colonne au Tonkin et en Annam dans les années 1887 et 1888, fut nommé sous-lieutenant au 4e régiment d'infanterie de marine, le 22 mars 1889, et séjourna au Sénégal en 1890-91. Promu lieutenant le 23 septembre 1891, il retourna une seconde fois au Sénégal en 1893-94, et, après son congé, avait repris service au Soudan. Il était chevalier de la Légion d'honneur.
GUYANE
COMBAT DE MAPA
(territoire contesté brésilien, 15 mai 1895).
Assassinat du capitaine Lunier. — Héroïsme du lieutenant Destoup. Par suite d'une erreur dans la dénomination de l'un des fleuves servant à la délimitation de notre colonie de la Guyane, erreur remontant au traité d'Utrecht (11 avril 1713), il existait une région sur laquelle la France et le Brésil éle-
:
vaient des revendications communes on nommait ce territoire le contesté franco-brésilien. De nombreux pourparlers, des arbitrages de toutes sortes n'avaient pas, depuis plus d'un siècle, fait avancer la question elle vient d'être réglée récemment par un arbitrage de la Suisse. En attendant, un chef insurrectionnel du Brésil, le capitaine Véroz Cardozo de Cabrai, homme énergique et vigoureux, s'était installé en maître sur ce territoire, s'instituant luimême général gouverneur. Etabli à Mapa, petite ville du Contesté, non loin du cap anciens del Norte, commandant à une bande de brigands forçats, brésiliens déserteurs, anciens émeutiers de la province de Para, il avait persuadé aux habitants du territoire que tout l'or trouvé par les prospecteurs (chercheurs d'or) était la propriété absolue des occupants, qu'en conséquence, il ne fallait pas permettre aux étrangers, particulièrement aux Français, de venir s'installer dans le pays.
;
:
Le Brésil, agissant avec traîtrise, avait procuré à Cabrai, des fusils à tir rapide nécessaires à sa bande lui envoyant également d'ex-officiers et sous-officiers de l'armée régulière, lui payant une solde considérable, lui promettant des avantages encore plus grands s'ils parvenaient, lui et les siens, à drainer au bénéfice du Brésil tout le trafic du pays. Cabral mit tout en œuvre pour arriver à ce but. Plusieurs pillages denos nationaux avaient été laissés impunis lorsqu'en 1891 la capture de Trajane,notre représentant noir à Counani, la capitale du Contesté, décida le gouvernement à agir vigoureusement. Le chef de bataillon Péroz, commandant les troupes à la Guyane, reçut l'ordre de demander des explications, d'exiger la mise en liberté du prisonnier et d'obtenir des garanties pour l'avenir. L'aviso le Bengali partit de Cayenne pour Mapa emportant 60 hommes d'infanterie de marine commandés par le capitaine Lunier et le lieutenant Destoup, ainsi qu'une section de débarquement, 24 marins sous les ordres de l'enseigne de vaisseau d'Escrienne. La troupe débarqua le 15 mai 1895, et l'infanterie de marine prit aussitôt position autour de la Ville. Le capitaine Lunier, accompagné d'un clairon et d'un sous-officier pénétra dans Mapa et fut reçu immédiatement par Cabrai, entouré d'une soixantaine de partisans porteurs«de Winchesters. Dès que Lunier eut réclamé la livraison du prisonnier, Cabral rompant l'entretien décharge à bout portant son revolver sur le malheureux officier, puis se jetant de côté démasque sa troupe et commande un feu de salve sur les marins arrêtés à 150 mètres. En même temps, des hommes postés aux étages supérieurs des maisons commençaient un feu rapide très violent.
4 marins furent tués sur le coup, 11 marins et le clairon ainsi que l'enseigne de vaisseau furent blessés.
-
,
Assassinat du Capitaine Lunier (Mapa).
r
Au bruit de la fusillade, le lieutenant Destoup fait mettre baïonnette au canon à ses marsouins et se jette au secours des marins entourés de tous les côtés.
Une lutte corps à corps s'engage terrible. Destoup reçoit dans ses bras le capitaine Lunier qui a été atteint de cinq coups de feu après l'avoir fait transporter en arrière, il prend le commandement de toute la troupe et charge vigoureusement. Un combat de rues succède alors à la mêlée l'église, les maisons, attaquées l'une après l'autre sont l'objet d'une défense opiniâtre. Le village est livré aux flammes au fur et - à mesure de sa prise; à 1 heure de l'après-midi, tout était détruit l'ennemi comptait 60 tués et autant de blessés, parmi lesquels Cabral lui-même. Malheureusement, de notre côté nous avions 7 morts et parmi eux le capitaine, 19 blessés dont l'enseigne de vaisseau. 78 combattants avaient donc réduit au silence plus de 300 partisans sans compter les habitants qui faisaient cause commune avec eux la mort du capitaine était vengée et l'honneur du drapeau français lavé dans le sang. Par son entrain, sa vigueur, sa présence d'esprit le lieutenant Destoup resté chef de l'expédition,aprèsla mise hors de combat des autres officiers, rétablit la situation gravement compromise par le misérable guet-apens dont les maLe Lieutenant Destoup. rins avaient été victimes. Un mois après, cet officier recevait par cablogramme la nouvelle qu'il était fait chevalier de la Légion d'honneur pour sa vaillante conduite. Entré au 66e de ligne en 1882, passé comme sergent dans
;
;
;
:
l'infanterie de marine, sorti de Saint-Maixent en 1891, dans un bon rang, Destoup avait ĂŠtĂŠ nommĂŠ lieutenant le 1er mars 1893.
TONKIN
COMBAT DE BANG-Bo
Le
(24 mars 1885).
IIIe de ligne à l'assaut. — Le lieutenant de Colomb. Retraite épique.
Après la prise de Langson et le combat de la Porte de Chine (1885), les Chinois avaient été reietés en désordre sur
leur territoire. Pendant que la colonne française se reposait des fatigues qu'elle venait d'endurer, nos ennemis rassemblèrent, en grande hâte, des renforts considérables puis élevèrent des retranchements formi dables sur tous les mamelons bordant les routes conduisant au Tonkin. Lorsqu'ils se sentirent en force suffisante les Célestes prirent immédiatement l'offensive et se précipitèrent sur nos postes de la frontière.
-
Le Général de Négrier.
Une attaque de nuit sur Dong-Dang fut heureusement repoussée: le général de Négrier résolut alors d'en finir et de poursuivre énergiquement les forces ennemies. Laissant à Langson et à Dong-Dang la garnisonstrictement nécessaire, il partit avec une colonne de 900 hommes seulement. Le résultat d'une pareille aventure ne pouvait laisser aucun doute une poignée d'hommes contre toute une armée, c'était l'échec certain, mais au moins, l'honneur de nos vaillants soldats devait être sauvé du désastre. La marche est conduite rapidement, la colonne repasse la Porte de Chine, ou du muins. les débris qui en restent, et le 23 mars, au matin, se heurte à une formidable position en avant de la vallée de Bang-Bô. Dans un terrain difficile montagneux, abrupt, couvert de forêts, de boi3 propices aux embuscades, la petite troupe lutte tout le jour. Trois forts chinois situés sur des mamelons assez élevés sont pris et repris plusieurs fois le dévouement du bataillon de la légion étrangère permet enfin d'en demeurer maîtres vers 5 heures du soir. On couche sur les positions, la nuit se passe sans incidents. Les Chinois se sont retirés et se concentrent dans la vallée où ils ont accumulé des moyens extraordinaires de défense. Tous les pics, les mamelons, les collines qui l'entourent sont hérissés de fortins, de blockhaus, de tranchées. Les étendards chinois flottent sur tous les sommets. A gauche, en arrière du village de Bang-Bû barrant la vallée et la route, couverte en avant par des bois touffus, dans un terrain raviné,s'élève une tranchée palissadée, garnie de canons, et appuvant à gauche et à droite à deux forts construits sur des rochers presque inaccessibles. En arrière, un immense camp retranché. Tel fut le spectacle que les Français purent contempler
:
;
s
le 24, au lever du jour, après qu'un brouillard assez intense se fut dissipé. C'était terrible un véritable cercle de fer allait étreindre notre vaillante phalange, la broyer, l'anéantir, mais il n'y avait pas à reculer. Le devoir ne le permettait pas, et d'ailleurs aucun homme n'y eût consenti à ce moment. A 6 heures du matin, le général de Négrier donne le signal de l'attaque. Les forces sont ainsi' disposées Le colonel Herbinger, à gauche, doit s'emparer du fort auquel s'appuie la tranchée le IIIe d'infanterie doit attaquer cette ligne lorsque le fort sera en notre possession et que les canons du centre auront été réduits au silence. Le 143e et la légion sont chargés d'enlever les forts du centre et de l'est. Ces dernières troupes ne tardent pas à s'élancer les pentes sont raides, les hommes montent lentement en s'accrochant aux broussailles, en se faisant la courte échelle, sous une grêle de balles, sous une pluie de feu. Rien ne les arrête. Après une lutte vigoureuse, les forts sont emportés, la position est à nous; mais 18 hommes sont déjà tués ou blessés. Le lieutenant Thibaut est tué, le lieutenant Mangin a les jambes fracassées et meurt le soir même. Dans l'après-midi, les Chinois reprennent l'offensive. Le 143e menacé d'être enveloppé, décimé par un feu d'enfer, abandonne les forts emportant ses blessés malheureusement la nature du terrain rend difficile le transport des morts, ils sont laissés sur place. La compagnie Cotter, de la légion, défend à elle seule le fort de Bang-Bô, le plus important. Trois fois les Chinois se lancent à l'assaut, pénètrent dans la place, trois fois ils sont repoussés. Cependant des groupes
!
;
:
:
;
toujours plus nombreux reviennent à la rescousse débordent nos faibles forces et la retraite devient nécessaire. Le lieutenant Durillon a les cuisses traversées. Le capitaine Cotter est tué, tous les officiers et les sous-officiers sont hors de combat, 63 hommes sont tués ou blessés. Les morts et la plupart des blessés sont abandonnés ces derniers sont aussitôt décapités par les hideux Chinois. Il est 5 heures du soir, la journée est définitivementperdue, de Négrier fait sonner la retraite générale et donne comme rassemblement Cua-Aï, sur le territoire tonkinois. Voyons maintenant ce qui s'était passé à gauche du champ de bataille. Le colonel Herbinger se trompe de chemin, se perd, mais n'essaye pas de prévenir le général en chef. Celui-ci croyant que le fort gauche est à nous, donne l'ordre au IIIe régiment d'attaquer la formidable tranchée, certain de la réussite puisque précisément à ce moment les forts de droite tombaient entre nos mains. Trois compagnies sont lancées à l'assaut arrivées sur la tranchée, elles sont broyées par des feux de front, mais également par des feux de flanc. On s'aperçoit alors que le fortin de gauche n'est pas encore à nous et que, dans ces conditions, le combat ne peut nous être que fatal. Aussi, la 4e compagnie du IIIe placée en réserve à l'entrée du défilé qui conduit à la Porte de Chine, reçoit l'ordre de se porter au secours de son bataillon. Mais, quitter la position qu'elle occupe, c'est découvrir l'ambulance placée derrière elle, c'est permettre à l'ennemi qui est encore massé sur les hauteurs de descendre dans la plaine et de couper la ligne de retraite de la colonne L'ordre étant formel, elle se met en marche. A peine arrive-t-elle à moitié chemin que les Chinois descendent sur
;
;
!
ses derrières, c'en est fait. Les débris du bataillon sont entourés de toutes parts.
-
.0::::Affaire de Bang-Bo. — Le Lieutenant de Colomb tombe blessé.
La lutte est terrible, les assauts sont rudes, mais la tran-
chée résiste, foudroyant tout ce qui approche. Le médecinmajor Renaud est mortellement blessé, il reçoit une nouvelle balle au cou pendant qu'on l'emporte et meurt aussitôt. Le capitaine Mailhat a la cuisse fracassée, ses hommes essaient de l'emporter; entourés, ils ne peuvent le défendre et sa tête ne tarde pas à rouler sur le sol. Le lieutenant Canin est tué le sous-lieutenant Normand est frappé à la gorge, quelquessoldats dévoués réussissent à le traîner dans une anfractuosité de rocher, il meurt en route et on le recouvre à la hâte de blocs de pierre pour que l'ennemi ne le trouve point son corps restera intact. Le lieutenant Grosz est blessé au côté gauche. La retraite s'imposait les cris « Jetez-vous dans les bois » retentissent, les clairons sonnent éperdûment. Le lieutenant A. de Colomb essaie une dernière fois d'enlever les 50 hommes qui restent autour de lui. Une balle vient lui broyer l'articulation du pied, et, aussitôt tombé, il est entouré de Chinois qui veulent le décapiter. Révolver au poing, appuyé contre un rocher, il se défend en désespéré, abattantcelui-ci, abattant celui-là, élargissant le cercle qui l'étreint deux soldats de sa compagnie le dégagent enfin et le traînent sous bois. Là, 20 blessés viennent se grouper autour de lui il les ranime, les encourage, leur donne l'exemple d'un rare stoïcisme et les entraîne rejoindre leurs camarades. Le sergent Pinchard l'aide dans cette noble tâche. Alors commence une retraite épique à travers bois et ravins les hommes valides, combien peu portent à tour de rôle, les blessés et l'officier, on marche aussi rapidement que ces derniers le permettent, on franchit les précipices au prix de difficultés inouïes, quand après deux heures ainsi passées, on aperçoit les débris du 143e et lalégion battant eux aussi en retraite sur la crête. On essaye de les rejoindre. Les Chinois
;
:
;
:
;
;
;
!
harcèlent la petite troupe, le lieutenant de Colomb engage ses hommes à l'abandonner pour qu'ils puissent se sauver plus facilement, ils refusent énergiquement et ne veulent pas séparer leur sort du sien ils jurent de mourir avec lui. On se traîne sur les genoux, on gravit un rocher toujours poursuivis par les balles ennemies, enfin, on tombe sur l'arrière-garde française. Là, le lieutenant de Colomb monte sur un cheval et continue à réconforter ses hommes les Chinois sont maintenus à distance par quelques feux placés à propos, jusqu'à ce qu'ayant rejoint le gros de la colonne, l'artillerie les défende encore plus efficacement. Le général de Négrier se fit présenter le jeune lieutenant et le félicita vivement de sa conduite héroïque ce n'était d'ailleurs point son coup d'essai. La retraite se poursuivit alors sur Dong-Dang, les Chinois sur les talons. Les blessés furent évacués sur Langson, presque aussitôt. Cette évacuation est à elle seule un épisode véritablement remarquable et son récit serait fertile en enseignements, mais, astreint par un cadre limité, nous nous bornerons à faire constater quelles durent être les angoisses de cette poignée de soldats, dans la nuit noire, sur des brancards défectueux, la pluLe Lieutenant de Colomb part du temps très éloignés les uns des autres, frémissant et tressaillant au moindre bruit, croyant toujours voir arriver sur eux les terribles Célestes armés du coupe-coupe qui doit les décapiter. « La
;
;
;
pierre qui roule, la feuille qui remue, la marche de l'escorte, un rien, tout nous émotionne, nous fait passer un frisson dans le dos, écrit un témoin oculaire, aussi, chacun gardaitil une dernière balle pour se brûler la cervelle au moment critique, car tomber vivant entre les mains des faces jaunes, c'était l'horreur des supplices, la mort lente et douloureuse, l'agonie terrifiante,'qu'il fallait à tout prix éviter. » Le lieutenant de Golomb, fils du général de ce nom, engagé volontaire, sorti de l'Ecole militaire d'infanterie en 1882, avait été nommé officier au 131e régiment d'infanterie. Passé au IIIe de même arme pour partir au Tonkin, ce vaillant militaire fut nommé lieutenant après Lang-Kep, cité à l'ordre du jour, puis décoré de la Légion d'honneur pour faits d'armes à l'affaire de Dong-Dang, et enfin nommé capitaine après Bang-Bô.
Rentré en France à la suite de sa terrible blessure, placé au 3e de ligne, le capitaine de Colomb qui avait subi l'amputation du pied dut, à son grand regret, prendre une retraite anticipée, le 24 décembre 1886. Actuellement, M. Albert de Colomb, un des membres les plus autorisés de la presse militaire, est trésorier-payeur général du Tonkin.
DAHOMEY
COMBAT D'ATCHOUPA
(28 avril 1890)
Trente contre un. Malgré les sanglantes leçons des affaires de Kotonou, de Godomey, de Miteo, les Dahoméens ne se tenaient pas pour battus. Ils se concertèrent et résolurent d'attaquer à nouveau Porto-Novo. Des espions ayant prévenu de cette attaque le commandant des troupes, le lieutenant-colonel Terrillon, celui-ci prit une décision énergique et donna l'ordre de tenter un coup d'audace en se portant au devant de l'armée ennemie, commandée par le roi Behanzin lui-même. Le 20 avril, une petite colonne se met en marche elle est composée de deux compagnies de sénégalais, un peloton de la compagnie disciplinaire du Sénégal récemment arrivée, quelques auxiliaires, en tout 350 hommes avec trois pièces de 4 de montagne. Cinquante malades seulement sont laissés à Porto-Novo. M. Ballot, résident de France, accompagne nos soldats. Au petit jour, on apprend que Behanzin est tout près avec une armée de 6.000 guerriers et de 2.000 amazones. La marche se poursuit avec précaution. En arrivant au village d'Atchoupa, vers 7 heures et demie, les auxiliaires qui forment la pointe d'avant-garde sont reçus à coups de fusil, et l'on aperçoit l'ennemi grouillant dans les broussailles, cherchant à entourer la colonne.
;
La 10e compagnie de sénégalais se déploie, marche sur le village en exécutant des feux de salve, ce qui permet à la troupe de former le carré sous sa protection. Les Dahoméens s'élancent résolument, poussant leurs cris de guerre, excités par le bruit des tambourins et des grelots agités par les féticheurs la fusillade est terrible. Le colonel TerrilIon,lelieutenantRoos
;
ont leurs chevaux tués, de nombreux
hommes sont blessés. Pendant deux heures, les Dahoméens chargent et essaient de briser la résistance dela citadelle vivante qui se dresse devant eux. Les nôtres les attendent l'arme au pied lorsqu'ils ne sont plus qu'à 150 ou Behanzin. 200 mètres, des feux bien ajustés les écrasent. Pour aider l'infanterie, les trois pièces placées dans les angles tirent à obus et à mitraille, produisant à chaque coup des vides effroyables dans les rangs ennemis. Cependant, il est 9 heures, la chaleur est accablante et les munitions diminuent on apprend aussi, à ce moment, quun corps de guerriers a réussi à franchir la ligne de retiaite et seporte sur Porto-Xovo. Le colonel Terrillon donne l'ordre de rétrograder le carré se met en marche lentement et s'arrête de temps à autre pour
:
:
;
exécuter des feux de masse. Les amazones sont particulièrement furieuses et s'acharnent à la poursuite. La colonne arrive de cette façon au Marché d'Adjagan, point très dangereux, occupé par de gros partis ennemis, aussi avant d'aborder le village l'artillerie le couvre de projectiles pendant un quart d'heure, en chassant les Dahoméens qui s'enfuient dans toutes les directions. Les troupes rentrent à Porto-Novo vers 11 heures. Ce glorieux épisode de la première campagne du Dahomey, pendant lequel 8.000 guerriers n'avaient pu entamer une poignée de Français, nous coûtaient 8 auxiliaires tués et 37 blessés dont 20 guerriers du roi Toffa. Le capitaine Arnoux et le lieutenant Szymansky étaient blessés. On compte qu'il y eut plus de 2.000 Dahoméens hors de combat !
SOUDAN
LA. PRISE DE SIKASSO (1ER
mai 1898).
Mort des lieutenants Gallet et Loury. La prise de Sikasso est certainementl'événement leplus important qui se soit passé depuis fort longtemps dans la boucle du Niger. Capitale du Kénédougou, Sikasso comptait environ 15,000 habitants. Son « tata» était en terre glaise, les murs en étaient très élevés leur tracé présentait une série de saillants arrondis et des rentrants ingénieusement combinés c'était une véritable enceinte bastionnée, très étendue, ayant environ trois kilomètres de tour, devant laquelle, en 1887, l'almany Samory échoua, malgré ses 5,000 guerriers. Soumis à la domination française, l'ancien roi Tieba, qui avait besoin de nos forces pour résister aux potentats voisins, devenait inquiétant dès qu'il ne se sentait plus en danger. Tout d'abord, le capitaine Quiquandon, puis le lieutenant Marchand, résidèrent auprès de lui comme représentants de la France et devinrent les conseillers intimes du roi et les généralissimes de ses troupes. La mission que Marchand, menacé bien souvent, eut à accomplir, n'était précisément pas une sinécure, car Tieba cherchait par tous les moyens possibles, par de continuelles équivoques, à échapper ou tout au moins à éluder les engagements pris vis-à-vis de nous. Au moment de l'expédition de 1891 contre Samory, le capitaine Péroz, de l'infanterie de marine, aujourd'hui colonel,
;
:
:
fut envoyé auprès de Tieba pour être fixé sur la contenance que celui-ci comptait prendre à cette occasion serait-il avec nous, serait-il hostile, serait-il neutre ? L'accueil que notre envoyé reçut fut peu engageant, mais Tieba consentit enfin à nous aider pur intérêt de sa part. En 1892, la résidence de Sikasso fut supprimée. A la mort de Tieba, en 1895, son fils Babemba lui succéda. Circonvenu par Samory, le roi du Kénédougou ne parut pas désireux de suivre son père dans son semblant d'alliance avec la France il resta, en quelque sorte, indécis. Lors des opérations qui eurent lieu, en 1897, dans le bassin de la Volta, le colonel de Trentinian envoya au « fama » le capitaine Braulot (tué plus tard à Bouna) pour s'assurer de ses intentions. Il fut reçut avec de grands honneurs et accueilli chaleureusement pendant son séjour à Sikasso ; grâce à cette intervention, l'expédition put avoir lieu sans être inquiétée. Mais, en janvier 1898, le lieutenant-gouverneur du Soudan, M.le lieutenant-colonelAudeoud, de l'infanterie de marine, ayant appris que des relations suivies existaient entre Babemba et Samory, notre ennemi le plus acharné, une seconde mission, sous les ordres du capitaine d'infanterie de marine Morisson, fut envoyée, fin février, auprès du Le lieutenant-colonelAudeoud. « fama ». Le capitaine Morisson devait rester à Sikasso pour y remplir les fonctions de résident de France. L'accueil fut cette fois nettement hostile. Morisson à travers les populations malveillantes et menaçantes dut rétrograder sur Ségou les bagages de la mission furent pillés.
:
;
;
;
Un châtiment s'imposait on résolut de marcher sur Sikasso pour endiguer cette vanité nègre, toujours prête à déborder, et imposer unehonne fois notre domination sur ces populations rebelles. Une colonne forte de 1,500 hommes, comprenant du canon (infanterie de marine, tirailleurs sénégalais, artillerie et conducteurs), partit de Bammako, sous le commandement du lieutenant-colonel Audeoud, assisté de son chef d'état-major, le commandant Pineau. Après quatorze combats et quinze jours de siège, l'assaut fut donné le 1er mai 1898 l'attaque commencée au point du jour ne prit fin que vers trois heures de l'après-midi. Trois colonnes avaient été formées. Dans la pénombre de l'aube, silencieuses, les trois colonnes s'avancèrent baïonnette au canon, puis s'arrêtèrent à genoux à trois cents mètres du grand tata, dont les formes, d'abord indécises, se révélèrent lentement sous l'action du jour, montrant les trois brèches béantes. Des remparts les premières balles sifflaient déjà. Des feux s'allumaient légers comme des feux follets. C'était l'éveil des sofas, tous à leurs postes. « Nous avancions au pas de charge, écrit un capitaine ayant assisté à l'affaire, menés par le clairon. A cinquante mètres de la brèche la fusillade éclata. A la brèche » crièrent les officiers. « En avant « En sept minutes, sans coup férir, la colonne franchit les cinq cents mètres qui la séparaient du fortin. L'élan des troupes était magnifique. Nous faillîmes enlever même Babemba qui avait été amené sur le mamelon par tout ce bruit» La résistance fut acharnée la défense du « tata où Babemba se fit tuer avec ses frères et 200 sofas de sa garde, fut héroïque. Ce réduit était si fortement organisé que la brèche ne put être pratiquable qu'après l'explosion de plusieurs obus à la mélinite les défenseurs se firent tuer sur place.
;
!
!
:
;
»
-
La ville fut défendue maison par maison :. un millier de soldats du fama restèrent sur le terrain. De notre côté, les pertes furent sensibles, ce qui prouve bien l'acharnement du combat et la ténacité de la résistance pendant ces deux semaines. 2 lieutenants- tués. 3 officiers blessés, 5 sous-officiers européens blessés, 56 tirailleurs indigènes tués et 150 blessés Au total, 216 morts ou blessés, ce qui constitue une perte considérable pour une affaire coloniale. Le lieutenant Gallet (Jean-Baptiste-Ladislas-Paul), hors cadres, détaché à Fétat-major du Soudan, a trouvé la mort glorieuse des braves devant Soukfourani, aux environs de Sikasso, en conduisant à plusieurs reprises, quelques jours avant, à l'assaut les tirailleurs sénégalais. Né le 19 avril 1870, sorti de Saint-Cyr le 1er octobre 1892, cet officier avait le plus bel avenir devant lui. Il appartenait au 148e régiment d'infanterie de ligne, à Verdun, lorsqu'il fut détaché au Soudan. Le lieutenant Loury (Hugues-Just), de l'infanterie de marine, détaché également à l'état-major du lieutenant-gouverneur, fut tué à la tête de sa compagnie au moment où elle marchait pour soutenir les tirailleurs indigènes. Né le 24 novembre 1867, engagé volontaire le 24 novembre 1885, sorti de Saint-Maixent le 24 mars 1890, nommé lieutenant le 1er avril 1892, Loury pouvait espérer, en raison de son jeune âge et de ses services, une situation toute exceptionnelle. Voici les noms des officiers ayant assisté à l'assaut 1° Colonne de droite capitaine Morisson, lieutenants Loury et Blondiaux, sous-lieutenant Gérard 2° Colonne du centre lieutenant Méjane ; 3° Colonne de gauche capitaine Coiffé, lieutenants Buck et Mangin
!
:
;
::
:
;
:
Artillerie de montagne capitaine Palâtre, lieutenants Pelletier et Sav-Portes ; Peloton de renfort capitaine de Monguers, lieutenant Houet (grièvement blessé, jambe fracassée). La prise de Sikasso, ce « repaire de bandits a été un événement d'une portée considérable pour la pacification définitive de nos possessions d'Afrique elle a inspiré une crainte salutaire aux chefs indigènes dont plusieurs firent de suite leur soumission au commandant du cercle qui a été installé dans la ville, etelle isola complètement l'indomptable Samory, désormais réduit à ses propres forces. Ce n'est pas trop que d'honorer les braves de la colonne Audeoud qui, au prix de réels sacrifices, sont arrivés à un tel résultat. Les noms des deux malheureux officiers resteront inscrits au Livre de Gloire.
:
;
»,
TONKIN.
DÉFENSE DE NA-CHAM (21
mai 1886).
Le sous-lieutenant Cabasse. Les pirates avaient décidé d'enlever le poste de Na-Cham, important gîte d'étapes, dont le commandant, le sous-lieutenant Joseph, était alité par suite d'accès violents de fièvre. Le 20 mai 1886, ils se réunissent à trois kilomètres du poste et, sûrs de leur victoire, ils font des sacrifices à Bouddha. Pendant la cérémonie, très absorbés et quelque peu enivrés, par le schum-schum (eau-de-vie de riz) dont ils avaient largement usé, les rebelles ne virent pas dans les brousses se dirigeant sur Na-Cham un convoi venant deLang-Son, sous la direction du sous-lieutenant Cabasse. Dès qu'il fut entré dans le poste, le lieutenant Cabasse prit le commandement toute la nuit, la petite garnison fait des travaux de défense, le mur d'enceinte est renforcé, des tonneaux, des caisses, des sacs de farine sont empilés tout ce résisqu'on trouva fut utilisé pour augmenter les moyens tance. Vers trois heures du matin, les pirates arrivent sans bruit. A 100 mètres du fossé, ils s'élancent en hurlant, persuadés qu'ils vont d'un bond franchir la palissade et surprendre les défenseurs endormis. Aucune sentinelle ne les avait signalés, leur confiance était extrême. Ils avaient à peine parcouru quelques mètres que des feux de salves successifs partent du fortin, en jettent une centaine à terre et arrêtent complètement l'élan des autres consternés de cette riposte inattendue.
;
;de
Rapidement, ils retournent en arrière et vont se masser sur une élévation dominant la place, d'où ils font pleuvoir sur les défenseurs une grêle de projectiles. Cabasse se multiplie, il anime ses hommes, les encourage; tout-à-coup il reçoit une balle au poignet qui va se loger ensuite dans le gras du bras. Après un pansement sommaire, il revient au rempart et active la défense, mais il a trop compté sur ses forces il s'évanouit un instant par suite de la perte du sang qui continue à couler de sa blessure. Pendant ce temps, ses soldats repoussent un deuxième assaut. Le lieutenant Cabasse revenu à lui se fait asseoir sur un tonnelet au centre du poste et tranquille, allume sa pipe qu'il fume consciencieusement, narguant les Chinois qui le prannent comme cible. Heureusement les pirates voyant l'inutilité de leurs efforts, le nombre considérable de leurs morts et de leurs blessés, se retirent bientôt surDong-Lam, poursuivis par les feux nourris de la vaillante garnison. Nous n'avions que 4 hommes tués et 18 blessés. Le lieutenant Cabasse fut fait chevalier de la légion d'Honneur à la suite de ce brillant fait d'armes.
;
SOUDAN.
NAFADIÉ ET KOKARO (31
mai, 14 juin 1885.)
Le capitaine Louvel.
Pendant la campagne de 1884-1885, au Soudan, le commandant d'infanterie de marine Combes, parcourut sur une grande longueur les rives du Niger. Il laissa un détachement à 80 kilomètres de Niagassola, sur la route du fleuve; cette troupe composée. de 120 tirailleurs sénégalais, avait à sa disposition elle était commandée par le une pièce de 4 de montagne capitaine Louvel, le lieutenant Dargelos et le sous-lieutenant indigène Suleyman-Dieng. Le 31mai 1885, le poste est attaqué subitement par Samory qui marche contre Tiéba, le roi du Kénédougou, un peu notre allié. Le capitaine Louvel, débordé, se replie dans la direction de Nafadié, emportant ses blessés; le soir, il s'enferme dans un tata en pisé, de 2 mètres de hauteur, servant d'enceinte au village. Samory, qui n'a pas quitté sa piste, vint l'y relayer et lance ses sofas à l'assaut. Une fusillade nourrie des défenseurs arrête l'élan des guerriers noirs et en couche une centaine dans le sable et les herbes. L'almany ordonne alors d'établir le blocus autour de Nafadié. Le commandant Combes qui se trouvait à Bammakou, à 300 kilomètres de là, prévenu le 2 juin par un émissaire, rassemble aussitôt 150 hommes et marche au secours du capitaine Louvel. Après une course de dix jours, il débouche
;
devant le village sans avoir été signalé par les soldats de Samory. « Resserrés dans cette étroite enceinte qui servait aussi de refuge à plusieurs centaines d'indigènes, dit le colonel Frey, les 120 braves avaient vécu, dix jours durant, de riz, de maïs, ne buvant que de l'eau recueillie dans de petites mares bourbeuses qui s'étaient formées à la suite d'un orage providentiel. » La petite troupe, enfin débloquée, se met alors en marche avec le commandant et se dirige sur Kayes. La poursuite commence de suite les sofas harcèlent la colonne continuellement, et Samory faisant preuve de qualités stratégiques, admirées par nos officiers eux-mêmes, envoie un de ses frères s'établir solidement sur la ligne de retraite des Français, à dix kilomètres de Niagassola, pour barrer la route au gué de Kokaro, rivière large aux bords escarpés. Le 14 juin, après une lutte énergique et sanglante, le passage fut quand même forcé et la colonne épuisée rentra à Kayes. Samory fit annoncer partout, à son de trompe, qu'il nous avait fait reculer, néanmoins, si les Français avaient dû céder la place, accablés par le nombre, grâce au capitaine Louvel et à sa brillante défense, l'honneur était resté sauf, pour nos armes et pour notre drapeau.
;
TONKIN
COMBAT DE LA TOMBE DU PONTONNIER (25
mai 1893)
Le capitaine Crouzillard.-Le lieutenantPhilippe
Au mois de mai 1893, le capitaine Crouzillard conduisait sur la Rivière claire, vers Ha-Giang, un convoi fluvial de ravitaillement, escorté de 12 hommes du 2e régiment étranger et 25 indigènes du 3e régiment de tirailleurs tonkinois. Le 23, vers huit heures du matin, le convoi arrivé à un coude de la rivière, dans un endroit appelé « la Tombe du Pontonnier » fut tout à coup assailli par une violente fusillade partant des rochers bordant la Rivière claire, où 200 pirates, commandés par le célèbre Hoang-Cau-Phuc, étaient postés en attendant l'arrivée des sampans. Le convoi s'arrête aussitôt, accoste sur la rive opposée sur laquelle l'escorte prend pied. Pendant quatre heures, cette poignée d'hommes lutte énergiquement, calme, résignée, séparée seulement de l'ennemi par la largeur de la rivière, environ 50 mètres, les chefs parviennent à maintenir une ferme discipline et peuvent dès lors régler leurs feux comme à l'exercice. Néanmoins, 2 légionnaires, 2 tirailleurs et 4 sampaniers sont tués. L'ordonnance du capitaine, le tirailleur Bui-Van-Thuoc, pénètre dans les sampans, malgré un feu très vif dirigé sur lui, et réussit à lâcher les quelques pigeons voyageurs qui s'y trouvaient, les pauvres bêtes affolées se dirigent aussitôt sur Ha-Giang emportant la nouvelle de l'attaque et une demande de secours immédiat.
A ce moment, la moitié environ des pirates parvient à tra-
verser la rivière, venant ainsi prendre notre vaillante petite troupe de dos et de flanc. Avec une rapidité qui lui fait le plus grand honneur, le capitaine Crouzillard prend ses dispositions pour résister à ce nouveau danger. Il réunit ses hommes au pied d'un banian, en tête de son convoi, et attend résolument l'assaut qui s'exécute aussitôt avec des hurlements sauvages, scandés des sons lugubres de la trompe de guerre. Les pirates se ruent sur les sampans pour les piller. Le lieutenant d'infanterie de marine Philippe, le fusil à la main, s'élance sur les Chinois, suivi d'une partie de l'escorte. Après un violent combat corps à corps, il parvient à repousser les ennemis qui sehâtent de repasser sur l'autre rive, d'où ils tiraillent encore un peu pour disparaître tout à fait. Vers six heures du soir, arrivent enfin les renforts demandés à Ha-Giang, mais ils trouvent le convoi intact sous la garde des braves qui l'avaient si bien défendu pendant plus de huit heuLe lieutenant Philippe. res, sous un soleil de feu et une grèle de mitraille, avec un courage et un entrain superbes.
i
Nos pertes n'étaient guère sensibles, tandis que les pirates avaient plus de 50 des leurs hors combat. Le capitaine Crouzillard fut cité à l'ordre de l'armée pour ce brillant fait d'armes. Le lieutenant Philippe, nommé bientôt capitaine, eut le triste honneur de recueillir au Soudan les débris de la colonne Bonnier. Nous le retrouverons en parlant de cette expédition de Tombouctou disons ici simplement que cet officier valeureux est mort en 1897 des suites d'affections graves contractées au cours de ses campagnes. Il était né à Beaune le 21 janvier 1851 sous-lieutenant du 10 octobre 1880.
;
;
MADAGASCAR
ATTAQUE DE VOHINGHEZO (11
mars 1897)
Mort du Capitaine Flayelle et du Lieutenant Montagnole Notre extension méthodique dans la province de Tulléar et dans l'ouest du cercle des Baras ayant été, à diverses reprises, entravée par les incursions à main armée d'une bande réfugiée dans le massif boisé du Vohinghezo, sis à l'est du confluent du Mongoka et du Malio, M. le capitaine Flayelle, commandant les troupes de la province de Tulléar, fut chargé de chasser cette bande de son repaire. Il disposait, pour l'opération projetée D'un détachement de la lre compagnie de la légion, sous les ordres de M. le lieutenant Montagnole de quelques hommes de la 11e compagnie du 13e régiment d'infanterie de marine d'une pièce de la 6e batterie de montagne (lieutenant Defert) d'un détachement de la 6e compagnie du 1er malgaches d'un détachement de la 8e compagnie du 2e malgaches (souslieutenant Garenne) ; d'un détachement de la milice de Tulléar (M. l'Inspecteur Charles) d'un détachement de la compagnie de Fianarantsoa (M. le garde Morel). Ce groupe quitta le poste de Soaserana le 11 mars dans l'après-midi, passa le Malio, et, après un repos de quelques heures, se remit en route à onze heures du soir. Voici le récit du combat, fait par un des survivants Un clair de lune suffisantpermet de marcher assez vite dans une région inconnue. Bientôt, on a la certitude que les rebelles sont avertis; leurs sentinelles fuient devant les
;
:
:
;
:
;;
éclaireurs et des feux s'allument dans la montagne en face. On arrive devant un bois qui paraît impénétrable tant 1obscurité est devenue profonde. Le capitaine veut attendre le jour pour attaquer, mais le lieutenant Montagnole s'est engagé au milieu des abatis avec deux éclaireurs; c'est le signal d'une décharge générale et qu'on évalue à deux cents coups de fusils. Le capitaine lance alors les légionnaires sur les tiaces du lieutenant; il traverse avec eux les abatis, mais il est difficile de pousser de l'avant car on ignore absolument le terrain; on ne voit que les coups Le capitaine Flayelle. de feu qui aveuglent et la fusillade, à bout portant, est tellement intense que les hommes n'entendent rien. C'est alors que le lieutenant X., s'approchant dans les fourrés, crie « En arrière ! » Mais le capitaine, dans un geste superbe et de toutes ses forces « Mais non pas en arrière en avant » A ce moment, un coup de feu le frappe de deux balles, l'une au cœur, l'autre à l'abdomen, le capitaine tombe à la
!
!
:
:
!
!
renverse Il dit à son ordonnance qui, quittant le convoi, s'était portée à ses côtés dès les premiers coups de feu «Griseur, je suis mort ! » L'ordonnance s'est agenouillée près de lui « Où ça?— Au côté », répond le malheureux blessé. « Attendez, je vais vous transporter en arrière pour vous faire panser; ce n'est peut-être pas si grave que cela. Il appelle des légionnaires
: :
»
à l'aide et, à trois, ils le transportent à travers les abatis, malgré la demande du capitaine qui veut être laissé sur place. La colonne n'a pas de médecin; deux infirmiers, aidés de Griseur, le pansent de leur mieux. Cela ne va pas sans quelque douleur. «Vous me faites souffrir, dit-il, laissez-moi mourir. » A l'ordonnance, qui parlait à voix basse « Ne parlez pas à voix basse, ce n'est pas la peine, j'entends tout Au lieutenant Defert, qui vient lui ce que vous dites. demander comment il va : a Laissez-moi mourir » dit-il encore. Blessé à cinq heures, le capitaine s'éteignait doucement à sept heures quarante, après trois ou quatre contractions de la bouche. S'il avait peu parlé, il avait pu conserver sa pleine lucidité. Son regard était resté clair jusqu'au dernier moment. Les deux balles étaient mortelles la première, entrée dans la région du cœur, restée dans la plaie et déterminant une hémorrhagie; la seconde, perforant le foie et sortant par le dos. On avait (Griseur) apporté, vers cinq heures et demie, le corps du lieutenant Montagnole, déjà froid. Il avait reçu sept balles. La bande mise en fuite, la colonne revint à Soaserana, d'où elle était partie et les deux officiers furent inhumés avec trois soldats tués dans le même combat. Le général Galliéni décida, à la suite de cette affaire, que les postes d'Ankazoabo, Soaserana, Vorondreo et Manena, porteront les noms de poste Flayelle, poste Montagnole, poste Durlach, poste Ramanarany. Le Capitaine Flayelle était né le 23 septembre 1858 sorti de Saint-Cyr et nommé sous-lieutenant au 91e de ligne lieutenant le 29 juillet 1885 au 1er régiment de tirailleurs algériens, il avait été nommé capitaine, le 26 septembre 1891, au 13le de ligne.
:
»
!
:
;;
Le capitaine Flayelle passa ensuite au 2e régiment étranger et avait été mis hors cadre. Le lieutenant Montagnole (Francisque-Germain), du 1er étranger, était né le 13 juillet 1869; entré au service le 11 octobre 1887, sous-lieutenant le 1er avril 1893, cet officier avait été nommé lieutenant en 1895. Il était sorti de Saint-Maixent.
SAHARA
PRISE DE TOMBOUCTOU (1er
janvier 1894)
ET MASSACRE DE DONGOÏ (15
janvier 1894).
2 sous-officiers tués.
11 officiers et
Vers la fin de 1893, le gouvernement jugeant que la conquête du Soudan était complètement finie, plaça, à la tête des nouveaux territoires, un gouverneur civil, M. Grodet, et un commandant supérieur, le lieutenant-colonel Bonnier, de l'artillerie de marine. Le bassin du Moyen-Niger avait bien été purgé des nombreuses bandes d'Ahmadou, mais personne n'avait encore pu pénétrer dans la ville sainte, Tombouctou la mystérieuse, dans la crainte de surexciter à nouveau le fanatisme des ennemis. Pourtant, en 1889, le lieutenant de vaisseau Caron, commandant la canonnière le Niger, avait débarqué à Kabara, avant-poste de Tombouctou, à 10 kilomètres de la ville. Le 28 décembrel893, l'enseigne de vaisseau Aube, qui s'était aventuré aux environs de Kabara, fut surpris par une bande de Touaregs et massacré avec les quelques hommes qui l'accompagnaient. Le commandant de la flottille, le lieutenant de vaisseau Boiteux, jugea nécessaire d'occuper Tombouctou et marcha sur elle avec une petite troupe de matelots il y entra sans coup férir le 1er janvier et s'installa dans deux maisons crénelées au nord et sud de la ville. Prévenu aussitôt, le lieutenant-colonel Bonnier accourut
;
:
3 compagnies de tirailleurs soudanais, avec des renforts commandés par les capitaines Tassard, Pansier et Philippe, 4 pièces de 80 mlm et 2 de 4. Cette colonne arrivait le 4 janvier au matin, par voie fluviale, et, le même jour, à 4 heures, entrait à Tombouctou. Le lieutenant de vaisseau Boiteux repartit aus-
sitôt rejoindre saflottille; les troupes se reposèrent toute la journée. Des renseignements ayant signalé au colonel la présence de campementstouaregs dans les environs de lavilleilorganisaune reconnaissance chargée d'en débarrasser la contrée et de venger la mort d'Aube. Le 12 janvier, à 6 heures 45 du matin, la colonne se mit en Le lieutenant de vaisseau Boiteux. marche sous le commandement du lieutenant-colonel Bonnier, accompagné des officiers suivants M. Regad,capitained'infanterie,hors cadre,chefd'état-maj or; M. Livrelli, capitaine d'artillerie de marine, hors cadre, sous-chef d'état-major; M. Garnier, lieutenant d'infanterie de marine, hors cadre M. Sensarric, capitaine — M. Nigotte, capitaine de la 2e légion étrangère
:
-
-;
;
;;
M. Grall, médecin de lre classe de marine M. Lenoir, vétérinaire en second, hors cadre M. A'Kloucb, interprète arabe, titulaire de 3e classe
M.
;
Tassard; 5 compagnies de tirailleurs soudanais;capitaine, lieutenant, M. Bouverot; 6 sous-officiers européens; 142 indigènes lie compagnie, 1er peloton sous-lieutenant, M. Sarda; 3 sous-officiers européens et 62 indigènes, et M. Hugueny,
;
;
chef de bataillon des tirailleurs soudanais. Le capitaine Philippe fut laissé à Tombouctou avec le reste de la colonne. Le 13, les troupes rencontrèrent les premiers campements touaregs et s'emparèrent de 3,000 moutons et chèvres; ce troupeau ralentit leur marche. Le lendemain, à
Massakori, elles échangent quelques coups de fusil avec des cavaliers armés et prennent encore 600 moutons. Les prisonniers annoncent alors Le lieutenant-colonel Bonnier. les Touaregs sont que tous rassemblés au campement de Djidjin près d'un village appelé Dongoï, à deux heures de marche. Il est à ce moment, 3 heures. Le colonel Bonnier prend la résolution de marcher sur le campement et de laisser à Massakori les hommes fatigués, les bagages, le troupeau sous la
garde du sous-lieutenant Sarda et de deux sections de tirail-
leurs. A 3 heures 15, la reconnaissance repart, laissant toutes les montures au bivouac. A 4 heures 45, elle débouche dans une plaine; à gauche, un marigot; à droite, une ligne de dunes. Deux porteurs de vivres, laissés à 800 mètres en ar-
;
rière, sont massacrés par trois cavaliers qu'on aperçoit en même temps, des cris se font entendre sur la gauche. La colonne se trouve alors subitement à l'entrée d'un campement qui vient d'être évacué depuis peu. Quelques femmes sont prises. Des sections sont détachées à droite et à gauche. Le centre, avec l'état-major, continue sa marche pendant une centaine de mètres. A 6 heures, le lieutenant-colonel Bonnier s'arrête dans une clairière de 200 mètres de long sur 100 de large. On allume des feux. On sonne l'assemblée. Au fur et à mesure que les sections reviennent, on prend les dispositions pour la nuit, mais le froid est vif et les couvertures sont restées au campement, néanmoins les hommes s'installent de leur mieux. Au petit jour, à 4 heures 15, quatre coups de feu éclatent du côté de l'ouest, où est installée la compagnie Tassard. Tout le monde se lève, malheureusement, il est trop tard A droite, les Touaregs qui ont renversé les faisceaux,lâchent les moutons et les bœufs à gauche, rampant à travers le troupeau, ils se précipitent sur la clairière du centre. Le capitaine Nigotte raconte ainsi la scène « A la lueur des feux, nous apercevons devant nous, et « venant de la clairière du lieutenant Bouverot, une masse « d'hommes à cheval et de fantassins qui se rue sur nous en « ordre et en silence. Ils sont à peine à quelques mètres. —A « ce moment, des javelots arrivent sur nous. « Les tirailleurs du capitaine Tassard, affolés, sans armes,
;
!
:
affluent dans la clairière, les bœufs sont poussés sur nous à « coups de lance. Toute résistance est impossible. « « Nous n'avons même pas le temps de nous retourner pour « essayer de nous rendre compte de ce qui se passe de ce « côté. Je tire un coup de révolver, mais je reçois un coup de « sabre qui me laisse étendu sur le sol. » Lorsqu'il revint à lui, plus rien n'existait — il était 4 heures 30 ! Quelques tirailleurs, échappés, le rejoignent et essaient de gagner le campementBouverot.Après mille péripéties, ils échappent par miracle aux Touaregs pillant les morts et achevant les Nigotte rallie blessés alors le sergent-major Beretti, de la 5e compagnie et 8 tirailleurs, dont 5 blessés et sans armes; ilsrestentaccroupisdans les herbes pour ne pas Le capitaine Nigolte. éveiller l'attention. Pourtant, vers 5 heures, ils quittent la place et reprennent le chemin de la ville, en se dissimulant le mieux qu'ils le peuvent les cris d'appel des Touaregs se font entendre partout; heureusement, les mimosas et les gommiers, assez épais, empêchent de les voir. La petite troupe arrive à 9 heures au bivouac de la veille après avoir rallié le sergent Lalire, de la 11e compagnie, et «
;
;
;
quelques tirailleurs blessés. Le capitaine Nigotte prend le commandement de tous les survivants auxquels se joint la section du lieutenant Sarda et la retraite se fait en ordre sur Tombouctou où il arrive le 17 à 10 heures du matin. Nous avions dans cette malheureuse affaire 11 officiers tués, 2 sous-officiers européens et 67 indigènes tués, 3 guides, 1 interprète et 10 auxiliaires tués. 130 cavaliers et250 hommes à pied seulement avaient réussi à faire ce massacre. La fatalité avait pesé lourdement sur la petite colonne et ce n'est pas le moment de rechercher ici si des fautes ont pu être commises. Paix soit aux morts que l'armée coloniale déplore et que le nom des vaillants qui ont succombé restent gravés dans le Livre d'or des martyrs coloniaux. Le commandant Joffre, qui dirigeait une colonne sur la rive gauche du Niger et qui venait de s'emparer de Goudam (1er février) fut prévenu immédiatement par le capitaine Philippe resté à Tombouctou. Avec son aide, on revint sur le lieu de la surprise et le 8 février on retrouva les corps de nos pauvres camarades. Les indigènes furent enterrés sur place, les européens furent emportés à Tombouctou où ils furent inhumés le 12 février. Le capitaine Philippe fut nommé officier de la Légion d'honneur pour sa'belle défense de la Ville. Les tribus ayant pris part au massacre, à part celle des Tenguerignif, furent anéanties en deux combats à Dahouré et à Sansan. On retrouva dans les tentes et sur les cadavres un grand nombre d'objets ayant appartenu à la colonne massacrée, entre autres les galons du Colonel Bonnier. Ajoutons que le nom de Bonnier fut donné à un fort de la ville de Tombouctou.
TONKIN
PRISE DE NINH-BINH PAR 8 HOMMES (5 décembre 1873).
L'aspirant Hautefeuille. Après la prise d'Hanoï, Francis Garnier avait expédié l'enseigne Balny pour s'emparer d'Haï-Dzuong en passant par Phuly. Mais le lendemain, ayant reconnu que la prise de Ninh-Binh devait être plus avantageuse, il envoya à Balny l'ordre de marcher sur cette ville. Ce fut M. Hautefeuille, aspirant, qui emporta l'ordre dans un canot à vapeur monté par 8 hommes d'équipage. Balny étant parti de Phuly lorsqu'il arriva, Hautefeuille n'hésita pas et résolut de tenter lui-même l'aventure. Le canot aborda devant la citadelle de Ninh-Binh, flanquée de batterie et de forts qui commencèrent à tirer dès qu'il fut aperçu pour comble de malechances, le petit bateau s'échoua dans la vase 6 hommes de son équipage sautent alors dans une jonque, pendant que les 2 autres restent à bord tirant continuellement. Hautefeuille et ses hommes payant d'audace chargent à la baïonnette les innombrables ennemis qui s'avancent L'aspirant Hautefeuille. vers eux; ils s'emparent du Gouverneur au milieu de son escorte et rentrent avec lui dans la
;
;
citadelle le revolver sous la gorge. Les annamites terrifiés n'osent bouger et signent la capitulation de la citadelle. Le drapeau français est hissé aussitôt sur un mirador, pendant que les soldats chinois fuient de tous côtés jetant leurs armes et leurs pavillons. On croit rêver en lisant une pareille expédition, surtout quand on songe que plus tard pour reprendre des citadelles semblables il fallut employer des milliers et des milliers d'hommes. Le vieux Gouverneur a dit depuis « Si j'avais su que vous « fussiez si peu nombreux, certainement que je vous aurais « fait couper la tête. » Aussi, les missionnaires qui avaient un collège à environ 4 heures de marche de la ville, furent prévenus aussitôt et amenèrent leurs chrétiens armés qui purent soutenir la faible garnison jusqu'à l'arrivée de renforts plus sérieux. Hautefeuille est aujourd'hui capitaine de vaisseau et commande la marine en Algérie.
:
SOUDAN. r COMBAT DE DORI (6
juin
1897).
Mort du lieutenant Bellevue. Un marabout peulh Modibo Diagourou qui pillait et rançonnait les caravanes, vint prêcher la guerre sainte jusqu'aux portes de Dori, petit poste français dans le Liptako, commandé par le capitaine Menvielle. Une reconnaissance comprenant 5 européens, une pièce de 80,120 tirailleurs et 25 spahis commandés par le lieutenant Bellevue, fut envoyée contre les Touaregs qui avaient été entraînés par Modibo. Le 6 juin 1897, la petite colonne parvenait à une dizaine de kilomètres du village de Diagourou. Un témoin oculaire raconte ainsi l'affaire On avait déjà entendu dans le lointain le son sinistre du « tebal » ( tambour de guerre) touareg, qui appelait les guerriers au combat. A l'aube, on vit distinctement se profiler sur les hauteurs voisines les boubous blancs des cavaliers ennemis qui observaient. Enfin, vers 7 heures du matin, la petite colonne, formée en carré, débouchait dans la plaine de Diagourou. On pouvait voir alors, dissimulée le long d'un thalweg et abritée par quelques bouquets d'arbres, une masse d'environ 200 cavaliers et de plus d'un millier de fantassins, déployée sur une longue ligne demi-circulaire, en bon ordre et prête au combat. C'était contre cette foule que la petite poignée d'hommes allait avoir à lutter. Elle s'avança coura-
:
;
geusement et s'arrêta à 400 mètres de l'ennemi puis le feu commença. L'artillerie et les tirailleurs font pleuvoir les obus et les balles, tandis que le lieutenant Bellevue se portait sur une hauteur, observant les mouvements des ennemis. Ces derniers ne se laissent point intimider et s'avancent lentement, mais sans arrêt, s'aplatissant sur le sol au signal de leurs chefs, lors du feu de salve, et se relevant dans l'intervalle. Fanatisés par le marabout qui leur avait promis l'immunité contre nos balles et leur avait assuré la victoire, ils marchent intrépides sous le feu terrible ils sont à peine à 60 mètres de nos lignes. Pendant ce temps, les cavaliers esquissent un mouvement enveloppant, se massent sur nos derrières et s'apprêtent à fondre sur nous. L'instant était solennel et décisif la petite troupe allait, peut-être, être submergée sous le nombre et le carré brisé et anéanti. Le lieutenant Bellevue voit le danger; il demande aussitôt l'autorisation de charger au capitaine commandant la colonne elle lui est accordée. Les spahis s'ébranlent au galop de charge, Bellevue à leur tête. Emporté par son courage, il fonce sur les Touaregs, suivi à peine de quelques-uns de ses hommes. On le vit alors se débattre pendant quelques instants, entouré de toutes parts, contre la multitude des lances qui l'assaillent. Un coup de feu l'atteint à la fesse, une lance lui laboure les côtes il l'arrache de sa propre main et la rejette enfin, le fils du chef M'Diougui lui lance à son tour son javelot dans le ventre en s'écriant d'une voix rauque « Que le salut soit sur toi, fils de Nazareth » Bellevue parvient néanmois à se dégager et, malgré ses affreuses blessures, on le voit revenir la tête haute, sans casque sous le soleil brûlant, an port du sabre et au galop. On le descend de cheval et il s'affaisse aussitôt sur le sol, entre les bras du médecin de la colonne, qui s'empresse de lui prodiguer les premiers soins. Grâce à son heureuse diversion, le plan des ennemis
:
;
;
;
!
:
;
;
échoue. Le clairon sonne la charge les tirailleurs, entraînés, s'élancent à la baïonnette; l'artillerie culbute un nouveau groupe de cavaliers qui se reformait sur la droite. Les ennemis, enfin déconcertés, disparaissent dans la brousse et abandonnent les lieux en laissant 150 cadavres. L'honneur du drapeau français était sauvé mais le lieutenant Bellevue succombait quelques heures après, sur le champ de bataille même, entre les bras de ses camarades désolés et impuissants, tandis que l'on voyait flamber au loin, dans la nuit, le village ennemi, que les tirailleurs avaient livré aux flammes. Le lieutenant Bellevue était sorti de Saint-Cyr et avait servi au 1er dragons il appartenait au 2e escadron des spahis.
;
;
ANNAM
COLONNE; DU QUANG-BING
(janvier 1886)
Mort du Capitaine Hugot et du Lieutenant Camus Sur les frontières du Tonkin et d'Annam, quelques petites colonnes avaient été lancées, en décembre 1885, à la poursuite du chef rebelle Thon-Tha-Thuyet. Le capitaine Hugot, blessé de trois flèches empoisonnées, mourut à Vinh vers le commencement de 1886. Le10janvier, commandant supérieur de Vinh, organisait une colonne légère de cent dix hommes pour recommencer l'opération conduite par le capitaine Hugot, et en confiait le commandement au lieutenant Camus, qui devait toujours ignorer la mort de son capitaine, survenue le 11 janvier. Le 17, vers 11 heures, la petite colonne arrivait à un gué du haut Song-Nai, rivière qui traverse le Quang-Bing de l'est au nord-ouest, barrée par trois petits fortins que défendaient des Muongs et des Chinois. Le combat s'engage dès le début de l'action, Camus tombe frappé de quatre flèches, dont une avait pénétré de quatre à cinq centimètres dans la cuisse droite. Le lieutenant Frseystatter, un de ses meilleurs camarades, qui lui était adjoint, lui fit prendre presque aussitôt du contre-poison. .Au bout de quelques minutes, M. Camus s'est levé et a donné l'ordre à une section, qui tirait contre un des fortins, de se porter à l'attaque de la position ennemie, dont elle était séparée par la rivière; il s'est mis en tête de la troupe.
le
;
Les hommes ne purent le suivre qu'à grand' peine, tant sa marche était précipitée, et on le vit sauter d'une hauteur de deux mètres dans la rivière sans s'inquiéter de savoir s'il était suivi. Il fit encore quelques pas et tomba frappé d'une balle dans le ventre en disant «En avant Ce fut sa dernière parole. Le caporal d'infanterie de marine Chenet s'élança à son tour pour sauver le lieutenant Camus il le soulevait dans ses bras, quand une balle l'atteignit lui-même et le traversa de part en part. Le corps de Camus disparut sous l'eau et fut emporté par le courant. Le détachement eut, dans cette affaire, quatre hommes tués et dix blessés.
:
!»
;
DAHOMEY
SURPRISE DE DOGBA (19
septembre 1892)
Le commandant Faurax — Le lieutenant Badaire.
-
Le traité de paix conclu, en 1890, avec le Dahomey, ne dura pas longtemps. En 1892, Behanzin envahissait à nouveau nos territoires de Porto-Novo et attaquait même l'équipage de la canonnière Topaze. Une expédition fut résolue aussitôt pour châtier l'insolent. Le colonel Dodds, de l'infanterie de marine, fut nommé le commandant des forces et reçut les pouvoirs civils les plus étendus. Environ 3,500 hommes furent mis à sa disposition. L'expédition fut préparée sur place très minutieusement; pour diminuer les fatigues et les privations du soldat, on assura un service de convois d'approvisionnements et de munitions, un service d'évacuation des blessés, un service d'arrière, etc. Les hostilités commencèrent le 9 août 1892, au matin nous eûmes 2 tués et 13 blessés dans cette première escarmouche sur Zobbo, dont nous parlerons plus loin. Le 17 août, la colonne expéditionnaire se mit en marche le 20, les troupes arrivèrent au village de Takou, dans lequel, après une heure de combat, elles firent leur entrée. Le 21,la colonne est attaquée à nouveau. Les commandants Riou et Lasserre furent blessés dès le début, le capitaine Bellamy également, ainsi qu'un sergent.
:
;
L'attaque redoublant d'intensité, la section d'artillerie ouvrit à son tour le feu et déblaya le terrain par des salves de mitraille. Nos pertes ne furent que de 6 tirailleurs blessés,dont un sergent très grièvement. Le 24,
la colonne,
poursuivant son mouvement, s'empare de
;
le Décamey est donc pacifié sans trop de résistance.
Katagon
La marche dans l'intérieur, qui va commencer pour aller sur Abomey, la capitale, sera beaucoup Le Commandant Faurax. plus pénible. Dans les premiers jours de septembre, la colonne franchit le Badao, frontière du Dahomey et pénètre dans le pays sans rencontrer les bandes signalées auparavant. Le colonel Dodds, rassuré, établit son bivouac à Dogba, sur un plateau dominant le confluent du Badao et de l'Ouémé. Il fait commencer un poste fortifié destiné à servir de point d'appui; les hommes se reposent quelques jours. Le 19 septembre, à 5 heures du matin, la sentinelle du petit poste d'infanterie de marine, placé en avant-garde, aperçoit un grand nombre de noirs qui s'avancent dans les heibes, elle crie Halte-là. puis lâche un coup de fusil le petit poste, aux aguets, ouvre aussitôt le feu. Enveloppé, il se replie vers
:
!
;
;
le camp, poursuivi par les Dahoméens nombreux. Une attaque violente se dessine les noirs arrivent par troupes. Au bruit de la fusillade, les hommes d'infanterie de marine, capitaine Roulland, sortent de leurs cases, se forment rapidement en tirailleurs sur une ligne parallèle aux abris et commencent le feu sur l'ennemi qui n'est plus qu'à 50 mètres. Le sous-lieutenant Badaire est tué dans sa case, au moment où il se levait pour rejoindre sa section. La canonnière l'Opale, mouillée non loin de là, ouvre le feu à son tour et couvre de projectiles la ligne de retraite de
l'ennemi. La 2e compagnie de la légion, capitaine Jouvelet, se porte au secours de l'infanterie de marine, le feu s'exécute avec ordre par salves de section, malheureusement les Dahoméens, embusqués, visent bien, principalement les officiers et, en peu d'instants, nous avons à regretter des pertes cruelles. Le commandant de la légion Faurax amène un peloton de renfort. Il tombe mortellement atteint à l'abdomen. Le capitaine Drude prend alors le commandement. L'ennemi, excité par ses féticheurs, essaie quelques retours aussitôt brisés sur nos lignes. Nos troupes prennent à leur tour l'offensive et exécutent des bonds de30 mètres. Bientôt le combat dégénère en feux isolés, dont l'intensité diminue de plus en plus; les Dahoméens fuient de toutes parts. Il est 10 heures du matin. Cette journée, la première sérieuse de la campagne, nous coûta, outre les 2 officiers tués, 3 Européens tués, 27 blessés dont 20 Européens. Par contre, l'ennemi laissait 130 morts sur le terrain, mais il avait dû certainement emporter plus du double de cadavres ou de blessés. Le fort construit à Dogba, à la suite de la conquête, a reçu le nom de Faurax.
MADAGASCAR
COMBATS DE TSARASOTRA
(29 et 30 juin 1895)
Le Commandant Lentonnet, le Capitaine Aube
Tout le Corps expéditionnaire de Madagascar, concentré à Suberbieville, travaillait à l'exécution d'une route carrossable. Nos avant-postes avaient été portés à 25 kilomètres au delà, à Tsarasotra, et se composaient d'une compagnie de tirailleurs algériens, d'une section d'artillerie et de 10 hommes des chasseurs d'Afrique, sous le commandement du chef de bataillon Lentonnet. Le 28 juin 1895, vers neuf heures du soir, le petit poste de tirailleurs, placé sur la face Est du camp, fut tout à coup attaqué par un groupe de Hovas assez considérable. Après une défense énergique, le petit poste battit en retraite lentement et put rentrer au camp sans être poursuivi. Le 29. vers six heures du matin, à la naissance du jour, plusieurs centaines deHovas, débouchant en colonne profonde d'un sentier qui longe l'Ipoka, se glissèrent au Sud du plateau de Tsarasotra, en escaladant les pentes et ouvrant le feu à 300 ou 400 mètres de nos troupes. La6eCiedu régiment d'Algérie se déploya immédiatement à gauche, la section d'artillerie se mit en batterie et tira à mitraille, les chasseurs d'Afrique, à pied, sous les ordres du lieutenant Corhumel et du brigadierClaverie, défendirent énergiquement la droite; mais, vers six heures et demie, une autre colonne ennemie déboucha à sontour.Le lieutenantd'infanterie
Augey-Dufresse reçut, à ce moment, une balle dans le côté et fut tué sur le coup un caporal de tirailleurs, Sapin, fut également tué et 6 hommes blessés. Le commandant Lentonnet donna alors l'ordre à la section de réserve de pousser, sous le commandement du capitaineAubé, une contreattaque sur le sentier de Beritzoka, et, en même temps, la section de son lieutenant indigène, Kacy, exécutait vers le Sud, du côté de FIpoka, une autre contre-attaque. L'ennemi, ainsi attaqué à la baïonnette de tous côtés, se replia en toute hâte vers l'Est, laissant 30 cadavres sur le terrain et fut poursuivi Le Commandant Lentonnet. par le capitaine Aubé et sa troupe, au pas gymnastique, jusqu'au delà des pentes de l'Est. Une 3e colonne hova, avec de l'artillerie, fut alors signalée marchant contre la section du capitaine deux demi-sections et 2 pièces furent envoyées aussitôt comme renfort à Aubé le combat avait été rude et les munitions manquant, peut-être nos hommes allaient-ils succomber. A ce moment, deux C'es de tirailleurs algériens, commandées par le capitaine Pillot. cantonnées à quelques kilomètres et marchant au canon, arrivaient au secours du poste. Voyant leur proie échapper,
;
;
;
les Hovas se retirèrent sur le mont Béritzoka où se dressait un camp retranché. Le commandant Lentonnet, décidé à en finir, demanda au au général Duchesne des troupes de renfort. Deux CiHS de chasseurs à pied avec une batterie d'artillerie et des munitions arrivèrent le soir même, avec le général Metzinger. Le 30 au matin, toute la garnison prit la formation de combat. Les Hovas, au nombre de 4,000, avec 4 canons à tir rapide, descendent un peu les pentes de la montagne et commencent le feu. Trois Cies de chasseurs, 1 de tirailleurs sont envoyées en avant avec 2 sections d'artillerie. Nos troupes marchent sans répondre au feu de l'ennemi à 200 mètres seulement, elles s'arrêtent et exécutent un feu rapide. Les Hovas ne lâchent pas pied, mais leur mouvement est arrêté. La charge sonne alors les hommes ont un élan magnifique, l'assaut est superbe; tous se précipitent comme une trombe sur les Hovas qui s'enfuient, poursuivis par des feux de salve fort bien exécutés et très meurtriers. Une section d'artillerie, hissée sur le plateau, tire sur une colonne ennemie, qui défilait à 3,000 mètres, et la disperse en peu de temps à 10 h. 20 tout était fini. Nous n'avions que 2 hommes tués et 15 blessés l'ennemi laissait entre nos mains 450 tentes, le drapeau du commandant en chef, 1 canon, 400 fusils et des approvisionnements considérables. C'était une victoire complète, dont tout le succès revient au commandant Lentonnet et au capitaine Aubé, et dont les résultats furent des plus appréciables pour la marche en avant du Corps expéditionnaire.
;
;
;
;
TONKIN
PREMIÈRE PRISE DE NAM-DINH (11 décembre 1873).
Le Marin Robert.
Après la prise de Hanoï, pendant que Balny marchait sur Haï-Dzuong Francis Garnier arrivant devant Ninh-Binh et ayant trouvé la ville prise par l'aspirant Hautefeuille résolut de pousser plus loin immédiatement. Avec la canonnière le Scorpion, il se dirige sur Nam-Dinh forteresse puissante située plus au Nord. Le 10 décembre, se présentant à l'entrée du fleuve, il trouve des préparatifs de défense et à peine arrive-t-il devant des batteries masquées, à ras de terre, qu'il est assailli d'une volée de boulets qui lui blessent -plusieurs hommes. La mâture de la chaloupe est atteinte, son blindage touché M. Bouxin qui accompagne Garnier saute à terre avec quelques hommes et réussit à enclouer les canons. Le lendemain, 11, nos troupes arrivent à Nam-Dinh; 3 colonnes de débarquement sont formées et attendent toutes prêtes dans des jonques. A cette vue, un feu terrible part de la citadelle, immense quadrilatère avec bastions en fer de lance aux quatre coins. Les colonnes sont jetées à terre. La première composée de 15 hommes, avec un canon, commandée par M. Bouxin est chargée de faire une simple diversion sur la face du bastion sud; la deuxième, dirigée par l'Ingénieur Bouillet a pour objectif la face du bastion est, à travers les rues de la ville qui se trouve sur les rives.
;
Enfin, Francis Garnier, à la tête de la troisième se lance dans une rue qui conduit à un redan précédant une porte de la citadelle. 1
Soldats enfonçant une porte.
à
Les deux dernières colonnes se trouvent tout coup réunies et attaquent le mirador d'entrée. La résistance est sérieuse les canons de la forteresse font un vacarme infernal, heureusement sans danger. A ce moment, l'affût du canon de la le colonne se rompt; la position est un instant critique Scorpion, qui suit le combat, tire alors de son côté dégageant nos hommes qui se ruent sur la porte. Les chevaux de frise dressés pour la défense servent pour l'escalade. Un marin plus agile, appelé Robert, se hisse par cet étrange escalier Garnier, qui le suit, lui crie
;
;
;
:
-
Tu passes le premier, mon gaillard, bon pour cette fois, mais que cela ne t'arrive plus Les deux Français apparaissant sur le parapet jettent dans la stupeur les Annamites qui abandonnent la position et s'enfuient à toutes jambes. Quelques instants après, le drapeau français flottait sur la tour de la citadelle
!
!
MADAGASCAR
DÉFENSE DE TAMATAVE
(25et26juin 1883).
Le Lieutenant Castanier. Le 10 juin 1883, à la suite du refus de la reine de Madagascar de reconnaître nos droits sur la côte des Sakalaves et de nous donner satisfaction, l'amiral Pierre s'empara de Tamatave après un léger bombardement. Il organisa de suite la ville pour la mettre à l'abri d'un coup de main. Une série de postes furent construits autour, du côté de la terre et reliés entre eux par une ligne d'a-
battis.
Le Lieutenant Castanier.
Les Hovas à plusieurs reprises tentèrent des attaques de nuit, ils furent toujours repoussés. Dans la nuit du 25 au 26 juin un gros
parti d'ennemis chercha à pénétrer dans la ville en contournant le fort du Sud. Ils vinrent se heurter contre le poste d'Aitken, commandé par le lieutenant Castanier et 25 hommes d'infanterie de marine. A trois reprises, les Hovas se lancent à l'assaut du poste, trois fois nos feux de salve les arrêtent. Pendant 4 heures, Castanier tient tête aux mille hovas qui l'attaquent et les met en fuite en leur infligeant de grandes pertes. Cité à l'ordre le lendemain, le lieutenant reçut la croix de la Légion d'honneur le 25 août suivant.
AFRIQUE OCCIDENTALE
L'AFFAIRE DE SINDER (5 mai 1898).
Le
sergentSamba Taraore et le caporalKouby Keita.
Le 5 mai 1898, le capitaine Cazemajou et l'interprète Olive, en mission dans le Soudan et installés à Sinder furent traîtreusement attirés hors du campement de troupes et tués à coups de bâton, sur l'ordre du Serky (sultan de Sinder). Quelques instants après, le sergent indigène SambaTaraore commandant l'escorte et les tirailleurs, qui s'étaient rendus sans défiance au marché, furent saisis et mis aux fers avec trois domestiques de la mission et bientôt rejoints par l'interprête Radie Diarra, un berger et un domestique, également enlevés et emprisonnés. Prévenu, le caporal Kouby Keita prit immédiatement le commandement et mit en état de défense la Soukala de la mission, distante de la ville d'environ 1.200 mètres, et repoussa dans la journée du 5 deux terribles assauts qui nous coûtèrent trois tués et cinq blessés, puis envoya dire au Serky que, si les prisonniers n'étaient pas immédiatement rendus, il prendrait et brûlerait la ville. (Sinder, entouré d'un tata, compte 9 à 10.000 habitants et il restait à Kouby
Keita huit tirailleurs.) Pendant la nuit du 5 au 6, la petite patrouille alla brûler quelques cases voisines de la ville, sans que l'ennemi ait osé bouger. Effrayé, le Serky fit rendre les prisonniers le 6 au matin et proposa, mais vainement aux tirailleurs de les prendre à son service.
Rendez-nous d'abord les corps de nos chefs et ce que vous avez pillé, nous verrons ensuite. » Telle fut la réponse obtenue. Le Serky promit de rendre, le lendemain matin, les corps des blancs. Le 7 et le 8 se passèrent sans incident, mais sans que les corps fussent rendus. Dans la nuit du 8, les tirailleurs brûlèrent de nouveau et sans éprouver de résistance, quelques cases voisines de la ville. Le 9 au matin, l'ennemi prononça contre la Soukala une furieuse attaque qui lui causa de fortes pertes, mais nous coûta encore trois blessés. Le 10, le sergent Moussa fit occuper les points extérieurs de la ville que les tirailleurs gardèrent pendant les journées des 11, 12 et 13, en interdisant l'accès aux habitants. Mais ils en furent repoussés le 14 au matin, par une nuée d'ennemis qui les poursuivirent jusqu'au mur de campement; dans cette action fut tué le brave Kouby Keita. Deux tirailleurs furent également tués. Deux tirailleurs et un domestique blessés. Les munitions étant épuisées, il fallut songer à la retraite, qui commença pendant la nuit du 14 au 15. La poursuite ennemie dura trois jours et nous causa encore un tué et trois blessés. Les débris de la mission arrivèrent enfin le 8 juillet à Ho, après des fatigues et des privations extrêmes. En résumé, sur les dix-huit tirailleurs de la mission, six avaient été tués, huit blessés, quatre seulement revinrent intacts. Sur les quinze autres indigènes, un fut tué et cinq furent blessés. Ces chiffres ont leur éloquence, et prouvent quelle a été l'héroïque conduite de la petite troupe. Les tirailleurs de la mission ont fait plus que leur devoir et ont prouvé une fois de plus quelle confiance on peut avoir en leur bravoure, leur ténacité et leur fidélité. A la suite de ce fait d'armes, le colonel commandant supé«
rieur a cité àTordre du jour du corps d'occupation les nom-
:
més
:
Kouby Keita, caporal n'a cessé de faire preuve d'une héroïque audace jusqu'au jour où il est mort glorieusement, tué d'une flèche empoisonnée. Cinq tirailleurs tués à l'ennemi à Sinder huit tirailleurs blessés; quatre tirailleurs non blessés. Samba Taraore, sergent a fait preuve d'une audace et d'une énergie extrêmes, en tenant huit jours à Sinder, en réclamant les corps des blancs et en réussissant à ramener à Ho les débris de la mission malgré les dangers, les fatigues et les privations éprouvés..
:
;
TONKIN
PRISE D'HAÏ-DZUONG PAR 28
!
HOMMES
(4 décembre 1873).
L'Enseigne Balny d'Avricourt. — Le Dr Harmand. Nous avons déjà dit qu'après la prise d'Hanoï, Francis Garnier qui n'avait pas assez de forces pour les porter sur tous les points à la fois, chercha d'abord à assurer ses communications avec la mer et pour cela de s'emparer des forteresses de Haï-Dzuong et de Ninh-Binh. L'enseigne de vaisseau M. Balny d'Avricourt fut envoyé sur la première avec l'Espingole, accompagné de 15 hommes d'infanterie de marine avec le lieutenant de Trentinian. En passant, il s'empare de Phu-Ly, puis arrive à 2 kilomètres de Haï-Dzuong le 3 décembre. M. de Trentinian avec 4 soldats fut dépêché près du TongDoc (gouverneur de la province) pour connaître ses intentions. Les réponses de celui-ci n'ayant pas été satisfaisantes, 10 coups de canon furent envoyés sur la citadelle. Des parlementaires se présentaient le lendemain, mais le Gouverneur refusa de venir à bord: Balny lui donna jusqu'à 8 heures du matin. La canonnière ayant dans la nuit trouvé un passage praticable put s'approcher à 250 mètres des forts. A 8 h. 1/2, le Gouverneur n'ayant pas paru, deux coups de mitraille furent envoyés sur le fort qui répondit aussitôt. La poignée d'hommes s'embarqua alors dans des canots et remorqués par la yole du bord débarquèrent sur la rive protégée par les canons. Les défenseurs de la ville tirèrent sans relâche sur la petite
troupe qui se lança bravement à l'assaut. Devant cette décision énergique, les Annamites s'enfuirent dans la citadelle qui se trouvait à environ 600 mètres, poursuivis par les nôtres, mais lorsque ceux-ci arrivèrent à l'entrée d'un redan, ils furent salués par des bordées de coups de canon qui ne leur firent heureusement aucun mal. Balny raconte ainsi l'affaire « Nous nous portâmes de suite en avant jusqu'à la porte du redan, devant laquelle nous devions nous buter, mais nous étions à l'abri des pièces. » En se faisant lacourteéchelle et en taillant à coups de sabre les chevaux de frise en bambou, les hommes arrivèrent sur le parapet. Effrayés, les Annamites s'enfuirent à nouveau. La citadelle recommença son feu. « La seule tactique était d'aller de l'avant, profiter de la décharge pour franchir le pont et nous abriter contre la porte de la citadelle. Le pont franchi au pas de course, nous nous trouvions à la porte mêLe Docteur Harmand. me. » Mais la colonne n'a pas de canon, pas d'échelle, une seule hache, les murs sont élevés et protégés de haies de bambous inclinés; la porte est dure et derrière des gabions pleins de terre ont été placés pour la renforcer. Tous les coups des annamites passaient heureusement à quelques mètres de nos hommes qui recevaient néanmoins
:
;
une pluie de pierres et de briques. Un soldat, le nommé Gautherot offrit d'essayer l'escalade ce fut en vain. A ce moment, le docteur Harmand parvint à casser un des barreaux supérieurs de la porte, puis un second. Balny, s'accrochant alors à la brèche se hisse aussitôt, le revolver au poing et se présente à l'ouverture en faisant feu. Cinq annamites placés là se sauvent. Balny, animé d'un' courage sans pareil, saute seul dans la place la fuite est générale, toutefois la position n'est pas sûre le docteur Harmand et quatre hommes passent par le même chemin et le rejoignent; la porte est enfin ouverte. Dans toute la citadelle, les Annamites lachèrent pied et s'enfuirent par la porte Est en emportant leurs armes. Balny et deux hommes s'élancent rapidement à cette porte tirant sur les fuyards 150 hommes armés se présentent au même instant, nos trois braves courent sur eux, aussitôt les ennemis jettent leurs armes en demandant grâce. Nos hommes n'en peuvent croire leurs yeux, au nombre de 28 seulement, ils se sont emparés d'une citadelle hexagonale possédant 6 bastions de 100 mètres de côté, ayant chaque porte protégée par un redan, les remparts garnis de 80 pièces de canon approvisionnées de nombreux coups, et servies par de nombreux défenseurs. C'est de la féerie et jamais dans l'histoire d'aucun pays on ne pourra enregistrer de pareils succès. Des soldats français étaient seuls capables de ce coup d'audace qui avait déjà eu un pendant à Hanoï et Nilih-Binh.
;;
;
à
MADAGASCAR
COMBAT DE SAMBIRANO
(27 août 1885).
Mort du sergent Hein. — Le capitaine Pennequin. Pendant que l'amiral Miot préparait une grande colonne destinée à s'emparer des lignes de Farafate, en 1885, le capitaine Pennequin, commandant le poste d'Amboudimadirou, apprend que les Hovas venaient d'incendier et de piller le village de Zougoa, situé à 24 kilomètres. Aussitôt, avec 70 hommes de la compa-
gniesakalave et
Ilanavalo, ex-reinc de Madagascar
50
hommes d'infanterie de marine, Pennequin part à la poursuite des ennemis. Lorsqu'à 4 heures et demie, il arrive au village, il ne trouve plus que des ruines fumantes et de nombreux cadavres. Les Hovas, au nombre d'un millier, avec de l'artillerie, se sont enfuis dans la direction de la vallée de Sambirano.
Mais la nuit étant venue, nos soldats campent sur place. Le lendemain matin, 27 août 1885, la petite colonne se remet en marche à la recherche des pillards. Ceux-ci sont signa-lés sur les collines avoisinantes et, vers 8 heures du matin, quelques feux de salve leur sont envoyés. Les Hovas mettent aussitôt leurs pièces en batterie et ripostent par une vive fusillade. Leur tir est ajusté, aussi fait-il dans nos rangs de nombreuses victimes. Dès le commencement de l'action, le sergent Hein est tué, le lieutenant Valette et huit hommes sont grièvement blessés. Le capitaine Pennequin fait transporter tous les blessés en arrière, puis ordonne une retraite rendue nécessaire. Les Hovas, croyant à une fuite, se précipitent, descendant les pentes des hauteurs et se jettent en courant sur les
Français. Pennequin, gardant son sang-froid, fait former le carré, agenouiller ses hommes et mettre la baïonnette au bout du canon. Les ennnemis sont briséspar cette muraille de fer et finalement rejetés en désordre dans les bas-fonds. Cette défaite se change bientôt en déroute et les Hovas disparaissent de tous les -côtés. Nous avions malheureusement à déplorer de nouveaux blessés et parmi eux le capitaine Pennequin, frappé un des premiers.
TUNISIE
COMBAT DE BEN-MÉTIR (11
mai 1881).
Au cours de l'expédition de Tunisie, le général Logerot voulut enserrer les Kroumirs entre nos troupes et la côte. Le 11 mai 1881, il envoya une reconnaissance sur Ben-Métir. Une vive fusillade, partie de la gorge de Khanguet-el-Hamman, accueillit nos soldats qui ripostèrent aussitôt. L'ennemi tenant solidement, tous les chasseurs d'Afrique furent mis en ligne, 120 goumiers à pied, sous les ordres du capitaine Heymann, se portèrent sur la droite, pour tourner la position, puis deux batteries de montagne de 80 furent installées en arrière et ouvrirent un feu intense. Les Kroumirs furent refoulés en peu de temps, mais nous avions de notre côté trois goumiers tués, un lieutenant blessé, un chasseur d'Afrique tué et un blessé. Vers 2 heures, les munitions commencent à faire défaut l'ennemi revient en grand nombre. Trois compagnies du 1er zouaves, sous les ordres du chef de bataillon Mercier, se portent en avant la 3e compagnie du 3e bataillon, capitaine Kœnig, prend la formation de combat et la fusillade recommence. La 4e compagnie, capitaine de Franclieu, vient soutenir la 3e et toutes les deux se portent en avantLes indigènes, embusqués derrière des rochers, dirigent sur elles un feu de salve qui tue un zouave. Le capitaine Kœnig fait alors sonner la charge et enlève à la baïonnette la ligne de résistance.
;
;
Pendant ce temps, notre flanc droit était menacé, mais le feu d'une batterie est immédiatement dirigé sur les Kroumirs qui s'arrêtent et s'enfuient de toutes parts. Nous avions 5 tués et 4 blessés dont un officier. Ce fut là le combat le plus sérieux de toute la campagne de 1881.
DAHOMEY
COMBAT DE POGUESSA (4
octobre 1892).
Mort du Capitaine Bellamy et du Lieutenant Amelot. Après la malheureuse affaire de Dogba, le colonel Dodds reprit sa marche surAbomey. La colonne était escortée par un parc et une ambulance flottants, ainsi que les canonnières Opale et Corail, sur l'Ouémé. L'ennemi s'était porté au gué de Tohué espérant surprendre toute la colonne. Le colonel Dodds,averti, décide de tenter le passage du fleuve au bivouac de Gbedé où la berge à pic permet l'établissement facile d'un va-et-vient. Pour donner change aux Dahoméens, une compagnie va reconnaître le gué de Tohué et, pendant ce temps, à la faveur d'un brouillard intense, le passage s'effectue sans incident. Le 4, à cinq heures et demie du matin, le Le capitaine Bellamy.
le
corps expéditionnaire se remet en marche sur deux colonnes et se dirige sur Poguessa, la prochaine étape, en suivant la rive droite de l'Ouémé. Une brousse épaisse et dure rend la marche lente et pénible, la surveillance difficile. Tout à coup, du milieu des hautes herbes part un feu nourri et meurtrier. Le capitaine Bellamy est tué raide de suite, le commandant Lasserre, le lieutenant Bosano grièvement blessés. Les tirailleurs sénégalais qui marchaient en tête, se déploient dans la brousse et répondent aux ennemis par un feu très vif. La 4e compagnie de la légion, commandée par le capitaine Poivre, accourt les soutenir; son lieutenant, Amelot, reçoit une balle en plein cœur; le lieutenant Farail a le bras traversé. Les blessés sont nombreux; le lieutenantFerradini, de l'infanterie de marine, de l'Etat-Major du Colonel, est grièvement blessé au cours d'une mission auprès du commandant du 3e groupe. les deux canonA ce moment, l'artillerie entre en ligne nières prêtent aussi leur appui à la colonne et envoient leurs projectiles sur les réserves de l'ennemi. La mitraille et les feux de salve dégagent assez vite le terrain; aussi, le combat se ralentit rapidement, les Dahoméens disparaissent finalement dans la forêt poursuivis par nos feux. Le champ de bataille était couvert de morts; 350 cadavres, dont ceux de 17 amazones, furent relevés par nos hommes 130 fusils se chargeant par la culasse tombèrent entre nos
;
;
mains. Nos pertes étaient de 8 tués dont 2 officiers et de 35 blessés dont 3 officiers.
TONKIN.
DÉFENSE HÉROÏQUE DE PHO-BINH-GIA.
Le Lieutenant Ducongé. — Le Sergent Haas. Le poste de Pho-Binh-Gia, placé à l'extrémité d'un défilé important et commandé par le lieutenant Ducongé, avec
tirailleurs tonkinois, fut brusquement attaqué, le 11 juin, par des bandes chinoises nombreuses qui ne tardent pas à envelopper le poste d'un cercle de fer. Le poste était défendu par un parapet en terre de cinquante centimètres d'épaisseur sur un mètre de hauteur, recouvert de mottes de gazon; quelques palissades en bambou, en mauvais état, garnissent le fossé. Le sergent Haas est chargé de la défense de la face est, le lieutenant prend celle de la face ouest. L'ennemi comprend plus de 1.000 chinois; néanmoins, une première attaque est repoussée. Vers onze heures du matin, les chinois installés dans les rochers, surplombant le poste, ouvrent sur celui-ci un feu intense et plongeant, qui dure jusqu'à la nuit. Le sergent Haas est blessé; il se panse lui-même et reste à son poste, encourageant tous les hommes par son exemple. Les pirates incendient les villages environnants et cherchent à brûler les cases voisines de l'enceinte. Profitant du trouble que ce feu occasionne, ils tentent enfin un nouvel assaut. Heureusement, le lieutenant a eu le temps de faire placer 39
des petits piquets, ce qui arrête l'élan de l'ennemi qui se retire sur les hauteurs. La nuit fut terrible, la fusillade continuant de part et
d'autre. Le lendemain matin, les feux plongeants recommencent. Les soldats restent à l'abri dans les cases les pirates crient aux tirailleurs de livrer l'officier et leur offrent 200 piastres par tête d'Européen. Le 13, ils renouvellent leurs offres et portent à400piastresl'indemnité pour le lieutenant, à 300 pour le sergent enfin, ils font des menaces de tout brûler et de décapiter tous les prisonniers. Rien n'y fait la vaillantepetite troupe Le lieutenant Ducongé. resta fidèle. Le 14, les communications sont tout à fait coupées. Un paysan dévoué parvient à franchir les lignes et se porta sur Lang-Son pour chercher des renforts. Il rencontra le capitaine Brulard qui se dirigea aussitôt à marches forcées sur le poste. Le 15, à 3 heures du matin, nouvelle attaque repoussée vers 7-heures, on entend une fusillade dans la direction de Lang-Son; ce sont les secours qui arrivent; l'espoir renaît
;
;
;
;
parmi les défenseurs, car les vivres commencent à manquer; il n'y a plus que de l'eau croupie à boire. Le 16, les feux continuent toute la journée; Le 17, le capitaine Brulard peut enfin s'emparer des positions du nord. La joie est grande dans la petite garnison qui n'a plus de munitions. Il reste bien des cartouches. 86, mais les hommes ont la carabine 74, et celles-ci ne peuvent servir. On essaie, néanmoins, d'en tirer; il se produit des éclatements de douilles, toutefois la balle a une force suffisantepour arriver jusqu'aux ennemis.
Le 19, la poignée de héros aperçoit la colonne de secours à
2 kilomètres qui livre un combat acharné, malheureuêtre d'aucune utilité. Dans lanuit du 19 sement elle nepeut au 20, les pirates décampent et les renforts pénètrent le 20
lui
au matin dans Pho-BinhGia. Le général en chef signala.cette brillante défense dans un ordre général : « C'est un honneur pour la Compagnie et pour
:
le 2e Tonkinois d'avoir dans ses rangs de si braves soldats. Ils pourront dire avec orgueil J'étais au siège de Binh-Gia. » La défense de ce petit poste fut, en effet, héroïque et rappelle celle fameuse de Tuyen-Quang. Le nom du lieutenant Ducongé mérite d'être conservé au livre d'honneur de l'infanterie coloniale et cité parmi les plus braves de ses vaillants officiers.
DAHOMEY
COMBAT DE ZOBBO (1ER
mars 1890).
Le Commandant Terrillon. A la suite d'un différend entre le Dahomey et l'Angleterre, en 1878, la France voulut s'assurer dans ce pays une influence prépondérante et un traité fut signé entre le capitaine de frégate Serval et le roi Glé-glé, qui confirmait nos anciens droits, datant de 1864, sur Kotonou, comptoir important de la côte. Une petite garnison fut envoyée en 1885 dans cette ville, mais deux ans plus tard, le roi Glé-Glé refusa de continuer à
reconnaître nos droits et, même, voulut nous forcer à renoncer au protectorat du royaume de Porto-Novo qui nous avait été octroyé en 1863. En 1889, Glé-glé envahit les territoires de notre protégé, le roi Toffa, et les razzia. Il incendia même la ville que nos vingt-sept tirailleurs et le capitaine Bertin ne purent défendre (28 mars 1889). M. Bayol, lieutenant-gouverneur des Rivières du sud, résolut d'aller demander des explications au roi du Dahomey. Il se rendit à Abomey en novembre 1889, accompagné de son secrétaire. Pendantplusieurs semaines, les deux Français furent retenus à la cour de Glé-glé, endurant mille souffrances, assistant à des sacrifices humains., à des hécatombes terrifiantes aussi, écœuré, Bayol consentit à signer la renond'esclaves ciation de la France et s'enfuit de cette ville maudite. Glé-glé mourut le 28 décembre de la même année et eut
;
pour successeur Behanzin. Ce dernier, bien qu'élevé en France, nous était hostile et ne cachait pas sa haine pour notre patrie et pour la civilisation. Il fit de suite arrêter à Widah plusieurs Français, dont le père Dorgère, et les emmena prisonniers à Abomey. Pour vengerune telle violation de nos droits, une expédition fut décidée. Le commandantd'in-
fanterie de marine Terrillon débarqua à Kotonou avec quatre cents hommes de troupe du Sénégal cinq cents auxiliaires furent mis à sa disposition. Le 21 février 1890, un premier engagement heureux nous coûta quatre blessés le 23, les Dahoméens tentent un retour ofM.liayol. fensif, mais des feux de salve exécutés avec calme à deux ou quatre cents mètres, et quelques boîtes à mitraille, les mirent en fuite aussitôt. Nous avions cette fois encore trois blessés, mais les ennemis laissaient dix-sept cadavres sur le terrain. Le 1er mars, le commandant Terrillon résolut de marcher en avant; une colonne est dirigée sur Zobbo, au nord de Kotonou, sur les bords du lac Nokoué. Les hommes furent transportés en pirogue jusqu'au lac.
;
;
A peine les premières troupes auxiliaires eurent-elles mis
le pied sur la terre ferme, qu'elles furent assaillies par une vive fusillade. Au bruit des coups de feu, les tirailleurs de la 2° compagnie se jettent dans la vase et, gagnant les rives, viennent au secours des premiers. Une mêlée indescriptible s'engage sur tous les points le combat est acharné. Le commandant et son état-major sont entourés; lesofficiers mettent le révolver au poing et font à leur tour le coup de feu. A ce moment, la charge sonne le capitaine Lemoine enlève les tirailleurs sénégalais avec entrain, emporte le villaged'un seul bond et poursuit énergiquement l'ennemi. Les pièces de canon, qui ont pu être enfin débarquées, sont mises en batterie sur les bords du lac un feu terrible de mousqueterie et d'artillerie met en déroute les derniers
;
;
:
assaillants. A dix heures, tout paraissait donc terminé, et les soldats, harassés, formant les faisceaux, s'installent pour prendre un repas froid. Tout à coup, les Dahoméens surgissent à nouveau à quelques cents mètres. Les faisceauxsont rompus et les postes de combat repris en un clin d'œil les trois pièces reprennent également leur tir. Une demi-heure après, nos troupes restaient définitivement maîtresses du terrain et pouvaient reprendre le repas interrompu. Avant de se réembarquer, la compagnie Septans fut chargée d'aller incendier le village. De retour à cinq heures à Kotonou, la colonne ne comptait que deux auxiliaires tués. Les Dahoméens avaient laissé bataille. plus de trois cents morts
;
se
MADAGASCAR
PRISE DE TANANARIVE (30 septembre 1895).
Le Général Duchesne.
La colonne légère chargée de s'emparer de Tananarive arriva le 29 septembre 1895 devant la ville, refoulant devant elle tous les contingents ennemis. La capitale de Madagascar est située sur un plateau rocheux, étroit, aux pentes abruptes, dans certains endroits verticales. Ce plateau a la forme d'un Y;les deux branches supérieures seules se raccordent en pente douce avec le fond des rizières. Le palais delaReine occupe le sommet du plateau, au centre de la branche inférieure de l'Y, dominant de 200 mètres le cours de FIkopa et les plaines environnantes. Autour de la ville, à l'est et au nord-est, Le Général Duchesne. se trouvent trois chaî-
:
nés de hauteurs parallèles au plateau de Tananarive Ambohidempona, Ankatso et Ambohibe. Les Hovas occupaientfortement la première ligne et avaient établi des batteries sur les mamelons voisins formant ainsi une sérieuse avant-ligne. Le général Metzinger reçut l'ordre de déborder cette ligne au sud, puis d'attaquer de front le palais de la Reine, pendant que le général Voyron attaquerait au nord.-est l'extrémité de la première ligne. Le mouvement commença le 30 au matin. Les Hovas prirent les devants et les obus commencèrent à pleuvoir sur nos cantonnements en même temps, l'arrièregarde était attaquée par l'ennemi campé à Ambohimanga. Une compagnie d'infanterie de marine et les Haoussas commandés par le colonel de Lorme supportèrent vaillamment l'attaque pendant plus de six heures, puis prirent l'offensive et se jetèrent à la baïonnette sur les Hovas qu'ils mirent en déroute, leur enlevant deux canons. Nous avions trois tués et quatorze blessés. De son côté, le général Voyron poursuivait sa route son artillerie répondit énergiquement aux batteries d'Ampanatonandoa. Trois fois les Hovas évacuèrent les hauteurs, trois fois ils remontèrent à leurs positions et recommencèrent le feu. Heureusement, leurs pièces mal pointées ne portaient pas et les quelques obus qui parvinrent à nos lignes n'éclatèrent point. Finalement, ils furent délogés et leur feu éteint définitivement. Le général Metzinger avait marché plus lentement, à cause du terrain très accidenté. Les tirailleurs algériens, placés en avant, excités et impatients, se précipitent tout à coup sur Andrainarivo, sans que l'attaque ait été préparée par l'artillerie.
;
;
:
Un feu des plus violents les force à se replier en toute hâte, deux sous-officiers et ayant subi des pertes importantes quatre tirailleurs tués, deux officiers et dix-sept tirailleurs blessés. Une contre-attaque envoyée aussitôt par les Hovas est heureusement arrêtée par le reste du bataillon de turcos. Les tirailleurs malgaches, arrivant à la rescousse, grimpent sur la crête, s'emparent des canons et les retournent immédiatement contre Tananarive. Les hausses ayant été emportées, le commandant Ganneval en fait fabriquer en bois sur place. Officiers et sous-ofticiers s'improvisent artilleurs et commencent le feu. Le premier obus hova tiré par le capitaine Aubé et le lieutenant Baudelaire tombe sur le palais de la Reine, jetant la panique dans la ville. A une heure et demie, toute la ligne des crètes était en notre pouvoir il ne restait plus qu'à enlever la ville. Tananarive venait d'ouvrir le feu de deux fortes batteries établies devant le palais il était deux heures. Le général Duchesne ordonna alors de faire pendant une heure un bombardement lent à la mélinite et forma six colonnes d'assaut de deux compagnies chacune, qui devaient être amenées au pied de la falaise par des chemins de traverse. A deux heures quarante-cinq, le bombardement commença. L'effet terrifiant des explosions acheva de démoraliser les défenseurs, aussi à trois heures trente, un pavillon blanc fut hissé sur le palais de la Reine remplaçant le pavillon royal. Un parlemetaire,Marc Rabibisoa,vint demander de la part de Ranavalo la cessation immédiate du feu. Le général Duchesne accorda une suspension d'armes de quarante-cinq minutes pour permettre d'aller chercher des négociateurs.
;
;
A l'heure dite, le fils du premier ministre, accompagné du ministre des Affaires étrangères, vint faire sa soumission et déclarer les hostilités terminées. Le général Metzinger partit alors en avant avec quatre bataillons, une batterie et une compagnie du génie et s'approcha de Tananarive dans lequel il pénétra le soir même, mais le général Duchesne ne fit son entrée solennelle que le lendemain matin, 1er octobre, précédé d'un peloton de cavalerie, il se dirigea vers le palais de la Reine, au milieu d'une haie de soldats formée par les troupes entrées la veille. La population, massée sur la route, accueillit fort bien les
Français.
TONKIN.
COMBAT DE GAï-TRAM
(17
juin
1891).
Le Lieutenant de Rauglaudre. A la demande de l'autorité civile, qui signalait un rassemblement d'un millier de pirates dans le cirque de Traïson et l'île des Deux-Songs, une opération militaire fut décidée, le 5 juin 1891, et confiée au colonel Dominé, le héros deTuyenQuang. La colonne, composée de divers détachements des garnisons des villes voisines, se concentra aux Sept-Pagodes où vinrent la rejoindre 350 gardes civils et un assez grand nombre de partisans. Des renseignements étant venus confirmer la présence des pirates dans le village de Lam-Sa, sur la rive nord du Songda-Bac, le colonel Dominé forma plusieurs détachements pour prendre l'ennemi entre plusieurs feux et l'anéantir dans son repaire. Le 17, la colonne principale débouche devant Lam-Sa, mais ce village est trouvé évacué; l'ennemi a fui la veille.
La marche est remise au lendemain, la chaleur étant accablante. Les divers détachements se rejoignent sur le col de CaïTram, puis retournent dans leurs garnisons, les pirates s'étant réfugiés dans les montagnes. Une portion de la colonne seulement avait eu affaire aux ennemis. Ce détachement, commandé par le commandant Raffenel, était parti le soir et avait marché toute la nuit jusque vers deux heures du matin. Il arrivait à neuf heures à Caï-Tram
et s'était formé aussitôt pour la grand'halte, avec trois postes de tirailleurs tonkinois. L'un de ces petits postes fut surpris tout à coup par des pirates venant de Nui-Yen-Tu et perdit en un instant 1 sergent français, 1 caporal, 1 sergent indigènes tués. Effrayés, les hommes ne surent se défendre et reculèrent en désordre sur le camp. Une section, commandée par le lieutenant de Rauglaudre, se jeta à leur secours et réussit, après un violent combat, à ramener les morts et les blessés tout en éprouvant, elle-même, des pertes sérieuses : 1 sergent français et 1 tirailleur tués; 1 tirailleur blessé. A ce moment, le Nui-Co-Bang, où le détachement devait rejoindre le gros de la colonne, parut couvert de pirates c'étaient ceux refoulés par les autres compagnies qui arrivaient. Le commandant Raffenel fit reprendre la marche et, malgré l'ennemi, se dirigea vers le Nui-Co-Bang pour s'ouvrir un chemin sur le col de Caï-Tram. Il était une heure du soir l'ascension des roches abruptes et la chaleur accablante épuisent les soldats qui sont harcelés par les pirates. Les coolies lâchent leurs charges et la colonne se voit forcée d'abandonner une partie des bagages, les morts en les cachant dans la brousse; après mille difficultés et plusieurs engagements, la tête de colonne parvient enfin au col laissant en route 4 hommes morts d'insolation. Le colonel Dominé, après la jonction, envoie chercher tout ce qui restait en arrière et relever les morts qui furent ramenés aux Sept-Pagodes, où les honneurs militaires leur furent rendus. Cette petite expédition de police, sans grand résultat, nous coûtait 12 tués et de nombreux blessés ou malades.
:
:
;
TUNISIE.
COMBAT DU DJEBEL-SEKKEK (26
Premiers coups
avril 1881).
de feu.
Le Gouvernement français ayant décidé d'infliger une punition exemplaire aux populations de la Tunisie, en particulier de la Kroumirie, pour les méfaits dont ils se rendaient coupables envers nos possessions algériennes, un corps expéditionnaire fut formé et les opérations commençaient
aussitôt. Après la prise de Tabarca et l'entrée des Français au Kef, la marche en avant futordonnée parle général en chef. Le 26 avril 1881, la brigade Vincendon, se mettant en mouvement à trois heures et demie du matin, fait une marche très pénible en dehors de tout sentier; elle atteint quelques heures plus tard le col de Feldj-Kala où s'étaient embusqués les Kroumirs. Un feu intense nous accueillit et en quelques instants nous perdîmes 2 tués et 4 blessés. La brigade Gallaud arrivait sur ces entrefaites; le 22e de ligne reçoit des coups de feu sur la crête et les Kroumirs viennent attaquer la compagnie du Couret. Celle-ci ouvrele feu et à deux reprises charge à la baïonnette, ce qui lui permet de se dégager et de se replier lentement. L'ennemi engage alors un combat pareil avec la compagnie Rousset qui riposte et rejoint le gros du régiment. Les Kroumirs montrent un acharnement extraordinaire; on voit de nomhreux chefs à cheval, dont un porte un étendard, par-
courir leurs rangs; ils conduisent une nouvelle attaque furieuse contre nos lignes. La compagnie Mathieu couvre notre flanc et répond par un feu vif, mais l'ennemi augmente toujours. Alors, à trois heures, le général Vincendon fait enlever les sommets situés à l'extrémité de la crête du Djebel-Sekkek par une colonne composée du 141e et d'un bataillon du 40e de ligne, et la 2e brigade continue son mouvement en tiraillant. Le feu ne cessa qu'à la fin du jour et les Kroumirs se retirèrent au-delà des montagnes. Nos troupes voyaient le feu pour la première fois; elles se conduisirent vaillamment et marchèrent avec un entrain et une vigueur remarquables. Nos pertes étaient de : 5 tués, dont 1 officier, le souslieutenant Payet du 22e de ligne, et de 16 blessés.
SOUDAN
DÉFENSE DE
Bu.
(22
février 1892).
Le capitaine Briquelot. — Le sergent Touchais.
:
Le colonel Humbert fut chargé en 1891 et 1892 d'opérations importantes contre Samory l'effervescence dans le pays devint, à ce moment, considérable. Les Maniankas, entr'autres, ne voulaient pas reconnaître l'autorité du fama de Ségou que nous soutenions le capitaine Briquelot, de l'infanterie de marine, résident dans cette ville, essaya de leur faire entendre raison et d'obtenir leur soumission. jugea qu'une actionétait Tous ses efforts ayant échouée nécessaire pour ne pas donner aux ennemis la croyance que nous reculions devant leurs prétentions. Le capitaine Briquelot, quitta Ségou le 13 février 1892, ayant avec lui 11 tirailleurs, 8 cavaliers auxiliaires, l'interprète Médoun, le sergent Touchais, et le clairon Serres. La colonne arriva le 20 devant Bla qu'elle trouva évacuée, le capitaine fit aussitôt entreprendre des travaux de défense importants, murer les portes, réparer l'enceinte bien lui en
;
il
;
prit. La colonne des Maniankas fut signalée le 22, à 9 heures du matin elle était formée de 4 groupes distants de 50 à 60 mètres. Les auxiliaires du capitaine Briquelot au nombre de 250 furent aussitôt dispersés sur les terrasses du tata.
;
-
Les assaillants, environ 1500, formèrent un arc de cercle devant le poste et commencèrent l'attaque vivement. A 200 mètres le capitaine fit ouvrir le feu; des salves bien dirigées couchèrent de nombreux ennemis dans la brousse. La colonne, coupée en deux tronçons, se lança néanmoins à l'assaut un feu plus vif l'arrêta net. Briquelot fait alors exécuter une sortie qui n'obtient aucun résultat; les Maniankas reviennent à la rescousse et se jettent désespérément sur la porte principale du fort, couverts par une ligne de tirailleurs porteurs de boucliers de bois. Heureusement, ils ne purent réussir dans leur attaque et se retirèrent pendant la nuit. Il était temps, les munitions manquaient et les hommes étaient harassés. Nous avions 1 tué et 7 blessés dont le clairon Serres; le sergent Touchais fut signalé dans un ordre du jour pour son intelligence, son calme et son courage.
:
DAHOMEY
GUET-APENS DE KOTOPA (26
et 27 octobre 1892).
Après l'affaire de l'Akpa, le colonel Dodds ayant recu des renforts, résolut de tenter une nouvelle fois le passage duKoto. Le26 octobre, à cinq heures du matin, les troupes furent rassemblées en silence, l'ennemi tenant toujours la rive opposée. Vers sept heures, le brouillard qui avait été dense jusque là, s'éclaircit un peu, ce qui permit à notre artilleried'ouvrirun feu violent sur la position de Kotopa. L'attaque, ainsi préparée, à la sonnerie les de « En avant batteries cessent de tireretles troupesparLe Colonel Dodds. tent rapidement. En plusieurs bonds, elles arrivent à bonne portée, exécutent des feux rapides, puis s'élancent à la baïonnette avec un élan irrésistible. L'ennemi fuit dans toutes les directions, laissant ainsi le passage libre la colonne se dirige vers l'ouest, pendant que
»,
;
lé capitaine Delestre continue un tir lent d'artillérie sur Kotopa. Arrivés devant le cours d'eau, les hommes prennent un peu de repos. Pendant ce temps, le génie commence la construction d'une passerelle qui, grâce aux nombreux matériaux trouvés à proximité, est rapidement achevée. La colonne passe le cours d'eau, mais il se trouve que ce n'est qu'un affluent, le Han, et que tout est à recommencer le
lendemain. Le 27, au matin, au moment où les troupes préparaient le nouveau passage, arrive un parlementaire de Behanzin qui annonce, de la part de celui-ci, son intention de faire la paix. Le roi du Dahomey faisait savoir, en même temps, qu'il évacuait les rives du Koto aussitôt et qu'à trois heures, un de ses ministres viendrait trouver le commandant de la colonne pour traiter. Celui-ci tardant à venir, les troupes repassent le Han, vers quatre heures et demie, et se dirigent vers le fleuve, en prenant toutefois les précautions voulues. Heureusement qu'il en fut ainsi, car nos soldats allaient tomber dans un véritable guet-apens. Le commandant Audéoud, arrivé le premier en vue du Koto, arrête ses trois compagnies et envoie des reconnaissances tâter le terrain. Un feu violent les accueille les rives étaient garnies de Dahoméens qui, sans notre service de sûreté, massacraient la colonne. Les trois compagnies se déploient et concentrent leurs feux sur le gué l'artillerie vient prendre position à leurs côtés et couvre le fleuve de ses projectiles. Profitant du désarroi jeté dans les rangs ennemis, les compagnies de marsouins se précipitent en avant et passent le gué sans trop de résistance. Une section de la légion ainsi qu'une pièce de canon passent également, ce qui achève de mettre en déroute les Dahoméens.
;
;
La colonne arriva alors et put traverser le Koto sans incident; ce combat nous coûtait seulement deux tués et douze blessés, mais les résultats de notre victoire étaient importants, puisqu'ils amenaient ainsi le colonel Dodds au cœur du Dahomey.
TONKIN PREMIÈRE PRISE D'HAJNOÏ (20
novembre 1873).
Le lieutenant de vaisseau Francis Garnier. Un négociant français, M. Dupuis, établi depuis longtemps au Yunnam, fut chargé, en 1872, par le maréchal gouverneur de cette province, de lui procurer des armes et des munitions pour lui permettre de continuer la lutte contre les rebelles du Kouang-Si. Dupuis résolut de se servir, pour aller à Hong-Kong, d'une nouvelle voie fluviale reconnue depuis peu par des missions, le Fleuve Rouge, qui conduisait directement à la mer. Des difficultés avec les mandarins annamites, à propos du passage de ses navires, chargés de sel, qu'il ramenait au Yunnam,l'immobilisèrent à Hanoï où sa flotte fut séquestrée. Notre compatriote s'adressa alors au gouverneur de la Cochinchine, qui lui envoya un lieutenant de vaisseau, Francis Garnier, avec mission de faire une enquête sur les faits qu'il avançait. On dit que des instructions secrètes enjoignaient à Garnier de se servir du prétexte pour faire ouvrir le Fleuve Rouge à la navigation européenne. Quoi qu'il en soit, Francis Garnier arriva à Hanoï le 5 novembre 1873; il s'installa avec son escorte, à proximité des rives du fleuve, dans le Camp des Lettrés. Les autorités refusant de l'entenannamites lui suscitèrent mille ennuis, dre, l'empêchant de se ravitailler, etc. Francis Garnier essaya par tous les moyens de faire relâcher Dupuis et ses navires et de faire ouvrir le pays au
commerce et à la civilisation; les mandarins firent la sourde oreille, devinrent agressifs, menaçants et firent de grands préparatifs de défense. Garnier fit un coup de maître. Il déclara le fleuve libre et demandait le désarposa un ultimatum le 19 novembre. mement de la citadelle, l'ouverture officielle du fleuve Rouge et la permission pour Dupuis de rentrer librement en Chine; le dernier délai était fixé à six heures du soir. Il déclarait, en outre, qu'à défaut de satisfaction, attaquerait la citadelle le lendemain matin. Il exécuta ponctuellement ce qu'il avait conçu. Quel courage ne fallait-il pas avoir pour se lancer dans une équipée qui pouvait tourner mal, eu égard à la disproportion des forces! Un lieutenant de vaisseau, avec 180 hommes, à 3.000 lieues de la Patrie, isolé dans une ville de 80.000 habitants, donnant l'assaut à un fort de 5 à 6 kilomètres de tour, garni de murs épais et hauts, de fossés, de glacis, de canons, gardé par une armée de 3.000 hommes ! C'était fou, mais bien français Le plan de la ville avait été dressé assez exactement par le lieutenant d'infanterie de marine de Trentinian, commandant le détachement d'infanterie de marine; on put donc repérer le tir pour les canonnières ancrées en face du port. Les troupes furent sur pied à quatre heures du matin et formées aussitôt en deux colonnes: lapremière, commandéeparM. Bain delà Coquerie,enseigne de vaisseau,comprenant30hommes et une pièce de montagne du Décrès; elle devait attaquer la porte sud-ouest de la citadelle. C'était une fausse attaque. La seconde comprenait 25 soldats d'infanterie de marine et 2 gabiers armés de grenades et de haches, sous les ordres du lieutenant de Trentinian. Un détachement de 29 marins, avec 3 pièces de 4 et leurs servants, sous les ordres de l'en-
Il
il
!
<
seigne de vaisseau Esmez, enfin 19 hommes du Bécrès; elle devait attaquer la porte du sud-est. Le camp, gardé par 10 hommes, restait sous lé commandement de Fingénieur Bouillet; l'enseigne de vaisseau Balny d'Avricourt commandait en rade. Tout ainsi minutieusement réglé, l'exécution fut rapide. Les canonnières Scorpion et Espingole, embossées à 1.200 mètres de distance donnèrent aux troupes un excellent appui, en intimidant outre mesure une garnison peu habituée à semblable épreuve. Dès les premiers pas, l'élan fut superbe. Les ponts furent passés rapidement et les chevaux de frise qui les défendaient servirent aux gabiers comme échelles d'assaut; les redans des portes furent pris en un clin d'oeil. Garnier constamment le premier, animait les hommes et leur criait En avant, mes enfants ! Il fut superbe de bravoure et de sang-froid. L'ennemi surpris fut d'abord rallié par le maréchal Mà, mais celui-ci blessé à la cuisse et transporté dans sa demeure, les soldats se^débandèrent pour se réfugier sous les portes. Aussitôt entrés dans la citadelle, nos hommes hissèrent le drapeau tricolore au sommet de la tour; il était sept heures moins cinq.L'action avait duré une heure. Plus de 2,000 hommes étaient prisonniers, paralysés par la peur, s'attendant à être massacrés; mais Francis Garnier qui avait pénétré révolver au poing par la brèche, avec de Trentinian, leur fit signe de déposer leurs armes, ce qu'ils accomplirent rapidement, se prosternant et implorant leur grâce. La victoire était complète. Une quantité prodigieuse d'armes tombait ainsi en notre pouvoir; des milliers de kilos de poudre, des éléphants, des chevaux, des canons, dés vivres, etc., étaient notre butin. Pourtant Francis Garnier sembla le soir envisager l'avenir
:
:
Si je ne meurs, dit-il, c'est un riche et florissant pays dont j'aurai ouvert l'accès à nia patrie. Pourvu que l'on me «
soutienne ! » On sait qu'il fut presque désavoué malgré ses prodigieuses victoires et que faute d'être soutenues, nos troupes durent évacuer le Tonkin. Pour le reconquérir en 1884 et 1885 combien ne fallut-il pas d'hommes là où une poignée de braves avait suffi dix ans plus tôt!
DAHOMEY
ARTAQUE ET DÉFENSE DE KOTONOU (3
et 4 mars 1890).
Le lieutenant Compérat.
En 1890, à la suite de la violation du traité.qui le liait avec nous, Behanzin, roi du Dahomey, avait envahi les états de notre protégé le roi Toffa, s'emparant de plusieurs agents des factoreries et les envoyant en captivité. Le commandant Terrillon chargé de conduire l'expédition nécessaire pour mettre le roi nègre à la raison, après avoir repoussé plusieurs attaques aux environs de Kotonou, s'était retranché fortement dans cette ville située sur le bord de la mer. Les ennemis se trouvaient massés aux environs, recevant des renforts continuellementet resserrant le blocus. Le 3 mars au soir, Terrillon prévenu par des espions qu'une attaque était imminente prit ses dispositions de combat. Les avant-postes reçurent l'ordre d'exercer une surveillance toute particulière; les sentinelles avaient été supprimées en raison de la nature du terrain couvert de broussailles dans lesquelles les nègres pouvaient ramper et enlever les hommes isolés. Tous les hommes veillèrent par bordées : de sept heures du soir à dix heures, un tiers de l'effectif, de dix heures à une heure du matin, un autre tiers, de une heure à quatre heures, l'autre tiers. A quatre heures tout le monde debout était à son poste. Un orage épouvantable marqua la nuit du 3 au 4 mars, éclairs, coups de tonnerre, vent terrible, rien n'y manqua; ce fut une véritable tempête.
Les Dahoméens profitèrent du bruit de l'orage et des ténèbres de la nuit pour se rapprocher des lignes sans être aperçus. Vers quatre heures, il y eut une accalmie. La lune apparaissait et disparaissait derrière les nuages épais, puis disparut tout à coup complètement. Les hommes faisaient bonne garde derrière les simples haies entourant la factorerie. A quatre heures quarante-cinq, le lieutenant d'infanterie de marine Compérat, qui était de garde avec une section de la compagnie gabonaise et une pièce de quatre dans un fort en construction sur la lagune qui fait communiquer le lac Nokoué à la mer et chargé de surveiller une forêt aux arbres touffus, entendit un bruit étrange, bizarre, qui paraissait se rapprocher. Vainement il essaie de voir, l'obscurité ne le lui permet pas. C'étaient cependant les ennemis qui rampaient dans- les herbes. Il prévient aussitôt ses hommes à voix basse et les fait abriter derrière une barricade composée de troncs d'arbres empilés. Tout à coup, à dix pas des remparts, des masses de Dahoméens dressent en poussant des clameurs et excités par les grelots des féticheurs. En avant marchent les amazones, leur colonelle en tête. Un feu de salve exécuté aussitôt avec calme arrête le premier élan et le canon de quatre envoie une volée de mitraille : une minute d'inattention et c'en était fait de cette vaillante troupe; le bastion est vivement entouré, deux français sont tués, sept gravement atteints en un clin d'œil; lepointeur est tué par une amazone. Lecommandant Terrillon qui se trouvait alors en route pour visiter précisément les avant-postes fait donner l'ordre
----
sè
au croiseur Sané se trouvant en rade de tirer ses gros boulets et ses balles de canons revolvers fouillent les bois en avant de nos lignes. Il y avait dans cette première colonne d'attaque un régiment d'amazones et neuf cents guerriers, mais une seconde colonne de mille à douze cents hommes débouche vers la droite de nos positions et s'élance aussi sur nos hommes. Au centre, pas un ennemi. Le capitaine Oudard qui s'y était porté y resta pendant tout le combat, l'arme au pied, lié par des ordres formels pour empêcher que les Dahoméens ne vinssent couper notre ligne et nous prendre entre leurs feux. L'attaque fut terrible; l'escalade est tentée, la bravoure des Dahoméens est extraordinaire; on tue les ennemis sur les palanques. Le lieutenant Compérat, blessé de trois balles dont une lui a brisé l'omoplate, est sublime de courage et d'énergie. Il excite ses hommes, les encourage et se fait soutenir par un homme; il dit à un sergent qui, blessé de deux balles, lui demandait d'aller se faire panser « Restez à votre place, moi aussi je suis blessé et je ne dis rien. » Trois hommes sont tués, huit blessés, le petit poste va succomber quand arrive enfin la 4e compagnie de tirailleurs sénégalais qui se précipite baïonnette au canon sous les ordres du capitaine Pansier et du lieutenant Lagaspie. le sergent A gauche les affaires étaient bien compromises Albert commandant l'avant-poste, au lieu de se défendre à outrance cherche à se replier sur les réserves. Heureusement à ce moment la 2e compagnie de tirailleurs sénégalais sous les ordres du capitaine Lemoine arrive en ligne et à dix pas, par un feu nourri, refoule les masses dahoméennes qui s'étaient ruées sur cette poignée de braves. Une mêlée furieuse s'engage, quelques Dahoméens se couchent pour laisser passer la charge puis se relèvent et fusillent dans le dos nos
:
:
tirailleurs. Une section fait alors demi-tour et par un feu violent les met hors de combat. Le jour étant venu, le capitaine Oudard peut alors prendre de nouvelles dispositions, diviser sa troupe et prendre les ennemis entre deux feux; l'ennemi fuit de toutes parts. Vers six heures un retour des Dahoméens est repoussé vigoureusement; quelques minutes plus tard les ennemis se reforment et essayent de se rapprocher de nos lignes, mais les pièces du croiseur et les pièces établies au centre par le capitaine Septans les dispersent aussitôt. Ce n'est pourtant que vers neuf heures et demie que les Dahoméens disparaissent complètement et que les Français peuvent se reposer. L'ennemi laissait sur le terrain cent vingt-sept morts dont sept amazones et, aux environs du poste, encore une centaine de cadavres. D'après les espions, il y eut dans cette affaire deux cent cinquante morts et quatre cents blessés. Malheureusement nous avions, de notre côté, huit tués, dont le maréchal des logis Moreau etl'artificier Gallois; vingt hommes avaient reçu des blessures assez graves. Le commandant des troupes félicita énergiquement les défenseurs. « Il faut avoir assisté à ce combat soutenu au milieu des ténèbres contre des ennemis nombreux et vigoureux, dit Terrillon dans son ordre du jour, pour apprécier l'énergie déployée par ce petit noyau d'hommes dont le moral fut à la hauteur de la situation critique qu'il a traversée. » Naussica, l'amazone préférée du roi Glé-glé, qui avait dansé devant la mission française quelque temps auparavant, était parmi les morts. Le fort terminé- à cette place s'appela fort Compérat pour honorer le brave officier qui, par son courage et son sangfroid, sut sauver nos hommes d'un massacre certain et épargner à notre drapeau un grave échec.
TCHAD
COMBAT DE KOUSSOURI
(22 avril 1899)
Mort de Rabah. — Mort du commandant Lamy et du capitaine de Cointet Depuis longtemps une colonne était lancée à la poursuite de Rabah. Après un repos de quelques jours à Koussouri, nos troupes décidèrent une attaque générale de la position du - sultan noir. Les forces, sous les ordres du commandant Lamy, comprenaient trois cent quarante fusils de la mission du Chari, cent soixante-quatorze de la mission de l'Afrique centrale, deux cent soixante-quatorze de la mission saharienne, trente chevaux des spahis, trois pièces de quatre-vingt et un canon à tir rapide de quarante-deux. Le 22 au matin, la marche commence- sur trois colonnes, les auxiliaires bornouans et baguirmiens à mille cinq cents mètres en arrière. Nous laissons maintenant la parole au capitaine de Lamothe qui fut un des acteurs de cette journée. a Rabah s'était installé à cinq kilomètres environ en aval de Koussouri, sur la berge même du Chari, au milieu d'une épaisse forêt de mimosas, gommiers et autres arbustes épineux. Son camp, de forme ovale, était défendu par une enceinte palissadée, mais moins forte et moins solide que celle de Kouno. Les abords avaient été dégagés, dans un rayon de huit cents mètres environ. Cinq à six mille personnes s'y trouvaient réunies, dont quinze cents armées de fusils. Il
avait encore ses trois pièces de quatre, mais n'avait pu remplacer son grand maître de l'artillerie, tué à Kouno. « Vers sept heures et.demie, Joalland engage le combat. Il rencontre une très vive résistance; il est immobilisé. Les troupes du Chari et l'artillerie sont portées sur la ligne de feu qui se trouve ainsi constituée, en commençant par la droite La mission Joalland, les compagnies Galland et de Cointet, l'artillerie,. ma compagnie. La Saharienne n'est pas encore arrivée. La fusillade est très nourrie, mais l'ennemi ne se sert que peu de ses canons. Il tente une sortie par la droite de la position, nos feux et ceux d'une section algérienne, qui vient de déboucher la repoussent. Un dernier bond nous porte à soixante-dix mètres du tata. Le commandant voudrait attendre l'entrée en ligne de la Saharienne, mais déjà nos Sénégalais ont entonné leurs chants de guerre. La charge sonne, ils s'élancent. « J'ai la joie de voir ma compagnie pénétrer la première dans le tata. A coups de baïonnette, nous nous frayons un passage à travers la foule des Rhabistes terrorisés. Dédaignant de ramasser, faciles trophées, les étendards, alors plantés autour d'un arbre, nous nous précipitons vers l'enceinte opposée. L'ennemi s'entasse pêle-mêle contre la palissade. Les cadavres s'amoncellent, la boucherie est affreuse. « Nous sortons enfin de cet enfer, fusillons, à bout portant, ceux de nos adversaires qui essaient de garnir, de l'extérieur, la fortification et je rallie mes hommes à deux cents mètres du tata, sur la lisière de la bande boisée qui borde le Chari. « Presque en même temps que nous, les 1re et 2e compagnies entraînées par le capitaine Robillot ont franchi l'enceinte. Le commandant les suit à cheval, avec son aide de camp, M. de Chambrun et son escorte de spahis. Mais, devant elles, la palissade opposée se garnit de fusils. Les Rabhistes ont tenté un dernier effort. Une décharge éclate, le capitaine de Cointet
:
est tué raide, le commandant et de Chambrun sont blessés. « Le retour offensif est vite repoussé et l'ennemi fuit de toutes parts. Il tombe sous les fusils de la colonne de gauche, qui le coupe du Chari et le poursuit, pendant trois kilomètres, dans la direction de Koussouri. « Illaissait un millier de cadavres sur le terrain, ses étendards et ses canons. Le combat n'avait pas duré trois
!
heures
:
Assis sous un grand arbre, nous déjeunions, quand deux tirailleurs s'avancent et nous disent « Rabah est mort. — Qu'on l'apporte, répond M. Gentil », et quelques instants après, la tête et la main droite du conquérant gisaient devant nous. « A la vue de cette tête exsangue, aux yeux crevés, une grande pitié nous prit. Certes, cet homme avait été pour nous un ennemi implacable; il avait semé partout la désolation, l'épouvante et la mort, mais nous ne pouvions avoir que de l'admiration pour son courage, son énergie, sa vaillante défense. « Quand on songe que d'abord simple chef de bandes de Zoubir et de Soliman, il était parti des bords du Nil avec quelques compagnons, qu'il avait su faire un tout discipliné de ces hordes de brigands, qu'il avait conquis le vieil et riche royaume du Bornou, qu'il faisait trembler le Sokoto et le Ouaddaï et que son rêve lui faisait entrevoir un vaste empire, allant du Niger au Nil, quand on songe à l'organisation qu'il sut donner aux peuples soumis, à la prospérité qu'il fit régner chez eux, à la régularité età la justice relatives de son administration, on est obligé de reconnaître, qu'il était de la race des grands conducteurs d'hommes. « Sa mort rendait notre victoire décisive: mais, le commandant Lamy mortellement blessé, le capitaine de Cointet tué, c'était la payer bien cher. » «
Les lieutenants Meynier et de Chambrun étaient gravement blessés, le lieutenant Galland et le capitaine de Lamothe légèrement touchés. Le commandant Lamy rendit le dernier soupir pendant le retour sur Koussouri où les honneurs militaires lui furent rendus ainsi qu'aux braves tombés à ses côtés.
MADAGASCAR
ATTAQUE DE FARAFATE (10
septembre1885).
Mort du lieutenant Lubert. Le corps expéditionnairede Madagascar s'empara, en 1885, de Diégo-Suarez, mais depuis deux ans nos troupes manquaient d'une direction unique qui pût donner de l'impulsion à leurs opérations. Par suite de lapaix signée avec la Chine, quelques renforts purent être envoyés dans la GrandeIle, et l'amiral Miot crut que cela lui suffirait pour enlever les retranchements deFarafateélevés autour de la ville de Tamatave.
Laposition était
,
formidable et, depuis l'année précédente les Hovas avaient accumulé en cet endroit les difficultés les plus grandes. Deux rivièL'Amiral Miot. res parallèles longent le pied des collines à l'ouest de Tamatave, formant un immense fossé naturel de 18 kilomètres. Quatre gués permettaient le passage, ils étaient garnis de solides ouvrages; des V
redoutes, des palissades, des abris casematés étaient, en outre, disséminés tout le long de la position. Le 10 septembre 1885, à cinq heures du matin, la colonne d'attaque, composée de 1.200 hommes et de 3 batteries d'artillerie, se met en marche et se dirige sur le gué de Sahamafy, à la droite de l'ennemi. Pendant que les canons de la flotte couvrent de leurs feux les hauteurs, la compagnie de débarquement de la Naïade simule une attaque sur la gauche. A neuf heures, le capitaine de frégate Laguerre, qui commandait l'avant-garde, est assailli par un feu très vif de mousqueterie partant d'un fort situé à 600 mètres environ, au delà d'un marais qui paraît infranchissable. Des renforts sont envoyés à cet officier les pièces se mettent en batterie et ouvrent le feu à leur tour. Elles sont aussitôt couvertes d'une grêle de balles qui malheureusement font des victimes dans la première section, le lieutenant Lubert est mortellement blessé, le maréchal des logis Jacquintué, plusieurs servants atteints; dans la seconde section, le capitaine Silvain est blessé, un matelot est tué. En outre, un afIÙt de 4 est brisé, un canon de 80 mis hors de service. Les autres pièces ripostent bravement. En plus de deux heures, elles envoient 325 obus sans grands résultats, ce que l'expédition prit le parti de renvoyant, le commandant trer à Tamatave. Les Hovas se mirent à la poursuite de nos troupes, ils furent heureusement arrêtés dans leur élan et nous laissèrent opérer la retraite en bon ordre. Cet échec,qui nous coûtait 2 tués et31 blessés, enhardit les ennemis qui, par deux fois, les 11 et 14 septembre, vinrent attaquer, à leur tour, la ville. Ils ne purent réussir dans leurs assauts et se retirèrent dans leurs anciennes lignes.
;
;
-
de
HAUT-SÉNÉGAL.
PRISE DE GOUBANKO (12 février 1881).
;
Le capitaine du Demaine
mort du capitaine Pol.
Voulant continuer l'œuvre de pénétration entreprise par ses prédédesseurs, le lieutenant-colonel Borgnis-Desbordes, de l'artillerie de marine, nommé commandant supérieur du Haut-Sénégal, organisa une nouvelle expédition. La colonne composée de 424 combattants, dont 156 Européens, 18 officiers, de 4 canons, 355 conducteurs et âniers, 452 animaux divers, partit de Médine le 9 janvier 1881, après avoir éprouvé, pendant la concentration, de grandes pertes à la suite d'une épidémie de fièvre typhoïde. Un poste fut installé à Kita, mais un repaire de bandits existant un peu au delà, à quelques kilomètres du village de Goubanko, le colonel résolut de le détruire avant de pousser plus avant. Le 12 février, nos troupes arrivaient devant le tata. L'enceinte de Goubanko était constituée par une muraille en argile ferrugineuse ayant la forme d'un vaste rectangle avec portes fortifiées, créneaux et plateformes pour le tir. Deux fortes traverses en argile partageaient le village en deux enfin un fossé à pic entourait l'enréduits indépendants ceinte extérieure. L'attaque de cette formidable position commença au point du jour à dix heures, les obus mettaient le feu aux habitations, alors que le mur restait toujours debout. « Les projectiles allaient manquer, dit un témoin; il ne
;
:
restait que onze obus. Le capitaine du Demaine, qui dirigeait le feu de l'artillerie, offrit de faire brèche à la pioche héroïsme qui d'ailleurs fut heureusement refusé, car la muraille tomba enfin laissant une large brèche de15 mètres de largeur. » Le chef de bataillon Voyron conduisit alors à l'assaut les tirailleurs, soutenus par les ouvriers d'artillerie, commandés par le capitaine Archinard. La lutte fut terrible pendant deux heures, on se disputa pied à pied la possession de la ville. Le commandant Voyron, les capitaines Archinard, Pujol, Monségur firent des prodiges les défenseurs vendirent chèrement leur vie et n'abandonnèrent les murailles opposées qu'à la dernière extrémité. Pendant cette bataille de rues, le capitaine d'artillerie de marine Pol, officier du plus grand avenir, fut mortellement
;
:
:
blessé.
-
Mon colonel, dit-il à Borgnis-Desbordes, je meurs en soldat. Je n'ai qu'un regret, c'est de tomber sous les coups des noirs, car ce n'est pas ici que j'aurais voulu donner ma vie. * Le combat se termina à midi et demi. Nos pertes étaient de 1 officier tué, 5 hommes tués et 24 blessés. La prise de Goubanko produisit un effet considérable dans la contrée elle parut si merveilleuse aux yeux des Sénégalais, que personne ne voulut d'abord y croire: l'almanyde Mourgoule fit mettre aux fers le premier qui vint la lui «
;
annoncer.
SOUDAN.
CAPTURE DE SAMORY (29
;
Le sergent Bratières
le
septembre 1898).
lieutenant Jacquin.
Un des faits les plus importants de la conquête du Soudan français a été sans contredit la capture de Samory, qui depuis si longtemps tenait nos troupes en échec et qui coûta à la France tant de morts et de sang. Nous laissons la parole aux deux acteurs principaux de de cette brillante affaire le lieutenant Jacquin et le sergent
:
Bratières : « La colonne sortait le 13 septembre de Beyla, écrit le lieutenant, et comme il est absolument impossible de transporter l'artillerie dans un pays semblable, comme d'un autre côté j'avais manifesté hautement et à plusieurs reprises mon désir de partir en colonne, le commandant de Lartigues m'avait pris comme officier adjoint; j'étais d'avance bien décidé à lâcher ces fonctions pour d'autres un peu plus actives. Le 15 septembre, nous recevons les nouvelles suivantes « Le lieutenant Wœlfell avec 180 hommes avait attaqué « Samory à douze jours au sud de Beyla, au passage de « Diougou, et lui avait fait 5.000 prisonniers. Les jours sui« vants, 25,000 autres personnes étaient venues faire leur L'affaire s'annonçait donc à merveille. Sa« soumission. mory, effrayé par cet échec, faisait demi-tour et se rejetait vers le nord-est. N'zo, nous y faisions notre jonction avec «. Arrivés le 21 à le lieutenant Wœlfell et le. capitaine Gaden. Immédiatement
:
»
:
!.
Voici la comon formait une colonne volante et en avant position de la colonne (Gour,aJet Gaden); 2 lieutenants Jacquin « 2 capitaines etMangin); un médecin de colonies (Boyé); 4 sous-officiers européens et 210 tirailleurs. Nous étions dans la forêt vierge depuis quatre jours et « nous allions encore nous y enfoncer davantage. Le 26, nous trouvons des déserteurs qui nous apprennent que Samory est à trois jours au sud et qu'il est disposé à y rester. Nous arrivons en effet à son campement, mais il est abandonné et il n'y reste que des malheureux affamés qui mangent les plus faibles pour vivre le 28 au soir nous trouvons un canon et le harnachement de Samory. Un prisonnier arrêté le soir nous dit que le matin même Samory était encore à trois heures de marche à l'est avec toutes ses troupes on décide de l'attaquer le lendemain même et de le poursuivre s'il
;
;
s'enfuit. «
Par bonheur, c'était à mon tour d'être à l'avant-garde.
-
Le 29, vers huit heures du matin, nous débouchons dans une immense clairière, coupée par une colline au-dessus de laquelle s'élevait une énorme fumée. Le campement de Samory se trouvait derrière. A huit heures trente, nous traversons deux marigots, le premier à bords escarpés, le second moins profond et entouré d'une foule de femmes etd'enfants en train de se laver. Sans leur donner le temps de s'enfuir, je fais prendre le pas gymnastique à ma section et nous tombons au beau milieu d'un petit village où sont logées les femmes de Samory; elles ont aux oreilles et au cou de gros bijoux. Craignant de voir mes tirailleurs se débander pour piller, je fais accélérer la course et, traversant un petit bois épineux, nous arrivons au campement des sofas. « Figurez-vous une plaine de deux kilomètres couverte de cases improvisées et au milieu de laquelle grouille une foule
:
immense de femmes, d'enfants, de guerriers ça et là des bœufs et des chevaux. « C'était se fourrer dans la gueule du loup. donc il fallait lui prendre la langue pour l'empêcher de mordre. « En un clin d'œil nous avions traversé le marché où notre irruption avait produit un méli-mélo inouï. mais mon guide « Je devais occuper la route de Miaout s'étant esquivé dans la bagarre, j'avise en chemin un grand escogriffe de marabout, et à coups de crosse de revolver, je le force à me désigner la case de Samory. » Voici le récit de la capture « Ce n'est qu'à 100 mètres, écrit à son tour le sergent Bratières, que l'almany aperçoit les Français. « Lui aussi est surpris; sa première pensée est la fuite. On le voit courant entre les cases la tête coiffée d'une chéchia sur laquelle est enroulé le turban blanc, apparaît toujours et nous sert de point de mire. Après avoir traversé son campement, il cherche à prendre la route et s'engage dans un petit bois. C'est là que trois tirailleurs lui barrent le passage et que je lui mets la main dessus. C'est un homme fou il crie, il gesticule, il m'entraîne du côté du campement, demandant à être tué devant sa case.' Le lieutenant Jacquin arrive avec la section à ce moment; je lui remets mon pripromet la vie sauve à la sonnier. Le capitaine Goureau condition que ses deux fils, quisont en avant-garde, se rendront immédiatement. Une heure après, toute l'armée de Samory était en notre pouvoir 400 fusils à tir rapide, 2 ou 3.000 fusils à pierre ou à piston, 83 caisses de cartouches, le trésor. » Ce coup de force eut un retentissement considérable ses deux auteurs reçurent une récompense méritée et l'almany fut déporté comme l'avait été autrefois Behanzin.
;
:
;
:
lui
:
;
AFRIQUE CENTRALE
DIKOA (1901)
Le lieutenant Dupertuis.
Après le sanglant combat de Koussoury (avril 1900) dans lequel Rabah fut tué, il fut décidé qu'une expédition commandée par le colonel Destenave organiserait le protectorat du Baguirmhi et occuperait le Kanem menacé par les Touaregs, auxiliaires de Fad-el-Allab, fils de Rabah, animé pour nous de la même haine que son père. Grâce à une organisation parfaite, et à une énergie inlassable, la colonne Destenave réussit pleinement dans la mission qui lui avait été confiée. Il fallait, en présence des difficultés incroyables amoncelées sur sa route, avoir le diable au corps pour réaliser les prodiges accomplis par cette vaillante petite troupe. 1 Après l'assaut de Dikoa, donné par la colonne Destenave, Fad-el-Allah, épouvanté, prend la fuite. Son armée, en débandade, se sauve. Les nôtres poursuivent hardiment les rabhistes. A l'avant-garde de la colonne se trouve le lieutenant Dupertuis, avec un sous-officier, un brigadier sénégalais et quelques hommes. Le lieutenant, le sous-officier et le brigadier, tous trois possédant d'excellentes montures, atteignent bientôt l'arrièregarde de l'armée de Fad-el-Allah, mais ils ne s'aperçoivent pas que les cavaliers français ne les suivent que de très loin. A la vue de l'officier, seul avec ses deux auxiliaires, le chef
des troupes rabhistes, un géant nommé Hitt, qui couvrait vaillamment la retraite avec les meilleurs guerriers de Fadel-Allah, se retourne et, soutenu par deux de ses soldats, engage avec les trois Français une lutte homérique. Bientôt les deux cavaliers rabhistes gisent à terre, tandis que le sous-officier français est tué et le brigadier grièvement blessé reste étendu sous son cheval. Hitt, le géant, se voyant seul à seul avec l'officier français, descend de cheval et met en joue le lieutenant Dupertuis qui, armé d'une lance, fonce sur son ennemi. Hitt tire, mais le coup manque et il reçoit au côté un coup de lance qui ne le blesse que légèrement, protégé qu'il est par une épaisse cartouchière. Le lieutenant Dupertuis revient à la charge. Hitt saisit la lance de l'officier, jette celui-ci à terre et veut se servir de son pistolet; de nouveau le coup manque! Dupertuis court à son cheval, s'empare de son sabre et revient sur le géant qu'il atteint peu grièvement. Ce dernier prenant alors sa carabine par le canon, la lève sur la tête du lieutenant qui pare le coup; mais Dupertuis a la garde de son sabre écrasée. L'officier évite un deuxième coup un troisième lui casse l'épaule. Il allait succomber lorsqu'il parvint à dégager son révolver, et, tandis que Hitt s'apprêtait à lui donner le coup de grâce, il lui envoie, à bout portant, deux balles dans l'abdomen. Le géant Hitt expirait sur-le-champ. Le lieutenant Dupertuis reçut la croix de la Légion d'honneur pour sa brillante conduite.
;
TONKIN.
COMBATS ET
PRISE DE LANG-MAN (octobre 1895-février 1896).
Le commandant Briquelot.
Des bandes de rebelles s'étant réfugiées dans le cercle de Ha-Giang, du 3e territoire militaire, en 1895, le commandant Briquelot, de l'infanterie de marine (3e tonkinois), fut envoyé à leur poursuite. Li-Chi-Tuan, le chef des pirates, avait établi son repaire dans les rochers de Lang-Man, véritable forteresse naturelle. Le 22 octobre, le commandant Briquelot fractionne ses forces en trois groupes, franchit la Rivière Claire au moyen de radeaux et, vers dix heures du matin, arrive en face des positions ennemies. On ne pouvait songer à enlever de vive force l'entassement de rochers formant le massif, aussi Briquelot établit un camp fortifié dans la plaine et harcèle les pirates journellement, les tenant en éveil en leur envoyant des bordées de coups de canon. Un ouvrage palissadé ayant été construit par l'ennemi au sommet d'une colline de 300 mètres, à pentes raides, 45 tirailleurs et 45 miliciens se lancent une nuit à l'assaut et sont assez heureux pour en chasser les défenseurs. Nos braves auxiliaires rapportèrent même les chevelures des morts pour s'en servir de trophée. Les pirates revinrent en janvier; le colonel Vallière chargea
le commandant Briquelot d'en finir une bonne fois avec ces
bandits. Le 9 février, le commandant fit escalader les hauteurs à ses troupes; le lendemain, à l'aide de cordes et au risque de se rompre les os, nos tirailleurs pénétrèrent dans les positions des rebelles évacuées depuis la veille, mais, à 1 heure, ils se heurtèrent à de nouvelles défenses dont les approches étaient semées de blocs de pierres, d'abatis, d'arbres, etc. Tout à coup, sur la droite, une fusillade éclate à travers les éboulis, de grosses pierres sont lancées du haut des rochers à pic qui bordent le sentier et pendant tout l'aprèsmidi on combattit dans cette position périlleuse. Le vacarme des feux, les hurlements des pirates, les cris des blessés, les appels des trompes de guerre, tous ces bruits divers emplissaient l'air, répercutés par les hauteurs et la cacophonie qui en résultait ajoutait encore à l'horreur du combat. Les légionnaires furent d'une bravoure à toute épreuve, les tirailleurs les imitèrent de leur mieux, aussi, vers le soir, les pirates débordés et tournés renoncèrent à la lutte et prirent la fuite dans toutes les directions, abandonnant leurs morts et leurs blessés. Malheureusement, cette expédition pénible épuisa le commandant Briquelot, qui mourut le 22 avril suivant avant d'avoir pu recueillir tous les fruits de sa bravoure. C'était une grande perte pour l'arme de l'infanterie de marine.
SÉNÉGAL.
COMBATS DE KOKONNA ET DE DIAMONKOS
(8 et 9 avril 1891).
Mort du lieutenant Orsat. — Le sergent Coweley. Continuant, pendant l'expédition 1890-1891, sa campagne contre Samory, le colonel Archinard battit d'abord, et définitivement Ahmadou, à Youri (3 janvier) puis, partant de Segou, se jeta sur les contingents de l'al-
many, concentrés dans la vallée du Milo, affluent de droite du Niger, à proximité de notre poste deSiguiri. Notre colonne prit contact avec les sofas, deux jours avant d'arjriver à Kankan, grand village de 8.000 habitants qui fut incen-
, Le colonel Archinard.
dié. Le colonel Archi-
nard, épuisé par des accès de fièvre bilieuse hématurique, se décida à rester dans cette place avec 2 compagnies et 6 pièces de montagne et lança une colonne composée de 3 compagnies de 120 hommes et 2 pièces de montagne sous le
commandement du capitaine Hugueny, de l'infanterie de marine, sur la capitale de Samory, Bissandougou. Le capitaine Hugueny marchait le 8 avril sur Sana quand dans un pays très couvert, vers les 11 heures, une fusillade très vive partit du village de Kokonna. Laissant passer les spahis de pointe d'avant-garde, les sofas avaient tiré à bout portant sur la tre compagnie. Le combat s'engagea et l'ennemi fut vivement délogé après avoir subi des pertes sérieuses, malheureusement nous avions le sous-lieutenant Orsat, tué d'une balle en plein cœur, 1 tirailleur tué, 1 capitaine et 1 tirailleur blessés. Les morts et les blessés sont placés sur des civières puis la colonne reprend sa marche, harcelée par des sofas cachés dans les hautes herbes. Le 9, la 6e compagnie, capitaine Arlabosse, est placée en avant-garde, ayant avec elle les spahis, une section de la 7e compagnie et une section d'auxiliaires. Dans la matinée, l'ennemi est signalé; d'ailleurs, en se retirant, il incendie les villages, jalonnant ainsi la route de nos soldats. A Diamonkos, derrière un ruisseau encaissé et aux abords couverts, les noirs apparaissent. L'avant-garde se déploie aussitôt, se porte au pas de charge vers le cours d'eau, qu'elle traverse sans perte et enlève la lisière du bois. Le sergent Coweley a l'omoplate traversée, quelques pas plus loin une balle le frappe à la tempe et l'étend raide mort; un autre sergent indigène est tué à ses côtés. Les sofas reculent lentement; à 3 heures, la colonne arrive à Bissandougou, mais ce n'est plus qu'un amas de ruines fumantes, la mission est donc terminée. Le lendemain, le capitaine Hugueny fait reprendre la marche pour retourner à Kankan; au cours de la route, grâce à une compagnie de renfort qui lui a été envoyée, il réussit
enfin à prendre contact avec les sofas et à les écraser complètement. Samory s'enfuit dans le sud. Le 11, la colonne était de retour auprès du colonel
Archinard.
TONKIN
ATTAQUE D'HANOÏ (21
décembre 1873)
Mort de Francis Garnier et de Balny d'Avricourt Pendant que Francis Garnier partait pour conquérir le Delta du Tonkin, Hanoï était resté sous la garde de M. Bain. Les choses ne tardèrent pas à se gâter. L'ennemi commença d'abord à reprendre le fort de PhuHoaï, un avant-poste de Hanoï; l'aspirant Perrin essaya en vain de le reprendre, ce fut notre premier échec. Francis Garnier revint sur l'Espingole le 18 décembre; il conçut le projet de reprendre le fort en l'assurant entre trois feux, malheureusement, on ne lui en laissa pas le temps. Le 21, dimanche, après la messe, la garnison française s'était répandue dans les casernements pour prendre le repas du matin. Garnier se trouvait avec ses officiers chez l'évêque Mgr Puginier. Tout à coup, un interprète se précipite en
:
criant
La citadelle est attaquée ». Le rassemblement s'opère aussitôt; les marins prennent les armes et Perrin se dirige vers le bastion menacé tandis que Bain surveille les autres faces de la citadelle. A son tour, Garnier monte sur la porte faisant face à l'ennemi. Sur les chaussées des rizières, les bannières s'agitent; les Annamites braquent quelques pierriers sur les remparts et commencent un feu d'enfer, heureusement peu redoutable. —
«
Les mandarins avec leurs éléphants sont en arrière, à courte
distance. Garnier cherche à calmer l'émotion autour de lui « Ce ne sera rien, crie-t-il; bon courage » Il fait aussitôt avancer une pièce de 4, dont les projectiles forcent les Pavillons Noirs à rebrousser chemin. Le mouvement de retraite s'accentue rapidement; les rebelles prennent deux routes, l'une allant vers Phu Hoaï, l'autre longeant l'enceinte d'Hanoï jusqu'à Thu-lé pour se diriger ensuite sur le même point. «Il faut les poursuivre, déclare Francis Garnier, pour ne pas les laisser s'abriter derrière ces digues d'une longueur de 1200 mètres. » Balny partit alors avec 12 hommes de l'Espingole et suivi de miliciens tonkinois vint se placer en dehors des parapets devant le point attaqué, se dirigeant sur Phu-Hoaï. Garnier partit par l'autre route avec 1 canon, 18 Français et des volontaires. Clairons sonnants, la petite troupe s'élance au pas de course; Garnier coupe à travers les rizières, la pièce restant sous la garde de 3 servants. L'héroïque marin va, le révolver au poing, criant toujours » « En avant! mes enfants Il arrive devant un remblai qu'il essaye d'escalader. Trois hommes et lui réussissent à sauter sur la digue, ils sont salués d'une décharge épouvantable. Le sergent-fourrier Dagorne est frappé d'une balle à la poitrine, le caporal Guérin est blessé à la tête, le troisième recule. Garnier reste seul épuisant ses cartouches et appelant au secours; il ne tarde pas à être entouré et décapité. Ses hommes qui avaient tourné le village de Thu-lé arrivent sur ces. entrefaites mais ne peuvent que recueillir ces tristes dépouilles qu'ils transportent en toute hâte à Hanoï.
!
!
:
:
Pendant ce temps, l'autre colonne continue sa route; un matelot, Bonifay, est tué. Plus loin, au cours d'un assaut de la digue, Sorre est blessé mortellement. Balny est enveloppé et disparaît emporté par Jes Pavillons noirs; les blessés sont nombreux. Le docteur Chédan rallie derrière une pagode les dix hommes qui lui restaient et bat en retraite rapportant seulement le corps de Bonifay, les autres ayant été enlevés par les Chinois. Trois heures après, les renforts venant de Cochinchine étaient annoncés; ils arrivaient 4 jours après! Trop tard, hélas, le malheur était irréparable.
MADAGASCAR
PRISE DE MAROVOAY ET COMBAT D'AMBODIMONTI (Mai 1895).
Le lieutenant-colonel Pardes.
La ville de Marovoay, capitale du Boëni, était un des centres les plus importants de la région Nord-Ouest de Madagascar, bâtie sur un des affluents de la Betsiboka. Sous le commandement d'un de nos plus violents ennemis, Ramazombazaha, les Hovas s'y étaient fortement retranchés et avaient construit un rova (fort) sur une colline dominant la ville. Les troupes désignées pour attaquer cette position furent divisées en trois colonnes. La colonne de gauche, sous les ordres du général Metzinger, comprenait trois compagnies du bataillon malgache, sous les ordres du lieutenant-colonel Pardes, trois compagnies de turcos, sous les ordres du lieutenant-colonel Pognard, une compagnie d'infanterie de marine, la 13e compagnie du génie et deux sections et demie d'artillerie. La colonne du centre, sous les ordres du capitaine de vaisseau Bienaimé, comprenait cent trente-cinq hommes des compagnies de débarquement et une compagnie de tirailleurs algériens. La colonne de droite comportait seulement une compagnie, sous les ordres du capitaine Delbousquet. Le 29 avril 1895, le départ fut donné et le lieutenant-colonel Pardes bouscula tout de suite quelques partis hovas.
Le 2 mai, au matin, la colonne de gauche est attaquée par un petit corps embusqué sur la route, mais l'ennemi est refoulé au bout de quelques heures. Une légère halte permet aux hommes de se reposer, puis la marche reprend lorsque, tout à coup, la colonne se trouve devant une position très forte mise en état de défense. Attaqués de front et sur la gauche, les Hovas lâchent pied et se débandent sur Marovoay. Pendant ce temps, la colonne du centre a remonté la Betsiboka à bord de trois canonnières, le PrirFwuguet, la Rance et le Lynx, débarque au confluent de la rivière de Marovoay, malgré le feu très vif d'une batterie ennemie et d'une pièce à demi enterrée qui enfilait la rivière.
La colonne Bienaimé s'élançe sur la ville, y pénètre pendant que ses défenseurs se sauvent dans toutes les directions. La colonne se jette à l'assaut du rovci et s'en empare en un
;
clin d'œil à onze heures, le pavillon français tlottait sur la colline. Les ennemis abandonnaient vingt canons, une mitrailleuse, dix mille cartouches, deux mille obus, cinq canons Hotchkiss et de nombreux approvisionnements de poudre. Un gros parti d'environ deux mille Hovas se réfugia à douze kilomètres au Sud, dans le village d'Ambodimonti. Le lieutenant-colonel Pardes, chargé de surveiller ce camp, avec quatre cent cinquante hommes, se heurte, le 15 mai, avec une colonne ennemie qui marchait à sa rencontre. Un violent combat s'engage; de véritables corps-à-corps ont lieu dans les hautes herbes, dans la brousse qui protège les mouvements de l'ennemi. Néanmoins, grâce à la valeur de nos soldats, celui-ci est repoussé, forcé d'abandonner soixante morts et un canon se chargeant par la culasse. Nous avions un officier blessé, le lieutenant Foreston, et onze tirailleurs blessés. Le lieutenant-colonel Pardes s'empara d'Ambodimonti quelques jours après.
SOUDAN
PEISE D'OUESSÉBONGOU (25 avril 1890).
Mort du capitaine Mangin, des sergents Daguet et Bérenger. Après la prise de Ségou (avril 1890), le commandant Archinard s'avança sur Ouessébongou, importante forteresse reliant la nouvelle capitale d'Ahmadou, Nioro, avec le Niger, dans le but d'affermir la sécurité de nos récentes conquêtes. Le 25 avril, la colonne française arrive devant la place au matin, après une marche pénible au milieu d'un désert sans eau. Les pièces de 80 se mettent aussitôt en batterie à 400 mètres du village les tirailleurs se déploient à droite et à gauche, les spahis se forment en ligne derrière, puis à 200 mètres au-delà, les auxiliaires bambaras attendent les événements. Dans la ville, ce fut une surprise générale, on n'attendait pas notre venue, aussi le tabala résonne-t-il aussitôt appelant les défenseurs qui ne tardent pas à garnir les murailles crénelées, disposées en crémaillères avec bastions et redans. Après une heure de bombardement, les pièces avancent de 100 mètres, et tirent en brèche sur le mur qui heureusement est peu solide. A 1 heure 35, la brèche est terminée, mais le colonel n'ose encore donner l'assaut. L'artillerie se place alors sur une colline et enfile la face attaquée.
;
v
A 4 heures, rien n'est encore fait; les hommes sont impatients, la chaleur et la soif les accablent. Le commandant se décide il exhorte les troupes, fait crier les griots. La colonne d'assaut s'ébranle en colonne de compagnie. Les tirailleurs, lieutenant Levasseur, marchent en tête, suivis des auxiliaires qui sont maintenus par la compagnie
;
:
du capitaine Launay. Les défenseurs ouvrent un feu très vif sur les nôtres le lieutenant Levasseur enlève ses hommes au pas gymnastique, entre le premier dans la ville, mais tombe tout de suite dangereusement blessé. Les deux hommes qui l'emportent sont tués; deux autres sont plus heureux et le ramènent en arrière. Le capitaine Mangin va le remplacer. Les auxiliaires n'osent avancer, mais les tirailleurs du capitaine Launay se précipitent en avant, le lieutenant Lucciardi en tête. A ce moment, le lieutenant Salvat est blessé au bras, il ne quitte néanmoins son poste que sur l'ordre de son capitaine, va se faire arracher la balle et revient prendre son poste. Le capitaine Bonnier qui prend la direction du combat rétablit un peu d'ordre dans l'attaque. Lucciardi perd, en quelques instants, la moitié de ses hommes; le capitaine Mangin est frappé à mort et deux sergents européens. sont tués la situation devient grave. Bonnier se multiplie; il rallie quelques guerriers bambaras et se mettant à leur tête gagne du terrain. Tout autour d'eux le sol est jonché de cadavres. Un incendie arrête encore une fois l'élan de nos troupes et les Bambaras pris de panique cherchent à s'enfuir. La nuit arrive, ordre est donné decoucher sur les positions, toutefois, les auxiliaires sont emmenés hors de l'enceinte.
:
Pendant la nuit, les Toucouleurs cherchent à cerner les sections, le tambourin de guerre ne cesse de battre. Une attaque furieuse a lieu, à deux heures, sur les deux barricades établies et défendues par la compagnie Launay la pièce de 80 lance des boîtes à mitraille, la section de garde à la brèche exécute des feux rapides, l'ennemi est repoussé.
;
Nouvelle attaque à trois heures et demie sur l'état-major, l'ambulance et les troupes campées en dehors de la ville: au point du jour, la lutte recommence. vivement sont enformées et d'assaut sont colonnes Deux levées; les assaillants grimpent sur les toits des cases,
cherchent à escalader les murs, ils marchent avec confiance, aussi, ne tardent-ils pas à couronner les remparts du réduit. La résistance est désespérée; les ennemis font balle avec tout ce qui leur tombe sous la main. On retire des blessures, du verre, de la ferraille, des cailloux. Au moment où les Bambaras se jettent dans les cours, une grande flamme s'élève du réduit, une explosion formidable se fait entendre, c'est le chef Diara qui vient de se faire sauter avec les siens. Le reste des défenseurs se fait tuer dans les rues ou brûler dans les cases avec leurs enfants. Nos pertes étaient malheureusement considérables 16 tués dont le capitaine Mangin, les sergents Daguet et Bérenger; 83 blessés, dont les capitaines Bonnier et Launay, les lieutenants Levasseur, Salvat et Lucciardi. Ce fut le fait de guerre le plus sérieux de la campagne du Soudan, mais aussi les résultats obtenus -furent très impor-
:
tants. La colonne retourna à Kayes, où elle arriva le 25 mai, après avoir parcouru 2.000 kilomètres. -
DAHOMEY
COMBATS DU CAMP DE LA SOIF
(14 octobre 1892)
Mort du commandant Stéphani et du capitaine Marmet Après le combat de Poguessa, le colonel Dodds fit reprendre à la colonne la marche sur Abomey, mais chaque pas en avant fut chèrement acheté et presque chaque jour nous eûmes un combat à enregistrer. Le 6 octobre ce fut au pont d'Adegou, le 11 à Oumbouémédi, le 13 à Akpa, le 14 au Koto. L'armée ennemie forte de 6 à 8.000 hommes disputait le terrain avec une ténacité inouie. Un marigot vaseux, le Koto, barrait notre route; les Dahoméens étaient établis en arrière de cet obstacle et s'étaient retranchés formidablement. Dès le matin du 14, notre artillerie ouvre le feu, 6 pièces sont successivement mises en batterie l'ennemi répond coup pour coup. Ce duel se poursuit pendant un certain temps pour permettre à la colonne de remonter vers le nord et essayer de traverser le marigot par un gué signalé à une distance de trois kilomètres. Vers 9 heures du matin, nos troupes débouchent tout à coup sur un plateau où elles sont aperçues-par les Dahoméens; ceux-ci envoient des soldats au-devant d'elles. Le soleil déjà haut commence à incommoder les Français; les officiers cherchent partout de l'eau potable. La fatigue est extrême.
;
;
Sur le bord du marigot, un fourré impénétrable empêche d'avancer nos troupes s'établissent alors en halte gardée et essaient de prendre un peu de repos en déjeunant. Heureusement, on découvre quelques trous contenant de l'eau de pluie et les soldats font le café, ce qui réconforte la plupart. Pendant ce temps des guides avaient été envoyés pour découvrir un point de passage ils reviennent en déclarant le pays impraticable pour l'artillerie, les tornades des jours précédents ayant détrempé le sol. Forceest donc à la colonne de tenter la chance. Le feu recommence; les Dahoméens, poussant leurs cris de guerre, se ruent sur notre artillerie qui les reçoit par des coups de mitraille, l'infanterie forme le carré, mais la place n'est plustenable. Pour éviter un désastre, Dodds décide que la colonnese portera à600mètres en arrièreetypassera lanuit. Le carré se met donc en marche, harcelé, fusillé par les Dahoméens embusqués derrière les arbres et -les termitières énormes qui couvrent le pays le capitaine Battreau est grièvement blessé et de nombreux soldats sont atteints. La colonne arrive néanmoins à se dégager et l'ennemi est maintenu dans les bois par l'artillerie. Le lendemain matin, le colonel Dodds prépare une corvée chargée d'aller jusqu'au Koto pour y prendre l'eau nécessaire aux hommes. Une compagnie d'Haoussas, commandée par le capitaine Sauvage, l'accompagne, et la lre compagnie de la légion se tient prête à l'appuyer. Dès le départ, les tirailleurs prennent le contact avec les Dahoméens qui sont restés embusqués toute la nuit et le feu devient assez vif. Les porteurs prennent peur, se sauvent et rentrent au camp. L'ennemi enhardi s'avance et menace le bivouac; la section de la légion du sergent Gaillard va renforcer les Haoussas, mais il est trop tard. Les Dahoméens débordent de tous
;
;
côtés et tombent sur le camp; en un instant les pertes sont grandes, le commandant Stéphaniesttué, le capitaine Marmet, de l'état-major, est mortellement blessé au centre même du bivouac. Les balles, les obus, sillonnent le camp; nous avons 5 tués et 35 blessés. Le capitaine Sauvage qui soutient le plus grand choc recule par échelons il veut emporter ses blessés, les brancardiers indigènes se couchent et refusent de marcher; le sergent Gaillard, avec ses hommes, charge à la baïonnette et parvient à dégager le convoi. Il est midi. Le capitaine de Fitz-James s'offre de sauver la colonne qui n'a toujours pas d'eau avec un peloton de spahis il partira en arrière en chercher à Oumbouémédi. A 9 h. 1/2 du soir la cavalerie quitte le camp et rentre à 4 heures du matin rapportant 1.100 bidons d'eau; une demi-heure après une violente tornade éclate inondant le camp et donnant alors plus d'eau qu'on en aurait désiré, rendant inutile le dévouement de Fitz-James et de ses spahis. Les hommes donnèrent à ce bivouac le nom du « Camp de la Soif.»
;
;
MADAGASCAR
COMBAT D'ANDRIBA (21
août 1895)
La marche sur Tananarive, brigade Voyron en tête, se poursuivait coupée de combats. Après celui de Tsarasotra, la colonne expéditionnaire se transporta vers le plateau central de Madagascar, continuant le travail de la route, qui exigeait des efforts surhumains. Le.20 août, elle arriva au pied des monts Ambohimena sur lesquels les Hovas avaient, depuis deux mois, concentré leurs moyens de résistance. Le seul passage, le col d'Andriba, large de 3.800 mètres était barré et bordé de fortifications. be quelque côté que l'œil se portât, dit un témoin, on « apercevait des camps et des ouvrages de défense. » Il y avait, dans ce coin, plus de 5.000 Hovas, avec de nombreux canons, commandés par des Anglais qui avaient organisé la résistance à l'européenne. Le général Duchesne résolut, néanmoins, d'attaquer vivement ces lignes formidables. Le 21 août, la brigade Voyron commença l'action; elle comprenait 2 bataillons d'infanterie de marine, 2 bataillons de tirailleurs Haoussas et Malgaches, 1 compagnie du génie et 1 escadron de chasseurs d'Afrique. Le général en chef suivait, à courte distance, avec une réserve composée du bataillon de la légion étrangère, la 8e batterie d'artillerie et 1 section de 80 de montagne. Les cavaliers, en éclaireurs, parcoururent d'abord un
terrain difficile; vers 11 heures ils débouchent en face du village d'Ambodiamontana. Une fusillade nourrie partant d'une longue tranchée accueille la colonne. Sans tirer, nos troupes s'élancent et, en un clin-d'œil, s'emparent du village où elles s'installent aussitôt pour se reposer. Vers 2 heures 1/2, une patrouille envoyée par la pointe d'avant-garde vers le village d'Amboutana, à 3 kilomètres de là, fut saluée par 3 obus à balles; un tirailleur est tué net et un autre blessé. Toutes les hauteurs, alors, se démasquèrent et une pluie de fer s'abattit sur l'avant-garde 2 compagnies de renfort et 1 batterie viennent au secours de celle-ci. Les Hovas redoublent leur feu et le rendent plus précis de nombreux blessés couvrent bientôt le sol. Pourtant, nos pièces parviennent à s'installer et ripostent aussitôt, 50 obus à la mélinite bien dirigés réduisent, en peu de temps, au silence, l'artillerie ennemie. La nuit se passa sur le qui-vive, et au petit jour nos troupes reprirent position pour combattre. On apprit alors que l'ennemi s'était enfui, abandonnant encore une fois le terrain devant nous toutefois, il détruisit tout en s'échappant et on ne retrouva que 7 pièces, 1 canon-revolver et quelques fusils. Notre succès nous ouvrait la route de la capitale.
;
;
;
FRANCE
BAZEILLES
(1ER
septembre 1870)
Héroïsme des Marsouins. — Le Commandant Lambert. Les Dernières Cartouches. Des récits de hauts faits de l'armée coloniale ne seraient point complets si l'on ne parlait de la page immortelle que les Marsouins ont su écrire dans l'Histoire au cours de la campagne franco-allemande de 1870-71. Bazeilles Comme ce nom fait vibrer le cœur de tous les braves de l'infanterie de marine et combien, nous les jeunes, nous devons être fiers d'avoir eu de tels aînés. Rappelons succinctementles faits principaux de la bataille. C'est le 1er septembre, après une lutte acharnée contre notre 12e corps, dans lequel se trouvait la fameuse Division bleue du général de Vassoigne, que les Bavarois recommencèrent le feu par un épais brouilard. Les marsouins étaient installés dans Bazeilles, toutes les maisons étaient transformées en citadelles. Vers quatre heures du matin, après une nuit d'attente et d'énervement, les premiers coups de feu retentirent. Nos soldats, attaqués brusquement, ripostèrent sans distinguer l'ennemi; celui-ci semble sortir.de terre. De toutes parts, les Bavarois apparaissent,se glissant dans les jardins, pénétrant dans les maisons, tirant des fenêtres, ouvrant un feu ininterrompu sur les troupes enveloppées. La tuerie commence aucuneballe n'est perdue, le sang coule à flots, les cadavres s'amoncellent.
!.
;
J'étais caché dans un coin de ma maison, dit un habitant de Bazeilles, témoin oculaire, les soldats français qui l'occupaient ne discontinuaient pas de tirer sur l'ennemi. Une bande de fantassins bavarois se précipite dans le corridor les Français qui les ont vus arriver les attendent à la baïonnette. « Resserrés par l'espace, et portés des deux côtés les uns sur les autres, ils peuvent à peine s'aborder. La mort, cependant, frappe des coups aveugles, la maison retentit de hurlements affreux; ce sont les cris des malheureux qui tombent traversés par les baïonnettes. Le corridor s'encombre de cadavres et de cette masse d'hommes le sang jaillit en ruis«
;
seau. » La lutte continue terrible dans toute la ville qui commence à brûler sur divers points. Cent deux officiers, deux cent treize sous-officiers et deux mille cinq cent cinquante soldats tombèrent pour ne plus se relever. La résistance acharnée des marsouins pousse les Bavarois au paroxysme de la fureur; ils font le siège de chaque maison et mettent le feu à tout ce qui est encore debout. Un des survivants de cette boucherie, le sergent Poitevin, du 2e de marine, écrivit ses impressions sur la journée. En voici quelques extraits « Des luttes de corps à corps s'engageaient dans les bâtiments. A chaque instant des cris rauques se faisaient entendre des corps inanimés recouvraient les parquets des maisons, dont les murs étaient maculés de sang et noircis par la poudre. Quand les ennemis s'apercevaient que leurs positions allaient être enlevées, ils pillaient eux-mêmes les mettaient ensuitelefeuavecdes torches maisons auxquelles et sans se préoccuper s'il y avait des femmes, des vieillards et des enfants. Ils incendièrent aussi l'église après s'être servi du clocher pour diriger leurs coups de feu sur une plus
:
;
ils
:
grande étendue et principalement sur les maisons de la Grande-Rue et sur la rue elle-même celle-ci tellement sillonnée de projectiles qu'on n'osait plus aller chercher les blessés dont les cris dominaient le bruit de la fusillade. Ce combat de maison en maison dura plusieurs heures. Combien de camarades, hélas sont disparus pendant cet horrible car-
! nage» L'ennemi ayant réussi à
cerner complètement le village, après six heures d'efforts acharnés, l'infanterie de marine commença à se replier vers Balan. La retraite fut aussi héroïque que la défense. « Pendant cette retraite, dit Poitevin, nous occupions encore aussi longtemps que possible les dernières maisons du village et celles qui se trouvent à proximité. Nous nous embusquions par groupes, combattant en désespérés, pour nous retirer le moins vite possible. Nous étions à peu près à ce moment cent cinquante à deux cents combattants. Après plusieurs tentatives de ce genre qui décimaient les troupes, on s'arrêta pour s'embusquer à nouveau et chercher, par une dernière tentative désespérée, à défendre ce qui restait du village, si terriblement éprouvé par les flammes. Près de la jonction de la route de Balan et d'une autre sortant du village nous rencontrâmes une maison complètement détachée qui, comme les autres, avait été visitée par nos soldats et occupée ensuite sans trop de dégâts dans le mouvement de retraite ». C'était la célèbre maison Bourgerie, celle représentée par Alphonse de Neuville dans son tableau des « Dernières cartouches». Le commandant Lambert, blessé, suivi de quelques officiers et d'une poignée de soldats, s'y réfugie. La maison est mise en état de défense, les fenêtres sont garnies de matelas, d'oreillers; les meilleurs tireurs s'installent et le feu reprend de plus bellk,
Un régiment bavarois tout entier, le 15e, cerne la maison faisant un feu d'enfer sur l'héroïque petite troupe. Le canon est amené. Un obus perce le plafond, tue sept hommes; les cartouches diminuent, le feu se ralentit Les Bavarois se rapprochent sensiblement, le chef du régiment crie au commandant de se rendre. Il refuse.
:
Laissons-lui la parole général rapport écrivait-il dans au moi, son J'avais avec « Delaury, de Vassoigne, les capitaines Bourgey, Picard, Saint-Félix, qui de Escoulié et Aubert, les lieutenants n'avaient pas voulu m'abandonner, et à peu près une centaine
».
:
Et il ajoutait « Grâce surtout à l'activité du capitaine Aubert, la maison fut vivement mise en état de défense ce brave officier, prenant un fusil, se plaça à une des fenêtres, et, grâce à sa merveilleuse adresse, il amena chez les hommes une émulation ». Le rapport contient également le récit détaillé de la défense de la maison Bourgerie : « Le feu de nos hommes, disait-il, fut d'abord si bien nourri qu'il empêcha l'approche de l'ennemi. Tout Allemand qui se montrait était immédiatement frappé. Cependant, malgré les abris, les nôtres n'étaient pas épargnés. C'est ainsi qu'un obus troua le plafond du 1er étage et mit plus de dix hommes hors de combat. Durant plus de deux heures, en ménageant notre feu et à la condition que tout coup portât, nous pûmes tenir en respect des assaillants dont le nombre allait croissant », Quand il ne resta plus que quelques cartouches, on les remit au capitaine Aubert, qui excellent tireur, abattait un ennemi à chaque coup. Et quand il n'en resta plus,qu'il n'y eut plus possibilité de trouer de poitrine bavaroise, le silence se fit dans la maison. Alors le commandant Lambert fait descendre dans la cave ceux qui survivent. A ce moment un grand bruit se fait entendre une batterie bavaroise va broyer la maison. Le commandant dit à ses compagnons « Je vais essayer de sortir et de vous avoir la vie sauve si vous m'entendez tuer, vous ferez une sortie à la baïonnette et vous tâcherez de percer sur Sedan. » Puis il ouvre la porte et se présente un « hurrah 1 » féroce, un hurrah de triomphe l'accueille et on se jette sur lui — Arrêtez crie un officier, le capitaine Lissignolo ; respectez d'hommes
;
:
ce brave.
!
:;
;
;
Et il donne la vie sauve à la poignée de héros et à leur chef qu'il autorise à garder son épée, autorisation que con-
firma le commandant du régiment bavarois, le colonel von Isenberg. « Cette décision d'un.officier ennemi, dit le sergent Poitevin, fit briller sur tous nos visages un éclair de fierté ». On sait le reste, Bazeilles flamba par tous les bouts; de nombreux habitants furent fusillés, asphyxiés et même brûlés vifs. Le général Von der Thann se couvrit là d'une triste gloire et tenta vainement de se disculper; l'Europe stigmatisa son acte comme il le méritait. Le commandant Lambert devint plus tard général de brigade et après sa retraite fut élu président général de la Société des Vétérans 1870-71 et sénateur du Finistère. Il mourut en 1901. Des monuments élevés à Bazeilles rappellent aux jeunes générations le souvenir glorieux de la défense des marsouins et la crypte du cimetière abrite les restes des braves tombés au champ d'honneur qui sont pieusement visités tous les ans pour l'anniversaire de cette mémorable journée.
TONKIN
COMBAT DE
Quoï-DANG (16
juillet 1890)
Le sergent Prokos. — Mort du lieutenant Margaîne A la suite de renseignements donnés par le père Girod, sur la présence d'un fort parti de pirates dans les environs, le
commandant Bergougnioux résolut d'envoyer une reconnaissance sur la route de Hong-Hoa à Dong-Van. Cette reconnaissance partit le 16 juillet 1890 du poste de Hong-Hoa elle était composée de 20 légionnaires et de 40 tirailleurs tonkinois, sous les ordres du sous-lieutenant Margaine. Le capitaine Ferrandini avait le commandement général. Après quatre heures de marche pénible la colonne arrivait près de l'arroyo de Quoï-Dang, mais il fut décidé que la halte ne se ferait qu'au sortir de la vallée qui, en cet endroit, se trouvait très resserrée et dominée de tous côtés par d'énormes rochers. A peine les hommes avaient-ils marché encore quelques minutes qu'un feu violent partait de trois cases sur pilotis qu'on apercevait sur un mamelon dénudé au centre d'une cuvette formée par l'élargissement du couloir rocheux. Le sous-lieutenant Margaine est blessé à la cheville et deux tirailleurs sont également atteints par cette première décharge. L'avant-garde se jette aussitôt dans un bois voisin pour se mettre à l'abri et envoie un sous-officier chercher du renfort.
;
Le sergent Prokos, de la légion, qui commandait leconvoi, laisse celui-ci à la garde d'un caporal et s'élance en avant se dirigeant vers une palissade munie d'une porte qui reliait deux des cases occupées par les pirates. Ses hommes s'étant arrêtés pour ouvrir le feu, sur un commandement fait on ne sait par qui, Prokos arrive seul devant la palissade et s'aperçoit alors qu'il n'est pas suivi. Il a immédiatement l'épaule fracassée d'une balle tirée à bout portant. Dans le bois, le lieutenant Margaine dirige sa troupe pour tourner l'ennemi bien que blessé il s'avance vers la lisière et avec sa lorgnette cherche à se rendre compte de la situation. Il est tué aussitôt par une balle qui le frappe à l'aine. Les tirailleurs tonkinois effrayés se jettent en arrière et malgré les rassemblements sonnés sur l'ordre du capitaine, oh ne les revoit plus avant la fin du combat. Pendant ce temps, les légionnaires se portaient au secours de Prokos le sergent Roti était blessé à son tour (il mourut quelques jours après à l'hôpital); le soldat Ortolani était tué devant la palissade, un autre soldat avait lajambe cassée, un autre, Schadé (plus tard admis aux Invalides), une balle dans les reins et le bras cassé. Le capitaine Ferrandini se voyant abandonné des Tonkinois donna l'ordre aux légionnaires de se retirer sur une position moins dangereuse. Le sergent Prokos emmena alors les blessés dans la vallée, près de l'arroyo, pendant que le caporal Veltin et quelques hommes cherchaient à voir ce que les pirates devenaient. Le petit groupe parvenait à peine au sommet du mamelon qu'une décharge mettait cinq hommes hors de combat tous ces blessés rejoignirent péniblement le sergent Prokos. Il était 9 heures du matin, le combat avait à peine duré deux heures. Jusqu'à midi les hommes restèrent dans la
;
;
;
même position tiraillant à l'aveuglette, en attendant toujours le retour des tirailleurs tonkinois. Réduit à l'impuissance, le capitaine donne enfin l'ordre de se retirer à un kilomètre en arrière et envoie un messager prévenir le poste de Hang-Hoa de la situation. Les blessés sont emmenés comme on peut, la petite colonne toujours harcelée par les pirates 9 hommes seulement sont valides, ils ripostent à qui mieux mieux, un d'eux est tué. Tout à coup on s'aperçoit que 4 hommes blessés et 1 caporal sont restés en arrière. Le capitaine hésite, mais la poursuite est trop vive et l'on ne peut voler à leur secours lui-même est exténué, il tombe inanimé dans l'arroyo et ne doit son salut qu'au dévouement de son ordonnance. A ce moment, tirailleurs rejoignent prétextant s'être égarés dans les bois. Le commandant Bergougnioux fait une marche forcée pour venir les délivrer. A 5 heures du soir, il pouvait enfin les rejoindre et le campement s'installait sous bonne garde pour la nuit. Le lendemain, on retrouva le lieutenant Margaine décapité, ainsi que deux légionnaires les Tonkinois tués avaient été respectés. Le sergent Prokos, grièvement atteint, n'avait pu être pansé que le soir, mais, pendant toute la journée, il avait donné l'exemple du courage et de l'abnégation. Il reçut la Légion d'honneur pour ce bel exploit; il entra l'année suivante à Saint-Maixent et fut nommé sous-lieutenant dans l'inianterie coloniale.
;
;
les
;
HAUT-DAHOMEY
LES COMBATS DE NIKKI ET DE MADÉCALI
(novembre 1897)
Le capitaine Ganier. — Le capitaine Baud
Parmi les quelques missions militaires envoyées dans le Haut-Dahomey, en 1897-1898, la plus importante est, sans contredit, celle du capitaine Baud, de l'infanterie de marine. Cet officier, déjà connu par ses explorations antérieures dans la boucle du Niger, en 1894 et 1895, avait été chargé par
le Ministre des Colonies de procéder à l'occupation des pays de l'hinterland du Dahomey, objet des convoitises des Anglais et des Allemands. Bien secondé par le capitaine Vermeersch, de la même arme, le capitaine Baud commençait, au début de 1897, la conquête du Gourma, et faisait sa jonction avec la mission du capitaine Voulet, venue du Soudan. Pendant que ces opérations avaient lieu, le lieutenant de vaisseau Bretonnet procédait, plus à l'est, à l'occupation de la rive gauche du Niger, entre Ilo et Boussa. Le capitaine d'infanterie de marine Ganier fut alors chargé d'assurer la jonction entre le capitaine Baud et le lieutenant de vaisseau Bretonnet, en procédant à l'occupation des postes de Kouandé et Kodjar, situés sur la verticale de Carnotville à Say. Le capitaine Ganier commandait la 8e compagnie de tirailleurs sénégalais, et avait pour lieutenants MM. Drot et Aymès le docteur Barthet assurait le service de santé.
;
L'occupation du Borgou se fit pendant les mois d'avril et mai 1897, et le lieutenant Aymès fut laissé à Kouandé, pendant que le reste de la compagnie continuait sa marche versle nord. C'est à ce moment que se produisit la révolte des Baribas, * révolte à laquelle l'or anglais ne fut pas étranger. Le capitaineVermeersch, qui venait d'arriveràPorto-Novo, fut alors chargé de conduire des renforts auBorgou,etilfut nommé résident du pays. Cet officier, agissant avec une grande rapidité, débloquait Kouandé et battait les Baribas sous les murs de la ville. Le capitaine Ganier, de son côté, revenait auBorgou où arrivaient égaLe Japitaine Baud. lement les compagnies Dumoulin et Dnhalde, que l'on avait fait venir en toute hâte du Sénégal. Le capitaine Ganier, le plus ancien des officiers présents, prit aussitôt le commandement, avec le capitaine Vermeersch pour chef d'état major. Il défit les Baribas en trois combats successifs et il enlevait Nikki, capitale du Borgou, le 13 novembre.
De nouveaux renforts furent alors envoyés au Borgou et le chef de bataillon d'infanterie de marine Ricour vient prendre le commandement avec le titre de commandant su-
périeur du Haut-Dahomey. Son premier soin fut d'assurer la jonction des postes du Borgou avec ceux du Niger fondés par le lieutenant de vaisseau Bretonnet. Il dut pour cela livrer un nouveau combat aux Baribas qui furent défaits à Allio, le 31 décembre 1897, après un combat dans lequel se signalèrent le capitaine Ganier, les lieutenants Aymès et Boissonas, le docteur Barthet. L'occupation du pays en fut la conséquence et les Baribas vinrent faire leur soumission. Le capitaine Baud que nous avons laissé au Gourma ne restait pas inactif. Après avoir rangé définitivement le Gourma sous nos lois, il pénétrait au Deudi. Quittant Kodjar, il occupait Carimana
le 14 octobre.
La colonne se rendant à Ilo, apprit que les habitants de Madécali avaient attaqué nos alliés (3 novembre). Bien que n'ayant qu'une trentaine de tirailleurs disponibles, Baud marcha sur la ville pour la punir. L'ennemi avait 2.000 hommes armés de fusils, d'arcs, de flèches, de javelots et de lances. La rencontre eut lieu dans une plaine couverte d'herbe épaisse et haute, empêchant de voir à dix pas nos hommes sont criblés de flèches, mais ils ripostent vigoureusement et font un feu d'enfer. A un certain moment, les assaillants reculent les tirailleurs alors s'élancent à la baïonnette et mettent en fuite les ennemis qui abandonnent plus de 200 morts sur la place. Malheureusement au cours du combat, le capitaine Baud eut le bras traversé par une flèche empoisonnée grâce à des
;
;
;
soins énergiques il put être sauvé, mais sa blessure le fit souffrir longtemps. Après la pacification de Deudi, il rentra en France en retraversant le Bornou ; nos troupes occupaient victorieusement le Haut-Dahomey et se reliaient à nos avants postes du Soudan.
TUNISIE
PRISE DE KAIROUAN (25 octobre 1881)
Le général Saussier Après la prise de Sfax, quelques opérations eurent lieu sur la frontière de la Tripolitaine, car les insurgés continuaient leurs incursions; ils s'enhardirent jusqu'à venir couper un aqueduc aux portes de Tunis et à plusieurs reprises ils attaquèrent les trains de chemin de fer. Le général Saussier résolut d'en finir, il prit le commandement des troupes et menavigoureusement la campagne. Le 10 octobre 1881, le corps expéditionnaire occupait Tunis et les forts. Trois colonnes furent alors formées pour marcher surKairouan, la ville sainte des Arabes, le centre de l'insurrection, afin de frapper le coup Saussier. Général Le décisif.
La première colonne, commandée par le général Forgemol, composée de 8.000 hommes, partit de Tébessa; La deuxième, commandée par le général Etienne, partit de Sousse; Enfin la troisième, sous la direction du général Saussier, partit de Zaghouan. Il y avait, en tout, 20.000 hommes. La division Forgemol fut attaquée à Haïdra, mais ellefut dégagée par quatre escadrons de chasseurs d'Afrique qui chargèrent avec brio, ainsi que par le 4e hussards qui se distingua; nous eûmes cinq tués et quinze blessés. Le 25 octobre, la cavalerie du général Bonie soutint encore le choc de 4.000 ennemis; elle eut à nouveau deux tués et douze blessés. De son côté, la colonne Etienne fut attaquée le 21, par 600 cavaliers, au campement de Kalaa-Sira. Deux escadrons du 6e hussards repoussèrent les ennemis le caïd Ali-benAmar fut tué. Enfin, le 25, le lieutenant-colonel Moulin arrivait devant Kairouan avec deux escadrons, toujours de 6e hussards, mais le drapeau blanc flottait sur la Casbah. La colonne Etienne le suivait de près le général tunisien vint lui-même ouvrir les portes et remettre les clefs au commandant français. Nos soldats, joyeux, firent une entrée triomphale dans la ville et s'installèrent dans les casernements. Le général Saussier arriva le lendemain et procéda le jour même à l'occupation officielle de Kairouan. Le soir, la colonne Forgemol opérait sa jonction.
;
;
SOUDAN
L'AFFAIRE
DU MARIGOT DE FATAKO
Le lieutenant-colonel Frey. —
(17-18 janvier 1886).
Paix avec Samory.
En prenant le commandement des troupes pour la campagne de 1885-1886, le lieutenant-colonel Frey avait comme objectif de rejeter, au-delà du Niger, Samory qui occupait nos territoires depuis 1883 et à qui l'échec d'une de nos colonnes en 1885 avait rendu l'audace. Une troupe de 900 hommes fut envoyée à sa poursuite Samory à la tête de 8.0no Sofas refuse le combat et bat en retraite, le colonel Frey redouble de zèle et force la marche pour l'atteindre. Laissant à Nafadie le gros de-sa colonne et les malades qui le retardaient, il forme un détachement composé de spahis, d'ouvriers indigènes, de 300 tirailleurs valides, 2 capitaines et quelques sous-officiers européens montés — chaque homme avait cinq jours de vivres. Le départ eut lieu le 17 janvier 1886, dans l'après-midi. Le soir même, la colonne trouve les traces de l'ennemi quelques prisonniers font connaître que Malin-Kamory, un des lieutenants du fama, est campé pour passer la nuit sur les bords du marigot de Fatako-Djiuo. Les chevaux sont laissés à la garde d'un piquet afin de ne pas donner l'éveil par leurs hennissements. Les hommes sont exténués, mais ils touchent au but et joyeux ils repartent dans la nuit.
;
;
A 1 heure du matin, le camp est signalé. Le passage du marigot est effectué en silence grâce à un prisonnier qui indique un gué et un sentier la colonne arrive
;
aux premières tentes. Toute l'armée est là, endormie. Un bambou brisé réveille quelques noirs qui lèvent la tête et s'apprêtent à se sauver. Avant de leur laisser le temps de prévenir les chefs, un feu de salve énergique vient jeter l'effroi parmi le campement. ») s'élève comme une « Toubako 1» (« Ce sont les blancs immense clameur. Aux feux de salve succèdent'des feux rapides puis nos soldats s'élancent à la charge. La mêlée est générale, cependant les Français peuvent se rassembler à nouveau et diriger des feux nourris sur la ligne des bivouacs qui se prolongeaient au loin. Quelques instants plus tard, l'ennemi fuyait de toutes parts, laissant ses chevaux, ses armes et d'innombrables morts. Nous n'avions de notre côté que deux blessés. La poursuite recommença au point du jour, mais Samory démoralisé par cette surprise et ce désastre envoya des émissaires proposer la paix. Il reconnaissait la possession à la France de toute la rive gauche du Niger jusqu'à Tankisso et devait retirer ses troupes sur la rive droite. Cette paix importante, qui fait honneur à l'initiative du colonel Frey et à la bravoure de nos vaillants soldats, amena la soumission d'Ahmadou, notre autre ennemi au Soudan, qui reconnaissait aussi notre protectorat. Une ère de tranquillité s'ouvrait qui, malheureusement, ne dura guère grâce à la mauvaise foi de Samory.
!
MADAGASCAR
COMBAT D'AMPOTAKA. (15
septembre 1895).
La construction de la route carrossable pour aller à Tananarive exigeant des travaux considérables et retardant, par conséquent, la marche du corps expéditionnaire, le général Duchesne résolut de laisser à Andriba le gros de ses troupes et de partir en avant avec une colonne légère. 4.000 hommes sont choisis; divisés en trois groupes ils sont placés sous le commandement du général Metzinger, du général Voyron et du colonel de Lorme. 266 chevaux, 2.800 mulets, 1.515 conducteurs auxiliaires complétaient la colonne. Le convoi emportait 22 jours de vivres réduits au strict minimum. Il y avait encore 190 kilomètres à parcourir Le 14 septembre 1895, le départ fut donné à 5 heures du matin. Les troupiers sont joyeux; ils se sentent près du dénouement et préfèrent bien certainement marcher que de camper en arrière des travaux, à la merci de toutes les maladies et épidémies. Dans la journée, la colonne arrive en face du col d'Ampotaka. C'est une position militaire de premier ordre que les Hovas ont fortifié avec beaucoup de soin. Des retranchements barrent tous les passages et on évalue à environ 6.000 hommes le nombre des défenseurs qui s'y trouvent répartis. Il est impossible de tourner la position, les flancs du défilé sont inaccessibles. Le général décide qu'on enlèvera le passage par une attaque de front, à la française
!
!
:
Le 15, dès le lever du jour, le mouvement commence le village d'Ampotaka est en flammes aussitôt. Les Français aperçoivent distinctement les ouvrages ennemis disséminés un peu partout, avec leurs parapets rouges et leurs créneaux réguliers. Deuxfortins sont à droite sur les montagnes de l'Est une redoute est placée au à centre avec 3 canons l'ouest, une batterie de 3 pièces. Des abatis sont disposés tout autour des ouvrages. Deux compagnies de ti-
;
;
railleurs algériens sont chargées d'enlever les forts de l'Est, le bataillon malgache a pour objectit les batteries de l'ouest. Le gros de la colonne doit attaquer le centre sous les Le colonel Gillon ordres du colonel Oudri. La marche est entravée par de profonds marécages et par des berges escarpées, néanmoins tout progresse à la fois. Le bataillon malgache, commandé par le commandant Ganeval surprend deux détachements hovas et emporte les parapets de l'Ouest. La légion, par des feux de salve bien réglés à 2.000 mètres, déloge l'ennemi d'une des deux redoutes de l'Est. L'artillerie peut enfin s'installer à 10 heures et ouvrir le elle enlève du premier coup le parapet de la seconde feu redoute et couvre de projectiles la position centrale.
;
Les deux compagnies de tirailleurs algériens prennent pied sur la crête du Tsinainondry et refoulent devant elles l'ennemi qui, pris alors entre deux feux, évacue ses positions. A 1 heure, tout était terminé nous avions le passage libret Les Hovas comptaient 200 tués nous avions 1 tué et 2
blessés.
;;
TONKIN
PRISE DU PAN-Aï (26-30
juillet —
21
août 1895).
-
Enlèvement de la famille Lyaudet. Mort des lieutenants Brisach et Vormèze. Au mois d'avril 1895, les pirates avaient enlevé au poste de Port-Wallut, dans l'île de Kébao, la famille de Lyaudet, espérant qu'on négocierait avec eux comme en 1893 pour Mme Chaillet et sa fille et qu'ils récolteraient ainsi une grosse rançon. Le gouverneur général, M. Rousseau, comprenant quelle faute on avait commise en rachetant les prisonniers, déclara que ce mode de procéder avait vécu et que, dorénavant, les bandes trouveraient devant elles les fusils de nos soldats au lieu de négociateurs. Le colonel Chaumont reçut l'ordre de constituer une colonne afin de reprendre les Lyaudet de vive force. La piste ne put être retrouvée de suite les autorités chinoises déclarèrent que la famille était retenue dans le massif du Pan-Aï, sur la frontière du Tonkin, entre Pohen et Pak-Lieu. Diverses reconnaissances au cours desquelles nous eûmes des tués et des blessés, et une mission topographique du lieutenant Sénèque, permirent d'établir une carte détaillée du massif nécessaire pour les opérations à y faire. C'était un sommet dominant,presque inaccessible, abordable seulement par des crêtes rocheuses, étroites et découvertes.
;
:
Deux colonnes furent concentrées à Moncay dans le commencement du mois de juillet l'une sous le commandement du lieutenant-colonel Riou, lrautre sous le commandement du chef de bataillon Mondon. Le colonel Chaumont avait le commandement général. Le 18 juillet trois détachements d'observation gagnèrent leurs emplacements le lieutenant Coulais sur les hauteurs du Thap-Nhi-Ngha, le lieutenant Angéli vers Pohen, le lieutenant Rivier, sur les pentes du Ma-Tao-San. Le 23 juillet les deux colonnes quittèrent Moncay pour cerner le massif. Dans la nuit du 23 au 24, les pirates vinrent surprendre le poste du lieutenant Angéli les hommes ripostèrent vivement, le lieutenant eut la jambe fracassée, mais le sergent Patoizeau rassembla les tirailleurs et contraignit les bandes à se retirer nous avions, malheureusement, le tiers du détachement hors de combat. Le 26 juillet, la colonne de l'Ouest prenait pied et réussissait à se maintenir sur l'extrémité de la ligne de faîte pendant que la colonne de l'Est qui suivait aussi la crête venait se heurter à une position hérissée d'obstacles et ne pouvant être tournée. Cette dernière colonne devait s'arrêter sous un feu meurtrier qui lui couchait par terre son chef, le commandant Mondon, grièvement blessé, 3 tués, 19 blessés parmi lesquels le capitaine Dupin. Le 30, la colonne de l'Ouest tentait un nouvel effort. « Avec leur bravoure, dit le général Duchemin. commandant en chef les troupes de Findo-Chine, dans son ordre du jour n° 77, du 16 septembre 1895, et leur entrain habituels, les légionnaires formant la tête de la colonne d'attaque cheminaient sous le feu, sur un glacis resserré entre deux précipices et semé de défenses accessoires, mais leur élan vint se briser contre le parapet. »
:
;
;
A ce moment tombaient le lieutenant Brisaeh et le légion-
naire Mallinger. Le lieutenant Chasles, de l'infanterie de marine, commandant la colonne de réserve, prenait aussitôt la tête, assurait l'enlèvement des blessés et la retraite de la colonne d'attaque avec une bravoure et un dévouement remarquables. Malgré leurs pertes, malgré les difficultés extraordinaires du terrain et la rigueur de la température, le moral de nos soldats ne fut pas un seul instant ébranlé et c'est avec le plus brillant entrain, qu'ils repartaient à l'assaut quelques jours plus tard le 21 août. L'artillerie amenée à bonne portée au prix des plus grandes difficultés avait efficacement préparé l'attaque. La tête de colonne est formée par un détachement du 10e de marine, commandé par le lieutenant Vormèze. Ce n'est qu'au pied du retranchement qu'elle est assaillie par un feu rapide, d'une violence extrême, sous lequel tombent le lieutenant Vormèze, tué à bout portant, les soldats Gauthier, Hurtu, Bezombe, le légionnaire Weiler. Le lieutenant Dubois de Saint-Vincent, commandant la colonne de réserve composéed'un détachement du 2e étranger, vole en tête de la troupe un instant hésitante et, à travers une grêle de balles, s'élance debout sur le parapet du fortin, en criant « En avant!» Le sergent Decombis, le caporal Sylvani, qui fut blessé grièvement, les soldats Zanoli, Curey, du 10e de marine, le légionnaire Desecq suivent de près et entraînent toute la colonne d'assaut qui entre dans le fort la baïonnette haute. Pendant ce temps les linhs-co chinois, sous le commandement du pho-quan Dang-Tien-Tuyen enlevaient vigoureusement le poste pirate situé à l'est. Cette brillante affaire, qui nous coûtait très cher malheureusement, a eu pour résultat le rejet en Chine d'une bande
:
forte et aguerrie et l'enlèvement de vive force d'un repaire réputé comme imprenable. La famille Lyaudet fut rendue à notre consul à LongTchéou, le 8 octobre, après de nombreuses négociations avec le maréchal Sou et le Tsong-li-Yamen de Pékin. Ce fait d'armes est placé au rang des plus beaux de la pacification du Tonkin.
DAHOMEY
COMBAT DE
YoKouÉ (4 novembre 1892).
Mort du lieutenant Menou. Après avoir marché de succès en succès, le colonel Dodds était arrivé à une petite journée de Kana, la ville sainte. Le 4 novembre, la colonne débouchant sur le plateau de Ouakon, surprend les Daho m é en s retranchés dans Yokoué, dernier village avant Kana. Six compagnies se déploient immédiatement et exécutent les feux au commandement. Notre artillerie entre à son tour en ligne et prend pour objectif le tata de la ville. Le feu des défenseurs se ralentissant Le roi Toffa. puis cessant tout à fait, nos hommes prennent un instant de repos. La marche est reprise à 2 heures; mais, de suite, nos éclai-
reurs sont tout à coup assaillis de coups de fusil; l'ennemi est caché à 50 mètres. Le colonel Dodds donne le signal de la charge. Les légionnaires, les Sénégalais, les Haoussas se précipitent avec un élan splendide les Dahoméens prennent la fuite. Au cours de la poursuite, une nouvelle attaque a lieu en arrivant à hauteur du village ce dernier est emporté d'assaut, mais, en arrière, un groupe d'ennemis, embusqué à 300 mètres, ouvre un feu nourri sur la colonne. Le capitaine Delestre l'orme une batterie de quatre pièces et exécute un tir à mitraille la légion fait en même temps des feux de salve. Rien ne bouge, les Dahoméens ne veulent pas céder. Le colonel fait charger à nouveau. Le capitaine Drude enlève ses hommes et les jette sur l'ennemi qui s'enfuit alors non sans nous avoir fait subir des pertes cruelles. Nous comptions 8 tués, dont le lieutenant Menou,49 blessés parmi lesquels les lieutenants Maron, Gay et MérienneLucas. Behanzin, en personne, commandait ses bandes ce qui explique l'acharnement désespéré avec lesquelles celles-ci s'étaient accrochées au terrain. Cette dernière résistance vaincue, Kana était découvert; notre colonne y entra le surlendemain 6 novembre.
;
;
;
MADAGASCAR.
COMBAT D'AMPANOTOKAMA (26
septembre 1895).
;
La colonne légère marchant sur Tananarive, n'en était plus qu'à 50 kilomètres elle entrait à ce moment dans l'Imerne, région cultivée et populeuse et, débarrassée d'une partie de ses vivres, de ses munitions, des blessés, elle allait à grands pas. Le 25 septembre 1895, le bivouac fut établi au pied du piton de Babay la cavalerie ayant signalé, au sud, un fort détachement de Hovas, des grand'gardes furent installées de divers côtés. La nuit se passa sans incidents et la marche fut reprise au lever du jour. L'avant-garde, composée de légionnaires, n'avait pas plus tôt débouché du village d'Ampanotokana, sur le plateau qui domine Sabotsy, qu'elle reçut droite et à gauche des coups de fusils et plusieurs Les Hovas tiraient à 300 mètres leurs premières décharges blessèrent quelques hommes. En un instant, la mêlée fut sérieuse le quartier-général, même, engagé avec l'avant-garde, se trouva pendant un quart-d'heure, au centre des combattants. Les balles sifflaient aux oreilles une d'elles traversa la sacoche et les fontes, ainsi que la selle du général de Torcy. Six hommes furent blessés, dont deux très grièvement. Sur ces entrefaites, le général en chef arrive au galop il fait prendre position aux batteries, qui ouvrent immédiate-
;
à
boulets.. ;
;
;
;
ment le feu. Les obus réduisirent au silence l'artillerie ennemie, mais la fusillade continua toujours très vive. Alors, la légion reçut l'ordre de lancer trois compagnies à la charge, sans sacs, de façon à déblayer complètement les abords de la position. Devant cette colonne lancée contre eux, les Hovas lâchèrent pied et s'enfuirent dans tous les sens à 6 heures 30, tout était terminé.. La marche fut reprise, après un court repos bien gagné par les combattants. En arrivant au sommet du Fandrozano, les Français aperçurent Tananarive. Des acclamations retentirent de toutes parts. La descente s'opéra sans incidents, mais en arrivant à hauteur de Tsimahandry, la tête de colonne fut accueillie par le feu très bien repéré de trois pièces d'artillerie, en position à Ambohipiara; un caporal de tirailleurs fut tué et quelques hommes blessés. Nos deux batteries d'avant-garde prirent position à nouveau et, en quelques instants, réduisirent au silence l'artil, lerie ennemie. Un bataillon de tirailleurs algériens, ayant mis sac à terre, escalada la position et s'en empara sans trop de mal. A 3 heures, la colonne dressait ses tentes au pied d'Alakamisy, ayant eu dans la journée 1 tué, 7 blessés grièvement et 7 disparus.
;
DAHOMEY
ATTAQUE DU BIVOUAC DE L'AKPA (20
octobre 1892)
Mort des Lieutenants Michel et Toulouse Le lendemain de l'affaire du Camp de la Soif, le Colonel Dodds ramena sa colonne éprouvée à Akpa, de façon à laisser reposer ses hommes et attendre des renforts.., Le 20 octobre, la colonne se déplace de nouveau parallèlement au Kota, pour s'établir sur un terrain un peu moins humide. Précisément, à ce moment, les Dahoméens surpris du répit qui leur était laissé se dirigeaient sur le premier bivouac. N'y trouvant personne, ils flairèrent un piège et se mirent à la recherche de la colonne. Les éclaireurs ayant signalé la marche des Français sur Akpa, les Dahoméens se dirigèrent de ce côté et réussirent à approcher du bivouac jusqu'à 20 mètres sans avoir été aperçus. Heureusement, unsoldat de la 3e compagnie de la légion, donne l'éveil à son chef le capitaine Drude. Celui-ci commande immédiatement un feu desalve qui arrête l'élan de l'ennemi. Profitant de ce mouvement de recul, l'artillerie dahoméenne qui s'était déjà établie en arrière, envoie une bordée sur le camp français du premier bivouac arrive également une grêle de projectiles. Le lieutenant Courtois, de la légion, exécute rapidement quelques feux d'ensemble puis lance ses hommes à la baïonnette, ce qui permet à quelques trainards du matin cachés dans la brousse de rejoindre sans encombre.
;
De l'autre côté, un convoi qui arrivait est attaqué vigoureusement; le capitaine Drude part à son secours, suivant de près le lieutenant Gay et son peloton qui était parti, sans ordres, marchant au canon. Le convoi sauvé, tout le monde rentre au-camp. Les Dahoméens amènent alors une mitrailleuse et deux le bombardement commence. canons Les soldats français essaient d'enfoncer la ligne qui les enserre. Le lieutenant Toulouze tombe mortellement blessé, le lieutenant Michel, de l'artillerie, s'établit en avant avec une pièce de canon et fauche la brousse de coups répétés il tombe frappé à mort en commandant le feu. Cependant, les Dahoméens ont fait des pertes cruelles ils commencent à se débander et bientôt la fuite s'effectue de tous côtés. A 6 heures le combat était terminé; nous avions 11 tués, dont 2 officiers, et 34 blessés.
;
; ;
MADAGASCAR
AFFAIRE D'IABOMARY (15
avril 1905).
Mort du lieutenant Janvier de la Motte. Le lieutenant Janvier de la Motte était arrivé à Madagascar. pour la seconde fois, le 1er novembre 1903. Chargé d'une nouvelle mission topographique dans la région extrêmement difficile d'Ambatondrazaka, il s'en acquitta de la manière la plus brillante. Il mettait la dernière main à son remarquable travail dans les bureaux de l'état-major, lorsque des événements aussi graves qu'inattendus se produisirent dans le Sud. Fanatisés par les prédictions intéressées des sorciers, une poignée d'indigènes se jetait l'improviste sur quelques officiers, sous-officiers et colons isolés, les massacrait odieusement et présentant comme d'éclatantes victoires ces lâches assassinats, entraînait de gré ou de force les populations à la révolte. A la nouvelle de ces faits, le lieutenant Janvier de la Motte, faisant valoir sa connaissance approfondie du théâtre des opérations, demandait instamment à y être envoyé. Nulle objection ne put vaincre sa généreuse insistance. Le général Galliéni, qui appariait ce brillant officier à sa haute valeur, le désigna comme adjoint au commandant des troupes en opérations. Jamais fonction de confiance ne fut plus dignement remplie. « Intelligent, très dévoué et très travailleur, excellent topographe, il a été en tout temps pour moi un précieux auxiliaire écrivait le chef de bataillon Vache, qui l'avait en grande affection.
à
»,
Après avoir secondé, avec le zèle le plus éclairé, cet officier supérieur dans le commandement de la province, le lieutenant Janvier de la Motte l'accompagnait dans une expédition contre B.efanoha, un des chefs rebelles les plus compromis dans les massacres, et qui s'était fortifié dans un massif montagneux dont la sauvagerie ne le cède en rien à celle de ses habitants et dont le parcours exige des troupes en opérations des efforts surhumains. Le lieutenant Janvier de la Motte supportait vaillamment fatigues et souffrances. Le 20 janvier 1905, il se distinguait d'une manière exceptionnelle en entraînant un groupe de partisans à l'assaut des repaires d'Itsiakara, d'où Befanoha était chassé malgré une vigoureuse résistance. Rentré à Faranfagana avec son commandant, le lieutenant Janvier de la Motte devait en partir bientôt de nouveau. Kotavy, l'assassin du lieutenant Baguet, chassé par nos troupes de la zone côtière, s'était jeté, avec un fort groupe de rebelles bien armés, dans les grottes presque inexpugnables d'Iabomary, formées d'un amoncellement de rochers gigantesques, recouverts d'une épaisse forêt. Le commandantVache décida d'attaquer cette position, le 15 avril 1905, et confia à son officier adjoint, sur sa demande, le commandement d'une section de tirailleurs sénégalais. A une heure quinze du soir, le lieutenant Janvier de la Motte, ayant atteint péniblement les abords escarpés dela position, lançait ses fougueux Sénégalais à l'assaut, sous un feu rapide des plus meurtriers, lorsqu'atteint d'une balle à la tête, il tomba foudroyé, au pied même des retranchements ennemis. Le lendemain, il était provisoirement inhumé dans le poste de Befotaka, dont la garnison, douloureusement impressionnée, rendait les honneurs au vaillant officier. Le corps a été ramené en France, en 1906.
SUD-ORANAIS ATTAQUE DU BLOCKHAUS DE BOU-DENIP
(1er
au 2 septembre 1906)
-
Brillante défense du lieutenant Vary.
Le
sergentKœnig
De brillantes opérations furent effectuées en août et septembre 1906 dans le Sud-Oranais par une colonne appelée « Colonne du Haut-Guir sous les ordres du colonel Alix et du commandant Fesch. Le poste de Bou-Denib, dans lequel commandait le commandant Fesch, fut tout à coup attaqué par la barka de Tazzougert. En avant de ce poste se trouvait un blockhaus, devenu fameux, commandé par le lieutenantVary, qui subit un siège dont le souvenir mérite d'être conservé. Voici le récit de ce remarquable fait d'armes établi par l'Etat-Major général de l'Armée Le 1er septembre, au matin, une agitation inusitée se manifestait dans les camps de la harka des rassemblements importants se formaient sur la. gara de Djorf, autour du bordj. Le lieutenant Vary, qui les suivait attentivement de son poste d'observation, signala, dès sept heures, des cavaliers s'avançant vers Bou-Denib. Bientôt, une ligne continue d'assaillants garnit tout l'arc de cercle entre l'oued Guir et la carrière elle ouvre le feu auquel répondent l'artillerie et les mitrailleuses du poste. Du côté de la redoute, le combat se poursuit ainsi sans modifications jusqu'au soir; les cavaliers et fantassins marocains font preuve d'une audace inouïe, les premiers viennent pa-
:
»,
:
;
;
rader jusqu'à 400 mètres de nos fusils, les seconds s'embusquent, par groupes, à 300 mètres des murs des ouvrages. Vers huit heures trente du soir, malgré le feu de l'artillerie, l'attaque ne se ralentit pas un deuxième assaut a lieu et, comme la précédente, cette nouvelle tentative de l'ennemi reste sans résultat, grâce au moral des défenseurs qui ne faiblit pas. Les hommes, qui n'ont rien mangé depuis le matin, se plaignent de la soif une double corvée d'eau est organisée, deux tirailleurs à chaque étage font boire leurs camarades. C'est vers dix heures que se place l'instant le plus critique de cette nuit émouvante l'assaut que livrèrent alors les Marocains dépasse tous les autres en furie. Malgré un feu terrible, les assaillants franchirent la palissade en fil de fer. qui bordait la plate-forme Est de l'artillerie, et escaladèrent le mur de soutien de cette plate-forme plusieurs d'entre eux parvinrent même auprès dela porte de la cour du blockhaus. Tandis qu'ils s'y réunissaient, le sergent Kœnig, chargé de la défense du rez-de-chaussée, lança à la main, au milieu du groupe, trois couples de pétards de mélinite qui supprimèrent le plus imminent du danger et firent évacuer la plate-forme. C'est à ce moment que le commandant Fesch ne pouvant détacher son esprit de la poignée de braves qu'une pareille marée humaine pouvait à la fin submerger, demanda à plusieurs reprises par le télégraphe — Comment ça va? A quoi le lieutenant Vary répondit — Toujours cernés, mais comptez sur nous Deux fois encore, vers onze heures trente et vers une heure du matin, l'ennemi reprit l'assaut et, de nouveau, le sergent Kœnig dut se débarrasser avec un couple de pétards du groupe le plus pressant. La fatigue des défenseurs était extrême et
;
;
:
;
:
:
!
la chaleur telle que plusieurs hommes s'étaient à demi dévêtus, deux d'entre eux tombèrent d'épuisement etfurent remplacés de suite aux meurtrières par des tirailleurs disponibles. V-ers deux heures trente, le tir de l'ennemi se ralentit il semble qu'il se soit lassé à la suite de ces cinq assauts infructueux. Peu à peu, les coups de feu s'espacent; on ne voit plus çà et là que quelques isolés cherchant à enlever des cadavres. Aux premières lueurs de l'aube le silence est complet, les Marocains ont disparu, c'en est fini de cette lutte harassante de dix-huit heures, et, quand le jour paraît, l'héroïque petite troupe, sortant sur le terre-plein, rend les honneurs à ce drapeau, déchiqueté par les balles, qu'elle a si vaillamment défendu et qui, grâce à elle, flotte plus fièrement que jamais sur Bou-Denib. On trouva sur le terrain quarante et un cadavres les traces de sang, les morceaux de cervelle et de chair qui jonchaient le plateau, témoignaient du nombre de ceux qui avaient été enlevés. De son côté, la garnison du blockhaus avait un homme tué et sept légèrement blessés..
;
;
MAURITANIE
COMBAT DE NIÉMELANE
(25 octobre 1906)
Mort héroïque du lieutenant Andrieuœ Le fort Coppolani, à trente jours de marche de SaintLouis, se trouve en Mauritanie, près du village de Tidjikdja, dans le pays qui sépare le Sénégal du sud duMaroc. C'est le point extrême de la pénétration française de ce côté. Un détachement de 120 hommes sénégalais, commandé par le capitaine Tissot, en formait la garnison; les lieutenants Andrieux et de Franssu, les deux sergents Fleurette et Philippe étaient les seuls français. Le capitaine Tissotavisé, le 23 octobre 1906, que les Maures menaçaient sérieusement nos avant-postes, décida contre eux
t
l'envoi d'une expédition. D'après les renseignements recueillis, l'ennemi était au milieu des fourrés dans le fond de la vallée. Il y avait un peu plus de 300 hommes. Les goumiers maures sont envoyés aussitôt pour faire la reconnaissance, Ils rentrent le24 dans la matinée et confirment ce qui avait été dit. L'ennemi se trouve dans le fond d'une vallée assez encaissée; il se garde certainement fort peu la nuit. De plus, les fractions du Tagant et même du Reigneba, sont toutes à proximité des tentes du chérif et sans doute prêtes à se joindre à lui. Une surprise a donc des chances de réussir. Le commandant du cercle se décide à la tenter. Le matin, à trois heures, un détachement comprenant deux lieutenants, deux sergents européens, 59 tirailleurs et 15 goumiers maures montés à
chameaux est mis en route sur Niémelane. Les tirailleurs sont munis de 150 cartouches et de quatre jours de vivre. Le lieutenant Andrieux qui commande la colonne a l'ordre de disperser la bande ennemie. Arrivé à l'oued Delbougui, le détachement quitte la piste pour ne pas être signalé au bivouac à deux kilomètres de ce cours d'eau. Vers minuit, il se remet en marche conduit par le guide que lui avait donné le commandant du cercle avant le départ. La nuit était alors obscure et il n'y avait pas de lune. Après avoir marché pendant environ quatre heures, le guide vient dire au lieutenant Andrieux qu'il est perdu, qu'il ne sait plus retrouver où il est et que par conséquent, il ne peut s'engager à conduire exactement pendant la nuit le détachement au point qui avait été convenu. Le commandant du détachement forme alors le bivouac et interroge les goumiers maures qui connaissent le pays. Comme aucun d'entre eux ne peut renseigner exactement sur le point où il se trouve actuellement, il se décide à attendre le lever du jour avec l'intention de chercher un point d'eau et de remettre au lendemain l'opération. Malheureusement il n'en eût pas le temps. L'ennemi, en nombre imposant, bien armé, complètement fanatisé, vient surprendre la colonne. Nos soldats étaient pleins d'entrain, mais n'étaient pas en nombre suffisant ils furent écrasés. Blessé à la cuisse gauche, dès le début de l'action, en se lançant en avant à la baïonnette, M. Andrieux conserva néanmoins son commandement et fit son devoir, comme un brave. Entouré par un ennemi insaisissable, qui ne cessait de le harceler, il persista à se tenir debout ou à genou au milieu de la grêle de balles, cherchant par ce moyen à soutenir le moral de ses subordonnés et de ses tirailleurs.
:
C'est en refusant de se dissimuler, de se coucher comme le lui recommandait le sergent européen Philippe, qui se trouvait auprès de lui, qu'il reçut le coup mortel. Une balle le frappa à la tête et le tua net. Le combat dans la suite fut tellement violent qu'il fut impossible de ramener son corps au poste, qui fut lui même attaqué dans la journée et cerné pendant plusieurs jours. Une colonne de secours put arriver à temps et dégager le fort. Le capitaine Tissot fit alors rechercher le corps du lieutenant Andrieux; qui avait été enfoui par les indigènes, et le transporta au poste, où on lui rendit les honneurs. La famille l'a fait depuis exhumer et ramener en France.
DAHOMEY
COMBAT DE MITRO
(27
mars 1890)
Mort du capitaine Oudard Après la résistance héroïque de Kotonou (4 mars 1890), le commandant Terrillon résolut de nettoyer les environsde Porto-Novo et d'en chasser tous les Dahoméens qui s'y
rassemblaient. Le 27 mars, il se met en route par la rive gauche de l'Ouémé, accompagné de la chaloupe canonnière Emeraude avec deux compagnies et demie de tirailleurs sénégalais, 40 tirailleurs gabonais, une section de 4 de montagne. Le chemin à suivre est des plus difficiles; il coupe des forêts impénétrables. Impossible de surveiller les flancs et pour avancer on est obligé de fouiller les coins douteux par des feux de salve. Après avoir franchi avec beaucoup de difficultés une colline argileuse, l'avant-garde arrive sur des groupes de villages auxquels elle met le feu pour déloger l'ennemi qui s'y trouve en force. Une vive fusillade part de tous côtés; on voit des Dahoméens partout, sur les arbres, dans les broussailles, dans les maisons. A Mitro, le capitaine Oudard qui marche en tête de sa compagnie de Gabonais, s'aperçoit que l'une des cases offre de la résistance il y pénètre bravement, mais à peine y estil entré qu'une balle vient le frapper dans le ventre il meurt aussitôt.
;
;
Au même moment, le sous-lieutenant Monnet, de la 4e compagnie, tombe mort d'un coup de chaleur. La rage au cœur, les tirailleurs se précipitent et ne tardent pas à débusquer les adversaires pendant que l'artillerie démolit le campennemi. Les Dahoméens se retirent rapidement; c'est une fuite désordonnée dans toutes les directions. Pour en finir, le feu est mis aux cases, puis les hommes s'installent pour passer la nuit, aux alentours ils étaient épuisés. « Dans cette journée pénible, nos soldats avaient montré une fois de plus leurs brillantes qualités militaires, marchant et combattant pendant neuf heures, au milieu de forêts inextricables, dans des marécages où ils enfonçaient jusqu'à la ceinture », a écrit à propos de ce combat un officier supérieur. Ce brillant fait d'armes qui, malheureusementnous coûtait cher, méritait d'être porté, ici, à l'actif de nos solides troupes coloniales.
:
MADAGASCAR
ATTAQUE DU CONVOI D'ANKAVANDRA (9
août 1897)
Mort du sergent Bruneau Le 8 août 1897, un convoi de trente bourjanes portant des munitions et de l'argent quittait le poste deTsiroanomandidy, à destination d'Ankavandra, sous l'escorte d'un caporal de six tirailleurs sénégalais commandés par le sergent Bruneau, de la 3e compagnie du régiment colonial. Le 9 août, vers onze heures du matin, au passage d'un cours d'eau, le petit détachement se trouve tout à coup en présence d'un fort parti de Sakalaves qui, embusqués derrière les arbres et dans les hautes herbes, ouvrent le feu sur l'escorte pour chercher à s'emparer du convoi. Le sergent Bruneau, sans se laisser effrayer par le grand nombre de ses adversaires, donne ses ordres avec le plus grand sang-froid, rassemble le convoi et dispose sa petite troupe pour répondre au feu nourri des Sakalaves. Au deuxième feu de salve, il tombe mortelle-
et
ment frappé d'une balle à la tête. Le caporal Allah Dimou Sisoko prend aussitôt le commandement, mais tombe bientôt à son tour, la cuisse fracassée par une balle. Il n'en continue pas moins à diriger le feu et à tirer assis jusqu'à ce qu'il meure, atteint par une nouvelle blessure à la tête. Le tirailleur de lre classe Samba Denfako le remplace et, bien que blessé lui-même au bras gauche, il ne cesse de diriger le tir de ses camarades agenouillés autour des caisses de munitions et d'argent abandonnées de leurs porteurs et confiées à leur honneur militaire. Les Sakalaves subissent
la
crâne attitude de cette des pertes sérieuses, et,intimidés-par poignée de braves, ils n'osent prendre l'offensive et finissent par s'éloigner, au moment où un groupe de partisans du Mandridano, accouru au bruit de la fusillade, apparaît sur la hauteur voisine. Le général Galliéni rendit hommage à tous ces braves et dans un ordre général adressé aux troupes signala la brillante conduite du sergent Bruneau et de ses sept sénégalais.
SÉNÉGAL
PRISE DE DABA
(janvier 1883)
Courage du capitaine Combes. — Mort du lieutenant
Picquart.
à
Ayant appris que Samory voulait s'installer Bammakou, pour nous empêcher de prendre pied sur la rive droite du Niger, le lieutenant-colonel Borgnis-Desbordes, commandant supérieur de la région, résolut de l'y devancer. Une colonne composée de 542 combattants, dont 29 officiers, 4 canons, 783 laptots ou âniers, 677 animaux de convoi, partit le 22 novembre 1882 de Sabouciré. Au passage du Daoulé, le capitaine Piétri, commandant l'avant-garde,fut reçu à coups de fusil par les gens du village de Daba situé non loin de là. Un fort tata dont l'épaulement atteignait ou dépassait souvent 1m. 20 faisait le tour de la ville ce tata avait la forme d'un quadrilatère. Toutes les maisons étaient de vraies casemates entourées, elles aussi, de petits tatas qui se reliaient les uns aux autres, ne laissant pour la circulation que des rues tortueuses et étroites n'atteignant quelquefois que 60centim. Deux pierriers et deux espingoles pris à la mission Galliéni, en 1880 (combat de Dio), étaient placés sur le rempart. L'artillerie ouvrit presque aussitôt le feu sous la direction du capitaine de Gasquet. Le tir étant juste, la brèche se faisait peu à peu; en outre, les obus désorganisaient la résistance. Cependant,lorsque le canon cessa de tonner, tous les habitants se précipitèrent vers la brèche pour nous résister et empêcher l'assaut.
:
;
Pendant ce temps, la colonne d'assaut s'était formée elle comprenait une compagnie de tirailleurs sénégalais, derrière laquelle devait marcher une compagnie d'infanterie de marine. Le capitaine Combes en prend le commandement et s'assure que tout est prêt. Le capitaine lève alors son sabre, le clairon sonne la charge et la colonne s'avance au pas de course. Un feu violent l'accueille sur tout le pourtour du tata et principalement en arrière de la trouée. Le capitaine Combes monte le premier sur la brèche. Les défenseurs sont vite délogés de leur première position, mais la lutte fut, dans l'intérieur du village, beaucoup plus longue et opiniâtre. Les Bambaras, retranchés derrière chaque mur, nous disputaient le terrain pied à pied; les soldats montaient sur le toit des cases, franchissaient les murs, enfonçaient les portes. Les clairons sonnaient toujours entraînant les hommes. A midi, après une heure et demie de lutte, le village était pris, malheureusement, la compagnie de tirailleurs avait ses quatre officiers blessés, dont un, le lieutenant Picquart, mourut le soir, et vingt-six hommes blessés. La compagnie d'infanterie de marine avait son officier tué et treize hommes blessés, sur un effectifde soixante-quatre combattants. Tout le reste du pays fut rapidement pacifié et la colonne put marcher sans nouvelles entraves sur Bammakou.
MAROC COMBAT DE BER-RECHID
(2
février 1908)
Mort du lieutenant Ricard et des brigadiers de Kergorlay et Rousseau Le 2 février 1908, vers une heure de faprès-midi, le demirégiment du 3me chasseurs d'Afrique, commandé par le chef d'escadron des Moustiers-Mérinville, était en marche après un premier contact avec les Marocains pour chercher une nouvelle position de combat à pied. Une première charge dégagea le front de la colonne. Mais beaucoup de chevaux avaient été tués, et, à cause du nombre de cavaliers démontés qu'il fallut prendre en croupe, la charge ne put être poussée à fond l'audace de l'ennemi s'en accrut. Comme les cavaliers marocains, harcelant nos troupes, en retardaient la marche, le chef d'escadron, vers une heure dix, donna aux lieutenants Ricard et Bonnaud, commandant les deux pelotons de queue, l'ordre verbal de charger les groupes les plus rapprochés, sans pousser à plus de 500 ou 600 mètres. L'ordre fut exécuté aussitôt, et, quand les pelotons, ayant dégagé la colonne, se trouvèrent à environ 600 mètres, le commandant fit sonner, à trois reprises, le ralliement. Le peloton Bonnaud et la plus grande partie du peloton Ricard rallièrent. C'est alors que le lieutenant Ricard se laissa entraîner par son tempérament téméraire à continuer la charge et, malgré les sonneries répétées, au lieu de revenir vers le demi-régiment dont il venait de dégager le flanc droit, il se rabattit sur sa gauche et, suivi de quelques hommes seulement, s'élança sur un groupe important de
;
Marocains qu'on apercevait dans la plaine. Au galop, les cavaliers français traversent une première troupe ennemie composée d'une soixantaine d'hommes; le chasseur Rousseau est tué. Le lieutenant Ricard et ses compagnons vont encore de l'avant ils atteignent un second groupe de Marocains, plus nombreux que le premier, ils le traversent. Alors, seulement, ils font demi-tour et réussissent à revenir sans encombre jusqu'au parti ennemi, au milieu duquel Rousseau était tombé. A ce moment une mêlée se produit, tandis que les brigadiers Le Boisselier et Artis, qui avaient vu le danger couru par leur lieutenant et leurs camarades, arrivent à leur secours. Le lieutenant Ricard a son cheval tué sous lui. Il refuse celui du chasseur Plas; puis, ce dernier essayant, avec le brigadier Artis, de l'entraîner loin du combat, il se dégage, réussit à saisir la carabine de Plas et abat trois cavaliers ennemis. Le chasseur de Kergorlay, - qui cherchait à le protéger derrière son cheval, tombe mortellement frappé d'une balle à la tête. Le lieutenant Ricard réussit encore à tuer, avec son revolver, un quatrième Marocain puis, atteint de deux balles, dont une au cœur, il tombe à son tour. Malgré les efforts héroïques des brigadiers Artis et Le Boisselier, et des chasseurs Plas et Vialla, pour reprendre à l'ennemi le corps,de leur officier, force leur fut de l'abandonner. Accablés par le nombre, ils furent refoulés sur leur escadron, épuisés et leurs sabres rouges de sang. Sur l'ordre du chef d'escadron, une nouvelle tentative fut faite aussitôt pour reprendre aux indigènes les corps de nos morts. Elle ne put réussir à cause de la présence de blessés et de cavaliers démontés, qui empêchait les allures vives. Un peu plus tard seulement, le lieutenant Holz, commandant le goum, découvrit le corps de Ricaid, de Kergorlay et de Rousseau. Les deux premiers étaient décapités.
;
:
HAUT-SÉNÉGAL
PRISE DE SÉGOU (6
avril 1890)
Après la prise de Koundian (février 1889), Ahmadou s'allia définitivement avec Samory; des mouvements hostiles se dessinèrent alors sur toute la ligne de nos postes. Partout on signalait des villages pillés, des femmes ou des enfants enlevés, des razzias faites jusqu'aux environs mêmes de Kayes et de Médine. Sur le Niger, le fils d'Ahmadou, Madani, qui commandait à Ségou, interdisait la navigation. Aucune pirogue ne pouvait plus passer, malgré les efforts actifs de deux de nos canonnières. Le Commandant Archinard résolut de s'emparer de Ségou, principale citadelle de l'Islam au Soudan. Cette opération exécutée à plus de 1.000 kilomètres de toute base d'opérations était très hardie la réussite résidait dans le secret et la célérité. Il partit le 15 février 1890, du camp de Longton, près de Médine, avec 600 tirailleurs sénégalais, 20 hommes d'infanterie de marine, 40 spahis, 8 pièces de canon et 1 mortier ainsi qu'avec 1.500 auxiliaires indigènes. En outre, en prévision du passage du Niger, puisque Ségou se trouve sur la rive droite du fleuve, une flotille de pirogues, préparée en secret à Bammakou, descendit le fleuve, sous le commandement de l'enseigne de vaisseau Hourst. La colonne arrive devant le fleuve le 6 avril au matin. Les sections d'artillerie, placées sur la rive gauche, dominent la ville et ses divers édifices.
;
Les troupes se reposent un instant et prennent leur repas du matin. Le passage commence à neuf heures, pendant que les pièces de 80 ouvrent le feu sur les groupes d'indigènes qui s'amassent en dehors de la ville. Après quelques coups bien ajustés, tous s'enfuient en désordre. Les trois compagnies embarquées attendent dans une île placée au milieu du Niger que l'artillerie vienne les rejoindre. Elles ne débarquent qu'à onze heures et demie sur l'autre
rive.
Le chef du village de Somonos vient faire sa soumission pendant que l'attaque de Ségou commence. Les murs en
terre pétrie et agglomérée ont trois mètres d'épaisseur : ils résistent assez bien à notre feu. Le débarquement de toutes les troupes achevé, le lieutenant Sansarric, de l'infanterie de marine, reçoit l'ordre d'entrer dans la ville et de pousser jusqu'au trésor d'Ahmadou placé dans un tata central. Dès que les indigènes voient nos braves marsouins se jeter en avant, ils se précipitent au dehors et fuient à toutes jambes dans la campagne. A une heure et demie, le feu cesse il ne restait plus de défenseurs dans la ville. Dans le tata d'Ahmadou on trouva toutes les femmes de ce chef qui avaient été abandonnées. La prise de Ségou ne coûta au corps expéditionnaire que • des fatigues, mais le résultat de cette affaire fut immense. Elle eut un retentissement jusque dans le centre de l'Afrique et ruina, à tout jamais, l'empire musulman d'Al-HadjOmar.
;
OUADAÏ
PRISE D'ABÉCHER (1er
juin
1910)
Mort du capitaine Fiegenschuh. — Héroïsme du lieu-
tenant Bourreau.
-.
La
eise
d'Abécher ne fut point un coup de force irréfléchi. Le capitaine Fiegenschuh et ses braves y pensaient depuis de longs mois ils voulaient conquérir Abécher : ils l'ont conquis. L'héroïque capitaine n'était point un homme à reculer. Quand une fois il avait décidé quelque chose, rien ne pouvait l'arrêter. Le danger pour lui n'existait pas il était brave jusqu'à la témérite la* plus folle. « Il avait tous les courages, disait de lui un de ses subordonnés, sauf celui de la prudence. » Le 31 mai, nos vaillants soldats étaient près d'Abécher. Devant eux il y avait une ville fortifiée, avec quatre mille fusils à tir rapide manœuvrés par des guerriers excellents, et chacun de ces guerriers avait derrière lui d'autres hommes prêts à saisir l'arme qu'il laisserait tomber. Eux, ils étaient deux cent quarante, et derrière eux il n'y avait que le désert à l'infini. Le poste le plus proche était à 300 kilomètres. La retraite était impossible c'était pour tous la victoire ou la mort. Le 1er juin, l'action décisive s'engagea. La fusillade éclata, meutrière. Dès les premiers coups, Fiegenschuh tomba, la gorge traversée d'une balle. La bouche pleine de sang, il ne pouvait articuler un mot. Il fit un signe, le lieutenant Bourreau accourut. Sur un papier, au crayon, il écrivit « Le ca-
;
;
:
:
pitaine Fiegenschuh, blessé, transmet le commandement au lieutenant Bourreau. » Bourreau prit le commandement, fit évacuer à l'arrière le blessé qu'on pansa tant bien que mal. C'était le soir. La nuit tomba sur le désert immense. Nos héros entendirent alors les clameurs de joie des ennemis. Ils savaient déjà que le grand chef blanc était blessé et ils escomptaient la victoire comme certaine. Le lieutenant Bourreau était brave, comme tous les braves qu'il avait avec lui. Mais.il était tout jeune, et il sentait peser de tout son poids l'effroyable responsabilité que le chef, en tombant, lui avait laissée. Cependant, il avait dit à Fiegenschuh le matin — Nous marcherons comme si vous étiez-là. Abécher sera pris. Et il tint parole. Au petit jour, l'action de nouveau s'engagea. Bourreau, à la tête de sa petite troupe, avança près des murs et mit en batterie les deux canons dont il disposait. Et alors il se passa cette chose admirable quand il entendit le canon, Fiegenschuh, qui, une minute avant râlait, se leva debout sur sa civière. On se battait il voulait voir. , Au plus fort de la mêlée, un parlementaire s'avança vers notre petite armée. C'était un gosse. Il dit que les guerriers, démoralisés par notre artillerie, voulaient se rendre. Il demanda les conditions. répondit Bourreau. — Pas un homme armé dans la ville, C'est ma première condition. A trois heures de l'après-midi, le 2 juin, la petite troupe, sous les ordres de l'héroïque lieutenant, faisait, dans Abécher son entrée triomphale. Au milieu des rangs, la civière de Fiegenschuh. Il rayonnait, l'admirable capitaine. Quand ils pénétrèrent dans la ville, tous ces braves, qui, depuis des
:
:
:
mois et des mois, avaient sans murmurer supporté tant de privations et de souffrances, qui allaient au feu comme à la fête, furent pris d'une telle émotion qu'ils se mirent à pleurer. C'est Bourreau lui-même qui a rapporté ce trait
surprenant. Dans Abécher on trouva des armes, des munitions en quantité. Il y avait notamment 900 fusils Gras, modèle 1874. Le soir, sur un bout de papier, Fiegenschuh écrivait ces quelques mots « Félicitations à tous. Merci de tout cœur. » Hélas, la guérison n'était pas possible et le capitaine Fiegenschuh mourut de ses terribles blessures.
:
MAROC
COMBATS DU SOUK-EL-TENIN
-
(29 février 1912)
Mort du lieutenant Bataille, du -maréchal de logis Didier, etc. Les troupes avaient bivouaqué la veille et la nuit précédente à Aïn-Mekoune. A trois heures du matin, le camp est levé et les quatre colonnes du Littoral, du Tirs, Brulard et Taupin se sont dirigées sur Aïn-Mekoune.Vers huit heures, après quelques échanges de coups de fusil aux avant-gardes, les batteries de 75 prennent position et entrent en action. La colonne avait pris Aïn-Mekoune comme objectif, afin d'y attendre le convoi de ravitaillement et. de munitions venant de Mediouna. C'est à ce lieu de rendez-vous que la colonne du Littoral prit position ayant la colonne Brulard à sa gauche, celle du Tirs à sa droite et la colonne Taupin en arrière, pour la protection du convoi. Les Marocains, peu nombreux, sont tenus en respect jusqu'à 11 heures par un feu lent. Vers midi, les chasseurs d'Afrique préposés à la garde d'une position voient un gros de Marocains arriver sur eux. Ils sont six pelotons un escadron du 1er régiment, capitaine Blasselle, et deux pelotons du 5e; ils font combat à pied. Mais, devant le nombre des adversaires qui approchent jusqu'à 50 mètres, le premier peloton charge. Il a deux blessés laissés sur le terrain. Le second peloton charge à son celui-ci perd aussi plusieurs hommes. tour Les six pelotons se lancent successivement dans une
:
;
charge furieuse pour relever les leurs. La mêlée est effroyable, indescriptible. Les chasseurs font un carnage terrible. Le champ de bataille est jonché de cadavres de Marocains. Malheureusement ces charges nous coûtent onze tués et de nombreux blessés. Les tirailleurs arrivent alors. Ils repoussent l'ennemi et relèvent les morts. Un des cadavres avait été décapité. De son côté, la colonne Brulard avait deux tués et dix blessés. A quatre heures, nos troupes sont maîtresses du terrain et rentrent à Aïn-Mekoune, où elles campent. Voici les pertes déplorées par le 5e régiment de chasseurs le maréchal des logis Didier, les chasseurs Bergeron, Condé, Lardier, Ciccodi, Guidice, Bonin, Martinelli, tués. Les.lieutenants Merle et Vallée; le maréchal des logis Granger, les chasseurs Turquois, Malton, Vergues, Roart, Ballot, Lacrox, Camigli, Muller, Tétrault, Desmarais, Avéroux, Arnaud, Sabatier, blessés. La colonne Taupin avait soutenu de son côté deux rudes attaques des Berbères qui coutèrent la vie au lieutenant
:
d'Ampotaka. d'Andriba. Sambirano. Tsarasotra. d'Ampanotokama.
Combat Combat Combat Combat de Combat de Défense Défense de Tamatave Prise de Marovoay Prise de
d'Ambiki.
:
Maroc
Combat de Ber-Réchid Combats du Souk-el-Tenin Mauritanie Combat de
: : :
Ouadaï
Prise
.,.
,. Nièmelane.
Tananarive.
:
,.r<
Sahara Massacre de Dongoï Prise de Sénégal Combat de Diamonkos Combat de Dio Combat de Prise de Daba Prise de Goubanko Prise de Soudan Affaire du Marigot de Fatako Combat de Capture de Défense de
:
.,
d'Abécher.
, Kokonna.
Tombouctou.
Ségou
.,
Dori. , Samory Bla
,, , ,
Kokaro. Nafadié
Koudian.
Prise de Prise d'Ouessébongou Prise de Sikasso
PAGES.
178 169 150 85 71
9 77 140
98 196 203 187 200 55 55 134
5 134 194 125 198 167 63 127 106 46 46 12 143 39
PAGES.
Sud-Oranais : Attaque du Blockhaus de
: :
Bou-Denib.
c
Tchad
Koussouri.. Tonkin Attaque d'Hanoï Combat de
Combat de Bang-Bo Combat de Caï-Tram Combats et prise de Combat de Combat de la Tombe-du-Pontonnier Défense de Défense héroïque de Pho-Binh-Gia Prise Première prised'Hanoï
Lang-Man. Quoï-Dang.
acham.
N
d'HaÏ-Dzuong.
Nam-Dinh. Ninh-Binh.
Pan-Aï. Sontay. :
Premièreprisede
Prise de Prise du Prise de Tunisie Combat de Ben-Métir Combat du Prise de Kairouan
184 119 137 28 102 132 158
48 44 91
82 111
74 61
172 15
Djebel-Sekkek104 87
165
TABLE DES GRAVURES
PAGES.
Affaire de Bang-Bo Assassinat du capitaine Lunier Le lieutenant Maquard à la prise de Sontay Les dernières
Portraits:
cartouches.
colonel lieutenant-colonel capitaine
Archinard, Audeoud, Baud, Bayol, lieutenant-gouverneur Behanzin, roi diidahomey Bellamy, Boiteux, lieutenant de vaisseau Bonnier, lieutenant-colonel Braulot, Castanier,
57 21
capitaine
lieutenant Colomb (de), lieutenant
colonel. lieutenant. capitaine colonel. docteur. lieutenant
général
Faurax, commandant Flayelle, Galliéni, Gillon,
général
Harmand, Hautefeuille, aspirant de marine Lentonnet, commandant Marchand,
,
commandant. amiral.'- ,
Miot, Négrier (de),
général
17 155
134 40 162 96 37 89 56
capitaine
Destoup, Dodds, Duchesne, Ducongé,
32 25
77 34 26 108
98 92 69
52 6
170 83 61
72 13
128 28
PAGES.
ROUEN
IMPRIMERIE J. GIRIECD
1912