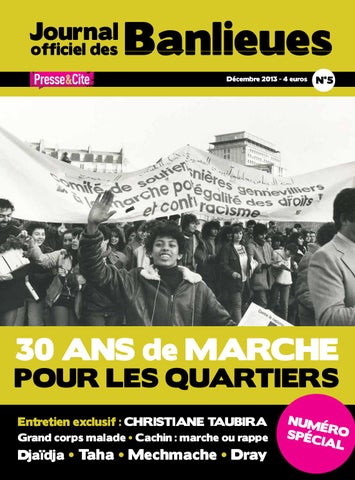Journal officiel des
Banlieues Décembre 2013 - 4 euros
N°5
30 ans de marche
pour les quartiers Entretien exclusif : christiane taubira
Grand corps malade • Cachin : marche ou rappe
Djaïdja • Taha • Mechmache • Dray
num éro spéc ial
Sommaire 14
10
Les mythes de la Marche
13 Gandhi
Dossier 1983 - 2013 : une génération qui a changé la culture
44
07 . Mémoire
3 2 . Grand corps malade
10 . Kit de désintox
42 . Médias de quartiers
08 . Mogniss Abdallah
Portrait Toumi Djaïdja
36 . Pascal Blanchard
Photo de couverture : Amadou Gaye. La Marche arrive aux Mureaux D’où venons-nous ? Journal officiel des banlieues n’est pas né en 2012. Il est le fruit de l’expérience d’une équipe plurielle, engagée dans une presse d’un nouveau genre, qui existe pour exprimer ce que les médias traditionnels ne veulent pas entendre : le récit de l’émergence d’une France nouvelle qui se bat pour être reconnue à part entière. Qui sommes-nous ? Ce média fait le pari d’une presse qui ne prête aucune allégeance à l’endogamie délétère des rédactions françaises, et revendique d’être produite par des journalistes issus de banlieue ou y travaillant depuis plus de dix ans. Que voulons-nous ? Produire les discours et récits qui nous permettront de ne pas nous enfermer dans des ghettos réels ou imaginaires ; sortir des marges de la société française pour en transformer le cœur. La rédaction Journal officiel des banlieues est édité par Presse & Cité, association loi de 1901, qui a pour objectif de réduire la fracture médiatique entre les banlieues et l’ensemble de la société française. Presse & Cité est une communauté d’une vingtaine de médias implantés dans les quartiers populaires. Elle défend ces médias et les habitants des quartiers auprès de la presse et des institutions, dans une logique d’intérêt général, et afin de changer le regard porté sur ces quartiers et populations. Presse & Cité organise chaque année des rencontres Médias-Banlieues et Université de la communication et des Banlieues. Presse & Cité est à la fois un média et un acteur social dont la vocation est de relier, dans un objectif de lien social, de participation démocratique et d’émancipation.
Flash code
2
Presse & Cité
Directeur de la publication : Farid Mebarki • Rédacteur en chef : Erwan Ruty • Rédaction : Mérième Alaoui, Anne Bocandé, William Bree, Charly Célinain, Mikael Corre, Thierry Grone, Maxime Hanssen, Camille Jourdan, Carlotta Macera, Sylvain Ortega, Marin Schaffner, Emma Roulin, Erwan Ruty, Jean Fabrice Tioucagna, Claire Tomasella, Yannis Tsikalakis, Julien Wagner • DA : CE, ER • Maquette : Charles Eloidin • Administration : Carmen Firan • Chargée de développement : Méva Raharisaina • Imprimé par : Copylis Siège commercial : Presse & Cité 25, rue du Chateau Landon 75010 Paris • Tél : 01 42 05 53 02 Site internet : www.presseetcite.info • E.mail : developpement@presseetcite.info • Numéro ISSN : 2268 5464
Edito rubrique
Visuel réalisé par ina.fr à l’occasion de la campagne « 3à ans de marche » dans le cadre du partariat Ina/P&C
L’encrier du roman national Les commémorations disent beaucoup de ce que nous traversons et des perspectives vers lesquelles il serait souhaitable de se diriger. La mémoire nationale, celle qui a su s’imposer à tous par le fait des institutions en gommant les aspérités locales et les interprétations minoritaires, parvient-elle toujours à réunir au-delà des appartenances et des clivages ? Lorsqu’en 1989 François Mitterrand mettait en scène, non sans heurts, le bi-centenaire de la Révolution française, il jouait la partition d’une République enfin apaisée avec ellemême. Une « République du centre » avec pour perspective la construction de l’Europe que les accords de Maastricht venaient d’accélérer, et l’ancrage dans la démocratie devenue indiscutable avec l’ébranlement du bloc soviétique et les massacres de Tian An Men. azertyu L’année 2013 marque le début des commémorations du centenaire de la Grande guerre. Et c’est sous les huées que le Président de la République a inscrit ces commémorations dans une perspective de concorde de tous les Français et de condamnation de toutes les haines et des intolérances. Le souvenir des fusillés et des troupes coloniales va-t-il contribuer à vivifier le récit national dans un contexte où le racisme le plus rance se pavane jusque parmi les élites de la République ? L’exécutif parviendra-t-il à refouler la « France moisie » qui éructe contre les Roms, la Garde des sceaux ou l’islam ? Rien n’est moins sûr. L’Europe et les valeurs qui la fondent, embolisées dans le sauvetage de l’Euro et la surveillance budgétaire, subissent l’usure des résurgences xénophobes venues de Grèce, de Hongrie ou d’Allemagne. Quant à l’exercice de la démocratie, il suinte la vieille supplique à l’homme providentiel et les demandes d’ordre moral, sexuel et identitaire. azertyu Dans ce contexte, le souvenir de la Grande guerre et des marches héroïques vers l’indicible âpreté du front, la fraternité avec l’indigène devenu frère d’arme, l’ennemi héréditaire si semblable sous la mitraille, ou vers les impitoyables sanctions nées d’un refus, d’un sursaut d’humanité, nous racontent les valeurs des hommes et des femmes de ce pays ; prêts à les confronter jusque dans la mort. Ces élans ne sauraient oublier ceux que l’on porte de notre vivant, telle cette Marche emmenée par la jeunesse des banlieues en 1983, qui témoigne que s’il est possible de mourir ensemble pour des valeurs, il est d’abord souhaitable d’essayer de vivre ensemble selon ces mêmes idéaux. azertyu Depuis le début de l’année, nombreux sont les acteurs en banlieue qui commémorent cette marche ; nombreux sont les marcheurs qui parlent enfin de cette épisode de l’histoire nationale et qui, à la colère et au saccage, ont préféré la citoyenneté et la fraternité. Dans des lieux parfois improbables, selon des modalités diverses, tous cherchent la page du roman national que voudra leur tendre la République pour qu’au bout de 30 ans, ils inscrivent à côté de ces marches qui font la France, la Marche pour l’égalité et contre le racisme. La marche qu’ils avaient imaginée pour unir le pays contre l’injustice faite à ces jeunes, morts parce qu’ils étaient Arabes ou Noirs. A cette main tendue, les pouvoirs publics hésitent et semblent s’interroger sur cette contribution au récit national. Le malaise est perceptible au point que c’est certainement depuis la Belgique, pourtant si désunie, qu’une initiative à la fois commémorative et réflexive affleure, à travers un film dédié à la Marche. L’encrier par lequel la banlieue exprime sa contribution à l’histoire de France, ne semble pas digne d’intérêt. A croire que les plumes qui brutalisent, raturent, dévoient le récit national depuis une dizaine d’années, ont suffisamment de contradicteurs. Farid MEBARKI Président de Presse & Cité 3
entretien exclusif
Christiane Taubira :
“ on a raté ce rendez-vous ” Selon Christiane Taubira, le 30ème anniversaire de la Marche a été raté par les pouvoirs publics. Elle l’a confié, en exclusivité, à un pool de médias partenaires de Presse & Cité, en marge d’une riche rencontre organisée le 1er décembre dernier au Sénat, à l’initiative de Pascal Blanchard et de l’Achac. Extraits en forme d’aveu d’une Ministre de la Justice qui reste néanmoins toujours combative. Propos recueillis par Mohad Aït Alibouch - Carole Dieterich - Moïse Gomis - Sebastien Gonzalvez - Rachid Najid - Erwan Ruty Photos : Anglade Amédée
Sebastien Gonzalvez / Lyon Bondy Blog : Un rapport de la Commission consultative des droits de l’Homme de mars dernier note une augmentation de 58% des actes antisémites, et de 30% des actes antimusulmans. L’Etat se donne-t-il suffisamment les moyens de lutter contre ces faits ? Christiane Taubira : J’ai diffusé une circulaire aux parquets, dès juillet 2012, pour demander de faire tout ce qui est possible pour lutter contre les actes racistes, antisémites, les discriminations et actes xénophobes. On a modifié les délais de prescription de trois mois à un an ; j’ai rappelé que l’on peut déposer plainte sans constitution de partie civile, et j’ai vérifié qu’il y avait bien, dans toutes les cours d’appel, des pôles anti-discriminations ou un magistrat référent dans tous les tribunaux de grande instance. Moïse Gomis / Radio HDR : Dans les quartiers, depuis l’époque de la Marche, il y a encore un rapport compliqué entre les habitants et la Justice ; qu’en pensez-vous ? Christiane Taubira : Il ne faut pas généraliser, mais il est aussi vrai que les rapports entre les citoyens des banlieues et les institutions en général doivent être améliorés, que cela soit avec l’école, les structures sociales ou la culture ; mais mon rôle a été tout d’abord de détacher la Justice du pouvoir politique. Elle doit protéger les citoyens les plus faibles. On peut discuter du ressenti ad vitam aeternam, il relève de ma responsabilité de faire en sorte que les délais soient respectés et que les moyens et effectifs sont là pour que la Justice fonctionne ormalement.
Il y a des mots à prononcer, des choses à construire, et ça ne peut se faire seulement par des associations dans des territoires limités. Carole Dieterich / Afriscope : Comment inscrire la Marche dans notre histoire nationale ? Christiane Taubira : On ne peut pas faire une loi mémorielle avec des aspects normatifs, comme sur l’esclavage. La Marche est un événement social, par lequel des gens ont décidé de s’affirmer dans la société et de donner des visages à la question des crimes racistes ; cela doit avant tout s’inscrire dans la mémoire collective et dans les politiques publiques. Les pouvoirs publics doivent seulement s’interroger aujourd’hui quant à savoir si la citoyenneté s’exerce de façon pleine et entière lorsque l’on affiche des différences visibles. Les dernières semaines ont rappelé que ce n’est pas gagné. Erwan Ruty / Presse & Cité : En France, l’histoire s’écrit par en haut ; or, l’Etat n’a pas pris la parole au sujet de cette marche, à l’occasion de ce trentième anniversaire… Christiane Taubira : Je le regrette. Dès le mois de mai, j’ai reçu à la Chancellerie des associations pour savoir ce qui s’organisait
4
et si se dessinait quelque chose avec une ambition nationale, qui s’adressait à l’ensemble de la société française. Il y a une responsabilité publique. On a raté ce rendez-vous, je le dis avec tristesse. Il y a des mots à prononcer, des choses à construire, et ça ne peut se faire seulement par des associations dans des territoires limités. Nous aurions dû avoir un grand rendez-vous. J’ai découvert des choses étonnantes, certains marcheurs disaient « c’est du passé, les jeunes ne savent pas que ça a existé ! » Mais si on n’apprend pas ce qui a existé, on ne peut s’inscrire dans une filiation, dire « je suis un héritier de luttes sociales émancipatrices. » Mohad Aït Alibouch / Kaïna TV : Les attaques racistes sont-elles plus violentes depuis que vous êtes ministre ? Christiane Taubira : Oui, incontestablement. Mais le plus grave, ce sont les paroles politiques. Indépendamment de ma personne, le racisme n’est pas une opinion, mais un délit qui touche des millions de personnes vulnérables. Et qu’on s’autorise maintenant plus ouvertement à la télé ou à la radio, sur la place publique, c’est un indicateur que la violence du rejet de l’autre s’accentue et que les gens se débarrassent des règles de la décence. Et si des gens sont travaillés par une incapacité structurelle, psychologique, à admettre l’existence et la présence de l’autre, qu’ils l’expriment chez eux face à leur miroir, mais pas dans l’espace public –il en va du pacte social, républicain.
spécial marche
L’année 1983,
tournant politique de la gauche La Marche dite « des beurs » n’est pas arrivée comme un coup de tonnerre dans un ciel serein : son succès, qui signait l’émergence médiatique et politique des « Français issus de l’immigration », intervient au moment où la gauche renonce à ses promesses sociales, et hésite entre humanisme et droitisation sur les questions sociétales. C’est ce qu’expliquait le colloque du CNRS en mars dernier à Paris consacré à cette année charnière.
L
Texte et photos Erwan Ruty
’historien Gilles Manceron campe d’emblée le décors de ces années : « 71 algériens sont assassinés en France dans les années soixante-dix, suite à des attentats revendiqués par l’extrême-droite. » Nous sommes dix ans après la fin de la guerre d’Algérie. En 1973, une succession de meurtres transforme Marseille en chaudron, rappelle Rachida Brahim, chercheuse à l’EHESS : « On y compte 14 morts en quatre mois, et dans tous les cas, les poursuites conduisent à des non-lieux ». En vingt ans, on pourra compter 200 homicides sur des maghrébins, selon ses calculs, dont « une trentaine lourdement pénalisés. Le plus souvent, ces actes sont considérés comme des délits et non des crimes ». Nous sommes avant le durcissement de la pénalisation du racisme, en 1992, suite à la loi Gayssot.
selon les sondages de l’époque, à en croire Alec Hargreaves, « seule la question de l’immigration est jugée comme différenciant la droite de la gauche ».
On voit des Arabes à la télé Dans les actualités ou les débats (au fameux « Apostrophes » de Michel Pivot comme aux « Dossiers de l’écran », émissions-phares des années 80), la France découvre ses immigrés et leurs enfants. Déjà ceux-ci, quand ils sont interviewés (et crèvent l’écran), contestent le discours dominant des élites qui hésite entre paternalisme et clichés que l’on dirait aujourd’hui racistes. En parallèle de l’essor du FN, on constate une très grande médiatisation de l’immigration. Si bien que bientôt,
Du péril rouge au péril vert Pour les conférenciers, les médias des années 80 auraient eu plutôt tendance à nuancer les discours anti-islam des politiques. Explication de Nicolas Bancel, historien spécialiste de l’histoire coloniale et post-coloniale : « On était après la libéralisation des ondes, de l’ORTF, après les radios libres, il y avait une liberté de ton inédite. Les journalistes avaient du temps, ils témoignaient d’une certaine empathie envers leurs sujets. » Selon Alec Hargreaves, « il y avait une certaine retenue dans les médias, avant la privatisation de TF1 par exemple : pas de concurrence et donc pas de course au sensationnel, contre les musulmans notamment. La vraie rupture date de 1989, selon lui. C’est là, au moment où le mur de Berlin tombe, où le péril rouge s’éloigne, qu’apparaît la première affaire du foulard, à Creil. L’islam entre alors vraiment à l’agenda politique, y compris au FN. » La peur d’une « cinquième colonne » musulmane en France émerge, au moment où la peur du communisme commence à s’estomper. C’est ce que Pascal Blanchard, du laboratoire de Communication politique du CNRS et directeur de l’Achac, résume par : « le péril vert remplace le péril rouge ».
Cette figure du jeune beur de banlieue éclipse celle du travailleur immigré.
Visuel de la série «Attention travail d’Arabe» Ali Guessoum / Agence Sans Blanc
Contexte social : 1983 et le tournant de la rigueur, déjà En 1973, le premier choc pétrolier, plonge l’Occident dans la crise économique. Le chômage apparaît. On arrête la construction des grands ensembles (circulaire Guichard, 1973). Le terrorisme d’origine moyen-oriental frappe la France, dans le droit fil du conflit israëlopalestinien, de la guerre du Liban, puis de la guerre Iran-Iraq. En 1979, l’ayatollah Khomeiny arrive au pouvoir en Iran. Il devient progressivement « l’ennemi extérieur »... Les difficultés rencontrées par la gauche dès son accession au pouvoir constituent aussi le fond du décors : économiquement, on passe de la « relance » en 1981, à la « rigueur » : c’est le fameux « tournant » de 1983, qui provoque un malaise, accentué par la défaite de la gauche aux municipales de 1983, notamment à Dreux, ville symbole où la droite conquiert la municipalité en s’alliant au FN. Un drame national. Jacques Attali, conseiller de François Mitterrand, le dira plus tard : avec la rigueur « on a repris en 1983 ce qu’on avait donné en 1981 », en terme de mesures sociales. La gauche se révèle impuissante face à la montée du chômage. C’est « la seconde mort des Trente glorieuses », remarque le sociologue Alec Hargreaves, spécialiste de la France à L’institut d’histoire française et francophone contemporaine (Floride). « Grèves chiites » : la parole politique se libère En 1980, la mairie PCF de Vitry expulse des travailleurs immigrés, dont le foyer est aussitôt rasé par les bulldozers. Tout un symbole. Fin 1981, les centres de rétention sont créés par la gauche. Et Gaston Deferre, ministre de l’Intérieur, se félicite des expulsions, rappelle Ludivine Bantigny, chercheuse à Sciences Po. Au moment des grèves de 1983 à PSA Aulnay, menées par des ouvriers majoritairement maghrébins, le même ministre, repris par le Premier ministre Pierre Mauroy, parle même de « grèves chiites » ! La peur du « vert » et Khomeiny semble faire perdre la raison des décideurs ! Pour Pascal Blanchard, « le PS voit la question de l’immigration comme une épine dans le pied qui lui fera perdre des voix. Moins on en parlera, mieux on se portera ». Ainsi, aux législatives de 1986, lors du débat télévisé Fabius-Chirac d’avant le scrutin, le
premier affirme ouvertement être en accord avec le maire de Paris sur son discours anti-immigrés et anti-étranger, pourtant extrêmement virulent.
La peur d’une « cinquième colonne » musulmane en France émerge, au moment où la peur du communisme commence à s’estomper. 5
Le moment où les beurs éclipsent les travailleurs immigrés A l’apparition des premiers rodéos, comme aux Minguettes (en banlieue de Lyon), « les journalistes ne savent pas trop comment se positionner », juge Edouard Mills-Affif. « On a alors une télé qui laisse parler les gens, voire même qui perd le contrôle de ses directs, face à la population locale. De nouveaux magazines apparaissent (Résistances, Gens d’ici etc), qui permettent à Antenne2 d’atteindre des sommets d’audience à 55%. Cette chaîne ouvre d’ailleurs son JT de 20 heures sur la marche. Marcel Trillat, un ancien qui vient du PCF qui a participé à la radio Lorraine Coeur d’Acier, créé le premier service société à la télé. Il négocie de présenter les extraits d’un film réalisé par des jeunes de Vitry, puis de les inviter sur le plateau. » Déjà on y entend : « les associations et les mouvements qu’on a créés n’ont rien donné, alors que quand les voitures brûlent, où une parole fait irruption, une gouaille populaire. Cette figure du jeune beur de banlieue éclipse celle du travailleur immigré. Ces derniers sont à la fois évacués du monde du travail, et évincés de toute représentation médiatique, et donc de la possibilité de jouer un rôle, d’exister socialement. »
spécial marche
La Marche « des beurs » vue du pouvoir
Le 31 mai 2013, Presse & Cité a réuni à Paris des personnalités de la Marche pour l’Egalité : Toumi Djaidja, son initiateur ; Samia Messaoudi et Marilaure Mahé, notamment. Ils ne sont pas encore arrivés. Les premiers auditeurs s’asseyent. Parmi eux, un vieux monsieur a pris place. Jean Blocquaux : un homme qui a fait l’histoire de cette marche... dans l’ombre. Et sort à la lumière pour la première fois. Avec ses dossiers jamais sortis jusqu’alors. Une page d’histoire de France surgit en direct.
Beur FM) est l’une de premières d’entre elles. Son impact est énorme. Certains de ses fondateurs, comme Samia Messaoudi, feront partie des marcheurs. Le nom même de cette radio a d’ailleurs été récupéré par la presse nationale vers la fin de la marche (Libération titrera ainsi en Une, le 3 décembre, à l’occasion de l’arrivée de la marche à Paris : « Paris sur beur »). « Il y a une vraie rupture avec la fin du contrôle de la communication de l’époque de Giscard. Nous, on ouvre la cocotte minute, et ça explose dans tous les sens. C’est Polac à TF1 (avant sa privatisation, avec son « Droit de réponse », une émission de plateau totalement libre et anarchique sur des sujets de société, impossible à imaginer, même aujourd’hui). C’est aussi un contexte où le droit d’association venait d’être accordé aux étrangers. C’est un terrain favorable ». Reste que la gauche, enfin au pouvoir depuis à peine deux ans, est encore sous le choc des émeutes des Minguettes (banlieue lyonnaise).
Dans les cabinets, il y avait des énarques qui avaient peur de ces jeunes issus des Minguettes, suite aux émeutes. Pour Jean Blocquaux : « Ces émeutes sont un traumatisme pour le gouvernement de gauche, qui met du temps à analyser ça : on était alors dans la « défense des droits des immigrés ». On n’avait pas identifié ces jeunes français et leurs revendications propres, la montée d’un racisme de vie quotidienne, les discriminations à l’embauche par exemple ; et la dégradation des relations entre la police et les jeunes. Il y avait bien des études sociologiques qui en parlaient, mais qui n’étaient pas remontées au niveau de la réflexion politique. Dans les cabinets, il y avait des énarques qui avaient peur de ces jeunes issus des Minguettes, suite aux émeutes. » Une marche rien moins que solitaire « Très rapidement, les marcheurs vont être reçus par les mairies, à Grenoble par exemple. La première personnalité nationale qui va à la rencontre des marcheurs est Edmond Maire, secrétaire général de la CFDT. Ensuite,
c’est Mme Dufoix, à Strasbourg, dans le quartier du Neuhof. Peu à peu, tous les politiques se précipitent pour aller à la rencontre des marcheurs : Lang, Cresson et tout. Des comités d’accueil de l’Eglise catholique ou protestante, parfois du PSU [parti autogestionnaire à la gauche du PS, ndlr], de la Ligue des droits de l’homme voire du PS s’impliquent dans les débats qui avaient lieu à chaque étape. Très tôt, avant même la marche, des dates d’arrivée dans les villes du parcours sont définies et des tracts imprimés avec un questionnaire demandant notamment qui voulait accueillir la marche : écoles, foyers de jeunes travailleurs etc. La Cimade organisait tout ça », relate M. Blocquaux. Le succès est réel, mais ce n’est que vers Strasbourg que la marche commence à faire vraiment parler d’elle (au moment où un jeune algérien, Habib Grimzi, se fait défenestrer d’un train par des militaires avinés). « Les comptes-rendus de la presse locale sont en général très positifs » se souvient M. Blocquaux. « La presse internationale est laudative : l’arrivée de la marche se voit dans le New York Times, dans la presse allemande ou marocaine... » Le tout sans attaché de presse, se permet de rappeler l’ancien membre du cabinet de Georgina Dufoix ! Des lendemains de marche qui déchantent Après la réception à l’Elysée et le passage quelque peu en force, face à la presse, des marcheurs qui annoncent avoir obtenu du Président (pourtant moins catégorique, lors des discussions en comité restreint avec quelques marcheurs !) la carte de séjour de dix ans pour les étrangers (une première en Europe), le soufflé semble pourtant retomber : « Le 20 décembre, je réunis les marcheurs et leur demande quels sont leurs projets, poursuit Jean Blocquaux. Tous veulent créer des associations dans leur quartier. Je dis d’accord, envoyez-moi vos dossiers. Je n’ai reçu que deux projets. De même, à la mi-janvier, Jack Lang, le ministre de la Culture, qui les avait reçus, leur avait proposé la même chose. Sans suite... Il y a bien eu des tentatives de l’Etat de poursuivre quelque chose. » Conclusion de M. Blocquaux : « Il n’y avait pas de structure pour encadrer la marche après son arrivée. Celui qui aurait pu être leader, Toumi, du fait de sa personnalité, ne voulait pas y aller. Et les autres étaient dans des démarches individuelles », jure Jean Blocqueaux. « Si quelqu’un avait repris la balle au bond, on l’aurait soutenu. » Ce sera SOS Racisme qui remplira ce vide, rapidement, avec le soutien de l’Elysée (via Jean-Louis Bianco en particulier, conseiller de Mitterrand).
© Amadou Gaye
I
l attend patiemment que le débat, introduit par Louisa Zanoun de Génériques commence. Personne ne le connaît. Mais lui connaît bien des acteurs de la Marche. Et pour cause : ce monsieur a été conseiller au cabinet de Georgina Dufoix, passionaria respectée de la gauche mitterrandienne flamboyante au moment de la Marche, et secrétaire d’état à la « Famille et aux travailleurs immigrés ». Un débat inédit entre marcheurs et autorités Jean Blocquaux ne faisait pas partie des intervenants prévus, mais dès qu’il prendra la parole, il sera au centre des débats, transformant la rencontre en un moment historique, inédit depuis 30 ans, de dialogue entre ceux qui ont fait la Marche, et ceux qui qui l’ont suivie, dans l’ombre, pour le compte des pouvoirs publics. Notre témoin de choix raconte ainsi comment, dès les premiers jours, à Marseille, « à titre personnel au début », il suivra la marche « de très près ». Et sortant de l’ombre à partir de Lyon, il la suivra dorénavant officiellement. La précèdera, la contournera, ou l’anticipera... Ce « compagnon de route » de l’événement analyse : « On avait les historiques de la défense des immigrés, la Cimade, la Ligue des droits de l’homme, qui jusqu’ici étaient les porte-paroles d’immigrés qui n’avaient pas le droit d’association, et puis on a les jeunes issus de l’immigration qui vont prendre la parole eux-mêmes, et ne plus avoir besoin d’interprètes. C’est ce qui fascine les médias, qui ont tout d’un coup vu des gens qui ne sont plus des théoriciens des droits, mais viennent parler de leur vécu ». Ce 31 mai 2013 : des scoops et de l’histoire en direct C’est ce que ce septuagénaire, pur et dur et digne serviteur de la République, viendra en tous cas raconter, archives personnelles inédites en main, devant une salle ébahie d’entendre l’histoire se redérouler devant elle. Mais aussi dialoguer avec les marcheurs qui n’avaient pas revu ce personnage incontournable des coulisses la marche, depuis trente ans. à l’en croire, au départ, « les politiques ont peur de cette marche : on ne sait pas du tout ce qu’il pouvait se passer, les difficultés que cela pouvait occasionner (…) Il y avait des sensibilités différentes à l’intérieur même du cabinet de Mme Dufoix. Moi j’ai reçu, dès septembre 83, dans mon bureau, Delorme, Costil et Toumi qui sont venus m’expliquer ce qu’était leur démarche. Il y a le texte de Costil et Delorme d’août 83 qui fait référence à Gandhi, à Martin Luther King. Et ce qui m’intéresse, c’est cette démarche non violente. D’entrée, j’y crois. De là, je vais essayer de faire partager cette impression. On prend quelques précautions : une instruction est donnée à tous les préfets qui vont être concernés par la traversée de la marche, de faire une surveillance de ce qu’il se passe, et de faire un rapport sur les différentes étapes. » Le ministre de l’Intérieur, Gaston Deferre, marseillais plus que sceptique sur cette initiative partie de sa ville d’élection, engagera des « discussions un peu vives », selon la litote de M. Blocquaux, avec les autres équipes plus favorables à l’initiative : « plusieurs fois, on est obligé de remonter jusqu’à Matignon ou l’Elysée pour décider de certaines choses. Et dès le 8 novembre, je fais une note à l’Elysée pour argumenter de la nécessité pour les marcheurs d’être reçus par la Présidence de la République ». Certains partisans de la théorie du complot croiront y découvrir dès lors une manipulation orchestrée en haut lieu à l’instar de l’épisode SOS Racisme qui a suivi; théories susceptibles de jeter un voile de discrédit sur un événement phare. La légende de la marche ellemême devra sans doute s’en accommoder. Un nouveau contexte : une gauche enfin au pouvoir, mais qui n’a rien vu venir « Le contexte était celui des radios libres », rappelle M. Blocquaux suite à son intervention du 31 mai. Radio Beur (devenue plus tard
Texte et photos Erwan Ruty
6
mémoire
Exposition : « Les enfants de l’immigration »
Affiche du fond privé de Mehdi Lallaoui
Beaubourg, 1984
Un mois après l’arrivée en fanfare à Paris de la Marche pour l’égalité et contre le racisme s’ouvre en janvier 1984 l’exposition « Les enfants de l’immigration ». Mise en place par le ministère de la Culture et le Centre Pompidou, cette manifestation, présentée dans le temple de l’art contemporain, consacre la reconnaissance institutionnelle des jeunes d’origine étrangère en France et constitue le premier programme culturel de l’immigration de cette envergure jamais réalisé en Europe. L’exposition, qui reçoit plus de 40 000 visiteurs en trois mois, est vécue comme une véritable expérience culturelle qui inclus arts visuels (photographie, sculpture, vidéo, peinture), représentations théâtrales ou encore performances musicales. Elle tire profit de l’explosion de créations urbaines en provenance de la banlieue, qui peut être considéré comme l’une des formes d’expression de la révolte des quartiers. Ainsi, l’exposition « Les enfants de l’immigration » présente une profusion de créations inédites. En outre, un étage entier est consacré à la représentation de la vie quotidienne et de l’environnement social des « enfants de l’immigration ». Si cette manifestation culturelle n’est pas seulement consacrée aux enfants de l’immigration maghrébine, ces derniers sont au cœur des différents programmes de l’exposition soutenus par le Fonds d’intervention culturelle et Inter Service Migrants. Dans le contexte de l’apogée du mouvement artistique des enfants de l’immigration maghrébine et de la médiatisation à outrance du label « beur » qui, selon la sociologue Catherine Withol de Wenden, constitue « la première mise en scène consciente et orchestrée d’un immense foisonnement d’images de soi », « Les enfants de l’immigration » a pour ambition de saisir et d’exposer le nouveau contexte socio-culturel en France et l’apport des héritiers de l’immigration maghrébine. Symptomatique d’une plus grande stigmatisation envers les primo-arrivants, opposés à la figure positive du « Beur » désormais à la mode, la génération des parents est totalement absente de l’exposition. En outre, l’historien Gérard Noiriel critiquera l’expression même de « jeunes d’origine immigrée » qui, selon le chercheur, n’a aucune existence au niveau juridique et ne fait que stigmatiser davantage un groupe social que l’on cherche à intégrer.
Claire Tomasella / Génériques 7
spécial marche
Mogniss Abdallah
entre devoir de mémoire et droit à l’oubli « Rengainez, on arrive ! » (Eds. Libertalia) est un livre sur 30 ans de crimes sécuritaires commis contre les habitants des quartiers. Entretien avec son auteur, Mogniss Abdallah, co-fondateur de l’agence de presse Im’média. Propos recueillis par Erwan Ruty
Affiche du fond privé de Mehdi Lallaoui
palestinien en Pologne !!! La Cimade, certains maoïstes voulaient instrumentaliser notre affaire pour illustrer d’autres discours ou combats antiracistes, mais dénaturaient les spécificités de notre propre affaire. C’est à ce moment que j’ai construit mon discours sur la nécessité de l’autonomie.
P&C : Votre livre est à la fois engagé et plein de retenue. Comment avez-vous trouvé la bonne distance ? Votre parcours l’explique-t-il ? M. A : Sans doute. J’ai commencé à militer au milieu des années 70, et il y avait une prégnance des questions internationales dont la situation au Moyen-Orient : guerre d’octobre 1973 [du « Kippour », ndlr], crise pétrolière... avec les répercussions en France, en particulier un regain de racisme envers l’immigration arabe. Alors que ma mère est Danoise, mon père, Égyptien lui, m’envoyait au bled pendant les vacances d’été. J’habitais entre Saint-Cloud, Suresnes et le bas Puteaux, où il y avait la première Maison des travailleurs immigrés (MTI), j’y ai aussi connu des militants du MTA [Mouvement des travailleurs arabes, ndlr], implantés dans un grand nombre d’usines d’alors. Tout a été rasé, maintenant, c’est des beaux quartiers. J’étais dans un lycée bourge mais très militant, avec des fanzines lycéens et des grèves chaque année. Ce sont des références auxquelles je m’attache encore, mais avec moins de prétention à l’avantgardisme ! C’est aussi l’époque où le travail précaire apparaît massivement. Et où, après 68, la jeunesse émerge. La question alors, c’est comment, par le théâtre, la musique, le film super 8... comment formuler nos nouvelles revendications autour de l’aspiration à vivre « ici et maintenant » à contre-courant du « tropisme blédard » [l’attachement au pays d’origine, ndlr] ? C’est l’époque de Trust, du journal La gueule ouverte, de l’hebdo Sans Frontière, de la pièce « Week-end à Nanterre », des radios libres... on voulait des choses différentes de ce que le PCF portait par exemple dans les MJC comme à Vitry ou Nanterre. D’autant qu’on ne voulait plus du travail ouvrier
aliénant, sans pour autant être dans le mépris de nos pères qui soit-disant rasaient les murs. Mais il y avait un vrai refus, ostentatoire, du travail, une petite délinquance « sociale ». Et des expulsions massives : près de 5000 par an ! Le pouvoir cherche alors une réponse à la crise, aux fermetures d’usines, et au chômage de masse. C’est aussi l’époque où les coups de flingue se multiplient. Les flingues sont en vente libre dans les supermarchés. Revendiquer l’élémentaire « droit à la vie »
C’est vrai que les gens issus de l’immigration ont aujourd’hui intériorisé qu’ils sont chez eux. Si je suis victime, je réponds, je porte plainte. devient une nécessité impérieuse ! L’arrivée de Mitterrand au pouvoir en 1981 calme le jeu pendant un an ou deux, mais aux Minguettes (Vénissieux), la police fait campagne pour le recours aux expulsions ! En 1979, avec Samir mon petit frère, il y a eu une grosse mobilisation contre notre expulsion ; il y avait pourtant un décalage avec ce que l’on voulait : on nous a alors proposé de rejoindre un camp d’entraînement
8
P&C : L’autonomie… et parfois même l’isolement : vous citez de nombreux avocats prestigieux qui ont défendu votre cause dans des procès tout au long de ces 30 ans, comme Gisèle Halimi, Jacques Vergès, Jean-Pierre Mignard, et même Gilbert Collard (sic !). Et pourtant, domine l’impression que ceux qui vous ont accompagné ne l’ont fait que brièvement... M. A : Oui, il y a toujours un contraste entre le temps de l’émotion, souvent médiatique, après un crime, et le temps du traitement judiciaire, très long. Pas un des marcheurs de la 3ème marche qui met Toufik Ouanès en avant n’a suivi le procès... Pour obtenir des gains dans un combat, il faut assurer le suivi, médiatique ou judiciaire. Certains réseaux, comme celui d’Im’média ou du Jalb [Jeunes arabes de lyon et de sa banlieue, Ndlr], ont fini par acquérir une expertise juridique et politique des dossiers, parfois à contre-courant des autres réseaux professionnels, où il peut y avoir un mépris des « militants-experts » : certains avocats avaient la volonté de protéger leur pré-carré, alors que nous, nous invitions les familles à s’impliquer dans le suivi de l’instruction judiciaire et les procès. Mais a-t-on réussi à transmettre aux nouvelles générations cette pratique ? Ce n’est pas certain. Il y a parfois un fatalisme dans le suivi, peut-être même trop de foi dans une « Justice juste »... Il faut dire qu’entre devoir de mémoire et droit à l’oubli, les familles hésitent toujours... P&C : Les temps n’ont-ils pas changé ? La Justice n’a plus le même visage que dans les années 70 ou 80. Il y a eu et il y a des ministres de la Justice d’origine maghrébine, guyanaise, et la fréquence des « crimes policiers et sécuritaires » est quand même en baisse, non ? M. A : On a l’impression que la violence est moindre, mais il y a une violence diffuse qui persiste : quand on compare les « képis » des années 70 et les « robocops » d’aujourd’hui, on a l’impression que c’était des pieds-niquelés, à l’époque ! Le potentiel de violence paraît pourtant plus fort aujourd’hui. « En face » aussi, les choses se sont durcies. Mais c’est vrai que les gens issus de l’immigration ont aujourd’hui intériorisé qu’ils sont chez eux. Ils ont moins la culpabilité d’être des étrangers. L’insertion individuelle dans la société française est, malgré tout, plus importante. Si je suis victime, je réponds, je porte plainte. Mais avec des formes de légalisme qui sont souvent en retrait par rapport à l’époque, comme avec la question des récépissés lors des contrôles, par exemple. Avant, c’était le principe même du contrôle d’identité policier qui était contesté. Aujourd’hui, c’est seulement l’abus de contrôle « au faciès » qui semble en ligne de mire. Regarder l’intervention de Nabil Ben Yadir à la JJPI sur www.presseetcite.info/f00
spécial marche
Relais Ménilmontant :
le centre social mythique de « la Marche » Au cœur du 20ème arrondissement de Paris, la petite structure a accueilli tous les comités de soutiens des marcheurs tout au long des aventures de 1983 et 1984 (Convergence 84).
Un centre social investi par les militants
Avant la Marche de 1983, le Relais était déjà un centre social qui appartenait à l’archevêché. Niché à proximité de la cité de transit où étaient logées des familles à majorité immigrées, le centre avait pour vocation de faciliter leur intégration. Cours d’alphabétisation, économie sociale et familiale, soutien aux familles dans les démarches administratives et même garde d’enfants… « A l’époque, ce n’était pas vraiment une garderie comme on en connaît aujourd’hui, mais il y avait déjà un endroit pour que les tout-petits jouent en sécurité et laissent leur maman finir leurs démarches ». Au moment où la Marche est lancée, une salle est demandée, notamment par l’intermédiaire des membres de Radio Beur (devenue Beur FM), au directeur pour réunir le Collectif jeunes d’Île-de-France. Collectif créé au départ pour préparer la commémoration des massacres des manifestants
algériens du 17 octobre 1961 à Paris. Très vite, ce sont les étapes des marcheurs, et surtout leur arrivée à Paris qui mobilisent tout le monde. « D’un coup, il y avait du monde partout, les militants ont complètement investi le centre. On a même accueilli des jeunes de province venus de Marseille ou Lille. Les membres du comité étaient constamment au téléphone avec les marcheurs sur place pour l’organisation. Les débats n’en finissaient pas… Parfois ils faisaient même des allers retours sur place pour tout finaliser … » poursuit l’ancien directeur qui fut un témoin privilégié de cette époque. On imagine en effet toute la logistique qu’il a fallu, sans Internet ni téléphone portable, pour organiser tous les débats et un rassemblement de plus de 100 000 personnes. Ce foisonnement, et la médiatisation autour de la Marche ont évidemment touché les gens du quartier, notamment les plus jeunes. « Les gens savaient bien ce qui se passait ici… Deux jeunes du quartier de 16 ans sont même partis marcher » précise Daniel Duchemin. Des jeunes qui avaient été marqués par le bouillonnement autour d’eux. « Un an après l’arrivée des marcheurs à Paris, on a déploré une série d’incendies criminels dans le quartier. On a tous été surpris quand des jeunes habitués du Relais ont eu l’idée de se mobiliser en mémoire d’un gamin mort dans un incendie. Ils ont organisé eux-mêmes une manif’ avec banderole etc. Ils ont même été reçus par la Radio Beur. Je me rappelle bien d’une fille de 12 ans qui, à la question : « Quel métier veux-tu faire plus tard ? » avait répondu sans hésitation « Femme politique » ! ». Un temps assez lointain où les jeunes devenus aujourd’hui parents, étaient sensibilisés ! Retour au calme… et aux activités sociales de quartier
Après l’épisode 1983, c’est le bébé né de la Marche, Convergences 84, qui se réunit à son tour au Relais. Aujourd’hui,
un groupe de bénévoles du MRAP tient une permanence pour les sans papiers. Et, « depuis le début de l’année scolaire, les anciens de Convergences 84 et de la Marche à Paris se réunissent ici tous les lundis pour préparer les commémorations des trente ans ». Mais très vite, les actions militantes ont laissé place aux activités d’origine du Relais. Le centre s’est institutionnalisé et a retrouvé ses actions sociales. Maison de quartier agrée par la caisse d’allocation familiale ou le ministère de la jeunesse et des sports, il s’inscrit aussi comme lieu d’éducation populaire. Pour les gens du quartier, le centre est surtout un rendez-vous incontournable pour l’accueil des familles et des enfants. Centre de loisir, soutien scolaire, salle multimédia et garderie pour les tout-petits. Ce sont les plus jeunes qui ont le plus investis les lieux, en témoignent la décoration arc-en-ciel. Aujourd’hui, il est fort à parier que ceux qui fréquentent le centre sont comme la majorité des jeunes Français de leur âge : ils n’ont jamais entendu parler de la Marche. « C’est vrai que c’est méconnu. Il faut qu’on leur raconte… », reconnaît Daniel Duchemin. Mais en ces temps de crise qui fragilisent les plus pauvres, il reste peu de place à l’histoire et à la nostalgie. Le Relais qui rassemble dans un même lieu écrivain public, cours d’alphabétisation et aide à l’insertion et à l’emploi, est un endroit précieux. A travers toutes ces activités concrètes, le centre accueille en moyenne 180 personnes par jour. Majoritairement des familles du quartier mais aussi une minorité qui fait le déplacement des autres arrondissements populaires de Paris et même des banlieues nord-est de la région.
Mérième Alaoui
© Amadou Gaye - Arrivée de la Marche à Strasbourg le 2à novembre 1983
U
n soir ordinaire au Relais de Ménilmontant. Des enfants de toutes les couleurs font les allers-retours dans les étroits couloirs colorés. Direction les toilettes, les salles d’animations ou opération lavage des ustensiles de peinture dans les lavabos… Scène bien connue des centres de loisir. Sur les murs, les plannings de l’organisation des activités, des photos... Qui pourrait imaginer que le centre social du quartier de Ménilmontant, au milieu de la longue rue qui porte le même nom, soit devenu en 1983 un endroit mythique pour la génération des marcheurs et de leurs soutiens parisiens ? « C’est dans cette petite salle que les marcheurs historiques, avec des proches, sont venus manger un couscous juste après la manifestation du 3 décembre ! Il y avait une sacré ambiance, du monde à craquer » se rappelle Daniel Duchemin, qui était alors le directeur de la structure.
9
kit de désintox
5 mythes de la Marche...
et leurs limites
Abdellali Hajjat, sociologue, auteur de « La Marche pour l’égalité et contre le racisme » ( Eds. Amsterdam ), le livre sans doute le plus précis sur le sujet publié à ce jour, revient sur quelques lieux communs liés à cette histoire qui, trente ans après son déroulement, peine encore à entrer dans le récit national de manière dépassionnée. Petite mise au point. Propos recueillis par Erwan Ruty
1
3
P&C : L’histoire officielle voit en la Marche la victoire d’un mode d’action non-violent, par opposition aux émeutes des Minguettes qui avaient bousculé l’actualité depuis 1981. Les auteurs des deux événements étaient-ils si différents les uns des autres ? AH : On oppose souvent violence illégitime, gratuite, sans revendication, sans parole des rebellions où on brûle des voitures et des magasins et non-violence des marcheurs. Mais une partie d’entre eux, très minoritaire, a participé aux confrontations avec les policiers lors par exemple en mars 1983 : Kamel Lazare ou Antonio Manouta par exemple. Il y a chez certains un basculement rapide à un mode d’action non-violent. Dans les deux cas, il y a du politique qui s’exprime. D’ailleurs, même en 2005, il y a bien un discours chez les émeutiers. Mais ça ne prend pas forcément des formes traditionnelles, mais par les blogs ou la musique.
P&C : On perçoit souvent, y compris dans le film « La Marche », comme une sorte de génération spontanée. On oublie toute la part d’aide des organisations traditionnelles de soutien aux immigrés, notamment dans la manifestation parisienne du 03 décembre, qui a vu la mobilisation de toutes les organisations de gauche de la France... AH : Oui, le réseau de soutien est monté dès la grève de la faim de 1981 par la Cimade Lyon. Les étapes de la Marche reflètent la cartographie des comités de soutien aux grévistes de la faim. Le groupe ne s’est pas lancé avant de savoir qu’il avait une quarantaine de comités de soutien. Il faut des parrains avocats et intellectuels notamment, pour compenser le stigmate sur les « beurs ». La qeustion est aussi : qui possède les « ressources » financières et organisationnelles ? C’est clairement le mouvement de soutien aux immigrés qui s’est construit après la seconde guère mondiale. Et c’est ce qui fera défaut en 1984 lors de « Convergence 84 ». Et c’est, a contrario, ce qui fait la différence entre la France et les Etats-Unis, où les marches des Noirs ont pour ainsi dire « bénéficié » des effets de la ségrégation et du ghetto qui ont permis de créer une culture (la soul music) et des institutions communautaires, des porte-parole etc. C’est dans cet infra-politique de certaines cultures que ces mouvements ont trouvé des points d’appui et qu’ont pu se développer des discours politiques. Alors qu’en France, il n’y a pas d’équivalent. Du moins avant la Marche. Après, il y aura les concerts Rock against police, sur le modèle anglais, ou Rachid Taha...
4
© Brahim Chanchabi / AIDDA
P&C : Les revendications initiales des marcheurs n’avaient rien à voir avec ce qui a finalement été obtenu, (la carte de séjour de 10 ans pour les travailleurs immigrés), alors que les marcheurs, presque tous français, n’étaient donc pas concernés par ce type de combat. Cela révèle-t-il un « cadrage » de la Marche par les organisations de soutien aux immigrés comme la Cimade, qui justement portaient ces revendications autour de la carte depuis longtemps? AH : Dans les textes, tracts, statuts de associations comme SOS Avenir Minguettes [d’où sont issus plusieurs marcheurs comme Toumi Djaïdja], il y a surtout des critiques violentes contre la police, des revendications sur le logement etc. Un changement de discours s’opère pour la Marche, où on passe du local au national. L’objectif premier de la Marche est d’interpeller le gouvernement, de mener une politique plus favorable aux immigrés. De prouver qu’une majorité de français sont fraternels et contre le FN. Pour cela, les marcheurs ont aussi besoin des médias, et de discours humanistes généraux. On ne peut rassembler des milliers de personnes avec des discours clivants. Il faut des « informations omnibus », comme dit Bourdieu, audibles par n’importe qui.
2 P&C : On dit souvent que le terme « Marche des beurs » est à la fois réductrice, puisque la moitié des marcheurs n’étaient pas des beurs, mais aussi politiquement nocive, puisque cela « communautarise » un combat qui était justement égalitariste. Quels étaient les usages du mot « beur » et leur signification ? AH : Il y a un décalage entre les revendications initiales et l’intitulé « Marche des beurs ». On racialise le propos à travers l’identité « beur ». La raison profonde de ce détournement est qu’on assiste alors en France à un moment où la perception de la société en terme de classes sociales est en déclin. Déclin du PS, du PCF, de la classe ouvrière. On commence alors à parler, notamment au PS, « d’exclus » plus que « d’ouvriers ». 1983, c’est le moment du « tournant de la rigueur » du gouvernement socialiste. Il va dorénavant falloir éluder le social. Mais c’est vrai que les marcheurs voulaient mettre en avant les premières victimes du racisme, qui étaient maghrébines. Conséquence, dans le public : les maghrébins sont les premiers perçus. Qui plus est, eux-mêmes ne se voyaient pas comme des ouvriers, même si certains avaient ce type de formation. Et ils n’étaient pas non plus reconnus comme tels, notamment par le PCF et l’aristocratie ouvrière. C’est ce que révèlent ces rebellions : un clivage, un impensé de la classe ouvrière. Enfin, l’utilisation du terme « beur » marque l’habituel problème entre un terme et son usage. Ce terme a servi à diviser ceux qui étaient jugés « intégrables » (les beurs) et les autres (les musulmans). Cette fracture se révèle surtout à la fin des années 80.
5 P&C : Y a-t-il vraiment eu un « vol » de la Marche par SOS Racisme, ou alors plutôt une capacité de ce mouvement à remplir le vide qui a suivi celle-ci, et que les autres associations, notamment issues de l’immigration, ne sont pas parvenues à remplir ? AH : Un nouvel espace politique est ouvert après la Marche. Quand SOS Racisme naît, il essaie d’intégrer des marcheurs. L’association bénéficie de ressources symboliques et financières qui sont sans commune mesure avec les autres. Christian Delorme soutient SOS et entre en conflit avec les autres associations, comme celles qui ont soutenu la Marche à Paris et qui sont dans un discours d’opposition plus radical.
10
spécial marche
Julien Dray : “ La Marche des beurs, c’était une manif’, pas une révolution ” Vice-président de la région Île-de-France, Julien Dray est le « père » de SOS Racisme, un mouvement qu’il fonde fin 1984 avec Harlem Désir. Il nous livre ici sa vision de la Marche dite « des beurs », des circonstances de la création de SOS et des attaques en récupération politique dont l’association a fait l’objet. Propos recueillis par Julien Wagner / CFPJ lente avec la droite en place entre 1986 et 1988, et qui va contribuer à la mobilisation de la jeunesse comme jamais auparavant.
DR
P&C : Comment expliquez-vous justement le succès de SOS Racisme dans le temps comparativement à celui de la Marche ? On avait bien analysé ce qu’il fallait faire. Nous nous sommes focalisés sur le combat pour l’égalité et sur la dimension « tous ensemble » plutôt que « les uns contres les autres ». Ensuite, on a su utiliser au maximum les instruments modernes de communication à notre disposition. Et puis, il faut être honnête, nous avions une expérience militante que eux n’avaient pas. Mais, contrairement à ce qu’il se raconte, personne n’a été exclu. S’ils avaient voulu, ils auraient été là, avec nous. Certains marcheurs se sont d’ailleurs spontanément retrouvés autour de SOS.
ent pas devenir des militants à plein temps. C’est pour ça que la chronologie est très importante pour éviter les confusions. Ils ont tout simplement refusé de continuer. Un refus qui va donner naissance à un mouvement qui regrettera le départ des marcheurs, les JALB, les Jeunes Arabes de Lyon et banlieue. Eux ont la volonté d’essayer de faire vivre quelque chose. Il y aura d’ailleurs une seconde marche avec Convergence 84, la marche des mobylettes, mais qui aura beaucoup moins de succès. SOS ne naît qu’au sortir de tout ça. Il ne pouvait donc pas y avoir de convergence entre les marcheurs et nous, puisque de l’eau avait coulé sous les ponts et que le noyau dur n’était plus là. SOS et les marcheurs participent d’un processus commun, mais sont deux choses distinctes. Tout ce qui conduit à dire « ils ont récupéré, ils ont écrasé, ils ont empêché que » est un raccourci historique qui ne dit pas la vérité.
P&C : Comment expliquez-vous qu’une douzaine de jeunes beurs des Minguettes entament une marche à Marseille, et que, quelques semaines plus tard, 100 000 personnes sont à Paris et les accompagnent ? S’ils ont démarré dans une relative indifférence, la cause, elle, existait. Elle faisait déjà la une de l’actualité depuis plusieurs mois. Ce qui se passait dans la banlieue lyonnaise notamment, la violence, les crimes racistes. Il existait le besoin d’une réaction. Des milliers de gens voulaient crier leur rejet du racisme et de la violence. A travers cette Marche, ils ont trouvé la possibilité de l’exprimer. Et puis, il y avait, je crois, une volonté de solidarité avec les jeunes et les acteurs associatifs. Ils étaient en première ligne et en prenaient plein la tête. Enfin, si la Marche a connu une telle réussite, c’est aussi grâce à la gauche, qui a fournit le gros des troupes du 3 décembre à Paris. La gauche militante au sens large, associatifs et syndicalistes. Rien que pour ça, entendre dire ensuite que la gauche a récupéré le mouvement, ce n’est pas très sympathique. P&C : A ce moment là, percevez-vous cet élan, et songez-vous déjà à la création de SOS Racisme ? On sent qu’il se passe quelque chose, que ça peut être un départ. Mais non, je ne
songe pas à la création de SOS Racisme en tant que tel. Je pense qu’il va se passer quelque chose et qu’il faut le faire vivre. A cette époque, je suis plutôt dans une dynamique culturelle. Mon sentiment est que la culture est un élément fédérateur de la jeunesse et que, par ailleurs, elle est porteuse d’un message antiraciste et généreux. Il y a donc une rencontre à organiser entre les deux. J’appartiens à une génération militante qui a connu le succès de Rock Against Racism, une mobilisation de plusieurs groupes de rocks anglais contre le racisme avec des concerts. Je prolonge simplement cette réflexion. P&C : Contrairement à SOS Racisme, la Marche n’a pas vraiment traversé les années … On ne peut pas comparer. J’ai beaucoup de respect pour les marcheurs mais, la Marche des beurs, c’était une manif, un fait social, pas une révolution. P&C : Vous trouvez qu’on en fait trop ? Non, non, non, simplement, en termes de fait de société, SOS Racisme n’a pas du tout le même impact, c’est tout. Sans hiérarchiser l’un par rapport à l’autre, SOS est un mouvement qui va être ancré dans le temps, qui va mobiliser toute une génération, qui va s’affronter de manière très vio-
“nous avions une expérience militante que les marcheurs n’avaient pas. ” P&C : Le sociologue Abdellali Hajjat, écrit dans son livre sur la Marche que vous aviez invité les marcheurs à vous rejoindre mais qu’ils ont refusé. Est-ce exact ? Non, c’est très compliqué. D’abord, il n’y a pas eu de démarches collectives mais que des démarches individuelles. Et puis, on ne les a pas invités plus que ça. Il y a eu une rencontre, au tout début, en novembre 1984, entre Harlem Désir, Toumi Djaïdja et le père Delorme. Harlem leur a présenté ce qu’il voulait faire, mais il n’y a pas eu de suite. P&C : Certains disent que des dissensions sont apparues entre les marcheurs et SOS Racisme sur la question palestinienne… Je réponds encore là-dessus mais je l’ai déjà fait. La Marche des beurs s’achève en décembre 1983. A la fin de cette marche, le noyau dur des marcheurs ne veut plus militer, voilà. Que trente ans après, avec la nostalgie, certains disent « on aurait pu »… La vérité c’est qu’à l’époque, ils ne voulai-
11
P&C : Dans une interview récente au Monde, vous revendiquez un projet très ambitieux pour SOS Racisme, à savoir, l’« hégémonie intellectuelle ». Or c’est justement l’un des reproches souvent adressé à cette association, en particulier par la nouvelle droite… Oui, c’est vrai, mais attention, je dis aussi que l’antiracisme ne peut pas être l’alpha et l’omega de la pensée de gauche. Elle ne peut en aucun cas être une pensée de substitution aux questions sociales et aux enjeux du combat pour l’égalité sociale. L’hégémonie culturelle, c’est de parvenir à dire et faire admettre par une immense majorité que la pensée raciste et les idées racistes ne sont pas des idées comme les autres. Dans notre société, être raciste est un délit, et c’est tant mieux. P&C : Vous parlez également de mission culturelle. Que voulez-vous dire ? Le combat, pour nous, était aussi un combat éducatif, contre les préjugés. Un combat de la connaissance contre l’ignorance, un combat pour l’apport que représente la
diversité. Le combat culturel, c’est défendre que la richesse naît aussi de la confrontation et du mélange, qu’il y a beaucoup à apprendre de l’autre. P&C : Il y a trente ans vous avez créé une association dont l’objectif affiché était la lutte contre le racisme et contre le Front national. Aujourd’hui, la parole raciste est hystérisée et le FN au plus haut. Ne peut-on pas dresser un constat d’échec ? D’accord, et que se serait-il passé s’il n’y avait pas eu SOS ? C’est une question incroyable, il n’y a qu’à SOS qu’on demande ça ! La vérité, c’est que le tournant n’est pas dans la création de SOS Racisme. Le vrai tournant se passe à la rentrée 1988. La gauche et François Mitterrand gagnent les élections présidentielles en partie poussés par ce mouvement générationnel. Et dans l’action gouvernementale qui va suivre, aucun élément ne va y répondre ni le valoriser. Au contraire, un an après, Michel Rocard appelle à des tables rondes consensuelles dont le but est d’enterrer le dossier. Le vrai reproche, il n’est pas à faire à SOS. Nous avons été écoutés, oui, mais pas entendus. Cette situation va d’ailleurs conduire à des conflits majeurs entre l’association et la gauche socialiste. P&C : SOS Racisme défendait alors un projet universaliste. Or, le combat antiraciste est aujourd’hui morcelé entre la lutte contre la négrophobie, l’islamophobie, l’antisémitisme… Quel regard portez-vous sur cette évolution ? La division n’est jamais bonne. L’opposition entre les uns et les autres, la concurrence mémorielle, la segmentation du combat, pour moi, tout ça n’est pas bon. Mais il y a des causes qui expliquent cela. La gauche n’a pas été assez volontaire dans la politique de lutte contre les discriminations, dans la revendication et l’affirmation d’une France métissée. De l’autre côté, face à cette situation, les mouvements associatifs n’arrivent pas à sortir de leur fonction de témoignages. Ils forment une borne repère, morale, mais qui n’arrive pas, dans ses formes d’organisation, dans ses propositions et dans son discours, à être un mouvement à l’offensive, qui revendique un projet de société.
spécial marche
Montpellier a eu sa Marche
La Marche a traversé, de Marseille à Paris en passant par Grenoble, Lyon, Strasbourg, Lille, tout l’Est de la France industrielle. Pourtant, d’autres villes se sont mobilisées, à leur manière. Parmi elles, Montpellier. Le 26 Novembre 1983. Récit de Paul Nunez, responsable local de la Cimade, l’un des initiateurs de cette marche qui, pour être locale, n’en fut pas moins d’une importance considérable pour ses participants. Et qui témoigne de l’écho de la Marche. Extrait d’un documentaire de Kaïna TV. Propos recueillis par Carlotta Macera et Jean-Fabrice Tioucagna ; avec ER.
La précarité des travailleurs immigrés de l’agriculture locale « Les luttes les plus vieilles sont elles des travailleurs de l’agriculture, à Béziers, à Nîmes, à Montpellier. C’est la grève de la faim du temple de la rue Magelone. Après, ça a été les luttes des foyers Sonacotra. Ces luttes ont réuni jusqu’à 25 000 personnes en France, c’est pas rien, ça a été les plus grosses luttes des années 70. Il faut savoir que les travailleurs étrangers étaient dans une situation de précarité ; dès qu’on ne voulait pas renouveler leur titre de séjour, on les expulsait manu militari (…) Jusqu’en 1982, les immigrés n’ont pas le droit de créer des associations. Ce
sont donc seulement des Français qui encadrent par leurs structures les travailleurs étrangers (…) Avant 83, le contexte, c’est aussi que beaucoup de jeunes des quartiers meurent abattus par des Français. La mixité sociale était alors beaucoup plus grande dans ces quartiers (…) »
se terminera au foyer Léo Lagrange avec un concert. Travailleurs français et immigrés étaient là, on était dans une affaire de classe sociale, de luttes populaires (…) Tout c’est organisé au 3 rue de Lodève, à l’association des travailleurs migrants, comme toutes les actions des années 70. Cela fédérait les mouvements associatifs espagnols, les associations familiales, les partis politiques, les syndicats, le PCF, le PS, le PSU, la LCR, la LDH, le MRAP, la Cimade... Pour les manifestations, c’était beaucoup d’hommes seuls, qui travaillaient dans l’agriculture avant le regroupement familial, ils venaient réclamer leurs droits. Sur 1500 personnes, la moitié était des travailleurs immigrés, des gens des foyers. Ils n’habitaient pas à la Paillade, Mais c’était déjà la fin d’une époque. Petit à petit, tout ça a commencé à disparaître. Le mouvement associatif dont j’ai fait partie a pris la place de ceux qui auraient dû mener ces luttes. »
l’immigration, pas un droit pour les travailleurs immigrés ; ceux qui mourraient étaient français. Après la Marche, il y a eu des manoeuvres, Convergence, SOS Racisme, la montée du FN. On ne parlait pas encore de sans-papiers. On croit alors que la carte de 10 ans va stabiliser tout ça, mais tous les régimes, Pasqua et autres, vont remettre ça en cause. On a créé de la précarité sociale. On est resté sur l’immigration, et on n’a pas parlé de la question sociale. Cette Marche a amené des choses bien, et après tout a dégénéré. Dès 84, le gouvernement fait tout pour dénigrer les gens des quartiers, dire qu’à Peugeot-Talbot, il y a l’islam qui monte etc. C’est Pierre Mauroy et tous ces gens de gauche qui ont mis à l’index les quartiers populaires. »
La montée à Paris
« Le bilan est simple : dans les années 70 et 80, on se bat pour les droits, et dans les années 2000, on se lamente sur les droits qu’on a perdus. Quand on se bat, on reste droit. Quand on se lamente, on baisse la tête et on pleure. On a la nostalgie, on appelle à la désobeissance, mais on n’arrête pas de collaborer. Les gens ne se battent plus, ils regardent trop la télé. Il y a une dérive des classes populaires qui est désastreuse. C’est comme depuis Spartacus, les droits ne se quémandent pas, ils s’arrachent. »
« Après la marche de Montpellier, on a essayé d’organiser les gens du quartier pour qu’ils puissent participer à la manif à Paris. On a loué tout un wagon, on était une cinquantaine de gens d’associations diverses, à la Bastille, avec les photos dH’ocine Bouziane. Devant, c’était les photos de tous ceux qui avaient été tués dans les mois précédents. Et il y en avait beaucoup. »
La mort de Hocine Bouziane « Ici, on a profité de la Marche pour faire une manifestation du Peirou [centre-ville, NDLR] à la Paillade, et on mettra en exergue le fait que au quartier GeliFigerolles Hocine Bouziane, un jeune qui sera abattu dans les circonstances que la Marche veut dénoncer. Cette Marche réunira au moins 1500 personnes, et
Immigration et question sociale « Les marcheurs demandaient une reconnaissance sociale des jeunes issus de
Se battre ou se lamenter
Regarder toute la video www.presseetcite.info/f001
Rachid Taha : « La Marche, c’est comme si le printemps avait donné l’hiver » Rachid Taha, chanteur de Carte de séjour, est emblématique à plus d’un titre : son groupe est d’origine lyonnaise, comme la Marche; il est de la génération de la Marche, il est à l’origine de la reprise de « Douce France », le classique de Charles Trenet, chanson qui l’a popularisé en 1986. Enfin, il a ouvert une boîte de nuit, dans un quartier alors populaire de la ville, la Croix Rousse, qui s’appelle « Le refoulé ». L’équipe de nos partenaires Kaïna TV l’a rencontré le 17 octobre dernier alors qu’il se produisait au Rockstore de Montpellier. Extrait.
Mano Negra, ou Zebda, qui veut dire « beurre » en Arabe… Mais quand je vois ce qui se passe aujourd’hui, je me dis que ça n’a pas changé grand-chose, le problème est toujours là. C’était important, mais c’est une défaite de la République française. C’est comme les Printemps arabes. C’est comme si le printemps avait donné l’hiver… »
« Pas mal de groupes ont été influencés par cette époque, comme la
C.M, JF.T et E.R
12
Et pourtant, Rachid Taha continue de chanter « Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, oui je t’aime, je t’ai gardé dans mon cœur (…) et te donne ce poème, oui je t’aime, dans la joie et la douleur… ».
histoire rubrique DOSSIER
Gandhi
Père spirituel de la Marche pour l’Egalité Révolutionnaire pacifiste, Mohandas Karamchand Gandhi est la figure emblématique de la non violence dans le monde entier. Surnommé le «Mahatma» (« Grande âme »), c’est lui qui a inspiré la Marche comme moyen d’action pacifique à Toumi Djaidja. Grâce au film que Richard Attenborough lui a consacré, sorti en 1982 et que le marcheur des Minguettes regardera sur son lit d’hôpital en 1983. Gandhi, avocat à Londres puis en Afrique du Sud, rentre en Inde en 1914 et décide de mettre fin à l’exploitation coloniale sans verser une goutte de sang. Avec sa mythique « marche du sel » et ses actions de désobéissance civile, il y parvient en 1947. Un an plus tard, le « Père de la nation indienne » meurt, assassiné par un extrémiste hindou. Pourtant, si son aura pacifiste est immense, sa non-violence est plus nuancée qu’il n’y paraît ; tout en inspirant des commentaires contrastés à une nuée de libérateurs hors normes.
“ Il y a beaucoup de causes pour les cause pour laquelle je suis prêt à tu quelles je suis prêt à mourir mais aucune er. ” Gandhi, Autobiographie ou mes expériences de vérité, 1927-1929.
“ Si l’on pratique « oeil pour oeil, dent pour dent », le monde entier sera bientôt aveugle et édenté. ” MAIS : « Je crois que s’il y a seulement le choix entre la violence et la lâcheté, je conseille la violence. ”
Gandhi mesure la fin
à l’aune des m
eans, so m e th s A “ : n o ti c a n oyens de so
the end”
« La philosophie de la non-violence de Gandhi est la seule méthode moralement et concrètement valable pour les peuples opprimés qui se battent pour leur liberté. » Martin Luther King, de retour d’Inde, en 1959
, ur te au n so à r se po op s’ s ai m ; en bi t es c’ r, « S’opposer à un système, l’attaque t. » an ill sa as re op pr n so r ni ve de à e, êm i-m so à et l’attaquer, cela revient à s’opposer
les contre des up pe s no sé ili ob m ux de et nous avons tout e al ni lo co n jamais complètement io a ss n’ re e pp êm l’o m ide lu ] rt [… fe s uf ai so m i ux lu « Nous avons tous les de taient pas notre liberté […] Je me suis éloigné de ives… » ec us gouvernements qui ne resp ce et non-violence ne sont pas mutuellement excl ce. Violenndhi], Time Magazine, 31.12.1999 désavoué la violen cred warrior » [Ga he sa
Nelson Mandela, « T
à propos de Gandhi : « Si la non-violence signifie continuer à reporter sine die la résolution de la question noire pour prix du refus de la violence, alors oui, je suis pour la violence ; la non-violence me va si elle marche. »
Malcolm X
13
Marcel Hartmann - Thomas Bremond © 2013 / CHI-FOU-MI PRODUCTIONS / EUROPACORP / FRANCE 3 CINEMA / KISS FILMS / ENTRE CHIEN ET LOUP / L’ANTILOPE JOYEUSE
DOSSIER rubrique
DOSSIER
La longue marche d’une génération qui a changé la culture française
L
a Marche de 1983 serait-elle un échec, « un printemps qui aurait donné un hiver », comme le dit Rachid Taha ? Politiquement, le bilan paraît contrasté. Si SOS Racisme, né un an après la Marche elle-même, a été le seul mouvement antiraciste d’ampleur nationale à impacter la société française dans presque toutes ses strates, le moins que l’on puisse dire est que les descendants des marcheurs, et les quartiers qui les ont vu naître, sont toujours considérés comme périphériques au récit national ; quand ils ne sont pas considérés comme des ennemis de la nation, ceux contre lesquels celle-ci se construit.
les provinces comme dans les métropoles urbaines. Qu’il s’agisse de mode vestimentaire, de manière de parler, de musique, de dessin, de danse, ou même de sport, la France ne s’exprime plus comme avant la Marche. Ce mouvement est lent, souterrain, mais c’est la victoire la plus profonde que cette génération ait porté ; celle d’un métissage généreux qui fonctionne à plein régime. Comme le fait remarquer Jamel Debbouze dans un récent entretien au journal Le Monde, « il faut dire aux gens qu’on fait partie de l’album de famille ». En d’autres termes, et comme le proclame l’un de nos confrères de Med’in Marseille, Ahmed Nadjar, ce n’est pas de ministère de l’Intégration dont nous avons besoin, mais bien de ministère de l’Acceptation. La tièdeur des soutiens institutionnels à Christiane Taubira dans les récentes insultes racistes dont elle a fait l’objet en témoignent amplement. L’absence complète de travail de mémoire à caractère national, au sujet des 30 ans de la Marche, de la part des pouvoirs publics, et en particulier le refus catégorique du ministère de la Culture de prendre en compte cette histoire, laissent rêveur sur le décalage abyssal entre l’establishment culturel français et les cultures populaires partagées par l’immense majorité de ce pays.
Pourtant, pourtant, la société française a évolué. En profondeur. Des jalons ont été posés, depuis 1983, qui ont bouleversé notre pays, si bien que régulièrement, les personnalités préférées des Français sont choisies parmi des enfants de l’immigration récente, qu’ils s’appellent Yannick Noah, Zinedine Zidane ou Omar Sy. Cette histoire, qui est l’histoire profonde d’un peuple, celle de l’émergence d’une nouvelle culture populaire, commence avec la victoire de Noah, puis les succès de Smaïn, pour continuer 30 ans plus tard avec Zidane, Thuram, Grand Corps Malade, Zebda, IAM, NTM, Debbouze, Omar & Fred, et tant d’autres qui peuplent dorénavant notre imaginaire comme naguère Gabin, Arletty ou Coluche...
C’est pourquoi il est indispensable de revenir sur quelques unes de ces étapes d’une très longue marche culturelle en cours, et ainsi d’esquisser l’ébauche d’un nouveau récit national. Avec l’espoir que rapidement, les décideurs soient aussi capables de raconter cette histoirelà, qui est dorénavant la nôtre à tous. Erwan Ruty
Cette culture populaire, née dans les banlieues des années 80, s’appelle la culture urbaine. Elle parle à toutes les couches de la jeunesse française, dans les villes et les campagnes, dans
14
rubrique DOSSIER
Nabil Ben Yadir :
« Je ne sais pas à quoi aurait ressemblé « La Marche » réalisé par un Français… »
Marcel Hartmann - Thomas Bremond © 2013 / CHI-FOU-MI PRODUCTIONS / EUROPACORP / FRANCE 3 CINEMA / KISS FILMS / ENTRE CHIEN ET LOUP / L’ANTILOPE JOYEUSE
Le réalisateur belge des « Barrons » présente le film tant attendu, « La marche ». Retour sur le tournage d’un film sensible, qui est l’acmé d’un cycle de commémorations des 30 ans de la Marche. Un film chaleureux, à l’image des marcheurs et qui, évitant le côté manifeste/film à thèse, donne d’abord à voir une émouvante aventure humaine et fraternelle. Et donc une oeuvre susceptible de séduire un jeune public dépolitisé, et de fournir un nouveau carburant à la légende de la Marche.
P&C : Pourquoi avoir accepté de raconter cette page de l’histoire des banlieues françaises, vous qui êtes belge ? Vous gardez de fait une certaine distance… NBY : En effet en tant que belge j’ai beaucoup plus de recul. Entre nous et vous, il y a des différences ! Par exemple ici la banlieue c’est vraiment particulier : vous êtes loin de tout, géographiquement. En Belgique non, les gens qui habitent en banlieue sont les riches ! Ca fait très classe de dire qu’on habite en banlieue. Moi qui vis à Bruxelles, à 1h30, je suis parfois plus proche de Paris que certaines personnes qui vivent en banlieue ! C’est dramatique… C’est une forme d’injustice à tous les niveaux, finalement tu n’existes pas à Paris car tu n’y es pas. On a tourné à Clichy-sous-Bois, c’était dramatique de voir l’état les tours ! C’est finalement le seul endroit qui pouvait correspondre aux Minguettes des années 80. Donc oui j‘avais un certain recul. Franchement je ne sais pas à quoi aurait ressemblé « La marche » réalisé par un Français… Ce sujet est trop ancré dans la politique, dans l’histoire… Il fallait oublier tout cela. Un homme politique dont je tairai le nom m’a dit « Ce film va donner la parole aux jeunes des banlieues ! ». J’ai répondu étonné : « Cela veut dire qu’ils ne l’ont pas ? ». La France a un problème avec son histoire. Je pense qu’il faut un touriste pour venir la filmer. Comment se fait-il que je ne savais pas que des mecs des Minguettes ont décidé de répondre par la non violence aux bavures policières ? Comment se fait-il qu’on dise encore 30 ans plus tard, que c’est SOS Racisme qui a organisé cette marche ? P&C : Le producteur dit qu’au départ, les financeurs vous ont mis dans un « tiroir », celui du film communautaire ? Est-ce que c’est ce qui explique qu’on fasse un film sur la marche 30 ans après seulement ! NBY : C’est en général très compliqué de monter un film mais je pense que les gens ont eu peur de voir un film communautaire… Alors qu’est ce qu’un film communautaire ? « Les barrons », c’est particulier car c’était un premier film, un ovni. J’étais un électromécanicien qui venait d’un des quartiers les plus mal aimés de Bruxelles et sans aucun diplôme. Quoi que je fasse ça aurait été compliqué ! Mais là il y avait une réticence à faire un film communautaire alors que je voyais cela avant tout comme un film français. Un film sur l’histoire de France, avec un regard belge. Mais on n’a pas essayé de convaincre tous ces gens inquiets… Et ce n’est pas noir partout, c’est cela qui est intéressant. Le scénario
est rassembleur. France télévision et Canal + ont mis l’argent et ont tout de suite compris ce qu’on voulait faire. A la fin, Luc Besson est venu apporter ce qu’il manquait avec une totale liberté et nous a permis de finaliser le film. Je ne pense pas que cela explique le fait qu’on fasse un film 30 ans après, ça voudrait dire qu’il y a eu 50 tentatives avant… J’ai peut-être eu cette distance en tant que belge en mettant les choses en face des gens. La marche est audelà d’un film cinématographique, il y a tout un message derrière. Ca a été le message des marcheurs, un film pour tout le monde, pas plus pour Pierre que pour Mohamed. P&C : Comment avez-vous préparé le film, notamment la rencontre avec les « vrais marcheurs » ? NBY : Un moment très important a été la rencontre avec Toumi Djaidja. Quand je suis descendu aux Minguettes pour le rencontrer je m’attendais à voir quelqu’un avec une haine, une amertume mais pas du tout. Je me suis pris une vraie claque ! J’ai été à l’endroit où il s’est ramassé la balle, au point de départ où tout a commencé… Donc ça été pour moi une vraie rencontre et je me suis dit que ce film allait être librement inspiré. Toumi est un mec avec une vraie paix intérieure, il trouve que c’est important de raconter cette histoire via le medium du cinéma. Les Américains l’ont compris depuis des dizaines d’années. Alors que 80% des jeunes ne connaissent pas cette histoire… Par contre ils savent tous qui a gagné la stars Academy 3, c’est quand même dramatique.
“ La France a un problème avec son histoire. Je pense qu’il faut un touriste pour venir la filmer. ” P&C : Justement, le choix des acteurs de la « bande » a-t-il eu lieu naturellement ? Lubna Azabal est particulièrement touchante… NBY : Oui elle joue le rôle de Keira c’est mon personnage préféré ! Elle a une chose extraordinaire c’est qu’elle n’a pas de filtre. Elle dit des choses horribles et c’est cela que les gens adorent ou détestent. Lubna Azabal habite à Bruxelles, on a des amis et même de la famille
15
en commun. Donc j’ai toujours voulu tourner avec elle car elle a un parcours très atypique. C’est une personne vraie qui ne mâche pas ses mots. Mais elle est douce, ce n’est pas du tout une Keira et ça a été très dur pour elle de rentrer dans le personnage. La scène dans le bistrot où elle dit qu’elle veut tout arrêter, est pour moi la meilleure du film ! P&C : Pourquoi avoir choisi l’humour pour un sujet assez « grave » ? NBY : Ca fait du bien l’humour déjà ! Ca rassemble. Quand vous voyez une salle qui rigole ou une personne qui rit, cela la rend tout de suite humaine. Les gens nous attendent dans un film de victimes ou ça ne fait que chialer, moi j’ai besoin qu’on rie, j’ai besoin qu’on passe par plein d’émotions différentes car c’est simplement la vie. Et c’est aussi une réponse à cet espèce de cinéma tellement formaté, où soit on rit, soit on pleure… Je ne veux pas ça. Et n’oublions pas que les marcheurs étaient des gamins, ils avaient 18 piges, ils partaient à l’aventure un peu comme en colo… Un jour ça rit, un autre ça pleure. P&C : Vous dites vous être inspiré par Harvey Milk de Gus Van Sant, sur «comment on devient un héros». Les marcheurs sont des sortes de super-héros qui découvrent leurs pouvoirs en marchant… Comment le mettre en image ? NBY : Oui ce film me parle car c’est la naissance de quelqu’un qui par la fatalité va avoir une conscience politique. Il y a plein de films qui m’inspirent mais là on se demande comment on filme la naissance de héros ? Comment un type qui est assis en bas de sa tour et qui se prend une balle, va être happé par le destin et se dire que ce qui lui est arrivé arrive à beaucoup d’autres personnes et il faut réagir maintenant. Quand on écoute Toumi, il était obligé de réagir comme cela, il sort du coma et il parle de faire une marche non violente alors que tout le monde veut prendre les armes ! Finalement il n’y a pas eu d’émeutes grâce à des gens comme ça qui ne se sont jamais mis en avant. On préfère montrer des Tony Montana que des Ghandi. Donc pour montrer cela, c’est très subjectif : filmer par des réactions, quelqu’un qui va convaincre avec ses mots, des regards, une facilité à faire des discours à la fin… Et puis la naissance d’un groupe. Comment suivre une personne pour petit à petit suivre tout un groupe. A la fin, Mohamed [Toumi, dans le film, NDLR] est finalement dans le groupe au même titre que tout le monde.
Propos recueillis par Mérième Alaoui. Regarder toute l’interview de Nabil Ben Yadir à la JJPI sur www.presseetcite.info/f002
DOSSIER rubrique
« Des héritages de cette Marche, j’suis pas persuadée qu’il y en ait des tas » Marie, Adriana, Felipe et Christophe sont quatre jeunes habitants de Toulouse agés d’une vingtaine d’années. Ils viennent de réaliser, avec l’association RMA production, un documentaire sur les 30 ans de la Marche pour l’égalité et contre le racisme. Eux qui ne connaissaient rien de la Marche de 1983 ont eu un mois et demi pour se construire un avis sur la question. Retour sur la conversation qui a fait suite à la projection de leur court-métrage, « La Marche des beurs des français ».
L
a Marche pour l’égalité et contre le racisme de 1983 est pour ainsi dire absente des manuels d’histoire. La connaissance d’un tel événement par les plus jeunes générations est parcellaire, voire inexistante. C’est du moins ce qu’ont confirmé les quatre jeunes toulousains qui viennent de réaliser un documentaire de trente minutes à ce sujet, dans le cadre d’un projet européen. Tous les quatre sont pourtant concernés de près par la question : Adriana est d’origine ukrainienne, Marie a une mère espagnole, Christophe vient des Antilles et Felipe est né au Maroc de parents espagnols. Ainsi, s’ils ne savaient rien de la Marche, il leur a tout de même été assez facile de dresser des ponts entre ce sujet qu’ils découvraient et leurs expériences antérieures. Christophe : « Déjà c’est la Marche des beurs, donc il fallait se poser la question de pourquoi ‘les beurs’. Et après, quand on nous a donné les références avec Martin Luther King et tout ça, ça rappelait un petit peu les marches des Antilles. En fait, ça englobe un petit peu toutes les affaires françaises au niveau du racisme et du colonialisme. Surtout aux Antilles où on est encore un petit peu dominé par les békés. Ils nous arnaquent quand même, hein, même après les révolutions, là. Mais bon… Donc du coup, ce qui m’a intéressé c’est de comprendre leur démarche et de comprendre, finalement dans quel état d’esprit étaient ces gens-là à cette époque-là. Et à la fin, on n’a pas l’impression qu’il y ait un grand changement… Par exemple, même Gandhi, le simple fait de marcher, là, de marcher dans toute l’Inde pour
virer entre guillemets les Anglais, je sais pas comment on peut concevoir ça…. C’est exceptionnel ! Et pour moi, c’est comme s’il menait une guerre, ou une bataille. Mais sans morts. » Toutefois, ces quatre jeunes gens se sont vite confrontés à la mémoire fugace de la Marche de 1983, et aux multiples tensions qu’elle génère aujourd’hui encore. Adriana : « J’ai d’abord essayé d’aller voir aux archives, mais il n’y avait rien ni aux archives municipales ni aux départementales. La moitié des vidéos c’était des choses passées aux infos. Un petit reportage à la limite mais quasiment que des trucs où le nom de la chaîne était marqué. On devait aussi prendre rendez-vous avec les personnes qui ont participé à la Marche pour les interviewer. Mais moi c’est une démarche que j’ai pas du tout aimé parce qu’on nous a donné une liste de plusieurs ‘marcheurs’, peut-être cinq ou six, et au final on s’est retrouvé avec seulement deux participants de la Marche dans le film. Je sais que, une fois, j’avais appelé moi, et la personne m’a dit : non, je suis désolé, je prépare aussi quelque chose pour les trente ans avec une autre association, j’ai pas du tout de temps à vous accorder… C’est pas non plus comme si on demandait toute une journée, mais bon apparemment… » A l’inverse, Marie, Adriana, Christophe et Felipe, maintenant qu’ils ont travaillé sur la question, regrettent le manque d’intérêt que notre société porte à la mémoire de la Marche. Adriana : « On a voulu faire un vrai micro-trottoir au début. Du coup, on est allé à la Fac au Mirail, mais on a eu que quatre personnes qui nous ont répondu dans la journée. »
Marie : « C’est lamentable que les jeunes d’aujourd’hui n’en sachent plus rien. C’est quand même terrifiant. C’est un mouvement qui a mobilisé cent mille personnes il y a trente ans. Moi, des héritages de cette Marche, je ne suis pas persuadée qu’il y en ait des tas… Je pense que ça a peut-être aidé un peu. Mais ça a pas été aussi utile qu’ils l’auraient voulu. D’un côté ça me rend super optimiste parce que je me dis, il y a trente ans, avec les moyens qu’ils avaient, de réussir à monter un truc pareil, normalement aujourd’hui on serait capable de faire un truc mille fois mieux. Et en même temps, je suis super pessimiste, parce qu’il y a plus personne qui fait rien. En fait, j’ai l’impression qu’aujourd’hui les seules marches qui sont pacifiques, c’est les marches en souvenir des morts. » Felipe : « C’est sûr qu’aujourd’hui il y aurait besoin de refaire une Marche pour l’égalité » Marie : « Oui, mais refaire une Marche en tant que Français offensés par le racisme montant. Ils ont dit qu’aux dernières élections il y a un Français sur cinq qui a voté pour le FN. Et quand en même temps tu sais que un Français sur quatre a au moins un grand-parent étranger, là tu te dis c’est quoi ce truc ? Mais, c’est vrai franchement, amuse-toi à regarder autour de cette table, on est quatre et il y en a pas un qui soit Français de souche » Toutefois, pour ce qui est de la possibilité qu’un événement comme la Marche ressurgisse aujourd’hui, les quatre toulousains restent circonspects. Christophe : « Le soir quand on est sorti après la diffusion, on est tombé avec des copains sur un gars qui exprimait ouvertement son racisme. C’était un peu bizarre... » Adriana : « L’égalité c’est bien. Les gens disent ‘oui, oui, on est pour l’égalité’. Mais le problème c’est que, une fois qu’ils ont dit ça, ils ne vont pas aller à pied jusqu’à Paris. »
© Yassine Latrache
Marie : « On s’est dit avec Christophe que maintenant les gens ils voudraient pas refaire une Marche comme ça. Parce que prendre un mois de leur temps pour marcher jusqu’à Paris ça les motiverait pas. Parce que bon tu comprends j’ai des cours, j’ai les études, j’ai mon travail, j’ai la famille… Et ils voudraient pas partir. C’est comme dans Forrest Gump, il faudrait qu’il y en ait un qui parte et que tout le monde le suive » Felipe : « Aujourd’hui, il faut un sujet qui soulève les gens. On l’a bien vu avec Leonarda. Il y a eu un soulèvement parce que les gens ils ont réagi à une injustice. Et ça, ça a mobilisé des gens. Mais malheureusement, il faut qu’il y ait un conflit à la base. » Propos recueillis par Marin Schaffner / ZEP
Les Carnets d’un marcheur (Traversée de la France profonde), de Bouzid Kara, Actes Sud Le premier et le plus authentique témoignage sur la marche, écrit pendant le trajet lui-même, par l’un des premiers marcheurs. Qui témoigne, le 07 décembre 2013 à la Bellevilloise : « Je ne suis pas venu pour voir Mitterrand, mais pour rencontrer les français, et les petits arabes qui se cachaient dans les coins ! »
16
© Ben Hito pour Kaina TV 2013
rubrique DOSSIER
1983-2013, Flash-back : la Marche en débat à Presse & Cité le 31 mai 2013 Episode 1/ Toumi Djaïdja, initiateur de la Marche : « A l’époque, la cour de Justice de Lyon a libéré des assassins… » Regarder la vidéo sur www.presseetcite.info/g001
17
DOSSIER rubrique
Le langage des cités
ou la construction d’une contre-culture Propos recueillis par Claire Tomasella
© Antonin « Treka »
«Meuf», «Krevard», «Avoir la dalle», «Chanmé»... Des mots issus de l’argot contemporain et qui font désormais partie du langage familier. Depuis plusieurs décennies, le langage né dans les cités s’est peu à peu introduit dans la société : de plus en plus de mots en verlan sont utilisés par les jeunes, de quelque milieu social qu’ils soient, et des « dictionnaires du verlan » ou de l’argot fleurissent.
L
L’apport de l’immigration
e dernier en date, paru aux éditions de l’Opportun sous le titre « Tout l’argot des banlieues ». Le Dictionnaire de la Zone en 2600 définitions, est l’oeuvre d’Abdelkarim Tengour, un ingénieur informaticien de 45 ans qui se définit lui-même comme un « lexicographe autodidacte ». Né dans le 14ème arrondissement de Paris, Abdelkarim Tengour a passé son enfance dans un grand ensemble de Massy (Essonne). C’est là, au milieu des années 1990, qu’il a puisé la matière pour les textes qu’il écrit et qui ont pour univers la banlieue, celui qu’il connaît le mieux. « En écrivant mes histoires, j’ai découvert de quelle façon avait évolué l’argot », se souvient Abdelkarim Tengour. Dans les années 2000, il crée le site Internet dictionnairedelazone.fr afin de publier ses créations littéraires. « Ce site n’était au début qu’une simple page perso. Pour accompagner mes textes, j’ai décidé de faire un lexique. Mais c’est cette annexe qui a attiré le plus de visiteurs », raconte l’ingénieur informaticien. Le site, consulté principalement par des linguistes, des étudiants et des journalistes, compte aujourd’hui plus de 2000 mots quand le livre, en avance sur le site et réalisé en un an et demi, propose 2600 entrées.
Beaucoup de termes du langage des cités sont aussi empruntés aux langues des immigrés. « Il y a une corrélation avec les différentes vagues de migrations. On observe des évolutions du langage au moment de la colonisation, de la guerre d’Algérie, du rapatriement des Pieds noirs et des Harkis ou encore une vingtaine d’années après la construction des grands ensembles », avance Abdelkarim Tengour. Ainsi, ces 20 dernières années ont vu l’emploi massif de mots d’origine arabe. « C’est le dawa » (le bazar) vient de l’arabe comme « choufer » (surveiller). « Narvalo » (fou) vient quant à lui du romani qui fournit une quantité énorme de mots à l’argot français. « L’argot ivoirien, le nushi, est rentré en force ces dernières années », ajoute Abdelkarim Tengour. On a vu par exemple apparaître le terme « enjailler » composé à partir du mot anglais « enjoy » qui signifie « se faire plaisir » et figure dans des paroles du rappeur La Fouine en 2011. « Un autre phénomène apparaît aussi : les gens ont plus de facilité à voyager et importent désormais des mots avec eux », ajoute le lexicographe.
De l’argot au langage des cités
Langage « des jeunes » versus langage « des cités » ?
« L’argot des cités a émergé au début des années 1980, pendant les années Mitterrand, au moment de la Marche pour l’égalité et contre le racisme. Cela coïncide avec l’émergence de toute une culture de gauche », explique Abdelkarim Tengour. Mais ce langage trouve sa base dans l’argot classique qui date du Moyen-Age et a été inventé dans une volonté de cryptage du message, cela afin de permettre à un groupe de ne pas être compris des autres. Il n’a cessé d’évoluer depuis cette époque à travers des processus de création nombreux : il peut s’agir par exemple de supprimer une syllabe en fin de mot (« clandé » pour clandestin), d’ajouter un suffixe comme dans « beurette », ou d’utiliser une métaphore. Ainsi un « bounty » désigne un Noir qui adopte la pensée d’un Blanc (à l’instar de la barre à la noix de coco -blanche- couverte d’un napage de chocolat -noir-). En outre, ce langage diffère d’une cité à une autre (par exemple, le terme « beur » est de l’argot parisien que les provinciaux ne connaissaient pas en 1983) ; avec notamment des différences de prononciation. Ces différenciations géographiques permettent aux jeunes de se reconnaître et traduisent le caractère identitaire de l’argot. Cependant, bien que les jeunes de chaque cité communiquent avec des termes et expressions spécifiques, il y a tout de même un socle commun et l’emploi du mécanisme ancien que constitue le verlan peut être considéré comme une règle générale. Son usage s’est répandu à partir des années 1970 avec, par exemple, la chanson de Renaud Laisse béton (1978). Cet emploi massif du verlan peut être analysé comme une volonté d’inverser les normes culturelles, tout comme le fait de porter sa casquette ou son pantalon de survêtement à l’envers.
« On confond souvent le langage djeunz et le langage des cités, estime Abdelkarim Tengour. Le premier puise dans le langage des cités, mais il est plus ludique. Il est créé pour ne pas se faire comprendre des adultes alors que le langage des cités est plus glauque, il touche à certaines réalités. L’argot des cités vient de l’argot des voleurs. Il a un aspect délinquant », explique péremptoirement Abdelkarim Tengour. Il a souvent trait au sexe, à la violence, à la drogue ou encore à la police. « On peut prendre pour exemple le terme de « boloss » apparu dans les années 1980. Il s’agissait au départ du client du dealer. Par la suite, il a signifié la victime, la personne que l’on peut racketter. Dans le langage djeunz, il est devenu le bouffon et a vu sa signification édulcorée ». C’est ainsi que les banlieues populaires des grandes villes sont souvent le théâtre d’un langage en constante évolution. Lorsqu’ils constatent que « leur » langage est parlé par d’autres, les inventeurs esquissent de nouvelles normes langagières et c’est ainsi que le langage se développe. Le phénomène de verlanisation du verlan s’inscrit dans cette démarche. « «Beur» signifie «Arabe» en verlan. Mais quand les médias s’en sont emparés, c’est devenu «Rebeu», qui est le verlan de «Beur» », ajoute Abdelkarim Tengour. La preuve que la source inépuisable que constitue le langage des cités, qui peut-être considéré comme une contre-culture, risque d’échapper encore longtemps à la volonté d’appropriation par la culture dominante.
Migrance n°41 : 1983, La Marche pour l’Egalité et contre le racisme Coordonnée par Louisa Zanoun, ce numéro spécial de Migrance donne la parole à des acteurs clés de la marche. Marilaure Mahé, Daniel Duchemin directeur du Relais Ménilmontant, la journaliste de Radio Beur Samia Messaoudi… Mais surtout des textes de mises en perspectives historiques de la mémoire de l’immigration française. La particularité de cette revue spécialisée.
18
1983-2013, Flash-back : la Marche en débat à Presse & Cité le 31 mai 2013 Episode 2 / Adil Jazouli, sociologue : « On a eu tendance, après la Marche, à chercher des leaders compatibles politiquement, des gens avec qui on pouvait composer, et qui ne disaient pas c’est tout ou rien ! Ce n’est pas illégitime, de la part du politique ! » Regarder la vidéo sur www.presseetcite.info/g002
19
Libération du 15 octobre 2013
Libération du 3 décembre 1983
rubrique DOSSIER
DOSSIER rubrique
Des blousons noirs aux rappeurs des « tié-quars » : 30 ans de cultures musicales des quartiers
3 décembre 83. Toumi Djaidja et ses acolytes, au bout de leur marche, arrivent à Paris. Ils sont dépeints en véritables rock stars par « Libé », qui met en exergue les riffs de Bob Marley et les volutes de fumée qui les accompagnent. Le « phénomène beur » est monté en épingle par la presse. Les quartiers populaires et les enfants d’immigrés fougueux qu’ils abritent, sortent de l’ombre et ouvrent un nouveau chapitre de la pop culture française.
au foot, ils font danser, bouger, il y a une chaleur. Le rapport au corps, ça joue. Tu peux faire la bringue, mais t’es pas non plus complètement défoncé ».
Back to the roots
Princess Erika ( à droite) - © Amadou Gaye
86, c’est aussi l’année du premier concert de raï à Bobigny, avec Khaled et Mami. « Avec Raïna Raï, qui a électrifié le raï, c’était ce qu’on écoutait en vacances, un souvenir du bled, avant que ça perce à la télé, c’était écouté par les algériens ou certains branchés », indique Ali Guessoum. « N’oublions pas ce qu’on écoutait à la maison, précise Mouss qui avec son frère Hakim a repris des chansons de l’immigration algérienne dans Origines Contrôlées. C’est notre complexité. Même si je fais du rock ou du ska sur scène, je danse toujours kabyle dessus [un des premiers morceaux de Zebda s’appelle d’ailleurs Mala Diural – A la skabyle », NDLR]. C’est comme ça que j’ai appris à danser dans les mariages, à exprimer quelque chose ».
Eclosion et explosion du rap français Zonards et funky « 83 c’est la sortie de Thriller » rappelle Mouss Amokhrane, du groupe Zebda, formé dans le quartier des Izards à Toulouse. « Dans la culture de quartier, on est à fond dans la musique noire américaine, la funk, la soul, on aime les petits pas de danse funky ». « Barry White et James Brown auraient pu redistribuer des royalties en banlieue renchérit Ali Guessoum, activiste culturel et responsable de l’agence de communication Sans Blanc. « On a été des ambassadeurs de la funk en France, j’ai des potes en 82 qui avaient 5000 vinyles chez eux, c’était des encyclopédies vivantes, ce qui ne tombe pas de nulle part : les rythmes afro-berbères sont un peu funk. On a une culture de danse, bien plus que le binaire de la polka ou de la valse. On n’a pas connu le formatage de l’Eglise qui interdisait les rythmes considérés comme diaboliques ». Au début des années 80, quels que soient leurs origines, les banlieusards se reconnaissent dans l’identité de classe de la périphérie portée par les loubards, les blousons noirs. « Ca écoutait du Renaud, se souvient Ali Guessoum. C’était les loubards, les vieux disaient espèce de « blouse noire », pour parler des blousons noirs. On pouvait s’identifier à eux parce que c’étaient des représentants des quartiers, de la zone. A l’époque il n’y avait pas encore de revendication identitaire. Le territoire, c’était la banlieue et la classe, c’était celle de l’ouvrier, du besogneux, du zonard ou de la jeunesse ».
Reggae music
Peu après sa mort en 81, Bob est le king dans les quartiers et la richesse musicale du reggae inspire, crée des passerelles entre les genres. « Certains dans le quartier sont connaisseurs et nous font découvrir Steele
Pulse, Burning Spear et surtout le raggamuffin ; on se met à toaster, relate Mouss. Les premières fois où Massilia Sound System vient jouer à Toulouse, ils viennent avec un jeune mec qui s’appelle Chill, Akhenaton (…) Avec les Clash, le ska-punk, le fait que certains punks sont très proches des jamaïcains, on s’ouvre au rock. Et puis il y a Carte de séjour ».
Rockeurs, rebelles ou ringards ?
En 1986, le groupe Carte de Séjour du rockeur Rachid Taha joue devant 100 000 personnes à la Concorde et reprend Douce France de Charles Trenet. Le tube agit comme une déflagration dans la société française. Jack Lang distribue le disque à l’Assemblée nationale. « Ça nous a désinhibés, se souvient Ali Guessoum. Le fait d’avoir des ambassadeurs, un côté rebeu rebelle, affirmé, à la mode, ça a été un électrochoc ». Pourtant le rockeur rebeu fera relativement peu d’émules dans les quartiers. « Le rap a ringardisé le rock, qui s’est embourgeoisé. Au départ c’était un truc de révolte, après ça s’est installé dans une espèce de confort, l’industrie du disque l’a codifié. La rage est devenue une institution. Alors qu’on était encore libres dans le hip-hop ». Pour Mouss, dont le groupe a de très nettes influences rock « il y a toujours eu dans les quartiers un ou deux héros qui osent dire « moi je m’en fous, je ne suis pas funky, je suis rock and roll ». Alors que le hip-hop, une culture de danse, sportive, est associé de fait à la culture quartier, dans le rock, il y a un côté ringard, blaireau dans le sport (…) Par contre au début des années 90, à la grande époque du mouvement alternatif [Zebda] va rencontrer un groupe comme la Mano Negra qui va nous impressionner, parce qu’ils sont à la fois rock, mais avec plein d’influences, reggae, latino, même un peu hip-hop. Ils ne sont pas froids dans le style. Ils jouent
Moins de 10 ans après les premiers tubes hip-hop de Kurtis Blow, Sugarhill Gang et Grandmaster Flash sur des samples de funk, le hip-hop est digéré dans les quartiers. Au début des années 90, Il peut être restitué sur fond social, à travers l’émergence du rap français. « C’est les petits frères de tous ces mômes qui avaient des collections de vinyles de funk qui ont pris le relais derrière les platines quand les groupes de rap ont émergé, explique Ali Guessoum, qui à l’époque réalise des pochettes d’albums de rap. Un courant musical qui va atteindre des sommets qualitatifs dans l’underground avant que son succès ne lui fasse largement dépasser les frontières des quartiers. Au point de devenir la nouvelle variété dans les années 2000. « Dès qu’il a rencontré le succès, le hip-hop a connu exactement la même chose que le rock estime Ali Guessoum. Les chefs de produit des maisons de disque, qui viennent du marketing, se sont dit que les bad boys ou la banlieue sont un bon produit. Les artistes qui faisaient des chroniques sociales et un journalisme des quartiers se sont surtout intéressés à leur ego et aux chaussures qu’ils portaient. C’est devenu un truc libéral où l’individualisme et la frime sont de mise ». Pour Mouss « le hip-hop n’est pas différent des autres styles musicaux, avec le succès il devient populaire. Une partie des artistes reste puriste et l’autre se tourne plus vers la variété. Le hip hop n’avait aucune raison de rester underground, c’est une culture. C’est une façon d’être, une musique actuelle, une modernité. C’est aussi la preuve que les quartiers existent. Ça aide les jeunes des quartiers d’avoir des musiques qui leur ressemblent. Les quartiers populaires portent depuis toujours les énergies de l’avenir, les modes, les styles qui finissent par être associés à tout le monde ». Ou comment, de la périphérie, la culture des quartiers a fini par occuper le cœur de la scène culturelle hexagonale.
Yannis Tsikalakis
La Marche pour l’Egalité. Entretiens avec Adil Jazouli et Toumi Djaïdja, Editions de l’Aube Adil Jazouli, qui était jeune sociologue à Vénissieux en 1983, a recueilli la parole très rare de son ami Toumi Djaïdja, initiateur de la marche. Dans cet entretien, il se livre pour la première fois depuis 30 ans. Ce fils de harki raconte son histoire familiale particulière, sa jeunesse à Vénissieux et son engagement dans la lutte antiraciste bien sur… Loin d’avoir une parole de haine et de revanche, Adil Jazouli a mis en valeur la sagesse qui caractéristique le personnage de Toumi.
20
1983-2013, Flash-back : la Marche en débat à Presse & Cité le 31 mai 2013 Episode 3 / Marilaure Mahé, ancienne marcheuse : « Qui ira à l’Elysée ? On avait la rumeur comme quoi, pour aller à l’Elysée, il fallait un casier judiciaire vierge… alors on a dit, on boycotte ! » Regarder la vidéo sur www.presseetcite.info/g003
21
Marche mondiale de femmes (Turquie 2010) - © Claire Malen
Marche pour l’égalité 1983 - © Amadou Gaye
rubrique DOSSIER
DOSSIER rubrique
30 ans de minorités dans le sport,
de Noah à Zidane
Yannick Noah (au centre) Roland Garros 1982 - © Amadou Gaye
L’historien Yvan Gastaut, professeur à l’Université de Nice, revient sur la place contrastée qu’occupent les minorités dans le sport en France depuis le début des années 80. Entre intégration et essentialisation, le sport est-il un vecteur de métissage ou un miroir aux alouettes ?
P&C : La victoire de Yannick Noah à Roland Garros est concomitante de la Marche. Quelle est la contribution de cet événement sportif à l’évolution de l’imaginaire français sur les minorités ? Yvan Gastaut : Ce sont deux choses très différentes. Mais c’est vrai que cette victoire de l’enfant d’une Blanche et d’un Noir, c’est une success story, et la préfiguration du Black-Blanc-Beur de 1998. Le contexte reste celui d’une période de forte expression du racisme, comme le montrent l’assassinat du petit Toufik à La Courneuve, les Arabes qui se font tuer à Marseille ou le score du FN aux municipales... Cela montre en tous cas que la société française a deux visages ; la figure du « Black », on dit bien « Black », pas « Noir » devient à la mode, un peu comme la mode « nègre » des années 20. Cette victoire est une émotion fondatrice. P&C : Pourtant, des sportifs étrangers ou d’origine étrangère avaient déjà émergé précédemment dans les équipes françaises ? YG : Oui, il y avait des italiens par exemple, ou des Maghrébins comme Ben Barek [joueur marocain jouant dans l’équipe de France des années 10 et 50]. L’équipe de France de foot de 1982, à Séville, est aussi métissée. Mais c’était à une époque où globalement, la société n’a pas de questionnement sur cette présence, ni sur elle-même, à ce niveau, ce n’est pas mûr. On ne les voyait pour ainsi dire pas. C’était l’époque coloniale. Noah, c’est la France métissée, à la fois le Cameroun et la France. Le sport est à l’avant-garde. Arrivent alors les coupes de cheveux imitées « black », c’est le moment où la mode s’empare de tout ça, comme Oliviero Toscani avec « United colors of Benetton. Mais en même temps, on a aussi les charters maliens en 86... L’apogée, c’est
le défilé de Découfflé en 89, pour le bicentenaire de la Révolution et son défilé emblématique du métissage. P&C : Quelque chose change-t-il avec la victoire des Bleus en 1998 ? YG : Oui, cette victoire Black-Blanc-Beur va en fait réunir tout le monde, avant, les beurs ne sont pas trop dans cette mode. Grâce à Zidane, on a tous les éléments réunis ; même si SOS Racisme et ses concerts à la Concorde rassemblaient déjà avant, le pouvoir rassembleur du sport est encore plus fort. C’est comme avec le patronat : dans le sport, c’est la performance qui compte, pas la couleur !
“ Le sport n’est pas une société exemplaire. La mode Black Blanc Beur, c’est une parenthèse enchantée ”. P&C : Le sport est de plus en plus présent dans la société ; est-ce qu’il est un vecteur pour l’intégration des minorités ? YG : Les sportifs sont les héros modernes, plus que la littérature ou le théâtre. D’autant que ce n’est pas le bagage culturel qui importe dans le sport ! Une politique d’intégration des athlètes est menée dans les
années 90, de fait, par le ministère de la Jeunesse et des sports. P&C : Pourtant, le sport peut aussi continuer à véhiculer des clichés. De ceux que pointent Senghor, lorsqu’il affirme que, pour les Occidentaux, « la raison est Hélène, et le sentiment nègre »... et le sport, a fortiori. YG : Oui, il y a un effet pervers, le sport peut aussi essentialiser, sur le mode : « les Noirs courent plus vite ». Et puis on peut saluer les héros gagnants, tout en exprimant beaucoup de racisme dans les stades dès les années 80, comme le révèle Joseph-Antoine Bell [footballeur gardien de but de l’OM dans les années 80, Ndlr] : violence, intolérance, cris de singe... Le sport n’est pas une société exemplaire. La mode Black Blanc Beur, c’est une parenthèse enchantée, trois ans plus tard, il y a les sifflets contre la marseillaise pendant le match France-Algérie. Et le coup de boule de Zidane est vécu par certains comme « l’arabe qui s’exprime dans sa profondeur absolue » ! Même si cette parenthèse peut se déliter rapidement, elle a le mérite d’exister. Il faut savoir profiter de ces événements quand ils se présentent. P&C : Est-il donc plus facile d’être français issu des minorités quand on est sportif ? YG : Les personnalités les plus appréciées des français sont issues du sport ou du cinéma, qui sont moins excluants que la littérature ou le théâtre. Mais cela reste des microcosmes.
Propos recueillis par Rwan Ruty
Une marche, deux générations, webdocumentaire de Ouafia Khéniche, sur France Info. « J’ai avant tout voulu éviter le côté commémoratif. Je me suis donc intéressée aux enfants des marcheurs. Une bonne façon de traiter de la société actuelle » raconte la journaliste de Radio France. On réalise dans ces regards croisés entre parents et enfants que « la transmission de la mémoire n’a pas forcément eu lieu. Cela s’explique aussi car ces enfants vont bien, ils n’ont pas forcément de problème d’identité » souligne-t-elle.
22
Mahiebine Mekhissi (J.O de Pékin 2008) - © Rondeau / Pressesports
rubrique DOSSIER
1983-2013, Flash-back : la Marche en débat à Presse & Cité le 31 mai 2013 Episode 4 / Djamel Attalah, ancien marcheur : « Moi quand j’étais gamin à l’école, mes copains, c’étaient David, Pierre, Jacques. Tout ça n’existe plus… » Regarder la vidéo sur www.presseetcite.info/g004
23
rubrique DOSSIER
2013 : les Minguettes du rap, loin de la Marche
Ming8 halls Starf, c’est le groupe de la banlieue lyonnaise qui monte en ce moment. Sortis tout droit des tours des Minguettes, les jeunes rappeurs ne se complaisent dans des lyrics faciles. Ils n’ont pas encore 30 ans et n’étaient majoritairement pas nés lors de la Marche. Pour eux, le constat n’est malheureusement pas brillant : l’impact de la Marche est faible, voire nul sur leur quotidien. Et si le hip hop est devenu le premier marché musical, générant plus de ventes que tout autre genre, ils n’ont pas vu cet eldorado. Lyon reste une ville sinistrée en terme de réussite de ses artistes hip hop.
SO : Est-ce que vous pensez que cette Marche a changé des choses dans votre quartier ? MHS : On pense que la Marche a fait changer certaines mentalités, en montrant qu’avec un peu d’organisation et de volonté on pouvait faire des choses à grande échelle. Maintenant concrètement, dans le quartier, rien n’a changé vraiment depuis 30 ans. Quand tu écoutes les dires des plus anciens, on a peut-être un peu plus de moyens pour divertir la jeunesse par le biais de maison de quartier, centres sociaux ou autres ... Sinon rien n’a vraiment évolué, les rapport avec la police,
le taux de chômage ou bien même la ghettoïsation ne se sont pas améliorés. SO : Pensez-vous que si le hip hop et la culture des banlieues se sont imposés dans le paysage culturel français, c’est en partie grâce à l’impact médiatique de cette marche, qui a mis pour la première fois les jeunes des banlieues au centre du traitement médiatique ? MHS : Non, on pense que ça n’a rien a voir. Maintenant, parler du hip hop comme une culture acceptée ou bien même faisant partie du paysage culturel français, c’est à notre avis erroné. On n’en est pas encore là ! SO : Le hip hop doit-il forcément revendiquer et porter un message, ou est-ce une culture comme une autre ? MHS : En substance, le Hip Hop doit porter un message. Tout le monde n’a pas forcement le même message à véhiculer, mais du fait qu’il est un moyen d’expression, il est forcement porteur d’un message plus ou moins engagé.
Propos recueillis par Sylvain Ortega / Lyon Bondy Blog
D.R.
SO : Est-ce qu’il vous arrive parfois de discuter entre vous de la Marche pour l’égalité et contre le racisme ? Connaissez-vous (bien) cet événement ? Si oui, qui vous en a parlé ? MHS : Sincèrement, il ne nous arrive quasiment jamais de parler de la Marche en tant normal. Maintenant, du fait des 30 ans de la Marche et de la sortie du film, on en a déjà parlé entre nous. Les plus renseignés ont fait part de leur savoir aux moins avisés. Certains en ont entendu parler par des personnes de leur entourage présentes à cette époque et qui étaient plus ou moins impliquées, d’autres en se renseignant comme tout le monde sur internet.
La Marche par la danse
C’est l’histoire de trois amis de Toumi Djaïdja. La culture est leur vecteur de transmission. A travers un projet artistique innovant, dont un spectacle de danse contemporaine urbaine, leurs trois associations vénissianes veulent transmettre la mémoire de la Marche de 1983.
T
rois structures associatives unissent leur talent pour raconter différemment une page de l’Histoire. Par le biais d’un projet artistique pluridisciplinaire, elles ont le dessein de transmettre l’épopée de la Marche. Ce projet à la fois artistique et d’éducation populaire, 100% issu de Vénissieux, la ville où tout a commencé, a été initié par « Vigilance Vénissiane », une association locale de lutte contre les discriminations. L’idée germe il y a trois ans : « nous avions pensé créer quelque chose d’audiovisuel et de multiple autour de la Marche » explique Pierre Bafounta, le président de l’association à l’origine de l’aventure. Pour mener à bien cette initiative, il s’entoure de Pascal De Maria et de l’association « Hareng rouge », une structure audiovisuelle, chargée de proposer un projet global respectant la volonté pluridisciplinaire. Il va en résulter de nombreuses expressions artistiques et pédagogiques dont le but est de transmettre la mémoire de cet événement : un documentaire, un clip musical avec les habitants des Minguettes, un café poésie, une web-série et surtout un spectacle de danse contemporaine urbaine.
remettre en avant cette force collective incroyable qu’a été la Marche ». A travers cette création, Azedine souhaite redonner l’envie de créer et de partager, comme l’avaient fait les jeunes des Minguettes en 1983. Différemment d’un film ou d’un documentaire, la danse a un pouvoir évocateur très important. Il est possible, par la gestuelle corporelle, de « dépasser le cap des mots et de se baser uniquement sur le ressenti » confie le fondateur de Second souffle.
« La danse permet de dépasser le cap des mots » La réalisation du show corporel est confiée à Azedine Benyoucef, de la compagnie de danse Vénissiane Second souffle. « Lorsque Pierre et Pascal sont venus me proposer d’écrire une chorégraphie sur ce qu’a été la philosophie de la Marche, j’ai tout de suite donné mon accord ». C’est une fierté pour lui de pouvoir mettre en scène ce qu’il qualifie de « légende urbaine ». Le rapport à la mémoire est omniprésent dans la réflexion du directeur artistique : « Dès la première rencontre avec mes danseurs, je leur ai dit qu’en interprétant cette chorégraphie, ils avaient une part de responsabilité ». En effet, le poids du sujet le rend différent d’un spectacle classique. Il ne s’agit pas simplement de monter sur scène et d’assurer une bonne prestation. La portée est ici plus profonde : « Il s’agit de porter une mémoire et de raviver les esprits de certaines génération ». Mais pas seulement. Azedine regarde aussi vers le présent : « dans le climat actuel, cette représentation peut aussi
Un travail avec Toumi Djaïdja, « cet artiste de la vie » Pour mener à bien cette partie du projet, le chorégraphe décide de s’inspirer directement du protagoniste principal des évènements de 1983 : Toumi Djaïdja. Il va entreprendre une sorte d’immersion dans le passé de l’initiateur de la Marche afin de comprendre le climat de l’époque, le message et la philosophie qui l’animait. « Il y avait une histoire réelle, des faits réels qu’il ne fallait pas négliger, artistiquement parlant. Il fallait alors que je me rapproche de Toumi. ». Les différentes rencontres,
au cours desquelles Azedine écrit le manuscrit, inspirent et bouleversent le danseur : « Nous avons eu beaucoup d’échanges. J’ai travaillé avec beaucoup de gens, mais travailler avec lui, cet artiste de la vie, fut le moment le plus émouvant de ma vie. ». Toumi apparaît comme une sorte de « messager » pour le chorégraphe : « C’est un homme qui a une idée de ce que pourrait être le futur. C’est ce que j’ai aussi voulu transmettre à mes danseurs ». Le projet global a pour vocation de pérenniser la transmission de la marche : « On est actuellement en pleine commémoration mais nous sommes contre l’idée que tout s’arrête le 3 décembre ». (date d’arrivée de la Marche en 1983). Bien que cette idée est née et réalisée sur le sol Vénissian, sa diffusion se veut plus large : « On met en honneur quelque chose qui est parti de chez nous mais le rayonnement peut et doit être régional, national » détaille Pascal De Maria.
Maxime Hanssen, Sylvain Ortéga / Lyon Bondy Blog
« Français d’origine contrôlée », un documentaire de Mustapha Kessous et de Jean-Thomas Ceccaldi Ce documentaire événement, en deux parties, parle de générations oubliées, « presque effacées du paysage national. Il redonne la parole à ces Français d’origine maghrébine. Des mots, leurs mots, pour revisiter le destin de ces générations et de ces rendez-vous manqués avec la République » explique le journaliste au Monde. 2x55’ - Diffusion sur France 2 en janvier 2014
24
1983-2013, Flash-back : la Marche en débat à Presse & Cité le 31 mai 2013 Episode 5 / Bernard Langlois, ancien journaliste d’Antenne2 : « A l’époque des rodéos, un certain nombre de journalistes excitaient les jeunes de banlieue. » Regarder la vidéo sur www.presseetcite.info/g005
25
© Wave Design - CID Nantes
Paris 1986 - © Amadou Gaye
rubrique DOSSIER
DOSSIER
Olivier Cachin
« Le rap et la Marche, deux histoires parallèles » Journaliste, Olivier Cachin suit depuis les années 80, la culture hip-hop. Il revient sur son émergence, au lendemain de la Marche pour l’égalité et contre le racisme.
Paris Trocadéro - © Amadou Gaye
AB : Pendant cette période, au-delà du fait que les acteurs ne soient pas les mêmes il y a la question de la visibilité médiatique. Pour le hip hop c’est H.I.P. H.O.P. en 1984 ou Rapline sur M6. OC : L’émission de Sydney et la mienne (NDRL : Rapline) sont des visibilités complètement accidentelles. Aux Etats-Unis, quand une culture commence à fonctionner commercialement, les publicitaires et les médias vont s’y intéresser, parce qu’il y a de l’argent à faire. Il n’y a pas d’états d’âme. En France c’est un peu différent. Sydney, c’est parce qu’une femme, Marie-France Brière, a flashé sur cette culture, a imposé Sydney, qui est le premier Noir à la télévision pour une émission régulière. Quand j’ai fait Rapline sur M6, c’était la même démarche : M6 voulait faire une émission d’été sur le « truc du moment », y’a eu le Jerk, le Twist etc. C’est une émission qui n’a jamais rien rapporté à la chaîne. En France on préfèrera toujours l’artiste plus lisse, même s’il vend moins mais qui va être plus fédérateur, et qui va moins faire que les gens regardent notre télé vont dire « oh lala le négro là il me gêne je vais le zapper ». C’est ça la mentalité en France. Et le rap s’est retrouvé en plein dedans puisque, de fait, il y a toujours eu beaucoup de « Noirs et Arabes ». Un peu moins au début où c’était plus multicolore. Ce n’était pas prémédité mais pendant toute la première génération il y avait des Blancs, des Noirs, des Arabes, des Français d’origine comorienne, algérienne, marocaine, ivoirienne, portugaise etc. Regardez Assassin, IAM, NTM, le Pussy Solar ! Ils sont multiculturels. Pas parce qu’ils ont décidé de dire « on va être multiculturel ». Ce sont juste des communautés d’intérêt de gens qui habitent au même endroit et se sont passionnés par le même truc. Ils ne savent pas ce que c’est, ni comment produire un disque, mais il y a cette envie. Une envie qui fait qu’ils vont se mettre ensemble et faire des disques qui comptent parmi les classiques. Ministère AMER sont les premiers qui amènent, avec un côté américain, la puissance noire, le groupe noir. Maintenant ça s’est beaucoup plus généralisé.
Paris Beaubourg 1988 - © Amadou Gaye
AB : L’émergence du hip hop dans les années 80 correspond à la période de la Marche pour l’égalité et contre le racisme. Comment ces deux histoires se rencontrent-elles selon vous ? OC : Ce sont des histoires parallèles mais je ne pense pas qu’il y ait de liens directs. La vraie démarche de ceux qui ont créé cette culture hip-hop en France était avant tout artistique. Elle n’était pas directement liée, comme pour la « Marche des beurs », à une demande de visibilité. La culture hip-hop a émergé d’une volonté de faire de l’art, de faire de la musique, de s’exprimer. C’est seulement à l’intérieur de cette démarche artistique qu’on a eu la demande identitaire, le côté « on veut être intégré ».
AB : Comment arrive-t-on à cette démarche identitaire ? OC : Si vous regardez la thématique de la première génération de rappeurs français, c’est humaniste. Même NTM ! Lisez les textes du premier album : l’argent pourrit les gens, Blancs et Noirs. C’est de l’humanisme pur et simple. Avec sur le deuxième album. L’imparfait du subjectif ; que voulez-vous que je fisse sinon du hardcore. Des gens qui ont - ce qu’ils ont eux même appelé le complexe du banlieusard. C’est ce que dit Akhenaton ; « quand tu vends un million d’albums t’es un grand artiste, quand t’es rappeur et que tu vends un million d’albums t’es un rappeur ». A chaque fois il faut reprouver la même chose. Autre exemple ; Lunatic. Ils vont présenter leur maquette à toutes les maisons de disque. Elles leur disent ; c’est bien mais on ne peut pas. Ils le sortent en indépendant. Disque d’or. Booba arrive avec son album solo, Temps mort. Il le présente aux maisons de disque : même réponse. Il le sort en indépendant. Disque d’or à nouveau. Après il fait son propre label, et il a une licence avec Barclay. Dans les autres musiques, on vous juge d’après le chiffre de ventes. Dans le rap c’est toujours plus compliqué. Donc la génération suivante a intégré tout ça - il y a eu des succès bien sûr – mais toujours épisodiques et jamais par rapport à l’ensemble du mouvement. AB : La marche pour l’égalité pose une interrogation fédératrice. Ensuite, on a l’impression que cette identité « banlieue » et cette identité française revendiquée éclatent, et que cela se ressent dans les trajectoires des rappeurs. Qu’en pensez vous ? OC : Le refus de l’acceptation de cette musique a amené à un repli sur soi et à un côté plus identitaire. Mais aussi, à la différence d’un mouvement comme la Marche des beurs, le mouvement hip-hop est individualiste. Par plein d’aspects le rap, en France, est une musique de droite. Les rappeurs veulent monter des entreprises, poser leur idée,
leur image. Ce sont des gens à qui on dit « vous n’existez pas » et qui vous disent alors « eh bien on vous emmerde, j’existe à travers ce que je fais », et ils vont amplifier cet égocentrisme. Tout cet individualisme ne s’accompagne pas forcément d’une démarche collective. Les rappeurs
“ Le refus de l’acceptation de cette musique a amené à un repli sur soi et à un côté plus identitaire ”. ne sont pas des gens qui vont se battre pour leur communauté. Ils vont éventuellement faire rayonner l’endroit d’où ils viennent. Ce n’est pas la même démarche que la Marche qui dit « on veut une identité en tant que nous maghrébins, nous français d’origine africaine ». AB : Est-ce que finalement le rêve de la Marche, qui est de devenir un citoyen ordinaire, ne se rapproche pas de l’egotrip de ce rap de droite ? OC : Oui, et de toute façon les rappeurs, en tant que banlieusards, sont le reflet d’une époque et d’une génération. Comme de la même façon les rappeurs des années 90, les NTM, Solaar etc, n’étaient pas aussi matérialistes parce que l’époque était différente. Je ne sais pas si les rappeurs veulent être des citoyens comme les autres mais en tout cas ce qu’ils aimeraient bien être, pour la plupart, c’est être des artistes comme les autres. C’est-à-dire ne pas avoir à se justifier à chaque fois qu’ils sortent un disque mais d’être jugés sur leur valeur artistique.
Propos recueillis par Anne Bocandé / Afriscope
En marche, de Marilaure Mahé, Eds. Sokrys Dans le florilège des livres et témoignages, celui de Marilaure Mahé est le seul roman. « Dans mon récit les marcheurs historiques sont présents avec leur vrai prénoms mais les personnages principaux sont fictifs. Bien sur je me suis inspiré de faits réel et ils sont réalistes, mais il n’existe pas » raconte la marcheuse historique. « Je veux que ce livre soit accessible au plus grand nombre et en particulier à la jeunesse. Mes personnages sont des jeunes qui traitent des problématiques des jeunes de leur époque, avec le vocabulaire et la façon de parler… » 26
1983-2013, Flash-back : la Marche en débat à Presse & Cité le 31 mai 2013 Episode 6 / Pascal Blanchard, Achac : « Pour comparer, à Washington, à 800 mètres de la Maison Blanche, il y aura le plus grand musée qui fera 17 500 m2, pour 500 millions de dollars, sur l’histoire des afro-américains. » Regarder la vidéo sur www.presseetcite.info/g006
27
Battle « Duo mythique » au Blanc-Mesnil 2012 - © Yannis Tsikalakis
Cheikna le serpent lumineux - © Amadou Gaye
DOSSIER
DOSSIER
De Smaïn à Jamel,
le stand-up, trait d’union entre la rue et les artistes ?
L’humour « made in banlieue » aura eu du mal à s’affirmer dans un paysage artistique français naguère trusté par Muriel Robin ou Raymond Devos. C’est avec Smaïn et surtout le Jamel Comedy Club, par le biais du stand up, que les jeunes des cités s’approprient enfin des lieux dits « parisiens » comme les théâtres. Et apprivoisent aussi le grand public. Comment le stand-up est devenu le trait d’union entre la rue et les artistes ? Dans cette tribune libre, Thierry Grone, lui-même coauteur d’une web série intitulée « Qui met le coco ? », donne son point de vue.
P
eu de place donc pour les minorités visibles, peu de sujets qui les concernent. Toute une génération qui n’a que des cassettes VHS pour rire aux blagues de Gaou. Smaïn sera un des premiers humoristes plébiscité par les quartiers populaires, parlant de ses origines avec ses spectacles « A star is beur » (1986) ou « T’en veux ? » (1989), et son célèbre gimmick « t’en veux ? », où un jeune défoncé propose du shit ; puis viendra Eric Blanc (qui est Noir) et ses imitations de Yannick Noah ou Valery Giscard D’Estaing… sans oublier Pascal Legitimus, au sein du groupe Les Inconnus, qui donne plutôt dans la parodie.
tués par un animateur et des DJ hip-hop, « le stand-up, c’est de l’humour urbain, pas du Bigard. Cela nous permet d’amener au cœur de la ville un public qui ne va jamais dans les théâtres parisiens, car on utilise les codes qu’ils connaissent pour leur parler d’un quotidien qui leur ressemble. » Les comédiens sont à l’image du public : métisse. Grâce à une autodérision corrosive, ils abordent tous les sujets sans complexes, raillent les stéréotypes qu’on leur colle à la peau et prennent leurs distances avec des sujets graves, comme la violence et le communautarisme.
La cité, tu l’aimes ou tu la kiffes
Pas d’accessoire. Pas de costume. Raconter sa vie à travers des histoires drôles sur le mode de la vanne, inspirées du quotidien, et où la langue de Molière est volontiers mise à mal, le verlan et les expressions du bled se retrouvant en première ligne. Mener un spectacle improvisé, qui prend à partie le public. Et réciproquement. De la spontanéité, de la répartie, des punchlines, comme dans le rap, une capacité à rebondir sur ses propres ratages, et à interagir avec la salle. L’identification du public à l’artiste prime, d’autant qu’ils sont tous deux souvent issus de minorités volontiers caricaturées dans l’imaginaire dominant. Il y a donc une part d’autodérision et de retournement du stigmate. Voilà les recettes de base d’un stand up.
D’Eddy Murphy, à Jamel en passant par Woody Allen : un style issu des « minorités »
Fellag- © Amadou Gaye
Se tenir debout, face aux siens d’abord… mais pour mieux les vanner
Un style qui puise son origine dans la culture populaire américaine de la fin du XIXe siècle, la stand-up comedy prend son essor à New York dans les années 1960, lorsque des comédiens comme Lenny Bruce repoussent les limites de la bienséance en abordant des sujets politiques, raciaux et sexuels. Inspiré par ce style acerbe, le comédien Richard Pryor est la figure emblématique de la stand-up comedy et de la contre-culture américaine. Domaine de prédilection des humoristes juifs ou afro-américains (notamment Woody allen et Eddy Murphy), le stand-up est devenu un outil de revendication sociale et d’affirmation identitaire. En France, Jamel Debbouze est l’un des premiers à importer le standup, même si d’autres humoristes comme Desproges, Coluche ou Bedos s’adressaient déjà directement au public, sans composer de personnage, et en parlant des problèmes de société. Jamel et son ancien comparse Kader Aoun (aujourd’hui remplacé par Mohamed Ha-
midi, lui-même repreneur du Bondy blog en 2006), ont créé le Jamel Comedy Club, diffusé sur Canal+, afin de révéler les espoirs du standup comme Amelle Chahbi, Claudia Tagbo ou Thomas Njigol. Jamel devient ainsi « révélateur de talents » qui ont du coup popularisé ce style.
Le stand up, nouvelle vitrine de la banlieue après le rap et le foot ?
Derrière un message comique et un bon moment passé entre public et artistes, cette nouvelle forme d’humour entend refléter la diversité «Multiethnique» ethnique de la société française. Sous le label : « Qui mieux qu’un mec de la tess peut parler de la tess » ? Pour Spike Boukambou, qui sillonne la banlieue parisienne depuis une dizaine d’années et a lancé des soirées ambiance « scène ouverte » dans des cafés-théâtres, et où les monologues courts se succèdent et sont ponc-
Il est plus simple de rigoler aux blagues Patson avec ses expressions « ça c’est cadeau… » ou « jeux de jambes », que celles d’un Laurent Gerra avec son langage soutenu… Aujourd’hui, les gosses de la rue s’identifient aux auteurs de stand up, car ils se retrouvent dans cette façon dont les jeunes se racontent des histoires et se lancent des vannes dans les halls d’immeubles. Ainsi le stand-up serait le trait d’union entre la rue et les artistes. Un trait d’union qui est avant tout une histoire de génération plus qu’une histoire de banlieue, et qui se retrouve volontiers dans le Comte du Bouderbala. Un style qui ne vient pas forcément de banlieue mais parle comme on parle entre 15 et 35 ans. Un exercice d’autant plus utile qu’on entend rarement ce que pense un jeune de 25 ans dans les médias. Une soupape d’expression pour aborder des questions de société de manière écrite, artistique et drôle. Les scènes de stand-up sont donc bien ouvertes un espace de parole et de liberté nécessaire pour toute une génération, qui n’y avait jusqu’alors pas accès. Par exemple, avant, les seuls comiques beurs qui représentaient les quartiers, étaient obligés d’aller dans le sens du vent. Avec le stand-up, quelle que soit son origine, on peut dire avec humour ce qu’on pense sur la société. Il y ainsi un côté militant : l’idée de « représenter » comme les rappeurs qui parlent de son quartier ; le stand up apporte donc ce que le public demande : la mixité sociale, faire marrer les gens et avoir un rire intelligent. Mais il y a bien rupture avec les vieilles habitudes de la scène comique française. Pour ses détracteurs, l’explosion du « made in banlieue » ou la théorie du « pour nous par nous » est une nouvelle preuve de l’échec du vivre ensemble en France. Reste donc une question : le public français, et surtout la ménagère de moins de 50 ans, sont-ils prêts a écouter ces nouveaux humoristes des temps modernes ? Si, au-delà de Canal +, des émissions de divertissement jouaient le jeu, sans doute oui…
Thierry Grone
La Marche des beurs, pour l’égalité, documentaire de Fouad Chergui, Clap TV « En 2009, on a marché de Marseille à Paris pour faire vivre cette histoire à dix jeunes qui ne a connaissaient pas ; on a contacté des marcheurs de 1983, ça n’a pas été facile ! » Néanmoins, Fouad parviendra à réaliser un documentaire très personnel et très émouvant, en allers-retours entre passé et présent, avec bon nombre de témoignages de jeunes, d’acteurs de l’époque (Toumi Djaïdja, Christian Delorme…) et de spécialistes (Adil Jazouli, Robert Marmoz…)
28
© Ali Guessoum - Agence Sans Blanc
DOSSIER
1983-2013, Flash-back : la Marche en débat à Presse & Cité le 31 mai 2013 Episode 7 / Yvan Gastaut, Unice : « A partir de mars 1983, les socialistes vont faire émerger l’islam comme une sorte de danger. » Regarder la vidéo sur www.presseetcite.info/g007
29
DOSSIER rubrique
Les folles « années beur » de Farid Boudjellal
Les livres recouvrent les murs de l’atelier. Sur le coin d’une étagère, un vieux numéro du magazine Sans Frontière traîne. Une couverture jaunie et un titre accrocheur « La beur génération ». En plein cœur de Belleville, Farid Boudjellal, 60 ans, modèle les personnages de ses albums, au milieu de ce désordre coloré. Il propose une tasse de thé, allume une cigarette. La fumée enveloppe le salon.
S
ilence. L’homme doux au franc-parler replonge dans ses souvenirs. Parler de la Marche pour l’égalité c’est faire revivre le jeune homme de 30 ans qu’il était. Repenser à L’Oud, ce premier album publié en 1983. Le début d’un rêve pour l’enfant de Toulon qui a toujours dessiné.
Dans les années 1970, Farid Boudjellal, fils d’immigrés algériens né en France, appartient à la génération soixante-huitarde. Il s’intéresse à la politique, aux mouvements d’extrême gauche tout en gardant une certaine distance. « On a toujours parlé de ma condition dans des termes misérabilistes. Avec la Marche, pour la première fois de ma vie je me suis reconnu dans un mouvement ». L’eau frémit. L’artiste se dirige vers la cuisine. Il boite. Trace de la polyomiélite qui l’a touché à l’âge de 8 mois. Avec son handicap, impossible de marcher de Marseille à Paris. Alors il met son talent au service de la cause : réalise des affiches, dessine pour la presse. Le 3 décembre, jour de l’arrivée des marcheurs à Paris, les Slimanis, héros de sa précédente bande dessinée, s’emparent de la page « Evénement » de Libération. Autour d’un dîner, cette famille d’origine algérienne évoque avec humour et impertinence les aléas de l’intégration, les conflits générationnels. Le père envisage de retourner au pays, les enfants, eux, n’y pensent même pas. L’ancien sympathisant communiste se souvient avec aigreur des mots de George Marchais : « La finalité de l’immigré, c’est de rentrer chez lui ». Il s’en insurge encore : « Je suis né en France. Vous entendez mon accent ? Je suis vraiment le Toulonnais moyen. Nous on voulait rester ici et la Marche a apporté cette idée de présence ».
Beur is beautiful
Il sirote une gorgée de thé, tire sur sa cigarette et explique, le sourire aux lèvres : « Après la Marche, il y avait une sorte d’euphorie. On écoutait de la musique arabe dans les boites de nuit. C’était l’époque du raï, du chaâbi ». Le regard de la société change. Les Français issus de l’immigration sortent de l’ombre. Dans les rues, tout le monde arbore la petite main jaune. Farid Boudjellal enchaîne les albums. La critique, élogieuse, y voit du « SOS Racisme en bande dessinée ». Il résume : « Avec mon look ringard de baba cool, je suis devenu branché parce que je m’appelait Farid Boudjellal ». Du haut de ses 30 ans, l’artiste regarde cette adulation médiatique avec distance. « J’étais conscient de mes imperfections, du travail que j’avais à faire ». Dès 1985, c’est le retour du boomerang : les années folles laissent place à la grande dépression. « Les beurs ne sont plus à la mode » lui lance un éditeur d’Albin Michel qui refuse de le publier. Le coup est rude. « En faisant de moi une mode, il m’avait effacé la société française ».
© Emma Roulin
L’idée de présence
“ Avec mon look ringard de baba cool, je suis devenu branché parce que je m’appelait Farid Boudjellal ”. La « littérature beur »
Le temps passe, une nouvelle expression apparaît : la « littérature beur ». Parfois rangé au rayon « racisme » des librairies, les créations des auteurs français issus de l’immigration ne sont ni françaises, ni maghrébines, ni maghrébines de langue française. Les spécialistes regroupent ces romans car ils évoquent des thèmes similaires : le quotidien en banlieue, les conflits générationnels, l’entre-deux culturel. « Des conneries » s’emporte Farid Boudjellal. « Un bourgeois qui raconte son quotidien dans le XVIe arrondissement, on ne dira pas qu’il fait de la littérature du XVIe arrondissement. » Les écrivains beurs sont perçus comme des artisans, des auteurs de témoignages, de documentaire. Leur créativité et leur imagi-
naire sont niés. « Les gens ont toujours tendance à penser que mes albums sont autobiographiques », explique Farid Boudjellal. Son combat : mettre à mal ces préjugés, prouver qu’il est un artiste à part entière, un auteur de bande dessinée avant tout. En 1988, Ramadan, le troisième album de la trilogie de L’Oud reçoit le prix Résistance au festival d’Angoulême. Petit à petit, les récompenses s’enchaînent et la légitimité suit. « Il y a eu des évolutions mais tout n’est pas gagné », conclut le dessinateur. Il se souvient des mots que lui avait lancés cet enfant à un festival : « Toi, tu n’es pas un arabe. Les arabes ils n’écrivent pas de livres ».
Emma Roulin / CFPJ
La longue Marche des beurs/pour l’Egalité, de Nadia Hathroubi-Safsaf, Eds. Les Points sur les I Surprise de constater que les jeunes générations de militants confondaient la marche de 1983 avec celle de 1984, la journaliste, rédactrice en chef du magazine Le Courrier de l’Atlas, Nadia Hathroubi-Safsaf a eu l’idée d’écrire son livre sur « un acte fondateur de l’histoire des luttes de l’immigration maghrébine. Mais aussi sur trente années de politique de la ville, la naissance de Sos racisme, Ni Putes Ni Soumises, les émeutes de 2005, la diversité en politique... ». Une enquête complète rythmée par des photographies d’époque avec une chronologie détaillée en fin d’ouvrage. 30
rubrique DOSSIER
Marche pour l’égalité : comment enfin rentrer dans l’histoire de France ? De même que la nation française n’est pas une simple juxtaposition de différentes populations (« un agrégat inconstitué de peuples désunis », comme disait Mirabeau au moment de la Révolution), l’histoire de France n’est pas la juxtaposition de micro-histoires vécues par des fractions de la population, mais bien le récit brodé a posteriori par la majorité, lorsqu’elle accepte d’incorporer ces micro-histoires vécues par des minorités diverses.
Cette acceptation par la majorité ne peut se faire qu’à plusieurs conditions :
à Beaubourg (« Les enfants de l’immigration »). Cet anniversaire serait-il donc un échec ? Plus de 430 000 euros concédés par l’Acsé à 45 projets honorent pourtant cette mémoire… S’agirait-il là d’un « agrégat inconstitué d’histoires désunies » ? Toujours est-il que l’Etat a choisi de ne pas choisir, parmi ces projets, celui qu’il aurait fallu imposer pour faire consensus national.
-l’implication de l’Etat, qui lui seul décide en général, en France, quels fragments d’histoire doivent être ajoutés au « roman national » (celui-ci s’écrivant « d’en haut » ; aujourd’hui via l’Education nationale, les commémorations, cérémonies officielles, et « lieux de mémoire », essentiellement) -la capacité des minorités à s’organiser pour imposer les fragments d’histoire qu’elles vivent, les rendre « nationalisables », et à trouver les éléments susceptibles de faire prendre conscience à l’Etat des raisons pour lesquelles il doit intégrer ces fragments d’histoire au récit national -la capacité par les minorités qui vivent l’histoire de discuter des compromis nécessaires pour que la majorité accepte l’intégration de ces fragments histoires au récit majoritaire
Quelles sont les raisons de cet échec ? -rôle de la pression du FN, de la lâcheté des élites politiques, du déphasage des élites intellectuelles et culturelles officielles, incompréhension de la gauche, difficultés de l’histoire ouvrière à faire une place à l’histoire des minorités immigrées post-coloniales… -rôle de ceux qui auraient pu porter ce projet : les entrepreneurs de mémoire les plus en lien avec les pouvoirs publics (Achac, Génériques…) -rôle des acteurs associatifs issus de cette histoire (Sans blanc, Tactikollectif, Réseau Mémoire et histoire, collectif pour la Marche et même… Presse & Cité), en raison de leur affaiblissement (notamment
© Axel Dupeux
Force est de constater que ces éléments n’ont pas été réunis à l’occasion du 30ème anniversaire de l’arrivée à Paris de la Marche pour l’Egalité et contre le racisme.
Ne reste-t-il qu’à retrousser ses manches, au moment où une ministre de poids se fait insulter et où le FN se fait entendre à nouveau, comme 30 ans auparavant à Dreux ? Les ressemblances contextuelles sont bien réelles, puisque la gauche, comme en 1983, est encore aux affaires, et regarde passer le train de l’histoire des minorités. Avec SOS Racisme, en 1984, elle avait fini par reprendre le train en marche ; mais en 2013 ? On risque de devoir attendre 2023 et le 40ème anniversaire de la Marche pour se prononcer. Harlem Désir aurait pu faire le lien entre les deux dates. Visiblement gêné de se retourner vers ce passé et expliquer publiquement le chemin parcouru par lui et la gauche depuis lors, ce qui aurait peut-être permis d’expliquer enfin à la nation ses échecs, et quelques réussites… Faute de quoi on reste encore dans l’amnésie, le déni, et qu’avant ce trentième anniversaire, 80% de la jeunesse de 2013 n’avait jamais entendu parler de cette Marche de 1983…
depuis la disparition de SOS Racisme, du Mrap et de la Cimade du paysage public), mais aussi de leurs divisions -rôle de la frilosité des institutions qui, là aussi, se comportent comme une poule sans tête courant devant un camion : François Lamy, Christiane Taubira, Jean-Marc Ayrault, et François Hollande confondus, le premier ayant même eu la douloureuse expérience de se faire tacler publiquement par la figure de proue de cette Marche, Toumi Djaïdja, lorsqu’il a voulu l’associer à la pose d’une pierre rappelant la Marche, à Vénissieux, cet automne –sans même compter Aurélie Filippetti et le ministère de la Culture, incapables de reproduire ne serait-ce qu’une exposition comparable à celle, fondatrice, qui s’est tenue 30 ans plus tôt
Encore heureux qu’un réalisateur belge, Nabil Ben Yadir, nous aide à la rappeler ; ce qui nous fera au passage comprendre, une fois de plus, en quoi le roman national français (et le rayonnement de la France), s’élabore parfois par ses marges, lorsque celles-ci, lentement, finissent par construire un récit consensuel acceptable par la majorité, et donc lorsqu’elles ont été suffisamment « intégrées » et acceptées par la majorité…
Erwan Ruty
1983-2013, Flash-back : la Marche en débat à Presse & Cité le 31 mai 2013 Episode 8 / Samia Messaoudi, Beur FM : « A Valence, on s’est fritté avec le Front national. » Regarder la vidéo sur www.presseetcite.info/g008
31
spécial marche
Grand corps malade : « On disait la “ Marche des beurs ” sans la connaître »
Avec Funambule, Grand corps malade signe un quatrième album toujours marqué par le métissage et les univers différents. L’album le plus abouti musicalement grâce à l’union avec Ibrahim Maalouf trompettiste touche à tout de renom international. Funambule, ton quatrième album, est encore une fois un hymne au métissage… Quelle couleur particulière lui donnerais-tu ? C’est toujours difficile de résumer un album car justement ce que j’aime c’est la variété. Variété des textes, des thèmes, des musiques… Du coup c’est compliqué pour moi de lui donner une couleur. Il y a des textes personnels, d’autres plus ouverts sur le monde, aussi parfois assez graves et d’autres beaucoup plus légers. Je pense que finalement je ferai toujours un peu ça. Personnellement quand j’écoute un album, je ne veux pas être dans la même ambiance sur 15 titres, j’ai envie de varier les humeurs. Donc une fois de plus cet album est dans cette vaine là.
créent. C’est ce que je recherche. Connu aussi pour ton engagement dans tes textes, quels sont les sujets qui te tiennent à cœur dans cet album ? S’il y a un texte qui est vraiment plus engagé c’est Course contre la montre, le duo avec Bohringer. On parle de ce système qui fonce droit dans le mur avec les maîtres mots qui sont profit, rentabilité, et qui imposent leur loi sur tous le reste. Qui passent même avant les rapports humains. On se rend compte que c’est un système qui ne fonctionne pas et qui laisse de plus en plus de gens en galère, au bord du chemin… Je me demande jusqu’où va aller cette course à l’argent.
Ibrahim Maalouf intervient dans cet album, et lui aussi est un touche à tout… Oui, lui aussi aime les rencontres plus ou moins inattendues. Il est trompettiste avec la particularité de faire de la musique un peu orientale et comme moi il est à fond dans le métissage. Il est capable de faire de la musique word, de sortir de gros beat Hip Hop. Je l’ai vu lors d’une création avec Oxmo Puccino où il dirigeait un orchestre symphonique. Il avait écrit toute la partition et parfois l’orchestre sonnait hip-hop ! J’ai adoré et je lui ai proposé de mettre un titre en musique. Mais petit à petit on a décidé qu’il ferait tout l’album. J’ai d’excellent retour sur la qualité musicale, on me dit que c’est l’album le plus abouti. Entre les textes et la musique il y a une vraie alchimie. Je la dois à Ibrahim, grand trompettiste de renommée mondiale !
“ Renaud, un incontournable. Il a cette poésie un peu urbaine, il est capable d’écrire une superbe chanson d’amour avec les mots « bitume », « trottoir » ou « cassoulet » ” Quelles sont tes inspirations et tes références ? Historiquement c’est vraiment un mélange entre la grande chanson française à texte qu’écoutaient mes parents type Brel, Brassens, Barbara, Jean Ferret… Ils ont nourri mon enfance. Mais il y a aussi le hip hop. Dès le début des années 90, j’ai été un grand fan de rap français. J’étais incollable sur toutes les premières années avec NTM, I AM, Little MC etc… Sinon l’une de mes grandes références c’est Renaud, un incontournable. Il a cette poésie un peu urbaine, il est capable d’écrire une superbe chanson d’amour avec les mots « bitume », « trottoir » ou « cassoulet »... On a le droit de faire de la poésie avec des mots très quotidiens, c’est un esprit que j’aime bien. On te présente comme la personne qui a démocratisé le slam ; aujourd’hui beaucoup revendiquent de faire comme toi. Penses-tu avoir des « héritiers » ? Il y en a peut-être mais ça serait très prétentieux de dire que ce sont des héritiers. Déjà, il faut rappeler que je ne suis pas pionnier du slam ; quand j’ai commencé il y avait déjà des slameurs dans pleins de petits bars. Bien sûr, mon premier projet a été très médiatisé et du coup je suis un peu le slameur le plus connu. Donc oui, il y a plein de monde qui me dit que je leur ai donné envie d’écrire, c’est un super compliment. Mais je pense que, au-delà de moi-même, cela est vraiment lié au slam. Quand tu assistes à une soirée slam, en rentrant chez toi, tu as envie de te mettre à écrire. Ca me l’a fait moi-même. Ca se propage comme une épidémie ! Je vais dans des écoles, des collèges mais aussi dans des prisons, partout ou j’ai l’occasion de le faire. Je n’apprends à écrire à personne, c’est un simple atelier avec des petits jeux, des exercices pour mettre les gens en confiance et qu’ils se lâchent. C’est avant tout une émulation pour donner envie d’écrire. C’est pour moi l’occasion de rencontrer des gens, ce sont des moments humains. Il y a toujours des contacts assez forts qui se
30 ans plus tard, les débats contre le racisme et sur la condition des quartiers sont encore d’actualité… Oui, on se rend compte que 30 ans c’est assez long et en même temps il ne s’est pas passé grand-chose. Les conditions de vie dans les quartiers populaires restent compliquées. Il y a encore des quartiers laissés à l’abandon, isolés de la dynamique comme Aulnay-sous-Bois, Clichy-sous-Bois. On est en région parisienne, mais aller à Paris est encore une galère ! Et pire malheureusement, en 2013 encore, le racisme est un mauvais vent qui souffle plus fort que jamais …
Propos recueillis par Mérième Alaoui
32
© Julien Mignot
Le sujet qui t’habite aussi beaucoup concerne les quartiers populaires… Tu as vécu une grande partie de ta vie à SaintDenis. Quel est ton sentiment vis à vis des 30 ans de la Marche pour l’égalité et contre le racisme ? Oui j’habitais Saint-Denis jusqu’à cet été, c’est très récent… Le problème c’est que je crois que malheureusement la Marche n’est pas très connue… J’en ai personnellement entendu parler par mes aînés car en 1983 j’avais 6 ans… On disait la « Marche des beurs » sans la connaître. Quand je me suis renseigné j’ai compris tout le mouvement militant derrière. J’ai aussi la chance d’être très pote avec Rachid Amghar, un militant qui était au MIB et qui a participé activement à la marche, et il m’a raconté. Mais franchement, sans tout cela, comme beaucoup dans les quartiers, ce mouvement reste assez vague pour moi…
spécial marche
Les Minguettes, 1983-2013 : mon petit pav’ aux pieds des tours
Monique vit aux Minguettes à Vénissieux depuis le début des années 1970. Témoin privilégié, elle raconte la transformation de sa cité d’adoption, son rôle de parent d’élève auprès des familles immigrées, sa participation à la Marche pour l’égalité et contre le racisme…
S
ur sa large table, Monique feuillette son album photos. Entre les clichés de ses enfants en vacances et une fête de famille, une double page tranche. Elle pointe du doigt son visage plus jeune de 30 ans, un pincement aux lèvres. Abritée sous un parapluie, elle défile avec son mari Pierre, une banderole « solidarité » à la main. Le 29 octobre 1983, ils participent à l’étape Vénissieux - Lyon de la Marche pour l’égalité et contre le racisme. «On avait accueilli les marcheurs dans l’église, raconte cette mamie énergique. Nous n’étions que deux cents dans la rue pour aller jusqu’à Place Bellecourt. C’était à cause de ce temps de chien. Il faisait gris, les jeunes étaient trempés.» Depuis la grève de la faim engagée par Toumi Djaïdja, le couple actif au Parti socialiste, apporte son soutien à la bande qui dénonce les crimes racistes. «On allait les voir plusieurs fois par semaine à Monmousseau [une des cités des Minguettes, Ndlr]. Je me souviens que ma mère, qui était assez bourgeoise, avait même signé leur pétition. C’était un changement radical pour elle qui nous interdisait de jouer avec les Arméniens de notre rue quand on était petits.»
Depuis plus de 40 ans, Monique vit aux Minguettes. Pourtant si on lui avait dit plus jeune qu’un jour elle allait habiter dans ce quartier populaire de Vénissieux, elle aurait doucement rigolé. De bonne famille, Monique est fille et petite-fille de soyeux Lyonnais. Elle grandit dans le très huppé 6e arrondissement, puis s’installe avec son mari près de la Place JeanMacé. Rapidement, l’appartement devient trop étroit pour leurs cinq, puis six enfants. Il faut trouver une solution. «Un ami nous avait parlé de la banlieue Sud-Est, où c’était moins cher et plus grand. Je me souviens m’être dit ‘’quelle horreur’’. Les Minguettes avaient déjà mauvaise réputation». Ne jamais dire jamais. Ils emménagent en 1971 dans une villa de la rue Auguste-Renoir aux pieds des tours bétonnées de la cité dortoir géante. Monique regarde sortir de terre les derniers immeubles. Elle, vit dans une charmante maison sur deux niveaux entouré d’un petit jardin arboré. Bien loin des quatorze étages des HLM sur lesquels elle a vue depuis sa fenêtre. «Une grue suffisait à faire deux tours, elles étaient si proches les unes des autres... Tout était bon pour faire des économies.» Le chantier du grand ensemble a débuté dans les années 1960 pour répondre au besoin de logements de la vague d’immigration maghrébine, et notamment des rapatriés d’Algérie.
« Il n’y avait rien »
Bientôt, la soixantaine de gratte-ciels forment un jeu d’orgues et l’essentiel de la ZUP (zone à urbaniser en priorité) est érigée : 9200 logements pour plus de 40 000 habitants, repartis dans une dizaine de quartiers. Celui de Monique est «tranquille, loin de Monmousseau et de la Pyramide, où il y avait plus de problèmes». Le plateau accueille des ménages de l’agglomération lyonnaise et des familles immigrées. «C’était très mixte», se rappelle-t-elle. Ça n’empêche qu’au début, son quartier est aussi isolé que les autres. «Il n’y avait rien, pas de médecin, pas de commerçants. Il fallait aller faire nos achats aux Clochettes à Saint-Fons, de l’autre côté de la nationale 7.» Pas facile non plus de scolariser ses enfants. L’école Saint-Exupéry et le collège Elsa-Triolet, tout près de son pavillon aujourd’hui, étaient encore en construction à l’époque.
« La tour aux mille enfants »
En servant le thé, elle se souvient des conditions de vie difficiles des adolescents dans les années 80. Les équipements collectifs
© Camille Jourdan
La banlieue Sud-Est ? Quelle horreur !
promis manquent cruellement. Le nombre de classes est insuffisant. La commune est touchée de plein fouet par la crise. La tension monte. En 1981, les premiers incidents éclatent entre jeunes et forces de l’ordre. Les Minguettes deviennent le symbole du mal de vivre des banlieues. Depuis son intérieur coquet, Monique se souvient : «Proche de la tour qu’on appelait “la tour aux mille enfants“, il y avait régulièrement des rodéos, des casses, des voitures qui brûlaient. Les gamins, jetés de l’école, s’occupaient comme ils pouvaient. Si par malheur, quelqu’un prenait le parti de la police, le lendemain, il pouvait être sûr que sa boîte aux lettres serait cramée. Les jeunes n’en pouvaient plus des contrôles au faciès musclés.» Une fois, elle avait pris la défense d’un petit qui sortait du bistrot du coin. «Les flics commençaient à le menacer avec une matraque, juste parce qu’il était basané et qu’il avait peur de montrer sa carte d’identité. Notre vice-président des parents d’élèves, lui aussi, se faisait arrêter jusqu’à trois fois par jour parce qu’il était Tunisien.»
“ Même au collège, ils mettaient tous les étrangers dans la classe pour déficients mentaux ”. Enfants mis sur la touche Enseignante en lettres à Lyon, puis nourrice aux Minguettes, Monique fait de l’école son terrain de bataille. Elle s’engage dans les associations de parents d’élèves. «Je me suis rendue compte de la différence qui était faite entre les enfants des tours et des villas. Les maîtresses ne voulaient pas les mélanger. Il y avait trois groupes. Le A pour les gamins « bien », le B pour les « moyens », et le C pour les étrangers. Pour me punir d’avoir dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas, ils avaient mis ma dernière fille dans le groupe C. Même au collège, ils mettaient tous les étrangers dans la classe pour déficients mentaux.» Sidérée, elle fait en sorte que les parents de ces enfants, pourtant nés sur le sol français, puissent assister au débat et se battre. «Ils n’osaient rien dire au début. Puis, j’ai beaucoup sympathisé avec les femmes algériennes,
33
je m’asseyais par terre avec elles. Elles se rendaient bien compte que leurs enfants étaient mis sur la touche. Alors on a décalé les réunions d’information dans l’après-midi pour qu’elles puissent venir. Le soir, elles n’avaient pas trop le droit de sortir.»
« Le repère des loubards »
Les tours se dégradent. Peu à peu, les familles de classes moyennes prennent leurs clics et leurs clacs. Les logements restent vacants. La mairie communiste ne remplace pas les foyers qui disparaissent dans l’objectif de réhabiliter le quartier. C’est à Monmousseau que les trois premières tours vides tombent. «On disait dans les journaux télévisés que c’était devenu le repère des loubards, une zone de non-droit», se rappelle Monique. Dans les années 1980, une vingtaine de barres sont démolies. «Les habitants regardaient ça comme un spectacle, il y avait une telle fumée !» S’en suit le ravalement de façade des bâtiments, la construction de salles des fêtes, des espaces verts et des jeux pour enfants. Mais le chantier est d’envergure, et tout prend du temps. «Le quartier de la Démocratie est resté en friche pendant au moins dix ans. Je crois que c’est seulement vers la fin des années 1990 que la médiathèque fut construite.» Aujourd’hui, il y a le tramway, un cinéma, un conservatoire de musique. Les constructions se font plus petites. «ça ressemble davantage à un quartier comme un autre. Les arbres ont poussé, c’est bien vert. Bon, il y a toujours des voitures qui brûlent mais je crois que la presse s’emballe parce que ça se passe aux Minguettes. Ca fait partie du mythe !» Depuis 1971, les voisins de Monique ont bien changé. Les familles immigrées qui se sont enrichies ont déménagé dans les villas aux pieds des tours. Quasiment tous les ménages lyonnais sont partis. «Ce qui a changé aussi, c’est la radicalisation de l’islam dans les quartiers, avec beaucoup de jeunes femmes qui portent le voile intégral. C’est l’infiltration du trafic de drogues aussi… Avant, les parents n’avaient même pas une voiture, ils se baladaient en vélo. Maintenant, il n’est pas rare de voir des Jaguars.» Aujourd’hui encore, Monique est déterminée à aider les jeunes en difficulté. Elle héberge deux étudiants étrangers en partenariat avec le Crous.
Camille Jourdan / CFPJ
spécial marche
Après la Marche. Une vie d’engagement, entre déceptions et utopies
« Actuellement, je suis peut-être encore dans une nouvelle forme d’utopie. » Militante qui rêvait d’égalité à l’époque de la Marche, Warda Houti se sent trahie par le mouvement antiraciste. Loin de ses espoirs initiaux, elle porte aujourd’hui un projet de développement économique au Maroc. Elle nous explique son parcours, ses espoirs déçus et son nouveau projet. « Il a toujours tout mis en œuvre pour que je réussisse », raconte cette bonne élève de l’école républicaine, passionnée de lecture. Elle n’a jamais connu le racisme étant enfant. « On vivait dans le milieu populaire, mais il n’y avait pas de stigmatisation. Nous n’étions pas membre d’une communauté contre une autre, mais simplement des individus. Mon père était connu comme monsieur Houti et il buvait le pastis avec le brigadier du village. »
D.R.
L’engagement et les luttes
Un contexte de révolution conservatrice anglo-saxonne
« On a sabré le champagne avec l’arrivée de Mitterrand. C’était l’époque des grandes promesses. » Fille de l’après 1968, alors que la France digère la gaullisme, la guerre d’Algérie, que les 30 Glorieuses se terminent avec la crise mondiale du pétrole de 1971 et l’avènement de Tatcher et Reagan, Warda voyait en Mitterrand « un grand espoir ». Le droit associatif est ouvert aux étrangers. De nationalité algérienne, elle décide de s’engager pour « peser sur la société ». Un mot d’ordre est à l’œuvre : se structurer, s’éduquer politiquement. « Je ne sais pas comment naît l’engagement. Je n’ai pas été touchée personnellement par l’injustice, explique Warda, qui admet avoir eu une enfance privilégiée. A la fac je rencontre l’action politique des militants arabes, que je ne connaissait pas : Palestiniens, Algériens, Berbères... La question des femmes, de la Palestine, de l’Amérique latine (…) On est pas très loin de la guerre d’Algérie et il y a encore des relents. Certains ont encore beaucoup d’amertume. On a aussi fait venir ces populations arabes sans planifier, sans savoir ce que l’on voulait en faire. »
Une enfance heureuse Née en Algérie en 1960 d’un père maquisard militant du FLN, Warda Houti débarque en France en 1965, dans une petite commune du Tarn. Il y a peu de maghrébins dans le coin et ses parents souffrent de l’isolement, malgré le beau soleil de la région. On est en période de plein emploi et le père de Warda profite de cette mobilité professionnelle pour bouger. Plus tard, préoccupé par la réussite des études de sa fille, son père décide de venir à Lyon, ville universitaire.
“ A l’époque il n’y avait pas autant de métissage et c’était exotique de voir un couple mixte ”.
C’est donc un choc violent qu’elle prend en pleine face lorsqu’elle découvre à Lyon l’univers militant, qu’elle se politise et perçoit une autre réalité, qu’elle ne connaissait pas. « L’immigration dans les années 60/70, c’est des hommes qu’on essaie de cadrer dans toutes sortes de structures et notamment dans des foyers de travailleurs. A l’époque il n’y avait pas autant de métissage et c’était exotique de voir un couple mixte. Et si une française sortait avec un Algérien, on la traitait de pute ! Puis il y a eu le regroupement familial, afin de « pacifier » cette immigration. Mais on a continué à penser que les immigrés allaient rentrer chez eux. On les installait dans des baraquements provisoires. » Mais voilà, cette génération métissée des années 80 est née ici et veut y vivre. Mieux, les jeunes demandent des droits.
“ Les gamins pensent qu’à l’époque nous nous sommes faits avoir ”. Un mouvement populaire vite récupéré Mais Warda ne pourra pas prendre part à la Marche : elle attend un heureux événement. « En octobre 1983, je vais accoucher dans un mois de ma fille, explique-t-elle. J’ai vécu l’arrivée de la Marche devant les infos. C’était juste démentiel ! Voir un petit gars des Minguettes dans le salon du Président... On se dit qu’un pas est franchi, même si nous ne sommes pas tous d’accord, puisqu’il ne sort pas grand chose de ce premier entretien. » Crédibilisés par la rencontre avec le Président, les collectifs commencent à augmenter leur niveau d’exigence. Le mouvement est autonome et il échappe totalement aux partis « classiques », qui se voient dépossédés d’une partie de leur l’électorat populaire, comme le raconte la militante : « On n’a pas eu le temps d’aller bien loin : un an après la Marche, une énorme machine est créé afin de casser le mouvement et de le récupérer : SOS racisme. On l’a pris comme un sabotage de notre mouvement. Ça s’est structuré dans l’ombre et ils ont débarqué avec leur grande main jaune « Touche pas à mon pote » du jour au lendemain, avec des moyens médiatiques sans commune mesure avec que nous pouvions mobiliser. On s’est sentis trahis et manipulés par le pouvoir politique de l’époque. Ils sont restés sourds à notre souhait de participer, tout en utilisant l’énergie et le mouvement que nous avions créé en le détournant à leurs fins, pour drainer une partie de la jeunesse vers des appareils satellites du Parti Socialiste. Harlem Désir est un pur produit du PS. Il l’a d’ailleurs bien confirmé aujourd’hui. On n’a pas été entendus, alors qu’on représentait une vraie force non violente, laïque et républicaine, qui voulait agir dans le cadre de la république. On a laissé passer une vraie chance. »
34
Le départ, après la frustration Le mouvement, alors, se disperse. Dans le même temps, le FN fait un score historique aux européennes de 1984. C’en est trop pour Warda, qui ne peut accepter de voir son pays et son combat dans cet état : « Je suis frustrée par tant d’années d’action pour rien et cette France me fait peur. Mon mari est marocain. Je prends donc mon gamin et je quitte la France pour Casablanca, pour quelques années. » Dans ce pays qu’elle ne connaît pas, Warda entame un parcours militant tourné vers les femmes et la dénonciation de leurs conditions de vie. Elle raconte : « Je m’essaie à la construction d’un journal féministe, avec quelques marocaines qui viennent aussi de l’étranger. Mais je n’arrive pas à rester dans ce pays où à chaque fois que j’ouvre la bouche les gens ont peur, où je n’arrive pas à me créer un réseau où je peux agir. Le journal est très vite censuré et je ne peux pas à faire mon métier. » Après cette parenthèse, elle décide donc de rentrer en France.
Sa nouvelle utopie Si elle travaille actuellement chez Emmaus Solidarité, Warda Houti développe à côté une coopérative au Maroc, « pour éviter le départ des jeunes ». Pour elle, qui se battait pour les droits et l’égalité des personnes issues de l’immigration en France, il s’agit là d’un véritable revirement et d’un constat d’échec de la société française. Elle explique son projet : « Actuellement, je suis peut-être encore dans une nouvelle forme d’utopie. Je m’attelle à la création d’une coopérative d’activités dans une magnifique vallée. Nous voulons créer des rencontres et des projets. C’est dans un petit village marocain à 1800 mètres d’altitude. Le revenu moyen par personne est de 30€. Le but est de donner les moyens de rester sur place, dans un village où la population a massivement émigré. Nous essayons de créer de l’emploi pour les jeunes, principalement. C’est un lieu d’accueil d’artistes en résidence et une maison d’hôtes. Nous sommes actuellement en recherche de fonds. » Loin de penser que la mondialisation est un progrès pour tous, elle la voit plutôt sous le prisme des classes sociales « L’immigré n’est pas un voyageur, c’est quelqu’un qui quitte sa terre avec sa famille pour louer sa force de travail, au péril de sa vie. Il faut voir ce qui se passe à Lampedusa », ajoute-t-elle, plaçant l’île italienne en symbole des atrocités de l’immigration forcée. Mais n’a-t-elle plus d’espoir pour la France ? « On considère les populations issues de l’immigration comme des populations à risque, explique-t-elle. On a laissé le champ aux intégristes de tout poil et je crains la fracture sociale. On est loin des espoirs de 1983. On a une approche communautaire des populations issues de l’immigration, avec en face un repli identitaire dans les quartiers, autour de l’islam. Quand on méprise les gens, qu’on ne les entend pas, qu’on a traité leurs pères comme une marchandise, qu’on les empêche de travailler et d’habiter où ils veulent, on ne peut pas s’étonner si certains adoptent des comportements radicaux. » Désabusée, elle estime cependant avoir rempli son rôle, à l’époque de la Marche : « Aujourd’hui, les institutions ne peuvent plus abuser les gamins. Rien n’a changé et ils pensent qu’à l’époque nous nous sommes faits avoir. Mais nous ne sommes pas responsables de ça. Nous avons sonné l’alerte. » Un signal qui a malheureusement résonné dans le vide.
Sylvain Ortega / Lyon Bondy Blog
spécial marche
Malek Boutih
Député : “ l’aboutissement d’un combat ” Député de l’Essonne depuis 2012 après avoir débouté de ce siège son ancien mentor fondateur de SOS Racisme, Julien Dray, le parcours de Malek Boutih, militant de l’antiracisme depuis les années 80, est édifiant à plus d’un titre ; il incarne pour ainsi dire celui d’une génération de Français, passés des « périphéries » de la société (ici : les bidonvilles de Nanterre où il a grandi), au centre (ici : un bureau au Palais-Bourbon). Son regard sur trente ans d’engagements à gauche brosse un portrait pour le moins contrasté de l’évolution de la société française et de ses quartiers. Propos recueillis par Erwan Ruty P&C : On ne vous entend plus beaucoup évoquer les questions liées à votre militantisme à SOS Racisme. Votre parcours personnel, après bien des difficultés, signifie-t-elle qu’il faille abandonner certains combats pour réussir ? MB : Quand j’ai été élu député, j’ai considéré que c’était le fin de histoire d’une génération : celui du combat d’une génération qui émerge dans le paysage alors qu’elle est vue et qu’elle se voit comme étrangère. On se demandait alors si on était Français ou encore étrangers. C’est l’aboutissement de ces combats qui réclamaient seulement le droit de vivre et d’être reconnu comme Français. Devenant député, une boucle est bouclée. Sur le champ de bataille des droits fondamentaux, les choses ont changé. Une présentatrice de télé noire ou rebeu, c’est devenu classique. Aux prochaines élections municipales, des têtes de listes de la diversité vont être élues. Ce combat a progressé, mais pourtant dans la même période, la marginalisation sociale de la jeunesse s’est accélérée. Et cela parce que la jonction entre les forces sociales traditionnelles et les banlieues ne s’est pas faite. Et c’est à cause des syndicats, des partis, conservateurs, qui considèrent encore les banlieues comme une marge, et non un moteur pour combattre le libéralisme. Tout ce dont on avait besoin pour s’en sortir a régressé. Les droits sociaux régressent, et les politiques d’enfermement progressent. La politique de la ville est devenue une politique de réserves. Vivre dans une cité est aujourd’hui plus dur qu’en 1983 : il y a eu une destruction des solidarités populaires du milieu associatif. Ceux qui font du business et les démerdeurs s’en tirent, pour les autres, c’est « chacun pour soi et Dieu pour tous ». Le bilan de ces trente ans est très paradoxal : le racisme primaire n’est pas plus fort qu’en 1983, mais la peur des ghettos est considérable. On est passé de la peur de la djellaba à celle de la casquette. L’actualité de la Bretagne le révèle : le pouvoir réagit avec beaucoup de patience. Si cinq gosses avaient fait pareil dans les banlieues, ils seraient à Fleury-Mérogis. Le rapport exotique aux banlieues domine encore à gauche, et c’est sur le terrain de la culture que l’offensive se fait. Mais cette contradiction républicaine, ce déséquilibre va être posé brutalement d’une manière ou d’une autre, peut-être par le FN.
est supérieur à celui des agriculteurs. Et maintenant, c’est nous qui allons devant les tribunaux pour être les accusateurs, plus les accusés. Quoi qu’on en dise, 2005 étaient des « émeutes républicaines », avec des gens qui s’exprimaient avec ce pays comme référence. Mais c’est vrai que SOS n’a pas eu assez de poids pour que les institutions politiques suivent ses revendications. Et face aux forces de destruction du libéralisme, ces acquis ne vont plus durer très longtemps. La preuve : aujourd’hui, au bout de 18 mois de pouvoir, le bilan, c’est « zéro + zéro = la tête à toto ». On n’a pas su saisir les
opportunités offertes par les banlieues. On se rend seulement compte qu’on a des gens en face de nous, les religieux, avec qui on ne peut plus discuter. La nouvelle génération, les nouveaux cadres issus des quartiers sont trop jeunes. Quand une organisation agricole demande à des agriculteurs de casser la porte du Préfet, ils viennent. Par contre, si moi je fais pareil, il n’y a personne derrière moi. Les meilleurs éléments de notre génération n’ont pas fait de politique, parce que la politique ne leur a pas fait de place. Les enfants d’ouvriers veulent l’émancipation sociale avant l’émancipation politique. Ce n’est que quand celle-ci arrivera que l’accord entre les corps intermédiaires et les masses pourra se faire. Le désir d’émeutes de 2005 vient de loin. Il fallait que cette génération vive ça : la violence mène à l’impasse, elle est destructrice. Le prolétariat s’est émancipé par les luttes, mais aussi par l’école, et l’alliance avec les classes moyennes. P&C : Mais beaucoup de questions soulevées par cette génération restent sans réponse MB : La génération de la Marche était française sans l’être. Leur message était ambigu. Ce discours, Convergence 84 n’arrive pas à le dire. La gauche et l’extrême-gauche avaient besoin de mythes de rechange, mais ils n’ont pas su former des cadres politiques. Ces organisations, comme la Cimade, les œuvres laïques, ont par ailleurs été ratiboisées par les politiques publiques. Elles ont été emportées par une grande vague de destruction des corps intermédiaires par la gauche. Ok, la nouvelle génération ne connaît pas cette Marche ; un jour, elle sera pourtant dans les livres d’histoire, quand la société française l’aura digérée. L’avantage, d’une certaine manière, c’est aussi que cette jeune génération n’est pas lestée par ce passé, comme l’ancienne l’a été par la guerre d’Algérie par exemple.
D.R.
P&C : Trente ans après la Marche, Harlem Désir est premier secrétaire du PS, mais quel est le bilan de SOS Racisme, qui a été créé dans la foulée de la Marche ? MB : On s’est battus pour être des gens comme les autres. Harlem est un personnage institutionnel classique, son passé a peu d’influence sur ce qu’il est. Nul n’est définitivement lié à son origine. Et on ne doit pas avoir de culpabilité par rapport à ça. Oui, je ne suis pas une assistante sociale à vie. Il faut accepter que l’émergence n’est pas une trahison.
L’idée est de dire aux gens : « ne vous laissez pas avoir par le modèle du ghetto. On peut s’en sortir en devenant fonctionnaire, homme politique… » Le bilan de SOS, c’est notamment la pratique des testings, qui a été validée par la Cour de cassation. Je crois que sans SOS, compte tenu de la violence infligée aux banlieues alors, on aurait une société en rupture, encore plus divisée, avec des violences sociales, religieuses très graves. On a imposé un rapport de force idéologique, un contexte culturel. La nouvelle génération a des relais dans le monde économique, culturel, et politique. Le poids électoral des banlieues
Maintenant, c’est nous qui allons devant les tribunaux pour être les accusateurs, plus les accusés.
35
P&C : Peut-être n’est-elle pas assez liée à ce passé, justement. Aujourd’hui, certains jeunes nés en France se revendiquent facilement « Algériens », « Tunisiens » etc, alors que la génération de la Marche voulait absolument se revendiquer comme française. MB : Les identités mythiques sont toujours plus faciles à porter que les identités réelles. Comme pour la communauté juive qui avait fui les pogroms d’Europe de l’Est, et du coup cherchait à tout prix la ressemblance avec les française, la génération suivante cherche à tout prix la différence. Paradoxalement, la réislamisation de cette génération ne veut pas du tout être réduite à de l’islamisme. C’est plutôt l’inverse d’un processus de désintégration. Comme quand certains français ont revendiqué leur régionalisme, leur identité bretonne ou basque… c’était en même temps que la République avançait dans ces régions.
spécial marche
Pascal Blanchard :
La Marche, un « mai 68 des enfants de l’immigration »... non partagé Pascal Blanchard, historien du fait colonial, responsable de l’Achac et de la commission Mémoire des quartiers, replace la Marche dans la longue histoire de l’immigration en France.
P&C : La Marche de 1983 est-elle un mouvement inédit dans l’histoire de l’immigration maghrébine en France ? PB : Non, elle ne sort pas de rien, elle a des parents et des grands parents. Dès le 14 juillet 1953, il y a la première manifestation d’Algériens à Paris, pour l’autonomie de l’Algérie. Pour la première fois depuis la guerre, la police tire à balles réelles sur une manifestation. En 1963, des luttes sont menées pour obtenir le droit de venir travailler en France, pour les algériens et les tunisiens. D’autres combats ont lieu pour la santé, la carte de séjour, mais ils sont noyés dans d’autres luttes. En 1973 ont lieu de grands massacres de maghrébins dans le sud de la France, de véritables arabicides. A La Ciotat, des travailleurs, d’abord maghrébins, se mettent en grève contre le journal La Provence et son traitement de ces massacres. Mais la Marche de 1983 est une révolte générationnelle, novatrice, médiatique, avec des modes d’expression dédiés à tous les Français, et pas seulement aux maghrébins.
© Yves Monteil
P&C : La Marche n’est-elle pas due au paradoxe existant entre une intégration culturelle forte de cette génération, et son manque d’intégration sociale (le chômage), contrairement aux parents, qui étaient socialement intégrés puisque travailleurs immigrés, mais qui, culturellement, restaient des étrangers ? PB : L’intégration sociale des parents était relative. Dans certains espaces, il y a bien une solidarité ouvrière, mais c’est rare. Dans les manifestations de mai 68, les immigrés, « travailleurs d’Afrique et d’Asie », sont à la fin des cortèges. P&C : N’y a-t-il pas un contexte culturel favorable à l’émergence de cette génération ? PB : Il y a bien émergence d’un espace artistique et littéraire qui émane du peuple ; il y a aussi un certain succès des élites sportives comme le révèle le cas de Yannick Noah. Mais le courant hip-hop arrive dix ans plus tard. Coluche, Tchao Pantin ne sont pas liés à cette histoire. C’est un rythme différent, et c’est pour ça qu’il y a un échec au lendemain de la Marche. Les élites et les nouvelles cultures populaires n’ont pas été en lien avec les marcheurs. Cette Marche est un « mai 68 des enfants de l’immigration », mais un mai 68 non partagé. En 1983, la gauche en est encore à se demander comment régler le problème de l’Oas... Et mettre fin au Bumidom [organisme qui gérait la venue et l’accueil des antillais en métropole, NDLR]. Si aujourd’hui 20% des Français ont entendu parler de la Marche, il faut voir qu’il y a quelques années, c’était encore moins !
P&C : Quel a été l’accueil de cette Marche par la majorité des Français ? PB : Si la Marche est concomitante de l’émergence du FN, c’est justement que les jeunes Arabes et Noirs deviennent visibles. Dans le reste de la société française, l’accueil est relativement positif : les institutions ne sont pas capables d’entendre ce que cette Marche dit. Les marcheurs n’arrivent pas à traduire de manière dialectique, entendable par des leaders politiques d’alors, sous forme de projets moulinés pour la politique, leurs revendications. C’est l’époque où les communistes envoient des bulldozers contre un foyer de travailleurs Sonacotra à Vitry ! Par ailleurs, le président, Mitterrand, était le dernier grand ministre des colonies de la Ivème République ! Tout cela est géré comme un problème colonial, pas comme une demande d’égalité. Mais il est vrai que cette Marche accompagne un réel tournant de la société française : on passe vraiment du colonial, au post-colonial. P&C : Quelles ont été les conséquences de la Marche sur la gauche ? PB : Il y a une question que la gauche n’a pas anticipé, c’est l’émergence des immigrés sur la scène politique (grèves des foyers, marche pour l’Egalité...), par le fait de ses propres enfants. Elle ne peut leur taper dessus, ce sont des classes populaires ! Mais elle ne peut s’allier à elles, au moment où le FN émerge dans ces mêmes classes. La réponse à ce dilemme, c’est la création de SOS Racisme pour canaliser les revendications de ces populations. Mais c’est un mouvement jeune, populaire, et le gouvernement ne va pas savoir quoi en faire. L’autre réponse, c’est la reprise en main par les syndicats des travailleurs immigrés. Il va aussi lui falloir instrumentaliser le FN pour qu’il monte, face à la droite. D’un autre côté, il y a aussi un tournant médiatique : on voit des Arabes à la télé... on ne pourra plus les tuer comme avant !
Propos recueillis par Erwan Ruty
36
Planche de l’exposition « L’histoire des présences arabo-orientales en France » - © ACHAC
C’est pour ça qu’il y a un échec au lendemain de la Marche : les élites et les nouvelles cultures populaires n’ont pas été en lien avec les marcheurs.
spécial marche
Pour la mémoire
de mon frère
Hassan Ben Mohamed s’est replongé dans les archives douloureuses de l’assassinat de son frère en 1980 par un policier raciste. Un livre est en cours d’écriture. L’ironie de l’histoire est que le petit frère est lui-même devenu policier…
«Ce soir, j’ai la gâchette facile». C’est après ces mots qu’un CRS, pointant sa mitraillette sous le nez des passagers d’une voiture, abat froidement Lahouari Ben Mohamed, lors d’un banal contrôle de police à Marseille, contrôle qui s’était déroulé jusque-là sans problème. Cette soirée du 18 octobre 1980, un jeune homme de 17 ans tombe sous le feu d’un policier raciste et avec lui, toute une famille et des amis en sont restés traumatisés. Le policier mis en cause ne sera pas puni. Hassan n’avait que 4 ans quand ce drame a touché sa famille, pourtant en 2010 il a l’idée de tout raconter.
jeunes de leur génération. Mais Hassan porte un regard particulier sur Toumi Djaidja, l’initiateur de la Marche, qu’il a pu rencontrer récemment. « J’apprécie beaucoup la personne de Toumi. En fait je le vois comme un frère, dans la mesure où lui aussi a vécu une injustice policière, et qu’il a survécu. Je ne peux pas m’empêcher de me dire que si mon frère aussi avait été un rescapé, il aurait pu être un Toumi Djaidja » avoue Hassan.
“Symboliquement, il pouvait prendre la place d’un policier raciste et c’est une bonne chose ” !
Traumatisme occulté
« J’ai réalisé que ma mère avait répondu favorablement à la demande d’interview d’un journaliste et qu’elle expliquait tout de façon paisible…Je me suis dit que c’était le meilleur moment pour raconter cette histoire que finalement je ne connaissais pas » raconte Hassan. Avec son cousin du même âge Majid El Jarroudi, ils se lancent dans les recherches. « Hassan a toujours été à Marseille et moi à Paris, on s’est perdus de vue alors qu’on a exactement le même âge. Je me suis rendu compte que ce traumatisme vécu à 4 ans, je l’avais presque occulté inconsciemment. Parce que j’ai toujours été marqué par la mort de Malik Oussekine [tué par les policiers lors des manifestations anti-Devaquet en 1986, Ndlr] et pourtant mon propre cousin avait lui aussi subi l’atroce violence raciste d’un policier… » précise Majid.
Affiche du fond privé de Mehdi Lallaoui
Marseille, traumatisée par la mort de Lahouari
Plus qu’une enquête de la famille, une thérapie Puis commence la plus douloureuse étape, les recherches d’archives qui ont duré trois ans… « C’est douloureux de revoir sa mère crier de douleur dans des archives vidéos. J’ai même pu voir les photos de l’autopsie… Je voulais vraiment aller dans les détails une fois pour toute. Certaines images resteront à jamais marquées dans ma mémoire, mais il fallait passer par là ». L’autre volet tout aussi sensible est le recueil des témoignages. La famille Ben Mohamed a toujours gardé un lourd silence sur ce drame. « Ma mère, mes frères ont joué le jeu et m’ont tout raconté… J’ai même pu avoir facilement le témoignage des amis de Lahouari présents avec lui ce soir-là. Ils n’avaient jamais parlé avant. C’est comme s’il me devait, à moi, petit frère, un peu la vérité. Donc c’est bien à moi et à personne d’autre que tout le monde pouvait parler ». Le cœur serré, Hassan poursuit tant bien que mal les entrevues. « Evidemment c’est lui qui a fait le plus dur : recueillir les paroles. A chaque fois ca se terminait en larmes… » précise Majid. Cette enquête, qui a l’aspect d’une thérapie n’est motivée ni par la haine ni par la soif de vengeance. La démarche du petit frère est au contraire une main tendue, pour apaiser et créer le dialogue qui manque encore aujourd’hui.
“ Ce traumatisme vécu à 4 ans, je l’avais presque occulté inconsciemment. Parce que j’ai toujours été marqué par la mort de Malik Oussekine ”. parlé à ma mère…». La réponse de la maman est sans appel : jamais Hassan n’entrera dans la police ! Mais le temps a passé, d’arguments en arguments, de réflexion en réflexions, la famille Ben Mohamed accepte finalement le choix du petit dernier. Il devient policier à Marseille en 1999.
« Comme si la police me devait quelque chose » Car le grand intérêt du futur livre à paraître sur cette histoire, c’est que Hassan, dont la famille a été détruite par un CRS, est devenu est devenu… policier. Un peu par hasard et par une certaine curiosité du métier... « J’étais chauffeur routier et mon père n’aimait pas ce travail qui me contraignait à avoir des horaires pas possibles… Il voulait que je fasse l’armée ! Après son décès, j’ai décidé de le faire » raconte Hassan. A son retour, une amie qui ne connaît pas son histoire familiale, lui propose d’intégrer la police qui recherche alors de nouvelles recrues. « Au départ c’était hors de question ! Puis avec le temps j’ai bien réfléchi. C’est étrange, dans mon esprit c’est comme si la police me devait quelque chose… Et j’en ai
« Prendre la place d’un policier raciste » « Il veut montrer que si son frère a été victime d’une injustice, tous les policiers ne sont pas racistes. Et puis symboliquement, il pouvait prendre la place d’un policier raciste et c’est une bonne chose ! » précise Majid. De façon générale, Hassan et Madjid ont découvert la Marche pour l’égalité une fois adultes, comme la majorité des
37
Car si Lahouari Ben Mohamed est mort en 1980, cela marque un tournant dans le tissu associatif antiraciste marseillais. Une sorte de signe annonciateur qui a préparé la Marche, dont le point de départ est Marseille. « Le drame de mon cousin a traumatisé toute la ville et personne n’a jamais oublié Lahouari. Des associations se sont créées, des maisons de quartiers, et la première manifestation des mamans pour la non-violence a eu lieu à cette occasion… Le travail de terrain antiraciste avait été d’une certaine manière fait pour que la Marche parte dans de bonnes conditions » analyse Majid. Se rassembler, créer le lien et comprendre son histoire, même en étant victime de violence raciste, c’est la ligne de conduite des deux cousins. C’est dans cet esprit qu’Hassan a voulu reprendre la pièce de théâtre de l’ami d’enfance de son frère, Moussa Masskri, devenu acteur professionnel. « A l’époque, les amis de mon frère ont lancé une pièce de théâtre appelé Ya Ouldi (Oh mon fils NDLR), en mémoire pour mon frère. Je leur ai demandé de la reproduire aujourd’hui, plus de 30 ans plus tard. Ils ont accepté ! » Pièce de théâtre, livre en cours… Hassan et Madjid en sont d’autant plus persuadés : connaître son histoire et l’histoire de l’immigration, aussi douloureuse soit-elle, est primordial. « Je trouve que les jeunes issus de l’immigration ne connaissent pas forcément leur histoire… l’histoire de leur parents c’est tellement important !» déplore le cousin. Et ce n’est pas un hasard si Hassan a pris un congé spécial pour voyager en Afrique, faire des recherches sur le chemin des esclaves…
Mérième Alaoui
Voir la vidéo de Stop le contôle au faciès : http://tinyurl.com/qd3jy4z
spécial marche
De père Gérard à frère Yacine, 30 ans d’engagement religieux en banlieue
En 1983, un prêtre et un pasteur proposent à des jeunes du quartier des Minguettes une marche, inspirée de celles de Martin Luther King et de Gandhi. A l’initiative et en amont de la marche, toute une tradition religieuse d’engagement dans les quartiers. A la Courneuve, l’époque des curés est révolue, mais d’autres ont pris le relais.
tés de nombreux migrants : Camerounais, Tamouls, Béninois, Antillais… Plus intercultuelle aussi : « Les musulmans sont plus nombreux, plus visibles », observe le père Gérard. A l’époque, dans les années 1980, « un travailleur musulman, c’était avant tout un travailleur » assure le curé, persuadé que c’est avec eux qu’il faut aujourd’hui mener un combat contre la précarité. Mener ce même combat qui fut le sien, lorsque ses interlocuteurs et alliés potentiels étaient davantage des cadres du Parti Communiste que des Imams. « Il y a trente ans on entrait à la Courneuve par le social », se souvient-il, « aujourd’hui, on y entre par la religion ».
a petite église Saint-Lucien est toujours là. Postée au bord du carrefour des six routes, entourée des barres d’immeubles de La Courneuve. Le père Gérard Marle a retrouvé son HLM, dans le quartier Verlaine, là où il habitait déjà trente ans plus tôt avec trois prêtres ouvriers. Il a aussi retrouvé les bidonvilles. « On s’était pourtant battu pour qu’ils disparaissent ». Ils sont aujourd’hui habités par des Roms. D’une manière générale, le quartier est « plus marqué qu’avant par la précarité. » La Courneuve, c’est 23,9 % de chômeurs (INSEE), plus de deux fois la moyenne nationale. Peu de travail donc, mais surtout pas grand chose pour lutter contre le chômage. « Sans emploi, les gens se sentent en trop. A l’époque, la classe ouvrière était exploitée, mais au moins il y avait un collectif et on savait contre qui il fallait se battre. » Le père Gérard raconte. Le parlé franc, le ton et le visage grave, au début. Ils s’allègent à mesure qu’il explique tous les « trucs » qu’il utilisait alors, avec d’autres, pour dénoncer et s’attaquer aux « injustices ».
“ Il y a trente ans on entrait à la Courneuve par le social... aujourd’hui, on y entre par la religion ”. « Tout a changé »
Que reste-t-il aujourd’hui de cette ville « métallo » et « communiste » ? « Rien, tout a changé ». 18 000 logements en moins dans la Cité des 4000, l’essentiel des usines disparues. La solidarité ouvrière s’est pour le moins étiolée. Le père Marle a redécouvert une Courneuve plus interculturelle. A la messe, il n’a retrouvé que « sept ou huit inoxydables », auxquels se sont ajou-
Aux « 4 000 nord », quartier Verlaine - où se dressent les quelques tours encore debout - les jeunes de quartier ont remplacé les curés. « Faîtes comme chez vous, si vous avez faim vous me le dîtes. On peut se tutoyer aussi ». Yacine Medjahed, la vingtaine passée, collier de barbe, accueille dans un petit local « prêté par la mairie ». Sur de large panneaux de bois bleus, l’acronyme de l’association, JMF, Jeunes Musulmans de France. Elle a été créée par des membres de l’UOIF, l’Union des organisations islamiques de France, une association proche des Frères musulmans. « Tu veux dire qu’on est des islamistes c’est ça ? » rétorque Yacine, et d’assurer : la JMF, « c’est une association laïque, loi 1901, il n’y a rien de cultuel ». Contrairement à d’autres associations musulmanes du quartier, la JMF ne dispense, par exemple, aucun cours d’arabe mais du français et des maths. « Si t’as pas ça, t’as rien ». Sur un mur du petit local, ce slogan : « Celui qui ne veut rien faire cherche des excuses, celui qui veut avancer, trouve des moyens. »
« Le PC nous aidait un peu »
Dans les années 1980, temps des grandes luttes sociales, les moyens mis en œuvre pour « avancer », c’était la Marche pour l’égalité et contre racisme mais surtout les manifestations ouvrières. Les tracts, rédigés et distribués avec les collègues, ou encore les grèves des loyers, pour réclamer aux bailleurs des conditions de vie acceptables dans les tours, construites dans les années 1950. « On s’est plutôt bien battu, le Parti communiste nous aidait un peu » rappelle le curé rouge, qui vécut sa prêtrise en première ligne et consacra son mémoire de licence de théologie à Karl Marx. La lutte pour la justice sociale pour tout sacerdoce, un engagement de terrain avec la JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne) et la CNL (Conférence nationale du logement). Une mission « évangélique » assure-t-il, mais « pas toujours en odeur de sainteté » dans une Église catholique qui avait tenté d’interdire les prêtres ouvriers dans les années 1950. Mais la lutte ouvrière fait désormais partie de l’histoire. Une histoire que Yacine est trop jeune pour connaître : « 1983 ? Ça remonte ! Je n’étais pas encore né ».
Entraide, fraternité et excellence
Yacine symbolise la nouvelle garde. Alors que la JOC se meurt, la JMF revendique 200 adhérents, dont 60 forment le « noyau dur ». Lui est musulman et voit, dans son action, un « engagement spirituel ». Au service des valeurs de l’Islam ? « Au service de valeurs universelles : l’entraide, la fraternité et l’excellence aussi ». L’entraide c’est par exemple Solidar’Cité, un projet solidaire que
38
© William Bree
L
© William Bree
« Rien de cultuel »
Sur un mur du petit local, ce slogan : “ Celui qui ne veut rien faire cherche des excuses, celui qui veut avancer, trouve des moyens ”. la JMF mène avec le Secours Populaire. Pour une soirée, l’association transforme une salle municipale en un « restaurant chic » et y invite les plus démunis. « Le but ? Décloisonner les gens. Ils ne viennent pas pour manger, mais pour l’ambiance. Ca permet à certains de sortir de l’exclusion ». La Fraternité, c’est l’ouverture à tous : « Il y a des non musulmans qui participent aux activités » assure Yacine. Il réfléchit un instant : « Franchement ? On s’en fiche qu’ils soient ou non musulmans. » Quant à l’excellence, c’est peut-être le plus important. Lorsque Yacine parle d’emploi, il ne parle pas de restauration, de livraison ou de télétravail. Aide aux devoirs, accompagnement scolaire, débats sur l’alternance, tout est fait pour tirer vers le haut. Au Forum de l’emploi, organisé une fois par an : « On met toujours à l’honneur une profession ». Des exemples ? Neurologue, journaliste… « Parfois je me dis : “Yacine, tu fais des actions dont toi-même tu n’as jamais bénéficié» ». Mais lorsqu’il raisonne au présent, Yacine se dit fasciné par le travail des éducateurs spécialisés, dans l’association Feu vert, à côté du local. « Je suis pantois devant leur travail ». Il se voit bien reprendre ses études, « en sciences de l’éducation ». Pour faire quoi ? « Je ne sais pas encore, prof’, ou conseiller chez Pôle emploi ». Une ambition qui au cœur de cette emblématique cité des 4 000, pas toujours célèbre pour les bonnes raisons, vaut bien un sacerdoce.
William Bree et Mikael Corre / CFPJ Lire l’entretien avec Christian Delorme : www.presseetcite.info/f003
spécial marche
Marche des quartiers Nord de Marseille pour l’Egalité Depuis deux ans à Marseille, les règlements de compte liés principalement au trafic de drogue font de nombreuses victimes dans les quartiers nord. La semaine dernière (1er juin), une marche contre la violence était organisée par le Collectif du 1er Juin. Témoignage de Marilaure Mahé, ancienne marcheuse de 1983 et nouvelle marcheuse de 2013. Propos recueillis par Charly Célinain « Nous comptons déjà 26 morts dans des règlements de compte liés au trafic de drogue ! » s’indigne Marilaure Mahé, habitante des quartiers Nord. Cette dernière s’implique au sein du collectif du 1er juin qui a organisé une marche dans le centre ville de Marseille pour dire stop à toutes les violences. Pour Marilaure Mahé, ce n’est pas une première puisque cette militante avait déjà fait la Marche pour l’Egalité (1983). Trente ans après, la revoilà en train de marcher mais pour une cause pas si éloignée de celle de 1983.
pour suivre l’avancée du dossier » prévient Marilaure Mahé. Cependant cette dernière sait bien qu’elles ne seront pas toutes prises en compte : « Il y a tellement de propositions... Mais une d’entre elles a été anticipée par la mairie : l’interdiction de vente des boissons alcoolisées dans les épiceries de nuit. Il faut aussi remettre des bus gratuits vers les plages, ouvrir les stades et les piscines pendant l’été. C’est le minimum ! ».
La drogue sème la mort
Pas qu’un problème de police
« Sur 26 morts, des gens sont impliqués dans le banditisme bien sûr, mais parmi les victimes il y a aussi de très jeunes personnes qui se font recruter pour cinquante euros » explique Marilaure Mahé. Une situation qui devient proprement intolérable pour les habitants des Quartiers Nord : « Toutes les semaines, il y a une agression à la kalachnikov. Quand on ne voit pas son enfant rentrer le soir, on ne peut s’empêcher de se demander s’il ne lui est rien arrivé ». Un climat pesant qui a poussé les habitants à agir. Agir pour dénoncer les violences, mais aussi pour en souligner l’origine l’abandon de nos quartiers par les pouvoirs publics.
Les 23 propositions du collectif du 1er juin ne concernent pas uniquement la sécurité et la police, souvent décriée ces derniers temps : « Ce n’est pas qu’un problème de police, ce n’est pas si simple. Nous insistons beaucoup sur les causes sociales, le chômage, l’accès à la formation. Dans les quartiers à Marseille, les infrastructures de loisirs (stades, piscines) sont fermées l’été, un bus pour aller à la plage a été supprimé. Forcément les jeunes n’ont rien à faire, ils font des conneries. Nous n’avons pas envie de mettre en avant les problèmes de sécurité parce qu’ils sont complexes et demandent une expertise que les habitants n’ont pas à eux seuls. Mais nous voulons être force de proposition sur tout ce qui est emploi, urbanisme, question scolaire et pour pallier aux défaillances des services publics... ».
Mobilisation des habitants
Pendant deux mois, tous les mardis à midi une trentaine d’habitants se rencontraient au centre social Malpassé pour mettre en place cette Marche du 1er juin. « Dans ces réunions, les habitants étaient plus nombreux mais il y avait également des salariés des centres sociaux, ou autres travailleurs sociaux... » précise Marilaure Mahé. « Nous ne voulions pas faire une marche blanche de plus mais une marche revendicative dans le centre ville. Nous ne sommes pas Marseille bis ! Nous sommes la moitié de la ville ! » dit la militante à propos des quartiers nord.
Problématique scolaire
« Nous sommes dans des quartiers où le décrochage scolaire est un gros problème. Dans les quartiers de Marseille, il existe de plus en plus de ségrégation spatiale en faveur de collèges de meilleure renommée ou privés » constate amèrement Marilaure Mahé. Un problème qui ne concerne pas que les élèves : « Dans les collèges difficiles, certains jeunes s’en sortent, qui sont solides psychologiquement mais ils subissent la discrimination à l’emploi même avec des diplômes. Le problème c’est que la détresse gagne également le corps enseignant. Les profs ne restent pas dans ces collèges ». Un problème de taille et un réel enjeu pour la jeunesse des quartiers nord de Marseille.
Marcheurs de tout Marseille
Même si la presse locale a tenté de réduire cette marche du 1er juin à une manifestation de mamans en colère, ce rassemblement était beaucoup plus large : C’était le rassemblement des quartiers populaires. « Principalement les grands ensembles mais aussi les noyaux villageois, on a noté aussi l’implication de certains comités d’intérêt de quartiers qui d’habitude s’intéressent surtout aux zones pavillonnaires » témoigne Marilaure Mahé.
Incompréhension
Après la marche du 1er juin, Marilaure Mahé s’indignait des commentaires d’articles qui relataient l’événement : « On pouvait lire des commentaires sur les gens des quartiers comme « Avec tout ce qu’on fait pour vous, vous en réclamez encore ?! ». Ils ne comprennent pas la problématique des quartiers populaires ». Ils ne savent pas ou ne veulent pas voir que les équipements publics sont inégalement répartis sur le territoire au détriment des ZUS
Récupération politique ?
Pour le collectif du 1er juin, il était important d’éviter toute sorte de récupération politique. C’est pourquoi les habitants des quartiers nord étaient en tête de cortège tandis que les élus étaient derrière : « Il fallait savoir comment on gérait la présence des élus. Nous avons exigé d’eux qu’ils ne portent pas d’écharpe, qu’ils n’aient aucun signe de distinction de parti. Ce qui n’empêche pas les médias de les reconnaître...et de leur tendre un micro » glisse la militante. Cette dernière précise également qu’ « une délégation de huit personnes (représentatives en âge, lieu de résidence... a déposé les propositions en préfecture ».
1983-2013
« En 1983, nous marchions pour dire : nous faisons partie de la jeunesse de France. Samedi 1er juin, nous avons marché pour dire : nous sommes marseillais à part entière, nous voulons les mêmes droits. Nous exigeons l’égalité des traitements sur ces territoires. Et on ne veut plus amener nos enfants au cimetière ! » confie l’ex-marcheuse de 1983. Cette dernière reconnaît que la composition du groupe de marcheurs est différente : « La moyenne d’âge n’est pas la même. A l’époque nous étions plus jeunes, aujourd’hui la moyenne est plutôt vers 40 ans. Mais nous ne sommes plus naïfs, nous connaissons les rouages, on lâchera rien ! ». Les institutions marseillaises sont prévenues.
23 propositions L’objectif était donc bien de se faire entendre au cœur de la cité phocéenne et surtout avant l’été : « Nous voulions absolument poser nos 23 propositions en préfecture. Maintenant nous avons tout le mois de juin
39
spécial marche
Deux semaines de marathon
pour l’anniversaire d’une Marche Il semble que la sortie du film de Nabil Ben Yadir, La Marche, ait donné le top départ d’un long cycle commémoratif du côté des militants de la mémoire des quartiers. Mais aussi, du côté des médias. Et pourtant… la mayonnaise n’a pas pris. Flop commercial côté cinéma, archi-flop civique du côté des associations, black out institutionnel… Récit d’un rendezvous « raté ».
24 novembre, Montpellier Chez Kaïna TV La salle du centre social de la Mosson bruisse pendant 3 jours de la présence de marcheurs/marcheuses, d’habitants, de militants associatifs ; un film sur la mini-Marche de Montpellier, le 24 novembre 1983 est diffusé, produit par l’association Kaïna, bien implantée aux pieds des barres de la Paillade. Pas mal de jeunes du quartier s’impliquent dans l’événement. Les débats se poursuivent même hors les murs, jusque dans les bars voisins, avec la présence de la Caravane de la mémoire d’Ac Le feu. Emmenée par Saliha Amara, la troupe Kahina et Cie (créée en 1975), joue la pièce « Responsables mais pas coupables ». La salle est comble, tout le quartier est venu en famille pour clore ce marathon mémoriel aux débats intenses, mais à l’accueil des plus chaleureux par l’extraordinaire petite équipe de Kaïna TV.
27 novembre, Palais de la Mutualité, Paris Meeting du PS en soutien à Christiane Taubira Que faire ? Rien. Que dire ? Des mots. Telle pourrait être la devise du Parti socialiste en matière d’antiracisme. Un joli clip avec les grands moments de l’histoire de France, cent ans de combats républicain (et parfois de honteuses débâcles). Une cohorte de ministres qui vient faire amende honorable à la Garde des Sceaux, pour rompre enfin son trop long silence. 18 caméras de télévision, mais pas de « grande et belle voix ». Harlem Désir, qui a oublié depuis longtemps que 30 ans plus tôt, il lançait SOS Racisme, ne dit rien de son parcours ni de celui du parti qu’il dirige, sur ces questions. Amnésie, mère de tous les drames à venir.
28 novembre, à Paris Projection du documentaire de Rokhaya Diallo Ce soir-là, au Comptoir général, un bar bobo de la capitale, le film « Les marches de la liberté » met en parallèle la marche pour les droits civiques de Washington de 1963, et celle pour l’égalité de 1983. En interrogeant surtout les jeunes de part et d’autres de l’Atlantique. La salle, comble, est très métissée (on peut noter en particulier la présence de beaucoup de jeunes Noirs, phénomène d’autant plus notable que ces derniers furent les grands absents de la Marche de 1983)… Ambiance festive et légère dans cette soirée à laquelle participe notamment Toumi Djaïdja et Hassan Ben Mohamed, frère d’un jeune marseillais assassiné par un CRS, au début des années 80 (Presse & Cité, partenaire de l’événement, diffuse un diaporama de son concours « Tape l’affiche », dédié à la représentation visuelle, en 2013, de l’événement de 1983)
30 novembre « Grande » marche contre le racisme Les parisiens, à l’appel des organisations anti-racistes traditionnelles, font un tour de chauffe entre République et Bastille, pour condamner la montée du racisme et les attaques dont a été victime Christiane Taubira. 10 000 personnes environ. Faut-il attendre qu’un Le Pen arrive au second tour d’une élection présidentielle pour être un million dans la rue ?
01er décembre, Paris, Palais du Sénat Colloque « Histoires croisées France/Maghreb » avec Pascal Blanchard Le gratin des marcheurs, des chercheurs et des journalistes attend le discours de Christiane Taubira, qui aurait d’autant pu être l’icône de cet anniversaire qu’elle a été la cible de la résurgence du racisme le plus moisi. Celui-là fera date pour les personne présentes, mais s’achèvera sur un triste « Nous avons raté ce rendez-vous ». On se consolera avec la qualité des intervenants et des expositions de l’Achac.
03 décembre, jour du 30ème anniversaire Paris, Place Montparnasse « Nous partîmes 100 000 en 1983, et sans aucun renfort, arrivâmes 16 en 2013 », aurait pu dire Corneille s’il était venu ce soir-là devant la gare Montparnasse. Heureusement, Edwy Plenel, directeur de Médiapart, était présent : il avait appelé à se rappeler. Du coup, France3 était là pour un direct, ainsi que Canal +, BFM, M6... Si vous voulez que votre anniversaire passe en direct à la télé, invitez Plenel. Les militants qui tenaient, transis, la banderole « Egalité des droits, justice pour tous » dans le froid mordant étaient satisfaits, du coup. Une bonne centaine d’organisation de gauche radicale étaient signataires de cet appel à la mobilisation, qui se télescopait avec une autre manif (un tout petit peu moins) anonyme, à la Goutte d’Or, 4 jours plus tard, pour le même motif. Misère de la gauche au XXIème siècle : ça mobilisait plus à l’époque du Cid, mais il est vrai que c’était contre les Sarrazins !
06 décembre matin, Paris Université européenne des Maisons des potes, débat avec des associations de quartier de l’ex-mouvance SOS Racisme Fidèle à sa tradition d’opposant de l’intérieur et de combat sur tous les fronts (justice, journalisme, emploi, élections, éducation populaire…), la fédération des maisons des potes termine son tour de France pré-municipal devant une centaine de jeunes habitants de quartiers populaires de tout le pays. 3 jours de débat et environ 100 intervenants de terrain plus tard, le bilan est mitigé : il ne faut rien lâcher, mais le vent ne nous est pas favorable.
06 décembre soir, Bondy (93) Cinéma André-Malraux, projection-débat autour du film « La Marche » L’immense salle de cinéma est quasi déserte. Une quarantaine de bondynois sont tout de même venus discuter, alors que l’équipe du film s’est faite porter pâle. En cause : un flop en terme d’affluence pour ce film, sur toute la France. Une semaine après sa sortie, on compte 126 000 spectateurs, pour environ 500 copies. Un échec à peine compréhensible, compte tenu du battage médiatique intense. Mais un signe du peu d’engouement pour cette page de l’histoire de France, et du peu d’empressement que les élites française, gouvernement compris, ont mis à lui apporter quelque relief. « La Marche » ne sera pas à Hollande ce que « Indigènes » a été pour Chirac, l’outil d’une prise de conscience nationale. A président timoré, résultat lamentable.
07 et 08 décembre, Paris, La Belleviloise « Ceux qui marchent encore » Le ghota de la gauche radicale des banlieues se réunit dans cette salle devenue en quelques années le haut lieu de la contestation parisienne, pour entendre la voix des oubliés de la Marche. Débats intenses, dizaines d’intervenants, spectacle musical (Casey, Rachid Taha…), projection de film (« Les marcheurs, chronique des années beurs »), théâtre (« Et puis nous passions le pantalon français »). On notera notamment la remarquable exposition en 20 panneaux iconographiquement magnifiques, narrant 30 ans de combats dans les banlieues, avec les mots de ceux justement qui ont mené ces combats (exposition réalisée par la jeune association « L’écho des cités », issue du Mib et du FSQP, et par le Tactikollectif de la famille Amokrane –Zebda- ansi que l’association Remebeur, portée par Ali Guessoum de l’agence Sans blanc). Un objet qui est une première en 30 ans de mémoire militante et qui circulera, on l’espère… Au revoir, et à dans 10 ans : le 40ème anniversaire sera un succès, n’en doutons pas. Erwan Ruty
40
spécial marche
Les nouvelles marches de 2013 Certains ont choisi de ne pas commémorer la Marche pour l’égalité de 1983, mais de la réactiver à leur manière : en repartant sillonner la France pour débattre dans les grandes villes de France. C’est le cas de l’association de Clichy-sousBois AC le feu avec sa Caravane de la mémoire et de la Fédération des maisons des potes, ancien satellite de SOS Racisme. Textes : Mérième Alaoui
Ac le feu :
« L’objectif est d’éveiller les consciences » « Ce n’est ni un anniversaire, ni une commémoration pour nous. Mais simplement une occasion de se rappeler d’un moment fondateurs dans l’histoire des luttes des quartiers populaires » explique Mohamed Mechmache, président de AC le Feu, qui a coordonné cette marche de 2013. Avec ses membres, ils ont constitué une exposition de photographies d’époque sont allés les présenter à Vénissieux, Marseille, Toulouse, Angers, Nantes, Roubaix, Nanterre… « A Vénissieux, l’ambiance était très intéressante, on a pu débattre, échanger… A chaque étape, c’est l’occasion pour les militants de AC le Feu de présenter l’histoire des marcheurs de 1983 mais surtout de débattre avec les gens sur la situation actuelle. L’objectif est de viser les jeunes, donc on tient des stands dans les collèges et lycées ». Et de rappeler que 80% des Français ne connaissent
© Roxanne Brelin
même pas l’existence de la Marche. « L’objectif est de réveiller les consciences. Les combats d’hier pour des droits communs doivent se poursuivre aujourd’hui, toujours contre l’exclusion, le racisme, l’islamophobie ! » Pour finir cette Caravane de la mémoire en beauté, AC le Feu prépare un grand rassemblement à Paris en décembre. « Pour cela il faut mobiliser les autres associations antiracistes et de quartier pour créer la plus grande manifestation possible ! On y travaille… Je pense par exemple à une grande fête avec des rappeurs de renom, mais surtout, des prises de parole pour rappeler au gouvernement actuel nos revendications d’hier qui sont toujours d’actualité : la lutte contre les contrôles au faciès et le droit de vote des étrangers par exemple… » martèle Mohamed Mechmache.
La Maison des Potes :
en ligne de mire, les élections municipales « On considère que ces trente ans ne doivent simplement être un énième rappel de la morale antiraciste. Dans chaque ville que nous traversons, nous avons des revendications claires et locales » explique Samuel Thomas. Le tour de France de la Fédération de la maison des potes a commencé le 7 octobre et se termine le 7 décembre avec des étapes telles que Lunéville, Strasbourg, Colmar, Marseille, Montpellier, Roubaix, Nancy, Lyon mais aussi des villes européennes limitrophes comme Fribourg ou Londres… « Nous avons un certains nombre de combats en cours que nous poursuivons sur place. On demande aux responsables de la ville de donner leur position sur : la candidature anonyme auprès des bailleurs sociaux, les politiques municipales des emplois qui font une différence entre les Français qui auraient des contrats type CDD et les étrangers qui restent cantonnés aux vacations… » A moins de 5 mois des élections municipales, l’objectif est de lancer des débats locaux sur la question de l’égalité des droits. Il s’agit aussi pour la Maison des potes, de rappeler un certains nombres d’avancées et de combats menés. Ainsi à Grenoble, lors de la visite des 23 et 24 octobre, l’occasion était de revenir sur la condamnation des maires de Pont de Chéruy et de Charvieu-Chavagneux pour discrimination par « pression sur les vendeurs et préemptions abusives à caractère raciste ». La semaine suivante,
visite à Montpellier de la discothèque “Le Souleil” qui avait été épinglée pour discrimination à l’entrée de l’établissement. Proche du Parti Socialiste, La Fédération des maisons des potes se dit déçu par le gouvernement actuel. « Oui il y a dans le gouvernements des amis… Mais on doit leur faire part de notre grande incompréhension. Les restrictions budgétaires touchent en premier lieu nos structures. Par exemple nos subventions ont baissé de 30% ! Sur le terrain on le voit bien : nous avons un gouvernement de gauche qui applique un programme de droite » tacle Samuel Thomas. Sans parler des « mensonges flagrants en ce qui concerne les quartiers sensibles. Les gens qui ont voté pour le PS se sentent oubliés ! Nous nous en rendons bien compte sur le terrain, la colère gronde… » prévient-il. Selon lui, même certains ministres sont mal à l’aise… qui encourageraient même les associations à créer un rapport de force pour les aider car ! Pour achever son tour de France, la Fédération de la Maison des Potes tenait une rencontre européenne les 5 et 6 décembre pour recueillir les meilleures solutions contre les discriminations et le racisme dans nos pays.
41
sélection médias de quartiers Partenaire Presse & Cité
Dans la banlieue lyonnaise, le film «La Marche» rassemble les marcheurs de 83 Par : Le 25 octobre, une dizaine de marcheurs s’étaient rassemblés dans un cinéma de Bron pour visionner le film de Nabil Ben Yadir qui raconte leur histoire, celle de la Marche pour l’égalité et contre le racisme, avant d’être mis à l’honneur en soirée à la Médiathèque de Vénissieux. En avant première, Mathilda pour Med’in Marseille, vous livre les réactions des marcheurs sur cette fiction réalisée autour d’une histoire qu’ils ont vécu il y a 30 ans, une aventure aussi fantastique que réélle. Séquences émotions : En sortant de la salle obscure, Bouzid et Arbi effacent les traces de l’émotion ressentie pendant la projection. Bien sûr, le film ne raconte pas tout le vécu des hommes et femmes qui traversèrent la France en 1983, mais l’essentiel y est. Les agressions quotidiennes, la rage et la colère devant les crimes racistes, la peur, la volonté d’en découdre et le choix de Toumi (Mohamed dans le film) de conduire une
action non violente d’envergure. Ce sera la marche pour l’égalité et contre le racisme. Pendant près de deux heures, on est plongé dans cette France qui au début des années 80 ignore une partie d’elle-même, la méprise ou la rejette plus ou moins violement. Mais ce que l’on voit aussi, c’est la découverte d’une France inconnue, ouverte, solidaire et les rencontres qui s’opèrent donnant courage, espoir et entrainant le succès que l’on sait. Mathilda Garcia Lire et regarder la suite sur : http://www.med-in-marseille.info/spip.php?article2169
Le réalisateur Pascal Demaria et le marcheur Farouk Sekai (à droite)
5 marcheurs et marcheuses de 1983
Partenaire Presse & Cité
Au Petit Quevilly, Fatima Milezy témoigne sur la Marche Par : L’une affiche un look utlra-féministe et se fait appeler Black Barbie. L’autre porte plutôt des jeans larges et des sweats à capuche. Elles font partie des rares femmes à évoluer dans le milieu majoritairement masculin du hip-hop. Ensemble, elles posent leur regard sur l’actualité et sur la place des femmes dans le rap et dans la société. au passé. C’est ce dont elle s’alarme pour l’avenir de son association dont les principales missions sont quelque fois mal perçues par les pouvoirs publics. Pour la militante des droits des travailleurs immigrés on assiste aujourd’hui à une « Lepennisation des esprits » qui pousserait certaines entreprises à recruter prioritairement les nationaux.
L’immeuble,17 rue Pablo Neruda abrite l’Association de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés (ASTI) dont la création remonte à 1983, c’est l’année aussi de la marche des « Beurs » partie le 15 octobre de Marseille et arrivée à Paris le 3 décembre. Coïncidence ou destins communs. En tout cas ces deux moments forts font désormais partie des luttes de l’histoire politique de l’immigration en France. Fatima Milézy, présidente de l’ASTI se souvient bien qu’à Rouen sa famille ainsi que d’autres rouennais ont hébergé des marcheurs en route pour la dernière ligne droite Paris où pour la première fois les portes de l’Elysée sont ouvertes aux jeunes des cités.30 ans après cet événement important qui a marqué la volonté politique de rompre avec le traitement des jeunes dans les quartiers populaires beaucoup de revendications pour l’égalité des droits et contre le racisme sont d’actualité et en net recul par rapport
Chérif Kane Ecouter la suite sur : http://www.radiohdr.com/Sonotheque--358.htm?PHPSESSID=efbaa61056266f2727bb8421125245b0
42
l’équipe Farid Mebarki / Melun
Erwan Ruty / Paris
Originaire de Petit-Quevilly dans la banlieue rouennaise, participe à la création de Respect magazine, co-fondateur de Ressources Urbaines, président de Presse & Cité… un multirécidiviste. Spécialiste de la rubrique financement et trésorerie, s’interroge sur l’économie de la presse et s’échine à faire émerger dans un contexte de crise, un modèle de média en prise avec l’économie sociale et solidaire et l’actualité des banlieues. Tout reste à faire.
Méva Raharissaina / Trappes
Directeur de Ressources Urbaines, l’agence de presse des quartiers ; fondateur et rédacteur en chef de Presse & Cité. Ancien directeur du service communication de la mairie de L’Île-SaintDenis ; ancien confodateur et secrétaire général de Respect magazine ; ancien rédacteur de Pote à Pote, le journal des quartiers ; ancien administrateur de l’association Survie ; ancien responsable du groupe Banlieues des Verts.
Carmen Firan / Paris Origine : transnationale Bio : Etudes en sciences sociales x 6 ans + immigrée x 8 ans + engagée dans l’associatif (Pro Democratia, Habitat-Cité, PlaNet Finance France... x 10 ans + théâtre x 3 ans Kiffe dans la vie : les beignets, P&C, sauver les pelicans (dans cet ordre)
Arrivée en France à l’âge de cinq ans, un jour de grande froidure du côté de Chartres. Elle posera plus tard ses valises dans le 78 et y effectuera des études littéraires à Trappes. Elle poursuit à la Fac de Nanterre des études de Sociologie de la Culture qu’elle clôturera par un diplôme en management de projet. Après des missions pour Malakoff Médéric et Eurodoc Systems, elle travaille pour des grandes agences de marketing (CPI Global, Groupe New York, Intervalles), elle trouvera son petit bonheur au sein de Presse & Cité en tant que chargée de développement
Jil Servant / Cayenne Parisien de naissance, Jil Servant a rejoint Lille pour finir diplômé de l’EDHEC, puis s’est frotté à la Martinique pour faire ses débuts dans le management musical et théâtral. Après un DESS Image et Société à Evry, il alterne entre réalisations de documentaires et productions de fictions à Paris, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en Chine, à la Réunion et à Mayotte, au sein de la société Palaviré Productions. En outre, il produit des films institutionnels notamment pour Ressources Urbaines et s’implique dans l’administration de Presse et Cité à laquelle il appartient toujours, même si en 2012, il choisit de vivre en Guyane, renforçant
Sylvain Ortéga / Lyon Journaliste de formation, je participe régulièrement au Lyon Bondy Blog, ainsi que dans divers blogs lyonnais. Du journalisme à la communication, j’ai travaillé dans des structures diverses telles que Regards, Le Progrès, Déclic, ou Handicap International. Ces expériences m’ont mis au contact de nombreux supports : web, presse écrite, vidéo, photo et graphisme ; et de sujets variés : société, culture ou politique.
Claire Tomasella / Paris Après des études de journalisme à Sciences Po Paris, Claire Tomasella travaille aujourd’hui à Génériques, association spécialisée sur l’histoire de l’immigration. Elle mène parallèlement des recherches à l’EHESS sur la représentation de l’immigration au cinéma, en France et en Allemagne.
l’équipe de Tic-Tac Production.
Charles Eloidin / Paris Graphiste polyvalent ayant travaillé pour de nombreuses revues. De Pote à Pote en passant par Respect Mag, Tracklist, Get Busy et The Source France, il poursuit son chemin en bon passionné d’arts graphiques, d’images numériques et de street art. Homme multicasquette et touche à tout, il travaille pour des maisons d’éditions, chaînes TV, associations et autres labels pour lesquels il réalise des sites web, vidéos ou des créations destinées à l’impression.
Jean-Fabrice Tioucagna / Montpellier Originaire de la Réunion, je débarque à Montpellier en 1996. Après un DEUG de Sociologie et une formation de Journaliste reporter d’Images, je collabore à diverses télés locales (Lyon, Lille, Epinal, La Réunion), et participe à la création d’une ancienne télé (M’ La Télé) à Montpellier. Puis, correspondant photo pendant deux années (Wostok Press). Fin 2007, je rencontre Kaina-Tv où je serai embauché l’année suivante. Ma passion pour l’image remonte au collège grâce à un atelier hebdomadaire en troisième. La caméra reste un excellent moyen de communication.
40 ans, co-fondateur et directeur de radio Hauts de Rouen (HDR) depuis 1995, ancien journaliste à Radio France (France Culture, France Inter, Radio-France Bleue Haute-Normandie). A travaillé pour radio Okapi (radio de l’ONU en République Démocratique du Congo). Rédacteur d’une étude en tant que consultant en communication pour le Groupe de Recherche sur le Développement Rural, intervenant en Afrique). Formateur en technique radio pour plusieurs radios de l’Afrique de l’Ouest.
Charly Célinain / Clichy (92) Après des études en Information et Communication, j’ai faite mienne l’obsession de Tony Montana “ The world is yours ” ! Le monde appartenant aux gens qui se lèvent tôt, j’ai commencé en 2005 en écrivant des chroniques (cinéma, livres, cultures urbaines...) pour l’émission matinale de la radio Générations 88.2 FM puis, de fils en aiguille, je me suis retrouvé derrière le micro. Dans le même temps, je réalisais des interviews filmés pour le site de la radio, j’écrivais des chroniques musique pour le site Orange.fr. J’ai été présentateur de live reports du festival Paris Hip Hop et rédacteur pour le site Canal Street.
Carlotta Macera / italienne de Montpellier Elle s’intéresse au journalisme citoyen et aux médias associatifs (radio, presse écrit, vidéo) en Italie et en Tunisie. Spécialisée dans la culture, l’histoire, la politique de l’espace méditerranéen et les questions d’immigration. Elle travaille actuellement dans une association audiovisuelle (WebTv) installée dans un quartier populaire de Montpellier, Kaïna TV.
Marin Schaffner / Paris Coordinateur du blog Z.E.P (Zone d’Expression Prioritaire) dans le cadre d’un service civique pour l’Afev, Marin est également engagé dans l’association Belleville Citoyenne, organisatrice du festival IRRUEPTION, événement d’expression populaire dans l’espace publique.
Mérième Alaoui / Goussainville Ancienne reporter pour RTL, je collabore au magazine le Point pour des articles “Société” mais aussi pour Salamnews. Très intéressée par le sujet de la mémoire immigrée maghrébine de France, je travaille aussi sur les problématiques liées aux quartiers populaires. Chroniqueuse pour la radio Africa N1 et pigiste pour Slate Afrique, je traite également de l’actualité de l’Afrique subsaharienne et du Maghreb
Maxime Hanssen / Lyon Maxime, 23 ans, explorateur de territoires, aussi bien urbains qu’européens. Après une maîtrise d’Histoire et la découverte de l’Europe centrale, j’ai décidé de renforcer mon engagement au sein du Lyon Bondy Blog. Nos banlieues sont talentueuses, belles et rebelles. Elles méritent une attention toute particulière.
Moïse Gomis / Hauts-de-Rouen
Thierry Grone / Saint-Denis Passionné par la culture Hip-hop et urbaine, investi depuis quinze ans dans le tissu associatif avec l’association Culture de Banlieue sur le territoire de Plaine Commune, qui a pour objectif de promouvoir la culture urbaine dans les quartiers populaires. Organisateur de soirées et concerts, en 2004 je deviens rédacteur en chef du magazine « Less univers » et en 2010 programmateur du festival alternatif urbain « Banlieusard et alors ? » qui se tient en février à Aubervilliers, La Courneuve et Saint-Denis. Scénariste et réalisateur de clips et courts métrages, je lance en octobre 2013 la web série « Qui met le coco ? » et créé une maison d édition, Pas Vu Pas Pris. Par ailleurs, je suis responsable du Point information jeunesse de la ville de La Courneuve.
Yannis Tsikalakis / Saint-Denis Après des études de droit et de sciences politiques, il se spécialise dans la question de la diversité culturelle et sociale dans les médias. Ce qui le conduit à un premier poste de chargé de mission à France Télévision. Passionné par les cultures urbaines et populaires, il rejoint le monde associatif dans les quartiers populaires en tant rédacteur et webmaster et participe à des projets de solidarité nord-sud.
Amadou Gaye / Fontenay-sous-bois Photographe de presse (pour l’agence Viva) et d’art depuis le début des années 80, Amadou Gaye a multiplié les expositions en France et à l’étranger (Cuba, GB), notamment sur le Paris et la France métissée des trois dernières décennies. Il a publié plusieurs ouvrages sur cette longue histoire culturelle (Ethnicolor, Paris la garce, et Génération métisse avec Lila Sébar, Eric Favereau et Yannick Noah). Il est aussi comédien, et a créé deux spectacles : Négritudes et Paroles nègres.
REMERCIEMENTS • Ce JOB n°5 spécial Marche a été réalisé dans un esprit d’ouverture et de sensibilisation pédagogique autour de la Marche pour l’égalité, suite à la 3ème Université des banlieues et de la communication, les 14 et 15 octobre 2013 à La Courneuve. En partenariat avec L’Ina (merci en particulier à Amandine Collinet) et avec Les Marchés citoyens (Sébastien Ravut) Avec : Maxime Hanssen (Lyon Bondy Blog), Sylvain Ortgéga (Lyon Bondy Blog), Barthélémy Gaillard (Ragemag), Jenna Bezahaf (EYCA), Sara Iskander, Mohammed Ouaddane (Mémoire & Histoires en Île-de-France), Mimouna Hadjam (Africa93), Dominique Renaux(Sakamo), Yannis Tsikalakis, Eva Allouche (Du côté des femmes), Fabien Guillaud, Carlotta Macera (Kaïna TV), Jean-Fabrice Tioucagna (Kaïna TV), Anne Bocandé (Africultures), Carole Dieterich (Africultures), Malha Bentaleb (Génériques), Juliette Mucchielli (Fondation Culture et diversité), Anglade Amédée (Africultures), Gabriel Gonnet (Regards2banlieue), Saci Ourabah (Regards2banlieue), Rachida El-Ghazali, Marin Schaffner (Zep), Claire Tomasella (Génériques), Bally Bagayoko (CG93).
Plusieurs articles ont été réalisés par des élèves du CFPJ pour le journal-école réalisé sur les 30 ans de la Marche entre le 25 novembre et le 06 décembre 2013 (merci en particulier à Laurence Delpierre, Abdessamed Sahali et Mérième Alaoui). Tous les articles et vidéos non publiés sur le JOB5 sont visibles sur le site www.presseetcite.info. Avec : Félix Roudaut, Emma Roulin, Matthieu Delacharlery, William Bree, Mikael Corre, Vincent Jolly, Alexandra Bresson, Julien Wagner, Eloise Trouvat, Camille Jourdan, Antton Rouget, Cosme Buxin, Assia Hamdi, Emeline Le Naour, Eloise Trouvat.
Certains visuels (pages 16, 17, 41) ont été réalisés dans le cadre du concours (graph, dessin, photo, peinture…) « Tape l’affiche », initié par Presse & Cité sur le thème : « 1983-2013 : 30 ans de Marche pour l’égalité et contre le racisme, et aujourd’hui, quel regard ? » En partenariat avec :
43
portrait
Il y a du Gandhi dans ce Toumi Toumi Djadjia est l’initiateur de la Marche pour l’Egalité et contre le racisme. Du 15 octobre au 03 décembre 1983, il en a été le messager. Il en est devenu l’icône. Comment devient-on une icône, surtout quand on ne souhaite pas le devenir ? C’est ce mystère qui fait sa force irrépressible. Celle d’une énergie, d’une conviction, d’un foi et, le concernant, d’un amour, au sens presque chrétien du terme.
permettait le choix : oeil pour oeil, dent pour dent était alors un choix ; la main tendue à ceux qui vous oppriment un autre choix. Qui saura jamais suffisamment sonder les coeurs et les âmes pour discerner pourquoi untel prend tel chemin, et tel autre le chemin inverse ? Cet été 2013, à Vénissieux, Toumi nous accueille chaleureusement chez lui. Il fait très chaud. On sort les chaises à l’extérieur de son petit pavillon en crépi terre de sienne, pour prendre l’air sur le trottoir, avant que sa mère nous offre des bricks, puis le couscous. Des amis de Toumi qui habitent le coin passent, Pascal Demaria, Pierre Bafounta. La famille aussi. Toumi a maintenant quatre enfants, et même un petit-fils de 18 ans. Miracle d’on ne sait quelle foi, le regard doux et pétillant du père, son sourire angélique, semblent lui donner quasi le même âge que certains de ses enfants. A vingt ans, à l’époque de la Marche, on reconnaissait le leader des marcheurs à sa tignasse foisonnante. Maintenant, elle a fait place à un crâne glabre. Mais l’énergie, la jeunesse, la vie et la voix, sont restées les mêmes. Cette voix mezzo voce, parfois à peine audible, mais d’un charisme inouï qui, lorsqu’elle se fait entendre en public dans les salles les plus impressionnantes et devant les publics les plus considérables, finit par éteindre tous les brouhahas, jusqu’à ce qu’un ange semble passer pour susciter l’écoute la plus attentive et captiver l’auditoire le plus distrait.
D.R.
Pourtant Toumi a toujours refusé les rôles de hérault, voire celui de prophète des nouveaux français enfants d’immigrés que d’aucuns, après le défilé parisien de 100 000 personnes du 03 décembre 1983, auraient voulu lui faire endosser. Un costume sans doute trop large pour ses frêles épaules. La parole de Toumi a sans doute aujourd’hui la force de ceux qui économisent justement leur voix. Car il n’a pas souhaité devenir l’idole de la « génération beur » que les médias, bien des associations, des partis et des citoyens ordinaires voulaient faire de lui. Affaibli par cette irrévocable blessure par balle qui, encore trente ans plus tard, le laisse d’une santé fragile ? Economie de moyens de celui qui fait vivre sa petite entreprise d’aide à la personne ? Humilité de celui qui, après un long voyage, ne rêve que de revenir cultiver son jardin (secret) et, comme Ulysse, revoir de son « petit village fumer la cheminée », retrouver son « petit Liré » , son « Loire gaulois » et sa « douceur angevine », pour paraphraser Du Bellay ?
B
ien entendu, il ne s’agit pas de jeter une OPA néo-colonialiste, de christianiser de force un fils de d’immigrés harkis installés en France depuis 1967. Cela relèverait du scandale. Mais il y a quelque chose de la figure christique, à la fois dans le parcours semé d’embûches de cet enfant de la balle, et dans sa manière d’être. D’autres, plus prosaïques, diraient qu’il a une âme de maître Yoda, ce petit être vert, de la Guerre des Etoiles (feuilleton qui n’est du reste pas avare de symboles eschatologiques, si ce n’est bibliques) qui, aux Padawan et futurs chevaliers Jedi commandait, et la sagesse leur enseignait. Un maître Yoda dont l’humilité n’a d’égale que la Force intérieure. Si l’on songe que le maître à penser de Toumi est Gandhi, on se rappellera de l’humour avec lequel Martin Luther King qualifiait ce dernier, tout hindou qu’il fût : « le plus grand Chrétien du monde moderne ». Et l’on se souviendra aussi à quel point le père Christian Delorme, notamment (mais aussi Jean Costil, pasteur et membre actif de la Cimade Lyon, organisation protestante d’aide aux immigrés et étrangers née de l’après-guerre), a compté dans la « deuxième vie » de Toumi Djaïdja. Un véritable compagnonage spirituel, qui n’a pas peu contribué à remettre sur pieds un jeune homme de 21 ans qui venait de se faire tirer dessus par un vigile, le 20 juin 1983. Et de la force de caractère, autant qu’une foi inébranlable en l’humanité, il a dû en falloir à Toumi, qui a survécu à ses blessures, et a trouvé la force de marcher plus de 1200 kilomètres quelques mois plus tard pour porter un message de paix à un pays qu’il ne connaissait pas et dont il devait logiquement penser jusqu’alors qu’il le haïssait, lui et les siens venus d’au-delà la Méditerranée quelques années après la guerre d’Algérie, une guerre civile et une guerre entre deux peuples qui avaient failli faire basculer la France dans une autre guerre civile, en métropole même. De la force d’âme, car à cette date, là où le crime qui a conduit Toumi à l’hôpital, une balle dans le ventre, a eu lieu, c’est-à-dire aux Minguettes (cité Monmousseau, pour être précis, à Vénissieux, banlieue de Lyon, Primat des Gaules, c’est-à-dire siège historique de l’Eglise de France), la violence régnait. Bien des jeunes y avaient cédé, pour répondre à l’injustice, au racisme, à la pauvreté, au désoeuvrement, aux exactions policières... les raisons ne manquaient pas, et, par-delà les frontières, aux Etats-Unis en particulier, certains dans des situations comparables l’avaient justifié depuis longtemps, comme Malcolm X, pour répondre « by any means necessary », à la violence policière. Mais il faut croire qu’un certain nombre de jeunes (Toumi n’était pas seul, il était président d’une association, SOS Avenir Minguettes, qui luttait pour l’amélioration de la vie quotidienne dans son quartier) avaient décidé de ne pas tomber « du côté obscur de la Force » : là où certains de leurs grands frères (au sens propre du terme concernant Toumi : Amar Djaïdja) étaient plongés dans une spirale de la petite délinquance, d’autres tentaient d’y résister. Ainsi, ils menaient sit-in et grèves de la faim (comme celle de juin 1983) pour répondre aux violences et injustices. Et ainsi, relevaient le défi qu’avait si bien décri Gandhi, dont Toumi aurait vu la vie cinématographiée par Richard Attenborough, Oscar 1983 du meilleur film et du meilleur réalisateur, sur son lit d’hôpital. Il y a donc alors comme un contexte qui
44
Une parole qui porte d’autant plus qu’après un long silence de près de trente ans (quoi qu’il se soit déjà exprimé en 2008 pour les 25 ans de la Marche), il décide de refuser l’invitation du ministre de la Ville actuel de commémorer la Marche et l’installation d’une stèle à Venissieux, et se fend même d’un communiqué, suprême affront ! pour s’en expliquer : « Je me vois dans l’obligation de sortir de ma réserve. Pendant 30 ans j’ai nourri l’espoir que l’égalité soit le chantier permanent de la République celle à laquelle nous aspirons tous. Mais aujourd’hui force est de constater, malgré des avancées certaines, l’inégalité frappe toujours voire plus encore (…) Je ne peux cautionner l’inaction politique en signant un chèque en blanc au gouvernement ». Alors, il fait la tournée de bien des invitations de France et de Navare, avec une certaine parcimonie dans ses choix d’intervention. A peine un rôle de figurant (ironie !) dans le film de Nabil Ben Yadir, pas ou prou d’interviews accordée, préférant garder ses mots pour ses proches de Vénissieux qui réalisent un documentaire, un livre, une pièce chorégraphiée, un site, autour de lui. De quoi faire enrager les rageux de toujours, et laisser sur leur faim les prolixes d’un monde de communication permanente et intensive : « ma parole ne se diluerait-elle pas dans un fatras de commentaires », s’interroge-t-il légitimement ?
Toumi a toujours refusé les rôles de hérault, voire celui de prophète des nouveaux français enfants d’immigrés que d’aucuns, après le défilé parisien de 100 000 personnes du 03 décembre 1983, auraient voulu lui faire endosser. De toutes manières, il le clame sagement, avec réalisme : déjà, à l’époque « nous n’avions aucune revendication, à part la Justice ou l’Egalité. Ce ne sont pas des revendications ». Mais un état d’esprit. Depuis le début des années 2000, la France a pour ministres de la Justice Rachida Dati, puis Christiane Taubira. Ce ne sont pas que des symboles. Certains de ceux qui hier étaient toujours devant les tribunaux, siègent parfois aujourd’hui place Vendôme. Il est des combats qui dépassent ceux qui en ont été les porteurs, et refusent de devenir des prêcheurs guidant leur peuple hors d’on ne sait quelle Egypte, ouvrant les eaux de telle ou telle Mer Rouge. C’est parfois sagesse que de le savoir le reconnaître, de ne pas s’acharner, et de laisser ces luttes suivre leur propre chemin dans l’Histoire.
Erwan Ruty