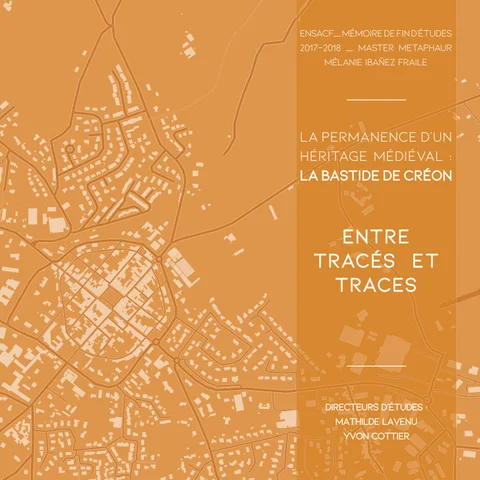ENSACF_ Mémoire de fin d’études 2017-2018 _ Master METAPHAUR Mélanie IBAÑEZ FRAILE
La permanence d’un héritage médiéval : la bastide de Créon
Entre tracés et traces
Directeurs d’études : Mathilde LAVENU Yvon COTTIER
École Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand
Ministère de la culture et de la communication
Année universitaire 2017_ 2018 Mémoire de cinquième année Domaine d’études METAPHAUR Mémoire et Techniques de l’Architecture et du Patrimoine Habité Urbain et Rural
La permanence d’un héritage médiéval : La bastide de Créon
Entre tracés et traces Mélanie IBAÑEZ FRAILE Directeurs d’étude : Mathilde LAVENU et Yvon COTTIER Date de soutenance : 15 Janvier 2018
4
SOMMAIRE_
REMERCIEMENTS..................................................................................................4 AVANT-PROPOS.....................................................................................................6 DÉFINITION DES TERMES......................................................................................10 INTRODUCTION...................................................................................................14 I_ RÉSEAU VIAIRE ET TRACÉS ................................................................................20 II_ PARCELLAIRE ET TRACES ..................................................................................66 CONCLUSION........................................................................................................110 LEXIQUE..................................................................................................................114 BIBLIOGRAPHIE......................................................................................................118 TABLE DES MATIÈRES...............................................................................................126 ANNEXES................................................................................................................128
6
REMERCIEMENTS_
Aux enseignants encadrants pour m’avoir orientée tout au long de ce travail. À Mathilde Lavenu qui a contribué à éclaircir mes idées et à améliorer la précision de mon vocabulaire en architecture. Et à Yvon Cottier pour la sensibilité qu’il partage quant à la question de l’héritage et les pistes de recherche conseillées. Merci aussi à Amélie Duntze pour les apports méthodologiques et à toute l’équipe encadrante METAPHAUR pour leurs corrections. Toute ma gratitude à Sylvie Desmond qui m’a accompagnée au long de la recherche et de l’écriture de mon mémoire, qui a partagé sa passion pour Créon et m’a donné accès aux archives municipales. Mes sincères remerciements aux maires de Créon : À monsieur Jean-Marie Darmian, maire de 1995 à 2014, qui m’a aidé à l’aurore de ma recherche grâce à son expérience des bastides et à son regard avisé en tant que président de l’Union des Bastides de Gironde. À monsieur Pierre Gachet, actuel maire de Créon, qui a su m’ouvrir une parenthèse dans son agenda chargé, pour répondre à mes questions et m’encourager dans la poursuite de ce travail. À monsieur Roger Caumont, maire de 1977 à 1995 qui a consacré une partie de son mandat au développement architectural et urbanistique de Créon et a partagé cette expérience avec moi, toute ma gratitude.
7
À Paloma, pour ses conseils de rédaction et son regard critique tout au long de la rédaction. À Carole Irigoyen, commerçante, habitante et élue à Monflanquin, pour ses réponses franches concernant sa vision de la bastide d’hier à aujourd’hui. Je remercie mes parents et ma famille pour leur soutien continu et leurs relectures, sans qui, la réalisation de ce mémoire n’aurait pas été possible. Je remercie Alex pour m’avoir soutenue et conseillée dans les moments de doutes.
8
AVANT-PROPOS_
Les études d’architecture forment un nouveau regard sur la ville, le paysage, les lieux et les cheminements, ce regard s’immisce dans chaque relation que nous entretenons avec l’espace, doté d’une sensibilité travaillée, la reconnaissance de l’environnement devient critique pas à pas. Ce qui nous est familier, ce que nous oublions de remarquer ou ce qui n’a pas changé, s’inscrit dans une routine visuelle impropre à l’architecte. Ce sont le questionnement et l’étonnement qui réveillent le terrain de réflexion quant à l’existant. Le domaine d’étude «Mémoire et Techniques de l’Architecture et du Patrimoine Habité Urbain et Rural» porte un intérêt sur ce dernier point. L’élaboration d’une architecture est indissociable de la prise en compte de son contexte, ce qui, au contraire, générerait des espaces bâtis incohérents qui n’intègrent pas l’histoire de leur site. C’est parce que je partage ces points de vue que mon choix s’est orienté vers ce domaine d’étude. Au cours de la première année de master, j’ai vu ma sensibilité s’accroître quant à la question du lieu, qui exprime la valeur d’un site à travers son histoire, sa société ou son urbanisme. La ville de Créon, a été fondée au Moyen-Âge1. En 2015 des festivités ont été organisées pour célébrer les sept siècles de la bastide. Cependant, depuis un demi siècle, le village d’environ 4500 habitants2 semble subir de grands changements3 (voir Fig. 2). En effet nous pouvons observer une forte densification s’exprimant par une urbanisation qui s’organise sous forme d’une large couronne périphérique autour d’un centre bourg caractéristique. Depuis
Fig 2_Carte actuelle de Créon, Réalisée en Octobre 2017 d’après cadastre.gouv Bâti à l’intérieur de la bastide Expansion urbaine à l’extérieur des limites de la bastide 100m
Fig 3_Plan de situation, emprise actuelle de la ville, Réalisée en Septembre 2017 d’après cadastre.gouv Le Pout
e
rn
ou
rs
Lib
Ve
Ve
rs Bo
rde
au
x
Créon
Vers Sauveter
re-de-Gu
yenne
La Sauve
Créon illac
s Cad
Ver
200m
1_ Mairie de Créon et Société Archéologique et Historique du Créonnais, Créon, De la fondation de la bastide au XXIe siècle, Mai 2015, p. 20 2_ D’après l’INSEE 3_ Des changements s’assimilant à l’étalement urbain, dus à la proximité avec Bordeaux
9
10
vingt ans, ma famille habite dans cette périphérie. Lorsque nous empruntons un chemin pour nous rendre à pied dans le centre, il est encore possible de discerner que nous suivons les traces d’anciennes intentions d’organisation de l’espace4. Cependant, malgré une volonté de la commune d’intégrer l’expansion urbaine à la bastide, nous ressentons une rupture entre les deux. Des questions de transmission de l’héritage de la bastide se posent. Originaire du Sud-Ouest de la France, les villes bastides ont toujours fait partie de mon environnement, Créon, mon village natal, Libourne, la ville où j’ai passé la fin de ma scolarité et Carbonne, la ville de ma famille maternelle. L’occasion d’avoir pu vivre5 plusieurs bastides m’a sensibilisée à la valeur historique de celles-ci, mais aussi à leur permanence malgré la confrontation avec des évolutions contemporaines. Cette expérience non savante6 m’a aussi permis de souligner le fait que les bastides possèdent une identité très marquée. Les premières intentions de réalisation de ce mémoire s’appuyaient sur une analyse sensible à travers une forme, le carnet de voyage. Grâce à cet outil, la question de la permanence dans la bastide aurait été traitée d’une manière plus sensible à l’aide de comparaisons entre les différentes cités. Cependant, le temps ne me permettait pas d’entreprendre une recherche aussi vaste. Aujourd’hui, le choix se concentre sur la bastide créonnaise, celle que je connais le mieux, pour pouvoir approfondir les champs d’étude particuliers. Ce choix m’a aidé à focaliser la recherche sur ce qui fait sens en la bastide, ce qui constitue son héritage. Toutefois, des comparaisons entre Créon et d’autres bastides permettront d’asseoir le propos.
4_ Relatives aux caractéristiques de la bastide
5_ Ici, le terme «vivre» exprime l’expérience du fonctionnement de la bastide dans son univers contemporain 6_ Du fait d’avoir eu lieu avant les études d’architecture
11
Lors des recherches, j’ai été bien accompagnée, notamment par la mairie de Créon qui s’est efforcée de trouver les documents demandés. Cependant, les collectivités locales et les archives départementales n’ont pas montré autant d’intérêt pour ce sujet d’étude.
7_ Notamment les entretiens avec les trois derniers maires de Créon pour comprendre comment mettre en place des politiques urbaines pour continuer à faire prospérer la bastide tout en la protégeant. 8_ Le collectif, crée en 1983 agit pour la préservation du modèle urbain de la bastide par des recherches et des publications. Leur travail se concrétise 10 ans après leur création parla réalisation d’un livre blanc : Centre d’étude des Bastides, Villes Neuves d’Europe du Moyen-âge, Le Livre Blanc des Bastides, ed. Privat, Mai 1993, 155 p.
À travers ce mémoire, je souhaite me familiariser d’un point de vue architectural avec la bastide en analysant la manière dont les divisions parcellaires et le réseau viaire qui composent son urbanisme, vont être les médiateurs de l’héritage de la nouvelle ville. Mon regard, associé à des discussions et des actions d’intérêts pour l’avenir de la bastide7, permet de développer un questionnement concernant la transmission d’un héritage médiéval. Ce questionnement se rattache aux recherches du collectif du Centre d’Étude des Bastides8 qui a œuvré pendant plusieurs années pour la reconnaissance des bastides comme patrimoine. J’envisage ce travail comme une association entre l’aboutissement à la formation de la pensée critique développée depuis le début des études et les questionnements contemporains liés à l’architecture, au patrimoine et à l’urbanisme. Il me permet aussi d’établir un lien entre l’univers dans lequel j’ai évolué avant les études d’architecture et le résultat de ces études pour contribuer à valoriser un patrimoine dont nous héritons sans prise de conscience réelle.
12
Définition des termes_
Avant tout, il semble nécessaire de définir certains termes relatifs à des notions d’urbanisme ou de patrimoine. Les définitions issues de théoriciens9 du patrimoine et de dictionnaires du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales sont associés à un point de vue personnel qui permettent d’introduire l’interprétation des notions développées dans le propos. La trace est un indice d’une partie d’un ensemble disparu, elle est la marque qui témoigne de l’existence passée de quelque chose10. Dans le développement de ce mémoire, la trace sera interprétée comme le témoignage d’un système urbain fort qui est partiellement présent aujourd’hui. La trace est une conséquence à une action qui tend à faire disparaître l’objet initial, ici la morphologie médiévale de la bastide. À Créon, les traces reflètent une intention nouvelle de bâtir au Moyen-âge. L’intérêt se porte sur l’analyse de ses traces dans le bâti, tant dans sa composition, que dans sa morphologie générale. Ainsi il est possible de déterminer si la bastide de Créon est un médiateur de transmission d’un patrimoine ou si ces traces ne reflètent plus l’intention d’origine : une bastide qui a évolué indépendamment de ses valeurs originelles. Dans l’histoire, les villes nouvelles s’établissent selon un plan régulier.11 Les tracés déterminent les rues qui séparent les îlots de la bastide et la place de la même superficie qu’un ilôt. à Créon les tracés,sont orthogonaux il suivent un plan en damier ou hippodamien.12 Ils incluent le réseau viaire et entretiennent une relation avec les ali-
9_ LAVEDAN Pierre : historien et urbaniste LE CORBUSIER, urbaniste, architecte, deigner CHOAY Françoise, historienne des théories et des formes urbaines et architecturales THINES-LEMP et BATTRO : écrivains en psychologie
10_ Dictionnaire: TLFI http://www.cnrtl.fr/definition/trace 11_ LAVEDAN Pierre, Les villes françaises, ed. Vincent, Fréal & Cie, Paris, 1960, p.88
12_ Ce terme vient du nom de l’urbaniste et théoricien grecantique, Hippodamos de Milet, qui «inventa la division des villes et adapta leur tracé aux conceptions philosophico-politiques [...]». Dictionnaire: TLFI http:// www.cnrtl.fr/definition/ tracé
13 13_ Article 51 LE CORBUSIER La Charte d’Athènes
14_ CHOAY Françoise L’allégorie du Patrimoine, ed. Seuil, Paris, col. Couleur des idées, 1992, 272 p.
gnements de façades. Les observations de Le Corbusier concernant la charte d’Athènes énoncent les origines anciennes du réseau actuel des voies urbaines en l’assimilant au reflet des intentions d’une époque donnée13. Le propos développe en quoi les tracés de la bastide font partie de l’objet d’étude en justifiant pourquoi ils sont estimés comme une des composante de l’héritage. D’autre part, nous nous intéressons au rôle des tracés médiévaux aujourd’hui, s’il sont respectés, valorisés ou adaptés aux évolutions du XXIe siècle. Ci-contre le plan de Barcelone (voir Fig. 3) illustre une manière de concevoir une ville nouvelle, (ici pour son extension en 1859) d’après l’urbaniste espagnol Cerda qui choisit une trame orthogonale pour créer une hiérarchie de voiries régulières et une uniformité du bâti. Malgré une distance d’échelle entre Créon et Barcelone, nous pouvons ressentir deux volontés de penser la ville qui se rapprochent. Ces villes nouvelles témoignent d’un renouveau urbain qui établit l’organisation de la ville autour de diverses préoccupations comme l’économie ou encore l’échange social. Les bouleversements de la période postindustrielle à la fin du XIXe siècle sont tels, qu’ils font prendre conscience de la valeur des villes anciennes et questionnant leur potentiels d’adaptation. Les évolutions des modes de vies, notamment l’utilisation de nouveaux modes de transport, entraînent des questionnements quant au devenir des villes. Françoise Choay approfondit la question en définissant ce phénomène comme une conversion de la ville matérielle en objet de savoir historique3. On parle d’héritage lorsqu’un bien qui possède une valeur patrimoniale est transmis, par les générations précédentes, avec une connotation de tradition4. La ville tend à évoluer selon l’héritage d’une période donnée transmise par son organisation urbaine. À Créon, on cherchera à comprendre si la permanence du tracé urbain depuis sept siècles relève d’une transmission de cet ordre.
14
Nous parlons de permanence lorsque l’expression d’un événement ou d’un système persiste aux aléas durant une temporalité étendue sur un long terme. D’après Thines-Lemp et Battro qui s’intéressent à cette notion en 1966 et en 1975, la permanence est un phénomène qui a pour conséquence la constitution d’une identité malgré des modifications dans ses propriétés perçues et dans ses propriétés spatiales4. À travers certaines caractéristiques définies, il est possible de définir une ville neuve comme une bastide (voir Fig. 4). Les témoins de ces persistances peuvent être détectée dans la logique urbaine qui conserve les tracés ou encore dans une architecture qui s’inscrit dans une continuité en conservant une typologie médiévale transposée à des usages contemporains. Il est alors possible de détecter une transmission se référant au Moyen-Âge. En effet, nous nous demanderons s’il existe une réciprocité entre la permanence et l’identité dans la bastide.
Sources iconographiques_ Tout document iconographique n’ayant pas de référence écrite provient d’une réalisation personnelle.
Format du mémoire_ Le format du mémoire s’assimile au tracé urbain qui définit la bastide. Le choix d’un carré s’explique par la régularité du plan de Créon qui organise la ville bâtie autour d’une place quadrangulaire. Cette taille de 21cm par 21cm s’approche aussi du format des cahiers du centre d’études des bastides , car mon travail s’inscrit dans une certaine continuité du travail de ce collectif qui n’existe plus aujourd’hui.
Fig 4 _ Vue aérienne de Barcelone Le plan de Cerda (1859) caractérise une mise en pratique du plan hippodamien pour la conception d’une ville nouvelle http://projets-architecte-urbanisme.fr/ barcelone-plan-cerda/
16
INTRODUCTION _
Durant le Moyen-Âge, du XIIe au XIVe siècle, le Sud-Ouest de la France voit naître un événement d’importance dans son histoire. Pendant une période de prospérité, avant la Guerre de Cent Ans15 (voir Annexe 1 p. 130), un phénomène de peuplement intense entraîne la naissance de plus de trois-cent bastides (voir Fig. 5). En France, les bastides s’étendent dans l’ensemble des anciennes régions Aquitaine et Midi-Pyrénées aujourd’hui. Selon le discours d’Odon Saint Blanquat, le mouvement de créations urbaines est une résultante d’un lent processus évolutif qui aboutit dans le meilleur des cas à un modèle caractéristique d’un urbanisme “gothique“ accompli“16 qui se traduit par une standardisation et une modularité de la morphologie urbaine. D’après le propos de Odo Georges17 lors de la conférence “les Bastides“ en 1993, le XIIIe siècle voit naître une nouvelle vision du monde accompagnée d’une «rationalité géométrique». Les recherches du CEB mènent à la conclusion d’une fondation de ces villes neuves en vue d’une nouvelle gestion du sol visant à défricher les terres et exploiter le sol par un fondateur qui donne un territoire dont les futurs habitants règlent la répartition et les dotent de privilèges juridiques et commerciaux18. D’après Odon Saint-Blanquat, suite à une augmentation démographique très forte, la bastide voit le jour comme un principe urbain qui remet en question les logiques d’habiter en milieu rural et met en place une organisation urbaine en relation avec son territoire. Les populations introduites dans la cité pour habiter les bastides sont des “poblans“, ils se voient dotés d’une parcelle étroite en lanière à l’intérieur de la bastide et d’une parcelle agricole à cultiver à l’extérieur de la bastide toutes
15_ CEB, Le Livre Blanc des Bastides, ed. Privat, Mai 1993, p.17
16_ SAINTBLANQUAT Odon. Comment se sont créées les bastides du Sud-Ouest de la France. In: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 4e année, N. 3, 1949. p.1 17_ Historien qui a travaillé sur la question de l’héritage de la bastide notamment à Monflanquin (47). 18_ CEB, Le Livre Blanc des Bastides, ed. Privat, Mai 1993, p.17
17 19_ CLEM (Centre de Liaison de l’Entredeux-Mers), L’Entredeux-Mers et son identité, Acte du septième Colloque, L’Entre-deux-Mers et son identité, ed. William Blake & Co, Octobre 2000, p. 91
20_ D’après l’architecte du patrimoine Rayko Gourdon durant le colloque de la «Ronde des bastides» à Monflanquin en Septembre 2017
identiques19. En plus d’une égalité de biens, un système d’équité fiscale s’applique aux habitants pour concentrer les activités autour du commerce. La bastide se distingue de la ville neuve au Moyen-Âge par l’origine de sa fondation qui s’émancipe de l’autorité religieuse et royale. Par conséquent, il est fréquent de retrouver dans les plans des bastides le symbole religieux, l’église exclue de la centralité de la ville. Ce geste représente un acte de rébellion à une époque où la crainte de Dieu est omniprésente20. La ville caractéristique
Préfecture Villes neuves à plan régulier Bastides à plan régulier Autres villes
Nouvelle Aquitaine
Fig 5_ Carte actuelle des Villes Neuves à plan régulier et des Bastides du Sud-Ouest Réalisé en Octobre 2017, d’après Le CEB, Villes Neuves d’Europe du Moyenâge, Le Livre Blanc des Bastides, ed. Privat, Mai 1993, p.25 50km
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Occitanie
18
du Moyen-Âge est verticale, elle est organisée selon la place du symbole religieux qui s’élève vers le ciel. Les perspectives étroites de la ville offrent une vue sur la cathédrale ou l’église21. Ordinairement, l’entité religieuse constitue le motif du rassemblement vers lequel convergents rues et ruelles sans préoccupation d’une circulation fluide et une division des usages de l’espace public. À Créon, la place quadrangulaire est perçue comme l’espace privilégié dans l’organisation urbaine. Du plan jusqu’à la vue du piéton, l’église est un élément qui apparaît comme secondaire, dans la composition de la bastide. La trame de la bastide se compose d’une structure viaire franche (voir Fig. 6) qui divise la ville en plan orthogonal 1 et découpe le tissu bâti en îlots réguliers 2 . Nous distinguons ces caractéristiques générales dans la majorité des bastides. Le plan orthogonal se décline en une hiérarchie de rues allant des andrones (l’espace réduit d’environ un mètre entre deux maisons mitoyennes) jusqu’aux carreyras (les rues de la bastide dans lesquelles peuvent se croiser deux charrettes.)22 La division parcellaire est une autre composante caractéristique de la bastide, on observe une répartition de parcelles en lanières 3 , propre à la période médiévale, qui donne lieu à des façades étroites sur la rue 4 . Les cornières ou arcades 5 , s’inscrivent dans la continuité des voies orthogonales, de plus, elles accompagnent la logique des parcelles en lanière en créant un seuil entre la place centrale 6 et la boutique, puis l’habitation. Cet espace public, représentatif de la ville marchande témoigne d’un usage passé, nous cherchons à savoir s’il est toujours en vigueur aujourd’hui et quelles sont ces traces.
21_ BLANQUART Paul, Une histoire de la ville Pour repenser la société, ed. La découverte, col. Cahiers Libres, Août 1997, p.75
22_ DUBOURG Jacques, Histoire des bastides: les villes neuves du MoyenÂge, ed. Sud-Ouest, Bordeaux, col. Référence, Novembre 2002, p.179
19
23_ CLEM (Centre de Liaison de l’Entredeux-Mers), L’Entredeux-Mers et son identité, Acte du septième Colloque tenu à Sauveterre-de-Guyenne les 25 et 26 Septembre 1999, L’Entre-deuxMers et son identité, ed. William Blake & Co, Bordeaux, Octobre 2000, p.72
Fig. 6_ Les caractéristiques de la bastide Réalisé en Novembre 2017 d’après une carte postale de Créon dans les années 80, Archives municipales Détails
3
4
La bastide de Créon est fondée en 1315 grâce à un contrat de paréage entre le Roi d’Angleterre (à l’époque la région était anglaise) et le Sénéchal d’Aquitaine Amaury de Craon. D’après l’interprétation de la charte des coutumes par Gabriel Loirette, on sait que la bastide est créée sur un territoire de l’abbaye de La Sauve-Majeure concédé au sénéchal de Guyenne dans l’espérance de résoudre des problèmes internes de la ville. En plus de négocier avec le prieur de La Sauve-Majeure, le sénéchal cherche à obtenir l’accord des seigneurs voisins pour initier la construction de la ville neuve. D’après la société archéologique de l’Entre-Deux-Mers la fondation prend appui sur une charte des coutumes (voir Annexe 2 p. 132) qui établit le fonctionnement fiscal, social et urbain de la bastide23. Nous nous demanderons en quoi l’établissement de cette charte des coutumes a un impact sur la permanence de la structure de la cité. 2
1
3
4
5
6
20
Malgré une morphologie affirmée, le village a changé de visage au XXIe siècle suite aux évolutions des modes de vie de l’ère postindustrielle. L’extension urbaine qui multiplie la surface construite de la ville déploie le tissu urbain hors les murs de la fortification de la bastide (voir Fig 7).
Fig. 7_ Vue aérienne de Créon en 2015 Archives municipales Zone du tissu urbain de la bastide d’origine Zone du tissu urbain de Créon «hors les murs»
Le questionnement porte sur la transmission du dispositif urbain d’origine de la bastide de Créon à savoir si la permanence d’une structure viaire et parcellaire, relève-t-elle d’un héritage médiéval ? En d’autres termes, s’il est possible, au XXIe siècle, de déterminer si la ville de Créon a évolué en conservant des traces d’un modèle urbain déterminé, et comment cette permanence est elle interprétée aujourd’hui.
21
Afin de comprendre les enjeux de la permanence du modèle urbain, la démarche est fondée sur une approche cartographique du site à différente échelles, allant de la région jusqu’au centrebourg de la ville. Une comparaison de cartes permet l’analyse comparera le village du XIXe siècle à celui d’aujourd’hui pour souligner les continuités et discontinuités entre le village médiéval et la ville périurbaine actuelle. Ces outils qui illustrent le propos du mémoire permettent l’aller-retour entre deux temporalités, l’une dans les années cinquante, lorsque l’étendue du village de Créon se résumait à l’intérieur des fortifications de la bastide, et l’autre, lorsque l’étalement urbain de la métropole bordelaise se greffe au centre ancien. Pour structurer le propos, il est essentiel de définir en premier temps, la valeur de la bastide, en quoi sa fondation, durant le MoyenÂge, va donner lieu à un système remarquable d’urbanisme. Nous définirons tout d’abord l’interaction de la bastide avec son territoire et le rôle des tracés dans lesquels elle s’inscrit. Les questionnements porteront sur la fonction de ces tracés à amorcer puis à définir la permanence des voiries de la cité malgré ses transformations dans le temps. Dans ce propos nous développerons la notion de trame et son impact sur l’évolution de la bastide en terme d’espaces publics et d’espaces bâtis. Ainsi, un corpus de références permet de définir la bastide comme patrimoine médiéval. Dans un deuxième temps, les divisions parcellaires et leurs traces feront l’objet d’études pour comprendre, si elles sont toujours les marques de l’époque de la fondation et comment elles sont retranscrites aujourd’hui. Un questionnement est formulé concernant la notion de trace. L’étude des interventions urbaines de ces dernières années permet de dévoiler la capacité ou non de la bastide à évoluer tout en transmettant son héritage parcellaire.
Chapitre I_
Réseau viaire et tracés
Fig_1 (à gauche) Partie du plan des réseaux viaires au XIXe siècle. Source : cadastre napoléonien, cadastre. gouv Fig_2 (à droite) Partie du plan des réseaux viaires au XXIe siècle. Source : cadastre actuel, cadastre.gouv
24
I
Réseau viaire et tracés
Il existe plusieurs types de bastides répertoriées par le Centre d’Étude des Bastides. Situées sur une crête (voir Annexe 3 p. 133), bordées par une rivière ou implantées dans une plaine, elles expriment par leur localisation un besoin précis qui motive leur création. Il est intéressant de considérer cet aspect car, malgré ces différences, elles conservent toutes des similitudes dans leur plan.1 Actuellement la Gironde compte huit bastides. La totalité se trouve dans une région appelée l’Entre-Deux-Mers située entre la Garonne et la Dordogne (voir Fig. 3) Créon se situe sur les hauteurs du plateau de l’Entre-Deux-Mers à environ 110 mètres d’altitude (voir Fig. 4_). Compte tenu de sa position en hauteur et du fait qu’elle soit encerclée d’eau on peut penser qu’elle est la conséquence d’un choix géographique stratégique. Autrement dit, de nombreuses barrières naturelles vont rendre difficile son accès en dehors des chemins prévus à cet effet. En outre, elle s’inscrit dans un réseau de villes existantes dont une partie sont des bastides. Entre elles, elles jouent un rôle de protection de la capitale de la région, Bordeaux. En déduisant les tracés originaux de l’analyse des compositions viaires sur les deux derniers siècles, nous cherchons à comprendre si les tracés de la bastide jouent un rôle dans la permanence de sa morphologie urbaine. Et, au regard de ses traces, comment la cité de Créon a-t-elle pu interpréter les tracés du fondateur pour transmettre l’héritage médiéval de sa bastide?
1_ LAVEDAN Pierre, Qu’est-ce que l’urbanisme ? Introduction à l’histoire de l’urbanisme, ed. Histoire de l’urbanisme, I, Antiquité, Moyen âge; II, Renaissance et Temps modernes, 2 vol., Paris, 1941, p.15
25
Gironde
Océan Atlantique Bordeaux
Libourne Créon
Cadillac
DORDOGNE Sainte-Foy-La-Grande
Blasimon Pellegrue
Sauveterre-de-Guyenne Monségur
Entre-Deux-Mers
E NN RO GA
Forêt des Landes
Agen Mont-de-Marsan
Fig. 3_ Plan de situation géographique des huits bastides de l’EntreDeux-Mers en Gironde
Dax Bayonne Biarritz
Villes bastides Grandes villes
Toulouse 10km Do r
110m
d ogn e
92m 73m
Bordeaux
36m
Gar 40km o
18m
Créon
0m
n
ne
Fig. 4_ Plan de situation topographique de Créon en Entre-DeuxMers. Réalisé le 20 Octobre 2017 d’après Google maps
54m
10km
26
1_ L’expression du pouvoir politique: s’implanter ex-nihilo a_ La rigueur de la fondation comme résistance aux pouvoirs médiévaux À partir du XIe siècle, la France connaît une forte augmentation démographique, notamment dans le Sud-Ouest. Les agents royaux relèvent que la population française gagne plus d’un million d’habitants entre le XIIIe et le XIVe siècle4. À l’époque, les familles qui vivaient en milieu rural disposaient de tenures5 qui ne répondaient plus aux besoins alimentaires de par leurs dimensions trop modestes. L’essor démographique a permis de stimuler la croissance urbaine et a provoqué une réorganisation de l’espace rural. Dans la majeure partie des cas, les bastides sont implantées en milieu rural, comme celle de Créon. La bastide anglaise s’inscrit dans une création groupée de bastides au sein de la région. Nous précisons que d’un point de vue urbain, les bastides anglaises ne possèdent aucune caractéristique qui les différencient des bastides françaises. Il est possible de (voir Fig. 5) que les bastides de différentes origines s’entremêlent sur un même territoire. D’après cette constatation, nous pouvons déduire que le modèle de la bastide prédomine sur la gouvernance à l’origine de sa création. Aucun vestige antérieur à la date de fondation de la cité ne prouve que Créon a été fondé à partir d’un base existante. La fondation ex-nihilo6 de la ville pose question lorsque que l’on perçoit sa forme. En d’autres termes, l’intention de la création d’une nouvelle forme urbaine apparaît en milieu rural, dans un contexte où l’espace ne semble pas être restreint, comme une mutualisation du
4_ BERNARD Gilles, L’aventure des Bastides, ed. Privat, Mai 1993, p.19 5_ Terres concédées par un seigneur qui accordait au «tenancier» la jouissance des lieux mais en conservait la propriété. DUBOURG Jacques, Histoire des bastides, Les villes neuves du Moyen-Âge, ed. SudOuest, col. Références, Luçon, 2002, p.112
6_ À partir de rien
27 Bastides anglaises (1266-1324)
Fig 5_ Les différentes origines de fondation des bastides et leur période de création.
Bastides anglaises (1268-1324) Bastide anglaise
Les quatre-vingts bastides sont conçues sous l’occupation anglaise en Aquitaine sur une période de moins de 60 ans. Nous constatons qu’une fédération entre les cités permet de dégager une tâche d’implantation précise qui contourne la forêt des Landes qui est un désert à cette époque. De plus, les bastides s’implantent à proximité de fleuves dans des zones fertiles. Ainsi, en choisissant un terrain fertile, proche de cours d’eau pour dynamiser l’économie, la prospérité des centres urbain est engagée.
Bastide de Raymond VII Bastide d’Alphonse de Poitiers
Zone d’implantation des bastides anglaises
Limites de la forêt des Landes plantée au XVIIIe siècle
Créon s’inscrit au NordOuest de la zone d’implantation. Réalisé en Novembre 2017, d’après CLEM, L’Entre-deux-Mers et son identité, ed. William Blake & Co, Bordeaux, Octobre 2000, p. 32
Créon Gironde
50km Bastides de Raymond VIIVII (1222-1249) Bastides de Raymond (1222-1249) 50km
Bastides d’Alphonse de Poitiers (1250-1270)
Bastides d’Alphonse de Poitier (1250-1270)
250 km
500km
Gironde
Gironde
http://www.sudouest. fr/2017/08/17/pourquoia-t-on-plante-la-foret-deslandes-3701586-3390.php Fig 6_ Carte de la France et situation de la zone d’analyse
50km
50km
Bastides anglaises (1266-1324)
Bastides Royales françaises (1270-1373)
28
bâti dans une enceinte fortifiée. Aujourd’hui, pour comprendre la portée de l’héritage d’une bastide, nous estimons qu’il est nécessaire d’assimiler les mécanismes de fondation de ces cités à leur relation au territoire. D’après le CEB, les bastides représentent un nouveau type d’établissement urbain qui subsiste à l’ordre féodal à l’inverse des castelnaux, sous la protection d’un château ou des sauvetés, sous la protection d’un établissement ecclésiastique. Ainsi, elles structurent le monde rural grâce à une organisation politique plus complexe basée sur une relation tripartite entre une seigneurie locale, son suzerain et une communauté d’habitants présents sur le site ou attirés par les privilèges et avantages que leur offraient ces villes nouvelles. C’est en favorisant l’émergence d’une société civile cherchant à se libérer des tutelles féodales et cléricales que le pouvoir royal va s’affermir et transformer un monde rural jusque là dispersé en lui associant une armature de villages et de bourgs autour de laquelle il va se fédérer.8 L’appui de la fondation de la bastide sur les villes existante nous permet d’émettre l’hypothèse, dans la volonté de fondation, d’un raisonnement par contraste. C’est-à-dire un choix de s’implanter ex-nihilo, tout en étant proche d’une cité existante qui lui permet d’établir une différence et de développer un fonctionnement propre. Quelle est l’influence de la bastide au regard de l’ensemble des villes médiévales ? À Créon, la proximité avec le bourg de La Sauve Majeure (environ trois kilomètres) (voir Fig. 7) s’explique par plusieurs raisons qui décrivent une situation paradoxale. Tout d’abord, la fondation
8_ Centre d’étude des bastides, Les cahiers du C.E.B., Centre d’Étude des Bastides N°6, 2002, p.21
9_ DUBOURG Jacques, Histoire des bastides: les villes neuves du MoyenÂge, ed. Sud-Ouest, Bordeaux, col. Référence, Novembre 2002, p. 70
Fig. 6_ Les villes en Entre-Deux-Mers au XIV ème siècle, réalisation Novembre 2017 d’après le Livre Blanc des Bastides
29
Entre-Deux-Mers Blaye
Arcins
Arsac
Bourg
Macau E GARONN
Blanquefort
Fronsac
Libourne Saint-Emilion E GN DO R DO
Arveyres
Vayres
Bordeaux
Créon
Rauzan
La Sauve Targon
Sauveterrede-Guyenne
Sainte-Foy-La-Grande
Pujols
Blasimon
Gensac
Castelmoron d’Albret Landerrouat Pellegrue Sainte-Ferme
Rions
De l’empire Romain à l’an mil: Civitas Agglomération présente en l’an mil
Créations ecclésistiques
Le Puy
Cadillac Saint Macaire
Gironde/Dropt Caudrot
La Réole Lamothe
Sauvetés Bourgs monastiques Commanderies templières
Créations seigneuriales Bourgs castraux
Bastides Bastide reconnue Bastide en cours de recherche
10km
Aubiac Bazas
Taillecavat
Monségur
Aillas
30
de la bastide s’affranchit des dépendances extérieures. De plus, la sauveté prospère depuis le XIe siècle. D’après le Centre de Liaison de l’Entre-deux-Mers il est difficile de justifier cette juxtaposition, de deux noyaux d’habitat par d’autres raisons que la rivalité et la neutralisation. Ces deux raisons trouvent leur sens plus tard lorsque la ville bastide voit grandir son influence sur son territoire tandis que le bourg abbatial perd de sa popularité.9 Nous déduisons que la bastide, en tant que modèle urbain apparaît en concurrence de la Sauveté et va prouver qu’à cette époque, une ville a un avantage de prospérer en développant son aspect économique au détriment de son aspect ecclésiastique. Nous pouvons ainsi penser que les choix idéologiques de la fondation de Créon sont accompagnés d’une volonté d’étendre l’influence de ses foires et marchés pour concurrencer l’emprise existante de la sauveté limitrophe. L’importance de la ville ecclésiastique, fondée deux siècles plus tôt que la bastide, montre que les territoires influencés par les prieurés de La Sauve-Majeure s’étendent au-delà du pays (voir Annexe 4 p.134), quel que soit leur pouvoir politique. D’après le moine Etienne Delaura, nous savons que l’abbaye de la SauveMajeure atteint son apogée d’influence au début du XIVe siècle10. Nous pouvons supposer que la fondation de la bastide en 1315 est un des facteur qui a participé à la perte de popularité de la sauveté. L’implantation de la ville bastide organise le territoire par une mise en tension de deux manières de raisonner la ville, l’une autour de la religion, l’autre autour de l’économie. L’essor des villes bastides instaure une qualité de vie durable et prisée ; Créon acquiert une notoriété supérieure au bourg abbatial de La Sauve Majeure. Nous comprenons alors que la reconnaissance des bastides a une ampleur internationale.
9_ CLEM (Centre de Liaison de l’Entredeux-Mers), L’Entredeux-Mers et son identité, Acte du septième Colloque, L’Entre-deux-Mers et son identité, ed. William Blake & Co, Octobre 2000, p. 96
10_ DUCLOT, LARCHÉ, TILLET, Histoire de l’abbaye de la Sauve Majeure par frère Etienne Dulaura Entre-deux-mers 1683, Tome II (transcription des livres IV et V), ed. de l’EntreDeux-Mers, Fondation d’Entreprise pour la connaissance de la Guyenne bordelaise (FELD), col. Archives et chroniques de l’EntreDeux-Mers, 2004, Bordeaux, p.275
31
Ainsi, nous pouvons penser que l’idéologie politique adoptée dans la fondation de la bastide a une vocation innovante pour son époque en s’émancipant des pouvoirs médiévaux réprimant. L’ambition de la bastide réside dans la génération d’un noyau de commerce. La volonté de s’implanter sans autre point d’attache que dans une logique de rivalité avec des noyaux urbains sous pression seigneuriale ou ecclésiastique démontre que l’idéologie des bastides s’inscrit dans une volonté de concurrence affranchie des pouvoirs féodaux et religieux, novatrice au fonctionnement médiéval. En quoi la structure de la bastide est-elle innovante ?
11_ HEERS Jacques, La ville au Moyen-Âge, ed. Fayard, Octobre 1990, Saint-AmandMontrond, p.130
La recherche concernant les bastides mène à une notion récurrente: l’innovation. Cependant, l’adoption d’un schéma idéal que traduit le plan hypodamien de la ville neuve était déjà utilisé à l’Antiquité11. Le caractère novateur de la bastide réside principalement dans la volonté de fondation qui va à l’encontre, encore une fois des principes urbains médiévaux (voir Fig. 7 et 8 p.30). En effet, si l’on compare Créon, à Saint-Macaire, une ville médiévale fondée au XIIIe siècle en Gironde, nous pouvons observer une discordance des plans surtout dans leurs géométries respectives. Saint-Macaire, bourg ecclésiastique, décrit un plan qui prend en compte plusieurs paramètres. Nous pouvons conjecturer que la géographie détermine la forme longitudinale du bourg sachant que la route qui suit la Garonne fonctionne comme l’axe générateur de la cité. Cependant, cet axe effectue une courbe de sorte à créer une convergence du plan vers l’église. Les îlots de formes aléatoire sont divisés en parcelles en lanières et semblent rayonner autour du symbole religieux. Au regard du réseaux viaire, nous pouvons déterminer que le maillage
32
urbain se résume en un plan concentrique de rues organiques. La trace des fortifications de Saint-Macaire crée une barrière entre la ville et le fleuve, elle témoigne d’une logique défensive médiévale, à savoir se protéger des éléments de liaison tout en s’implantant sur une zone privilégiée, dans ce cas, la butte. En comparaison, Créon suit un plan régulier, les rues rectilignes dessinent un plan en damier dont la fortification supposée était le seul élément courbe de la composition. Le rayonnement de la place centrale s’effectue à travers la linéarité des axes. Ainsi, nous pouvons souligner que le dessin du plan témoigne d’une innovation lorsqu’il est confronté aux cités médiévales caractéristiques. Cependant, nous pouvons remettre en question la relation entre la volonté d’équité de la fondation et le résultat du dessin urbain. Le principe de régularité mis en place, très systématique ne cherche pas à établir une relation entre le bâti et le viaire qui s’inscrit dans ces principes d’égalité. Le tracé détermine une volonté à l’échelle urbaine qui n’est pas perceptible dans la façon d’habiter la ville. Nous expliquons ce point en deuxième partie. Pourquoi la morphologie urbaine de la bastide semble nier son contexte? En 1948, Charles Higounet, géohistorien spécialiste des bastides, établit une analyse cartographique dans laquelle il constate que de nombreuses bastides avait été implantées en zone frontalière, il avance alors l’idée selon laquelle certaines d’entre-elles ont été fondées dans un but militaire et stratégique12. Cependant, en 1954, l’historien J.P. Trabut-Cussac s’oppose avec véhémence à cette théorie selon lui, «On ne saurait accorder crédit plus longtemps à une explication militaire, même partielle, de l’origine des bastides
12_ HIGOUNET Charles, Bastides et frontières, Le MoyenÂge, 1948, pp 113120
33 Fig. 7_ Plan du réseau viaire de Saint-Macaire organisé autour de l’église située sur le point culminant du village Réalisé en Novembre 2017 d’après Géoportail
Fortifications Tracés Site privilégié générateur Principe d’influence du site privilégié sur le dessin de la cité
100m
Fig. 8_ Plan du réseau viaire de Créon organisé orthogonalement autour de la place marchande Réalisé en Novembre 2017 d’après Géoportail
100m
34
élevées dans un dessein essentiellement politique et administratif, accessoirement financier, les bastides n’étaient pas à l’origine des forteresses.»13 Bien que les hypothèses des historiens divergent, nous pouvons supposer que la concentration du bâti en bastide peut s’expliquer par une volonté de contrôle, renforcée par une population restreinte (environ 500 habitants). Ainsi, il est plus aisé de faire respecter les devoirs de la cité aux habitants. Créon est une bastide de plaine qui ne dévoile aucune trace de volonté défensive hormis dans son plan. L’enceinte de la ville, une fortification, constituée d’au moins une palissade en bois et d’un fossé14, joue un rôle avant tout financier et non pas défensif. Elle compte quatre portes qui régulent les entrées des axes principaux. Un chemin de ronde derrière la fortification dessine l’unique circulation non orthogonale de la cité (voir Fig. 9). On cherche alors à comprendre l’objectif de la mutualisation de l’habitat au XIVe siècle. Lors de sa venue en Entre-Deux-Mers, en 1314, Amaury de Craon officialise la localisation de la bastide au croisement de deux routes. Il s’engage à implanter sa ville neuve sur une superficie de 1800 acres (soit 7,23km2). L’année suivante c’est un arpenteur qui est chargé de tracer, sous la protection des soldats, un cercle de 800 pieds de rayon (soit 243m) en choisissant un vieux chêne, proche du carrefour, comme point de départ. Il a délimité rigoureusement une place carrée de 200 pieds de côté (soit 61m) et dessine des rues principales Nord-Sud et Est-Ouest qui passeront sous des arcades conçues pour une circulation efficace15. Nous pouvons remettre en question les pratiques de fondation
13_ CLEM (Centre de Liaison de l’Entredeux-Mers), L’Entredeux-Mers et son identité, Acte du septième Colloque, L’Entre-deux-Mers et son identité, ed. William Blake & Co, Octobre 2000, p. 91
14_ D’après JeanMarie Darmian, maire de Créon et président des villes bastides de Gironde, rencontré en Avril 2017
15_ Idem
35
car le tracé de la ville entière était réalisé par des arpenteurs et non pas des urbanistes. Autrement dit, ces derniers exécutaient des tracés directement issus d’un pouvoir politique influent en cherchant à introduire une volonté d’équité dans la ville neuve. Comment le pouvoir politique amorce une permanence dans la cité?
Chemin de ronde de la bastide Chemin de contournement de la cité Espace des fortifications d’après hypothèse
Fig. 9_ Plan de la bastide de Créon et des tracés en périphérie Réalisé en Novembre 2017, d’après Le CEB, Villes Neuves d’Europe du Moyenâge, Le Livre Blanc des Bastides, ed. Privat, Mai 1993, p.25
50m
36
L’implantation de la bastide est accompagnée de réflexions concernant la place de la religion dans l’urbanisme. Nous détectons que la majorité des plans des bastides, quelle que soit leur époque de fondation, présentent un rejet en second plan de l’église, institution religieuse, crainte à l’époque. Ces quatre plans (voir Fig. 10/11/12/13) décrivent des morphologies de bastides qui exposent une logique viaire centrée sur la place, où le centre religieux est en déséquilibre dans le plan. Malgré une intention forte qui induit la formation de la ville sur le chemin d’une idéologie laïque, la religion a toujours une place dans la bastide. De plus, l’espace public dédié à l’église, qualifié de parvis, est nettement moins important, nous pouvons l’interpréter comme une intention de privilégier les relations socio-économique et non pas ecclésiastiques. Ces observations nous permettent de déduire que c’est au moyen d’une morphologie urbaine qui privilégie les rapports sociaux-
Fig. 10 _ Plan de la bastide de Libourne (Gironde 33) Fondée en 1270 Réalisée en Novembre 2017 d’après les Cahiers du Centre d’ d’É Étude É tude des Bastides Fig. 11 _ Plan de la bastide de Puybrun (Lot 46) Fondée en 1279 Réalisée en Novembre 2017 d’après les Cahiers du Centre d’Étude ’Étude des ’É Bastides Place centrale Église du village
Libourne
50m
Puybrun
100m
Parvis actuel d’accès à l’église
37
16_ Ce terme est employé en se référant à une époque donnée : le Moyen-Âge. Cette notion tournée vers l’avenir apparaît ici pour définir une rupture au contexte dans les principes de fondation de la bastide.
17_ Constat personnel
Fig. 12_ Plan de la bastide de Sauveterrede-Guyenne (Gironde 33) Fondée en 1281 Réalisée en Novembre 2017 d’après les Cahiers du Centre d’ d’É Étude É tude des Bastides
économiques que l’urbanisme de la bastide acquiert un caractère avant-gardiste16 dans le sens où le symbole de culte, socle de la fondation des villes, à l’époque, est déplacé en second plan. Toutefois, au fil du temps, l’intérêt religieux est décroissant à l’inverse de l’aspect économique qui lui, croît. C’est en ce sens que nous pensons que le terme ville neuve décrit une innovation justifiée autrement que par une nouvelle existence. Autrement dit, l’instauration de nouveaux principes matérialisés par un urbanisme différent interagissent comme l’association entre des réglementations sociales et une morphologie urbaine caractéristique : la bastide. À Créon, la place centrale exclut l’église et son parvis (voir Fig. 14 page 36) en dehors du “centre de gravité“ du plan. L’accès au bâtiment religieux s’effectue par un angle de l’espace principal de la ville. Cette circulation est vécue comme un lien peu évident entre deux espaces limitrophes. la relation diagonale rompt avec le plan orthogonal. L’église a une orientation qui butte rapidement contre les façades de la rue du Docteur Fauché. Ceci
Fig. 13_ Plan de la bastide de Bretenoux (Lot 46) Fondée en 1277 Réalisée en Novembre 2017 d’après les Cahiers du Centre d’Étude ’Étude des Bastides ’É
Bretenoux
100m
Sauveterre-de-Guyenne
50m
38 Les arcades
Église Notre Dame de Créon
Place de la Prévôté
Mairie
teur u Doc Rue d é Fauch
Place de la Prévôté
Une politique déterminante dans la construction d’un
Créon
modèle urbain durable
100m 100m 100m
se Notre
Place de la
e de Créon
Prévôté
Mairie
LAÏCITÉ
I
Fig. 14_ Diagramme des différents plans bâtis, Vue haute depuis la place de la Prévôté, Créon, Réalisé en Octobre 2017 Fig. 16_ Plan de la bastide de Créon Réalisée en Novembre 2017 d’après les Cahiers du Centre d’étude des Bastides
39
18_ Mairie de Créon et Société Archéologique et Historique du Créonnais, Créon, De la fondation de la bastide au XXIème siècle, Mai 2015, 207 p.
Fig. 15_ Diagramme
d’une vue piétonne depuis la place de la prévôté à Créon vers l’église. On voit que le bâti institutionnel et commercial est plus important que le bâti religieux rejeté en second plan de l’espace privilégié dans l’organisation urbaine.
montre que la logique urbaine a évolué, c’est-à-dire que d’autres centres d’intérêts que les repères religieux sont privilégiés dans ce dispositif de villes neuves18. À l’échelle du piéton (voir Fig. 15), l’espace fermé de la place est en relation directe avec le bâtiment administratif, la mairie, ancienne prévôté et le bâti marchand. Si nous considérons le dessin en plan et le ressenti du piéton, il est possible de détecter une cohérence qui se rattache toujours à la volonté d’ordonner l’espace selon des priorités d’usage : la bastide met en place son socle administratif et marchand. Cet établissement assure une stabilité de la ville. L’un par la réglementation, l’autre par le développement économique de la cité.
Bâti marchand
Église
Mairie : Institution de la ville
Place de la Prévôté
40
Grâce à quels dispositifs la bastide génère une permanence ? b_ L’autonomie de la bastide : Une permanence amorcée
La régularité des tracés de la bastide est accompagnée d’une récurrence dans son fonctionnement. La date de fondation d’une bastide s’associe à un événement unique : l’authentification de la charte des coutumes par la cour ducale de Bordeaux. L’intitulé de cette charte est évocateur dans le sens où une volonté de permanence voit le jour, dès la création de ces cités médiévales, avant même qu’elle ne «fonctionnent»18. Un édit de Westminster confirme la charte, c’est le seul document qu’il reste aujourd’hui comme preuve de la fondation19. La charte des coutumes établit le fonctionnement de la bastide en détail. Des perceptions financières régulées La création des bastides reflète souvent d’arrières-pensées financières de la part de leurs fondateurs. Au XIe siècle, à Créon, un système de péage, aux portes de la ville, permet de percevoir des revenus en plus des taxes sur les terrains de la bastide. Les poblans étaient tenus de payer une redevance, appelée cens, pour les emplacements de la maison, du jardin et des terres cultivables dont ils disposaient.20 Ces impositions témoignent d’une mise en place stricte d’une réglementation propre à la bastide. Nous pouvons en déduire que la charte des coutumes favorise l’établissement d’une relation entre un type d’urbanisme et son fonctionnement.
18_ Dans le sens où la vie n’existe pas encore dans ces centres de population et où l’on ne sait pas si le système sera viable.
19_ DUBOURG Jacques, Histoire des bastides: les villes neuves du Moyen-Âge, ed. SudOuest, Bordeaux, col. Référence, Novembre 2002, p.98
20_Idem
41
Instaurer des traditions
21_Ibidem p.38
22_Témoignage d’un habitant de Camblanes, à 15km de Créon, âgé de 65 ans (Août 2017)
En participant au mouvement des bastides, les hauts personnages fondateurs espèrent aussi développer le commerce. Toutes les semaines, comme énoncé dans la charte des coutumes, le marché s’installe sur la place centrale. Ce jour, a été choisi par le sénéchal fondateur, en laissant le lundi libre pour le marché de La Sauve-Majeure. L’organisation de ces marchés était favorisée par l’existence de nouvelles voies de communication qui procuraient des profits importants aux fondateurs. Ces nouvelles occasions de percevoir des droits étaient mentionnées dans la charte de 1315. Sur les marchés, les habitants étaient exonérés des charges tandis que les étrangers devaient s’acquitter de redevances. Ils devaient régler un péage pour entreposer leurs marchandises, puis un droit de leude pour les marchandises vendues.21 Le commerce intérieur de Créon motive la création de nouvelles routes pour faciliter l’accès à des produits dont on ne dispose pas sur place. Les foires et les marchés présentent des avantages qui favorisent les échanges entre les habitants de la bastide et les gens extérieurs. C’est l’occasion privilégiée qui offre une animation hebdomadaire à l’agglomération et permet la circulation de nombreuses denrées. Les foires se tenaient une à deux fois par an, selon l’importance de la bastide. Aujourd’hui encore, dans les villages aux alentours de Créon, les gens se souviennent de l’importance de la foire de la bastide cinquante ans auparavant «On allait à Créon pour acheter les cochons lors des grandes occasions»22.
42
D’après les historiens, les échanges effectués sur les foires et les marchés étaient contrôlés par les fondateurs qui mettaient au point une réglementation précise au sujet des droits de leude, des fraudes ou des taxes acquittées pour la traversée de la ville. Certaines bastides sont fondées à partir même de manifestations commerciales existante (Puyguilhem en Dordogne) «faire une bastide close en le marché, hors le château»23. La condition économique est si importante dans la fondation qu’elle est parfois même, non pas sa raison d’être mais au contraire sa matière première. Bien que les voies de circulation ne soient pas nombreuses, les marchands colporteurs redonnent une animation aux routes de France. Les croisades ont accéléré les processus d’ouverture de voies maritimes qui partaient notamment du port de Bordeaux. «Sans aspirer vraiment à un développement des grands courants internationaux, les créateurs des bastides ont pressenti l’accroisse-
23_HIGOUNET-NADAL Arlette, Histoire du Périgrd, Privat, Toulouse, 1983, p.34
Fig 16_ Photographie du marché de Créon le mercredi matin en été Réalisée en Août 2017
43
24_ DUBOURG Jacques, Histoire des bastides: les villes neuves du MoyenÂge, ed. Sud-Ouest, Bordeaux, col. Référence, Novembre 2002, p.98
ment des échanges extérieurs que pouvait susciter l’édification de nouveaux villages»24. Cette connotation d’avant-gardisme est justifiée par plusieurs aspects établit par l’organisation de la bastide; la volonté d’expansion économique est le socle de cette permanence. L’instauration d’événements cycliques participe à une certaine pérennité de la morphologie urbaine. Le fait d’entretenir une tradition qui perdure, comme celle du jour du marché (voir Fig. 16 et 17), entraîne des répercussion sur le maintien des dispositifs urbains d’origine. Par leur durée, il attribue une valeur aux traditions. Pour que ces rites prospèrent, l’autonomie de la bastide repose sur un élément important : s’intégrer à un réseau de communication efficace pour que les populations continuent de faire perdurer les coutumes.
Fig 17_ Photographie du marché de Créon le mercredi matin en hiver Réalisée en Décembre 2017
44
2_ Le maillage territorial: la mise en réseau des cités a_ Un territoire existant avantageux à la croisée des chemins Au XIVème siècle, Bordeaux est déjà la capitale de la région, le duché de Guyenne (voir Fig. 17) qui appartient aux anglais, depuis près de deux-cent ans lors de l’alliance entre Aliénor d’Aquitaine et la famille Plantagenêt héritière de la couronne anglaise. La ville d’importance portuaire s’inscrit dans un maillage de voies économiques étendu sur plusieurs continents notamment ceux du commerce triangulaire, l’Europe, l’Afrique et l’Amérique. Charles Higounet justifiait l’implantation des bastides anglaises par la volonté de protéger Bordeaux alors capitale du territoire aquitain anglais26. Nous remarquons que Créon est implantée sur un site stratégique de son territoire. Entourée par deux fleuves, sur un point culminant à plus de 100m d’altitude, hauteur faible mais considérable dans un contexte où la topographie s’approche du niveau de la mer. Elle bénéficie d’une proximité avec la côte Atlantique (une petite centaine de kilomètres par la route). Le ville est entourée de la grande forêt de la Silva Major. D’un point de vue géographique, à l’abri des invasions, la bastide de Créon s’inscrit dans un contexte favorable à sa prospérité. D’après l’interprétation de «la charte des coutumes de Créon de Gabriel Loirette en 1952, «la situation de la bastide montre clairement sa mission et son caractère. A l’Ouest de la ligne de défense formée par Sainte-Foy-la- Grande, fondée par Alphonse de Poitiers en 1255-1256, par Pellegrue et Sauveterre, fondées par Edouard en 1281 et en 1283, et par la place forte de La Réole, qui défend
26_HIGOUNET-NADAL Arlette, Histoire du Périgrd, Privat, Toulouse, 1983, p.34
Fig 17_ Carte du territoire du duché de Guyenne avec les départements actuels Réalisée en Septembre 2017, d’après https:// commons.wikimedia. org/wiki/File:Carte_ de_la_Guyenne.svg
45
250 km
200km
Créon
50km
46
les abords de Bordeaux par la vallée de la Garonne, il n’existait pas au début du XIV siècle de lieu fortifié de Sauveterre à Bordeaux. L’accès de Bordeaux n’était pas défendu à l’Est et le plateau de l’Entre-Deux-Mers pouvait être un chemin d’invasion. Il n’est donc pas étonnant qu’Edouard, conseillé par ses sénéchaux, ait voulu combler ce vide en fondant la bastide de Créon en 1315. De ce fait, Créon s’est insérée dans le dispositif militaire de la Guienne (ancien nom de la Guyenne au XIVème siècle). Mais, taillée aussi dans une clairière de la Silva major, elle a été en même temps un nouveau centre de peuplement et de mise en valeur.»25 La fondation de la ville bastide pose question quant à son origine et les historiens partagent plusieurs interprétations de son existence. Cependant, la morphologie de son urbanisme nous permet de détecter une volonté d’instaurer une logique affirmée encore lisible aujourd’hui. La bastide n’est pas un modèle urbain, exclusivement français, ce qui montre qu’elle n’est pas le fruit d’une décision politique territoriale (voir Annexe 5 p.135). La Gironde en compte huit. La totalité se trouve dans une région appelée l’Entre-Deux-Mers située entre la Garonne et la Dordogne. Considérée au Moyen-Âge comme une zone marginale, Créon est aujourd’hui une ville d’influence de cette zone26. On peut supposer que ce choix de territoire est motivé par les raisons géographiques avantageuses mais aussi par la proximité de certaines villes. On remarque en effet aujourd’hui que la plupart des bastides sont devenues chef-lieu de Canton, résultante de leur succès et de leur permanence, elles marquent le territoire par une influence toujours en vigueur dans les zones urbaines, périurbaine, et majoritairement rurale27. La répartition des
25_ LOIRETTE Gabriel, La charte des coutumes de la ville de Créon Annales du Midi : revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale, vol.64, n°20, Toulouse, 1952, p. 284
26_ Ville d’influence dans le sens où elle mutualise un grand nombre de centres d’intérêts et d’infrastructures destinés à accueillir les populations de l’Entre-DeuxMers 27_ D’après Pierre Simon, historien (Septembre 2017)
47
juridictions de l’Entre-Deux-Mers au XIIIe siècle (voir Annexe 6 p.136) indique que la prévôté de Créon domine une grande partie du territoire, les juridictions ecclésiastiques s’imposent sur des territoires restreints noyés par les territoires de seigneuries laïques ou de prévôtés ducales. L’Entre-Deux-Mers connaît une évolution dans le maillage territoirial où les bastides commencent à imposer leur pouvoir politique en tant que siège de juridiction.
27_ DUBOURG Jacques, Histoire des bastides: les villes neuves du MoyenÂge, ed. Sud-Ouest, Bordeaux, col. Référence, Novembre 2002, p.104
La situation d’un village près d’un autre village, le long d’un itinéraire très fréquenté, ou mieux, à un croisement de routes important, est généralement un gage de prospérité. Ce facteur est pris en considération par les diverses autorités fondatrices27. La création d’une nouvelle structure urbaine impacte l’échelle territoriale par une fédération involontaire d’un modèle répliqué qui instaure des principes en rupture avec l’époque. Les principes de fondation de ces cités font preuve d’une ouverture politique démocratique, à l’heure où le pouvoir est absolu et où l’inégalité sociale reste fondée sur des privilèges innés réservés à la noblesse. Nous pouvons penser que l’intention de transgresser les normes sociales et urbaines établie au Moyen-Âge vont avoir un rôle dans la permanence des tracé de la bastide. Quelles relations la bastide de Créon entretient-elle avec les grandes villes à proximité ? À l’échelle territoriale, le réseau viaire montre que la bastide est implantée au carrefour de deux grands axes (voir Fig.18 p.47). À la croisée des chemins de Bordeaux à Sauveterre-de-Guyenne et de Libourne à Cadillac, l’implantation de la bastide choisit un site
48
stratégique concernant les distances qui la sépare des autres cités. Elle se situe à une équidistance des grandes villes. Les raisons de ce choix sont motivées par la facilité d’accès occasionnée par la volonté de créer une cité économique comme vu précédemment. Ainsi, les quatre portes de Créon dans la bastide reprennent les points cardinaux de ces quatre villes existantes. Chaque semaine, les villageois n’hésitaient pas à couvrir quelques lieues pour aller vendre à l’extérieur leur surplus de production agricole.28 Dans les années 1950, on trouve des pratiques similaires de voyageurs, de négociants ou de forains, venant passer un ou deux jours au cœur de la bastide pour participer au marché ou aux activités citadines29. Si la bastide de Créon s’appuie sur l’importance des grandes villes aux alentours pour s’intégrer au réseau viaire de l’Entre-DeuxMers, son implantation décrit une volonté d’isolation en la plaçant à une distance d’une vingtaine de kilomètres de chacune d’entre elles. Au Moyen-Âge, cette distance pouvait être parcourue en une heure et demi à cheval et en une demi journée de marche30, ce qui la rend particulièrement accessible pour son activité marchande. Même si son économie dépend beaucoup des apports extérieurs, elle garde tout de même une certaine distance et son organisation condensée témoigne de l’intention de construire un noyau fort isolé de l’extérieur. Nous pouvons imaginer que l’aspect économique de la cité induit une décision de fédération entre les cités pour mieux contrôler les mouvements sur les routes et avoir le dessus sur les Sauvetés et les villes Royales. Le choix du site implique donc une certaine autonomie de la ville, une organisation propre liée à une division du territoire. Tout en conservant une proximité à diverses ville. Ainsi, nous pouvons supposer que la permanence de la bastide est due à un fonctionnement autonome qui se fédère à d’autres villes prospères pour évoluer.
28_ DUBOURG Jacques, Histoire des bastides: les villes neuves du MoyenÂge, ed. Sud-Ouest, Bordeaux, col. Référence, Novembre 2002, p.106
30_ Moyenne calculer selon une allure de cheval de 15km/h et une allure de marche de 6 km/h
Fig. 18_ Carte schématique de l’EntreDeux-Mers, relation des distances entre Créon et ses quatre points cardinaux Réalisée en Octobre 2017, d’après Géoportail 10km
49
e enn Guy
Bordeaux
Dord
ogne
Libourne
20 km
Gironde
23 km
Entre-Deux-Mers
CrĂŠon 25k m
km 18
Cadillac Garonne
Sauveterrede-Guyenne
50
Les tracés viaires sont-ils facteurs de la permanence de la bastide ? Sur les quatre villes de référence, l’une d’entre elles est la plus importante d’Aquitaine encore aujourd’hui : Bordeaux. Les trois autres sont des bastides fondées antérieurement, entre 1270 et 1281. La comparaison des réseaux viaires entre une carte du XIXe siècle (voir Annexe 7 p.137) et du XXIe siècle permet de révéler une permanence dans les tracés viaires. Les tracés ont conservé une hiérarchie cohérente du réseau viaire qui définit une trame très marquée (voir Fig. 19 et 20). On distingue une reprise des axes principaux du XIXe siècle pour les transformer aujourd’hui en route ou en autoroute. Au fil des deux derniers siècles, le maillage territorial s’est complexifié mais on remarque que les principaux croisements se renforcent, par une augmentation des voiries, autour des mêmes villes qu’autrefois. Créon est toujours desservi par des axes importants menant directement aux villes d’influence, Bordeaux la préfecture ou Libourne la sous-préfecture. La bastide, aujourd’hui chef lieu de canton est aussi à proximité des axes rapides menant à l‘Espagne ou à la capitale française. Nous pouvons supposer que la qualité de la connexion de la bastide à son territoire est un facteur de croissance au long de ces sept siècles d’existence, à l’époque où la conquête du territoire s’associait à des réseaux viaires performants. Toutefois, cette facilité d’accessibilité peut aussi avoir un effet contraire et provoquer l’effacement de l’organisation médiévale si, d’un point de vue urbain, elle ne répond plus aux évolutions des modes de vie.
Fig. 19_ Carte de la Gironde au milieu du XIXe siècle Réalisée en Novembre 2017, d’après la Carte LEVASSEUR du département Atlas National illustré des 86 départements et des Possessions de La France divisé Pau arrondissements, cantons Et communea avec le tracé de toutes les routes, chemins de fer et canaux, ed. Combette, Paris, 1854
Fig. 20_ Carte de la Gironde au XXIe siècle Réalisée en Novembre 2017, d’après Géoportail 10km
51
Gironde Guyenne vers Paris
Libourne Sainte-FoyLa-Grande Bordeaux Créon
Blasimon Sauveterrede-Guyenne
Cadillac
Pellegrue
Montségur
Forêt des Landes vers Toulouse
vers l’Espagne
52
b_ Créon et son territoire aujourd’hui, bouleversements ou continuité des tracés ? Dans les superpositions des réseaux filaires31 de Créon au XIXe, XXe et XXIe siècle (voir Fig. 21, 22 et 23), nous pouvons remarquer que les tracés à l’intérieur de la bastide ne sont que peu modifiés. Ils conservent leur fonction, c’est-à-dire que les rues secondaires parallèles, desservent toujours les deux axes principaux, qui marquent les quatre entrées d’autrefois, lorsqu’ils coupent le chemin de ronde. Aujourd’hui les deux voies des axes principaux sont des routes départementales importantes la RD 671 (axe Est-Ouest) et la RD 20 (axe Nord-Sud). En outre, nous pouvons observer le passage du chemin de fer sur le plan du XXème siècle au Nord de Créon, malgré sa proximité immédiate à la cité, il ne franchit pas les limites de l’ancienne fortification, l’accès est direct, cependant il préserve la structure interne viaire de la bastide. Aujourd’hui, nous pouvons discerner la trace de cette voie ferrée, elle est matérialisée par une piste cyclable (voir Annexe 8 p.138) qui reprend le tracé sur plusieurs dizaines de kilomètres. Au XXe siècle, de nombreux réseaux apparaissent, pour connecter le centre médiéval à des lotissements en périphérie, ou encore à d’autres villages aux alentours. L’apparition de nouvelles voiries matérialise le succès du modèle urbain dans le temps. À l’échelle de la ville, l’attention portée à la permanence des tracés viaires, réside dans son utilisation. En effet, si l’on contraint les véhicules à utiliser la bastide en respectant les tracés médiévaux, il est difficile d’adapter la ville aux exigences contemporaines. Mais c’est ainsi que l’on initie la démarche de conservation d’une valeur de sept siècles passés. Au cours du temps, lorsque l’on cherche à améliorer l’accessibilité transversale à la bastide, les interventions sur les voiries suggèrent une volonté de respect par rapport à
31_ DOUADY Clément-Noël, De la trace à la trame : la voie, lecture du développement urbain, ed. L’Harmattan, Paris, 2014, 255p.
Fig. 21_ Réseau viaire proche _ Créon au XIXe siècle (1815) Réalisé d’après carte d’état Major
50km
54
la constitution originelle de la ville. Par exemple si l’on observe, des rues du plan orthogonal ont été prolongées pour passer du chemin de ronde au boulevard périphérique actuel. D’après l’Union des Villes Bastides de Gironde, nous savons que Créon a été pillée et incendiée en 133832, elle s’est ensuite dotée de portes en pierres et de palissades, dont il ne reste rien aujourd’hui. Mais lorsque l’on observe le plan, le chemin de ronde apparaît comme une évidence en tant que témoin de l’ancienne fortification. Au cours du temps, les actions liées à la volonté de préserver la bastide prédominent sur les modes de vie contemporains. Moyennant une succession de pouvoirs politiques sensibilisés à la valeur de la bastide et à une détermination à transmettre un héritage médiéval, il est encore possible de lire aujourd’hui un patrimoine facile à effacer de par sa fragilité. La trame viaire présente une autre particularité, celle de la deuxième couronne qui encercle Créon. Elle pose question quant à son émergence car elle est déjà partiellement présente sur les plans les plus anciens collectés (Plan d’État-Major, 1820-1866) (Voir fig. 24). Toutefois, nous pouvons observer sur le cadastre napoléonien (voir fig. 25), datant également du XIXe siècle que ce deuxième «périphérique» n’est pas représenté. On suppose alors que seule est représentée la fortification de Créon, repérée en orange sur le document, correspondant au chemin de ronde. Diverses traces permettent d’envisager que cette deuxième voie périphérique n’est pas un tracé original. Les rues secondaires du centre de la bastide ne sont pas toujours prolongées jusqu’à ce tracé, de manière à contrôler les entrées de la ville par les quatre portes. Une situation concomitante révèle la situation des fortifications : le tissu bâti à l’extérieur du chemin de ronde paraît imperméable compte tenu d’une organisation de bâtisses mitoyennes successives tournées, pour les plus anciennes, vers l’intérieur. De plus, le bâti localisé dans la frange entre les deux couronnes périphériques aujourd’hui, est
32_ Site internet de l’Union des bastides de Gironde, section Créon http://www. bastides33.fr/
55 Fig. 24_ Cadastre napoléonien, chemin de ronde et boulevard de Créon Réalisé en Novembre 2017 d’après le plan d’état major (18201866) 200m
Fig. 25_ Cadastre napoléonien, chemin de ronde de Créon Réalisé en Novembre 2017 d’après cadastre napoléonien
50m
56
composé en majorité d’équipements publics. Ils tranchent avec la logique de construction de la bastide et peuvent prouver qu’aucune construction antérieure n’était située dans cette zone. La morphologie d’une ville comprenant des fortifications est propre à la fabrication32 de la ville médiévale32. Aujourd’hui, le chemin de ronde est conservé, il est pourvu d’une piste cyclable mais il est peu fréquenté car il est très étroit. Le boulevard parallèle est celui emprunté par les voitures, en terme de circulation, ce sont les voies rectilignes qui détiennent le caractère prioritaire dans la majorité des cas, sinon, les carrefours ont été transformés en rond-points et la priorité est équivalente pour chacune des directions. Ainsi, en privilégiant le cheminement vers le centre du bourg, une logique d’identité de la bastide est respectée. En terme de circulation, les politiques de la ville s’orientent de plus en plus vers un respect du centre ancien en créant, des zones de rencontre, limitant la vitesse des véhicules qui se rapproche alors de l’allure des usagers à l’époque médiévale (voitures tractées par des chevaux). Après un oubli de l‘usage de la ville, aujourd’hui, les interventions tendent à être plus sensible à l’héritage transmit. Ainsi, il témoigne d’une logique de déplacement rectiligne au sein de la cité. Cette logique se raccorde à l’échelle du territoire et façonne la permanence d’une structure de voies de communication identitaires (voir lexique). La création d’une nouvelle structure urbaine impacte l’échelle territoriale par une fédération involontaire d’un modèle répliqué qui instaure des principes en rupture avec l’époque. Les principes de fondation de ces cités font preuve d’une ouverture politique démocratique, à l’heure où le pouvoir est absolu et où l’inégalité sociale reste fondée sur des privilèges innés réservés à la noblesse. Nous pouvons penser que l’intention de transgresser les normes sociales et urbaines établie au Moyen-Âge vont avoir un rôle dans la permanence des tracés de la bastide.
32_ Fabrication dans le sens où la bastide est créée à la manière d’un objet, dans son ensemble du tout au tout.
32_ Les ed. Cie,
LAVEDAN Pierre, villes françaises, Vincent, Fréal & Paris, 1960, p.95
57
3_ Le tracé des rues et des espaces publics : la trame adaptée
33_ DUBOURG Jacques, Histoire des bastides: les villes neuves du MoyenÂge, ed. Sud-Ouest, Bordeaux, col. Référence, Novembre 2002, p.179
En arpentant les rues de la bastide, il est possible de se rendre compte rapidement que les alignements des rues parallèles mènent à des perspectives choisies. La rue est le principe d’irrigation d’une ville, elle constitue une entité d’un ensemble qui définit un réseau viaire propre33. Ce réseau est significatif, en effet, il donne des informations sur la fonction précise des rues d’une ville. À Créon, le plan orthogonal exige des rues perpendiculaires entre elles. Ce quadrillage va de pair avec les nouvelles logiques urbaines liées à l’économie de la cité médiévale. a_ La hiérarchie des axes : une logique d’espaces publics Après avoir décidé du site de fondation de la bastide, des arpentins tracent les emplacements des rues, des limites et des fortifications de la cité par un marquage au sol. Nous connaissons aujourd’hui les procédés de cette “urbanisation subite“ grâce à des historiens retraçant le parcours de création du modèle urbain, notamment dans un document concernant la formation de Villefranched’Astarac dans le Gers : «...à un jour fixé, la bastide est dessinée sur le sol, au cordeau, dans tous ses détails : ses rues droites, parallèles et perpendiculaires les unes aux autres, aboutissent les unes aux autres et laissent au milieu de la place un quadrilatère...»33. Ainsi, dès sa fondation, la future ville bâtie n’aura pas l’opportunité de s’étendre et de s’accommoder selon les aléas des époques. On impose une trame qui obligera le tissu bâti à une certaine rigueur. En relevant ces constatations, une question se pose : La rigidité de l’organisation de la trame viaire est-il synonyme de sa permanence ?
58
Dès le XIVe siècle, les principes d’organisation viaire instaurent une hiérarchie dans laquelle chacune des rues possède un statut particulier : les rues de la bastides sont qualifiées selon leur usage (voir Annexe 9 p.139) Les axes principaux, les routes, sont ceux qui indiquent les quatre directions. Depuis leur création, ces tracés partent de la place centrale et filent au-delà des limites de la ville pour la connecter à des centres d’intérêts d’importance. Dans la ville on les détermine comme les carreyras34, il existe deux axes de cette importance à Créon : ceux qui découpent le plan en quatre en se coupant à l’angle de la place de la Prévôté et de l’église. La bastide possède trois degrés d’importance de ses voies de communication. Ces tracés filent au-delà des limites de la ville pour la connecter à des centres d’intérêts d’importance. Les deux axes générateurs de la bastide sont présents au XIXe siècle (voir fig.26), ils façonnent l’organisation urbaine avec une gradation très marquée dans la hiérarchie des tracés. Cette carte est le reflet de la permanence d’une époque, le Moyen-Âge. Le document, issu du cadastre napoléonien et du plan d’état Major, témoigne d’un respect des fonctions fondatrices attribuées à une composition de l’espace précise. Le graphique exposant la démographie créonnaise selon le temps montre qu’à cette période, la population totale de la cité correspond à la proportion d’origine (environ 500 habitants) cela explique pourquoi, hormis quelques constructions agricoles, la ville bâtie se restreint à l’intérieur de la bastide et fait prospérer son fonctionnement dans une logique de continuité. Au XXe siècle (voir fig. 27), la population commence à augmenter en passant à plus de 2500 habitants à la fin du siècle. La carte datant des années cinquante, révèle le début de l’urbanisation “hors les murs“34. Néanmoins, les nouveaux amas de bâtissent qui se
34_ BERNARD Gilles, L’aventure des Bastides, ed. Privat, Mai 1993, 155 p.
Limites de la ville Axes principaux Axes secondaires Carrérots et ruelles Affluants Bâti
Réalisé d’après cadastre.gouv (cadastre napoléonien et carte d’état major)
200m
nombre d’habitants à Créon
Fig. 26_ Plan de la hiérarchie du réseau viaire au XIXe siècle
5000 3750 2500 1250 0
1793
1806
1831
1841
1851
1861
1872
1881
Population
1891
1901
1911
1926
1936
60
créent s’implantent près des axes principaux toujours très marqués. La période industrielle a marqué la bastide et son réseau viaire serré. Certaines routes secondaires sont désaxées pour s’actualiser et contribuer à la durabilité du modèle urbain. Aujourd’hui, après une explosion démographique liée à l’étalement urbain de la métropole de Bordeaux (voir Annexe 10 p.140), le visage de la ville s’est métamorphosé (voir fig. 28), cependant, une permanence des tracés se fait ressentir. Les tracés “fondateurs“ sont toujours considérés majeurs. Malgré les difficultés actuelles de circulation en centre-ville35, ces tracés établissent une relation entre la place centrale et les grandes villes aux alentours. L’organisation de lotissements longeant les axes existants manifeste une division par les voiries (voir fig. 29). La carte relève par quatre zones de couleur les séparations par les axes prédominant. La typologie du bâti adopte également une posture de préservation. Comme nous pouvons l’observer sur le plan, les édifices publics et industriels sont en relation directe avec le grand boulevard périphérique. Nous pouvons interpréter cette disposition comme une frange de protection qui permet une fréquentation du boulevard due aux services limitrophes. Cette zone constitue une limite franche entre la manière d’habiter dans le centre-ville et en périphérie. En outre, cette répartition connote d’un respect pour la trame existante et d’une cohérence entre la structure viaire et le tissu bâti de la ville, les locaux commerciaux, d’une typologie plus imposante que celle du centre ancien, sont disposés à l’extérieur de la ville pour ne pas abîmer le paysage urbain. La morphologie de l’expansion urbaine prête à penser qu’elle participe à la permanence de la structure viaire de Créon. Créon conserve une structure viaire dessinée au Moyen-Âge. Toutefois, les cartes précédentes expriment les besoins de la ville à
35_ D’après Pierre GACHET, maire actuel de Créon, rencontré en Octobre 2017, la ville est très encombrée. D’après une étude réalisée par la municipalité en 2016, 3500 voiture par jour empruntent le grand boulevard périphérique.
61
modifier ses tracés pour subvenir à de nouvelles nécessités. Ainsi, l’usage de la structure viaire reste un point sur lequel nous pouvons questionner la notion de transmission. Les transformations appliquées à la bastide prêtent à penser qu’une inquiétude de durabilité de la ville devance une préoccupation pour la sauvegarde de l’héritage. Aujourd’hui, le réseau viaire qui régit la bastide exprime une rigueur d’organisation urbaine qui semble avant-gardiste en 1315. Cette trame est représentative d’une transmission que l’on peut associer à une organisation démocratique en milieu rural. Les tracés constituent aujourd’hui un héritage de cette époque. Fig. 29_ Plan de répartition des lotissements et du bâti public et industriel Différentes zones résidentielles à l’Ouest de la bastide Différentes zones résidentielles au Sud de la bastide Différentes zones résidentielles au Nord de la bastide Différentes zones résidentielles à l’Est de la bastide Bâti public et industriel Zone publique et industrielle
200m
62
100m
63 Fig 30_ Croquis, vue de la rue du docteur Fauché vers les arcades de la place Réalisé 2017
en
Octobre
Fig 31_ Carte postale ancienne vue de la rue du docteur Fauché vers les arcades de la place Archives municipales Fig 32_ Plan de Créon avec l’orientation de la vue représentée en croquis et carte postale Réalisés en Novembre 2017 d’après le Site du Centre d’Étude des Bastides
36_ DOUADY Clément-Noël, De la trace à la trame : la voie, lecture du développement urbain, ed. L’Harmattan, Paris, 2014, p. 151
b_ Les tracés, reflet du temps Les rues de la bastide étaient conçues de sorte à ce que l’évidence du cheminement mène vers la place au centre, cœur économique de la cité. Au Moyen-Âge, le passage dans Créon était bénéfique au fondateur car il profitait de taxes d’entrée à la cité. Aujourd’hui, nous pouvons encore partiellement lire ces intentions. Effectivement, les perspectives des rues ont été conservées. À l’époque, les charrettes empruntaient les rues perpendiculaires pour atteindre la place ou passer son chemin en traversant la ville. Dans les deux cas, il est encore possible d’effectuer ce cheminement. Toutefois, le chemin ne passe plus sous les arcades, il est dévié pour border le nouveau socle plus petit. L’importance de la place n’en est pas amoindrie étant donnée qu’elle est toujours investie par le marché qui interdit aux véhicules de circuler en centre ville ce jour-là. En comparant des cartes postales du début du XXe siècle à des croquis de l’état actuel des lieux (voir Fig. 30 et 31) nous pouvons observer que l’espace réservé aux véhicules a perdu sa linéarité. Ceci se justifie par le nouvel usage de véhicules motorisés et la volonté de les faire ralentir en centre ville. Cependant, si l’on considère le cadre, soit la façon dont le réseau viaire occupe l’espace et établit ses connexions36, nous relevons que l’espace public dédié à la rue demeure inchangé. Effectivement, si l’on considère les deux cadrages, le premier vers le centre de la bastide et le second vers le boulevard périphérique (voir Fig. 33 et 34 p. 62), cette rue maintien une morphologie similaire. Le nouvel édifice, sur le premier croquis à l’angle à gauche (voir Fig. 32) indique que la densification s’effectue dans un respect volumétrique de l’existant.
64
100m
65 37_ Dans le document de Nara, la valeur du patrimoine est associée à la notion d’authenticité. La valeur de la bastide ici, existe par la permanence des tracés malgré les évolution dans le temps et dans la morphologie urbaine. Convention du Patrimoine Mondial , ICOMOS, 1-6 Novembre 1944, Document de Nara sur l’authenticité https://www.icomos. org/charters/nara-f. pdf Fig 33_ Croquis, vue de la rue du docteur Fauché vers le boulevard Réalisé 2017
en
Octobre
Fig 34_ Carte postale ancienne vue de la rue du docteur Fauché vers le boulevard Archives municipales Fig 35_ Plan de Créon avec l’orientation de la vue représentée en croquis et carte postale Réalisés en Novembre 2017 d’après le Site du Centre d’Étude des Bastides
Ce phénomène de conservation est dû à une volonté de révéler le plan de la bastide au XIXe siècle. Comme le prouve le plan d’alignement de 1869 (voir Annexe 11 et 12 p.141). Nous pouvons déduire que la préoccupation de mettre en valeur l’orthogonalité du plan et les perspectives rectilignes sont d’actualité à cette époque et se ressentent encore aujourd’hui. Cependant, comme nous relevons dans le compte rendu du conseil municipal, la restitution du tracé des rues se base sur une interprétation qui n’a pas été précédée d’études des traces éventuelles de l’état d’origine. Si nous considérons ces décisions municipales, elles démontrent une automatisation de la réflexion quant à la structure urbaine et une lecture naïve de la ville. En outre, nous pouvons questionner l’intention de restitution quant à sa relation à l’héritage de la bastide. En effet, il induit une notion d’évolution qui, malgré des changements morphologiques, laisse transparaître des éléments caractéristiques, de valeur37 permettant de reconnaître la bastide. L’alignement “forcé“ mis en oeuvre au XIXe siècle est, certes, une intention de dévoiler les dispositifs d’origine soit-disant pour les revaloriser. Or nous pensons que la valeur d’un héritage ne réside pas dans des interventions qui tendent à détruire les éléments d’une période donnée, jugée moins importante, au détriment d’une autre période antérieure dont on souhaite révéler les témoins. Mais au contraire l’héritage est composé des facteurs liés au temps (les évolutions, les pillages, les abandons, les destructions, les incendies,...) qui se développe en respectant une trame, celle de la bastide et de son plan orthogonal. Lors de cette prise de décision, le tracé de la bastide n’était pas en péril et l’intervention qui a été partiellement réalisée n’avait pas un rôle essentiel dans la sauvegarde de ce patrimoine.
66
La trame viaire de la bastide interagit avec son territoire à plusieurs échelles pour ancrer la bastide dans son site. À l’échelle territoriale elle connecte, dès le XIVe siècle, la bastide aux grandes et petites villes qui rayonnent aux alentours, sur des territoires plus ou moins vastes. La mise en oeuvre d’un réseau de voiries témoigne d’une volonté, par l’intégration aux voies de communication, d’un essor économique durable. À l’échelle urbaine, elle impose une rigueur d’usage à travers le plan en damier, notamment dans la hiérarchie des axes. Dans le centre ancien, la structure bâtie alignée aux voiries fait preuve d’un respect du tracé. La permanence viaire de la bastide semble impliquer des choix urbains déterminants pour la transmission de son héritage.
La rigueur de construction de la trame viaire constitue-t-elle un élément suffisamment fort pour induire la permanence de la morphologie urbaine et transmettre un héritage?
Fig 36_ Photo du marché de Créon le Mercredi matin, prise de vue depuis la mairie Source : Brochure de tourisme GIRONDE TOURISME “Randonnées dans les Bastides en Gironde“ Conseil Départemental de la Gironde
4180250
4180500
4180500
Chapitre II_
4180250
Parcellaire et traces
Fig_1 (à gauche) Partie du plan de l’organisation parcellaire au XIXe siècle, d’après le cadastre napoléonien Fig_2 (à droite) Partie du plan de l’organisation parcellaire au XXIe siècle, d’après le cadastre actuel, géoportail
70
II
Parcellaire et traces
La ville subit des modifications au cours du temps qui sont liées à des changements de modes de vie. Parfois, ces modifications engendrent des effacements des traces du passé. Nous nous questionnons quant aux limites d’évolution qui permettent toujours une lecture de ce qu’est l’héritage. Jusqu’à quel point l’héritage subsiste malgré l’effacement des marqueurs du passé dans la ville? La division parcellaire dessine les limites de propriétés dans la ville (voir Fig. 3). Ces fragmentations des terrains à bâtir sont représentatives d’une certaine logique associée à l’intention de la fondation de la bastide. Autrement dit, l’intention est de répondre à des besoins économiques par une disposition et une typologie du bâti adaptées. Dans ce modèle urbain, la régularité des tracés est accompagnée d’une division tout aussi rigoureuse de la structure parcellaire. En effet, la logique à l’intérieur des îlots détermine une division de parcelles en lanières. Ces parcelles, caractéristiques du Moyen-âge, sont avantageuses car elles permettent d’accueillir une typologie liée au commerce. En outre, leur morphologie s’adapte aux taxes fixant un impôt proportionnel à la dimension de la façade donnant sur la rue1. Cette organisation témoigne d’un fonctionnement urbain particulier dans lequel la rue et la place sont les espaces privilégiés. En quoi la structure parcellaire en bastide représente t-elle un facteur de renforcement de la trame urbaine caractéristique ?
1_ CHOUQUER G., Parcellaires, cadastres et paysages, Revue archéologique du Centre de la France, n°32, 1973, pp. 205230 http://www.persee. fr/doc/racf_02206 6 1 7 _ 1 9 9 3 _ num_32_1_2698
Fig.3_ Cadastre actuel de Créon Géoportial 100m
71
72
1_ Le bâti et la structure parcellaire a_ Adaptation à la trame parcellaire La question du territoire en bastide est intéressante car l’un des principes phares de la fondation se base sur l’équité qui se concrétise par une division égale des terrains à bâtir pour la population. D’après l’historien Pierre Simon, cet urbanisme traduit un état de la société qui se voulait beaucoup plus égalitaire2 que la société féodale traditionnelle comme vu précédemment. La création des bastides s’accompagne d’un développement de la bourgeoisie au sens propre du terme, c’est-à-dire que les gens qui habitent dans un bourg et qui font du commerce, tout en bénéficiant de garanties judiciaires et fiscales dans le cadre des coutumes. Cependant nous pouvons remettre en question divers points liés aux intentions du fondateur. Tout d’abord, le principe d’équité. Dans la comparaison entre Créon et Saint-Macaire, en considérant le tissu bâti cette fois, nous descellons de fortes inégalités engendrées par le modèle de la bastide (voir Fig 4 et 5). Malgré des similitudes, les parcelles en lanières suivent toujours une logique longitudinale avec leur façade étroite donnant sur la rue. L’organisation parcellaire de Saint-Macaire donne lieu à des équivalences de rapport entre l’espace public et l’espace privé. En revanche, la bastide créonnaise peut sembler au premier regard, être un modèle qui rétablit une certaine équité, or elle est responsable de disparités en proposant des situations privilégiées aux abords de la place de la Prévôté. Les bâtisses donnant sur l’espace public bénéficient d’un contexte où l’échange commercial et social sont plus évidents, lorsque d’autres bâtiments font face au boulevard. Le plan de Créon évoque ce privilège de situation, c’est d’ailleurs pour cette raison que nous
2_ Pierre SImon, historien, Intervention à Monflanquin le 30 Septembre 2017 lors de la ronde des bastides
73
3_ HEERS Jacques, La ville au MoyenÂge, ed. Fayard, Octobre1990, SaintAmand Montrond, (Chap. III Les villes neuves) p.130
observons un tissu urbain plus dense au abord du “cœur de la ville“. D’après Jacques Heers, au Moyen-Âge, les villes neuves sont dessinées avec un tracé régulier surtout par automatisme3. Nous pensons que les origines de ces structures n’est certainement pas du à une imitation rigoureuse, cependant il est parfois la transcription maladroite d’une intention qui peut paraître fonctionner en plan mais qui est un échec en pratique et donne lieu à une équité foncière mais certainement pas à une équité urbaine.
Fig. 4_ Plan actuel du “village-rue“ de SaintMacaire Réalisé en Novembre 2017 d’après Géoportail 100m
Fig. 5_ Plan actuel de la bastide de Créon Réalisé en Novembre 2017 d’après Géoportail
100m
74
L’analyse parcellaire des alignements du bâti dévoile une zone privilégiée en centre ville dans laquelle le bâti est aligné à la rue (voir Fig. 5 et 6). Tandis qu’à l’extérieur du boulevard, les parcelles changent de typologie, elles sont plus généreuses et moins étroites. Le bâti s’implante au centre de la parcelle, éloigné de la voirie. L’ensemble du tissu bâti et sa relation à la structure parcellaire dévoilent deux schémas d’implantation du bâti. Un premier, dense, génère une mixité concentrée localement et répond à une logique de mixité d’activités dans un espace restreint pour le rendre plus dynamique. Un second, aéré, révèle une typologie propre à l’étalement urbain, soit, des zones résidentielles de lotissements construits des années 60 à aujourd’hui4. Dans cette disposition, nous pouvons clairement identifier les limites du tissu bâti ancien. La transition entre la ville ancienne et la nouvelle se matérialise franchement par le boulevard. Nous pouvons interpréter ce tracé comme une limite dans la structure urbaine. Alors que la ville de Créon n’est pas protégée pour son témoignage médiéval, cette limite définit la qualité des interventions urbaines effectuées. La possibilité de lire aussi clairement la limite entre les deux villes témoigne d’une préoccupation politique de conservation d’une structure inconsciemment valorisée. La confrontation des deux villes, l’une ouverte et l’autre fermée sur l’espace public tend à nous faire penser que les choix municipaux sont à l’origine d’une volonté de distinguer les deux compositions. Cependant, d’après la connaissance des fonctionnements politiques dans les petites villes, nous préférerons nous orienter vers une hypothèse qui justifie un parti pris de conserver la bastide en densifiant de manière aléatoire la périphérie de Créon. Cette hypothèse nous renvoie alors à la permanence de la cité. En effet, nous pensons que cette permanence est vécue comme une évidence, elle impose donc un respect des traces originelles. La transmission de l’héritage de la bastide outrepasse la notion de
4_ Mairie de Créon et Société Archéologique et Historique du Créonnais, Créon, De la fondation de la bastide au XXIème siècle, Mai 2015, p. 34
Fig. 5_ Plan actuel de la bastide de Créon Réalisé en Novembre 2017 d’après Géoportail Fig. 6_ Bâti actuel de Créon Réalisé en Novembre 2017 d’après Géoportail Parcelles avec bâti aligné à la voie Parcelles avec bâti partiellement aligné à la voie Parcelles sans bâti aligné à la voie 100m
75
76
trace, elle fait référence au patrimoine habité5, sans rupture dans le temps ni besoin de réaffectation du bâti. Nous déterminons que le processus définition de la valeur patrimoniale qui s’inscrit dans une continuité devient complexe du fait de son succès intemporel6. N’ayant pas de point de rupture la question de la sauvegarde de la cité se génère automatiquement par son investissement constant. Toutefois, nous pouvons questionner la nature de la transmission étant donné que chaque génération interprète le modèle urbain avec une vision différente. Dans les années 80, le développement de la ville de Créon entraîne de nouveaux besoins. Le maire du village, à cette époque Roger Caumont, entreprend, un projet d’espace culturel au cœur de la bastide7. Le choix du site se justifie par une volonté de dynamiser
5_ Collectif sous la direction de GRAVARIBARBAS Maria, Habiter le patrimoine: Enjeux, approches, vécu, ed. Presses universitaires de Rennes, col. Géographie sociale Rennes, 2005 6_ Dans le sens où la bastide a toujours été habitée et que le tissu bâti a été entretenu au cours du temps en laissant un héritage qui continue de s’écrire aujourd’hui. 7_ D’après l’entretien avec monsieur Caumont, maire de Créon de 1977 à 1995, le 30 Octobre 2017
Emprise du centre culturel composé d’un cinéma, d’une bibliothèque, d’une salle de danse et d’une salle de représentations
Fig. 7_ Partie du plan parcellaire de Créon au XIXe siècle avec l’emprise du projet de l’espace culturel. 100m
77
le centre ancien. L’intervention génère l’implantation de la culture à dans un tissu urbain qui devient de plus en plus résidentiel. Le programme est conséquent pour le gabarit de la bastide, il doit s’implanter sur plusieurs parcelles. La trace des parcelles en lanières n’est pas conservée (voir Fig.7), l’intention est de créer un pôle attractif qui ne “dénature“ pas le bâti de la bastide. Le projet s’implante alors dans une rue secondaire (voir Fig. 8), actuellement piétonne. Il est certain que face aux problématiques de dynamiser le centre ancien, le projet est une réussite. Néanmoins, il remet en question la transmission d’un héritage en effaçant les traces du passé (voir Annexe 13 p.143). D’un point de vue du langage architectural, les façades essayent tout de même de s’approcher de la typologie bâtie de la bastide. Malgré leur largeur qui rompt avec le schéma des élévations étroites de la bastide, nous relevons une intention de s’approcher du langage architectural existant (voir Fig. 10 et 11).
50m
Fig. 8_ Plan de Créon avec la rue Montesquieu
Fig. 9_ Photographie de l’entrée de l’espace culturel depuis la rue Montesquieu, Novembre 2017
Entrée
Salle de spectacle
Bibliothèque
78
Tuiles canales Corniche Ouvertures verticales Balcons en fer forgé
Fig. 10_ Façade du projet du centre culturel, rue du Docteur Fauché qui reprend le langage des façades existantes avec des ouvertures verticales et des balcons au premier étage. Source : municipales
Archives
Géométrie hémisphérique 2m
Tuiles canales Corniche
Ouvertures verticales
Fig. 11_ Troisfaçades de la bastide attenantes à la place de la Prévôté. Contrairement à la large façade du centre culturel, nous pouvons observer l’étroitesse du bâti donnant sur l’espace public. Source : Réalisé en Décembre 2017
Balcons en fer forgé Géométrie hémisphérique
2m
79
8_ Ce terme renvoie à la notion de cohésion sociale dans un lieu déterminé, la mémoire collective est en lien avec l’héritage car elle touche l’affect d’une collectivité qui a le désir de sauvegarder un objet menacé, remarquable ou non. Source : D’après RICOEUR Paul, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Editions du Seuil, Essais, 2000, p. 143
Ce projet nous amène à penser que la structure parcellaire caractéristique de l’époque médiévale s’affaiblit au fil de temps. Les diverses propriétés des terrains témoignait encore de la logique de division parcellaire en centre de bastide mais malgré la difficulté pour la mairie d’acquérir ces différentes parcelles, une fois le projet construit, les traces médiévales sont effacée et la rue perd son caractère marchand au profit d’un seule et même façade uniforme. L’intervention de l’agence d’architecture HPL est dépourvue d’un intérêt patrimonial d’un point de vue de la structure parcellaire, car le projet comporte divers programmes et il aurait été possible de s’inscrire dans une continuité de la structure existante. Aujourd’hui nous savons que certaines traces du Moyen-Âge ont été effacées très récemment à cause de l’expansion de la ville. La fragilité de la structure médiévale s’affirme ce dernier siècle et met en péril la transmission de l’héritage de la bastide. Si nous considérons la bastide comme un patrimoine habité sauvegardé grâce à la mémoire collective8, cet exemple pose question quant aux sacrifices nécessaires pour la conservation d’un témoin du passé. Autrement dit, l’effacement partiel du parcellaire permet de dynamiser un centre qui a vocation a être de moins en moins investi. Or pour conserver la bastide, nous pensons qu’il est nécessaire de l’habiter, donc les concessions, si elles sont minimes peuvent s’inscrire dans le processus global de sauvegarde et devenir essentielles à la transmission de l’héritage. La fragilité de la bastide de Créon a suscité des questionnements quant à sa protection. En 1965, les acteurs de la ville reconnaissent qu’elle est porteuse d’un intérêt patrimonial. Elle est inscrite à l’inventaire départemental des sites. D’après l’Atlas des sites inscrits et classés de la Gironde, l’inscription d’une partie de la bastide a pour «objectif principal [...] la conservation de milieux et de paysages
80
dans leurs qualités actuelles. La procédure simplifiée d’inscription à l’inventaire départemental des sites constitue une garantie minimale de protection, en soumettant tout changement d’aspect du site à déclaration préalable.»9 Autrement dit, le périmètre déterminé (voir Annexe 14 p.144) est soumis à un contrôle pour les changements à venir. La transmission de l’héritage médiéval devient plus évidente et l’arrêté du 23 Mars 1965 officialise la valeur de la bastide pour son intérêt historique (voir Fig. 12). Les façades à pans de bois ont disparu pour laisser places aux traces des époques traversées par la bastide. Elles témoignent des interventions de plusieurs périodes, et suivent toujours rigoureusement la typologie d’origine avec les arcades et l’alignement pour respecter le plan orthogonal (voir Fig.
1
2
9_ Source : http://webissimo. developpementdurable.gouv.fr/IMG/ pdf/Atlas_Sites_ Gironde_cle0661c1.pdf
Fig. 12_ Site inscrit, d’après la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de l’Aquitaine : la place de la Prévôté et les façades attenantes Source : Atlas départemental des sites de Gironde http://webissimo. developpementdurable.gouv.fr/IMG/ pdf/Atlas_Sites_ Gironde_cle0661c1.pdf
Bâti dont la façade est inscrite Espace inscrit 50m
public
81
14 et 15 p. 80 à 83 ). Certaines traces dévoilent la volonté de construire de manière durable, par exemple, les andrones (petite séparation d’environ un mètre entre deux bâtisse) jouent le rôle de coupe feu. L’intention de sauvegarde de la bastide découle d’une volonté de conserver le paysage urbain originel, cependant, le site inscrit se limite à la place de la Prévôté et à ses façades (voir Fig 13). Ainsi, même si la démarche de protection est initiée avec un espace majeur inscrit, nous pouvons nous questionner quant à la reconnaissance du véritable sujet de patrimoine du modèle urbain, qui d’après nous réside aussi dans l’organisation urbaine de l’ensemble du centre ancien.
Fig. 13_ Photographie aérienne de la place de la Prévôté, vue des façades Sud-Est et Nord-Est, années 60 Source : municipales
Archives
82
1
Fig. 14a_ Parement en pierre de taille Datation : XIXe siècle (période haussmannienne)
Fig. 14_ Élévation Nord-Est, Source : Réalisée en Décembre 2017 a,b,c,d et e_ Photos réalisées en Novembre 2017
Les datations sont issues d’interprétations personnelles 5m
Fig. 14b_ Corniche à modillons et corniche moulurée Datation : Fin XVIIIe - début XIXe (période néoclassique)
83
Fig. 14c_ Arcade en anse de panier Datation : XIVe siècle (Moyen-Âge)
Fig. 14d_ Œil de bœuf Datation : début XIXe siècle
Fig. 14e_ Androne (séparation incendie) Datation : XIV-XVe siècle (Moyen-Âge)
84
2
Fig. 15a_ Baie géminée à meneaux en pierre Datation : entre XVe et XVIe siècle (fin Moyen-Âge, début Renaissance)
Fig. 15_ Élévation Sud-Est, Source : Réalisée en Décembre 2017 a,b et c_ Photos réalisées en Novembre 2017
Les datations sont issues d’interprétations personnelles 5m
Fig. 15b_ Balcon en encorbellement Datation : entre XVe et XVIe siècle (fin Moyen-Âge, début Renaissance)
85
Fig. 15c_ Amorce d’appareillage Trace d’une rupture de continuité du bâti qui suppose que le bâtiment de droite ayant pignon sur rue est plus récent
86
b_ Hiérarchie du bâti et des espaces publics La place publique est un trait essentiel du plan élaboré. Tout d’abord, ses dimensions sont rigoureusement calculées de sorte à ce que le terrain qui leur est réservé soit considérable par rapport à la taille de l’agglomération. D’après l’interprétation du Centre d’Étude des Bastides, le plan en damier de certaines bastides comme celle de Cologne (1283) dédie un îlot sur neuf de l’ensemble d’origine à cet espace10 (voir Fig. 16). À cette époque, aucune ville ancienne n’approche ces proportions11. Elle a une forme régulière, soit d’un carré, d’un rectangle ou d’un trapèze, quelle que soit sa forme elle est franchement dessinée et ses côtés sont rectilignes. À Créon, Les arpentins du sénéchal de Guyenne tracent des lots de 20 pieds de largeur (soit 6 m) et d’une profondeur avec jardins calculée méticuleusement sur la base du carré de l’hypoténuse12, la place reprend le gabarit des îlots du centre ville (voir Fig. 17). À l’époque où la presse n’existe pas encore et les moyen de communication sont très restreints, la bastide accorde de l’importance aux échanges sociaux et fait preuve d’innovation pour son époque. À l’image du forum romain, la place se dresse non pas comme un vide mais comme un espace associé à des éléments qui la forment, la complète et la définisse. En combinant les échanges, elle assure une prospérité à la ville. Nous remarquons que l’urbanisme au Moyen-Âge est caractérisé par une dualité entre intérieur et extérieur qui est générée par des préoccupations de défense (l’intérieur) et de conquête, (l’extérieur)13. Les arcades14, bordent la place en créant un “lieu autre“ qui va bousculer l’appréhension de l’espace public par le seuil. Les passages couverts des arcades sont conçus à l’origine pour abriter les charrettes qui passent et s’arrêtent près des commerces. Elles ont aussi un rôle de transition propre à une typologie marchande.
10_ http://bastidess. free.fr/traceOrthogonal. htm 11_ LAVEDAN Pierre, Qu’est-ce que l’urbanisme ? Introduction à l’histoire de l’urbanisme, , ed. Histoire de l’urbanisme, I, Antiquité, Moyen âge; II, Renaissance et Temps modernes, 2 vol., Paris, 1941, p. 88 12_ Mairie de Créon et Société Archéologique et Historique du Créonnais, Créon, De la fondation de la bastide au XXIème siècle, Mai 2015, 207 p. 13_ FOUCAULT Michel, Dits et écrits 1984, Des espaces autres (conférence au Cercle d’études architecturales, 14 mars 1967), in Architecture, Mouvement, Continuité, n°5, octobre 1984, pp. 46-49 14_ Aussi appelées arceaux, ambans, couverts ou cornières.
87 Place centrale Référence de gabarit des îlots limitrophes Bâti Bâti (halle)
ouvert
Fig. 16_ Plan de Cologne (1283) Réalisé en Décembre 2017 d’après cadastre. gouv 100m
Fig. 17_ Plan de Créon Réalisé en Décembre 2017 d’après cadastre. gouv 100m
88
Depuis plusieurs décennies, jusqu’à aujourd’hui, les commerçants se sont approprié cet espace (voir Fig. 18). Dans certaines bastides, à Monflanquin par exemple, les arcades ont donné leur nom à la place aux arcades; aussi, il n’est pas rare d’entendre à Créon «Je travaille sous les arcades». Cette expression montre à quel point la typologie architecturale définit le lieu. En plus d’apporter un caractère à la place, les arcs ont un rôle structurel, ils supportent l’habitation au dessus de la galerie augmentant ainsi la surface habitable (voir Fig. 19). La composition des maisons bâties sur les parcelles permettent une gradation d’espaces allant du public, la place, au privé, le jardin de fond de parcelle. L’aménagement des espaces permet aux habitants de vivre et de travailler dans la même bâtisse. Nous pouvons associer cette limitation des mouvements à un gain de temps et d’argent qui va inciter les populations à développer ce concept et lui assurer une continuité. Aujourd’hui ces espaces ne sont pas toujours adaptés aux besoins actuels15, notamment d’un point de vue de la lumière, le schéma d’implanta-
15_ D’après Carole Irigoryien, habitante et commerçante «sous les arcades», entretien du 30 Septembre 2017
Fig. 18_ Carte postale du début du XXe siècle montrant le passage sous les arcades et l’appropriation de l’espace par les commerçants Archives municipales
89
Place
Voie actuelle
Ancienne voie couverte
Échoppe
Patio et Habitation puits
Jardin privé
Public
Privé
Fig. 19_ Coupe axonométrique sur une parcelle en lanière Réalisée en Novembre 2017 d’après une maquette au bastideum de Monpazier 16_ VIOLLET-LE-DUC, Eugène, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, tome 6, ed. B. Bance, 1859, Paris, p. 250 Fig. 20_ Plan d’une partie d’îlot à Monpazier, Source : VIOLLETLE-DUC Eugène, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, tome 6, ed. B. Bance, 1859, Paris p. 250 0
10m
20m
30m
tion des maisons en longueur est problématique. Ce constat a été relevé par Viollet-Le-Duc au XIXe siècle à Monpazier16. L’architecte retient le plan de la cité comme le plan théorisé des bastides (voir Annexe 15 p.145) et relève les unités d’habitations égalitaires qui répondent aux intentions de la fondation (voir Fig. 20). Toutefois, les nouveaux besoins d’espace et de lumière impliquent des accessions sur plusieurs maisons qui effacent les traces des construc-
Emprise d’une propriété d’origine
Emprise d’une propriété générée par les besoins actuels
90
tions en longueur et perdent en cohérence avec la lecture de la façade. En analysant le plan d’épannelage de la cité (voir Fig. 21), nous pouvons observer que les hauteurs du bâti suivent aussi la logique permettant de qualifier l’espace de la place. En s’éloignant du centre ville, les hauteurs du bâti sont dégressives, les façades de la place de la Prévoté varient entre deux et trois niveaux maximum, elles génèrent une hiérarchie. L’implantation du bâti qui ferme la place participe à la qualification de cet espace car il définit précisément sa forme. De plus il génère un resserrement dans les cheminements qui précèdent l’arrivée sur la place pour créer un contraste qui lui octroie d’autant plus de valeur. L’espace public de la place est morphologiquement considéré comme le plus important de Créon. Nous pensons que l’affirmation du bâti implique un respect formel qui entraînera des modifications minimes comme celle du bâtiment de la Mairie dans les années 1900. Avant la reconstruction, l’importance du bâtiment institutionnel demeure dans son implantation (voir Fig. 22), en effet elle semble occuper deux parcelles. Nous pouvons souligner que la largeur du bâtiment matérialise son importance et son pouvoir. Dans cet
Fig. 21_ Plan d’épannelage du bâti actuel de Créon Réalisé en Novembre 2017 d’après Géoportail 50m
R+3 R+2 R+1 RDC Bâti périphérique
Fig. 22_ (à gauche) Carte postale de l’ancienne mairie détruite au début du XXe siècle Source : Archives municipales Fig. 23_ (à droite) Carte postale de la mairie détruite actuelle, années 1950 Source : Archives municipales
91
92
exemple, le témoignage médiéval est exprimé par l’implantation et non par l’architecture peu remarquable du bâtiment. Les choix de reconstruction du nouvel édifice sont alors justifiés (voir Fig. 23 p.). L’ancien bâtiment, l’hôtel de la Prévôté, est déposé car il ne peut pas supporter un étage supplémentaire17. La nouvelle construction en pierre s’inscrit dans un langage classique faisant référence à l’architecture Haussmannienne (voir Fig. 24) du XIXe siècle. De plus, elle s’inscrit dans une logique de hiérarchie par son élévation. La hauteur du bâtiment lui confère plus de notoriété que les autres, d’usages diverses (voir Fig. 25). Cette décision évoque un exemple de transmission, nous pouvons l’interpréter comme une volonté de
17_ Mairie de Créon et Société Archéologique et Historique du Créonnais, Créon, De la fondation de la bastide au XXIe siècle, Créon, Mai 2015, p.191
Fig. 24_ Carte postale de la mairie vue depuis les arcades dans les années 1970 Source : Archives municipales
93
RF
Arcades
Optique
Agence immobilière
RF
Mairie
Bar PMU
Agence immobilière
Optique
Place de la Prévôté
Fig. 25_ Façade de la Mairie dans l’état actuel avec les usages publics en rez-dechaussée, donnant sur la place Source : Réalisé en Décembre 2017
faire subsister certaines hiérarchies significatives établies à travers le temps. Les efforts déployés pour assurer la permanence de la ville naissent à cause de la fragilité de l’héritage. Dans cette situation, les élus, sensibles à l’organisation dans la bastide, transmettent en jaugeant à bon escient ce qu’il est nécessaire de conserver ou de modifier pour que la compréhension de la ville médiévale continue d’exister.
Arcades
94
2_ La bastide, opportunités et limites a_ L’expansion, une continuité ? Au XXe siècle, la densification est très rapide, et concerne surtout la périphérie de la ville D’un point de vue parcellaire, l’expansion urbaine s’établit dans une structure différente de celle de la bastide (voir Annexe 16 p.146). Les parcelles sont propres aux typologies de lotissements selon leur période de construction, et se différencient des parcelles en lanières du Moyen-Âge. Comme nous pouvons l’observer sur les images (voir Fig. 26 et 27), la densité engendrée par l’expansion urbaine est beaucoup plus faible que celle que l’on retrouve en centre ville. Ce contraste nous permet de sentir la distinction entre deux temporalités, deux manières d’habiter. L’une, s’assimile au tissu dense et mêlé aux commerces que l’on peut trouver dans le centre d’une métropole. En terme de paysage urbain, la dominance du bâti sur les espaces verts s’affaiblit en périphérie pour laisser place à des maisons dont les jardins sont visibles depuis la rue (voir Fig. 28 p.). Ce tissu urbain, plus aéré dévoile un typologie bâtie résidentielle datant du siècle passé qui continue à se développer aujourd’hui.
95
1902
Fig. 26_ Photo aérienne de Créon, prise depuis un ballon dans les année 1900 Archives municipales
N
2010
Fig. 27_ Photo aérienne de Créon dans les années 2000 http://www.mairiecreon.fr/
N
96
50m
Fig. 28_ Plan de situation de “l’îlot vert“ Fig. 29_ Photographie d’un potager dans la bastide prise depuis le chemin de ronde, Octobre 2017
Nous avons vu dans le premier chapitre que la densification de la ville s’inscrit dans une continuité, concernant les réseaux viaires, cependant l’analyse parcellaire exprime une rupture avec la structure établie au Moyen-Âge. Néanmoins, la notion de continuité pose question quant à sa nature. Donner une continuité à un élément voué à se développer, est-ce reprendre ses caractéristiques pour construire une “suite“ l’imitant ? Nous pensons que dans ce cas, l’idée de contraste présente une réponse, le dispositif parcellaire du XXe siècle se développe autour de la bastide au-delà du grand boulevard périphérique sans impacter la structure existante. Nous interprétons la mise en place de ce contraste comme une révélation du tissu ancien. La couronne urbaine engendrée par le développement de Créon, agit
97 18_ Concept explicité par l’architecte du patrimoine R. Gourdon pour définir une volonté de bâtir sans réelle conscience patrimoniale de l’existant : la bastide
19_ Architecte intervenant lors du colloque de la ronde des bastides le 30 Septembre 2017 à Monflanquin.
20_ Du latin Tabula rasa, l’expression exprime une intention de bâtir à partir d’une base vide dépourvue de caractère, rétablie dans son état d’origine pour construire de nouvelles bases. https://www.lesphilosophes.fr/ locke/essai-sur-lentendement-humain/ philosophe-anglais/ Page-2.html
à la fois comme une révélation mais aussi comme une protection, elle impose les limites de la ville ancienne qui, d’après nos hypothèses, semblent respecter aujourd’hui le plan de la bastide au XIVe siècle. La continuité de la bastide réside alors dans le fait que la structure parcellaire d’origine continue d’exister malgré une nouvelle urbanisation, qualifiée d’urbanalisation18 par l’architecte du patrimoine Rayko Gourdon19. Il est vrai que malgré une urbanisation spontanée de la périphérie de Créon, nous pouvons sentir qu’une conscience collective a établit les limites de la valeur de la ville et a intuitivement choisi de ne pas s’implanter en faisant table rase20 de l’organisation établie. Nous pouvons traduire cette expansion “hors les murs“ comme un ensemble cohérent qui apparaît subitement et crée un seuil entre la bastide et l’extérieur. L’héritage est préservé, cependant la capacité restreinte de la ville entraîne des modifications qui rendent de plus en plus compliquée la capacité de la bastide à s’adapter aux besoins. En effet, le centre ville, dont l’ampleur est franchement délimitée, offre peu de possibilités de développer les services nécessaires à une population croissante. Dans un scénario où la ville continue de croître, la transmission de l’héritage persiste si une compensation au centre ville se crée, de manière à répartir les services entre centre ancien et nouveaux pôles. Ainsi la bastide sera préservée et valorisée comme le centre ancien de Créon. Cependant, dans cette situation, le dynamisme du centre médiéval est remit en question.
98
b_ Stratification ou conservation ? L’état actuel de la bastide dévoile des traces du passé, or nous savons, d’après le cadastre napoléonien (voir Fig. 30), que nombre d’entre elles n’existent plus en comparaison du XIXe siècle. En effet, comme l’indique le plan ci-dessous, nous relevons la présence d’une halle sur la place centrale. Cette halle, comme les arcades, s’inscrit dans la typologie marchande de cet espace public et témoigne d’une grande activité économique depuis le MoyenÂge. Cet édifice, l’un des plus important de la ville, fait partie des critères d’identification de la bastide21. À Créon la halle a disparu, elle a été volontairement détruite par la municipalité en 187222 pour cause de fréquentations importunes. Dans cette situation, le choix politique s’est rabattu sur la résolution la plus simple d’un problème de conservation, seulement trois ans après l’année de décision d’alignement des façades pour retrouver les tracés d’origine. Nous
21_ DUBOURG Jacques, Histoire des bastides: les villes neuves du MoyenÂge, ed. SudOuest, Bordeaux, col. Référence, Novembre 2002, 382p.
22_ Mairie de Créon et Société Archéologique et Historique du Créonnais, Créon, De la fondation de la bastide au XXIe siècle, Créon, Mai 2015, p.161
Fig. 30_ Plan de Créon au XIXe siècle, d’après le cadastre napoléonien Géoportail Bâti Halle 100m
99
remarquons ainsi que la préoccupation patrimoniale est sélective et qu’une hiérarchie d’importance est appliquée aux marqueurs du passé. Le choix déterminé, implique le sacrifice d’un élément du passé, cette décision porte une valeur pratique injustifiée d’un point de vue de l’héritage.
23_ DUBOURG Jacques, Histoire des bastides: les villes neuves du MoyenÂge, ed. SudOuest, Bordeaux, col. Référence, Novembre 2002, 382p.
24_ BAILLY G-H et LAURENT Philippe, «Le patrimoine des halles», Info Bastide, n°41, Avril 1999, p.13
Des hypothèses basées sur des confrontations avec d’autres bastides permettent de déterminer la typologie de la halle (voir Fig. 31 et 32 p.). Par exemple, ici à Villeréal, elle est construite avec une charpente en bois remarquable, les poutres ont de grandes dimensions pour atteindre de grandes portées, dans ce cas jusqu’à quinze mètres23. D’après le plan (voir Fig. 33 p.), les gabarits varient, en fonction de la taille de la ville. La bastide de Villeréal est plus étendue que celle de Créon, elle comprend entre un et deux îlots de plus par rangée, la taille de la place est sensiblement similaire mais l’ampleur de la halle est plus importante. Si les tracés viennent à disparaître, la halle peut être un témoin de l’envergure de la ville. Mais nous remarquons que les éléments bâtis ont tendance à être encore plus fragiles que les tracés urbains. La disparition de la halle de Créon entraîne une perte de cohérence sur la place. Détruite depuis plus d’un siècle, elle n’a jamais été remplacée par un autre bâti, ce qui signifie qu’aujourd’hui, nous avons de nouvelles attentes concernant l’espace public, et la halle apparaît comme un frein aux ambitions d’aménagements urbains ; cet espace est un parking aujourd’hui (voir Fig. 33 p.). Par ailleurs, le statut de cet édifice menacé se généralise dans la majorité des bastides. En 1900, seule une halle, à Saint-Pierresur-Dives (14) est inscrite sur la liste d’édifices remarquables des Monuments Historiques24. Depuis, une prise de conscience collective
100 Fig. 31_ Maquette de la halle de Villeréal (47) Bastideum Monpazier
Fig. 32_ Photographie de l’intérieur de la halle de Villréal en Septembre 2017
Fig. 33_ Plan cadastral de Villeréal Réalisé en Décembre 2017 d’après Cadastre. gouv
100m
101
25_ le Conseil International des Monuments et des Sites oeuvre pour la conservation et la protection des monuments, des ensembles et des sites du patrimoine culturel 26_ BAILLY G-H et LAURENT Philippe, «Le patrimoine des halles», Info Bastide, n°41, Avril 1999, p.13 Ce numéro rendait compte d’un circuit passant par Créon, organisé par le CEB pour le Comité International des Monuments et des Sites (ICOMOS) qui avait retenu “les bastides“ comme l’un des thèmes de discussion de la 12ème assemblée générale à Mexico en Octobre 1999
et des opérations de protection du Ministère de la Culture ont vu le jour. Ainsi, 180 halles parmi 3000 sont protégées au titre des Monuments Historiques à la fin du XXe siècle. La halle est un édifice représentatif de la bastide et de son développement économique, il constitue un héritage à part entière. Sa valeur est identifiable par le manque structurel d’une importance bâtie après sa destruction. Dans les bastides où elle existe toujours, nous pensons qu’elle peut être qualifiée de patrimoine quotidien car elle est investie par un usage qui persiste : le marché. Avant qu’un élément hérité ne soit officiellement reconnu à sa juste valeur, les solutions les moins coûteuses sont déployées, au prix d’un effacement du témoin du passé et de sa trace. Les pouvoirs politiques doivent être en mesure de reconnaître un héritage et de le conserver tant que faire se peut lorsque son existence est menacée. Un questionnement sur le patrimoine quotidien apparaît pour dénoncer le peu de considération envers ces valeurs d’usage qui traversent le temps et décrivent des pratiques qui fondent notre société aujourd’hui. D’après l’ICOMOS25, un édifice qui porte une valeur d’usage toujours existante «n’est “patrimoine“ que dans la mesure où il reste “vivant“, c’est-à-dire dans la mesure où il continue à être vécu de façon permanente»26. La continuité d’un usage qui définit la bastide est un facteur de permanence. Ainsi, nous jugeons que, dans ce cas, la sauvegarde de ce témoin aurait été justifiée car elle se serait inscrite dans une continuité défendue par l’occupation hebdomadaire d’un usage pérenne, le marché.
102
La fragmentation d’une unité spatiale brouille la lecture urbaine du XIVe siècle, et même si l’intervention est parfois réversible (voir Fig 34 et 35), elle rompt le schéma établit et instaure une utilisation de l’espace qui ne respecte plus l’héritage du modèle de la bastide. La superposition des différentes interprétations de la ville d’origine donne lieu à une stratification. Les élus de chacune des périodes que traverse Créon adoptent un comportement qui considère ou non l’héritage transmis par le modèle urbain.
Fig. 34_ Photographie du parvis de la mairie de Créon, il est encore possible de cheminer sur le tracé d’origine, cependant il est réservé à certains usagers publics. réalisée en Octobre 2017
Fig. 35_ Photographie aérienne de la bastide avec vue sur la place de la Prévôté dont on perçoit la rupture du parvis avec le plan orthogonal existant
103 27_ Cette conscience collective est transmise aux nouveaux habitants
La stratification et la conservation ne sont pas deux notions contradictoires étant donné qu’il est possible, dans les deux cas, de préserver les traces du passé de ses effacements potentiels. Toutefois, les politiques de la ville n’ont pas toujours considéré la valeur de l’héritage de la bastide, et on privilégié les besoins contemporains. Nous pouvons souligner que l’échelle urbaine exprime un héritage intuitif. C’est-à-dire, que la valeur de l’organisation urbaine du centre ancien de Créon est déterminée par une conscience patrimoniale collective27. Nous la qualifions d’intuitive au regard de l’évolution de la ville. Toutefois, l’échelle architecturale, en cohérence avec la structure de la ville, est bien plus menacée. Les traces s’effacent avec le temps à cause de la dissociation entre les tracés urbain et l’héritage architectural. Ainsi, nous pouvons penser que l’héritage de Créon subit une stratification de l’aménagement urbain car il ne respecte pas toujours la transmission du langage de la ville. D’autre part, la distinction entre le centre ancien et l’expansion urbaine fait preuve d’une intention de conservation qui souligne l’héritage transmit par contraste. en mettant en oeuvre une typologie distincte en périphérie. Nous pouvons justifier ce phénomène par la notion de patrimoine habité qui, grâce à la mémoire collective des habitants, transmet un héritage. Seulement, ce patrimoine, par le fait qu’il soit vivant, ne peut être figé. Il demande donc de s’adapter à des contraintes d’évolution. Nous pouvons alors nous questionner si ce patrimoine serait-il toujours transmis s’il cesse d’être habité à un moment donné?
104
3_ Les traces et la trame a_ Une transmission adaptable Nous considérons qu’il est nécessaire de réunir deux conditions pour que la notion d’héritage émerge. En premier lieu, la reconnaissance de la valeur du sujet à travers le temps, autrement dit, la compréhension du caractère de témoignage de l’élément concerné. En deuxième lieu, le moyen de transmission, mis en oeuvre par les acteurs de la ville27. D’après George Baird, la parcelle constitue la base de la morphologie urbaine28. Nous pensons qu’elle est représentative d’un système politique originel et permet de comprendre un urbanisme tel que celui des parcelles en lanière. En effet, à l’origine, la façade restreinte sur l’espace public limite les taxes des propriétaires. Cet urbanisme génère une diversité de services présents dans un espace réduit et participe au dynamisme du cœur de la ville. De plus, il entraîne une densité importante qui permet de qualifier les espaces publics. En s’éloignant du centre, cette densité s’affaiblit, rythmée par un Plan Local d’Urbanisme29 qui détermine une occupation des sols contrastée : les acteurs de la ville déterminent un franchissement qui semble assurer la permanence de l’héritage de la bastide (voir Fig. 36 et 37). Nous pouvons observer une dilatation de l’espace bâti en s’éloignant de la périphérie. L’espace public est majeur et les seuils se multiplient. La réglementation participe au maintien de l’entité médiévale. D’un point de vue morphologique, le fonctionnement de l’extension urbaine n’altère pas la lecture de la bastide, mais au contraire, joue le rôle de révélateur de la cité ancienne. Ainsi, en
27_ Institutions à l’origine du développement de la ville (Mairie, CAUE, Communauté des communes, etc) 28_ MERLIN Pierre, Morphologie urbaine et parcellaire, ed. Presses Universitaires de Vincennes, col. Espaces, Novembre 1988, p. 141 29_ PLU de Créon http://www.mairiecreon.fr/upload/ document_201601291
Fig. 36_ (en haut à gauche) Plan de situation d’une partie de Créon Source : d’après Géoportail Fig. 37_1,2 et 3 Coupes urbaines schématiques, la dilatation du bâti du centre vers la périphérie Source : d’après Google maps et arpentage dans Créon
36 Rue Galilée
≈ 5m
105
1 Rue Galilée 1
2
3
Bâti dense / 2 niveaux
100m
≈ 20m
2 Boulevard Victor Hugo
Trottoirs étroits
Voie très étroite / 1 sens
D
Créon, Nouvelle-Aquitaine Google, Inc. Street View – mai 2016
https://www.google.fr/maps/@44.7758392,-0.3474463,3a,75y,221.63h,101.36t/data=!3m6!1e1!3m4!1sRqpvhGkJ77Tg0WhZcl0Pvg!2e0!7i13312!8i6656
16/12/2017
18 Rue George Sand - Google Maps
18 Rue George Sand
Bâti éparse / 1 niveau
Trottoirs larges
Voie plus large / 2 sens ≈ 22m
3 Rue George Sand
Bâti très éparse / 1 niveau
Jardins / Seuil
Trottoirs larges
Voie moyenne / 2 sens
Date de l'image : sept. 2008
Créon, Nouvelle-Aquitaine
© 2017 Google
106
continuant d’habiter la bastide, son héritage continue à être transmis et la morphologie urbaine est préservée. Cependant, nous pouvons nous questionner sur les limites de croissance de la ville. Jusqu’à quel point de la bastide peut-elle assurer une permanence de sa morphologie ? La bastide présente une forme de permanence perceptible dans ses tracés et ses traces qui est justifiée par l’investissement continu de la cité. L’appropriation de la cité engendre sa pérennité. Créon est devenu un ensemble composé d’une bastide, que nous interprétons comme un cœur médiéval et un développement contemporain. Ils se complètent aujourd’hui mais posent question quant à leur devenir. Même si la ville a montré que son potentiel de croissance surpassait les intentions conceptrices ce dernier siècle, l’évolution s’intensifie et pose problème quant aux nouvelles possibilité d’appropriation. Ainsi, la transmission de l’héritage est en péril et la bastide, se doit d’anticiper une croissance bouleversante pour la cité médiévale. Les traces du Moyen-Âge subissent des interprétations qui permettent d’habiter la bastide avec une certaine flexibilité. C’est ce phénomène d’appropriation qui permet le développement de la mémoire collective et génère ainsi une transmission d’un héritage. D’un point de vue architectural, cet héritage pose question quant à sa nature, il semble être le résultat d’une stratification bâtie plus ou moins éloignée du Moyen-Âge. Cependant les traces urbaines indiquent que la trame de la ville est permanente, nous pensons que c’est elle qui constitue le véritable héritage de la bastide.
107
b_ Vers une protection de la bastide
Dès le XIXe siècle, l’évolution parcellaire de la cité dévoile des effacements de l’héritage médiéval (voir fig. 37 p.). Même si le processus d’effacement des traces du passé est lent, le plan exprime une appropriation des parcelles dont la tendance est aléatoire. Entre autres, nous pouvons observer que l’îlot au Sud-Ouest de l’église s’approche plus d’une typologie médiévale au XXIe siècle (voir fig. 38 p.) qu’au XIXe. Cette évolution brouille la lecture de la ville et nous pouvons penser qu’elle est le résultat d’un changement cadastral récent et non pas d’une division d’origine. Par ailleurs, nous observons dans la comparaison des deux cadastres, qu’une stabilité parcellaire apparaît dans la zone inscrite attenante à la place. Ainsi, le recours à la l’inscription surgit comme une solution envisageable pour continuer à transmettre cet héritage urbain. Néanmoins, cette requête pose question pour deux raisons différentes. Tout d’abord au sujet de son efficience, la mise en place d’un secteur protégé entraîne t-elle nécessairement des processus de valorisation du patrimoine ? Cette question émerge au regard de la fiche d’inscription de la place de la Prévôté rédigée en 2012 (voir Annexe 17 p.147) énonçant des principes de valorisation de la place qui ne sont pas mis en application aujourd’hui. Ainsi, la valeur historique du cœur de la bastide est reconnue et chaque intervention entraîne des démarches de sauvegarde, cependant sa valorisation est laissée de côté faute de moyens. L’héritage continue de fluer via la permanence de la cité, mais cette continuité de la trame urbaine, peu valorisée, expose la bastide à un risque d’altération plus grand. D’autre part, l’inscription questionne la
108 Fig. 38_ Plan parcellaire du XIXe siècle des modifications apportées aux parcelles en lanières Source : d’après le cadastre napoléonien cadastre.gouv et le PLU de Créon NB : L’analyse est issue d’une interprétation personnelle de la morphologie parcellaire 50m
Parcelles en lanières identifiables au XIXe siècle Parcelles modifiées comportant des traces d’un découpage en lanières au XIXe siècle Autres parcelles distinctes de la typologie médiévale Périmètre de la zone inscrite en 1965
109 Fig. 39_ Plan parcellaire du XXIe siècle des modifications apportées aux parcelles en lanières Source : d’après le cadastre actuel, cadastre.gouv et le PLU de Créon NB : L’analyse est issue d’une interprétation personnelle de la morphologie parcellaire 50m
Parcelles en lanières identifiables au XXIe siècle Parcelles modifiées comportant des traces d’un découpage en lanières au XXIe siècle Autres parcelles distinctes de la typologie médiévale Périmètre de la zone inscrite en 1965
110
transmission de l’héritage par le biais du patrimoine habité. De fait, nous pensons qu’une certaine flexibilité de la bastide est nécessaire à une appropriation. Ce phénomène intervient comme une moyen à la transmission de l’héritage. Selon Jean-Marie Vincent30 « ces populations se constituent des racines. Elles se réapproprient le patrimoine d’un lieu. En ce sens le patrimoine peut et doit être facteur d’intégration »31. C’est parce que la bastide de Créon est un patrimoine habité qu’elle assure une continuité de son héritage. La volonté de sauvegarde peut mener la politique de la ville à instaurer une ZPPAUP32 par exemple, comme c’est le cas dans d’autres bastides françaises33. Par les réglementations engendrées par une mesure telle, l’intention de sauvegarde et de valorisation remet en question ce phénomène d’appropriation. Indirectement elle fragilise la transmission de l’héritage en imposant des contraintes de flexibilité qui ne suivent pas l’évolution de la façon d’habiter. Ainsi, le choix d’un équilibre entre sauvegarde et appropriation permet d’offrir une continuité à la bastide.
30_ Inspecteur général de l’architecture et du patrimoine, Viceprésident de la section française de l’ICOMOS 31_ BAILLY G-H et LAURENT Philippe, «Le patrimoine des halles», Info Bastide, n°41, Avril 1999, p.13 Ce numéro rendait compte d’un circuit passant par Créon, organisé par le CEB pour le Comité International des Monuments et des Sites (ICOMOS) qui avait retenu “les bastides“ comme l’un des thèmes de discussion de la 12ème assemblée générale à Mexico en Octobre 1999 32_ Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et paysager 33_ à VillefrancheDu-Rouergue (12) en 2003 par exemple Fig. 39_ Photographie de la devise de Créon en latin sur une façade dans la bastide «exigua quisem sed strenua», en français : Petite certes, mais active Source : Réalisée en Octobre 2017
111
112
Conclusion_ L’affirmation d’une structure urbaine caractéristique, dès la fondation de la bastide, implique par ses choix morphologiques une détermination des usages par une simplicité d’organisation. Le plan orthogonal rompt avec la complexité des villes médiévales bâties en stratification. À la fin du Moyen-Âge, l’ambition de la bastide de créer une rupture avec les fonctionnements urbains médiévaux fait preuve d’avant-gardisme. La création d’une place1, l’exclusion de la religion, l’autonomie, l’orthogonalité du tracé et la régularité de la structure bâtie composent autant de traces qui témoignent d’une contradiction avec le contexte géopolitique médiéval. Les fondements de la bastide renforcent sa prospérité et s’inscrivent aussi dans une logique nouvelle, en la plaçant au sein d’un maillage territorial fonctionnel, son autonomie et son essor économique sont assurés. De plus, sa construction ex-nihilo lui assure un contrôle participant à sa pérennité. Ces principes établis prospèrent à la Renaissance et fonctionnent encore aujourd’hui, c’est en ce sens qu’ils sont innovants pour le XIVe siècle. L’identité d’une culture est générée en grande partie par le contexte dans lequel elle évolue. L’urbanisme est un élément de la construction de l’identité. La nouvelle planification de l’espace entraîne les populations de la bastide à s’approprier un contexte nouveau qui rompt avec des principes familiers. Les repères de la ville traditionnelle médiévale sont bouleversés, les perspectives des rues perdent leurs effets sinueux pour laisser place à une lecture claire des centres d’intérêt. La bastide comme ville médiévale renvoie
1_ La place à la Renaissance Source : http://unt. unice.fr/uoh/espaces-publics-places/ la-place-de-la-renaissance/
113
à une nouvelle vision de la ville. Elle n’est plus une conséquence des événements passés traduits par une composition stratifiée des structures viaires et parcellaires, mais au contraire, une entité qui génère des événements. Les notions d’identité et d’appropriation participent à la volonté de transmission des valeurs novatrices établies dès le XIVe siècle. L’établissement rigoureux des principes de fondation permettent de resserrer le lien entre les populations et le lieu investi.
2_ Définition de l’identité «Caractère de ce qui demeure identique ou égal à soi-même dans le temps» Source : http://www. cnrtl.fr/definition/identit%C3%A9
L’appropriation attribue une notion identitaire à la bastide et déclenche une volonté de transmission de l’expérience des habitants, ainsi nous pouvons parler de patrimoine. L’expression du patrimoine que constitue la bastide se traduit par la continuité de la structure urbaine de la ville, qui malgré les évolutions conserve une similitude dans son plan : l’orthogonalité et la régularité des structures viaires et parcellaires. D’après le CNRTL, l’identité est synonyme de permanence2. Ce qui nous amène à penser que la bastide génère des continuités depuis le Moyen-Âge d’un point de vue social -avec l’identité- et d’un point de vue urbanistique -avec la permanence-. Au cours des sept siècles passés, les politiques de la villes liées à l’extension urbaine ont choisi d’intervenir à l’extérieur de la cité médiévale en périphérie principalement. La permanence du modèle urbain est perçue simultanément en tant que cause et conséquence de l’héritage. En effet, elle représente la volonté première, dès la fondation, de créer une structure viaire et parcellaire pensée pour durer grâce à une prospérité économique. Mais elle est aussi la résultante de cette intention en raison du développement d’une mémoire collective. L’étude comparée de différentes bastides fait
114
apparaître la théorie de permanence avec des structures régulières pour la plupart. Au XIXe siècle, lorsque le tissu bâti de Créon s’étend, les acteurs de la ville ont une part foncière disponible dans le centre bourg, mais le besoin de bâtir prend forme majoritairement en dehors de la structure du XIVe siècle. Les îlots conservent leurs formes tandis que des nouvelles constructions impactent le dessin des parcelles en lanières. Cette mutation montre qu’il est plus aisé de donner une continuité aux réseaux viaires qu’aux structures parcellaires. Ainsi, les modifications des réseaux de voiries et de parcelles subissent des changements, sans êtres dénaturées, ils restent toujours identifiables tels que des caractéristiques de la bastide, c’est ainsi que l’on parle d’héritage. Nous avons vu, à travers plusieurs exemples que la bastide se fragilise au cours du temps. Pour cause, les politiques urbaines déploient diverses interprétations de l’héritage transmis. Même si le schéma en damier persiste et implique une intuition de respect, la transmission n’est pas toujours une priorité politique et la mémoire collective doit faire face aux problématiques d’évolution. De nos jours, la régularité de la bastide pose question : elle présente des possibles continuités au XXIe siècle. Mais jusqu’où le modèle de la ville peut-il assurer le maintien de sa permanence? Ce pléonasme décrit les limites d’un patron urbain créé pour durer, aujourd’hui en péril. Nous pouvons difficilement envisager un centre ville d’un tel gabarit pour une ville qui continue de s’étendre. L’expansion urbaine peut coexister avec le cœur médiéval.
115
Actuellement, le rapport entre le nouveau et l’ancien exprime une relation de respect au sein de laquelle la périphérie créonnaise se lit comme un écrin protégeant le centre ancien. Cet couronne habitée apporte une continuité à la transmission de l’héritage car elle s’inscrit dans le prolongement des tracés urbains. Cependant cette logique d’implantation a des limites. Si la croissance urbaine s’intensifie, le gabarit de la ville contemporaine devient disproportionné face à son centre ancien. Qu’en sera-t’il de l’héritage médiéval si des infrastructures telles que des lycées ou des hôpitaux apparaissent en périphérie ? La bastide pourra-t-elle continuer d’assumer son rôle de centre ? La ville sera-t-elle morcelée à partir des tracés originaux ?
Le phénomène d’appropriation induit la permanence du modèle urbain par la mémoire collective. Grâce à l’investissement continu de la cité, l’héritage peut être transmis, mais cette appropriation, sans mémoire collective, peut endommager son caractère. Cette fragilité suscite des questionnements concernant la mise en oeuvre d’une reconnaissance officielle de ce patrimoine habité. En effet, nous avons démontré qu’elle est un témoin du Moyen-Âge. Cependant, sans réglementation liée à sa valeur médiévale, ce modèle urbain est voué à disparaître. Pour y remédier, le recours à la protection peut être un aboutissement qui pose question quant à la véritable nature de l’héritage et de son processus de transmission. Nous pouvons penser que si, à l’avenir, la bastide de Créon fait l’objet de protections plus restrictives qu’aujourd’hui, la transmission de l’héritage via l’appropriation sera altérée.
116
117
SOMMAIRE_ Bastide................................................................................................ Carrérot................................................................................................. Identité....................................................................................... Morphologie
urbaine......................................................................
Lexique
118
BASTIDE Villes neuves appelées «bastides». « Bastida seu villa nova », «bastida seu populatio », les deux expressions reviennent sans cesse. Bastide, en languedocien, désigne proprement une construction, sans plus, et a pris, par extension, le sens de ville en construction, d’où ville neuve1.
1_ Saint-Blanquat Odon. Comment se sont créées les bastides du Sud-Ouest de la France. In: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 4e année, N. 3, 1949. p. 278
Aujourd’hui le mot « bastide » semble renvoyer à une réalité facile à définir, évoquant un type bien particulier de villages pittoresques, dont les caractéristiques sont stables : un village créé au XIIIe ou au XIVe siècle dans le Sud-Ouest de la France selon un plan orthogonal dont le lotissement de maisons individuelles s’organise autour d’une place centrale à arcades, équipée d’une halle et dont l’exemple le plus célèbre est Monpazier en Dordogne (voir fig.). Mais en y regardant de plus près et surtout en lisant les historiens spécialistes de l’occupation du sol au Moyen-Âge, on découvre que les ambiguïtés sont nombreuses. Ce mot « bastide » renvoie en effet à un ensemble de définitions qui reflètent la complexité historique d’une notion dans ses aller-retour entre un urbanisme médiéval typique du Sud-Ouest de la France, une organisation du terroir ou enfin une construction rurale et fortifiée, d’époque plus récente, localisée en Provence2.
2_ FRAYSSE Patrick et RÉGIMBEAU Gérard, Signes et formes dans la revalorisation d’un modèle urbain du SudOuest de la France : quand les bastides se refont une beauté, 2324 novembre 2007, Colloque international Le Beaudans la ville, Tours
Il existe plusieurs configuration de plan de bastide, toutefois, les bastides à deux axes perpendiculaire comme Créon, sont considérées comme les plus typiques et sont la plupart du temps, celles qui sont retenues dans le sens commun, leur modèle est le plus élaboré. Ce plan se réfère à l’organisation des villes antiques qui se sont formées à l’intersection de deux axes perpendiculaire, dont le plan en échiquier s’est constitué autour3.
3_ DUBOURG Jacques, Histoire des bastides: les villes neuves du Moyen-Âge, ed. SudOuest, Bordeaux, col. Référence, Novembre 2002, p.162
119
CARREROT 4_ http://bastidess. free.fr/bastideArchitecture.htm
En langue d’Oc, ce terme signifie «petite rue». Les carrerots sont les rues secondaires, elles croisent perpendiculairement les axes principaux4. IDENTITÉ
5_ BAUDRY Robinson, JUCHS Jean-Philippe, Définir l’identité, Éditions de la Sorbonne, Paris, 2006, p.155
L’identité est un trait de caractère qui se réfère à un lieu, à une culture ou à une ethnie. Ici, nous parlerons d’identité des populations en référence au lieu et à son architecture, forts et caractéristiques : la bastide. «L’historiographie elle-même, depuis une quinzaine d’années environ, tend à montrer que l’identité est une notion parfaitement opératoire pour l’analyse historique.5» En effet, l’identité porte une connotation historique et il est intéressant d’étudier l’attachement identitaire de certains habitants à la bastide étant donné que la majorité entretiennent une relation entre leur intérêt historique et leur attachement sentimental à la cité. MORPHOLOGIE URBAINE
6_ D’après Programme de recherche TLFÉtym, http://www.atilf. fr/tlf-etym, ATILF CNRS & Université de Lorraine.
D’après son étymologie, la morphologie est science qui étudie la forme et la structure des organismes6. La morphologie urbaine englobe les structures viaires et parcellaires de la bastide, elle décrit la composition de la ville : son tissu bâti (la densité ou la répartition), son organisation viaire ou encore les dispositifs parcellaires liés au cadastre. Grâce à l’analyse des strates de construction de la ville, la morphologie urbaine témoigne d’une évolution historique liée à une culture ou une politique.
120
Bibliographie
122
Bibliographie_ Ouvrages_Patrimoine ■ CHOAY Françoise L’allégorie du Patrimoine, ed. Seuil, Paris, col. Couleur des idées, 1992, 272 p. ■ Collectif sous la direction de GRAVARI-BARBAS Maria, Habiter le patrimoine:
Enjeux, approches, vécu, ed. Presses universitaires de Rennes, col. Géographie sociale Rennes, 2005
■ LE CORBUSIER, La charte d’Athènes suivi de entretien avec les étudiants des écoles d’Architecture, ed. Seuil, col. Points, 1942, 189 p. ■ RICOEUR Paul, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Editions du Seuil, Essais,
2000, p. 143 ■ VIOLLET-LE-DUC Eugène, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, tome 6, ed. B. Bance, 1859, Paris p. 250
Ouvrages_Urbanisme et architecture ■ BLANQUART Paul, Une histoire de la ville Pour repenser la société, ed. La découverte, col. Cahiers Libres, Août 1997, 193 p. ■ DOUADY Clément-Noël, De la trace à la trame : la voie, lecture du développement urbain, ed. L’Harmattan, Paris, 2014, 255p. ■ HEERS Jacques, La ville au Moyen-Âge, ed. Fayard, Octobre 1990, Saint-AmandMontrond, (Chap. III Les villes neuves) pp.127-145 ■ LAVEDAN Pierre, Qu’est-ce que l’urbanisme ? Introduction à l’histoire de l’urbanisme, , ed. Histoire de l’urbanisme, I, Antiquité, Moyen âge; II, Renaissance et Temps modernes, 2 vol., Paris, 1941, pp 11,18 ■ LAVEDAN Pierre, Les villes françaises, ed. Vincent, Fréal & Cie, Paris, 1960, 219p ■ MERLIN Pierre, Morphologie urbaine et parcellaire, ed. Presses Universitaires de
Vincennes, col. Espaces, Novembre 1988, 291 p.
■ SAALMAN Howard, Medieval cities, ed. Planning and cities, Avril 1974, 127 p.
123
Ouvrages_Bastides ■ BERNARD Gilles, L’aventure des Bastides, ed. Privat, Mai 1993, 155 p. ■ CENTRE D’ÉTUDE DES BASTIDES, VILLES NEUVES D’EUROPE DU MOYEN-ÂGE, Le Livre Blanc des Bastides, ed. Privat, Mai 1993, 155 p. ■ CENTRE D’ÉTUDE DES BASTIDES, VILLES NEUVES D’EUROPE DU MOYEN-ÂGE, Les cahiers du CEB, n°6, ed. Grapho 12, 2002, 112 p. ■ COSTE Michel et DE ROUX Antoine, Bastides: villes neuves médiévales (1 vol), ed. Rempart, Paris, col. Patrimoine vivant, Avril 2007, 159p. ■ DUBOURG Jacques, Histoire des bastides: les villes neuves du Moyen-Âge, ed. SudOuest, Bordeaux, col. Référence, Novembre 2002, 382p. ■ SAINT-BLANQUAT Odon. Comment se sont créées les bastides du Sud-Ouest de la France. In: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 4e année, N. 3, 1949. pp. 278289
Ouvrages_Créon ■ LOIRETTE Gabriel, La charte des coutumes de la ville de Créon Annales du Midi : revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale, vol.64, n°20, Toulouse, 1952, pp. 283-295 ■ Mairie de Créon et Société Archéologique et Historique du Créonnais, Créon, De la fondation de la bastide au XXIe siècle, Créon, Mai 2015, 207 p.
Actes de colloque ■ CLEM (Centre de Liaison de l’Entre-deux-Mers), L’Entre-deux-Mers et son identité, Acte du septième Colloque tenu à Sauveterre-de-Guyenne les 25 et 26 Septembre 1999, L’Entre-deux-Mers et son identité, ed. William Blake & Co, Bordeaux, Octobre 2000, 314 p. ■ Collectif du CNRS, Morphologie urbaine et parcellaire, (acte de du colloque d’Arc-etSenans le 28 et 29 Octobre 1985) ed. MERLIN Pierre, D’ALFONSO Ernesto et CHOAY
124
Françoise col. Temps & Espaces, Novembre 1988, Millau, 290 p. ■ FRAYSSE Patrick et RÉGIMBEAU Gérard, Signes et formes dans la revalorisation d’un modèle urbain du Sud-Ouest de la France : quand les bastides se refont une beauté, 23-24 novembre 2007, Colloque international Le Beaudans la ville, Tours
Revues ■ CALMETTES C., PONS C. DELMAS J, FRAYSSE P. , Patrimoine et aménagement
du territoire, Info Bastide, Bulletin du Centre d’étude des Bastides, n°41, Avril 1999 ■ CHOUQUER G., Parcellaires, cadastres et paysages, Revue archéologique du Centre de la France, n°32, 1973, pp. 205-230 ■ FOUCAULT Michel, Dits et écrits 1984, Des espaces autres (conférence au Cercle d’études architecturales, 14 mars 1967), in Architecture, Mouvement, Continuité, n°5, octobre 1984, pp. 46-49
Sources orales ■ Entretien avec Jean-Marie Darmian, ancien président de l’Union des Villes Bastides de Gironde et ancien maire de Créon de 1995 à 2014 (15/04/2017) ■ Entretiens avec Sylvie Desmond, adjointe au maire de Créon en charge de la vie associative, du patrimoine et de la mémoire (05/2017-11/2017) ■ Manifestation de la Fédération Régionale des Bastides de la Nouvelle Aquitaine «La ronde des bastides» à Montflanquin (30/09/2017) ■ Entretien avec Pierre GACHET, maire actuel de Créon (10/2017) ■ Entretien avec Roger CAUMONT, ancien maire de Créon de 1977 à 1995 (30/10/2017)
125
Sites internet ■ Centre d’étude des bastides (consulté le 06/03/2017) http://www.bastides.org/regularite.html ■ Charte des coutumes de la ville de Créon (consulté le 04/05/2017) http://www.persee. fr/doc/anami_0003-4398_1952_num_64_20_5934 ■ Mairie de Créon (consulté le 10/04/2017) http://www.mairie-creon.fr/historique-dela-ville.html ■ Plan Local d’Urbanisme de Créon http://www.mairie-creon.fr/upload/document_20160129180914.pdf (consulté le 10/04/2017) ■ Cartographie et environnement (consulté le 08/2017) http://www.observatoire-environnement.org/OBSERVATOIRE/ ■ Carte de Guyenne (consulté le 03/09/2017) https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ commons/8/8d/Carte_de_la_Guyenne.svg ■ Le plan hippodamien (consulté le 03/09/2017) https://www.universalis.fr/encyclopedie/hippodamos-de-milet/ ■ Exode rural / exode urbain (consulté le 16/09/2017) http://oekoumene.fr/blog/2011/03/10/l%E2%80%99urbanisation-francaise-depuis-la-revolution-industrielle-1800-2010/ ■ La bastide de Monflanquin (consulté le 20/09/2017) http://patrimoinmonflanquin.free. fr/carrerot.htm ■ Dictionnaires et étymologies (consulté le 12/10/2017) http://www.cnrtl.fr/etymologie/ permanence ■ L’abbaye de la Sauve-Majeure (consulté le 20/11/2017) http://www.petit-patrimoine. com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=33505_1 ■ La place urbaine à la renaissance (consulté le 25/11/2017) http://unt.unice.fr/uoh/espaces-publics-places/la-place-de-la-renaissance/ ■ Atlas des sites classés et inscrits de la Gironde (consulté le 25/11/2017)
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Atlas_Sites_Gironde_ cle0661c1.pdf
Table des matières
128
TABLE DES MATIÈRES_ Sommaire.....................................................................................................................................3 Remerciements.........................................................................................................................4 Avant-Propos.............................................................................................................................6 Définition des termes..........................................................................................................10 Introduction................................................................................................................................14 Chapitre I_ Réseau viaire et tracés.......................................................................20 1_ L’expression du pouvoir politique: s’implanter ex nihilo......................18 a_ La rigueur de la fondation comme résistance aux pouvoirs médiévaux b_ L’autonomie de la bastide, une permanence amorcée 2_ Le maillage territorial: la mise en réseau des cités................................42 a_ Un territoire existant avantageux à la croisée des chemins b_ Créon et son territoire aujourd’hui : Bouleversements ou continuité des tracés? 3_ Le tracé des rues et des espaces publics: la trame adaptée.......................56 a_ La hiérarchie des axes, une logique d’espaces publics b_ Les tracés, réflecteurs temporels
129
Chapitre II_ Parcellaire et traces................................................................................66 1_ Le bâti et la structure parcellaire.....................................................................70 a_ Adaptation à la trame parcellaire b_ Hiérarchie du bâti et espaces publics 2_ La bastide, opportunités et limites...................................................................92 a_ S’étendre, une continuité ? b_ Stratification ou conservation ? 3_ Les traces et la trame ......................................................................................102 a_ Une transmission adaptable b_ Vers une protection de la bastide
Conclusion................................................................................................................................110 Lexique.......................................................................................................................................114 Bibliographie............................................................................................................................118 Annexes.....................................................................................................................................128
SOMMAIRE_ Chapitre I_ A1_ Frise chronologique.................................................................................130 A2_ Interprétation de la charte des coutumes (1952).............................132 A3_ Un exemple de bastide de crête : Monflanquin...............................133 A4_ Prieurés de la Sauve Majeure au XIIe siècle........................134 A5_ Répartition des bastides d’Europe...................................................135 A6_ Les juridictions en Entre-Deux-Mers au XIVe siècle...................136 A7_ Carte de Gironde en 1854 par Lavasseur...................................137 A8_ Carte des pistes cyclables.................................................................138 A9_ Maquette des dispositifs de rues dans la bastide.............139 A10_ influence urbaine des villes en Gironde au XXIe siècle...140 A11_ Plan d’alignement de Créon en 1869..............................................141 A12_ Compte rendu
du conseil municipal du 13 Juin 1869...142
Chapitre II_ A13_ Plan de la structure urbaine de Monpazier......................................143 A14_ Plans du projet du Centre culturel de Créon.....................................144 A15_ Plan d’étude de masse de la bastide de Créon (1970)................145 A16_ Plan du site inscrit de Créon, PLU....................................................146 A17_ Fiche descriptive du site inscrit........................................................, 147
Annexes
132
Annexe 1_
Aquitaine française
Aquitaine anglaise
1154 1154
1229 1229
1337 1337
1453 1453
Traité Traitédede Meaux-Paris Meaux-Paris Fin Findede l’indépenl’indépendance dancedudu comté comtédede Toulouse Toulouse
couronneananLaLacouronne glaiseconteste conteste glaise légitimitédede lalalégitimité PhilippeVIVIdede Philippe Valois,héritier héritier Valois, trônedede dudutrône France France
Bataille Batailledede Castillon Castillonetetfinfin dedelalaGuerre Guerredede Cent CentAns Ans
1208 1208
LaLaduchesse duchessed’Aquid’Aquitaine, taine,Aliénor Aliénord’Aquid’Aquitaine taineetetson sonmari, mari,Henri Henri Plantagenêt, Plantagenêt,deviennent deviennent rois roisd’Angleterre. d’Angleterre.Début Début d’un d’unécartèlement écartèlemententre entre lalaFrance Franceetetl’Angleterre l’Angleterre
Première Première croisade croisade contre contrelesles albigeois albigeois
Guerre des albigeois
Guerre de Cent Ans
1339 1339
13 13Juin Juin1315 1315 1000
1100
Fondation Fondationdedel’abl’abbaye bayedans danslalaSilva Silva Major Major
1069 1069
Construction Construction des desfortificafortifications tionssuite suiteà à des despillages/ pillages/ incendies incendies
FONDATION FONDATIONDE DELALA BASTIDE BASTIDEDE DECRÉON CRÉON PAR PARUN UNSÉNÉCHAL SÉNÉCHAL DU DUROI ROIANGLAIS ANGLAIS
1200
Litige Litigeentre entre lesleshabitants habitants dedeLaLaSauve Sauve etetl’abbé l’abbé Bertrand Bertranddede Saint SaintLoubès Loubès
1249 1249
1400
Apogée ApogéededelalaSauve Sauve Majeure, Majeure,l’abbaye l’abbaye rayonne rayonneenenFrance Franceetet enenEurope Europeoccidenoccidentale, tale,elle elleest estununlieu lieu dedepèlerinage pèlerinage
Début DébutXIVè XIVès.s.
Période de fondation des bastides dans le Sud-Ouest de la France
Fondation Fondationdedelala première premièrebasbastide tide: Cordes : Cordes (Tarn (Tarn81) 81)
1222 1222
Fondation Fondationdedelala dernière dernièrebasbastide tide: Labastide : Labastide d’Anjou d’Anjou(Aude (Aude 11) 11)
1373 1373
1500
Frise chronologique
133
FAITS HISTORIQUES LIÉS AU TERRITOIRE
Aquitaine française
1630 1630
1549 1549
Créon Créontouché touché par parlalapeste peste
1600
Fin FinXVè XVès.s.
1906 1906
Première Première municipamunicipalité lité
DestrucDestruction tiondedelala halle hallesur sur lalaplace place
ConstrucConstruction tiondedelala Mairie Mairie
1800
1900
1965 Inscription de la place de la Prévôté et de ses façades à l’inventaire départemental
2000
LA SAUVE
Reconstruction Reconstructiondede lalaSauve SauveMajeure, Majeure, l’abbaye l’abbayea aperdu perdudede son sonimportance importanceetet lalaville villeest estenenrivalité rivalité économique économiqueavec aveclala bastide bastidededeCréon Créon
1700
1872 1872
CRÉON
Construction Construction dudusiège siègededelala prévôté prévôtéroyale royale dedel’Entrel’EntreDeux-Mers Deux-Mers
1790 1790
Apogée ApogéededelalaSauve Sauve Majeur, Majeur,l’abbaye l’abbaye rayonne rayonneenenFrance Franceetet enenEurope Europeoccidenoccidentale, tale,elle elleest estununlieu lieu dedepèlerinage pèlerinage
1882 1882
1965 1965 Création CréationduduCentre Centre d’Étude d’Étudedes desBastides Bastides
1982 1982
Publication Publication duduLivre Livre Blanc Blancqui quidédéfinit finitl’histoire l’histoire des desbastides bastides etetleslesreconreconnaît naîtcomme comme héritage héritage médiéval médiéval
2007 2007
BASTIDES ET PATRIMOINE
Arrêté ArrêtéNational Nationalcontre contrelaladestruction destruction des desarcades arcadesetetpour pourlalavalorisation valorisationdedelala place placeauausein seindes desbastides bastidesdedeFrance France
134
Annexe 2_ Interprétation de la Charte de coutumes de 1315 de la bastide de Créon qui énonce les principes de fonctionnement lors de la fondation de la cité
Chapitre 1
L O I R E T T E Gabriel, La charte des coutumes de la ville de Créon Annales du Midi : revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale, vol.64, n°20, Toulouse, 1952, pp. 283295 Source : http:// www.persee.fr/ doc/anmi_00034398_1952_ num_64_20_593
135
Fig 1_ (en haut) Photographie d’une bastide de crête, Monflanquin dans le Lot-et-Garonne (47). Source : http://www. ccbastides47.com/ monflanquin Fig 2_ (à droite) Plan de Monflanquin Réalisé en Novembre 2017 d’après Le Livre Blanc des Bastides, p.45
50m
Annexe 3_ 1_ On entend par «rythme» une régularité du plan des voiries qui détermine des sections d’axes équivalentes se coupant à angle droit.
2_ La petite taille de la cité et son faible nombre d’habitants à l’origine, permet une visibilité sur son fonctionnement
Chapitre 1
L’exemple de Monflanquin, une bastide de crête illustre le fait que le plan orthogonal est appliqué quelles que soit les conditions. En dépit d’une forte déclivité, probablement à l’origine d’une volonté militaire, on remarque un respect rigoureux de l’orthogonalité des axes. Ces axes qui rythment1 la bastide sont le reflet d’un parti pris politique franc, d’une volonté d’hygiène de l’espace et de contrôle des usages2. Ces axes sont aujourd’hui encore lisibles. Comme l’explique l’urbaniste Pierre Lavedan, cette géométrie s’assimile à l’application du triangle de Pythagore en urbanisme, Monflanquin décrit son extrême limite théorique car la topographie aurait dû entraîner une solution pratique prenant en compte les courbes de niveau. Mais le schéma classique a été appliqué sans concession à la réalité topographique et l’un des coins de la place met clairement en exergue le centre du tracé de la bastide3. (voir fig. 1_)
136
Royaume d’Angleterre
Annexe 4_ Domaine royal Domaine en1270royal en1270 Apanages et Apanages fiefs deset fiefsprinces des princes
Manche Saint Empire
Autres fiefs de Autres fiefs de la mouvance la mouvance capétienne capétienne
Duché de Normandie
Fiefs du roi Fiefs du roi d’Angleterre d’Angleterre
Duché de Bretagne
Seigneuries Seigneuries ecclésiastiques ecclésiastiques Abbaye de La Abbaye de La Sauve-Majeure Sauve-Majeure
Chapitre 1
Prieurés de La Prieurés de La Sauve-Majeure Sauve-Majeure
Océan
Comté de
Comté d’Anjou
Blois
Comté de Poitou
Atlantique
Fig. 7_ Appartenances territoriales des royaumes français et anglais au XIIIème siècle «L’abbaye de la sauve majeure et le conflit entre Plantagenêts et Capétiens» Réalisation Novembre 2017 d’après le L’EntreDeux-Mers et son identité, p.97
Comté du Maine
Comté de Champagne
Comté de la Marche
Duché de Bourgogne Comté de Nevers Bourbon
Comté du Périgord Duché de Guyenne
Duché de Guyenne
Royaume de Navarre
Royaume de Castille
Mer Méditerrannée Royaume d’Aragon
100km
137
Annexe 5_ La répartition des bastides médiévales en Europe Le phénomène de création de villes neuves au Moyen-Âge ne se restreint pas au territoire français, ces dispositifs sont mis en place aussi au Portugal, au Nord de l’Espagne, au Pays de Galles, dans le Nord de l’Italie, en Pologne, en République Tchèque et en Slovaquie.
200km
Chapitre 1
Source : d’après Le Livre Blanc des Bastides, Centre d’étude des bastides, villes neuves du Moyen-Âge, 2007
138
Annexe 6_ Bordeaux
Fig_ Les juridictions de l’Entre-DeuxMers bordelais à la fin du XIIIème siècle et la fondation de la bastide de Créon
Garonne
Chapitre 1
d’après le Livre de L’EntreDeux-Mers et son identité, p.102
10km
Dordogne
Entre-Deux-Mers
10km
Source :
1 Limite de paroisse 2 Limite de juridiction 3 Château siège de juridiction 4 Abbaye siège de juridiction 5 commanderie siège de juridiction 6 Bastide siège de juridiction 7 Autre siège de juridiction 8 Prévôté d’entreDeux-Mers et prévôté ducale 9 Seigneuries laïques 10 Juridiction ecclésiastique 11 Juridiction urbaine 12 Juridiction de Créon telle qu’elle est présentée dans la charte de franchise de 1315
Créon
50km
Créon
139
Annexe 7_ LEVASSEUR Victor, Carte de Gironde au XIXème siècle, col. A. Combette, ed. de Lemercier, Paris, 1854
Chapitre 1
Source : l’Atlas national illustré des 86 Départements et des Possessions de la France divisé par Arrondissements, Cantons et Communes avec le tracé de toutes les routes, chemins de fer et canaux. Dressé d’après les Travaux du Cadastre du Dépôt de la Guerre et des Ponts et Chaussées par Victor Levasseur, Ingénieur Géographe attaché au Génie du Cadastre et de la Ville de Paris. Gravé sur acier par les meilleurs artistes.
140
Annexe 8_ Carte des pistes cyclables en Entre-DeuxMers, en vert la piste cyclable, ancienne voie ferrée passant par Créon Source :
Chapitre 1
http:// www.tourisme. fr/282/office-detourisme-creon.htm
141
Annexe 9_ Maquette des diverses rues en bastides. nous pouvons repérer trois gabarits de rues, seulement trois apparaissent à Créon.
Andronnes
Carrérots
Rue secondaire
Carreyras
Cet espace entre Rue piétonne Accessible pour
Rue principale
deux maisons
dans laquelle
une charrette
mitoyennes limite
deux charrettes
les propagation
peuvent se croiser
d’incendies 500m
Chapitre 1
Source : Bastideum de Monpazier
142
Annexe 10_ Carte des zones d’influences urbaine en Gironde dans les annÊes 2000
Chapitre 1
Source : http/ / m a p p e monde-archive. mgm.fr/num21/ articles/banzoF2_v
143
Annexe 11_ Plan d’alignement de la bastide en 1869
Chapitre 1
Source : Archives municipales
144
Annexe 12_ Page du conseil municipal du 13 Juin 1869 : approbation des modifications d’alignements de façades dans les rues de la bastide
Chapitre 1
Source : Archives municipales
145
Annexe 13_ Plan de toiture et façade de l’entrée du centre culturel Source : dossier du projet en 1987 par l’agence HPL, Archives municipales
2m
Lecture des parcelles en lanières encore visible
1m
Chapitre 2
Lecture des parcelles en lanières effacée
2
ENVIRONNEMENT, PATRIMOINE ET CADRE DE VIE 146
Annexe 14_ Plan du périmètre site inscrit le 23 Mars 1965 : La place de la Prévôté et ses abords Source : PLU 2010 de Créon, Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine de la Gironde 20m
ADRE DE VIE
Bâtis cités dans l’arrêté de protection du 23/03/1965
Chapitre 2
Le périmètre du site inscrit de la place de la Prévôté (source : STAP de la Gironde)
Parcelles ayant changé de numérotation Site inscrit non bâti
de Créon - Rapport de présentation Extrait de PLU l’arrêté concernant le site inscrit :
«Place de la Prévôté (non cadastrée), et immeubles qui la bordent, parcelles n°156 à 161, 161 à 167, 179, 180 à 183, 243 à 246, 256 à 258 et 267 à 273. Section AB du cadastre. En ce qui concerne les immeubles bâtis, cette mesure ne s’applique qu’aux façades (y compris las arcades) et aux toitures (23 Mars 1965)»
147
À Créon, les arpentins, du sénéchal de Guyenne tracent des lots de 20 pieds de largeur (soit 6 m) et d’une profondeur avec jardins calculés méticuleusement sur la base du carré de l’hypoténuse*.
Annexe 15_ Plan de l’organisation géométrique de Monpazier Source : http:// bastidess.free.fr/ traceOrthogonal. htm 50m
Mairie de Créon et Société Archéologique et Historique du Créonnais, Créon, De la fondation de la bastide au XXIe siècle, Créon, Mai 2015, 207 p. *
PONS Jacques, La bastide de Monpazier, DoMonpazier cument final de synthèse, 1997, page 48. **
Chapitre 2
«Là se retrouve, de façon évidente, l'usage de La corde à 12 intervalles ou 13 nœuds pour appliquer le triangle de Pythagore. En effet, partout présent, le triangle de Pythagore répartit l'espace dans une proportion 3/4, sans oublier l'enceinte, la longueur des rues principales (dont l'intersection marque le centre de la bastide) avant les moulons (quartiers) et la place (qui n'est pas exactement le centre de la bastide).»**
148
Annexe 16_ Plan d’étude de masse de la bastide de Créon dans les années 1970, la périphérie de Créon est très peu occupée et la majorité des habitants vit dans la bastide qui, elle, n’est pas réellement touchée par l’expansion urbaine.
Chapitre 2
Source : Archives municipales
Place de la Prévôté et immeubles
Gironde
149
Critère(s) de la protection
Superficie(s)
Type(s) de site
Référence(s) SIG
23 mars1965 (arrêté ministériel)
Site d’intérêt pittoresque
U
*YtVU
1,19 ha
Bourgs, centres anciens, bastides, places de bastides et autres ensembles de patrimoine urbain
SIN0000400
Motivation initiale de la protection « Il convient de les protéger {les places à cornières} pour éviter que les propriétaires suppriment « les couverts ». d’après l’extrait du procès-verbal de la réunion de la Commission départementale des Sites, Perspectives et Paysages de la Gironde, M. Duru, le 27/11/1961 ». 1961
2012
Etat actuel du site �n�ironne�ent du site : Le bourg de Créon se trouve dans l’Entre-Deux-Mers, à un carrefour de routes départementales qui desservent ce territoire entre la Garonne et la Dordogne. Il est implanté sur un léger relief à environ 100 m d’altitude duquel partent, en étoile, différents petits vallons. C’est une bastide du �I�e siècle dont la forme générale est presque circulaire (tour de ville sur les anciens fossés). Elle possède un plan orthogonal quadrillé, à mailles carrées ou rectangulaires qui épouse l’enveloppe circulaire. Le centre de la composition urbaine est la place marchande conformément à la composition des bastides, avec ses maisons à cornières ou couverts. C’est la place de la prév�té. L’église prend place à l’angle sud-est de la place.
DREAL Aquitaine
Description du site :
Le site protège la place de la bastide, vaste espace d’environ 5000 m2, ainsi que les parcelles présentant une fa�ade sur l’espace public. Des couverts sont présents sur trois c�tés de la place, ils s’inscrivent dans 2012 le prolongement des rues qui conduisent vers la place. Seul le c�té o� se trouve la mairie en est dépourvu. Les passages sous couvert sont réservés aux piétons, les
véhicules circulent sur le pourtour de la place. L’espace central est goudronné et entièrement dévolu au stationnement excepté les jours de marché. Si les fondements de la place et des couverts sont médiévaux, l’aspect des fa�ades est varié. La fa�ade nord de la place est assez homogène avec un alignement de maisons à un seul niveau au dessus des arcades. Les fa�ades sud et est présentent surtout des fa�ades �I�e dans un vocabulaire néo-classique avec deux niveaux de plancher au-dessus des arcades. Ces immeubles ont une double vocation commerciale et habitation. �insi, sont présents sur la place des commerces de bouche, des banques, des assurances, des détaillants. La mairie � tr�ne � sur la place par son volume imposant et son st�le � pompier �. Les arcades sont assez régulières, elles présentent des pro�ls en � anse de panier � plus ou moins large ou en plein cintre. �t�t �ctue� du site : Les b�timents qui entourent la place de la �rév�té supportés par les cornières n’ont plus le caractère médiéval d’origine mais ils assurent une belle composition urbaine et architecturale autour de la place centrale. Malheureusement la pauvreté du traitement de l’espace et l’invasion par les véhicules rendent ce site bien aride. De plus, le sol sous les arcades est disparate et sans qualité.
Fiche descriptive de l’inscription de la place de la Prévôté et des façades attenantes_ d’après la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de l’Aquitaine Source : Atlas départemental des sites de Gironde http://webissimo. developpementdurable.gouv.fr/ IMG/pdf/Atlas_ Sites_Gironde_ cle0661c1.pdf
Chapitre 2
Date(s) de protection
Créon
Place de la Prévôté et immeubles
47
Site inscrit Commune(s)
Annexe 17_
FICHE
150
Enjeux et préconisations Rendre une �me à cette place : - Réduire les surfaces de stationnement, rechercher un traitement de surface moins routier, privilégier un aménagement à caractère plus en accord avec l’ensemble architectural et �l’esprit de la bastide �. - Planter des arbres pour apporter de l’ombre, disposer des bancs. - Poursuivre la valorisation des fa�ades autour de la place et dans l’ensemble de la bastide. - Proposer un cahier des charges pour l’esthétique des
Annexe 17_ bis Les préconisations pour la conservationde ce patrimoine n’ont pas été mises en application plus de cinq ans après la prise de décision.
enseignes et pour le mobilier extérieur des commerces. • Conclusion : �a place de la prév�té est le c�ur de la bastide, entourée de couverts o� se c�toient commerces et restaurants. � la croisée des rues principales, elle conserve son r�le de p�le commercial. C’est une belle place en terme d’urbanisme et d’architecture, mais livrée aux voitures, c’est un c�ur sec � �n pro�et de réaménagement de la place est indispensable. Rédaction 2012
Cartes
L’inscription officialise la valeur du cœur de la bastide, cependant elle n’a pas le pouvoir d’engager la préservation de ce patrimoine
Place de la Prévôté et immeubles
Chapitre 2
© IGN scan 25® 2007
Source : ©BD Parcellaire - IGN 2013, droits réservés FICHE
47
Monuments historiques
MHI : « Eglise Notre-Dame », (16/04/2002) (MH en bordure de site, son périmètre se superpose avec celui du site) Zone de protection archéologique : « Le bourg : bastide médiévale ». Mode protection : prescription archéologique dans une zone autre que N du PLU
Fig.1_ Plan actuel de Créon Source : réalisé en Septembre 2017, d’après Géoportail 100m