Diffusion ACTES SUD
Août septembre 2023


Août septembre 2023

TOUS LES VISUELS PRESENTÉS DANS CE DOCUMENT SONT PROVISOIRES & PEUVENT NE
PAS REFLÉTER LA FINALITÉ DES PROJETS ÉDITORIAUX
Les visuels qui n’apparaissent pas sont toujours en cours de développement

Regards croisés sur la finance durable
Dominique Bourg et Philippe Zaouati Entretien mené par Anne-Cécile BrasComment la finance, de simple outil qui facilite le commerce, est-elle devenue, ces cinquante dernières années, le mastodonte que l’on connaît, déconnecté de toute réalité matérielle ? Aristote, premier philosophe de l’économie, alertait déjà sur la différence entre l’échange économique de biens et l’échange chrématistique, c’est-à-dire le commerce dans le seul but d’accumuler le plus d’argent possible. Avec l’invention de la monnaie est née la tentation de la démesure, de l’enrichissement infini et de la toute-puissance qui lui est associée. À tel point que l’on est en droit de se demander qui, du pouvoir politique ou du pouvoir économique, est véritablement aux manettes aujourd’hui.
Croissance et finance s’autoalimentent dans un mouvement perpétuel que rien ne semble pouvoir arrêter. Pourtant, si les zéros peuvent s’ajouter à l’infini sur les écrans des traders, les ressources de la planète sont, elles, limitées. Devant l’urgence écologique, la finance peut-elle jouer un autre rôle que celui du pompier pyromane ? Si l’ambition sincère de la finance durable est de dépasser le greenwashing pour atteindre les objectifs du développement durable, en a-t-elle réellement les capacités ? Quels sont ses outils pour y parvenir ?
Le financier met en garde : “Nous ne pouvons pas nous contenter de discuter entre professionnels de la façon d’utiliser tel ou tel critère environnemental et social pour sélectionner nos investissements. Si on ne parvient pas à « dézoomer » en adoptant une réflexion un peu plus macroéconomique, on devient des techniciens qui parlons à d’autres techniciens. C’est à mon avis le danger principal de la généralisation de la finance durable que l’on observe aujourd’hui.” Qu’en pense le philosophe ? La prise de recul est effectivement nécessaire et il est intéressant de remettre en perspective les ambitions de l’homme depuis le mécanocène, pour mieux comprendre ce qui l’a conduit à cette obsession d’aller toujours plus vite, plus loin, plus fort : “Avec l’avènement de la physique mécaniste moderne, le monde finit par apparaître comme un simple agrégat de particules distribuées de façon continue. […] Déchue du statut de déesse à celui de pure matière, la nature n’aura d’autre vocation que celle de ressource vouée à une exploitation sans fin, de ressource destinée à la création de valeur économique via le travail humain.” Il paraît dès lors urgent de redonner sa primauté au vivant. Mais alors que le réchauffement climatique est déjà en marche, la question de l’action juste se pose : faut-il se radicaliser ou est-il finalement plus pertinent de réformer le système en place ?
À travers leur échange, Dominique Bourg et Philippe Zaouati brossent un état des lieux sans concession du système financier actuel et de sa capacité à faire évoluer l’économie dans le bon sens. Avec une certitude commune :
Points forts
• Un décryptage de qualité des enjeux de la finance contemporaine.
• Des prises de position sur la nouvelle réglementation européenne.
• Deux auteurs très impliqués dans le débat écologique.
• Parution au moment du festival Agir pour le vivant, fin août à Arles.
Philosophe francosuisse, Dominique Bourg est professeur honoraire à l’université de Lausanne. Spécialiste des questions de durabilité et de démocratie écologique, il a fait partie de la commission Coppens qui a préparé la charte de l’environnement en 2005, et a présidé le conseil scientifique de la Fondation Nicolas-Hulot pour la nature et l’homme. Il a publié de nombreux articles et livres, dont Primauté de vivant (Puf, 2021) avec Sophie Swaton, et Science et prudence (Puf, 2022) avec Nicolas Bouleau.
Diplômé de l’École nationale de la statistique et de l’administration économique, Philippe Zaouati est le fondateur de Mirova, société de gestion d’actifs reconnue comme l’un des pionniers de la finance verte et durable. Fortement impliqué dans le débat public, il a contribué à la création de labels et de normes de transparence sur le climat, et a été membre du Groupe d’experts de haut niveau européen (hleg) sur la finance durable. Auteur d’essais et de romans, il intervient dans plusieurs écoles et universités.
“Même si nous pensons la catastrophe inéluctable, nous devons continuer à agir.”
 Raphael Liogier
Raphael Liogier

Voici un livre profondément original et qui fera sans doute date. Raphaël Liogier y démontre que ce n’est pas tant la modernité, que d’aucun n’ont de cesse de décrire, qui est la cause de nos divers effondrements (sociaux, psychique ou civilisationnelle) mais a l’inverse la trahison de sa promesse. Considérant l’originalité et la force de son aperçu, Khaos suscitera, a n’en pas douter, de très nombreux débats.

Couvertureprovisoire
La modernité qui nous exhorte au 18e siècle à nous affranchir de toutes les tutelles est une promesse si radicale, une ouverture si immense, si difficile à supporter qu’elle a été immédiatement trahie et dégradée. Quelle est la nature de cette promesse initiale ? Pourquoi, par qui, et dans quelles conditions cette promesse a-t-elle été trahie et détournée ? En quoi et pourquoi cette promesse pourrait-elle encore être tenue ? Et surtout en quoi et pourquoi il est plus urgent que jamais de tenir enfin cette promesse ?
Il se pourrait bien que les réponses à ces questions permettent de sortir d’un grand nombre des impasses contemporaines. Pour n’en citer que quelques-unes parmi des centaines : les fausses controverses politiques, scientifiques et éthiques, stériles et profondément toxiques, entre universalisme et communautarisme, entre modernité et postmodernité, entre progressisme et conservatisme, entre priorités écologiques et priorités technologiques, entre laïcité et religion, entre liberté et égalité, entre efficacité et équité, entre subjectivité et objectivité, entre diversité et unité. Les confusions sur les théories du genre, les théories queer et trans, les théories décoloniales, le wokisme, le féminisme, face à l’Intelligence artificielle, les manipulations génétiques, l’immortalisation et l’augmentation humaine, se ramènent toutes d’une manière ou d’une autre à l’incompréhension du sens réel de la modernité.
Depuis une vingtaine d’années RaphaëlLiogierexploredansses ouvrages les mutations de l’identité humaine. Il est notammentl’auteurauxéditions Les Liens qui libèrent de Sans emploi. Condition de l’homme postindustriel et de Descente au cœurdumâle.
Parution : août 2023
ISBN : 979-10-209-2093-5
Prix : 22 €
ESSAI
13,5 × 21,5 CM
272 PAGES
PRIX PRÉVISIONNEL
23 €
MISE EN VENTE
23 AOÛT 2023
978-2-330-18165-9
-:HSMDNA=V]V[Z^:
“


Traduit de l’anglais par Béatrice Marie
Antidote au désespoir et feuille de route pour temps très incertains, Earth for All est le pendant du célèbre rapport Meadows, Les Limites à la croissance, commandé par le Club de Rome en 1972. Cinquante ans après, toujours sous l’égide du Club de Rome, un groupe de scientifiques et d’économistes de premier plan propose deux scénarios et cinq changements de cap radicaux pour parvenir, en une seule génération, à un état de prospérité partagée sur la Terre.
Earth for All démontre de manière concluante que l’avenir de l’humanité sur une planète vivable dépendra de la réduction drastique des inégalités socio-économiques et d’une répartition plus équitable des richesses et du pouvoir. Il constitue une lecture essentielle sur le long chemin qui nous mènera vers une société où la Terre est à tous et pour tous.”
Thomas Pikettyu La notoriété du Club de Rome, réputé pour la qualité de son expertise.
u La force de conviction qui porte le livre et un appel à l’action qui tranche avec la noirceur de la collapsologie ambiante.
u Un ouvrage de prospective qui se montre très convaincant. Ni anxiogène ni idéologique.
u La rigueur scientifique (des graphiques indispensables pour asseoir le propos) ; la vocation pédagogique : un souci constant du lecteur (un peu de technicité mais pas trop ; clarté d’exposition de la méthode utilisée) ; une mise en récit réussie et un ton alerte.
u Dernière version, la plus urgente et la plus rigoureusement étayée, des scénarios issus de la science des systèmes.
u L’ouvrage paraît dans onze langues (à ce jour).
« Questions de société »
Sandrine Dixson-Declève, docteure en sciences de l’environnement, spécialisée dans les politiques publiques, est présidente de Club de Rome et responsable du projet Earth for All.
Owen Gaffney est analyste en matière de développement durable à l’échelle mondiale.
Jayati Ghosh est professeure d’économie à l’université du Massachusets (Boston) et à l’université Jawaharlal Nehru (New Delhi).
Jorgen Randers est professeur de stratégie climatique à la BI Norwegian Business School (Oslo).
Johan Rockström est co-directeur de l’institut de recherche de Potsdam (Allemagne) sur les effets du changement climatique et professeur à l’université de Stockholm. Il est internationalement connu pour son travail pionnier de formalisation des neuf limites planétaires, qui sert aujourd’hui de référence scientifique dans le monde entier.
Le projet Earth for All a débuté en 2020. Une équipe internationale de scientifiques, d’économistes et d’experts pluridisciplinaires a planché sur les possibilités de mondes alternatifs. Ils ont exploré, grâce à un modèle de dynamique des systèmes baptisé Earth for All, un large éventail d’hypothèses (qui tiennent compte du comportement humain, du développement technologique, de la croissance économique, de la production alimentaire, etc.) et leurs conséquences sur la biosphère et le climat au cours du xxie siècle.
Ils ont travaillé à partir de deux scénarios – trop peu, trop tard et le saut de géant – et cinq changements de cap visant à réduire substantiellement les risques d’effondrement :
1. mettre fin à la pauvreté ;
2. s’attaquer aux inégalités flagrantes ;
3. émanciper les femmes ;
5. opérer une transition vers l’énergie propre. Le modèle Earth for All a permis de connecter les diverses actions entre elles et d’évaluer si, ensemble, elles créent une dynamique économique qui engage très rapidement l’économie mondiale sur une voie résiliente. Résultat : ces cinq changements de cap pourraient faire disparaître la pauvreté absolue vers 2050, à condition que la prochaine décennie connaisse la transformation économique la plus rapide de l’Histoire. Une transformation plus importante que le plan Marshall, la Révolution verte, les mouvements anticoloniaux qui ont conduit à l’indépendance des nations, les mouvements pour les droits civiques, la conquête de la Lune, le miracle économique chinois des trente dernières années. C’est tout cela à la fois… et plus encore. Un défi que ce livre relève : ses auteurs nous prouvent que c’est faisable.
Per Espen Stoknes est psychologue et économiste. « Questions de société
4. assainir notre système alimentaire au bénéfice de la santé humaine, animale et de celle des écosystèmes ;
Le Manuel de la grande transition, un indispensable pour penser et agir face aux bouleversements actuels. Grande thématique par grande thématique, cet ouvrage propose un socle de connaissances et de compétences issues de différentes disciplines pour appréhender les grands enjeux scientifiques, économiques, éthiques, juridiques et politiques.

Pour la première fois, un collectif d’environ soixante-dix enseignants-chercheurs, issu d’une grande variété de domaines (environnement, sciences du vivant, biologique ou physique, économie, droit, gestion, philosophie, santé, sociologie, sciences politiques) s’est réunie pour réaliser le manuel de la « Grande transition ».
Car la Grande transition ne touche pas simplement l’environnement ou l’économie comme il est de coutume de le penser mais le cœur même de nos représentations et donc tous les domaines du savoir. Plusieurs experts ont été également consultés : Dominique Bourg, Gaël Giraud, Alain Grandjean, Catherine Larrère, Marc Dufumier, Jean Jouzel. L’ouvrage expose ainsi dans un langage clair et accessible les processus impliqués dans le réchauffement climatique et la dégradation du vivant, mais aussi les différentes responsabilités des acteurs, le creusement des inégalités environnementales ou encore les mécanismes financiers qui en sont l’une des causes.
Remise en vente : août 2022
ISBN : 979-10-209-0906-0
Prix : 24,50 €
Au-delà de la seule description des faits, il identifie des leviers d’action individuels et collectifs : réorganisation sociale du travail, mesures économiques, transformations des modes de vie et des façons de produire (agroécologie, permaculture, etc.).
Le Campus de la Transition est un lieu d’enseignement, de recherche et d’expérimentation créé en 2018 par un collectif d’enseignants-chercheurs, d’entrepreneurs et d’étudiants réunis par une volonté commune : « Promouvoir une transition écologique, économique et humaniste, à l’échelle des enjeux qui bouleversent notre siècle. » Le Campus de la Transition innove radicalement dans les contenus de ses enseignements, mais aussi dans la manière de les enseigner. L’expérience de l’apprenant se poursuit bien au-delà du seuil de « l’amphi ». Les enjeux d’une transition écologique concernent autant nos têtes que nos cœurs et nos corps.
Traduit de l’allemand par Olivier Mannoni.
30 août 2023
11 × 17 cm
112 pages 10,00 €
ISBN : 978-2-228-93390-2





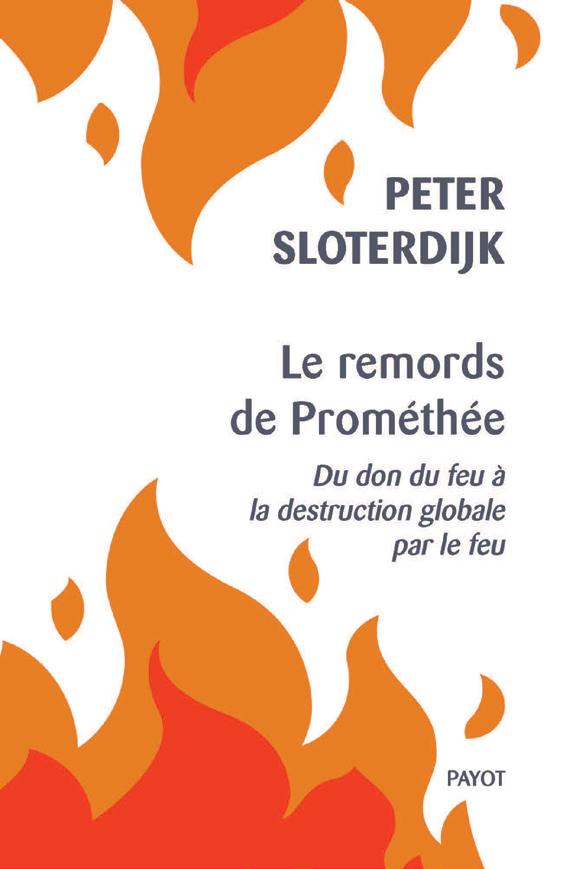
L’histoire de l’humanité, c’est l’histoire de nos diverses utilisations du feu depuis la préhistoire jusqu’à aujourd’hui. Et autant le dire tout de suite, c’est une catastrophe.


Ҍ Sloterdijk poursuit avec Bruno Latour (mort il y a un an) l’échange intellectuel, critique et amical qu’ils eurent pendant des années.
Ҍ Une pensée stimulante sur la catastrophe écologique que nous affrontons.
La crise environnementale et énergétique a débuté quand le feu et le travail humain ont fusionné. La preuve avec cette fresque des rapports économiques de l’être humain avec le feu, depuis la préhistoire jusqu’à l’anthropocène, des chasseurs-cueilleurs à la fusion nucléaire, des premiers gaspillages des ressources de surface – animales (extinction d’espèces chassées massivement)
et végétales (feux de forêts) – jusqu’à celui des ressources souterraines (charbon, lignite, pétrole), en passant par l’hyperconsommation actuelle, la fin possible de la reproduction humaine, et les solutions latouriennes pour tenter d’arrêter la « catastrophe ». Comme d’habitude avec Sloterdijk, c’est brillant, érudit, parfois surprenant, toujours stimulant.

Actu A lité
Ҍ 1er anniversaire de la mort de Bruno Latour le 9 octobre.
Peter Sloterdijk est l’un des plus importants philosophes d’Europe. Il est notamment l’auteur, chez Payot, d’un essai sur notre nouveau rapport au passé et à la transmission de l’expérience : Après nous le déluge, et récemment de Gris : une théorie politique des couleurs.
éGAleMent

250 illustrations en couleur isbn : 978-2-330-18137-6
[Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée]
Aude Gros de Beler
Jean-Claude Golvin
Voyager à travers l’Égypte ancienne en regardant les villes, les temples ou les pyramides tels qu’ils étaient au temps de leur splendeur devient un rêve accessible. Ce guide offre la combinaison unique du talent de Jean-Claude Golvin, premier spécialiste au monde de la restitution par l’image des grands sites de l’Antiquité, et des connaissances de l’égyptologue Aude Gros de Beler, pour un guide à la fois savant et superbement illustré. Si les magnifiques aquarelles nous présentent les sites au temps des pharaons, l’ouvrage, dans un souci de précision archéologique, propose également des plans des tombes et des temples, des cartes, des photographies de l’intérieur des sépultures (civiles et royales), au total plus de deux cent cinquante images pour illustrer le propos. Le guide permet ainsi d’appréhender clairement les sites anciens, et de constituer une base solide de connaissances avant même d’être sur place, puis d’accompagner de manière circonstanciée les excursions. En plus de la description détaillée des sites, un texte les replace dans leur contexte religieux, économique et historique, et des conseils de visite sont donnés pour chaque lieu visité.
Cet ouvrage constitue le compagnon indispensable du voyageur désireux de comprendre le secret des vestiges qui, souvent dénaturés par le temps, s’offrent sous un jour nouveau à ses yeux.
Jean-Claude Golvin est architecte dplg et directeur de recherche au cnrs. Il a dirigé pendant dix ans le Centre franco-égyptien de Karnak. Il est l’auteur de très nombreux ouvrages, notamment la série des “Voyages” aux éditions Errance & Picard.
Aude Gros de Beler est égyptologue, chargée de cours à la faculté Vauban (Nîmes), éditrice aux éditions Actes Sud.
Elle a écrit une quinzaine d’ouvrages sur l’Égypte (jeunesse et adulte).
Tous deux sont coauteurs de L’Antiquité retrouvée (Errance, 2023, 5e édition).
Points forts
• Un guide complet, par une autrice égyptologue qui a travaillé sur les sites pendant de nombreuses années.
• Une invitation au voyage avant même d’être arrivé sur place.
• Les aquarelles de Jean-Claude Golvin, ainsi que de nombreux éléments d’iconographie (plans, cartes), pour un ouvrage précis et esthétique.
Mots clés
• Égypte – Archéologie – Temples – Voyage – Guide –Aquarelles




du sanctuaire 12. Lac artificiel 13. Écuries et hangars pour les chars 14. Temple de la XVIIIe dynastie, dit temple “des Thoutmosis” 15. Lac sacré 16. Bosquet 17. Constructions administratives 18. Habitations et locaux réservés aux prêtres 19. Rempart bastionné en brique crue

Très bel ensemble d’édifices, le mieux conservé des sanctuaires de ce type sur la rive ouest de Thèbes ; certaines parties, notamment les plafonds, linteaux et portiques de la deuxième cour, possèdent encore leurs couleurs d’origine. Demander au gardien de monter dans le “migdol” (pavillon royal) qui présente des scènes aussi originales que charmantes et ne pas oublier de faire le tour du temple car les murs extérieurs sont parfois ornés de scènes grandioses: en témoigne, sur le revers du premier pylône, la célèbre chasse aux taureaux sauvages conduite par le roi lui-même.
La reconstitution montre comment, sous le règne de Ramsès III, s’organisait le site de Medinet Habou. Parmi les structures qui apparaissent sur le dessin, certaines ont disparu et d’autres restent visibles, entières ou fragmentaires.
On arrive à Medinet Habou par un canal artificiel reliant le Nil à un débarcadère (1) dominé par une tribune permettant d’accéder, par deux volées de marches, aux bateaux amarrés le long des quais. Construite dans l’axe du temple, cette tribune rejoint une première porte percée dans un mur en pierre de taille, de faible hauteur et non bastionné, entourant l’ensemble des édifices cultuels et faisant office d’enceinte extérieure (2). À mi-course, sa face nord accuse un changement d’orientation de quelques degrés à cause de la présence du temple funéraire voisin (3), construit par Ay et Horemheb à la fin de la XVIIIe dynastie. À peine quelques mètres séparent le muret extérieur de l’enceinte intermédiaire (4). Celle-ci, construite en brique crue, culmine à 20m de hauteur et s’inspire de modèles profondément asiatiques. Et pour cause: lors de ses campagnes en Syrie et en Palestine, largement représentées sur les parois de son sanctuaire, Ramsès III n’a cessé de côtoyer ce type de rempart avec chemin de ronde, tourelles, créneaux et portes fortifiées. À Medinet Habou, tous ces éléments apparaissent, y compris les fameuses tours de garde, couramment désignées sous le terme sémitique de “migdols” (5 et 6).
Seul celui situé à l’est (5) est bien conservé: il marque l’entrée du temple de Medinet Habou. Il devait en exister un équivalent à l’ouest (6), mais il n’en reste plus rien. La présence d’une telle construction dans le temple funéraire de Ramsès III doit être interprétée comme une porte d’entrée triomphale devant rappeler la victoire de Pharaon sur les peuples étrangers. En effet, les décors extérieurs présentent de nombreuses scènes où le roi, en taille héroïque, exécute des captifs devant les divinités du panthéon égyptien. De même, chaque tour est ornée d’une file de sept prisonniers ligotés qui symbolisent les ennemis héréditaires de l’Égypte. Ainsi, lorsque l’on pénètre à l’intérieur de la forteresse, composée de pièces réparties sur deux étages, on est surpris par le changement total de registre iconographique. Ici, ni sacrifices, ni guerres, ni victoires, ni pharaons glorieux. Les reliefs sont aimables et présentent le
Medinet Habouroi, confortablement installé, qui se restaure, respire des fleurs ou joue au senet (sorte de jeu de dames) avec ses filles. Sans doute ces images doivent-elles nous éclairer sur la réelle fonction de ce bâtiment qui, en fait, devait servir de lieu de détente où, à l’occasion, le roi venait se reposer, se distraire ou se restaurer en compagnie de ses courtisans, de sa proche famille ou des femmes du harem.
“Migdol ouest” (détruit)
Campagne en Nubie
Calendrier des fêtes
Sanctuaire (détérioré)
Plan du temple de Ramsès III à Medinet Habou.
Première campagne en Libye Campagne contre les Peuples de la Mer, an 8
Fête de Sokaris (registre supérieur)
Palais royal Chapelles des Divines Adoratrices
2e cour 1re cour
Pylône
Chasse aux taureaux sauvages
Sortie de Min (registre supérieur)
Deuxième campagne en Libye, an 11 (scène finale)
Temple de la XVIIIe dynastie
Deuxième campagne en Libye, an 11 (registre inférieur) et campagne douteuse en Asie (registre supérieur)
“Migdol” est
Petit temple
1279-1212
La nécropole des artisans de Deir el-Medina Située à l’ouest du vallon, elle abrite les sépultures des ouvriers et des fonctionnaires de l’Institution de la Tombe qui, pendant près de cinq siècles, ont œuvré dans la Vallée des Rois. Aménagées suivant un modèle composite, tenant à la fois de la pyramide héliopolitaine et de l’hypogée libyen, ces tombes présentent une véritable unité de structure (cour, chapelle, puits et caveau) même si, dans la composition finale, certains détails varient en fonction du rang du propriétaire ou de l’époque.
Ainsi, l’accès à la tombe s’effectue par un pylône d’entrée donnant sur une cour bordée de murets blanchis à la chaux. Au fond, s’ouvre la chapelle funéraire précédée d’un péristyle et ornée d’une petite pyramide dont la hauteur dépasse rarement 7 à 8 m. Ici, deux possibilités peuvent être envisagées. Soit la pyramide couvre la chapelle, soit elle l’inclut: dans le premier cas, la pyramide est pleine, en pierre ou en brique, et comblée de gravats; dans le second, elle est creuse et en brique. Quelle que soit la solution adoptée, ses faces sont blanchies à la chaux et le sommet orné d’un pyramidion en pierre décoré de bas-reliefs. C’est dans cette cour, lieu public par excellence, qu’ont lieu les funérailles ainsi que la Belle Fête de la Vallée du désert, grande fête des morts qui se déroule chaque année.
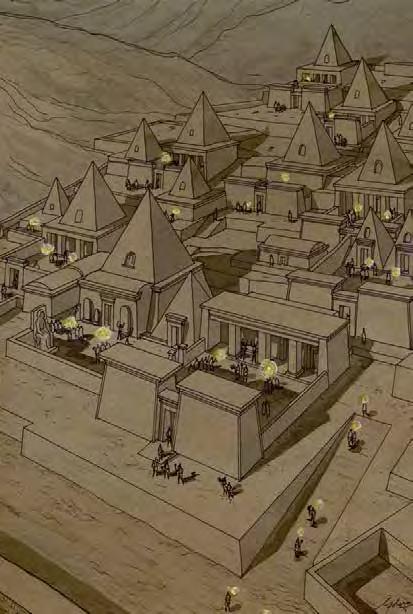
De part et d’autre de la porte ou sur les murs de la cour se trouvent des stèles et des statues du défunt devant lesquelles on vient déposer des offrandes et faire des fumigations d’encens ou des libations d’eau. On pénètre alors dans la chapelle aux parois décorées d’images du défunt et de sa famille car, très souvent, ces tombeaux sont collectifs. Le mur du fond est orné d’un petit naos où, généralement, se tient la statue du propriétaire. Le puits, creusé dans la cour ou dans la chapelle, conduit aux appartements funéraires dont les pièces, parfois nombreuses, sont voûtées, blanchies à la chaux et peintes de couleurs vives ; les scènes, fortement influencées par le décor des hypogées royaux pour lesquels les artisans travaillent, présentent des extraits du Livre de la sortie au jour (improprement appelé “Livre des morts”).
Parmi les cinquante-trois tombes décorées de Deir el-Medina, dont la plus grande majorité remontent au règne de Ramsès II, seulement quelques-unes sont ouvertes à la visite: généralement, Sennedjem (TT 1), Inerkhâou (TT 359), Irynefer (TT 290) et Pached (TT 3). Contrairement aux autres sépultures civiles de la nécropole thébaine (Cheikh Abd el-Gourna, Assassif, Dra Abou el-Naga…) où l’on visite généralement la chapelle funéraire, ici ce sont les caveaux qui s’ouvrent à nos yeux. Ils sont de petite taille, mais l’état de conservation des peintures qui ornent les parois et le plafond voûté est étonnant.
Thèbes

 (1279-1213 ..-.)
(1279-1213 ..-.)
TT 40 - Houy
Vice-roi de Kouch, Gouverneur des Pays du Sud. XVIIIe dynastie, règnes d’Akhenaton (1349-1333 av. J.-C.) et de Toutânkhamon (1330-1320 av.J.-C.)
Outre la qualité incontestable de la représentation et du style, l’intérêt de cette sépulture réside dans son thème iconographique : en tant que vice-roi de Kouch – c’est-àdire gouverneur de Nubie –, Houy vient présenter à Toutânkhamon le tribut annuel du Sud.Ainsi, on assiste à l’arrivée des bateaux chargés de produits exotiques et de métaux précieux et au défilé des différentes provinces de Nubie (Kouch au sud et Ouaouat au nord) déposant leurs présents au pied de Pharaon.
Surveillant du Trésor d’or et d’argent, Juge, Surveillant du Cabinet. XVIIIe dynastie, règne de Thoutmosis IV (?) (1398-1388 av.J.-C.)

S’il ne fait aucun doute que les peintures ne témoignent pas d’un style éclatant, on reste toutefois admiratif devant certaines images de cette tombe où, notamment dans les scènes de chasse dans le désert, l’artiste a su parfaitement saisir les expressions de terreur ou de torpeur des animaux traqués, puis emmenés par les chasseurs.

Père divin de la Maison d’Amenhotep III, XIXe (1295-1188 av.J.-C.) ou XXe dynastie (1188-1069 av.J.-C.), règne non déterminé


Si la qualité d’exécution n’est pas exceptionnelle, les scènes présentées dans cette sépulture sont assez rares. On y voit, notamment, la procession des statues royales d’Amenhotep III et de la reine Tiyi, qui sont déplacées en traîneau, se dirigeant vers le lac sacré du sanctuaire, escortées par des prêtres et des flabellifères.





-:HSMDNA=V]V]V^:
on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons ?
Essai traduit de l’anglais par Amanda Prat-Giral
Préface de Cyril Dion
Rob Hopkins nous invite à rêver en grand, en remettant l’imagination – cette capacité de dire “Et si…” et d’envisager un autre monde en cohérence avec nos besoins et nos aspirations – au cœur de nos vies.
Le cofondateur du mouvement des Villes en transition nous rappelle que des changements drastiques, rapides et inattendus sont possibles, et ce pour le meilleur. Il a pu observer des initiatives couronnées de succès autour du monde, en commençant par sa petite ville de Totnes en Angleterre, où la communauté est devenue un moteur de développement solidaire et d’innovation sociale et environnementale, avec des répercussions positives sur tout le territoire. En ces temps de catastrophes climatiques, de perte de biodiversité, d’insécurité alimentaire, d’appauvrissement des écosystèmes et de crises politiques, cet appel à libérer notre imagination collective laisse entrevoir une vigueur nouvelle pour les enjeux de demain. Et plus encore pour ceux d’aujourd’hui !
“De Totnes aux grandes métropoles, [Rob Hopkins] démontre que l’on peut vraiment transformer l’urbain à condition d’impliquer les citoyens et de sortir des solutions toutes faites.”
Nicolas Celnik et Thibaut Sardier, Libération“Cet essai à la mode anglo-saxonne, qui marie à la fois la didactique et le témoignage, débarque pour nous promettre un « monde d’après » plus radieux que celui dont nous avons hérité avec la crise sanitaire.”
Ingrid Merckx, SocialterActiviste écologiste britannique des plus influents, Rob Hopkins est enseignant en permaculture et initiateur du réseau international des Villes en transition, aujourd’hui présent sur les cinq continents avec plus de mille antennes. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages importants sur ce sujet : Manuel de transition. De la dépendance au pétrole à la résilience locale (Écosociété, 2010), Ils changent le monde ! 1001 initiatives de transition écologique (Seuil, 2014), Le Pouvoir d’agir ensemble, ici et maintenant, avec Lionel Astruc (Actes Sud, 2015).

u Un livre à l’esprit positif pour contrer le défaitisme imposé par l’actualité
u Et si… : 10 000 ex. en édition courante
u Le pouvoir d’agir ensemble : 4 500 ex. en édition courante
u Manuel de transition (Écosociété) : 13 000 ex. GFK
-:HSMDNA=V]V\]^:

Essai traduit de l’anglais (États-Unis) par Elsa Petit
À l’école, nos enfants passent leur temps à suivre des instructions, à bien se tenir et à subir des contrôles. Même en dehors de l’apprentissage formel, ils ont peu d’occasions de jouer et d’explorer l’environnement sans surveillance. En somme : nous entravons leur devenir maîtres de leur propre vie. Cette situation peut engendrer des enfants anxieux qui perçoivent leur existence comme une série de problèmes. Une autre voie est possible : selon Peter Gray les enfants qui ont la liberté de poursuivre leurs centres d’intérêt apprennent avec énergie et passion. Les enfants viennent au monde désireux d’apprendre et équipés avec les meilleurs outils : la curiosité, l’entrain et la sociabilité. Pour les aider, nous devons faire confiance à leur capacité de prendre en main leur propre développement. En se basant sur des faits anthropologiques, psychologiques et historiques, l’auteur prouve que le jeu libre favorise l’autonomie, la résolution des problèmes, la vie en communauté et l’équilibre émotionnel.
“Peut-être utopique, cet essai donne cependant envie de croire en ces initiatives éducatives innovantes. Il apporte des perspectives positives et alternatives sur l’école, telle qu’elle pourrait être demain : accessible, démocratique et plus humaine.”
Christelle Chandanson, Librairie Elkar (Bayonne), Page des libraires
Peter Gray est un psychologue américain, directeur de recherche au Boston College. Il est connu pour ses critiques du système éducatif traditionnel et est invité régulièrement à intervenir auprès de groupes de parents, d’éducateurs ou de chercheurs.
u Un livre qui questionne l’éducation traditionnelle et réclame un renouveau u Riche en exemples de formes alternatives d’éducation u Auteur incontournable sur l’apprentissage par le jeu u Libre pour apprendre : 5 000 ex. en édition courante
-:HSMDNA=V]V]UW:

Les parents s’interrogent souvent sur ce qui est le plus important pour le développement du cerveau de leur enfant. Ils veillent à bien le nourrir et à le stimuler. Pourtant, l’essentiel réside dans la qualité de leur relation avec lui. L’enfant a besoin d’être vu, senti, entendu, accueilli, rassuré et aimé.
Bonnes ou mauvaises, toutes les expériences structurent son cerveau. Celles d’avant la naissance aux premières années de vie sont fondatrices : c’est une période de développement d’une extrême intensité et d’une grande plasticité.
Les comportements répétés sont encodés et s’inscrivent profondément dans son cerveau, formant un câblage qui sera activé le moment voulu. Aider l’enfant à bien encoder son cerveau lui assure une meilleure réussite sociale et professionnelle et un meilleur équilibre psychique.
Riche en informations et en exercices pratiques, cet ouvrage aborde divers sujets comme les émotions, les croyances, la mémoire et l’hygiène mentale. Il permet de comprendre le fonctionnement du cerveau afin d’aider les enfants à révéler leur plein potentiel.
Journaliste, réalisatrice, productrice et conférencière, Stéphanie Brillant consacre son travail à la libération du potentiel humain. Elle a réalisé le film documentaire
Le Cerveau des enfants, un potentiel infini (2017) et publié trois ouvrages chez Actes Sud autour des vertus transformatrices de la respiration et de l’amour.
u Guide pratique issu du film
Le Cerveau des enfants, un potentiel infini (2017)
“Sa « bible » fait le point sur l’état des connaissances et propose une foule d’exercices ludiques, faciles à appliquer dans la vie de tous les jours. En comprenant le fonctionnement du cerveau, enfants et adultes peuvent révéler leur plein potentiel et atteindre un meilleur équilibre psychique, physique, social et professionnel. Libre à nous de faire fructifier les graines que nous voulons dans le verger de notre famille !”
Psychologie positive
u Un essai qui allie neurosciences et exercices pratiques pour mieux comprendre les enfants : émotions, croyances, mémoire, développement psycho-physique
u Accessible aux parents et à tous les éducateurs
u L’Incroyable Pouvoir du souffle : 28 500 ex. en édition courante
u L’Incroyable Pouvoir de l’amour : 9 500 ex. en édition courante
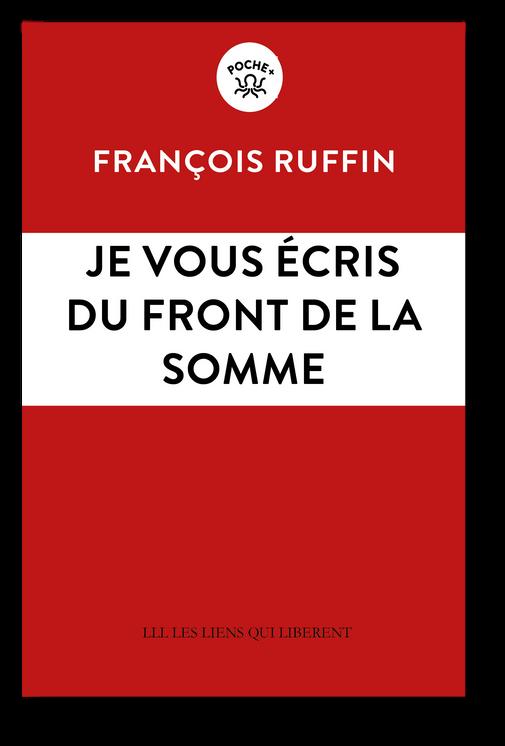
Poche + : parce qu’un livre n’est jamais clos, mais toujours dans le mouvement du monde, Je vous écris du front de la Somme est réactualisé et précédé d'une nouvelle introduction de l'auteur.

« Quel projet, depuis quarante ans, portent nos dirigeants ? Aucun, tout juste être “compétitif”.
Comment appeler ça un “projet” ? Comment espérer que notre peuple en sorte ranimé ?
Comment être surpris de son état d’esprit, d’apathie, de jalousie ? Pour faire Nation, il y faut un destin. Ou du moins un dessein commun... »
«JevousécrisdufrontdelaSomme,quivientdecraquer….»
Durant sa campagne, une porte après l’autre, François Ruffin a entendu cette petite musique sur « les assistés », « les cas soc’ », eux qui « touchent des aides », pendant que « nous, on n’a droit à rien ». Au bistro, son voisin de bière le déplorait : « Je vous aimebien,maisjenepeuxpasvoteràgauche:jesuispourletravail!»
Alors, dans ces terres ouvrières, que dire, que faire ? Mêlant analyses et témoignages, le député-reporter se bagarre, bien sûr, contre « les vrais assistés », ceux d’en haut, qu’on ne voit pas. Mais surtout, il en appelle à reprendre la valeur (du)travail,plaidepourune«Républiquedufaire-ensemble».

Plutôt qu’un « vivre-ensemble » passif et poussif, « faire- ensemble », c’est relever le nez vers un horizon. C’est viser une même direction. C’est se dépasser dans l’action.
Député de la Somme, François Ruffin apublié unequinzained’ouvrages dont Il est où le bonheur (2019, LLL) et Le temps d'apprendre à vivre : La bataille des retraites (2022,LLL),réalisé Merci patron ! (César du meilleur documentaire en2017), J’veuxdusoleil! (2019) et Debout les femmes! (2021)

Couvertureprovisoire
Parution : 30 août 2023
Prix : 9,90 €
C’est faire face à ce défi tragique, le choc climatique. Bref, « faire-ensemble » notre partd’histoire,plutôtqued’enresteràl’écart.
Le nouveau poison de notre société
Olivier AbelPoche + : parce qu’un livre n’est jamais clos, mais toujours dans le mouvement du monde, De l'humiliation est réactualisé et précédé d'une nouvelle introduction de l'auteur.

L’humiliation est partout dans nos vies et elle est devenue le coeur sombre de nos sociétés. Elle offense et ridiculise, envenime la violence et l’injustice, et génère le ressentiment. Et pourtant, nous y sommes le plus souvent insensibles, et muets.
Parution : 30 août 2023
Prix : 9,90 €
L’humiliation fait taire le sujet parlant, elle ruine la confiance, l’estime et le respect de soi. Elle dévaste durablement les circuits de la reconnaissance, de manière démesurée. Elle s’attaque d’abord à ceux qui ne sont pas considérés comme pleinement citoyens, aux minorités langagières, religieuses, raciales, sexuelles, sociales, etc. Mais on peut aussi être humilié par les objets, les formes de l’architecture, les formes de l’imaginaire marchand, les publicités, les formulaires administratifs...
Une part majeure de notre vie politique semble se décider sur ces sentiments sombres attisés par les réseaux sociaux, qui disent des réalités vécues. Il est urgent d’imaginer ce que serait une société où l’on aurait appris à déjouer au mieux l’humiliation, tant dans nos institutions communes que dans nos vies ordinaires. Pourquoinepasessayerdemettreenœuvreunesociétémoinshumiliante? C’estpossible,c’estvital,faisons-le.
Olivier Abel est philosophe, ancien doyen de la faculté protestante de Paris. Complice de Paul Ricoeuretd’Emmanuel Levinas il est devenu l’un des grands spécialistes de la « fonctionimaginairede laparole».


 Couvertureprovisoire
Couvertureprovisoire
Votre enfant de la naissance à 7 ans
Poche + : parce qu’un livre n’est jamais clos, mais toujours dans le mouvement du monde, Dites-moi à quoi il joue, je vous dirai comment il va est réactualisé et précédé d'une nouvelle introduction de l'auteure.

L’auteure a créé pour vous le ludomètre, qui permet de comprendre et de prendre soin de l’équilibre et de l’évolution psychologiques et émotionnels de votre enfant. Comment ? En le regardant jouer.
Couvertureprovisoire
Parution : 30 août 2023
Prix : 9,90 €
Jouer avec sa bouche à 4 mois pour devenir curieux ; jouer à cacher-coucou à 12 mois pour apprendre à se séparer ; jouer à transgresser à 2 ans pour comprendre les limites ; jouer à cache-cache à 3 ans pour dépasser la peur de perdrel’autre;joueràsedéguiserà4anspouraffirmersapersonnalité;jouer à « faire semblant » à 5 ans pour stimuler son imaginaire ; jouer à créer des histoires à 6 ans pour développer son langage indispensable à l’équilibre relationnel et jouer à des jeux de société à 7 ans pour se confronter à soi et auxautres…
C’est en jouant que le bébé, l’enfant, se construit et jette les bases de sa sécurité intérieure, équilibre sa vie affective, affirme sa personnalité. Il en gardera le plaisir de découvrir qui lui sera si utile dans sa vie d’écolier puis d’adulte.

Sophie Marinopoulos est psychologue et psychanalyste, spécialistereconnuedel’enfance et de la famille, fondatrice des espaces d’accueil solidaire parents-enfants Les Pâtes au Beurre. Elle est l’auteure de nombreux ouvrages parmi lesquels Ellesaccouchentetnesont pasenceintes (2011)et Écoutez-moi grandir (2016) aux éditions Les Liensquilibèrent.


 Sophie Marinopoulos
Sophie Marinopoulos
Poche + : parce qu’un livre n’est jamais clos, mais toujours dans le mouvement du monde, Le corps bavard est réactualisé et précédé d'une nouvelle introduction de l'auteure.

À notre insu, notre corps s'exprime. Il dit nos peurs, nos angoisses, nos désirs, notre histoire, la vraie.
Couvertureprovisoire
Parution : 30 août 2023
Prix : 9,90 €
Derrière un corps social exposé vit et sévit un être intime, qui souffre souvent dans son corps de ne pas être entendu. Il en est ainsi de cet enfant qui pleure sanslarmes;decetautrequicriesasolitudelaboucheferméedansunsilence assourdissant ; ou de celui qui, sur la plage, à califourchon sur le dos de sa mère, dessine des mots tactiles, à la recherche de lui-même. Le corps bavard, c'est aussi cette femme à la vie sociale, professionnelle, familiale épanouie, qui panique dès qu'elle doit se déplacer ; ou encore ce responsable d'entreprise aux comportements inattendus, disproportionnés, qui derrière son air assuré révèle une autre peau, psychique cette fois, qui se craquelle comme si elle ne pouvaitcontenirsonpropriétaire.

Le corps bavard, ce sont des histoires réelles de personnages qui nous entourent, qui vivent avec nous, tels des anonymes que nous connaissons, à moins que ce ne soit nous-même. Tous, nous partageons en notre chair des éprouvés qui nous font toucher parfois des questions fortes, intenses sur ce quenousvivons,commentnouslevivons,pourquoinouslevivonsainsi.
Sophie Marinopoulos est psychologue et psychanalyste, spécialistereconnuedel’enfance et de la famille, fondatrice des espaces d’accueil solidaire parents-enfants Les Pâtes au Beurre. Elle est l’auteure de nombreux ouvrages parmi lesquels Dites-moiàquoiiljoue.Je vous dirai comment il va (2009), Elles accouchent et ne sont pas enceintes (2011) et Écoutez-moi grandir (2016) aux éditions Les Liensquilibèrent.

30 août 2023
11 × 17 cm 100 pages 8,00 €
ISBN : 978-2-7436-6070-3




« Cette expérience, qui correspond par bien des côtés à ce que j’en attendais, en diffère quand même par un abîme : c’est la réalité, non plus l’imagination. » Quand la philosophie se heurte à la réalité.
En 1934, trois ans après son agrégation de philosophie, la normalienne Simone Weil prend un congé de l’Éducation nationale pour travailler à l’usine. Elle considère son année d’usine comme la plus décisive de sa vie et de sa pensée. Son Journal, écrit la même année, nous renseigne sur la nature de ce bouleversement physique et intellectuel. Le caractère troué de l’écriture de ce Journal


témoigne directement de la souffrance de son corps, de la manière dont le corps meurtri s’inscrit dans la pensée, dans le langage. Cette écriture sur le vif montre ce qui est en deçà de la philosophie et qui la réclame, exhibe ce contre quoi l’écriture à venir devra lutter, quel silence elle combat, et en quoi ce silence est peut-être le nôtre.
• Des thèmes toujours actuels : souffrance au travail, pénibilité, conditions de travail, fatigue, déshumanisation, etc.
• Un témoignage « sur le vif » de la condition ouvrière. Un peu à l’image du témoignage d’À la ligne de Joseph Ponthus (plus de 150 000 ex.)
• Aucune édition du Journal d’usine seul.
• On redécouvre aujourd’hui la voix originale de Simone Weil (cf. les bonnes ventes des titres de la collection et chez Payot).


• Le Journal d’usine est disponible uniquement dans La Condition ouvrière (Folio, 2003, 51 000 ex.) et les Œuvres complètes t. 2 (Gallimard, 800 ex.).
La pensée de Simone Weil (1909-1943) est empreinte de spiritualité et de compassion. Sa vie et son œuvre révèlent son profond mysticisme (La Pesanteur et la Grâce) et son ardente recherche de justice sociale (La Condition ouvrière).

ÉGALEMENT

Préface et traduction de Thierry Gillybœuf
30 août 2023
11 × 17 cm 90 pages 7,00 €
ISBN : 978-2-7436-6071-0



-:HSMHOD=[[U\VU:

Comment retrouver du sens à son travail ? Un bréviaire toujours d’actualité à l’heure des bullshits jobs.

La révolution industrielle, la démesure de la production dans le capitalisme émergent, nourri de la pensée libérale utilitariste, ont consacré l’idée d’un travail de plus en plus aliénant, qui a rompu avec le réel, le monde et la nature. Le basculement de l’artisanat vers l’industrie a ôté au travail son utilité, dont Morris dit qu’elle réside dans un espoir qui se décline selon trois modalités : le repos, la qualité du produit et le plaisir que l’on tire du travail bien fait. À l’heure des bullshit jobs, « Travail utile contre travail inutile », ce texte prémonitoire,
fait figure de manifeste, de bréviaire, alors que le modèle économique dévastateur mis en place depuis un demi-siècle semble parvenu en bout de course. Ce recueil est accompagné de deux autres textes, l’un qui dénonce les inégalités sociales et l’avènement de la vie humaine arraisonnée par la technique, et l’autre qui illustre ce qu’a pu être le « travail utile » : une célébration de la vie et d’une civilisation davantage à l’échelle humaine. Morris nous invite ainsi à nous rappeler que le Beau est synonyme de liberté et de sens.
• Un éloge du travail manuel, de l’artisanat et de la production à échelle humaine.
• Une thématique très actuelle : retrouver le sens du travail.
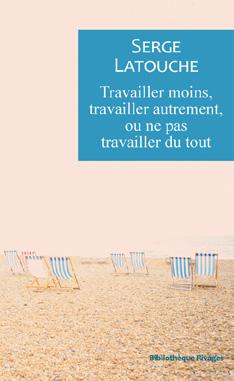
• Un auteur phare de la décroissance et des mouvements libertaires.
• Recueil comprenant les textes : « Comment je suis devenu socialiste », « Travail utile contre travail inutile » et « Architecture gothique ».
• William Morris dans la PBR : L’art et l’artisanat (2011, 15 000 ex.) et Comment nous vivons, comment nous pourrions vivre (2013, 5 500 ex.).
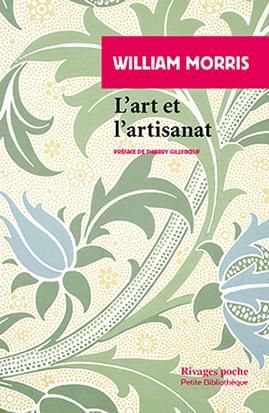
Poète, romancier auteur des premiers textes de fantasy, traducteur des sagas nordiques, dessinateur, ébéniste, peintre, imprimeur, fondateur du mouvement « Arts and Crafts », William Morris (1834-1896), issu d’une famille aisée et décorateur de grandes demeures bourgeoises, fut aussi un activiste libertaire nourri d’idéaux socialistes.
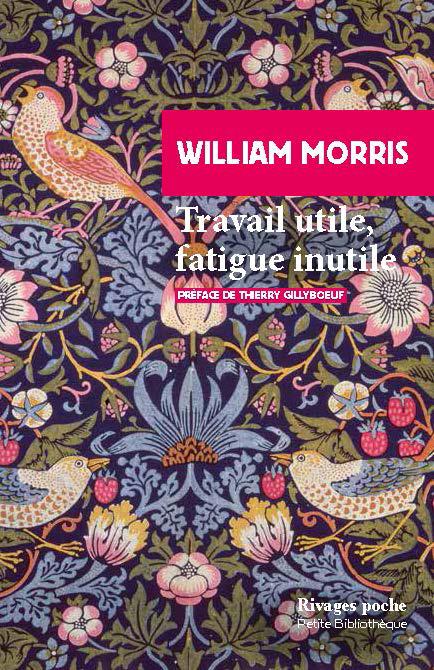
Textes choisis, traduits du grec, préfacés et annotés par Nicolas Waquet
30 août 2023
11 × 17 cm 110 pages 8,00 €
ISBN : 978-2-7436-6069-7 -:HSMHOD=[[U[^\:







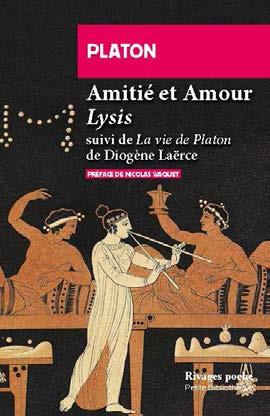
L’amitié peut se définir en partie comme une inclination bienveillante, mais elle ne s’y réduit pas. Ne serait-elle pas aussi la forme la plus haute de l’amour ?
• L’amitié chez les grands philosophes : un thème qui rencontre toujours un grand succès auprès des lecteurs.
Le Lysis, datant de la jeunesse de Platon, porte entièrement sur l’amitié, dont les Anciens se faisaient une idée différente de la nôtre, et qui dépasse le seul cadre de l’affection.
L’amitié se comprend comme une inclination bienveillante, mais aussi comme une forme de possession, un attachement à ce qui est nôtre, capable de nous manquer et d’être objet de quête et de désir. Cette pensée si singulière de l’amitié apparaît d’autant mieux qu’on la
replace dans l’œuvre, la vie et la réflexion du grand philosophe athénien, matière de la Vie de Platon par Diogène Laërce (IIIe siècle apr. J.-C.). Par sa langue et son ton résolument vivants, le présent ouvrage formera un livre unique. Le lecteur éprouvera ainsi le plaisir de s’immerger à nouveau dans la question complexe et passionnante de l’amitié, éclairée, approfondie et enrichie par les vues pénétrantes de Platon.
• Une approche toujours aussi novatrice qui fait de l’amour un spectre large et permet d’éclairer d’un jour nouveau les nouvelles réalités amoureuses.
• Suivi d’extraits de la Vie de Platon par Diogène Laërce.
• Un recueil sur l’amitié dans la même veine que Simone Weil, Amitié (2016, 20 000 ex.) ; Nietzsche, Hymne à l’amitié (2019, 3 500 ex.) ; ou encore Aristote, L’amitié (2020, 2 800 ex.).
 Sarah Carton de Grammont, Anne Yvonne Guillou, Adeline Herrou, Sophie Houdart, Christine Jungen, Carolina Kobelinsky et Marion Langumier
Sarah Carton de Grammont, Anne Yvonne Guillou, Adeline Herrou, Sophie Houdart, Christine Jungen, Carolina Kobelinsky et Marion Langumier

18 euros TTC
ISBN 978-2-36624-802-9
Après la réédition de Bambois de Claudie Hunzinger, la collection Radeau accueille cette fois-ci son tout premier texte de création, écrit à quatorze mains par sept femmes anthropologues. Un jour, l’une d’entre elles, Adeline Herrou, dont le travail porte sur la société chinoise contemporaine, se retrouve confrontée à la disparition de ce que, en anthropologie, on appelle un « terrain », son territoire d’étude : Pékin est en pleine mutation et des pans entiers de la capitale, ses bâtiments, sa vie de quartier, disparaissent pour mieux s’adapter aux métamorphoses du pays. L’anthropologue chevronnée qu’elle est découvre alors qu’elle éprouve de la nostalgie. Mais celle-ci est-elle légitime ? Et que dit-elle de son positionnement, en tant que chercheuse occidentale ? C’est ainsi que commence l’aventure de ces sept anthropologues, qui se sont réunies plusieurs fois depuis 2018, pour questionner, individuellement et collectivement, leurs états d’âmes face à la disparition de leurs terrains respectifs. Et si, parfois, elles avaient de bonnes raisons d’être nostalgiques ? Tels les canaris au fond de la mine, les anthropologues sentiraient-elles « venir le grisou » ? Officiellement déclarée, avérée, ou passée sous silence, la catastrophe n’est-elle pas déjà là, en cours, sous leurs yeux ?
Pour tenter de répondre à ces questions ambiguës, elles ont choisi de faire un pas de côté par rapport à leur pratique habituelle : en optant pour la fiction, en renouant avec l’écriture créative, en faisant appel à leurs souvenirs, leurs lectures, en mettant en scène leur subjectivité. À rebours, on devine ainsi de quoi sont faits leur terrain et ce qui les préoccupe, en tant qu’anthropologues, mais aussi en tant que sujets politiques.
À travers les yeux de ces sept anthropologues, se sont autant de territoires différents que lectrices et lecteurs pourront découvrir : Sarah Carton de Grammont travaille sur la Russie post-soviétique, Anne Yvonne Guillou sur la mémoire du régime Khmer au Cambodge, Adeline Herrou sur la Chine contemporaine, Sophie Houdart sur la zone contaminée à Fukushima, Christine Jungen sur les politiques d’archive au Moyen-Orient, Carolina Kobelinsky sur les migrations aux frontières de l’Europe et Marion Langumier sur la vallée de l’Omo en Éthiopie.
• Un livre qui réinvente la manière de faire de l’anthropologie et, plus largement, de réfléchir au devenir de nos sociétés contemporaines.
• En utilisant tour à tour les outils des sciences humaines et ceux de la fiction, cet ouvrage fait preuve d’une brillante inventivité, en renouvelant les pratiques d’écriture.
• Des textes qui constituent autant de portes d’entrée dans des cultures et des territoires mal connus en France, tributaires de nombreux clichés.

208 pages / 130 x 210 mm
18 euros TTC
ISBN 978-2-36624-798-5
Après plusieurs années d’une relation de couple toxique où elle a expérimenté une emprise insidieuse, Erin est parvenue à fuir pour recommencer sa vie seule. D’abord en banlieue parisienne, sans donner le moindre signe de vie à l’homme qui l’humiliait depuis des années. Elle se réapproprie son quotidien, adopte une chienne qui devient rapidement une compagne précieuse, fait l’expérience d’une vie plus apaisée au rythme de nouvelles lectures. Mais l’environnement de la capitale lui pèse encore trop et, du jour au lendemain, elle achète une vieille voiture, repère une maison disponible pour quelques mois dans les Pyrénées, où elle n’est jamais allée et où elle ne connaît personne, et s’y rend, seule. Dans ce village isolé où elle n’a plus à craindre d’être jugée, elle apprend à vivre au rythme des saisons et de la nature. Par à-coups, elle entreprend de se reconstruire pas à pas, de se réapproprier son corps, par des randonnées de plus en plus longues ou encore
À propos des Orageuses :
« Un texte court, poignant, qu’on reçoit comme un coup de poing nécessaire. Un roman sur les femmes, pour les femmes. Essentiel ! »
Librairie du Tramway
« Un premier roman habité, énergique, pour comprendre que la violence n’est pas issue de tous les hommes mais d’assez pour que toutes les femmes aient peur. À offrir à tous les mâles alpha ! »
Librairie Quai des Brumes
de l’escalade. Elle fait également la connaissance d’une voisine, vivant seule à proximité depuis des années. Une des rares personnes à qui elle parle et dont l’attention et la bienveillance l’aident à reprendre confiance en elle. Dans son 2 e roman, Marcia Burnier explore une nouvelle facette de l’émancipation féminine pour fuir les travers d’une société patriarcale violente, en questionnant la possibilité du soin et la place essentielle du sauvage et de la nature comme écrin protecteur pour une nécessaire reconstruction.
Marcia Burnier est une autrice francosuisse. Elle a co-créé le zine littéraire féministe It’s Been Lovely but I have to Scream Now et a publié différents textes dans les revues Retard Magazine, Terrain vague et Art/iculation. Née à Genève, elle a grandi dans les montagnes de Haute-Savoie. Elle a notamment suivi des études de photographie et cinéma à Lyon 2.

« Ce texte est une pépite féministe, une lecture saisissante qui révolte autant qu’elle émeut et enthousiasme, une véritable ode à la sororité… Féroce et jubilatoire ! »
Librairie Le Comptoir des Mots
« Un récit urgent qui sort des tripes, sur le fil entre l’espoir et la haine. Une voix impérieuse, brute, avec des personnages à la chair brûlante et blessée. Un livre qui crame toutes les souffrances et les aberrations de la culture du viol. Cathartique ! »
Librairie La Virevolte
• Après le succès des Orageuses, 14.000 exemplaires vendus tous formats confondus, le 2 e roman de Marcia Burnier paraît également dans la collection Sorcières.
• Un roman de résistance et de reconstruction, qui aborde avec force les questions d’emprise, de consentement, de domination patriarcale au sein du couple et les conséquences destructrices que cela peut avoir.
• Un puissant exemple de reconstruction d’une femme humiliée, un hymne à la nature, au sauvage comme écrin et la possibilité d’envisager d’autres relations au vivant.
« Le premier roman de Marcia Burnier est aussi vif qu’engagé, fort que réjouissant, et pour sûr, il fait du bien ! »
ESSAI
13,5 × 21,5 CM
384 PAGES
PRIX PRÉVISIONNEL
24,50 €
MISE EN VENTE
6 SEPTEMBRE 2023
978-2-330-18266-3
-:HSMDNA=V]W[[X:

Comment la Chine, qui figurait parmi les pays les plus pauvres dans les années 1960, est-elle devenue la deuxième puissance mondiale ? Cette performance unique dans l’Histoire, la Chine la doit aux immenses efforts déployés par son peuple, à sa farouche volonté, mais aussi à son extraordinaire machine de guerre économique. Dans cet essai, fruit de trois années d’enquête, Ali Laïdi nous révèle les ressorts historiques, philosophiques, spirituels et politiques qui ont conduit à la mise en œuvre de cette machine, les stratégies que la Chine a déployées, de l’époque de l’Empire à celle du Parti communiste actuel, et les modes opératoires qu’elle utilise, des plus visibles aux plus cachés.
DU MÊME AUTEUR
« Questions de société »
u Il ne s’agit pas d’un ouvrage de géopolitique, mais d’un essai sur les stratégies chinoises de guerre économique – le premier dans les mondes francophone et anglophone
u Le Droit, nouvelle arme de guerre économique : 6 700 ex. (AS + Babel)

Cet essai s’appuie sur une centaine de témoignages (d’experts, universitaires, diplomates, entrepreneurs, anciens membres des services de sécurité, etc.) et des rapports confidentiels pour révéler l’existence de cette machine de guerre économique.
Il décrit les acteurs et les organismes chinois qui mènent cette guerre économique, ainsi que les armes et les techniques utilisées : transferts technologiques forcés, espionnage économique, non-respect des droits de propriété intellectuelle, opérations d’influence, d’infiltration, et jusqu’à l’utilisation plus récente de l’extraterritorialité du droit chinois (à l’image de ce que font les États-Unis).
Il évoque les opérations et les méthodes chinoises, les opérations d’influence dans les entreprises occidentales, mais aussi dans les laboratoires des universités et plus largement dans les amphithéâtres du monde entier.
Docteur en science politique, Ali Laïdi est chroniqueur à France 24, responsable du Journal de l’Intelligence économique, et chercheur à l’École de pensée sur la guerre économique (epge). Il intervient régulièrement à l’Institut des hautes études de défense nationale (ihedn). Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels Les Secrets de la guerre économique (Seuil, 2004), Histoire mondiale de la guerre économique (Perrin, 2016), Le Droit, nouvelle arme de guerre économique. Comment les États-Unis déstabilisent les entreprises européennes (Actes Sud, 2019) et Histoire mondiale du protectionnisme (Passés/Composés, 2022), qui a reçu le Prix du livre d’économie 2022. « Questions de société
Il relate les premiers pas des experts chinois de l’intelligence économique en France et la manière dont la France leur a ouvert grand les bras.
Il rend hommage aux premiers lanceurs d’alerte qui n’ont pas été écoutés.
Il pointe la naïveté des Américains et des Européens, l’avidité et la cupidité des entreprises qui n’ont vu que leurs profits et ont abandonné les intérêts stratégiques de leur pays.
Il décrit les ripostes européenne et américaine, qui sont finalement très récentes, et montre pourquoi et comment Washington a choisi de déterrer la hache de guerre économique contre Pékin, tandis que Bruxelles ne sait plus à quel saint se vouer.
À la fois enquête et récit, cet essai lève le voile sur la machine à conquérir le monde qu’est le dragon chinois.
“Je me suis entretenu avec une centaine de personnes pour décrypter la stratégie d’intelligence économique chinoise : des entrepreneurs, des chercheurs, des experts, des diplomates, des économistes, des anciens des services de renseignement et de sécurité. Ils m’ont permis de remonter le temps et de montrer pourquoi et comment la naïveté et la cupidité des Occidentaux a nourri la machine de guerre économique chinoise. Grâce à tous ces témoins, je révèle le double langage d’une Chine qui attire les investissements étrangers, les contraint aux transferts de technologie, copie les produits des entreprises concurrentes, espionne les laboratoires, infiltre les universités étrangères, protège ses marchés, manque à ses engagements envers l’omc, achète l’Afrique, conquiert le monde à travers les nouvelles routes de la soie et, enfin, déstabilise l’Amérique et l’Europe.
Dans le domaine de l’intelligence économique, le modèle chinois se distingue des autres puissances. Il combine l’approche frontale américaine,
la vision sécuritaire soviétique, puis russe, le tranchant du samouraï japonais et la subtilité intellectuelle française. Sans oublier ses influences confucéenne et marxiste-léniniste. Le tout avec une force de frappe en moyens humains et financiers cent fois supérieurs à celle de ses adversaires-concurrents et une capacité exceptionnelle de se projeter dans le temps long. Les guerriers chinois sont patients. Ils ne craignent pas le réveil d’une Amérique qui mène envers eux la plus grande guerre économique de l’Histoire. Les loups chinois se préparent de longue date à l’affrontement final. Entre les deux géants, tous les coups sont permis pour préserver ou conquérir l’Olympe terrestre. Quant à l’Europe – déjà hors-jeu –, elle espère limiter les dégâts collatéraux de ce choc titanesque. Le dragon chinois se tient droit sur ses pattes, les ailes déployées, prêt à cracher ses flammes pour réduire en cendres le moindre obstacle.” « Questions
de société »
 Patrick Viveret
Patrick Viveret

La bataille de la Transition a été perdue. Il nous faut faire preuve de lucidité et de radicalité, tant dans la perspective que dans le diagnostic. Et, comme la chenille qui se transforme en papillon, raisonner dorénavant en termes de « métamorphose ». Voilà un exercice loin d’être évident, car pour la chenille, l’état de papillon représente la fin du monde, en tout cas de son monde.
Si les principaux responsables économiques et politiques avaient pris au sérieux les avertissements dont ils avaient connaissance dès les années 1980, « la Transition écologique solidaire » aurait pu être réussie. Mais ils se sont contentés de greenwashing et de petits gestes et ont refusé de s’attaquer aux inégalités sociales générées par « l’hypercapitalisme ». Le résultat de cette irresponsabilité mériterait une sanction juridique. Car ses effets son désastreux et déjà visibles sous nos yeux : mégafeux, inondations, aggravation de phénomènes climatiques extrêmes, montée du niveau des eaux, sécheresses, risque d’une guerre de l’eau potable, progression considérable du nombre des réfugiés climatiques alors même que nous n’avons pas encore atteint un réchauffementmoyende1,5°C.
Doit-on pour autant désespérer ou borner nos objectifs à une simple « adaptation » au changement climatique ? Ce serait une autre erreur tragique. Car cette adaptation ne peut réussir sans assumer l’exigence d’une mutation qui relève d’une toute autre échelle. La croyance qu’il suffira de combiner des mesures d’austérité écologique et des adaptations technologiques se révélera largement insuffisante. Il nous faut urgemment accepter la fin d’un monde révolu. Cette posture de la chenille peut apparaître sous de multiples formes : politiques, économiques, religieuses, émotionnelles,sexuelles,etc.
L’intérêt de cette approche, en termes de métamorphose plus que de transition, est qu’elle nous permet de comprendre et de nommer les temps régressifs dans lesquels nous sommes entrés sans pour autant céder auxperspectives déprimantes de l’effondrisme. Elle engage au réalisme sur la situation actuelle tout en orientant l’action civique vers un imaginaire positif que l’on peut résumer ainsi : unehumanitéplussage,tournéevers l’intelligencecréatriceetcoopérativepeutréussiràaffrontercesdéfiscolossaux.

Patrick Viveret estphilosopheet magistrat honoraire à la Cour descomptes. Il est cofondateur du "Forum pour d’autres indicateurs de richesse" , initiateur des rencontres internationales "Dialogues en humanité". Il a publié de nombreux ouvrages, parmi lesquels La cause humaine, Du bon usage de la find'unmonde aux éditionsLesLiensquiLibèrent.
Parution : Septembre 2023
ISBN : 979-10-209-2477-3
Prix provisoire : 16 €
« Pour la première fois depuis sa création, l’homme sera confronté à son vrai problème permanent. Que faire de sa liberté arrachée à l’urgence économique ? Comment occuper les loisirs que la science et l’intérêt composé lui auront gagnés pour mener une vie judicieuse, agréable et bonne ? »
John Maynard Keynes est un des économistes les plus importants du XX e siècle. Initiateur de la «relance par la demande» et promoteur de l’État providence, c’est dans le contexte de la crise de 1929 qu’il rédige son oeuvre fondamentale, La théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie (1936). En 1944, à la conférence de Bretton Woods qui crée le Fonds monétaire international (FMI), il est l’un des principaux architectes du système monétaire international de l’après-guerre. Remise en vente : août 2022

ISBN : 979-10-209-0465-2
Prix : 7 €
En 1930, John Maynard Keynes publie un essai aux accents prophétiques sur le devenir du capitalisme. L’économiste y prédit l’avènement d’une société d’abondance rendu possible par une accumulation du capital sans précédent. Il appelle de ses voeux une vie sociale émancipée de l’utilitarisme économique et de ses valeurs dévoyées par l’intérêt. Il attaque un système portant au pinacle la «science économique» et exhorte ses experts à s’installer à l’arrière du train de l’histoire…
John Maynard Keynespour parents d’ados qui pètent les plombs
Yapaka
Un livre à la fois sérieux et plein d’humour pour aider les parents à garder le cap dans la tourmente de l’adolescence de leurs enfants. Nouvelle édition dotée d’un cahier pratique en fin d’ouvrage permettant aux parents de trouver près de chez eux aide et réconfort !
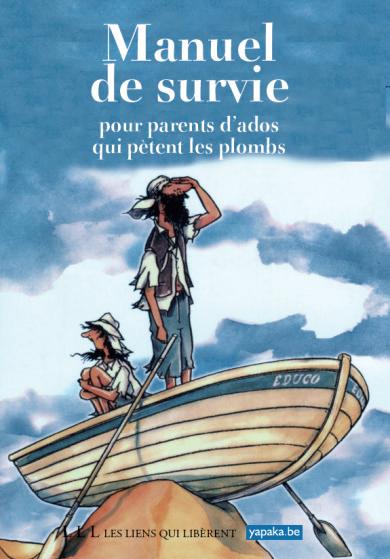
Être adolescent est une énigme aussi pénible pour soi… que contagieuse pour l’entourage ! Le jeune est tendu… et ses parents explosent, comme par ricochet ! La vie de famille prend alors des allures de voyage au sein d’un cyclone. On a l’impression de vivre la fin d’un monde, et c’est un peu vrai puisque l’adolescence signe la fin d’un monde : celui de l’enfance. Exit les chevaliers servants en culotte courte et les gentilles princesses en nattes qui poussaient doucement sous les yeux attendris de papa et maman. La maison du bonheur a fait place à une sorte de Jurassic Park où chacun se demande comment sauver sa peau…
Faut-il laisser faire ? Doit-on baisser les bras et attendre que cela se passe ? Ce livre écrits par d’éminents spécialistes de l’adolescence vous remet dans toutes les situations que vous vivez avec vos ados et vous donne de nombreux conseils pour y répondre de manière idoine.
Remise en vente : août 2022
ISBN : 979-10-209-0402-7
Prix : 7 €
Comme en attestent les différents chapitres : Renoncer à la perfection – Accepter de se sentir mal – Relativiser – Se mettre d’accord sur l’essentiel entre parents – Lui lâcher les baskets – Accepter d’être ringard – Garder le fil-poser des limites – Évoquer sa propre adolescence – Revisiter la famille – Repérer les signaux de détresse…
Un livre de surcroît agrémenté de 17 illustrations quadri souvent hilarantes.

Langue d’origine : français
1eк office septembre 2023 / 9782355970597
12 euros / 50-60 p. / 15 x 13 cm


Des mots sépia, noirs et blancs, en couleur, à l’instar des tableaux de l’auteur, dont la visée est l’apaisement pour l’artiste et pour le lecteur-contemplateur. Bref, des « Instantanés sereins »

Il ne s’agit pas, comme dans La grâce ou l’éloge du commencement, du déroulement d’un unique texte, mais de brefs poèmes, cependant l’esprit est le même. On y retrouve, en plus marquée, la soudaineté et la fugacité d’impressions – de celles, souvent indéfinissables, qui vous font brusquement interrompre un geste ou une parole.
De tableau en tableau, de livre en livre, Joseph-Antoine d’Ornano tente de capturer ces « instants de vie secrète » pour les poser sur la toile ou le papier.
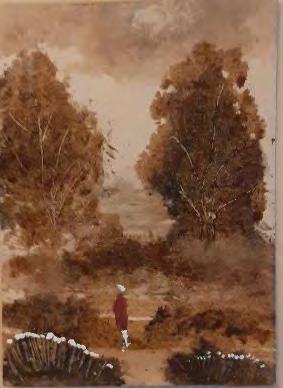
Ici l’image d’une robe jaune ou blanche et de ballerines ; là, la tristesse du soir que « connaissent les fleurs » ; ailleurs encore un « jour de semaine ordinaire / Où rien vraiment ne s’est passé / Rien qui vaille la peine », mais dont on se souviendra peut-être, à l’heure du départ ultime, « comme d’un jour heureux ».
Nostalgie, dira-t-on ? Non point. Douceur, luminosité, mystère aussi, seraient des mots plus appropriés. Au lecteur-contemplateur d’apprécier les deux premières et d’essayer de saisir, s’il le souhaite, la clef du dernier. « Tout n’est pas donné », aime à répéter Joseph-Antoine d’Ornano.
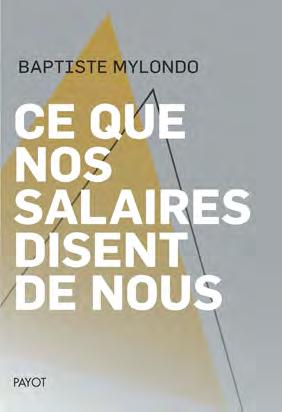
sommes-nous payés à notre juste valeur ? est-il légitime qu’un patron gagne plus que ses employés ? Pourquoi ceux qui ont un travail « essentiel » (infirmières, éboueurs, enseignants...) peinent-ils à en vivre, alors que certains bullshit jobs sont grassement payés ? Une enquête sur les rapports entre travail, rémunération et utilité sociale. l e livre
Ҍ Une analyse des rapports qu’entretiennent travail, rémunération et utilité sociale.


Ҍ Un plaidoyer pour une véritable justice sociale et salariale.
Ҍ Un titre qui parle à tous et qui donne le ton , dans la droite ligne d’Où va l’argent des pauvres de Denis Colombi (10 000 ex. vendus, déjà 700 réassorts depuis janvier).

Ҍ Des propositions afin de repenser une rémunération plus juste pour tous : du plus pragmatique (la révision des grilles salariales) au plus utopique (le revenu universel).
13 septembre 2023
14 × 20,5 cm
224 pages 19,00 €
ISBN : 978-2-228-93386-5





Quand les éboueurs, les cheminots ou les enseignants font grève, c’est tout notre quotidien qui s’en trouve chamboulé. sans eux, la machine se grippe. en revanche, si un trader ou un grand patron en venait à débrayer, l’impact serait sans doute moindre… alors pourquoi les uns sont-ils beaucoup mieux payés que les autres ? notre salaire en dit long sur ce que nous faisons, mais aussi, et surtout, sur ce que nous « valons ». il détermine notre niveau de vie, notre pouvoir d’achat et,
finalement, notre place dans la société. or lorsqu’il est question de salaire, on a généralement tendance à reproduire les hiérarchies sociales existantes. on estime qu’un patron d’entreprise mérite un meilleur salaire que son ouvrier, qu’il est légitime qu’un footballeur engrange des millions quand une femme au foyer ne touche rien. Pourquoi ? D’où vient cette déconnexion entre rémunération et utilité sociale ?
revenU DU travail travail éConomie soCiologie

Ҍ réforme des retraites, inflation, pouvoir d’achat en berne, inégalités qui se creusent : tous les signaux sont au rouge pour une rentrée sociale qui s’annonce tendue.
Ҍ Fin octobre-début novembre : publication annuelle des chiffres sur la pauvreté en France (dont les travailleurs pauvres) de la Fondation abbé Pierre et du secours catholique.
éGAleMeNt
l’A uteur militant de la décroissance et du revenu inconditionnel, Baptiste mylondo enseigne les sciences économiques et la philosophie politique à science Po lyon. il est également traducteur de plusieurs livres (dont Branko milanović), et se consacre à la critique de la « valeur travail » et des inégalités.

septembre 2023
15,5 × 22,5 cm
352 pages 20,00€
ISBN : 978-2-228-92613-3 -:HSMCMI=^W[VXX:
Le bestseller aux 40 000 lecteurs déja conquis !
Le L ivre
Que se passe-t-il lorsque je contracte un emprunt ? D’où vient l’argent que me prête la banque ? Qu’appelle-t-on la dette ? Qu’est-ce qu’une obligation ? Pourquoi les États veulent-ils absolument « sauver » les banques ? Et pourquoi est-il urgent que nous, citoyens, comprenions les rouages de l’économie et de la finance ?
Avant de devenir un vulgarisateur reconnu de l’économie et de la finance sur le Web, Gilles Mitteau a été étudiant en école de


commerce, puis vendeur à Wall Street. Fort de son expérience, il nous explique, dans cet ouvrage fourmillant d’exemples tirés de notre vie quotidienne, quels sont les principes à l’œuvre dans le système capitaliste et pourquoi, définitivement, l’économie comme la finance ne sont pas des sciences exactes, mais au contraire profondément humaines et politiques : nous pouvons donc en interroger les règles et, pourquoi pas, changer ces dernières…
1 Déjà 40 000 lecteurs conquis en 3 ans : un bestseller pour Payot !
1 Trois ans après sa sortie : des ventes hebdo toujours régulières et une présence maintenue par les libraires sur table.
1 Une communauté de 400 000 abonnés en expansion constante.
1 Une nouvelle crise financière menace à l’international, l’inflation étrangle les Français : vulgariser l’économie et la finance est capital et un acte militant !
Gilles Mitteau, ancien trader à Wall Street, a tout lâché pour devenir vulgarisateur sur YouTube : sa chaîne Heu?reka compte aujourd’hui 400 000 abonnés et est saluée unanimement pour son contenu d’extrême qualité.
Traduit de l’espagnol par Vivien Garcia


« Que le livre soit ton meilleur ami, ton conseiller, ton guide. On n’en sait jamais assez ! » L’anarchisme en 10 leçons pour les grands comme pour les petits !
1 Une approche pragmatique et joyeuse des principes de l’anarchisme.
Ce petit pamphlet a été écrit par le pédagogue José Antonio Emmanuel. L’auteur y propose un exposé simple et poétique des idées-forces libertaires et de la manière de les mettre en pratique. Contrairement à ce que son titre pourrait laisser croire, cet ouvrage s’adresse aux lecteurs de tous âges. Il encourage une éducation libertaire, proscrivant toute forme de fanatisme ou d’oppression et appelle à la construction d’une société dans laquelle filles et garçons pourraient grandir libres et inspirés par des valeurs d’entraide, d’égalité,
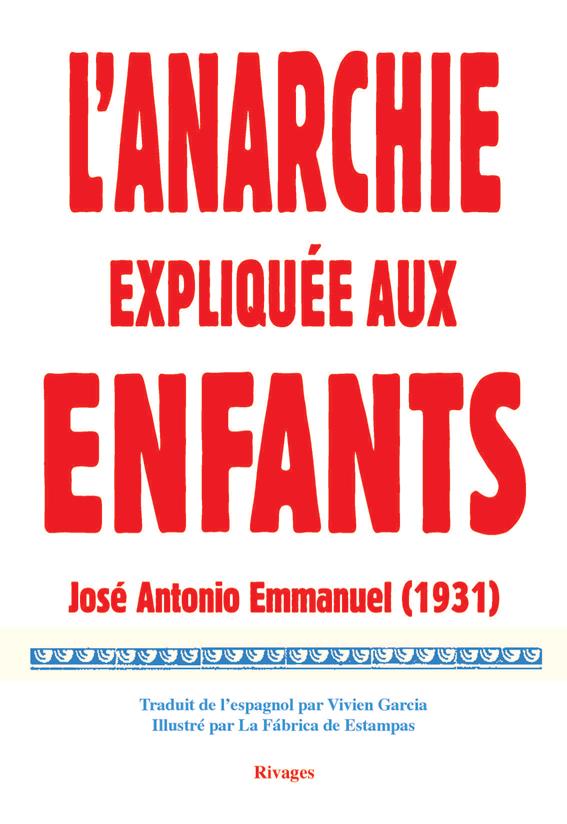
20 septembre 2023
16,5 × 24 cm
48 pages 12,00 €

ISBN : 978-2-7436-6103-8


et d’amour. La promotion de la lecture joua un rôle majeur dans les politiques culturelles de la Seconde République espagnole. Divers éditeurs et imprimeurs liés au mouvement libertaire y contribuèrent largement, trouvant là un tremplin pour la diffusion de nouveaux discours émancipateurs. Publié en 1931, L’Anarchie expliquée aux enfants émane de ce contexte.
1 Une belle édition accompagnée d’illustrations rose, bleu et jaune, qui tranchent avec l’imaginaire populaire du rouge et noir.
1 On assiste, ces dernières années, à un regain d’intérêt pour l’anarchisme et les pédagogies libertaires.

Olivier Besancenot est historien de formation Facteur de profession, il a été deux fois le candidat de la LCR aux élections présidentielles (2002 et 2007) avant d'être jusqu'en 2011 le porte-parole du NPA. Il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages sur l’histoire du mouvement ouvrier et des luttes sociales.
 Olivier Besancenot et Michaël Löwy
Olivier Besancenot et Michaël Löwy
Cinquantième anniversaire du coup d’état de Pinochet au Chili.
Cette fiction historique basée sur des faits réels rend hommage aux militants qui ont affronté, le 11 Septembre 1973, le coup militaire sanglant du Général Pinochet et de ses troupes. Ni livre d’histoire, ni essai théorique, ce récit politique romancé traite de la conspiration putschiste et de cette journée du 11 septembre.
Cette séquence historique est revisitée à travers le point de vue d’acteurs et actrices de la gauche chilienne de l’époque qui ont résisté en combattants, les armes à la main. Parmi eux, celui qui a refusé de capituler jusqu’à son dernier souffle : Salvador Allende. Alors qu’il représentait l’espoir de la gauche de tout un continent, il se donne la mort peu avant que les putschistes tentent de s’emparer de lui. Symbole de la vague d’autoritarisme anticommuniste que connut l’Amérique du sud durant les années 70, le coup d’État de la junte militaire intervient dans un contexte de guerre froide Il a été rendu possible par le soutien des Etats-Unis qui dès le début de la présidence d’Allende organise un boycott des prêts internationaux plongeant le Chili dans une grave crise économique.
• Un parti-pris original, celui d’un récit romancé fondé sur une solide enquête par deux voix importantes de la gauche contemporaine.
• Un hommage à Salvador Allende dont le terrible destin a profondément marqué la gauche française, passionnée par la gauche latinoaméricaine.
• Le récit implacable de la liquidation d’un État de droit sur l’autel du capitalisme.

Michael Löwy, est sociologue, philosophe marxiste et écosocialiste francobrésilien. Il est directeur de recherches émérite au CNRS et enseigne à l’EHESS. Il a cosigné chez Textuel Luttes écologiques et sociales dans le monde (2020) avec Daniel Tanuro.
La France, elle, fait face au coup d’État en ouvrant les portes de son ambassade à près de 800 réfugiés qu’elle exfiltrera, leur permettant d’échapper aux camps et à la torture.
50 ans du coup d’État de Pinochet au Chili le 11 septembre 2023.
6 septembre 2023
14 × 22,5 cm
224 pages 19,00 €
ISBN : 978-2-228-93389-6



La suite du best-seller Femme désirée, femme désirante. Danièle Flaumenbaum
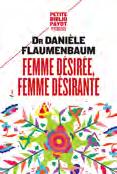
s’attache ici à la communication amoureuse et au moyen de se défaire de ce qui la parasite et nous détourne de notre partenaire.
« Je l’aime mais je ne comprends pas, on n’y arrive pas… » Le nouveau livre de Danièle Flaumenbaum traite des trois choses qui nous encombrent de ce point de vue et dont il faut se défaire (le maternel et le paternel ; les imaginaires sexuels ; les deuils et séparations), et des trois choses pas si simples à acquérir pour
accéder à une « nouvelle conscience » de soi et de l’autre (prendre soin de soi, être attentif à l’autre, parler aux enfants). Après quoi, on est enfin adulte en amour. L’objectif, comme toujours avec Flaumenbaum, est d’arrêter de se plaindre, se prendre en main, et vivre enfin la vie qu’on veut vivre.
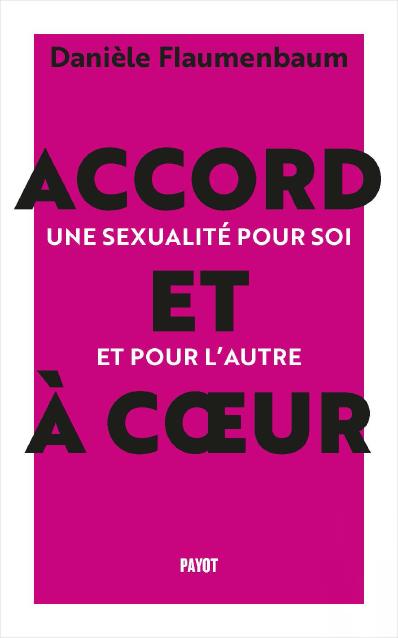
Ҍ Suite de Femme désirée, femme désirante, avec une ouverture sur les hommes et la communication.

Ҍ Une autrice vivifiante et réconfortante, dont les livres se révèlent très vite des guides de vie.
Quel Q ues chiffres
Ҍ Femme désirée, femme désirante : 150 000 ex.
Ҍ Les passeuses d’histoires : ce que nous transmettent nos grandsmères : 15 000 ex.

ÉGaleMent
Danièle Flaumenbaum, gynécologue et acupunctrice, a étudié la médecine chinoise et l’alchimie sexuelle taoiste, et utilise les outils de la psychanalyse transgénérationnelle.
© Patricia Canino
Sociologue, Charles BosvieuxOnyekwelu est chargé de recherche au CNRS. Ses travaux portent sur la sociologie des élites, du travail et des professions ainsi que sur les études de genre Il s’intéresse en particulier aux différentes manières par lesquelles les élites justifient les inégalités et leur domination sur le monde social. Il a notamment publié Croire en l’État : une genèse de l’idée de service public en France (18731940) (éditions du Croquant, 2020)
 Charles Bosvieux-Onyekwelu
Charles Bosvieux-Onyekwelu
L’université, un navire en train de couler.
La précarité vampirise l’enseignement supérieur et la recherche Plus de 50% des enseignements sont assurés par des personnels non-titulaires. À l’indétermination de l’avenir s’ajoutent l’injonction à la mobilité, l’instabilité géographique et le silencieux chantage au poste qui conduit les postulants à tout accepter.

En s’appuyant sur les travaux sociologiques traitant de la mise en faillite des services publics, ce livre analyse les causes et les effets de la précarité grandissante qui sévit dans le secteur de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche La précarisation des universitaires s’inscrit dans un contexte plus large, marqué par la fragilisation de l’emploi public et la mise en cause du statut des fonctionnaires.
C’est en lien avec ces évolutions délétères pour tous et toutes que prennent sens les diverses mobilisations qu’a connues l’Université depuis une quinzaine d’années, mobilisations qu’on ne peut déconnecter de la constitution d’un service public de l’enseignement supérieur et de la recherche, c’est-à-dire de l’idéal d’une éducation et d’un savoir accessibles au plus grand nombre.
• Une analyse minutieuse des réformes néolibérales imposées à l’université depuis une vingtaine d’années et de leurs effets: développement de la recherche sur projet, recours massif aux vacataires pour l’enseignement, turnover permanent du personnel administratif, etc.
• Un témoignage vécu de l’intérieur des absurdités, des souffrances et du gâchis que constitue cette précarisation délibérée de l’université.
• Une mise en perspective sociologique de l’inscription de la faillite de l’Université dans celle plus large des services publics.
TÉMOIGNAGE
14,5 × 24 CM
304 PAGES
PRIX PRÉVISIONNEL
23 €
MISE EN VENTE
6 SEPTEMBRE 2023
978-2-330-17314-2
-:HSMDNA=V\XVYW:

Traduit de l’allemand par Olivier Mannoni et Valéry Pratt
Préface de Michal Hausser-Gans
Survivre à Treblinka
Déporté du ghetto de Theresienstadt au camp d’extermination de Treblinka, où il a rejoint le petit millier d’“esclaves travailleurs” contraints de servir les “maîtres-bourreaux” dans leur entreprise de mort, Richard Glazar relate son quotidien, puis son évasion. Rescapé, il est l’un des grands témoins des procès de Treblinka – doté d’un sens du détail, de la nuance et de l’exactitude hors du commun, estiment les historiens. Claude Lanzmann le considère comme l’un des personnages les plus importants de Shoah.
À la fois poignant, palpitant et d’une absolue dignité, ce récit demeurera l’un des témoignages les plus puissants sur le quotidien et l’horreur des camps de la mort.
u Richard Glazar n’est pas sans points communs avec Primo Levi, ont relevé certains historiens. Tous deux ont relaté avec acuité et recul ce que les SS ont perpétré. Tous deux conjoignent un art du récit et une réflexion sur la Shoah. Tous deux ont montré que c’est l’importance vitale accordée aux relations humaines, à l’amitié, à la fraternité qui permet de sauvegarder l’espérance dans l’humanité.
Richard Glazar est né à Prague en 1920, dans une famille juive assimilée de la classe moyenne qui parle tchèque et allemand, pas yiddish. Il suit des études de philosophie et d’économie quand le représentant du Reich décrète la fermeture des universités en novembre 1939, à la suite d’émeutes estudiantines. Pour le protéger, ses parents l’envoient vivre dans une ferme, non loin de Prague, où il coule deux années paisibles, durant lesquelles il participe aux travaux agricoles. Convoqué à Prague par l’administration allemande le 2 septembre 1942, il est arrêté et déporté à Theresienstadt le 12 septembre, avant qu’on lui remette en octobre un ordre de transport pour “un autre ghetto, à l’est” : Treblinka. Glazar a d’abord publié son témoignage sous forme abrégée en tchèque, dans une revue (1967), puis sous forme de livre, en allemand (Fischer Verlag, 1992) et en anglais (Northwestern University Press, 1995).
Treblinka fut avec Auschwitz l’un des principaux sites d’extermination systématique des Juifs, des Tziganes et des homosexuels. 900 000 Juifs y ont été assassinés en 1942 et 1943. Richard Glazar (1920-1997) juif tchèque, fut déporté en octobre 1942 du ghetto de Theresienstadt (Tchécoslovaquie) à Treblinka (Pologne). “Sorti des rangs” à l’arrivée à la rampe du camp, il rejoignit une équipe de détenus chargée de trier les vêtements, les valises, l’argent et les autres effets personnels ramassés à chaque arrivée de convoi : une machine qui tournait sans interruption, alimentant par le pillage systématique la machine de guerre du IIIe Reich, mais aussi le confort personnel des SS qui gardaient le camp.
Glazar raconte, avec une minutie stupéfiante, la vie quotidienne du camp : l’intégration des “nouveaux”, le fonctionnement de la sélection, la récupération des biens des personnes assassinées, les petits trafics des officiers SS, le typhus, l’horreur, mais aussi la solidarité entre les détenus survivants. Cette solidarité débouchera au cours de l’été 1943 sur une insurrection minutieusement calculée, au cours de laquelle de nombreux SS seront tués. La plupart des détenus évadés seront repris et assassinés. Mais Richard Glazar, lui, parvient à s’enfuir et survit. Il rejoint la ville allemande de Mannheim, où il se fait passer pour un travailleur aryen et demeure jusqu’au débarquement des troupes américaines.
Points forts
Ainsi parlait saint Augustin d’Hippone, théologien chrétien romain du ive siècle. Combien connaît-on de maximes sur le voyage, toutes plus sérieuses, profondes et évocatrices sur l’envie, la nécessité, parfois la peur de parcourir le monde ? Ce livre retrace l’histoire du voyage et des déplacements de populations. Départ à la Préhistoire, arrivée dans le monde moderne ! Comme une dynamique déambulation, l’auteur nous guide sur les pas de l’Homme et de ses incessantes pérégrinations. Première étape, les hommes préhistoriques, en constant mouvement dans des conditions hostiles pour assurer leur survie, trouver de quoi se nourrir et se protéger. Puis au fil de son développement, il s’installe et crée de grandes civilisations dont les frontières s’étendent autour des premières aires urbaines. Qui dit frontières dit guerres de territoires, dont nous suivons les armées lancées au galop pour s’approprier l’espace de l’ennemi. L’avènement des religions monothéistes apporte aussi son lot de mutations, en raison des missionnaires, croisés et autres prosélytes envoyés parfois à l’autre bout du monde pour convaincre de la foi à adopter – ou l’imposer par la force. La curiosité grandit à mesure que les limites du monde s’étendent ; et les grands voyageurs l’explorent, parfois par intérêt pour la géographie et les civilisations, comme Ibn Battuta ou Zheng He, parfois par attrait commercial, comme Marco Polo qui en tire ses Carnets de la route de la Soie. S’ouvre ensuite l’ère des conquêtes occidentales, avec pour chefs de file les colons débarquant en Amérique, qui l’envahiront du détroit de Béring au cap Horn.
• Un ouvrage ambitieux sur un sujet original : l’histoire du voyage des Hommes depuis la Préhistoire jusqu’à l’époque moderne.
• Un récit qui nous emmène sur les pas de voyageurs aussi bien mythiques qu’inconnus du grand public, tout autour de la terre.
• Un style enlevé et dynamique, rendant la lecture accessible.
Mots-clés
• voyage – histoire – géographie – migrations – récit
Ancien sportif de haut niveau et retraité d’une carrière dans l’immobilier, Didier Huon de Kervadec se passionne pour la géographie et l’histoire. Ses nombreux voyages l’ont mené sur les cinq continents.

“Le monde est un livre, et ceux qui ne voyagent pas n’en lisent qu’une page.”
humaines pour le voyage et retrace les itinéraires qui ont façonné
978-2-330-18109-3
provisoire : 29 €
[Troisième édition, revue et corrigée]
Jean-Claude Golvin et Michel Reddé
Jamais dans l’histoire la Méditerranée et les terres qui la bordent ne se sont trouvées unies au sein d’un même ensemble politique, sinon sous l’autorité de Rome, pendant les quatre premiers siècles de notre ère. Or la mer est source de profits infinis pour celui qui sait la dominer et mettre en relation des mondes étrangers. La Méditerranée est ainsi le centre et l’émanation du plus vaste et durable empire de l’Europe, le lien entre des pays encore plus différents à cette époque qu’ils ne le sont aujourd’hui.
Ce livre nous invite à un grand voyage entre les rivages de cette mer intérieure qui unit l’Orient et l’Occident, l’Europe et l’Afrique. Alexandrie, Athènes, Pouzzoles, Rome, Arles, Carthage, Leptis Magna… sont autant d’escales où le talent de Jean-Claude Golvin nous permet d’accoster. Jean-Marie Gassend illustre la manœuvre des voiliers à l’aide d’aquarelles qui donnent envie de s’embarquer et de suivre le vent. Michel Reddé nous décrit la navigation de ces milliers de bateaux qui sillonnent sans cesse les vastes étendues liquides pour assurer le transport du blé, de l’huile, du vin et ravitailler les grandes villes du monde romain, tandis que les flottes militaires assurent la paix sur une Méditerranée que les Romains ont faite leur pour régner sur le monde. Mare nostrum, “c’est notre mer”, disent-ils alors en parlant d’elle.
Michel Reddé est archéologue et historien ; ses spécialités sont l’armée romaine, les camps militaires et la marine militaire romains. Ancien professeur des universités à l’université de Nantes, il est désormais directeur d’études émérite à l’école pratique des Hautes Études.
Jean-Claude Golvin est architecte dplg et directeur de recherche au cnrs. Il a dirigé pendant dix ans le Centre franco-égyptien de Karnak. Il est l’auteur de très nombreux ouvrages, notamment la série des “Voyages” aux éditions Errance & Picard.
Points forts
• Le travail commun d’un historien et d’un illustrateur et archéologue, pour un ouvrage à la fois érudit et superbement illustré.
• Une source unique sur le fonctionnement et l’architecture des ports à l’époque romaine.
• Les magnifiques aquarelles de Jean-Claude Golvin pour replonger le lecteur les temps antiques.
Mots clés
• Méditerranée – Port – Rome – Antiquité – Histoire –Archéologie – Aquarelles
On considère, traditionnellement, qu’il s’agit là du port commercial. Il donnait accès directement à la mer, par un goulet.
En apparence, ces deux bassins furent assez peu endommagés lors de la destruction de Carthage et les fouilleurs américains et britanniques ont retrouvé les quais et les installations sous une couche de débris de la cité punique, utilisés comme remblais par les Romains. Les deux bassins furent réutilisés après la refondation augustéenne, mais avec des fonctions différentes. L’ancien port de guerre perdit son rôle militaire, mais il n’accueillit sans doute pas des bateaux de fort tonnage, en raison d’une profondeur trop faible. Il fut, sous l’Empire, bordé d’une colonnade qui ouvrait sur des entrepôts, et abritait un temple dans l’îlot central, lui aussi entouré d’un portique. L’avant-port rectangulaire fut bordé lui aussi de magasins et de quais. Sa forme fut modifiée dans le courant du iie siècle de notre ère, les angles étant coupés, ce qui donna à ce plan d’eau un aspect qui rappelait celui du Portus Traiani, à Ostie. La capacité de la darse, toutefois, était assez faible, le tirant d’eau toujours insuffisant, et on peine à imaginer que c’était là le grand port par où transitait l’annone d’Afrique, où, selon une loi du Code Théodosien (XIV, 25), devait être concentré tout le ravitaillement de la province. Déjà Cicéron, vers la fin de la République, disait que la Carthage punique était succincta portibus, “entourée de ports” (De lege agraria, II, 32, 87). Quand, en 383 apr. J.-C., le futur saint Augustin s’embarqua pour Ostie, ce n’est sans doute
pas ce bassin qu’il utilisa. Mais seule l’archéologie pourra éventuellement, un jour, résoudre le problème des autres ports de Carthage, que nous ne connaissons pas encore.


Vers la fin du ier siècle de notre ère, les exportations africaines concernaient surtout les céréales ; on ne parlait guère de livraisons d’huile, car celle-ci n’avait pas encore très bonne réputation à Rome, au dire de Pline et de Juvénal. Cent ans plus tard, les choses avaient bien changé. L’huile d’olive constitue, on le sait, un produit de base de l’agriculture méditerranéenne. Corps gras essentiel, elle entre évidemment dans l’alimentation, et constitue une composante indispensable de nombreuses recettes culinaires. L’olive se consommait aussi, comme aujourd’hui, sous forme de fruits qui offrent un fort pouvoir énergétique. C’est aussi un produit indispensable aux soins du corps, il sert de base à de nombreux onguents et aux parfums. Avec le développement massif de l’usage des thermes, sous l’Empire, on en fit une consommation effrénée,
puisqu’on s’enduisait pour se faire masser. C’est encore une plante médicinale, en même temps qu’un combustible pour l’éclairage. Naturellement, il existait des variétés très importantes d’olives et d’huiles, ainsi que d’autres plantes grasses, et on ne les utilisait pas de manière indifférente : chacune avait sa fonction, sa qualité, son prix. L’Italie était un gros producteur d’huiles d’excellente qualité, fort estimées sur le marché de la capitale. Sous la République, les oliveraies étaient particulièrement développées en Sabine, dans le Samnium, la Campanie, l’Apulie et suffisaient largement à la consommation de la Péninsule, qui était exportatrice, même vers l’Orient. L’accroissement considérable de la population romaine, au dernier siècle avant notre ère, devait, comme pour le blé, inverser ces courants d’échanges. Si les olives et les huiles produites en Italie même continuèrent d’alimenter les grandes villes, en sus de la consommation locale, les quantités requises dépassaient désormais les possibilités de la métropole. Il fallait donc importer, d’autant que les prix, dans les provinces, étaient sans doute inférieurs, malgré le coût du transport. Désormais, c’étaient le sud de l’Espagne (Bétique), l’Istrie, l’Afrique (Tunisie) et la Tripolitaine qui allaient dominer le marché. On a ainsi estimé à 53 millions le nombre d’amphores vides déversées sur le Testaccio, à Rome ; encore ne s’agit-il là, probablement,
que d’une partie de la consommation romaine. Comme pour le blé, le commerce maritime destiné à la capitale s’effectua d’abord sur la base de contrats entre les gros producteurs et l’État, mais l’administration romaine s’assura progressivement de l’approvisionnement de ce produit indispensable. Sous Hadrien, l’annone semble englober non seulement la fourniture de blé mais aussi d’huile et, en 166, on voit apparaître un agent du préfet de l’annone, chargé de recenser l’huile d’Afrique et d’Espagne (CIL, II, 1180). À partir du règne de Septime Sévère (193211), on assiste aux premières livraisons gratuites, et à des achats sur le marché de Tripolitaine (A. E., 1973, 76). Mais il s’agissait de l’annone de la capitale. Ailleurs, pour les villes de moindre importance, la part de l’initiative privée resta sans doute longtemps prépondérante. C’est seulement vers la fin du iiie siècle et au Bas-Empire que l’on vit apparaître une véritable fiscalisation des livraisons d’huile ; encore ne fut-elle sans doute jamais généralisée. Le pouvoir se contentait de prélever, en nature, sous forme d’impôt, ce qui était nécessaire aux distributions gratuites, au ravitaillement des grandes villes, à l’armée. Mais, à côté de ces réquisitions subsistait évidemment un marché privé, libre.
aurait pris trois mois pour regagner, non sans peine, l’Italie, après avoir été dérouté tantôt vers les îles Gymnésies, tantôt vers la Sardaigne, tantôt même vers différents points de la côte libyenne vis à vis de ces îles. On exporte de Turdétanie [Bétique] du blé et du vin en grande quantité, ainsi qu’une huile dont l’excellence égale l’abondance. On en fait venir également de la cire, du miel, de la poix, quantité de graines d’écarlate et un cinabre qui ne le cède en rien à la terre de Sinope.” (III, 2, 6, trad. Les Belles Lettres)
Les découvertes archéologiques illustrent ici, mieux que partout ailleurs, la véracité des propos de Strabon. Les prospections qui ont eu lieu dans la vallée du Guadalquivir ont en effet montré la densité des vestiges agricoles de cette région, mais aussi la réalité d’une production locale d’amphores à huile bien caractéristiques, dont différents ateliers ont pu être identifiés. On retrouve ces amphores sur le marché romain, au Testaccio, dans tout l’Occident, en particulier dans la vallée du Rhône et jusque sur les sites militaires de la frontière de Rhénanie et de GrandeBretagne, ainsi que sur toutes les côtes atlantiques de la Gaule : leur présence est la marque de ces relations maritimes à longue distance, si fréquentes et si variées. Les “Dressel” 20, ainsi nommées selon la première typologie qui a été dressée par le savant allemand H. Dressel, à la fin du xixe siècle, présentent en effet une forme caractéristique qui les fait reconnaître entre toutes : leur panse quasi sphérique, sans épaulement marqué, ne comporte, à la base, qu’une très petite pointe ; leur col, court et étroit, porte deux anses courtes, solides, avec un timbre (marque de fabrique) inscrit dans leur pâte. L’épaisseur de la pâte, la taille du conteneur, jusqu’à 70 litres, entraînait un poids total très important, de l’ordre d’une centaine de kilos. On est assez bien renseigné sur la circulation de ces amphores grâce aux marques peintes sur le col, et qui se déclinent sur quatre lignes, que les spécialistes indiquent avec des lettres grecques :

1. Poids de l’amphore vide (en moyenne 30 à 35 kg) ;
2. Nom de l’exportateur (mercator) ;
3. Poids de l’huile contenue dans l’amphore (autour de 70 litres) ;
4. Nom du producteur ou du domaine, éventuellement date consulaire (à partir du iie siècle), port d’embarquement, parfois marque de contrôle douanier.
Les lagunes et la configuration du littoral narbonnais sous le Haut-Empire. 1. Narbo Martius (Narbonne).
2. L’Atax (aujourd’hui l’Aude). 3. Lac Rubresus (bassins lagunaires partiellement colmatés). 4. Île SaintMartin avec présence probable de la capitainerie du port. 5. Port-la-Nautique, avant-port de Narbonne de 30 av. J.-C. jusqu’à la fin du ier siècle apr. J.-C.
6. Mandirac-Castélou. L’embouchure de l’Atax est canalisée par deux digues dès le milieu du ier siècle de notre ère. 7. Port fluvial de Narbo Martius, quai d’Alsace.
Grâce à ces indications précises, une étude récente effectuée sur les sites militaires de la frontière de Germanie a pu ainsi mettre en évidence l’importance des circuits commerciaux, mais aussi l’existence de fournisseurs privilégiés, site par site, au IIe siècle de notre ère.
Une autre découverte extraordinaire est venue confirmer la richesse de la Bétique, la variété de ses exportations en même temps que le texte de Strabon : une épave, trouvée au large de Port-Vendres, dans le Languedoc (“PortVendres II”). L’épave, qui avait coulé à l’entrée du port, dans les années 40 de notre ère, a été fouillée de 1974 à 1984. C’est le chargement qui est intéressant, plus que la coque, qui a pratiquement disparu. On y a en effet reconnu plusieurs lingots d’étain blanc pur, provenant des mines d’Estrémadure, des lingots de cuivre, de plomb extrait dans la Sierra Morena, des amphores “vinaires” qui contenaient du defrutum – une sorte de vin cuit – de la meilleure qualité (c’est l’inscription qui le dit), des amphores contenant des saumures de maquereau, et des amphores à huile. Les marques peintes, très nombreuses, permettent d’identifier au moins neuf marchands, qui avaient réalisé un transport en commun, sans doute en affrétant un navire auprès d’un armateur (naviculaire). Un de ces négociants vendait à la fois de l’huile et du vin. Les timbres amphoriques permettent d’identifier au moins dix ateliers. On perçoit avec cette épave que le chargement devait être complexe et que l’idée qu’on se fait parfois d’une monoculture des grandes régions exportatrices ne correspond pas nécessairement à la réalité. Il est possible en effet – mais non certain – que les propriétaires de Bétique aient pratiqué à la fois la culture céréalière, celle de la vigne, celle de l’olivier. C’est toutefois cette dernière qui était la plus rentable, en terme de surplus commercial, alors que celle du vin était probablement secondaire. La région oléicole n’était pas limitée à un étroit couloir dans la vallée du Guadalquivir, mais correspondait à une vaste zone, qui utilisait les affluents du fleuve pour descendre les produits jusqu’à Hispalis (Séville), véritable port de mer à l’intérieur des terres. C’est là qu’on chargeait les bateaux, et l’État se préoccupa naturellement, à partir du IIIe siècle de notre ère, de surveiller ce commerce en nommant un procurator ad ripam Baetis, un agent impérial chargé du district douanier du Bétis
Une fois à l’embouchure du Guadalquivir, les navires de commerce trouvaient, selon Strabon, “la tour de Caepio, construite sur un rocher battu des flots, ouvrage admirable qui, pareil au phare, a été conçu pour la sauvegarde des navigateurs. En effet, comme les alluvions déposées par le fleuve provoquent la création de hauts-fonds et que la mer, devant son embouchure, est semée de récifs, il fallait un signal bien visible” (Strabon, III, 1, 9, trad. Les Belles Lettres). Après quoi, on passait devant Cadix, l’antique Gadès, en grec Gadeira, qui constituait un très grand port d’escale, en raison de sa position près du détroit de Gibraltar.
Créée entre 31 et 27 av. J.-C. pour accueillir des vétérans de la VIIIe légion et abriter les navires d’Antoine pris à Actium, la colonie romaine de Fréjus (Octavanorum colonia, quae Pacensis appellatur et classica, d’après Pline, H. N., III, 35) prenait la suite d’un premier établissement fondé par César (Forum Iulii). La présence d’une escadre semble attestée au moins jusqu’au début du Ier siècle de notre ère, et la vocation navale de Fréjus devait durer jusqu’aux guerres civiles qui suivirent la mort de Néron. La ville fut alors un enjeu stratégique entre les Vitelliens et les Othoniens. Après cette date, nous n’en entendons plus guère parler dans les sources. Jusqu’à une époque récente, notre connaissance des infrastructures de Fréjus était tributaire des fouilles menées avant la Seconde Guerre mondiale. Celles-ci avaient révélé un bassin portuaire de forme polygonale, d’environ 22 ha de superficie, aujourd’hui complètement envasé, même si ses môles, bien conservés par endroits, sont encore visibles dans le paysage actuel. Il est vraisemblable que ce port, installé au sud-est de la ville antique, a réutilisé une ancienne lagune, bien que de très importants travaux de dragage aient été nécessaires. Ses quais se développent sur une longueur d’environ 2 km. Celui du sud avait une largeur de 4 m, une longueur de 540 m. Il était surmonté par un rempart crénelé, haut de 4 m. Au nord et à l’est, les quais, moins bien connus, forment un rentrant dans le port, ménageant une sorte de goulet qui conduit à la mer libre, vers l’est, sans qu’on sache bien où se trouvait exactement le trait de côte antique. On connaît malheureusement assez mal les installations portuaires et il faut beaucoup se méfier des attributions traditionnelles des monuments de Fréjus. L’identification de la Lanterne d’Auguste, grande tour qui flanque le quai sud, du côté du goulet, et où l’on reconnaît d’ordinaire un phare, reste très improbable. Vers le nord-ouest, la colonie de Fréjus est installée immédiatement en bordure du port, mais les études récentes montrent qu’elle fut construite beaucoup plus progressivement qu’on ne l’a dit. Deux “plates-formes”, parfois considérées comme bastions, n’ont sans doute aucune fonction militaire : au sud, la butte Saint-Antoine abritait une villa, peut-être pour des fonctions officielles. Quant à l’enceinte urbaine, elle est usuelle pour une colonie romaine, mais n’a pas été construite telle que nous la connaissons aujourd’hui dès le début du règne d’Auguste.
Au sud-ouest de la ville, des fouilles menées dans les années 1970 ont permis de mettre en évidence les vestiges probables de casernements militaires, sans doute ceux du camp augustéen de la flotte, ce qui conduit actuellement à penser qu’un port primitif, non localisé avec exactitude, existait sans doute dans l’estuaire de l’Argens, au sud de la ville. C’est au mieux dans les premières décennies de notre ère (vers 30 ?) que le bassin fortifié, à l’est de la colonie, fut creusé. Peut-être abrita-t-il alors les vaisseaux de l’escadre, mais ce n’est pas sûr. Les vestiges d’un phare ont été découverts au large de Fréjus, sur l’îlot du “lion de mer”.

la capitale, à la fin de la République, donnée qu’on peut comparer à celle que les sources nous fournissent pour Paris, vers la fin du xviiie siècle (730 000 hl). Sans doute faut-il prendre ces chiffres avec prudence : ils offrent au moins un ordre de grandeur. Ajoutons à cette première raison l’appel que constituait désormais le marché des Italiens installés dans les provinces, négociants, mais aussi soldats, qui formaient une clientèle importante. Enfin, et surtout, le goût immodéré pour le vin de certains peuples barbares a favorisé la production massive de vin de qualité courante. L’archéologie, à la suite des textes littéraires, met aujourd’hui au jour le faste des grands aristocrates gaulois qui offraient volontiers à toute leur clientèle, parfois des milliers d’hommes, de gigantesques banquets dans lesquels le vin, produit étranger de grand luxe, coulait à flot. “Aimant le vin, ils s’emplissent de celui qu’apportent les marchands sans le mélanger d’eau et leur passion les poussant à utiliser la boisson dans toute sa violence, ils s’enivrent et sombrent dans le sommeil ou dans des états délirants. Aussi beaucoup de marchands italiens, en raison de leur amour du gain, tiennent-ils pour une aubaine le penchant des Gaulois pour le vin : apportant le vin soit par bateaux en utilisant les cours d’eau navigables, soit par charrois à travers la plaine, ils en tirent un prix incroyable : en échange d’une jarre de vin, ils reçoivent un esclave en échange de la boisson.” C’est ainsi que Diodore de Sicile, au début de l’époque augustéenne, décrit les mœurs gauloises (V, 25-27). Il est très vraisemblable que les marchands italiens ne se contentaient pas d’esclaves, encore que ce fût là un marché lucratif. Mais on a remarqué qu’en Gaule, les plus importants stocks d’amphores
Reconstitution d’une installation viticole, avec ses pressoirs à levier, ses fouloirs, ses chais.
Un atelier de fabrication d’amphores d’après l’exemple de Sallèles-d’Aude, au milieu du ier siècle.

vinaires provenaient de régions riches en minerai, notamment dans la région de Toulouse. Les Gaulois n’étaient d’ailleurs pas les seuls à aimer le vin et à le troquer contre des produits de grand prix : les Illyriens, par exemple, pratiquaient un commerce de même nature, si l’on en croit Strabon, à peu près pour la même époque (V, 1, 8). Ils se rendaient en effet à Aquilée, où du vin était apporté par mer, afin d’être transvasé dans des tonneaux que les Barbares remportaient chez eux, en contrepartie de peaux, de bétail et… d’esclaves.
Au dernier siècle de la République, le vin italien était donc exporté en très grande quantité dans tout l’Occident, y compris sur les lointains oppida de la Bretagne celtique. On suit sa trace grâce à la carte des amphores qui le véhiculent alors, les Dressel 1, et dont on trouve de nombreux témoignages sur tous les sites terrestres, mais aussi dans les épaves (44 recensées en 1986) qui jalonnent les côtes de Provence ou le nord de l’Espagne. L’une d’entre elles a été fouillée au large de la Madrague de Giens, de 1972 à 1992. Outre les informations essentielles que ce chantier, l’un des plus importants jamais réalisés en archéologie sous-marine, a apportées pour la connaissance des navires de cette époque, la cargaison a pu être estimée à environ 6 000 à 6 500 amphores de type Dressel IB, disposées en quinconce sur trois couches superposées, soit 3 m de hauteur.
Un tel chargement représente au minimum entre 120 000


Gaule pour réduire les partisans de Vitellius. “La menace dirigée par la flotte d’Othon contre la Narbonnaise, qui avait prêté serment à Vitellius, fut annoncée à Fabius Valens [un des généraux de Vitellius] par des messagers tout effarés ; auprès de lui se trouvaient déjà les délégués des colonies implorant du secours [il s’agit des colonies du sud de la Gaule]. Valens leur envoya deux cohortes de Tongres [Belges], quatre escadrons de cavalerie, toute la cavalerie auxiliaire des Trévires [habitants de la région de Trèves] que commandait Julius Classicus ; mais une partie de ces forces fut retenue à Fréjus ; car si toutes s’étaient portées vers la route de terre, il était à craindre que la mer ne demeurât libre, ce qui eût hâté la manœuvre de la flotte d’Othon. Douze escadrons de cavalerie et l’élite de l’infanterie auxiliaire marchèrent à l’ennemi, et on leur adjoignit une cohorte de Ligures, familiarisés de longue date avec le pays [la Ligurie recouvre toute la région littorale, depuis Marseille jusqu’au golfe de Gènes], et cinq cents Pannoniens [peuples de la rive droite du Danube, de Vienne à l’embouchure de la Save] non encore encadrés. La bataille s’engagea aussitôt, et dans cet ordre : une fraction de soldats de marine mêlés d’indigènes était étagée sur les hauteurs voisines de la mer ; tout l’espace
compris entre les hauteurs et le littoral, c’est-à-dire tout le terrain plat, était occupé par les prétoriens, dont sur la mer la flotte prolongeait en quelque sorte la ligne, les vaisseaux prêts au combat ayant tous l’avant tourné vers la terre devant laquelle ils formaient un front menaçant. Quant aux Vitelliens, moins forts en infanterie, mais possédant une cavalerie solide, ils font prendre position aux Alpins sur les montagnes voisines et derrière leur cavalerie ils rangent leurs cohortes en ordre serré. Les escadrons des Trévires, qui se gardaient mal, s’offrirent aux coups de l’ennemi dont les vétérans l’accueillirent de face, tandis qu’en flanc ils étaient accablés sous une grêle de pierres lancées par la bande d’indigènes tout à fait aptes à ce genre de combat et qui, répandus parmi les troupes régulières, montraient, braves ou lâches, une égale résolution dans la victoire. Les Vitelliens étaient ébranlés ; la flotte mit la terreur à son comble en se portant sur leurs derrières. Entourée de tous côtés, l’armée entière eût péri
Entrée de l’empereur par la porte d’Auguste dans la ville de Ravenne, avant son départ avec la flotte pour une expédition dans les Balkans. L’arrivée du “maître” donne toujours lieu à une cérémonie officielle au cours de laquelle la foule vient acclamer le souverain.

Dans un port italien les troupes qui accompagnent l’empereur s’embarquent pour une expédition dans les Balkans. La colonne Trajane, à Rome, qui figure les expéditions de Trajan contre les Daces, montre des scènes de ce type.
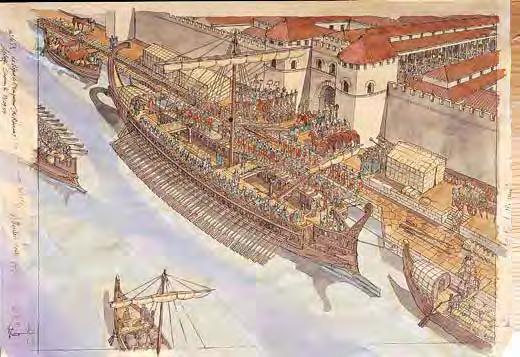
si l’obscurité de la nuit n’avait arrêté le vainqueur et masqué la retraite” (Trad. H. Goelzer, Les Belles Lettres). Dans le chapitre suivant, nous apprenons que la Corse et la Sardaigne ont été maintenues dans l’obéissance à Othon grâce à la flotte. On voit ainsi que celle-ci constitue une force militaire non négligeable. D’ailleurs les Vitelliens prennent bien garde de ne pas dégarnir le port de Fréjus, qui constitue, dans cette région, un point d’appui important dont le contrôle paraît toujours essentiel. C’est là, en effet, qu’Auguste, tout de suite après Actium, avait détaché les bâtiments et les équipages pris à Antoine, créant ainsi, en Méditerranée occidentale, un grand port de guerre. Tacite qualifie toujours la ville de “clef de la mer” en 69 (Hist., III, 43).
Alors que les rhéteurs du iie siècle, Aelius Aristide en tête, vantaient, dans des discours académiques, la prospérité et
la paix de l’Empire, ce dernier connaissait une activité militaire quasiment ininterrompue. Non que la pax romana fût un mythe. Mais elle ne signifie pas que Rome n’avait plus d’adversaires. Le principal d’entre eux était le grand rival parthe, contre lequel plusieurs expéditions durent être menées, ce qui n’empêcha pas le danger de s’accroître considérablement au iiie siècle avec l’arrivée d’une nouvelle dynastie, celle des Sassanides. Au nord de l’Europe, le monde barbare exerçait une pression de plus en plus forte sur le Danube, depuis le milieu du iie siècle de notre ère. Ne parlons pas des guerres de pure conquête voulues par Trajan, comme celle de Dacie. En Afrique n’existait aucune menace majeure mais des troubles éclataient de temps en temps, comme ce fut le cas en Maurétanie Tingitane (l’actuel Maroc) sous Antonin.
Si le cœur de l’Empire était en paix, sa périphérie était donc confrontée à la guerre, sinon de manière permanente et généralisée, du moins épisodiquement. Mais l’armée ne disposait pas de force de réserve qui pût intervenir ici ou là. Quand on voulait monter une expédition ou, tout simplement, faire face à une menace qui dépassait les seules forces disponibles localement, il fallait dégarnir provisoirement un secteur calme pour acheminer des renforts. On observe ainsi, à travers les inscriptions, le déplacement de très nombreuses troupes, d’un bout à l’autre de l’Empire. Le soldat romain marchait beaucoup, changeait d’ailleurs
408 pages
32 illustrations en couleur isbn : 978-2-330-17947-2
septembre 2023
Napoléon III était fasciné par Jules César et avait entrepris d’en rédiger la biographie ; mais très vite, la période de la guerre des Gaules devint le vrai sujet de son livre. L’originalité de celui-ci réside dans sa volonté de retrouver sur le terrain les traces du conflit. Pour ce faire, il a réuni les meilleurs historiens de son époque et fait appel à des officiers brillants pour entreprendre des recherches sur les lieux décrits par César, et les résultats se sont avérés stupéfiants. De Gergovie à Alésia, les fouilles ont permis de confirmer chaque épisode des batailles et des sièges, tout en suivant les mouvements de troupes. En cela, Napoléon III est l’un des fondateurs de l’Archéologie nationale ; entouré des meilleurs savants de son époque, il a mis en œuvre la fantastique énergie des érudits locaux à travers toute la France, envoyant des troupes pour vérifier certains itinéraires des légions de César ou faire reconstruire les machines de guerre romaines pour les expérimenter. Pionnière, cette fantastique aventure collective nous étonne, tant par les moyens dont elle put disposer en son temps que par les progrès scientifiques qu’elle a suscités, et que nul ne saurait aujourd’hui renier.
La lecture que fait Napoléon III du Bellum Gallicum de César reflète le constant souci de l’empereur de ne négliger aucun des aspects nécessaires à la compréhension du texte, des faits, de la politique et des hommes.
Loin d’être un objet de curiosité, cet ouvrage reste, par les informations qu’il nous livre, un document d’actualité. En effet, l’archéologie a confirmé depuis l’extrême justesse des études sur lesquelles il repose. C’est un document fondamental pour tous ceux intéressés par l’histoire et la guerre des Gaules.
Un atlas de trente-deux cartes est reproduit, et il est complété par les commentaires de Napoléon Ier à Sainte-Hélène, rédigé par l’un de ses aides de camp, sur la tactique militaire de Jules César.
Points forts
• La réédition d’un ouvrage méconnu et fascinant, qui montre la continuité entre les chefs de guerre antique et moderne.
• Un livre dont la rédaction a donné lieu aux débuts de l’archéologie telle qu’on la connaît aujourd’hui.
• Un atlas de trente-deux cartes pour situer mieux encore le contexte de l’ouvrage.
Mots clés
• Napoléon III – Jules César – Guerre – Gaule –Archéologie





Présence de la mort dans les noms de lieux
Stéphane Gendron
Le langage pour évoquer la mort sous toutes ses formes est d’une très grande richesse. C’est sans doute l’un des domaines qui a suscité le plus de créativité. Mais qu’en est-il de la toponymie ?
Dans quelle mesure les noms de lieux qui nous entourent sont-ils liés à cette préoccupation fondamentale qu’est la mort ?

Les cimetières et autres lieux d’inhumation en lien avec les découvertes archéologiques ont fait l’objet de nombreuses recherches, ainsi que le domaine judiciaire, les lieux d’exécution et leurs désignations.
Points forts
• Une étude complète des toponymes macabres, en lien avec les récentes découvertes archéologiques.
• Un travail linguistique qui permet de questionner le rapport de l’humain à la mort.
• Des cartes qui illustrent et permettent de situer visuellement les phénomènes toponymiques.
Mots clés
• Linguistique – Toponymie – Géographie –Archéologie – Noms – Mort
16 x 24 cm
144 pages
20 illustrations en noir et blanc isbn : 978-2-330-18111-6
septembre 2023
prix provisoire : 24 €
Pourtant, lorsque l’on consulte une carte géographique, la mort ne semble pas être le thème le plus fréquent dans la toponymie. Rares sont les communes qui en portent le souvenir. C’est surtout en regardant du côté de la microtoponymie – les lieux-dits et noms de parcelles cadastrales – que l’on trouve l’essentiel du corpus étudié dans le cadre de cette étude. Autrement dit, la mort est souvent écartée de la proximité des vivants, de leur lieu d’habitation, et se trouve reléguée à des espaces plus éloignés, par conséquent plus discrets. Il paraît important de reprendre ces recherches et de les confronter aux récentes découvertes archéologiques. La toponymie témoigne assez abondamment des situations qui provoquent la mort, l’ordonnent, lui confèrent un caractère officiel (les lieux de justice). Elle évoque régulièrement la crainte de la mort en situation de crise (maladies, épidémies), et parfois garde la trace d’événements macabres (massacres, meurtres). La conjuration de la mort est également un aspect non négligeable dans ces désignations. Ainsi, cet ouvrage questionne de manière nouvelle un certain nombre de toponymes ou de familles toponymiques dont la fixation est essentiellement due aux relations que les hommes entretiennent avec la mort.
Stéphane Gendron est spécialiste de toponymie, président de la société française d’Onomastique (Archives nationales, Paris). Dans ses publications, il s’attache à faire connaître ce versant d’un patrimoine parfois oublié, souvent négligé, que sont les noms de lieux de nos régions.
Comment la CIA, avec l’aide d’anciens nazis, orchestra après-guerre une tentative de manipulation des cerveaux américains par le biais du LSD.
Ҍ Une enquête palpitante, souvent surprenante, menée dans les archives d’Allemagne, des États-Unis et de Suisse, dont celles du laboratoire Novartis (ex Sandoz).
Ҍ Un livre pensé comme une suite de L’Extase totale et qui renoue avec le talent narratif de l’auteur.

Ҍ Un style vif et percutant, aux saillies parfois déjantées ! L’auteur, qui se met lui-même en scène, joue l’émotion quand il prône en épilogue un usage thérapeutique du LSD microdosé comme celui administré à sa propre mère, malade d’Alzheimer.
Traduit de l’allemand par Olivier Mannoni

Ouvrage dirigé par Sophie Bajard
27 septembre 2023
15,5 × 23,5 cm
300 pages 24,00 €
ISBN : 978-2-228-93384-1

Avril 1943 : alors que Harry J. Anslinger, le McCarthy de la drogue, est désespérément en quête d’un sérum de vérité pour faire parler ses suspects et que, à Dachau, le médecin SS
Kurt Plötner étudie les effets de la mescaline sur ses cobayes, un jeune chimiste suisse de la firme Sandoz, Albert Hofmann, expérimente à bicyclette le premier trip au LSD. Dans la guerre froide qui s’annonce, les États-Unis comprennent vite le potentiel de ce nouveau et puissant hallucinogène. Avec l’aide d’anciens nazis passés à son service, la CIA transforme le LSD, à l’origine remède miracle traitant les affections mentales, en massif outil de contrôle des esprits américains. Elle entraînera malgré elle sa propagation auprès de la beat generation et de la vague contestataire des années 1960. C’est l’incroyable histoire de cette vaste manipulation mentale, menée dans les années 1950-1970, et de l’emprise des hallucinogènes sur toute une génération que raconte ce livre mené comme un thriller d’espionnage.
l’A uteur
Né en 1970, Norman Ohler est un écrivain et scénariste allemand vivant à Berlin. Il est l’auteur de plusieurs romans et ouvrages de non-fiction sur la Seconde Guerre mondiale, plébiscités par la presse et les lecteurs : Les Infiltrés. L’histoire des amants qui défièrent Hitler (Payot, 2020) et L’Extase totale. Le IIIe Reich, les Allemands et la drogue (La Découverte, 2016). Son œuvre a été traduite dans plus de 30 langues.
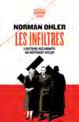
Ҍ Une galerie de personnages célèbres : Albert Hofmann, Harry J. Anslinger, Aldous Huxley, Timothy Leary, John Lennon, Richard Nixon et Elvis Presley.
Ҍ Anniversaire de la découverte du LSD par Albert Hofmann.
Ҍ La sortie du livre est prévue simultanément en septembre en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas.
Ҍ La France est l’un des plus importants consommateurs de substances psychoactives en Europe. L’usage thérapeutique de certaines drogues illicites est en discussion dans nombre de pays.
Ҍ Les Infiltrés sort en PBP au même office que High Trip.
Ҍ L’Extase totale a été un succès : 15 000 GF, 2016 + 6700 poche, 2018. High Trip est composé du même cocktail détonant : drogues + nazis (+ CIA).
éGAleMent

« Ce livre est le Moby Dick de l’historien, il traverse les siècles et relie les paysages, les êtres vivants et le flux du temps dans un récit merveilleusement lisible » (Amitav Gosh).
Œuvre magistrale sur les crises climatique et énergétique, les ravages de la croissance à tout prix et les points d’intersection entre l’humain et le non-humain, ce livre est la première histoire complète de cette étendue de terre et d’eau glaciales située entre l’Alaska et la Russie qu’on appelle la Béringie. Par là sont passées, il y a 20 000 ans, les premières personnes ayant pénétré sur le continent américain. Cette région-frontière sans cesse mouvante forme un écosystème complexe au sein duquel l’être humain est loin d’occuper toute la place.
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Laurence Richard.
20 septembre 2023
15,5 × 23,5 cm
400 pages 28,00 €
ISBN : 978-2-228-93385-8

Bathsheba Demuth suit les gens qui traversent le détroit dans leurs bateaux en peau de morse et leurs baleinières commerciales, mais elle suit aussi les animaux, les morses et les baleines, les
renards, les rennes, les corbeaux et les loups ; elle suit encore les ressources naturelles, les gisements de pétrole, d’étain et d’or ; elle suit enfin les nations et les idéologies capitalistes et communistes qui se les disputent dans un environnement extrême. Tous sont liés entre eux par des flux d’énergie et ce livre en fait l’histoire, une histoire qui nous confirme que nous ne pouvons pas nous déconnecter de la nature : l’énergie que nous siphonnons, les vies que nous prenons et les terres que nous altérons nous façonnent à leur tour. À l’heure de la crise climatique, ce n’est pas la moindre de ses qualités que de nous montrer la voie de la survie.
Ҍ Un des très grands livres d’histoire environnementale de ces dernières années, qui rappelle par certains côtés, notamment l’histoire orale, les travaux de Jean Malaurie (Les derniers rois de Thulé), et par d’autres se situe dans la continuité des pensées de Rachel Carson, de Philippe Descola et de de Bruno Latour.

Ҍ Une œuvre magistrale, louée pour ses qualités stylistiques, sa construction originale qui couvre la vie humaine et non humaine en surface comme sous la surface, et l’impressionnant travail archivistique et de terrain de Bathsheba Demuth.
Bastheba Demuth est actuellement professeure d’histoire environnementale et sociale à Brown University. À 18 ans, elle est partie vivre dans le Yukon, au nord-ouest du Canada. Là-bas, durant plusieurs années, elle a appris les techniques de survie dans l’Arctique : maîtriser les chiens huskies, chasser le caribou, pister l’ours, etc. Puis elle a étudié et vécu dans des communautés arctiques d’Eurasie et d’Amérique du Nord, explorant les interactions entre l’environnement, les animaux et les hommes de la région. Le résultat est ce livre unanimement salué par les historiens comme un événement.
22 x 27 cm
96 pages
env. 80 illustrations en noir et blanc et quadri
ISSN : 0007-4730
ISBN : 978-2-36919-202-2
Parution : septembre 2023
Prix : 20 €
Mots-clés : Lozère, maisons médiévales, Aquitaine, xiie siècle, art cistercien, décor peint, xviiiesiècle, sculpture, Louis XIV, fonte de fer.
Publication de la Société française d’archéologie, le Bulletin monumental s’attache, depuis 1834, à proposer des études de référence sur l’architecture et le patrimoine, du Moyen Âge au xxe siècle, qui s’adressent aussi bien aux spécialistes qu’aux amateurs.

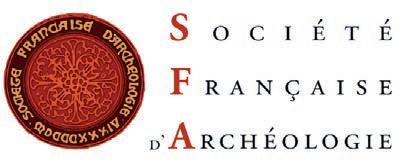
Chaque livraison est richement illustrée et offre des études de fond inédites complétées par des rubriques d’actualité sur des découvertes récentes et de comptes rendus sur les parutions importantes en France et à l’étranger.
Martin Mallard et Clémence Dequaire, « Approche du castrum de La Garde-Guérin et de ses maisons médiévales »

Jean-Baptiste Javel, « Les enduits gaufrés et les décors peints non historiés de l’église abbatiale de Cadouin (Le Buisson-de-Cadouin, Dordogne) »
Daniel Bontemps, « La statuette équestre de Louis XIV et les débuts de l’art de la fonte de fer ornée vers 1700 en France »

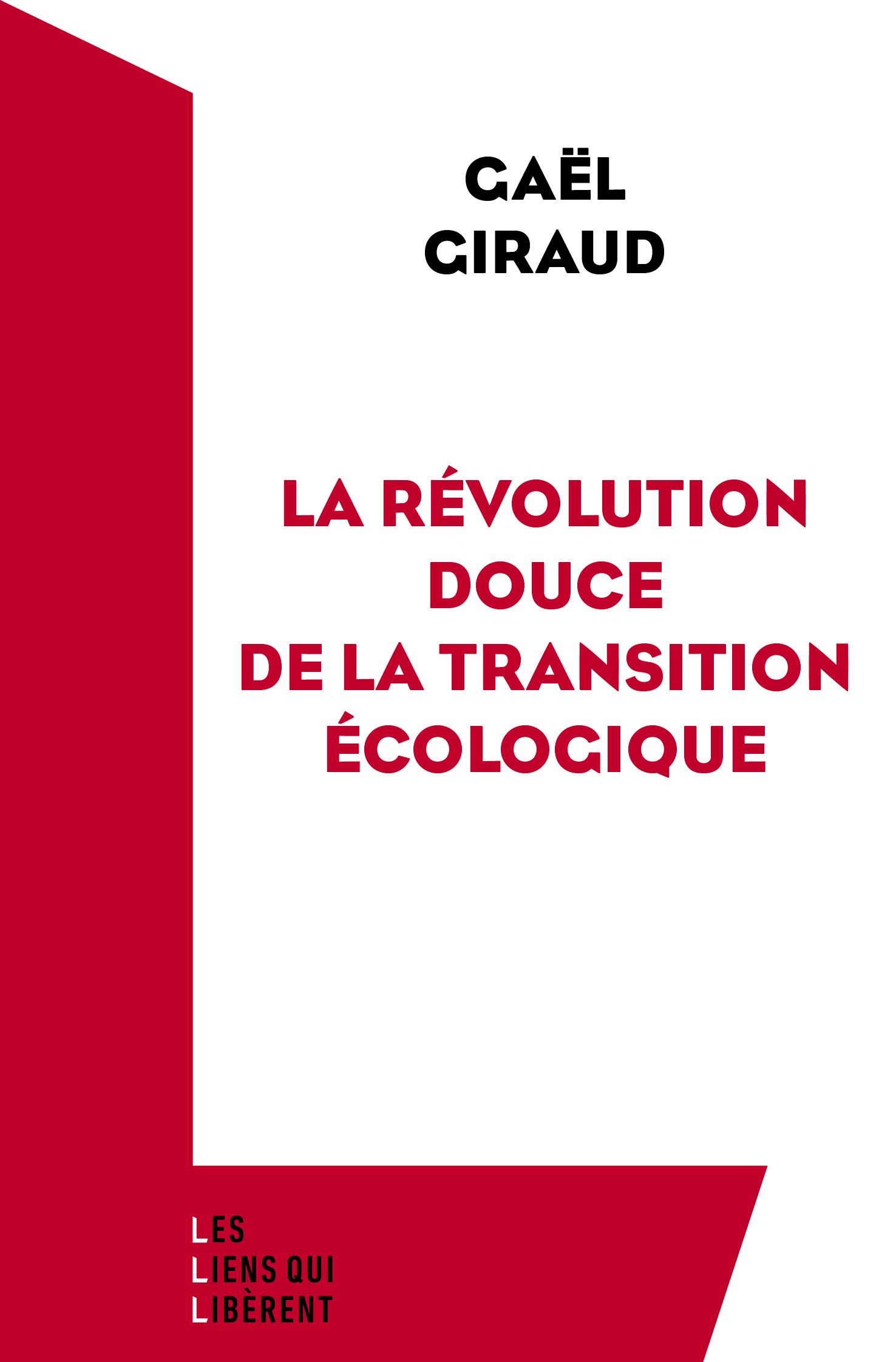

Gaël Giraud analyse la crise écologique, ses liens avec la finance de marchés, et esquisse une réponse à l’impasse où nous nous trouvons. Il se livre à une critique acerbe de la manière dont l'économie est enseignée, comprise et in fine mise en application par les décideurs publics. Il explique comment elle échoue à répondre aux défis contemporains car elle ne prend en compte ni le concept de complexité, ni le facteur énergétique, ni la question de la monnaie. L’économiste y avance des propositions concrètes pour faire face à l'urgence climatique en vue de construire un avenir possible.
Couverture provisoire
On néglige aujourd'hui largement le rôle central joué par l'énergie et les minerais dans l'élaboration de tout raisonnement économique, alors que les ressources énergétiques et minières ne sont pas infinies. De plus, contrairement à ce qui est affirmé par la plupart des économistes, la monnaie n'est pas « neutre » : les variations de la quantité de monnaie disponible ont un impact majeur sur toutes les variables macro-économiques et pas uniquement sur le niveau général des prix. « Dans ce modèle, écrit Giraud, il est impossible de comprendre qu'aujourd'hui les marchés d'actifs financiers dérivés représentent plusieurs fois le PIB de l'ensemble de l’économie mondiale et que seulement 7% des transactions qui ont lieu sur ces marchés impliquent un acteur économique de la sphère réelle ». De sorte qu’aujourd’hui, la politique de lutte contre l’inflation par les banques centrales occidentales part d’un diagnostic erroné (l’inflation est tirée par la raréfaction des énergies fossiles et non par un excès d’émission monétaire) et choisit un remède dangereux pour la stabilité financière et économique mondiale.
Pour Giraud, le PIB est un paramètre obsolète car il passe sous silence les relations humaines et sociales, le respect de l'environnement et le rapport aux matières premières : « Le PIB se concentre sur la production et la consommation de biens et d'argent, alors que la richesse de la vie sociale ne se réduit pas du tout à ces valeurs » note Giraud. « Le PIB ignore les inégalités sociales, il suit une logique de la moyenne indifférente à la distribution effective des richesses. Le PIB ne prend pas non plus en compte les effets néfastes du productivisme (et du diktat d'un rendement boursier de 15% par an) et de la "dérégulation" (la flexibilité comme seule politique de lutte contre le chômage) sur la vie sociale et l'environnement. C'est un indice indifférent à la détérioration des biens communs vitaux (eau, air, terre, réchauffement climatique, écosystèmes...), à la violation des droits fondamentaux et à l'augmentation de la pénibilité du travail. »

Gaël Giraud est directeur du programme de justice environnementaleàl'universitéde Georgetown, professeur à la McCourt School of Public Policy, jésuiteetdirecteurderechercheau CNRS. Ilestl’auteurdenombreux ouvrages parmi lesquels Composer un monde en commun : Une théologie politique de l’Anthropocène (Seuil, 2022) ou L'Économie à venir, avec FelwineSarr(Editions LLL,2021).
Parution : Septembre 2023
ISBN : 979-10-209-2479-7
Prix provisoire : 20 €
Giraud se livre également à une critique très documentée de la finance non régulée qui domine aujourd'hui les marchés. Un exemple : les banques déplacent aujourd'hui leurs méga-ordinateurs dans les sous-sols de leurs immeubles, espérant ainsi que leurs logiciels de trading automatiques pourront gagner quelques micro-secondes sur leurs concurrents dans le passage des ordres de vente et d’achat.

Giraud ne s'arrête pas à la critique mais avance des constats et des propositions volontaristes, en soulignant tout d'abord le rôle important que les banques et la finance en général peuvent jouer dans la bifurcation écologique.
A ce jour, montre-t-il, les bilans des banques sont remplis de produits dérivés « bruns », c'est-à-dire liés aux énergies fossiles ; c'est pourquoi les établissements de crédit s’opposent en coulisse à la transition écologique car, si celle-ci avait vraiment lieu, lesdites banques perdraient la quasi-totalité de leurs fonds propres et seraient en faillite : « Pour un euro prêté sur les marchés financiers en faveur des énergies renouvelables, les banques françaises en ont prêté huit aux énergies fossiles […]. Qui peut croire que cette étrange sélection de clients dans le secteur de l'énergie par nos banques est le résultat d'une concurrence loyale ? » s'interroge l'économiste. Le livre propose des solutions réalistes pour « libérer » nos banques de leur addiction aux fossiles sans pour autant faire payer par le contribuable la note de leurs errements passés.
La transition écologique peut aussi permettre la réindustrialisation verte de l'Europe, sur un continent où l'industrialisation est en panne, voire en régression, depuis de nombreuses années : quelques choix concrets, comme l'hydrogène vert, le photovoltaïque organique, etc. peuvent permettre la renaissance industrielle du continent. Enfin, Giraud soutient fortement la perspective d’une gouvernance par les communs. Nous devons cesser de considérer la planète comme un ensemble de biens privés ou destinés à la privatisation (l'air, l'eau, le sol, les ressources naturelles, le fond des océans mais aussi la santé globale, voire le corps humain) afin de favoriser le développement d'une société plus juste, plus durable, et finalement capable d'un avenir.
 Benjamin Brice
Benjamin Brice
En 2022, Benjamin Brice sort un ouvrage à compte d’auteur, La sobriété gagnante. Sans éditeur et sans diffuseur. Il en vend en moins d’un an plus de 2500 exemplaires de son simple fait. Il reçoit des soutiens enthousiastes de la presse (Le Figaro, Le Monde, L’Obs, France inter, etc.) et de certains intellectuels ou politiques (comme Dominique Méda ou François Ruffin). Son livre L’impasse de la compétitivité approfondit l’un des arguments de son livre en le documentant largement.

Avec une idée aussi forte qu’originale et contre-intuitive dans notre monde libéral : la compétitivité n’est pas la solution de nos économies mais précisément le problème.
Dansladernièrepériode,lesgouvernementsfrançais–dedroite,degauche etducentre–ont tous mis en place des politiques visant à stimuler la compétitivité du pays : baisse du coût du travail, flexibilisation de la main-d’œuvre, réduction de la fiscalité des entreprises et maîtrise des dépenses publiques. Malheureusement, les résultats se font attendre, puisque le déficit de la balance manufacturière bat des records chaque année et que la réindustrialisation reste un mot vide. À côté de cela, les objectifs de maîtrise des dépenses entraînent le sous-financement des services publics. Quant à l’obstination des gouvernants à demander, surtout au grand nombre, des efforts impopulaires, elle mine profondément le fonctionnement de notre régime démocratique. Tout cela est d’autant plus dommageable que le monde a beaucoup changé depuis les années 1980, lorsque la compétitivité est devenue une priorité. Dans une conjoncture de tensions internationales, de péril écologique et de déficit extérieur structurel, il faut changer de logiciel. Ne ratons pas le virage qui est devantnous!
Couvertureprovisoire

Benjamin Brice estdiplôméde l’ESSECetdocteurensciences politiquesdel’EHESS.Ilest l’auteurde Lasobriétégagnante. Pouvoird’achat,écologie,déficits: Commentsortirdel’impasse? (LibriNova,2022).
Parution : Septembre 2023
ISBN : 979-10-209-2478-0
Prix provisoire : 16 €

80 % des plaintes des femmes pour violences aboutissent à un classement sans suite.
Pourquoi cette situation et comment sortir de cette inégalité systémique indigne ?
« Classée sans suite », trois mots qui signifient qu’aucun procès ne se tiendra jamais. Jusqu’aux années 1920, les femmes n’avaient pas le droit de porter plainte. Aujourd’hui, 76 % des enquêtes pour viol n’aboutissent pas, presque toujours par manque de preuves.
13 septembre 2023
12 × 19,5 cm 224 pages 18,00 €
ISBN : 978-2-228-93387-2

c’est également le cas de 80 % des plaintes des femmes victimes de violences. le système judiciaire montre ainsi sa défaillance, incapable de garantir aux femmes, non pas seulement un procès équitable, mais tout simplement un procès.
si la parole des femmes s’est indiscutablement libérée, les oreilles de la justice, elles, restent encore sourdes à leurs plaintes. le livre proposera d’abord un état des lieux de la difficulté de faire valoir ses droits en tant que victime aujourd’hui, puis une analyse des blocages systémiques dans cette marche vers l’égalité concrète. enfin, seront envisagées les voies d’amélioration qui s’offrent à nous, collectivement, afin de lutter résolument contre l’inégalité faite aux femmes en matière judiciaire.
Ҍ Des scandales fracassants chaque jour, avec la libération de la parole des femmes et la médiatisation des combats : cf. les féminicides ou les scandales PPDA, Hulot & co.
Ҍ Une justice patriarcale au sens fort du mot : dont les rouages ne savent pas respecter et reconnaître les violences faites aux femmes, par manque d’habitude (jusqu’aux années 1920, les femmes n’avaient pas le droit de porter plainte) et de volonté politique (la soi-disant «grande cause» du quinquennat) ?
Ҍ Une autrice avocate médiatisée, porte-parole d’Osez le féminisme (forte communauté sur les réseaux sociaux et grande capacité médiatique).

Mots-clefs
JUstice Féminisme Femmes victimes De viOlence POlice RecOnnAissAnce viOl
viOlences cOnJUgAles HOmme AgResseUR AgRessiOn FRAnce inJUstice FéminiciDe sOciété tRibUnAl PROcès clAssé sAns sUite Actu A lité
Ҍ traitement médiatique des féminicides et décompte annuel : 34 femmes ont été assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint à l’heure où j’écris cet argumentaire (mars 2023).
violaine de Filippis-Abate est avocate, engagée pour les droits des femmes, porte-parole d’Osez le féminisme et chroniqueuse à L’Huma.
Quel Q ues chiffres
Ҍ 80% des plaintes déposées par des femmes pour violences sont classées sans suite.
Ҍ 1% des viols aboutissent à une condamnation.
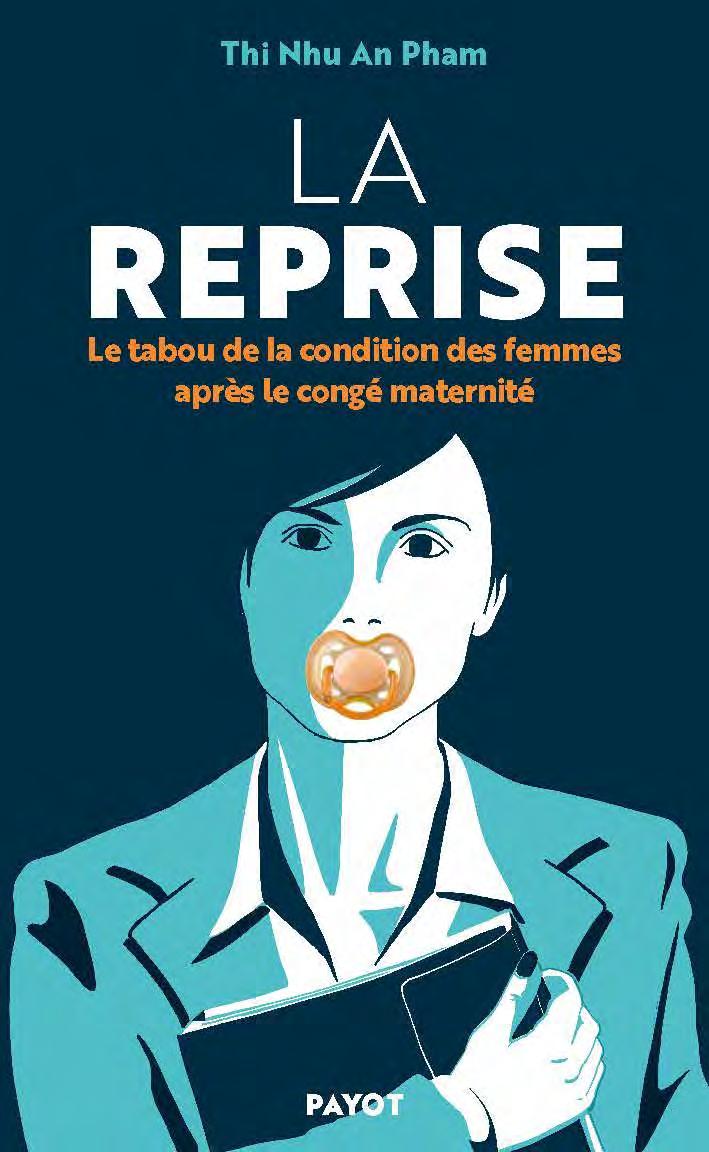



« Ces tests entrepris au départ pour elle, dans un dialogue qui poursuivait les sous-entendus de nos face-à-face, je les ai continués pour mettre derrière moi ce qui m’a tellement bouleversée, quitter le ressassement du souvenir et des regrets, tourner la page par et avec les mots. »
Quelques poèmes et un carnet de tests qui jouent avec les codes et l’imaginaire féministe, et revisitent les différentes étapes de l’état amoureux. Un questionnaire poétique, oulipien, drôle et engagé, auquel la lectrice, le lecteur est invitéE à répondre.
L’AUTRICE
Née en 1974, diplômée des BeauxArts de Paris, collaboratrice de la revue Vacarme, Rachel EastermanUlmann est une fée variant les plaisirs de l’existence entre le militantisme, l’art, la poésie et la mode.
112 pages / 115 x 175 mm
10 euros TTC
ISBN 978-2-36624-805-0
« Une histoire d’amour racontée à travers des tests, où chaque question amène à une mini-réflexion sur la vie, l’amour, le corps ou les légumes! »
Librairie Mollat
« Dans ce drôle de livre concept, ludique et féministe, Rachel Easterman-Ulmann vous aide à définir quelLE amoureuxSE vous êtes. Quelle chanson de Dalida, quelle illusion, quel silence, quelle licorne, même. (...) Arriver à insuffler du sens et un message féministe non genré dans ce genre, il fallait le faire ! »
Bookalicious
• Entre création littéraire et parodie de tests féminins, un livre à part dans la collection Sorcières qui paraît pour la première fois en poche.

• Un livre-jeu tendre et poétique.
• Un détournement féministe des tests des magazines féminins.
Quelle fém niste êtes-vous ?
12 questions et 4 profi s pour savoir de quoi votre émancipation est e fru t.
01 - Une femme d except on c 'est une femme qui ?
a- Reste debout malgré tout
b- Se fout d'être belle quand elle pleure
c- Sait jouer de ses synapses
d- Porte une barbe
02 - L évei de votre consc ence ce fut quand vous avez compris que ?
a- L'école maternelle était relative à la mère
b- Le masculin l'emporte sur le féminin
c- On ne naît pas femme, on le devient
d- Les lesbiennes ne sont pas des femmes
03 - Votre corps est ?
a- Un bel ouvrage
b- Conquérant
c- Utopique
d- Un champ de bataille
04 - La fém n té c 'est ?
a- Quand vous voulez
b- Une assignation
c- Difficile de s'y retrouver dedans et pourtant
d- Votre ennemie
05 - Votre combat ?
a- C'est le combat de touTEs
b- Les petits ruisseaux font les grandes rivières
c- Nationaliser les usines à paillettes
d- Vous porte
06 - S vous dev ez choisir votre étendard, vous prendr ez ?
a- Votre corps
b- Un joli camaïeu de plumes, de strass, et encore de la paillette
c- Un aigle noir
d- Vous vous êtes toujours contentéE d'un parapluie
07 - La papa La par té ?
a- Vous en rêvez
b- Ce n'est pas votre genre
c- Ça a ses raisons d'être
d- C'est le moyen d'une bonne représentation
08 - La mama La man festation que vous aimer ez organ ser ?
a- Celle qui se transformera en révolution
b- La kitty pride
c- Un sit-in pour soutenir les mathématiques sensibles
d- Un kiss-in pour embrasser votre target, décidément inaccessible
09 - Votre héro ne po itique ?
a- Louise Michel
b- Angela Davis
c- Ai Xiaoming
d- Elle est morte
10 - Vous êtes a/le d gne hér t èrE de ?
a- Cléopâtre
b- Virginia Woolf
c- Marie Curie
d- Votre mère
11 - S vous deviez faire votre art c e que le qual té mettr ez-vous en avant ?
a- La sagacité
b- Rebelle
c- L'hystérie
d- L'amalgame de l'autorité et du charme
12 - À quoi sert de vivre ibre ?
a- Chanter, marcher, rêver
b- Combattre la fleur au fusil
c- Construire unE autre monde d- Sans amour…
Résultats :
Faites les comptes vous êtes :
Une major té de Vous en êtes une fol e
Ce n'est pas que les autres ne le sont pas, mais vous, vous faites fi de toute retenue, n'en pouvant plus des carcans que la société impose. Fille de rien, fille de bien, vous souhaitez le meilleur pour chacunE et tenez les représentations pour des moyens radicaux de dire votre différence. Le sourire aux lèvres, vous vivez en pleine lumière la radicalité fabuleuse d'une liberté de choix. De la femme cachée à l'intérieur de vous, vous vivez en toute connivence tous les affects. À la merci d'une insulte, vous transformez l'expérience de la démesure pour combattre le silence, faisant peau neuve dans une humeur émerveillée. Votre pensée est à l'unisson et exalte différence et solidarité dans des réflexions égalitaires, créant avec ces instruments de résistance les conditions d'une vie meilleure, intense, sans regret. Affrontant les jugements, défiant les interdits, signifiant par vos entrechats que les conquêtes à venir sont à portée de main.
Une ma or té de Vous en êtes une futée
Ce n'est pas que les autres ne le sont pas, mais vous, vous avez tout compris des enjeux de domination depuis la cour de récréation où vous jouiez à la guerre, en toute décomplexion, la cheffe de la résistance. Vous y étiez libre de vos gestes et vous l'êtes restéE sur tous les terrains. Vos réflexions sur votre place dans le monde se sont accompagnées de celle sur le genre, ne comprenant pas qu'on vous souhaite soumisE à des désirs qui n'étaient pas les vôtres, juste parce que vous étiez une fille/un garçon.
Vos envies et votre curiosité se portaient, et portent encore aujourd'hui, de la chimie à la géographie en passant par les corps déliés. Vous êtes unE aventurière, vous cherchant dans les, belles lectures, activités physiques débordantes, et voyages. Vous vivez toutes vos envies sans peur, laissant les reproches sur ceux et celles qui se fondent dans les normes. Vous êtes unE affranchiE qui porte en elle/lui une idée de bonheur et de vérité.
Une majorité de Vous en êtes une f ère Ce n'est pas que les autres ne le sont pas, mais vous, vous caressez d'un regard guerrier le monde. PrêtE à tous les combats, vous osez vous défaire des attaches d'un autre temps. Dessinant dans le brouhaha du quotidien une société qui, chérie, accepte et cultive les particularités. Dans les conversations familières ou inconnues, vous faites entendre votre voix dans une tendre détermination. Sans hésitation vous montrez votre visage le plus complet, abandonnant les poses alanguies pour les discours d'affirmation. Vos idées brisent les peurs et ouvrent bien des cœurs. Votre aura écrit en toute autorité la belle histoire d'une libération. Vous glissant dans une superbe fluidité pour percer tous les plafonds de verre. Vous conduisez votre vie, vos élans, vos luttes avec une étincelante fougue. Vous êtes exactement ce que vous voulez être, dans un devenir où les monstres sont les plus adoréEs des créatures.
Une ma or té de Vous en êtes une fur euse
Ce n'est pas que les autres ne le sont pas, mais vous, vous avez la rage qui déborde. Votre poil se hérisse à chaque outrage. Cette colère qui prend source dans certains gestes, douleurs minorés, injustices criantes, vous la régulez pour construire unE monde à votre image, fougueuse et joyeuse. Votre corps envahit ardemment l'espace, votre tête élabore de singuliers discours porteurs d'espoir, votre cœur au bord des lèvres, rien ne vous effraie. Au creux de vos mains, les plus beaux jours accompliront leur geste dans l'idée victorieuse de lendemains au goût de miel. Vous revendiquez les refus non négociables, tout autant que l'irrévocabilité de vos plaisirs entêtés. Vos opinions façonnées au creux d'encouragements sororals vous avancez avec l'impétueuse volonté d'affronter la haine de ceux et celles qui vous refusent votre libre existence. Votre courage à l'unisson de vos aspirations, vous ne cessez de crier.
Que le langue est la vôtre ?
1ère publication in Vacarme n°69 [automne 2014]
12 questions et 4 profi s pour prendre rendez-vous avec de beaux endema ns
01 - Vous êtes?
a- Plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit
b- Polyglotte
c- Plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral
d- CernéE
02 - Vous semez ?
a- Des petits cailloux
b- En séparant bien le bon grain de l'ivraie
c- Le doute
d- L'autre récolte
03 - La sensual té vous a souha tez sans ?
a- Phrases
b- Fard
c- Frein
d- Fin
04 - Vous tournez ?
a- Autour
b- 7 fois votre langue dans votre bouche
c- La tête
d- La page
05 - Vous donnez ?
a- Envie
b- Et vous présentez la note
c- Et recevez tout autant
d- Votre langue au chat
06 - Vous êtes attachéE à ?
a- Vos habitudes
b- Tout dire
c- Tout voir
d- Sa personne
07 - Votre corps est traversé ?
a- À l'évidence
b- De part en part
c- En sens interdit
d- Mille et une fois
La face cachée de la transition énergétique et numérique
Poche + : parce qu’un livre n’est jamais clos, mais toujours dans le mouvement du monde, La guerre des métaux rares est réactualisé dans une nouvelle édition largement augmentée et réactualisée

Révolution numérique, transition énergétique, mutation écologique, etc… D’aucuns journalistes, politiques, chercheurs et prospectivistes, nous parlent d’un nouveau monde enfin affranchi des matières fossiles, des pollutions, des pénuries, des tensions politiques et militaires … Eh bien cet ouvrage formidablement documenté, fruit de six ans d’enquête, nous montre qu’il n’en est rien !
En nous émancipant des énergies fossiles, nous sombrons en réalité dans une nouvelle dépendance. Celle des métaux rares. Ils sont devenus indispensables au développement de la nouvelle société écologique (éoliennes, panneaux solaires, etc.) et numérique (ils se nichent dans nos smartphones, nos ordinateurs, tablettes et autreobjetsconnectésdenotrequotidien).
Or, les coûts environnementaux, économiques et géopolitiques de cette dépendance serontpiresencorequeceuxdenotresociétéindustrielleactuelle.
Pendant six ans, Guillaume Pitron a enquêté dans une douzaine de pays sur toutes ces nouvelles matières rares qui détrônent progressivement les énergies fossiles. Et pour cela, il lui a fallu côtoyer les replis des mines d'Asie tropicale, survoler les déserts de Californie en bimoteur, s’incliner devant la reine d'une tribu oubliée d’Afrique ou dépoussiérer des vieux parchemins remisés dans de vénérables institutions londoniennes.

Couvertureprovisoire
Parution : septembre 2023
Prix : 9,90 €
La guerre des métaux rares

Édition courante : 45 000
Poche + : 40 000
L'enfer numérique
Édition courante : 35 000
Journalisteetréalisateurde documentaires, Guillaume Pitron estconnupourses enquêtes sur les enjeux économiques,politiqueset environnementaux de l’exploitation des matières premières. Son premier ouvrage, La Guerre des métauxrares.Lafacecachée de la transition énergétique etnumérique (LesLiensqui libèrent,2018),traduitdans unedouzainedepays,aété décliné en documentaire sur la chaîne Arte. Il est également l'auteur de l'Enfernumérique,Voyageau boutd'unlike (LesLiensqui Libèrent,2021).

Le genre vu par un primatologue
Poche + : parce qu’un livre n’est jamais clos, mais toujours dans le mouvement du monde, Différents est réactualisé et précédé d'une nouvelle introduction de l'auteur.

Voici un vibrant manifeste pour l’égalité des genres par l’un des plus éminents primatologues de notre temps. Pour établir si les préférences et les comportements humains que nous qualifions parfois de genrés ont une origine biologique, Frans de Waal les compare avec ceux d’autres primates, non affectés par nos biais culturels.


Et les résultats ébranlent profondément les croyances prises pour des vérités sur la masculinité et la féminité, l’autorité, le pouvoir, la coopération, la compétition, les liens filiaux et les comportements sexuels. Au cours de décennies passées auprès des grands singes, l’auteur a constaté que les femelles étaient autant que les mâles, si ce n’est plus, impliquées dans les choix de partenaires sexuels, qu’elles pouvaient exercer une domination non pasphysique,maissociale,parlestatut,leprestigeetlesalliances.SelonFrans de Waal, il est faux de penser que l’homme posséderait une nature plus dominatrice que la femme, justifiant qu’il occupe une place prépondérante danslasociété.
Couvertureprovisoire
Parution : septembre 2023
Prix : 9,90 €
Passionnant récit de la vie sociale des grands singes, avec lesquels nous partageons 96% de notre patrimoine génétique, ce nouveau livre de Frans de Waal élargit le propos sur la dynamique des genres humains. Il promeut un modèle inclusif qui embrasse les différences, plutôt que de les nier. Les découvertes de Frans de Waal s’inscrivent avec force dans les débats contemporainssurlegenre,l’égalitéetl’opposition
Frans de Waal est un primatologue américanonéerlandais. Son point de vue original,celuid’une comparaison entre les espèces, l’a conduit à abattreladistinctionentrenature etcultureetàdémontrerlavanité ducloisonnemententrelesétudes surleshommesetcellessurles animaux.Ilapubliédenombreux ouvragesdevulgarisation,telsque L’Âge de l’empathie (LLL, 2010), Sommes-nous trop « bêtes » pour comprendre l’intelligence des animaux ? (LLL, 2016) et La DernièreÉtreinte (LLL,2018).

27 septembre 2023
11 × 17 cm
464 pages 11,00 €
ISBN : 978-2-228-93388-9


L’histoire des amants qui défièrent h itler
Comment passer d’une attitude d’observateur passif à celle de résistant actif ?
À Berlin, un couple d’Allemands bohèmes se dresse contre Hitler au cœur du IIIe Reich.
Ҍ Tous les ingrédients d’un thriller addictif sont ici réunis : une passion amoureuse qui finit tragiquement, le combat sans compromis contre l’oppresseur, une histoire d’espions à la solde du KGB, l’Allemagne nazie des années 1930-1940.
Harro Schulze-Boysen est officier au ministère de l’Aviation du Reich, Libertas Haas-Heye
attachée de presse à la Metro-GoldwynMayer à Berlin. Tous deux viennent de familles
allemandes aisées, proches des dignitaires du parti nazi, dont Göring qui fut le témoin de leur mariage en 1936. Pourtant, par conviction
démocratique, Harro est déjà entré dans l’opposition. Sous des dehors de jeune couple
bohème aux amours libres qui s’étourdit de fêtes, ils vont contribuer à fonder l’Orchestre
rouge, célèbre mouvement de résistance à Hitler, et livrer d’importants secrets militaires au KGB. Démasqués, ils sont condamnés pour haute trahison et exécutés peu avant la Noël
1942. Toute trace de leurs noms et de leur mémoire sera gommée sur volonté de Hitler. À travers le portrait de ces deux attachants héros au destin tragique, l’auteur peint un panorama saisissant de la folle Berlin des années 1930-1940 et de l’inexorable passage de la République de Weimar au IIIe Reich.
Ҍ Livre vendu dans dix pays et recensé en France par tous les médias nationaux : « Solidement documenté, bien conduit, le récit fait revivre avec bonheur ses deux personnages centraux » (Le Figaro Magazine). « De sa plume alerte, Norman Ohler brosse le portrait d’un couple de parfaits Aryens qui osèrent dire non en infiltrant le système. Un pari remporté haut la main. » (Historia).
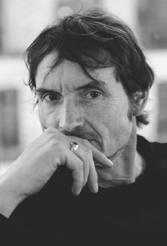
Ҍ L’auteur relate avec maestria l’aventure de ce couple hors norme : son écriture nerveuse et vive happe dès le prologue et leur assure une victoire posthume contre l’oubli.
Ҍ Premier livre en français sur ces leaders méconnus de la résistance allemande. L’auteur a eu accès aux archives privées inédites du groupe de l’Orchestre rouge, comme aux archives de la Loubianka à Moscou.
Né en 1970, Norman Ohler est un écrivain et scénariste allemand vivant à Berlin. Il est l’auteur de plusieurs romans et ouvrages de non-fiction sur la Seconde Guerre mondiale, plébiscités par la presse et les lecteurs : L’Extase totale. Le IIIe Reich, les Allemands et la drogue (La Découverte, 2016) a été traduit dans plus de 30 langues. Son dernier livre, High Trip. Les nazis, le LSD et la CIA, sort simultanément chez Payot.
Ҍ L’Extase totale a été un succès : 15 000 GF, 2016 + 6700 poche, 2018.
Ҍ Le grand format des Infiltrés, paru en mai 2020, s’est vendu à 3300 ex.
histoire Traduit de l’allemand par Olivier Mannoni Ouvrage dirigé par Sophie Bajard13 septembre 2023
11 × 17 cm
176 pages 8,50 €

ISBN : 978-2-228-93391-9





Peut-on vraiment, aujourd’hui, s’épanouir dans le travail ?
Un essai sur le travail bien fait, la satisfaction qu’on en retire, et le lien social qui en résulte. Autrement dit, sur ce qui fait qu’on est content d’aller bosser. La clé, c’est la sublimation, ce qu’on met de soi-même dans un travail pour que ce soit un travail de qualité et non pas seulement une activité. Le travail de qualité fait intervenir le corps, l’échec et la créativité, mais aussi l’endurance, la transformation et l’accomplissement de soi. Ce qui détruit
l’auteur
ou empêche le travail de qualité, créatif et épanouissant est lié à l’organisation du travail. Le taylorisme et le tournant néolibéral sont anti-sublimatoires, le culte de la performance et de l’évaluation réduit le travail à une activité, nous emprisonne dans la servitude et atteint l’estime de soi. On l’aura compris, ce livre parle donc aussi de la souffrance au travail et des moyens de l’éviter.
Ҍ Un livre apparemment à contre-courant de la vague de mécontentement social et de la tendance au « résentéisme » (qui succède au présentéisme et au « quiet quitting », et concerne des salariés amers, désengagés, haïssant leur travail), mais en réalité très actuel puisqu’il montre finalement que le sentiment de frustration et la souffrance qui en résulte viennent justement de ce que l’organisation néolibérale du travail détruit notre aspiration à un travail de qualité.
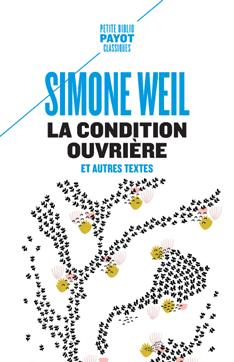
Ҍ Un des grands psychanalystes contemporains et un auteur de fonds avec déjà 6 titres chez Payot.

Quel Q ues chiffres
Ҍ Parution du GF : 2021. Réassorts : 600 ex. en 2022.
Christophe Dejours est psychiatre et psychanalyste. Il dirige à Paris l’Institut de psychodynamique du travail. Son essai sur la souffrance au travail, Souffrance en France (Seuil), a rencontré un grand succès. Ses idées sur le travail sont théorisées dans les deux tomes de Travail vivant (Payot).

Ce qu’il y a de meilleur en nous Travailler et honorer la vieÉG ale M ent
Le système ne peut pas fonctionner sans nous. S’il nous oppresse, nous avons le pouvoir de le mettre en panne.
Le système néolibéral est proche de la panne, de l’arrêt, provoqué non par une grève générale mais par le fait que les gens n’y croient plus, n’ont plus envie de produire. L’organisation du travail mise en place dans les années 1980, cette évaluation individuelle des performances qui veut détruire les solidarités et l’entraide, se heurte aujourd’hui à des résistances. Des artistes mettent en scène les dégâts provoqués par ces méthodes, des magistrats parviennent

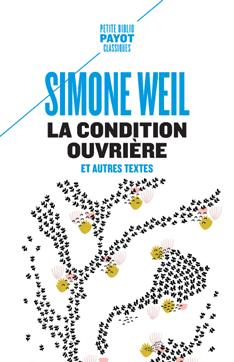
à faire condamner de puissantes entreprises, la majorité des salariés doutent de l’efficacité d’un modèle qui les abîme au quotidien, tandis que, dans l’ombre, certaines sociétés réinventent avec succès la coopération sans diminuer leur rentabilité. De Souffrance en France à Ce qu’il y a de meilleur en nous, Christophe Dejours offre ici la meilleure introduction à sa pensée sur le travail et sur les moyens de sortir du néolibéralisme.
13 septembre 2023
11 × 17 cm
176 pages 8,50 €
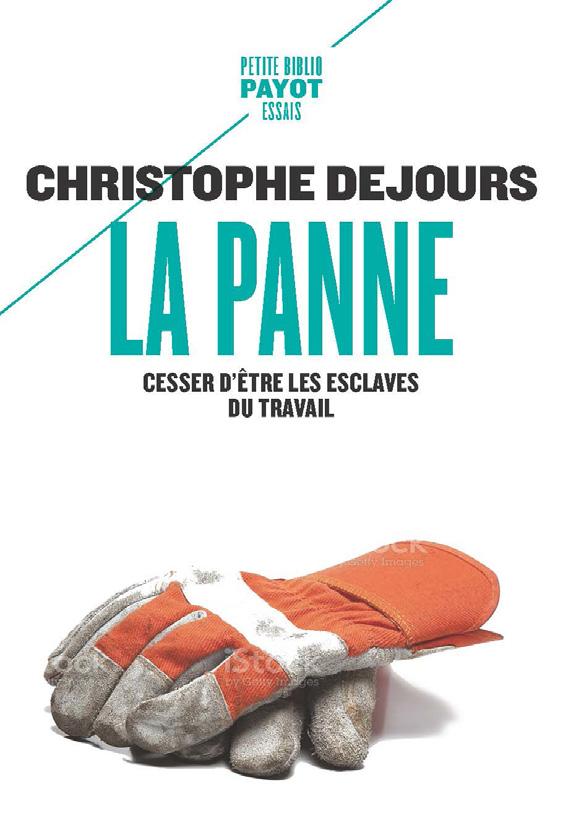
ISBN : 978-2-228-93394-0




Christophe Dejours est psychiatre et psychanalyste. Il dirige à Paris l’Institut de psychodynamique du travail. Son essai sur la souffrance au travail, Souffrance en France (Seuil), a rencontré un grand succès. Ses idées sur le travail sont théorisées dans les deux tomes de Travail vivant (Payot).


Ҍ Ce n’est pas le travail qui donne un sens à notre vie, c’est nous qui donnons un sens à notre travail. Dès lors, nous pouvons résister à un système qui nous oppresse et lui en substituer un autre qui nous dynamise.
Ҍ Un des grands psychanalystes contemporains et un auteur de fonds avec déjà 6 titres chez Payot.
Ҍ Titre épuisé, paru à l’origine chez Bayard. Ventes : 5500 ex. GfK.
classique
Comment changer la société si les discours sont impuissants face à la violence d’État ? Un recueil inédit d’Emma Goldman sur un sujet plus que jamais actuel.
Émeutes à répétition, chômage élevé, marches de la faim : la fin du XIXe siècle est marquée par un désarroi brutal. À New York, la jeune
Emma Goldman, 24 ans, harangue les foules de chômeurs. Son discours le plus célèbre a lieu le 21 août 1894 en pleine rue, à Union Square, devant plus de trois mille personnes.
Textes choisis, traduits de l’anglais et présentés par Léa Gauthier.
13 septembre 2023
11 × 17 cm
112 pages 8,00 €
ISBN : 978-2-228-93393-3




D’une grande virulence, prônant l’expropriation des riches, il lui vaut d’être condamnée à un an de prison pour incitation à l’émeute. On

trouvera son discours au début de ce recueil, qui se clôt par la conférence que Voltairine de Cleyre, elle aussi tenante de l’action directe, prononcera alors pour défendre son amie. Entre les deux, quatre textes sur le thème de l’action et la violence : « An anarchist Looks at life » (1933) ; « Preparedness, the road to universal slaughter » (1915) ; « The psychology of political violence » (1917) ; « The power of an ideal » (1912).

Ҍ Après la féministe (De la liberté des femmes), après l’éloge de l’anarchisme comme éthique de vie (L’anarchisme, ce dont il s’agit vraiment), voici un autre visage d’Emma Goldman : celui du radicalisme politique, quand les appels au changement ne sont pas entendus par le pouvoir et que la violence devient alors une action possible.


Ҍ Une autrice très populaire actuellement chez les jeunes.
Ҍ Payot, seul éditeur généraliste à offrir – avec un certain succès – un espace dédié à la pensée anarchiste dans sa collection de poche.
Quel Q ues chiffres
Ҍ De la liberté des femmes (2020) : 6000 ex. et 800-1000 réassorts par an ; L’anarchisme : ce dont il s’agit vraiment (2022) : 3600 ex. en 6 mois, et 300+ réassorts par mois.
Emma Goldman (1869-1940), que les autorités américaines considérèrent un temps comme « la femme la plus dangereuse des États-Unis » en raison de son activisme, est l’une des grandes figures du féminisme mondial et de l’anarchisme international.

i l nous faut être prêts à chaque
Traduit de l’anglais (États-Unis).
Recueil inédit.
27 septembre 2023
11 × 17 cm
150 pages 9,00 €
ISBN : 978-2-228-93420-6




Le racisme est systémique. Ses manifestations sont souvent invisibilisées. Ses formes sont sournoises. Ce livre les décèle pour mieux les combattre.

Dans les années 1990, l’anthropologue hollandaise Philomena Essed se fait connaître mondialement en créant le concept de racisme quotidien (everyday racism), qui intègre le point de vue du genre et de l’intersectionnalité.
Nous publions dans ce recueil inédit deux essais de Essed dans lesquels elle revient sur le racisme quotidien et ses implications sur les populations racisées, et s’interroge sur ce qu’est réellement l’antiracisme.

Points forts
Ҍ Seul recueil poche du marché.
Ҍ Le racisme et l’antiracisme sont de plus en plus présents dans le débat public grâce à des militants et des personnalités publiques (Rokhaya Diallo, Assa Traoré, etc.).
Ҍ Un livre qui devrait intéresser à la fois les universitaires et les jeunes, très sensibles à ces thèmes de société.
Ҍ Philomena Essed intègre la PBP pour rejoindre notre série autour du racisme, de la pensée décoloniale et de l’intersectionnalité, aux côtés de Crenshaw, Hill Collins, Truth, Quijano et Lugones, etc.

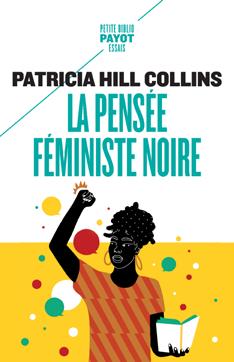
Philomena Essed, professeure d’anthropologie culturelle à l’université Antioch (Ohio), est spécialiste du racisme, du genre et de l’intersectionnalité.
ÉG a L e M ent

Traduit de l’anglais (États-Unis) et de l’espagnol.
Recueil inédit.
27 septembre 2023
11 × 17 cm
150 pages 9,00 €
ISBN : 978-2-228-93421-3







Une réflexion incontournable pour comprendre l’oppression et l’invisibilisation des femmes racisées.

Ҍ Comme Quijano, María Lugones est connue mondialement et ses écrits ont été peu traduits en français et aucun au format poche.
Philosophe féministe et décoloniale, María
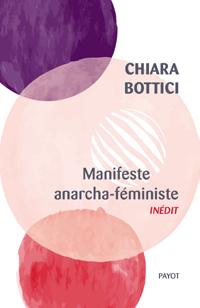
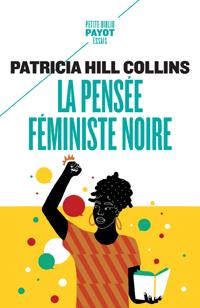
Lugones a développé les thèses de la colonialité du pouvoir (Anibal Quijano) et de l’intersectionnalité (Kimberlé Crenshaw) pour aboutir à la notion de « colonialité du genre » comme moyen de comprendre le phénomène d’invisibilisation des femmes, en particulier racisées. Sa réflexion, critique d’un féminisme blanc, a nourri en profondeur les théories décoloniales et est utilisée aujourd’hui dans le monde entier,
notamment dans des perspectives antiracistes et féministes. Ce recueil inédit rassemble deux essais incontournables de Lugones, « Coloniality and gender » et « Playfulness, “world”-travelling, and loving perception ». Dans ces textes, la philosophe critique le système de genre européen et prolonge sa réflexion dans le champ plus général de la relation à l’autre, notamment dans le voyage.
Ҍ Depuis les parutions de Segato, Boussahba, Hill Collins, Crenshaw, etc., la PBP se positionne sur ces approches très modernes et populaires chez les jeunes.
Ҍ À destination d’un public plus large et jeune que les seuls spécialistes et universitaires.
Née en Argentine, María Lugones (1944-2020) est philosophe. Elle enseignait à l’Université d’État de New York. Connue pour ses thèses sur la colonialité du genre, elle fait partie de la première génération de théoriciens et théoriciennes de la pensée décoloniale.

essais
La référence essentielle pour comprendre la persistance du colonialisme européen dans le monde actuel et ses effets sur l’oppression des populations racisées.
Ҍ Anibal Quijano est connu mondialement, tant dans le champ universitaire que militant. Ses textes sont peu traduits en français et aucun n’existe en poche.
Traduit de l’espagnol (Pérou).

Recueil inédit.
27 septembre 2023
11 × 17 cm
150 pages 9,00 €
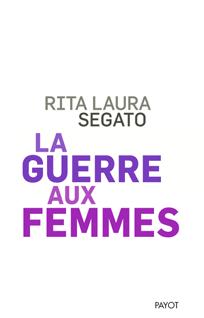
ISBN : 978-2-228-93419-0






Dans les années 1990 en Amérique du Sud, dans un contexte de mobilisations importantes des populations racisées qui s’opposent à l’eurocentrisme et au racisme ambiant, un groupe d’universitaires s’empare de la question et se penche sur les possibles continuités du colonialisme dans les sociétés sud-américaines. L’un d’eux, Aníbal Quijano, crée et théorise la notion de « colonialité du pouvoir » qui devient le concept central de la
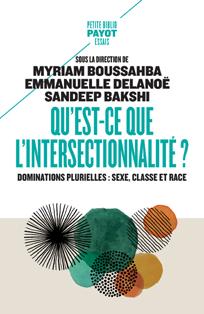
foisonnante pensée décoloniale, toujours en développement aujourd’hui. Ce recueil inédit rassemble les deux essais fondamentaux de Quijano, « Colonialité du pouvoir, eurocentrisme et Amérique latine » et « Race et colonialité du pouvoir », dans lesquels l’auteur alimente l’approche intersectionnelle, touche au racisme, au féminisme, aux rapports de domination, à la politique, ou encore au savoir.
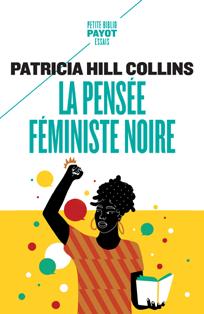
Ҍ Depuis les parutions de Molinier, Segato, Boussahba, Hill Collins, Crenshaw, etc., la PBP se positionne sur ces approches très modernes et populaires chez les jeunes.
Aníbal Quijano (1928-2018), sociologue et théoricien politique péruvien, est considéré comme l’un des pères fondateurs de la pensée décoloniale.

Préface et traduction de Nicolas Waquet
20 septembre 2023
11 × 17 cm 120 pages 8,50 €
ISBN : 978-2-7436-6068-0





« La raison pour laquelle on vieillit et on meurt n’est pas d’ordre physique, mais métaphysique. » Une réflexion caustique – et pessimiste – sur la vieillesse par le plus grincheux des philosophes.
L’Art de vieillir présente un choix d’aphorismes et de brèves réflexions tirés des cahiers où le philosophe, né en 1788, a consigné idées et humeurs entre 1852 et sa mort en 1860. Dans ces Senilia, il ne se contente pas de réfléchir à la vieillesse et au vieillissement. Sa pensée demeure alerte et vagabonde, et
embrasse de nombreux thèmes, des sciences aux religions, en passant par les relations entre les sexes. Le choix des aphorismes rend justice à la variété des pensées et des thèmes, et brosse un portrait psychologique et intellectuel du vieux philosophe.
• Un recueil inédit tiré des derniers cahiers du philosophe.
• Un regard lucide et caustique sur la vieillesse.
• Un des penseurs les plus influents. « Peut-être n’y a-t-il aucun philosophe qui ait exercé sur la vie artistique et culturelle une influence si profonde et si durable. » (Roger-Pol Droit, Le Monde).
• Le complément idéal de L’Art de se connaître soi-même (2015, 18 000 ex.).

• Un petit livre dans la même veine que L’Art d’avoir toujours raison (plus de 300 000 ex.) ou de L’Art d’être heureux (plus de 70 000 ex.).
La philosophie d’Arthur Schopenhauer (1788-1860) a influencé de nombreux auteurs et penseurs : de Nietzsche à Freud, de Wagner à Herman Hesse, ou encore de Clément Rosset à Michel Houellebecq.


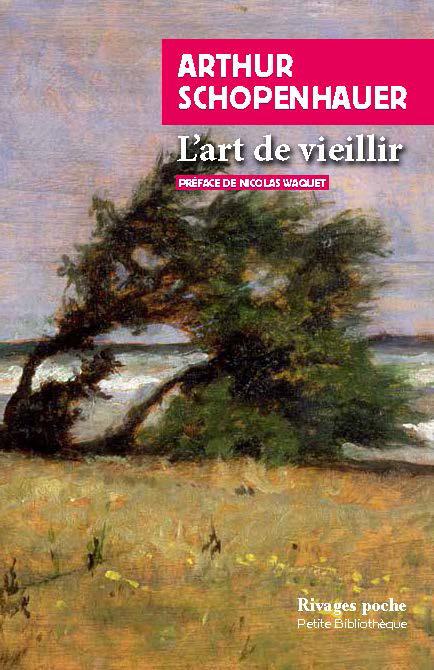
Édition établie et présentée par Franck Salaün
20 septembre 2023
11 × 17 cm
150 pages 8,50 €
ISBN : 978-2-7436-6072-7




Émancipation de la femme, apprendre de la nature, allaiter son enfant : il est grand temps de redécouvrir la plume avant-gardiste de Louise d’Épinay.
En mars 1756, à l’âge de trente ans, Louise d’Épinay fait un premier bilan de son existence (Mon portrait). Trop longtemps, sa timidité excessive et sa mauvaise santé l’ont empêchée d’affirmer sa véritable personnalité. Mais elle a changé. Ce changement est lié à une prise de conscience et aux marques d’estime de plusieurs hommes de lettres parmi les plus considérable de son temps, à commencer par
Grimm, son amant, Diderot, Galiani, Voltaire, ou encore Tronchin. Dans ses échanges avec ceux qu’elle surnomme ses « ours », et d’autres proches, comme dans ses œuvres, elle manifeste progressivement des qualités insoupçonnées qui la hissent au niveau de l’amitié philosophique. Les textes réunis de ce volume permettent d’apprécier la finesse de cette femme exceptionnelle.
• La redécouverte d’une autrice phare du XVIIIe siècle restée dans l’ombre des illustres amis et admirateurs qu’ont été Diderot, Voltaire ou Rousseau.
• Présentation de Franck Salaün, spécialiste de littérature du XVIIIe siècle, professeur à l’Université Paul-Valéry de Montpellier.
• Élisabeth Badinter lui consacre un élogieux portrait dans Mme du Châtelet, Mme d’Épinay. L’ambition féminine au XVIIIe siècle (Flammarion, 20 000 ex.).

• Recueil comprenant : des lettres choisies (Rousseau, Diderot, Voltaire, etc.), des extraits de l’Histoire de Mme de Montbrillant, « Un rêve de Mlle Clairon » et des critiques littéraires.



Louise d’Épinay (1726-1783) est une femme de lettres et pédagogue qui fréquente les intellectuels de son temps : Diderot, d’Alembert, Marivaux ou encore Montesquieu. Très attachée à ses enfants, elle se heurte aux conventions et provoque notamment le scandale en choisissant d’allaiter. Amie de Rousseau, ils auront l’un sur l’autre une influence très importante, notamment sur les sujets de l’éducation des enfants, du lien parent-enfant et de l’allaitement maternel.

Traduit de l’hébreu et présenté par Paul B. Fenton
1re éd. poche : mai 2002
20 septembre 2023
11 × 17 cm
144 pages 8,50 €
ISBN : 978-2-7436-6075-8

Toute la formation du monde au moyen de 10 nombres et des 22 lettres de l’alphabet hébraïque et de leurs combinaisons.
l e livre
« Le Sēfer Yeșīrāh ou Livre de la Création est un essai sur les problèmes de la cosmologie et de la cosmogonie. Écrit probablement entre le IIIe et le VIe siècle, il fait partie des textes spéculatifs les plus anciens qui existent en hébreu. Son sujet principal, ce sont les éléments du monde qui se trouvent dans les dix nombres élémentaires et premiers, les Sephiroth, comme le livre les

appelle, et les vingt-deux lettres de l’alphabet hébreu. Ceux-ci représentent ensemble les forces mystérieuses dont la convergence a produit les diverses combinaisons que l’on peut observer à travers toute la création ; ce sont les “trente-deux sentiers mystérieux de la sagesse”, avec lesquels Dieu a créé tout ce qui existe. » (Gershom Scholem)
1 Un des livres phares de la pensée kabbalistique.
1 Édition bilingue hébreu/français (essentielle à la compréhension du texte).
1 Une traduction qui restitue la dimension poétique du texte hébraïque, par Paul B. Fenton, professeur émérite au département d’études arabes et hébraïques à la Sorbonne.
1 La seule édition poche disponible du texte sur le marché. (Une seule autre édition disponible à 30 € aux éditions Beit Hazohar.)
Quel Q ues chiffres
1 5 400 ex. vendus, épuisé depuis 2018.
Tantôt attribué à Abraham, tantôt au rabbi Aqība, voire au prophète Jérémie ou encore à son fils Ben Sirach, le Livre de la Création est l’un des textes les plus mystérieux de la pensée juive. Autant son auteur que sa date de rédaction nous sont encore aujourd’hui inconnus.