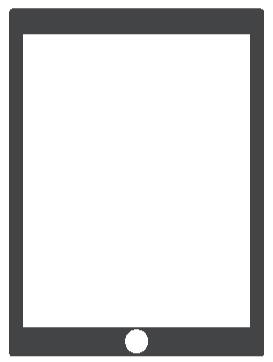AVANT-PROPOS
Qu’est‑ce que cette devise de Peer Gynt “Être soi‑même” ? La for‑ mule a été sans doute volée à Ou bien… ou bien…, l’œuvre majeure de Sören Kierkegaard qu’Ibsen avait dévorée et qui semblait lui don ner des clefs de compréhension de son existence. Car si Peer Gynt est traversée de légendes nordiques et de rêveries présurréalistes, elle est aussi une autobiographie déguisée, du moins dans ses trois premiers actes. Ibsen, s’inspirant littéralement de ses échecs et de ses fautes, n’a pas souhaité brosser de lui‑même ni de son pays un portrait flatteur.
Si la modernité de la pièce doit nous surprendre aujourd’hui, c’est par son questionnement existentiel (plus encore que Kierkegaard, Ibsen est peut‑être le père de l’existentialisme). Rappelons que Peer Gynt s’inscrit dans une trilogie aux côtés de deux œuvres colossales : Brand et Empereur et Galiléen. Certains voient dans Peer Gynt une illustration de la “sphère de l’esthétique” de Kierkegaard, tandis que Brand serait une parabole sur les limites de la “sphère de l’éthique*”, autre concept du penseur danois. Brand serait alors un “juge”, comme celui inventé par Kierkegaard, et notre Peer un Don Giovanni qui enlève Ingrid, comme le personnage de Mozart enlève Zerlina le jour de son mariage. La troisième pièce, Empereur et Galiléen, est une sorte de synthèse complexe de toutes ces possibilités existentielles. La politique, la religion, l’art, le désir, la morale, la perte de sens, la modernité… Quels thèmes ne sont pas abordés dans ces pièces ?
* Voir Sören Kierkegaard, Stades sur le chemin de la vie [1845], in Œuvres complètes, t. IX, traduit du danois par Paul Henri Tisseau et Else Marie Jacquet Tisseau, Éditions de l’Orante, Paris, 1978. Les stades, ou les “sphères d’existence typiques”, sont trois : esthétique, éthique et religieux.
Peer, conseillé par une ombre appelée Le Courbe, apprend que la vie n’est qu’une série de détours, tandis que Brand, son opposé, pas‑ teur intransigeant, ne négocie jamais avec ses idéaux et va jusqu’à provoquer la mort autour de lui.
“Comment vivre ?” semble nous demander Peer Gynt, antihéros ressemblant à son créateur ; parfois lâche, parfois charmeur, parfois abject, parfois génial, il n’en finit pas de distiller sa maigre liberté dans un monde invivable.
Le questionnement éthique est donc au centre de l’œuvre, mais Ibsen se garde de tirer la moindre conclusion moralisante. Il est, selon ses dires, “un photographe” de l’âme humaine et, dans cette pièce qu’il qualifie de “ce qu’il a écrit de plus fou”, il ne prétend pas juger ses contemporains mais seulement dialoguer avec sa propre folie.
Un an avant la publication de Peer Gynt, en 1866, Henrik Ibsen n’a plus d’espoir ; il n’a plus l’espoir d’être heureux, d’être joué, il n’a plus l’espoir de devenir célèbre, et ce désespoir lui donne la plus précieuse des libertés. Il s’est enfui cinq ans auparavant vers le sud, après avoir ruiné le théâtre de Christiania (nom porté par l’actuelle ville d’Oslo). Il a quitté les aurores boréales et ne revien‑ dra en Norvège que vingt‑sept ans plus tard, le temps d’écrire quelques chefs‑d’œuvre et de devenir le père irréfutable de la dra‑ maturgie moderne.
Peer Gynt est initialement un Lesedrama, ou closet drama en anglais, c’est‑à‑dire une pièce faite pour être lue. Elle excède totalement les usages dramatiques des années 1860, où le public en est encore aux pièces de Scribe : drames historiques édifiants. Par ailleurs, elle s’adresse aux Norvégiens et à la Norvège, pays qui n’existera comme État‑nation indépendant qu’à partir de 1905, date à laquelle le fils d’Ibsen, Sigurd, est nommé Premier ministre de la Norvège. Quand Ibsen publie cet étrange “poème dramatique”, il ne songe pas qu’il deviendra le poète emblématique de son pays.
Six ans après sa publication, Peer Gynt est reconnue dans toute l’Europe comme un chef d’œuvre littéraire. Plus encore, l’œuvre est perçue comme un paradigme de l’indépendance de la Norvège.
C’est à ce moment‑là qu’Ibsen propose à un jeune compositeur de musique, Edvard Grieg, de l’aider à porter à la scène son Lesedrama pour le théâtre de Christiania. Au départ, Grieg est peu enthousiaste à l’idée de ce projet. Il écrira pourtant, lui aussi, un chef d’œuvre : la musique de scène de Peer Gynt. Cette partition lui assurera la postérité dans le monde entier, rejetant dans l’ombre ses œuvres ultérieures.
Comment se sont articulés la partition musicale de Grieg et le texte d’Ibsen ? Nous le savons en partie, mais en partie seulement. Ce mélange hétéroclite de mélodrames (au sens lyrique), de musiques de scène, de chansons populaires, de folklore et de cantiques, pour un orchestre de plus de cinquante musiciens, s’accorde mal avec les exigences de la représentation d’une pièce aussi longue.
Le 23 janvier 1874, conscient que son œuvre doit faire l’objet d’une adaptation pour être jouée, Ibsen écrit une lettre à Edvard Grieg où il imagine, de façon détaillée, une version pour la scène, aujourd’hui perdue*. En voici des extraits choisis, ceux‑là mêmes qui ont guidé certains choix pour cette adaptation.
[…] j’ai comme projet de créer une représentation de Peer Gynt […] composeriez‑vous la musique ? Voici comment je nous propose d’adapter la pièce : […]
Le premier acte est gardé tel quel, quelques coupes dans les dialogues seulement. Le monologue de Peer Gynt des pages 23, 24, 25 doit faire l’objet d’un mélodrame ou être traité à la manière d’un récitatif. On doit ajouter à la scène du mariage de la musique et des ballets pour la rendre plus vivante. Il faut composer une musique de scène qui irait jusqu’à la fin de l’acte. Pour le deuxième acte, la scène avec les trois vachères doit être chantée avec, si possible, quelque chose de démoniaque. […] De même, la scène de la femme en vert doit être traitée en mélodrame. De même pour les scènes suivantes dans le palais
* Henrik Ibsen, Letters of Henrik Ibsen, traduit du norvégien par John Nilsen Laurvik et Mary Morison, Fox, Duffield & Company, New York, 1905, lettre 111, du 23 janvier 1874, p. 269‑271 [ma traduction].
du Dovre, qu’il faudra raccourcir. Les scènes de la harpe trol‑ lienne et de la danse seront évidemment musicales.
Dans la scène suivante, les voix des oiseaux seront chantées tandis qu’on entend au loin des hymnes.
Pour le troisième acte […], quelques accords suffisent pour la scène entre Peer Gynt, la femme et l’enfant troll.
La quasi‑totalité du quatrième acte doit être coupée et rempla‑ cée par un vaste tableau qui raconte les voyages de Peer. […]
On gardera derrière le rideau le chœur d’Anitra et de ses sœurs, tandis que, sur un autre plan, on verra Solweig vieillie chanter au soleil devant sa maison […].
Au cinquième acte, l’orchestre fait entendre la tempête en mer ; ce dernier acte doit être considérablement raccourci […] les scènes en mer et dans le cimetière seront supprimées. Il faut aussi de larges coupes dans les scènes du fondeur de boutons et du roi des trolls. […] tandis qu’on entend au loin des can tiques, le chant de Solweig conclut la pièce […].
Grieg ne respectera pas ce chemin de fer à la lettre ; il se sentira libre de composer des passages symphoniques inouïs, sur la mort d’Aase ou la poursuite infernale des trolls, aujourd’hui devenus des classiques.
Le texte qui suit dans sa version française a pour but de faire entendre la pièce avec l’intégralité de la musique de Grieg et de rêver cette version perdue par Ibsen et permettre une représentation de Peer Gynt, texte et musique compris, en préservant la totalité de la par‑ tition et la quasi totalité de l’œuvre d’Ibsen.
J’ai donc suivi ces indications partiellement, et j’ai aussi synthé‑ tisé et redistribué certains passages qu’Ibsen souhaitait suppri‑ mer, et inventé, selon son désir, un résumé des pérégrinations de Peer avant l’acte IV. Ibsen proposait par exemple de couper tout l’acte IV, ce qui revenait à sacrifier des pans entiers du texte ori‑ ginal, pourtant nécessaires à la narration. De plus, les paroles des parties chantées composées par Grieg ont été traduites en français pour homogénéiser la représentation. Il s’agit donc d’une “tradap tation”, mélange d’adaptation respectueuse et de traduction fidèle,
qui s’efforce de témoigner de la somme intellectuelle que représente l’œuvre littéraire.
J’ai tenté de donner à ce texte la rapidité et le lyrisme de la langue d’Ibsen, faite à la fois de trivialités et de fulgurances métaphysiques, de langue noble et de langue triviale, de pensée profonde et d’hi‑ larante fatrasie.
Il est certain que j’ai, par l’adaptation, éloigné Peer Gynt de sa Nor vège natale. On me pardonnera cette trahison, qui n’a eu pour des‑ sein que d’affirmer la puissance universelle du poème.
Olivier Py, novembre 2024
PERSONNAGES
Aase, la mère de Peer Gynt
Peer Gynt
Des passants
Aslak, un forgeron
Les invités de la noce
Mads Moenn, le fiancé
Les parents de Mads Moenn
Solweig
Helga, sa sœur
Ingrid, la fiancée et la fille d’Haegstad
Trois vachères
Une femme en vert
Le roi des trolls
Des trolls
Le Courbe
Des oiseaux
Kari, une voisine d’Aase
Un voleur et un receleur
Anitra et ses sœurs
Begriffenfeldt
Huhu, un fou à l’asile du Caire
Fellah
Plume
Un capitaine
Un matelot
Un passager
Un cuisinier
Un pasteur
Une foule en deuil
Des branches mortes, des feuilles mortes, un courant d’air, des gouttes de rosée, des brindilles
Un fondeur de boutons
Le Maigre
Des voix
À la ferme d’Aase.
aase. Tu mens, Peer !
ACTE I Scène 1
peer. Je dis toujours la vérité.
aase. Jure le !
peer. À quoi bon ?
aase. Tu as peur de jurer ! Voyou !
Des mensonges ! Rien que des mensonges !
peer. La vérité toute crue !
aase. Tu n’as pas honte ? Tu dis que tu pars chasser, Tu reviens un mois après, le pantalon troué, et sans ton fusil !
Je dois avaler ça ? Bon alors, ce bouc…
peer. Un vent amer, un vent mortel ! Et soudain, derrière un arbre mort, Le bouc cherchait de l’herbe sous la neige. aase. C’est ça !
peer. Je retenais mon souffle, je regardais ses cornes, J’entendais ses sabots qui crissaient dans la neige, Un animal étincelant comme on n’en voit jamais.
aase. C’est sûr…
peer. Je tire ! Pan ! Il tombe ! Il se relève !
Je saute sur lui et je l’attrape par l’oreille gauche ! Il se débat, il beugle, je suis pris dans ses cornes ! Il s’enfuit au galop vers les falaises immenses !
aase. Mon Dieu !
peer. Et là bas, tout en bas, je voyais les lacs noirs,
Je voyais les icebergs échoués sur les berges, Et d’un coup, l’animal a bondi dans le vide.
Je chevauchais le monstre à travers les nuages,
Mais j’étais ébloui par des rais de soleil.
Je voyais l’aigle noir qui planait dans le vide, Et tout au fond de l’abîme, de grands glaciers brillants.
Moi, je n’entendais rien dans le vent du vertige, Et c’est là que j’ai vu comme une tache blanche
Sur le miroir obscur des eaux en contrebas.
C’était notre reflet qui volait dans la nuit.
aase. Mon Dieu ! Et alors ? Et alors ?
peer. Le bouc du ciel, le bouc d’en bas, l’un contre l’autre.
Ils se sont fracassés dans un éclat d’écume.
Je chevauchais toujours le bouc parmi les vagues…
Et puis je suis rentré.
aase. Et le bouc ?
peer. Il est encore là‑bas ! C’est tout, voilà !
aase. Pas la moindre blessure ? Ouais, ouais, un miracle ! À peine un petit trou au fond du pantalon.
Tu sais mentir, c’est sûr, et tu mens comme le Diable.
J’avais lu cette histoire dans les contes de…
peer. Mais non, c’est vrai, ça arrive vraiment des fois…
aase. La vérité aussi se déguise en mensonge, Et toi, tu lui ajoutes un costume et des ailes.
Tu as cousu la vie avec le fil du rêve.
Qui pourrait démêler le vrai faux du faux vrai ?
peer. Si t’étais pas ma mère,
Je te foutrais mon poing dans la figure !
aase. Je voudrais être morte et dormir sous la terre.
Je ne peux rien pour toi… Tu es perdu !
De la Norvège profonde aux contrées lointaines, Peer Gynt, rêveur audacieux et vantard, fuit ses responsabilités et ses amours sincères en quête d’identité et de gloire jusqu’à comprendre la vacuité de sa propre existence. Avec nesse et humour, entre fantastique et lucidité, Henrik Ibsen explore des questions universelles, telles que le besoin de reconnaissance, le libre arbitre, la folie et le rêve, qui résonnent puissamment encore aujourd’hui.
Dans cette “tradaptation”, mélange d’adaptation respectueuse et de traduction dèle, Olivier Py donne à ce poème dramatique la rapidité et le lyrisme de la langue d’Ibsen, faite à la fois de trivialités et de fulgurances métaphysiques, de pensée profonde et d’hilarante fatrasie.
La pièce est enrichie d’un cahier d’aquarelles inédites d’Olivier Py, o rant une sorte de synthèse en images d’une œuvre parfois énigmatique.
Né en Norvège, Henrik Ibsen (1828-1906) quitte son pays et habite successivement plusieurs grandes villes d’Europe, dont Rome au début des années 1880, où il écrit Le Canard sauvage. Cet exil volontaire ravive sa créativité, et ses pièces, notamment Peer Gynt, lui o rent une notoriété internationale.
Écrivain, metteur en scène et comédien, Olivier Py dirige le théâtre du Châtelet, à Paris, depuis 2023. Toute son œuvre est publiée chez Actes Sud.
14 € TTC FRANCE
ISBN 978-2-330-20460-0