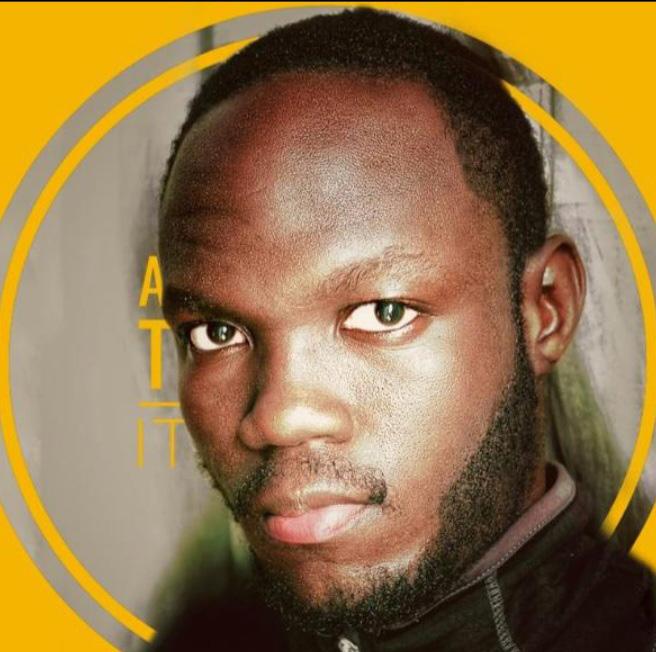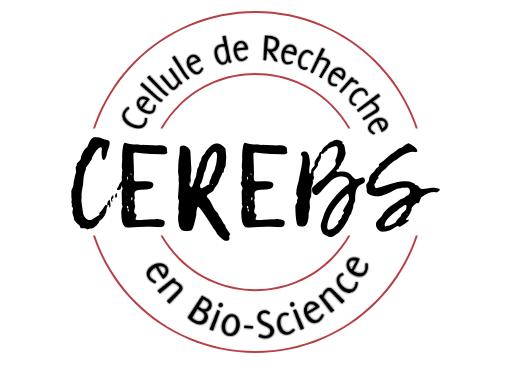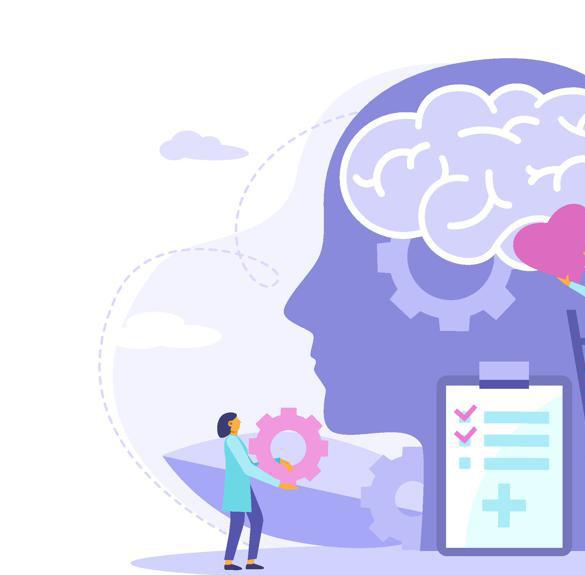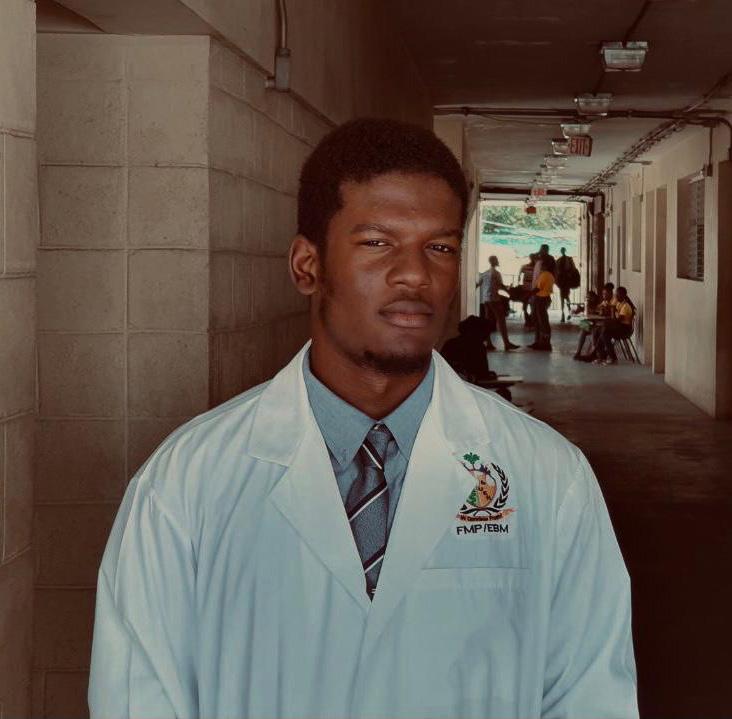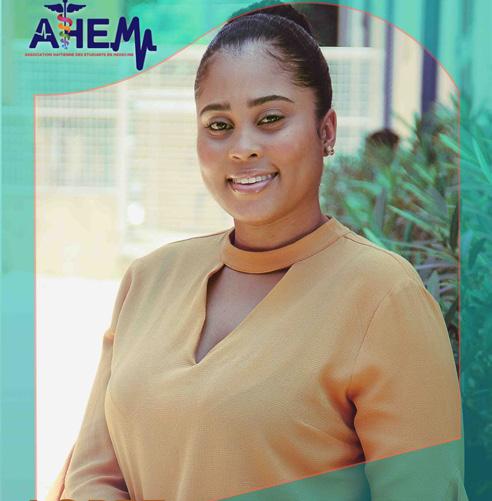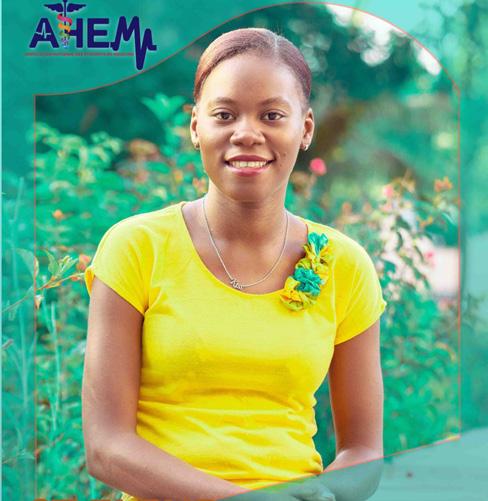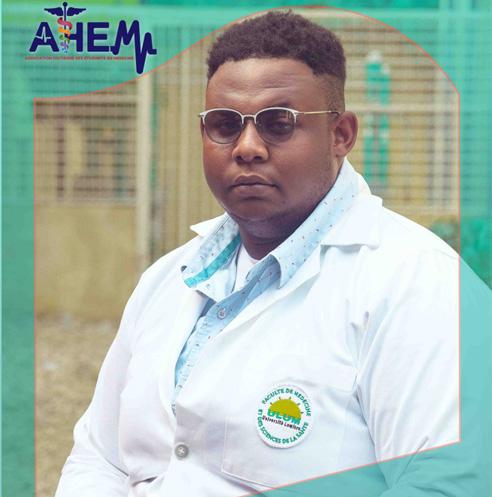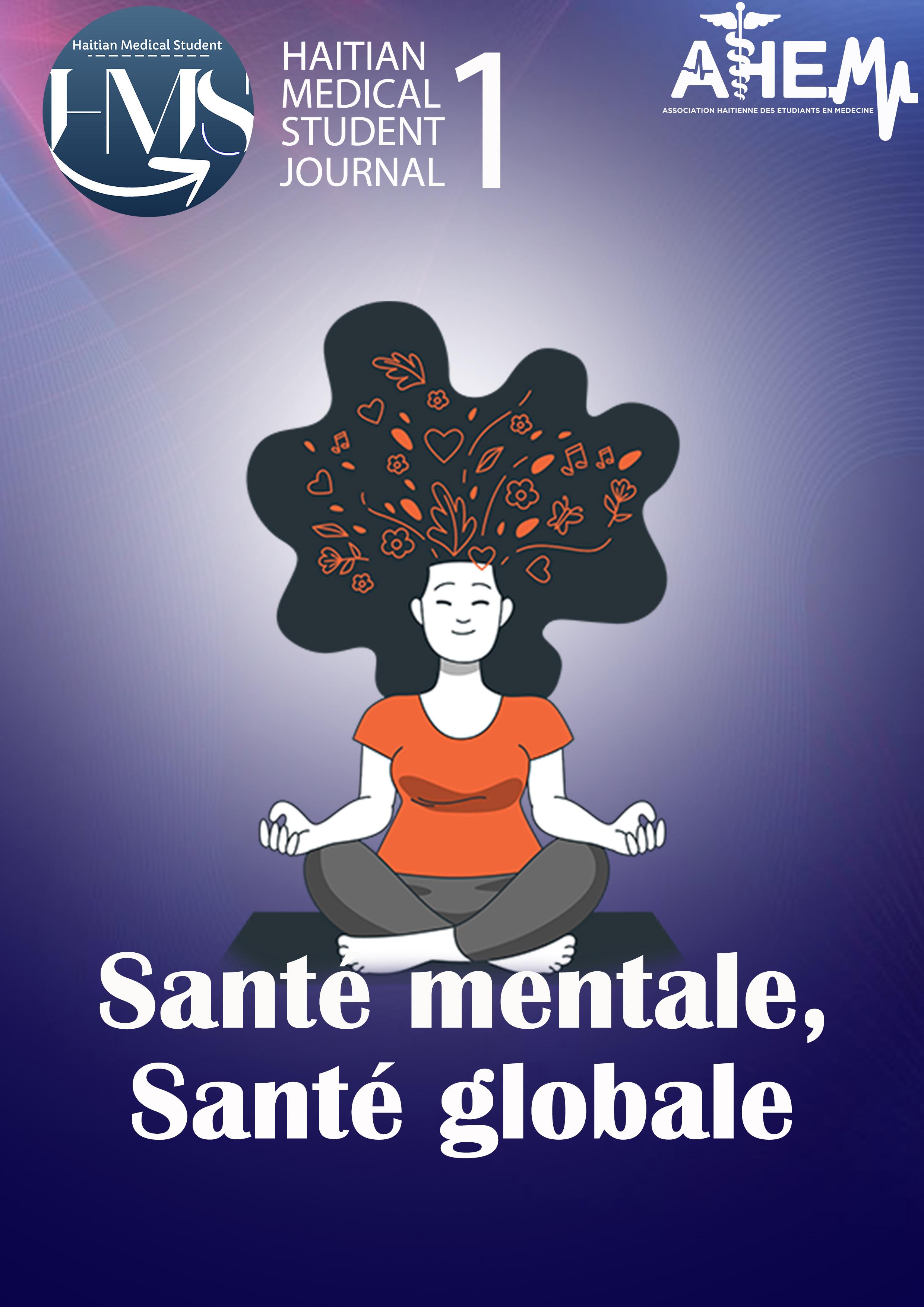
Directrice de la revue
Ludjie Love Smeischelle MERILAN
Directrice adjointe de la revue
Amanda COTY
Secrétaire de rédaction
Soaya Rincher LOUIS
Concepteur de contenu

Jacques-Rodnel LOUIS
Éditeurs de contenus

Kevin RAPHAEL
Margdianie POINT-DU-JOUR Neyssa DEMORCY Paguito JOSEPH Pouchenie BLANC Rosny Dave AZEMAR Wellington DERAMEAU 2022-2023
Publication Association haïtienne des Étudiants en Médecine-IFMSA (AHEM-IFMSA) (+509) 4470-120


Qui sommes-nous?
AHEM est la plus grande association nationale d’étudiants en médecine et est un membre à part entière de International Fédération of Medical Students Association (IFMSA), une entité internationale qui regroupe plus de 130 pays.
Née suite à un besoin de rassemblement des étudiants en médecine, au lendemain du séisme, l’association a su rassembler jusqu’à aujourd’hui plus d’une centaine de membres provenant des facultés médecine d’Haiti de cinq (5) universités du pays.
Vision
Notre vision est de regrouper et unifier les étudiants de toutes les facultés de médecine en Haïti, de créer des liens solides et permettre ainsi une meilleure coopération entre eux, indispensable à l’amélioration du système de santé.
Les étudiants en médecine au service de la population améliorent ainsi leurs compétences et apprennent à devenir des leaders potentiels de la société notamment du système sanitaire.
Objectifs
L’Objectif principal est de favoriser le plein épanouissement des étudiants haïtiens en médecine.
Les autres, secondaires sont: Faciliter le progrès scientifique des étudiants en médecine haïtiens. Fournir un espace où les étudiants peuvent discuter de sujets relatifs à l’éducation, la science et la santé Promouvoir les échanges entre les étudiants en médecine d’Haiti entre eux et ceux d’ailleurs.
Suggérer des solutions aux problèmes communs des étudiants en médecine d’Haïti.
Encourager le volontariat des étudiants en médecine.
Contactez-nous: ahem-haiti@ifmsa.org @ahem-ifmsa
2
3 4 6 57 47 40 26 21 20 SOMMAIRE Editorial Mots du président de l’AHEM Articles à thème Vie associative SCORE- SCORP- SCOPH- SCOME- SCOPE- SCORA SCORE SCORP Actu Divers Présentation Membres du Comité Éxécutif de l’AHEM
Éditorial
Kevin Raphaël
Président de l’AHEM (2021-2022)
Étudiant en année d’Internat à la FMP
Chers membres, chers étudiants/personnels dans le domaine de la santé, C’est avec grand enthousiasme que j’introduis la toute première publication du nouveau journal de l’Association Haitienne des Étudiants en Médecine (AHEM), le Haitian Medical Student Journal. Ce journal servira à terme, à partager les projets, les idéaux et les valeurs des étudiants haitiens dans le domaine des sciences de la santé avec nos associations-soeurs et au monde entier. Je tiens également à féliciter la commission SCORE qui à travers le travail remarquable de leur comité a pu mettre à exécution ce magnifique projet.


Pour ce tout premier numéro, le thème retenu est « Santé mentale et Santé globale », thème qui s’inscrit dans la lignée des préoccupations nouvelles sur le sujet de la santé mentale et de la place qu’elle occupe dans la santé globale. Il est évident que la santé mentale a longtemps été négligée dans la pratique publique. Pourtant, selon l’OMS, à l’échelle mondiale et pour toutes les maladies importantes, les troubles mentaux et comportementaux représentent la plus grande proportion de la charge mondiale de morbidité, plus de 22 %, mesurée en années vécues avec une incapacité.
Durant la dernière décennie, avec les efforts de l’OMS et d’autres organismes, la perception de la santé mentale en tant que facteur de morbidité et la reconnaissance de son impact sur la qualité de vie a été enfin documentée. Cet avancée, devant se traduire selon le Plan d’action global pour la santé mentale 2013-2030 de l’ONU par l’intégration de programmes de santé mentale dans les services de soins de santé primaire, est, de manière prévisible très inégale selon les pays. ...

Articles à thème


Nedjeh S. Noël, membre d’AHEM/SCOPE depuis deux ans, est étudiante en 4ème année à la Faculté de Médecine et de Pharmacie (FMP) de l’Université d’État d’Haïti où elle participe aux différentes activités de la vie étudiante

La
santé globale : une nouvelle approche médicale
Depuis 1948, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), chargée de lutter contre les maladies, définit la santé comme « un état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». Déjà, par cette définition, la santé n’était plus une affaire de sanité de corps mais le terme se référait aussi à la bonne santé mentale et sociale. La santé est une question sociale du fait que les maladies ont une histoire et une influence sur la société et que toutes les classes de la population n’y réagissent pas de la même manière. L’OMS définit la santé mentale comme suit : « un état de bien-être permettant à chacun de reconnaître ses propres capacités, de se réaliser, de surmonter les tensions normales de la vie, d’accomplir un travail productif et fructueux et de contribuer à la vie de sa communauté ». Quelques années plus tard, ce bien-être s’étendra aussi à la qualité de vie et sera en santé celui qui peut réaliser ses ambitions, satisfaire ses besoins et s’adapter à ces derniers. Entrent donc en jeu les déterminants de santé qui sont, selon l’OMS, « les circonstances dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent ainsi que les systèmes mis en place pour faire face à la maladie ». Pour être en bonne santé, il faut donc que vos besoins nutritionnels, sanitaires, éducatifs, sociaux et affectifs soient satisfaits.
Avec la mondialisation où notre planète n’est devenue qu’un petit village et l’avancée des moyens de transport faisant qu’on peut effectuer un tour du monde dans les règles de l’art en neuf mois, un nouveau concept, la santé globale, voit le jour dans les années 2000. Les mouvements de personnes et de biens s’étant intensifiés,
le potentiel de circulation des maladies transmissibles a considérablement augmenté donnant lieu aux pandémies que notre monde a connues. Aussi, la santé globale se rapporte aux facteurs qui influencent de façon directe ou indirecte la santé des individus et de la population et qui circulent outre les frontières. Certains problèmes de santé deviennent donc des problèmes mondiaux. La résolution de ces problèmes de santé passe donc par une approche interdisciplinaire concernant la médecine mais aussi la politique, l’économie, le commerce, l’environnement, le droit.
“Global health is an area for study, research, and practice that places a priority on improving health and achieving equity in health for all people worldwide. Global health emphasizes transnational health issues, determinants, and solutions; involves many disciplines within and beyond the health sciences and promotes interdisciplinary collaboration; and is a synthesis of population-based prevention with individual-level clinical care.” Koplan, et al., 2009.
Cette définition permet de mieux comprendre le concept de santé globale et ses objectifs. Il est dit que la santé globale s’intéresse particulièrement aux problèmes de santé qui touchent plusieurs pays et, dans le domaine infectieux, on passe des épidémies té globale est interdisciplinaire et favorise letenariats par le seul fait qu’aucun organisme, ou aucun pays, ne peut prétendre à résoudre ces problèmes complexes seul. Il faut donc les voir sous différentes perspectives d’où les différentes disciplines et favoriser le partage d’informations, de connaissances entre pays afin de pouvoir garantir une avancée qui
7
Décembre 2022
perdurera. Pour finir, les objectifs sont d’améliorer la santé et d’atteindre l’équité en matière de santé pour tous les peuples à travers le monde.
L’amélioration de la santé concerne trois concepts bien connus en santé publique à savoir la prévention, la promotion et l’éducation pour la santé. L’équité en santé est un sujet intéressant car nous savons que l’environnement, les ressources, l’accès aux soins et les systèmes de santé diffèrent d’un pays à un autre. L’équité, c’est la justice en matière de droits, de distribution et d’accès ou encore c’est le principe selon lequel chacun peut prétendre à un traitement juste, égalitaire et raisonnable. La globalisation fait du monde un petit village mais toujours est-il que ce village est fait de riches, de parvenus, de ceux qui arrivent à peine à garder la tête hors de l’eau et bien sûr de gueux qui dépendent de la bonne foi des autres. Ainsi, tous les pays ne peuvent répondre à la maladie à la même vitesse ni avec les mêmes moyens sans oublier que la réponse médicale dépend aussi de la perception
sociale ; la pandémie récente de Covid-19 peut en témoigner. À la lumière de ces faits, la santé globale peut-elle vraiment atteindre cet objectif qu’est l’équité en santé pour tous ?
Références :
Fassin, D. (2015). Santé globale, un nouveau concept ? Quelques enseignements de l’épidémie à virus Ebola. Med Sci, 463-464. Koplan, J. P., Bond, C. T., Merson, M. H., Reddy, K. S., Rodriguez, M. H., Sewankambo, N. K., & Wasserheit, J. N. (2009). Towards a common definition of global health. Lancet, 1993-95.
OMS. Charte d’Ottawa du 21 novembre 1986. Préambule à la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, tel qu’adopté par la Conférence internationale sur la Santé, New York, 19-22 juin 1946. https://www.unige.ch/campus/numeros/114/ dossier1
8
CEREBS: Cellule de Recherche en Bioscience

Wellington DERAMEAU; Ludjie Love S. MERILAN; Neyssa DEMORCY
Jacques-Rodnel LOUIS, sont étudiants en DCEMIII et en internat à l’Université d’État d’Haiti et membres de SCORE et de CEREBS. Ce dernier est la Cellule de Recherche en Bioscience qui travaille sur diverses thématiques en recherche médicale. Accompagnée du professeur et vice-doyen Dr. Marc-Felix CIVIL, cette cellule a déjà organisé des séances de formations en recherche pour des étudiants dans leur faculté.





9
; Kevin RAPHAEL;
DERAMEAU Wellington1,3*; MERILAN Ludjie Love S.1,3 ; RAPHAEL Kevin1,3 ; LOUIS Jacques-Rodnel1,3, DEMORCY Neyssa1,3 ; Marc-Felix CIVIL2.
1 Faculté de Médecine et de Pharmacie – Université d’Etat d’Haïti.
2 Laboratoire de Médecine Ethique et Société (LABMES)
3 Cellule de Recherche en Bioscience (CEREBS)
* Correspondance
*La version publiée ci-dessous représente un premier jet qui est sujet à modification ultérieure pour publication finale.
Résumé
INTRODUCTION. - L’objectif principal de notre étude était de décrire les connaissances, attitudes et pratiques de la population haïtienne sur les maladies mentales. Mais également d’identifier les facteurs associés afin de fournir des informations sur les besoins, les problèmes et les obstacles liés au développement d’interventions de santé mentale efficaces et pertinentes au niveau local, tout en permettant d’établir une base à utiliser dans les évaluations futures et aider à mesurer l’efficacité de la capacité des activités d’éducation sanitaire à modifier la compréhension et les comportements liés à la santé mentale de la population haïtienne, et enfin de suggérer une ou des stratégies d’intervention qui reflète les circonstances locales spécifiques et les facteurs culturels qui influencent la perception des maladies mentales en Haïti.
MATERIELS ET METHODES. - Il s’agit d’une étude transversale mixte (qualitative et quantitative), portant sur les connaissances, attitudes et pratiques des maladies mentales en Haïti menée sur un échantillon de 189 personnes vivant en Haïti, sur une période allant de Septembre 2021 à Aout 2022. La collecte des données a réalisé par un questionnaire en ligne et via une enquête de terrain. L’analyse statistique a été réalisée sur le site pvalue.io
RESULTATS. - Avec un taux de participation de 100% pour 189 questionnaires. L’âge médian étant alors de 28 ans et la moyenne 25 ans. 43,4% avait eu quelqu’un de leur entourage à en souffrir ; pour 63,5% de toute la population il s’agissait d’un membre de leur famille. Seulement 2% de nos interrogés avaient ou ont encore un trouble mental cliniquement diagnostiqué. 41,3% croient que les vaudouisants peuvent tout à fait (12,9%) ou en partie (28,6%) provoquer une maladie mentale chez quelqu’un. Plus de la moitié pense qu’une maladie mentale peut être en partie (50,8%) ou tout à fait (29,1%) la conséquence d’un mauvais comportement (de soi ou d’un parent). 58,7% se seraient immédiatement rendu dans un centre spécialisé suite au constat de signes et symptômes d’une maladie mentale. Presque toute la population (97,4%) est d’accord avec le fait que les malades mentaux ne doivent pas être régulièrement battus. Plus de la moitié croient que les prières et pratiques religieuses pourraient en partie (51,3%) ou tout à fait (13,8%) peuvent les aider à surmonter un problème mental.
CONCLUSION. -Pour ce travail, on a pu constater que le niveau de connaissances des participants était assez élevé. La quasi-totalité avait une idée plus ou moins précise de ce qu’est une maladie mentale et l’incapacité physique/mentale liée à celle-ci. Par contre, au niveau des attitudes et des pratiques, il est évident qu’une bonne partie de la population reste en partie attaché aux principes magico-religieux quant aux explications étiologiques et à la prise en charge des maladies mentales.
MOTS CLES : Connaissance ; Attitude ; Pratique ; Maladie Mentale ; Santé Mentale.
10 Septembre 2022
Connaissances, attitudes et pratiques sur les maladies mentales en Haïti
ENTWODIKSYON. - Objektif prensipal etid nou an se te dekri konesans, atitid ak pratik popilasyon ayisyèn nan sou maladi mantal yo. Epitou idantifye faktè ki asosye yo yon fason pou bay enfòmasyon sou bezwen, pwoblèm ak obstak ki gen rapò ak devlopman entèvansyon sou sante mantal ki efektif epi enpòtan lokalman. Pandan nap bay yon baz pou itilize nan tout pwochen evalyasyon epi ede mezire efikasite aktivite edikasyon sante nan chanje konpreyansyon ak konpòtman ki gen rapò ak sante mantal popilasyon ayisyèn nan, epi finalman sijere youn oswa plizyè estrateji entèvansyon ki reflete sikonstans lokal espesifik ak faktè kiltirèl ki enfliyanse pèsepsyon maladi mantal an Ayiti.
MATERYÈL AK METÒD. - Sa a se yon etid transvèsal miks (kalitatif ak kantitatif) sou konesans, atitid ak pratik maladi mantal an Ayiti ki fèt sou yon echantiyon 189 moun k ap viv an Ayiti, sou yon peryòd ki soti septanm 2021 rive out 2022 apati yon kesyonè sou entènèt epi atravè yon sondaj sou teren. Analiz estatistik yo te fèt sou pvalue.io
REZILTA. - Ak yon to patisipasyon 100% pou 189 kesyonè. Laj medyàn lan te 28 ane epi mwayèn lan te 25 ane. 43.4% te gen yon moun yo konnen ki soufri maladi mantal; pou 63.5% nan tout popilasyon an se te yon manm nan fanmi yo. Se sèlman 2% nan moun ki repon nou yo te gen oswa toujou gen yon maladi mantal ki dyagnostike. 41.3% kwè ke vodou ka konplètman (12.9%) oswa pasyèlman (28.6%) lakòz maladi mantal lakay yon moun. Plis pase mwatye panse ke yon maladi mantal ka an pati (50.8%) oswa konplètman (29.1%) konsekans move konpòtman (tèt li oswa yon paran). 58.7% imedyatman prale nan yon sant espesyalize apre obsèvasyon siy ak sentòm yon maladi mantal. Prèske tout popilasyon an (97.4%) dakò yo pa ta dwe ap bat malad mantal regilyèman. Plis pase mwatye kwè ke lapriyè ak pratik relijye ta ka an pati (51.3%) oswa konplètman (13.8%) ede yo simonte yon pwoblèm mantal.
KONKLIZYON. -Pou travay sa a, nou te jwenn ke nivo nan konesans nan patisipan yo te byen wo. Prèske tout nan yo te gen yon lide plis oswa mwens presi sou ki sa yon maladi mantal ye ak enkapasite fizik/mantal ki lye ak li. Yon lòt bò, nan atitid ak pratik, li evidan yon bon pati nan popilasyon an rete an pati atache ak prensip majiko-relijye konsènan eksplikasyon etyolojik yo ak jesyon maladi mantal.
MO KLE : Konesans ; Atitid ; Pratique ; Maladi Mantal ; Sante Mantal.
Abstract
INTRODUCTION. - The main objective of our study was to describe the knowledge, attitudes and practices of the Haitian population on mental illnesses, and identify the associated factors in order to provide information on the needs, problems and obstacles related to the development of effective and locally relevant mental health interventions, while providing a baseline for use in future evaluations and helping to measure the effectiveness of health education activities in changing understanding and behaviors related to the mental health of the Haitian population, and finally to suggest one or more intervention strategies that reflect the specific local circumstances and cultural factors that influence the perception of mental illness in Haiti.
MATERIALS AND METHODS. - This is a mixed (qualitative and quantitative) cross-sectional study on knowledge, attitudes and practices of mental illness in Haiti conducted on a sample of 189 people living in Haiti, over a period from September 2021 to August 2022. Data collection was carried out by an online questionnaire and via a field survey. Statistical analysis was performed on pvalue.io
RESULTS. - With a participation rate of 100% for 189 questionnaires. The median age was then 28 years and the average 25 years. 43.4% had had someone close to them suffer; for 63.5% of the entire
11 Rezime
population it was a member of their family. Only 2% of our respondents had or still have a clinically diagnosed mental disorder. 41.3% believe that voodoo can completely (12.9%) or partially (28.6%) cause mental illness in someone. More than half think that a mental illness can be partly (50.8%) or completely (29.1%) the consequence of bad behavior (by oneself or a parent). 58.7% would have immediately gone to a specialized center following the observation of signs and symptoms of a mental illness. Almost the entire population (97.4%) agrees that the mentally ill should not be regularly beaten. More than half believe that prayers and religious practices could partly (51.3%) or completely (13.8%) help them overcome a mental problem.
CONCLUSION. -For this work, it was found that the level of knowledge of the participants was quite high. Almost all of them had a more or less precise idea of what a mental illness is and the physical/mental incapacity linked to it. On the other hand, at attitude and practices, it is obvious that a good part of the population remains partly attached to magico-religious principles as regards the etiological explanations and the management of mental illnesses.
KEYWORDS: Knowledge ; Attitude ; Practice ; Mental Illness ; Mental Health
12
Traditionnellement
la santé mentale était définie comme l’absence de troubles mentaux. Cette définition supposait qu’un individu exempt de troubles mentaux ait une bonne santé mentale et qu’à l’opposé, une personne atteinte de troubles mentaux ne pouvait jouir d’une bonne santé mentale. L’Organisation mondiale de la santé (OMS), nous a permis de mieux aborder le concept de santé mentale en donnant une approche épistémologique en définissant « la santé mentale comme un état de bien-être dans lequel un individu prend conscience de ses propres capacités, peut faire face aux stress normaux de la vie, peut travailler de manière productive et est capable d’apporter une contribution à sa communauté ».[1] La santé mentale a longtemps été négligée dans la santé et la pratique publiques. La société a généralement tendance à accorder une plus grande importance aux maladies biologiques que les troubles mentaux [2]. Malgré les nombreux efforts de l’OMS ou d’autres organismes pour l’amélioration de la perception de la santé mentale, il existe encore de nombreux obstacles. Tels que la stigmatisation, le manque de connaissances approfondies des différents troubles et la discrimination qui ont rendu le traitement des troubles mentaux négligés ou sous-estimés. La couverture efficace du traitement reste extrêmement faible. [3] L’intégration des programmes de santé mentale dans les services de soins de santé primaires n’est pas encore réalisée dans plus de 30 % des pays, et 25 % des pays n’ont toujours pas de législation en matière de santé mentale [4] dont Haïti. Cependant pour ce dernier il existe un document sur la composante santé mentale de la Politique Nationale de Santé publiée en 2014 par le MSPP. Cependant la mise en place de services de prise en charge dans le paquets essentiels de soins devient utopique quand moins de 1% du budget du MSPP est attribué à la santé mentale, sans compter les ressources humaines et financières avec seulement 2 centres psychiatriques pour le pays (Beudet, Mars & Kline), mais le gros du problème réside paradoxalement dans un paramètre que beaucoup de pays ont résolu, à savoir la perception et la compréhension des maladies mentales par la population, sans lesquelles on ne peut penser à une intégration des notions de soins mentaux dans les soins
primaires. Par ailleurs, il n’existe pas de données fiables sur la prévalence des problèmes de santé mentale en Haïti. Alors qu’en raison des taux élevés de violences criminelle et politique et de catastrophes naturelles, Haïti représente un terrain propice au développement des troubles mentaux.
Pour ne rien arranger, les croyances culturellement pertinentes en matière de maladie chez les familles haïtiennes peuvent impliquer des étiologies naturelles ou surnaturelles, ce qui amène les individus à demander secours aux guérisseurs religieux qui représentent souvent la première ligne de prise en charge des malades mentaux. [5] [6].
Si à l’égard de ces observations, on peut de manière empirique catégoriser le niveau de connaissances, les attitudes et les pratiques des Haïtiens face aux maladies mentales. Peu d’études ont été réalisées afin de systématiser leur compréhension et leur conduite face à la survenue de telles maladies dans leur environnement immédiat ou lointain. Tenant compte de l’évolution proportionnelle de la santé mentale de la population par rapport aux problèmes sociaux, politiques, économiques et culturels qui ravagent la société haïtienne.
Les résultats d’une telle étude aideront à planifier des activités d’éducation sur la santé mentale, à évaluer la capacité à reconnaitre et classer un trouble mental en préalable à des investissements dans la prise en charge des maladies mentales.
13 INTRODUCTION. -
APPROCHES THÉORIQUES
Ce travail de recherche s’est fondé dans une triple perspective : Une socio-épidémiologique afin d’appréhender les attitudes et les comportements des sujets face à la maladie mentale dans leurs environnement socio-culturel, approche qui nous permet de comprendre comment la santé mentale a été négligé dans la santé et la pratique publiques.
La seconde perspective s’accentue sur les approches Biopsychologiques afin d’avoir une meilleure compréhension des constantes de la connaissance des déterminants biologiques de la santé mentale, en mettant l’emphase sur les dimensions culturelles de la santé mentale dans la communauté haïtienne.
Enfin, la perspective anthropologique de ce concept nous permet de voir que des croyances chez la plupart des familles haïtiennes ont une certaine dépendance à l’égard des guérisseurs religieux de toute confession pour de nombreux problèmes mentaux.
MATERIELS ET METHODES
Il s’agit d’une étude transversale mixte réalisée en Haïti selon un échantillon non probabiliste permettant de mesurer les connaissances, attitudes et pratiques de la population haïtienne sur les maladies mentales.
Toute personne remplissant les critères suivants : consentement libre et éclairé, être âgé d’au moins 18 ans, demeurant et domicilié spécifiquement dans le pays durant l’enquête, ont été inclus. Celles et ceux qui refusent de continuer, qui ont moins de 18 ans, ne résidant pas dans le pays sont automatiquement exclus ; enfin, les gens ne pouvant pas s’exprimer ne sont pas inclus.
Instruments de mesure
La collecte des données a été réalisée par un questionnaire en ligne (google form) et via une enquête de terrain, pour ainsi dire un questionnaire à questions fermées pour la cueillette des données de l’enquête quantitative et des questions ouvertes confinées dans un canevas d’entretien qui servaient pour la cueillette des données de l’enquête qualitative.
En préparant ce questionnaire nous avons mis en évidence les trois dimensions suivantes : la dimension cognitive qui renvoie au niveau de connaissances sur les maladies mentales ; la dimension émotionnelle qui renvoie aux perception, croyance et représentation sur les
maladies mentales ; et la dimension pratique qui pousse la personne à agir face à cette maladie.
Critères de jugement
Le critère de jugement principal était les connaissances, attitudes et pratiques de la population vis-à-vis de la santé mentale évaluées sur trois éléments : Dimensions Socio-épidémiologiques, dimensions Biopsychologiques et Anthropologiques.
Analyse
Les données ont été téléchargées puis analysées pour les calculs statistiques par le système pvalue.io. Des matrices d’unités de sens ont été construites pour analyser les verbatim issus des entretiens individuels semi directifs selon les trois critères de jugement susmentionnés.
Éthique
Cette étude a été approuvée par le Laboratoire Médecine Éthique et Société de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’Université d’Etat d’Haïti. Le formulaire, qui pouvait être rempli en ligne ou en présentiel, était anonyme et le consentement de tout participant a été obtenu. Aucune compensation financière n’a été fourni en échange du partage d’informations et les participants ont reçu une explication verbale ou écrite des buts et objectifs de l’étude.
RESULTATS
Réalisation de l’enquête Pendant l’enquête 189 personnes ont rempli le questionnaire en ligne via « google form » sur leur téléphone intelligent ou leur ordinateur. Le consentement qui se trouvait à la première page après des explications claires et précises, était une condition pour poursuivre la navigation. 100% des questionnaires ont été exploités.
14
Caractéristiques sociodémographiques
Pour ce travail, la population était composée de 50,3% d’hommes contre 49,7% de femmes soit un sexe ratio de 1,01. La majeure partie soit 69,8% de la population interrogée avait un âge compris entre 18 et 29 ans ; l’âge médian étant alors de 28 ans et la moyenne 25 ans. Pour ce qui est du statut matrimonial 63,5% de la population de l’enquête était célibataire, 16,4% marié et 19,6% en couple. Il y a dans notre travail 95,8% d’étudiants. Pour ce qui est de la religion 53,4% des interrogés se déclarent de foi chrétienne protestante, 20,6% déclarent n’en avoir aucune et 17,5 % se disent catholiques.
Caractéristiques cliniques
La quasi-totalité de la population (95,8%) n’avait aucun trouble ou pathologie mentale. Cependant, près de la moitié soit 43,4% avait eu quelqu’un de leur entourage à en souffrir ; pour 63,5% de toute la population il s’agissait d’un membre de leur famille. Pour mesurer les facteurs de risques, nous avons questionné la consommation de substances illicites, les traumatismes sociaux ou familiaux et la présence d’une maladie mentale diagnostiquée. La plupart (93,1%) n’ont pas l’habitude de consommer des substances tel que le cannabis (risque X2 pour la schizophrénie) ; 46% de la population d’étude avait expérimenté un traumatisme social durant leur vie, 54% ont eu des traumatismes familiaux ou de l’enfance (divorce, maltraitance, deuil, abus sexuels, carences d’affectives). Seulement 2% de nos interrogés avaient ou ont encore un trouble mental cliniquement diagnostiqué : dépression, trouble anxiodépressif et trouble bipolaire qui ont apparu entre 15 et 28 ans.
Niveau de connaissance de la population d’étude sur les maladies mentales
En ce qui concerne le niveau des connaissances, 98,4% de la population affirment avoir entendu parler de la maladie mentale majoritairement dans leur milieu professionnel ou via un professionnel de la santé ou encore les réseaux sociaux ; 90,5% disent savoir ce qu’elle est. Plus de la moitié, soit 63% décrivent la maladie mentale comme une maladie héréditaire totalement ou en partie. De nos interrogés, 65% croient que toute personne dépendante (âgée, handicapée) est tout à fait ou en partie sujette à développer une maladie mentale, soit respectivement 19% et 46%. Par rapport aux habitudes pouvant être des facteurs de risques
de développer une maladie mentale, 44,4% affirment que la consommation du cannabis est en partie responsable de schizophrénie, 23,3% pensent que cette consommation est tout à fait à incriminer dans cette pathologie ; 74,6% sont d’avis que ce risque est plus grand si la personne a commencé à un très jeune âge. 59,3%, considère la maladie mentale comme une maladie grave à cause de l’impuissance face à la maladie (43,9%), ou de la vulnérabilité de certaines personnes (34,4%). Concernant l’âge, 64,6% disent que tout le monde est à risque de développer une maladie mentale tandis que 15,9% affirment que ce sont les personnes âgées qui sont plus à risque. Environ 75,2% croit que l’on peut, totalement (22,8%) ou en partie (52,4%), guérir de ce type de maladie.
Attitudes de la population d’étude par rapport aux maladies mentales
A travers notre étude nous avons pu relever que 61,9% des personnes croient que la guérison d’une maladie mentale ne passe pas du tout par la prière et le jeune tandis que 23,8% pensent qu’en partie ils peuvent aider. Une bonne partie, 63,5% sont d’avis que le meilleur remède pour les maladies mentales reste et demeure les médicaments prescrits par un personnel de soin. Pour mettre en évidence l’aspect culturel et anthropologique, nous avons questionné l’origine des maladies mentales. 41,3% croient que les vaudouisants peuvent tout à fait (12,9%) ou en partie (28,6%) provoquer une maladie mentale chez quelqu’un. Plus de la moitié pense qu’une maladie mentale peut être en partie (50,8%) ou tout à fait (29,1%) la conséquence d’un mauvais comportement (de soi ou d’un parent). La quasi-totalité de l’échantillon est d’accord que les maladies mentales ne sont pas en rapport direct avec le niveau économique. N’étant pas spécifique à une catégorie de gens, les riches comme les pauvres peuvent en être atteints, de même que pour les malfaiteurs et les non-croyants (ici les non-chrétiens). Un peu moins de la moitié soit 48,1% pensent que l’on peut en partie causer une maladie mentale chez quelqu’un, 13,8% pensent que l’on peut tout à fait le faire mais 22,2% croient que cela n’est pas possible. Enfin, 13,8% affirme que les prières de toutes sortes peuvent causer une maladie mentale chez quelqu’un.
15
Pratiques
de la population d’étude par rapport
aux maladies mentales
Concernant les pratiques de nos enquêtés par rapport aux maladies mentales, 58,7% se seraient immédiatement rendu dans un centre spécialisé suite au constat de signes et symptômes d’une maladie mentale, tandis que 16,9% en parleraient avec leurs proches. Dans le cas où ce serait quelqu’un de leur entourage, c’est 65,1% qui l’emmèneraient dans un centre spécialisé dans la prise en charge d’affections mentales. Face aux problèmes mentaux, c’est la quasitotalité (93,1%) qui affirme qu’il faut s’assurer d’une prise en charge adéquate. Il y a près d’un tiers soit 29,6% qui pensent qu’en partie toute personne avec une maladie mentale doit être enfermée contre 65,1% qui affirment que pas du tout. Presque toute la population (97,4%) est d’accord avec le fait que les malades mentaux ne doivent pas être régulièrement battus, affirmant au contraire que ceux-ci doivent être écoutés. Par rapport aux soins médicaux, 69,3% de nos enquêtés préfèreraient consulter un médecin face à une maladie mentale en premier lieu. Plus de la moitié croient que les prières et pratiques religieuses pourraient en partie (51,3%) ou tout à fait (13,8%) peuvent les aider à surmonter un problème mental tandis que la presque totalité pense que l’aide d’un médecin traitant peut être tout à fait ou en partie utile, respectivement 50,8% et 39,2%. Enfin, 80,4% prendraient régulièrement leurs médicaments face à un problème mental, et préfèreraient en cas d’échec du premier traitement en parler au médecin traitant (63,5%) ou voir un autre médecin de préférence (18,5%).
ANALYSE ET DISCUSSION
Cette étude est une enquête qui mesure et analyse les connaissances, attitudes et pratiques (CAP) de la population haïtienne vis-à-vis des maladies mentales. L’échantillon qui a été incluse dans l’étude a été sélectionné aléatoirement via un formulaire accessible à toute personne possédant un téléphone intelligent ou un ordinateur avec accès à un compte google. Cet échantillon était composé de presqu’autant de femmes que d’hommes. Il était majoritairement jeune, célibataire et universitaire ceci pouvant s’expliquer par la technique de formulaire en ligne pour le recueil des informations, les jeunes utilisant le plus les réseaux sociaux. Cet
échantillon est représentatif de la population haïtienne du point de vue de l’âge car il s’agit d’une population majoritairement jeune [7] mais non représentatif par rapport au niveau de scolarisation car seul 1,3% (150 000 personnes) de la population à accès aux études universitaires. [8] Presque tous les interrogés se disent sains d’esprit, contrairement à la population mondiale (1 pour 8) [9] et aux Etats-Unis d’Amérique car selon une étude de Kessler MC. et Mc Gonagle K. 50% de la population qui y vit ont développé au moins un trouble mental au cours de leur vie [10] . Cependant, cette affirmation donnée par la personne elle-même est trop subjective et ne peut donc être généralisée à toute une population. La prévalence de la maladie mentale en Haïti nous aurait été utile dans ce cas, malheureusement, aucune donnée fiable sur le sujet n’a été trouvé. Très peu de nos interrogés consomment une substance illicite (cannabis), par contre une bonne partie avoue avoir vécue des traumatismes sociaux ou familiaux. Près de la moitié avait connu quelqu’un avec des troubles mentaux, pas forcément diagnostiqué par un professionnel, mais ce qui peut laisser penser que la population côtoie les « malades mentaux »
La notion de maladie mentale semble être populaire parmi nos interrogés, puisque la quasi-totalité affirme en avoir déjà entendu parler et savoir ce qu’elle est ; ceci est quand même rassurant, car pour mieux prendre en charge une pathologie il faut un meilleur niveau de connaissance de cette dernière et pas seulement chez les professionnels de santé. Le niveau de connaissance de la population interrogée est relativement bon, surtout en ce qui a trait au rôle de la génétique dans le développement des maladies mentales, les populations susceptibles de la développer, les habitudes qui augmentent les risques, la gravité de la maladie et la prise en charge, ceci pouvant s’expliquer par la composition de l’échantillon qui est majoritairement universitaire. Nous avons relevé et regroupé les idées qui traversaient les réponses aux questions ouvertes précédemment présentées dans les tableaux. Pour la plupart d’entre eux, les maladies mentales sont des dérèglements au niveau de la pensée, des émotions et/ou du comportement. D’autres définitions moins fréquentes ont été évoquées, allant de maladies négligées et
16
mal comprises en Haïti à affectation socioaffectives en passant par affectation des structures cognitives. Ceci témoigne de l’évolution du mode de pensée de la population, car elle a longtemps considéré les maladies mentales comme ayant des origines superstitieuses, divines ou diaboliques [11]. En ce qui a trait à ce qui peut causer ces affections, le terme retrouvé le plus souvent est traumatismes psychiques, mais nous avons également relevé : Condition de vie (socio-économique), hérédité et consommation des substances neurotoxiques (drogue, médicaments). Questionnés sur les signes et symptômes des maladies mentales ceux qui ont été le plus souvent retrouvés sont d’ordre comportementales, suivis de près par les signes et symptômes émotionnels et physiques.
Pour les attitudes de la population face aux maladies mentales, nous pouvons dire, selon les résultats, qu’une bonne partie soit près d’un tiers reste attachée à la prière (chrétienne), ont cette image du vaudouisant qui a le pouvoir de provoquer des maladies mentales chez quelqu’un, ou encore pense que ces pathologies sont des conséquences de nos mauvaises actions ou de celles de nos parents. Mais presque tous sont unanimes sur le fait que ce ne sont pas des maladies de riches ou de pauvres, de malfaiteurs ou de non-croyants.
Parlant des pratiques de la population face aux maladies mentales, nous avons remarqué que plus de la moitié fait confiance aux centres spécialisés et aux médecins pour eux-mêmes ou pour leur entourage. Presque tous sont d’avis sur le fait qu’il faut toujours s’assurer d’une bonne prise en charge, ce qui est rassurant pour la santé mentale de la population. Contrairement à des comportements populaires selon lesquels il faut bastonner régulièrement tout malade mental pour des raisons diverses, la quasi-totalité de notre échantillon n’est pas d’accord avec cette idée. Ceci pouvant encore une fois s’expliquer par le niveau de scolarisation de la population incluse dans l’étude. Concernant les solutions, quoique beaucoup pensent que les médecins peuvent aider à la guérison d’une pathologie mentale, une bonne partie croit que les prières et pratiques religieuses ne sont pas à négliger. Ceci laisse supposer que la meilleure prise en charge devrait se faire par une psychiatrie communautaire « athéorique », considérant le milieu social et la culture du malade, comme c’est le cas à Madagascar [10]. En d’autres termes, une prise
en charge pragmatique, comme c’est le cas pour de nombreux pays moins développés, serait meilleure en Haïti [12]. Il aurait fallu questionner et analyser la corrélation entre les deux pratiques afin de voir si la population les considère comme complémentaires, supplémentaires ou contraires devant dans ce cas choisir une seule méthode. Enfin, presque tous affirment qu’ils seraient enclins à suivre régulièrement un traitement prescrit par un personnel qualifié et entameraient les démarches nécessaires en cas d’échec de celuici échouerait. Pratique qui suppose que la population prend, pour la plupart, ces maladies très au sérieux. Mais, il s’agit ici de quelqu’un qui est supposé sain d’esprit, et qui n’a pas vécu les effets secondaires des divers médicaments qui sont prescrits en cas de pathologie mentale. Le formulaire en ligne, le manque d’hétérogénéité de notre échantillon sont les principales limites de notre travail. En effet, cette méthode de formulaire en ligne nous confronte au problème de vérification de l’identité de la personne, de son comportement en répondant aux questions et de l’authenticité des réponses. Pour ce qui est du manque d’hétérogénéité, il peut être considéré comme une conséquence de la technique de formulaire en ligne, accessible seulement à une portion de la population haïtienne. Cependant, nous avons tenté de combler ces limites en proposant le formulaire à des personnes d’horizons et de milieux socio-professionnels différents, et par des restrictions comme l’obligation de fournir son adresse e-mail et la possibilité de ne remplir le formulaire qu’une seule fois.
CONCLUSION / RECOMMANDATION
Pour ce travail, on a pu constater que le niveau de connaissances des participants était assez élevé. La quasi-totalité avait une idée plus ou moins précise de ce qu’est une maladie mentale et l’incapacité physique/mentale liée à celle-ci. Par contre, au niveau des attitudes et des pratiques, il est évident qu’une bonne partie de la population reste en partie attaché aux principes magico-religieux quant aux explications étiologiques et à la prise en charge des maladies mentales. Ceci représente évidemment des paramètres d’intervention pour une amélioration de la santé mentale en Haïti.
17
En ce sens, comprendre les connaissances, aptitudes et pratiques de la population joue un rôle important en vue d’adopter des stratégies ciblées afin de réduire le poids de ces maladies.
REFERENCES
1. OMS, « Culture et santé mental en Haïti : Une revue de littérature 2010 ; 2010
2. Sara Abou Azar, Krystelle Hanna. CrossSectional Study of Knowledge, Attitude and Practice (KAP) towards Mental Illnesses among University Students in Lebanon. January 2016 DOI:10.4172/2471-4372.1000125
3. Ayano G, Assefa D, Haile K, Chaka A, Haile K, Solomon M, Yohannis K, Adane AA, Jemal K. Mental health training for primary health care workers and implication for success of integration of mental health into primary care: evaluation of effect on knowledge, attitude and practices (KAP). Int J Mental Health Syst. 2017;11(1):63. https://doi.org/10.1186/s13033017-0169-8
4. Dickinson WP. Strategies to support the integration of behavioral health and primary care: what have we learned thus far? J Am Board Family Med. 2015;28(Supplement 1):S102–6. https://doi.org/10.3122/jabfm.2015.s1.150112.
5. Desrosiers A, St Fleurose S. Treating Haitian patients: key cultural aspects. Am J Psychother. 2002;56(4):508–521. [PubMed] [Google Scholar]
6. E. Auguste and A. Rasmussen.Vodou’s role in Haitian mental health. Glob Ment Health (Camb). 2019; 6: e25. Published online 2019 Oct 18. doi: 10.1017/gmh.2019.23
7. Composante Santé Mentale de la politique nationale de santé. MSPP. Octobre 2014. Disponible sur https://mspp.gouv.ht/ site/downloads/Composante%20Sante%20 Mentale%20MSPP.pdf
8. Laetitia GERARD, PhD. Etat des lieux de l’enseignement supérieur en Haïti. Mai 2017. Disponible sur https:// cooperationuniversitaire.com/2017/05/03/ etat-des-lieux-de-lenseignement-superieuren-haiti/#:~:text=Selon%20le%20rapport%20 du%20GREF,de%20l’enseignement%20 supérieur%20haïtien
9. OMS. Troubles mentaux. Juin 2022. Disponible sur https://www.who.int/ fr/news-room/fact-sheets/detail/mentaldisorders#:~:text=En%202019%2C%20
une%20personne%20sur,la%20pandémie%20 de%20COVID%2D19
10. La santé mentale à Madagascar. L’information psychiatrique. Volume 79, numéro 10. Décembre 2003.
11. Andrena Pierre, Pierre Minn, Carlo Sterlin, Pascale C. Annoual, Annie Jaimes, Frantz Raphaël et al. Culture and Mental Health in Haiti : A Literature Review. Volume 35, numéro 1, printemps 2010. URI : https:// id.erudit.org/iderudit/044797ar DOI : https:// doi.org/10.7202/044797ar
12. L R. From categories to context : a decade of the « New cross cultural psychiatry ». 1990 ; 156 : 307-27.
13. T Bedirhan Ustin,MD, PhD. The Global Burden of Mental Disorders. American Journal of Public Health. 1999. 89 ;1315-1318.
14. GBD 2019 Mental Disorders Collaborators. Global, regional, and national burden of 12 mental disorders in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Volume 9, Issue 2, February 2022, Pages 137-150
15. OMS. Santé mentale : renforcer notre action. Disponible sur https://www.who.int/fr/ news-room/fact-sheets/detail/mental-healthstrengthening-our-response
16. Brodwin P (1996). Medicine and Morality in Haiti: The Contest for Healing Power, vol. 3 Cambridge University Press: Cambridge. [Google Scholar]
17. Sara Abou Azar, Krystelle Hanna. Cross-Sectional Study of Knowledge, Attitude and Practice (KAP) towards Mental Illnesses among University Students in Lebanon. January 2016 DOI:10.4172/2471-4372.1000125
18. Henry Dorvil, «Maladie mentale comme problème social» service social, vol 39, no 2, 1990, p. 44-58, [http://id.erudit.org/ iderudit/706476ar]
18
Tableau
Tableau 1.- Analyse de contenu catégoriel à partir des unités de sens issues des réponses fournies par les personnes interrogées en répondant à la question relative à leurs savoirs sur les maladies mentales, les causes qui peuvent les engendrer et les signes et les symptômes qu’ils connaissent.
Connaissances sur les maladies mentales
Leurs savoirs Fréquence Les causes
Émotionnels : tristesse, peur, angoisse, irritabilité, sentiment de dépréciation de soi…
100
Fréquence Les signes et symptômes Fréquence Maladies graves 10 Traumatismes psychiques 130
Affectation des structures cognitives 9 Condition de vie (socio-économique) 30
Comportementaux : humeur labile, agressivité, difficultés à trouver de l’intérêt dans ses activités, à exécuter des tâches quotidiennes, abus de certaines substances…
150
Affectation socioaffectives 7 Héréditaire (Génétique)
Troubles involontaires et du système nerveux 19
Dérèglements au niveau de la pensée, des émotions et/ou du comportement
50
Maladies négligées et mal comprises en Haïti 6
Consommation des substances neurotoxique (drogue, médicaments)
40
Cognitifs : difficultés importantes à se concentrer, à raisonner normalement, troubles de la mémoire……
80
55
75
Sensoriels : troubles de la perception visuelle ou auditive…
Physiques : maux de tête, fatigue intense, troubles du sommeil, manque d’appétit…
100
Ce tableau nous présente les unités de sens et leur fréquence issues des réponses des personnes interrogées aux questions ouvertes qui leur ont été posées sur leurs connaissances sur maladies mentales. De toutes les définitions sur les maladies mentales la grande majorité exprime que la maladie mentale est liée à un ensemble des dérèglements au niveau de la pensée, des émotions et/ou du comportement, dont les causes sont toujours des traumatismes psychiques, ce qui explique la grande fréquence des signes et des symptômes liées à des troubles comportementaux ( humeur labile, agressivité, difficultés à trouver de l’intérêt dans ses activités, à exécuter des tâches quotidiennes, abus de certaines substances…)
19 ANNEXES



SCORE est une commission de l’Association Haïtienne des Étudiants en Médecine (AHEM) faisant partie de la grande famille de la Fédération Internationale des Associations d’Étudiants en Médecine (IFMSA). Fondée en 1991, elle permet aux professionels de santé à travers le monde d’élargir leurs connaissances en les initiant à la recherche médicale dans le cadre du programme d’échanges en recherche de l’IFMSA.
En Haïti cette commission est dédiée à la recherche scientifique et au réseautage entre les étudiants locaux et internationaux. Le but étant de promouvoir et de rehausser le niveau de la recherche scientifique en Haïti en fournissant aux étudiants en médecine les moyens et les opportunités nécessaires à leur encadrement.Les membres ont régulièrement accès à des formations, des événements ciblés ou autres dans un environnement stimulant et enrichissant. Nous avons aujourd’hui une plateforme, l’HMS Journal, permettant aux alumni de publier leurs travaux scientifiques et des articles divers et variés. Le but ultime de cette commission est de mettre sur pied un programme d’échanges en recherche entre les étudiants haïtiens et ceux vivant à l’étranger, et ainsi intégrer le programme de l’IFMSA, ce qui nous pensons sera très bénéfique pour le progrès de la recherche scientifique en Haïti.

22
MOT DE LA COORDONNATRICE
Chers SCOREens et SCOREennes, C’est avec grand plaisir que je vous adresse ces mots par le biais de la première publication du Haitian Medical Student Journal, la revue de notre chère association, l’Association Haïtienne des Etudiants en Médecine. Ce projet qui a longtemps été chéri par notre commission, SCORE et ses différents coordonnateurs est aujourd’hui une réalité ! Ceci a été rendu possible grâce à l’aide et au dévouement de différentes personnalités. Ce sont notamment le président de l’association, mon collègue et SCOREens, Kevin, et également chacun des membres du comité de la revue qui proviennent des différentes commissions. Ensemble nous avons rendu ce rêve possible, merci.
Le thème de cette première sortie : Santé mentale et Santé globale, nous rappelle encore une fois combien l’aspect mental qui a longtemps été négligé surtout chez nous a une place importante dans la santé, surtout dans le cadre de la globalisation de cette dernière. Ne la négligeons pas, et faisons de la santé globale la pierre angulaire de notre combat en tant que professionnel de la santé. Tout le monde mérite des soins de santé de qualité.
Maintenant je m’adresse à vous, membres de SCORE, que l’amour de la recherche continue de vous animer pour que vous ayez le courage de faire bouger les choses et de faire évoluer les mentalités, je vous porte dans mon cœur. Et vous étudiants, médecins, invités qui passez par-là, sachez que la recherche médicale a une importance capitale dans le développement de la connaissance, et contrairement à certaines idées reçues, ne se tient pas uniquement en laboratoire. Si vous avez l’habitude, continuez, sinon, vous attendez quoi pour vous y mettre ? Formez des petits groupes, apprenez, rédigez, et faites avancer la science, la médecine.
Vous êtes à présent dans la section SCORE, là où vous tombez amoureux de la recherche, principal sujet de discussion.
Formez-vous, prenez soin de vous et bonne lecture ! Blue hugs.
Ludjie L. S. MERILAN, NORE 21-22 Étudiante en 5ème année de médecine. FMP/ UEH.
23
Ludjie Love S. Merilan est étudiante en médecine à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’Université d’État d’Haiti. Elle est membre d’AHEM dès sa première année de médecine et actuellement coordinatrice de SCORE.

Recherche médicale, entre mythes et réalité
Résumé
La recherche médicale est l’ensemble des activités ayant pour objectif de développer le savoir en santé. Les trois principaux types sont la recherche fondamentale qui concerne les études qui se font en laboratoire ; la recherche clinique correspondant aux études scientifiques réalisées sur les humains afin de développer des connaissances biologiques ou médicales ; et la recherche en sciences humaines et sociales qui concerne le versant social, éthique, épistémologique et philosophique de la médecine. La recherche médicale est d’une importance capitale, car elle permet entre autres la compréhension des maladies et l’élaboration de nouveaux traitements. Mots clés : recherche médicale, recherche scientifique, types de recherche
Rezime
Rechèch medikal se ansanm aktivite ki gen kòm objektif pou devlope konesans nan lasante. Twa prensipal tip yo se : rechèch fondamatal ke konsène etid ki fèt nan laboratwa ; rechèch klinik ki se etid syantifik ki fèt sou moun pou yo ka devlope konesans byolojik oswa medikal ; epi rechèch nan syans imèn ak soyal ki konsène pati sosyal, etik, epistemolojik ak filozofik lamedsin. Rechèch medikal gen yon enpòtans san parèy, paske li pèmèt anpil bagay tankou konpreyansyon maladi ak kreyasyon nouvo tretman. Mo kle : rechèch medikal, rechèch syantifik, tip rechèch.
Abstract
Medical research is the set of activities aimed at developing health knowledge. The three main types are basic research which concerns studies that are done in the laboratory; clinical research corresponding to scientific studies carried out on humans in order to develop biological or medical knowledge; and research in the human and social sciences which concerns the social, ethical, epistemological and philosophical side of medicine. Medical research is of paramount importance, since it allows, among other things, the understanding of diseases and the development of new treatments.
Key words : Medical research, scientific research, types of research
24
Le plus souvent lorsqu’on entend recherche en médecine, ce qui nous vient premièrement en tête c’est l’image d’un laboratoire, de manipulations complexes. Mais est-ce que la recherche en médecine n’est que cela ? Quels en sont les différents types ? Son importance ? Nous nous sommes proposés de vous éclairer sur ces questions dans cet article.
La recherche se définit comme la production de savoir. Elle est dite scientifique lorsqu’elle vise à mettre en lumière de nouvelles informations ou à en vérifier d’anciennes afin d’augmenter ou de vérifier les connaissances. Le terme « recherche médicale » fait référence aux activités ayant pour objectif de développer ou de contribuer au savoir généralisable en matière de santé dans le domaine de la recherche impliquant des participants humains(1). Les professionnels de la santé qui y participent proviennent d’horizons diverses, parmi lesquels on retrouve médecins, biologistes, biochimistes, ingénieurs biomédicaux, chimistes, dentistes, vétérinaires, économistes sanitaires, infirmiers et pharmaciens.
Les trois principaux types de recherche médicale sont la recherche fondamentale, la recherche clinique et la recherche en sciences humaines et sociales(2).
• La recherche fondamentale dite académique est théorique. Elle concerne les études qui se font en laboratoire. Sa finalité n’est pas économique à court terme. Elle crée la connaissance, explique et élabore des théories. En d’autres termes elle va permettre la compréhension des causes et conséquences d’une maladie, l’élaboration de nouvelles molécules pour la création d’un médicament, d’un vaccin, ou à tester des thérapeutiques en laboratoire.
• La recherche clinique également appelée étude ou expérimentation, correspond aux études scientifiques réalisées sur les humains afin de développer des connaissances biologiques ou médicales. Pouvant être interventionnelle ou non, elle ne se limite pas aux essais cliniques ; mais permet aussi d’identifier des mécanismes moléculaires ou cellulaires impliqués dans des maladies, des facteurs de risque génétiques ou environnementaux, de comparer plusieurs
approches diagnostiques ou thérapeutiques, d’évaluer une action de santé publique.
• Enfin, la recherche en sciences humaines et sociales est très particulière. Relevant plus du versant social, éthique, épistémologique et philosophique de la médecine ; elle consiste à se poser une question puis évaluer son impact sur la morale, les fondements bioéthiques avec toujours l’individu au centre.
La recherche médicale est d’une importance capitale(3), car, les connaissances qui y sont acquises peuvent être ensuite appliquées afin d’aider à comprendre certaines maladies, à élaborer de nouveaux traitements, soins ou méthodes de prévention, et à améliorer les méthodes de prise en charge. Elles vont également permettre aux autorités politiques de prendre les meilleures décisions pour la population en matière de santé.
La recherche médicale ne se tient pas uniquement dans les laboratoires. Elle a le plus souvent lieu suite à une observation à l’hôpital, dans notre entourage dans une localité. Avec des bases solides sur la méthodologie de la recherche et de la volonté, nous pouvons faire de la recherche. Puisque la recherche médicale a pour but de faire avancer la médecine de manière scientifique, faisons avancer la médecine, faisons de la recherche !
Références
1. Recherche medicale. In: Larousse [Internet]. Available from: larousse.fr/ encyclopedie/medical/recherche
2. Fondation Alzheimer. Focus sur les differents types de recherches [Internet]. Fondation Alzheimer. 2019 [cited 2022 Oct 30]. Available from: fondation-alzheimer.org/ focus-sur-les-differents-types-de-recherches/
3. Jouquan J. La formation à la recherche au cours des études médicales : quelques considérations , quelques questions et quelques pistes. Pedagog Medicale. 2019;19(2018):109–12.
25

SCORP( Standing Committee on Human Rights and Peace ) est un département de l’association haïtienne des étudiants en médecine qui elle même est sous l’égide d’un plus grand regroupement: l’International Federation of Medical Student Associations. SCORP considère les droits humains en santé comme un axe à explorer et entend développer des stratégies pour encourager et promouvoir la protection des droits humains dans la pratique médicale par des plaidoiries, des sensibilisations mais aussi par le renforcement des capacités et le soutien des étudiants dans la réalisation d’activités et de projets pour la construction d’un monde juste et pacifique où prime le bien-être de chaque individu. Cela passe notamment par l’amélioration des connaissances sur les droits humains, la construction de la paix afin qu’ils puissent agir de façon éthique conformément aux droits de l’homme, la motivation et la promotion par des campagnes de sensibilisation, l’élaboration de politiques publiques des droitx humains en santé. En Haïti, à AHEM, nous organisons des activités pour les étudiants en médecine membre de l’association et pour le public en général. Cette année par exemple, SCORP a organisé en partenariat avec l’Institut Haïtien de Langues des Signes une séance de formation en langues des signes, des activités d’aide dans des orphelinats et autres.
SCORP se tient debout pour les droits humains, la paix et la santé dans le monde et en Haïti notamment.

27
Pouchenie Blanc, membre de SCORP.
Je suis Pouchenie Blanc, étudiante en Médecine et en Sciences Juridiques, débatteuse, juge et coach à Fokal, rédactrice en chef du Bulletin de la Vie Etudiante de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’Université d’Etat d’Haïti. Je suis également activiste des droits de l’homme, consultante en droits humains et présidente d’une fondation qui travaille avec les enfants : Fondasyon Lespwa Pou Pitit Tè a. Je suis membre de CapArt, passionnée de lecture et de littérature.
Au carrefour des droits humains et de la santé
Les droits humains n’ont jamais eu un champ d’exclusion en ce qui concerne la personne humaine dans quelle que soit la dimension considérée. Ainsi, cela traduit la responsabilité de tous les secteurs de considérer les droits humains dans leurs perspectives d’évolution afin de parvenir au bien être collectif qui n’est pas seulement un idéal mais un objectif à atteindre.
La santé comme état de bien être complet c’est à dire physique, mental et social et pas seulement une absence de maladie ou d’infirmité rentre dans le cadre d’une garantie de droits de l’individu. Selon l’OMS, la possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain. La pratique médicale devient donc l’accomplissement d’un devoir se joignant à la jouissance d’un droit inaliénable celui de la santé coiffé par un plus grand, le droit à la vie. Il s’agit donc pour l’individu de trouver de façon accessible, des soins de qualité que nécessite sa situation.
Le système sanitaire haïtien arrive à peine à fournir des soins formels à 47% de la population, et ce dans des conditions précaires la plupart du temps avec un taux très faible dans le milieu rural. Cette situation en plus d’avoir des conséquences sur la santé de la population, constitue une violation flagrante des droits de la personne garantie par la déclaration universelle des droits de l’homme dont Haïti a adhéré. Moins de la moitié des enfants du pays ont reçu les vaccins de base, un enfant sur douze n’atteint pas son 5e anniversaire. Le pays compte en moyenne 5,9 médecins ou infirmières et 6,5 professionnels de santé pour10 000 habitants. Ce tableau traduit la faiblesse de notre système sanitaire mais aussi l’incapacité de nos dirigeants de construire un
état de droit où la population ne vivote pas mais s’épanouit en droits, libertés et devoirs.
L’inaccessibilité à des soins de qualité constitue une violation des droits de l’homme; réversiblement, des violences physiques et verbales, des discriminations, des inégalités peuvent affecter la santé de l’individu. Les droits humains en santé incluent non seulement un accès équitable et digne à des services sanitaires, des conditions de travail sécuritaires, des politiques de santé bénéfique à tous, en particulier aux plus vulnérables des coopérations florissantes pour la santé des peuples mais aussi la présence des facteurs fondamentaux déterminants de la santé. Le droit à la santé sous tend l’accessibilité, la disponibilité, l’acceptabilité, la qualité, la participation et la responsabilité, d’autre part il convient de considérer la sécurité sociale, l’éducation, l’alimentation comme parties prenantes de la santé de l’individu.
Beaucoup de défis sont à relever dans le système de santé haïtien, ce qui concommitamment constituerait une avancée dans la construction de la paix et de l’égalité. Eduquer, protéger, soigner, prévenir la violation des droits humains, promouvoir la paix et l’égalité dans les systèmes de santé et autres secteurs de la vie, voilà une manière d’allier les droits humains à la santé.
 Source EMMUS IV OMS/ccsbrief_hti
Source EMMUS IV OMS/ccsbrief_hti
28

Comité permanent de la santé publique (SCOPH)

Le Comité permanent de santé publique (SCOPH) regroupe les étudiants en médecine du monde entier pour apprendre, acquérir des compétences, coopérer, explorer et partager des idées pour répondre à toutes les problématiques liées à la Santé Publique, y compris les problématiques de Santé Globale, politiques de santé, activités de promotion de la santé et d’éducation.
Les étudiants en médecine de l’IFMSA ont formé le Comité permanent de la santé des étudiants (SCOSH) en 1952, animé par une forte volonté de participer activement à la prévention et élaborer des politiques concernant les problèmes de santé. Au cours des années suivantes, la grande variété d’activités a conduit à la transformation du SCOSH en Comité permanent de Santé (SCOH) en 1963. En 1983, le nom du Comité a changé une fois de plus au Comité permanent de la santé publique (SCOPH).
Au cours de ces six décennies, SCOPHeroes a mis en œuvre, maintenu et amélioré une grande variété de projets communautaires à l’échelle locale, nationale et niveau international. Grâce à ces activités, nous poursuivons notre vision d’une société et nous développons notre propre potentiel d’être un complet et habile professionnel de la santé.
Mission
Le Comité permanent de la santé publique favorise le développement de la médecine étudiants du monde entier sur les questions de santé publique à travers un partage des connaissances, réseautage, gestion des activités, apprentissage communautaire, le renforcement des capacités, le plaidoyer et l’accès aux opportunités d’apprentissage externes.
Objectifs
a) La prévention des maladies au sein de notre société.
b) Promotion et éducation à la santé au sein de notre société.
c) Sensibilisation aux problèmes de santé mondiale et publique au sein des étudiants et notre société.
d) Plaidoyer pour les politiques de santé en tant que porte-parole des étudiants en médecine du monde entier.
e) Développer les compétences et les connaissances des étudiants en médecine en tant que futurs professionnels
f) Travailler en équipe internationale et collaborer avec des organismes externes de santé publique organisations d’utiliser le potentiel de plus d’un million de médecins dans le monde étudiants.
g) Collaboration multidisciplinaire.
h) Collaborer avec des organisations aux niveaux national, régional et mondial.
30
Salutations à tous les lecteurs du journal, mes collègues, et à toute la population en général !
C’est une grande occasion pour moi en tant que NPO (National Public Health Officer) de vous adresser ces petits mots en vous présentant SCOPH (Standing Committee of Public Health). Le comité permanent de santé publique (SCOPH) est la commission responsable des activités liées non seulement à la santé de la population tant au niveau local qu’au niveau international (Global Health). Nous avons un regard bien particulier sur la population, car nous nous intéressons au bien être. Et pour parler de bien être nous avons besoin non seulement d’une bonne santé physique mais aussi d’une bonne santé mentale. La santé mentale est un pilier important sans lequel le concept de santé perdrait toute son essence.
Sur ces mots, je vous exhorte au nom de SCOPH-AHEM : Ensemble prônons la santé mentale pour tous, Ensemble prônons le bien-être pour tous.
31
Andersen AUGUSTE, Coordonnateur de SCOPH
MOT DU COORDONNATEUR

SCOME (Standing Committee on Medical Education)

Depuis la fondation de l IFMSA, l’une des plus anciennes commissions travaillant sur le volet enseignement médical dans le monde.
Objectif
Forum d’échanges pour les étudiants intéressés par différents aspects de l’enseignement médical dans l’objectif d’atteindre de poursuivre et d’atteindre leur but.
Visions
Que les étudiants en médecines faisant partie de l IFMSA atteignent un niveau optimal de développement sur le plan personnel et professionnel afin de mettre un maximum de potentiel au service du monde.
Missions
La mission est que SCOME représente le cadre à l’intérieur duquel les étudiants en médecine contribuent eux-mêmes au développement de la science médicale dans le monde.
33
MOT DU COORDONNATEUR
L’AHEM en tant que la plus grande famille des étudiants en médecine d’Haïti, a toujours l’impérieuse nécessité de réunir ses membres et les membres du grand corps estudiantin de médecine du pays par tous les moyens. En effet dans leurs missions de coordination des activités de l’association les commissions sont appelées à poser des actions prenant cet itinéraire. C’est ainsi que nous accueillons ce journal des étudiants en médecine qui constituera une énième pierre posée pour les jalons d’une pratique d’étude médicale utilitaire en Haïti
Le standing commitee on medical education Scome qui est un forum d’échanges pour les étudiants intéressés par différents aspects de l’enseignement médical dans l’objectif de poursuivre et d’atteindre leur but avec la vision que les étudiants atteignent un niveau optimal de développement sur le plan personnel et professionnel afin de mettre un maximum de potentiel au service du monde.
Ce journal rentre dans le cadre même de la mission de SCOME et doit représenter une plateforme à l’intérieur duquel les étudiants en médecine contribueront eux-mêmes au développement de la recherche et de l’enseignement de la science médicale dans le pays.
34
Kervens Saint-Hilaire NOME

Dès la création de l’IFMSA en 1951, SCOPE a été créé et sert de pont de liaison entre les différents étudiants en médecine à travers le monde de par les échanges qui se font entre les différentes associations faisant partie de l’IFMSA. Sa mission principale est de promouvoir une meilleure connaissance des systèmes de santé, des cultures ainsi qu’une bonne collaboration entre les futurs professionnels de la santé à travers le monde. Ainsi, elle nous permet de créer des liens, de découvrir d’autres systèmes de santé, d’expérimenter des soins de santé dans un autre système de santé, de procurer des chances équitables à tout étudiant en médecine, de faciliter les connections entre les étudiants en médecine à travers le monde et améliorer notre vision globale de la santé. Pour atteindre cet objectif, SCOPE organise des activités locales et internationales.
SCOPE Haïti a été créé en 2010 en même temps que l’AHEM et poursuit ces mêmes objectifs. Depuis nous cherchons à prioriser nos activités nationales tout en travaillant sur les processus qui nous permettront de jouir de l’accès international ce qui nous ouvrirait de nombreux horizons.

36

La commission sur la santé et les droits sexuels et reproductifs, y compris le VIH et le SIDA, a été créé en 1992, animée par une forte volonté de prendre une part active aux interventions concernant le VIH et les infections sexuellement transmissibles (IST) et de soutenir les personnes vivant avec le VIH/SIDA en travaillant à réduire la stigmatisation et la discrimination. Il constitue l’une des six commissions de la Fédération internationale des associations d’étudiants en médecine qui constituent l’organe de tous les étudiants en médecine du monde entier. Ses membres sont appelés des SCORangels.
Au sein de L’AHEM, cette commission a vu le jour dès la naissance de l’Association et devient actif au sein de l’IFMSA en 2014. La commission s’implique dans la vie sociale de la population haïtienne. Elle a su éduquer, former, aider différentes couches de la société par ses campagnes, journées de formation, journées de sensibilisation, cliniques mobiles, etc... ayant parfois des partenariats avec l’UNFPA, OHMASS, GSCC.
Par exemple : SCORA a organisé une formation sur différents types de cancers atteignant sa sphère d’intervention à savoir le sein, la prostate et le col de l’utérus. Cette activité s’est tenue à la Mission Église des Frères Unis en Christ à delmas 33.
SCORA a organisé une sensibilisation à l’hopital St .Luc.
«Ce fut une Sensibilisation sur le cancer où nous avons enseigné aux malades atteints de cancer comment manger et quoi manger et aux parents des malades, comment apporter leur soutien aux malades. Pour finir la journee on a distribué des corbeilles de fruits!»

38
Publicités
Samysan de mon nom SAMuel Y SANon, est une entreprise évoluant actuellement dans le domaine de la photographie uniquement.

Vision:
Notre vision est de se faire une identité visuelle originale reconnue internationalement et de pouvoir offrir des service de qualité adaptés aux différents genres et goûts sans limitations, pour toutes occasions et partout dans le monde selon une horaire définie sur toute l’année.
Mission:
Immortaliser chaque moment fort de la vie d’une personne ou d’une communauté, que ce soit lors d’une célébration, ou pour se faire un souvenir de son apparence à un moment de sa vie.
Pour plus d’informations: diasmys@icloud.com (+509) 4062-4240
Instagram: @dr.samysan

39
Actu


Mardoché DAMELUS
L’aînéd’une famille de deux enfants, il a fait ses études préscolaires et primaires à l’Ecole Notre Dame de l’Assomption et il a poursuivi ses études fondamentales au Petit Séminaire Collège Saint Martial. Il a achevé ses études au Collège Etzer Vilaire jusqu’en classe de Philo. Dès son enfance, il commence à développer un amour pour l’art. Il a commencé à jouer de la musique dans une église et a continué à pratiquer la musique à l’Ecole de Musique Augustin Bruno. En classe de 3e secondaire, son professeur de littérature, Mr Frantz JACQUES l’encourageait à écrire après avoir remporté le 2e prix des meilleures nouvelles de sa promotion. Il développait le sens de leadership depuis l’école classique où il a occupé divers fonctions (de secrétaire à président de sa promotion). Après ses études Classique, il a intégré l’école de médecine et est actuellement en 4e année à l’Université Lumière.

41
Le droit à la santé, un droit à reconstituer en Haïti
Peu
considéré, des choses normalement qui devraient être placées au premier rang s’effondrent jusqu’à laisser apercevoir dans l’opinion qu’elles sont en pleine disparition.
Dans toute société ces éléments sont fondamentaux au niveau basal de leur construction et même pour l’après, la santé en est un.
Loin de la perception de la grande majorité, les questions de santé sont profondes et elles sont situées au centre de grandes perspectives politiques et sociales. D’ailleurs, selon la déclaration universelle des droits de l’homme, la santé est déclarée comme un droit et elle a toute son importance au niveau de l’association médicale mondiale.
Visiblement, même les moins avisés sont en mesure de comprendre que nous avons un système de santé qui se détériore. Qu’est-ce qui pourrait en être la cause? Qui doit se décharger de cette détérioration?
En Haïti, la plupart des gens sont mal informés et certains ne reconnaissent même pas que l’accès à des soins de santé n’est pas une faveur. Une autre catégorie peu avisée pense que les approches sanitaires sont simples et ont pour imagination une simple affaire qui se règle dans un milieu hospitalier, sans faire considération de son
fameux aspect promotionnel à travers les démarches de la santé communautaire qui faciliteraient ceux qui ont la responsabilité de faire valoir la santé comme droit en impliquant la population comme acteurs, l’ensemble de ces problématiques incide directement sur l’un des droits de l’être humain en Haïti, son droit à la santé.
Du côté de ceux qui ont une haute capacité de réflexion, ils ne cessent de moucharder l’effondrement de ce système qui devient beaucoup plus important par le fait que les politiques ne font pas de son amélioration l’objet d’un devoir politique, et au fur et à mesure sa considération comme droit n’est plus.
Dans les plus grandes sociétés le débat est différent et se déroule assez souvent autour de certaines questions soulevées par le comité d’éthique de l’AMM qui attribue les considérations de race, d’origine ethnique, de religion, de statut social, d’hospitalisation de ceux qui souffrent des troubles mentaux (quand ces derniers sont en mesure de prendre des décisions), etc... Comme des problématiques de l’éthique qui entravent ce droit.
Selon l’OMS, la vulnérabilité par rapport à l’accès aux soins de santé est beaucoup plus remarquable chez les défavorisés. En m’appuyant sur cette approche, je déduis que
c’est valable globalement au sein d’une population se retrouvant dans un pays moins avancé comme le nôtre, avec un niveau plus élevé chez nos plus défavorisés.
C’est encore pire cette violation car il y a certains endroits reculés, où les gens n’ont jamais rencontré un prestataire de soin, tout simplement parce qu’il n’y a pas une politique de santé publique réglementant ces questions.
Le droit à la santé, dans notre société, est un malade à sauver en urgence. Eviter d’aborder de manière superficielle les questions de santé est un signal montrant un abandon de l’amateurisme en cours de lancement.
Références
Association Médicale Mondiale B.P. 63, 01212 Ferney-Voltaire Cedex, Franc Courriel : wma@wma.net fax (+33) 450 40 59 37 Site Internet : www.wma.net
DEFINITIONS DES SIGLES
AMM; Association Médicale Mondiale
OMS; Organisation Mondiale de la Santé
42
Né
un 18 juin, Samuel Yves SANON ,est un photographe amateur, un dessinateur mais aussi un étudiant en médecine en DCEM3 à la faculté de médecine de l’Université d’État d’Haiti(UEH). Optimiste, il est un amant de la vie, de la nature , des neurosciences. Croyant en Dieu et en l’humanité, il aspire à vivre ses rêves pleinement et sans regrets.
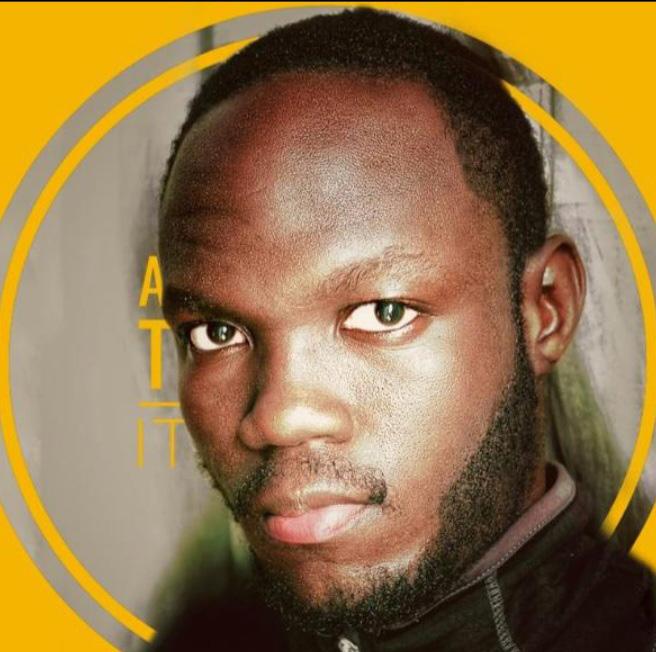
43
«Enchanté!»
Overview
The knowledge of different types of general patterns in how people think and behave and the scientifically proven landmarks discoveries in morphological, structural and functional neuronal network differences associated with social behavioral differences, have helped the concepts of neurodivergent and neurotypical people to emerge. Being aware that Autism is part of neurodivergent people is critical to understand that we’re all part of the same population in diversity, and that we’re unique in our own way to be. Acceptance is key to minimize offences and reduce stigmatization among us and clear the disability idea tied to their person.
Résumé
La connaissance des différents types de schémas généraux sur comment les gens pensent et agissent, et les découvertes scientifiquement prouvées sur les repères morphologiques, structuraux, et fonctionnels des différences de réseaux neuronaux associés aux différents comportements sociaux, ont aidé à l’émergence des concepts de gens neurodivergents et neurotypiques. Être conscient que l’autisme fait partie des neurodivergeants est essentiel pour comprendre que nous faisons tous partie de la même population dans la diversité, et que nous sommes uniques dans notre propre façon d’être. L’acceptation est la clé pour minimiser les offences et réduire la stigmatisation parmi nous et enlever l’idée d’handicap attaché à leur personne.
Rezime
Lè nou vin konnen ke genyen plizyè chema jeneral sou kijan moun reflechi ak aji, ak dekouvèt syantifik sou fòm, estrikti ak fonksyònman sou diferans nan rezo newòn ki asosye ak diferan konpòtman sosyal yo ede pou konsèp moun newodivèjan ak newotipik. Konsyans ke otis la fè pati de newodivèjan yo kapital pou nou konprann ke nou fè pati de yon sèl popilasyon ak divèsite nou e ke nou chak inik nan fason nou ye. Akseptasyon se kle pou n minimize òganis ak redwi stigmatizasyon pami nou epi retire ide de andikap ki atache ak moun yo ye an.
44
Hello
#BlackLivesMatter l’un parmi les nombreux ashtags les plus populaires sur internet, les idées qu’ils véhiculent, comme celles du Féminisme, gagnent du terrain, dirigent la pensée juvénile de la génération actuelle, et signent des protestations contre des abus faits sur des individus qui autrefois étaient sans voix, ou plutôt sans défenses et s’adaptaient aux «normes» et exigences que les plus favorisés profiteraient égoïstement. Alors que chaque activiste cherche à défendre le groupe auquel il.elle appartient, on a tendance à oublier que le vrai souci réside dans les jugements sensoriels, stéréotypés que dans la valeur humaine intrinsèque ellemême des autres. Un féministe comprendra parfaitement : Pourquoi réclamer l’égalité des genres ou mieux une équité entre «eux» et «elles» quand si au prime abord on est conscient de la valeur, ou mieux de la potentialité égale entre «eux et «elles»? Pareil pour les gens d’ethnies, de races différentes, mais qu’en est-il de ceux pour qui leur jugement est remis en question à cause de leur «façon» d’être complètement divergente par rapport à ceux qui normalisent le «social» ?
Laissez-moi vous parler d’un monde, qui très probablement vous serait étrange, inconnu, ou plutôt malheureusement que vous avez ignoré,
dédaigné dans le passé, si vous êtes un «neurotypique». Enchanté !
Bienvenue chez les esprits divergents , ce monde où tout le monde paraît être isolé tandis qu’au fond ils se connaissent l’un l’autre, leur sens d’empathie est a un niveau tel que leur réponse face aux émotions des autres est celle que chacun aimerait qu’on lui réponde, les gens de ce monde aiment ce qu’ils font, ils ont de l’intérêt que pour ce qui les passionnent, ils sont perfectionnistes, prenant soin des plus petits détails, malheureusement, ils aiment voir le bonheur des autres même quand le leur est négligé.
Dans des études en neuropsychiatrie, ils sont vus comme des gens qui s’isolent socialement, ayant des difficultés de communication et d’interaction avec les autres , ce qui peut se comprendre vu que des personnes ne parlant pas le même langage auront certainement des difficultés de communication.
De quoi s’agit-il au juste ? Est-ce une maladie ? Un trouble psychologique ? Un trouble psychiatrique, psychomoteur? Un handicap ? Un retard mental? Une anomalie développementale ? De quoi en est-il réellement ce problème avec ces gens «associaux» ? Beaucoup se sont mis à se faire une réponse en «étudiant» le comportement des enfants différents
du reste des autres, les neurodivergeants , associant leur attitudes et aptitudes à des profils morphologiques, topographiques et structuraux neuronaux en comparaison à d’autres profils qualifiés de «normaux» , les neurotypes. Finalement on est parvenu au syndrome d’Asperger, décrit dans le manuel des psychiatres. Comme conséquence, pendant des années on a cherché à «guérir» par des thérapies expérimentales pour «socialiser» les autistes, plutôt que «d’éduquer» les deux partis, les autistes et les non autistes, à s’entendre mutuellement dès leur plus jeune âge. Et alors? L’autisme, cette communauté où chacun est jugé pour ce qu’il est et ce qu’il aime faire, est jusqu’à présent une population presque muet au reste du monde, où ceux qui y vivent tentent à tout prix de se faire une place auprès du groupe de son choix qui le nie en se basant sur les normes sociétales favoritistes. Pourquoi un médecin autiste ne peut pas se faire une carrière dans la spécialité de ses aptitudes aisément, naturellement comme le faciliterait la structure médicale pour les non autistes? Pourquoi à des entreprises égales doiton multiplier les efforts des autres par mille pour avoir les mêmes résultats qu’eux ? Devons-nous nous
45
séparer «réellement» des autres et créer notre propre environnement pour qu’enfin on nous comprenne et qu’on nous prenne comme on est et pour ce qu’on est? ou doiton attendre l’arrivée d’un nouveau ashtag de lutte pour nous faire entendre et prendre des mesures d’adaptation pour nous faire une place dans ce monde où nous sommes censés servir pour le bien commun de tous?
This framework was created by autists and other neurodiverse people at https://www. divergentminds.org/ to help others like them
Autism spectrum disorder (ASD) is a developmental disability caused by differences in the brain. People with ASD often have problems with social communication and interaction, and restricted or repetitive behaviors or interests
Pardo CA, Eberhart CG. The neurobiology of autism. Brain Pathol. 2007;17(4):434447. doi:10.1111/j.17503639.2007.00102.x
New Genetic Driver of Autism
and Other Developmental Disorders Identified A new mouse study identifies the Necdin (Ndn) gene as a causal factor of autism with 15q11-q13 chromosomal abnormality. https:// neurosciencenews.com/asd-ndngene-18888/
What’s the difference between neurodivergence and neurodiverse? https://tinyurl.com/m3bpvb7v
Some Autism Spectrum Disorder Symptoms Linked to 4the effects of transcranial photobiomodulation on children with ASD : https://www. mdpi.com/2227-9067/9/5/755/htm
Vous êtes un parent d’un enfant autiste ? Commencez ici : https:// www.instagram.com/p/
46
Divers


Né
un 18 juin, Samuel Yves SANON ,est un photographe amateur, un dessinateur mais aussi un étudiant en médecine en DCEM3 à la faculté de médecine de l’Université d’État d’Haiti(UEH). Optimiste, il est un amant de la vie, de la nature , des neurosciences. Croyant en Dieu et en l’humanité, il aspire à vivre ses rêves pleinement et sans regrets.
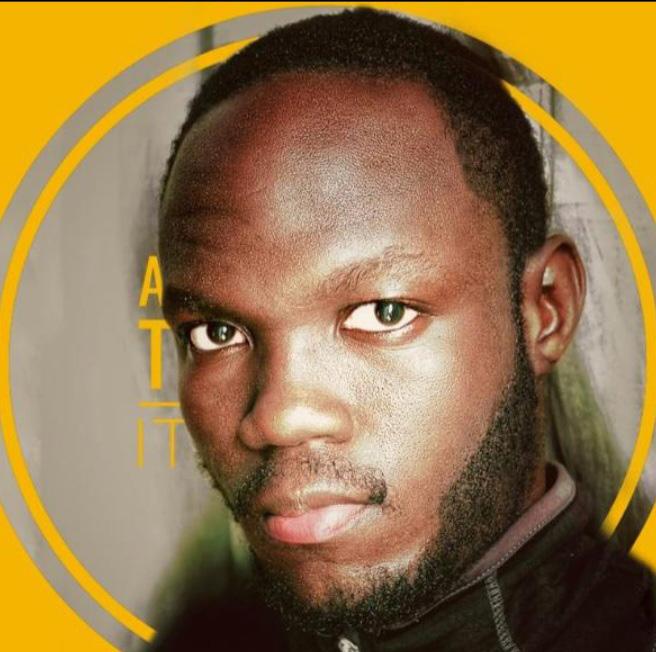
48
FROZEN
Tôt

ce matin-là, il faisait encore froid, le soleil à l’horizon, nous pouvions à peine entendre les gémissements de certains patients. Des portes qui s’ouvrirent et les va-et-vient des parents annoncent le début d’une nouvelle journée de travail au sein de l’HUEH. En orthopédie, nous venions de terminer notre garde et c’est alors que je fus attiré par son regard. Ce dernier plus glacial que le froid de l’aube, plus grand que l’enfant qui le portait sur moi, perçant jusqu’à contraster compassion et empathie de notre quotidien. Car, après avoir aperçu ce bleu dans ses yeux, l’objectif de ma caméra n’a pu garder son calme en apprenant le lien étroit de son père et ses enfants, qui eux ont hérité du gène de leur grandmère. Ainsi, leur conférant un regard froid mais pourtant brûlant, que seule dans l’image nous pourrions comprendre le vécu de cet enfant qui riait silencieusement malgré la souffrance de ses petites sœurs en pédiatrie. Ce monde, tel que décrit par Waardenburg.


Soaya
Rincher LOUIS, née le 18 novembre 2001, âgée de 21 ans, est originaire de l’Artibonite.
Son plus grand rêve, étant de devenir médecin ; elle est actuellement étudiante en médecine en deuxième cycle (DCEM1) à la faculté de médecine et de pharmacie/école de biologie médicale et d’optométrie de l’Université d’ État d’Haïti. Membre de la SCORA de l’association haïtienne des étudiants en médecine (AHEM), elle porte aussi une admiration pour le portrait, la poésie, le maquillage. Elle est une passionnée de l’art.

50
Quand elle est là, on ne sait pas Elle frappe en plein midi mais on ne la voit pas Elle est mère d’insomnie, sœur d’inappétence Elle amène à la folie et génère l’imprudence Elle est celle qui est toujours présente alors que frappe la solitude Au revoir l’euphorie et interdit la béatitude Mais qui est-elle?
Elle noircit les journées et blanchit les nuits Elle rend bizarre et bannit les fous rires Elle nous plonge dans un puits de désespoir Là où flottent que des idées noires On sourit, les gens osent croire que la vie est rose Sans se douter de cette chose Qui tue à petite dose Et qui fait place aux psychoses ! Mais qui est-elle?
Elle a D pour déni du mal être Elle a E pour ennui de l’être Elle a P pour la prostration du moi Elle a R pour la réjection de soi Elle a E pour Être antiraciste Elle a S pour le silence des envies refoulées par la peur L’autre S pour la submersion par les larmes nocturnes Elle a I pour l’indifférence qu’elle crée en se cachant dans les pénombres Elle a O pour l’obscurité dont elle est l’auteur en brisant nos lunes Elle a N pour la nostalgie des désirs d’un vieux cœur en ruine Imprévisible ! Elle est tout ce qu’il y a de plus mortelle, Elle…

ELLE
Publicités
La cellule de Recherche en Bio-Science (CEREBS) est le seul organisme en Haïti, entièrement dédié à la recherche expérimentale, biologique, médicale ainsi qu’à la santé des populations, tout en encourageant le développement d’une culture scientifique. Nos chercheurs ont pour vocation l’étude de toutes les maladies humaines, des plus fréquentes aux plus rares; et du comportement de la population.
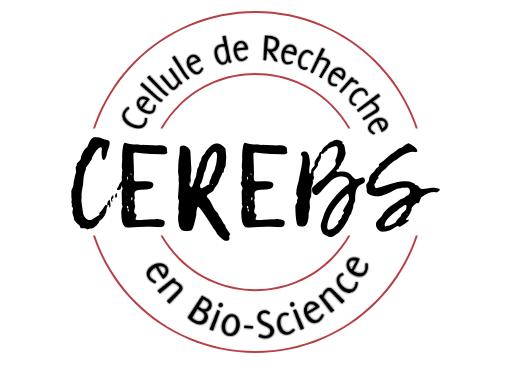
Vision:
-Mettre en exergue des recherches dans l’ensemble des domaines scientifiques et sociétaux.
-Produire du savoir et mettre ce savoir au service de la société.
Mission:
-Produire et diffuser des connaissances scientifiques.
-Concevoir des innovations et des savoir-faire pour la société.
-Participer aux débats scientifiques et sociétaux.
-Former à la recherche et par la recherche,
Pour plus d’informations: cerebs2021@gmail.com (+509) 4310-2769
52
Margdianie
POINT-DU-JOUR, née le 26 octobre 1997 à Port-Au-Prince, est une étudiante finissante en médecine à la faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université Notre Dame d’Haïti. Outre l’univers médical, l’ancienne du Collège Marie-Esther, a toujours porté en elle un amour singulier pour la littérature. Dès son plus jeune âge, l’écriture représentait déjà un passetemps, une passion qu’elle tentait de camoufler. Cependant, parmi ses nombreux écrits non publiés, et sa réticence à participer à des concours littéraires, elle finit par oser et fut la première gagnante de la seconde édition du concours littéraire de Medcriture. Elle est responsable de la rubrique «coin divers» du HAITIAN MEDICAL STUDENT JOURNAL et aussi membre de SCOPH/AHEM.

53
Le néant, le déclin!
9h du soir, le téléphone sonne enfin après maintes tentatives depuis des lustres. De l’aurore au crépuscule, je composais rageusement ces huit chiffres importés de l’abime, car il fallait que je libère de mon sein meurtri ce fardeau âcre qui me ronge au quotidien. Il doit savoir, il doit à tout prix écouter mes syllabes lugubres. Néanmoins, en moi, le scepticisme atteint un lointain apogée. Car, je doute fort qu’il décroche, puisqu’avec lui aucune aura positive ne s’exhale ; point d’assurance, tout a été et continue d’être chaotique et infernal. Ma mère, très modeste commerçante, éleva seule mon petit frère Sergot et moi. Dès notre plus jeune âge, nous l’entendions souvent grommeler à son encontre d’incessants reproches qui se différaient peu à peu au fil des ans. Ils devenaient beaucoup plus obscurs. Quelques-uns s’achevaient parfois par de violents sanglots, d’autres par des torrents de gouttelettes sépulcrales dont, une fois assis sur ses jambes, nous essuyions toujours du revers de mains. Elle nous choyait constamment peu importe le paroxysme de sa peine. Vêtue de la jupe et du pantalon, elle était l’agglomération même du courage et de la bravoure. À onze ans, les notions de mal-être, de désarroi et de déception séjournaient déjà au carrefour de mon subconscient, elles résonnaient assez fort à chaque soupir et chacune des remontrances que ma mère lui adressait. Une mère inconsolable, ça blesse. Enfants, Sergot et moi étions déjà ses victimes mais notre innocence nous rendait presqu’inconscients de cette fâcheuse réalité. Celle, du jeûne involontaire, du sans domicile fixe, du renvoi de l’école pour défaut de paiement, d’une mère lourdement endettée mais par-dessus tout, celle du père absent. Cependant, par un refoulement, nous respirions la joie de vivre jusqu’au jour où j’ai dû après le lycée, arrêter mes études pour aider ma mère à financer celles de Sergot. Ce dernier, quant à lui, perdait souvent des jours de classe pour mettre lui aussi les mains à la pâte. Il n’y a pas si longtemps, nous abandonnions notre nouvel abri sous la contrainte des bandits armés. Deux minuscules pièces situées au cœur de Martissant qu’ils ont affreusement dévalisées puis incendiées.
Alors, hébergés à présent chez un proche, notre incomplète famille tentait de survivre aux déboires, non pas que ceux de la vie, mais aussi les conséquences de ses irresponsabilité et cruauté sans bornes. Et vint un jour sur le chemin de l’école, mon petit frère reçut par un policier voulant disperser une foule en furie et en quête de carburant, un projectile qui ne lui était guère destiné. Il rendit l’âme aux urgences d’un hôpital dénué de matériels, de carburant et de médecins. Anéantie, ma mère remuant ciel et terre pour les obsèques de Sergot, un soir fut enlevée, violée et assassinée en dépit d’une énorme somme impossible de payer. C’est le néant, le déclin. Et voilà qu’une fois décroché, mes larmes jaillissent, je m’écroule et sans lui laisser l’occasion de palabrer, je vocifère : « ÉTAT DE MON PAYS, TU M’AS TOUT PRIS ! »
Margdianie POINT-DU-JOUR
54
Edwine
REMFORT, 26 ans, Léoganaise, est une étudiante en médecine à l’Université Notre Dame d’Haïti. Membre de SCOPH/AHEM, elle est la 2ème gagnante du concours SIDA : zéro discrimination, organisé par la SCORA. Élue Miss ANACAONA de Léogane en 2015, Edwine Remfort est aussi passionnée de l’écriture et a déjà publié en collectif « kase lezo » avec le groupe LAKOU PWEZI.

55
Vide ensoleillé de poussière Rêves incertains Âme meurtrie
Turpitudes incessantes
L’ombre du sentiment d’être mal compris nous hante.
Coincée dans le malaise du silence Des larmes souillent notre quotidien De façon languissante, on est là Et chaque jour d’ailleurs
Esprit engourdi!
Transpercée de part en part, Notre santé mentale, un puzzle sans contours
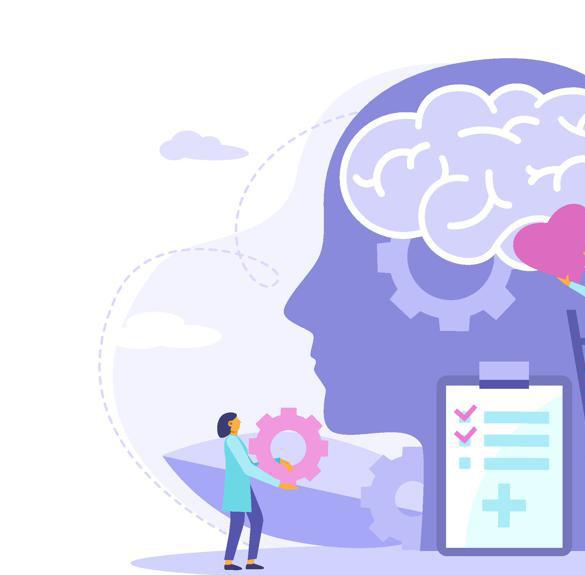
Vide
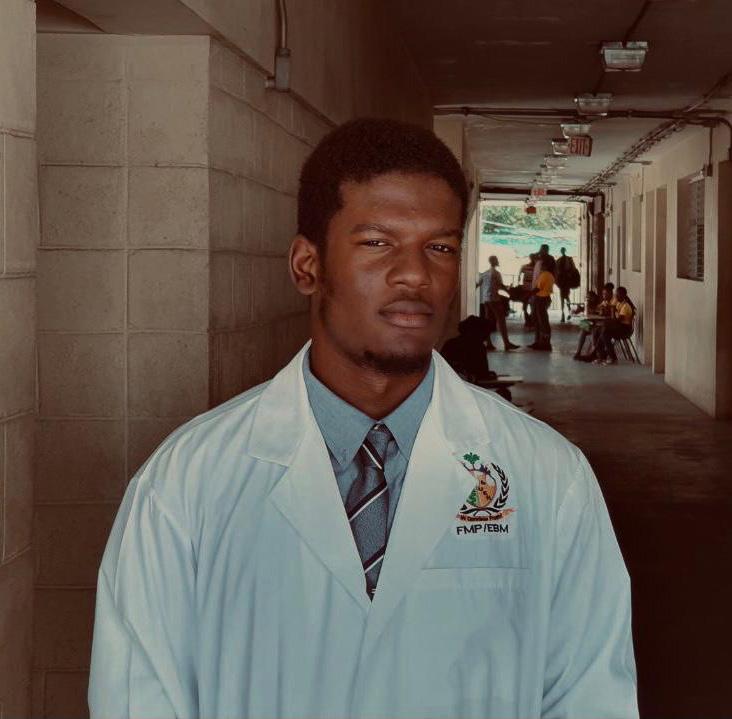






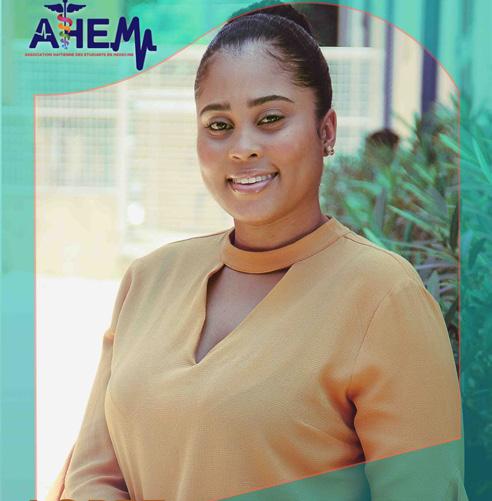

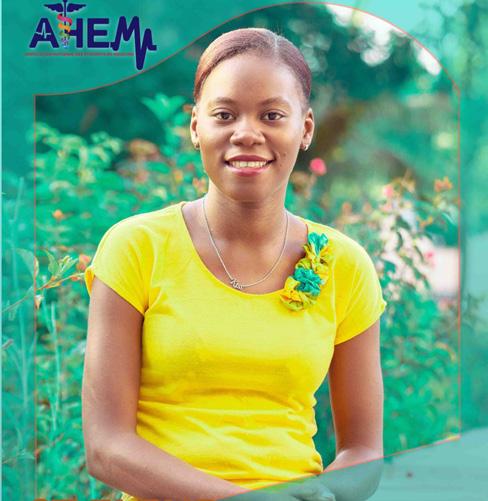
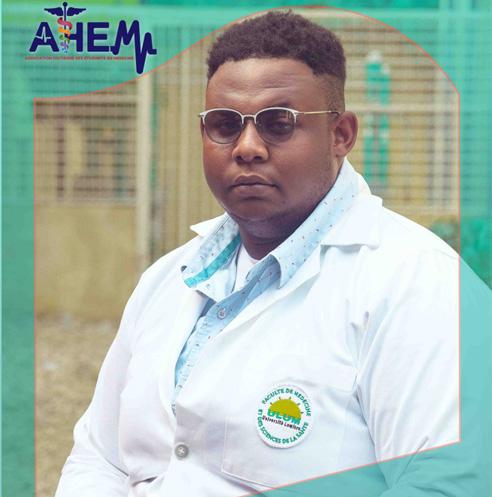
57 Membres du Comité Éxécutif de l`AHEM
Président Neyssa DEMORCY Vice-présidente aux A-E Samantha DUCLET Secrétaire Rhod CONSTANT Trésorier Ludjie L. S. MERILAN Coordonnatrie de SCORE Kervens ST-HILAIRE Coordonnateur de SCOME Danaé NOËL Coordonnatrice de SCOPE Raphaëlla LOPEZ Vice-présidente aux A-I Andersen AUGUSTE Coordonnateur de SCOPH Vanessa ST-FLEUR Coordonnatrice de SCORA Dave LOUISSAINT Coordonnatrice de SCORP
Kevin RAPHAËL

58
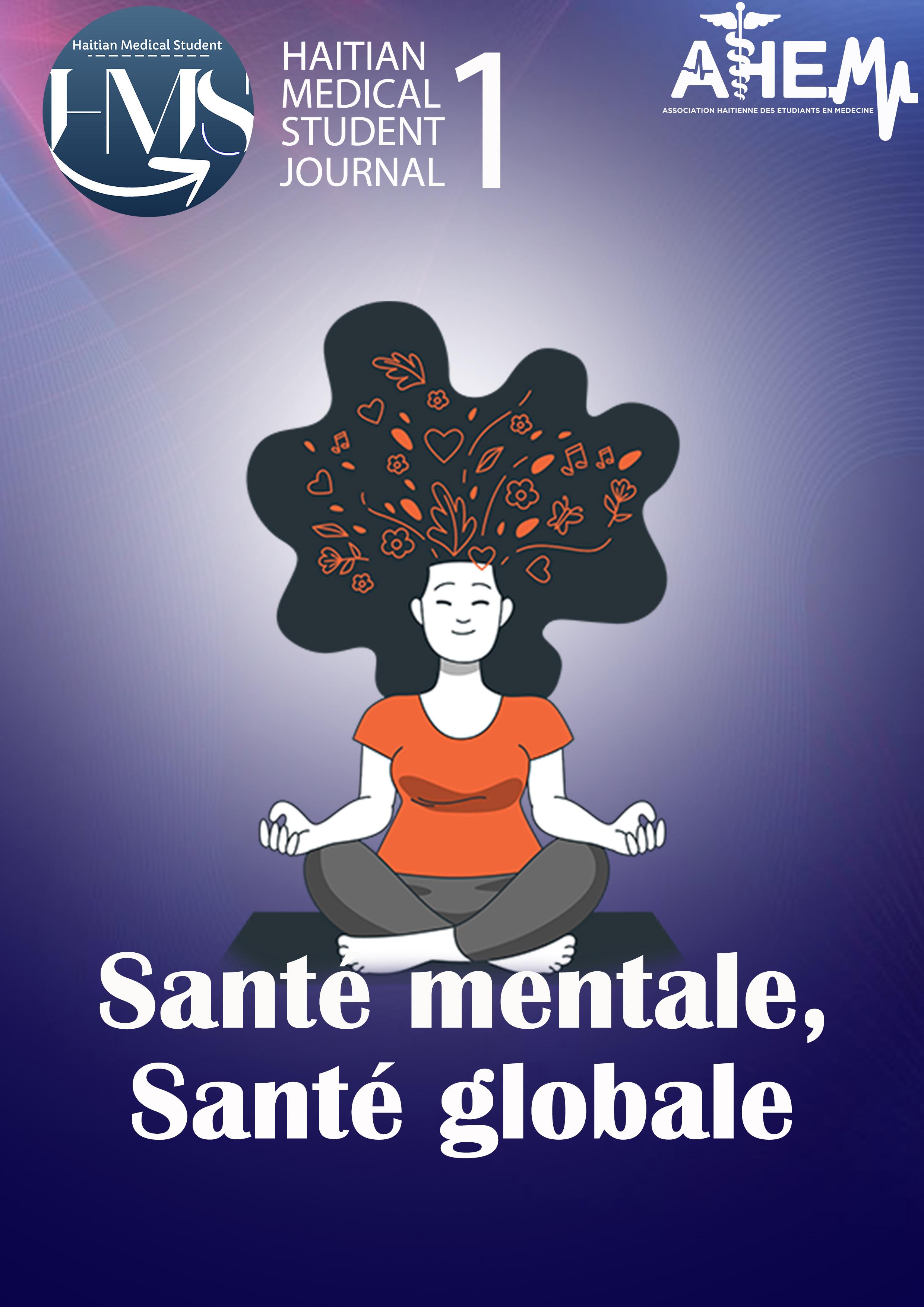
























 Source EMMUS IV OMS/ccsbrief_hti
Source EMMUS IV OMS/ccsbrief_hti