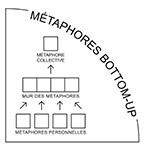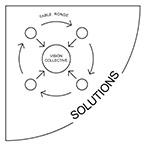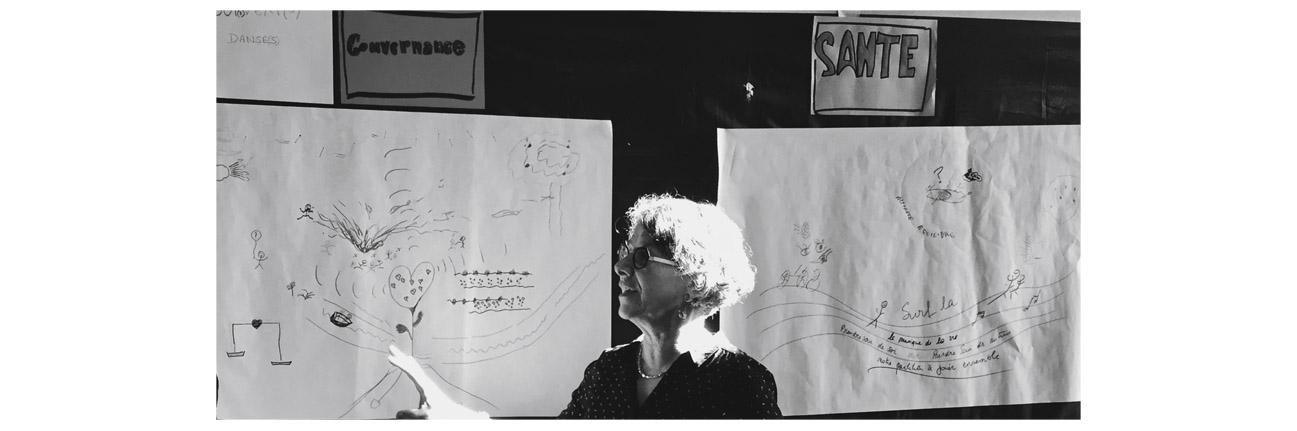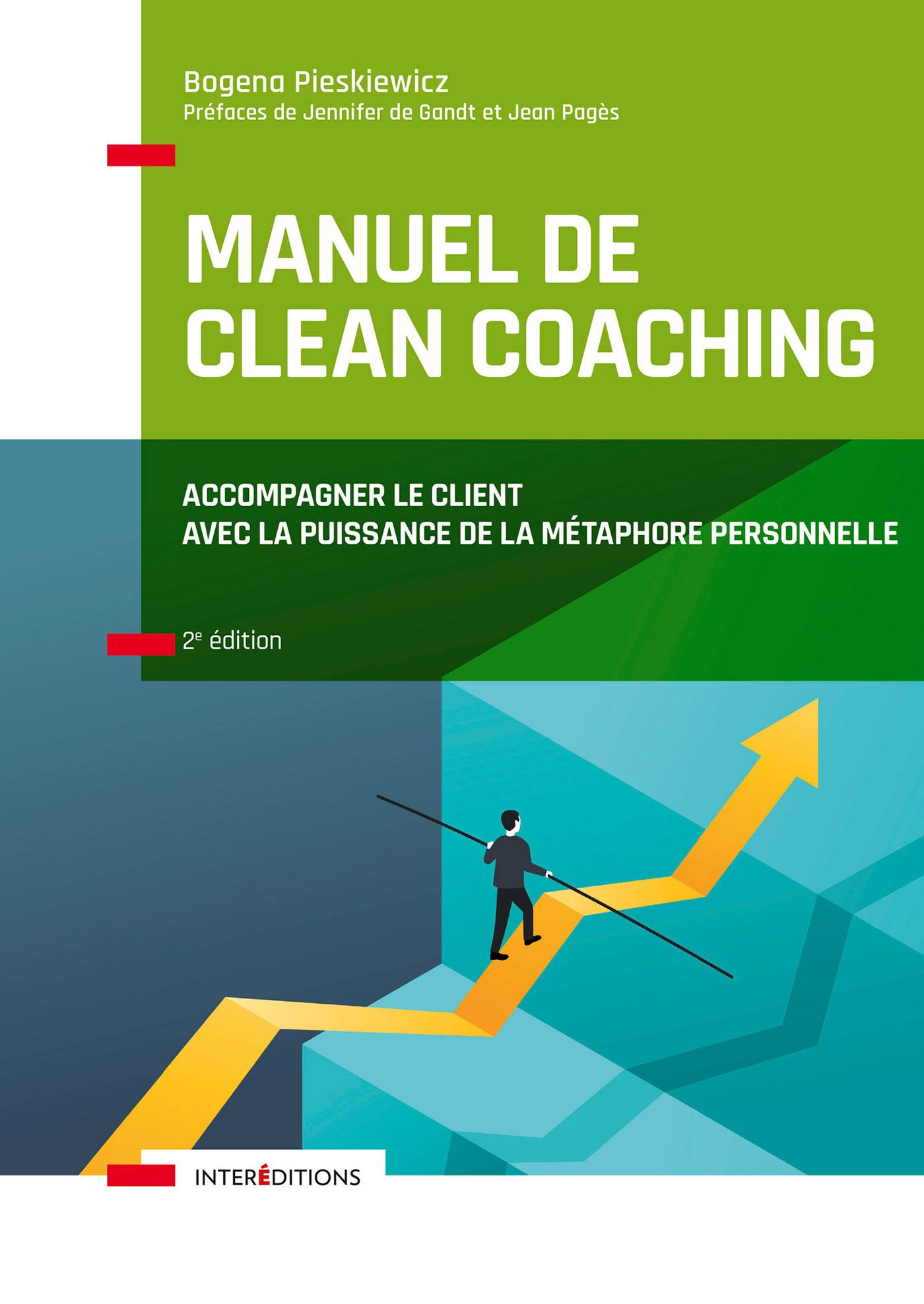
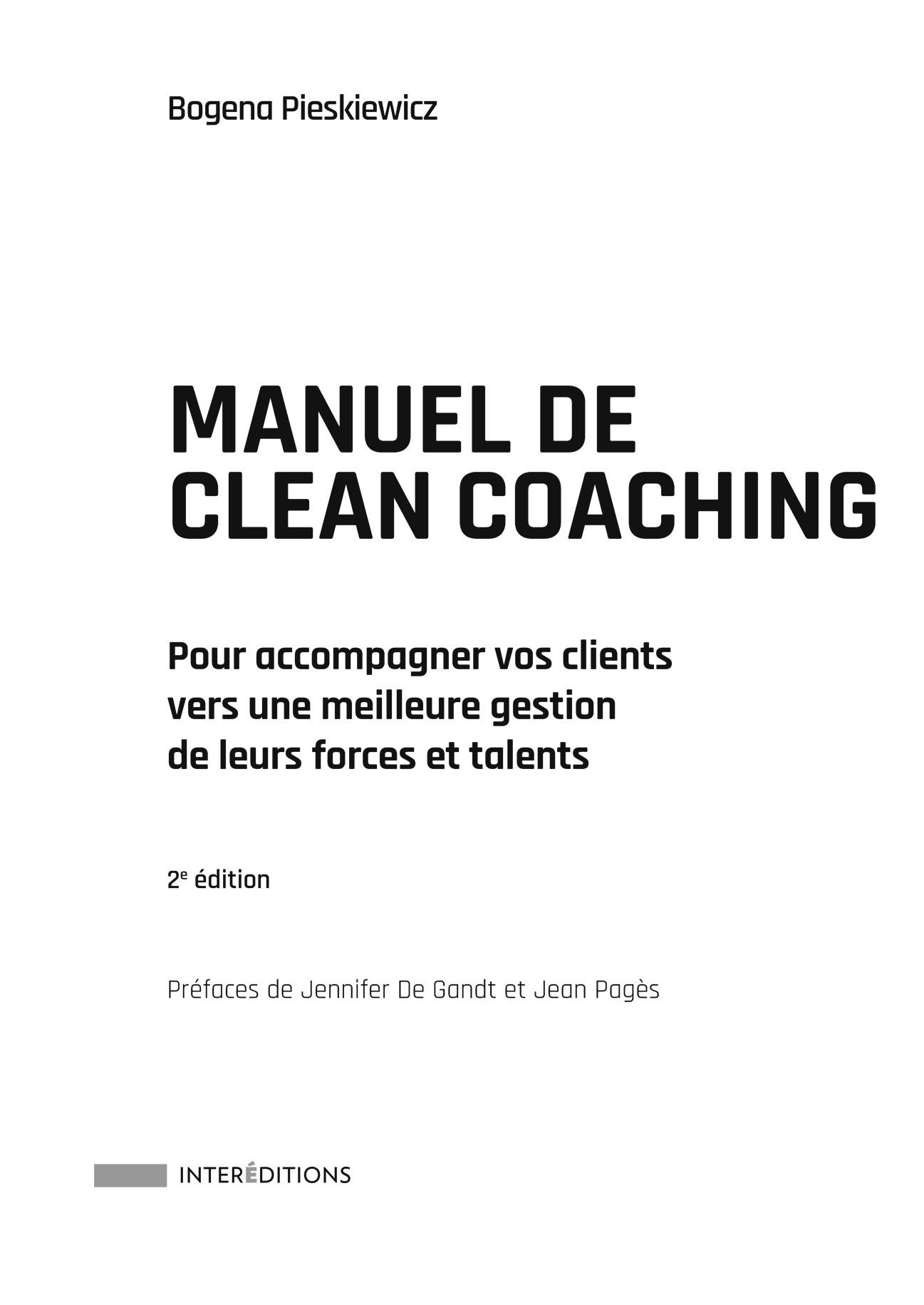
Illustration de couverture : Adobe Stock Création graphique de la couverture : Studio Dunod
© InterÉditions, 2021
InterÉditions est une marque de Dunod Éditeur, 11 rue Paul Bert, 92240 Malakoff
ISBN : 978-2-7296-2243-5
Ce document numérique a été réalisé par PCA
Table des matières
Couverture
Page de titre
Copyright
Préface à la première édition
Préface à la deuxième édition
Introduction - Faire venir à la conscience des intuitions à travers la métaphore
Première partie
POURQUOI LA MÉTAPHORE EN COACHING ?
Ce que l'esprit comprend, il le comprend par assimilation, ou par analogie
L'arrivée du Clean Language en France
David Grove, l'inventeur du Clean Language
Penny Tompkins et James Lawley, modélisateurs de David Grove
Jennifer De Gandt, promotrice de l'approche Clean en France
Après le Clean Language, l'Émergence Cognitive
Les salons d'Emergent Knowledge, des lieux de partage
1. LES SPÉCIFICITÉS DU CLEAN COACHING
Le Clean Coaching : une méthode de coaching basée sur la métaphore
Le Clean Coach, un facilitateur qui s'efface
Un processus où le client apprend par lui-même
La méthode : une alternance entre deux modes de pensées
Une séance de coaching
1. Définir l'objectif de la séance (cerveau gauche)
2. Trouver une métaphore personnelle (cerveau droit)
3 Explorer la métaphore pour trouver des solutions (Cerveau droit)
4 Transformer les solutions métaphoriques en actions (Cerveau Gauche)
La boîte à outils de l'approche Clean
Le Clean Language
La Modélisation Symbolique
Le dessin métaphorique
La Question Sextuple
2. DE LA MÉTAPHORE À LA MÉTAPHORE PERSONNELLE
La métaphore, cette inconnue si connue
La dynamique de la métaphore
Le marché aux métaphores
Le symbole
Les domaines-sources des métaphores
Le langage de la métaphore
Le vocabulaire sensoriel
La synergie Tête-Cœur-Corps
Les mémoires Tête-Cœur-Corps
La métaphore personelle
La métaphore spontanée en conversation
La métaphore spontanée en coaching
3. L'ESPRIT DE LA MÉTAPHORE
L'ingrédient secret de l'amphore : l'analogie
Communiquer par analogie
Se mettre à la place de l'autre
Faciliter l'apprentissage
Passer un message
Innover
Partager sa mission
Trouver une métaphore par analogie
La métaphore conceptuelle
Le concept de bonheur
Le bonheur est-il comme un vitrail multicolore ?
Le bonheur est-il comme une savonnette ?
Le bonheur est-il volatil comme un parfum ?
Le bonheur se laisse-t-il cueillir ?
L'économie du bonheur au Bhoutan
Le dentifrice dans le tube
La météo fait-elle courir un risque au stockage en nuage ?
Écrire un livre c'est comme un voyage
Être architecte d'écriture
Deuxième partie
LE CLEAN LANGUAGE ET LA MODÉLISATION SYMBOLIQUE
La Modélisation Symbolique ouvre un voyage dans le monde intérieur, l'espace individuel des métaphores et symboles
4. LE DIALOGUE AVEC LA MÉTAPHORE
Les questions de base
Exemples de formulation des questions
La dynamique réponse-question
La syntaxe répétitive
Le rythme et la modulation de la voix
Le rythme de la voix suit celui de la pensée (synchronisation)
Les rythmes de la pensée de Guy Claxton Converser avec la métaphore
La posture du facilitateur
Une attitude de neutralité
Un langage sensoriel et incarné
Le principe de minimalisme
5. LA MODÉLISATION SYMBOLIQUE CÔTÉ CLIENT
De la carte mentale à la carte métaphorique
Le Paysage métaphorique
Une séance de modélisation symbolique avec Simon
Définir l'intention de la séance
Trouver la métaphore personnelle
Dessiner le Paysage métaphorique
Chercher la Métaphore systémique
Trouver des solutions métaphoriques
Atterrir
6. LA MODÉLISATION SYMBOLIQUE CÔTÉ FACILITATEUR
Une séance de Modélisation Symbolique
La boussole de la Modélisation Symbolique
L'intention de la séance
Qu'est-ce que le Clean Start ?
Donner l'information
Définir l'objectif
La métaphore personnelle
Développer trois symboles
Zoom sur un symbole
L'auto-modélisation
Le Paysage métaphorique
La métaphore systémique
Les solutions
L'atterrissage
Troisième partie
LE CLEAN COACHING COLLECTIF
7. INTELLIGENCE HUMAINE ET PERFORMANCE COLLECTIVE
Des intelligences différentes
Mesurer l'intelligence : le QI
La révolution cognitiviste
Les étapes du développement
L'intelligence sensori-motrice (0-2 ans)
L'intelligence symbolique (2-6 ans)
L'intelligence métaphorique et linguistique (6-11 ans)
L'intelligence analogique et logico-mathématique (11-16 ans)
La reconnaissance d'intelligences multiples
L'intelligence émotionnelle
L'intelligence sociale
Chez les fourmis
Chez les humains…
La performance collective
L'intelligence collective
8. LA CRÉATIVITÉ PARTICIPATIVE AVEC LA MÉTAPHORE
La communication métaphorique
Le paradoxe de la métaphore
Le souci de l'autre
Les solutions métaphoriques
Les cartes métaphoriques
La vision métaphorique collective
9. LES OUTILS DE LA CRÉATIVITÉ PARTICIPATIVE
Le rôle et l'éthique du facilitateur
La boussole de Clean Coaching collectif
La synergie entre le rationnel et l'imaginaire
L'Intention
Les Métaphores
Les Solutions
L'Atterrissage
Les outils de créativité
Le dessin métaphorique
Le Clean Language en groupe
La Question Sextuple
Une variété d'applications
La vision Présent-Futur
La Table ronde
La vision systémique
La vision collective
Une application hybride : les World Cafés
Conclusion
La métaphore, une matière qui permet l'émergence d'une connaissance de soi, de l'autre et du collectif
Lexique Clean
Bibliographie
Remerciements
Préface à la première édition
C’EST AVEC JOIE QUE J’ÉCRIS LA PRÉFACE POUR CE LIVRE DE BOGENA, œuvre complète sur le Clean Coaching. L’auteure s’est donnée pour mission de transmettre aux lecteurs français le travail de David Grove en Clean Language, Clean Space et Émergence Cognitive, ainsi que celui de Penny Tompkins et James Lawley (la Modélisation Symbolique). Je la remercie sincèrement d’avoir pris très à cœur la nécessité de rédiger en français ce livre, témoin de la manière bien particulière dont Clean a été reçu et développé en France, et qui certainement deviendra pour de longues années un outil indispensable pour nos étudiants en Clean.
Habituellement, lorsqu’une (nouvelle) discipline anglo-saxonne arrive en France, cela nécessite tout d’abord une phase de pénétration profonde des idées suivie par une traduction adaptée à la mentalité et à l’esprit français. Bogena a répondu à cette double tâche de rester fidèle aux idées d’origine (l’origine dans ce cas précis étant la Nouvelle-Zélande et l’Angleterre), tout en étant sensible au mode de pensée et au ressenti du pays qui en fera germer les graines (la France et la Pologne).
Ce livre va aider les étudiants déjà en formation Clean en France, et permettre une approche du sujet à tous ceux qui seront curieux de découvrir ce qu’est Clean avant d’aller plus loin. Vous allez trouver ici des expériences personnelles et des exercices structurés qui vont vous initier au monde de la créativité appliquée à la pratique des coachs et des thérapeutes. Ce livre est destiné à ceux qui sont à la recherche d’un moyen d’accompagner leur client en faisant émerger chez eux leur intelligence intérieure qui alors les guidera. Enfin, vous
allez découvrir aussi le pouvoir, bien connu des Anciens, de la Métaphore mise au service de la Facilitation centrée sur le Client.
Je vous souhaite vraiment de trouver autant de joies et de surprises dans le Clean que Bogena et moi-même.
Jennifer De Gandt
Préface à la deuxième édition
LA PREMIÈRE ÉDITION DU LIVRE DE BOGENA PIESKIEWICZ sur le Clean Coaching montrait la puissance de la pensée métaphorique pour accompagner les personnes vers de nouvelles compréhensions de leurs problématiques et l’émergence de solutions créatives.
Cette seconde édition apporte de nouveaux éclairages sur l’intelligence collective et les ressources du Clean Coaching pour la mobiliser avec bonheur. À l’encontre d’opinions anciennes, la négligeant au profit d’élites ou d’experts, Bogena Pieskiewicz rappelle que les recherches récentes sur les groupes et les organisations démontrent son efficacité pour autant que soient facilitées la variété des points de vue, leur expression libre et leur conjugaison.
L’intelligence collective repose sur l’intelligence sociale, et répond aux aspirations humaines de regroupement et aux bénéfices que chacun peut trouver dans la coopération avec les autres.
Depuis environ quarante ans, les méthodes d’organisation et de facilitation de l’intelligence collective telles que le Forum Ouvert, le World Café ou l’Appreciative Inquiry connaissent une forte popularité dans les organisations et ont démontré leur intérêt pour le traitement de sujets variés. Elles reposent toutes sur la confiance accordée aux individus, à leur intelligence sociale et à leur désir de coopérer pour cheminer vers une vision partagée.
La métaphore constitue une ressource précieuse pour ces approches en tant qu’elles sont non seulement, de fait, constamment présentes dans nos pensées et sous-tendent nos raisonnements,
mais aussi reliées au vivant et créatrices de visions personnelles et collectives.
En effet, les valeurs sous-jacentes aux métaphores individuelles, exprimées dans un groupe, peuvent être partagées et ce partage conduit à l’émergence d’une conscience collective qui permet de visualiser ce que le groupe souhaite de meilleur pour lui-même. Nous sommes là au cœur de la phase « Devenir », ou « Dream », du processus d’exploration appréciative. Elle invite, à partir des réussites et des forces du passé et du présent à rêver le meilleur futur collectif possible.
C’est la démonstration faite par Bogena Pieskiewicz et une équipe de facilitateurs lors du Congrès mondial de l’Appréciative Inquiry (World Apprecitaive Inquiry Conference) à Nice en mars 2019. Les participants ont d’abord été invités à créer individuellement leur propre métaphore d’un « Village Appréciatif », ensuite à la partager en sous-groupes, à rechercher les valeurs qui les réunissaient afin d’élaborer une métaphore commune, dessinée à plusieurs mains. L’expression des métaphores, issues des sous-groupes, a débouché sur un « espace partagé de conscience collective », prélude à l’élaboration d’actions que les participants ont emportées avec eux pour les mettre en œuvre dans leur communauté de vie. C’est ainsi que la métaphore peut non seulement permettre la création de nouveaux possibles, mais aussi de déboucher sur des solutions concrètes.
Comme le soulignaient déjà David Cooperrider et Frank Barrett, « La métaphore générative est une invitation à voir le monde différemment, à faciliter l’acquisition de nouvelles connaissances, à créer de nouveaux scénarios pour des actions futures et dépasser les aires de rigidité. »
Cette nouvelle édition du Manuel de Clean Coaching éclaire et précise l’usage de la métaphore et constitue une précieuse contribution aux processus d’intelligence collective.
Fondateur
Inquiry 1
Jean Pagès
de l’Institut français d’Appreciative
Introduction
Faire venir à la conscience des intuitions à travers la métaphore
Cette deuxième édition s’enrichit du Clean Coaching collectif, une méthode adaptée au monde de l’entreprise qui s’inspire des neurosciences en développant des outils concrets de facilitation métaphorique.
Dans les années 1980, je surfais déjà sur la vague d’une démarche de qualité de vie au travail. Pendant une année, j’ai accompagné en tant qu’animatrice des groupes de volontaires, appelés « cercles de qualité », sur des projets visant l’amélioration de l’accueil du public, de la communication et des relations entre les différentes administrations territoriales au bénéfice des usagers.
À partir de cette opportunité qui m’a été donnée, où j’ai pris le goût d’accompagner les groupes vers une meilleure gestion de leurs forces et talents, j’ai amorcé un virage professionnel. Ayant suivi une formation à la Programmation Neuro-Linguistique, j’en suis devenue formatrice et j’ai commencé à l’enseigner en français, puis en polonais. J’ai découvert ainsi la subjectivité de l’expérience humaine et la complexité dans la communication quand on partage des modèles du monde différents les uns des autres. Au fil des pages, vous aurez l’occasion de découvrir les liens entre la PNL et les outils de Clean Coaching qui s’en inspirent souvent.
Après un Certificat européen en Psychothérapie, j’ai commencé à accueillir des patients au Centre d’Évolution dans le quartier latin de Paris. En tant que thérapeute, je ressentais un inconfort face à leur demande en réparation ! Or, selon les présupposés de la PNL et mon intime conviction, les personnes ne pouvaient être cassées puisqu’elles avaient déjà toutes leurs ressources pour réaliser leurs
objectifs. Entre l’interférence de mon leg paternel – mon père était horloger et réparait des montres – et ma perception de la demande des patients, je ne me sentais pas à l’aise… Je me suis donc tournée vers le coaching, les patients sont devenus des clients et je me suis sentie à ma place. Cette posture s’est confirmée quand j’ai découvert le Clean Language pour accompagner mes clients dans un processus d’exploration personnelle pour y trouver des réponses et des solutions propres à chacun d’eux. Je me suis enfin sentie en phase avec moi-même grâce à l’esprit Clean procurant cette alchimie subtile entre la neutralité bienveillante et la confiance dans le processus et le génie du client.
J’ai eu la chance de participer aux quatre séminaires que David Grove a donné à la Bouvetière en Normandie, entre 2004 et fin 2007. C’est durant cette période que David a développé des liens directs avec Jennifer De Gandt, notre hôtesse et mes compagnons d’apprentissage de la première heure… Anne de Blignières, Sophie de Bryas, Lynn Bullock, Lynne Burney, Silvie de Clerck, Noémie Dehouck, Laure Duthu, Tania Korsak, Nadine Lebeau, Maurice Brasher, Philippe Lemaire. C’est à ce moment-là qu’il nous a encouragés à développer nos propres applications.
David Grove a publié peu et la plupart des ouvrages sont écrits par ceux qui l’avaient connu directement et qui avaient popularisé son savoir-faire ainsi que son savoir être, l’esprit Clean. Après sa disparition en 2008, j’ai pris à cœur de contribuer à faire connaître son génie. L’occasion s’est présenté quand j’ai commencé à enseigner les quatre disciplines : le Clean Language, la Modélisation symbolique, le Clean Space et Emergent Knowledge.
J’ai imaginé ce livre comme un guide où j’accompagne les lecteurs dans la découverte du Clean Coaching individuel et comme une référence pour ancrer la pratique. Cinq ans plus tard, je l’élargis au Clean Coaching collectif.
Cet ouvrage, résolument imprégné de l’esprit Clean, s’inscrit dans la dynamique de transmission. Je vous invite à la découverte de ce nouveau chemin tracé par le Clean Coaching Collectif, où le mouvement des groupes viendra s’enrichir des apports de chaque intelligence avec son allié : la métaphore…
Partie I
POURQUOI LA MÉTAPHORE EN COACHING ?
Ce que l’esprit comprend, il le comprend par assimilation, ou par analogie.
Denis Diderot
1 LES SPÉCIFICITÉS DU CLEAN COACHING
« Le Clean Coaching favorise l’émergence de transformations profondes dans nos systèmes de représentation et dans nos modes de fonctionnement »
Éric Rhodes
L’ARRIVÉE DU CLEAN LANGUAGE EN FRANCE
La découverte du Clean Language a transformé mes pratiques professionnelles dans le coaching. Et pas seulement les miennes. En effet, cette approche a également bouleversé celles des autres membres de la communauté qui s’est constituée autour de Jennifer De Gandt. À l’origine de notre histoire : un homme, David Grove, et une femme, Jennifer De Gandt. Le premier est à la source de la méthode, la seconde est l’initiatrice de sa diffusion en France.
David Grove, l’inventeur du Clean Language
Psychothérapeute néo-zélandais, David Grove pratique aux ÉtatsUnis dans les années 1980 et développe des méthodes cliniques pour résoudre les souvenirs traumatiques. Il travaille avec les victimes de violences (abus, viols, incestes) et s’intéresse également
1
aux traumas des vétérans de la guerre du Vietnam. Il repère que ses patients utilisent spontanément la métaphore. Celle-ci traduit leurs ressentis et la façon qu’ils représentent ce qui leur est arrivé. Pour l’exprimer, lorsque les patients n’ont pas de mots, la métaphore leur redonne la parole.
Il expérimente alors une approche unique : il poursuit la conversation sur le même mode et ne cherche pas à interpréter ni à proposer sa propre métaphore. Il veille à ne pas contaminer la représentation de la réalité du patient en respectant ses mots avec la plus grande exactitude. Pour lui, même les silences doivent être accueillis car ils font partie de la pensée inconsciente du patient d’où émergent les éléments de la métaphore sous forme d’images, de paroles, de réminiscences… Ce souci de rester neutre est à l’origine de l’appellation de la technique de questionnement qu’il emploie : le Clean Language.
Penny Tompkins et James Lawley, modélisateurs de David Grove
Les résultats hors du commun de David Grove et sa renommée de psychothérapeute innovant attirent l’attention de l’Américaine Penny Tompkins et du Britannique James Lawley. Couple dans la vie, ils sont tous deux enseignants en Programmation Neuro-Linguistique (PNL). Ils proposent à David Grove, sur le modèle de la PNL, de transformer sa compétence intuitive en méthode qui puisse être enseignée. David accepte la proposition en posant comme condition l’interdiction de le questionner sur ce qu’il fait.
Pour étudier son approche, Penny et James deviennent à tour de rôle patients et élèves. Ils mettent à plat et formalisent la manière dont David Grove conduit la séance en utilisant la métaphore personnelle du patient. Ils partent de sa façon de faire pour bâtir une méthode qu’ils baptisent Modélisation Symbolique. Le résultat de cette modélisation fera l’objet d’un livre qu’ils publieront en 2000 à compte d’auteurs. Son titre : « Metaphors in Mind – Transformation through Symbolic Modelling » 2
Jennifer De Gandt, promotrice de l’approche Clean en France
Le Clean Language et la Modélisation Symbolique vont être introduits en France à l’initiative de Jennifer De Gandt : professeur d’anglais à travers le monde, elle devient, dans les années 1980, enseignante en Programmation Neuro-Linguistique et crée NLP Sans Frontières. Elle est aussi une des premières à appliquer cette méthode au monde de l’entreprise. En 1995, en Angleterre, elle rencontre David Grove et se passionne pour son approche originale. Quand elle fait la connaissance de Penny et James en 1996, elle suit leur formation et leur propose de dispenser celle-ci en France. Ce projet prendra quelque temps à voir le jour. La première étape est franchie quand Penny Tompkins et James Lawley présentent le Clean Language lors du congrès de la PNL à Paris en 2001. À partir de cette date, Jennifer De Gandt devient le pivot du développement du Clean en France.
Depuis cette date, et pendant une dizaine d’années, elle organise des séminaires didactiques animés par Penny et James à la Bouvetière en Normandie. Je n’en ai manqué aucun. Au début de l’été, Jennifer réunit des praticiens et des clients bénévoles pour des sessions de supervision qu’elle assure avec Penny et James. Ces sessions permettront par la suite de délivrer les certifications de facilitateurs en Clean Process, la première ayant lieu en 2007.
Par ailleurs à Paris, Jennifer accueille chaque mois des personnes qui désirent pratiquer. J’y apprends par immersion, étant à tour de rôle coach et client. Elle instaure ainsi une régularité qui se poursuit encore aujourd’hui. Autour d’elle, chacun de nous développe un sentiment d’appartenance à un réseau dédié à la pratique et à la diffusion du Clean. C’est ainsi que naît naturellement le Réseau Clean en France (www.cleanlanguage.fr).
Après le Clean Language, l’Émergence Cognitive…
Pendant ce temps, David Grove est déjà plus loin dans sa recherche permanente pour tisser les ponts entre les sciences et la psyché. Il
se passionne pour les théories de systèmes et les recherches en réseaux sociaux. Il développe ainsi une série de protocoles inspirés par les sciences, mais aussi par les traditions de guérison de la Grèce antique et de whakapapa maori. Il s’inspire par exemple de la théorie du système des vivants qui ont une capacité d’autoadaptation en fonction du milieu. Il pose l’espace comme milieu d’exploration de la pensée inconsciente. Le client s’y déplace physiquement pour revisiter son histoire personnelle. Il l’appelle le Clean Space.
L’ensemble de ces protocoles post-Clean Language portent le nom d’Émergence Cognitive (Emergent Knowledge).
L’Émergence Cognitive désigne le processus de prise de conscience où, dans la verticalité de la pensée, l’inconscient cognitif et le conscient se rencontrent.
Les salons d’Emergent Knowledge, des lieux de partage
En novembre 2004, David Grove nous livre ses inspirations. Il invente la formule de Salon EK (Emergent Knowlegde) à la Bouvetière, un lieu de partage où il présente ses recherches en cours et offre aux participants la possibilité de les expérimenter. Lors du dernier séminaire, il crée même un protocole qui va être déterminant pour moi. Il va transformer mon rêve en réalité.
Au cours de celui-ci, je matérialise mon projet sous forme d’un collage, pour illustrer les sources de mes motivations et leur origine familiale. On y voit, un à un, tous les éléments de ma lignée, marquée par la Seconde Guerre mondiale, ma quête de faire des choses pour apporter la paix, mes différentes étapes de vie, mon identité, tout ce qui donne le sens à mon projet. J’annonce mon intention de transmettre l’approche Clean dans mon pays et ma langue d’origine. Quand je prends l’engagement
d’enseigner le
Clean Coaching dans le pays de mes ancêtres, David Grove propose de m’y soutenir par sa présence. Nous prenons date pour organiser deux premiers séminaires en 2008 à Varsovie.
3
Cette posture de David Grove de permettre que les choses arrivent juste par sa présence m’a toujours impressionnée, et aujourd’hui je tends à la faire mienne. Même si les deux séminaires, programmés en Pologne, n’auront malheureusement pas eu lieu. Le 7 janvier 2008, David Grove s’éteint alors qu’il met au point un protocole d’auto-modélisation assistée par e-learning qui porte le nom de Card-I-act.
Vous l’avez compris, la philosophie de cet homme m’inspire encore très fortement aujourd’hui. David connecte la personne à son monde intérieur. Il impulse un processus où chacun apprend, à son rythme, dans un va-et-vient d’informations qui émerge de son for intérieur. J’ai pu vivre les changements qui s’opéraient en moi et être témoin de la transformation chez les autres.
Ces expériences ont conforté ma vision de l’être humain comme un être complet, tel un système vivant qui apprend et se développe tout au long de son existence. Le potentiel de changement est infini. J’adopte alors définitivement comme mode d’accompagnement le Clean Coaching.
LE CLEAN COACHING : UNE MÉTHODE DE COACHING BASÉE SUR LA MÉTAPHORE
Le mot coacher vient du français « le cocher » qui désigne le conducteur d’une voiture, tirée par un ou plusieurs chevaux. Le cocher est celui qui conduit l’attelage pour amener son client à sa destination. Puis le terme a été utilisé pour désigner l’entraîneur sportif, le coach sportif. Par extension, le coach et le coaching ont ensuite intégré la sphère professionnelle et personnelle pour accompagner les clients dans la réalisation de leurs objectifs.
Le coaching professionnel est une méthode d’accompagnement ayant pour objectif de générer des énergies, du sens et des solutions propres à chaque coaché.
Cette définition est commune aux différents types de coaching :
• Le cadrage s’effectue sur l’objectif du client, par le biais d’un contrat.
• Le coach part du principe que le client dispose de toutes les ressources nécessaires pour atteindre les résultats qu’il se fixe.
• Le coach suit des règles éthiques et déontologiques : le nonjugement, le respect, la neutralité, la bienveillance.
Le Clean Coach, un facilitateur qui s’efface
En Clean Coaching, le coach adopte la posture de facilitateur qui s’inspire de celle de David Grove. Il sait travailler dans l’instant quand il utilise des questions minimalistes du Clean Language pour connecter le client à son monde intérieur.
Le Clean Coaching est une méthode de coaching où le professionnel privilégie des outils Clean et adopte une posture et l’éthique de Confiance – Neutralité – Acceptation – Minimalisme
Le facilitateur part du présupposé que le client est le mieux placé pour résoudre ses problèmes et trouver ses propres solutions. Il limite alors ses interventions au strict nécessaire, sachant que, plus il devient transparent, plus le client suivra son propre cheminement et meilleur sera le résultat. Il adopte une posture Clean qui signifie neutre et se donne comme ligne de conduite de :
• ne pas chercher à connaître le sens que le client attribue à un symbole ou une métaphore ;
• ne pas contaminer par ses apports, c’est-à-dire ni conseiller ni suggérer ;
• ne pas avoir d’attente quant aux résultats immédiats ;
• faire confiance aux ressources dont dispose le client.
Volontairement effacé, le rôle du facilitateur n’en est pas moins essentiel. Il aide le client à trouver sa métaphore personnelle. Il l’accompagne dans l’exploration de son monde symbolique. Le client
apprend à se connaître à travers ses symboles, à transformer les obstacles en ressources et à trouver ses propres solutions.
Au fil de la transformation de la métaphore, le changement se produit dans la réalité du client.
Un processus où le client apprend par lui-même
D’une manière générale, les métaphores sont des mots ou des images simples pour exprimer des états complexes. Quand la métaphore reflète la perception d’un vécu personnel, donne sa vérité propre ou traduit des sentiments, elle devient « métaphore personnelle ». En Clean Coaching, elle fournit la matière pour explorer le processus de la pensée et permettre au client d’ouvrir une fenêtre sur son monde intérieur.
Quant au facilitateur, il fait confiance au processus. Le client prendra le chemin qui lui appartient et le changement se produira, et ce, uniquement au moment opportun.
La méthode : une alternance entre deux modes de pensées
Mon expérience de thérapeute puis de coach m’a montré que le client a généralement une bonne connaissance de son problème. Dans le domaine où il sait, il raconte le pourquoi du comment il a ce problème, et tout ce qu’il a tenté pour résoudre sa difficulté. Quand il épuise les explications, il se cogne à la limite du je ne sais pas, voire du je ne sais plus. C’est à cet instant que le facilitateur peut proposer un mode opératoire innovant, dans lequel il invite le client à aborder son problème par le biais de la métaphore.
L’intérêt du Clean Coaching est qu’il introduit une alternance entre la pensée logique et rationnelle du cerveau gauche et la pensée métaphorique du cerveau droit.
Dans le contexte professionnel du coaching, l’aspect rationnel sera préservé car le facilitateur fait appel au cerveau gauche pour faire un état des lieux. Il va ensuite progressivement inviter son client à voir sa problématique sous forme d’une métaphore faisant appel
cette fois-ci au cerveau droit Le facilitateur accompagne ainsi son client jusqu’à ce qu’il trouve ses propres réponses. En fin de session il va les intégrer dans un contexte réel, sollicitant de nouveau son cerveau gauche.
Dans une séance de Clean Coaching on retrouve ces quatre séquences :
1. Objectif : définir l’objectif de la séance en faisant appel au cerveau gauche.
2. Métaphore : trouver la métaphore personnelle de l’état présent en sollicitant le cerveau droit.
3. Solutions : explorer la métaphore pour trouver des solutions en faisant appel au cerveau droit.
4. Plan d’action : transformer les solutions métaphoriques en actions concrètes en sollicitant le cerveau gauche.

UNE SÉANCE DE COACHING
Laure fait partie d’une équipe en charge d’un référentiel de normes à déployer dans toutes les unités de production. À la suite d’un entretien annuel, elle s’est engagée à s’impliquer encore davantage
La boussole Clean Coaching
4
dans la motivation de l’équipe pour mener à bien leur projet d’envergure internationale. Elle choisit de se faire accompagner en Clean Coaching et me donne son accord pour utiliser les éléments de sa séance et découvrir comment cela se passe en pratique.
1. Définir l’objectif de la séance (cerveau gauche)
La séance débute par une conversation.
Laure – Mon collègue, Luc, est tout content parce qu’on a publié dans les délais. C’est vrai que l’injonction de la direction est qu’on publie dans les délais quoi qu’il arrive. Pour moi, qu’on publie dans les délais n’est pas suffisant. Je veux également de la qualité. Car mon boulot, c’est avant tout de m’assurer de la qualité de ce qu’on a produit !
Pour définir l’objectif de la séance, je reprends textuellement ses propres mots et je pose la question de manière suivante :
BP – Et qu’on publie dans les délais n’est pas suffisant et tu veux également la qualité, alors qu’aimerais-tu qu’il y arrive ?
Laure – J’aimerais rendre une publication dans les délais, mais aussi une publication de qualité. Oui c’est ça : j’aimerais réussir une publication de qualité dans les délais !
2. Trouver une métaphore personnelle (cerveau droit)
Pour aider Laure à trouver une métaphore personnelle, je résume ce qu’elle vient de dire à propos du problème et son objectif, et demande :
BP – Et tout cela ressemble à quoi ?
Elle se tait comme si elle donnait le temps à la réponse de venir et je respecte ce temps de silence.
Laure – Ce qui me vient à l’esprit, c’est un serrurier qui fait des clefs. Quand, pour être dans les délais, il fournit une clef qui est mal faite, cela n’a pas d’intérêt.
À ce moment, j’invite Laure à dessiner Elle esquisse un trousseau de clefs et une serrure de porte.
3. Explorer la métaphore pour trouver des solutions (Cerveau droit)
Je pose d’autres questions Clean en m’appuyant sur le dessin.
BP – Quand le serrurier fournit une clef qui est mal faite et ne marche pas, qu’est-ce qui se passe ensuite ?
Laure – Le client est furieux. Il estime que ce n’est pas un service professionnel, dit-elle en dessinant un client furieux.
BP – Et quand un service n’est pas professionnel, il y a-t-il autre chose à propos de professionnel ?
Laure – C’est comme si le professionnel donnait au client une clef sans se soucier s’il va pouvoir ouvrir la porte.
BP – Et le client, qu’aimerait-il qu’il arrive ?
Laure – Un service de professionnel, c’est-à-dire avoir une clef qui ouvre sa porte.
Je continue à poser d’autres questions qui suivent la logique de la métaphore :
BP – Et y a-t-il autre chose à propos de la clef ?
Laure – Il faut que la clef soit suffisamment formée… Elle dessine une clef crantée.
BP – Qu’est-ce qui doit se passer pour que la clef soit suffisamment formée ?
Laure – Pour cela il faut deux étapes… La première, c’est tester les dents de la clef pour voir si elles sont bonnes. La deuxième, c’est comprendre que, même si ce n’est pas une clef en multiples exemplaires, on peut la reproduire si nécessaire.
À ce moment-là, je reste une fois de plus silencieuse et laisse Laure savourer sa découverte.
Laure – J’ai compris. Il faut que je puisse démontrer qu’il faut deux étapes.
4. Transformer les solutions métaphoriques en actions (Cerveau Gauche)
Lorsque Laure quitte le langage de la métaphore, je lui rappelle son objectif initial : réussir une publication de qualité dans les délais, et lui propose de noter ce qu’elle sait maintenant à ce propos. Alors elle l’écrit : Ce n’est pas la pression des délais, mais mon exigence de service professionnel qui est en jeu. Je cherche une solution qui concilie les deux.
Pour l’encourager à le traduire en plan d’action, je lui demande quel est le premier pas qu’elle peut faire pour cela. Alors Laure énumère ce qu’elle va faire :
– Primo, il faut tester les dents de la clef pour voir si elles sont bonnes.
– Secundo, ce n’est pas une clef en multiples exemplaires, mais si cela est nécessaire, on peut la reproduire… On pourrait en produire un deuxième exemplaire et l’essayer en usine. J’ai compris et je vais proposer à mes collègues et à ma responsable de travailler en deux étapes.
À la suite de sa séance de coaching, Laure envisage une toute nouvelle stratégie de publication : d’abord tester et déployer le référentiel qualité dans un espace interne au sein de son unité. Si les résultats s’avèrent bons, elle pourra alors démultiplier sa publication sur la plateforme mondiale.
Laure va utiliser la métaphore pour communiquer ses solutions et obtenir l’adhésion de ses collègues. À commencer avec Luc, elle va trouver les mots justes pour qu’il l’entende :
– Écoute, Luc, je suis tout à fait d’accord avec toi sur l’importance des délais ! Mais si on oublie la qualité pour les tenir, alors cela me fait penser à un serrurier à qui on commande une clef. Il la rend dans les délais, mais elle n’ouvre pas la porte. Alors le client n’est pas satisfait car cela
ne lui sert à rien. Ce qu’il veut, c’est une clef opérationnelle dans les délais.
Le Clean Coaching est un processus dynamique. Il se fait non seulement au cours de la séance, mais se poursuit entre les séances. Le facilitateur fait le point au début de la séance suivante pour évaluer la réalisation des objectifs par rapport à la précédente. À cette occasion, le client peut constater que des changements se sont effectués presque à son insu. La problématique a tout simplement disparu. Quand Laure revient sur les bénéfices à la suite de notre séance, elle raconte :
– Avant, j’avais une colère très forte contre mon collègue Luc. Depuis, on s’est réajusté. Nous partageons les mêmes inquiétudes au sujet de l’outil opérationnel qui doit être démultiplié auprès de dizaines de milliers de collaborateurs dans le monde ! Alors, pour préparer notre présentation commune, nous nous sommes mis d’accord sur le fait de tester le référentiel qualité sur une vingtaine d’utilisateurs de l’équipe. Maintenant, on se soutient mutuellement ! En plus, on a une vision commune vers où l’on veut aller.
À chaque séance, le client peut évaluer les résultats à court terme. Mais ce n’est pas tout. Il y a aussi des bénéfices à long terme, lorsque le client s’approprie ses métaphores et s’en sert comme guide dans sa vie personnelle et professionnelle. Nous y reviendrons à la fin du chapitre.
LA BOÎTE À OUTILS DE L’APPROCHE CLEAN
Dans la boîte à outils de facilitateur, il y a une méthode, la Modélisation Symbolique, et plusieurs techniques que nous verrons en détail au fil des chapitres. Voici un aperçu global des outils de base en plus de la Boussole de Clean Coaching : le Clean Language, le dessin métaphorique, la Question Sextuple. Et surtout il y a la métaphore personnelle, la spécificité du Clean Coaching.
Le Clean Language
Le Clean Language est une technique de questionnement inventé par David Grove pour accompagner les clients en thérapie sous forme d’une conversation avec la métaphore personnelle.
Ayant adopté le Clean Language dans ma pratique, je mesure avec le recul son intérêt pour mes clients. Auparavant, je dépensais beaucoup d’énergie pour les aider à quitter les ornières de pensées et de croyances limitantes. Les questions Clean sont peu connues et paraissent inoffensives ; les clients peuvent se détendre et consacrer toute leur énergie à trouver leurs propres solutions en accord avec leur modèle du monde.
Les quatre composantes du Clean Language
✓ Douze questions de base et questions spécialisées.
✓ Syntaxe répétitive et utilisation exacte des mots.
✓ Modulation de la voix.
✓ Dialogue avec la métaphore.
La Modélisation Symbolique
C’est une méthode de facilitation d’un processus où le client crée un modèle métaphorique de son mode de fonctionnement.
Le client trouve une métaphore qui correspond à son besoin du moment. Le facilitateur utilise le Clean Language pour aider le client à explorer sa métaphore et à découvrir des obstacles ignorés, des freins cachés mais aussi des ressources parfois inattendues. Le client apprend qu’un schéma de comportement, illustré par sa métaphore, peut se transformer et lui livrer des éléments de solutions. De métaphoriques, les solutions seront converties en actions concrètes.
Pour l’exemple, souvenez-vous de la solution trouvée par Laure qui a fait le lien entre la fabrication d’une clef sur mesure en deux étapes et la publication d’un référentiel de qualité en deux temps.
Le dessin métaphorique
Le client matérialise sa métaphore personnelle sur un support visuel. Cette technique lui permet de se laisser absorber rapidement dans la pensée inconsciente. Une cliente décrit ainsi ce qui se passe en elle : Quand je parle, je parle avec le Moi qui contrôle. Dès que je fais un dessin, je ne suis plus en contrôle, plus en justification, plus en raison, juste en réponse à des questions…
En dessinant, les clients sont impressionnés par quelque chose qui vient de leur inconscient : j’ai été impressionné quand quelque chose m’est venu à l’esprit, alors j’ai fait un dessin, et puis quand on reboucle, ça prend un sens.
Parfois un client sceptique au départ peut ensuite reconnaître la puissance du dessin en disant : Si on me dit « dessine ! », cela me bloque. Et pourtant dessiner la situation est un outil très puissant. Ma problématique s’est résolue dans le dessin.
La Question Sextuple
Un peu d’histoire avant de vous parler de la Question Sextuple …
5 67
La théorie des « Six degrés de séparation »
Appelée aussi « la théorie des six poignées de main », elle a été énoncée en 1929 par l’écrivain hongrois Frigyes Karinthy . Elle évoque la possibilité que toute personne sur le globe peut être reliée à n’importe quelle autre, au travers d’une chaîne de relations individuelles comprenant aux plus six maillons.
Inspiré par cette théorie, David Grove a réalisé un protocole simplissime qui permet en une seule et même question, répétée six fois, d’arriver à l’essentiel de ce que l’on sait, « la connaissance cognitive ».
La Question Sextuple a des multiples applications et permet de :
• faire un état de lieu ;
• se vider la tête de ses préoccupations ; 2
résumer les acquis d’une séance de coaching ;
• renforcer la confiance en soi et ses capacités à faire face à la vie.
La métaphore personnelle
La métaphore personnelle reflète nos représentations intérieures de soi, des autres et de la vie. En Clean Coaching, elle fournit la matière pour l’auto-modélisation de notre propre mode de fonctionnement. Elle développe l’imaginaire et booste la créativité pour trouver des solutions qui s’accordent avec le système de valeurs et d’identité personnelle.
À titre de témoignage, je vais vous raconter comment la métaphore de nomade m’avait guidée dans ma vie personnelle et professionnelle jusqu’au moment où elle est devenue périmée. Ayant les outils et l’état d’esprit Clean, nous pouvons évoluer grâce à nos métaphores qui se transforment en synergie avec nous.
•
Coach-nomade « kotchovnichka »
On me posait souvent cette question : Selon toi, entre tes deux pays, où préfères-tu vivre à plein temps, en France ou en Pologne ? Je trouvais cette question embarrassante car, pour moi, il n’y avait pas de choix à faire et j’avais l’impression qu’on m’y obligeait par ce questionnement. Elle ravivait chez moi une ambivalence d’identité. Suis-je française d’origine polonaise ou polonaise de citoyenneté française ? Le jour où j’ai réalisé que, de cœur, je suis citoyenne du monde et européenne par choix, la métaphore de nomade s’est imposée à moi En polonais, une nomade se dit Koczowniczka et se prononce (kotchovnitchka ) une Coach-nomade en quelque sorte
Cette métaphore m’avait accompagnée pendant la période où je partageais mon temps entre Paris, ma yourte principale, et Varsovie, Montréal et la Toscane. Pour être légère dans mes déplacements, j’avais adopté le mode de vie nomade pratiquant l’art du minimalisme au quotidien. Mais la métaphore s’est périmée à la suite des évènements qui ont drastiquement limité les voyages et j’ai pris conscience qu’il était temps de trouver une nouvelle métaphore pour me guider dans la Vie liquide , où les conditions d’incertitude constantes deviennent notre quotidien
8 9
2 DE LA MÉTAPHORE À LA MÉTAPHORE PERSONNELLE
« Les métaphores ont une façon de tenir le plus de vérité dans le moindre espace »
Orson Scott Card
LA MÉTAPHORE QUI RÉSIDE AU CŒUR du Clean Coaching est la métaphore personnelle. Mais tout d’abord, qu’est-ce qu’est la métaphore ? Certains clients ont en effet besoin de le savoir. D’autres ont besoin d’être rassurés sur le sérieux de la méthode. Les praticiens gagnent eux aussi en confiance s’ils connaissent les mécanismes du processus métaphorique. Ce livre est le résultat de ma recherche pour comprendre pourquoi la métaphore fonctionne en Clean Coaching. Les deux chapitres à venir, dédiés à la métaphore et à la pensée par analogie en donnent les clefs.
LA MÉTAPHORE, CETTE INCONNUE SI CONNUE
La métaphore est plus qu’une figure de style pour rendre nos conversations expressives. Statistiquement, il a été établi que nous utilisons une expression métaphorique tous les 10 à 25 mots. Il semble en effet que les métaphores mènent une vie secrète à notre
1
insu. La plupart du temps nous n’en sommes pas conscients quand nous faisons appel à elles :
• Dans la pensée, en quête d’une solution : Comment tirer le frein à main avant qu’on aille dans le mur ?
• Dans la communication, pour faire passer un message qui amène à réfléchir. Ainsi Pierre Rabhi nous interpelle : Quelle planète laisserons-nous à nos enfants ? Quels enfants laisserons-nous à notre planète ?
• Dans le langage populaire, les clichés métaphoriques font partie d’un vocabulaire consacré par l’usage. Ainsi, pour dire que le travail est une préoccupation majeure qui empiète sur le reste, on dit avoir le nez dans le guidon.
Les métaphores s’avèrent également omniprésentes sur la place publique. Véhiculées par les médias, elles infiltrent et conditionnent nos opinions au point que nous finissons par y croire : la consommation est le moteur de la croissance. Elles boostent la créativité en inspirant des noms pour des solutions innovantes comme : le stockage en nuage ou la cape spatio-temporelle .
Dans la communication, la métaphore est un moyen puissant pour faire passer un message. L’exemple cité reprend la publicité d’un réseau social dans le sud de la France : Elle s’invite à la machine à café, blêmit votre teint pourtant frais, prend ses aises sur le canapé du salon : la morosité se prend pour une cheftaine, et on ne voit vraiment pas pourquoi on la laisserait faire ! La suite est une invitation à faire place au printemps et aux fleurs, aux rencontres, aux contacts professionnels prometteurs, place aux sourires et à la fête, place à l’humain.
Quand George Lakoff développe, dès les années 1980, sa théorie de la métaphore, il part du présupposé que la métaphore est à la base de notre raisonnement. Il soutient que les métaphores sont présentes à chaque instant de notre vie, orientant notre perception et notre pensée. Selon lui, une observation attentive de notre langage permet de voir que les métaphores structurent notre façon de penser et d’agir. Ainsi, derrière les expressions : son point de vue est indéfendable, mes critiques vont droit au but, il s’est rendu à mes
2 3 4
arguments et nous avons fait la paix… il y a une métaphore qui compare la discussion à la guerre. En fonction de cette métaphore, nous ne nous contentons pas de parler de la discussion en termes guerriers, c’est toute notre attitude d’appréhender la discussion qui en est influencée
La dynamique de la métaphore
Alors qu’est-ce la métaphore ? Essayons de la définir. Le terme « métaphore » vient du grec metapherein qui signifie « transporter ». On perçoit une proximité linguistique avec le mot amphore qui, en Grèce, servait pour transporter et stocker des produits qui n’avaient pas de forme comme des liquides (huile, vin) ou des grains en vrac (blé, orge). Nous retrouvons cet aspect de contenance, où une chose contient une autre chose dans la définition devenue classique de George Lakoff et Marc Johnson.
L’essence d’une métaphore est qu’elle permet de comprendre quelque chose, et d’en faire l’expérience, en termes de quelque chose d’autre
Prenons par exemple cette phrase où un journaliste commente à la télévision les élections en cours de dépouillement : Les choses mijotent et cela sent bon. Une petite phrase qui, par un moyen détourné, permet de saisir quelque chose d’inconnu. Ici, la cuisine sert de support pour illustrer l’opération de décomptage de voix. La logique de la métaphore culinaire nous invite à deviner la suite. Si cela mijote et cela sent bon, alors il suffit de prendre patience pour apprécier le résultat comme on le ferait en attendant de déguster un bon petit plat qui se prépare. On ne connaît pas encore le résultat final, mais l’issue du scrutin semble favorable. La métaphore est une forme de communication indirecte, où le sens du message est mis dans un habillage simple et facile à comprendre.
Pour saisir d’un coup d’œil la dynamique de la métaphore, je vous propose un schéma où le sens du message « inconnu » est rendu explicite par analogie avec quelque chose de « connu ».
5
La métaphore donne à l’inconnu un sens en termes de connu.
Testons ce schéma sur les exemples suivants :

• Le sens de l’engagement peut être expliqué comme une histoire d’animaux qu’on raconte aux enfants : Le cochon dit à la poule : les œufs, pour toi, c’est l’engagement partiel, le bacon, pour moi, c’est l’engagement total.
• Pour dire en quoi une voix est unique, Yvan Cassar compare, lui, la voix d’un ténor, Roberto Alagna à la matière imparfaite : Il peut chanter de manière lyrique ou, carrément, chercher le grain, la cassure, la petite imperfection, cette saleté qui donne l’émotion. Entre la noirceur et la lumière, la puissance et la fragilité, on trouve en lui un mélange tout à fait unique.
En communication, la métaphore est une ressource puissante car elle permet de faire passer un message d’une manière simple, parfois humoristique et surtout, dont on se souvient :
• Pierre de Coubertin est auteur de la devise olympique en termes d’activités humaines : Voir loin, parler franc, agir.
• On trouve également la métaphore dans une incitation au développement personnel : Le plus beau voyage est à l’intérieur de soi.
6
Le marché aux métaphores
À quoi reconnaît-on une métaphore dans le langage courant ? Pour y répondre, nous allons différencier les métaphores explicites, implicites et conceptuelles. Certaines expressions vous mettent sur la piste d’une métaphore explicite : c’est comme si… cela fait penser à… cela ressemble à…
• Cela me fait penser à un dernier train en partance. Si je ne le prends pas, je risque de rester sur le quai.
• J’ai eu l’impression d’écrire avec une kalachnikov, mais j’ai réussi à remettre ma copie à temps.
• La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre (Albert Einstein).
Par contre, dans la métaphore implicite réside une part de mystère. On devine à quoi quelque chose est comparé, mais seules les conséquences sont énoncées. Quand je suis au volant de ma voiture et que la conduite d’un autre automobiliste me paraît particulièrement agressive, je me lance un avertissement intérieur : Attention, c’est un tueur ! Le rapprochement reste implicite entre un automobiliste dont la conduite présente un danger potentiel et quelqu’un qui tue délibérément.
Une autre forme de métaphore implicite est la métaphore conceptuelle, c’est-à-dire une métaphore qui structure notre façon de penser à propos d’un concept abstrait. Prenons par exemple notre rapport au temps pour identifier la métaphore conceptuelle :
• Je suis pressée par le temps signifie : il est sous-entendu que le temps est une machine qui peut compresser comme un rouleau et, pour y échapper, je dois mettre les bouchées doubles.
• Le temps est compté indique que le temps est une ressource qu’il s’agit de gérer au mieux pour ne pas en manquer, voire le rentabiliser pour en faire plus en moins de temps.
• Le temps fuit à toute vitesse et je ne sais pas comment le rattraper implique que le temps est un être vivant qui échappe au contrôle et probablement à la gestion.
La métaphore conceptuelle structure notre rapport au temps, guide le raisonnement et intervient dans la prise de décision.
Le symbole
En Grèce antique, le « symbolon » était un tesson de poterie que l’on cassait à dessein en morceaux pour créer un signe de reconnaissance. En effet, la réunion par un assemblage parfait de deux parties constituait une preuve d’authenticité. Ce système était utilisé lors d’échanges de courrier ou pour valider des contrats.
Le symbole, figure ou image employée comme signe d’une autre chose (Littré).
Le symbole se caractérise par un caractère unitaire car une forme simplifiée représente une idée plus grande :
• Une image de pomme entamée devient le symbole de Apple, le signe distinctif de l’entreprise et de ses produits.
• Le chant de la Marseillaise, devenu l’hymne national, symbolise les valeurs de la République : la laïcité, l’égalité, la fraternité.
• Un geste, faisant un V avec les doigts, symbolise la victoire.
• Un Svastika, symbole de chance ou de nazisme ?
La même image peut avoir deux significations symboliques opposées. Par exemple, le symbole spirituel hindou, une croix aux branches coudées appelée le Svastika, est un symbole de bonne chance. Après transformation en croix gammée il évoque le nazisme.
Dans le langage populaire, il existe des clichés symboliques :
• le plafond de verre, qui désigne un empêchement structurel qui bloque la possibilité d’un avancement professionnel ou social ;
• le nœud d’un problème ;
• la clef de la solution.
Pour distinguer le symbole de la métaphore, je propose la comparaison suivante. La métaphore a une structure analogue à une phrase et le symbole à celle d’un mot. Ainsi Xavier Caumon présente les compétences managériales sous formes de symboles dans une phrase métaphorique :
« Les outils du management sont : le sonar, la longue-vue, le hautparleur et l’oreille qui traîne, la calculette, la burette d’huile, la carotte et le bâton. »
Symboles de compétences managériales
Symboles
Compétences managériales
Le sonar L’écoute active
La longue-vue Une vision à long terme
Le haut-parleur La capacité à communiquer et à se faire entendre
L’oreille qui traîne Capter ce qui se dit de façon informelle
La calculette Valoriser, chiffrer et évaluer
La burette Mettre de l’huile dans les rouages pour éviter des conflits
La carotte et le bâton Féliciter ou sanctionner selon le cas
LES DOMAINES-SOURCES DES MÉTAPHORES
Si l’amphore symbolise l’habillage de la métaphore, alors les éléments dont elle est faite doivent être connus pour la bonne compréhension du message. Comme l’amphore peut être faite de toutes sortes de matériaux : verre, terre, bois ou métal, la métaphore
7
s’inspire des évènements de la vie quotidienne, des expériences de vie, des apprentissages et des connaissances multiples.
Zoltan Kovecses enseigne la psycholinguiste à l’Université de Budapest. Il a compilé des milliers d’ouvrages et transcriptions orales pour constituer un corpus linguistique de métaphores. À partir de cette base il a identifié six domaines-sources qui inspirent la plupart de nos métaphores. J’ai complété la liste en y ajoutant un septième domaine : les Médias. Celui-ci va inclure des actualités, des évènements culturels, sportifs et sociaux, la culture, la littérature, la tradition orale, et les réseaux sociaux…
Domaines-sources des métaphores
1 Êtres vivants : humains, animaux, plantes
2. Corps : physiologie, motricité, maladie…
3 Choses : objets, constructions, artéfacts
4. Activités : comportements, compétences, sports, loisirs…
5. Environnement : espace de vie, nature, voisinage…
6 Physique : lois, énergie, gravité, mouvement, espace
7. Médias : actualité, culture, réseaux sociaux…
Voici quelques exemples, où le choix de la métaphore porte la signature de sa source.
8
Métaphores selon leur domaine-source
Êtres vivants
✓ Le temps est un ami discret, il disparaît quand on n’a pas le temps
✓ Un manager, c’est comme un chien de tête en traîneau, ça entraîne tout le monde.
✓ Je me sens comme une plante qu’on a mise dans un trop petit pot.
Corps
✓ Ma tête me dit non, mais mon corps me dit oui.
✓ Travailler c’est comme suer sous la pluie sans voir les résultats de ses efforts
✓ Le cadavre grandit dans le placard au fur et à mesure que le temps passe.
Choses
✓ Ma batterie est à plat et je ne sais pas comment la recharger.
✓ Je suis comme la Nationale 7, mes pas me mènent toujours vers le Sud
✓ Je fais le pont entre deux cultures, je me mets entre les gens et ils peuvent m’emprunter.
Activités
✓ Se sentir comme un funambule qui avance dans l’obscurité.
✓ La vie est une course et je m’aperçois que la ligne d’arrivée n’est pas très loin
✓ Pour sauter dans la piscine, il ne faut pas rester collé au plongeoir.
Environnement
✓ Le futur se referme en dunes de sable où il est difficile d’avancer.
✓ Le bonheur est comme l’écho, il vous répond mais ne vient pas
✓ Ce n’est pas au milieu de la tempête que l’on change d’équipage.
Physique
✓ J’ai utilisé toute mon énergie pour tenir le stress à distance.
✓ La vérité est comme la lumière, on ne la voit pas mais elle éclaire
✓ Le temps est un phénomène de perspectives
Médias
✓ Je suis plutôt la Cigale que la Fourmi.
✓ Ce projet est une vraie Arlésienne.
✓ L’art social a un côté Grotte de Lascaux, où on arrive à un geste essentiel pour laisser sa trace
LE LANGAGE DE LA MÉTAPHORE
Si vous désirez saisir le langage qu’utilisent les métaphores, amusez-vous à repérer les métaphores en pratiquant une écoute littérale. Vous allez alors remarquer que leur vocabulaire est celui de mots concrets, sensoriels et familiers. Des mots de tous les jours. Pourtant, les métaphores génèrent des images, procurent des émotions, font entendre leur musique. Essayons de lever le mystère sur la manière dont les mots opèrent dans notre esprit pour déclencher une expérience multisensorielle.
Le vocabulaire sensoriel
On entend généralement par concret ce qui existe dans la réalité par opposition à l’abstrait qui est un concept immatériel. Par exemple les termes : un enfant, un chocolat, la pluie, une rue génèrent des représentations visuelles, auditives et kinesthésiques qui correspondent à ce que vous connaissez de votre réalité. À l’inverse, l’abstrait n’est pas déterminé par le réel, mais appartient au monde des idées et concepts comme les compétences, nos valeurs, le temps. Ainsi, le mot chat est concret par opposition à félin qui est un terme conceptuel et désigne une catégorie animale, une famille de carnivores féli-formes.
Prenons par exemple les paroles de Deng Xiaoping, dirigeant chinois, à la tête d’un parti unique au pouvoir : Peu importe que le chat soit gris ou noir pourvu qu’il attrape les souris. Quand vous entendez les mots, dont chacun vous est connu, le chat, la souris,
9
les couleurs le gris et le noir, les verbes d’action attraper les souris, ils génèrent des images, des sonorités dans votre tête et des sensations dans votre corps. Vous avez peut-être dans votre tête l’image d’un chat en train de chasser et vous ressentez un pincement au cœur pour les souris de Tian’anmen. Alors, vous saisissez le message que « la fin justifie les moyens ».
La synergie Tête-Cœur-Corps
Le langage de la métaphore, en associant les mots concrets et sensoriels, crée des ressentis dans le corps, génère des images visuelles et auditives dans la tête, procure des émotions dans le cœur. Lorsqu’on entend une métaphore, celle-ci s’adresse à notre tête et à notre capacité d’imagination. Elle touche notre cœur et notre sensibilité émotionnelle. Elle mobilise la perception sensorielle et motrice de notre corps.
Le langage de la métaphore parle à la tête, au cœur et au corps
La métaphore est une ressource inépuisable en communication interpersonnelle. Elle facilite la compréhension des concepts abstraits, des idées novatrices, des choses inconnues car elle utilise

les termes familiers pour expliquer en peu de mots ce qui est de prime abord inconnu.
En manipulant un vocabulaire concret qui parle à nos cinq sens, la métaphore laisse un impact mémorable qui tient au fait que l’on se souvient plus facilement des images de ressentis émotionnels que d’une explication rationnelle. Parfois humoristique, la métaphore amène à transformer le point de vue de manière spontanée sans rencontrer de résistances. Pour George Lakoff , la métaphore est à la base de notre fonctionnement mental. Selon sa théorie de la métaphore incarnée, la structure métaphorique de notre esprit vient du fait que nous pensons et raisonnons avec notre corps. Ce dont le corps ne peut faire l’expérience est appréhendé à travers des analogies et des métaphores qui constituent le seul moyen de donner sens à des concepts sans réalité tangible.
Les métaphores utilisent le monde sensoriel pour décrire, comprendre et raisonner sur le conceptuel et le rationnel (Jennifer De Gandt)
Prenons pour preuve le vocabulaire d’Internet. Vous ouvrez la boîte aux lettres pour relever le courrier, vous envoyez des messages à des adresses, vous transmettez des documents avec des pièces jointes, vous visitez des sites, vous effectuez des recherches, vous consultez des pages, vous créez des liens, vous naviguez. Des expressions comme surfer sur la Toile, installer un pare-feu, héberger un site sur un serveur, attacher un fichier témoignent d’une transposition de termes concrets et sensoriels à l’innovation technologique en constant développement.
Les mémoires Tête-Cœur-Corps
La théorie de la métaphore incarnée fait appel au présent par rapport à ce que nous vivons. Cependant, elle ne s’arrête pas là puisqu’elle inclut également le passé à travers ce dont le corps se souvient. Le cerveau puise dans les mémoires du corps, du cœur et de la tête, car il ne reconnaît que ce qu’il connaît. Cela implique que,
10
pour comprendre quelque chose de nouveau, il a besoin de s’appuyer sur ce qu’il connaît déjà. Alors, il va explorer les mémoires qui sont de nature différente :
• la mémoire sémantique de la tête : connaissances, apprentissages, informations ;
• la mémoire épisodique du corps : expériences, souvenirs personnels ;
• la mémoire émotionnelle du cœur : évènements associés aux émotions.
La mémoire sémantique et l’intelligence de la tête
Les métaphores regorgent d’associations d’images qui n’existent pas dans la réalité. Néanmoins, à partir d’éléments réels, puisés dans vos mémoires, vous arrivez à imaginer des associations insolites pour saisir un message.
L’imagination a la faculté de combiner des idées et des images pour former des représentations inédites d’objets ou de situations, sans les connaître par expérience.
Prenons par exemple l’expression : utiliser une grue pour soulever un œuf. Votre mental cherche dans sa mémoire sémantique. Si les ingrédients s’y trouvent, un œuf et une grue, alors votre imagination va les assembler pour montrer sur l’écran de votre esprit une image métaphorique. Et en un clin d’œil, vous saisissez le message. Face à la lourdeur de procédures imposées par l’administration, il y a deux attitudes possibles : abandonner tout de suite ou s’armer de patience pour arriver au résultat.
La mémoire épisodique et l’intelligence du corps
Revenons à la métaphore de Deng Xiaoping. Si vous avez déjà rencontré un chat dans votre vie, vous allez en avoir une image qui correspond à votre expérience personnelle selon votre préférence
sensorielle : soit visuelle (image d’un chat), soit auditive (miaulement, ronronnement), soit kinesthésique (la douceur du pelage ou au contraire une réaction allergique aux poils de chat) ou les trois à la fois. Votre corps réagit quand les images se rattachent à des expériences personnelles ou des ressentis universels : respirer, bouger, voir, sentir… tels qu’ils sont évoqués dans les exemples suivants.
Lisez ces phrases et observez la manière dont votre corps répond :
• Le chocolat est non seulement agréable au goût, c’est également un merveilleux baume pour la bouche – la salive qui monte du fond de la gorge, une sensation de douceur.
• Se sentir caressé à rebrousse-poil – une sensation désagréable sur la peau.
• Grincer des dents – la mâchoire qui se serre.
• Se sentir pousser des ailes – une sensation de fourmillement dans le dos et de légèreté dans les jambes.
L’imagerie cérébrale révèle que les mêmes régions sont activées quand on entend doux au toucher comme de la soie que quand on touche réellement un tissu soyeux. Quand vous percevez un changement de température et vous dites j’ai froid, le qualificatif froid est sensoriel car il génère une sensation kinesthésique. Lorsque la perception d’un sens chevauche celle d’un autre sens, on observe un phénomène de synesthésie. Ainsi, la couleur rouge (la vue) donne la sensation du chaud (le ressenti), le crissement d’une lime à ongle sur la vitre (ouïe) donne le frisson (le ressenti) et une sensation désagréable dans les oreilles (le ressenti).
La mémoire émotionnelle et l’intelligence du cœur
Vous venez de comprendre comment votre corps réagit au langage sensoriel de la métaphore. Quand le ressenti corporel perdure, il donne lieu à une émotion, à laquelle vous associez une signification de plaisir, d’irritation ou de désagrément.
Un exemple concret : quand un manager se confie en disant : Je subis une pression d’enfer. On nous presse comme des citrons. La coupe peut déborder très vite car elle n’est plus aussi solide qu’avant…, ses métaphores génèrent des images dans notre tête et des ressentis émotionnels dans le corps. La mémoire émotionnelle nous projette dans une situation analogue, vécue soit personnellement, soit par quelqu’un d’autre et génère un sentiment d’empathie.
L’empathie serait absente à la suite d’une communication factuelle : La direction nous demande de réduire les effectifs tout en maintenant la production au même niveau. Cela augmente la pression sur les équipes car les salariés vivent dans l’angoisse d’être licenciés sans savoir qui sera prochainement concerné.
Vous venez de voir que le langage concret et sensoriel de la métaphore fait appel à nos cinq sens et active les trois intelligences, celle de la tête, du cœur et du corps. Quand un client est coupé de ses émotions, ce qui arrive fréquemment, la métaphore va l’aider à activer et réconcilier toutes ses intelligences. Déjà en cela, elle est un outil de changement.
LA MÉTAPHORE PERSONELLE
Il arrive parfois qu’il nous manque des mots pour dire ce que l’on pense, car c’est trop compliqué… ou ce qu’on ressent car c’est trop imprécis… La métaphore qui se manifeste à ce moment-là devient notre métaphore personnelle.
La métaphore personnelle est une forme visible qui permet de mettre en mots et en images l’indicible de soi .
11
Elle va donner forme à l’indicible de nos représentations intérieures dans un langage familier.
Les trois mondes de notre univers intérieur
✓ Le monde de la tête : état d’esprit, pensées involontaires, voix intérieures, premières impressions, croyances et valeurs.
✓ Le monde du cœur : émotions, sentiments, affinités, appréhensions, intuitions éphémères, sensations de déjà-vu.
✓ Le monde du corps : ressentis physiques, indices faibles, symptômes, gestes et réactions involontaires
Les métaphores sont des miroirs reflétant nos images intérieures de soi, de la vie et des autres (Rubin Battino ).
Il y a les métaphores spontanées et celles qui sont sollicitées par un questionnement du Clean Language. Apprenons à faire la différence pour nous en servir en Clean Coaching.
La métaphore spontanée en conversation
Un soir d’avril, j’écoute la radio et je me laisse captiver par la voix de Hugues de Montalembert , peintre et réalisateur de films documentaires installé à New York, lorsqu’il évoque l’agression à l’acide qui lui a fait perdre la vue. Quand la journaliste fait un commentaire en disant « votre vie a été anéantie », Hugues ne laisse pas passer cette métaphore, qui n’est pas la sienne. Il rectifie : « Non, pas anéantie. Je me suis retrouvé entravé comme un cheval. Alors je me suis demandé comment couper l’entrave. »
La recherche d’un moyen concret de se défaire de l’entrave est devenue son moteur d’action pour apprendre à se déplacer en tant que non-voyant. Dès qu’il est devenu autonome, il a repris ses voyages en solitaire en Asie et s’est reconverti dans l’écriture. Auteur à succès, il continue à sillonner le monde et à donner l’exemple qu’un handicap peut être une source de créativité et de vitalité.
12 13
La métaphore spontanée en coaching
Les métaphores peuvent donc s’inviter spontanément et quand cela se passe lors d’une séance de coaching, j’y suis particulièrement attentive. En effet, elles révèlent souvent la structure du problème et les axes de solutions. Elles livrent des informations et les clefs pour aller à l’essentiel.
Exemples de métaphore spontanée en coaching
– Une cliente exprime sa prise de conscience par rapport au fait qu’elle a été influencée par ses parents dans le choix de carrière dans la fonction publique en ces termes : « Je me suis aperçue que j’étais assise dans un fauteuil que je n’avais pas choisi » Ayant déjà publié quelques romans, elle aspire à se consacrer à sa véritable vocation, l’écriture
– Une jeune commerciale déçoit son employeur par ses performances médiocres en vente de produits financiers. À sa demande, elle entame une démarche de coaching pour améliorer son chiffre d’affaires. Dès le début de l’entretien, elle se confie en plaignant : je suis ou trop requin ou trop assistante sociale. Sa métaphore révèle un conflit de valeurs. Les séances l’amèneront à retourner à son ancien métier d’agent immobilier, où elle proposait à des clients un logement qui leur convenait vraiment
Questions de Clean Language pour trouver la métaphore personnelle : la séance de Félix
Félix vient en séance de coaching avec l’impression que d’avoir déjà tout l’empêche de savoir ce qu’il désire réellement… et il aimerait en savoir plus sur son désir…
D’un naturel enthousiaste, Félix s’exprime avec volubilité et humour, mais ne s’attarde pas sur ce qu’il ressent et pratique une sorte de zapping émotionnel Je vais volontairement utiliser les moyens que nous offre le Clean Langage pour ralentir son débit de parole et l’inviter à tourner son attention vers cet espace au fond de lui où la pensée vagabonde et rencontre les réponses venant de l’inconscient cognitif .
Je vais lui poser seulement quatre questions à propos du mot désir, mais je les accompagne d’une répétition de ses propres mots tout en modulant ma voix À la suite de ce type de guidage, Félix ralentit le débit de paroles, devient plus silencieux et attentif à ce qui se passe dans son for intérieur Il se laisse surprendre par des informations sensorielles qui émergent et réagit en riant, incrédule Si je ne réfléchis pas, ce qui me vient spontanément, le désir, ce serait comme l’enfant qui tire le bas du pantalon de son père ou de la jupe à sa mère et crie « eh, eh, n’oublie pas ! » C’est un enfant jeune et en même temps qui traverses les différentes étapes de la vie… C’est un peu Peter Pan. Comme la métaphore a donné une forme à l’indicible de son désir, Félix sait maintenant quelle ligne de conduite adopter :
Je réalise que mon désir me reconnecte à moi-même et c’est ma vie globale qui s’enrichit et trouve du sens. Avec la métaphore de Peter Pan, je sais accueillir ma légèreté, ma spontanéité, mon impatience comme des qualités et non comme des points faibles. Je vois les avantages que je peux en retirer dans ma vie professionnelle notamment.
La rencontre avec la métaphore personnelle déclenche parfois un processus de connaissance de soi. Si vous adhérez au principe socratique Connais-toi toi-même, alors l’approche Clean est pour vous.
De la métaphore, vous connaissez désormais le décor, je vous amène dans le chapitre suivant vers l’envers de celui-ci et à la découverte de la pensée par analogie qui génère la métaphore.
14
3
L’ESPRIT DE LA MÉTAPHORE
Traiter l’inconnu comme connu définit l’analogie
Emmanuel Sander
L’INGRÉDIENT SECRET DE L’AMPHORE :
L’ANALOGIE
Dans le chapitre précédent, nous avons vu que la métaphore avait une définition à multiples facettes, l’amphore étant une image adaptée en tant que contenant d’un contenu qui reste caché à nos yeux. Mais qu’est-ce qui permet de mettre un tel contenu dans une telle forme d’amphore ? C’est l’analogie, nous dirait Aristote.
L’analogie est une opération mentale qui se fonde sur la perception des similitudes entre les choses ou les idées de natures différentes
Une analogie explicite est une comparaison, tandis qu’une analogie implicite est une métaphore.
L’analogie enrichit le vocabulaire dans toutes les langues. Par exemple en français, la partie basse d’une montagne s’appelle le pied de la montagne, par analogie avec le pied de l’homme. Ce n’est pas la forme du pied de l’homme qui est concernée mais la fonction. Le pied soutient l’homme comme la partie basse soutient la
1
montagne. Une permutation de termes où le pied est mis à la place de la partie basse crée l’expression le pied de la montagne.
Le rapprochement par analogie s’effectue entre deux contextes de nature différente ou entre deux phénomènes distincts :
• Habitat animal et humain : le nid est à l’oiseau ce que la maison est à l’homme.
• Vie et voyage : voyager vers une destination, c’est comme mener la vie vers un but.
• Musique et animaux : la mélodie est un cheval de course, l’harmonie est un cheval de trait .
• Son dans l’air et onde dans l’eau : une onde à la surface de l’eau est comme la propagation du son dans l’air.
Se fonder sur un phénomène visible, familier et bien compris permet de percevoir mentalement le déroulement d’un phénomène qui n’est pas accessible à nos sens : les électrons tournent autour d’un noyau comme les planètes tournent autour du Soleil.
Remarquez la différence de taille entre le système solaire et l’atome. L’analogie s’intéresse à la structure et au fonctionnement au-delà de l’aspect physique : la structure de l’atome ressemble à celle du système solaire.
COMMUNIQUER PAR ANALOGIE
Pour annoncer l’emploi d’une analogie dans la conversation, nous utilisons souvent une des expressions suivantes : cela fait penser à… ; cela ressemble à… ; c’est comme si…
Se mettre à la place de l’autre
2
Perdue dans l’usine à gaz
Veronica vit dans une petite ville en Toscane et fait des traductions à domicile. Elle m’écrit par mail ses dernières nouvelles : Je suis particulièrement fatiguée car les deux dernières semaines ont été consacrées à une traduction juridique Maintenant, c’est pratiquement terminé, mais je perds un temps fou pour la mise en forme du texte Word est devenu une telle usine à gaz que je ne maîtrise plus grand-chose Cela me fait penser à la technique des supermarchés : tu crois savoir où sont les choses, mais comme entre temps tout a été changé de place, tu es obligée de faire tous les rayons.
En empruntant l’image d’un client perdu dans les rayons d’un supermarché, Veronica fait passer un message qui justifie son silence et sollicite l’empathie lorsqu’elle se plaint de ses démêlés avec Word qu’elle qualifie d’usine à gaz J’en déduis que Word est devenu trop complexe par rapport à ses besoins réels. Vous pouvez voir que le sens de l’analogie nous apparaît à la lumière de notre propre expérience. Même si le supermarché que je fréquente à Paris est différent de celui de Toscane où vit Veronica, tous ceux qui ont fait des courses dans un supermarché savent combien c’est agaçant de chercher des produits d’usage courant sans les trouver à leur place habituelle. Il en résulte une perte de temps, de l’agacement, une lassitude et parfois l’envie de tout abandonner.
L’analogie du supermarché non seulement reflète en miroir l’expérience de Veronica, mais elle me permet aussi d’entrer en résonnance avec son impatience, voire son sentiment d’exaspération. L’analogie et la métaphore sont à la source d’une communication empathique et génèrent de la connivence émotionnelle. Le message métaphorique de Veronica me donne envie de l’aider. Je pourrais, par exemple, lui proposer d’imaginer ce qu’elle ferait dans un supermarché où elle ne trouverait pas d’articles à leur place habituelle.
Imaginons les questions que Veronica pourrait se poser :
– Qu’est-ce que je ferais dans un supermarché où tout a été changé de place ? Je pourrais demander à l’accueil où se trouvent maintenant les articles que je cherche.
Ensuite, Veronica peut réfléchir par analogie :
– Si la solution pour le supermarché était de se rendre à l’accueil pour avoir les informations utiles, quelle pourrait être la solution analogue pour trouver les fonctions dont j’ai besoin dans la nouvelle version Word ?
La métaphore permet de prendre du recul par rapport à un problème et, en le transposant dans un contexte familier, trouver facilement des solutions.
– Je peux les trouver sur le site de Word, consulter les FAQ et les opinions des utilisateurs de la nouvelle version ou demander de l’aide en ligne.
Ensuite il est facile de traduire les solutions métaphoriques en actions concrètes dans un contexte réel.
Faciliter l’apprentissage
L’analogie est une simplification efficace pour acquérir de nouvelles connaissances en se servant de connaissances antérieures.
Trouver une chaise ni trop haute ni trop basse
Dans le cadre d’un colloque international, un lieu d’échange de pratiques entre des psychothérapeutes français et des psychologues en formation, à l’université de Hanoi en 2005, j’ai assisté à la présentation d’un programme d’insertion destinées aux personnes âgées, intitulé « Comment vivre longtemps en bonne santé et être utile à la société ».
Faire des choses pour les autres est la source principale de satisfaction et de motivation dans la tradition bouddhiste et s’inscrit dans l’orientation socialiste de la société vietnamienne Pour amener les seniors à l’autonomie, on leur dispense des cours de diététique, d’hygiène, des exercices physiques adaptés à leur âge et leur état de santé.
Les formateurs s’inspirent de la vie quotidienne pour leur apprendre la manière de se fixer des objectifs réalistes afin d’être utiles à leur famille et leur communauté. Par exemple, ils suggèrent de choisir un objectif à la portée de chacun : « c’est comme une chaise ni trop haute ni trop basse, où on peut s’asseoir en toute sécurité »
Le recours à l’analogie remplace une longue explication, apporte une note d’humour, s’inscrit dans le quotidien et facilite l’apprentissage à tout âge !
Passer un message
De même en entreprise, les dirigeants et managers procèdent souvent par analogie. Ils rapprochent des éléments, des univers, des contextes a priori éloignés, ce qui ouvre des horizons inattendus. Par exemple, ils n’hésiteront pas à comparer l’organisation de leur service à celle d’un immeuble, ou encore à faire un parallèle entre un plan commercial et une campagne électorale, entre la gouvernance de l’entreprise et le pilotage d’un avion de ligne.
Innover
Nous créons toujours à partir de ce que nous connaissons déjà. Prenons un exemple en robotique. Pendant des années, on a construit les robots en s’inspirant du fonctionnement de l’être humain ! Ils rencontraient des difficultés à aller dans des endroits exigus ou à angle droit. Les chercheurs italiens se sont alors inspirés de l’intelligence de la pieuvre qui utilise sa morphologie pour capter et analyser les informations par les cellules de chacun de ses nombreux membres. En concevant un robot qui s’inspire du génie de la pieuvre, ils espèrent mettre au point une technologie capable de réaliser des opérations très délicates dans le corps humain.
Partager sa mission
Dans le cadre d’un projet humanitaire, un homme conçoit le projet de relancer la production artisanale de soie au Cambodge, dévasté par des années de guerre et de terreur, en allant chercher des tisseuses dans les campagnes. Il crée un centre d’apprentissage et de production de soieries selon la méthode traditionnelle pour relancer la production de la soie, c’est sa petite pierre. Porteur d’un
projet sociétal, il exprime sa mission sous forme d’un credo : « Je suis comme une petite pierre à laquelle vont s’ajouter d’autres petites pierres pour construire une base solide. »
Penser par analogie
✓ Facilite la compréhension de nouveaux concepts ;
✓ Permet de prendre du recul ;
✓ Inspire des solutions concrètes ;
✓ Allège le discours en le rendant ludique ;
✓ Booste la créativité.
Et pour toutes ces raisons, nous avons tout à gagner à mieux connaître l’analogie, ce moteur d’une pensée créative et innovante.
TROUVER UNE MÉTAPHORE PAR ANALOGIE
Cerveau gauche – Cerveau droit
Paul Broca et Carl Wernicke ont introduit une distinction entre deux hémisphères cérébraux Ned Hermann s’en est inspiré en développant un modèle de deux cerveaux, gauche et droit L’imagerie moderne n’a pas confirmé l’existence physique de cette dualité Elle facilite néanmoins la compréhension de la différence entre les raisonnement rationnel et imaginaire
Pour rendre cette distinction plus ludique, nous allons faire une analogie avec l’Expert et l’Artiste et tester l’hypothèse d’Emmanuel
3
Sander :
La métaphore est un fruit de la coopération entre le cerveau gauche et le cerveau droit.
Le cerveau gauche agit en Expert. Il consulte sa banque de données mémorisées, comprend les choses selon la définition qu’il en a. Il se base sur une analyse factuelle, fait la relation de cause à
effet, ne croit que ce qui correspond à la connaissance qu’il en a. Il appelle un chat, un chat.
Face à la nouveauté, il passe le relais au cerveau droit qui développe une pensée non linéaire et imagine ce qui n’existe pas forcément en réalité à la manière d’un Artiste. Il perçoit des similitudes et rapproche des univers éloignés, en comparant la Terre à une orange bleue, par exemple. Il voit au-delà des apparences, où il identifie des schémas, des relations et des mécanismes de répétition. Il contribue à créer des catégories et des normes pour des choses nouvelles.
Nous observons le même processus dans la génération d’une métaphore, où les capacités du cerveau gauche sont utilisées en synergie avec celles du cerveau droit.
Ikiaqqijuq, voyager à travers le temps et l’espace
Eva Aariak, première ministre du Nunavut (territoire canadien) de 2008 à 2013, a introduit le système Windows en inuit dans son pays et a créé un nouveau vocabulaire pour le système d’exploitation Ainsi pour nommer Internet, elle a inventé le terme ikiaqqijuq qui signifie voyager à travers le temps et l’espace, une allusion à la capacité qu’auraient les chamans à espionner des lieux distants. Pour les Inuits, le nouveau c’est l’Internet, le connu c’est le voyage chamanique.
Pour mieux comprendre le processus, imaginons ce qui se passe dans la tête de quelqu’un comme Eva Aariak, en utilisant la métaphore de l’Expert et de l’Artiste.
L’Expert est le premier à se mettre en marche quand il repère et retient les traits caractéristiques d’Internet :
• des réseaux informatiques interconnectés en un réseau mondial ;
• des informations circulant dans un temps instantané ;
• des services à usage courant : le courrier électronique, les banques de données, le commerce en ligne, etc.
Quand l’Expert passe la main à l’Artiste, celui-ci choisit intuitivement un contexte culturel familier aux Inuits. Ensuite, il teste les ressemblances entre Internet et le monde des chamans dans un
4
mouvement de va-et-vient. Ce qui lui permettra de se poser, in fine, une question implicite qui va générer une métaphore : Et tout cela ressemble à quoi ? La réponse émerge sous forme d’une révélation : C’est comme voyager à travers le temps et l’espace… c’est-à-dire Ikiaqqijuq en inuit !
Le schéma suivant résume ce va-et-vient entre l’Expert et l’Artiste et montre comment leur coopération produit une métaphore par analogie.

Une métaphore conceptuelle : Internet devient
Ikiaqqijuq
Vous avez là un exemple de la manière dont le voyage chamanique devient une métaphore conceptuelle et permet aux Inuits de comprendre Internet. Par analogie avec leur propre culture où les chamans voyagent à travers le temps et l’espace pour trouver des informations, des internautes Inuits sauront s’en inspirer pour surfer sur l’Internet. Ils ne seront pas étonnés de trouver des messages dans leurs boîtes aux lettres, ni de trouver des informations sur le Web. La métaphore ikiaqqijuq, autrement dit voyager à travers l’espace et le temps, imprime sa logique sur la cognition. Elle devient une métaphore conceptuelle dans le système cognitif et linguistique des Inuits.
LA MÉTAPHORE CONCEPTUELLE
George Lakoff , professeur de linguistique cognitive à l’Université de Californie considère que les métaphores sont à la base du sens donné à nos concepts. Il a été le premier à développer la théorie de la métaphore conceptuelle.
5
Ainsi, quand on choisit intuitivement un domaine-source pour générer une métaphore personnelle, on ignore les conséquences sur notre façon de penser. Commençons par mon propre exemple.
L’intuition est comme une mélodie légère
Pour certains, l’intuition est un sentiment fugitif, pour d’autres une pensée qui effleure l’esprit, ou plutôt un ressenti au creux de la gorge, un picotement au niveau du cœur, ou l’estomac qui se resserre. Comme l’intuition est éphémère, on a tendance à ne pas s’y fier en se disant qu’on se trompe peut-être. Mais quand on commence à lui faire confiance, elle se développe et devient une boussole intérieure qui permet de ne pas s’égarer et de trouver son propre chemin
J’ai observé, que pour moi, l’intuition se manifeste selon la logique suivante :
– j’éprouve un ressenti fugitif et subtil ;
– si j’y suis attentive, alors je capte un message qui se précise dans le temps ;
– si je n’y prête pas attention, le ressenti s’atténue et disparaît avec son message.
Pour trouver une métaphore, je relis ma liste et me pose la question suivante :
– Et tout cela ressemble à quoi ?
Je note la réponse et récapitule ce qui se passe dans ma tête :
– L’intuition c’est comme une mélodie discrète qu’on n’entend que si on y prête l’oreille
Intuition
– Un ressenti physique subtil et fugitif
– Si je suis attentive à ce que je ressens…
– Si je ne suis pas attentive à mon ressenti, je ne le perçois plus…
Domaine-source : Musique
– Cela ressemble à une mélodie que l’on capte à peine
– C’est comme si je tendais l’oreille pour mieux l’entendre.
– C’est comme si je n’écoutais pas et le son devient inaudible.
Ma métaphore m’apprend comment je peux développer l’intuition en suivant sa logique. Je vais davantage écouter mon corps pour repérer des indices faibles, comme des notes de musique, pour entendre leur mélodie et deviner le message de mon inconscient.
LE CONCEPT DE BONHEUR
Le bonheur est une idée si indéterminée que, malgré le désir que nous avons d’être heureux, personne ne peut jamais le définir en termes précis. Alors la métaphore peut en donner un aperçu.
Le bonheur est-il comme un vitrail multicolore ?
Pour moi, le bonheur se décline en moments de plaisir au quotidien. Parfois ce sont des choses tellement petites qu’elles peuvent paraître insignifiantes à d’autres personnes, mais elles me procurent un sentiment de bien-être : admirer une première fleur au printemps, recevoir le sourire d’un enfant, faire une balade à deux au bord de la mer, capter un rayon de soleil dans la grisaille du jour… Ainsi, chaque instant de mini-bonheur apparaît comme un petit morceau de verre coloré et tous les morceaux mis ensemble forment un vitrail multicolore.
[SOURCE : CHOSES – Vitrail]
Vous allez voir comment d’autres personnes résument leur philosophie du bonheur par le biais de leur métaphore personnelle. Elle forge leur attitude face au bonheur en les poussant à agir pour le quérir ou les invite à être passif pour l’attendre patiemment…
Le bonheur est-il comme une savonnette ?
J’ai frôlé le bonheur, c’est une véritable savonnette, confie Claude Lelouch sur les ondes de la radio. La difficulté à garder le bonheur est pour lui similaire à la texture de la savonnette qui glisse des mains. En épousant la logique qui régit le monde des savonnettes, nous basculons dans la pensée métaphorique. Pour quelqu’un qui exprime ce point de vue, on peut en déduire qu’il va être actif pour jouir du bonheur, mais aussi il saura s’accommoder de sa perte.
[SOURCE : CHOSES – Savonnette]
Le bonheur est-il volatil comme un parfum ?
Quand je fais du Qi Gong avec les habitants d’origine chinoise dans le 13 arrondissement de Paris, je partage avec eux non seulement leur pratique, mais aussi leur sagesse. Ainsi le bonheur est un parfum que l’on ne peut pas saisir car, comme le parfum est volatil, le bonheur est éphémère. Le bonheur ne peut être perçu qu’à l’instantané. Et de la même manière que le parfum disparaît lorsque le nez s’y habitue, l’habitude du bonheur fait oublier qu’il est là. Alors la sagesse nous invite à ressentir le bonheur au présent, sans considérer qu’il soit acquis. C’est une invitation au lâcher-prise où le bonheur ne dépend pas de soi mais de la perception qu’on en a.
[SOURCE : CHOSES – Parfum]
Le bonheur se laisse-t-il cueillir ?
Dans une de ses chansons, Gilles Vigneault, chanteur-poète québécois, nous invite à cueillir les grammes du bonheur car personne n’a vu de bonheur au kilogramme Il joue avec les mots sur le registre de l’humour et de la poésie. En opposant le gramme et le kilo, le bonheur est perçu comme une succession de moments brefs plutôt qu’un état. Cela nous laisse le choix de capter des instants de bonheur en les rajoutant dans le panier de notre vie ou laisser le panier vide en attendant toujours mieux.
[SOURCE : ACTIVITÉS – Cueillette]
L’économie du bonheur au Bhoutan
Pour illustrer comment la métaphore structure également la pensée collective, prenons l’exemple d’une société. Lorsque le roi Jigme
Singye Wangchouk, monarque absolu, monte sur le trône du Bhoutan en 1971, il instaure le principe du Bonheur National Brut comme base du développement économique de son royaume.
Il s’inspire du PNB, le Produit National Brut, qui est une émanation de la culture économique de notre époque. Pour rappel, le PNB
e
mesure la production totale de biens et de services d’un pays pendant une période donnée. Les indicateurs sont des agrégats d’indices, établis par statistiques, concernant la production, les finances, les revenus, les services. La croissance du PNB est considérée comme une mesure de la santé économique.
Par analogie avec le PNB, le roi et ses économistes appliquent le BNB, Bonheur National Brut, pour mesurer, à la place de la croissance, l’amélioration de la qualité de vie ses sujets. À partir de cette base le roi engage des actions concrètes, parmi elles :
• protéger l’écosystème sur 60 % du territoire national ;
• dispenser gratuitement les soins de santé en interdisant l’usage du tabac ;
• rendre l’éducation gratuite et les programmes compatibles avec la quête du bonheur ;
• enseigner la valeur du bonheur dans les écoles en réécrivant les manuels.
Par exemple, en mathématiques, on proposait autrefois des problèmes du genre : Un paysan a quatre vaches. S’il en vend deux, combien lui en reste-il ? Aujourd’hui le texte a été modifié de la façon suivante : Un paysan a quatre vaches et comme il a un bon cœur, il en offre une à chacune de ses trois filles. Combien de vaches a-t-il maintenant ?
Dans le royaume du Bhoutan, le rapprochement par analogie du PNB et du BNB a fonctionné en générant une métaphore correspondant à l’objectif d’un roi bouddhiste : créer les conditions où l’homme peut vivre heureux sans détruire la terre et en conformité avec les croyances de son pays.
[SOURCE : MÉDIAS – Économie]
Le Bonheur selon les domaines-sources
1. Êtres vivants
Le bonheur est un chien qui traverse une autoroute (Cali)
2. Corps
Le bonheur c’est le sourire du cœur (Delphine Lamotte).
3 Choses
Le bonheur et les verres se brisent facilement (Proverbe danois).
4 Activités
Le bonheur, c’est un métier Cela s’apprend (Marie Laforêt)
5. Environnement
Le bonheur est comme l’écho, il vous répond mais ne vient pas (Carmen Siva)
6. Physique
Le bonheur, c’est quand le temps s’arrête (Gilbert Cesbron).
7 Médias
Le bonheur est un ange au visage grave (Amedeo Modigliani).
La plupart du temps, nous ne sommes pas conscients que la métaphore conceptuelle influence notre raisonnement. Il en résulte parfois des erreurs d’appréciation et de fausses conclusions.
Le dentifrice dans le tube
Oleg Kachine, un journaliste engagé, relate le mouvement de citoyens qui manifestent en faveur de la démocratie en Russie : On ne peut pas remettre le dentifrice dans le tube une fois qu’il en est sorti. Cette simple règle est la garantie de changements à venir.
Ainsi le mouvement des Moscovites sortant massivement dans la rue est comparé à la dynamique de la pâte dentifrice qu’on presse hors du tube. Comme cette opération est irréversible, le lecteur doit en déduire que le changement est inéluctable. Avec le recul, on constate que l’intuition du journaliste ne s’est pas confirmée et que, dans la réalité, le mouvement de citoyens a été réprimé. La
législation a été durcie pour donner les moyens de faire rentrer le dentifrice dans le tube !
[SOURCE : CHOSES – Tube de dentifrice]
La météo fait-elle courir un risque au stockage en nuage ?
Un journal polonais, Gazeta Wyborcza, relate le fait suivant en août 2012. Vishwa Bandu Gupta, un ministre d’État indien, prend position sur le stockage de données informatiques en nuage en ces termes :
À
notre époque, il suffit d’avoir un ordinateur connecté à un nuage pour que tous vos programmes et documents s’y trouvent. Et jusqu’à aujourd’hui personne n’a fait de recherches pour savoir si, en cas d’orages, il y aura des perturbations.
Le ministre en déduit des conséquences désastreuses pour la sécurité informatique dont il est responsable. Il va s’en servir pour justifier des mesures restrictives qui vont impacter la liberté de communication et en particulier celle des réseaux sociaux qui sont dans son collimateur.
Si son propos nous invite à sourire, il apporte aussi une preuve que le raisonnement sur un concept abstrait comme le stockage en nuage, en suivant une logique climatique, aboutit à une décision et des actions concrètes.
[SOURCE : NATURE – Orages]
Écrire un livre c’est comme un voyage
En abordant l’écriture de ce livre, je me suis aperçue que c’était pour moi comme un voyage initiatique dans le monde de l’écriture dont j’ai tout à apprendre. Comme le voyage est une activité routinière pour la nomade que je suis, je prends le temps de sentir les lieux, d’observer les gens, de faire le plein d’impressions sensorielles, sans m’attacher à une direction précise. Ma curiosité me pousse à approfondir de nouvelles pistes au fur et à mesure qu’elles se
6
présentent en chemin. Ce genre de voyage peut se faire par étape, s’interrompre puis reprendre quelques mois après comme un vagabondage sans un but précis.
Cette manière de voyager comporte des points forts, mais aussi des écueils. J’ai réalisé que, lorsque seul le voyage compte, l’arrivée à la destination n’a pas d’importance. Cette métaphore ne me permet pas de concrétiser un projet d’écriture !
[SOURCE : ACTIVITÉS – Voyages]
Être architecte d’écriture
Ayant cherché une autre métaphore pour me donner un autre point de vue sur mon projet j’ai trouvé l’idée de choisir comme domainesource un métier de bâtiment, l’architecture.
Si j’étais architecte, je me poserais des questions d’architecte. Quelle est la commande ? Le destinataire final ? Le budget ? Les délais ? La spécificité ? Est-ce une école, une salle de concert, une maison pour une famille ou pour une mamie à la retraite qui veut recevoir ses petits-enfants ? Quelles sont les contraintes environnementales et fonctionnelles ? Si c’est une salle de concert, comment résoudre les questions d’acoustique, d’accès et de sécurité ? Qu’est-ce qu’il faut pour construire une belle salle de concert pour un public d’amateurs de musique ?
En développant cette métaphore au niveau du cerveau droit, le cerveau gauche s’est mis à comprendre et traduire les solutions métaphoriques en plan d’action pour écrire et terminer ce livre.
Qui est le lecteur ? Quelles sont ses connaissances dans la matière que je veux lui présenter ? De quoi a-t-il besoin pour avoir envie de continuer la lecture ? Et techniquement, quel est le fil conducteur qui articule les chapitres entre eux ? Quelles sont les portes d’entrée… le nombre de parties, le contenu de chaque chapitre, des illustrations pour faciliter la lecture, des articulations entre les sections, des fiches pratiques et des annexes ?
La métaphore de l’architecte en écriture m’a permis de recentrer mon travail sur le lecteur, ses besoins et la manière d’y répondre.
Elle intègre les contraintes imposées par l’édition. En épousant sa logique, j’ai trouvé la structure du livre et un fil rouge qui donne la direction, facilite le choix de ce qui fait partie du contenu et ce qui est à laisser de côté pour un autre ouvrage.
[SOURCE : ACTIVITÉS – Métier d’architecte]
Vous savez maintenant que la métaphore suit la logique d’un domaine-source pour trouver ses propres conclusions. La métaphore reste universelle, mais elle reflète l’expérience personnelle de chacun.
Pour aider quelqu’un à trouver sa métaphore personnelle le facilitateur dispose d’un savoir-faire, celui de connaître et pratiquer le Clean Language. Nous allons découvrir maintenant la technique de questionnement dans « le Dialogue avec la métaphore. »
Partie II
LE CLEAN LANGUAGE ET LA MODÉLISATION SYMBOLIQUE
La Modélisation Symbolique ouvre un voyage dans le monde intérieur, l’espace individuel des métaphores et symboles.
Hélène Pradas-Billaud1
4 LE DIALOGUE AVEC LA MÉTAPHORE
Proche par certains aspects du langage de l’enfance, ancrée parfois dans des représentations archaïques, les métaphores parlent de et à l’enfant en nous Hélène Pradas-Billaud
QUAND LES GENS UTILISENT SPONTANÉMENT des métaphores personnelles pour exprimer ce qu’ils pensent et ressentent, on leur répond rarement dans le même registre. Si, par exemple, quelqu’un partage avec vous son inquiétude en termes métaphoriques : Je crains de laisser partir le dernier train et de rester sur le quai, quelle serait votre réaction ?
Seriez-vous tenté de minimiser en disant : c’est juste un mauvais passage, ou donner un conseil : pensez d’abord à votre santé, ou votre avis : c’est une opportunité pour faire le point et réorienter votre carrière ? Ne se sentant pas compris, votre interlocuteur risque de poursuivre ses explications, de faire semblant de prendre en compte votre avis ou encore se taire car toutes vos interventions, bien que bienveillantes, vont à l’encontre d’une authentique écoute et ne l’aident pas à trouver sa propre solution.
David Grove a perçu l’intérêt d’explorer le monde qui se cache derrière une métaphore personnelle qui ouvre une porte sur le
monde des représentations personnelles et de la pensée inconsciente. Il a inventé une façon particulière de converser avec la métaphore d’un client. Cette technique a été décrite par Penny Tompkins et James Lawley, dans leur ouvrage Les Métaphores dans la tête , sous le nom de Clean Language Ce nom ayant acquis une notoriété internationale, il a été adopté sans le traduire en français. Par extension, le qualificatif Clean est employé comme référence à l’approche Clean de David Grove : l’approche Clean, l’attitude Clean, le processus Clean, etc. Nous allons découvrir la richesse et la complexité du Clean Language et ses quatre composantes de manière séquentielle.
Les quatre composantes du Clean Language

Le danger serait d’oublier la synergie entre ces composantes. Pour comprendre le fonctionnement d’une montre, on la démonte, mais c’est l’assemblage des pièces détachées qui en assure un bon fonctionnement. En tant que fille d’horloger, je sais de quoi je parle !
LES QUESTIONS DE BASE
Les questions Clean se distinguent des questions courantes par leur forme qui est à la fois concrète, minimaliste et directe. Reprenons l’exemple de quelqu’un qui craint de laisser partir le dernier train et de rester sur le quai. Le facilitateur pourra s’adresser à son interlocuteur en formulant une question Clean de la manière suivante :
• Concrète, avec une question qui cible un élément à la fois, comme si c’était un objet sensoriel que l’on peut voir, sentir, toucher ou entendre : Quel genre de rester est-ce ?
1
• Minimaliste, avec une question qui reprend les mots exacts sans reformulation : Il y a-t-il une relation entre rester et le dernier train ?
• Directe, avec une question qui va orienter l’attention du client dans une direction nouvelle : Qu’aimeriez-vous qu’il arrive maintenant ?
En étudiant la structure des entretiens thérapeutiques de David Grove, Penny Tompkins et James Lawley ont fait l’observation suivante : dans 80 % des interactions avec les métaphores de ses patients, David Grove utilisait seulement douze questions qui constituent la base du Clean Language. D’autres questions sont parfois nécessaires pour s’adapter au contexte et nous les verrons plus loin sous le nom de questions complémentaires ou spécialisées.
Pour simplifier leur apprentissage, les questions Clean sont regroupées par type d’information à révéler.
Les questions de base du Clean Language (X ou Y = élément de la réponse du client)
Information Questions de base
Intention Qu’est-ce que X aimerait qu’il arrive ?
Attributs Quel genre de X est-ce ?
Y a-t-il autre chose à propos de X ?
Localisation Où est ce X ?
Métaphore Et c’est comme quoi ? Et cela ressemble à quoi ?
Relations Y a-t-il une relation entre X et Y ?
Et quand X, qu’est-ce qui arrive à Y ?
Temps Qu’est-ce qui se passe après que X ?
Qu’est-ce qui se passe juste avant que X… ?
D’où pourrait venir X ?
Conditions Qu’est-ce qu’il doit se passer pour que X ?
Est-ce que X peut (veut) ?
Exemples de formulation des questions
Pour que ces questions deviennent plus concrètes, prenons l’exemple d’une séance avec Léa. Anesthésiste dans une maternité parisienne, Léa se plaint de la fatigue engendrée par ses gardes de vingt-quatre heures car elle met de plus en plus longtemps à récupérer. Quand je lui demande quel est le résultat qu’elle attend de la séance, elle répond qu’elle aimerait avoir plus d’énergie.
Avant de commencer la séance nous nous mettons d’accord pour suivre un protocole. Je vais poser les douze questions, chaque question une seule fois. Chacune des réponses de Léa vont me guider pour poser la question suivante. Les réponses de Léa sont en italiques.
Je commence par les questions des Attributs qui révèlent la nature et la forme de l’objet en question.
ATTRIBUTS
1 – Quel genre d’énergie est cette énergie ?
Léa – C’est une énergie vitale.
2 – Y a-t-il autre chose à propos de l’énergie vitale ?
Léa – C’est la même énergie qu’on trouve dans les arbres, dans le contact entre la terre et le ciel.
Léa répond en situant par gestes l’énergie autour d’elle. Alors je pose la question de Localisation en montrant avec ma main cet espace autour d’elle.
LOCALISATION
3 – Où est l’énergie vitale ?
Léa – En moi et autour de moi, partout !
Je résume les trois réponses de Léa avant de poser la question qui fera émerger sa métaphore.
MÉTAPHORE
4 – Et l’énergie vitale qu’on trouve partout, dans les arbres, dans le contact entre la terre et le ciel, en toi et autour de toi, et quand l’énergie vitale en toi et autour de toi, c’est comme quoi ?
Vous avez remarqué la répétition redondante. J’utilise ici la syntaxe Clean qui facilite l’émergence de la métaphore. Nous y reviendrons par la suite. Après un temps de silence comme si la réponse se frayait un chemin de l’inconscient vers la conscience, Léa répond.
Léa – Comme une Toupie qui tourne de plus en plus vite. Quand je propose à Léa de dessiner, elle croque une toupie multicolore, un jouet qui lui rappelle son enfance. Les questions suivantes vont explorer cette métaphore.
RELATION
5 – Et y a-t-il une relation entre le contact entre le ciel et la terre et la Toupie ?
Léa – Quand je suis en contact avec la Toupie, mon organisme s’illumine.
6 – Et quand l’organisme s’illumine, qu’est-ce qui arrive à la Toupie ?
Léa – La Toupie tourne de plus en plus vite.
TEMPS
Les questions de Temps permettent de découvrir la séquence dans laquelle les évènements se produisent. Imaginez pour cela une ligne de Temps, où la Toupie tourne dans un présent métaphorique. Ma première question va projeter la Toupie dans le futur, la deuxième dans le passé et la troisième va chercher la Source.
7 – Et quand la Toupie tourne très vite, qu’est-ce qui se passe ensuite ?
Léa – La Toupie ralentit et on voit toutes ses couleurs apparaître, puis elle tombe…
8 – Et qu’est-ce qui se passe juste avant que la Toupie ne tombe ?
Léa – Elle perd le contact.
9 – Et d’où pourrait venir le contact ?
Léa – De la terre en contact avec le ciel.
Les neuf questions ont successivement fait émerger, puis développer la métaphore personnelle. Celle-ci est devenue psychodynamique car elle reflète et influence les pensées et les émotions chez Léa. Quand un symbole représente une partie de soi, il peut répondre et révéler sa mission. Ainsi les questions suivantes vont explorer ce que veut la Toupie et comment elle peut l’obtenir.
INTENTION
10 – Et qu’est-ce que la Toupie aimerait qu’il arrive ?
Léa – Elle aimerait continuer à tourner et rester en contact.
Les deux dernières questions vont s’intéresser aux conditions nécessaires pour qu’arrive ce que désire la Toupie.
CONDITIONS
11. Et est-ce que la Toupie peut tourner et rester en contact ?
Léa – Non, elle ne peut pas. Elle a besoin de se reposer.
12. Et qu’est-ce qu’il doit se passer pour que la Toupie se repose ?
Léa – La Toupie aime le changement. Elle aime être là où il y a beaucoup de monde, mais elle aime aussi être seule. Il est important de bien gérer les deux, car c’est ça qui rend la vie intéressante.
À ce moment-là, le rythme de la voix de Léa change et revient à un débit plus rapide qui est son rythme normal. Le regard qu’elle pose sur moi m’indique qu’elle sort de la pensée métaphorique et revient au réel. Je termine la séance en lui proposant de noter ce qu’elle sait maintenant au sujet de l’énergie.
Léa résume ce qu’elle a appris en quelques phrases :
C’est important pour moi de bien gérer l’énergie. Elle a une légèreté et l’amour et la vie peuvent être plus intéressants grâce à elle. Elle me donne de la force à condition de rester près de sa
source car elle a le pouvoir de la guérison. Elle m’est plus proche maintenant car elle est nommée. J’aimerais qu’on devienne amies et que l’on apprenne à s’apprécier mutuellement.
Vous pouvez maintenant revoir toutes les questions Clean qui ont été posées à Léa dans le tableau suivant.
La séance de Léa
Questions Réponses
Intention – Qu’aimerais-tu qu’il arrive pendant cette séance ?
Attributs – Quel genre d’énergie est-ce ?
– Y a-t-il autre chose à propos de l’énergie vitale ?
J’aimerais avoir plus d’énergie
C’est une énergie vitale
C’est la même énergie que l’on trouve dans les arbres, dans le contact entre la terre et le ciel
Localisation – Où est cette l’énergie vitale ? En moi… et autour de moi, partout !
Métaphore – Et l’énergie vitale qu’on trouve partout, dans les arbres, dans le contact entre la terre et le ciel, en toi et autour de toi, et quand l’énergie vitale en toi et autour de toi, c’est comme quoi ?
Relation – Et y a-t-il une relation entre le contact entre le ciel et la terre et la Toupie ?
– Et quand l’organisme s’illumine, qu’est-ce qui arrive à la Toupie ?
Temps – Et quand la Toupie tourne très vite, qu’est ce qui se passe ensuite ?
– Et qu’est-ce qui se passe juste avant que la Toupie ne tombe ?
– Et d’où pourrait venir le contact ?
Comme une Toupie qui tourne de plus en plus vite.
Quand je suis en contact avec la Toupie, mon organisme s’illumine.
La Toupie tourne de plus en plus vite !
La Toupie ralentit et on voit toutes ses couleurs apparaitre, puis elle tombe…
Elle perd le contact
De la terre en contact avec le ciel
Intention – Et qu’est-ce que la Toupie Elle aimerait continuer à tourner
aimerait qu’il arrive ? et garder le contact.
Condition – Et est-ce que la Toupie peut tourner et rester en contact ?
– Et qu’est-ce qu’il doit se passer pour que la Toupie se repose ?
La dynamique réponse-question
Non, elle ne peut pas Elle a besoin de se reposer
La Toupie aime le changement
Elle aime être là, où il y a beaucoup de monde, mais elle aime aussi être seule. Il est important de bien gérer les deux car c’est ça qui rend la vie intéressante.
D’une manière générale, la question suit la dernière réponse dans 80 % des cas. Pour nous familiariser avec la dynamique : réponsequestion Clean, je vous propose de parcourir la transcription d’une séance de coaching
Liz est une femme indépendante, exerçant un métier qu’elle adore autant que sa fille adolescente qu’elle élève seule. Comme elle veut faire tout toujours bien, elle jongle avec le temps et vit sous une tension permanente. Quand je lui pose la question de ce qu’elle attend de la séance, elle répond qu’elle aimerait savoir pourquoi elle se met elle-même autant de pression.
Je présente la séance avec Liz sous forme d’un tableau pour :
• illustrer la dynamique de réponse-question ;
• faire un commentaire sur la technique.
Réponses client1
Questions facilitateur2
Et qu’aimerais-tu qu’il arrive maintenant ?
Commentaires
Le facilitateur commence la séance par la question de l’Intention Il note la réponse pour la rappeler à la fin au client.
Lâcher des tensions, toutes formes de
lâcher des tensions, et toutes formes de pression que
Le facilitateur résume la réponse, et développe un de
pression que je me mets. tu te mets, et quel genre de pression est-ce ? ses éléments, ici la pression.
C’est une pression qui ne s’arrête jamais. et une pression qui ne s’arrête jamais, et y a-t-il autre chose à propos de pression ?
Il pose au moins trois questions pour développer un élément de la métaphore.
C’est une pression comme si quelque chose me poussait.
comme si quelque chose te poussait, où est-ce précisément ?
La question de localisation ramène l’attention de Liz vers ce qu’elle ressent.
C’est là, au-dessus de l’omoplate quand une pression qui ne s’arrête jamais, et comme si quelque chose te poussait, là au-dessus de l’omoplate, et cela ressemble à quoi ?
Un Aiguillon qui me pique, me réveille et ne me laisse jamais tranquille…
C’est un Aiguillon pour un Cornac !
un Aiguillon te pique audessus de l’omoplate, te réveille et ne te laisse pas tranquille, et y a-t-il autre chose à propos d’Aiguillon ?
c’est un Aiguillon pour un Cornac, et quel genre de Cornac pourrait-être ce Cornac ?
Le facilitateur résume toutes les réponses pour révéler le nom d’un symbole
Liz trouve un premier symbole : l’Aiguillon Le facilitateur va poser d’autres questions pour approfondir le sens du symbole.
Le facilitateur continue à différencier différents éléments de la métaphore avant d’explorer les relations.
C’est un Cornac qui fait avancer l’Éléphant avec l’Aiguillon.
et quand le Cornac fait avancer l’Éléphant, qu’arriveil ensuite ?
Quand la métaphore devient narrative, le facilitateur suit sa logique et continue à explorer les relations à travers l’espace…
L’Éléphant est fatigué car il ne s’arrête jamais !
d’où pourrait venir le Cornac ?
Le Cornac vient de très loin dans le temps et quand il vient de très loin dans le temps, d’où précisément vient-il ?
J’ai une image comme ça, à travers les temps, depuis des générations,
à travers les temps, et depuis des générations, et c’est presque impossible à
Puis à travers le temps
En questionnant la source, le facilitateur incite Liz à trouver la cause
Ensuite les conséquences
c’est presque impossible à dater ! dater, et puis que se passe-til ?
Le Cornac s’empêche d’être au repos, il continue…
et quand le Cornac s’empêche d’être repos et continue, qu’aimerait-il qu’il arrive ?
Le Cornac aimerait descendre quand le Cornac aimerait descendre, est-ce qu’il peut descendre ?
Le Cornac ne sait pas faire autre chose et craint ce qu’il va devenir s’il décroche.
Le Cornac voudrait que l’on ne l’oublie pas !
si le Cornac craint ce qu’il va devenir s’il décroche, qu’aimerait-il qu’il arrive ?
Le facilitateur demande de quoi a besoin celui qui a ce problème, ici le Cornac.
Le facilitateur vérifie la possibilité de satisfaire le besoin de Cornac.
Face à une objection, le facilitateur va négocier
Le Cornac aimerait rester en relation avec les autres
si le Cornac voudrait que l’on ne l’oublie pas, et qu’estce qui doit se passer pour cela ?
qu’est-ce qui doit se passer pour rester en relation avec les autres ?
Le Cornac aimerait que l’on parle avec lui si l’on parle avec lui, qu’est-ce qui se passe ensuite ?
Le Cornac peut se détendre … le Cornac peut se détendre, qu’est-ce qui se passe ensuite ?
Le facilitateur cherche des solutions
Et des réponses pour satisfaire des besoins consécutifs
Le facilitateur accompagne les effets d’un changement
Quand Liz cesse de parler au nom de Cornac pour parler d’elle, c’est le signal qu’elle revient au contexte rationnel
J’ai envie de mettre des bougies, et apprendre à faire autrement
Que sais-tu maintenant à propos de « lâcher des tensions, toutes formes de pression que tu te mets » ?
Le facilitateur rappelle textuellement la réponse de Liz à la question de l’Intention
Je sais, qu’il y a quelque chose dont je peux me séparer
Y a-t-il autre chose que tu sais ?
Le facilitateur peut poser cette question plusieurs fois pour aider Liz à prendre conscience de ce qu’elle a
Je sais aussi que me séparer ce n’est pas le rejeter mais être en relation avec
En italique : les réponses du client
En gras : la question Clean
appris pendant le processus d’exploration métaphorique.
Je récapitule le scénario de cette séance. Pour aider Liz à trouver une métaphore personnelle, je vais d’abord développer trois symboles : le Cornac qui utilise un Aiguillon pour faire travailler l’Éléphant.
Ensuite, je questionne les relations entre ces symboles à travers l’espace et le temps. Quand la métaphore devient psychodynamique, je l’accompagne de manière narrative.
Mes questions s’adressent directement aux symboles pour négocier les solutions dans la logique métaphorique. Et en testant l’effet des solutions métaphoriques dans le temps, je crée un pont avec le réel. Liz manifeste à la fin de la séance l’envie de mettre des bougies et apprendre à faire autrement.
En fin de séance Liz ajoute en commentaire : J’avais besoin de l’appui que le facilitateur m’a donné dans la simplicité des questions, et de rentrer dans la cadence. Et c’était nécessaire que les questions soient répétitives et fermes.
Comment poser les questions Clean ?
✓ S’appuyer sur la dernière réponse du client pour poser la question suivante
✓ Répéter les mots exactement en respectant leur forme.
✓ Utiliser le langage sensoriel, comme si un mot pouvait avoir une forme, une couleur, une taille, une sonorité et une localisation.
✓ Accompagner la question Clean du geste, en projetant la voix en direction de l’espace métaphorique
✓ Se laisser guider par la logique de la métaphore.
1 2
LA SYNTAXE RÉPÉTITIVE
David Grove pensait que le client apprend par expérience et que l’expérience métaphorique équivaut à l’expérience réelle. Pour créer un climat propice à cela, il a inventé une syntaxe particulière. Celleci se distingue de la syntaxe ordinaire par la restitution répétitive des mots, une modulation de la voix et le silence qui en fait partie !
En début de séance, j’avertis le client que je vais l’accompagner avec des questions spécifiques à la méthode de Clean Coaching. Certains clients trouvent parfois les questions bizarres, mais lorsqu’ils s’aperçoivent que cela les aide à trouver informations venant de leur for intérieur, ils n’y prêtent plus l’attention.
La syntaxe Clean permet de réguler le flot de paroles et maintenir l’attention dans le processus de cheminement intérieur où la pensée inconsciente devient consciente.
La structure syntaxique ressemble à un entonnoir à trois niveaux, ponctuée par les conjonctions : Et… (mots client), et quand (mots client), question Clean (silence) ?
Je vous invite maintenant à retrouver Félix qui utilise l’humour et les commentaires comme techniques d’évitement mais qui souhaite découvrir ce qu’il désire vraiment. Dans son cas, la syntaxe Clean se révèle très utile pour maintenir son attention tout au long du processus métaphorique.
2
Dialogue avec la métaphore de Félix
Niveau 1 (Attention)
Le facilitateur commence sa phrase par la conjonction « et » pour indiquer la continuité avec la dernière réponse et répète simplement les mots sur lesquels il veut attirer l’attention du client : Et (mots client)…
Facilitateur – Et un désir d’idéal et de réalité pour cet idéal, et au niveau du cœur, et à la fois dedans et vers l’extérieur…
La simple répétition des mots permet de capter l’attention et, en entendant ses propres mots, Félix abandonne le besoin d’expliquer
Niveau 2 (Focalisation)
Le facilitateur ajoute la conjonction « quand » pour focaliser l’attention sur le(s) mot(s) sur lesquels va porter la question : et quand (mots client)…
Facilitateur – Et quand un désir d’idéal et de réalité pour cet idéal, et au niveau du cœur, et à la fois dedans et vers l’extérieur…
Lorsque Félix entend exactement ses propres mots au ralenti, il ralentit également son élocution et devient plus attentif à ce qui se passe en lui La deuxième répétition sert à poser des repères dans le cheminement intérieur
Niveau 3 (Question Clean)
Le facilitateur pose la question Clean et s’impose le silence en attente de la réponse : … question Clean ?
Le facilitateur marque un temps de silence avant de poser la question : Facilitateur – et c’est comme quoi ?
Félix – Mmm, cela n’a pas une forme précise, ça pourrait ressembler à un pot d’échappement d’une voiture…
Quand la métaphore se manifeste sous forme d’une image qui surprend, elle provoque une réaction émotionnelle et Félix se met à rire
Félix – Une nouvelle fois si je ne réfléchis pas, et ce qui me vient spontanément, le désir, ce serait comme l’enfant qui tire le bas du pantalon de son père ou de la jupe de sa mère et crie : « eh, eh, n’oublie pas ! … C’est un peu Peter Pan.
Au début de la séance, l’emploi de la syntaxe intégrale facilite l’émergence de la métaphore et elle accompagne le client, ici Félix, dans son cheminement intérieur. Quand le processus s’accélère, le facilitateur peut progressivement réduire la syntaxe à deux, voire un niveau.
Le facilitateur peut aussi choisir entre la syntaxe à 3, à 2 ou à 1 niveaux selon le contexte : la thérapie, le coaching, la facilitation collective ou la conversation informelle.
Choisir le niveau de syntaxe
La syntaxe à trois niveaux (coaching, thérapie) :
✓ ralentit le rythme de parole et induit un léger état de transe les yeux ouverts ;
✓ accompagne la remontée des souvenirs ;
✓ facilite l’émergence de la métaphore
La syntaxe à deux niveaux (facilitation collective) :
✓ s’adapte à l’exploration de la métaphore ;
✓ suit la logique de la métaphore ;
✓ accompagne de manière narrative la métaphore personnelle
La syntaxe à un niveau (conversation) :
✓ s’adapte au rythme du processus qui s’accélère ;
✓ prend un caractère conversationnel dans la phase de négociation ;
✓ accompagne la sortie du processus métaphorique.
LE RYTHME ET LA MODULATION DE LA VOIX
En pratiquant la syntaxe répétitive, le facilitateur module le rythme et ton de la voix. Il marque une pause et garde le silence juste avant de délivrer la question.
Rythme et modulation sur l’exemple de Léa
Voyons cela sur l’exemple de Léa, au moment où je l’invite à trouver sa métaphore personnelle de l’énergie.
Niveau 1 (Attention)
D’abord, je répète les réponses de Léa en commençant par « et » : et l’énergie vitale qu’on trouve partout, dans les arbres, dans le contact entre la terre et le ciel, en toi et autour de toi
Niveau 2 (Focalisation)
Ensuite, j’ajoute la conjonction « quand » qui précède les mots concernés par la question à venir à la fin : … et quand l’énergie vitale en toi et autour de toi…

Niveau 3 (Question Clean)
À la fin, je suspends ma voix sur un silence avant de poser la question : … et c’est comme quoi ?
Léa – Comme une Toupie qui tourne de plus en plus vite. La syntaxe complète de la question que je viens de poser à Léa ressemble à celle d’un entonnoir
Les trois niveaux de la syntaxe Clean
Le rythme de la voix suit celui de la pensée (synchronisation)
Cette manière de délivrer la question permet à la cliente de se sentir reconnue dans ce qu’elle vit, sans jugement, juste avec une curiosité bienveillante. Ainsi, à la fin de la séance, Léa s’est confiée à moi :
–
D’habitude j’ai des difficultés à nommer les choses que je ressens. Quand je mets des mots sur mes sensations, c’est comme si je violais leur virginité. La question longue et répétitive m’a aidée à prendre une autre perspective pour regarder les réponses venir en moi. Il y avait comme une étape intermédiaire dans une séquence, où je perçois d’abord une sensation, puis vient l’image avant que n’arrive la pensée.
Les rythmes de la pensée de Guy Claxton
Selon Guy Claxton , auteur de la théorie de l’intelligence extensible, le rythme de la parole est en corrélation avec la pensée. Il oscille entre l’extrême rapidité de la pensée instinctive, la modération de la pensée rationnelle et la lenteur de la pensée inconsciente.
3
La corrélation entre le rythme de la parole et la pensée
La pensée instinctive – ultra-rapide
Le rythme s’accélère quand les circonstances exigent une réaction rapide : attraper un objet qui tombe, éviter in extremis la portière d’une voiture en circulant à vélo L’information sur le danger imminent passe par un circuit rapide qui contourne le cortex dans le cerveau afin de mobiliser le corps pour une réaction Ce type de pensée se manifeste dans les performances sportives ou artistiques, où une longue pratique remplace la cognition. Il s’agit de la pensée instinctive et son rythme est le plus rapide.
La pensée rationnelle – modérée
Elle se caractérise par un rythme modéré, qui correspond à la réflexion, au dialogue interne, à l’élaboration de stratégie ou de prise de décision. Quand la pensée consciente s’exprime par la parole, le débit est régulier, plus ou moins rapide jusqu’à lent, selon le contexte : conversation à bâtons rompus, discussion animée ou explication du pourquoi et du comment…
La pensée inconsciente – lente
Le rythme de la parole ralentit quand la pensée se met en mode de rêverie, de contemplation, et d’introspection Un sentiment d’intériorisation et de fluidité l’accompagne Des images, des réminiscences, des associations d’idées remontent en surface de l’inconscient De là émergent les symboles et les métaphores C’est le royaume de la pensée inconsciente.
Guy Claxton a décrit ce phénomène, David Grove en a fait l’expérience lors de ses thérapies et l’a inclus intuitivement dans le Clean Language.
Des mots, une syntaxe, la voix, vous avez tout pour poursuivre la conversation sur la métaphore du client.
CONVERSER AVEC LA MÉTAPHORE
David Grove a été précurseur du dialogue avec la métaphore du client. Il a décrit ainsi sa démarche en ces termes : Je pose une
question directement à la métaphore, et la métaphore peut répondre. Le client est souvent stupéfié par la réponse. Il crée un discours avec sa métaphore en devenant un observateur passionné de ce qui se passe.
Dialogue avec la métaphore
✓ Le Facilitateur adresse la question à la métaphore.
✓ La Métaphore manifeste sa réponse sous forme verbale ou non verbale (images, sensation, mouvement, geste)
✓ Le Client communique la réponse au facilitateur.

La Toupie tourne de plus en plus vite et finit par tomber
Pour illustrer le dialogue avec la métaphore, reprenons la séance avec Léa au moment où elle réalise que la Toupie tourne de plus en plus vite et finit par tomber. En tant que facilitatrice, je pose la question à la Toupie et Léa répond à sa place.
Facilitatrice – Et qu’est-ce qui se passe juste avant que la Toupie tombe ?
Léa (suspendant d’abord son souffle) – Elle perd le contact.
Facilitatrice – Et qu’est-ce que la Toupie aimerait qu’il arrive ?
Léa – Elle aimerait continuer à tourner et rester en contact
Facilitatrice – Et est-ce que la Toupie peut tourner et rester en contact ?
Léa – Non, elle ne peut pas Elle a besoin de se reposer
Facilitatrice – Et qu’est-ce qu’il doit se passer pour que la Toupie se repose ?
Léa – La Toupie aime le changement. Elle aime être là où il y a beaucoup de monde mais elle aime aussi être seule Il est important de bien gérer les deux, car c’est ça qui rend la vie intéressante
La congruence entre le comportement non verbal et le questionnement joue un rôle important. D’une manière générale, le facilitateur évite de créer un rapport direct avec son client, en le regardant dans les yeux par exemple. Il focalise son attention sur l’espace métaphorique du client : la direction du regard, ce qu’il montre par geste, ce qu’il dit ou dessine. De cette manière, il s’efface et laisse la place au dialogue entre le client et sa métaphore personnelle.
Voyage intérieur avec la métaphore
Laissons la parole à Nathalie pour témoigner de la puissance de la conversation avec la métaphore. Dans sa vie professionnelle, elle accompagne des chômeurs en quête d’emploi. À titre personnel, elle fait de multiples explorations métaphoriques pour elle-même, en participant à un groupe de pratique, animé par Jennifer De Gandt à Paris.
Nathalie : Quand je voyage dans le monde intérieur, il y a déjà tout ce dont j’ai besoin Le travail de facilitateur, c’est donner la vie à des symboles. Tout est utilisé, mes dires, mes gestes, mes ressentis. Le facilitateur m’incite à dessiner et le dessin devient mon ami, une partie de moi qui est toujours prête à m’aider. Quand je parle, j’ai l’habitude de parler avec le Moi qui contrôle. Mais quand j’attends la réponse qui vient de ma métaphore, ce ne sont pas les mêmes parties du cerveau qui travaillent. Le cerveau gauche entend la question, le cerveau droit répond. À travers les symboles, je vais voir les choses différemment. La compréhension se fait. C’est possible parce qu’on n’est pas dans une conversation ordinaire, mais dans une conversation avec ma métaphore.
LA POSTURE DU FACILITATEUR
Un voyageur retourne dans le pays de son enfance après une longue absence en compagnie d’un ami aveugle. Le compagnon aveugle ne peut pas voir ce que l’autre perçoit avec les sens tels que la vue et l’ouïe, alors il pose des questions dans un langage sensoriel et factuel. Au fur et à mesure des réponses, il se fait une carte dans sa tête à partir de laquelle il pose la question suivante. Chaque question, telle une lampe torche, dirige l’attention de son ami et révèle un aspect du paysage. Ainsi poursuivent-ils leur voyage en explorant un Paysage métaphorique qui se découvre au gré de leur compagnonnage complice.
Être facilitateur Clean c’est comme être un compagnon aveugle pour accompagner son client dans le Paysage métaphorique de son monde intérieur. Et là s’arrête la ressemblance. Car être facilitateur, c’est pratiquer en plus une attitude de neutralité, l’utilisation délibérée d’un langage sensoriel et incarné (proche du corps), et un accompagnement minimaliste.
Le facilitateur Clean pratique une neutralité optimale dans sa posture, tant dans son écoute que son accompagnement.
Une attitude de neutralité
Le principe de neutralité s’exerce dans la reprise littérale des mots du client, mais il va au-delà. Le facilitateur exprime son empathie dans l’acceptation inconditionnelle de ce que le client exprime à travers ses métaphores. Il ne projette pas sa propre compréhension de mots du client. Il évite de manifester tout signe d’acceptation ou de désapprobation.
Ainsi une cliente s’est sentie embourbée dans sa vie comme dans un fumier. En développant sa métaphore, elle a découvert que le fumier était un lieu de recyclage de matière usée pour préparer le terreau où les nouvelles plantes peuvent prendre racine.
L’attitude neutre consiste à ne pas éviter un symbole déplaisant et le traiter avec équanimité. C’est aussi d’être un employeur juste en traitant toutes les informations à égalité, sans les juger bonnes ou mauvaises.
Un langage sensoriel et incarné
Le facilitateur reprend exactement les mots utilisés par son interlocuteur. Cependant, quand il pose une question, il utilise le registre sensoriel pour inciter le client à recevoir la réponse venant de son corps et de ses cinq sens plutôt que de sa tête. Il apprend à capter les indices corporels pour les intégrer dans les questions car les messages para-verbaux appartiennent aussi au langage sensoriel.
Messages para-verbaux comme réponses
✓ Un signe de la main.
✓ Un hochement de tête.
✓ Un bruit physiologique (un raclement de gorge).
✓ Une sensation corporelle (picotement, tremblement, fourmillement).
✓ Un soupir, des bâillements
✓ Un mouvement involontaire.
✓ Un dessin, une image, une photo
✓ Un élément qui attire le regard (un jeu de lumière sur le mur).
Quand le facilitateur formule sa question dans un langage sensoriel, le client peut avoir la réponse sous forme d’images visuelles et auditives ou de sensations dans son corps. Lorsque les perceptions deviennent concrètes pour lui, le client peut les localiser dans son espace perceptuel et incarné. Le langage sensoriel fournit la clef pour créer une synergie entre le corps, le cœur et l’esprit qui se matérialise sous forme d’une métaphore personnelle.
Le principe de minimalisme
Le facilitateur se garde de tout commentaire à propos d’une métaphore personnelle et la traite avec une respectueuse distance. Si le client dessine sa métaphore, le facilitateur adresse sa question au dessin.
Le facilitateur limite ses interventions au strict nécessaire en sachant que, plus il devient transparent, plus le client suivra sa propre voie. Sa modération est discrète : elle se traduit par le choix de la question Clean qui se doit d’être en adéquation avec la dernière réponse du client.
Le facilitateur suit en confiance le processus car la métaphore choisie par le client reflète sa façon de penser et contient à la fois l’expression du problème et les ingrédients pour le résoudre. Quand
4
Les règles du facilitateur Clean
✓ Reprendre les mots du client sans les déformer.
✓ Utiliser le langage sensoriel et concret.
✓ Poser la question Clean par rapport avec la dernière réponse.
✓ Donner le cadre du temps de la séance, mais respecter le timing du client
✓ Faire preuve de respect, de neutralité, de confiance, dans le processus de modération Clean.
la métaphore est personnelle et identifiée, elle est « activable », c’est-à-dire qu’elle conduira le client vers le changement, immanquablement mais à son rythme.
5 LA MODÉLISATION SYMBOLIQUE CÔTÉ CLIENT
Votre expérience du monde est déterminée par la façon dont vous le voyez, ce qui explique pourquoi, lorsque vous modifiez votre perception de vous-même, vous transformez aussi le monde dans lequel vous vivez.
Guy Finley
POUR COMMENCER CE NOUVEAU CHAPITRE, je vous emmène au pays de mes souvenirs.
Perdue dans la nuit noire
Un soir, lors d’une promenade nocturne au nord de l’île de Bréhat, je perds de vue mes compagnons et me retrouve seule dans le noir d’une nuit sans étoiles. Un vent très fort souffle du sud et la pluie s’annonce. Je décide de faire confiance à ma connaissance de la topographie de l’île pour retrouver la maison qui se trouve près d’un passage étroit, séparant l’île en deux parties, nord-sud. Au gré de mes pas, je cherche dans l’obscurité des silhouettes familières des maisons si différentes de nuit Le phare me sert de repère pour me situer par rapport à mer J’espère rejoindre un chemin côtier qui me mènerait à ma maison Lorsque je reconnais dans la silhouette du pont reliant la partie nord au sud de l’ile, je me rends compte que je suis allée trop loin ! Alors je fais demi-tour et reviens sur mes pas Dès que je reconnais la silhouette de l’église, je connais le moyen de rallier le plus court chemin pour rentrer et me mettre au chaud !
Mes repères, la mémoire épisodique et l’intelligence du corps m’ont permis d’arriver à destination. J’ai trouvé l’explication de ce phénomène dans les travaux d’Edward Tolman, psychologue américain qui peut se vanter d’être le précurseur de l’approche cognitive moderne du comportement animal.
DE LA CARTE MENTALE À LA CARTE MÉTAPHORIQUE
Tolman introduit la notion de la carte mentale. La Carte mentale, argumente-t-il, fournit la seule explication plausible en ce qui concerne les raisons pour lesquelles le rat choisit rapidement un itinéraire alternatif dans un labyrinthe quand son chemin habituel pour atteindre sa récompense est bloqué. Au lieu de chercher à l’aveugle par la méthode essai-erreur, les rats se comportent comme s’ils avaient une carte à caractère mental et non comportemental. La preuve en est que, même lorsque le labyrinthe se trouve inondé, les rats savent choisir le bon chemin en nageant. Cela prouverait qu’au lieu de mémoriser une séquence d’actions comme tourner à gauche ou à droite, les rats ont développé une représentation topographique du labyrinthe.
1
Carte mentale – représentation qu’un individu se fait de l’organisation de son espace physique et mental.
Même une exploration permet de créer une carte mentale comme le démontre l’exemple suivant. On a composé deux groupes de rats pour mesurer leurs performances d’orientation dans un labyrinthe. Le premier groupe de rats avait le loisir d’explorer librement le labyrinthe avant l’épreuve et le deuxième en a été privé. Ensuite on a placé un appât au centre de labyrinthe. Les rats du premier groupe ont été plus rapides pour trouver l’appât que les rats du second groupe.
Mon manque d’orientation est proverbial. J’ai même un talent infaillible pour choisir une direction opposée à celle où je devrais aller. Et pourtant dans mon aventure nocturne, sur l’île de Bréhat, j’ai découvert que je savais m’orienter en me fiant à ma propre carte mentale, où j’avais enregistré les données sur la topographie de l’île en m’y promenant de jour.
LE PAYSAGE MÉTAPHORIQUE
Nous allons découvrir maintenant un type de carte qui permet de s’orienter dans le labyrinthe de notre esprit. Les neurosciences nous confirment le potentiel d’informations présentes dans le cerveau sous formes de métaphores. La Modélisation Symbolique est une méthode permettant de réaliser une auto-modélisation de nos représentations sous forme d’une carte métaphorique, le Paysage métaphorique. À l’instar d’une carte routière, elle donne des informations utiles pour contourner des obstacles et trouver des moyens pour réaliser nos buts.
Le Paysage métaphorique est une carte mentale qui permet de s’orienter dans le labyrinthe de notre esprit
Le Paysage métaphorique partage les attributs d’une carte mentale dans la mesure où il :
• donne des repères sous forme de symboles ;
• indique des obstacles, des freins et des ressources ;
• offre une vision globale et systémique ;
• indique des itinéraires alternatifs qui mènent à un but.
Dans un premier temps, la carte métaphorique permet d’identifier nos enjeux personnels et des schémas de comportements. Le questionnement du Clean Language permet de trouver des solutions métaphoriques et de tester leur validité.
Dans un deuxième temps, elle permet de conduire le changement évolutif qui prend en compte les enjeux d’adaptation à l’environnement. Le client peut la modifier quand il constate qu’elle n’est pas adaptée à l’objectif à atteindre.
La connaissance de nos cartes mentales métaphoriques donne la liberté de choisir celle qui est adaptée à qui on est et où on veut aller Souvenez-vous de mes deux cartes métaphoriques qui m’ont servi pour écrire ce livre (chapitre 3). La première métaphore, où l’écriture est un voyage vagabond, me mène vers l’impasse. La deuxième, celle de l’architecte de l’écriture, m’offre des repères pour parvenir à mon but.
Souvenons-nous de Léa qui aimerait avoir plus d’énergie et qui a compris par le biais de sa métaphore que son énergie vitale est comme une Toupie qui tourne de plus en plus vite, puis perd le contact et tombe. En séance, nous ne sommes pas allés au-delà de la découverte de sa métaphore personnelle, mais elle pourrait être le début d’une séance de Modélisation Symbolique, où Léa découvrirait ses propres solutions de gestion d’énergie.
La Modélisation Symbolique est une méthode permettant de réaliser une auto-modélisation de nos représentations sous forme d’une carte mentale métaphorique.
Pour mieux comprendre le processus de l’auto-modélisation, nous allons suivre le récit d’une séance avec un client familiarisé avec l’exploration de ses métaphores personnelles car il n’en est pas à sa
première séance. Nous l’appellerons Simon pour préserver son identité réelle.
UNE SÉANCE DE MODÉLISATION SYMBOLIQUE AVEC SIMON
Simon est dirigeant d’un cabinet de coaching et management, une structure souple qui s’adapte à la personnalité de ses six associés. Lorsqu’il vient me voir, c’est pour dépasser une problématique de communication avec ses collègues.
En effet, il s’est rendu compte que celle-ci est brouillée lors de certains évènements. Il me relate qu’une associée s’est faite porteparole de ses collègues pour lui parler des difficultés relationnelles avec lui. Par exemple, quand elle a besoin de lui parler, il semble être ailleurs et elle a l’impression qu’il y a un mur de verre entre elle et lui. La conversation devient alors difficile.
Simon a conscience de son comportement quand il est en pleine réflexion sur un sujet qui le préoccupe. Il reconnaît que cela se fait aux dépens de bonnes relations avec ses collaborateurs. Ce conflit entre le relationnel et le besoin de concentration est abordé pendant cette séance.
Définir l’intention de la séance
Comme beaucoup de clients en coaching, Simon connaît parfaitement le pourquoi du comment. Pour définir l’intention de la séance et abréger les explications, je lui résume les informations dont je dispose avec ses propres mots afin de lui demander ce qu’il aimerait qu’il arrive pendant la séance. Alors il répond :
– Préserver le mécanisme protecteur de concentration et améliorer les relations avec mes collaborateurs.
Cette phrase qu’il note sur une feuille sera le point départ pour une séance de Modélisation Symbolique.
Trouver la métaphore personnelle
Comme Simon utilise le langage rationnel du cerveau gauche, je le rencontre sur ce terrain avant de le guider vers la pensée métaphorique, apanage du cerveau droit. Pour le faire, je résume d’abord la situation mot à mot, puis je pose la question qui génère la métaphore. Il s’interrompt, puis après un bref silence il répond :
– Une idée qui me vient, tu sais, c’est très long de digérer la viande, entre six et neuf heures pour digérer la viande dans l’intestin. Si tu amènes un aliment sucré à cette digestion, le sucré se digère en vingt minutes. Il a une collision entre les deux qui crée une fermentation et perturbe le système digestif. C’est un peu ça.
Simon imagine sa métaphore personnelle en s’inspirant du système digestif du corps :
– C’est comme si la relation c’était du sucré, et comme si la réflexion profonde c’était une protéine qu’il me faut longtemps pour digérer et assimiler et qu’il ne me faut surtout rien d’autre à côté.
Alors je lui demande de dessiner sa métaphore. Il prend une des feuilles de papier avec les crayons de couleur pour y dessiner une tête sommaire, trace un rectangle au-dessus des yeux et y inscrit un point d’interrogation. Ne soyez pas surpris que le dessin prenne une forme différente de celle que suggèrent les mots et adoptez une attitude de curiosité neutre dans l’accompagnement comme je le fais pour Simon.
Ce dernier commente son dessin en montrant le rectangle :
–
… C’est là où je réfléchis intensément. Parfois rien ne sort de la réflexion. Ce n’est pas une réflexion consciente étape par étape. C’est souvent une réflexion globale comme dans une Boîte noire.
Simon ajoute deux flèches à droite de la tête. Il désigne les flèches qui représentent pour lui les relations :
– Il y a moi, en relation…
Ensuite il montre le rectangle noir sur le dessin et explique :

–… Je suis en même temps en concentration. Et donc avec une espèce de mécanisme de boîte noire.
Les réponses à mes questions se matérialisent sous forme de dessin que Simon commente au fur et à mesure :
– Et donc, pendant ce moment-là, il n’y a rien qui sort, mais mon besoin, c’est que rien ne rentre non plus. Le processus de réflexion est en cours et toute information qui entre perturbe le processus.
Simon regarde en silence le dessin, puis il entoure d’un cercle rouge la pointe de la flèche, en disant :
– Quand je suis dans la Boîte noire et je rumine, la Boîte noire et les relations extérieures sont incompatibles !
Symbole : Boîte noire
Rappelons-nous qu’un symbole métaphorique peut représenter un obstacle, une ressource, une valeur, une compétence ou une partie de soi. Pour Simon, le Cercle rouge signifie que la concentration et les relations sont incompatibles. Ce troisième symbole va devenir
plus tard un Gros sens interdit Mais n’allons pas trop vite. Le secret de l’accompagnement est la lenteur qui permet d’explorer en profondeur les significations symboliques de chaque image.
Récapitulons les trois symboles avant de poursuivre :
• La Boîte noire représente la concentration.
• Les Flèches représentent les relations.
• Le Cercle rouge signifie l’incompatibilité entre la concentration et les relations.
Dessiner le Paysage métaphorique
Comme nous venons de différencier trois symboles, je peux introduire une nouvelle série de questions pour explorer les interactions dans l’espace et le temps. C’est maintenant que la métaphore va se transformer en Paysage métaphorique. Nous verrons aussi que la dynamique du Paysage métaphorique permet d’aller plus loin que la simple métaphore personnelle.
Je reprends le fil des questions pour creuser les interactions entre les trois symboles. Simon dessine avant de répondre. Il vient de tracer un carré en pointillé autour de la tête :
– Et donc je mets une espèce de protection qui s’étend sur la boîte noire. Je la mets en pointillé, parce que ce n’est pas aussi fermé que la précédente, mais elle filtre énormément. Elle protège. C’est une espèce de Champ de protection.
Paysage métaphorique : Champ de protection
Le rythme de ses réponses continue à se ralentir, ponctué par le silence. Simon est en train de s’auto-modéliser en trouvant les réponses au fond de lui. Il y a des informations qui émergent dans l’interaction entre son dessin et son processus d’introspection. En tant que coach, je respecte cette discussion intime en intervenant de moins en moins.
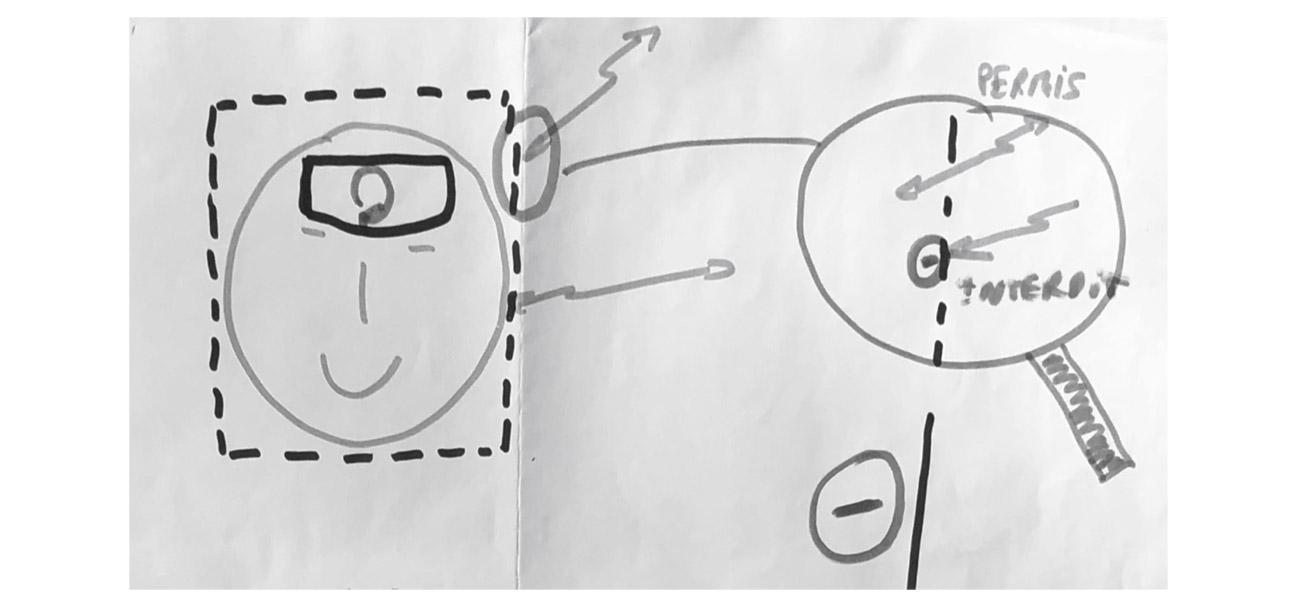
Puis Simon prend conscience d’une difficulté qu’il ignorait apparemment :
– Ce que m’apprend ce dessin c’est que le Champ de protection est en pointillé et je n’ai pas aujourd’hui la maîtrise de la taille du pointillé.
Quand Simon prend conscience d’une difficulté, je lui pose la question de l’intention pour identifier de quoi il a besoin pour y faire face. En guise de réponse Simon dessine une Loupe Puis il écrit un commentaire : Permis pour une des Flèches et Interdit sur l’autre, accompagné d’un panneau d’interdiction.
Simon continue à penser à voix haute. Il réalise que même une Loupe ne lui permettrait pas de maîtriser le contenu des échanges car : Si l’autre veut à tout prix se faire entendre, je dois mettre plus d’interdit. Alors il rajoute sa nouvelle solution. La ligne devient continue avec un Gros Sens Interdit. Simon ajoute : Le Sens Interdit veut dire que je ne suis pas là !
Après d’autres questions que je lui ai posées en l’accompagnant dans le processus d’auto-modélisation, Simon arrive à la conclusion qu’aucune des solutions n’est pas satisfaisante. En fin de compte, il aimerait retourner dans la Boîte noire.

Au fur et à mesure que Simon explore son Paysage métaphorique, il prend conscience que toutes les solutions qu’il imagine s’avèrent inefficaces. Il s’enferme dans l’impasse de la Boîte noire !
Chercher la Métaphore systémique
En tant que facilitatrice, je me fixe un nouveau cap : inviter Simon à prendre du recul et découvrir le schéma de fonctionnement à travers une métaphore systémique. Concrètement je résume les principaux évènements symboliques avant de poser la question pour susciter une métaphore. En guise de réponse Simon prend une nouvelle feuille et fait un dessin :
– C’est comme un Automobiliste qui ne signalerait pas ses intentions, ne mettrait pas ses clignotants, ne mettrait pas ses phares, dont les feux de freinage ne marcheraient pas. C’est comme une absence de signalisation !
Pour accompagner la métaphore systémique, je vais développer de nouveaux symboles, en commençant par l’Automobiliste.
Métaphore systémique : Camion de nitroglycérine
– L’Automobiliste, c’est quelqu’un qui conduit un très… très… gros camion transportant de la nitroglycérine. C’est un camion qui ne peut pas tourner vite, comme quelqu’un qui a une grosse inertie derrière lui… et donc il ne peut pas manœuvrer… ni freiner en quelques mètres.
La métaphore systémique représente l’Automobiliste conduisant un très gros Camion de nitroglycérine sur une route où il croise d’autres automobilistes. Elle révèle un nouveau problème : le Camion ne peut ni manœuvrer ni freiner en quelques mètres.
À l’annonce du problème, je demande à Simon ce qu’il aimerait qu’il arrive dans cette situation (question de l’Intention). Comme réponse, Simon inscrit une Distance de sécurité sur son dessin et le commente : L’Automobiliste aimerait qu’on lui laisse un espace pour qu’il puisse manœuvrer !
La Métaphore systémique
Quand la métaphore représente un schéma de fonctionnement, elle devient systémique. Voici ses applications en Modélisation
Symbolique :
✓ Identifier un schéma de fonctionnement récurrent.
✓ Faire le lien entre les interactions et leurs conséquences
✓ Révéler l’intention positive et des symboles.
✓ Tenir compte des objections pour négocier les solutions
✓ Tester et ajuster les solutions dans la durée.
Trouver des solutions métaphoriques
Les solutions vont émerger de la négociation entre les symboles dans la logique de la métaphore. Je commence la nouvelle série de questions en commençant par les conditions de changement :
Qu’est-ce qui doit se passer pour qu’on laisse un espace pour que l’Automobiliste puisse manœuvrer ?
Ensuite, je poursuis le processus, en posant d’autres questions ciblées sur les possibilités, les ressources nécessaires et les effets de chaque solution. Revenons à Simon qui poursuit sa réflexion en commentant ce qu’il dessine :
– Le Processing (réflexion en cours), et des Capteurs et un Curseur… Et il y a, pour accueillir ces capteurs… et ouvrir ces capteurs… et ce processus n’est pas là aujourd’hui. Il manque une partie…
Simon est totalement engagé dans le processus de créativité, où il réfléchit à haute voix, se pose lui-même des questions et y répond en dessinant ses réponses :
– Puisqu’on reste dans la métaphore du Camion, c’est comme si le Processing (réflexion en cours) mangeait trop d’énergie. On pourrait dire qu’il y a une barre là, le Processing, qui est à 80 % en consommation. Je mets une barre là : les Filtres, qui serait à 10 %. C’est-à-dire je mets 10 % de mon énergie à filtrer pour avoir une interaction raisonnable.
Il teste cette partie de la solution en simulant son fonctionnement :
– Si je peux laisser le Processing à 80 % et alors je vais monter le curseur d’Interagir à 10 %. Le problème, ce que je ne suis pas sûr que je le souhaite !
Comme une objection apparaît, je ne la laisse pas passer sans demander à Simon ce qu’il veut par rapport à elle. Simon réfléchit et trouve une astuce qu’il dessine en bas du dispositif : J’aimerais qu’il y ait un lien qui me permette d’affecter la puissance. Un équaliseur, quoi !
Solutions : Équaliseur et respiration
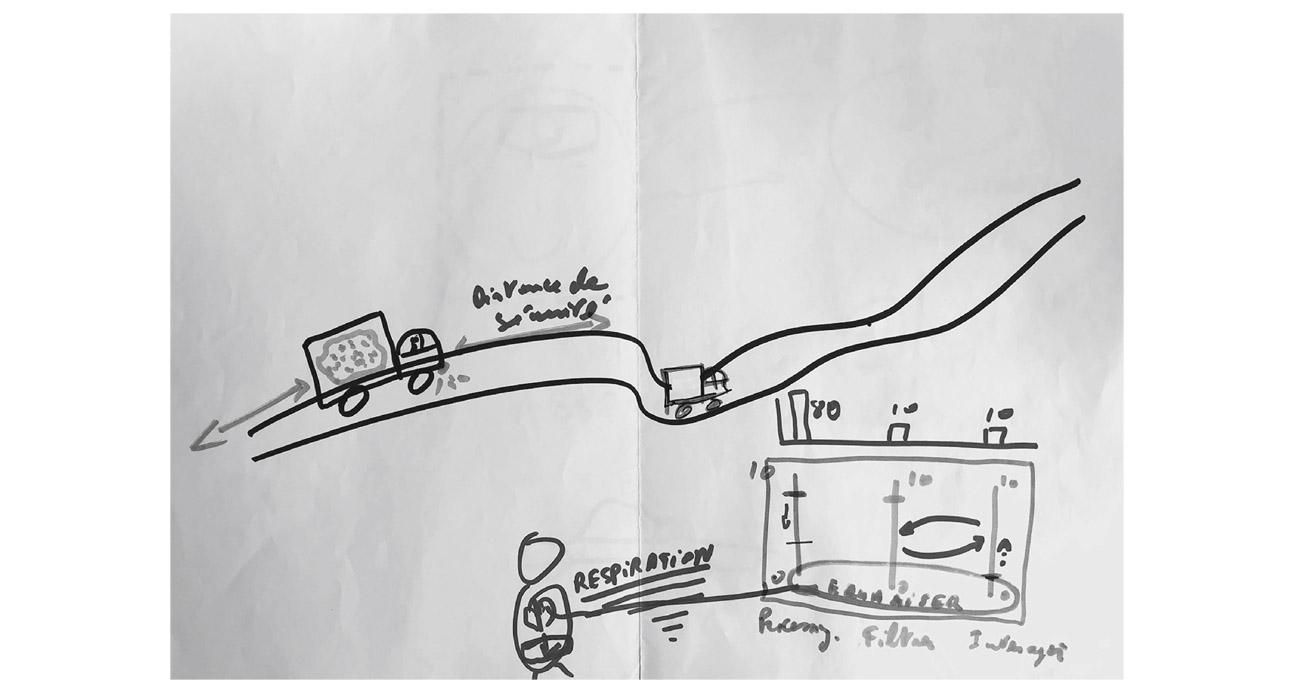
De l’Équaliseur viendrait la solution ? Patience, nous allons bientôt le savoir… car Simon justifie son choix : – C’est un Équaliseur qui me permet de dire OK, toi ici, tu peux baisser ton énergie, je ne t’arrête pas. Toi tu peux consommer moins, toi tu peux consommer plus. Sans l’Équaliseur cela ne peut pas marcher. Parce que l’Équaliseur a un lien avec tout. Sans lui il n’y avait pas de lien entre cela et cela et cela.
Simon semble satisfait de l’Équaliseur qui régule les échanges relationnels en préservant sa capacité de concentration. Afin de trouver les ressources dont il a maintenant besoin pour cela, je lui demande d’où pourrait venir l’Équaliseur ? Alors il dessine une silhouette avec des poumons et répond : … De la respiration. La respiration s’avère une ressource suffisante pour mettre en place l’Équaliseur et répartir son énergie de manière équilibrée entre lui et ses relations, ce qui lui permet de préserver la concentration. Le Dispositif de sécurité semble achevé.
Vous avez vu que la recherche de solutions suit la logique de chaque métaphore. Quand la métaphore se transforme, les solutions sont différentes. Par exemple La Boîte noire de Simon fait émerger des solutions mécaniques : le Champ de Protection et le Gros Sens Interdit. Quand l’Automobiliste au volant du Camion de nitroglycérine
émerge sur une route, la quête de solutions change d’orientation en devenant systémique. Elles ne sont plus dans le Champ de Protection de soi, mais dans le Champ des interactions avec les autres.
Simon s’arrête de dessiner, reprend contact avec la réalité de l’instant en me regardant droit dans les yeux pour me dire : Je ne veux pas aller plus loin aujourd’hui. Le ton de la voix devient plus fort, le débit de la parole s’accélère, le regard n’est plus focalisé sur le dessin ni perdu dans le vague, mais cherche un contact visuel avec la facilitatrice que je suis. Je capte ces indices qui valident le retour de mon client dans le réel, où le cerveau gauche reprend la main.
Atterrir
La Modélisation Symbolique permet au client non seulement d’explorer son propre fonctionnement, mais aussi réaliser une carte mentale qui lui permet de mieux se comprendre. Quand le client explore son Paysage métaphorique et interroge ses symboles pour découvrir leurs freins, leurs ressources et leurs solutions, il crée une carte mentale. Le Paysage métaphorique est psychoactif dans le sens où toutes les transformations modifient ses processus de pensée.
D’abord, le Paysage métaphorique permet de mettre au jour sa carte mentale. Il fournit les clefs du pourquoi et comment le quelqu’un se comporte d’habitude. Par exemple, Simon met au jour son fonctionnement habituel à travers la métaphore de la Boîte noire, où il a tendance à s’enfermer pour se préserver sa capacité de concentration en devenant opaque pour ses collaborateurs.
Ensuite, Simon change de regard sur les interactions avec les autres en se mettant au volant du Camion de nitroglycérine. Quand il change de métaphore, il cherche des solutions pour équilibrer les échanges avec son environnement relationnel. Il imagine un dispositif systémique qui régule l’énergie qu’il consacre à la concentration et aux relations.
Il crée ainsi une mise à jour de sa carte mentale qui lui permet d’atteindre son but, de concilier ses besoins personnels et relationnels. Il résout, ce faisant, son dilemme de ne pas avoir à choisir entre l’un ou l’autre. Sa nouvelle stratégie, comprenant un équaliseur et la respiration, modifie sa carte mentale exactement comme une carte routière qui indique de nouveaux itinéraires. Pour terminer la session, je propose à Simon le retour dans le réel sous forme de la Question Sextuple Mon but de de lui faire prendre conscience de ce qu’il a appris sur le processus de l’automodélisation. Pour ce faire, je rappelle textuellement à Simon ce qu’il attendait de sa séance : Préserver le mécanisme protecteur de concentration et améliorer les relations avec mes collaborateurs.
Simon note ses réponses en silence :
1. Réfléchir en mode Boîte noire, c’est vital pour moi.
2. Je lui donne toutes les priorités.
3. C’est nuisible aux relations.
4. Ce serait bien de mettre plus de fluidité.
5. Pour cela, il me faut un peu de ressources et générer une distance de sécurité.
6. En respirant, je peux trouver le calme et la capacité à communiquer sur ce qui se passe en moi.
Quand je demande à la fin quelle différence cela fait de le savoir maintenant, il répond avec un sourire moqueur : Je peux tranquillement me laisser envahir par mes ruminations. Il rajoute ensuite ce qu’il va faire à partir de maintenant en quatre points : D’abord je décide si j’accepte de rentrer en relation :
– Si oui, je vais jouer le jeu en diminuant comme ceci (et il me montre qu’il baisse le curseur de Filtre sur le Dispositif de sécurité).
– Je vais aussi me limiter à une conversation légère et mondaine.
– Je vais surtout éviter les sujets qui sollicitent une réflexion de ma part quand ma tête est déjà prise par la mienne.
2
– Et avant tout, je vais respecter le besoin de rester seul pour réfléchir.
Je quitte ce jour-là un Simon que la séance a bousculé, mais aussi un Simon qui a quelque chose de changé dans le regard. Un rendez-vous est pris dans sept jours afin de clore cette séance. Il est essentiel de mettre du temps entre les deux séances. Simon doit revisiter, intégrer, s’approprier ce que la pensée inconsciente a fait émerger et les solutions qui en ont découlé.
En Clean Coaching, nous considérons que le processus commence pendant la séance et continue son travail de transformation les jours suivants, parfois plus longtemps. Il se traduit par des changements qui s’intègre dans la réalité courante.
À la rencontre suivante, Simon fait le point et je lui laisse la parole : Globalement, je me rends compte que j’accorde beaucoup d’importance à ce processus et que je veux le protéger Cela me montre aussi que je n’étais pas conscient de l’importance que je lui accordais. N’étant pas conscient de cela, j’acceptais les interactions que peut-être je ne devais pas accepter. Si je n’ai pas le choix pour avoir l’interaction, je vais pouvoir annoncer cela, en disant, attention, quelque part il y a ma boîte noire qui est mise en route et je ne suis pas disponible pour des choses sérieuses.
Je ne dis rien et reste sur le seuil de son modèle du monde. Tout cela appartient à Simon, je n’ai ni à juger ni à commenter. La Modélisation Symbolique est un merveilleux véhicule pour voyager au pays de son monde intérieur.
6 LA MODÉLISATION SYMBOLIQUE CÔTÉ FACILITATEUR
Vous ne pouvez rien apprendre à quelqu’un Vous pouvez seulement l’aider à trouver par lui-même Galilée
NOUS ÉTIONS DANS LE CHAPITRE PRÉCÉDENT du côté du client. Nous partons maintenant du côté du facilitateur pour découvrir comment j’accompagne Simon dans le processus d’auto-modélisation avec la Modélisation Symbolique.
Pour le facilitateur, la Modélisation Symbolique est une méthode de facilitation d’un processus, où le client procède à une auto-modélisation de son mode de fonctionnement
UNE SÉANCE DE MODÉLISATION SYMBOLIQUE
Pour vous faciliter la compréhension de la Modélisation Symbolique version coach, nous allons commencer par le déroulement des principaux évènements d’une séance, celle de Simon.
Les étapes de la séance de Simon
2.1
Métaphore Personnelle
2.2
Symboles
Simon note par écrit son intention pour la séance qui remplace l’objectif en Clean Coaching :
– Préserver mon mécanisme protecteur de concentration et améliorer les relations avec les collaborateurs.
La recherche de la métaphore se fait en posant des questions sur le mécanisme protecteur et aboutit à un premier dessin de la métaphore : La concentration c’est comme la digestion.
En posant les questions sur les éléments de la métaphore visuelle, on développe trois symboles successifs, dont la signification est donnée au fur et à mesure que Simon répond aux questions.
La Boîte noire = Concentration
Les Flèches = Relations
Le Cercle rouge = Conflit entre les deux symboles
3.1
Le Paysage Métaphorique
L’exploration des relations entre les symboles rend la métaphore psychodynamique. Elle se transforme en Paysage métaphorique, où apparaissent successivement :
– le Champ de Protection,
– la Loupe pour filtrer,
– le Gros Sens Interdit
La dernière solution, le Gros Sens Interdit conduit Simon dans l’impasse de la Boîte noire
3.2
Métaphore de schéma
Simon prend de la hauteur et voit le schéma de son fonctionnement grâce à une nouvelle métaphore qui émerge du Paysage : C’est comme un automobiliste qui ne signalerait pas ses intentions en conduisant un très-très-gros camion transportant de la nitroglycérine !
4. Solutions
Simon trouve des solutions en dessinant un dispositif à plusieurs composantes :
– un Dispositif de sécurité pour garder une distance avec les autres ;
– un Équaliseur de régulation d’énergie ;
– la Respiration qui se révèle être une ressource pour mettre en place l’Équaliseur.
Simon semble satisfait du résultat et décide de s’arrêter
5.
Simon récapitule ce qu’il a appris dans la séance et met à jour sa
1. Intention de la séance
Atterrissage carte mentale.
Ainsi le processus de l’auto-modélisation de Simon ressemble à un chemin en spirale, où chaque étape permet de découvrir des nouveaux aspects de son Paysage métaphorique.
LA BOUSSOLE DE LA MODÉLISATION SYMBOLIQUE
Le facilitateur dispose d’un outil qui lui permet de suivre la dynamique du processus tout en gardant le cap de l’objectif.
La boussole de Modélisation Symbolique
La Boussole est une carte stratégique qui permet de dérouler le processus étape par étape :
1. Cadrer l’Intention.

2. Développer la Métaphore personnelle.
3. Explorer le Paysage métaphorique.
4. Négocier les Solutions.
5. Atterrir et planifier les Actions.
Par la suite nous allons utiliser des abréviations pour reconnaître les questions du Clean Language.
Les types de questions du Clean Language
Les questions Clean sont nommées selon le type d’informations qu’elles cherchent à révéler. Par exemple nous utilisons la lettre T pour les questions concernant le Temps, etc.
A – Attribut : Quel genre de X est-ce ? Y a-t-il autre chose à propos de X ?
L – Localisation : Où est ce X ?
M – Métaphore (Nommer un symbole) : c’est comme quoi ?
R – Relation : Y a-t-il une relation entre X et Y ?
T – Temps : … qu’est ce qui se passe avant ? … ensuite ?
S – Source : D’où pourrait venir X ?
I – Intention : Qu’aimerais-tu qu’il arrive ? Qu’aimerait le Symbole X qu’il arrive ?
C – Conditions : Que doit-il se passer pour que cela arrive ?
E – Effets : Qu’est-ce qui se passe ensuite ? et ensuite ?
Nous allons maintenant parcourir à nouveau la séance de Simon avec des commentaires méthodologiques en suivant les cinq repères de la Boussole.
L’INTENTION
DE LA SÉANCE
Qu’est-ce que le Clean Start ?
Il s’agit d’un rituel où le client décide du choix des places. Ainsi le client prend symboliquement la responsabilité du processus dont il
1 1
fixe le cap. Je pose les questions suivantes :
• Où voulez-vous vous asseoir maintenant ?
• Où voulez-vous que je me place moi-même ?
Cela signifie que c’est le client qui décide sur quoi il veut travailler et jusqu’où il est prêt à aller. En effet, faire confiance au client et respecter son timing est primordial. Il arrive que la résistance au changement se produise quand on ne donne pas au client le temps dont il a besoin pour changer à son rythme.
Plus tard, le vouvoiement fera place au tutoiement. Dès la première séance, nous avons convenu avec Simon de nous tutoyer ce qui est une pratique courante en Clean Coaching car cela rend les questions plus directes.
Donner l’information
Pour mettre à l’aise, j’explique en quelques mots la méthode avant de commencer la séance Clean :
Je vais vous poser des questions qui peuvent paraître bizarre. Mais grâce à elles vous allez trouver votre métaphore personnelle et découvrir d’autres aspects de ce qui vous préoccupe. C’est une manière de voyager à l’intérieur de soi pour avoir des informations qu’il serait difficile d’avoir autrement et qui vous permettront de trouver vos solutions.
Si c’est un client en cours de coaching, je demande ce qui s’est passé depuis la dernière séance. Parfois, le rappel des objectifs précédents sert à mesurer le chemin. En effet, les changements s’intègrent d’une manière naturelle dans la vie et ces questions permettent de réaliser les progrès ou la disparition de ce qui posait problème et était sujet d’une des séances précédentes.
Même si le client est déjà familier de l’approche, comme c’est le cas de Simon, je vais présenter le déroulement du processus :
Je te fais la proposition de voir à quoi te sert ce mécanisme de protection. Tu connais le principe de Modélisation symbolique. On fait une sorte d’état présent sous forme de métaphore qui reflète par
analogie ton fonctionnement. Et puis au fur et à mesure que tu chemines, tu apprends à cartographier le schéma de tes comportements et de tes valeurs sous une forme métaphorique. Quand ce sera le moment pour toi, tu décideras ce que tu veux en faire : le garder tel quel en le connaissant mieux, le mettre à jour ou le modifier.
Définir l’objectif
En Clean Coaching, le facilitateur ne cherche pas la bonne formulation de l’objectif, il pose juste la question de l’Intention. Elle semble mieux adaptée pour rencontrer le client dans son état d’esprit, ses préoccupations, son ressenti émotionnel, ses attentes. Et par la suite l’accompagner dans la transformation de l’objectif initial.
Question de l’Intention
Pour définir l’intention de la séance, le facilitateur pose au client la question de l’Intention :
✓ (I) – Qu’aimerais tu qu’il arrive maintenant ?
✓ … dans ta vie ?
✓ à l’issue de la séance ?
✓ … par rapport à ce qui vient d’être dit ?
Prenons le cas de Simon. Il sait analyser son comportement et donne des explications rationnelles sur l’origine de son problème et sur les stratagèmes qu’il utilise pour le contourner :
Dans mon fonctionnement habituel la relation prime toujours. Ce qui fait que je ne suis pas sûr d’avoir la ressource pour me recentrer Et ce mécanisme-là est pour moi un mécanisme protecteur parce qu’il me permet, quand j’ai quelque chose d’important sur lequel il faut que je sois concentré, de m’abstraire de la relation.
L’inconvénient, c’est que je m’en abstrais trop durement.
Je m’accorde au discours rationnel avant de le guider vers le raisonnement métaphorique, apanage du cerveau droit. Pour ce
faire, je reprends ses dernières paroles pour canaliser son attention sur l’état présent et demander ce qu’il aimerait qu’il arrive pendant la séance :
I –… dans ton fonctionnement normal la relation prime toujours… ce qui fait que tu n’es pas sûr d’avoir la ressource pour te recentrer… et il a un mécanisme protecteur qui te permet de t’abstraire de la relation... et l’inconvénient c’est que tu t’en abstrais trop durement…, et étant donné tout cela, qu’aimerais-tu qu’il arrive maintenant ?
– J’aimerais préserver le mécanisme protecteur de concentration et améliorer les relations avec mes collaborateurs.
À partir de cette réponse, où Simon définit ce qu’il attend de la séance, nous passons à l’étape suivante.
LA MÉTAPHORE PERSONNELLE
Dans l’échange qui va suivre, je vais repartir de la dernière réponse de Simon pour poser la question suivante. Pas toute la réponse, mais seulement certains éléments.
Poser la question par rapport à la dernière réponse, verbale ou non verbale
✓ Prenez un élément significatif de la dernière réponse.
✓ Repérez un indice non verbal qui met en relief un élément de réponse : la direction du regard, le ton de la voix, un mot qui revient souvent, un geste suggestif
✓ S’il y a un dessin, demandez à l’intéressé ce qui attire son attention.
Rappelez-vous de la syntaxe à trois niveaux (chapitre 4). Au début, je vais utiliser la syntaxe complète, puis au fur et à mesure que Simon rentre dans le processus d’auto-modélisation, où il fait corps avec sa métaphore et ses symboles, je vais la réduire à un ou deux segments. Tout le long de l’accompagnement, je vais utiliser les mots exactement tels qu’ils ont été formulés par Simon.
La syntaxe à trois niveaux
1. Pour attirer l’attention, commencez la phrase par la conjonction… et pour indiquer la continuité avec la dernière réponse du client. Ensuite répétez simplement les mots sur lesquels vous voulez attirer l’attention du client ;
2 Pour focaliser l’attention, dites… quand, suivi des mots sur lesquels vous allez poser la question ;
3. Posez la question, précédée d’une suspension de voix et suivie d’un silence.
Simon continue ses explications rationnelles : Quand je réfléchis, je réfléchis intensément. Parfois rien ne sort de la réflexion. Ce n’est pas une réflexion consciente étape par étape. C’est souvent une réflexion globale comme dans une boîte noire. Et donc à ce moment-là, il n’y a rien qui sort, mais j’ai besoin que rien ne rentre non plus. Le processus de réflexion est en cours et toute information qui arriverait de l’extérieur perturberait le processus.
Pour assister Simon dans la recherche d’une métaphore personnelle, je formule la question en utilisant la syntaxe à trois segments :
M –… et tu réfléchis intensément… et ce n’est pas une réflexion consciente étape par étape… mais une réflexion globale comme dans une boîte noire… et quand le processus de réflexion est en cours et que toute information qui arrive perturbe le processus, et cela ressemble à quoi ?
Simon se tait, et au bout d’un long silence répond : c’est comme la digestion…
Puis il continue dans la logique de la métaphore : c’est très long de digérer la viande, entre six et neuf heures pour digérer la viande dans l’intestin. Si tu amènes un aliment sucré à cette digestion, il y a une collision entre les deux qui crée une fermentation et perturbe le système digestif. C’est comme si la relation, c’était du sucré, et comme si la réflexion profonde, c’était une protéine qu’il me faut longtemps pour digérer et assimiler et qu’il ne faut surtout rien d’autre à côté…
Quelques indices me disent que Simon est associé à sa métaphore personnelle. Il ne cherche plus de contact visuel avec moi, il regarde devant lui et mime par gestes ce qu’il perçoit de sa métaphore.
Quand la métaphore personnelle se manifeste…
✓ Le rythme de parole change, le corps s’anime et bouge.
✓ Les mains s’animent et miment ce qui se passe dans la métaphore
✓ Le regard se promène dans l’espace comme s’il voyait des images.
À ce moment-là, je demande à Simon de faire un dessin.
Le dessin est une technique qui permet de visualiser, sur un support physique, la métaphore que l’on a en tête. En tant que coach, je l’intègre régulièrement dans les séances car il joue un rôle simplificateur et permet des interventions minimalistes. Faire dessiner nos clients pendant les séances est un complément à la métaphorisation. Nous avons constaté son efficacité pendant les séances d’entraînement en groupes de pratique, animés par Jennifer De Gandt à Paris. Je l’enseigne depuis à d’autres facilitateurs en France et à l’étranger sous le label de la French Touch.
Le dessin, support visuel
En devenant un support visuel, le dessin permet de poser les questions sur les éléments qui y figurent
✓ Demandez au client ce qui attire son attention.
✓ Repérez un indice non verbal, tel que le ton de la voix, une ponctuation particulière qui met en relief un élément du dessin
✓ Désignez par geste un élément du dessin sans le toucher ;
✓ Posez la question en utilisant le pronom « ça » : Quel genre de ça est-ce ?
Y a-t-il une relation entre ça et cela ?
À partir du moment où Simon met en dessin sa métaphore, je vais diriger mes questions sur les éléments dessinés en me basant sur les indications qu’il me donne verbalement et non verbalement.
Développer trois symboles
N’importe quel élément de la métaphore (terme, expression verbale ou non verbale comme un geste, un bâillement, la direction du regard, etc.) peut être différencié par le questionnement et devenir un Symbole.
Le symbole métaphorique
Le symbole est porteur de sens. Il représente un obstacle, une ressource, une compétence, une valeur, une partie de soi… Il est reconnaissable à trois critères :
✓ Il a une forme sensorielle : forme, couleur, sonorité, texture
✓ Il est localisé dans l’espace, à l’intérieur ou à l’extérieur de soi.
✓ Il a un nom
Afin que la métaphore révèle à Simon son contenu symbolique, je vais développer trois symboles à partir son dessin avec les questions de développement A-L-M.
Questions A-L-M
✓ A – Les questions d’Attributs permettent de découvrir les traits caractéristiques : Quel genre de X est ce X ?
✓ L – La question de Localisation, comme son nom indique, permet d’identifier le lieu dans l’espace réel ou imaginaire : Où est-ce (précisément) X ?
✓ M – La question, appelée Métaphore, permet de trouver une métaphore ou nommer un symbole : Et quand… (en résumant les réponses) c’est comme quoi ?
Revenons à Simon qui a dessiné une tête, un rectangle sur le front, un point d’interrogation et deux flèches. Quand je lui demande
de commenter le dessin, il désigne d’abord les deux flèches puis le rectangle noir :
Simon – Il y a moi, il y a mes relations… et je suis en même temps en réflexion. Et donc je suis avec une espèce de mécanisme de Boîte noire…
Je lui montre du doigt la Boîte noire :
A – Y a-t-il autre chose à propos de la Boîte noire ?
Simon tout en poursuivant sa réflexion – la Boîte noire, c’est là où je réfléchis, me concentre et rumine…
A – … la Boîte noire où tu réfléchis, te concentre et rumine, et y a-til autre chose à propos de la Boîte noire ?
Simon comme s’il pensait tout haut – … la relation extérieure et la Boîte noire sont incompatibles.
T – … quand la relation extérieure et la Boîte noire sont incompatibles, qu’est-ce qui se passe ensuite ?
En guise de réponse, Simon dessine un carré autour de la tête avant de le commenter – Et donc je mets une espèce de protection qui s’étend sur la Boîte noire. Je la mets en pointillés, parce que ce n’est pas aussi fermé que la précédente, mais elle filtre énormément. Elle protège. C’est une espèce de champ de protection.
Zoom sur un symbole
Quand, dans le processus du questionnement, un nouvel élément significatif apparaît, je fais un arrêt sur l’image, pour le développer et révéler son contenu symbolique. Cela ressemble à faire un zoom sur un élément d’image pour l’agrandir et en faire une photo. En Modélisation symbolique, on zoome avec les questions A-L-M et les questions spécialisées.
Questions spécialisées
✓ A – Est-ce que X a une forme ? Taille ? Couleur ? Texture ?
✓ A – Quel âge pourrait avoir X ? Comment est-il habillé ?
✓ A – Quel genre de X était-il avant ?
✓ L – Où est-ce précisément ? Dedans ? Dehors ?
✓ L – Où cela pourrait être ?
✓ R – Quel genre de relation est-ce ?
✓ R – Quel genre de relation pourrait être entre X et Y ?
✓ T – Et quand X, qu’est ce qui arrive à Y ?
Pour illustrer la manière dont je pose des questions de développement, j’attire l’attention de Simon sur le dernier élément de sa réponse :
A – Et le Champ de protection a-t-il une taille ou une forme ?
Simon – Il est carré, juste plus gros que ma tête.
Simon, après un temps de réflexion, vient de tracer un carré en pointillé autour de la tête :
Et donc je mets une espèce de protection qui s’étend sur la boîte noire. Je la mets en pointillé, parce que ce n’est pas aussi fermé que la précédente, mais elle filtre énormément. Elle protège. C’est une espèce de Champ de protection. Ce que m’apprend ce dessin, c’est que le Champ de protection est en pointillé et je n’ai pas aujourd’hui la maîtrise de la taille du pointillé.
L’auto-modélisation
Simon, en donnant une signification à un symbole, le Champ de protection, crée un repère dans sa carte mentale. Il est en train de s’auto-modéliser. Autrement dit, il explore son mode de fonctionnement pour en faire une carte mentale et des repères, ses symboles pour se connaître et devenir un manager conscient de luimême.
✓ Le client explore son mode de fonctionnement pour en faire une carte mentale et des repères de valeurs, ses symboles.
✓ Il apprend à mieux se connaître pour devenir un manager conscient de lui-même, de ses valeurs, de ses ressources et de ses besoins.
✓ Il découvre comment trouver ses propres solutions et les mettre en œuvre en accord avec son modèle du monde
Dans un processus d’auto-modélisation symbolique, les réponses viennent sous forme d’images, de sensations et d’associations d’idées. Par exemple, Simon dessine avant de répondre comme si la réponse se matérialisait d’abord dans le dessin. Comme si sa main savait la réponse avant sa tête. Le rythme de réponse est au ralenti, le silence précède les paroles. C’est une forme de transe, les yeux ouverts, où il est connecté au niveau de la pensée inconsciente.
La transe les yeux ouverts
✓ Le client semble être dans un état proche d’une transe, en gardant les yeux ouverts.
✓ Il monologue en parlant à voix haute
✓ Le rythme de parole est différent du rythme normal, parfois plus rapide ou plus lent, voire très lent.
✓ Les réponses se matérialisent dans le dessin ou par geste avant d’être verbalisées
✓ Le client poursuit tout seul le processus jusqu’à ce qu’il s’arrête en attendant la question suivante.
✓ Alors il rétablit le contact visuel en attente d’une question
Dans la session avec Simon, je pose relativement peu de questions et j’écoute sans l’interrompre en posant mon regard soit sur le dessin, soit dans l’espace, là où il y a l’information. Mes questions sont de simples repères qui orientent l’attention de Simon sur tel ou tel aspect de sa métaphore et incitent à aller plus en profondeur. Quand je module ma voix, quand je répète ses propres
Le processus d’auto-modélisation
mots, quand j’adapte la syntaxe au rythme du processus de l’automodélisation, je guide l’esprit de Simon vers la profondeur de la pensée.
Pour d’autres clients, il est nécessaire, surtout en phase de démarrage, d’accompagner le processus avec la syntaxe complète et les questions spécialisées.
LE PAYSAGE MÉTAPHORIQUE
Après avoir différencié plusieurs symboles métaphoriques, je passe à l’étape suivante pour explorer leurs relations et interactions à travers l’espace et le temps. Pour ce faire je vais introduire une nouvelle série de questions : Relations/Temps/Source.
Questions d’exploration R-T-S
✓ R – Y a-t-il une relation entre X et Y ?
✓ R – Quel genre de relation est-ce ?
✓ R – Quand X, qu’est ce qui arrive à Y ?
✓ T – Quand X, qu’est-ce qui se passe ensuite ?
✓ T – Quand Y, qu’est-ce qui se passe avant ?
✓ S – D’où pourrait venir X ?
Quand Simon commence à explorer la dynamique des relations à travers l’espace et à faire bouger les symboles dans le temps, la métaphore devient psychodynamique et se transforme en Paysage métaphorique. Pour sentir la différence, imaginez que la métaphore est une photo tandis que le Paysage métaphorique est une scène de théâtre, où les symboles jouent leurs rôles, tels des acteurs qui tissent des relations, interagissent, parfois s’opposent, parfois unissent leurs forces et ressources pour réaliser leurs buts en commun. Quand les Symboles révèlent leurs intentions, ils donnent des clefs des solutions métaphoriques.
T – Et quand tu n’as pas la maîtrise de la taille du pointillé, qu’est-ce qui se passe ensuite ?
Simon en dessinant – Là, se serait intéressant de faire une Loupe.
Un nouvel élément émerge dans le paysage, je pose quelques questions en zoomant pour le développer :
A – … Y a-t-il autre chose à propos de la Loupe ?
Simon – La Loupe qui me dit comment je fais pour être le maître… pour décider en fin de compte ce qui passe et ce qui ne passe pas. Pour décider ce qui sera coincé et ce qui va pouvoir passer dans les deux sens… c’est-à-dire ce qui est permis et ce qui est interdit…
R – … Y a-t-il une relation entre la Loupe et l’Interdit ?
En réponse Simon dessine un panneau de sens interdit. Alors je désigne du doigt ce dernier pour le questionner :
A – … Y a-t-il autre chose à propos de ça ?
Simon – … Euh, c’est par rapport aux relations. Par exemple, cela va être permis de dire des blagues, de parler de la pluie et du beau temps. Cela va être interdit d’aborder des choses qui nécessiteraient la réflexion ou qui présupposent un traitement de l’information de ma part. Et du coup une écoute réelle de l’autre ne m’est pas permise à ce moment-là.
T – Quand une écoute réelle de l’autre ne m’est pas permise à ce moment-là, qu’est-ce qui se passe ensuite ?
Simon – Il se passe que si l’autre veut à tout prix se faire entendre, je mets encore plus d’interdit. Donc la ligne, au lieu d’être discontinue, elle devient continue avec un Gros Sens Interdit.
A – Et quand la ligne devient continue avec un Gros Sens Interdit, y a-t-il autre chose à propos du Gros Sens Interdit ?
Simon – Ce Gros Sens Interdit signale que je ne suis pas là car je n’ai pas la ressource…
Quand Simon comprend le sens du symbole, le Gros Sens Interdit, j’interroge le besoin qui s’y cache :
I – Et quand le Gros Sens Interdit signale que tu n’es pas là, qu’aimerait-il qu’il arrive ?
Simon – Il aimerait retourner dans la Boîte noire.
La métaphore systémique
Simon prend conscience que toutes les mesures correctrices se révèlent inefficaces et il a envie de s’enfermer dans l’impasse de la Boîte noire. Il rencontre une difficulté récurrente car ne sait ni concilier ni choisir entre le mécanisme protecteur de concentration et l’amélioration des relations avec ses collaborateurs.
La métaphore systémique permet de représenter un schéma récurrent qui entrave la possibilité de changement (conflits, dilemme, impasse, paradoxe)
Pour ce faire, j’utilise la technique de back-tracking, où je rappelle, en revenant en arrière, des symboles et des informations représentées sur le dessin avant de poser la question pour faire émerger une nouvelle métaphore : … et il – y a la Boîte noire, les Flèches, la Loupe pour filtrer les relations, le Champ de protection dont tu ne maîtrises pas la taille du pointillé, le Gros Sens Interdit… et il aimerait retourner dans la Boîte noire… et quand tout cela… cela ressemble à quoi ?
Le back-tracking
Cette technique de facilitation permet de faire des allers et retours dans le Paysage métaphorique. Pour ce faire, le facilitateur résume une série de réponses avant de poser la question Clean.
Simon prend une nouvelle feuille de papier et commence à dessiner une nouvelle métaphore en commentant au fur et à mesure qu’elle émerge : c’est comme un automobiliste qui roule sans freins ni clignotants…
Et tout comme pour une nouvelle métaphore, je recommence à la développer avec les questions d’attributs. Ensuite j’enchaîne en utilisant une technique d’exploration stratégique : les Vecteurs.
Les Vecteurs
Cette stratégie de questionnement s’inspire de la navigation. Le navigateur change parfois de direction, en fonction de la météo et du vent, mais il garde le cap de la destination. De même, le facilitateur garde le cap de l’intention et pose plusieurs questions de suite pour…
✓ Identifier l’intention de la séance.
✓ Différencier un symbole métaphorique.
✓ Explorer les relations entre les symboles.
✓ Évaluer l’impact d’un évènement métaphorique
✓ Faire émerger une métaphore de schéma.
✓ Découvrir l’origine de difficultés
✓ Traiter une objection.
✓ Constater des effets dans le temps
A – … Quel genre d’Automobiliste est cet Automobiliste ?
Simon – Un Automobiliste qui ne signalerait pas ses intentions, ne mettrait pas ses clignotants, ne mettrait pas ses phares, dont les feux de freins ne marcheraient pas. C’est comme une absence de signalisation.
T – Et quand il y a une absence de signalisations, qu’est-ce qui se passe ensuite ?
Simon – Cela devient une conduite passionnelle et dangereuse.
T – Et quand la conduite est passionnelle et dangereuse, qu’est-ce qui se passe ensuite ?
Simon – L’Automobiliste est comme quelqu’un qui conduit un très, très, gros camion transportant de la nitroglycérine. Un camion qui ne peut pas tourner vite ni freiner en quelques mètres. Comme quelqu’un qui a une grosse inertie derrière lui et donc il ne peut pas manœuvrer…
Je viens de poser une suite de questions en suivant le Vecteur de Temps pour laisser Simon explorer les conséquences d’une conduite en l’absence de signalisation.
Le Paysage métaphorique est une carte mentale dynamique qui permet de simuler le fonctionnement dans le temps, de prévoir les conséquences et d’imaginer des actions correctrices C’est ce qui va arriver à Simon, qui découvre à travers l’Automobiliste, au volant d’un camion transportant de la nitroglycérine, la dangerosité d’interrompre le processus de concentration !
LES SOLUTIONS
À la différence de la première métaphore où Simon ne trouvait que des solutions techniques, la nouvelle métaphore lui donne accès à une vision systémique qui va l’inciter à élaborer des solutions adaptatives à son environnement relationnel. Le questionnement ressemble à une négociation pour identifier les conditions de changement, les solutions.
Questions pour trouver des solutions I-C-E
✓ I – Qu’est-ce que X aimerait qu’il arrive ?
✓ C – Qu’est-ce qui doit se passer pour que cela arrive ?
✓ C – Est-ce que X peut/veut le faire ?
✓ E – Et quand X, qu’est-ce qui se passe ensuite ? Et quand X, qu’est ce qui arrive à Y ?
I – Quand l’Automobiliste conduit un très, très, gros camion transportant de la nitroglycérine, qu’aimerait-il qu’il se passe ?
Simon note sa réponse directement sur le dessin – une distance de sécurité.
Est-ce une solution au problème de Simon ? Pour le savoir, je vais explorer avec lui les conditions de faisabilité. Cela ressemble à une négociation entre les symboles qui ont des besoins à satisfaire ou des ressources à apporter. La question qui permet d’identifier la ressource porte bien son nom de Source : S – D’où pourrait venir une distance de sécurité ?
Simon – L’Automobiliste aimerait qu’on lui laisse un espace pour qu’il puisse manœuvrer. À la limite, il pourrait être plus flexible à condition qu’il y ait un flou plus espacé.
Quand il y a un besoin qui demande d’être pris en compte, alors je pose la question de Condition :
C – Qu’est-ce qui doit se passer pour qu’il y ait un flou plus espacé ?
Simon continue à dessiner Je suis le fil de sa pensée en regardant ce qui sort sous son crayon. D’abord, il trace un carré avec trois flèches verticales qu’il nomme : Processing, Filtres et Interactions. Comme il est absorbé dans un processus de créativité, je garde le silence en attendant qu’il s’arrête pour lui poser la question :
T – Et quand Processing est à 80 %… et Filtres à 10 %… et Interactions à 10 %, et puis qu’est-ce qui se passe ?
Simon – Je peux baisser le Processing à 80 % pour augmenter les Interactions à 10 %… mais je ne suis pas sûr que je le souhaite vraiment !
Zoom pour traiter une objection
À chaque objection, il y a une solution :
✓ Qu’aimerais-tu qu’il arrive alors ?
✓ Qu’est-ce que X aimerait qu’il se passe dans cette situation ?
Continuez à questionner les conditions :
✓ Qu’est-ce qui doit se passer pour cela ?
✓ Est-ce que X peut/veut ?
✓ D’où pourrait venir X (ressource, obstacle) ?
✓ Et quand X, qu’est ce qui se passe ensuite ?
✓ … et ensuite… et ensuite… ? (Tester les effets)
Quand Simon exprime un doute, je relève son objection pour lui poser une question de l’Intention :
I – Et quand tu n’es pas sûr que tu le souhaites vraiment, alors qu’aimerais tu qu’il arrive ?
Simon (après un long silence) – J’aimerais qu’il y ait un lien qui me permette d’affecter la puissance. Un Équaliseur, quoi !
J’observe un changement dans le ton et la physionomie qui reflète chez Simon pas moins qu’une révélation. Est-ce la pièce manquante qu’il vient de trouver ? Nous allons le découvrir en quelques questions
Zoom sur une Ressource
Quand un élément significatif apparaît dans le processus, pratiquez un Zoom pour découvrir ses ressources :
✓ I – Quel genre de X est-ce ? Y a-t-il autre chose à propose de ?
✓ R – Y a-t-il une relation entre X et Y ?
✓ S – D’où pourrait venir X ?
A – Et quel genre d’Équaliseur pourrait être cet Équaliseur ?
Simon – C’est un Équaliseur qui me permet de dire ok, toi, ici, tu peux baisser ton énergie, je ne t’arrête pas. Toi, tu peux consommer moins, toi, tu peux consommer plus.
A – Y a-t-il autre chose à propos de l’Équaliseur ?
Simon – Sans l’Équaliseur cela ne peut pas marcher. Parce que l’Équaliseur a un lien avec tout. Sans lui, il n’y avait pas de lien entre cela et cela et cela.
J’entends que c’est un point au cœur du dispositif de Simon et je pose une question qui permettra de révéler la ressource.
S – Et si l’Équaliseur a un lien avec tout, d’où pourrait venir l’Équaliseur ?
Simon se tait, puis il dessine une silhouette, en même temps qu’il me répond : de la respiration qu’il inscrit en majuscules sur sa feuille.
A – Quel genre de respiration pourrait être cette Respiration ?
Simon – C’est une respiration lente et profonde.
L – Et quand la respiration est lente et profonde, où est-ce précisément ?
Simon dessine sur la silhouette une paire de poumons et une flèche vers le ventre, puis une autre flèche vers l’Équaliseur
Pour s’assurer de la viabilité de la solution je vais lui poser d’autres questions en suivant le vecteur des effets dans le temps.
Tester les effets
Pour tester la viabilité d’une solution, testez ce qui se passe à la suite de son application.
✓ T – Et quand X , qu’est ce qui se passe ensuite ? et ensuite ? et ensuite ?
✓ R – Et quand « la solution » qu’est ce qui arrive à … (objection X) ?
T – Et quand la respiration est lente, profonde et basse, qu’est-ce qui se passe ensuite ?
Simon (en simulant l’action sur le dessin) – Cela (le curseur du Processing) baisse et du coup cela (le curseur des Interactions) peut monter.
T – Et quand cela (le curseur de Processing) baisse et du coup ça (le curseur des Interactions) peut monter, qu’est-ce qui se passe ensuite ?
Simon – Il se passe qu’il y a plus de fluidité dans la relation.
T – Et quand il y a plus de fluidité dans la relation, qu’est-ce qui se passe ensuite ?
Simon – Il y a un système de régulation en place qui n’existait pas auparavant !
Pour terminer, je viens de poser une suite répétitive de questions, en suivant le vecteur-temps, afin d’amener les solutions métaphoriques à maturité. Quand elles semblent satisfaire Simon, il reprend le contact visuel avec moi et m’arrête en disant qu’il ne veut pas aller plus loin aujourd’hui.
L’ATTERRISSAGE
Quand le client estime qu’il est arrivé aussi loin que cela lui est possible au cours de la séance, il change spontanément et vous pouvez vous en rendre facilement compte car sa voix devient plus rapide, son regard change et il établit le contact visuel avec vous. Souvenez-vous des rythmes de la pensée pour faire le lien suivant.
Rythmes de la parole et de la pensée dans le processus de l’automodélisation
Pensée inconsciente
Quand le client est dans le processus de l’auto-modélisation, le rythme de sa parole est lent car il est branché sur la pensée inconsciente d’où émerge les réponses métaphoriques.
Pensée rationnelle
Quand la voix change de registre, le rythme de sa parole s’accélère pour devenir modéré, indice non verbal de retour à la pensée rationnelle et consciente.
Pensée instinctive
Elle se manifeste quand le client s’engage dans l’action
C’est le moment de boucler la séance de Simon en pratiquant la Question Sextuple. David Grove la nommait aussi comme la Question des Six Amis, à l’image des six connaissances qui vous relient à n’importe qui à travers le monde. C’est comme si vous aviez six amis qui vous apportent des réponses de votre pensée inconsciente. Des cadeaux issus de ce que vous avez appris pendant l’exploration métaphorique de votre paysage intérieur. Alors noter par écrit les réponses, c’est comme se poser de nouveaux repères dans sa carte mentale qui se met à jour.
2
Question Sextuple
Noter par écrit les réponses, c’est comme poser de nouveaux repères dans sa carte mentale qui se met à jour. Après avoir rappelé l’intention de la séance, posez une suite de questions en demandant au client de noter ses réponses :
✓ Quelle est la première chose que vous savez maintenant ? Et la 2 ? … et la 6 ?
✓ Quelle différence ça fait de le savoir maintenant ?
✓ Quel est le premier pas que vous pouvez faire dès maintenant ? Et le 2 , 3 … 6 ?
✓ Et peut-être avez-vous besoin d’une ressource pour cela ?
✓ Avec quoi repartez-vous ?
En rappelant à Simon l’intention initiale de la séance, je lui demande :
– Que sais-tu maintenant à propos de « comment préserver le mécanisme protecteur de concentration et améliorer les relations avec mes collaborateurs » ?
Puis j’enchaîne en lui demandant quelle est la première chose qu’il sait maintenant ? Ensuite je passe à l’énumération. Plus je suis minimaliste dans mon questionnement, moins j’interfère dans la récapitulation mentale de mon client. Simon note ses réponses en silence car il n’est pas tenu de les partager à haute voix.
Ensuite, je lui demande si cela fait une différence de le savoir maintenant, ayant l’intention sous-jacente de le laisser évaluer le gain de la séance. Simon répond sur une note d’humour qu’il peut se laisser tranquillement envahir par ses ruminations.
Comme je raccompagne Simon à la porte à l’issue de cette séance, je vous accompagne à la fin des applications en Clean Coaching individuel. Nous allons voir ensemble comment la métaphore et les techniques de facilitation peuvent aussi accompagner les groupes et équipes pour développer leur intelligence collective et la créativité participative.
e e e e e
Partie III LE CLEAN COACHING COLLECTIF
Les grands enjeux de l’humanité ne sont pas la faim, la pauvreté, le développement durable, la paix, la santé, l’éducation, l’économie, les ressources naturelles… mais notre capacité à élaborer de nouvelles organisations capables de les résoudre. Notre enjeu principal est l’intelligence collective.
Jean François Noubel1
INTELLIGENCE HUMAINE ET PERFORMANCE COLLECTIVE
L’intelligence humaine, ce n’est pas seulement ce que mesurent les tests, c’est aussi ce qui leur échappe
Edgar Morin
POUR S’ADAPTER AU MONDE ACTUEL en pleine mutation et en changement continu, les organisations, groupes, entreprises ont tout à gagner à connaître, comprendre et savoir développer l’intelligence collective. Dans ce contexte, le Clean Coaching constitue un outil innovant au service des groupes et des équipes. Tout comme dans son approche individuelle, il puise sa force dans son éthique et relève le défi d’offrir une solution participative. Mieux encore, il permet l’émergence d’intelligences multiples, au-delà de tout intérêt personnel, favorisant ainsi l’accès à l’intérêt collectif.
DES INTELLIGENCES DIFFÉRENTES
Dans son livre, Super-collectif, la nouvelle puissance de nos intelligences, Émile Servan Schreiber évoque l’expérience réalisée par Sir Francis Galton, gentleman voyageur, savant éclectique de la société cosmopolite du XIX siècle et cousin germain de Charles Darwin. Il assista un jour à un curieux concours dans une fête
1 e
7
foraine. Des badauds devaient payer quelques sous pour écrire sur un ticket à combien ils estimaient le poids de la viande que l’on pourrait tirer d’un bœuf qui y était exposé. Le gagnant était celui dont l’estimation était la plus proche du poids réel. Francis Galton avait récupéré les 787 tickets utilisés par les participants pour les soumettre à une analyse statistique. Les estimations variaient entre 408 et 680 kg, mais la moyenne était, à quelques dizaines de grammes près, le poids réel, 543 kg. Le jugement collectif s’avérait ainsi d’une surprenante justesse, Francis Galton venait de prouver statistiquement l’existence d’une certaine forme d’intelligence collective.
Une foule d’ignorants serait-elle plus perspicace qu’une équipe d’experts ? Pour corroborer cette hypothèse, James Surowiecki , journaliste scientifique au New Yorker, publie en 2004 les résultats de ses investigations. Dans un livre, devenu best-seller sous le titre La Sagesse des foules, il relate plusieurs cas où la résolution des problèmes par des groupes d’individus s’avère plus efficace que par des comités d’experts. La foule posséderait donc un intéressant pouvoir d’évaluation statistique. En observant l’émergence de ce phénomène dans différents groupes, il relève les récurrences suivantes :
• Plus grande est la foule, plus fiable est le résultat de l’estimation.
• La diversité des opinions est aussi importante que le nombre de personnes qui y participent.
• Ceux qui croient détenir la vérité se trompent la plupart du temps.
• Plus il y a de gens qui se laissent séduire par une même réponse, moins le groupe parvient à trouver la bonne.
• Chacun doit réfléchir de façon indépendante pour éviter de tomber dans le piège de la pensée unique.
2
Il en déduit que pour stimuler l’intelligence collective dans un groupe, il convient de :
• réunir des personnes de divers milieux ayant des idées originales ;
• permettre à différents avis de se croiser sans recourir à la polémique ;
• cultiver la variété d’opinions pour combler les lacunes de connaissances ;
• choisir la meilleure option par consensus au lieu d’un vote à majorité.
Mais qu’entend-on réellement par intelligence, qu’elle soit individuelle ou collective ? Pour le découvrir, je vous propose un flash-back dans l’histoire pour être au clair avec cette notion.
Mesurer l’intelligence : le QI
En 1905, à la demande du gouvernement français, Alfred Binet et Théodore Simon cherchent un moyen objectif pour mesurer l’âge mental des enfants en âge scolaire. Ils s’intéressent au départ à des indicateurs potentiels comme la graphologie, la céphalométrie, la chiromancie et finissent par retenir les compétences suivantes, à savoir :
• comprendre des idées, savoir reconnaître des tendances et formuler des concepts ;
• appliquer la logique et la raison, traiter des informations ;
• planifier, résoudre des problèmes, prendre des décisions ;
• savoir s’exprimer, argumenter et communiquer.
Ils mettent au point un test sur une échelle métrique de 100, connu sous le nom de quotient intellectuel standardisé de l’intelligence, en abrégé : QI.
Le quotient intellectuel (QI) est une mesure, effectuée à l’aide de tests, pour évaluer le niveau intellectuel par rapport à l’âge mental.
Le QI est le rapport entre l’âge mental multiplié par 100 et l’âge réel. Par définition, le QI moyen est à 100 ; une différence d’écarttype par rapport à cette moyenne définit la déficience intellectuelle (QI < 70) et la précocité intellectuelle (QI > 130). Le QI trouve alors
de nombreuses applications à commencer par l’orientation des élèves dans leur scolarité. Son utilisation s’élargit progressivement à d’autres secteurs comme par exemple le recrutement et la gestion des ressources humaines ou encore le profilage d’individus qui ont maille à partir avec la justice. Le QI fait ensuite une belle carrière, en particulier outre-Atlantique, où Richard J. Herrnstein et Charley Murray développent ensemble une théorie selon laquelle le QI serait un des indicateurs les plus fiables pour prédire la réussite scolaire, professionnelle et sociale.
La révolution cognitiviste
Deux courants se succèdent alors dans le champ de la recherche sur l’intelligence :
• Le courant classique assimile l’intelligence à un organe cérébral dont l’activité est mesurée par le QI.
• Le courant cognitiviste est introduit dans les années 1950 par Jérôme Bruner et George Miller, pionniers de ce qui a été appelée la révolution cognitive. Les processus cognitifs permettent à l’organisme vivant de s’adapter aux changements qui se produisent dans l’environnement. Ils concernent la mémoire, l’apprentissage, la résolution de problèmes et l’invention des outils.
La cognition est le processus par lequel l’organisme apprend et s’adapte à l’environnement (J Bruner et G Miller)
Le terme cognition peut également être utilisé pour désigner non seulement les processus de traitement de l’information tels que le raisonnement et les fonctions exécutives en général, mais aussi, des processus plus élémentaires comme la perception, la motricité et les émotions. D’après Antonio Damasio , neuropsychologue et auteur de l’essai, L’Erreur de Descartes, la raison des émotions, la prise de décision ne peut pas se faire sans lesdites émotions. Il soutient que
3 4
l’erreur de René Descartes était la séparation dualiste de l’esprit et du corps, la rationalité de l’émotion.
Le concept de cognition est actuellement étendu au-delà du seul cadre de la cognition humaine pour inclure tous les processus intelligents y compris ceux des animaux et des systèmes d’intelligence artificielle.
LES ÉTAPES DU DÉVELOPPEMENT
Le biologiste et psychologue suisse Jean Piaget est connu pour ses travaux concernant la psychologie du développement et le structuralisme génétique. Pour découvrir comment se développe l’intelligence, il observe des enfants depuis leur plus jeune âge. Ceux-ci construisent progressivement leurs structures cognitives dans l’interaction entre la maturation du système nerveux et l’acquisition du langage. Ils intègrent des acquis et capitalisent les progrès en passant par des étapes de croissance. Piaget identifie un modèle de développement cognitif par étapes.
L’intelligence sensori-motrice (0-2 ans)
Les petits enfants explorent leur schéma corporel pour développer la coordination motrice. Ils identifient des objets d’abord sur la base de leurs propriétés sensorielles comme la couleur, la forme, le mouvement, le bruit, le goût, la texture… À la fin de cette période, ils commencent à faire des liens entre les objets et leurs attributs sensoriels : doux comme une peluche, rond comme une orange, grand comme mon papa. Ils intègrent progressivement la notion de permanence des objets, c’est-à-dire qu’ils comprennent que les objets continuent d’exister même quand ils ne sont pas visibles à leurs yeux.
L’intelligence symbolique (2-6 ans)
5
Quand le jeune enfant accède aux images mentales, il entame la période de l’intelligence symbolique. Il sait traiter les images comme des substituts des objets qu’elles représentent. Il devient capable de penser en termes symboliques, ce dont témoignent ses dessins. L’intelligence symbolique permet l’acquisition du langage.
L’intelligence métaphorique et linguistique (6-11 ans)
Pour apprendre quelque chose de nouveau, l’enfant cherche à rapprocher ce qui est nouveau de ce qu’il connaît déjà. Il utilise implicitement des formules métaphoriques : c’est comme si…, cela ressemble à… Il apprend à comprendre et à faire des métaphores en parlant et en dessinant. Sa capacité à produire des images mentales crée une sorte de réservoir de représentations sensorielles. À partir de ses représentations mentales, le jeune construit son modèle du monde.
L’intelligence analogique et logico-mathématique (11-16 ans)
L’adolescent développe la capacité à traiter des informations pour comprendre comment le monde fonctionne. Quand il sait résoudre un problème, il peut résoudre d’autres problèmes similaires par analogie. À ce stade, l’adolescent est capable de réfléchir sur des probabilités et de manier la logique formelle et abstraite. Les trois intelligences – symbolique, métaphorique et analogique – se manifestent par la capacité de dessiner et comprendre les symboles et les métaphores, d’apprendre et de résoudre des problèmes par analogie.
L’intelligence analogique demeure une source de créativité pour trouver des solutions innovantes, à l’instar de Gutenberg qui a appliqué le principe de la pressoir à raisin pour inventer la presse d’imprimerie. Elles se renforcent par la pratique de la métaphore qui mobilise le cerveau de manière globale pour créer une synergie systémique entre la pensée logique déductible et la pensée imaginaire.
En parallèle, d’autres formes d’intelligences continuent à émerger pour nous permettre de nous adapter aux changements dans un monde en évolution permanente. La grande aventure des intelligences ne s’arrêtera probablement jamais.
LA RECONNAISSANCE D’INTELLIGENCES MULTIPLES
On a longtemps cru que l’intelligence était une faculté unique, mesurable et bien définie, dont chacun de nous hériterait. Mais le psychologue du développement américain, Howard Gardner a dénoncé, dans les années 1980, la tyrannie du QI qui valorise uniquement des compétences logico-mathématiques. Pour lui, d’autres types d’intelligence existent, sinon comment expliquer qu’un mauvais élève devienne un cinéaste de renom ? Il dénombre sept types d’intelligences :
• l’intelligence linguistique,
• l’intelligence logico-mathématique,
• l’intelligence musicale et rythmique,
• l’intelligence spatiale,
• l’intelligence kinesthésique et corporelle,
• l’intelligence intrapersonnelle,
• l’intelligence interpersonnelle.
Seulement sept ? Ayant reconnu le caractère arbitraire de ce nombre, Gardner complète progressivement cette liste par :
• l’intelligence naturaliste,
• l’intelligence spirituelle,
• l’intelligence existentielle.
Selon Gardner, il est important de développer les talents et de promouvoir les intelligences multiples chez tous les individus dès l’école. Pour donner un bon exemple, il s’était impliqué dans les programmes éducatifs pour y introduire l’informatique et les activités artistiques. Remarquons au passage, dans la liste de Gardner, l’absence de l’intelligence émotionnelle qui se cache en réalité sous
6
deux étiquettes différentes, à savoir intrapersonnelle et interpersonnelle.
L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE
Les premières études sur l’intelligence émotionnelle (IE) apparaissent au début des années 1990 avec les travaux de deux psychologues américains, Peter Salovey et John Mayer . Selon leur définition, l’intelligence émotionnelle correspond à la capacité de reconnaître, comprendre et maîtriser ses propres émotions et savoir composer avec les émotions des autres.
En peu de temps, la notion d’intelligence émotionnelle gagne en popularité grâce à l’engagement de Daniel Goleman , journaliste scientifique pour le New York Times, qui publie une série de livres sur cette thématique. Si Goleman croyait à l’intelligence émotionnelle, il ne croyait pas à l’existence d’un test fiable comparable à celui du QI pour la mesurer. Et ce, jusqu’à l’apparition d’un test conçu par le psychologue israélien Reuven Bar-On en 1997. Il mesure l’interaction entre une personne et son environnement par un questionnaire qui se remplit en ligne.
L’intelligence émotionnelle décrit l’agrégation d’habilités, de capacités et de compétences utilisées pour faire face à la vie efficacement (Reuven Bar-On).
Les résultats du test apparaissent sur un rapport complet qui fait ressortir les axes de développement par l’analyse des liens entre cinq aptitudes.
7 8
Les cinq aptitudes émotionnelles
✓ Intelligence interpersonnelle : empathie et aptitude relationnelle.
✓ Intelligence intrapersonnelle : conscience de soi et de ses émotions.
✓ Adaptabilité : flexibilité et sens de réalités
✓ Humeur générale : aptitude au bonheur.
✓ Gestion du stress : tolérance au stress et contrôle des impulsions
Selon Bar-On l’intelligence émotionnelle et l’intelligence cognitive contribuent autant l’une que l’autre à l’intelligence générale d’une personne :
• Les personnes qui ont un QE supérieur à la moyenne réussissent mieux à faire face aux pressions de l’environnement.
• Une déficience dans l’intelligence émotionnelle peut entraver la réussite dans la vie, voire se traduire par l’existence de problèmes psychologiques.
• Des problèmes d’adaptabilité sont particulièrement répandus parmi les personnes qui présentent des déficiences d’épreuve de la réalité, de tolérance au stress et de contrôle des impulsions.
L’intelligence émotionnelle et l’intelligence cognitive contribuent autant l’une que l’autre à l’intelligence générale d’une personne (Reuven BarOn).
L’INTELLIGENCE SOCIALE
Quittons la notion d’intelligence individuelle pour aborder l’intelligence de groupes. Le psychologue américain Edward Thorndike est connu pour ses recherches sur l’intelligence animale. Sur la base de ses observations des animaux sociaux comme des insectes qui vivent en communauté (fourmis, termites, abeilles), des
oiseaux et des poissons qui se déplacent en formation (oiseaux migrateurs, bancs de poissons), des animaux qui chassent en meute (loups, hyènes, lions) et des mammifères vivant en groupes (singes, castors, etc.), Thorndike pose les fondements de l’intelligence sociale dès 1920 comme une capacité, au sein des groupes, à interagir et coopérer dans un but commun.
Pour illustrer cela, nous pouvons mettre en parallèles deux communautés, celles des fourmis et celle des hommes, pour découvrir s’il existe des convergences dans leur façon de vivre ensemble.
Chez les fourmis…
Pour se nourrir, les fourmis vont chercher de la nourriture à proximité de leur habitat. Elles commencent par errer de façon aléatoire et, lorsque l’une d’entre elles découvre une source de nourriture, elle retourne à la fourmilière en déposant des phéromones le long de son trajet. Ses congénères pourront suivre le même chemin qui les mène à la source de la nourriture. Pour s’assurer que celle-ci est de bonne qualité, la fourmi dispose d’un jabot social (sorte de second estomac), où elle stocke des aliments pour les tester en les partageant avec les autres fourmis. Si la source de nourriture est validée, les fourmis se mettent en rang pour chercher des provisions. Chaque fourmi, en suivant le même chemin, déverse de nouveau des phéromones et la piste devient une véritable voie olfactive.
Les fourmis ont développé la capacité à faire des choix selon des critères multiples de validation, tels que la qualité de la nourriture, la distance, la sécurité de la piste. Leur réussite tient au parfait équilibre entre la contribution de chaque membre dans l’exploration et l’exploitation des sources de nourriture. Selon les besoins de la communauté, les fourmis se spécialisent dès la naissance en devenant sentinelles pour défendre leur territoire, ouvrières pour maintenir la logistique dans la fourmilière, puéricultrices pour élever les générations futures, ou reines pour assurer leur descendance.
Une fourmi a-t-elle conscience de faire partie d’une collectivité ?
Probablement pas, mais elle a la capacité de faire sa part et de contribuer à l’intelligence sociale au sein du groupe.
Chez les humains…
Autrefois, les habitations humaines poussaient de manière organique, comme des champignons à proximité de centres d’intérêts vitaux pour la communauté. En regardant un plan d’une ville ancienne comme Paris, on peut deviner les traces d’activités aujourd’hui disparues. Pour exemple, l’une des plus longues rues de la capitale : la rue de la Glacière, suit le tracé d’un chemin bien précis, enjambant la rivière de la Bièvre devenue souterraine de nos jours, vers le hameau de la Glacière. Autrefois cette rivière se couvrait de glace en hiver et les enfants y patinaient. Découpée en pains, la glace était entreposée entre des couches de paille dans des puits de cinq à douze mètres de profondeur pour être commercialisée à la belle saison. Vendue par des crieurs à Paris, la glace servait à la confection de glaces et sorbets, à rafraîchir des boissons et à conserver des poissons.
Vous pouvez vous amuser à trouver d’autres noms évocateurs dans votre quartier, quelle que soit la ville où vous habitez. Je vous en livre quelques-uns que j’ai découverts à Paris comme la rue du Pont aux Choux, la rue des Fontaines du Temple, le passage de la Petite Boucherie ou la rue de la Verrerie. À chaque rue sa fonction, il suffisait à l’époque de suivre le chemin en s’inspirant du nom. Aujourd’hui, si les rues existent encore nous n’y trouvons plus ni glace, ni ateliers d’antan ! À partir de ces exemples, nous pouvons relever les ressemblances suivantes qui caractérisent l’intelligence sociale :
• Les individus apprécient la proximité de leurs semblables et tendent à être regroupés pour en tirer des avantages.
• Chaque individu est en relation avec un ou plusieurs autres individus du groupe.
• La communication se fait sous forme de signaux olfactifs, visuels ou auditifs propre à chaque espèce (phéromones, cris, verbes, chants, gestes, rituels, attitudes).
• La coordination au sein d’un groupe prend le plus souvent la forme d’interactions simples et compréhensibles pour chaque membre.
• Chaque individu trouve un bénéfice à coopérer car sa performance au sein du groupe est meilleure que s’il était isolé.
La façon, dont chaque intelligence individuelle vient contribuer au fonctionnement d’un groupe, et le mode de coopération dépendent de multiples facteurs, et notamment des raisons pour lesquelles des individus se réunissent.
Les types de groupes
✓ Une foule est une multitude de personnes qui se retrouvent au même endroit pour une raison (manifestation, marché, promenade).
✓ Un groupe est un ensemble de personnes réunies par un intérêt temporaire commun (joueurs de pétanque, orchestre, réunion)
✓ Une équipe est un groupe d’individus qui se mobilise pour un but commun (équipe de foot, équipe-projet).
✓ Une organisation rassemble des personnes ayant un but collectif (entreprise, association, ONG).
LA PERFORMANCE COLLECTIVE
Selon Alex Pentland , chercheur en physique sociale au sein du MIT de Boston, certaines équipes réussissent mieux que d’autres sans être spécialistes des sujets à traiter.
Les récents travaux d’Anita Woolley , spécialiste de l’étude des comportements de groupes, et de Tomas W. Malone, directeur du Centre pour l’Intelligence Collective du MIT, abondent dans ce sens. Dans une tribune du New York Times le 16 janvier 2015, ils révèlent,
9 10
à travers les résultats de deux études, que ce qui fait la qualité d’une équipe ne repose pas tant sur l’intelligence de chacun de ses membres que sur la capacité à faire équipe.
Dans une première étude complétant les travaux de Pentland, les auteurs ont démontré qu’il n’y avait pas de corrélation entre les QI des participants et la réussite des groupes. L’extraversion ou l’introversion des individus, pas plus que la motivation à faire réussir leur équipe ne faisaient pas la différence. Les équipes performantes se démarquaient des autres par trois types de constantes :
• Leurs participants contribuaient de manière égalitaire aux discussions et ne laissaient personne dominer le groupe.
• Leurs membres obtenaient d’excellents résultats à un test de lecture de « l’état d’esprit dans les yeux », évaluant la capacité à décrypter les états émotionnels complexes à partir d’images de visages dont seuls les yeux étaient visibles. Une aptitude, qui abonde en faveur de la « théorie de l’esprit ». Cette dernière consiste à deviner et garder en mémoire la trace de ce que les autres pensent, connaissent, croient.
11
• La présence de femmes semble avoir un effet positif sur les résultats si on les compare à ceux obtenus par des équipes à dominante masculine.
Sur ce dernier point, il semblerait que ce ne soit pas un nombre égal d’hommes et de femmes qui compte, mais le fait que les femmes aient tendance à être plus en capacité de lire l’état d’esprit des autres.
Dans une deuxième étude, observant les capacités d’intelligence collective au sein de groupes d’individus travaillant cette fois à distance, les auteurs confirment les conclusions de la première. L’équité de temps de parole, la surreprésentation féminine, et la capacité à comprendre les émotions des autres demeurent des facteurs décisifs.
En conclusion, quel que soit le mode d’interaction (en face à face, ou par voie dématérialisée), les équipes les plus performantes restent celles qui communiquent beaucoup, de manière égalitaire et
possèdent de bonnes compétences en compréhension des émotions des autres.
Les facteurs de performance collective
✓ La fluidité dans la communication
✓ L’égalité dans la répartition du temps de parole.
✓ Le respect de toutes les contributions
✓ Le but commun et la vision partagée.
L’INTELLIGENCE COLLECTIVE
Il apparaît, au terme de ce chapitre, que l’intelligence collective est un processus d’émergence, où les intelligences multiples convergent vers un but commun et une vision partagée.
Quelle que soit sa nature – logique, émotionnelle, créative ou corporelle – la notion d’intelligence est particulièrement cruciale pour permettre aux individus d’évoluer, de progresser et d’être performants dans des situations nouvelles qui nécessitent un apprentissage et une adaptation à des circonstances changeantes.
Les individus et les équipes sont confrontés chaque jour à un éventail toujours plus large de tâches, des problématiques à résoudre, des défis à relever. Pour Béatrice Arnaud et Sylvie
Caruso-Cahn , « l’intelligence collective est une réponse face à un monde complexe, dans lequel il n’y a plus de réponse simple et unique, dans lequel personne ne détient ni la connaissance, ni la vision de l’ensemble du système. » Le succès de la nouvelle forme de coopération collective est lié à la mise en commun de talents, de savoirs et de savoir-faire et de savoir-être, tels que l’écoute, le souci de l’autre et la communication fluide et compréhensible.
12
LA CRÉATIVITÉ PARTICIPATIVE AVEC LA MÉTAPHORE
Savoir écouter c’est posséder, outre le sien, le cerveau des autres Léonard de Vinci
APRÈS AVOIR PASSÉ EN REVUE LES DIFFÉRENTES FORMES D’INTELLIGENCE pour cerner ce que l’on entend par l’intelligence collective, nous allons découvrir la pertinence de la métaphore permettant de développer l’intelligence sociale et collective.
LA COMMUNICATION MÉTAPHORIQUE
La métaphore semble être une matière omniprésente en pensée et en parole, semblable à l’air que l’on respire sans que l’on y prête attention. Disponible partout et tout le temps, elle a le potentiel d’être une ressource inépuisable pour développer la sensibilité à nousmême et aux autres. Elle semble reproduire le paradoxe en révélant ce qui doit être caché. Elle permet de formuler un message que l’on n’oserait pas exprimer directement comme le fond de sa pensée, l’impalpable de l’émotion, l’éphémère de l’intuition, le film que l’on se fait à propos d’une situation qui nous angoisse.
8
Le paradoxe de la métaphore
Communiquer en utilisant des métaphores, tout comme porter des masques à Venise, autorise des transgressions. Celui qui s’exprime, ose le faire en se sachant protégé par la métaphore. Il est plus facile de dire que l’on a « les ailes coupées » pour exprimer sa déception de ne pas disposer de moyens adéquats pour réussir sa mission que de se plaindre d’un budget qui a subi des coupes. Personne ne va le prendre pour soi mais, au contraire, l’auditoire va ressentir de l’empathie et l’envie d’agir pour résoudre le problème. Ainsi, des propos critiques, plaintes ou interpellations deviennent plus recevables et suscitent davantage d’empathie.
Le paradoxe de la métaphore est de révéler ce qui veut être caché
1
Laure , responsable qualité dans une grande entreprise, est familière de la métaphore qu’elle pratique dans l’exercice de sa fonction managériale. À l’occasion d’une réunion, elle propose de faire le point sur l’harmonisation de procédures en cours. Comme elle formule sa question de manière à générer des métaphores, elle obtient des réponses suivantes de la part de ses collaborateurs :
– C’est comme une araignée pas très attirante.
– C’est comme un brouillard où je marche à reculons.
– C’est comme les égouts de Paris, on entrevoit la lumière et on sait qu’on sortira au bout du tunnel de Saint-Cloud.
À la place des informations techniques habituelles, Laure recueille des points de vue personnels qui lui permettent d’évaluer ce qui reste à accomplir. Elle comprend que certains collaborateurs n’ont quasiment pas touché aux outils, tandis que d’autres se trouvent en difficulté face à leur complexité. Ces informations lui donnent des indications précieuses pour accompagner au mieux les équipes sur le terrain et qu’elle n’aurait peut-être pas obtenu autrement.
Le souci de l’autre
Dans un autre registre relationnel, si on sait qu’une personne est « soupe au lait », on tolère plus facilement ses coups de gueule en sachant que l’orage passe aussi rapidement qu’il n’éclate. Les métaphores deviennent facilement des repères mnémotechniques pour se souvenir des besoins et des traits de caractères des gens dans son entourage. De par sa formation en Clean Coaching, et avec sa sensibilité aux risques psychosociaux, Laure utilise les métaphores pour communiquer avec ses collaborateurs.
Communiquer avec ses collaborateurs avec des métaphores
Lors d’une formation à la gestion du stress au sein d’une même équipe, Laure propose de choisir une carte de photolangage pour illustrer ce que chacun ressent en situation de stress. Les participants partagent leurs métaphores lors d’un échange collectif. Le responsable d’ingénieriesystème choisit celle d’un château médiéval, protégé par les douves et un pont-levis. Il explique qu’il referme le pont-levis quand on lui fait une demande qui bouscule son agenda. Ayant compris comment on le met sous stress, ses collègues vont pouvoir l’éviter à l’avenir. Et s’il arrive à quelqu’un de l’oublier, quelqu’un d’autre ou l’intéressé va lui rappeler avec une pointe d’humour « attention le pont levis va se lever ! »
Et quand Laure prend un poste dans une nouvelle équipe, elle adopte une stratégie pour bien s’intégrer et cohabiter avec ses nouveaux collègues :
Je repère les métaphores lorsque mes collègues parlent d’eux-mêmes et de ce qui les stresse :
– le responsable des publications qui se sent comme un hamster dans une roue qui tourne de plus en plus vite et risque de l’éjecter ;
– mon responsable hiérarchique qui se sent tel un funambule avançant dans l’obscurité sans savoir où il met le pied à chaque instant.
En connaissant leurs métaphores, je sais quand ce n’est pas le moment de les bousculer Et si l’occasion se présente, je leur passe un message en me référant à leurs métaphores Et je remarque que cela les détend et crée une connivence entre nous
LES SOLUTIONS MÉTAPHORIQUES
D’une manière générale, la métaphore génère du sens. Elle fait référence à ce que l’on connaît par expérience, savoir ou intuition.
Fondée sur l’analogie, la métaphore facilite le processus d’apprentissage car se référer à ce que l’on connaît déjà permet de comprendre et de partager le sens.
La métaphore utilise l’analogie pour révéler l’inconnu en termes de connu.

En connaissant la logique de la métaphore, on saura chercher des solutions d’abord dans la métaphore pour les transposer en actions concrètes. Des difficultés de communication peuvent se cacher derrière les images d’un mur qui sépare, une échelle à laquelle il manque des barreaux, un bateau sans capitaine…
En explorant une métaphore collective, comme celle d’une équipe de rugby, on peut mettre à jour les forces et faiblesses d’une équipe, évaluer à quelle étape elle se trouve et lui apporter un soutien adéquat. Les chefs d’équipe, les managers ou les gestionnaires peuvent comprendre le problème du point de vue de leurs collaborateurs en suivant cette logique. Voici un exemple dans l’équipe de Laure.
Dans les sables mouvants
Mon service qualité, en cherchant à améliorer ses prestations, a demandé une appréciation auprès d’équipes opérationnelles. Au lieu d’une liste de détails, c’est une métaphore qui nous a été retournée. Les équipes opérationnelles se voient comme « enlisées dans les sables mouvants » et attendent du service Qualité une aide concrète pour s’en sortir.
Dans ce cas précis, la logique de la métaphore pousse Laure à penser à ce qu’elle mettrait en œuvre pour une équipe prise au piège des sables mouvants. Pour elle, l’urgence serait qu’elle retrouve la terre ferme avant d’aller de l’avant. Par conséquent, elle va proposer des solutions concrètes et un suivi adapté à la situation.
Le Clean Language permet d’établir un dialogue avec la métaphore, d’explorer ce qui se cache derrière les mots et de trouver des solutions qui transforment notre regard. Sous la plume de l’écrivaine polonaise Olga Tokarczuk, certaines difficultés de communication semblent insurmontables :
« Parler à quelqu’un qui ne veut pas comprendre, c’est essayer d’ouvrir la serrure avec un brin d’herbe, de couper du pain avec une branche de basilic, de visser une ampoule dans un nid d’oiseau, de mettre un disque entre deux pierres. Cela ne sert à rien. »
S’il s’agissait d’une métaphore personnelle, alors une exploration avec le Clean Langage permettrait peut-être de découvrir des pistes de solution.
Dans un autre registre, un pédiatre s’est inspiré d’une métaphore médiatique « le Roi lion » pour faciliter le dialogue avec un jeune garçon, venu le consulter pour une énurésie.
Le Roi lion
Du point de vue de la méthode, le pédiatre crée un dialogue avec la métaphore de Simba l’enfant-lion qui, orphelin, devait affronter des multiples problèmes et les résoudre pour grandir et devenir roi à son tour pour lui poser une série de questions Clean :
– Et quand Simba fait pipi au lit, qu’aimerait-il qu’il arrive ?
– Qu’est-ce qui se passe juste avant ?
– Et d’où pourrait venir ce dont Simba aurait besoin ?
Caché sous le masque de sa métaphore, le garçon livre des choses qu’il n’aurait pas pu exprimer autrement. Il se sent compris et reconnu dans sa vérité, ce qui en soi peut l’aider à résoudre son problème.
Le Clean Language est tout aussi performant pour développer la créativité et la conscience collective.
Les Vikings
L’équipe commerciale d’une entreprise de vente en ligne est chargée de préparer une campagne promotionnelle destinée à conquérir de nouveaux segments de marché. Invité à choisir une métaphore pour l’illustrer, le groupe opte pour une métaphore guerrière : La conquête par des Vikings de nouvelles terres et de leurs richesses.
Sous le projecteur du questionnement Clean, les commerciaux perçoivent le caractère guerrier de leur métaphore Les raids vikings terrorisent les populations et les mettent en fuite !
La prise de conscience de ces conséquences amène l’équipe à changer de métaphore. Les drakkars se transforment en bateaux d’assistance médicale pour répondre aux besoins des populations. Cette vision va inspirer un plan d’action en rapport avec la nouvelle mission d’assistance à la place de la conquête
Cet exemple démontre que la logique de la métaphore devient un fil conducteur pour découvrir des solutions innovantes et, par analogie, les traduire en actions concrètes.
LES CARTES MÉTAPHORIQUES
Auteur d’expressions devenues proverbiales, Alfred Korzybski s’est donné comme mission de trouver une méthode pour communiquer sur la base de faits et non de présupposés. Il a inspiré Richard Bandler et John Grinder, pour créer de la Programmation Neurolinguistique (PNL), une méthode cognitiviste de développement personnel et de communication. Selon la PNL, nous ne pouvons pas percevoir le monde directement. Notre perception du réel est influencée par nos filtres sensoriels et se matérialise sous forme de représentations mentales qui deviennent notre modèle du monde. Ces dernières s’enrichissent au fil de nos interactions et expériences avec les autres.
Dans un groupe, quel qu’il soit, on trouve autant de modèles du monde que d’individus. Il serait donc illusoire de penser que parler la même langue suffit pour se comprendre, car chacun s’exprime à partir de ses représentations et selon sa carte personnelle du
2
monde. Korzybski traduit le décalage entre la réalité et la représentation que nous en avons, à travers l’expression : « la Carte n’est pas le territoire ». Mais que signifie le mot « carte » ?
Développé par un groupe de géographes, dont le plus connu est Kevin Lynch , le concept de la carte mentale est issu d’un courant d’idées, connu sous le nom de « géographie de la perception ». Initialement, une carte mentale est une cartographie de nos représentations spatiales permettant de s’orienter dans l’espace géographique. Par extension, il s’agit d’une cartographie de nos représentations permettant de s’orienter dans l’espace de l’esprit.
Au chapitre 6 nous avons découvert un processus d’automodélisation. Au cours de la séance, Simon réalise une cartographie métaphorique de son modèle du monde. Il va en faire son carnet de route pour réaliser ses objectifs, contourner des obstacles et utiliser ses ressources de manière nouvelle pour lui.
En facilitation collective, les métaphores personnelles prennent une autre direction, celle de la communication interpersonnelle et de la créativité collective. L’exposition des métaphores personnelles aux yeux des autres permet à chacun de partager sa vision du monde et découvrir celles des autres participants. À partir des métaphores personnelles le groupe pourra ensuite construire une vision collective sous forme d’une carte métaphorique rassemblant des valeurs communes.
LA VISION MÉTAPHORIQUE COLLECTIVE
Le terme de vision est une nominalisation que l’on peut dériver du verbe « viser » ou du verbe « voir ». La vision permet de se projeter pour atteindre un but et donner du sens à nos actions. Elle s’inscrit dans une temporalité qui n’est pas forcément linéaire, comme le souligne le philosophe et écrivain sénégalais Souleymane Bachir Diagne :
La Vision détermine nos décisions et actions.
3
C’est aussi dans ce sens que nous aborderons le concept de vision.
La vision c’est…
✓ Une représentation cognitive du présent ou du futur
✓ Une direction pour agir au présent pour réaliser le Futur.
Illustrons maintenant le processus de construction d’une vision collective à partir des métaphores personnelles à travers l’exemple d’une Master-class, réunissant une dizaine de formateurs, coachs et designers montréalais. Comme point de départ, les participants choisissent le thème de la facilitation et répondent individuellement à la question :
Comment serait le monde où il y a une culture de la facilitation ?

Après un premier temps de réflexion, chacun trouve une métaphore personnelle pour illustrer sa vision du monde, où il y a une culture de facilitation et fait un dessin sur une feuille individuelle de papier.
Une métaphore individuelle
Dans un deuxième temps, toutes les métaphores sont affichées sur un mur, formant une galerie de représentations individuelles.
En visitant la galerie, les participants s’imprègnent de la diversité des images pour y découvrir : un Jardin de permaculture, un Jardin des jardins, des Cœurs vivants à l’écoute de soi et des autres, une Chaîne d’humains connectés, un Arbre d’où émerge un Œil de Culture globale…
Puis, chacun est invité, à tour de rôle, à présenter individuellement sa métaphore. En retour, il reçoit la curiosité bienveillante des autres participants sous forme de questions Clean qui révèlent le sens des représentations. Les participants peuvent ainsi reconnaître, sous différentes formes symboliques, des valeurs et aspirations universelles. Le facilitateur leur propose alors d’identifier des éléments communs et des idées originales.
Dans un troisième temps, à partir d’éléments communs et pépites d’idées uniques, les participants réalisent une fresque métaphorique.
 Un mur de métaphores
Un mur de métaphores
Créativité participative

Dessinée à plusieurs mains, elle se matérialise sous la forme d’une farandole de cœurs humanoïdes qui traverse toute la feuille. Au fur à mesure de sa réalisation apparaissent des figures porteuses de sens : le Leader acrobate criant Eureka, le Leader de la danse, le Leader du rêve… Le consensus se faisant sur les valeurs communes, on assiste à l’émergence d’une conscience collective d’où découle la compréhension de ce que le groupe veut faire ensemble, mais aussi pourquoi le faire, autrement dit : le sens et le but de l’action.
Dans un quatrième temps, un participant choisi par le groupe fait le tour de la métaphore collective en soulignant la signification des symboles et rappelle les valeurs qui font consensus au sein du groupe : l’Écoute de soi, l’Écoute de l’autre, la Vision systémique, le Développement durable, la Culture globale, l’Innovation, l’Apprentissage.
La vision collective permet au groupe d’imaginer des solutions répondant à la logique de leur métaphore. Ceci va se faire dans un cinquième temps, les idées des uns deviennent source d’inspiration pour les autres. Une compétition générative d’idées se matérialise pour indiquer des pistes d’actions concrètes :
• Le Leader acrobate se transforme en maître jardinier pour semer les graines et cultiver les talents dans le cadre d’un coaching génératif.

• Le Leader du rêve fabrique des conférences sous les titres : compotes de métaphores.
• Le Leader de la danse lance une campagne d’affiches pour promouvoir la facilitation avec les métaphores et le coaching génératif
Présentation de la métaphore collective
.
Engagements et actions
Les participants inscrivent leurs propositions sur des Post-It qu’ils collent directement sur la fresque en prenant l’engagement de participer ainsi à la réalisation de la vision collective d’un monde où il y une culture de facilitation générative.
Un an plus tard j’ai demandé à Dominique Barbès , de partager avec nous son témoignage en tant que participante. 4

Co-créer une métaphore collective
Co-créer cette métaphore collective interrogeait le sens de mon engagement professionnel comme coach et facilitatrice dans le monde d’aujourd’hui, une question qui me tient à cœur. La « voie-voix » des métaphores a permis un échange bien différent de nos conversations habituelles entre professionnels.
L’exercice a réveillé l’énergie, la créativité, la passion qui nous habitent Nous nous sommes alors reliés dans le plaisir de faire ensemble, plutôt qu’œuvrer à réussir individuellement. Grâce aux images collectives et au mouvement dynamique, empreint de vie, de la fresque, je me suis enrichie du terme « génératif » qui s’est associé à celui de « facilitation ». La métaphore collective a inscrit chez moi une prise de conscience, est devenue un moteur riche de sens.
J’attache désormais encore plus d’importance à transmettre les fondements de ma pratique En diffusant, comme formatrice et mentor, cette « culture de la facilitation », j’ai conscience de contribuer à transformer les conversations au sein de nos organisations, et par extension de la société
Dans le processus de construction d’une vision partagée à partir de métaphores personnelles les participants apprennent à travailler en intelligence collective.
L’égalité de temps de parole, la qualité d’écoute Clean, le respect des contributions ce sont des facteurs de performance collective.
En groupe, en favorisant l’écoute au-delà des mots et dans le respect de différents modèles du monde, la métaphore rend la communication plus fluide. Elle contribue également à développer l’intelligence sociale car, en générant l’élan vers l’autre, elle transforme la compétition en coopération. Quand des métaphores individuelles, exposées sur le Mur, convergent vers une vision métaphorique partagée, les participants s’accordent sur leurs valeurs en créant un espace de conscience collective.
La mise en œuvre d’un projet collectif qui nous dépasse génère un sentiment de fierté, donne le sens au travail et à la vie en général.
Autrefois les tailleurs des pierres qui bâtissaient les cathédrales avaient la fierté de contribuer à une œuvre intemporelle. De nos jours, les cathédrales modernes prennent forme de projets partagés et sociétaux et les outils et l’esprit Clean peuvent y contribuer.
9
LES OUTILS DE LA CRÉATIVITÉ PARTICIPATIVE
Nous assistons au passage d’une phase solide à une phase liquide de la modernité À l’état liquide, rien n’a de forme fixe, tout peut changer.
Zygmunt Bauman
Après un panorama de fond posant les briques des savoirs utiles sur l’intelligence humaine et la métaphore, découvrons maintenant en pratique les outils de la facilitation collective Clean.
LE RÔLE ET L’ÉTHIQUE DU FACILITATEUR
Pour accompagner une équipe, le facilitateur Clean se donne pour mission de faire émerger l’intelligence collective au sein d’un groupe de personnes et de la mobiliser pour atteindre un but commun. Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, cela suppose de mettre en œuvre et de garantir, au sein du collectif, de bonnes capacités d’écoute, d’attention et de coopération. Pour cela, le facilitateur dispose de différentes techniques :
• la métaphore et le Clean Language pour développer la communication fluide « au-delà des mots » ;
• le dessin pour stimuler l’intelligence symbolique et faciliter le partage des représentations ;
• la métaphore ascendante (bottom-up) pour construire une vision partagée, donner du sens et indiquer la direction des actions ;
• la fertilisation entre les métaphores pour trouver des solutions consensuelles ;
• la Question Sextuple pour favoriser l’émergence du sens et renforcer le co-apprentissage ;
• la Boussole pour accompagner les transitions entre le rationnel, l’imaginaire et l’action.
Attentif à ce qui se passe dans le groupe, le facilitateur veille à intégrer les apports individuels au processus collectif. Ce faisant, il adapte le rythme de l’animation aux besoins des participants et aux évènements qui émergent en cours du processus. En animation, il avance à la manière d’un funambule sur le fil de processus collectif. Pour maintenir l’équilibre, il adopte la posture conforme à l’éthique de Clean Coaching et dispose d’un outil stratégique, la Boussole de Clean Coaching.
L’éthique Clean
✓ Confiance dans le processus et l’émergence de l’intelligence collective.
✓ Neutralité dans les interactions avec le groupe.
✓ Acceptation de ce qui émerge dans le processus
✓ Minimalisme des techniques.
Nous commençons par la Boussole pour comprendre son utilité pour le facilitateur-funambule.
LA BOUSSOLE DE CLEAN COACHING COLLECTIF
Cet outil s’inspire de la boussole du voyageur, instrument de navigation qui permet de s’orienter dans l’espace géographique et
garder le cap de la destination. Dans le contexte de facilitation, il s’agit de garder le cap de l’objectif dans le processus collectif.
Le facilitateur utilise la boussole pour concevoir des scénarios d’animation, choisir des techniques et des questions du Clean Language en suivant les repères d’étapes.
La synergie entre le rationnel et l’imaginaire
Rappelons-nous que la Boussole de Clean Coaching que nous avons vue au chapitre 1 est structurée sur la distinction Cerveau gauche – Cerveau droit .
• Le côté gauche correspond, métaphoriquement parlant, à l’intelligence cognitive qui se manifeste dans le traitement rationnel d’informations, le classement des choses en catégories pour en déduire l’usage et passer à l’action.
• Du côté droit, le cerveau pense par analogie, ce qui lui permet de faire des rapprochements entre le connu et l’inconnu pour imaginer des métaphores et des solutions innovantes.
En créant une synergie entre les deux modes de pensée, cognitif et analogique, le groupe connecte le rationnel et l’imaginaire pour une utilisation optimale du cerveau global. Dans le contexte du coaching collectif, le facilitateur rencontre les participants dans le rationnel pour les guider, à travers la créativité métaphorique, vers la recherche des solutions et leur mise en œuvre dans le réel.
La deuxième boussole se présente sous forme d’une carte opérationnelle en quatre séquences :
• Intention : poser le cadre et valider le Thème ;
• Métaphores : développer la créativité métaphorique ascendante (bottom-up ) ;
• Solutions : trouver des solutions métaphoriques ;
• Atterrissage : revenir au contexte réel pour agir.
Pour le facilitateur, elle a l’utilité d’une carte d’orientation. Elle indique la direction mais laisse la liberté de choisir le chemin pour
1 2
arriver à destination en autorisant la souplesse pour s’adapter à ce qui émerge dans le processus.
Nous allons découvrir maintenant comment utiliser la boussole en facilitation collective.

L’Intention

Le but de cette première séquence est de nourrir le côté rationnel et de préparer la transition de la pensée rationnelle à la pensée métaphorique. Pour ce faire, le facilitateur instaure un climat de confiance par sa posture et sa relation avec les participants. Il partage des informations qui font sens pour le groupe en expliquant les objectifs et la méthode.
Poser le cadre
La boussole de Clean Coaching collectif
Pour installer le processus dans un cadre rationnel, le facilitateur va :
• donner des informations utiles (programme, horaire, règles de fonctionnement et de confidentialité) ;
• recueillir les attentes des participants ;
• organiser un parking à questions pour y déposer les interrogations des participants en vue d’y répondre à un moment propice.
Pour sensibiliser les participants à la communication métaphorique, le facilitateur peut délibérément ponctuer sa présentation des métaphores et faire une induction générale :
– Soyez curieux et laissez-vous surprendre par ce que vous allez découvrir sous l’apparence banale des métaphores… Vous allez explorer des voies nouvelles de créativité pour imaginer le futur et la manière de le réaliser en s’appuyant sur vos ressources et celles de vos co-équipiers…
– Vous allez mieux connaître les intelligences multiples qui sont à l’œuvre… et quand les intelligences multiples se mobilisent sur un but commun, la créativité et l’intelligence collective sont en synergie pour rêver le futur et ensemble trouver comment le rendre réel…
Choisir le Thème
En général, le Thème répond à la question : Pourquoi est-on réuni ? Parfois il peut émerger au cours de la session. Il peut-être :
• communiqué en amont de l’atelier : « Mobiliser l’intelligence collective pour un futur alternatif » ;
• imposé par le commanditaire « Redéfinir les rôles et les responsabilités des équipes » ;
• libre et choisi par consensus dans un groupe de travail « Prendre soin des soignants ».
Pour valider individuellement le Thème, le facilitateur pose la question de l’Intention en s’adressant à tous les participants pour obtenir des réponses individuelles :
– Quand (rappel du Thème), qu’aimeriez-vous qu’il arrive maintenant ? Notez-le.
En Clean Coaching la question de l’Intention est utilisée pour définir l’objectif car elle permet d’obtenir une réponse plus large, pas forcément sous le contrôle de la personne.
Lorsque l’Intention est posée, le passage à la pensée métaphorique peut commencer.
Les Métaphores
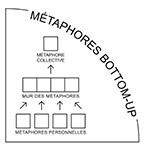
Le scénario de cette deuxième séquence prévoit la co-construction d’une vision partagée en suivant un mouvement ascendant (bottomup), depuis les métaphores personnelles, en provenance de la base (bottom) vers la métaphore collective (up). Cette technique s’appelle Bottom-up. Le facilitateur accompagne ce processus à travers trois étapes en suivant le mouvement bottom-up :
1. Bottom : réalisation de métaphores personnelles.
2. Exposition : partage des représentations.
3. Up : co-construction d’une métaphore collective.
La Vision en Clean Coaching
La Vision est une projection de ce que l’on pense et la façon dont on voit les choses à travers une métaphore. Elle n’est pas synonyme du Futur, du Rêve ou du Devenir. Elle a une dimension atemporelle et représente :
✓ le futur que l’on imagine ;
✓ la perception d’une situation ;
✓ la représentation systémique d’une organisation.
La Vision donne le sens et détermine ce qu’il y à faire pour qu’elle devienne notre réalité.
Bottom : la réalisation de métaphores personnelles
Pour commencer, les participants vont apprendre à utiliser le dessin et la métaphore pour partager leur façon de voir les choses. Afin de trouver une métaphore, ils se souviennent de leurs réponses à la question de l’Intention et se laissent guider par les questions suivantes :
– Imaginez que ce soit déjà votre réalité…
– Cela ressemble à quoi ?
– Dessinez-le.
Chacun dessine sa métaphore qui représente de manière métaphorique sa vision personnelle.
Exposition : le partage des représentations
Les participants placent les dessins de leurs métaphores sur un support commun (mur, sol, table). Ils les regardent d’abord en silence, puis chacun d’eux dispose d’un temps de parole pour présenter sa propre métaphore. Pour encourager les participants à être curieux, le facilitateur donne l’exemple. Au préalable, il aura affiché une liste de questions Clean et de consignes simples de questionnement. Il peut aussi utiliser des moyens ludiques…
Partage d’expérience de Thierry Brigodiot : le gobelet des questions Clean
J’utilise le Clean comme un langage me permettant d’accompagner un groupe ou une personne dans le groupe. Là, où « le processus était le plus abouti », c’était dans une animation avec Benjamin sur la santé au travail (six groupes dont trois groupes de six personnes par animateur)
Nous avons proposé aux participants d’imaginer « à quoi ressemblerait une journée sereine au travail ? » et de l’illustrer par un dessin. Après avoir mis un échantillon de questions Clean dans plusieurs gobelets en plastique, nous avons invité tout le monde à piocher des questions au hasard. Les animateurs ont donné l’exemple en questionnant les premières métaphores présentées dans le groupe. Ensuite les autres participants ont enchaîné avec leurs questions tirées des gobelets. Cela les a amusés, c’était ludique.
Up : co-construction d’une métaphore collective
À l’issue des présentations individuelles, le facilitateur guide les participants dans la recherche des symboliques communes et des idées originales, en questionnant :
– Qu’est-ce qui est commun ?
– Qu’est-ce qui est unique ?
À la suite de leurs réponses, il englobe la mosaïque des métaphores d’un geste et demande :
– Et tout cela ressemble à quoi ? Illustrez-le.
Les participants s’organisent comme ils veulent pour réaliser une métaphore collective. Elle peut prendre forme d’une fresque, d’un collage, d’un dessin. Le facilitateur veille à ce que l’on y ajoute une légende et que l’on désigne quelqu’un pour la présentation en plénière, un moment fédérateur.
En effet, la métaphore collective n’est pas seulement une manière ludique de partager la vision, elle indique aussi la direction de l’action, où le groupe veut aller et ce qu’il veut réaliser dans le futur.
3
La Métaphore « bottom-up »
✓ Un état des lieux pour faire un diagnostic et trouver des solutions.
✓ Une carte systémique pour saisir comment le système fonctionne et apporter des changements.
✓ Une vision du futur pour déterminer des actions
Les Solutions
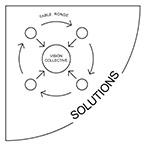
Dans cette troisième séquence, destinée à amener le groupe à trouver des solutions métaphoriques, il s’agit de mettre en place les conditions nécessaires pour que les intelligences multiples viennent fertiliser les solutions individuelles.
Le principe de pollinisation : les idées des uns inspirent les autres et contribuent à la floraison de l’intelligence collective.
Pour créer des conditions, où les idées des uns inspirent les autres, le facilitateur utilise les questions suivantes :
– Qu’est-ce qui doit se passer pour que cela arrive ?
– D’où pourrait venir (ressource, moyen, personnes) ?
– Qu’est-ce qui doit se passer juste avant (condition préalable) ?
– Et quand (ressource) qu’est-ce qui arrive à (blocage) ?
– Qu’est-ce qui se passe ensuite (conséquences) ?
À titre d’exemple, voici quelques techniques d’animation.
Le mur de solutions
Chaque participant est invité à dessiner une solution métaphorique qu’il affiche, en la commentant, sur un support commun. Parmi les solutions proposées, les participants identifient des éléments communs et des idées originales pour construire une solution collective, selon le principe de la métaphore bottom-up.
État présent-État désiré
Au préalable, les participants réalisent collectivement deux métaphores :
• la première en réponse à la question : Comment est la situation actuelle ?
• la seconde en réponse à la question : Comment aimerionsnous que ce soit ?
En comparant les deux métaphores, les participants évaluent l’écart et trouvent des solutions métaphoriques en posant une série de questions : Qu’est-ce qui doit se passer pour que cela arrive ?
La Table ronde
Gdansk, février-avril 1989
Les représentants du gouvernement polonais et ceux du syndicat Solidarnosc négocient la sortie de crise autour d’une Table ronde. Les Accords de Gdansk ont eu un effet de dominos provoquant des changements systémiques dans les pays situés à l’Est en Europe.
Le facilitateur organise l’espace et met à la disposition des participants le matériel pour dessiner sur des grandes feuilles. Les participants se placent autour d’une table (maximum six par table).
Dans un premier temps, chacun dessine directement sur une feuille une solution métaphorique. Ensuite il la présente aux autres participants qui peuvent le questionner.
Dans un deuxième temps, tous se lèvent pour changer de place et prendre celle de leur voisin de gauche. Ils y trouvent des solutions métaphoriques sur lesquelles chacun dessine une suggestion complémentaire.
Dans un troisième temps, chaque participant retrouve sa solution métaphorique enrichie par les contributions de ses collègues. Ensemble, ils décident comment mettre en place un plan d’action.
L’Atterrissage
En suivant le mouvement de la Boussole, cette quatrième séquence prépare la transition de la créativité métaphorique au contexte rationnel. Métaphoriquement parlant, après avoir plané dans l’imaginaire, les participants effectuent « un atterrissage » dans le réel. Pour ce faire, le facilitateur procède en quatre étapes :
1. Question Sextuple ;
2. Engagements personnels ;

3. Plan d’action ;
4. Feed-back appréciatif.
L’Atterrissage par la Question Sextuple
Le but de l’atterrissage est de télécharger les informations recueillies sur les séquences précédentes et de consolider les acquis. Le facilitateur s’adresse à chaque participant dans le groupe en utilisant la technique de la Question Sextuple. Il rappelle le Thème et invite les participants à noter toutes les réponses qui leur viennent spontanément en tête.
– Que savez-vous maintenant à propos de… suivi d’un rappel exact de l’intention de la séance.
Le questionnement fait partie d’un processus itératif, c’est-à-dire que la même question est ponctuée par un adjectif numérique jusqu’à six fois :
– Quelle est la première chose que vous savez ?
– Et la deuxième ? etc.
Ayant posé la dernière des six questions, le facilitateur ajoute une question supplémentaire pour évaluer l’écart :
– Quelle différence cela fait de le savoir maintenant ?
Chacun est libre de garder ce qu’il sait pour lui ou de le partager avec les autres participants en plénière.
Les engagements personnels
En poursuivant la dynamique de questionnement sextuple, le facilitateur peut demander aux participants :
– Quel est le premier pas que vous pouvez faire dès maintenant pour réaliser votre Vision ?
– Et le suivant ? Etc.
Les participants peuvent annoncer leurs propositions oralement, ou écrire sur des Post-It pour les déposer sur un support commun. S’il y a plusieurs propositions qui se recoupent, des groupes de travail s’organisent pour proposer des actions collectives, comme écrire une Charte de Qualité relationnelle, par exemple.
Le Plan d’action
Cette étape consolide la conversion de solutions métaphoriques en actions concrètes. Quand il y a plusieurs propositions qui se recoupent, le facilitateur propose de poursuivre en groupes de travail. La plupart du temps, les participants s’organisent par affinité pour préparer la mise en œuvre en utilisant des outils de conduite de
projet : rétroplanning, tableau de bord, etc. Ils doivent proposer des actions concrètes et les inscrire dans la temporalité.
Le Feed-back appréciatif
Lors de son dernier séminaire en 2007, consacré à l’émergence cognitive dans la conduite de projet, David Grove nous a montré l’exemple d’un feed-back appréciatif. À cette occasion, il nous a fait prendre conscience que partager nos découvertes et valoriser nos contributions renforce le processus de co-apprentissage et crée une conscience collective.
Pour ce faire les participants sont invités à énoncer précisément ce qu’ils ont aimé et appris, les uns des autres, dans le processus de créativité participative. Ils terminent par des remerciements nominatifs.
LES OUTILS DE CRÉATIVITÉ
Vous connaissez maintenant la Boussole qui est un méta-outil pour facilitateur Maintenant revenons sur trois techniques que vous connaissez déjà, pour découvrir comment les utiliser dans la facilitation collective : le dessin, le Clean Language et la Question Sextuple, appelée aussi « Question Puissance Six ».
Le dessin métaphorique
Facile et ludique, le dessin active l’intelligence symbolique de l’enfant qui sommeille en chacun de nous, et libère l’imaginaire. Pour répondre à d’éventuelles objections, le dessin peut être présenté comme un support visuel, au même titre qu’un schéma ou un croquis. D’autres supports visuels peuvent être utilisés : journaux pour faire un collage, le photo-langage, des objets comme symboles…
Il est facile de poser une question Clean sur un dessin. Il suffit de désigner un élément pictural de la métaphore et le questionner, en le
nommant « ça » : Questionner le dessin
✓ Qu’est-ce qui attire ton attention ?
✓ Y a-t-il autre chose à propos de ça ?
✓ Quel genre de ça est-ce ?
✓ Y a -t-il une relation entre ça et cela ?
En animation collective, le dessin est plus qu’un support visuel de la métaphore :
Dessin, support visuel
✓ Il met à la portée d’un groupe d’individus la possibilité de construire une vision partagée à partir des métaphores individuelles.
✓ Il ouvre un espace commun, où l’expression individuelle contribue à la créativité participative.
D’après Anita Olland l’utilisation du dessin comme support de la métaphore personnelle permet d’aller collectivement vers des questions de fond.
4
Partage d’expérience – Le dessin au service d’un projet professionnel
Coach d’étudiants, en seconde année de Sciences Politiques, Anita Olland organise des ateliers pour faciliter le choix d’un projet professionnel. En introduisant la métaphore personnelle et le dessin, elle apporte la preuve que l’on peut accompagner collectivement un groupe, où chacun travaille individuellement son propre projet. Pour ce faire, Anita donne la consigne suivante :
Pensez à votre projet qui correspond à ce que vous aimeriez faire plus tard, à l’issue de vos études.
Si ce projet se réalise, ce serait comme quoi ? Dessinez-le. Ensuite Anita donne un exemple de questionnement de la métaphore avec la Boussole de Clean Language Puis elle invite le groupe à travailler en binômes pour explorer mutuellement leurs métaphores En fin d’atelier, les étudiants constatent qu’aborder leurs projets par le biais de la métaphore leur permet de lever des inhibitions et de se projeter plus loin.
– Le projet semblait clair dans ma tête… Pourtant l’expliquer à quelqu’un m’a permis de préciser des choses à faire.
– Le dessin permet de mettre en évidence des parties occultées et d’aller chercher des renseignements qui manquent
– Cela m’a permis de me poser de bonnes questions sur les détails et les évidences. Maintenant je crois que mon projet va se réaliser.
– Au-delà du projet professionnel, c’est un projet de vie qui émerge
Le Clean Language en groupe
La pratique du Clean Language en groupe ressemble par certains aspects à une pratique conversationnelle. Les questions sont posées directement par rapport au sujet, sans répétition superflue. La syntaxe se limite à la reprise des mots prononcés par son interlocuteur dans leur forme exacte.
La syntaxe du Clean Language en groupe
✓ Répéter les mots exactement.
✓ Questionner un seul élément à la fois.
✓ Questionner les relations entre deux symboles.

✓ Limiter le nombre de questions à moins de trois.
Le Clean Language peut être associé à d’autres pratiques de facilitation.
La Boussole des questions Clean Language
Partage d’expérience de Dominique Barbès – Le Clean dans ma boîte à outils
Les questions Clean sont toujours dans ma boîte à outils, même si je ne mène pas l’intégralité d’un coaching Clean. Voici plusieurs exemples de situations dans lesquelles je peux les utiliser, parfois au pied levé.
Quand j’ouvre une rencontre dans laquelle je souhaite que les participants soient réellement engagés et co-responsables, j’ai conservé ces trois questions d’ouverture, où des réponses sous forme de métaphores sont encouragées :
– Si cette rencontre se passait comme tu le veux, ce serait comme quoi ?
– Pour que la rencontre soit comme ça, TU seras comme quoi ?
Les réponses sont accueillies sans échange et notées par le facilitateur. Les métaphores individuelles arrivent progressivement, des images émergent, puissantes, diverses et chargées d’énergie. L’espace d’apprentissage collectif se co-construit.
Autre exemple, alors que je facilitais le démarrage d’un nouveau groupe de travail, transversal à plusieurs services et chargé de suivre la mise en œuvre d’une nouvelle planification stratégique Je souhaitais aborder la question de leur identité J’ai donc étalé des images en photolangage et j’ai simplement posé la question :
– Et ce Comité, à quoi voulez-vous qu’il ressemble ?
Chacun a apporté une métaphore et nous avons approfondi avec d’autres questions Clean du type :
– Y a-t-il autre chose à propos de ? C’est comme quoi ? Et quand ceci, que se passe-t-il avec cela ?
Les caractéristiques de ce collectif en émergence sont apparues en quinze minutes La rencontre s’est ainsi terminée en énergie, les membres du comité reliés entre eux avec une représentation stimulante et positive de leur nouveau « Nous » collectif
À la rencontre suivante de ce comité, nous disposions de la matière pour reprendre la question de l’identité et créer les conditions de réussite : –Voici vos souhaits de la dernière rencontre…
– Et pour que cela arrive, que doit-il se passer ?
De cette façon nous avons construit ensemble le Pacte, l’entente explicite, qui a relié les membres du comité et leur a permis de réussir leur mission.
La Question Sextuple
La Question Sextuple est connue sous le nom de Power of Six , ou la Question Puissance Six. Elle s’adresse à l’intelligence cognitive de l’individu et invite à verbaliser pour soi-même le savoir dont on est détenteur. En accompagnement collectif, le facilitateur fait appel à cette question pour accompagner chacun à découvrir ce qu’il a appris au cours du processus.
La question est brève et utilise de manière répétitive un verbe appelé Driver. Le verbe savoir est le plus courant. Le facilitateur utilise le questionnement en s’adressant individuellement à chacun.
Poser la Question Sextuple
✓ Que savez-vous (individuellement) à propos de… ?
✓ Quelle est première chose que vous savez (chacun) maintenant ?
✓ Et la deuxième ?
✓ et troisième ?
✓ … quatrième ?
✓ cinquième ?
✓ … sixième ?
Quelques applications les plus courantes :
• faire un remue-méninge pour trouver un sujet d’intérêt commun ;
• trouver rapidement une métaphore personnelle ;
• terminer une séquence de travail ;
• faciliter la transition entre l’imaginaire et le rationnel ;
• préparer le feed-back appréciatif…
5
Utiliser la Question Sextuple pour trouver une métaphore
Le facilitateur annonce le sujet sous forme interrogative, par exemple : Comment serait le monde où il y a la culture de facilitation ?
Chaque participant note individuellement ses six réponses :
✓ Quelle est première chose que vous savez ?
✓ et la deuxième ?
✓ … la troisième ?
✓ quatrième ?
✓ … cinquième ?
✓ … sixième ?
Puis chacun relit sa liste pour répondre à la question… (liste de réponses) :
–Et quand tout cela devient réalité, cela ressemble à quoi ?
Partage d’expérience de Thierry Brigodiot – La sixième réponse va à l’essentiel
Pour moi, c’est la question Puissance Six (Sextuple) qui convoque l’intelligence collective de manière très astucieuse. En plénière, pour faire un débriefing, je pose la question en englobant d’un geste la mosaïque de métaphores :
– Que savez-vous maintenant à propos de tout cela ?
Chacun prend la parole à tour de rôle. Il y a une première récolte qui apporte plusieurs idées.
Je laisse le groupe répondre dans tous les sens en notant les mots clefs Peu importe qu’au final il y ait une quarantaine de propositions À chaque fois, la sixième réponse va à l’essentiel, comme dans ce service de Santé au Travail qui était dans une difficulté complexe, ils ont répondu à la première question : « on est des professionnels, on est compétents Puis à la sixième question est sorti l’essentiel : il faut qu’on travaille sur nos postures !
La question « Puissance Six », c’est à mes yeux une belle contribution du Clean qui convoque l’intelligence collective de manière très astucieuse parce qu’il y a zéro déchet et toutes les contributions sont valables. C’est valable non seulement dans le cadre du coaching, mais c’est aussi valable quasiment partout, dans beaucoup de situations où on a passé du temps ensemble Pour moi, c’est la forme du Clean la plus accessible
UNE VARIÉTÉ D’APPLICATIONS
La facilitation Clean apporte cette spécificité de savoir s’adapter à ce qui émerge et composer avec l’existant. Ainsi chaque animation devient unique et créative, en s’adaptant à la dynamique collective du groupe.
Pour préparer un scénario, le facilitateur utilise la Boussole afin de structurer le canevas de l’animation. Pour ce faire, il va mener une réflexion pour concilier les objectifs du commanditaire, les attentes et les besoins des participants. Le scénario sera un canevas suffisamment souple pour permettre d’intégrer les attentes des participants et l’imprévu : traiter une objection, clarifier le sens, faire des impasses ou introduire des éléments d’animation complémentaires.
Les scénarios répondent à divers contextes d’animation : créativité, cohésion d’équipe, conduite de projet, workshop, briseglace, etc. et peuvent s’intégrer à d’autres méthodes d’accompagnement : Enquête Appréciative, Story Telling, World Café, comme nous l’illustrerons en fin de chapitre.
Voyons maintenant, à travers quelques exemples, comment s’approprier les techniques Clean pour dérouler des scénarios d’animation.
La vision Présent-Futur
Le Bateau ivre
Une entreprise, spécialisée en peinture et produits chimiques, a l’ambition de devenir leader sur le marché nord-africain. Or, à la suite d’une fusion, il y règne un climat de méfiance parmi ses cadres qui craignent pour leur poste. Étant donné le contexte culturel, valorisant le respect de la hiérarchie, la métaphore permet de contourner les résistances pour parler franchement.
Sur la base de ces informations, le facilitateur se donne comme métaobjectif de créer les conditions pour restaurer la confiance et développer la coopération. Le scénario est le suivant :
– Métaphore collective bottom-up pour faire le diagnostic : Comment estce actuellement ?
– Vision : Comment aimerions-nous que ce soit ?
– Pont entre les deux pour trouver des solutions : Qu’est-ce qui doit se passer pour que cela arrive ?
Les participants se prêtent avec curiosité à l’exercice pour dire ce qu’ils pensent en le dessinant Le diagnostic semble sévère : la maison en feu d’où s’échappent en criant des gens, des employés qui plient sous le poids d’un éléphant, des oiseaux dont les pattes clouées au sol tentent en vain de s’envoler Le questionnement Clean révèle le sens des symboles :
– la pesanteur des procédures et de la structure comme un éléphant impossible à soulever ;
– l’incendie reflétant la peur du futur dans un environnement concurrentiel ;
– les oiseaux cloués au sol pour dire l’impuissance et des tentatives avortées, etc.
La métaphore collective qui émerge à partir de la symbolique commune prend forme d’un bateau luttant contre les vagues d’une mer déchaînée : un bateau ivre, où chacun rame comme il peut
Pour sortir de l’impasse, ce n’est pas la peine de chercher ni les causes ni les responsables, quand on peut poser la question magique, celle de l’Intention : Et vous êtes comme dans un bateau ivre, où chacun rame comme il peut, et qu’aimeriez-vous qu’il arrive maintenant ?
Le Bateau ivre peut se transformer en Navette spatiale
À la place d’une réponse verbale, les participants se mettent à dessiner une vision alternative : une Navette spatiale Ils s’appliquent à préciser chaque détail qui a une signification importante à leurs yeux :

– Les membres de direction occupent le poste de pilotage, situé en tête. Ils peuvent aussi communiquer avec leurs équipes, expliciter leur vision et donner le cap.
– Le management occupe les places du milieu, se charge de la conduite des projets et de la communication
– Les collaborateurs, assis en rangs, connaissent leurs rôles et missions.
– Pour connaître les clients, on les invite à bord et ils font partie du voyage
– Les flèches pointent l’horizon, réalisation entre 2010 et 2015. Progressivement les participants, passifs au départ, se piquent au jeu et se mettent dans les groupes de travail, selon leurs compétences. Chaque groupe va présenter une proposition pour restaurer la confiance et faciliter la coopération :
– Instaurer une charte de Qualité relationnelle et développer le travail participatif.
– Mettre en place des tableaux de bord et des réunions brèves pour le suivi.
– Instaurer la relation client au cœur de la stratégie du développement commercial
Cet exemple illustre comment prendre du recul sur une situation, trouver des solutions et construire une vision d’un futur motivant.
L’approche bottom-up est particulièrement adaptée à la résolution de
points de blocage et au développement de la cohésion entre les membres de l’équipe.
La Table ronde
Un Mobile Store pour les Nuls
Un opérateur de téléphonie mobile souhaite organiser une séance de créativité pour ses techniciens spécialisés dans la sécurité des smartphones. Les participants sont curieux de découvrir comment la métaphore peut contribuer à présenter des solutions innovantes pour la prochaine « promotion de la sécurité mobile à l’occasion de la sortie de nouveaux smartphones ».
Dans le scénario, les techniciens de sécurité auront l’occasion d’expérimenter deux optiques en se mettant tour à tour à la place des clients ou des fournisseurs Répartis sur deux Tables rondes : celle des utilisateurs et celle des fournisseurs, ils imaginent des solutions pour réussir leur prochaine campagne de promotion. Ce faisant, ils s’aperçoivent que les solutions exprimées du côté client sont très différentes de celles imaginées côté fournisseurs.
La présentation plénière des deux axes de solutions aboutit à la décision de fusionner les deux métaphores pour créer un concept promotionnel qu’ils appellent : « Mobile store pour les Nuls » Les clients pourront y trouver un accueil qui se met à leur portée : une écoute personnalisée, des informations sous une forme simple et ludique, des séances éducatives pour apprendre des gestes de sécurité
Cet exemple illustre comment le processus de fertilisation croisée aboutit à des solutions qui font consensus. Le protocole de la Table ronde facilite la convergence des points de vue différents dans une créativité participative.
La vision systémique
Pilotes ou designers d’optimisation Lean ?
Une équipe d’experts qualité est missionnée pour implanter une méthode d’amélioration continue de la qualité des produits et services (Lean Six Sigma – L6S) au sein d’une entreprise de téléphonie mobile. Le scénario prévoit une première modélisation pour représenter graphiquement la complexité du système dans son fonctionnement actuel et faire un diagnostic. Une deuxième modélisation va intégrer des solutions pour atteindre l’objectif de « déployer la solution L6S à l’ensemble du système »
Le facilitateur invite les participants à faire un état des lieux en posant la question :
– Et actuellement votre périmètre d’action, cela ressemble à quoi ?
À partir d’un jeu de bûchettes (chaque bûchette représentant dix personnes), de Post-It pour étiqueter les acteurs clefs, de ficelles de couleurs pour indiquer des relations entre eux, l’équipe construit une métaphore en 3D du périmètre d’action et de l’ensemble des processus clefs de l’entreprise. Cette représentation collective aboutit à une image chaotique, une participante s’exclame :
– C’est comme le bazar qu’il y a dans nos têtes !
Guidés par le questionnement Clean de la série « Que doit-il se passer pour que cela arrive ? », les participants procèdent à une deuxième modélisation. Le territoire d’action L6S sort du chaos pour se réorganiser en plusieurs cercles qui représentent les degrés de coopération avec différents interlocuteurs.
À partir de cette nouvelle représentation, les experts définissent des actions prioritaires dont la publication d’un Livre Blanc pour populariser la démarche L6S au sein de l’entreprise
Au moment de l’atterrissage, on assiste à une redéfinition des rôles. Les participants qui se considéraient au départ comme Pilotes d’optimisation se redéfinissent en Designers d’une plateforme de décollage L6S. Leur mission en découle : former et accompagner de futurs acteurs du déploiement L6S dans l’entreprise et à l’international.
Dans cet exemple, la métaphore collective, issue d’une modélisation 3D, permet de déployer une approche globale à l’ensemble de l’organisation. Cette expérience illustre également comment une métaphore collective peut faciliter le regard systémique et la réorganisation d’un périmètre d’action.
La vision collective
L’Appreciative Inquiry en bref
Inventée par David Cooperrider à la fin des années 1980 à l’Université de Cleveland aux États-Unis, l’Enquête Appréciative (Appréciative Inquiry – AI) propose une méthode de conduite du changement . Au lieu de détecter et de corriger des dysfonctionnements dans une organisation, on met l’accent sur ce qui fonctionne et sur les forces vives de l’entreprise.
Après concertation entre la direction et un groupe de pilotage de projet pour encadrer le choix du Thème et préparer une fiche d’entretien appréciatif, la méthode se déploie en cinq étapes :
1. Définition : décider du projet positif ;
2. Découverte : apprécier le meilleur de ce qui est ;
3 Devenir (en anglais Dream) : partager la Vision du futur « ce qui pourrait être » ;
4. Design : co-construire des options de réalisation « ce qui devrait être » ;
5 Déploiement : soutenir les projets de changement : « ce qui sera »
6 1
Des Villages Appréciatifs
La Conférence internationale de l’Appreciative Inquiry réunit des fondateurs internationaux et praticiens de l’Approche Appréciative venant d’une cinquantaine de pays. En mars 2019 à Nice, la conférence avait pour thème « Comment mettre en lien les différents acteurs mondiaux de l’enquête appréciative et favoriser les échanges de pratiques pour le bien commun »
Dans le cadre des échanges prévus lors de l’évènement, nous formons une équipe mixte, franco-canadienne de six facilitateurs Clean, pour conduire un atelier destiné à montrer comment la métaphore peut s’appliquer à la méthode appréciative. Notre équipe veut montrer comment on peut construire une vision métaphorique qui peut s’intégrer à la deuxième étape méthodologique AI : le Devenir.
Le Thème de notre atelier propose d’imaginer des lieux de vie sous le nom de « Villages Appréciatifs », au sein desquels la communauté appliquerait les principes de l’Approche appréciative Une quarantaine de participants à l’atelier sont répartis de façon aléatoire autour de cinq tables thématiques, animées par un facilitateur Clean :
Culture, Éducation, Environnement, Gouvernance, Santé.
Une induction collective ouvre l’atelier :
– Imaginez à quoi ressemblerait le Village Appréciatif sur le thème qui est le vôtre. Adoptez l’œil du débutant pour apprécier la magie des questions minimalistes. Faites une expérience particulière de présence à vous-même, où vous écoutez la question, vous écoutez la réponse et vous vous écoutez vous-même. Et si cela arrivait tel que vous le souhaitez, ce serait comme quoi ? Faites un dessin.
Guidés par des facilitateurs chaque groupe construit une métaphore collective à partir de dessins individuels Les métaphores sont ensuite affichées sur les panneaux muraux avec des légendes :
– La révolution Culturelle ouvre des perspectives de cocréation et de co-apprentissage.
– L’Éducation, c’est comme surfer sur la musique de la vie au cœur de la cité
– L’Environnement, c’est comme un tissu vivant de cellules interconnectées qui évoluent et interagissent.
– La Gouvernance, c’est comme un Conseil de village avec des élections sans candidat et un partage du pouvoir
7 8
La Santé, c’est comme un espace de vie où chacun se reconnecte à la santé primaire globale.
Présentation de Villages Appréciatifs
Une présentation collective donne l’occasion d’approfondir les métaphores avec les questions Clean et les visions métaphoriques prennent corps. Des liens se créent entre les différents Villages Appréciatifs. Un espace partagé de conscience collective se dessine et constitue un tremplin pour engager la recherche des solutions, en réponse à la question suivante :
– Qu’est-ce qui doit se passer pour polliniser des Villages Appréciatifs dans le monde ?
Les solutions sont ajoutées directement sur le mur des métaphores, à l’exemple du Village de la Culture qui se dote d’Espaces multidisciplinaires pour pratiquer la méditation, d’une Agora pour échanger sur la place publique, d’une Médiathèque pour découvrir des programmes artistiques interactifs.
L’atterrissage commun, accompagné par la question Sextuple, incite les participants à s’engager dans l’action dans leurs communautés de vie
À la fin de cet atelier de quatre-vingt-dix minutes au total, nous avons été gratifiés par le témoignage suivant : Croiser les mondes de l’Enquête Appréciative et du Clean Coaching, c’est comme croiser deux courants d’air, l’un est orange, l’autre vert… L’un est le langage de la conversation, l’autre est l’espace métaphorique du Clean Language. Ces deux courants sont complémentaires. Ensemble, ils créent la qualité Appréciative-Clean.
Cette expérience illustre comment un atelier d’animation Clean peut venir fertiliser un évènement particulier (ici consacré à la méthode d’Appreciative Inquiry) et ouvrir des espaces partagés de conscience collective.
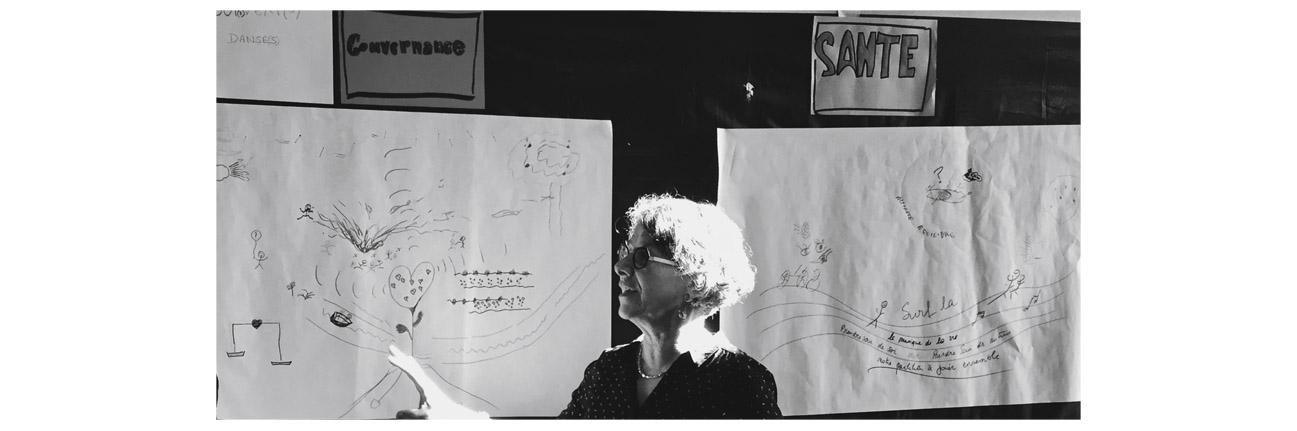
–
Une application hybride : les World Cafés
Un Clean World Café
À la demande d’un éditeur de plateformes collaboratives, Mohammed Aouichat imagine un scénario original de World Café Clean Le thème transversal fait sens pour l’ensemble de l’entreprise : Comment pouvonsnous mieux gérer notre Relation Client ?
Une installation en mode café est adoptée pour que de petits groupes puissent y prendre place, dans une atmosphère conviviale et décontractée. À chaque table, s’installent un hôte permanent et quatre ou cinq voyageurs itinérants. Toutes les tables discutent simultanément sur le thème central des questions successives :
– Quand vous évoquez la relation client, qu’est-ce qui vous monte à l’esprit ? Notez-le
– Et quand vous savez tout cela, la relation client pour vous, cela ressemble à quoi ?
– Représentez-le
(dessins, textes, cartes métaphoriques)
Sur le principe de la Table ronde, les participants dessinent leurs métaphores individuelles puis se déplacent pour compléter les métaphores de leurs voisins. À l’issue d’un tour complet, où toutes les métaphores ont été enrichies par des apports mutuels, les participants peuvent rejoindre une autre table. L’hôte permanent de la table présente la symbolique des métaphores qui s’y trouvent aux nouveaux arrivants. Lorsque tous les participants ont fait le tour des quatre tables, le groupe passe à l’étape de co-créativité sur le principe du bottom-up Les participants de deux différentes tables se regroupent pour créer une métaphore commune Chacun des groupes présente sa métaphore collective, avant de co-créer une vision partagée par tous les participants présents. Ils y reprennent tous les éléments symboliques révélés dans ce processus bottom-up. Après une présentation plénière de la vision partagée, les participants sont invités à faire une synthèse.
À l’issue de ce Clean World Café, qui aura duré deux heures et demie, le groupe de vingt-neuf participants a pu programmer neuf actions prioritaires à mettre en place. Avant de se quitter, ils expriment la volonté de renouveler l’expérience sur d’autres sujets concernant leur entreprise. Cet exemple d’une application hybride
9
allie des techniques de Clean Coaching et un processus conversationnel d’émergence d’intelligence collective, World Café.
Partage d’expérience de Mohammed Aouichat – La sagesse du client qui sait
En tant que facilitateur d’émergence de l’intelligence collective de différents groupes, je peux, avec recul, considérer que le processus métaphorique permet d’aller plus loin et plus vite que le processus conversationnel. En effet, en orientant les participants vers l’expression symbolique, le processus métaphorique leur permet de basculer collectivement sur un niveau de conscience plus ouvert et plus sensible qui booste naturellement leur créativité, au-delà des barrières hiérarchiques.

Grâce à la puissance de la métaphore et du Clean Language, les risques récurrents, liés au langage verbal, sont de facto contournés Le mode métaphorique permet à chacun d’être plus authentique et plus efficace. L’approche métaphorique, quand elle est animée de façon juste, minimaliste et peu interventionniste, facilite grandement le travail du facilitateur… pour peu qu’il arrive à faire entièrement confiance à la sagesse instinctive du client qui sait !
Ces quelques exemples d’applications collectives témoignent du fait qu’en adoptant la posture Clean et ses outils, le facilitateur est en mesure de :
Un Clean World Café
prendre en compte la demande du commanditaire et les attentes des participants ;
• produire un scénario adapté au contexte ;
• modifier en temps réel son scénario à l’émergence des besoins individuels et collectifs ;
• proposer des applications créatives voire hybrides.
Ce qui fait la qualité d’une équipe, c’est la motivation ; de s’engager et de s’y tenir. Or on ne peut pas motiver quelqu’un et, selon Marc Rittenberg , on peut seulement créer des conditions où chacun trouve la motivation personnelle pour s’engager et agir. Pour ce faire il a identifié quatre leviers universels de l’auto-motivation, liés à l’interaction avec les autres et le besoin de donner sens.
Les quatre leviers de l’auto-motivation
✓ Être écouté et se sentir compris.
✓ Être reconnu en tant que personne.
✓ Donner du sens à ce que l’on fait et pourquoi on le fait.
✓ Contribuer à une œuvre utile pour la communauté.
La mission du facilitateur consiste à réunir les conditions où chacun individuellement trouve ce dont il a besoin, et qui a du sens, pour être motivé et agir en faveur d’un but commun partagé.
Les outils Clean, en synergie avec la métaphore personnelle, augmentent la capacité d’écoute, et font respecter l’équité du temps de parole. En stimulant la curiosité, la métaphore suscite l’intérêt et active l’empathie. Comprendre l’autre permet de se mettre à sa place, donne l’envie de lui tendre la main pour l’aider ou pour faire ensemble. Dans un mouvement ascendant, la métaphore individuelle prend l’essor dans la créativité de chacun pour devenir collective. Et quelle que soit la technique, l’esprit Clean et son éthique ouvrent grand l’espace de la créativité pour qu’émergent
l’intelligence et la conscience collective.
Vous avez maintenant en main les connaissances, les outils et des pistes d’applications pour polliniser l’esprit Clean dans les
•
10
contextes collectifs de vos choix.
Conclusion
La métaphore, une matière qui permet l’émergence d’une connaissance de soi, de l’autre et du collectif
« Il est inutile de forcer les rythmes de notre existence L’art de vivre consiste à apprendre comment dédier du temps à chaque chose »
Carlo Petrini, fondateur de Slow Food
LE CLEAN COACHING MET À NOTRE PORTÉE DES OUTILS OPÉRATIONNELS pour explorer nos métaphores personnelles afin de se connaître et y trouver de leviers de changement : coaching individuel avec la Modélisation symbolique, outils collectifs tels que la Vision bottom-up, la Table ronde et la fertilisation, le dessin individuel et collectif, la Question Sextuple et le Feed-back appréciatif. L’auto-modélisation est au cœur de la méthode. Le facilitateur accompagne le client et l’équipe dans la gestion de leurs forces et de leurs talents.
Pour répondre à la question qui m’est souvent posée, « peut-on s’auto-modéliser ? », je partage avec vous mon expérience.
L’écriture de ce livre m’a rendue consciente de mes propres mécanismes cognitifs à l’œuvre dans le processus et d’un phénomène d’émergence de sens. Ma pensée se focalise dans le flot d’informations sur celles qui sont en résonnance avec le sujet sur lequel je travaille. Je laisse une part au hasard : coïncidences, conversations, métaphores qui m’interpellent et tous ces ingrédients se retrouvent pêle-mêle dans la marmite de l’inconscient où la pensée s’élabore. Dans la journée, je sens la présence des idées, tel un nuage énergétique qui m’accompagne comme un ami… La nuit,
je fais des rêves où le processus de connexion d’idées se poursuit…
Parfois, je me réveille vers trois heures du matin ayant en tête des idées claires. Une urgence de les poser sur le papier s’impose car je sens le danger de l’oubli au réveil. Je me mets à écrire, les mots sortent tout seuls telle une écriture automatique… Quand les versions de textes se succèdent par itérations, je corrige chaque nouveau texte à la main ce qui active une connexion entre le corps et l’esprit. Quand les connexions se font entre des idées captées inconsciemment (l’invisible) avec les pensées conscientes (le visible), un nouveau sens émerge. Ce processus est jubilatoire, il me remplit de joie.
Je cherche une métaphore qui donnerait forme à ma stratégie d’écrivaine. Celle qui émerge est slow food car elle invite à ralentir la cadence, prendre le temps de choisir ses aliments, de les connaître avant de les cuisiner convenablement et de les savourer en bonne compagnie. La lenteur d’escargot, l’emblème de l’organisation « Slow Food », donne sens à mon besoin inné de donner du temps au temps. Cette métaphore m’apporte la connaissance de mon propre processus de créativité et la confiance dans ma compétence de mener mon projet d’écriture à bien. Le slow food, devenu ma métaphore personnelle, a un caractère systémique car il me fournit le modèle de mon fonctionnement opérationnel. Ainsi je peux l’utiliser dans d’autres contextes pour prendre une décision importante, organiser un voyage ou encore m’autoriser à reporter des choses si je ne me sens pas prête… en adoptant l’attitude de slow food.
Le secret de la métaphore ne serait-il pas la capacité de donner une forme transitoire à un contenu liquide et de pouvoir s’adapter aux changements successifs ? Quel que soit le mode d’accompagnement individuel ou collectif, la métaphore nous invite à ralentir, à prendre le temps de savourer nos différences et à vivre en bonne intelligence sociale. Des repères individuels et collectifs peuvent se construire de manière métaphorique. Le caractère évolutif de la métaphore, où rien n’est figé, s’avère adapté à une réalité du monde qui, de solide, est devenu liquide. Où il n’y a pas de réponse simple ni unique, où personne ne détient ni la connaissance ni la vision du futur et de l’ensemble du système. Mais chacun en a
une représentation partielle qu’il lui sera plus facile de livrer sous forme de métaphore qui le protège de la critique de celui qui sait.
Les métaphores personnelles ont la vocation de prendre place dans l’émergence d’une sagesse collective, source d’inspiration d’une créativité participative, ayant impact sur nos vies comme le bien-être social, le souci des humains et du vivant, résilience quant aux changements climatiques… En bref, ce qui est bon pour la planète et les générations à venir !
Lexique Clean
Analogie : opération mentale qui se fonde sur la perception des similitudes entre les choses et les idées de nature différente.
Apprentissage : processus cognitif, où on apprend sur la base de ce que l’on connaît déjà en rajoutant des informations et des expériences nouvelles.
Atterrissage : application de la Question Sextuple pour terminer une session de Clean Coaching.
Auto-modélisation : démarche personnelle d’exploration de son mode de fonctionnement.
Back-tracking : technique qui permet de rappeler les éléments de réponses précédents pour poser la question suivante.
Bottom-up : technique de créativité qui permet de construire une métaphore collective à partir de métaphores personnelles.
Boussole Clean : outil qui permet de concevoir et animer une session de Clean Coaching.
Cadrage : technique de facilitation qui donne un cadre rationnel et sécurisant à la créativité métaphorique.
Carte mentale : représentation d’un espace spatial et cognitif.
Clean Coaching : méthode d’accompagnement qui permet de générer des énergies, du sens et des solutions propres à chaque coaché.
Clean Language : technique de questionnement adaptée à l’exploration métaphorique.
Clean Language collectif : technique simplifiée du Clean Language pour la facilitation collective.
Clean Space : technique de l’émergence cognitive, où l’espace devient le co-facilitateur pour collecter des informations plus ou moins conscientes, et stimuler l’émergence du sens.
Conscience collective : phénomène d’émergence d’un consensus sur les valeurs, la vision partagée et la recherche participative des solutions.
Communication métaphorique : interaction qui utilise la métaphore comme moyen pour transmettre un message.
Dessin libre : support visuel utilisé dans le processus de l’accompagnement avec les métaphores personnelles.
Dialogue avec la métaphore : conversation initiée par le facilitateur entre la métaphore et le client.
Domaines-sources : classement de contextes qui inspirent les métaphores personnelles :
1. Êtres vivants : personnes, animaux, plantes.
2. Corps : physiologie y compris la maladie.
3. Choses : matière, constructions, produits.
4. Activités : faire, vivre, accomplir.
5. Environnement : lieu de vie, nature, climat.
6. Physique : lois, gravité, énergie.
7. Médias : culture, littérature, tradition orale, presse, réseaux sociaux.
Emergent Knowledge : ensemble de protocoles (Clean Space, Question Sextuple) développés par David Grove, où l’inconscient cognitif et la pensée consciente se rencontrent.
État présent / État désiré : technique de créativité participative pour trouver des solutions.
Facilitateur Clean : professionnel d’accompagnement qui adopte la neutralité optimale dans la posture et le minimalisme dans ses interventions.
Facilitation métaphorique : processus d’accompagnement avec la métaphore et les techniques Clean.
Facteurs clefs de performance collective : éléments essentiels pour la réussite d’une démarche collective : la fluidité dans la communication, l’égalité de temps de parole, le respect de toutes les contributions, le but commun et la vision partagée.
Feedback appréciatif : partage mutuel de ce que l’on apprend les uns des autres.
Imagination : faculté de combiner des idées et des images pour former des représentations nouvelles.
Intelligence analogique : capacité à traiter des informations et résoudre des problèmes par analogie.
Intelligence collective : processus d’émergence où les intelligences multiples convergent vers un but commun.
Intelligence émotionnelle : capacité de reconnaître, comprendre et gérer ses propres émotions et composer avec les émotions des autres personnes.
Intelligence interpersonnelle : capacité empathique et relationnelle permettant d’interagir avec les autres et de créer du lien.
Intelligence intrapersonnelle : conscience de soi, de ses processus cognitifs et émotionnels.
Intelligence métaphorique : aptitude à se représenter une chose en termes d’autres choses.
Intelligences multiples : formes d’intelligences, développées à partir de talents, savoir-faire et savoir-être.
Intelligence symbolique : aptitude à représenter le sens des choses à travers leurs substituts, les symboles.
Intelligence sociale : capacité, au sein des groupes, à interagir et coopérer dans un but commun.
Intention : souhait implicite d’obtenir satisfaction d’un besoin.
Langage sensoriel : capacité à exprimer une pensée avec un contenu visuel, auditif ou kinesthésique.
Logique métaphorique : raisonnement par analogie avec un domaine-source dont s’inspire la métaphore.
Métaphore : figure de style qui utilise l’analogie pour révéler l’inconnu en termes de connu.
Métaphore collective : représentation métaphorique d’une vision partagée par un groupe de personnes.
Métaphore conceptuelle : outil cognitif, instrument d’appréhension et de conceptualisation du monde applicable à tous les domaines (Lakoff & Johnson).
Métaphore incarnée : forme de communication indirecte qui utilise le langage sensoriel pour décrire, comprendre et raisonner sur le conceptuel et le rationnel.
Métaphore personnelle : forme visible qui permet de mettre en mots et en images l’indicible de soi, son monde intérieur.
Métaphore systémique : forme d’auto-modélisation qui permet de représenter les schémas récurrents tels qu’un conflit, un dilemme, une impasse, un paradoxe dans le processus de modélisation systémique.
Modélisation Symbolique : méthode permettant de réaliser une auto-modélisation de nos représentations sous forme d’une carte métaphorique, le Paysage métaphorique.
Objection : difficulté qui émerge au cours de l’exploration métaphorique.
Paysage métaphorique : étape de l’auto-modélisation, où la métaphore devient psychodynamique et donne les clefs de son mode de fonctionnement.
Pensée inconsciente : processus cognitif sous-jacent à la pensée consciente.
Posture de facilitateur : attitude conforme à l’éthique Clean : confiance dans le processus et le génie du client, acceptation inconditionnelle, neutralité et minimalisme des interactions.
Questions Clean : 12 questions concrètes, précises et directes, classées par type d’informations : Intention, Attributs, Localisation, Métaphore, Relations, Temps, Source, Conditions, Effets.
Questions spécialisées : questions qui complètent l’exploration du Paysage métaphorique et permettent de différencier les symboles.
Question sextuple : technique de questionnement qui recourt à la répétition itérative pour stimuler l’émergence de la connaissance.
Pollinisation : processus de créativité participative, où les idées des uns inspirent celles des autres.
Ressource : élément symbolique qui peut se transformer en ressource en révélant son intention.
Rythmes de la pensée : la pensée instinctive qui se caractérise par le rythme de parole le plus rapide ; la pensée rationnelle par un rythme modéré ; la pensée inconsciente par un rythme lent, ponctué de silences.
Solution métaphorique : phénomène d’émergence de solutions dans le processus de créativité participative.
Symbole : figure ou une image employée comme signe d’une idée ou d’une autre chose.
Symbole métaphorique : élément métaphorique qui, développé par quelques questions Clean, va représenter une valeur, une ressource, une compétence ou un blocage.
Syntaxe Clean : technique de questionnement qui permet de réguler le flot de paroles et de maintenir l’attention dans le processus de cheminement intérieur.
Table ronde : technique de créativité participative pour trouver des solutions dans le processus de pollinisation.
Thème : but ou sujet d’une session collective.
Théorie de l’esprit : aptitude à deviner des sentiments et des pensées et savoir l’utiliser en communication interpersonnelle.
Vecteurs : stratégie de questionnement pour explorer une direction (causes, conséquences, conditions).
Vision : représentation du futur qui donne une direction pour agir dès à présent.
Vision partagée : représentation métaphorique qui émerge d’une mise en commun de valeurs symboliques communes.
Vision personnelle : façon de se représenter les choses, au présent ou au futur.
Voix Clean : technique vocale qui consiste à ralentir le rythme et à moduler la voix afin de poser une question.
Zoom : technique de questionnement pour différencier un élément ou un aspect d’une métaphore.
Bibliographie
ARNAUD. BEATRICE & CARUSO CAHN. SYLVIE. 2016. – La Boîte à outils de l’intelligence collective. Dunod InterÉditions
BAUMAN. ZYGMUNT. 2007. – Le Présent Liquide. Seuil. 2013.
BAUMAN. ZYGMUNT. 2013. – La vie liquide. Arthème Fayard/Pluriel
CLAXTON, GUY. 1999. – Hare Brain, Tortoise Mind. How intelligence increases when you think less. Ed. Harper Collins Publishers.
COSACEANU, ANCA. 2017. – La métaphore conceptuelle, The Annals of Ovidius University of Coanstanta: Philology Series Vol. XXVIII.
GOODALE, MELVIN.A. & WESTWOOD, DAVID. 2008. – An evolving view of duplex vision : separate but interacting cortical pathways for perception and action. Ed. PWN.
De GANDT, JENNIFER. 2008. – La pensée métaphorique dans le coaching professionnel : Clean Language, Clean Space et Modélisation Symbolique. Dans Le Grand Livre de Coaching. Ed. Eyrolles,
GROVE, DAVID, & PANZER, B.J. 1989. – Resolving Traumatic Memories: Metaphors and Symbols in Psychotherapy. New York, Irvington,
HARLAND, PHILIP. 2009. – The Power of six, A Six Part Guide to SelfKnowledge, Wayfinder Press.
HARLAND, PHILIP. 2017. – Des solutions dans la tête. À la découverte de la Puissance Six. Dunod-InterÉditions.
HOFSTADTER, DOUGLAS & SANDER, EMMANUEL 2013. – L’Analogie, Cœur de la pensée. Odile Jacob.
JOHNSON, MARK. 1987. – The Body in the Mind. University of Chicago Press.
JOUVENET, ROLAND. 2009. – Le cerveau magicien. Odile Jacob.
JUSZCZYK, KONRAD. 2017. – Madrosc metafory. Coach Space & Wydawnictwo RYS, Poznan.
KOVECSES, ZOLTAN. 2002. – A practical introduction. Oxford : Oxford University Press.
KOVECSES, ZOLTAN. 2006. – Language, Mind and Culture, Oxford University Press.
LAKOFF, GEORGE & MARK JOHNSON. 1986. – Les Métaphores dans la vie quotidienne. Éditions de Minuit.
LAKOFF, GEORGE. 1987. – Women, Fire, and Dangerous Things, What Categories Reveal about the Mind, University of Chicago, 1987.
LAKOFF, GEORGE. 1993. – The contemporary theory of metafor. In: Andrew Ortony (ed.) Metaphor and Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 202-251.
LAWLEY, JAMES et TOMPKINS, PENNY 2007. – Métaphores dans la tête. Transformation par la Modélisation Symbolique et le Clean Language. Dunod-InterÉditions.
LAWLEY, JAMES & TOMPKINS, PENNY 2004. – A Strange and strong sensation, Vidéo, Ed. The Developing Company Press,
LAWLEY, JAMES & TOMPKINS, PENNY. 2004. – Clean Language revisited. The Evolution of a model www.cleanlanguage.co.uk.
PIESKIEWICZ, BOGENA & KOLODKIEWICZ, MAGDA. 2011. – Metafora w coachingu, zastosowanie metody Clean Coaching w pracy z organizacjami in Coaching jako katalizator rozwoju organizacji New Dawn, Warszawa.
Pradas-Billaud, Hélène. 2010. Les jours. 2013. – Belle lurette ; 2017. La formidable histoire de Charles Pipeyroux. Edition Chèvre-feuille-étoilée.
ROSSI, ERNEST 1993. – Psychobiologie de la guérison. Influence de l’esprit sur le corps. Ed. Hommes et Perspectives.
SANDER, EMMANUEL. 2000. – Analogie, du Naïf au Créatif. Ed. L’Harmattan.
SERVAN-SCHREIBER, EMILE. an. 2018. – Supercollectif, La nouvelle puissance de nos intelligences. Ed. Fayard
SULLIVAN, WENDY and REES, JUDY. 2008. – Clean Language, Revealing Metaphors and Opening Minds, Crown House Publishing.
SUROWIECKI, JAMES. 2004. – The Wisdom of crowds. Anchor Books.
WALKER, CAITLIN. 2014. – From contempt to curiosity. Clean Publishing.
WAY, MARIAN. 2013. – Clean Approches for coaches. How to create the conditions for change
Remerciements
La nature de l’intelligence collective est également émergente. J’ai ainsi un sentiment de reconnaissance profond à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation finale de ce Manuel de Clean Coaching. Mes remerciements vont à :
Ceux qui m’ont inspirée par leurs idées : David Grove, Jennifer De Gandt, Penny Tompkins, James Lawley, Emmanuel Sander, Zoltan Kövecses, Daniel Servan-Schreiber…
À Hélène de Castilla et l’équipe de Dunod-InterÉditions pour leur bienveillance dans mon long processus d’écriture…
À Anne Sophie Picquart, coach d’écriture qui m’a aidée à mettre le pied à l’étrier dès la première édition… D’autodidacte, je suis devenue écrivaine…
À Louise Dufour, compagnonne d’écriture qui me challenge pour que mes textes soient « corrects » comme on dit au Québec…
À Jane Gayral et Delphine Mabire pour les illustrations…
À Xavier Caumon et Laurent Gessay, mes partenaires de IFMFonction2, qui m’ont soutenue pour réaliser la méthode de Clean Coaching…
À Dominique Barbès, Laure Duthu, Anita Olland, Mohammed Aouichat, Thierry Brigodiot et Benjamin Duval pour leurs partages d’expériences…
À mes amis québécois, Marc Labonté, Jacques Tremblay, Carole Hardy, Caroline Boivin, Roch Landry…
À mes amis polonais Bozena Grabowska, Agnieszka Marlinska, Konrad Juszczyk (Poznan), Julian Czurko (Lodz), Joanna Sadowska Buda, Magda Robak, Bartosz Tyminski (Varsovie), Beata Marciniak (États-Unis) qui transmettent le Clean à leur tour…
À la communauté appréciative, dont Jean Pagès, Jean-Christophe Barralis, Christine Cayré et les participants de notre atelier de Vision collective à la Conférence d’Appreciative Inquiry à Nice…
À mes amis, lecteurs-correcteurs bénévoles, Laure Duthu, Jean Barbès, Keitia Priem-Moy, Isabelle Ampart, Fabrice Aimetti…
À ceux dont nos chemins se sont croisés en formation ou ailleurs, créant une grande constellation de praticiens, clients, curieux et sympathisants…
À vous, lecteurs, à qui je transmets ce guide de voyage avec la métaphore dans un monde moderne et liquide !
1. Cooperrider D. & Barrett F., « Generative metaphor intervention: a new approach for working with systems divided by conflict and caught in defensive perception », in Appreciative Inquiry – An emerging direction for organization development, Cooperider D. et al. (sous la direction de), Stipes Publishing, 2001.
1. Consultant-coach, fondateur d’Erceor, membre de la Maison du ProcessWork (France).
2. Traduit par les membres du réseau Clean, il a été édité en 2006 sous le titre Des Métaphores dans la tête – Transformation par la Modélisation Symbolique chez InterÉditions
3. Whakapapa (qui se prononce fakapapa en maori) est un principe basé sur la lignée qui comporte en elle le passé et le futur de l’individu.
4. Laure Duthu, ingénieure dans des postes de management transverse dans un groupe d’électronique pour l’aéronautique et la défense.
5 Philip Harland est auteur d’un livre intitulé Power of Six ; traduction en français : Les Solutions dans la tête, à la découverte de la Puissance Six, InterÉditions, Malakoff, 2017.
6. Frigyes Karinthy (1887-1938), écrivain, dramaturge, poète, journaliste et traducteur hongrois.
7 Stanley Milgram (1933-1984), psychologue social américain
8. Kotchovnik (au masculin), personne dont le mode de vie consiste à se déplacer d’un endroit à un autre d’une manière temporaire. Mode de vie de tribus nomades en Asie. Dictionnaire de langue polonaise PWN, 1998.
9 Zygmunt Bauman, La Vie liquide, Arthème Fayard, Paris, 2013
1. Écrivain de science-fiction américain, auteur du Cycle d’Ender.
2. Martin McGall et son équipe de l’Imperial Collège à Londres ont imaginé une cape spatio-temporelle qui serait capable d’ouvrir un espace-temps dans la lumière en contrôlant sa vitesse par le biais de fibres optiques.
3 Open your Mind, Newsletter, 6 avril 2012
4. Georges Lakoff et Marc Johnson, Les métaphores dans la vie quotidienne (États Unis), les Éditions de Minuit, Paris, 1986.
5 E Sander, D Hofstadter, « La vie politique est-elle un concours de métaphores ? », Sciences Humaines, n 215, mai 2010
6. TV Arte : dans « Une heure avec Roberto Alagna, Yvan Cassar, chef d’orchestre ».
7 Xavier Caumon, consultant coach, Institut Français du Management, Fonction2, Paris
8. Zoltan Kovecses, linguiste hongrois, auteur de Where Metaphors Come From, Oxford Unversity Press, 2015.
9 Lucia Wainberg, socio-artiste franco-uruguayenne, Montevideo, Uruguay
10. Women, Fire, and Dangerous Things, What Categories Reveal about the Mind, University of Chicago, 1987.
11. Définition collective, praticiens en Clean Coaching, Varsovie 2013.
12 Metaphor and Guided Imagery for Psychotherapy and Healing, AbeBooks, 2005
13. Hugues de Montalembert, artiste peintre et écrivain français, France Inter, avril 2011.
14 Voir chapitre 4 : « Le dialogue avec la métaphore »
o
1. Emmanuel Sander, Professeur en Psychologie et Sciences de l’éducation (Genève). Auteur de la théorie de l’acquisition et de transmission de connaissances fondée sur l’analogie. « Analogie, du Naïf au Créatif », Sciences Humaines 2014.
2 France Inter, Interview de Vladimir Cosma, compositeur français
3. Sander, Emmanuel, Analogie, du Naïf au Créatif, L’Harmattan, Paris, 2000.
4. Courrier international n 1061 du 3 mars 2011, page 30, « Eva Aariak, l’étoile polaire des Nunavummiut ».
5 Lakoff, George & Mark Johnson, Les Métaphores dans la vie quotidienne, Éditions de Minuit, Paris, 1986.
6. Cloud computing, un réseau de serveurs mutualisés et virtualisés qui offre l’accès à des ressources informatiques distants.
o
1. Hélène Pradas-Billaud écrit des poèmes et des romans dont : Les jours blancs (2010) ; Belle lurette (2013) ; La formidable histoire de Charles Pipeyroux (2017). Éditions Chèvre-feuille-étoilée.
1. Penny Tompkins, James Lawley, Les Métaphores dans la tête, InterÉditions, Malakoff, 2006.
2. Page 37 au chapitre 2, Félix trouve sa métaphore personnelle de désir avec les questions Clean.
3 Auteur de Hare Brain, Tortoise Mind, The Ecco Press, Harper Perennial, 1977
4. Image auditive : par analogie avec l’image visuelle, ce sont des mots, des sons, des bruits qu’on perçoit dans son for intérieur.
1. Voir chapitre 2 : « De la métaphore à la métaphore personnelle ».
2. Voir chapitre 6 : « Modélisation Symbolique côté facilitateur ».
1. Voir chapitre 4 : « Le dialogue avec la métaphore ».
2. Voir chapitre 4 : « Le dialogue avec la métaphore ».
1. Jean-François Noubel, conférencier, créateur de site de partage de connaissances.
1. Éditions Fayard, 2018. Émile Servan-Schreiber, docteur en psychologie cognitive, est journaliste et ingénieur en intelligence artificielle.
2. Éditions Jean-Claude Lattès, 2008.
3 Co-auteurs de la théorie et du concept de l’élite cognitive : The Bell Curve, Intelligence and Class Structure in American Life, publié par New York, Free Press, 1994.
4. Éditions Odile Jacob, 1995.
5 Jean William F Piaget (1896-1980) universitaire suisse et auteur, pionnier dans le domaine de la psychologie du développement de l’enfant
6. Frames of Mind : the Theory of Multiple Intelligence, New York : Basic Books, 1983 ; traduit en français : Les formes de l’intelligence, Odile Jacob, 1997.
7 Emotional Intelligence Imagination, Cognition and Personnality, Psychology Press, Philadelphie, 1990
8. Emotional Intelligence, 1995. Édition en français : L’Intelligence émotionnelle, Robert Laffont, 1997.
9. Auteur du concept « Big Data : vers l’ingénierie sociale ? », 2010.
10 “Evidence for a Collective Intelligence Factor in the Performance of Human Groups” Science, 2010
11. Anita Woolley et al. “Reading the Mind in the Eyes or Reading between the Lines. Theory of Mind Predicts Collective Intelligence Equally Well Online and Face-To-Face”. Plos One, 2014.
12 Extrait de l’introduction du livre : La boîte à outils de l’intelligence collective, Dunod, Malakoff, 2016
1. Voir la séance de coaching du chapitre 1.
2. Une carte n’est pas le territoire compilation de textes de Korzybski, traduits par Mireille de Moura et Jean-Claude Derni, Éditions de l’Éclat, 2007.
3 Images de la cité, Dunod, 1989
4. Coach professionnelle certifiée (PCC), facilitatrice certifiée en Clean Coaching, pédagogue et superviseure de coaches, basée à Montréal.
1. Je ne prétends pas ici expliquer l’état de recherche actuelle sur ce sujet, en me limitant à présenter la structure de la Boussole de Clean Coaching.
2. L’expression bottom-up sera expliquée plus loin.
3 Thierry Brigodiot et son associé, Benjamin Duval utilisent le Clean Coaching dans le conseil en management, Pragma Management, Paris 8
4. Anita Olland, business et executive coach en français et en allemand, praticienne de Clean Coaching.
5 Philip Harland, Des solutions dans la tête – À la découverte de la Puissance
Six, InterÉditions, Malakoff, 2017
6. https://ifai-appreciativeinquiry.com.
7 WAIC – World Appreciative Inquiry Conference, 19 - 22 mars 2019
8 Dominique Barbès, Marc Labonté, Jacques Tremblay (Québec-Canada), Thierry Brigodiot, Benjamin Duval, Bogena Pieskiewicz (France).
9. Mohammed Aouichat, facilitateur certifié en Clean Coaching, consultant-coach expérimenté et enseignant en universités et écoles d’ingénieurs à Rennes, concepteur de l’application Clean World Café.
10 Conférencier à Walter Haas School of Business, à l’Université de Berkeley, Californie
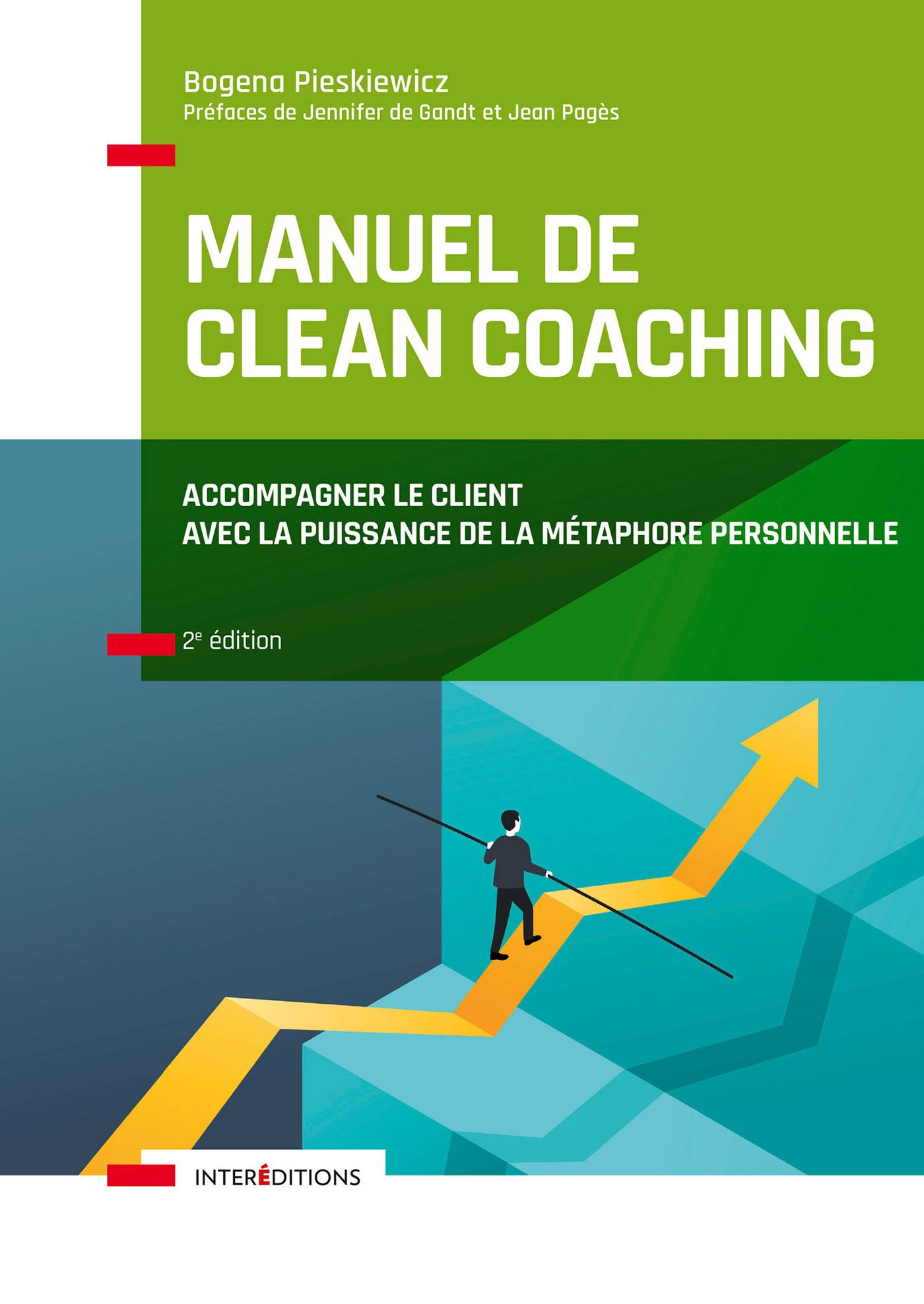
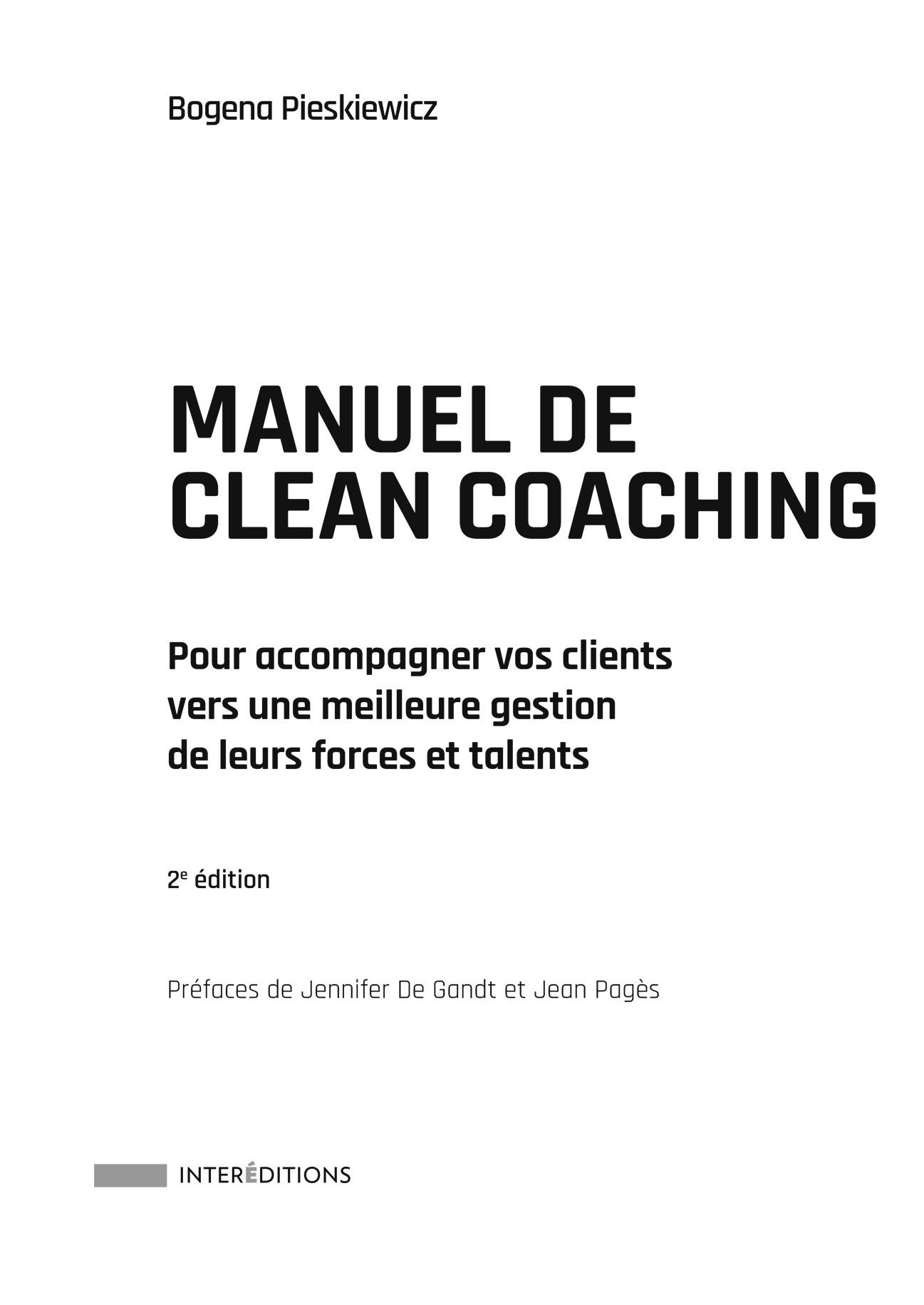









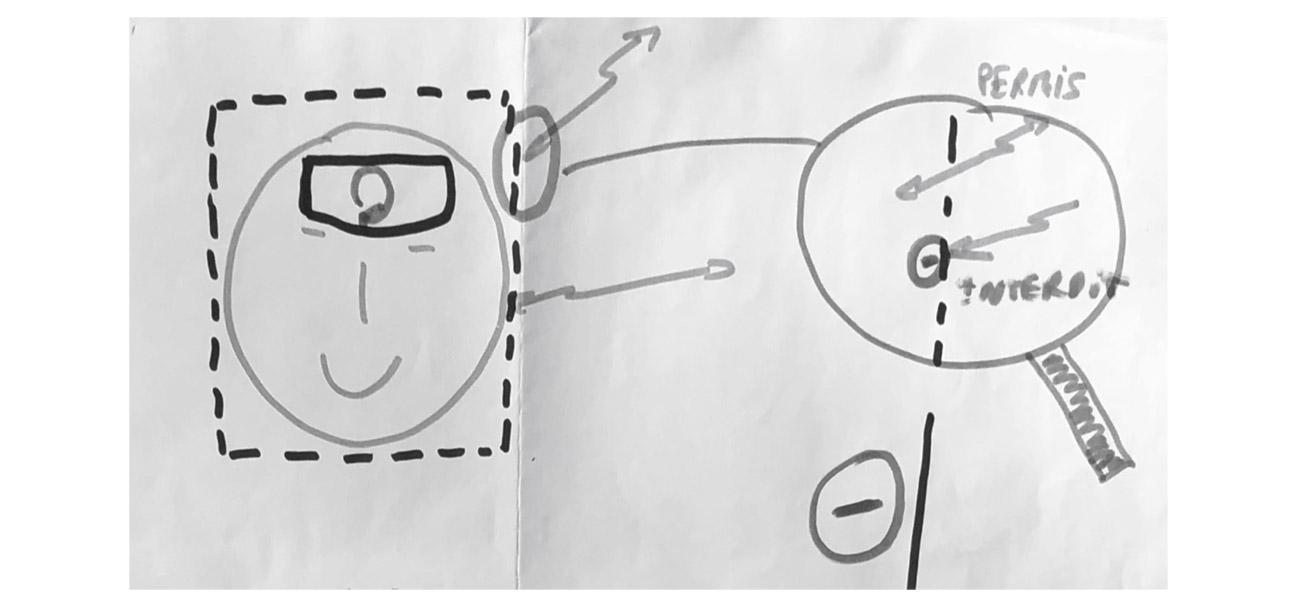

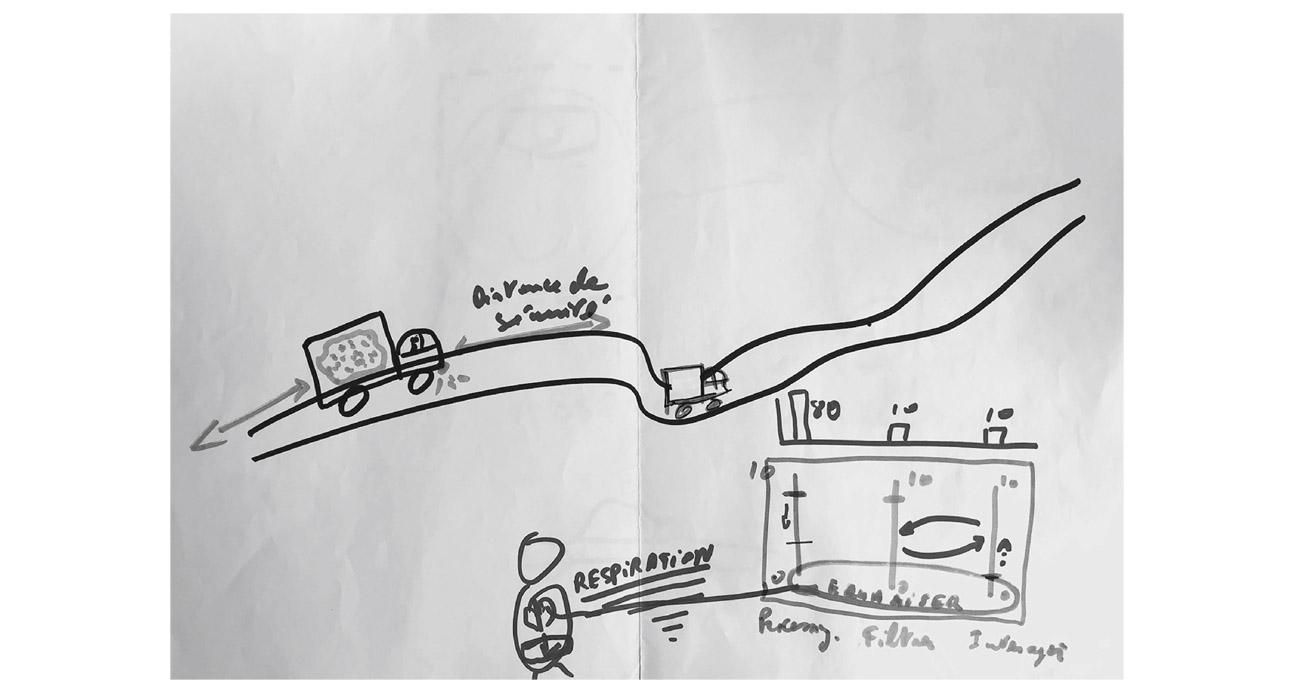



 Un mur de métaphores
Un mur de métaphores