CODE GRAMMATICAL
Français • 1re année du secondaire


CODE GRAMMATICAL
Français • 1re année du secondaire

CONFORME À LA PROGRESSION DES APPRENTISSAGES
Adj adjectif
Adv adverbe
Conj conjonction
Dét déterminant
N nom
Prép préposition
Pron pronom
V verbe
GAdj groupe adjectival
GAdv groupe adverbial
GN groupe nominal
GPrép groupe prépositionnel
GV groupe verbal
GVinf groupe du verbe à l’infinitif
P phrase
Sub. subordonnée
CONSTITUANTS DE LA PHRASE (P)
Sujet
Prédicat
Complément de phrase

attr. attribut compl. complément
CP complément de phrase
CD complément direct du verbe
CI complément indirect du verbe
ABRÉVIATIONS DIVERSES
aux. auxiliaire
f. féminin
ind. indicatif
m. masculin
p. p. participe passé
pers. personne (1re, 2e, 3e)
pl. pluriel
s. singulier
PICTOGRAMMES
Correct
Incorrect
Ajout
Déplacement
Effacement
Encadrement
Remplacement
Nouveaux contenus
Outils indispensables pour repérer et analyser des mots ou des groupes de mots dans une phrase, les manipulations syntaxiques sont au cœur de la compréhension de la grammaire.
L’AJOUT d’un mot ou d’un groupe de mots dans une phrase
Utilité Cette manipulation sert entre autres à déterminer la classe d’un mot, comme un nom, un adjectif qualifiant ou un verbe à l’infinitif.

UTILISE-LES POUR VÉRIFIER
TES ACCORDS, POUR PONCTUER TES TEXTES ET POUR QUE LA GRAMMAIRE
SOIT PLUS LOGIQUE POUR TOI !
J’ai une idée.
J’ai une idée géniale.
AJOUT D’UN ADJECTIF
APRÈS IDÉE = Nom
LE DÉPLACEMENT d’un mot ou d’un groupe de mots dans une phrase
Utilité Cette manipulation sert à identifier les constituants de la phrase ou à déterminer la fonction d’un groupe de mots, comme un complément de phrase.
Mes voisins ont organisé une superbe fête l’automne dernier Mes voisins, l’automne dernier, ont organisé une superbe fête
GROUPE DE MOTS DÉPLAÇABLE = COMPLÉMENT DE PHRASE
L’EFFACEMENT d’un mot ou d’un groupe de mots dans une phrase
Utilité Cette manipulation sert à reconnaitre le noyau et les expansions dans un groupe ou à identifier un groupe ou un constituant facultatif dans une phrase, comme un complément de phrase.
L’ENCADREMENT d’un mot ou d’un groupe de mots
Utilité
Cette manipulation sert à identifier le sujet de la phrase (encadrement par c’est… qui ou ce sont… qui) et à reconnaitre un verbe conjugué (encadrement par ne... pas).
Les nuits sans lune, des amateurs d’astronomie viennent camper ici.
Les nuits sans lune, des amateurs d’astronomie viennent camper ici
GROUPE DE MOT EFFAÇABLE = COMPLÉMENT DE PHRASE
Les feuilles tombées au sol forment un joli tapis coloré. ce sont Les feuilles tombées au sol qui forment un joli tapis coloré.
LE GROUPE PEUT S’ENCADRER = SUJET DE PHRASE.
LE REMPLACEMENT d’un mot ou d’un groupe de mots
Utilité
Cette manipulation sert à identifier la classe d’un mot en remplaçant un mot inconnu par un autre de même classe que l’on connait. Elle sert aussi à délimiter un groupe de mots, comme le groupe sujet dans une phrase, en remplaçant un groupe de mots par un pronom.
Olga est plutôt discrète. Olga est très discrète.
LE MOT PLUTÔT SE REMPLACE PAR UN AUTRE ADVERBE = ADVERBE.
l’adjectif la préposition le
Le nom fait partie des classes de mots variables.
Il est toujours le noyau d’un groupe nominal (GN).
SES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Il sert à désigner une personne, un animal, un objet, un lieu, une époque, un évènement, un sentiment, un concept abstrait, etc.
Il peut être Il est
Il est généralement précédé Il commence par Il peut donner Il possède
d’un déterminant.
l’école, un cahier, un très grand local
une lettre majuscule. Kim Thúy, Montréal, un Québécois
il peut y avoir des mots entre le déterminant et le nom.
variable en nombre : un genre qui lui est propre : masculin ou féminin.
un gymnase, une école
singulier ou pluriel. un gymnase, plusieurs écoles
• son genre (m. ou f.) ;
• son nombre (s. ou pl.) ;
• sa personne (3e pers.).
3e pers. f. s. ce sont des personnes, des lieux et des habitants.
Cette école est grande
LE DÉTERMINANT DEVANT LE NOM
Un nom commun n’est pas toujours précédé d’un déterminant. Il peut, entre autres, être : – seul ; Juin est le mois de ma fête. Parents et amis sont invités à la réception.
précédé d’une préposition. En juin, c’est ma fête.
Un nom propre peut être précédé d’un déterminant, notamment quand il est :
– précédé d’un complément ; Le talentueux Xavier Dolan a réalisé son premier film à 20 ans. – utilisé pour désigner des populations, des organismes, des œuvres, etc.
Le Guernica de Picasso est un tableau impressionnant.
Pour reconnaitre un nom commun
• Remplace un nom par un autre nom de même genre et de même nombre que tu connais et qui fonctionne dans le contexte.
• Ajoute un adjectif avant ou après le nom.
Le navire voguait paisiblement. Le bateau voguait paisiblement.
Je ne verrouille jamais la porte.
Quand tu ne connais pas le genre d’un nom, ajoute-lui un adjectif qui ne se prononce pas de la même façon au masculin et au féminin. mon expérience fabuleuse fabuleuse = f., donc expérience = f. Tu peux aussi vérifier son genre dans le dictionnaire.
Je ne verrouille jamais la grande porte jaune. ou
D’AUTRES CARACTÉRISTIQUES DU NOM
Certains noms varient en genre. Ils ont un trait animé, c’est-à-dire qu’ils désignent quelque chose de vivant et qui bouge.
un enseignant, une enseignante un chat, une chatte un magicien, une magicienne un homme, une femme Louis, Louise un Québécois, une Québécoise

Pour en savoir plus : La composition, p. 52
Le nom peut avoir deux types de formes.
• Forme simple : il ne peut pas être décomposé. un roman, une classe
• Forme composée : il est formé de plusieurs mots. un arc-en-ciel, un sous-sol, , un sac de couchage
ATTENTION ! LES NOMS COMPOSÉS N’ONT PAS TOUJOURS DE TRAIT D’UNION.
Le déterminant fait partie des classes de mots variables.
Il précède toujours un nom. Il ne peut pas être utilisé seul.
SES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Il sert à introduire un nom.
Il peut aussi : – indiquer une quantité ; – participer à la reprise de l‘information. Pour en savoir plus : La reprise de l’information, p. 62
receveur d’accord. simple (formé d’un seul mot) ou
Il est Il peut être Il reçoit
le genre (m. ou f.) et le nombre (s. ou pl.) du nom.
ce dauphin
m. s.
toujours placé à gauche d’un nom. composé (formé de plusieurs mots).
des baleines plusieurs spécimens le Pacifique cet immense océan notre si belle excursion
le bateau plusieurs bateaux notre bateau
il peut y avoir des mots entre le déterminant et le nom.
n’importe quel bateau beaucoup de bateaux la plupart des bateaux
Pour reconnaitre un déterminant
• Remplace le déterminant par un autre déterminant que tu connais et qui fonctionne dans le contexte.
Les requins possèdent beaucoup de dents. Les requins possèdent des/plusieurs/ deux dents.
Il faut harmoniser les sons quand le déterminant est placé devant un nom commençant par une voyelle (a, e, i, o, u, y) ou par un h muet.
• Les déterminants définis le et la se changent en l’. On remplace donc la voyelle e ou a du déterminant par une apostrophe.
l’aventure la aventure
l’homme le homme
• Les déterminants possessifs féminins ma, ta, sa deviennent mon, ton, son mon amie ma amie ton habitude ta habitude
• Le déterminant démonstratif masculin ce devient cet cet individu ce individu cet hôtel ce hôtel
DÉTERMINANT INDÉFINI
Il précède un nom désignant un élément dont on ne précise pas le nombre ou l’identité.
DÉTERMINANT DÉFINI
Il précède un nom désignant un élément connu ou une catégorie générale.
DÉTERMINANT POSSESSIF
Il indique à qui appartient l’élément qu’il introduit.
un/une/des ; plusieurs ; tout/toute ; chaque ; certains/certaines ; etc.
Un océan nous sépare. J’ai remis chaque petit poisson dans l’eau.
le/la/l’/les
La luxueuse croisière d’hier était formidable. (une croisière précise)
J’aime les mammifères marins.
mon/ma/mes ; ton/ta/tes ; son/sa/ses ; notre/nos ; leur/leurs ; etc.
Notre grande aventure a commencé ce matin. (celle de mon ami et moi, par exemple)
ON UTILISE CES DÉTERMINANTS LORSQUE LE NOM QU’ILS ACCOMPAGNENT EST CONNU. LE CONTEXTE PERMET DE COMPRENDRE DE QUEL NOM PRÉCIS ON PARLE.
DÉTERMINANT DÉMONSTRATIF
Il sert à montrer, à désigner.
DÉTERMINANT NUMÉRAL
Il exprime le nombre.
Attention ! Le déterminant numéral est presque toujours invariable.
Pour en savoir plus :
L’accord du déterminant : cas particuliers, p. 47
DÉTERMINANT PARTITIF
Il précède un nom désignant une réalité qui ne se compte pas.
DÉTERMINANT INTERROGATIF
Il précède un nom désignant un élément sur lequel on pose une question.
DÉTERMINANT EXCLAMATIF
Il précède un nom désignant un élément sur lequel on exprime une émotion.
ce/cet/cette/ces
Cet homme était bizarre. (celui dont j’ai parlé plus tôt, par exemple)

un/une ; deux ; quatre ; trente-trois ; mille ; etc.
Quatre bateaux ont chaviré. Il y a soixante-sept sortes de baleines.
du/de la/de l’/des
À la plage, je n’aime pas avoir du sable dans mes chaussures.
quel/quelle/quels/quelles ; combien de Combien de voyages as-tu faits cette année ?
quel/quelle/quels/quelles ; que de ; combien de Que d’anecdotes nous aurons à raconter à maman à notre retour !
Les déterminants contractés sont formés à partir des déterminants définis le et les et des prépositions à ou de. à + le = au à + les = aux de + le = du de + les = des
ATTENTION ! IL N’EST PAS POSSIBLE DE REMPLACER UN DÉTERMINANT CONTRACTÉ PAR UN AUTRE DÉTERMINANT. Je vais au poste de police. Je vais un poste de police.
L’adjectif fait partie des classes de mots variables.
Il est toujours le noyau d’un groupe adjectival (GAdj).
Il exprime une qualité, une caractéristique ou un classement dans une catégorie.
Il est
un mot variable.
receveur d’accord.
un adjectif qualifiant
Il permet : – de classer ou de qualifier le nom ou le pronom auquel il se rattache ; – de préciser une description ; – d’enrichir un texte.
Il peut être
un adjectif classifiant.
Il reçoit (QUALITÉ OU CARACTÉRISTIQUE) (CLASSEMENT DANS UNE CATÉGORIE)
le genre (m. ou f.) et le nombre (s. ou pl.) du nom ou du pronom qui lui donne l’accord.
Ils se sont endormis pendant la longue route
Elle était seule Ils étaient seuls f. s. f. s. m. pl.
Attention ! CERTAINS ADJECTIFS NE CHANGENT PAS DE FORME AU FÉMININ.
m. s. f. s.
Le lac était calme. La mer était calme.

une main moite un bon fruit une terrasse ombragée
le système solaire une spécialité québécoise
Les adjectifs qui désignent un peuple s’écrivent toujours avec une lettre minuscule.
La population québécoise est fière de ses origines diverses.
PSITT ! LES NOMS PROPRES DE PEUPLES
PRENNENT UNE MAJUSCULE (EX. : les Français ) ET LE NOM COMMUN QUI DÉSIGNE UNE LANGUE PREND UNE MINUSCULE (EX. : le français ).
Seul un adjectif qualifiant peut être précédé d’un adverbe d’intensité comme très, peu, vraiment, etc. des mains vraiment moites les fruits trop murs
L’adjectif classifiant, lui, est toujours placé directement après le nom.
l’autobus très scolaire l’autobus scolaire
Pour reconnaitre un adjectif
• Remplace l’adjectif par un autre adjectif que tu connais et qui fonctionne dans le contexte.
Ce spectacle touchant est un chef-d’œuvre. Ce spectacle drôle/triste/tragique est un chef-d’œuvre.
Ces adjectifs sont issus d’un verbe au participe passé ou au participe présent.
L’adjectif issu d’un participe passé C’est un participe passé employé seul (sans auxiliaire).
C’est une mission accomplie avec succès. (accomplie = adjectif participe issu du verbe accomplir)
Ces adjectifs s’accordent comme les autres adjectifs.
Pour distinguer un adjectif d’un participe présent
• Encadre le mot par ne pas Si l’encadrement est possible, ce mot est un verbe au participe présent et non un adjectif.

L’adjectif issu d’un participe présent Il se termine par -ant.
Cette mission angoissante est terminée. (angoissante = adjectif participe issu du verbe angoisser)
Pour en savoir plus : Le mode participe, p. 38
SOUVIENS-TOI QUE SI LE MOT EST UN ADJECTIF, TU PEUX LE REMPLACER PAR UN AUTRE ADJECTIF.
En touchant mes poches vides, j’ai paniqué.
En ne touchant pas mes poches vides, j’ai paniqué.
La phrase est correcte : touchant est un verbe au participe présent.
Le pronom fait partie des classes de mots variables. Il est donneur d’accord.
• S’il est sujet, il donne sa personne et son nombre au verbe.
• Il donne son genre et son nombre à l’adjectif ou au participe passé employé avec l’auxiliaire être qui s’y rattache.
SES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Il permet : – de reprendre l’information et d’éviter les répétitions ; – de désigner le narrateur et les personnages dans un texte.
Pour en savoir plus : La reprise de l’information, p. 62
Il est ou Il peut être
un pronom de reprise, qui remplace un mot ou un groupe de mots dans un texte.
un pronom de la communication, qui désigne les personnes qui interviennent dans une situation de communication. je, leur, y, chacun, qui
simple (formé d’un seul mot) composé (formé de plusieurs mots).
n’importe qui, les vôtres, celui-ci, celles-ci
Ce sont généralement des pronoms de la 3e personne du singulier ou du pluriel. (elle, il, lui, eux, l’)
Il possède alors un antécédent (l’élément repris par le pronom).
Le lion s’approcha de la fillette. Elle le regarda dans les yeux.
Antécédent de Elle : la fillette
Antécédent de le : le lion
Il s’agit des pronoms de la 1re et de la 2e personne du singulier ou du pluriel. (je, me, moi, nous, tu, te, toi, vous)
Je te le dis ! Je et te sont des pronoms de la communication.
Attention ! UN pronom de la communication peut aussi être un pronom de reprise s’il a un antécédent.
PRONOM PERSONNEL
Il indique la personne grammaticale (1re, 2e ou 3e).
PRONOM DÉMONSTRATIF
Il désigne la personne ou la chose dont on parle.
PRONOM RELATIF
Il introduit une subordonnée relative.
PRONOM INDÉFINI
Il renvoie à une personne ou à une chose imprécise.
PRONOM POSSESSIF
Il marque l’appartenance ou la possession.
PRONOM NUMÉRAL
Il indique la quantité d’une réalité qu’il représente.
PRONOM INTERROGATIF
Il remplace un élément pour former une phrase interrogative.
reconnaitre

je, me, moi, tu, te, toi, il/elle/iel, ils/elles/iels, lui/leur, on, se, nous, vous, eux, le/la/les, en, soi, y
J’aimerais que tu goutes à ces délicieux loukoums.
ce, ça, c’, ceci/cela, celui/celle/ceux/celles, etc.
Ceux-ci viennent directement d’Istanbul.
qui, que, qu’, quoi, dont, où, lequel, etc.
La personne qui a cuisiné ce plat partagera volontiers sa recette.
Les pronoms iel/iels ne sont pas genrés et sont utilisés pour désigner une personne ou un ensemble de personnes qui ne s’identifient pas à un genre défini.
certains, beaucoup, personne, plusieurs, n’importe qui, quelqu’un, quiconque, etc.
N’importe qui peut réussir ces délicieux chocolats.
le mien, le nôtre, le leur, les tiens, les vôtres, etc.
J’aime les pâtisseries de ma grand-mère, mais j’apprécie aussi les tiennes.
un/une, quatre, cinquante-cinq, etc.
Parmi les convives, huit voulaient manger la dernière part de gâteau.
qui, que, qu’, qui est-ce qui, qu’est-ce qui, qu’est-ce que, quoi, combien, lequel/laquelle/lesquels/lesquelles, etc.
Qui a reçu la dernière part du gâteau ?
• Remplace le pronom de reprise par son antécédent.
LE PRONOM NUMÉRAL SE DISTINGUE DU DÉTERMINANT NUMÉRAL, CAR IL N’INTRODUIT PAS UN NOM.
Prune est partie en Colombie. Elle adore son voyage. Prune est partie en Colombie. Prune adore son voyage. (Le mot Elle est le pronom de reprise de « Prune ».)
Pour distinguer un pronom d’un déterminant
Le pronom se trouve à gauche ou à droite d’un verbe alors que le déterminant précède un nom.
Il fait partie des classes de mots variables.
Il a la particularité de se conjuguer.
Il est toujours le noyau d’un groupe verbal (GV).
Le verbe permet d’exprimer des actions, des caractéristiques, des émotions et des opinions qu’il situe dans le temps (passé, présent, futur).
Sa forme de base est

Il peut être conjugué
l’infinitif. à un temps simple
aimer, courir, savoir, prendre
PSITT ! C EST LA FORME QU IL A QUAND TU LE CHERCHES DANS UN DICTIONNAIRE OU DANS UN CONJUGUEUR.
en personne et en nombre ;
1re, 2e ou 3e personne du singulier ou du pluriel
Il reçoit
Il varie ou
tu aimes, il court
Le verbe en mode et en temps. à un temps composé (auxiliaire + participe passé).
Indicatif présent, imparfait, etc.
Impératif présent, passé Subjonctif présent, passé
la personne et le nombre
1re pers. pl.
du pronom sujet ; Nous le suivrons.
M A N I P UL A
Pour reconnaitre un verbe
• Remplace le verbe par le même verbe conjugué à un autre temps.
• Encadre le verbe conjugué à un temps simple par ne… pas
Attention !
nous avons aimé elle est arrivée
3e pers. s.
du noyau du GN sujet. Le trésor des pirates vaut une fortune.
Tu cours tous les matins.
Tu courais tous les matins.
• Si le verbe est conjugué à un temps composé, encadre seulement l’auxiliaire par ne… pas. ou
• Si le verbe est à l’infinitif, ajoute ne pas à sa gauche.
Tu cours tous les matins.
Tu ne cours pas tous les matins.
Tu as couru ce matin.
Tu n’as pas couru ce matin.
Tu cours pour prendre ton autobus.
Si le verbe est précédé d’un pronom complément (le/la/les, me, se, te, etc.), le ne se place devant ce pronom. Mon entraineur ne me remet pas ce prix précieux.
Tu cours pour ne pas prendre ton autobus.
QUELQUES CATÉGORIES DE VERBES
VERBE TRANSITIF
VERBE INTRANSITIF
VERBE PRONOMINAL
VERBE ATTRIBUTIF
VERBE IMPERSONNEL
Il est construit avec un ou plusieurs compléments du verbe. (Il ne peut pas exister seul.)
Il est construit sans complément du verbe.
Il est précédé d’un pronom de la même personne que le sujet. À l’infinitif, le verbe est précédé du pronom se/s’.
Il se construit avec un attribut du sujet. Les principaux verbes attributifs sont être, paraitre, sembler, devenir, demeurer, rester.
Il est conjugué à la 3e pers. s. avec le pronom impersonnel il, un sujet qui ne représente rien.
Léo adore son chat.
Léo adore.
Le chat de Léo miaule.
Je m’évanouis. s’évanouir
Lenny se méfie. se méfier
Le chien est docile
Il reste debout.
Il fait beau dehors.
Il faut manger sainement.
Le tableau suivant présente des terminaisons des temps simples de la conjugaison de verbes fréquents.
INFINITIF

en -er en -ir en ir, -oir, -re, verbes avoir, être, aller
présent aimer finir partir vouloir faire avoir être aller
INDICATIF
présent aime aimes aime aimons aimez aiment
imparfait aimais aimais aimait aimions aimiez aimaient
passé simple aimai aimas aima aimâmes aimâtes aimèrent
futur simple aimerai
aimeras aimera aimerons aimerez aimeront
conditionnel présent aimerais aimerais
aimerait aimerions aimeriez aimeraient
SUBJONCTIF
présent aime aimes aime aimions aimiez aiment
IMPÉRATIF
présent aime aimons aimez
PARTICIPE
finis
finis
finit
finissons
finissez
finissent pars pars part partons partez partent
finissais
finissais
finissait
finissions
finissiez
veux veux
veut voulons
voulez
veulent fais fais fait faisons faites* font* ai as a avons avez ont suis es est sommes êtes sont vais vas va allons allez vont
finissaient partais partais partait partions partiez partaient voulais voulais
finis
finis
finit
finîmes
finîtes
voulait
voulions vouliez voulaient faisais faisais faisait faisions faisiez faisaient avais avais avait avions aviez avaient étais étais était étions étiez étaient allais allais allait allions alliez allaient
finirent partis partis partit partîmes partîtes partirent voulus
finirai
finiras
finira
finirons
finirez
finiront
finirais
finirais
finirait
finirions
finiriez
partirai
partiras
partira
partirons
partirez
partiront
voulus
voulut voulûmes
voulûtes
voulurent fis fis fit fîmes fîtes firent eus eus eut eûmes eûtes eurent fus fus fut fûmes fûtes furent allai allas alla allâmes allâtes allèrent
voudrai
voudras
voudra
voudrons
voudrez
voudront
ferai
feras
fera
ferons ferez feront aurai auras aura aurons aurez auront serai seras sera serons serez seront irai iras ira irons irez iront
partirait
partirions
partiriez
finiraient partirais partirais
partiraient
finisse
finisses
finisse
finissions
finissiez
finissent parte partes parte partions partiez partent
finis finissons
voudrais
voudrais
voudrait
voudrions
voudriez
voudraient ferais ferais ferait ferions feriez feraient aurais aurais aurait aurions auriez auraient serais serais serait serions seriez seraient irais irais irait irions iriez iraient
veuille veuilles veuille voulions
vouliez
veuillent fasse fasses fasse fassions fassiez fassent aie aies ait ayons ayez aient sois sois soit soyons soyez soient aille ailles aille allions alliez aillent
finissez pars partons partez veuille veuillons veuillez fais faisons faites* aie ayons ayez sois soyons soyez va allons allez
présent aimant finissant partant voulant faisant ayant étant allant passé aimé fini parti voulu fait eu été allé * forme irrégulière
HOMOPHONES
Les homophones sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ont une orthographe et un sens différents.
ver : petit animal invertébré ; vert : couleur ; vers : en direction de ; verre : récipient pour boire/substance transparente et fragile
Pour t’aider à orthographier un mot homophone, détermine la classe du mot en utilisant la manipulation syntaxique du remplacement. Tu peux aussi t’aider des mots qui l’entourent.
(Ça/Sa) mère est convaincue que nous avons fait (ça/sa) avec de l’aide.
LE MOT HOMOPHONE EST PLACÉ DEVANT UN NOM ET IL PEUT ÊTRE REMPLACÉ PAR UN AUTRE DÉTERMINANT COMME LA. C’EST DONC LE DÉTERMINANT SA.

LE MOT HOMOPHONE EST PLACÉ APRÈS UN VERBE ET IL NE PEUT PAS ÊTRE REMPLACÉ PAR UN AUTRE DÉTERMINANT. IL PEUT ÊTRE REMPLACÉ PAR LE PRONOM DÉMONSTRATIF
CELA. C’EST DONC LE PRONOM ÇA. Pour en savoir plus : Les classes de mots, p. 2
LISTE D’HOMOPHONES
Voici une liste d’homophones accompagnés de manipulations qui aident à les distinguer.
CLASSES DE MOTS
a ou as Verbe avoir à la 3e ou 2e pers. s. de l’ind. présent
à Préposition
ça Pronom démonstratif
sa Déterminant possessif
ce Déterminant démonstratif OU
Pronom démonstratif
MANIPULATIONS
Remplacement par le verbe à l’imparfait (avait ou avais) ou encadrement par n’… pas
Remplacement par une autre préposition
EXEMPLES
Tu as (avais) un livre.
Tu n’as pas un livre.
Je parle à (avec) ma mère.
Remplacement par le pronom cela Marco adore ça (cela), jouer aux échecs.
Remplacement par le déterminant ma
Remplacement par le déterminant un OU
Remplacement par le pronom cela
se Pronom personnel Ajout du pronom lui-même, ellemême, elles-mêmes ou eux-mêmes après le verbe
ces Déterminant démonstratif
Ajout de -là après le nom
Remplacement par cela est
Léa adore sa (ma) chambre.
Ce (Un) bibelot est précieux. OU
La dernière fois, ce (cela) n’était pas aussi délicieux.
Louis se lève (lui-même) tôt tous les matins.
Ces robes-là sont plus jolies. c’est Pronom ce + verbe être à la 3e pers. s. de l’ind. présent
C’est (Cela est) bientôt l’heure du départ. sais ou sait Verbe savoir à la 1re et 2e pers. s. ou 3e pers. s. de l’ind. présent
ses Déterminant possessif
Remplacement par le verbe à l’imparfait (savais ou savait) ou encadrement par ne… pas
Tu sais (savais) où est caché le trésor. Tu ne sais pas où est caché le trésor.
Remplacement par le déterminant mes Huan range ses (mes) chaussures ici. s’est pronom se + aux. être à la 3e pers. s. de l’ind. présent
Ajout du pronom lui-même, ellemême, elles-mêmes ou eux-mêmes après le verbe.
Jenny s’est (s’était) amusée au parc. Jenny s’est (elle-même) amusée au parc.
(SUITE)
la Déterminant
OU
Pronom de reprise
l’a ou l’as Pronom le/la + verbe avoir à la 3e ou 2e pers. s. de l’ind. présent
là Adverbe
leur Pronom
leur ou leurs
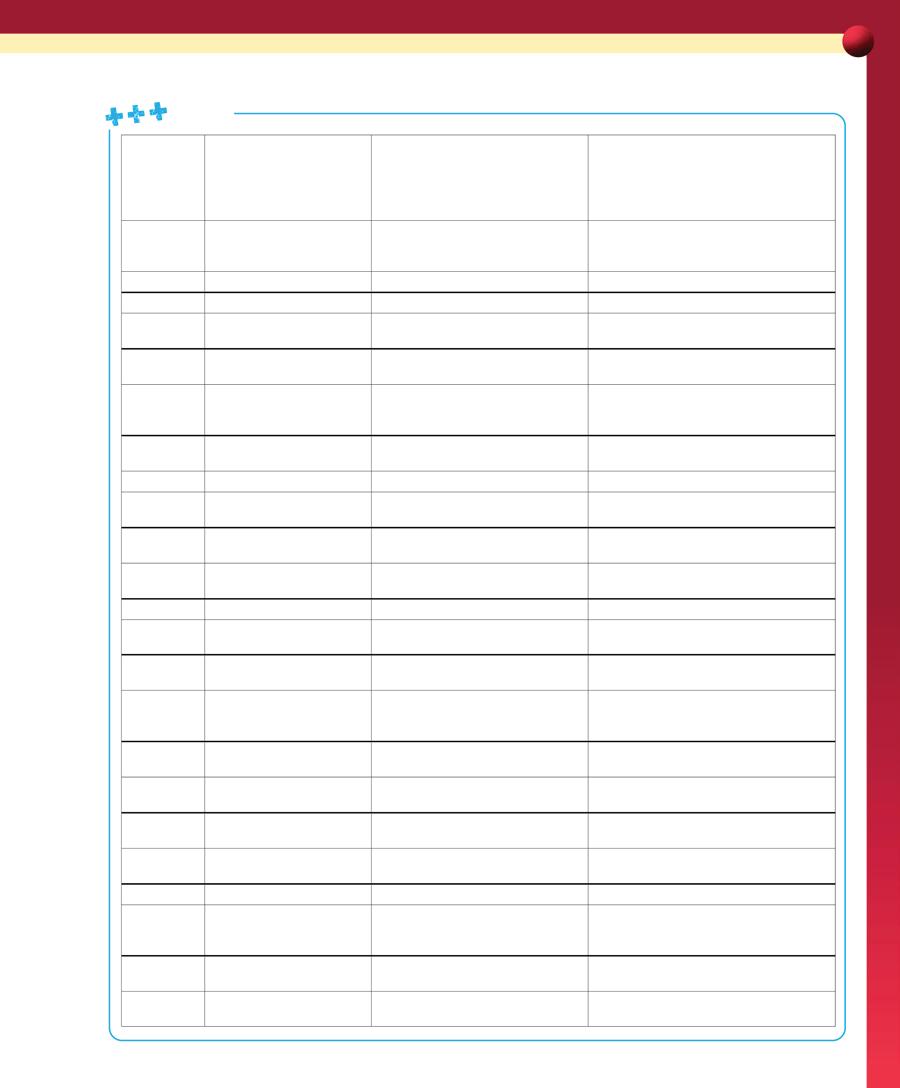
Déterminant possessif
ma Déterminant possessif
m’a ou m’as Pronom me + verbe avoir
Remplacement par le déterminant une OU
Remplacement par l’antécédent
Remplacement par le pronom et le verbe à l’imparfait (l’avait ou l’avais)
Remplacement par l’adverbe ici
Le cheval mange la (une) pomme rapidement. OU
Je connais cette histoire. Je la lis (l’histoire) rapidement.
Cette tasse, il me l’a (l’avait) donnée hier.
Qui est là (ici) ?
Remplacement par le pronom lui Je leur (lui) ai parlé de mon voyage.
Remplacement par le déterminant un/ une ou des
Ils ont mis leurs (des) valises dans le camion.
Remplacement par le déterminant un/ une Je décore ma (une) chambre.
Remplacement par le pronom et le verbe à l’imparfait (m’avait ou m’avais)
Mon père m’a (m’avait) acheté un nouveau bureau.
mais Conjonction de coordination Remplacement par la conjonction cependant J’aime courir, mais (cependant) je préfère nager.
mes Déterminant possessif
m’est ou m’es
Pronom me + verbe être
mon Déterminant possessif
m’ont Pronom me + verbe avoir à la 3e pers. pl. de l’ind. présent
on Pronom personnel
Remplacement par le déterminant des Je vais manger chez mes (des) voisins.
Remplacement par le pronom et le verbe à l’imparfait (m’était ou m’étais) Il m’est (m’était) arrivé une bonne nouvelle.
Remplacement par le déterminant un/ une J’adore mon (un) cours de yoga.
Remplacement par le pronom et le verbe à l’imparfait (m’avaient)
Mes amis m’ont (m’avaient) organisé une fête.
Remplacement par le pronom il/elle J’aime quand on (il) me remercie. ont Verbe avoir à la 3e pers. pl. de l’ind. présent
ou Conjonction de coordination
où Pronom relatif
OU
Adverbe interrogatif
son Déterminant possessif
sont Verbe être à la 3e pers. pl. de l’ind. présent
ta Déterminant possessif
t’a Pronom te + verbe avoir à la 3e pers. s. de l’ind. présent
tes Déterminant possessif
t’es ou t’est Pronom te + verbe être à la 2e ou 3e pers. s. de l’ind. présent
ton Déterminant possessif
t’ont Pronom te + verbe avoir à la 3e pers. pl. de l’ind. présent
Remplacement par le verbe à l’imparfait (avaient)
Mes frères ont (avaient) les yeux bleus.
Remplacement par la conjonction et Je mangerai de la pizza ou (et) du spaghetti ce soir.
Remplacement impossible par la conjonction et
Remplacement par le déterminant un/ une
Remplacement par le verbe à l’imparfait (étaient)
Le restaurant où (et) je mangerai est proche.
Ma tante et son (une) amie partent camper.
Toutes les deux sont (étaient) amies depuis l’enfance.
Remplacement par le déterminant un/ une Quand vas-tu ranger ta (une) chambre ?
Remplacement par le pronom et le verbe à l’imparfait (t’avait)
Manon t’a (t’avait) demandé de le faire tantôt.
Remplacement par le déterminant des Tes (Des) valises sont perdues.
Remplacement par le pronom et le verbe à l’imparfait (t’étais ou t’était)
Remplacement par le déterminant un/ une
Remplacement par le pronom et le verbe à l’imparfait (t’avaient)
Tu t’es (t’étais) peut-être trompé de numéro.
As-tu ton (un) passeport ?
Ils t’ont (t’avaient) demandé ton avis.
Le discours direct consiste à rapporter, mot pour mot, ce qu’une personne a dit, pensé ou écrit.
Le discours rapporté direct peut être présenté de plusieurs façons :

1
2
3
Il comporte souvent plusieurs indications, ou marques, sur : qui ? a dit quoi ? à qui ? quand ? où ?
J’ai pris le papier et je l’ai retourné. Au verso, correctement tracé d’une main ferme, j’ai lu ce court message : « Tu as jusqu’à dix heures du soir. »
« Mère, dis-je, il avait jusqu’à dix heures. » […]
« Allons, Jim, cherche cette clé ! reprit ma mère. »
4
« Elle est peut-être à son cou », hasarda-t-elle.
— Ainsi donc, Jim, interrogea le docteur, vous avez l’objet qu’ils cherchaient, n’est-ce pas ?
— Oui, le voici, monsieur.
Et je lui ai remis le paquet de toile cirée.
Adapté de STEVENSON, Robert-Louis. L’île au trésor, traduction de Déodat Serval, Éditions Rencontre, 1968, p. 43, 60.
DANS UN TEXTE NARRATIF
Le discours direct permet : – d’intégrer des dialogues ; – de donner une impression de réalisme au récit ; – d’alléger le texte et de le rendre dynamique ; – de laisser transparaitre les émotions des personnages en leur attribuant une façon de s’exprimer (accent, registre de langue, tics verbaux, humour, etc.).
Le propos rapporté entre guillemets est introduit par un verbe de parole (exemples de verbes introducteurs : répéter, raconter, dire, crier, etc.).
Une phrase incise encadrée par deux virgules est insérée à l’intérieur du propos rapporté entre guillemets.
PSITT ! ON NE MET PAS DE VIRGULE DEVANT LA PHRASE INCISE QUAND LES PROPOS SE TERMINENT AVEC DES POINTS DE SUSPENSION, D INTERROGATION OU D EXCLAMATION.
Le propos rapporté entre guillemets est suivi d’une phrase incise précédée d’une virgule.
Le propos est rapporté sous forme de dialogue où des tirets indiquent un changement d’interlocuteur.
DANS UN TEXTE COURANT
Le discours direct permet : – de citer les paroles d’une personne ; – de justifier un propos, une idée ; – de renforcer un point de vue.
Le discours indirect consiste à rapporter les paroles ou les pensées d’un personnage en les reformulant. Celui qui rapporte les paroles n’est pas obligé d’utiliser les mêmes mots que l’émetteur (la personne qui produit le message), mais le sens du message ne doit pas changer. Dans le discours indirect, les paroles sont rapportées à même le texte, sans signe de ponctuation particulier. Dans un texte narratif, le discours indirect peut servir à résumer en quelques mots le contenu d’un long dialogue. Mon grand-père me raconta que maman n’avait pas toujours été sage à l’adolescence.
Le vocabulaire d’un texte narratif doit être soigneusement choisi pour que le lecteur puisse facilement imaginer les personnages, les lieux, les émotions, etc., présentés dans le récit. Préparer un champ lexical lié au thème de ton histoire peut t’être très utile.
Le champ lexical correspond à l’ensemble des mots et des expressions qui se rapportent à un même thème. Par exemple, voici un champ lexical de la peur.
SUJET, IDÉE

CE SONT DES SYNONYMES : ILS PARTAGENT LA MÊME CLASSE ET ONT UN SENS ÉQUIVALENT.
frayeur, affolement, effroi, épouvante
CE SONT DES MOTS GÉNÉRIQUES : ILS REPRÉSENTENT UNE CATÉGORIE DE CHOSES OU D’ÊTRES.
sentiments, émotions
Pour en savoir plus : Le sens des mots, p. 53
peureux, épeurant, apeurer, peureusement
CE SONT DES MOTS DE MÊME FAMILLE : Ils sont liés par le sens et ils SONT CONSTRUITS À PARTIR DE LA MÊME BASE
avoir la chair de poule, être effrayé/ tétanisé, être mort de peur, une peur bleue, trembler comme une feuille panique, phobie, anxiété
CE SONT DES MOTS SPÉCIFIQUES : ILS REPRÉSENTENT DES CHOSES OU DES ÊTRES QUI FONT PARTIE D’UNE CATÉGORIE.
Pour l’auteur, le champ lexical permet :
• de jouer avec les mots ou de donner un style particulier au texte ;
• de créer une ambiance, une atmosphère ;
• de varier le vocabulaire et d’éviter les répétitions.
CE SONT DES groupes de mots ou des expressions qui nous VIENNENT SPONTANÉMENT EN TÊTE QUAND ON PENSE À UN SUJET.
Pour les lecteurs, le champ lexical permet :
• d’analyser un texte en dégageant le thème principal et en interprétant l’intention de l’auteur.
La chronologie correspond à l’ordre dans lequel des évènements se déroulent dans le temps.
Dans les récits, il peut arriver que les évènements de l’histoire soient racontés dans un autre ordre que l’ordre chronologique. Il s’agit alors de ruptures chronologiques ou de sauts dans le temps. Il en existe deux types.
Communément appelé flashback, le retour en arrière présente des évènements qui se sont passés avant ceux qui sont en train de se dérouler dans l’histoire.
Ce sont des évènements qui se sont réellement produits.

l’Anticipation
L’ordre chronologique
Le retour en arrière
L’ANTICIPATION
L’anticipation présente des évènements qui devraient se produire plus tard dans le récit.
Ce sont des évènements qui devraient ou qui pourraient se produire dans le futur.
UN RETOUR EN ARRIÈRE
Les elfes étaient disparus il y a plus d’un siècle. Son grand-père lui avait raconté l’histoire de leur tragique extinction à de nombreuses reprises lorsqu’elle était enfant. Mais au fond d’elle, Léla sentait que ce peuple continuait d’exister quelque part. Un jour, elle le retrouverait, elle en était convaincue. C’était sa destinée et rien ne pourrait l’empêcher de l’accomplir.
Les Éditions CEC inc.
Pour t’aider à identifier les ruptures chronologiques, prête attention aux indices de temps (quelques jours plus tôt, l’an prochain, etc.).
PSITT ! AS-TU REMARQUÉ QUE LES TEMPS DE VERBES CHANGENT SELON LES RUPTURES CHRONOLOGIQUES ?
une ANTICIPATION
Les ruptures chronologiques sont très utiles dans les récits.
• LE RETOUR EN ARRIÈRE donne des informations supplémentaires et éclaire le lecteur sur le passé d’un personnage afin de mieux comprendre ses réactions, ses décisions, son portrait psychologique et ses relations avec les autres personnages.
• L’ANTICIPATION permet d’évoquer des tournures d’évènements possibles et engendre souvent du suspense : les évènements se produiront-ils vraiment ainsi ?
Pour raconter une histoire, l’auteur a recours à de nombreux temps de verbes. Cependant, on ne peut pas employer tous les temps dans un même texte. Il faut d’abord choisir entre deux systèmes verbaux : le système verbal du présent ou le système verbal du passé. Ensuite, il faut s’assurer que les temps verbaux utilisés s’harmonisent.

Système verbal : Combinaison de temps de verbes qui vont bien ensemble.
Lorsqu’on utilise le système verbal du présent, on raconte l’histoire comme si elle se déroulait dans le moment présent. Le présent du personnage correspond au présent du lecteur.
LE PASSÉ CORRESPOND AUX RETOURS EN ARRIÈRE.
Le passé
Le passé composé et l’imparfait
Le présent
Le présent
LE FUTUR CORRESPOND AUX ANTICIPATIONS.
Le futur
Le futur simple
Lorsqu’on utilise le système verbal du passé, on raconte une histoire alors qu’elle est déjà terminée. Le personnage a tout de même un présent, un passé et un futur, mais ceux-ci se déroulent tous dans le passé du lecteur. Il s’agit du système verbal le plus répandu dans les récits.
Le passé du personnage
Le plus-que-parfait
Le présent du personnage
Les actions principales sont racontées au passé simple ou au passé composé.
Les descriptions et les actions secondaires sont racontées à l’imparfait.
Le futur du personnage
Le conditionnel présent
LE PRÉSENT DU LECTEUR
Les registres de langue (ou variétés de langue) sont des catégories dans lesquelles on classe les différentes façons de s’exprimer. Le registre employé se reconnait par le choix du vocabulaire et la qualité de la syntaxe. Il existe quatre registres.
Ce registre surtout utilisé à l’oral est le plus relâché. Il se reconnait à sa non-conformité aux règles de la langue.

Y’était supposé être yinke parti une s’maine pis là y’é rendu à l’aut’ bout’ du monde. Y tripe sa vie ben raide.
Ce registre est celui utilisé à l’oral dans la plupart des situations de la vie courante. Les règles de base de la langue y sont respectées malgré certains écarts langagiers occasionnels.
Y’était supposé être juste parti une semaine et là y’é rendu à l’autre bout du monde. Il a beaucoup de fun.
Ce registre est employé couramment à l’écrit ou dans les prises de parole plus formelles. Il n’admet aucun écart langagier. Il est compris par toutes les personnes qui parlent la langue.
Il était censé être parti seulement une semaine et maintenant, il est rendu à l’autre bout du monde. Il a beaucoup de plaisir.
Ce registre est le plus recherché. Il est utilisé presque exclusivement à l’écrit. Il se démarque par son vocabulaire riche et sa syntaxe souvent complexe.
Son intention initiale n’était que de s’éclipser pour une semaine. Le voilà maintenant qui pérégrine autour du globe. La béatitude dans laquelle le plonge ce vagabondage le comble.
La plupart des textes sont écrits dans un registre standard. Cependant, les auteurs choisissent parfois un registre familier ou populaire, en particulier dans les discours directs. Cela rend certains dialogues plus réalistes.
Les organisateurs textuels structurent le texte. Ils mettent en évidence les transitions entre ses différentes parties ainsi que l’enchainement des idées.
EXEMPLES
• premièrement, deuxièmement, finalement
• d’abord, ensuite, enfin
• pour commencer, pour poursuivre, pour terminer
• en premier lieu, d’autre part, bref
• etc.
Introduire un ordre
à l’extérieur, plus loin, à gauche, en haut, aux environs, au milieu de, etc. Indiquer un lieu depuis que, autrefois, actuellement, après, alors que, plus tard, etc. Indiquer le temps de plus, sur le plan physique, sur le plan psychologique, etc. Apporter de nouvelles informations
Les marqueurs de relation indiquent le lien qui existe entre deux phrases ou entre deux éléments d’une phrase. Leur choix se fait à partir de ce qu’on souhaite exprimer.
EXEMPLES DE MARQUEURS DE RELATION QUELS LIENS EXPRIMENT-ILS ? À QUOI SERVENT-ILS ?
de plus, également, aussi, puis, et, etc.
d’abord, ensuite, enfin, en premier lieu, premièrement, deuxièmement, d’une part… d’autre part, etc.
mais, néanmoins, toutefois, cependant, par contre, etc.
parce que, en effet, grâce à, c’est-à-dire, à cause de, etc.
donc, alors, ainsi, c’est pourquoi, etc.
Une addition

Ils permettent d’ajouter une nouvelle information ou d’en lier deux ou plusieurs.
Un ordre (ou une énumération) Ils permettent d’ordonner des informations.
Une opposition, une concession ou une restriction
Ils introduisent une idée contraire à celle qui vient d’être évoquée.
Une explication ou une cause Ils permettent de nuancer une idée ou de présenter un autre point de vue.
Une conséquence ou une conclusion Ils permettent de développer ou de préciser une idée ou donnent une raison ou une justification. bref, en somme, donc, finalement, etc.
pour, afin de, afin que, pour que, de manière que, etc.
comme, tel que, par exemple, ainsi, entre autres, etc.
si, à condition que, à condition de, etc.
Une synthèse
Un but
Une illustration
Une condition
Ils indiquent le résultat d’une idée ou d’une suite d’idées.
Ils font connaitre l’intention d’une action.
Ils donnent des exemples pour appuyer l’idée.
Ils exposent un fait qui dépend d’un autre fait. ou, soit…, soit, ou bien, sinon, etc. Un choix
Un temps ou un moment
Ils présentent des possibilités ou une alternative. avant de, pendant que, au moment où, quand, plus tard, etc.
Ils précisent le moment où des faits ou des situations se produisent.
Attention ! Il est essentiel d’employer les marqueurs de relation appropriés pour indiquer le lien souhaité.
Ce contrat était conclu avant de partir en mer pour que le voyage se déroule bien.
Ce contrat était conclu afin de partir en mer parce que le voyage se déroulait bien.
La répétition d’un mot peut nuire à la fluidité en lecture et à la qualité du texte. Pour éviter les répétitions, on utilise des mots de substitution, qu’on appelle des reprises.
EXEMPLES DE RÉPÉTITIONS
Depuis toujours, les Vikings ont mauvaise réputation. Les Vikings sont perçus comme des guerriers sanguinaires.
Ce peuple avait une mythologie très riche. On trouvait dans leur mythologie plus d’une dizaine de dieux.
Les enfants, les parents et les grands-parents vivaient tous ensemble dans de grandes maisons Ces maisons pouvaient mesurer jusqu’à 70 mètres de long.
Pour en savoir plus :
Le pronom, p. 6
EXEMPLES DE RÉPÉTITIONS
Les Vikings étaient des explorateurs
Le territoire de Terre-Neuve a d’ailleurs été découvert par ces explorateurs
Savais-tu que les Vikings domestiquaient parfois des ours ? Les ours étaient capturés lorsqu’ils étaient bébés, puis étaient élevés par une famille.
En 2018, un garçon de 13 ans a découvert une pièce de monnaie viking sur une plage. La pièce de monnaie viking a mené à la découverte du trésor de Rügen.
Les Vikings étaient d’excellents navigateurs. Les bateaux des Vikings étaient très rapides.
Pour en savoir plus :
Le groupe nominal (GN), p. 12
Le sens des mots, p. 53

EXEMPLES DE REPRISES PAR UN PRONOM
Depuis toujours, les Vikings ont mauvaise réputation. Ils sont perçus comme des guerriers sanguinaires.
Ce peuple avait une mythologie très riche. On trouvait dans celle-ci plus d’une dizaine de dieux.
Les enfants, les parents et les grands-parents vivaient tous ensemble dans de grandes maisons Certaines pouvaient mesurer jusqu’à 70 mètres de long.
Le pronom doit être du même genre et du même nombre que le ou les mots qu’il remplace.
ON A REMPLACÉ LA RÉPÉTITION PAR UN PRONOM PERSONNEL
ON A REMPLACÉ LA RÉPÉTITION PAR UN PRONOM DÉMONSTRATIF
ON A REMPLACÉ LA RÉPÉTITION PAR UN PRONOM INDÉFINI.
EXEMPLES DE REPRISES PAR UN GN
Les Vikings étaient des explorateurs
Le territoire de Terre-Neuve a d’ailleurs été découvert par ces aventuriers
Savais-tu que les Vikings domestiquaient parfois des ours ? Les animaux étaient capturés lorsqu’ils étaient bébés, puis étaient élevés par une famille.
En 2018, un garçon de 13 ans a découvert une pièce de monnaie viking sur une plage. Cette pièce a mené à la découverte du trésor de Rügen.
Les Vikings étaient d’excellents navigateurs. Leurs bateaux étaient très rapides.
ON A REMPLACÉ LA RÉPÉTITION PAR UNE ASSOCIATION (UN DÉTERMINANT POSSESSIF + UN AUTRE NOM DÉSIGNANT L’ANTÉCÉDeNT).
ON A REMPLACÉ LA RÉPÉTITION PAR UN SYNONYME.
ON A REMPLACÉ LA RÉPÉTITION PAR UN TERME GÉNÉRIQUE.
ON A REMPLACÉ LA RÉPÉTITION PAR UN GN SANS SES EXPANSIONS
LA REPRISE PAR UN GAdv
Exemple de répétition
Les Vikings sont peut-être les premiers Européens à avoir mis les pieds à Terre-Neuve. À Terre-Neuve, on trouve des traces de leur présence remontant au 11e siècle.
Exemple de reprise par un GAdv
Les Vikings sont peut-être les premiers Européens à avoir mis les pieds à Terre-Neuve. Là-bas, on trouve des traces de leur présence remontant au 11e siècle.
Le point de vue est la manière dont l’auteur émet un message. Il peut être neutre (objectif) ou subjectif.
• Dans un point de vue neutre, l’auteur n’émet aucune opinion personnelle et aucun jugement.
• En règle générale, le point de vue neutre est celui utilisé dans le texte descriptif, puisqu’il sert à décrire un sujet à partir de faits.
• Dans un point de vue subjectif, l’auteur émet son opinion personnelle et prend position.
• En règle générale, le point de vue subjectif est celui utilisé dans le texte justificatif, puisqu’il sert à justifier une opinion personnelle.
ASTUCE 1 : ÉVITER LE VOCABULAIRE EXPRESSIF
Le vocabulaire connoté, ce sont les mots qui ajoutent un sens mélioratif ou péjoratif à la réalité décrite. Ces mots sont à utiliser quand ils font l’unanimité et ne traduisent pas une opinion personnelle.
ASTUCE 2 : EMPLOYER LA TROISIÈME PERSONNE
Il faut éviter d’utiliser le pronom je, même s’il ne sert pas à donner une opinion. Il faut plutôt utiliser le pronom il et opter pour une tournure de phrase impersonnelle.
Dans ce texte, je vais vous décrire les chats.

Dans ce texte, il sera question des chats.
Le destinataire est le lecteur auquel l’auteur s’adresse dans son texte. Celui-ci doit toujours l’avoir en tête pendant qu’il rédige son texte.
ÉTAPE 1 : IDENTIFIER SON DESTINATAIRE
Réfléchir au destinataire auquel le texte s’adresse, c’est-à-dire se demander qui va lire le texte.
• Des enfants ? Des adolescents ? Des adultes ?
• Un groupe d’individus en particulier ?
(Par exemple, des amateurs de sport, des scientifiques en herbe, etc.)
• Un public plus large composé d’individus aux caractéristiques très différentes ?
ÉTAPE 2 : RELEVER LES CARACTÉRISTIQUES DE CE DESTINATAIRE
Tenter de réfléchir aux particularités du destinataire.
• Son âge
• Ses champs d’intérêt
• Sa maitrise de la langue
• Ses connaissances sur le sujet
• Etc.
ASTUCE 3 : ÉVITER LES PHRASES ET LES GROUPES INCIDENTS
Pour adopter un point de vue neutre, il faut éviter d’intégrer dans le texte des phrases et des groupes de mots incidents tels que selon moi, à mon avis, j’ose espérer, qui servent, justement, à exprimer une opinion.
ÉTAPE 3 : TENIR COMPTE DE SES CARACTÉRISTIQUES
Tenir compte des caractéristiques du destinataire dans :
• le choix du sujet ;
• la mise en page (le choix des polices d’écriture, des illustrations, etc.) ;
• la façon de piquer sa curiosité ;
• la complexité du texte (la longueur des phrases, le choix du vocabulaire) ;
• l’utilisation des procédés descriptifs ;
• l’exploitation du sujet (présentation plus globale et simple, ou plus en profondeur).
Le choix du vocabulaire est important. Selon les mots choisis, une phrase peut avoir un sens neutre ou un sens expressif (on dit aussi connoté).
• Un mot est neutre quand il ne laisse transparaitre aucun jugement, qu’il énonce objectivement un fait.
• Un mot est expressif quand il ajoute un sens positif (vocabulaire mélioratif) ou négatif (vocabulaire péjoratif) à la phrase dans laquelle il est employé.
VOCABULAIRE EXPRESSIF

VOCABULAIRE NEUTRE
VOCABULAIRE MÉLIORATIF
VOCABULAIRE PÉJORATIF
Elle aime la biologie. Elle adore la biologie. Elle hait la biologie.
La voiture est rouge. La voiture est d’un rouge magnifique. La voiture est d’un rouge crasseux. J’ai rencontré un élève. J’ai rencontré un prodige. J’ai rencontré un fainéant.
C’est une chanson fréquemment interprétée.
C’est une chanson remarquablement interprétée.
Le vocabulaire expressif sert à exprimer une appréciation favorable ou défavorable, à transmettre des émotions, à caractériser un univers narratif, etc. Le vocabulaire expressif est aussi souvent utilisé dans les textes qui présentent un point de vue subjectif.
C’est une chanson exécrablement interprétée.
Certains mots ont un sens différent (une connotation différente) selon le contexte dans lequel ils sont employés. fait de grandes choses. MÉLIORATIF Il a fait de grandes bêtises. PÉJORATIF de grandes jambes. NEUTRE
Voici des clés de correction à appliquer quand tu corriges un texte. Elles t’aideront à éviter les erreurs de SYNTAXE, de PONCTUATION, d’ACCORD, de CONJUGAISON et d’ORTHOGRAPHE. Pour être efficace, concentre-toi sur un aspect à la fois.
• Vérifie le sens du texte en le relisant lentement.
• Assure-toi de n’avoir oublié aucun mot.
– Les adverbes de négation sont toujours formés avec un ne

En laissant des traces de tes manipulations et de tes doutes lorsque tu corriges ton texte, tu éviteras de te questionner plus d’une fois sur un même mot.
• Utilise les manipulations syntaxiques pour t’assurer que chaque phrase contient un sujet et un prédicat, et parfois un complément de phrase.
• Vérifie que tu as ponctué correctement tes phrases :
– Les phrases commencent par une majuscule et se terminent par un point (. ! ? …).
– Une virgule sépare le complément de phrase placé au début d’une phrase, ou deux virgules s’il est placé au milieu.
– Une virgule se trouve devant les conjonctions (car, mais, donc) et entre les éléments d’une énumération.
• les receveurs d’accord des GN (adjectifs et déterminants) en les reliant au nom ou au pronom donneur.
– Le nom, son déterminant et ses adjectifs sont tous du même genre et du même nombre.
• les verbes en les reliant à leur sujet, et conjugue-les correctement.
– Les verbes aux temps simples et les auxiliaires des verbes aux temps composés reçoivent la personne et le nombre du noyau sujet.
– Les participes passés avec l’auxiliaire être reçoivent le genre et le nombre du noyau sujet.
• de l’Orthographe d’usage des mots
– Prête attention aux mots qui peuvent contenir une lettre muette, une double consonne ou un son qui peut s’écrire de plusieurs façons.
• des mots Homophones
• des verbes aux terminaisons en [É]
– er : infinitif présent des verbes en -er (SE REMPLACE PAR MORDRE)
CONSULTE UN DICTIONNAIRE, UN RECUEIL DE CONJUGAISON ET TON CODE GRAMMATICAL !
– é, ée, és, ées : participes passés des verbes en -er (SE REMPLACEnt PAR MORDU)
– ez : presque tous les verbes à la 2e pers. pl. (SE REMPLACE PAR MORDEZ)
– ai : les verbes au futur simple à la 1re pers. s. et le verbe avoir à l’indicatif présent à la 1re pers. s.
