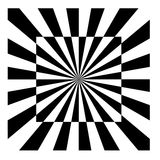9 minute read
rencontrer Traverser le Brabant wallon dans les pas de l’artiste et de l’urbaniste
from Espace-vie n°305 - Déc 2021 - Comment les agriculteurs tentent de résister à la pression foncière ?
Traverser le Brabant wallon dans les pas de l'artiste et de
Quand l’artificialisation des sols croise les regards de l’artiste et de l’urbaniste, cela nous amène à voir autrement nos paysages, leur formation et les schémas culturels qui les dessinent. Rencontre ici à mi-chemin entre Jérôme Giller et Hélène Ancion autour de cinq escales visuelles évocatrices de l’artificialisation.
Advertisement
Propos recueillis par Caroline Dunski et Karima Haoudy Photos : Yoan Robin – WIP Collective Que vous évoque cette photo ?
Hélène Ancion : de prime abord, de la photo rejaillit immédiatement la dimension irréversible de l’artificialisation qui consiste en une consommation foncière pour de multiples usages dont la construction de routes. L’allure de cette route posée sur son tapis de plastique est aussi une invitation à la découverte. Mais à une découverte paradoxale dès lors que la route semble être impraticable et qu’elle n’aboutit nulle part. Cette image ne seraitelle pas symbolique de l’impasse de l’irréversibilité, inhérente à l’artificialisation des sols ?
Jérôme Giller : ma première réaction est la surprise. La surprise de voir cette route provisoire et la facilité de poser du goudron sur un lit de plastique. La photo crée un contraste saisissant entre le paysage environnant et l'empreinte technique et féroce de l'Homme sur la terre. On sent qu'il y a de grosses machines derrière. Cette route pose la question de l’irréversibilité de l’empreinte technique sur les paysages. À contrario la marche laisse peu de traces, peu d’empreintes. Enfin, le profil rectiligne de cette route met en relief l’emprise de la technique et de la vitesse sur les paysages à l’opposé de la marche qui épouse le rythme du corps dans des tracés sinueux.
l'urbaniste
© Jerôme Giller

Hélène Ancion
Hélène Ancion est chargée de mission en aménagement du territoire et urbanisme chez Inter Environnement Wallonie (IEW). Auteure de l’ouvrage Stop béton. Le territoire au service de l’urgence écologique et sociale qui amène des propositions concrètes pour que l’étalement urbain ne soit plus une fatalité, Hélène Ancion travaille sur l'évolution de la règlementation en aménagement du territoire et urbanisme, anisi que sur la formation des CCATM.
Jérôme Giller
Jérôme Giller est artiste-marcheur. Son travail artistique s’élabore à partir de la marche à pied qu’il utilise comme outil d’expérimentation physique des territoires et méthode de création. Marcher lui permet d’élaborer une pensée sur les relations qui se tissent entre corps, identité et géographie. En 2020, à l’orée du premier déconfinement, il mène le projet « Marcher avec... le Brabant wallon », mis en œuvre par la plateforme PULSART de sensibilisation à l’art contemporain.
Pour aller plus loin
L’artificialisation est le processus par lequel des surfaces sont retirées de leur état naturel, forestier ou agricole. Elle induit un changement irréversible dans l’utilisation du sol au profit de fonctions urbaines (habitat et activités corolaires : surfaces commerciales, services publics, commodités, espaces publics, infrastructures de transports, parkings, etc.). Source : Réduisons l’artificialisation des sols en Wallonie, vadémécum, CPDT, 2019
Quel est l’habitat le plus approprié pour vivre sous l’ère du dérèglement climatique ? Cette carte illustre les variations de l'artificialisation en Brabant wallon. Quel est le mode de déplacement le plus approprié (voiture, vélo, train, pieds, cheval, etc.) pour sentir ces variations ?
H. A. Dans cette rue, on aperçoit clairement un exemple inspirant d’utilisation d’un bâti ancien, soit la maison blanche dont la façade est perpendiculaire à la chaussée. Ce réemploi évite la consommation foncière liée à la construction de nouveaux logements. On aperçoit aussi timidement, dans le fond, des maisons quatre façades qui interrogent nos modèles sociétaux. Le rêve de la quatre façades est bâti sur le modèle culturel de la famille nucléaire que la publicité nous a vendu allègrement à partir des années 1950. Aujourd’hui, à l’heure du réchauffement climatique et de l’éclatement de la cellule familiale dite traditionnelle, la permanence de ce modèle de vie et d’habitat m’interpelle. Comment expliquer qu’il continue à s’imposer à de nombreuses personnes, si ce n’est pour servir des intérêts commerciaux et spéculatifs ? Il est temps d’arrêter de construire du neuf et de sortir de ces modèles-carcans, en rénovant le bâti existant, en le recyclant, notamment via des divisions mieux adaptées aux familles monoparentales, aux personnes isolées, etc. Si le bâti ancien se recycle comme cette maison blanche, nos modèles plus récents devraient aussi pouvoir se recycler. H. A. J’opterai pour la marche à pied, avec une traversée en une journée de l’est au centre du Brabant wallon, soit partant de la carte du « vert le plus foncé » jusqu'au « jaune » en passant par le « rouge ». La marche permet très vite de percevoir à échelle humaine la configuration des territoires, des lieux de vie et ce, sans le confort matériel d’autres modes de transport qui nous isolent de la réalité. L’adoption de la marche permet en outre de mesurer les aspérités d’un urbanisme et d’un aménagement du territoire par trop dépendants de la voiture. Comment peut-on envisager d'aller habiter où que ce soit alors qu'il n'est possible d'aller nulle part à pied, pas même pour demander du sucre au voisin ?

Nombre de bâtiments
11.000
Age du bâti
> 100 ans entre 50 et 100 ans < 50 ans
Taux d'artificialisation
5% - 10% 20% - 30% 10% - 15% 30% - 55% 15% - 20%
0 5 10 km
Auteur: MC Vandermeer, PBW, 2020 Sources: IWEPS, 2020 - SPF, 2019
J. G. Difficile de répondre, n’étant pas architecte. La question de l’habitat à l’heure du dérèglement climatique doit composer avec le cout économique des matériaux et du travail et aussi, avec l’éthique. Dès lors, je préconiserais des maisons passives qui idéalement réutilisent des matériaux et du bâti anciens, pour prolonger leur espérance de vie. Mais est-ce possible ? C’est sans doute plus couteux que la construction neuve. D’autre part, j’aperçois sur cette photo des typologies de maisons différentes qui sont susceptibles de générer des modes de vie aussi différents. Et ce, contrairement, aux lotissements de quatre façades qui tendent à uniformiser les modes de vie. Des modes de vie alignés et rythmés par la vitesse, induite par la voiture. Je vois aussi dans cette photo un grand paradoxe de notre société qui prône d’un côté la sédentarité à travers la propriété et de l’autre le nomadisme professionnel, encouragé par le tout à la voiture. Pour ma part, en tant qu’artiste-marcheur, le nomadisme conjugué à de l’habitat qui a une faible empreinte sur le sol (comme le refuge de la tente ou l’habitat léger) correspond plus à ma philosophie.
J. G. Sans hésiter : la marche ! C’est le mode le plus lent qui permet de ressentir les différences d’artificialisation entre les territoires, d’une part, et d’éprouver, d’autre part, l’absence ou la raréfaction de transports alternatifs à la voiture. C’est bien la prégnance de la voiture, outil technique de notre civilisation, qui contribue à l’artificialisation et qui engendre la carte que l’on voit ici. Pour l’anecdote, rejoindre Beauvechain-L’Écluse est impossible directement en train. Il faut prendre un bus et puis marcher longtemps, ce qui représente cinq heures de trajet alors que l’on est à moins de 50km de Bruxelles !
En quoi la marche peut-elle endiguer l’artificialisation ?
H. A. Comme je le souligne dans mes travaux, la marche offre un point de vue imprenable qui laisse se développer la vision macro et la vision micro en même temps, ainsi que toutes les échelles intermédiaires. En marchant, on prend conscience des distances et des configurations, on expérimente au sens propre un lieu. Circuler à pied donne une connaissance intime des enjeux qui se nouent et de la complexité du réel. Comment se fait-il que les décisions d’aménagement du territoire liées aux piétons et aux dessertes de transport en commun soient le pré carré d’experts qui ne se déplacent pratiquement jamais ainsi pour leurs trajets professionnels ?

J. G. Parce qu’elle peut tout simplement remplacer la voiture. Mais pour y arriver, il faut un autre rapport à l’espace, à la géographie et à la vie ! C’est aussi à l’aménagement du territoire de revoir et de redessiner nos lieux de vie en renforçant l’accessibilité à des fonctions essentielles, sans dépendre de la voiture. Sans dépendre de la vitesse et de l’accélération. J. G. Cette instabilité du paysage me ramène au souvenir de l’arrière d’une façade Art-Déco que j’apercevais depuis chez moi et qui agrippait ma curiosité tant elle était façonnée par des décrochements surprenants, des variations sculpturales subtiles et des extensions biscornues. En un laps de temps très court, cette façade a été abattue et remplacée par une paroi lisse. Cette métamorphose m’a attristé comme de nombreux comblements d’ilots intérieurs qui ne laissent plus de place au vide, à la friche. Ces comblements, remplacements, reconstructions/constructions participent de ces changements permanents que l’œuvre Permis de bâtir illustre. Des transformations amplifiées par la médiocrité des matériaux qui obéissent à l’obsolescence programmée appliquée à l’urbanisme. En tant que marcheur, je suis content de voir que certains projets issus de ce modèle s’écroulent et n’aboutissent qu’à la ruine auquel ils mènent. Un peu à l’image effrayante des villes chaotiques de Mad Max ou de Blade Runner que l’urbanisme d’anticipation nous prédit. Des friches qui nous rappellent que si on veut continuer... il va falloir arrêter.
En quoi l'artificialisation peut aussi générer une instabilité des paysages bâtis et naturels, des modes de déplacement, des perceptions et, enfin, des valeurs foncières ?
H. A. Cette œuvre évoque la dualité entre l'impermanence des lieux et la permanence de ce qui est construit. Permis de bâtir... ou permis de pâtir ? Un simple acte notarié pour la concrétisation du rêve de sa vie, alias une maison, va définitivement abimer le paysage de ceux qui y habitaient avant vous. Un acte « anodin » a des conséquences sur le long terme. Le mesure-t-on suffisamment ? Le paysage qui mue, qui change, c’est ce qui émerge des promenades de décodage que j’organise au sein d’IEW. Elles servent à décoder les milieux urbains ou semi-urbains pour appréhender ce qui fait vivre un quartier, et quelles transformations il a connues. L’artificialisation ne porte pas que sur les paysages, elle s’applique à nos modes de vie qui tendent à une aseptisation et une standardisation. Enfin, j’aime beaucoup le côté mécanique de l’œuvre : l'écrit s’efface dans un mouvement qui parait presque naturel. Comme quand un paysage disparait par le biais des constructions.

Permis de bâtir est une œuvre de WIP Collective. Tracé à la craie sur une plaque de métal, l'article 44 de la Loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme (1962) se dématérialise sous l'effet des vibrations causées par son énonciation au travers d'un haut-parleur. Une métaphore de l'instabilité des territoires en construction par les plasticiens Jérôme Boulanger et Thibaut Drouillon.