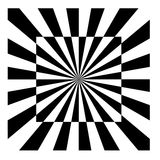9 minute read
apprendre Comment appréhender le territoire du Brabant wallon ?
from Espace-vie n°305 - Déc 2021 - Comment les agriculteurs tentent de résister à la pression foncière ?
Comment appréhender le territoire du Brabant wallon ?
La marche et le regard ont été utilisés de tout temps pour approcher des territoires. Qu’en est-il du Brabant wallon ? Des acteurs différents l’ont arpenté pour mettre en relief ses multiples facettes et contribuer ainsi à irriguer l’aménagement du territoire de visions sensibles.
Advertisement
Texte : Caroline Dunski - Photos : Caroline Dunski et Yoan Robin
Qu’ils soient artistes, scientifiques, passants ou habitants, ils s’appuient sur les ressources de l’arpentage par la marche et le regard pour livrer du Brabant wallon une cartographie du territoire susceptible d’amorcer un changement. Un changement qui concerne tant la façon dont on le perçoit, loin des clichés, que la manière dont il est vécu, loin de l’urbanisme techniciste. Comment ces récoltes de terrain nourrissent l’aménagement du territoire ?
Appréhender le territoire par la marche pour l’aménager autrement
Parcourir, interroger, ressentir… le territoire. C’est ce que proposent des méthodes telles que la « marche exploratoire » ou le « diagnostic en marchant », nées fin des années 80 au Canada, afin de dégager les aspérités et les ressources pour améliorer les pratiques d’aménagement du territoire. Au printemps dernier, le service Égalité des Chances de la Ville de Wavre organisait des « marches exploratoires » avec des associations féministes et le Plan de cohésion sociale, dans le but d’établir un recueil de recommandations pour un aménagement territorial plus inclusif et attentif à la sécurité, à la mobilité, et aux espaces de reconstruction du lien social. Pour un aménagement du territoire faisant place, aussi, à une dimension de genre généralement ignorée.
Des faits au sentiment d'insécurité
Concrètement, munies d’un « carnet d’enquête » et d’une carte géographique, par petit groupe de quatre à six personnes, les participantes identifient, pour un site choisi, les composantes de l’aménagement qui peuvent constituer un risque d’agression et causer un sentiment de sécurité ou d’insécurité. Dans le carnet d’enquête, elles décrivent d’abord leurs premières impressions en quelques mots. Sur le trajet des rues et ruelles qu’elles empruntent, elles sont ensuite attentives aux améliorations à apporter à l’environnement immédiat, à l’éclairage, à la présence ou non de toilettes publiques, à la circulation des piétons, des PMR ou encore des poussettes… Viendront ensuite les remarques relatives à la possibilité de voir ou d’être vues, d’entendre et d’être entendues, aux endroits où quelqu’un pourrait se cacher en vue de les agresser, aux possibilités d’appeler à l’aide si cela s’avère nécessaire… Bref, le « carnet d’enquête » permet de consigner des tas d’éléments factuels et objectifs susceptibles de générer un sentiment de sécurité ou d’insécurité et de proposer des améliorations. Valérie Dirix, collaboratrice du secrétariat général Égalité des chances et Coopération au développement, prévoit de finaliser le recueil de ces suggestions d’ici la fin de l’année. Il devra être soumis aux services concernés, comme l’aménagement du territoire, ainsi qu’au Collège communal, avant d’être présenté lors de « Women Wavre 2022 ».
Le « diagnostic en marchant » est également une méthode de connaissance spatiale et sociale développée dès 2017 à l'UCLouvain et utilisée dans le cadre de la recherche-action WADA, « Wallonie Amies Des Ainés », menée avec l’AViQ, Agence pour une Vie de Qualité. L’adaptation de nos espaces intérieurs et extérieurs au vieillissement de la population est un enjeu majeur en Brabant wallon, puisque c’est une des provinces wallonnes où le taux de vieillissement est l’un des plus importants.
Braine-l’Alleud est une des six communes pilotes choisies. Le projet, rebaptisé « BL’ADA », a été effectué en aout 2017. En amont, avant d’aller sur le terrain, les ainés participent à des entretiens individuels et au partage d’idées dans une démarche d’intelligence collective. Trois marches se sont déroulées dans trois parties de la commune, afin de sonder des environnements différents : le centre, d’une part, et les extrémités de territoire communal où les ainés ne vont jamais.
Jérôme Giller
Adapter l'environnement à l'humain
La table ronde « Place aux ainés », organisée par la Maison de l’urbanisme - Centre culturel du Brabant wallon, était l’occasion pour Robert Grabczan, ingénieur civil architecte, et Myriam Leleu, sociologue et gérontologue, de présenter la méthode de la recherche-action. Myriam Leleu y souligne que deux grands enjeux se posent en matière d’adaptation au vieillissement : soit les ainés s’adaptent aux espaces et lieux qui s’imposent à eux ou, à l'inverse, ce sont les espaces et lieux qui s’adaptent aux besoins d’une population, qui sont façonnés par leurs usages. L’essence même des marches exploratoires et diagnostics en marchant est bien sûr de permettre que l’environnement s’adapte à l’humain plutôt

sur les représentations sociales que se font une trentaine d’acteurs de ces paysages. Ils soulignent que « les regards posés sur les paysages sont profondément culturels et émanent dès lors des individus et de leur histoire personnelle ». Stéphanie Quériat, chercheuse pour la Conférence permanente du Développement territorial, docteure en Histoire, Art et Archéologie (ULB), mène des recherches sur la perception du paysage par la population et s’est intéressée aux regards que des artistes portent sur les territoires wallons. Elle précise que « pour le Brabant wallon, il est difficile de retrouver une expression artistique de l’entité administrative ». Il semblerait que la province soit rarement un objet littéraire à part entière et que le Brabant wallon serve plus généralement de décor, comme pour le film Le maitre de musique tourné au Château de La Hulpe, ou encore pour Ariane, le roman de Myriam Leroy. Le Brabant wallon n'est pas encore un personnage littéraire…
que l’inverse. Au cours de l’évènement, Robert Grabczan, insistait sur les effets sociaux de la marche : « On marche ensemble, il y a donc des valeurs partagées. Le fait d’être en groupe permet de rencontrer la personne et d’établir des échanges humains immédiats avec les gens que l’on rencontre. » Cette expérience collective permet, par ailleurs, de renouveler la fabrique de l’aménagement du territoire par la confrontation de la réalité vécue aux connaissances des « experts ». À la réalité conçue se conjugue la réalité augmentée, engrangée par la marche, qui peut être utile aux « décideurs-concepteurs » de nos espaces publics. Il est important de souligner que la marche est bien considérée ici comme faisant partie de la boite à outil de l’urbanisme. Robert Grabczan de nous rappeler que « le diagnostic en marchant n’est pas la garantie d’un bon projet, mais permet de consolider un diagnostic. »
Appréhender le territoire par le regard pour le représenter autrement
Les territoires peuvent aussi s’appréhender par le regard. Que l’on soit artiste, habitant, géographe… le prisme emprunte alors la voie du sensible. Les auteurs de l’Atlas des Paysages de Wallonie. Les Plateaux brabançon et hesbignon se sont penchés
Véronique Rousseaux

Louvain-la-Neuve, héroïne utopique
Néanmoins, il ne s’agit pas de nier la puissance narrative de territoires moins marqués par un continuum historique ou identitaire fort. Tout récemment, la néolouvaniste Véronique Rousseaux diffusait son tout premier roman-essai, dont le personnage central n’est ni le narrateur Lucas, venu d’un village montagneux français pour retrouver sa tante à la demande de sa mère, ni la mystérieuse tante en question, mais bien Louvainla-Neuve elle-même.
De 1991 à 1995, l’auteure de La ville au bord du lac, romaniste de formation, était rédactrice responsable d’Espace-vie. Elle y a acquis une fameuse connaissance des matières liées à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire, qu’elle a développée ensuite en effectuant des missions de rédaction pour la Division de l'aménagement et de l'urbanisme, du logement et du patrimoine (DGATLP) à la Région wallonne, puis en travaillant au Centre de recherches et d'études en actions territoriales (CREAT, UCL). « J’écris des nouvelles depuis toujours. J’aime écrire des histoires, surtout les inventer. C’est le premier roman que je fais imprimer. J’ai mis trois ans à l’écrire, en y consacrant 30 minutes de temps en temps. J’avais commencé par en faire un essai, puis j’ai choisi de créer un personnage naïf qui ne connait pas les principes fondateurs de la nouvelle ville. L’histoire sert à mettre certaines choses en évidence. » Lucas cite des ouvrages, articles ou visites guidées qui contextualisent Louvain-la-Neuve, son histoire, sa naissance, son organisation sociale si différente des autres villes… et décrit la ville sous divers angles, comme s’il entrainait le lecteur ou la lectrice dans une marche exploratoire : urbanisme, architecture, mobilité, place du minéral et du végétal, présence de l’humain…
À la fois roman et essai, le livre de Véronique Rousseaux est un texte engagé né de son exaspération face à la volonté d’étendre le centre commercial l’Esplanade. Pour rappel, 80 % des habitants de Louvain-la-Neuve ayant pris part à la consultation populaire organisée le 11 juin 2017 se sont exprimés contre cette extension. La ville au bord du lac constitue un regard sur la ville, sur ce qu’elle est aujourd’hui en comparaison de ce que ses concepteurs en rêvaient. Véronique Rousseaux effectue une analyse politique et, dans les dernières pages, esquisse une nouvelle utopie pour la ville qu’elle habite depuis 25 ans.
Pour aller plus loin
Marcher avec… Le Brabant wallon, éd. Jérôme Giller avec le soutien du CCBW, 2021. 10 euros (frais de port compris). À commander sur le site www.ccbw.be Véronique Rousseaux, La ville au bord du lac, 2021. 13 euros (+ frais de port) Droits d'auteur au profit de l'asbl Altérez-Vous Initiatives. À commander sur le site www.publier-un-livre.com
MARCHER AVEC… À LA CONFLUENCE DE L’URBANISME ET DE L’ACTION ARTISTIQUE
Durant l’été 2020, après des mois de confinement, avec la plateforme PULSART de sensibilisation à l’art contemporain, le Centre culturel du Brabant wallon invitait les habitants d’ici et d’ailleurs à sortir pour « Marcher avec… le Brabant wallon » en compagnie de l’artiste bruxellois Jérôme Giller. Le but de l’expérience artistique : recréer du lien avec les autres et l’espace physique qui nous entoure et se réapproprier collectivement l’espace public et social. Les marcheurs ont sillonné le territoire de Braine-l’Alleud, Rixensart, Beauvechain, Waterloo et Limelette. « La marche me permet de ramener dans le vivant à travers des questions beaucoup plus politiques et citoyennes, confie Jérôme Giller. Cela me permet aussi de repenser des gestes artistiques à partir du corps. La marche permet de convoquer des gestes plus proches de ceux du sculpteur. Depuis les années 70, se développent des logiques de dématérialisation de l’art. Les performances, le mouvement des corps dans l’espace, c’est aussi de l’art. J’aurais pu devenir urbaniste, mais j’ai trouvé mon sillon dans l’art contemporain. » Un très bel ouvrage constitue la trace de cette expérience collective de marche « avec les sons, les odeurs, le vent, la pluie, le soleil, le temps, l’espace, le bitume, la terre, les champs, les lignes, les points, les arrêts, le silence, les mots, le passé, le futur, le présent, avec soi, et avec les autres… » Marcher ensemble, c’est plus que se mettre collectivement en mouvement. C’est mettre en branle les pratiques de l’urbanisme. Comme le dit un marcheur, « la pratique de la marche collective peut nous permettre de reprendre en main la fabrique de la ville. Je défends la position qu’en tant qu’habitant, acteur d’une ville, on devrait pouvoir reprendre en main les politiques urbaines. Ce serait intéressant d’emmener avec nous des représentants politiques sur ce genre de chemin et d’avoir ensuite une discussion ensemble sur les espaces écologiques, la destruction des paysages, jusqu’où l’humain habite, comment il cohabite, etc. »