TERRE CRUE & GRANDE HAUTEUR
La construction d’édifices de grandes hauteurs en terre crue porteuse, aujourd’hui ? à Paris, est-elle une utopie ?
RESUME
« Terre crue » et « grande hauteur » semblent deux termes dichotomiques. Il existe pourtant une tradition millénaire d’architecture de grande hauteur en terre crue dans le monde. Oubliée en France durant la première moitié du XXème siècle, nous possédons, aujourd’hui, de solides connaissances scientifiques concernant l’architecture de terre. Alors que l’édifice de grande hauteur fait aujourd’hui partie du paysage urbain francilien, le savoir découvert sur le matériau terre, l’expérience acquise dans le domaine de l’architecture en terre crue, ainsi le contexte naturel et culturel, nous permettent, aujourd’hui, d’envisager la construction d’architectures de grande hauteur en terre crue à Paris.
MOTS CLES
Terre crue - Grande hauteur - Matériau – Matière - Symbolisme - Communauté
Acheminement - Procédé constructif - Erosion - Paysage - Echelle - Paris
REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier mes deux encadrants de mémoire, monsieur Xavier Lagurgue et monsieur Vincent Laureau, pour leurs conseils qui m’ont ouvert les yeux sur les champs de recherches possibles. Je remercie aussi Monsieur Vincent Laureau pour ses conseils de méthodologie et les corrections apportées pendant l’écriture de ce manuscrit.
Je tiens à remercier monsieur Paul-Emmanuel Loiret, de l’agence Joly&Loiret, pour l’entretien qu’il m’a accordé, me permettant d’avoir un regard d’acteur sur le sujet.
Merci aussi à madame Cécile Marzorati, de l’association Bellastock, pour ses réponses sur le festival La ville des Terres.
J’aimerais aussi remercier l’Ecole Nationale Supérieure de Paris Val-de-Seine, pour la grande qualité de ses infrastructures et de son encadrement pédagogique, qui m’ont permis, pendant trois ans, de découvrir l’architecture et d’apprendre le métier d’architecte.
Pierre Vialle-Millereau « La construction d’édifices de grandes hauteurs en terre crue porteuse, aujourd’hui à Paris, est-elle une utopie ? »
« La construction d’édifices de grandes hauteurs en terre crue porteuse, aujourd’hui à Paris, est-elle une utopie ? »
Figure 38 : Cartographie des architectures de grande hauteur en terre crue, indicateur contexte
Figure 41 : répartition des installations franciliennes signataires de l'accord de partenariat avec la société du Grand Paris (source : Réseau de transport public du Grand Paris –Schéma de gestion et de valorisation des déblais, 07/2017) ..............................................
Figure 42 : Installation Cosson de stockage de déchets inertes de Thiverval-Grignon Yvelines. A gauche, vue satellite (source : bingmaps.com). A droite, photo du 18 / 07 / 2016 (source : Booklet de l'exposition "Terres de Paris, de la matière au matériau")
Figure 43 : Plateforme ECT de gestion et stockage de matériaux inertes de Villeneuvesous-Dammartin Seine-et-Marne. A gauche, vue
Figure 57 : Ziggourat de Tchogha Zanbil. A gauche, axonométrie de la Ziggourat originelle (source
-
AVANT-PROPOS
Il pleut sur Paris ce matin du 27 février 2016. J’attends sous son porche, l’ouverture du pavillon de l’arsenal. Les portes s’ouvrent et Paris se réinvente à moi. C’est une effervescence de panneaux, de maquettes, de perspectives, de plans, de coupes... Les projets rivalisent de végétation pour démontrer à quel point ils prennent en compte les exigences environnementales. Il n’y a pas assez de mille arbres pour cacher le périphérique porte Maillot ou pas assez de façades en micro-algues pour alimenter le quartier Masséna… et puis, posé sur une table en fond de couloir, un morceau de terre. C’est, en fait, un détail constructif. Il me renvoie aussitôt vers un projet de tour construite en terre crue. Je trouve l’idée extrêmement originale et je me demande ce qui a poussé le studio d’architecture Joly & Loiret à proposer ce projet. Je me souviens alors d’une conférence de CRATerre1 lors de ma deuxième année à l’Ecole Nationale Supérieure Grenoble sur les constructions en terre dans le monde et leurs impacts écologiques. Contrastant avec les autres projets de « Réinventer Paris » présents autour de moi, je me demande pourquoi est-ce que c’est la première fois que j’entends parler d’architecture de terre à Paris.
1 CRATerre est une association et un laboratoire de recherche sur les constructions en terre de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble
INTRODUCTION
“ Voir l’univers dans un grain de sable
Et le paradis dans une fleur sauvage
Tenir l'infini dans le creux de sa main
Et l'éternité dans une heure. ”
William Blake, Le mariage du Ciel et de l’Enfer, 1793
Utilisant les ressources se trouvant à sa disposition, l’Homme a depuis toujours utilisé, pour son architecture, la terre présente sous ses pieds. Néanmoins, les constructions en terre (et plus généralement, en matériaux traditionnels terre, bois et pierre) se sont fortement réduites en même temps que les progrès technologiques introduisaient le béton et l’acier comme nouveaux matériaux de construction. La part des constructions en terre dans les sociétés occidentales est même devenue très marginale. Or, selon le 5ème rapport d’évaluation du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat « les bâtiments sont responsables de 40% de la consommation finale d’énergie et de près de 19% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial »2. Face aux problèmes écologiques liés aux matériaux conventionnels de construction (énergie grise, sable en voie de disparition dans certaines régions…), l’emploi de matériaux à empreinte écologique réduite paraît inévitable. Or, la terre crue est un matériau naturel qui ne nécessite pas de phase préalable de transformation industrielle (contrairement au ciment, béton, acier, aluminium, briques cuites, produits synthétiques, etc.). Ainsi, la production d’énergie grise et d’émissions de gaz à effet de serre liée à sa production et à son transport reste faible.
Outre ses vertus écologiques, mon intérêt pour le matériau terre s’ancre dans ses profonds paradoxes :
Aujourd’hui, l’architecture en terre représente 50% de l’habitat mondiale et 15% des œuvres architecturales inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO3, néanmoins le matériau terre n’est que (très) partiellement utilisé dans l’architecture contemporaine urbaine.
La terre, du fait de ses propriétés mécaniques, semble être un matériau peu propice à la grande hauteur, cependant le centre historique de la ville de Shibam, au Yémen, est constitué de maisons-tours de 30 m de haut.
L’architecture de terre est répartie sur les cinq continents mais l’architecture de grande hauteur en terre crue est majoritairement présente au Maghreb et au MoyenOrient.
Alors que l’architecture de grande hauteur s’est multipliée à partir du début du XXe siècle avec l’arrivée du béton et de l’acier dans la construction, pour des besoins de
2 Stocker Thomas F., Qin Dahe, 2013, Climate Change 2013 The Physical Science Basis Working Group I Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press
3 Anger Romain, Fontaine Laetitia, 2009, Bâtir en terre : du grain de sable à l'architecture, Paris, Belin
logement et de bureaux, l’architecture de terre de grande hauteur est une architecture majoritairement ancienne et religieuse ou protectrice.
La terre est un matériau permettant la construction d’une architecture rapide. Mais c’est un matériau soumis rapidement au phénomène d’érosion.
C’est un matériau qui se « redécouvre » aujourd’hui dans les pays du Nord et qui bénéficie d’une image positive, notamment due à ses qualités environnementales C’est le matériau du « pauvre » dans les pays du Sud, où le béton et l’acier bénéficient d’une meilleure image4 (Laureau, 2013)
Alors que la terre est un matériau présent naturellement sous nos pieds, sa mise en architecture coûte plus chère dans les pays du Nord par rapport aux matériaux conventionnels.
Alors que les moyens de transport de matière évoluent, l’architecture de terre continue de consommer la matière proche de son site.
Paradoxale, la construction d’édifices de grande hauteur en terre crue peut être une des solutions pour répondre aux problèmes écologiques et d’urbanisation de Paris. Le matériau terre serait-il le matériau idéal ? Le matériau nous permettant de construire à coût écologique nul ? Quelles sont les capacités mécaniques du matériau ? Comment est-il acheminé ? Les procédés de construction permettent-ils de construire à grande hauteur ? La construction de tels édifices est-elle une limite physique ou bien culturelle ? Alors que la tour devient un type architectural présent dans les grandes métropoles mondiales, et présentes à Paris et en région parisienne, Pourquoi n’y a till pas de tour en terre crue ? La construction d’édifices de grande hauteur5 en terre crue porteuse, aujourd’hui à Paris, est-elle une utopie6 ?
4 Laureau Vincent, 2013, La ville en terre au Mali, Cybergeo : European Journal of Geography, Aménagement, Urbanisme, URL : journals.openedition.org/cybergeo/25907. Vincent Laureau y évoque le contraste entre la représentation du matériau terre pour les occidentaux et les locaux, notamment mali : « Pour l’individu issu de la sur-modernité lors d’un voyage touristique, la spécificité de son regard voit dans ce patrimoine un fragment d’exotisme qu’il souhaite voir conserver comme témoignage pour les générations futures. À l’inverse, pour l’individu local, se disant « né ici et grandi ici », ce patrimoine représente le poids du passé avec son cortège de contraintes ; c’est plus un handicap qu’un atout. »
5 Dans le cadre de ce mémoire, la localisation parisienne et la temporalité actuelle impliquent la possibilité d’une architecture contemporaine. Nous précisons, par grande hauteur, un édifice ayant aussi élancement important.
6 Utopie, définition d’après Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : A. − Ouvrage qui conceptualise une société idéale à construire. B. − Au fig. Ce qui appartient au domaine du rêve, de l'irréalisable.
Jean Nouvel a qualifié l’architecture de «pétrification d'un moment de culture»7, et c’est en étudiant cette transformation d’éléments physiques en relation avec un contexte culturel que nous tenterons de répondre à la problématique.
A. Nature
Nous nous intéresserons, tout d’abord, à l’incidence de la géographie, de l’environnement naturel, des climats et des risques sismiques sur l’architecture de terre en hauteur. Nous pouvons remarquer que la majorité de ce type d’édifices est construit dans des régions chaudes, arides ou désertiques. Il faut, en effet, de longues périodes sans pluie et à forte température pour permettre la construction en terre afin d’en limiter son érosion. Pour des raisons de difficulté de construction avec ce matériau, l’architecture de grande hauteur en terre crue est aussi généralement située dans des contextes naturels dépourvus d’autres ressources, de manière abondante, pour la construction.
Puis, nous nous attèlerons aux questions physiques Les tours-maisons de Shibam, au Yémen ont des murs en terre crue porteuse d’un coefficient d’élancement8 unique leur permettant d’enceindre dans sa vieille ville des maisons-tours de 30 m de hauteur dans un environnement urbain très dense. Néanmoins les murs restent d’une épaisseur conséquente (80 cm à leur base, 30 cm à leur sommet). Le laboratoire CRATerre tente de mettre au point des techniques permettant de construire en terre crue porteuse avec un coefficient d’élancement se rapprochant des matériaux conventionnels, mais la question de la mixité structurelle se pose dans le cadre de constructions à Paris aujourd’hui.
Nous analyserons, enfin, le matériau terre à l’échelle microscopique. De chaque contexte naturel émane un type de terre différent. Néanmoins, chaque terre est « un mélange de grains de différentes tailles (cailloux, graviers, sables, silts et argiles) en proportions variées »9 (Anger, 2011, p.5) La terre est en fait un béton d’argile c’est-à-dire « un matériau de construction composite fabriqué à partir de granulats agglomérés par un liant » 10 (Anger, 2011, p.10). Cette nouvelle connaissance du matériau, qui date du début
7 Dans un entretien pour le quotidien « Le Temps » du 15 août 1998
8 Coefficient d’élancement, définition de l’office québécois de la langue française : Rapport entre la hauteur non supportée et l'épaisseur à sa plus petite dimension, dans un élément de structure en longueur sous compression qui se trouve généralement à la verticale.
9 Anger Romain, 2011, Approche granulaire et colloïdale du matériau terre pour la construction, Thèse pour obtenir le grade de docteur, École Doctorale Matériaux de Lyon (EDML), dir. H. Houben / C. Olagnon
10 Ibid., p.10
des années 2000, permet de mieux comprendre ses propriétés mécaniques et de transposer des techniques de construction liés au béton de ciment directement au matériau terre.
B. Culture
Nous aborderons dans une deuxième partie, les questions culturelles des constructions en terre crue de grande hauteur.
On remarque que le rôle de la communauté est prépondérant. Les deux grandes familles historiques d’édifices de ces types sont les bâtiments religieux et les fortifications. Soit une communauté reliée par des liens mystiques, ou bien, une communauté devant organiser son existence afin de se protéger de l’extérieur. A Paris, la construction d’édifices de grande hauteur sont principalement des bureaux, réunissant, sous un même toit, des milliers d’individus d’une communauté de travail. Toutes ces architectures de grandes hauteurs expriment aussi le besoin collectif de marquer son territoire.
L’architecture, et notamment l’architecture de terre, ce sont d’abord des Hommes qui conçoivent, acheminent, construisent… Dans les pays du Sud, les métiers traditionnels de la construction en terre se perdent à cause de la réduction du nombre d’édifices construits avec ce matériau. Au Yémen, d’après Salma Samar Damluji, « le problème est que nous avons perdu les maîtres-bâtisseurs qui formaient les plus jeunes. Ceux qui se disent architectes ou artisans aujourd’hui ne savent en fait plus rien de l’architecture vernaculaire »11. Parfois, les habitants réapprennent les techniques traditionnelles, comme pour la reconstruction d’un village à Ma’anqiao, en Chine, suite à un séisme. Faire reconstruire le village par ses habitants fut la solution la plus économique. Dans les pays du Nord, les hommes restent la principale ressource malgré les avancées technologiques, que ce soit pour innover ou pour bâtir.
Puis nous aborderons les questions symboliques liées au matériau terre. La construction de la tour de Babel12 (tour en terre crue pouvant relier la terre aux cieux afin d’accéder directement au paradis) et ses conséquences (voir chapitre Culture - Symbolisme), semble avoir mis une limite symbolique dans le monde chrétien. Alors qu’encore majoritairement utilisé dans les pays du Sud, la terre représente dans ces pays le matériau du passé, du pauvre… Tandis que dans les pays du Nord ses qualités environnementales en font un matériau vu positivement. Aujourd’hui ce matériau semble être dans une phase de 11
redécouverte en France depuis les années 70, notamment grâce au laboratoire CRATerre qui étudie ce matériau et milite pour sa mise en œuvre. L’utilisation de la terre crue est aussi intéressante car elle s’insère dans l’écologie de refondation, soutenue notamment par Gaston Bachelard13, pour qui l’Homme s’imagine un futur à partir de son environnement, et par conséquent, pour avoir une vision plus naturelle du futur14, il faut qu’il évolue dans un environnement à la matérialité naturelle.
C. Transformation
Nous nous intéresserons ensuite aux processus de transformation : du paysage d’abord, de la matière en édifice ensuite et, enfin, de la transformation du matériau terre dans le temps. La terre est le matériau vernaculaire par excellence. Lourde et nécessitant beaucoup de matières pour la modeler, l’architecture de terre est particulièrement liée au contexte naturel qui l’entoure. L’état des lieux des grandes architectures de terre montre ce lien très fort, quasi ombilical, à son paysage. Paris est une ville ultra dense ne proposant pas, à priori, de paysage urbain permettant l’extraction et l’utilisation de terre pour la construction. Or, Selon Alexandre Labasse15, « chaque année, plus d’une vingtaine de millions de tonnes sont extraites en Ile-de-France »16 (Labasse, 2016, p.4) Des sondages et tests sur ces terres extraites, ou à extraire, permettent de montrer que cette matière disponible est équivalente à un million de logements terre crue17
Nous verrons ensuite comment les hommes transforment la matière afin d’ériger des murs et construire des édifices. Chaque culture possède ses propres procédés constructifs qui découlent de quatre grandes familles de transformation de la matière : la bauge, le pisé, les briques et le torchis18 (Houben & Guillaud, 1989, p.15). Ces procédés consomment beaucoup de mains d‘œuvres induisant des coûts élevés, ce qui peut être un frein à la construction d’architecture de terre à grande hauteur. Afin de faire baisser les coûts de la construction en terre, mais aussi afin de pouvoir étaler la production sur l’année (et non pas seulement sur la période estivale), des ateliers de préfabrication voient le jour en Europe
13 Bachelard Gaston, 1942, L’eau et les rêves. Essai sur l’imagination de la matière, Paris, Ed. José Corti.
14 Naturelle, définition d’après Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : Qui est dans, appartient à la nature; qui n'est pas le produit d'une pratique humaine
15 Architecte et Directeur général du Pavillon de l’arsenal pendant l’exposition Terres de Paris
16 Loiret Paul-Emmanuel, Joly Serge, Anger Romain, Ronsoux Lionel, Gasnier Hugo, 2016, Booklet de l'exposition "Terres de Paris, de la matière au matériau", Paris, Éditions du Pavillon de l’Arsenal
17 Anger Romain, Joly Serge, Loiret Paul-Emmanuel, Rauch Martin, 2016, Conférence inaugurale de l'exposition "Terres de Paris", col. lenght: 81 min. URL : http://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenaltv/conferences/hors-cycle/10509-terres-de-paris.html
18 Houben Hugo, Guillaud Hubert, 1989, Traité de construction en terre, Marseille, Ed. Parenthèses.
(Atelier de Martin Rauch à Schlins, en Autriche) et à en région parisienne Paris (unité de fabrication fonctionnelle à Sevran prévue pour 2019)19.
La terre est un matériau dont les parties exposées à l’environnement extérieur s’érodent plus rapidement que les matériaux conventionnels. Ainsi la mosquée de Djenné, au Mali, doit chaque année être soignée afin que l’érosion n’attaque pas la partie structurelle de ses murs de terre. Cette restauration est accomplie par tous les habitants de la ville lors du jour célébré comme l’arrivée de la saison des pluies20 Bien que « l’économie du don » fonctionne à Paris, comme le prouve le festival annuel d’architecture éphémère organisé par Bellastock, ce système ne semble pas viable à long terme, et pas compatible non plus avec une organisation professionnelle de la filière terre. Martin Rauch, explique que cette érosion peut prendre fin naturellement au bout de quelques années selon le procédé de construction, et il explique aussi comment prendre en compte cette érosion naturelle pendant la phase de conception de l’édifice afin d’éviter des restaurations annuelles ou pluriannuelles21
19 Joly&Loiret, 10 octobre 2017, Communiqué de presse URL : http://jolyloiret.com/wp-content/uploads /2017/10/JL_20171010_CYCLETERRE_COM_CP.pdf
20 BBC : Human Planet, 2011, Mali mud mosque, col. Lenght: 4 min. URL : https://www.youtube.com/watch?v=3SI5NdNEosE
21 Rauch Martin, 2015, Refined earth construction & design with rammed earth, Munich, Ed. DETAIL.
METHODOLOGIE
“La logique est une manière méthodique de se tromper en toute confiance.”
A. Pièces à convictions
a. Etat des lieux
L’étude a tout d’abord consisté à faire un état des lieux des architectures de terre de grande hauteur. Cette étude recense les architectures en terre crue porteuse, de plus de 10 m, sur toute la surface du globe, à travers le temps.22 La limite de 9 m de hauteur minimale a été décidée suite à l’étude des cases obus situées dans le nord du Cameroun. Ces habitations construites en utilisant le procédé constructif « bauge », ont des murs passant d’une épaisseur de 30 cm à leur base, à 3 cm à leur sommet (voir figure 1).
C’est la plus fine épaisseur pour des murs en terre crue répertoriés sur Terre, et cette prouesse technique m’a poussé à ne considérer que les édifices plus hauts. Une fois les édifices recensés, il m’a fallu lister les informations me permettant de les comparer. Ces informations tentent de classifier ces édifices tant sur leur plan géographique (localisation, climat, paysage proche, contexte paysagé), constructif (procédé de construction, hauteur, épaisseur, type d’édifice…), social (qui l’a construit ? pour qui ?) ou temporel. Comptabilisant trente-cinq édifices, il a été possible de les cartographier suivant ces différents critères. De plus, chaque édifice a été photographié en vue aérienne afin de considérer leur environnement proche. Une majorité des édifices ont aussi été dessinés en plan et en coupe afin de pouvoir comparer leur épaisseur, leur hauteur… Plus que les données quantitatives décrites ci-dessus, cet état des lieux m’a permis de m’intéresser aussi à l’histoire de ces constructions, aux raisons de leur construction, à leur rôle social… Il y a aussi eu un état des lieux des constructions, et techniques n’entrant pas dans les critères précédemment cités, qui a aussi alimenté en pièces à conviction ce mémoire.
22 On note quelques exceptions étudiées pour leur caractère exceptionnel : les édifices de moins de 9 mètres de hauteur mais dont la taille leur permet de les classer dans des édifices de « grandes dimensions » ; le Potala, au Tibet, construit en mur de terre agglomérée à de la pierre mais le seul dans un climat montagnard.

« La construction d’édifices de grandes hauteurs en terre crue porteuse, aujourd’hui à Paris, est-elle une utopie ? »
b. Entretiens avec des acteurs
En parallèle de cet état des lieux « bibliographique », j’ai rencontré des acteurs actuels et français, capables de mettre en tension les informations précédemment citées avec les possibilités offertes sur Paris aujourd’hui. J’ai rencontré l’agence d’architecture Joly & Loiret, qui avait proposé la construction d’une tour en terre crue dans le cadre du concours « Réinventer Paris » en 2015. De plus, l’agence Joly&Loiret travaille en collaboration avec le laboratoire de recherche sur l’architecture en terre crue CRATerre23 l’ouverture d’une unité de fabrication fonctionnelle à Sevran prévue pour 2019 J’ai aussi échangé avec Cécile Marzorati, de Bellastock, une association d’architecture expérimentale ayant organisé l’édification d’une ville en terre éphémère pour 500 personnes lors de trois jours de festival en Juillet 2017.
B. Classement de l’information
a. Carte mentale
Tous ces éléments de recherche m’ont permis d’élargir les champs de recherche. Partant de l’architecture en terre crue et de ses possibilités offertes pour l’architecture de grande hauteur, ces recherches préalables m’ont permis de leur associer une liste nouvelle de mots complémentaires. Il existe un lien entre tous ces nouveaux éléments, néanmoins il a été possible de les ajouter progressivement à une carte mentale des champs de recherche par associations proxémiques avec les champs existants déjà.
23 CRATerre est une association et un laboratoire de recherche sur les constructions en terre de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble

b. Tableau
Afin d’organiser l’écriture de ce mémoire, j’ai classé ces champs de recherche en trois catégories me permettant ainsi de structurer mon plan : Nature, Culture et Transformation
J’ai ensuite divisé ces catégories en trois échelles : macroscopique, mesoscopique et microscopique (voir figure 3). Il existe ainsi des liens verticaux et horizontaux forts avec les autres éléments du tableau créé. Cela permet ainsi de favoriser l’association d’idées présente dans la carte mentale.
NATURE
Géographie
Phénomènes géologiques
Echelle Macro
Environnement naturel
Phénomènes climatologiques
Contexte
Physique
Mur porteur
Echelle Méso
Terre porteuse
Armature
Chaîne de forces
CULTURE TRANSFORMATION
Symbolisme
Représentation matériau terre
Ecologie de refondation
Développement durable
Mythe
Echelle
Communauté
Vernaculaire
Monument historique
Typologie des bâtiments
Patrimoine
Acheminement
Paysage urbain
Paysage politique / habité
Approvisionnement
Réemploi
Construction
Procédé constructif
Tradition / Innovation
Préfabrication
Energie grise
Modernité
Echelle Micro
Matériau terre Matière
Comportement mécanique
Typologie des matériaux
Théorie Nature
Acteur Don
Social
Collectivité
Transmission
Théorie Culture
Erosion
Soin / Réparation
Anticipation
Théorie
Figure 3 : Tableau de classement des champs de recherche
Les informations classées par parties (Nature, Culture et Transformation) m’ont ensuite permis de leur associer à des lectures théoriques (voir chapitre suivant) afin de permettre de théoriser un cas général à partir des multiples pièces à conviction répertoriées.
Les parties Nature, Culture et Transformation ont ensuite chacune fait l’objet d’une conclusion partielle me permettant de conclure sur le caractère utopique de la construction d’édifices de grande hauteur en terre crue aujourd’hui à Paris. La somme de ces conclusions m’a permis de conclure de manière globale.
« La construction d’édifices de grandes hauteurs en terre crue porteuse, aujourd’hui à Paris, est-elle une utopie ? »
C. Théorie
Ces informations récupérées m’ont incité à lire, entre autres, des ouvrages, ou parties d’ouvrages, traitant de la vision de la modernité et du temps par l’Homme (L’intérieur du temps d’Aldo Van Eyck, Condition de l’homme moderne de Hannah Arendt, Nous n’avons jamais été modernes de Bruno Latour et Le culte moderne des monuments d’Alois Riegl), de la relation symbiotique entre l’Homme et la Terre (L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information de Gilbert Simondon, Ecoumène d’Augustin Berque, Le Regard éloigné de Claude Lévi-Strauss), du symbolisme des matérialités (L’eau et les rêves de Bachelard Gaston), du don (Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques de Marcel Mauss) et de l’incidence de l’Homme et de son architecture sur le paysage (A la découverte du paysage vernaculaire de Jackson John Brinckerhoff, Traité d'architecture sauvage de Jean-Paul Loubes). Ces lectures m’ont permis de théoriser les pièces à conviction inventoriées.
Note sur les crédits photos : J’ai utilisé presque exclusivement des images venant de l’encyclopédie en ligne « Wikipédia », car, libres de droits, elles me permettent de les réutiliser sans être contraint par quelconque droit d’usage.
NATURE
« Entre moi et moi-même, il y a la Terre. »
Jean Marc Besse, Philosophie et géographie, 1998
Echelle Macro
NATURE CULTURE TRANSFORMATION
Symbolisme
Géographie
Phénomènes géologiques
Environnement naturel
Phénomènes climatologiques
Contexte
Physique
Mur porteur
Echelle Méso
Représentation matériau terre
Ecologie de refondation
Développement durable
Mythe
Echelle
Communauté
Vernaculaire
Acheminement
Paysage urbain
Paysage politique / habité
Approvisionnement
Réemploi
Construction
Procédé constructif
Tradition / Innovation
Echelle Micro
Terre porteuse
Armature
Chaîne de forces
Matériau terre
Matière
Comportement mécanique
Typologie des matériaux
Monument historique
Typologie des bâtiments
Patrimoine
Acteur Don
Social
Collectivité
Transmission
Préfabrication
Energie grise
Modernité
Erosion
Soin / Réparation
Anticipation
Nous allons commencer notre investigation par le rôle des phénomènes naturels dans l’édification d’architectures de grande hauteur en terre crue. Nous allons commencer par analyser l’incidence de la géographie, de ses climats et de ses risques sismiques. A travers la cartographie des grandes architectures de terre, nous étudierons si ces phénomènes favorisent ou empêchent la construction de grandes architectures en terre crue. Nous étudierons ensuite pourquoi et comment un mur en terre tient, et nous calculerons jusqu’à quelle hauteur théorique un mur en terre crue peut s’élever. Nous étudierons enfin la composition de la matière terre et nous analyserons si la terre des sols de Paris est utilisable pour ce type d’architecture.
A. Géographie

Dans Bâtir en Terre, Laetitia Fontaine et Romain Anger nous informent qu’aujourd’hui, l’architecture en terre représente 50% de l’habitat mondial et 15% des œuvres architecturales inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO24 (voir figure 5).
Site du patrimoine mondial Zone construite en terre
Or si on analyse la localisation des architectures de grande hauteur en terre (figure 6), on remarque qu’elles se situent majoritairement au Maghreb et au Moyen-Orient. Et quasi exclusivement entre le 15e et 45e parallèle nord.
Pourquoi y a-t-il une disparité géographique dans l’architecture de terre que l’on ne retrouve pas lorsque l’on parle de grande hauteur ? Paris appartient-elle à un contexte naturel lui permettant de construire des édifices de grande hauteur en terre crue ?
45e parallèle nord
15e parallèle nord
a. Phénomènes climatologiques
La Cartographie des architectures de grande hauteur en terre crue, indicateur climatique (figure 7) montre que ces architectures sont principalement réparties dans les climats arides ou désertiques.


Pour construire en terre crue, il faut en effet qu’il fasse chaud afin de faire sécher les constructions sans risque de gel. Il faut aussi qu’il ne pleuve pas afin de ne pas détériorer l’édifice en construction. Paris se situe dans une zone continentale humide, ce qui n’est pas un avantage pour la construction en terre crue. Néanmoins, on remarque que d’autres édifices ont été construits dans des climats similaires (en Autriche) ou pire (au Tibet). Les

édifices construits en Autriche l’ont été par Lehm Ton Erde, entreprise de construction de Martin Rauch, utilisant la technique du pisé. Cette entreprise de construction préfabrique les murs de pisé dans des ateliers à l’abri des intempéries. Il est cependant obligé d’effectuer les assemblages pendant l’été, les chantiers durant plusieurs mois.
b. Risques sismiques
On remarque sur la Cartographie des architectures de grande hauteur en terre crue, indicateur risques sismiques (figure 8) que la majorité des édifices de grande hauteur a été construite dans des régions au risque sismique faible.
Les architectures de terre de grande hauteur sont particulièrement sensibles aux séismes car les édifices semblent très peu capables d’encaisser les forces horizontales des séismes. La citadelle de Bam, en Iran, a été, par exemple, détruite dans sa quasi-totalité le 26 décembre


2003 par un tremblement de terre de magnitude estimée à 6,5 Mw par l'United States Geological Survey, causant 26 271 morts et 30 000 blessés25 (figures 9 et 10).



Il existe cependant une proportion importante d’édifices construits dans des régions au risque sismique élevé. Cela peut s’expliquer par le fait que l’architecture de terre est relativement facile à réparer. Paris est située dans une zone sismique faible, ce qui constitue donc un atout pour la construction d’édifices de grande hauteur en terre crue.
Après avoir vérifié que Paris n’est pas dans une zone géographique empêchant la construction d’architectures de grande hauteur, nous allons maintenant essayer de comprendre comment tient un mur en terre.
B. Physique
Dans ce chapitre, nous calculerons, dans un premier temps, la dimension maximale d’une tour en terre crue porteuse, d’après la résistance en compression moyenne de la terre des sols de Paris. Puis nous analyserons le phénomène de « chaine de forces », ouvrant à des possibilités simples de construire en hauteur.
a. Mur porteur
Nous allons maintenant calculer la hauteur maximale théorique qu’un mur en terre crue gardant la même épaisseur sur toute sa hauteur peut supporter.
Le laboratoire CRATerre a effectué des tests de résistance sur des échantillons des sols de la ville de Paris (voir partie Matière & Matériaux) : la terre crue parisienne supporte environ 2,5MPa (soit 2,5 N par mm², soit 2 500 000 N par m²)
En considérant une constante gravitationnelle de 9,81 N m2 kg-2, la terre crue parisienne supporte environ 2 500 000 N. m²/9,81 N m2 kg-2 = 254 842 kg par m²
Considérons un mur de pisé de 32,5 cm d’épaisseur (norme allemande26) et de 1 m de longueur.
Il pourra soutenir 0,325 m x 1 m x 254 842 kg.m-² = 82 823 kg, soit environ 83 tonnes. 26 Röhlen Ulrich, Ziegert Christof, 2013, Construire en terre crue: construction, rénovation, finitions, Paris,
Figure
Sachant que la masse volumique d’un mur
pisé est environ égale à ρ = 1 900 kg par m3, le mur en pisé précédemment défini pourrait soutenir 82 823 kg x 0,325 m x 1 m / 1 900 kg.m-3 ≈ 134 m de hauteur de mur de pisé de même base que la sienne.
c. Mur porteur avec plancher
Considérons un immeuble en pisé de 10 m par 6 m, avec des étages de 2,5 m de hauteur.
De la même manière que précédemment, on considère que les murs de pisé font 32,5 cm d’épaisseur. La longueur totale des murs est de 10 m x 2 + 6 m x 2 = 32 m.

Ces murs pourront soutenir 0,325 m x 32 m x 254 842 kg.m-² = 2 650 357 kg, soit environ 2 650 tonnes.
i. Poids d’un étage de 2,5 m de hauteur
Nous allons maintenant calculer le poids d’un étage de 2,5 m de hauteur afin de savoir combien d’étages cet édifice pourrait supporter.
Le poids des murs est égal à Pmurs = 32 m x 0,325 m x 2,5 m x 1 900 kg par m3 = 49 400 kg

Le poids d’un plancher nous est donné par la formule27 :
27 Cours de structure de master 1 : Estructura 3, Professeur : Ing. Mario E. Castro, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (Universidad de Buenos Aires) Cette formule sert normalement dans le cadre d’une
Wk = Gk + η x Lk
Où W est le poids d’un plancher habité
G : Charge permanente (G = 0,7xlxL)
η : Facteur de participation de la surcharge (=0,25 dans notre cas)
L : Surcharge de service selon le règlement CIRSOC 101 (L = 0,3xlxL)
Wk = Gk + η x Lk
W = (0.7 T/m² * 6m * 10m) + (0,25 * 0,3 T/m² * 6m * 10m) = 46,5 tonnes
Le poids total d’un étage équivaut à Ptotal = Pmurs + W = 46,5 t + 49,4 t = 95,9 tonnes
Ainsi, un immeuble pourrait supporter 2650 t / 95,9 t = 27 étages (soit 27 x 2,5m = 67,5 m de hauteur, voir figure 13)
Ceci est un calcul purement théorique, de première approximation, ne prenant pas en compte de nombreux facteurs (procédés constructifs, noyaux de circulations, ouvertures
construction en béton, mais nous l’utilisons ici en première approximation car la terre compactée et le béton ont des masses volumiques comparables : ρterre crue = 1 900 kg par m3 / ρbéton = 2 300 kg par m3

dans le bâtiment, phénomènes venteux, risques sismiques…). Néanmoins, il permet de continuer l’investigation.
d. Chaîne de forces
Nous allons maintenant nous intéresser au phénomène de « chaîne de forces ».
Soit un récipient contenant une quantité de terre. Lorsque l’on exerce une force F verticale sur le dessus de cette quantité de terre, une partie de F est redirigée vers les parois du récipient (voir figure 14)28.
Ce phénomène s’explique par le fait que l’énergie tend à se dissiper le plus rapidement possible et cherche donc un obstacle sur lequel s’appuyer. Les grains formant la terre à l’intérieur du récipient entrent en contact sous l’action de la force F et se transmettent les efforts de F.

Cela signifie que plus un récipient est grand, plus ses parois reprennent des efforts horizontaux. Il est ainsi plus facile de mouler de petites quantités (technique constructive de l’adobe ou de la brique de terre comprimée) de terre que de grandes (pisé).
e. Armature
Comme nous venons de le voir, une partie des forces verticales est redirigée à l’horizontal. L’idée de l’architecte Henri Vidal (1895-1955) fut d’enceindre les couches de terre entre deux armatures afin de reprendre ces forces horizontales :
« L’Homme a d’abord construit avec de la terre. Puis il a ajouté un deuxième élément, qui était une colle, pour lier les particules de terre, ce
28 Anger Romain, 2015, Conférence La Terre et les fibres végétales : matériaux de construction du futur, durée: 88 min. URL : https://www.youtube.com/watch?v=WJIJb625_O4&t=1916s
qui a conduit à l’invention du béton. Ce béton travaillant mal à la traction, il a fallu ajouter un troisième élément, les armatures, pour réaliser du béton armé ou précontraint, constitué de grains, d’un liant et des armatures. Et un matériau plus simple que le béton, formé seulement de deux éléments, les grains et les armatures, a été laissé de côté. »

 Henri Vidal
Henri Vidal
C’est une technique très ancienne, utilisée notamment sur certains pans de la Muraille de Chine ou pour la construction de la Ziggurat de Dur‐Kurigalzu (voir figure 15)
C’est ce principe que Romain Anger29 a repris dans sa thèse à travers l’expérimentation d’une tour de sable (sans liant argileux) de trois mètres de haut et de quatre centimètres d’épaisseur. Une armature est placée à chaque couche de 1cm de sable. La structure est composée de 4 « L » de 30 cm de longueur et 20 cm. Chaque L est relié aux autres par un chainage tous les 30 cm de hauteur (voir figure 16). Proportionnellement cela représente une tour de 30 m de hauteur avec des murs de 40 cm d’épaisseur.

Théoriquement, et en restant dans le champ physique, il est donc possible de construire des édifices de grande hauteur en terre crue. De plus, nous avons vu que la géographie de Paris n’est pas un obstacle à la construction de cette architecture. Aussi, les sous-sols de Paris sont composés de terre capable d’être utilisée pour de telles constructions.
C. Matière & Matériau
Nous allons maintenant nous intéresser à la matière terre, définie par CRATerre lors du la conférence Xe congrès Terra31, en 2008, comme « une matière plurielle et à l’heure actuelle, le principal obstacle à sa compréhension est sa diversité. »32 (CRATerre 2008). De par sa diversité, il est possible que certaines terres ne conviennent pas à une architecture de grande hauteur en terre crue, notamment par ses capacités mécaniques. Nous étudierons donc si la terre des sols de Paris est utilisable pour ce type d’architecture.
a. Formation
Au-dessus de la roche mère33, le sol est composé de différentes couches, dont l’épaisseur peut varier de quelques centimètres à quelques dizaines de centimètres selon les régions, que l’on peut classer en trois horizons. Ces horizons résultent de la transformation de la roche mère sous-jacente sous l’influence de divers processus physiques, chimiques et biologiques liés aux conditions bioclimatiques et à la vie végétale et animale34 :
Horizon A : Sol de surface. Couche éluviale35 principalement constitué d’humus, c’est-à-dire de matière organique animale et végétale en décomposition, lessivé en argile et en oxyde de fer. Elle est trop riche en matière organique pour être utilisée pour la construction (matériau pas assez solide et colonisation possible par des végétaux)
31 Congrès mondial sur les architectures de terre
32 Anger Romain, Doat Patrice, Fontaine Laetitia, Houben Hugo, Jorand Yves, Olagnon Christian, Van Damme Henri, 2008, La terre, un béton comme les autres ? Quelques mécanismes de stabilisation du matériau terre, Terra 2008 - 10ème Conférence Internationale sur l'Étude et la Conservation du Patrimoine Bâti en Terre, Edité par Rainer Leslie, Rivera Angelyn Bass et Gandreau David, Bamako, Mali URL : https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/terra_2008.pdf
33 Roche mère, définition d’après Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : Roche à partir de laquelle s'est constitué le sol par des altérations physiques ou chimiques.
34 Houben Hugo, Guillaud Hubert, Dayre Michel, Centre de recherche et d'application pour la construction en terre, 1995, Traité de construction en terre, Marseille, Éd. Parenthèses
35 Éluviation, définition d’après Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : Entraînement de substances solubles ou colloïdales par des eaux d'infiltration, qui provoque un appauvrissement de certaines couches du sol (on dit aussi Lessivage).
Horizon B : Sous-sol. Couche illuviale36 riche en argile et en oxyde de fer. Couche à utiliser pour la construction car principalement constituée de matière minérale très stable dans le temps.

Horizon C : Matière originelle. Roche en décomposition provenant de la « désagrégation et de l’altération de la roche mère en profondeur »37 (Anger, Laetitia, 2009)
b. Constitution
De chaque contexte naturel émane un type de terre différent. Néanmoins, chaque terre est composée de granulats, d’argile, d’air et d’eau en proportions variées. Le matériau terre pour la construction est constitué d’une ossature granulaire et d’un liant argileux, dont les différentes proportions déterminent les propriétés du matériau. Ce mélange est appelé « terre crue » lorsque la proportion d’argile n’est pas prédominante.

ii. Ossature granulaire
La terre est constituée de granulats de différentes tailles :
Cailloux : 200 mm – 20 mm
36 Illuviation, définition d’après Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : Processus d'accumulation en profondeur des particules de sol transportées en solution ou en suspension par les eaux d'infiltration`` (Forest. 1946).
37 Anger Romain, Fontaine Laetitia, op. cit , p. 67-72.
Graviers : 20 mm – 2 mm
Sables grossiers : 2 mm – 0,2 mm




Sables fins : 0,2 mm – 0,06 mm
Silts : 0,06 mm – 0,02 mm
Silts fins : 0,02 mm – 0,002 mm
Ces différents grains forment l’ossature granulaire qui va supporter, notamment, les charges de compression. Il faut que ces grains soient liés entre eux afin de former un matériau pouvant être utilisé pour construire.


http://craterre.org/diffusion:ouvrages

iii. Liant argileux
L’argile, ou plus précisément le liant argileux qu’il forme avec l’oxyde de fer et l’eau, sert à lier les granulats entre eux, principalement par force électrostatique.
Argile
Selon Romain Anger, les argiles sont des « colloïdes minéraux », c’est-à-dire des particules de taille inférieure à 1 μm. Leur capacité à lier dépend de la nature des argiles38 et des oxydes de fer39 Or la petitesse des particules colloïdales leur confère des masses insignifiantes, ce qui les rend capable d’occuper le moindre recoin du milieu dans lequel elles baignent. Les particules du liant argileux sont donc capables de venir dans les interstices laissés entre les différents granulats du matériau terre et donc de lier les différents grains entre eux. Néanmoins, leur grande sensibilité aux différentes interactions entre leurs interfaces fait que le passage entre états fluides, pâteux, gélifiés ou granulaires est facile (Anger, 2011, p.79).
Eau
L’étude des milieux granulaires humides est encore plus récente que celle des milieux granulaires secs.40 Dans l’ article « qu’est ce qui fait tenir les châteaux de sable ? » des chercheurs de l’université de Notre-Dame (Indiana, Etats-Unis) mettent en évidence le rôle de l’eau dans les milieux granulaires humides : « De petites quantités de liquide peuvent modifier radicalement les propriétés des milieux granulaires […] conduisant potentiellement à de nouveaux phénomènes physiques non rencontrés dans la matière sèche. » 41 (Hornbaker, Albert, Albert, Barabási, Schiffer, 1997, p. 765). Depuis le début des années 2000, nous savons que « l’eau, grâce à sa tension superficielle, joue un rôle majeur dans la cohésion du matériau terre. » 42 (CRATerre 2008). Aussi, les études récentes sur l’influence de l’eau dans le matériau terre ouvrent de nouvelles voies de connaissance des possibilités offertes par le matériau terre, notamment son assimilation à
38 Kaolinite, Smectite ou Illite principalement
39 Goethite, Hématite, Ferrihydrite, Lépidocrocite, Fougérite ou autres
40 CRAterre-ENSAG, Fontaine Laetitia, Anger Romain, 2011, rapport d’activité Grains de Bâtisseurs 2004 ‐2010, Grenoble, CRAterre
41 Hornbaker D. J., Albert R., Albert I., Barabási A.-L., Schiffer P., 1997, What keeps sandcastles standing ?, Nature, Volume 387, Publication 6635, p. 765 « Small quantities of wetting liquid can thus dramatically change the properties of granular media, leading to a large increase in the repose angle, clustering and correlation in grain motion. Our results indicate that interstitial liquids can alter many aspects of pattern formation, self-organization1–4 and segregation13 in granular materials, potentially leading to new physical phenomena not encountered in dry matter. »
42 Anger Romain, Doat Patrice, Fontaine Laetitia, Houben Hugo, Jorand Yves, Olagnon Christian, Van Damme Henri, op. cit
un béton d’argile et les transpositions possibles avec les connaissances techniques que nous avons du béton de ciment (Anger, 2011, p.79).

iv. Air
L’air retenu dans les mélanges de terre crue ne participe pas à la résistance mécanique et emprisonne des micro-organismes qui peuvent détruire les composants organiques des matériaux de construction43 La proportion d’air doit donc être réduite dans le mélange de terre crue.
c. Béton d’argile Comme nous l’avons vu, la terre est une matière diverse. « Pour faire face à cette diversité, la solution est peut-être de considérer cette matière terre dans le cadre plus large des bétons, « béton » étant un terme générique qui désigne un matériau de construction composite fabriqué à partir de granulats (sables, graviers, etc.) agglomérés par un liant : la terre est un béton d’argile » 44 (CRATerre 2008).
Cette nouvelle connaissance du matériau, qui date des années 2000, permet de mieux comprendre ses propriétés mécaniques et de transposer des techniques de construction liés aux bétons de ciment directement au matériau terre. Cette nouvelle approche du matériau terre afin de faire face aux diversités des terres présentes plusieurs avantages décrits par
43 Röhlen Ulrich, Ziegert Christof, 2013, Construire en terre crue: construction, rénovation, finitions, Paris, Le Moniteur
44 Anger Romain, Doat Patrice, Fontaine Laetitia, Houben Hugo, Jorand Yves, Olagnon Christian, Van Damme Henri, 2008, La terre, un béton comme les autres ? Quelques mécanismes de stabilisation du matériau terre, Terra 2008 - 10ème Conférence Internationale sur l'Étude et la Conservation du Patrimoine Bâti en Terre, Edité par Rainer Leslie, Rivera Angelyn Bass et Gandreau David, Bamako, Mali URL : https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/terra_2008.pdf
Romain Anger dans sa thèse, Approche granulaire et colloïdale du matériau terre pour la construction :
« L’intérêt premier d’un béton est de ne pas posséder de caractéristiques mécaniques, thermiques ou rhéologiques figées, puisqu’il est possible à loisir d’améliorer voire de programmer ses propriétés pour répondre au mieux aux besoins spécifiques d’un projet architectural dans un contexte donné. Tout repose sur l’art du mélange des constituants qui vont servir à formuler le béton. Dans le cas de la terre, une difficulté à surmonter est la diversité des matières premières, à la fois d’un point de vue du squelette granulaire et de la nature colloïdale de la fraction argileuse. Cela implique une formulation spécifique en fonction de la terre naturelle utilisée. »45
Anger, 2011, p.221
Les propriétés mécaniques des matériaux terre produits dépendront donc de la nature du liant argileux, de ses proportions dans le matériau terre et des conditions climatiques extérieures.
d. Propriétés
Le matériau terre possède de nombreuses propriétés physiques46, mais nous allons nous intéresser ici à celles ayant le plus d’influence pour notre étude sur la construction d’édifices de grande hauteur : la plasticité pour comprendre les modes de construction et la résistance mécanique pour savoir combien de charge peut supporter le matériau terre.
i. Plasticité
La plasticité de la terre est son aptitude à être modelée. Les différents mélanges et proportions des granulats et du liant argileux vont déterminer l’état hydrique du matériau terre. Le test dit des limites d'Atterberg permet de classifier l’état hydrique de la terre crue en trois grands états :
Solide : présence de très peu d’eau. La terre va être soumise à des forces de compression importantes pour la modeler. Cet état de la terre est utilisé dans les
45 Anger Romain, op. cit., p. 221
46 Couleur, Ameublissement, Stabilité structural, Adhérence, Masse volumique apparente, Masse volumique spécifique, Teneur en eau, Porosité, Pouvoir absorbant, Potentiel capillaire, Diffusion capillaire, Perméabilité, Chaleur spécifique, Surface spécifique, Capacité totale d’échange, Taux de saturation, Retrait linéaire, Résistance sèche, Granularité, Plasticité, Compressibilité, Cohésion.
techniques du pisé ou de la brique de terre comprimée (cf. nous parlerons des techniques dans le chapitre « transformation – procédés constructifs »).
Plastique : Proportion d’eau plus importante permettant à la terre d’être malléable et d’être ainsi mouler dans de petits moules (technique de l’adobe).
Liquide : Proportion d’eau importante. La terre est dans un état visqueux traditionnellement utilisée pour les enduits (ou mélangé sous forme de barbotine à des fibres comme la paille). C’est aussi l’état dans lequel sont expérimentés les nouveaux bétons d’argile.
ii. Résistance à la compression
La résistance à la compression est « contrainte maximale admissible par un matériau soumis à une charge d’écrasement »47 et sert à connaitre la charge que peut supporter une quantité de terre. Elle est variable d’un échantillon de terre à un autre. Pour le pisé, la résistance en compression se calcule après 28 jours, une fois que le pisé est bien stable.
Pendant les travaux du Grand Paris, 5000 sondages48 ont été réalisés. On connaît ainsi la nature des sols de la région parisienne. L’agence Joly & Loiret, dans le cadre de sa participation au concours Réinventer Paris, a fait analyser des échantillons des déblais des travaux du Grand Paris afin de savoir si ces déblais pourraient être réutilisés49. Les différents tests effectués (contrôle des polluants, test granulométrique, test du Proctor, la compaction du mélange et la résistance à la compression) indiquent que ces déblais sont réutilisables pour la construction en terre (nous détaillerons dans le chapitre Transformation-Acheminement quelles terres sont réutilisables et en quelles quantités).
Après trois semaines de séchage, les tests indiquent une résistance à la compression d’environ 2,5 MPa (c’est-à-dire que cette terre est capable de supporter environ 250 grammes par millimètre carré, soit environ 250 tonnes par mètre carré).
D. Théorie Nature
« Monde et terre sont essentiellement différents l’un de l’autre, et cependant jamais séparés. Le monde se fonde sur la terre et la terre surgit au travers du monde. »50
47 http://www.instron.fr/fr-fr/our-company/library/glossary/c/compressive-strength
48 Réseau de transport public du Grand Paris – Schéma de gestion et de valorisation des déblais, Juillet 2017, Société du Grand Paris
49 Joly & Loiret, 2014, Habiter la terre, Réponse au concours Réinventer Paris, Document confidentiel
50 Heidegger Martin, 1949 [1962], Chemins qui ne mènent nulle part, Paris Gallimard
Heidegger, 1949, p.52
Nous avons vu comment la nature influe sur la construction d’architectures de grande hauteur. Nous allons dans cette partie essayer de comprendre les enjeux théoriques qui lient ce type d’architecture avec l’homme.
a. L’homme, un être situé Nous avons vu l’influence de la nature sur les architectures en terre de grande hauteur : leurs relations à l’échelle macroscopique, mesoscopique et microscopique. De la même façon, l’homme est influencé par la nature à toutes ces échelles. Dans Ecoumène, Augustin Berque analyse la relation de l’homme à son contexte naturel :
« L’être humain est un être géographique. Son être est géographique. S’il ouvre à l’absolu, ce dont les diverses cultures ont des visions différentes, il est d’abord, et nécessairement, déterminé par une certaine relation à ce qui fait l’objet de la géographie : la disposition des choses et du genre humain sur la terre, sous le ciel. » 51
Berque, 2010, p.78
La culture d’une communauté est ainsi façonnée par la géographie : les modes de vies varient que l’on vive en Afrique dans un climat désertique ou en Europe dans un climat continental. La flore, la faune, les rythmes influencent notre rapport au monde et modèlent nos modes de vie. Augustin Berque décrit ainsi l’homme et sa culture comme dépendante à son rapport à la Terre :
« La géographie et l’histoire montrent à l’évidence que les formes de l’habitat humain ne sont pas les mêmes partout, et qu’elles évoluent dans le temps. Il est presque aussi évident que les sociétés humaines ont des attitudes spécifiques envers ces formes. On s’en rend forcément compte si l’on compare deux époques dans l’histoire ou deux cultures dans le monde. » 52
Berque, 2010, p.78
L’architecture, comme production culturelle située, nait de cette relation de l’homme à son environnement. Ainsi, l’architecture traditionnelle est vernaculaire53. L’architecture de
51 Berque Augustin, 2000, Ecoumène : introduction à l'étude des milieux humains, Paris, Belin
52 Berque Augustin, op. cit , p.78
53 Vernaculaire, définition d’après Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : Propre à un pays, à ses habitants.
terre est une architecture particulièrement située, principalement due à son poids et donc à ses difficultés d’acheminement. Cette architecture permet donc à l’homme d’évoluer dans un contexte lui permettant d’entretenir sa relation symbiotique54 au monde. Jean-Paul Loubes décrit, dans Traité d'architecture sauvage, la nécessité de reconnecter l’architecture à son contexte naturel afin de proposer une architecture géopoétique, sensible et en harmonie avec son environnement :
« Pour une conception des choses liée à la localité, fondée dans l’expérience du lieu (locus, topos), il est bon à mon sens, de remonter jusqu’à la Physique d’Aristote, qui décrit le lieu comme « difficile, étrange, puissant ». C’est à partir de là que l’on peut se saisir du concept géopoétique, et, en tenant compte de tous ces autres paramètres qui entrent en jeu (dimensions, matériaux…) parvenir à une architecture pleinement géopoétique.»55
Loubes, 2010, p. 10
b. L’architecture de terre, facteur d’individuation
Cette relation à l’environnement, exprimée par l’architecture de terre, se retrouve lors de la construction. L’homme, au cœur du processus de construction, façonne le matériau terre. Il agit sur la matière, il la modèle. Il est au cœur du système de transformation entre la matière brute (terre) et la forme (moule) : il est l’énergie permettant cette transformation Dans L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information, Simondon Gilbert met en avant cette énergie nécessaire à la transformation :
« L’opération de prise de forme ne suppose pas seulement matière brute et forme, mais aussi énergie. »56
Simondon, 1989, p. 45
A plus grande échelle, l’homme amène son énergie afin d’édifier sa maison, son village, son paysage urbain… au sein de sa communauté, l’énergie mise lors de la fabrication du matériau terre est partout. L’homme perçoit alors son rapport au monde et aux autres, cela
54 Symbiotique, définition d’après Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : Relation de dépendance.
55 Loubes Jean-Paul, 2010, Traité d'architecture sauvage : manifeste pour une architecture située, Paris, Le Sextant
56 Simondon Gilbert, 1989, [2005], L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information, Grenoble, Jérôme Million.
permet de le situer au sein de ses semblables et cela participe ainsi à son « individuation »57 (Simondon, 1989, p. 45).
Les grandes architectures de terre sont plus que la somme des énergies nécessaires pour la construction d’architecture de terre de petites dimensions De par les problèmes techniques de construction, d’acheminement de la matière58… la quantité d’énergie nécessaire est décuplée. Hanna Arendt, dans son livre Condition de l’homme moderne, définit cette addition collective d’énergie comme « puissance » :
« Tandis que la force est la qualité naturelle de l’individu isolé, la puissance jaillit parmi les hommes lorsqu’ils agissent ensemble et retombe dès qu’ils se dispersent. »59
Arendt, 1958, p.260
Le rassemblement des hommes étant, pour Hanna Arendt, « le seul facteur matériel indispensable à l’origine de la puissance », la philosophe la considère potentiellement comme action « illimitée » car « elle n’a pas de limitation physique dans la nature humaine, dans l’existence corporelle de l’homme, comme la force »60 (Arendt, 1958, p.261). Cette non-limitation permettant potentiellement la construction d’édifices de grande hauteur en terre crue.
Cette émanation d’une puissance collective permet à des communautés de réaliser des travaux bien plus grands que la somme des travaux pouvant être réalisés par une somme d’individus. Cette puissance leur permet de laisser une trace tant sur le paysage que dans l’histoire. De manière analogue à l’individuation dont participe la formation du matériau terre, on peut penser que, les grandes architectures de terre participent à « l’individuation » d’une communauté, c’est-à-dire à l’affirmation dans le monde de cette communauté.
L’architecture de terre permet donc à l’homme de donner forme à son environnement. Il influe ainsi sur la terre, comme la terre influe sur lui.
57 Individuation, définition d’après Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : Fait d'exister en tant qu'individu
58 Mais aussi par leur caractère symbolique, que nous étudierons dans le chapitre Culture
59 Arendt Hannah, 1958, Condition de l’homme moderne, Paris, Calman-Levy
60 Ibid., p.261
Symbolisme.
c. Anthropocène61
Cette relation ombilicale a cependant été mise à mal depuis l’avènement du cartésianisme dans les sociétés occidentales devenues « modernes » 62 (Latour, 1991) Cette séparation de la nature et de la culture, a engagé une dissociation de l’homme avec son environnement, dont la répercussion en architecture tient son apogée durant le mouvement « moderne »
Cette fracture entre l’architecture et son contexte naturel est symbolisé par la « machine à habiter » de Le Corbusier, qui décontextualise totalement l’habitat63 (Loubes, 2010). Cette décontextualisassions de l’être géographique a été amplifiée par l’arrivée de nouveaux moyens de productions. L’avènement du machinisme a fini par couper cette relation consciente de l’homme à la matière, définit plus haut. Or, cette relation existe belle et bien, comme le décrit Jackson John Brinckerhoff dans Landscape :
« Il existe une action et une réaction constantes entre nous et cet environnement. […] Nous commençons d’apprendre que le monde qui nous entoure affecte chaque aspect de notre être, que loin d’être des spectateurs du monde nous en sommes des participants »64
Jackson, 1961, p.2
Cette dissociation entre culture et nature est en réalité une invention des « modernes » et n’a en réalité jamais existé (Latour, 1991). Ne croyant pas avoir d’impact sur leur environnement, les « modernes » ont, en fait, décupler les dégâts écologiques. Alors que l’accumulation illimitée de richesse était prônée par le capitalisme, les dégâts de ce dernier sur la terre se faisaient ressentir :
« En voulant dévier l’exploitation de l’homme par l’homme sur une exploitation de la nature par l’homme, le capitalisme a multiplié indéfiniment les deux »65
Latour, 1991, p.17
Le Congrès International de Géologie 34e a annoncé en 2012 que l’Holocène était terminée et que nous appartenions à l’Anthropocène, confirmant ainsi les effets de l’homme sur la
61 Anthropocène, définition d’après Wikipédia Lexicales : terme relatif à la chronologie de la géologie proposé pour caractériser l'époque de l'histoire de la Terre qui a débuté lorsque les activités humaines ont eu un impact global significatif sur l'écosystème terrestre.
62 Latour Bruno, 1991, Nous n’avons jamais été modernes, Essai d’anthropologie symétrique, Paris, La découverte
63 Loubes Jean-Paul, op. cit
64 Jackson John Brinckerhoff, Landscape, vol. 10, numéro 1, p.2
65 Latour Bruno, op. cit., p. 17
planète depuis le début du 19e siècle66 Les impacts de l’homme sur la Terre se retournent contre lui aujourd’hui, avec une recrudescence des problèmes écologiques. Cette nouvelle ère de l’Anthropocène est résumée par Bruno Latour : « Les natures que l’on voulait dominer absolument nous dominent de façon également globale en nous menaçant tous »67 (Latour, 1991, p.18) Face aux changements climatiques, face aux dégâts écologiques, face à la raréfaction des matières premières, mais aussi pour reconnecter l’homme à son environnement, il paraît nécessaire que l’architecture, dont l’impact sur l’environnement est primordial68, adopte des pratiques moins consommatrices d’énergie fossile et de matière non recyclable.
E. Conclusion Nature
Nous avons vu que la construction d’édifices de grande hauteur en terre crue à Paris est tout à fait réalisable, tant d’un point de vue géographique, physique que matériel69 Le climat parisien, peu favorable à première vue, n’est pas un obstacle, de grandes architectures de terre ayant été construites dans des climats plus difficiles. De plus, le travail en atelier permet de répartir l’activité tout au long de l’année et pas seulement pendant la phase de chantier. Les risques sismiques faibles en région parisienne participent aussi à la faisabilité de ces constructions. La terre de Paris a été testée par le laboratoire de recherche CRATerre et elle est tout à fait capable de supporter des édifices de plusieurs étages (le calcul théorique allant jusqu’à vingt-sept étages).
Ce type de construction pourrait aussi permettre une reconnexion entre l’homme et son environnement tant la terre est un matériau « situé » par excellence. Le travail manuel nécessaire pour bâtir ces édifices participe à « l’individuation » de l’homme (Simondon, 1989) et l’affirmation d’une communauté. Etape nécessaire afin de faire face aux risques écologiques imminents.
66 Hache Emilie, 2014, De l'univers clos au monde infini, Paris, éd. Dehors
67 Latour Bruno, op. cit., p. 18
68 Selon le 5ème rapport d’évaluation du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat « la construction et la maintenance des bâtiments sont responsables, au niveau mondial, de 20 % des émissions de gaz à effet de serre et de 40% de l’énergie consommée ».
69 Matériel, définition d’après Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : Relatif à la matière
CULTURE
Echelle Macro
NATURE CULTURE
Géographie
Phénomènes géologiques
Environnement naturel
Phénomènes climatologiques
Contexte
Physique
Mur porteur
Echelle Méso
Terre porteuse
Armature
Chaîne de forces
Matériau terre
Symbolisme
Représentation matériau terre
Ecologie de refondation
Développement durable
Mythe
Echelle
Communauté
Vernaculaire
Monument historique
Typologie des bâtiments
Patrimoine
Acteur Don
Echelle Micro
Matière
Comportement mécanique
Typologie des matériaux
Social
Collectivité
Transmission
TRANSFORMATION
Acheminement
Paysage urbain
Paysage politique / habité
Approvisionnement
Réemploi
Construction
Procédé constructif
Tradition / Innovation
Préfabrication
Energie grise
Modernité
Erosion
Soin / Réparation
Anticipation
Nous allons à présent aborder le rôle du contexte culturel dans l’édification de ces grandes architectures en terre crue. Nous débuterons par les références symboliques que convoquent ce type d’architecture, depuis le mythe de la tour de Babel jusqu’à la revalorisation du matériau terre dans nos sociétés occidentales. Dans un deuxième temps, nous allons voir comment ces édifices sont l’œuvre d’une communauté, d’un groupe d’individus unissant leurs forces dans le but de se forger un destin commun. Après avoir catégorisé les différents types de communautés desquelles émergent les grandes architectures en terre crue, nous nous intéresserons à quelques cas particuliers afin de comprendre les liens sociaux qui définissent les relations au sein de ces communautés. Enfin, nous analyserons le rôle des individus au sein de ces collectifs, et notamment leur capacité à apprendre et transmettre
A. Symbolisme
Nous allons nous intéresser dans cette première partie à la représentation de l’architecture de grande hauteur en terre crue dans l’imaginaire collectif. Nous essaierons de déterminer si ces édifices peuvent être acceptés dans le contexte parisien.
a. Représentation hauteur
i. Tour de Babel
« Toute la Terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinear et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: « Allons! Faisons des briques et cuisons-les au feu! » La brique leur servit de pierre, et le bitume de ciment. Ils dirent encore: « Allons! Construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » L'Eternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes, et il dit: « Les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris! Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons! Descendons et là brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement ». L'Eternel les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre. C'est pourquoi on l'appela Babel: parce que c'est là que l'Eternel brouilla le langage de toute la terre et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. »
Genèse 11.1-9
Le mythe de la tour de Babel (probablement inspiré de la ziggurat de Babylone, construite au début du IIe millénaire avant J.-C) raconté dans la Bible71, se déroule peu après le Déluge, quand le roi Nemrod et ses hommes entreprirent de bâtir une tour dont le sommet toucherait le ciel. Pour punir les hommes de leur excès d’orgueil, Dieu les éparpillent sur Terre et leur donne à chacun un langage différent afin qu’ils ne puissent plus se comprendre. La construction de la tour échoue donc et cet épisode a longtemps été perçu, dans le monde occidental, comme une punition envers l’excès d’orgueil des hommes, comme en témoignent ses différentes représentations dans la culture occidentale Construite en terre, on constate sur les représentations figure 21, que la chute de la ville de Babylone, représentée par la destruction de la tour de Babel, continue de hanter les représentations graphiques même plusieurs millénaires après cet épisode.

On remarque sur la Cartographie des architectures de grande hauteur en terre crue, indicateur historique (figure 22), que la majorité des architectures de grande hauteur en terre crue a été construite jusqu’à très récemment en dehors du monde chrétien (Maghreb, Moyen -Orient, Espagne période musulmane, Pérou période inca, Asie).

On peut ainsi penser que le mythe de la tour de Babel a marqué un plafond de verre symbolique concernant l’architecture de grande hauteur dans le monde chrétien, empêchant ainsi l’édification de grandes architectures en terre crue en Occident Si l’on compare la localisation des architectures de grande hauteur en terre crue avec la cartographie de la population musulmane dans le monde en 2014 (figure 23), on se rend compte en effet que la grande majorité des architectures de grande hauteur en terre crue ont été construits en terres musulmanes.
Population musulmane en pourcentage



De manière plus vaste, nous allons maintenant aborder la symbolique des architectures en grande hauteur de nos jours, sans préciser le matériau utilisé.
ii. Architectures de grande hauteur
Dans un premier temps, accès direct au ciel, aux dieux, à l’au-delà, et par conséquent à l’éternité, la figure de la grande hauteur continue d’exprimer ce péché d’orgueil dans le monde contemporain : « Les tours symbolisent le pouvoir » 72 pour Huriot Jean-Marie73. Vue d’un côté comme la réponse pour contrer l’expansion urbaine car « formidable outil de concentration maximale dans un volume vertical » 74 (Benoit, 2009), l’architecture de grande hauteur, et les tours en particulier, « ont une forte puissance symbolique de réussite, de richesse, de développement, de position dominante dans l’échiquier politique ou économique du monde. »75 (Huriot, 2011) ou encore, sont les « symboles d'une réussite économique, d'un goût affirmé pour le défi et d'une vision surplombante du monde. » 76 (Benoit 2009). Lieu de concentration des pouvoirs économiques, les tours imposent leur « verticalité au monde qui l'entoure, forcé de l'observer du sol. » 77 (Benoit, 2009). D’ailleurs, leur rationalité économique pourrait, pour Manuel Appert78, « n’être envisagée qu’en considérant la symbolique des tours et le prestige qui leur est associé »79 (Appert, 2011) tant ce qu’elles représentent va bien au-delà de leur attributs fonctionnels. Cependant, ces architectures de grande hauteur sont controversés car « par leur proéminence, elles induisent aussi des impacts paysagers majeurs »80 (Appert, 2015) qui peuvent changer l’aspect d’une ville. Aujourd’hui, Paris s’inscrit dans ce que Manuel Appert décrit une « une verticalisation des villes européennes sans précédent »81 (Appert, 2015) où les projets d’édifices de grande hauteur se multiplient. Néanmoins, ces projets suscitent des controverses, comme la Tour Triangle, en 2014, qui doit être construite au niveau du parc des Expositions de la porte de Versailles, dans le 15e arrondissement de
72 Huriot Jean-Marie, 24 octobre 2011, Les tours du pouvoir, Métropolitiques, URL : https://www.metropolitiques.eu/Les-tours-du-pouvoir.html
73 Professeur en économie à l’université de Bourgogne
74 Benoit Guillaume, 16 juin 2009, Les volumes de la ville - Le complexe de la tour, Le Figaro, URL : http://evene.lefigaro.fr/lieux/actualite/tours-immeubles-gratte-ciel-hauteur-taille-2070.php
75 Huriot Jean-Marie, op. cit
76 Benoit Guillaume, op. cit.
77 Ibid
78 Maître de conférences en géographie à l’université Lyon-2
79 Appert Manuel, 12 septembre 2011, Politique du skyline. Shard et le débat sur les tours à Londres, Le Figaro, URL : http://www.metropolitiques.eu/Politique-du-skyline-Shard-et-le.html
80 Appert Manuel, 16 décembre 2015, Le retour des tours dans les villes européennes, Le Figaro, URL : http://www.metropolitiques.eu/Le-retour-des-tours-dans-les.html
81 Ibid
« La construction d’édifices de grandes hauteurs en terre crue porteuse, aujourd’hui à Paris, est-elle une utopie ? »
Paris. A la question « Seriez-vous favorable à ce qu’à titre exceptionnel, dans des projets précis, puisse être envisagée la construction de quelques immeubles de grande hauteur (…) en dehors du centre historique de Paris ? », 62 % des personnes interrogées y ont répondu défavorablement82 d’après l’urbaniste Gwenaëlle d’Aboville. Cependant, dans le cas de la Tour Triangle, après plusieurs sessions de débats avec les habitants, il semblerait que « le débat ne porte pas tant sur le sujet de la forme urbaine, mais que les questions soulevées sont essentiellement de nature programmatique » 83 (d’Aboville, 2015).
b. Représentation matériau terre
Dominique Gauzin-Muller – experte européenne de l’architecture écologique et rédactrice en chef de la revue française Ecologik / EK affirme en 2015 que « la terre crue a désormais conquis le champ de l’architecture contemporaine. Des centaines de réalisations, d’une grande qualité technique et esthétique, émergent sur les cinq continents. Le nouvel essor de ce matériau naturel - non énergivore et bien adapté aux programmes participatifs - peut désormais couvrir une partie significative des besoins en habitat écologique »84 Aujourd’hui le matériau terre semble être redécouvert dans les pays du Nord pour plusieurs raisons :
Le patrimoine mondial en terre crue témoigne aussi d’une présence pérenne, qui transparaît au travers de la longue liste d’ouvrages en terre crue inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.85
Il y a un réapprentissage des techniques de construction opéré par CRATerre, centre de recherche sur les constructions en terre crue fondé en 1979. Ses recherches scientifiques et techniques ont été notamment validées à Paris par la Cité des Sciences et de l’Industrie de La Villette, dès 2008, dans l’exposition et le livre Bâtir en terre.
La France est aussi le seul pays au monde où existe, pour les architectes et ingénieurs, un enseignement spécialisé post-master dans le domaine de l’architecture de terre (Diplôme de Spécialisation et d’Approfondissement en
82 d’Aboville Gwenaëlle, 13 mars 2015, Les Parisiens opposés à la grande hauteur ? - Retour sur la concertation autour du projet de la tour triangle, Le Figaro, URL : http://www.metropolitiques.eu/LesParisiens-opposes-a-la-grande.html#nb1
83 Ibid.
84 Gauzin-Müller Dominique, 2016, Architecture en terre d’aujourd’hui: les techniques de la terre crue, Paris, Museo
85 Doat, Patrice, Hays, Alain, Matuk, Silvia, Vitoux, Francois, Houben, Hugo, Auteur, 1983, Construire en terre, Paris, Éd. Alternatives
Architecture de terre de l’ École Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble)
bénéficiant de la triple caution culturelle, scientifique et pédagogique de l’UNESCO.86
Des expositions et conférences sensibilisent la population et stimulent la diffusion des connaissances sur la construction en terre crue (Conférences Terra depuis 197287, Des architectures en terre au centre Pompidou en 198188, La ville des terres par l’association Bellastock en 2017 … ).
Le matériau terre crue est vu comme un matériau écologique du fait de sa faible énergie grise et du peu de produits chimiques qu’il contient, comparé aux matériaux conventionnels.
Les lauréats des prix internationaux les plus prestigieux, tel le célèbre prix Pritzker, construisent aujourd’hui en terre : Renzo Piano89, Wang Shu90 , Herzog & de Meuron91 ou Snoheta92
Le développement de la construction en terre crue dans les pays industrialisés s’accompagne, ces dernières années, d’une utilisation en couches de moins en moins épaisses : le marché des enduits en terre, et surtout des enduits de finition de terre colorées, a fortement augmenté. Cette meilleure image (du matériau terre) a ainsi promu les autres types de construction terre, et même valorisé la construction monolithique et porteuse en terre crue.93
Nous avons donc vu que l’architecture de grande hauteur en terre crue peut être symboliquement acceptée en Occident et à Paris en particulier, du fait de sa forme et du renouveau du matériau terre dans les pays industrialisés, en France particulièrement. Nous allons maintenant nous intéresser aux hommes qui construisent ces monuments, et dans un premier temps, leurs communautés.
B. Communauté
Comme nous l’avons vu dans la partie Nature, la terre est un matériau extrêmement énergivore, que ce soit pour son acheminement ou pour sa transformation en forme
86 http://craterre.org/enseignement:dsa-architecture-de-terre/
87 https://terra2016.sciencesconf.org
88 http://craterre.org/
89 Emergency children’s surgery center, Renzo Piano Building Workshop, Ouganda, en construction
90 WaShan Guesthouse, Amateur Architecture Studio, Chine, 2008
91 Ricola Kräuterzentrum, Herzog & de Meuron, Suisse, 2014
92 The King Abdulaziz Center for World Culture, Snøhetta, Arabie Saoudite, en construction
93 Röhlen, Ulrich, Ziegert, Christof, op. cit.
architecturale. La question de la grande hauteur accentue cette donnée énergétique de par le niveau de complexité de l’édification de ce type de bâtiment comparé à des bâtiments de basse hauteur (un édifice dix fois plus grand est plus que dix fois plus complexe et compliqué à construire, voir chapitre Nature-Théorie). Ces édifices ne peuvent ainsi pas être construits par des individus seuls. Ces édifices sont l’œuvre d’un travail de groupes plus ou moins importants d’individus pour lesquels ces grandes architectures marquent leur appartenance à une communauté. Comme on le voit sur la carte des grandes architectures classées par typologie de bâtiments (figure 24), la grande majorité des édifices peuvent se classer en trois catégories : les bâtiments religieux, les villes fortifiées et les édifices d’habitation sans rempart.
Nous avons classé ces communautés en fonction de la raison qui les a poussée à édifier : se protéger, croire et s’entraider.
a. Se protéger
Nous allons, dans cette partie, nous intéresser aux communautés qui ont construit de grandes architectures de terre au travers de deux exemples : les Hakkas, en Chine, et les habitants de Shibam, au Yémen.

Les Hakkas, sont des chinois Han du sud de la Chine longtemps obligés de migrer car chassés de chez eux suite aux changements de dynastie. A la recherche de terres meilleures, ils ont investi le Fujian en construisant des maisons (ou plutôt des villages) fortifiées à partir du XVe siècle. Ces édifices pouvant accueillir 700 personnes étaient la plupart du temps ronds (symbolisant le ciel) mais parfois carrés (symbole de la terre) (figure 25). Ces toulous, littéralement maison-terre (土楼 : tǔlóu, 土 : tǔ (terre), 楼 : lóu (maison)), sont construites en pisé. Elles ne comptent qu’une seule entrée et les ouvertures ne sont présentes qu’au premier étage, là où les armes, notamment, étaient entreposées (figure 26).


C’est donc la vie d’un village qui s’organisait à l’intérieur des murs en terre protecteurs pouvant aller jusqu’à 3 m d’épaisseur : autour du puits extérieur central vivaient les animaux de la ferme et était installés les lieux de vie communs (théâtre et la salle du précepteur notamment), les cuisines étaient placées au rez-de-chaussée, les habitations (dont toutes les pièces communiquaient entre elles) à l’étage et les lieux de culte dans les parties supérieures. En 2008, 46 toulous de la province du Fujian ont été inscrits sur la liste

du patrimoine mondial de l'UNESCO car constituant « un exemple unique de peuplement humain, fondé sur une vie en communauté et des besoins défensifs tout en maintenant une relation harmonieuse avec leur environnement. »94
ii. Maisons-tours de Shibam

L’ancienne ville de Shibam, la « Manhattan du désert », est connue pour ses maisons-tours en terre crue de plusieurs étages (figure 27). La hauteur de ces maisons, vient du fait que cette agglomérat de tours servait aussi à protéger la ville des colonies étrangères. La structure urbaine de la ville et l’agencement des maisons-tours sont faites pour épouser les traditions locales de même que pour s’adapter aux conditions climatiques. La ville de Shibam était une ville de riches marchands et immigrants. A première vue, la stratification sociale de la ville n’est pas marquée dans son architecture : les immeubles sont homogènes en hauteur et en nombre de fenêtres en bois. Chaque tour n’appartenait qu’à une seule famille. La seule différence extérieure entre ces tours fût qu’elles soient peintes en blanc ou pas. A part le palace du sultan ou la mosquée, seul un petit nombre d’édifices étaient complètement peints en blanc95 Les maisons-tours ne possèdent qu’un seul accès à la rue (à l’intérieur des remparts). Ces pièces sans fenêtre sont utilisées comme grenier pour les grains, le blé et les dattes, afin de permettre aux familles d’avoir des provisions pour une année.96 Des passages connectant les maisons -tours dans leur partie supérieure ont été conçus pour deux raisons : permettre aux femmes de circuler entre les différents
94 UNESCO - Centre du patrimoine mondial : http://whc.unesco.org/fr/list/1113
95 Damluji Salma Samar, 2007, The architecture of Yemen : from Yafi' to Hadramut, Londre, Laurence King
96 Ibid
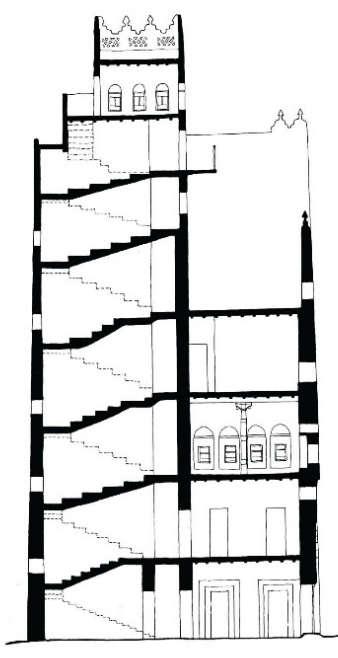
« marawih » (étage réservé aux femmes) et, en temps de guerre, permettre aux soldats de circuler librement d’une tour à une autre. Shibam est constituée de différentes classes sociales97 et les classes sociales les plus basses habitaient dans des maisons de plain-pied à l’extérieur des enceintes de la ville afin de ne pas dénaturer l’homogénéité architectural de la vieille ville. La ville de Shibam est ainsi un exemple criant des liens vitaux qu’entretient une communauté avec son architecture, à la base conçue dans le but principal de la protéger.
b. Croire
Nous allons maintenant étudier les communautés qui ont construit de grandes architectures en terre crue par besoins religieux. Nous évoquerons le cas de la ville de Djenné et des villes islamiques.
i. Djenné
D’autres communautés se sont organisées autour d’une croyance commune. C’est par exemple le cas de Djenné, où la réparation de la Mosquée (dont nous étudierons plus en détail les mécanismes dans la partie Transformation – Erosion) est devenue un rituel et fait place à une célébration commune.
Djenné est une ville malienne située dans la plaine alluviale du Bani, affluent du Niger. De par sa géographie éloignée d’autres sources de matériaux de construction, la ville est principalement construite en terre crue (figure 28). La mosquée de la ville est l’une des plus
97 Du rang le plus haut au plus bas : les Sultans (les propriétaires de la ville), les Qarar (les marchands), les Ja’Alah (professions manuelles), les Du’afa (les employés), les Mustakhdam (les servants) et des Abid (les esclaves).

importantes d’Afrique et un bâtiment de grande hauteur en terre crue remarquable. A cause de la fragilité de la terre crue au vue des conditions climatiques (saison des pluies, grandes chaleurs…), le parement en terre crue protégeant la partie structurelle de la mosquée se dégrade et doit être réparé chaque année. L’arrivée de la saison des pluies marque ainsi le jour de la réparation de la moquée



C’est alors que tous les enfants de la ville accourent pour transporter la boue de la rivière vers la grande place en face de la mosquée. De là, les femmes de la ville lancent des boules de terre aux hommes qui, perchés sur la mosquée, recouvrent cette dernière d’une nouvelle peau de protection pour l’année (figure 29). Chaque personne a ainsi un rôle à jouer dans ce travail « impressionnant, salissant, méticuleux et amusant »98 (Bedaux, 2003), et, de ce fait, dans cette communauté, chacun trouve sa place en contribuant à cet effort collectif.
ii. Islam
Nous avons vu dans la partie symbolisme, que le mythe de la tour de Babel a desservi la construction d’édifices de grande hauteur en terre crue en Occident. Aussi on retrouve une majorité d’édifices religieux musulmans dans notre inventaire des grandes architectures en terre crue (voir annexes). Or, le Coran incite ses fidèles à être généreux avec l’islam, notamment par la sourate LXIV :
98 Bedaux R., Diaby B, Maas Pierre, 2003, L'architecture de Djenné, Mali : la pérennité d'un Patrimoine Mondial, Snoeck-Ducaji & Zoon

« Si vous faites à Dieu un prêt généreux, il vous paiera le double, il vous pardonnera car il est reconnaissant et plein de longanimité »
Sourate LXIV, Coran
On peut ainsi penser que l’islam a favorisé l’émergence d’une culture architecturale en terre crue de grande hauteur dans les pays arabes, alors que a priori la terre n’est pas le matériau le plus favorable pour ce genre de construction. Le fait de croire en l’islam a permis aux peuples de s’unir et de construire la majorité des édifices religieux de grande hauteur en terre crue.
c. S’entraider
Nous allons étudier, dans cette partie, les communautés qui ont construit de grandes architectures en terre crue en s’entraidant. Nous allons analyser le cas de Man’anqiao, village détruit par un séisme et reconstruit par ces habitants. Puis nous étudierons la construction d’une ville éphémère en terre crue lors du festival « la ville des terres », organisé par Bellastock.
i. Man’anqiao
En mai 2008, à la suite d’un tremblement de terre dans la région du Sichuan en Chine, qui causa 70 000 morts, des millions de personnes se retrouvèrent à la rue. Le village de Man’anqiao, traditionnellement construit de maisons en pisé, fut particulièrement touché. Ses habitants, cultivateurs de rizière très modestes (entre 85 et 120 euros de revenu annuel par habitant), n’ont pas pu recourir aux matériaux conventionnels pour reconstruire leur maison. Avec une équipe d’architectes de l’université de Xi’an, les habitants ont rebâti leur village en utilisant la terre locale et la technique du pisé. Quasi oubliées, ces techniques de construction ont dû être réapprises et le village a été reconstruit en trois mois (figure 30). Avec le savoir-faire des professeurs de l’université de Xi’an, la main-d’œuvre locale et en récupérant 90 % des matériaux de construction des décombres du séisme, les coûts ont pu être réduits à 15 euros par mètre carré99
99 Mu Jun, Ng Edward, Zhou Tiegang, Wan Li, 10 April 2012, Back to earth, URL : https://www.domusweb.it/en/architecture/2012/04/10/back-to-earth.html
Chaque année, l’association d’architecture expérimentale Bellastock organise un festival d’architecture éphémère dont le but est de construire son logement pendant les trois jours du festival à partir de matériaux recyclés. Du 13 au 16 juillet 2017, 500 bénévoles ont ainsi construit une ville éphémère en terre crue, afin de sensibiliser les participants (qui sont en majorité des étudiants d’écoles d’architecture) sur le réemploi des « terre excavées produites par les travaux du Grand Paris »100 . 30 000 Blocs de Terre Comprimée (BTC) ont été réalisées grâce à une usine mobile afin de subvenir aux besoins des 100 équipes (de 5 membres) participantes101 . Les bénévoles et les organisateurs ont ainsi formés une communauté, où le savoir-faire a dû être transmis rapidement afin de permettre aux participants de construire une habitation sommaire pour y passer la première nuit. Outre la diversité des styles architecturaux, ce qui frappe en regardant les constructions, c’est la diversité des techniques d’assemblages des briques employées de manière presque instinctive que l’on retrouve dans les constructions en terre (figures 31 et 32).




100 http://www.bellastock.com/actualites/ville-terres-festival-bellastock-2017/

101 Les participants avaient aussi le droit d’utiliser quelques tasseaux de bois et toiles pour leurs constructions.

C. Acteur
« C’est enfin une façon de renforcer ce qui nous lie : celui qui transmet prend conscience qu’il fait partie d’une communauté d’humains. »102
André, 2017
Nous allons maintenant nous intéresser aux acteurs de ces communautés : à ceux qui construisent, à ceux qui planifient ces grands travaux. Nous allons étudier les deux aspects principaux qui forment le socle d’une culture constructive : apprendre et transmettre. Nous analyserons l’apprentissage du métier de maçon à Djenné (qui convoque une part importante de symbolisme allant bien au-delà du simple savoir-faire architectural) et la transmission au Yémen (dans un contexte architectural historiquement riche mais en disparition). Ces deux exemples nous semblent intéressants car tous deux sont confrontés aux espérances qu’offre la modernité, ils proposent des solutions différentes.
a. Apprendre et transmettre à Djenné

« « Boubacar » s’exclame Sékou avec gravité. « Qu’est-ce que tu fais là ? Manifestement tu travailles sans réfléchir ! » Plusieurs des manœuvres qui se tiennent proches se mettent à rire. « Où est le cordeau ? » demande Sékou. « Tu ne peux placer les briques sans utiliser le cordeau ». »103
Anecdote citée dans L'architecture de Djenné, Mali : la pérennité d'un Patrimoine Mondial , p. 29
102 Alvarez Céline, André Christophe, Gueguen Catherine, Kotsou Ilios, 2017, Transmettre - Ce que nous nous apprenons les uns les autres, Paris, Iconoclaste
103 Bedaux R., Diaby B, Maas Pierre, op. cit., p. 29
Ville entièrement construite en terre crue, Djenné a été placée sur la liste du patrimoine mondial104 par l’UNESCO en 1988105.Rogier Bedaux106 définit le système d’apprentissage du métier de maçon107 comme l’une des « deux composantes fondamentales de la réalisation et de la reproduction du patrimoine architectural de la ville et, par extension, de son identité » 108 (Bedaux, 2003)

Or cet apprentissage est éloigné de nos codes occidentaux. Il est basé sur l’échange pendant plusieurs années (quatre ou cinq ans) avec les « maitres maçons », devenant alors « mentors », pendant et en dehors des périodes de chantier. Lors de ces échanges des « secrets, sorts, bénédictions et incantations, ainsi que des revendications identitaires ethniques et historiques » sont inculqués aux jeunes constructeurs 109 (Bedaux, 2003). En effet, Trevor H.J. Marchand110 a déduit de ses recherches auprès des maçons des Djenné que leur « pédagogie n’est pas basée sur le langage, ni prescrite en termes rigidifiés par un organisme officiel. Au contraire, les compétences qualifiées et les pratiques qu’inculque la formation sont enseignées et apprises sous une forme participative organisée « sur le
104 http://whc.unesco.org/fr/list/116/
105 Elle fait aussi partie du patrimoine mondial en péril du « fait de la dégradation de la situation sécuritaire dans la région qui ne permet pas la mise en œuvre des mesures de protection du bien ». Source : https://fr.unesco.org/news/villes-anciennes-djenne-liste-du-patrimoine-mondial-peril-opportuniteprotection-renforcee
106 Spécialiste de l'architecture africaine
107 Avec le regroupement des maçons en association professionnelle, le barey-ton.
108 Bedaux R., Diaby B, Maas Pierre, op. cit
109 Ibid
110 Professeur au département d’anthropologie et de sociologie de l’école des études orientales et africaines de l’université de Londres
« La construction d’édifices de grandes hauteurs en terre crue porteuse, aujourd’hui à Paris, est-elle une utopie ? »
site »» 111 (Marchand 2006). Cette enseignement se poursuit jusqu’à ce qu’un jeune maçon soit reconnu comme « maître » par ses pairs et le public. Cette dernière étape est validée par la constitution de sa propre clientèle. De manière symbolique, sa qualification est reconnue par « le don d’un outil de base, et, finalement, par la transformation de son statut en celui de maçon. » 112 (Bedaux, 2003). Pour le mentor, cette période d’enseignement « provoque une reconnaissance et une réflexion critique sur son rôle, son pouvoir et ses responsabilités dans la reproduction de la profession et du cadre bâti de Djenné. » 113 (Marchand 2006). Ainsi, « ils produisent les générations successives d’agents qualifiés dotés d’une combinaison complexe d’expertise technique, sociale et occulte. » 114 (Bedaux, 2003). Les maçons de Djenné s’inscrivent ainsi dans une lignée de maçons, vieille de six cent ans115. Cet héritage qu’ils acquièrent et qu’ils transmettent, n’est ainsi pas seulement technique et constructif, mais est aussi un agrégat d’histoire, de croyance, de spiritualité, de liens sociaux… de tout ce qui constitue la culture d’une communauté. Cela leur permet ainsi de penser et de construire la ville, entre tradition et innovation. Ils sont à même de « produire et reproduire un environnement bâti qui ait du sens. Un tel environnement bâti comporte à la fois l’architecture et les espaces urbains qui, ensemble, répondent de façon dynamique aux besoins changeants et aux aspirations des habitants, tout en les conditionnant et en restant enracinés dans le dialogue avec l’histoire et avec le lieu. »116 (Marchand 2006).
e. Réapprendre à transmettre
Nous allons maintenant étudier les travaux de Hassan Fathy et de Salma Samar Damluji, qui ont essayé de restaurer les traditions constructives respectivement en Egypte et au Yémen. Le travail de Salma Samar Damluji nous intéresse particulièrement car il concerne directement l’architecture de grande hauteur en terre crue dans la région des maisons-tours l’Hadramaout. Cependant, nous étudierons d’abord le travail de son mentor Hassan Fathy en Egypte, car Damluji Salma Samar travailla pour lui au début de sa carrière d’architecte et il l’a beaucoup inspiré.
111 Marchand Trevor H.J., novembre 2006, Le rôle des maçons et de l'apprentissage dans la pérennité de l'architecture vernaculaire de Djenné, Londres, School of Oriental & African Studies - University of London
112 Bedaux R., Diaby B, Maas Pierre, op. cit
113 Marchand Trevor H.J., op. cit.
114 Bedaux R., Diaby B, Maas Pierre, op. cit.
115 D’après le Ta’rikh el F-Feetach, le grand souverain songhay Askia Mahammed (qui a régné de 1493 à 1528 de notre ère) a recruté de force 500 maçons de Zagha (ou Diaga) après avoir conquis cette ville. (Bedaux, 2003).
116 Marchand Trevor H.J., op. cit.
i. Hassan Fathy, l’exemple de New Gourna
Contrairement à Djenné, où la tradition architecturale a été perpétuée par la « transmission dynamique et attentive, d’une génération à la suivante, de la connaissance basée sur la qualification »117 (Marchand 2006), la ville de Gourna, en Egypte, avait perdu son savoirfaire architectural vernaculaire au profit de constructions modernes au moment où Hassan Fathy décida de construire des logements s’inspirant des traditions constructives ancestrales. 118 Entre 1946 et 1952, il créa New Gourna pour accueillir la communauté de Vieux Gourna, qui vivait au-dessus des tombes dans l’ancien cimetière de Thèbes.119 Il construisit ainsi une ville en terre inspirée des traditions vernaculaires locales en portant attention aux problèmes bioclimatiques. Il se retira petit à petit de ce qu’il considéra comme un échec, car New Gourna fut finalement que peu habitée par les personnes pour qui il l’avait construit à l’origine120. Néanmoins, il se félicita de voir qu’il avait réussi à réinstaurer une culture constructive traditionnelle qui se perpétue :
« En janvier 1961, je suis allé à Gourna. […] Deux choses seulement prospèrent. Ce sont les arbres que j’ai plantés, qui sont maintenant grands et forts, et les quarante-six maçons que nous avons formés et qui travaillent tous dans la région, utilisant le métier qu’ils ont appris à Gourna, preuve de la valeur de notre formation d’artisans locaux. »121
Fathy, 1970, p.302
ii. Damluji Salma Samar, son travail au Yémen
Etudiante à l’Architecture Association de Londres, elle travailla avec Hassan Fathy en 1975-1976 et 1983-1984122. Cette architecte a reçu le prix « Global Award en 2012 » pour ses travaux avec sa fondation « Daw’an Mud Brick Foundation » qui restaure des édifices dans l’ouest de Daw’an, au Yémen. Elle se revendique modestement comme « l’instrument d’une cause qui la dépasse » pour connaître et faire reconnaître la « créativité et le génie de l’architecture » du Yémen123 Elle n’a cessé d‘aller sur le terrain, principalement dans
117 Marchand Trevor H.J., op. cit.
118 Damluji Salma Samar, 2015, Une autre architecture, la géométrie, la terre, le vernaculaire: leçon inaugurale de l'École de Chaillot prononcée le 4 mars 2014 (The other architecture : geometry, earth and the vernacular : inaugural lecture at the Ecole de Chaillot delivered on 4th march 2014), Paris, Ed. Cité de l'architecture et du patrimoine.
119 http://whc.unesco.org/fr/activites/637/
120 Ibid.
121 Fathy Hassan, 1970, Construire avec le peuple : histoire d'un village d'Egypte, Gourna, Paris, La Bibliothèque arabe
122 https://website.aub.edu.lb/fea/publicprofile/Pages/profile.aspx?MemberId=ssdamluji
123 Damluji Salma Samar, op. cit.
la région de l’Hadramaout au Yémen, car c’est un territoire de culture architecturale vernaculaire riche mais en détérioration : « Le phénomène de ces centaines d’immeubles abandonnés de l’Hadramaout est à l’origine de mon envie de travailler sur ces bâtiments et de ramener à la vie ces villes et ces villages»124 (Damluji, 2014). Elle y a observé les édifices et les villages, et elle a dialogué avec les « maitres bâtisseurs », qui sont les véritables détenteurs des savoir-faire constructifs. 125

« Cette connaissance technique était l’apanage de maîtres maçons et d’artisans travaillant à partir des matériaux et des proportions par instinct et, comme le faisait remarquer Fathy : « sans besoin de dessin technique » ». 126
Il ne s’agit pas pour elle d’utiliser les techniques traditionnelles yéménites pour « sauvegarder le passé à tout prix ». Pour elle, « création » et « réhabilitation » appartiennent tous deux au domaine de l’architecture. Son but n’est pas de « sauver le




patrimoine pour lui-même, mais de raviver la matrice culturelle et économique d’une civilisation en danger »127 . Le patrimoine auquel elle fait allusion disparait lentement au profit des constructions modernes, déconnectées des traditions constructives yéménites. Ce « remplacement » entraîne un cercle vicieux car les savoir-faire disparaissent aussi :
« Le problème est que nous avons perdu les maîtres-bâtisseurs qui formaient les plus jeunes. Ceux qui se disent architectes ou artisans aujourd’hui ne savent en fait plus rien de l’architecture vernaculaire ; ils ne connaissent même plus la vraie taille d’une brique en terre crue. Le travail est très mal fait au regard de la précision, des techniques de construction et des savoir-faire d’origine. »128
Damluji, 28 mars 2012
Les maisons-tours du Yémen ont été construites il y a 600 ans, comme la grande mosquée et les premières maisons de la ville de Djenné. Le territoire sur lequel sont construites les maisons-tours est bien plus vaste que la ville de Djenné, et par conséquent le patrimoine architectural en terre crue est beaucoup plus important. Néanmoins, la ville de Djenné continue de perpétuer l’enseignement des constructions traditionnelles tandis qu’au Yémen cet enseignement a quasiment disparu. Il est ainsi intéressant de noter que les techniques seules peuvent se réapprendre rapidement, mais le fait de garder une culture constructive locale, en lien avec le contexte culturel, et ainsi d’installer une transmission de ce savoir est beaucoup plus compliqué. Il faut garder à l’esprit que ce sont les hommes qui bâtissent et qui perpétuent les traditions. Dans le cadre de constructions en terre crue de grande hauteur à Paris, l’implémentation d’une culture constructive contextualisée (à la fois technique et culturelle) devra émerger et son apprentissage et sa transmission devront en être favorisés.
D. Théorie Culture
a. Donner
L’homme est un « animal politique »129 d’après Aristote. C’est-à-dire qu’en vivant parmi les autres hommes, il vit parmi d’autres animaux politiques. Nous avons vu qu’il évolue dans un collectif lui permettant de se protéger des contraintes extérieures, de partager ses
127 Ibid
128 Damluji Salma Samar, 28 mars 2012, l'autre architecture, Entretien dans lecourrierdelarchitecte.com
URL : http://www.lecourrierdelarchitecte.co m/article_2999
129 Aristote, 330 AV JC, Politique
croyances, de lui permettre de construire des choses qu’il ne pourrait pas bâtir seul. Mais ce collectif lui permet aussi d’évoluer à titre personnel, de se situer par rapport aux autres, d’apprendre et de transmettre. Pour le philosophe écossais Alasdair MacIntyre, ce collectif fait même partie de l’individu :
« Dans de nombreuses sociétés traditionnelles, prémodernes, c’est par son appartenance à divers groupes sociaux que l’individu s’identifie et est identifié par les autres. Je suis frère, cousin, et petit-fils, membre de cette maisonnée, de ce village, de cette tribu. Ces caractéristiques ne sont pas accidentelles, on ne peut les ôter pour révéler ‘le vrai moi’. Elles font partie de ma substance, elles définissent au moins en partie et parfois entièrement, mes obligations et mes devoirs. Les individus héritent d’un espace particulier au sein d’un entrelacs de relations sociales; sans cet espace, ils ne sont rien, parias ou étrangers dans le meilleur des cas ».130
McIntyre, 1981
L’homme, est donc un être situé (voir partie « Théorie Nature ») et un animal social131. Néanmoins, le fait d’appartenir à une communauté n’est pas gratuite et l’individu doit apporter à celle-ci. Il doit contribuer à son bon fonctionnement et permettre sa survie. L’anthropologue Marcel Mauss, a étudié de nombreuses civilisations pas encore monétisées Comme il l’a démontré dans son Essai sur le don, paru en 1925, ces communautés fonctionnent sur le don pour organiser les échanges entre les individus d’un même groupe ou entre des individus de différentes communautés :
« La vie matérielle et morale, l’échange, y fonctionne sous une forme désintéressée et obligatoire en même temps. De plus cette obligation s’exprime de façon mythique, imaginaire ou, si l’on veut, symbolique et collective : elle prend l’aspect de l’intérêt attaché aux choses échangées : celles-ci ne sont jamais complètement détachées de leurs échangistes ; la communion et l’alliance qu’elles établissent sont relativement indissolubles. En réalité ce symbole de la vie sociable-la permanence d’influence des choses échangées-ne fait que traduire assez directement la manière dont les sous-groupes de ces sociétés segmentées,
130 MacIntyre Alasdair, 1981 [2013], Après la vertu, Paris, PUF
131 Social ou politique sont les deux synonymes employés par Aristote pour désigner l’homme, dans son livre Politique
de type archaïque, sont constamment imbriqués les uns dans les autres, et sentent qu’ils se doivent tout. »
Marcel Mauss, 1925, p.132132
Néanmoins, « donner »133 (Mauss, 1925) semble être un mot peu approprié, tant le don n’est pas gratuit et exige quelque chose en retour :
« En principe, tout don est toujours accepté et même loué. On doit apprécier à haute voix la nourriture préparée pour vous. Mais en l’acceptant, on sait qu’on s’engage. On reçoit un don « sur le dos ».
Marcel Mauss, 1925, p.155134
Cette relation donneur/receveur régule de fait les statuts sociaux du groupe et plus le « don » est important, plus il révèle les richesses d’un individu et plus il subordonne un individu aux moyens plus limités.
Dans le cas des grandes architectures de terre, nous avons vu que les hommes doivent dépenser des quantités d’énergie bien supérieures à leur propre possibilité en tant qu’individus isolés. La participation des populations à la construction peut aussi être considérée, de manière analogue au façonnage de la brique d’argile (voir partie « Théorie Nature »), comme source d’individuation car « la chose qui circule a gardé en elle la trace des personnes entre lesquelles elle a circulé. Même abandonnée par le donateur, elle est encore quelque chose de lui » 135 (Marcel Mauss, 1925). Ainsi l’architecture bâtie grâce au don des populations garde en elle un fragment de ceux qui l’ont construite. Participer à la construction de la ville, c’est ainsi appartenir à une communauté. C’est accepter ses codes et épouser ses traditions, mais aussi laisser une trace qui dépassera la mort de ceux qui l’ont bâtie. D’ailleurs, ne pas participer à ces efforts collectifs, c’est s’exclure : « l’abstention de quelqu’un était bien mauvais signe, présage et preuve d’envie, de « sort » » 136 (Marcel Mauss, 1925).
Quelle est la part du don aujourd’hui dans nos sociétés occidentales ? La grande majorité des grandes architectures de terre recensée en annexes a été construite avant le 18e siècle.
132 Mauss Marcel, 1925 [2007], Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques, Paris, PUF
133 Donner, définition d’après Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : Céder gratuitement et volontairement la propriété d'une chose
134 Mauss Marcel, op. cit., p. 155
135 Ibid.
136 Ibid
Que valent ces principes de dons dans nos sociétés contemporaines alors que « dans les morales anciennes les plus épicuriennes, c’est le bien et le plaisir qu’on recherche, et non pas la matérielle utilité. Il a fallu la victoire du rationalisme et du mercantilisme pour que soient mises en vigueur, et élevées à la hauteur de principes, les notions de profits et d’individu. On peut presque dater –après Mandeville (Fable des Abeilles) – le triomphe de la notion d’intérêt individuel » 137 (Marcel Mauss, 1925, p. 237). Nous avons vu qu’il est possible de rassembler des groupes pour des projets de construction en terre avec le festival La ville des terres. Mais de manière plus empirique, il semble que l’économie collaborative est en train d’émerger dans nos sociétés contemporaines. Pour l’économiste américain Jeremy Rifkin, c’est d’ailleurs le principal changement économique du monde moderne :
« L'économie des communaux collaboratifs est le premier système global à émerger depuis l'avènement du capitalisme et du socialisme au début du XIXe siècle. »
Rifkin Jeremy, 2014138
Aussi peut-on penser que la construction d’architectures de grande hauteur, à Paris, ne sera pas limitée par un manque de « main-d’œuvre » car les hommes semblent prêts à donner de leur temps, de leur énergie… pour des causes qui bénéficient à leur communauté. Or, face aux défis (écologiques, migratoires, économiques…) qui se présentent à nous, l’architecture de grande hauteur en terre crue peut représenter une solution.
b. Monumentalité
La volonté de marquer de son empreinte un édifice pour montrer son appartenance à une communauté l’est aussi pour laisser un souvenir de soi après sa mort. On se remémore chaque grande civilisation à travers ses bâtiments les plus symboliques. On pense aux pyramides d’Egypte, aux temples romains, au Parthénon… La liste des grandes architectures en terre crue recensée (voir annexes) est de ce type : grande Muraille de Chine, le Potala au Tibet, le Huaca del sol au Pérou… Cette volonté des peuples à vouloir laisser une trace dans l’histoire a été théorisée par l’historien de l'art autrichien Alois Riegl au début du XXe siècle. Dans son livre « Le culte moderne des monuments », il définit le terme monument par « une œuvre créée de la main de l’homme et édifiée dans le but précis de
137 Ibid., p.237
138 Rifkin Jeremy, 18 septembre 2014, Propos recueillis par Olivier Pascal-Moussellard pour Telerama, URL : http://www.telerama.fr/idees/jeremy-rifkin-ce-qui-a-permis-le-succes-inoui-du-capitalisme-va-seretourner -contre- lui, 117006.php
conserver toujours présent et vivant dans la conscience des générations futures le souvenir de telle action ou telle destinée (ou des combinaisons de l’une et de l’autre). » 139 (Riegl, 1903, p.35) Il précise d’ailleurs qu’« aussi longtemps que les hommes ne renonceront pas à l’immortalité terrestre, le culte de la valeur d’ancienneté trouvera ses limites insurmontables dans le culte de la valeur de remémoration intentionnelle » 140 (Riegl, 1903, p.86). Cette volonté de perdurer au-delà de la mort, Vincent Laureau141 l’analyse dans la ville de Dia, au Mali, dont la présence de tombeaux « de nombreux grands savants de la religion musulmane » en fait ville sainte de l’Islam africain142 (Laureau, 2012). Il remarque que « les tombeaux, construits en terre, sont régulièrement entretenus et portent la trace dans l’urbain d’une mémoire active qui participe à la pérennité de ces constructions. Cette empreinte historique de la ville est entretenue par le désir de mémoire de ses habitants, c’est un patrimoine vivant. »143 (Laureau, 2012). Ainsi nous ne voyons pas seulement le monument en lui-même, mais nous percevons, du moins avons conscience, des épreuves auxquelles il a survécu dans le temps, et des soins, s’il y en a eu, qui lui ont été apporté pour le sauvegarder
La taille d’un bâtiment joue un rôle important dans la perception historique que nous nous en faisons. En effet, lorsque nous voyons la Grande Muraille de Chine ou bien les pyramides de terre du Pérou, nous ne nous imaginons pas seulement l’énergie déployée pour construire de tels édifices, mais nous imaginons aussi la difficulté de le faire en ces temps préindustriels. Or si la taille du bâtiment peut être importante, l’échelle « c’est ce qui rapporte la grandeur de l’édifice non seulement à la taille humaine, mais aux réalités du monde sensible. » 144 (Berque, 2000). Ainsi, ces édifices de grande hauteur peuvent perdre leurs qualités d’édifice architectural en voulant être démesurément grande. En effet, d’après l’architecte hollandais Rem Koolhass, dans son essai “Bigness or the Problem of Large” de 1995 : « La grandeur, c’est quand l’architecture devient à la fois le « plus » et le « moins » architectural : le « plus » est dû à l’énormité de l’objet, le « moins » à sa perte
139 Riegl Alois, 1903 [1984], Le culte moderne des monuments: son essence et sa genèse (Der moderne Denkmalkultus, sein Wesen, seine Entstehung), Paris, Seuil
140 Ibid., p.86
141 Architecte et docteur en urbanisme
142 Laureau Vincent, 2012, Patrimoine urbain en terre au Mali : un processus de renouvellement perpétuel, in, FabricA n°6, ENSA-V / LéaV, URL : http://leav. versailles.archi.fr/#/ressources/238
143 Ibid.
144 Berque Augustin, op. cit.
d’autonomie (il devient instrumentalisé par d’autres forces dont il dépend) »145 (Koolhass, 1995). L’architecture de grande hauteur en terre crue, de part nature contextualisée (voir partie « Théorie nature »), doit ainsi faire attention à cette question de taille et d’échelle si elle ne veut pas tomber du côté le moins architectural et ainsi ne plus correspondre au contexte dans lequel elle se trouve (dans notre cas : Paris aujourd’hui).
c. Imaginaire naturel
Alors que nous parlons de développement durable, notre imaginaire se porte depuis la première révolution industrielle vers le progrès technologique comme solution aux maux contemporains. Notre culture moderne invente « un monde dans lequel la représentation des choses par l’intermédiaire du laboratoire est à jamais dissociée de la représentation des citoyens par l’intermédiaire du contrat social » 146 (Latour, 1991, p.17), c’est-à-dire où la Nature et la Culture sont dissociées. Or, pour l’anthropologue et ethnologue français Claude Levi-Strauss, dans son livre Le Regard éloigné de 1983, « nous apprenons […] à mieux aimer et à mieux respecter la nature et les êtres vivants qui la peuplent en comprenant que végétaux et animaux, si humbles soient-ils, ne fournissent pas seulement à l’homme sa subsistance, mais furent aussi, à ses débuts, la source de ses émotions esthétiques les plus intenses, et, dans l’ordre intellectuel et moral, de ses premières et déjà plus profondes spéculations.»147 (Lévi-Strauss, 1983, p. 16). Les sources premières d’inspiration de l’homme furent donc naturelles, mais, à présent, notre vision moderne sépare complètement les hommes des choses qui l’entourent. Or, d’après le philosophe français Gaston Bachelard, l’imaginaire culturelle d’une communauté se forme à partir de son environnement :
« C’est seulement quand on aura étudié les formes en les attribuant à leur juste matière qu’on pourra envisager une doctrine complète de l’imagination humaine. On pourra alors se rendre compte que l’image est une plante qui a besoin de terre et de ciel, de substance et de forme.
[…] Pour qu’une rêverie se poursuive avec assez de constance pour donner une œuvre écrite, pour qu’elle ne soit pas simplement la vacance d’une heure fugitive, il faut qu’elle trouve sa matière, il faut qu’un
145 « Bigness is where architecture becomes both most and least architectural: most because of the enormity of the object; least through the loss of autonomy it becomes an instrument of other forces, it depends. »
Koolhass Rem, 1995, Bigness or the Problem of Large, New York, Monacelli Press
146 Latour Bruno, op. cit., p. 17
147 Lévi-Strauss Claude, 1983, Le Regard éloigné, Paris, Plon
élément matériel lui donne sa propre substance, sa propre règle, sa poétique spécifique. […] Dans la cosmologie du rêve, les éléments matériels restent les éléments fondamentaux. »148
Bachelard, 1942, p.9
L’amélioration des connaissances scientifiques et technologiques, amplifiée par la première révolution industrielle et l’invention de l’acier, du béton armé et autres matériaux industriels à inonder nos villes de matériaux artificiels L’artificialisation de son environnement a donc mis une distance entre la Culture et la Nature. L’implantation d’une architecture aux matériaux naturels, comme la terre crue, en milieu urbain permettrait ainsi à l’homme de reconnecter sa pensée à la Nature et ainsi de se forger un imaginaire naturel, beaucoup plus proche de ses nouvelles problématiques écologiques. Une architecture aux matériaux naturels permettrait ainsi à l’homme de trouver de nouvelles solutions aux défis qui se présentent à lui.
E. Conclusion Culture
L’association des mots « hauteur » et « terre crue » porte en Occident le mythe de la tour de Babel. Néanmoins, les constructions d’édifices de grande hauteur connaissent un intérêt croissant en Europe et à Paris, et, dans le même temps, la terre représente une alternative écologique aux matériaux conventionnels. Ainsi, la construction d’édifices de grande hauteur en terre crue à Paris paraît tout à fait réalisable concernant les symboliques écologiques qu’elle dégage De plus, la région parisienne semble abriter des populations prêtes à « donner » pour que des projets d’intérêt général voient le jour. De plus, la France a acquis depuis plusieurs dizaines d’années un réel savoir scientifique (notamment via le laboratoire CRATerre) prêt à être mis en œuvre, enseigné puis transmis.
La monumentalité des architectures de grande hauteur en terre crue serait un marqueur historique d’une conscience écologique répondant aux besoins actuels (réchauffement climatique, étalement urbain…). La réintroduction de matériaux naturels dans la ville, permettrait aussi à l’homme de se fabriquer une image naturelle de l’avenir, lui permettant de réinventer un monde plus en harmonie avec son environnement. La construction d’édifices de grande hauteur en terre crue à Paris serait ainsi un symbole écologique fort, qui serait en partie solution et terreau d’innovations face aux défis qui nous attendent.
Echelle Macro
NATURE CULTURE
Géographie
Phénomènes géologiques
Environnement naturel
Phénomènes climatologiques
Contexte
Physique
Mur porteur
Echelle Méso
Terre porteuse
Armature
Chaîne de forces
Matériau terre
Symbolisme
Représentation matériau terre
Ecologie de refondation
Développement durable
Mythe
Echelle
Communauté
Vernaculaire
Monument historique
Typologie des bâtiments
Patrimoine
Acteur Don
Echelle Micro
Matière
Comportement mécanique
Typologie des matériaux
Social
Collectivité
Transmission
TRANSFORMATION
Acheminement
Paysage urbain
Paysage politique / habité
Approvisionnement
Réemploi
Construction
Procédé constructif
Tradition / Innovation
Préfabrication
Energie grise
Modernité
Erosion
Soin / Réparation
Anticipation
Nous allons maintenant étudier tout ce qui touche à la transformation de la matière afin de devenir architecture. Nous allons dans un premier temps étudier comment sont acheminées ces quantités de terre et leurs relations aux paysages. Nous aborderons ensuite les travaux du « Grand Paris » et nous nous interrogerons pour savoir s’il est possible d’utiliser les excavations de terre des projets du « Grand Paris » pour construire des édifices de grande hauteur à Paris. Nous étudierons ensuite les procédés de construction et leurs évolutions. Enfin, nous analyserons les effets de l’érosion sur ces grandes architectures de terre crue et s’il existe des moyens d’y remédier
A. Acheminement
« Le paysage, c'est l'endroit où le ciel et la terre se touchent »149
Corajoud, 2010
a. Contexte paysager
En regardant les vues satellites des grandes architectures de terre référencées en annexe (voir figure 36 et 37), on remarque que la grande majorité de ces architectures est inscrite dans un contexte paysagé très organique. La terre est à portée quasi immédiate de la plupart de ces architectures. En effet, les quantités de terre nécessaires sont extrêmement importantes, et, de manière analogue à la construction de ces édifices, l’énergie nécessaire à l’acheminement de la matière terre représente un coût énergétique très important. De plus, la majorité des architectures référencées pour cette étude a été construite avant la première révolution industrielle et le développement des moyens de transport. On remarque aussi que ces architectures ont été majoritairement construites dans des contextes urbains (voir figure 36, 37 et 38). Milieu urbain lui-même généralement construit en terre (Ad-Dir’iyah, aïT-ben-Haddou, Bahla, Bam, Chan Chan, Djenné, Toulous des Hakkas, Ghadamès, Hatra, Itchan Kala, Ma‘Anqiao, MohenJo Daro, Ping Yao, Samarra, Shibam, Tarim).
Palais de Saad Ibn Saud Ad-Dir’iyah,
Citadelle de Bam, Iran
Toulous des Hakkas, Fujian, Chine
Grande Muraille à Jiayuguan, Chine
Mohenjo Daro, Pakistan
Temple de Karnak, Thebes, Egypte
House Rauch, Schlins, Austriche
Kasbah d’Aït-BenHaddou, Maroc
Zone archéologique de Chan Chan, Pérou
Remparts du palais de l’Alhambra, Grenade, Espagne
Palais du Potala, Lhasa, Chine
Muraille de Ping Yao, Chine
Marché central, Koudougou, Burkina Faso
Piscine municipale, Toro, Espagne
Fort Al Jahili Al-Aïn, Emirats Arabes Unis
Ziggourat de Tchogha Zanbil, Iran
Ghadamès, Lybie
Remparts de la Médina de Marrakech, Maroc
Mosquée Al-Mutawakki, Samarra, Iraq
Reconstruction d’un village après séisme, Ma‘Anqiao, Chine
Maison vernaculaire du 21e siècle, Ayerbe, Espagne
Ziggourat d’Ur, Irak Fort de Bahla, Oman
Grande mosquée de Djenné, Mali
Enceintes de la ville d’Hatra, Iraq
Grand Kiz Kala, Merv, Tukmenistan
Maisons tours de Shibam, Yémen
Bureaux de l‘imprimerie Gugler, Pielach, Autriche
Cases Obus, Nord Cameroun
Pyramide de Sésostris II, El-Lahoun, Egypte
Muraille D’Itchan Kala, Ouzbékistan
Huaca del Sol, Moche, Pérou
Mosquée Al-Muhdhar, Tarim, Yemen
Escalier céleste et Cité d’Orion, Plaine de Mahra, Maroc
Ecole des arts visuelles d’Oaxaca, Méxique
Figure 37 : Localisation des « vue satellite des grandes architectures de terre crue » (figure 36).

En rouge les contextes urbains ou péri-urbain, en bleu les contextes isolés.

On peut ainsi en déduire un principe d’« Extraction – Construction » commun à ces architectures, représenté figure 39. Cette règle d’« Extraction – Construction » indique que la terre est extraite dans le but de construire un édifice en terre crue (à proximité de son lieu d’extraction).

Construction
Extraction
Or nous allons voir que le contexte parisien nous oblige à revoir cette règle dans le cadre de constructions de grandes dimensions en terre crue à Paris.
a. Contexte parisien
i. Déblais
Paris est une ville ultra-urbanisée et l’on s’imagine mal trouver une source de terre en quantité suffisante à proximité d’un projet de grande architecture en terre crue. Néanmoins, les travaux opérés en région parisienne excavent une quantité extrêmement importante de

terre. Selon Alexandre Labasse150 « chaque année, plus d’une vingtaine de millions de tonnes sont extraites en Ile-de-France, auxquelles s’ajouteront jusqu’en 2030 une quarantaine de millions de tonnes excavées pour permettre l’aménagement du futur réseau de trains métropolitains. »151 (Labasse, 2016). Selon l’agence d’architecture Joly&Loiret, « en extrapolant les données actuelles, à l’horizon 2030, les volumes cumulés de terres inertes extraites en Île-de-France seraient de l’ordre de 400 millions de tonnes152, un tas gigantesque qui atteindrait presque deux fois la hauteur de la tour Eiffel. L’impact économique estimé à plusieurs milliards d’euros, est aussi préoccupant que l’impact écologique, la filière entassant près de 70% des excavations. »153 (Joly&Loiret, 2016). Ces quantités impressionnantes de déblais posent principalement deux problèmes écologiques :
Leur transport représente l’équivalent de 850 semi-remorques évacuant en moyenne 23 000 tonnes de déblais par jour pendant 15 ans154
Les zones de stockages de ces déblais créent d’immenses dunes de terre, recouvrant de grandes surfaces potentiellement agricoles (voir chapitre suivant).
Figure 40 : équivalences déblais cumulés de terres inertes Cependant, ces excavations présentes l’avantage d’être connues et donc de pouvoir devenir une ressource dont les quantités peuvent être anticipé.
ii. Stockage
D’après l’agence d’architecture Joly&Loiret, « Selon l’article L541-1-1 du Code de l’environnement, les terres excavées prennent le statut de déchet si le détenteur s’en défait ou a l’intention de s’en défaire. Considérées aujourd’hui comme impropres à l’usage selon
150 Architecte et Directeur général du Pavillon de l’arsenal pendant l’exposition Terres de Paris
151 Loiret Paul-Emmanuel, Joly Serge, Anger Romain, Ronsoux Lionel, Gasnier Hugo, 2016, Booklet de l'exposition Terres de Paris, de la matière au matériau, Paris, Éditions du Pavillon de l’Arsenal
152 Selon l’extrapolation des chiffres du Predec (Plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics) : «25 MT/an à l’horizon 2019, 35 MT/an à l’horizon 2026, voire 2030 ».

153 Loiret Paul-Emmanuel, Joly Serge, Anger Romain, Ronsoux Lionel, Gasnier Hugo, op. cit
154 Extrapolation des quantités globales de déchets pendant cette période, basé sur l’extrait du compte rendu de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, Assemblée nationale, 24/03/2015.
les conclusions du Predec (Plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics), elles sont en grande majorité envoyées directement en Isdi (Installations de stockage de déchets inertes).»155 (Joly&Loiret, 2016)
La majorité des lieux de traitement et stockage de ces terres se situent en Ile-de-France. La figure 41 montre les sites intermédiaires (dépollution, lavage, concassage, criblage) et les exutoires finaux (stockages) dans le cadre des travaux du Grand Paris.




155 Loiret Paul-Emmanuel, Joly Serge, Anger Romain, Ronsoux Lionel, Gasnier Hugo, op. cit.
156 Ibid
50 hectares
On remarque sur les figures 42 et 43 l’emprise au sol important (plusieurs dizaines d’hectares) de ces lieux de stockages qui deviennent des lieux impropres à toute autre exploitation. Nous sommes confrontés à un principe d’« Extraction –Stockage » (figure 34).




Extraction
Stockage
iii. Utilisation
Ce principe d’« Extraction –Stockage » est mis à mal par les quantités de déblais toujours plus importantes et la raréfaction des lieux de stockage. Comme le souligne Alexandre Labasse, « la façon dont ces terres seront traitées représente un enjeu financier et écologique considérable, qu’il convient d’analyser au regard des engagements de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Celle-ci impose en effet, à l’horizon 2020, un objectif de 70% de valorisation et de recyclage des déchets du
bâtiment »157 (Labasse, 2016). Alors qu’aujourd’hui, « seuls 20 à 30% de ces déblais ont été retraités pour être recyclés, généralement en produits de sous-couche routière ou de remblaiement divers »158, en 2020, l’objectif serait donc de recycler 70% des terres excavées pour la construction (figure 35).
Or, comme nous l’avons vu dans la partie « Nature », les 5 000 sondages effectués dans les sols parisiens montrent que ces terres extraites peuvent être utilisées pour édifier des bâtiments de grandes dimensions en terre crue. De plus, comme le rappelle Joly&Loiret, on peut aujourd’hui « prévoir en amont le potentiel de ces terres et le calendrier de l’excavation et donc de leurs disponibilités.»159 (Joly&Loiret, 2016). Sachant qu’un logement en terre crue consomme environ 100 tonnes de terres160, on pourrait, avec les 400 millions de tonnes de déblais à l’horizon 2030, potentiellement construire 4 millions de logements en terre crue grâces aux sous-sols franciliens.
157 Ibid

158 Source Predec, état des lieux 2010
159 Loiret Paul-Emmanuel, Joly Serge, Anger Romain, Ronsoux Lionel, Gasnier Hugo, op. cit
160 Anger Romain, Joly Serge, Loiret Paul-Emmanuel, Rauch Martin, 2016, Conférence inaugurale de l'exposition Terres de Paris durée: 81 min. URL : http://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenaltv/conferences/hors-cycle/10509-terres-de-paris.html
B. Construction
« Construire n’est pas un problème. Mais remplir une structure de vie, ça, c’est la vraie question… Certains rêveurs croient qu’il suffit de quatre murs et d’un toit pour changer la réalité. »161
Francis Kéré, 2017
Nous allons maintenant nous intéresser à la transformation de cette terre en tant que matière jusqu’à son édification en tant que bâtiment de grande hauteur en terre crue. Nous étudierons dans un premier temps les transformations de la matière au matériau terre, puis du matériau à l’édifice.
a. De la matière au matériau
i. Un matériau écologique
Alors que la terre est un matériau utilisé depuis des millénaires et sur tous les continents, ce matériau fut oublié dans les pays développés après la Seconde Guerre Mondiale. Selon Manuela Franzen, « c’est seulement avec la révolution industrielle, rendant l’énergie économiquement accessible, que la transformation des matières premières évolue de manière significative. Alors que la révolution industrielle offrait un potentiel d’énergie « inépuisable », donnant lieu à un développement de production et de transformation par la chaleur très important et inconnu auparavant, la société contemporaine est obligée de reconsidérer la disponibilité d’énergie pour ses processus de transformation » 162 (Franzen, 2014). En réduisant son acheminement à de très courtes distances et en ne nécessitant pas de cuisson pour sa transformation, la terre crue se révèle être un matériau à énergie grise faible. En analysant le cycle de vie de ce matériau, et en le comparant aux cycles de vie de l’acier et du béton (voir figure 46), on se rend compte que le matériau terre crue est un matériau réversible, c’est-à-dire à la fois recyclable et renouvelable.
161 Kéré Diébédo Francis, 28 février 2017, Un architecte enraciné URL : http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/02/28/diebedo-francis-kere-un-architecteenracine_5086976_3212.html
162 Franzen Manuela, 2014, La matérialité de l’architecture durable en Europe, Paris, IMQE, FPT, MIQCP, ESA
Cette réversibilité lui permet d’avoir de faibles besoins en quantité d'énergie lors de son cycle de vie comparés aux autres matériaux de construction (incluant la production, l’extraction, la transformation, la fabrication, le transport, la mise en œuvre, l'entretien puis pour finir le recyclage, à l'exception notable de l'utilisation). En somme, c’est l’agence Joly&Loiret qui résume le mieux les qualités écologiques de la terre crue :
« Elle affiche un très faible bilan en carbone164 (environ quatre fois inférieur à celui du béton armé); elle est totalement biodégradable si elle n’est pas stabilisée; elle est saine à 100% et sans COV165; elle est perspirante, régule l’humidité, la température intérieure et possède une forte inertie.»166
163 Chabanne Julien, 2006, Une ossature bois spécifique aux remplissages, Mémoire de Diplôme de Spécialisation et d’Approfondissement - Architecture de Terre, Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble, dir. Patrice Doat
164 100 à 200 kWh par tonne. Source : Thomas Jusselme, Table ronde : Les freins et les leviers de la filière terre dans le bâtiment, Amàco, 2016.
165 Ces composés organiques volatils constituent la principale source de pollution à l’intérieur des édifices. Pour mémoire, on considère aujourd’hui que l’intérieur d’un logement parisien est davantage pollué que les rues alentour, en raison des COV émis par les différents matériaux mis en œuvre (vernis, peintures, plastiques, etc.)
166

ii. Un matériau social
Sans revenir sur le contexte culturel et social développé dans la partie « Culture », nous pouvons néanmoins ajouter une brève partie dans ce chapitre pour signaler que « la terre est surtout valorisante pour les constructeurs »167 (Joly&Loiret, 2016). En effet, la réalisation d’un mur en terre crue demande des connaissances et de la main d’œuvre qualifiée : il faut en moyenne 6 heures et demie de travail pour un mur en pisé, contre 2 heures et demie pour un mur en béton.168 Choisir de construire en terre, c’est valoriser le travail du maçon par rapport aux transformations industrielles effectuées en amont dans le cycle de vie des matériaux industriels.
iii. Un matériau esthétique
En passant de la matière au matériau, la terre devient un élément architectural. Selon Joly&Loiret « elle est belle, douce, chaleureuse, sécurisante et favorise ainsi le bien-être des habitants » 169 . Ressource locale, elle reflète le contexte naturel environnant. Les différentes techniques de construction (il en existe une infinité de variantes) la mettent en valeurs et reflètent le contexte culturel du site. Avec la technique de l’adobe, l’assemblage des briques offre une infinité de possibilités d’ornementation. Avec le pisé, les strates compactées restent visibles, avec une texture riche par son grain et sa couleur. Chaque procédé permet de faire ressortir les dimensions haptiques (qui concernent le sens du toucher) et esthétiques du matériau.
167 Ibid
168 TERA (Association de soutien aux métiers, aux techniques et au patrimoine en terre crue de Rhône-Alpes), Intensité sociale, http://www.tera-terre.org/terre-et-territoires/
169 Joly & Loiret, 2014, Habiter la terre, Réponse au concours Réinventer Paris, Document confidentiel
f. Du matériau à la grande architecture de terre Bien que nous ayons vu un aperçu des nouvelles techniques de construction au chapitre « Nature », nous allons nous intéresser aux procédés constructifs ayant permis de construire les édifices répertoriés comme grandes architectures de terre (voir annexes). La Cartographie des architectures de grande hauteur en terre crue, indicateur procédé (figure 48), nous indique que la grande majorité de ces architectures a été édifiée en utilisant la technique de l’adobe ou du pisé. On remarque aussi que ces deux techniques délimitent des zones géographiques au sein desquelles ces procédés constructifs sont majoritairement utilisés


(figure 49), on remarque aussi que les édifices appartenant aux régions géographiques utilisant principalement la technique de l’adobe ou du pisé n’ont pas été construits à la même période historique. On en déduit que des traditions constructives se sont développées régionalement s’inscrivant sur des périodes de plusieurs siècles.






Il existe une infinité de techniques et de variantes de construction en terre crue, néanmoins douze grandes familles ont été répertoriées dans la « roue des techniques » du Traité de construction en terre crue (voir figure 50). L’adobe et le pisé appartiennent à deux grandes familles qui sont respectivement « mouler » et « comprimer ».


L’adobe est la technique de construction principalement utilisée au Maghreb et au MoyenOrient (voir figure 48) Ce procédé consiste à fabriquer des briques de terre crue façonnées à la main ou moulées, puis séchées pendant quelques jours à l’air libre ou sur des aires

couvertes. Les briques sont ensuite assemblées à l’aide de mortier (voir figure 51). Le mortier de terre doit transférer une partie de son humidité aux briques de terre afin


d’atteindre une consistance suffisamment ferme pour supporter le poids de la maçonnerie, ce qui limite la hauteur des murs pouvant être assemblée par jour171 (entre1,5 et 2,5 m par jour).
En analysant les plans et coupe d’une maison-tour à Shibam (voir figure 52), on remarque que pour obtenir des édifices de grande hauteur, les quantités de matières sont plus importantes en partie basse de l’édifice que dans sa partie haute. On a ainsi des murs plus larges (80 cm) qu’au sommet (30 cm). On trouve aussi beaucoup plus d’ouvertures dans les parties supérieures que dans les parties inférieures.
171 Röhlen Ulrich, Ziegert Christof, op. cit.
172 Gauzin-Müller, Dominique Sémon Pauline, op. cit
Le pisé est la technique de construction principalement utilisée en Europe et en Asie (voir figure 47). La technique du pisé consiste à damer de fines couches de terre pulvérulente174 entre deux banches (voir figure 51). Comme nous l’avons vu dans la partie « Nature », il


173 Damluji Salma Samar, 2007, The architecture of Yemen : from Yafi' to Hadramut, Londre, Laurence King
174 Pulvérulente, définition d’après Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : Qui a la consistance de la poudre, qui est à l'état de poussière ou qui se réduit facilement en poudre ou en poussière.
est nécessaire d’ajouter des couches relativement fines (10-15 cm) afin de pouvoir les compacter. En effet, si les couches sont trop épaisses, la partie inférieure de la couche nouvelle ne subira aucun effort175 Le mélange étant à peine humide, le décoffrage est immédiat.

Le pisé est la technique contemporaine la plus utilisée en Europe (voir figure 48) mais sa grande consommation de main-d’œuvre en fait une technique très peu compétitive en terme de coût, en comparaison avec les matériaux conventionnels comme le béton et l’acier. Pour baisser les coûts de production177, le constructeur autrichien Martin Rauch a conçu une usine de préfabrication de murs en pisé, que nous pouvons voir figure 54 Céramiste de profession, Martin Rauch est aujourd’hui considéré comme l’un des maîtres de la construction en terre crue. Construisant d’abord de petits édifices (maisons, chapelles), c’est en travaillant en collaboration avec des architectes de renom (Herzog & de Meuron, Snohetta, ...) qu’il a dû innover pour pouvoir construire des projets de telles dimensions (non retenus dans les annexes car pas en terre crue porteuse). Ses équipes ont mis au point une machine permettant de coffrer des murs allant jusqu’à 80 m de long (pouvant ensuite être redécoupés selon les besoins et les impératifs liés à son transport). On y voit que la main d’œuvre est réduite aux manutentionnaires et qu’une quantité importante de murs peut être préfabriquée et stockée en attendant leur mise en œuvre. Sur les chantiers, qui durent plusieurs mois (même pour les petits édifices), il reste en revanche des maçons pour assembler ces murs et réaliser les détails (voir figure 55). Selon Martin Rauch, s’il avait construit la maison Schlins (voir annexes) « dans un pays à la main d’œuvre meilleur marché, elle aurait coûté 60% moins chère et aurait pu devenir une sorte de standard » tant les prix des murs en pisé préfabriqués sont proches des matériaux conventionnels.
175 Les efforts auront été redirigés vers les parois
176 Gauzin-Müller, Dominique Sémon Pauline, op. cit.
177 Et échelonner la production sur l’année, et non pas seulement sur les chantiers les mois d’été.
Ces murs en pisé préfabriqués peuvent même être amenés à être plus compétitifs si la terre est recyclée et donc fournie gratuitement à terme. Martin Rauch cherche ainsi à développer la préfabrication des murs en pisé car « si l’on continue de construire comme nous l’avons fait dans les pays industrialisés, il va y avoir une catastrophe écologique, tant les coûts écologiques des constructions ne sont pas pris en compte »178 (Rauch, 2015). Plus généralement, en Allemagne par exemple, la terre crue atteint un niveau de préfabrication industrielle et de qualité équivalent à celui des produits conventionnels (mortiers secs en sacs ou en silos, panneaux de construction et briques de terre, mélanges prêts à l’emploi de terre humide conditionnée…)179.






178 Rauch Martin, op. cit.
179 Röhlen Ulrich, Ziegert Christof, op. cit.
« Un bon chapeau et de bonnes bottes »


Règle de construction en terre crue




Nous allons maintenant aborder la transformation dans le temps du matériau terre après la construction de l’édifice. Dans un premier temps, nous définirons la notion d’érosion et verrons des exemples de ces dégradations. Puis, nous nous intéresserons à l’action de soin et de réparation dont nécessitent les bâtiments en terre crue, au travers de l’exemple de la grande mosquée de Djenné. Nous verrons, enfin, comment on peut anticiper ce phénomène d’érosion à travers le travail du constructeur de bâtiments en pisé, Martin Rauch.


a. Définition & exemples
L’érosion est définie par le centre national des ressources textuelles et lexicales par « action d'un agent, d'une substance qui ronge, use progressivement; résultat de cette action. » Dans le cas de la construction en terre crue, les agents détériorant l’édifice sont le vent et la pluie. Dans les constructions contemporaines, on préconise un soubassement étanche et une toiture à débord pour protéger contre l’humidité.180
Lors de mes recherches pour l’inventaire des grandes architectures de terre, j’ai remarqué que de nombreuses constructions étaient détériorées, notamment celles n’étant pas habitées et ayant généralement une fonction cultuelle. Voici ci-dessous trois exemples de détérioration importantes :
Pyramide de Sésostris II : construite au XX° siècle av. J.-C



Ziggourat de Tchogha Zanbil : construite au XIII° siècle av. J.-C

Grand Kiv Kala : construit au IV° siècle av. J.-C
180 Anger Romain, Fontaine Laetitia, op. cit
Ces images de la dégradation de ces édifices sont frappantes, voire émouvantes quand on sait le travail qu’il a été nécessaire de fournir pour leur construction. Nous montrons ici des édifices pluri-centenaires voire plurimillénaires, donc forcément, les dégradations sont plus visibles.181 L’historien de l'art autrichien, Aloïs Riegl, définit, dans son livre Le Culte moderne des monuments (1903), le « culte de la valeur d’ancienneté » par :
« Le culte de la valeur d’ancienneté s’oppose ainsi directement à la conservation du monument : car, sans aucun doute, le libre jeu des forces naturelles aboutit nécessairement à la destruction totale du monument. La ruine devient de plus en plus pittoresque en fonction du nombre de ses parties atteintes par la dégradation. »

Alois Riegl, 1903, p.69182
Ces dégradations font maintenant partie de ces édifices et la valeur que nous donnons à ces édifices intègre cette érosion. Néanmoins, et bien que nous puissions percevoir une valeur à ces dégradations, nous allons nous intéresser maintenant aux moyens de protéger les édifices afin qu’ils puissent être habités.

181 Nous verrons au prochain chapitre l’exemple de la Grande mosquée de Djenné, qui doit être recrépie chaque année.
182 Riegl Alois, op. cit , p. 69
b. Soin / Réparation
Dû à l’érosion, la grande mosquée de Djenne se dégrade de telle sorte qu’elle doit subir un recrépissage chaque année. La périodicité de cette réparation apportée à la mosquée semble s’accélérer, le recrépissage étant pluriannuel il y a quelques années encore. Comme évoqué dans la partie Culture, ce recrépissage s’apparente à une fête servant à resserrer les liens entre les individus de la communauté.



Comme nous pouvons le voir sur les images ci-dessus (figure 59), l’édifice endommagé est réparé avec de la boue des lacs de la plaine alluviale du Bani, adjacents à Djenné. Le recrépissage est manuel, sans outil, mettant le corps en relation direct avec l’édifice. Cette relation corps-matière, la fête organisé dans toute la ville pour le recrépissage et le fait que l’homme est situé sur un « piédestal » lui permettant de recrépir les parties hautes de la mosquée, sont des facteurs d’« individuation » (Simondon, 1989) similaire à ceux étudiés pour la fabrication de l’édifice (voir chapitre « Nature - Théorie »).



Comme le souligne Anne Ouallet, le reste de la vieille ville, construite en terre également, est soumise à des dégradations nécessitant des réparations : « À Djenné, ville malienne du patrimoine mondial dont l’ensemble de la vieille ville construite en banco est classé, les vulnérabilités sont d’ordres physique, social et environnemental. La vulnérabilité du bâti se voit par la dégradation des murs en banco et la tentation de remplacer ce matériau fragile par de la brique»183 (Ouallet, 2009). Ce recrépissage s’opère donc aussi pour les maisons de la vieille ville de Djenné, elles aussi construites en terre crue. Olivier Scherrer184, constructeur spécialisé en terre, a étudié les coûts d’un recrépissage utilisant les matériaux traditionnels et le revêtement des façades en briques cuites. Il en conclut que pour être économiquement intéressante, la technique de parement en briques cuites devrait avoir une durée de vie sans entretien d’au moins 14 ans.185 L’utilisation d’un crépissage traditionnel permet aussi d’entretenir une tradition de soin et participe à la conservation du paysage architectural de la ville de Djenné.
Ce soin apporté aux habitations en terre nous amène à repenser l’idée même de patrimoine. Alors qu’en occident, le patrimoine se transmet à la nouvelle génération lui permettant d’hériter d’un potentiel capital financier, Vincent Laureau nous explique dans « La ville en terre au Mali » que, dans le cas d’un patrimoine en terre crue au Mali, celui-ci « s’apparente donc à un poids handicapant, car c’est un gouffre financier. Il devient un fardeau dont on hérite, comme on hérite d’une dette […] Cette indifférence avec le patrimoine est particulièrement flagrante aujourd’hui dans les pays émergents, le récent accès à la « modernité » se traduisant par un abandon délibéré des éléments patrimoniaux, parfois même par un rejet. » 186 (Laureau, 2013). C’est cette vulnérabilité physique de la terre qui est pourtant mise en valeur en occident selon Anne Ouallet, car « La notion de patrimoine elle-même renvoie, de manière intrinsèque, à celle de vulnérabilité. En effet, elle a été construite sur l’idée qu’il était nécessaire de réagir à des situations de vulnérabilisation (le plus souvent de bâtis, plus récemment d’éléments immatériels et d’ordre mémoriel) pouvant amener à une très forte dégradation, voire à une disparition. »187 (Ouallet, 2009) Il s’agirait donc de repenser l’idée d’un « patrimoine qui
183 Ouallet Anne, 2009, Vulnérabilités et patrimonialisations dans les villes africaines : de la préservation à la marginalisation, Cybergeo : European Journal of Geography, URL : http://journals.openedition.org/cybergeo/22229 ; DOI : 10.4000/cybergeo.22229
184 Constructeur spécialisé dans le matériau terre
185 http://djenne-patrimoine.org/lejournal.htm
186 Laureau Vincent, 2013, La ville en terre au Mali, Cybergeo : European Journal of Geography, Aménagement, Urbanisme, URL : journals.openedition.org/cybergeo/25907
187 Ouallet Anne, op. cit
se fonde sur un rapport au temps spécifique, attaché à un contexte culturel particulier. Il s’agit alors d’un patrimoine propre à un lieu, à une population, à une culture, à un climat, à des matériaux, etc. » 188 (Laureau, 2013)
c. Anticipation
Le constructeur autrichien Martin Rauch tente de solutionner cette dégradation en anticipant le phénomène d’érosion. Pour des murs en pisé, il insère une pièce en terre cuite en porte à faux de 2 cm tous les 40-60 cm de hauteur (2 ou 3 couches de terre compressée)

Les murs mesurant 40 cm d’épaisseur, cela représente une protubérance de 5% (voir figure 58)
Etape 4
Etape 1
Etape 2
Etape 3
Mais cela permet de limiter le phénomène d’érosion à 2 cm de dégradation dans le temps. Selon les différents essais et construction qu’il a fait, avec ce système, la dégradation est stoppée naturellement au bout de 2 cm.189 La figure 59 montre cette érosion contrôlée grâce au système expliqué plus haut (la seule différence est que dans ce cas la pièce est située à affleurement du mur en pisé).
188 Laureau Vincent, op. cit.
189 Anger Romain, Joly Serge, Loiret Paul-Emmanuel, Rauch Martin, op. cit
Cette technique a notamment été implémentée dans la « House
».
Martin Rauch, elle a aussi vocation d’ornementation et la distance entre les pièces peut varier pour les besoins esthétiques de l’édifice.
D. Théorie transformation
Nous avons vu que la construction de grandes architectures en terre crue impliquait des transformations allant de la grande échelle (le paysage) à l’échelle microscopique (l’érosion de la matière). Nous allons maintenant essayer de comprendre comment ont été


appréhendés ces changements de manière théorique et comment ils influent notre perception sur ces grandes architectures de terre.
a. Paysage urbain
« Le tracé d’une ville est œuvre de temps plutôt que d’architecte »190
Reynaud, 1863, p. 574/575
La construction de ces grandes architectures de terre implique un acheminement important de matière. On a ainsi une action réciproque de l’architecture et du paysage : la géographie influe sur le type d’architecture qui s’est développé dans un contexte donné, les transports de matières modifient le paysage. Or pour John Brinckerhoff Jackson, dans A la découverte du paysage vernaculaire, « Le paysage traduit le genre de vie des hommes»191 car « c’est l’organisation d’un espace qui puisse répondre à des besoins humains. »192 (Jackson, 1961, p.8). Ainsi, pour Jackson, l’homme modèle le paysage sur lequel il habite :
« Du Japon au Midwest américain, mais également partout ailleurs, les hommes se font graveurs, sculpteurs ou modeleurs, ils touchent à peine la terre, ou au contraire la remuent de fond en comble, en fonction des données de la nature, mais également des idéaux spirituels et moraux dont ils sont porteurs. L’apparence du paysage, ses formes et ses contenus, traduisent cette attitude culturelle variable de l’humanité visà-vis des milieux naturels au sein desquels il lui est donné de vivre.» 193 Jackson, 1961, p.10
Pour John Brinckerhoff Jackson, il existe deux sortes de paysages : le « paysage habité », informel, et le « paysage politique », planifié (Jackson, 1961). Pour lui, « Le paysage politique, c’est d’abord le paysage de la grande échelle, qui manifeste les larges vues du pouvoir et s’étend à travers un espace perçu comme homogène et en prise directe sur les régions qu’il contrôle. »194 (Jackson, 1961, p.19).
On pourrait penser que la ville se situe naturellement dans le paysage politique, organisé, hiérarchisé, planifié afin de faire vivre ensemble un grand nombre de personnes entre elles.
190 Reynaud Léonce, 1863, Traité d’architecture - Chapitre 7ème - Villes, Paris, Ed. Dunod URL : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k86632b/
191 Jackson John Brinckerhoff, 1984, [2003], A la découverte du paysage vernaculaire, Arles, Actes sud, ENSAP
192 Ibid., p.8
193 Ibid., p.10
194 Ibid., p.19
En fait la ville semble être, à l’image de l’homme, à la fois « politique » et « habitée », c’est-à-dire un « imprévisible mélange des deux »195 (Jackson, 1961, p.5). En effet, Léonce Reynaud, dans son Traité d’architecture de 1863, analysait que la ville est en fait fabriquée d’un maillage entre l’individu et le collectif, c’est-à-dire entre les aspirations individuelles et les nécessités collectives :
« Que la ville compte une longue suite de siècles ou se soit rapidement développée, peu importe, ce n’est point une seule pensée qui l’a enfantée. Elle résulte des travaux accumulés par un grand nombre d’intelligences, elle est le produit de volontés fort diverses, mais qui concourent harmonieusement; elle est conforme à une loi qui a ses origines et ses motifs à la fois dans les circonstances locales, dans la constitution politique, dans les évolutions du passé et dans les mœurs des habitants. »196
Reynaud, 1863, p. 574/575
L’organisation de la ville n’est donc pas le fruit d’une volonté unique mais, cependant, elle est façonnée par une histoire commune permettant à « ce grand nombre d’intelligence » d’agir de manière harmonieuse. Camillo Sitte, dans L’art de bâtir les villes, explique que cette relation harmonieuse pour construire la ville était due aux respect des règles artistiques en vigueur :
« Si jadis de belles places urbaines et des villes entières ont vu le jour en une lente évolution, sans plan parcellaire, sans concours public et sans effort apparent, nous ne le devons ni au hasard, ni au caprice des individus. Cette évolution n’était pas fortuite, et jamais les bâtisseurs ne se laissaient guider par leur propre fantaisie. Inconsciemment, tous obéissaient au contraire à la tradition artistique de leur temps, et celleci était si sûre que l’entreprise aboutissait toujours au meilleur résultat. »197
Sitte, 1889, p.132/133
195 Ibid., p.5
196 Reynaud Léonce, 1863, Traité d’architecture - Chapitre 7ème - Villes, Paris, Ed. Dunod URL : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k86632b/
197 Sitte Camillo, 1889 [1996], L’art de bâtir les villes, Paris, Ed. Seuil
Ainsi, pour Pascal Sanson, le paysage urbain participe à la « représentation de la ville » et à son inscription « dans une logique de forme » en constituant « une sorte de matrice où l’espace se signifie historiquement et esthétiquement. »198 (Sanson, 2007, p. 9).
Le paysage urbain d’un Paris composé d’architectures de grande hauteur en terre crue devra donc s’inscrire dans cette « matrice » et participer à l’évolution paysagère de la capitale française. De par la densification future possible de la ville de Paris, les qualités écologiques de ces architectures et leur perception par les habitants, les édifices de grande hauteur en terre crue pourraient permettre la transformation du paysage urbain parisien, en associant les données contextuelles (historiques, géographiques, culturelles…) et nécessités actuelles (écologiques, urbanisation de la population, limitation de l’étalement urbain…).
b. Modernité & Tradition
Pour Bruno Latour, le monde occidental a été soumis à une doctrine moderne caractérisée par une double séparation : celle de la « Nature » avec la « Culture » (voir chapitre « Théorie-Nature), et celle du temps présent avec le passé. Pour Bruno Latour, les modernes ont pensé la temporalité comme « l’idée d’un temps qui passerait irréversiblement et qui annulerait derrière soi tout le passé » 199 (Latour, 1991, p.70).
Définissant ainsi l’idée de progrès comme forcement futur car « si nous n’y prenons garde, pensent-ils (les modernes), nous allons revenir au passé, nous allons retomber dans les âges obscurs » 200 (Latour, 1991, p.94) Or ce modernisme semble avoir été l’apanage des occidentaux : « Nous, les Occidentaux , sommes absolument différents des autres » tel est le cri de victoire ou telle est la longue plainte des modernes » 201 (Latour, 1991, p.132).
Cependant, pour Latour, le temps doit être définit autrement :
« Supposons par exemple que nous regroupions les éléments contemporains le long d’une spirale et non plus d’une ligne. Nous avons bien un futur et un passé, mais le futur a la forme d’un cercle en
198 Sanson Pascal (Directeur de la publication), 2007, Le Paysage Urbain. Représentations, Significations, Communisation, Paris, L’Harmattan
199 Latour Bruno, op. cit., p. 70
200 Ibid., p.94
201 Ibid., p.132

expansion dans toutes les directions et le passé n’est pas dépassé mais repris, répété, entouré, protégé, recombiné, réinterprété et refait. […]
Dans un tel cadre, nos actions sont reconnues enfin comme polytemporelles. » 202
Latour, 1991, p.102
Si nos actions sont « polytemporelles », alors elles trouvent un écho dans le passé et en trouveront dans le futur. Quand on prend conscience des différents cycles qui nous entourent et nous influencent à la grande échelle (la terre qui tourne autour du soleil, la terre qui tourne autour d’elle-même, le cycle des glaciations, rythme nycthéméral…), à l’échelle humaine (cycles hormonaux, cycle circadiens, cycles alimentaires…) ou à l’échelle microscopique (division des cellules, …), on se rend compte du caractère rythmique et cyclique du temps.
Cette « polytemporalité » doit être vue comme une continuité par l’architecte Aldo Van Eyck où « passé, présent et avenir doivent jouer à l’intérieur de l’esprit et former un continuum. Sans cette continuité, les artefacts que nous produisons ne sauront se rattacher (trouver une perspective). »203 (Van Eyck, 1972, p.91). Pour Damluji Salma Samar, il faut se servir de ces liens entre les époques pour créer des architectures pouvant perdurer :

« En vérité, les trois éléments dont nous débattons –le passé, le présent, le futur- sont inséparables et les frontières qui les délimitent sont intangibles : la preuve en est dans la présence de cités, de tissus urbains et d’environnements durables et intemporels. […] Je crois que nous, les
202 Ibid., p.102
203 Van Eyck Aldo, 1972, L’intérieur du temps, Le sens de la ville, Paris, Seuil.
architectes, avons besoin de l’histoire et du passé. Nous devons travailler à partir du passé, en tirer des enseignements, l’analyser et le comprendre pour mieux œuvrer pour le futur. » 204
Damluji, 2014
En restaurant les maisons-tours multi centenaires de Shibam, Damluji Salma Samar analyse aussi que « les constructions sur lesquelles je (elle) travaille doivent être préservées pour l’avenir parce qu’elles sont, à certains égards, beaucoup plus avancées que tout ce qui se fait aujourd’hui »205 (Damluji, 2014). Le temps n’est donc pas forcément synonyme d’amélioration. Les liens polytemporels permettent de sélectionner les meilleures solutions quelle que soit leur époque d’origine. C’est le temps qui permet de dire si une innovation améliore une tradition ou non. Pour Hassan Fathy, le but d’une innovation serait même de devenir une tradition. En effet, cela signifierait que cette innovation a permis d’apporter un avantage significatif dans le temps :
« La tradition n’est pas forcément désuète et synonyme d’immobilisme. De plus, la tradition n’est pas obligatoirement ancienne, mais peut très bien s’être constituée récemment. Chaque fois qu’un ouvrier rencontre une nouvelle difficulté et trouve le moyen de la surmonter, il fait le premier pas vers l’établissement d’une tradition. » 206
Fathy, 1970
Dans le cas de la construction en terre crue de nombreuses innovations se sont succédées depuis des millénaires. Ces innovations ont à chaque fois répondu à des problématiques spécifiques liées à différents contextes, donnant, par exemple, naissance à une infinité de techniques de constructions (voir chapitre « Transformation - Construction »). Dans sa description de la ville d’Ur, Aldo Van Eyck rappelle à quel point l’expérience de l’environnement reste quasi immuable207 ce qui permet, selon lui, de réduire ces dissonances entre temps et innovations :
204 Damluji Salma Samar, op. cit.
205 Ibid
206 Fathy Hassan, op. cit.
207 « Les choses ne devaient pas être si déférentes à Ur, il y a cinq mille ans de cela : même briques laborieusement fabriquées à partir de boue sableuse, même soleil pour durcir à peine avant de les désintégrer impitoyablement ; mêmes espaces distribués autour des mêmes cours ; même bâtiments clos : même passage brutal de l’ombre à la lumière, même fraicheur après la chaleur ; même nuits étoilées ; mêmes frayeurs peutêtre ; même sommeil » Van Eyck Aldo, 1972, « Un miracle de modération », Le sens de la ville, Paris, Seuil.
« Si l’on comprend que l’expérience de l’environnement faite au cours du passé conserve sa valeur dans le présent (qu’elle demeure toujours contemporaine), les oppositions insurmontables s’atténueront entre passé, présent et avenir, entre anciennes et nouvelles conceptions de l’espace, de la forme, et de la construction, entre production manuelle et production industrielle. »208
Van Eyck, 1972, p.93
E. Conclusion Transformation
Nous avons déjà vu que la terre des sols de Paris est utilisable pour construire des édifices de grande hauteur (voir chapitre « Nature »). Nous apprenons aussi, que cette terre est disponible grâce aux excavations des travaux en région parisienne. Cette terre, dont les terrains de stockage commencent à manquer, sera aussi disponible en quantité pouvant être planifiée pendant quinze ans grâce aux travaux du « Grand Paris ». Cette matière terre se transforme en matériau terre crue avec une quantité d’énergie nécessaire à cette transformation beaucoup plus faible que les autres matériaux conventionnels, car il n’y a pas besoin de la cuire. Non stabilisée, cette terre est totalement biodégradable en fin de vie.
La mise en œuvre de ce matériau est aussi en constante évolution, les innovations répondant à des besoins locaux. A Paris, l’installation d’une unité de fabrication fonctionnelle à Sevran prévue pour 2019209 participe à cette évolution des procédés de construction pour répondre aux besoins franciliens.
La construction de ce type d’architecture induira aussi des changements dans le paysage urbain parisien. Ces modifications devront intervenir en respectant la ville déjà présente, son histoire et sa culture. Les transformations des procédés constructifs aideront à la réalisation de ce paysage et pourront initier une tradition constructive propre aux architectures de grande hauteur en terre crue à Paris. Cette ville, est tant visitée et aimée pour son patrimoine architectural, que c’est pour cette raison que son architecture doit évoluer et être aux avant-gardes des questions environnementales, afin d’être l’une des villes symbole face aux problèmes écologiques.
208 Van Eyck Aldo, 1972, « L’intérieur du temps », Le sens de la ville, Paris, Seuil.
209 Joly&Loiret, 10 octobre 2017, Communiqué de presse URL : http://jolyloiret.com/wp-content/uploads /2017/10/JL_20171010_CYCLETERRE_COM_CP.pdf
A. SYNTHESE
Bien que peu favorable, si l’on considère les techniques traditionnelles de construction en terre crue, le climat parisien est tout à fait capable de permettre la construction de ces édifices, surtout que la méthode de préfabrication en atelier semble prendre de l’ampleur en Europe et en région parisienne. Les nouvelles connaissances de la matière terre et sa nouvelle définition en béton d’argile favorisent les transferts de technologies et de connaissances depuis les bétons de ciment utilisés conventionnellement aujourd’hui. De plus, la terre des sols de Paris a été testée et est totalement apte à la construction en terre crue.
Oubliée pendant la première moitié du XXe siècle, la construction en terre, en France, possède, aujourd’hui, un solide savoir-faire théorique avec notamment le laboratoire de recherche CRATerre et le Diplôme Supérieur d’Architecture sur les constructions en terre de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble. On voit aussi émerger une filière terre crue permettant, par exemple, la construction future de « Manufacture-surSeine », projet de logements en terre crue ayant remporté l’un des concours « Réinventer la Seine ». Les vertus écologiques de la terre et sa grande nécessité de main d’œuvre en font un matériau bien perçu par la population Cependant, ce matériau reste peu connu en France, et on ne sait pas si les habitants potentiels oseront sauter le pas et habiter dans un logement si peu conventionnel.
Cette terre aussi, est disponible en grande quantité grâce aux travaux en région parisienne. Les travaux du Grand Paris permettent, par exemple, de prévoir les quantités de terre disponibles pendant 15 ans. Les techniques traditionnelles de construction en terre crue permettent déjà, comme à Shibam, de construire des maisons-tours de trente mètres de haut. On peut donc penser que la faisabilité technique et constructive d’édifices de grande hauteur en terre crue va s’améliorer compte tenu des avancées scientifiques sur la matière terre. Il existe, par exemple, déjà de nombreux essais pour parvenir à construire avec une terre « coulée » similairement à un béton de ciment. Comme nous l’avons vu, l’érosion peut être anticipée. Le problème majeur des constructions en terre restant surtout la gestion du contact de la terre avec l’eau210 (Anger, 2015).
La construction d’édifices de grande hauteur en terre crue permettrait aussi de créer des symboles écologiques forts dans Paris. Ces derniers participeraient au renouvellement du
paysage urbain parisien Leurs constructions pourraient être, en partie, confiées à une communauté prête à « donner » pour l’intérêt général. Par la « puissance » collective nécessaire à leurs édifications, ces architectures permettraient à ces communautés de « s’individuer » (Simondon, 1989). Il serait alors possible de voir émerger une réelle tradition constructive spécifique à ce type d’architecture dans le contexte parisien. Cette renaturalisation de l’environnement parisien aiderait ses habitants à se reconnecter en partie à la Nature, et ainsi à imaginer des solutions plus harmonieuses face aux défis écologiques qui nous attendent
L’optimisme reste néanmoins de mise quant à la possibilité de voir éclore un édifice en terre crue porteuse, tant la mixité structurelle semble avoir la préférence des constructions contemporaines en terre crue de grande dimension. Néanmoins, validant à chaque fois les questionnements menés durant la rédaction de ce mémoire, la construction d’édifices de grande hauteur en terre crue porteuse à Paris est donc réalisable.
B. RETROSPECTIONS
Alors que j’ai eu l’idée d’écrire ce mémoire après avoir vu le projet de tour en terre dans le cadre du concours « réinventer Paris », je me suis vite rendu compte que cette tour était en structure béton et seulement en terre crue de parement Moi qui pensais m’appuyer sur ce projet pour écrire mon mémoire, j’ai dû repenser les champs de mes recherches afin de m’intéresser à la possibilité de construire ce type de bâtiment en terre crue porteuse. Parce qu’il n’y a pas d’architecture contemporaine de grande hauteur (supérieure à 30 mètres) en terre crue, j’ai donc chercher des exemples d’édifices en terre crue de grandes dimensions sur lesquelles je pouvais appuyer mes propos. Ces recherches m’ont permis de me créer un ensemble de champs de recherches, que j’ai ensuite classé afin d’organiser mon étude. En écrivant chaque partie, dont il me semblait que chacune d’elles aurait mérité l’écriture d’un mémoire, je me suis rendu compte qu’il n’y avait pas d’obstacle majeur à la construction de ce type d’édifices aujourd’hui à Paris. Lors de la conférence « Terres de Paris », Paul Emmanuel Loiret décrit la période actuelle à Paris comme une période « d’alignements des planètes »211 (Loiret, 2016) tant les possibles difficultés pour ce type d’édifice n’ont jamais été aussi réduites. La question n’est plus de se demander si la construction d’édifices de grande hauteur en terre crue porteuse, aujourd’hui à Paris, est une utopie mais peut-être de se demander pourquoi n’a-t-on encore jamais construit ce type d’édifice dans le monde ?
Alors que de plus en plus « d’Appréciations Techniques d'Expérimentation » (ATEx) sur la construction en terre sont validées, je n’ai d’ailleurs pas développé, dans ce mémoire, la question de la législation, contraignant la construction en terre en France. Il me semble, en effet, que la loi vient toujours réglementer un fait nouveau, et a donc, forcément, toujours un temps de retard sur l’innovation. Prendre en compte la législation dans ce mémoire pour déterminer si l’on peut construire ce type d’édifice aujourd’hui à Paris, aurait été, je pense, prendre le problème à l’envers. Si l’on montre que ce type de construction est possible, alors la règlementation changera.
De la même manière, je n’ai pas pris parti pour la construction d’édifice de grande hauteur Je voulais me concentrer sur la possibilité de les construire ou non, laissant au lecteur sa propre opinion sur les raisons de le bâtir, leurs bienfaits ou leurs méfaits.
J’ai aussi décidé de mettre de côté la possibilité de mixité structurelle. Même si les références contemporaines utilisent beaucoup le principe d’une structure en matériau conventionnel et d’un parement en terre, cette approche, dans le cadre de ce mémoire, m’aurait paru quelque peu hors sujet. En effet, j’ai essayé de m’attacher au côté novateur de la construction de ce type d’édifices et terre crue porteuse.
En étudiant les avancées scientifiques sur le matériau terre, j’ai été amené à étudier des recherches en biomimétisme. Il existe quelques études scientifiques sur les capacités des termites à construire des termitières en terre de plusieurs mètres de haut. Si l’on rapporte un termite à notre échelle, c’est-à-dire si on l’agrandit 500 fois, il serait capable de bâtir des termitières de 3 kilomètres de haut, quand les plus grandes constructions humaines habitées en terre crue font 30 mètres de hauteur (voir figure 65).
30 mè tres
Malheureusement ces recherches sur les termites concernaient en très grande majorité leur aptitude à bâtir des termitières capables de maintenir des températures constamment fraîches en toutes saisons à l’intérieur, alors que la température extérieure dépassait souvent les 40°C. On peut ainsi se demander si les futures études en biomimétisme au sens large, et pas seulement sur les termites, vont nous permettre de construire beaucoup plus haut de manière naturelle en terre crue. Aussi, si des insectes n’ayant pas nos capacités techniques arrivent à construire aussi haut par rapport à leur taille, pourquoi ne l’avons-nous pas encore fait ?
C. PERSPECTIVES PERSONNELLES
« Beyond index » 212




Janvier 2014, cela fait maintenant quatre ans que je travaille en Chine. Depuis plusieurs jours, caché derrière un épais brouillard de pollution, je ne peux voir le bâtiment en face de ma fenêtre. Je vérifie chaque jour le taux de particules fines dans l’air de Pékin sur le site de l’ambassade américaine, la seule à donner les vraies valeurs de pollution. Sur une échelle allant de 0 à 1000, le taux de particules fines affiche « Beyond index » pour le 8e

jour d’affilé. C’est-à-dire que le taux est supérieur à 1000 µg/m3, alors que les recommandations de l’OMS213 indiquent de ne pas dépasser 25 µg/m3 plus de 3 jours par an. Alors ingénieur dans l’industrie automobile, ce « Beyond index » là me pousse à quitter la Chine et reprendre mes études afin de travailler (enfin) sur des projets à taille humaine et écologiques. Je tente alors le concours d’entrée à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble. Neuf mois plus tard, en septembre 2016, au sortir de ma première journée de cours d’architecture, je suis amené à suivre une conférence d’un architecte chinois (décidément…) dans l’amphithéâtre de l’école. La salle est bondée. Jean Dethier214, maître de cérémonie, nous présente l’architecte Wang Shu215 nous parler de ses constructions à Hangzhou, près de Shanghai. C’est la première fois que j’entends parler d’architecture de terre
En écrivant ces dernières lignes et en regardant mon parcours, avoir fait un mémoire sur l’architecture de terre me paraît aujourd’hui une évidence : j’ai suivi pendant un an les cours de M. Loiret à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble, puis j’ai intégré le séminaire « Technologies nouvelles pour l'architecture, l'urbanisme et l'environnement » où j’ai eu comme directeur de mémoire M. Vincent Laureau, qui avait fait un doctorat sur l’architecture de terre au Mali.
La découverte de ce type d’architecture, aussi répandu dans le monde et pourtant aussi peu connu en France aujourd’hui (je notais d’ailleurs avec amusement les réactions de mes proches à l’énoncé de mon sujet de mémoire) m’a énormément intéressé Aussi j’aimerais approfondir cette découverte par des visites d’édifices et, si possible, participer à des chantiers.
De manière similaire aux études d’architecture à proprement parlé, l’écriture de ce mémoire m’a permis d’étudier des champs de connaissances très divers, alimentant par ce biais mes réflexions personnelles. Plus encore que l’architecture de terre et la grande hauteur, j’ai donc aimé le processus scientifique et philosophique émanant de la rédaction de ce manuscrit. De plus, ces quelques mois de recherche, sur un sujet aussi vaste, laissent un goût d’inachevé, mes recherches amenant d’autres questionnements entraînant d’autres
213 Organisation mondiale de la Santé
214 Architecte belge, conçoit et réalise des expositions sur l'architecture, l'habitat et la ville au Centre Pompidou depuis 1975, et notamment l’exposition Architectures de terre : ou l’avenir d’une tradition millénaire du 28 octobre 1981 au 1er février 1982.
215 Architecte chinois, prix Pritzker 2012, qui travaille avec le matériau terre, notamment lors de la construction de la WaShan Guesthouse en Chine en 2008
recherches dans un processus itératif sans fin. Aussi, j’aimerais sûrement après quelques années d’exercice du métier d’architecte, entrer dans un cycle doctoral.
En faisant mes recherches, j’ai aussi été émerveillé par le nombre de projets, d’architectes, de constructeurs, de bénévoles qui veulent changer les choses. Alors que la vie quotidienne nous amène parfois à être fatigué, déprimé, découragé, enragé… le fait d’avoir bercé pendant ces six mois dans ce mouvement optimiste et positif fut une réelle motivation, me rappelant fièrement pourquoi j’ai décidé de faire ce métier.
BIBLIOGRAPHIE
Pierre Vialle-Millereau « La construction d’édifices de grandes hauteurs en terre crue porteuse, aujourd’hui à Paris, est-elle une utopie ? »
D’Aboville Gwenaëlle, 13 mars 2015, Les Parisiens opposés à la grande hauteur ? - Retour sur la concertation autour du projet de la tour triangle, Le Figaro, URL : http://www.metropolitiques.eu/Les-Parisiens-opposes-a-la-grande.html#nb1
Alvarez Céline, André Christophe, Gueguen Catherine, Kotsou Ilios, 2017, TransmettreCe que nous nous apprenons les uns les autres, Paris, Iconoclaste
Amàco, 2016, Construire en terre crue, série de vidéos, URL : https://www.youtube.com /watch?v=1K99mrBlV04
Anger Romain, Joly Serge, Loiret Paul-Emmanuel, Rauch Martin, 2016, Conférence inaugurale de l'exposition Terres de Paris durée: 81 min. URL : http://www.pavillonarsenal.com/fr/arsenal-tv/conferences/hors-cycle/10509-terres-de-paris.html
Anger Romain, 2015, Conférence La Terre et les fibres végétales : matériaux de construction du futur, durée: 88 min. URL : https://www.youtube.com/watch?v= WJIJb625_O4&t=1916s
Anger Romain, Fontaine Laetitia, 2009, Bâtir en terre : du grain de sable à l'architecture, Paris, Belin
Anger Romain, 2011, Approche granulaire et colloïdale du matériau terre pour la construction, Thèse pour obtenir le grade de docteur, École Doctorale Matériaux de Lyon (EDML), dir. Hugo Houben / Christian Olagnon
Appert Manuel, 12 septembre 2011, Politique du skyline. Shard et le débat sur les tours à Londres, Le Figaro, URL : http://www.metropolitiques.eu/Politique-du-skyline-Shard-etle.html
Appert Manuel, 16 décembre 2015, Le retour des tours dans les villes européennes, Le Figaro, URL : http://www.metropolitiques.eu/Le-retour-des-tours-dans-les.html
Arendt Hannah, 1958, Condition de l’homme moderne, Paris, Calman- Levy
BBC : Human Planet, 2011, Mali mud mosque, durée: 4 min. URL : https://www.youtube.com/watch?v=3SI5NdNEosE
Bedaux R., Diaby B, Maas Pierre, 2003, L'architecture de Djenné, Mali : la pérennité d'un Patrimoine Mondial, Snoeck-Ducaji & Zoon
Bachelard Gaston, 1942, L’eau et les rêves. Essai sur l’imagination de la matière, Paris, Ed. José Corti
Benoit Guillaume, 16 juin 2009, Les volumes de la ville - Le complexe de la tour, Le Figaro, URL : http://evene.lefigaro.fr/lieux/actualite/tours-immeubles-gratte-ciel-hauteur-taille2070.php
Berque Augustin, 2000, Ecoumène : introduction à l'étude des milieux humains, Paris, Belin
Chabanne Julien, 2006, Une ossature bois spécifique aux remplissages, Mémoire de Diplôme de Spécialisation et d’Approfondissement - Architecture de Terre, Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble, dir. Patrice Doat
Corajoud Michel, 2010, Le paysage, c'est l'endroit où le ciel et la terre se touchent, Paris, Actes Sud Nature
CRAterre-ENSAG, Fontaine Laetitia, Anger Romain, 2011, Rapport d’activité Grains de Bâtisseurs 2004 ‐2010, Grenoble, CRAterre
Damluji Salma Samar, 2007, The architecture of Yemen: from Yafi' to Hadramut, Londre, Laurence King
Damluji Salma Samar, 28 mars 2012, L'autre architecture, Entretien dans lecourrierdelarchitecte.com URL : http://www.lecourrierdelarchitecte.com/article_2999
Damluji Salma Samar, 2015, Une autre architecture, la géométrie, la terre, le vernaculaire: leçon inaugurale de l'École de Chaillot prononcée le 4 mars 2014 (The other architecture : geometry, earth and the vernacular : inaugural lecture at the Ecole de Chaillot delivered on 4th march 2014), Paris, Ed. Cité de l'architecture et du patrimoine
Doat, Patrice, Hays, Alain, Matuk, Silvia, Vitoux, Francois, Houben, Hugo, Auteur, 1983, Construire en terre, Paris, Éd. Alternatives
Fathy Hassan, 1970, Construire avec le peuple : histoire d'un village d'Egypte, Gourna, Paris, La Bibliothèque arabe
Farocki Harun, 2009, In Comparison, format: 16mm, durée: 61 min. URL : https://www.youtube.com/watch?v=-TvLdK_srHk
Franzen Manuela, 2014, La matérialité de l’architecture durable en Europe, Paris, IMQE, CNFPT, MIQCP, ESA
Gauzin-Müller Dominique, 2016, Architecture en terre d’aujourd’hui: les techniques de la terre crue, Paris, Museo
Gauzin-Müller, Dominique Sémon Pauline, 2016, Architecture en terre d’aujourd'hui - Les techniques de la terre crue, TERRA Award
Heidegger Martin, 1949 [1962], Chemins qui ne mènent nulle part, Paris Gallimard
Houben Hugo, Guillaud Hubert, Dayre Michel, Centre de recherche et d'application pour la construction en terre, 1995, Traité de construction en terre, Marseille, Éd. Parenthèses
Huriot Jean-Marie, 24 octobre 2011, Les tours du pouvoir, Métropolitiques. URL : https://www.metropolitiques.eu/Les-tours-du-pouvoir.html
Jackson John Brinckerhoff, 1984, [2003], A la découverte du paysage vernaculaire, Arles, Actes sud, ENSAP
Kéré Diébédo Francis, 28 février 2017, Un architecte enraciné URL : http://www. lemonde.fr/afrique/article/2017/02/28/diebedo-francis-kere-un-architecteenracine_5086976_3212.html
Koolhass Rem, 1995, Bigness or the Problem of Large, New York, Monacelli Press
Latour Bruno, 1991, Nous n’avons jamais été modernes, Essai d’anthropologie symétrique, Paris, La découverte
Latour Bruno, Nov. –Décembre 2005, En tapotant sur Rem Koolhaas avec un bâton d’aveugle, Architecture d’aujourd’hui, n°361 pp. 70 -79
Loubes Jean-Paul, 2010, Traité d'architecture sauvage : manifeste pour une architecture située, Paris, Le Sextant
Laureau Vincent, 2014, La ville et la terre, apprendre de Bamako. Le cas de Bozobuguni, un quartier autoconstruit, Thèse pour obtenir le grade de docteur, Université paris ouest Nanterre la Défense, dir. Philippe Gervais-Lambony / Philippe Potié
Laureau Vincent, 2013, La ville en terre au Mali, Cybergeo : European Journal of Geography, Aménagement, Urbanisme, URL : journals.openedition.org/cybergeo/25907
Laureau Vincent, 2012, Patrimoine urbain en terre au Mali : un processus de renouvellement perpétuel, in, FabricA n°6, ENSA-V / LéaV, URL : http://leav. versailles.archi.fr/#/ressources/238
Loiret Paul-Emmanuel, Joly Serge, Anger Romain, Ronsoux Lionel, Gasnier Hugo, 2016, Booklet de l'exposition Terres de Paris, de la matière au matériau, Paris, Éditions du Pavillon de l’Arsenal
Lévi-Strauss Claude, 1983, Le Regard éloigné, Paris, Plon
Marchand Trevor H.J., novembre 2006, Le rôle des maçons et de l'apprentissage dans la pérennité de l'architecture vernaculaire de Djenné, Londres, School of Oriental & African Studies - University of London
Mauss Marcel, 1925 [2007], Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques, Paris, PUF
MacIntyre Alasdair, 1981 [2013], Après la vertu, Paris, PUF
Mu Jun, Ng Edward, Zhou Tiegang, Wan Li, 10 April 2012, Back to earth, URL: https://www.domusweb.it/en/architecture/2012/04/10/back-to-earth.html
Ouallet Anne, 2009, Vulnérabilités et patrimonialisations dans les villes africaines : de la préservation à la marginalisation, Cybergeo : European Journal of Geography, URL : http://journals.openedition.org/cybergeo/22229 ; DOI : 10.4000/cybergeo.22229
Prussin Labelle, 1970, Sudanese Architecture and the Manding - African Arts - volume 3, Los Angeles, University of California - James S. Coleman African Studies Center
Rauch Martin, 2015, Refined earth construction & design with rammed earth, Munich, Ed. DETAIL.
Reynaud Léonce, 1863, Traité d’architecture - Chapitre 7ème - Villes, Paris, Ed. Dunod URL : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k86632b/
Riegl Alois, 1903 [1984], Le culte moderne des monuments: son essence et sa genèse (Der moderne Denkmalkultus, sein Wesen, seine Entstehung), Paris, Seuil
Rifkin Jeremy, 18 septembre 2014, Propos recueillis par Olivier Pascal-Moussellard pour Telerama, URL : http://www.telerama.fr/idees/jeremy-rifkin-ce-qui-a-permis-le-succesinoui-du-capitalisme-va-se-retourner-contre-lui,117006.php
Röhlen Ulrich, Ziegert Christof, 2013, Construire en terre crue: construction, rénovation, finitions, Paris, Le Moniteur
Sanson Pascal (Directeur de la publication), 2007, Le Paysage Urbain. Représentations, Significations, Communisation, Paris, L’Harmattan
Simondon Gilbert, 1989, [2005], L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information, Grenoble, Jérôme Million
Sitte Camillo, 1889 [1996], L’art de bâtir les villes, Paris, Ed. Seuil
Van Eyck Aldo, 1972, L’intérieur du temps, Le sens de la ville, Paris, Seuil.
Anger Romain, Doat Patrice, Fontaine Laetitia, Houben Hugo, Jorand Yves, Olagnon Christian, Van Damme Henri, 2008, La terre, un béton comme les autres ? Quelques mécanismes de stabilisation du matériau terre, Terra 2008 - 10ème Conférence Internationale sur l'Étude et la Conservation du Patrimoine Bâti en Terre, Edité par Rainer
Leslie, Rivera Angelyn Bass et Gandreau David, Bamako, Mali URL : https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/terra_20 08.pdf
Vatandoust Rasool, Mokhtari Eskandar, Nejati Mahmoud, 2008, Consolidation and Reinforcement of Destabilized Earthen Structures in Bam after the Earthquake of December 2003: Some New Approaches, Terra 2008 - 10ème Conférence Internationale sur l'Étude et la Conservation du Patrimoine Bâti en Terre, Edité par Rainer Leslie, Rivera
Angelyn Bass et Gandreau David, Bamako, Mali URL : https://www.getty.edu /conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/terra_2008.pdf
White Kenneth, 1996, Du Palais des Doges à une isba en Sibérie, Bordeaux, ENSA Bordeaux
TABLE DES ANNEXES
NATURE
K AS b AH D ’Aï T- bEN -H ADDOU
Localisation : Aït-Ben-Haddou, Maroc, Maghreb
Climat : Méditérranéen
Risque sismique : Risque bas
Hauteur : 13m
Longeur : 12,6m
Largeur : 13,5m
Epaisseur murs base : 62cm
Epaisseur murs sommet : 32cm
CULTURE
Date de construction : XI° - XXI° siècle
Type : Habitat
Maîtrise d’ouvrage : Individuel
Architecte : -
Constructeurs : -
Autres : « Aït-Ben-Haddou est l’exemple le plus connu de l’architecture de terre du sud marocain. Le ksar est un ensemble de bâtiments principalement en pisé, avec certaines parties en adobes (parties hautes) et en pierres (soubassements). La terre



TRANSFORMATION
Procédé constructif principal : Pisé
Autres Procédé constructif : -
est aussi utilisée dans la confection des sols, des planchers, des terrasses et des plafonds. Les maisons atteignent jusqu’à 15 mètres de hauteur avec leurs tourelles d’angles sommitales décorées de motifs géométriques réalisés dans la maçonnerie d’adobe.» (CRATerre-ENSAG, Inventaire de l’architecture de terre, ISBN : 978-2-906901-69-8, avril 2012)
Soubassement en pierre : Parfois
Contexte paysager : Urbain

F ORT A L J AHILI
NATURE
Localisation : Al-Aïn, Emirats Arabes Unis, Moyen Orient



Climat : Désertique
Risque sismique : Modérément élevé
Hauteur : 13m
Longeur : 58m
Largeur : 42m
Epaisseur murs base : 48cm
Epaisseur murs sommet : 34cm
CULTURE
Type : Protection
Maîtrise d’ouvrage : Autorité
Architecte : - / Roswag & Jankowski Architekten
(Restauration)
Constructeurs : -
Autres :
TRANSFORMATION
Procédé constructif principal : Pisé
Autres Procédé constructif : -
Soubassement en pierre :Contexte paysager : Urbain
C ITADELLE DE bAM
NATURE
Localisation : Bam, Iran, Asie

Climat : Désertique chaud
Risque sismique : Modérément élevé
Hauteur : 12m
Longeur : 193m
Largeur : 153m
Epaisseur murs base : 15,5m
Epaisseur murs sommet : 5,5m
CULTURE
Date de construction : XII° - XVIII° siècle
Type : Protection
Maîtrise d’ouvrage : Autorité
Architecte : -
Constructeurs : Population
Autres : «La forteresse de Bam est entièrement réalisée en terre crue, principalement utilisée sous forme d’adobes maçonnées avec un mortier de terre. Ces briques ont des dimensions variées en fonction des époques de fabrication. On distingue deux

TRANSFORMATION
Procédé constructif principal : Adobe
Autres Procédé constructif : Mortier de Terre
familles principales. Des briques de grandes tailles, utilisées pour le mur d’enceinte et les structures verticales, et les briques de petites tailles (environ 25x25x5cm) utilisées notamment pour la réalisation des couvertures voûtées dont les formes sont extrêmement variées (berceaux, voûtes d’arêtes, coupoles,..). La terre est aussi présente pour la réalisation d’enduits intérieurs et extérieurs et sous forme de bauge pour certains murs de clôtures.»
(CRATerre-ENSAG, Inventaire de l’architecture de terre, ISBN : 978-2-906901-69-8, avril 2012)
Soubassement en pierre :Contexte paysager : Urbain

NATURE
Localisation : Djenne, Mali,


Afrique de l’ouest
Climat : Semi-aride chaud
Risque sismique : Risque quasi nul
Hauteur : 20m
Longeur : 62m
Largeur : 59m
Epaisseur murs base : 2,5m
Epaisseur murs sommet : 85cm
CULTURE
Date de construction : XIII, 1907 (restauration)

Type : Bâtiment religieux
Maîtrise d’ouvrage : Autorité
Architecte : -
Constructeurs : Population
Autres : « L’authenticité du site, en particulier du tissu ancien classé, s’affirme à travers l’utilisation continue du même matériau de construction depuis plus d’un millénaire : la terre, utilisée sous forme de briques cylindriques, façonnées à la main (djenné
TRANSFORMATION
Procédé constructif principal : Adobe
Autres Procédé constructif : -
ferey) et, depuis le début du XX° siècles, sous forme d’adobes (toubabou ferey). La transmission des savoir faire spécifiques à ce mode de construction est assurée par le barey-ton, corporation de maçons de père en fils.» (CRATerre-ENSAG, Inventaire de l’architecture de terre, ISBN : 978-2-906901-69-8, avril 2012)
Soubassement en pierre : -
Contexte paysager : Urbain
COUPE
NATURE
Localisation : Fujian, Chine, Asie
Climat : Subtropical humide


Risque sismique : Risque très bas
Hauteur : 13,5m
Longeur : 25m
Largeur : 25m
Epaisseur murs base : 120cm
Epaisseur murs sommet : 85cm
CULTURE
Date de construction : XV° - XX° siècle
Type : Habitat collectif
Maîtrise d’ouvrage : Autorité
Architecte : -
Constructeurs : Familles
Contexte paysager : Urbain peu dense
Autres : «Circulaires ou carrées, elles sont orientées vers l’intérieur et pouvaient abriter jusqu’à 800 personnes. Elles ont été construites dans un but défensif, autour d’une cour centrale avec des

TRANSFORMATION
Procédé constructif principal : Pisé
Autres Procédé constructif : -
fenêtres ouvertes vers l’extérieur seulement à partir du 1er étage et une seule entrée. Servant d’habitation à tout le clan, les tulou fonctionnaient comme des entités villageoises et étaient aussi appelées « petits royaumes familiaux » ou « petites villes prospères ». Les tulou présentent des murs de boue fortifiés couverts par des toits de tuiles avec de larges avanttoits en surplomb.» (CRATerre-ENSAG, Inventaire de l’architecture de terre, ISBN : 978-2-906901-698, avril 2012)
Soubassement en pierre : -
Contexte paysager : Péri-urbain
COUPE
gHADAM è S
NATURE
Localisation : Guadames, Lybie, Maghreb

Climat : Désertique chaud
Risque sismique : Risque quasi nul
Hauteur : 8,5m
Longeur :10m
Largeur : 9m
Epaisseur murs base : 47cm
Epaisseur murs sommet : 36cm
Epaisseur murs sommet : -
CULTURE
Date de construction : XV° - XX° siècle
Type : Habitats individuels
Maîtrise d’ouvrage : Familles
Architecte : -
Constructeurs : Familles
Autres : «Tous les bâtiments blanchis à la chaux de Ghadamès sont construits en adobes (toub), associées au bois de palmier pour les menuiseries. Les toitures terrasse sont réalisées avec des poutres de palmier recouvertes de plusieurs couches de terre, dont les


TRANSFORMATION
Procédé constructif principal : Adobe
Autres Procédé constructif : Poutres de palmier
propriétés et la méthode de mise en œuvre varient de façon à obtenir une parfaite étanchéité. L’habitat très dense, bâti sur 3 niveaux au dessus des allées couvertes, assure une excellent régulation et un confort thermique exceptionnel dans le climat aride du désert saharien.» (CRATerre-ENSAG, Inventaire de l’architecture de terre, ISBN : 978-2-906901-698, avril 2012)
Soubassement en pierre :Contexte paysager : Urbain


























































































