TÉMOIGNAGE
Le miraculé des Andes
CHALETS
Verbier, station quatre saisons
ART
Le surréalisme
Le surréalisme a 100 ans quatre saisons

TÉMOIGNAGE
Le miraculé des Andes
CHALETS
Verbier, station quatre saisons
ART
Le surréalisme
Le surréalisme a 100 ans quatre saisons




Leçon de vie
Il a 74 ans et vit à Montevideo entouré de sa femme, de ses filles et de ses petits-enfants. On imagine Nando Parrado profiter de sa retraite sous le soleil généreux de l’Uruguay. Mais une partie de lui hante à jamais les neiges éternelles de la cordillère des Andes. Là où, il y a cinquante-deux ans, l’avion qui l’emmenait au Chili s’est écrasé avec 45 passagers à bord. À 3600 mètres d’altitude, habillés comme pour l’été, seize d’entre eux survécurent au froid, à la soif, à la faim et au désespoir pendant septante-deux jours.
Cette histoire est connue. Elle a fait l’objet de plusieurs livres et de films. Nando Parrado parcourt désormais aussi le monde pour la raconter sur scène. Pas pour la gloire ou par esprit de lucre, mais pour transmettre un message, très simple : garder la foi et ne pas se laisser abattre, même quand la situation semble perdue.
Alors oui bien sûr, on objectera que c’est parfois plus facile à dire qu’à faire. Mais pendant l’heure que dure le récit du miraculé des Andes, l’auditeur se dit qu’en effet rien n’est impossible. Nando Parrado n’explique pas par quel mystère lui et ses camarades ont réussi à survivre dans des conditions extrêmes. Il donne, en revanche, toutes les raisons qui auraient fatalement conduit à leur perte : la panique, la perte de l’envie farouche de vivre et l’anéantissement de l’espoir. Le choix des mots est, chez lui, primordial. Nando Parrado ne parle jamais du malheur de son accident, mais de la chance qu’il a eue de s’être assis dans la partie de l’avion qui ne s’est pas fracassée contre la montagne. Comme il ne parle jamais ni de courage ni d’héroïsme, mais de ce désir d’amour et de vie qui l’a fait tenir.
Il y a quelques années, il est retourné là-haut avec sa famille. La roche, la neige… La nature inhospitalière était en tout point identique à celle du drame de 1972. Dans ce décor impitoyable, une seule chose avait changé : un homme de 74 ans qui trouva là un nouveau sens à sa vie.
Emmanuel Grandjean Rédacteur en chef

Une publication de la SPG
Route de Chêne 36 – CP 6255 1211 Genève 6 www.spg.ch
Éditrices responsables Marie Barbier-Mueller Valentine Barbier-Mueller
Rédacteur en chef Emmanuel Grandjean redaction@lvxmagazine.ch www.lvxmagazine.ch
Ont participé à ce numéro : Joseph Arbiss, Christophe Bourseiller, Marine Cartier, Philippe Chassepot, Richard Malick, Cora Miller, Thierry Oppikofer
Publicité :
Edouard Carrascosa - ec@lvxmagazine.ch
Tél. 058 810 33 30 - Mob. 079 203 65 64
Abonnement : Tél. 022 849 65 10 abonnement@lvxmagazine.ch
Pages immobilières et marketing : Marine Vollerin
Graphisme et prépresse : Bao le Carpentier
Correction : Monica D’Andrea
Distribution : Marine Vollerin, Julie Chat
Production : Stämpfli SA Berne
Tirage de ce numéro 15’000 exemplaires
Paraît deux fois par an
Prochaine parution juin 2025
Couverture (Photo © Thanabodin Jittrong)
Cette revue, créée en 2022, est éditée par la SPG
Tous droits réservés.
© 2024 Société Privée de Gérance SA, Genève
Les offres contenues dans les pages immobilières ne constituent pas des documents contractuels. L’éditeur décline toute responsabilité quant au contenu des articles. Toute reproduction même partielle des articles et illustrations parus dans ce numéro est interdite, sauf autorisation préalable et écrite de la rédaction.

2
ÉDITO
8
CHRONIQUE
Voici venu le temps des coachs inspirants
10
PRÉSENT
Le Moyen Âge sort de l’ombre

14
SOCIÉTÉ
L’or qui monte, qui monte

PAROLES
16 François Parcy : « À toutes celles et ceux qui sèment »
22
Nando Parrado, le miraculé des Andes TÉMOIGNAGE
26
STYLE
Palma fait ses jeux

32
DESIGN
La bergère réinventée



37 52
ABCDESIGN
Superléger !
38
PORTFOLIO
Prises de noces

44
ART
L’art au-delà du réel
ARCHITECTURE
Verbier de rêve

Chérie, j'ai rétréci la Bugatti JOUET 58
HORLOGERIE
Virtuoses en lignes
PATRIMOINE
La maison des savoir-faire
68
Un Américain dans les vignes RÉGAL

72 PAGES IMMOBILIÈRES
Salon d’Art moderne et contemporain, du 30 janvier au 2 février 2025, Palexpo
Galleries \ A&R Fleury \ Afikaris \ Applicat-Prazan \ Ars Belga \ Ayyam Gallery \ Bailly Gallery \ Bernier / Eliades \ Blue Velvet \ Catherine Duret \ Christine König Galerie \ Christophe Person \ Clavé Fine Art \ Contemporary Fine Arts \ Ditesheim & Maffei Fine Art \ Fabienne Levy \ Galerie Anne-Sarah Benichou \ Galerie Christophe Gaillard \ Galerie Eva Presenhuber \ Galerie Fabian Lang \ Galerie Georges-Philippe et Nathalie Vallois \ Galerie Hubert Winter \ galerie lange + pult \ Galerie Lelong & Co. \ Galerie Le Minotaure \ Galerie Loevenbruck \ Galerie Mennour \ Galerie Mezzanin \ Galerie Nathalie Obadia \ Galerie Peter Kilchmann \ Galerie Pietro Spartà \ Galerie Rosa Turetsky \ Galerie Suzanne Tarasieve \ Galleria Enrico Astuni \ Galleria Franco Noero \ Galleria Monica de Cardenas \ Galleria Poggiali \ Gowen \ Hauser & Wirth \ In Situ – fabienne leclerc \ Karma International \ Krobath Wien \ Larkin Erdmann Fine Art \ Lee & Bae \ Lovay Fine Arts \ M77 \ Magnin-A \ Mai 36 Galerie \ Michel Rein \ Ncontemporary \ Olivier Varenne \ Richard Saltoun Gallery \ Rosenberg & Co. \ Sébastien Bertrand \ Semiose \ Simon Studer Art \ Skopia / p.-h. Jaccaud \ Tang Contemporary Art \ Taste Contemporary \ Templon \ Tornabuoni Arte \ Van de Weghe \ Von Bartha \ Waddington Custot \ Wilde \ Xippas \ 10 A.M. Art Solo \ Claire Gastaud \ Espace_L \ Galerie Kaleidoscope \ Galerie Sator \ Galleri Golsa \ Gathering \ HdM Gallery \ Heinzer Reszler \ Ketabi Bourdet \ Kissed then Burned \ Livie Gallery \ Studio Gariboldi \ Suprainfinit Art Editors & Publishers \ Archivorum\ Cahiers d’Art \ Dilecta \ JRP|Editions \ multipleart \ Provence \ Philippe Cramer \ Take5 Institutions & Art Spaces \ CALM – Centre d’Art La Meute \ Centre d’Art Contemporain Genève \ Centre d’édition contemporaine Genève \ ECAL – Ecole cantonale d’art de Lausanne \ EDHEA \ FCAC – Fonds cantonal d’art contemporain –Geneva \ FMAC – Collection d’art contemporain de la Ville de Genève \ Fondation d’Art Teo Jakob \ Fondation CAB \ Fondation Gandur pour l’Art – Geneva \ Fondation Opale \ Fondation Plaza \ HEAD – Haute école d’art et de design Genève \ Kunst Museum Winterthur \ Kunsthaus Biel / Centre d’Art Bienne \ MAH – Musée d’art et d’histoire de Genève \ MAMCO Genève \ MASI \ MBAL – Musée des Beaux-Arts Le Locle \ Plymouth Rock – Zurich \ Sammlung Scharf-Gerstenberg \ The Cranford Collection Special exhibitions \ Sur-mesure \ Orchestre de la Suisse Romande Awards \ Prix Mobilière \ Prix Solo Art Genève-F.P. Journe
Par Christophe Bourseiller, comédien, journaliste et essayiste
J’observe, de nos jours, une troublante « mania ». Après la Beatlemania, la sériemania, voici venu le temps assez peu béni de la coachmania. Eh oui, coach, c’est le mot-clé d’une époque à la dérive et qui crie SOS. Chacun cherche son coach et sans coach me voici devenu attelage sans cocher. Coach, voici un métier d’avenir… Que signifie précisément cet étrange vocable ? Bien entendu, le coach est un mage qui prodigue des « conseils », payants et souvent onéreux. Ce démiurge qui murmure à l’oreille des simples mortels remplace et détrône les psychanalystes, psychiatres et psychologues du XXIe siècle, devenus ringards, pour nous aider, dit-il, à surmonter les rudes épreuves du quotidien. Oui, car le coach est avant tout un accompagnateur, qui nous tient la main dans la rue. En quoi ce personnage estil qualifié pour nous escorter ?
Le tennisman reconverti
Le hic, c’est que n’importe qui peut s’improviser coach du jour au lendemain. Vous imaginez le nombre de psychopathes suicidaires, de cinglés au sourire en émail et de gourous fornicateurs qu’on peut croiser ? Vingt pour cent des signalements pour dérives sectaires concernent tout de même le coaching. Des coachs au black qui sont de parfaits escrocs, il y en a des pelletées. Prenez mon cas. Chroniqueur dans ce beau magazine, je pourrais facilement me déguiser en coach. Mais je ne suis pas sûr de vous guider sur le bon sentier.
Il y a pourtant des coachs dans tous les domaines de la vie. On connaît surtout, bien sûr, les coachs sportifs qui sont en
réalité de simples entraîneurs, mais il y a aussi des coachs lifestyle, des coachs en entreprise, des coachs de vie, des coachs « bien-être », des coachs de crise, des coachs sociaux, des coachs perso, voire des coachs quantiques, des coachs réincarnation, des coachs sexuels, ou des coachs magiques. Sans parler des influenceurs, que l’on croise sur YouTube ou Instagram. Tous ces







personnages qui gesticulent sur les écrans se disent des coachs, à l’exemple d’une certaine Sissy Mua, qui est à la fois youtubeuse et coach fitness. Figurez-vous que même l’ancien tennisman Henri Leconte est devenu coach. Avec sa compagne Maya, qui est elle-même coach de vie et hypnothérapeute, il a lancé une entreprise de coaching. Ma foi, c’est un filon, c’est un roc, c’est un










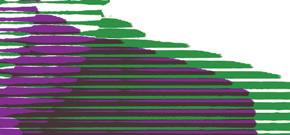















pic, c’est un cap. Que dis-je ? C’est une péninsule…
Père de substitution
Comme le dit le jeune philosophe Pierre Le Coz dans un récent numéro du magazine de vulgarisation Sciences humaines : « Nous sommes passés du père au grand frère, du patron au coéquipier, et de l’entraîneur au coach. » Ainsi le coach n’est autre qu’un père de substitution correspondant à l’époque présente. Pourquoi ? Parce qu’on a tué le père. On s’élève à tout bout de champ contre le patriarcat. Mais comme on a, néanmoins, besoin d’une figure paternelle, on a inventé le coach, celui qui donne toujours de bons conseils. C’est pourquoi on dit parfois que Socrate fut le premier coach, même si, en réalité, cette méthode qui s’inspire de la psychologie humaniste est apparue en 1962 aux États-Unis à l’Institut Esalen, peu avant la naissance du mouvement hippie. Alors, dis-moi qui tu coaches, je te dirai qui tu es. Ce monde occidental est coach, parce que ce monde a désespérément besoin de béquilles. C’est pourquoi l’on demande avant tout aux coachs d’être inspirants.
Chewing-gum mental
Attention, inspirant, c’est l’autre motclé de l’époque. Un voyage, un livre, se doivent aujourd’hui d’être inspirants. Avez-vous vu un film inspirant ? Vos vacances ont-elles été inspirantes ? L’automne le fut-il ? Bref, nous nageons dans la sommation de l’inspirant. Nous sommes aspirés par l’inspirant, au point d’expirer. Comme le remarque le blogueur Jean-Laurent Turbet : « Je n’en peux plus d’être inspiré. Pas un livre qui ne soit inspirant, pas une philosophe trentenaire qui enchaîne les lieux communs qui ne soit inspirante […] pas de jeune influenceur qui t’explique comment vivre ta vie alors qu’il n’a jamais vécu la sienne, qui ne soit inspirant. »
Dans le prolongement de ce réquisitoire, j’aimerais hasarder une hypothèse : et si les auteurs dits inspirants n’étaient en réalité que d’habiles producteurs en série de chewing-gum mental ? Vivons-nous sous le joug des bonimenteurs qui
ressassent des formules toutes faites et enfoncent des portes ouvertes en se disant inspirants ?
Il y a toujours eu des maîtres spirituels, des moralistes, des penseurs de talent. Mais la vague inspirante, elle, s’adresse aux amnésiques, à ceux qui préfèrent la copie frelatée à l’original magnifique, à ceux qui citent Pablo Ruiz, mais n’ont pas lu Carlos Castaneda.
La parole du vide
Je me suis toujours demandé quelle marchandise on nous fourguait, sous le fameux label « inspirant ». J’ai mené
« Plus c’est plat, plus c’est creux, plus c’est vide, plus c’est évident, plus c’est banal, plus c’est inspirant… »
l’enquête, tel un grand reporter sur le front ukrainien. Je suis même allé sur le site d’un influenceur et coach qui se veut justement inspirant. Ce monsieur se nomme Romain Plagnard. On le voit sur son site poser en photo, de dos, face à un lac de montagne. Et il répond à la question sensible : « Qu’est-ce qu’un inspirant et quels sont ses secrets ? » Mais que dit-il exactement ? « Pour être inspirant, il faut rechercher ce qui vous passionne, ce qui donne du sens à votre vie. Écoutez votre cœur. » On s’en serait douté. Il ajoute, subtil, que pour être inspirant, il faut être… bienveillant. Ainsi, il explique, pour ceux qui n’auraient pas compris : « La bienveillance est l’inverse de la méchanceté, de la médiocrité. Ce n’est pas une simple valeur selon moi, c’est un effet juste magnifique quand elle est utilisée à bon escient. Cela permet de créer un vrai lien émotionnel avec son public. » Bon sang, mais c’est bien sûr.
Ainsi, pour être inspirant, il est important de débiter des platitudes avec beaucoup de conviction. Plus c’est plat, plus c’est
creux, plus c’est vide, plus c’est évident, plus c’est banal, plus c’est inspirant… Il existe désormais toute une littérature inspirante, qui forme un marché en plein essor. Mais qu’est-ce qui fait qu’un livre est inspirant ou qu’il ne l’est pas ? Pour le savoir, j’ai visité le site de l’éditeur inspirant Indigraphe : « Soutenue par une écriture résolument optimiste et nourrie par des valeurs d’humanisme et d’amour, la littérature inspirante célèbre le bonheur de se plonger dans une aventure épique et romanesque. […] C’est un genre littéraire qui, à travers la quête d’un héros ou d’une héroïne, va proposer des clés concrètes et accessibles aux lecteurs.trices pour permettre une compréhension plus fine de ses relations aux autres. »
Le soleil, c’est bien Pour rendre les choses encore plus cristallines, permettez-moi de vous offrir deux citations particulièrement inspirantes. Julia de Funès : « Le travail n’est ni malheur ni bonheur, c’est un moyen au service de la vie. » L’avantage de ne rien dire, au fond, c’est qu’on peut plaire à tout le monde. Attendez, j’ai mieux encore. Voici Patrick Burensteinas, inventeur d’une formule décisive et définitive : « Le bonheur ne se choisit pas, il est. » Alors, moi aussi, j’ai décidé dans cette chronique de devenir inspirant et je vous laisse méditer ces quelques paroles de mon cru, qui, je l’espère, vous éclaireront d’une lumière bienfaisante et surtout bienveillante : « Le soleil, c’est bien. » « L’amour est. » Ou encore : « Ma vie est un fleuve sur lequel je navigue. » Vous voyez mon capitaine, j’aspire moi aussi à devenir inspirant.
J’ajoute que les influenceurs inspirants n’ont qu’un mot à la bouche : « apprenant ». Voici encore un joli cliché du moment. Ben oui, pour se faire inspirer, il faut être dans une démarche apprenante, vous me suivez ? Autrefois, on effectuait dans sa vie des voyages initiatiques ou des voyages culturels. De nos jours, on passe des vacances apprenantes. Je ne saurais trop conseiller aux apprenants inspirés par les inspirants d’expirer un bon coup et de méditer ce proverbe anglais : « Les belles paroles ne beurrent pas les épinards. »


précédente: Le gisant
Ci-dessus: un passage de la tapisserie de Bayeux (exécutée entre 1066 et 1083) qui raconte la conquête normande de l’Angleterre. (DR)
Le mot « moyen » dans « Moyen Âge » signifierait-il médiocre, sans envergure ou transitoire ? C’est ce qu’ont voulu faire croire les Lumières et la Renaissance. C’est un préjugé que combat Martin Aurell, historien médiéviste de référence, qui tient à nous rappeler à quel point cette période fut riche. Par Philippe Chassepot
Àla question : « À quelle époque aimeriez-vous vivre si vous pouviez voyager dans le temps ? » 70% des Français sondés par le très sérieux institut Insee ont répondu « dans le passé ». Une proportion énorme qu’on peut tenter d’expliquer ainsi : on s’ennuie un peu dans un présent qu’on ne connaît que trop. Le futur ? Il s’annonce parfois si sombre qu’on préfère encore n’en rien savoir (seulement 5% des interrogés aimeraient s’y promener), et le passé est idéalisé, car on n’y parlait pas surpopulation, bilan carbone ou véganisme. Les légendes ont toujours été tenaces, et il est tentant de croire que « c’était mieux avant », selon le cliché mi-sérieux, mi-rigolard. La tendance ayant un peu agacé Marion Cocquet et Pierre-Antoine Delhommais, les deux auteurs publiaient en 2022
Au bon vieux temps , aux Éditions de L’Observatoire. Face à cette réécriture partielle de l’histoire, ils soulignaient : « Ce furent des siècles rythmés par la misère, la faim, la maladie, la violence, la souffrance et la mort », avant d’étaler beaucoup d’exemples savoureux. Comme la qualité et la diversité de la nourriture – ou plutôt leur absence – et le fait que si les flambées d’hiver avaient lieu dans une seule maison dans un village, ce n’était pas par noble instinct de communauté, mais bien pour économiser le bois.
D’ailleurs, ne dit-on pas « moyenâgeux » pour dénoncer une situation anachronique, des comportements devenus inacceptables ou simplement une misère qui n’aurait plus lieu d’être ?
C’est là que Martin Aurell intervient. Professeur d’histoire médiévale, ancien directeur du Centre d’études supérieures
de civilisation médiévale à Poitiers, il est tombé très jeune dans la marmite du Moyen Âge et dit ceci : cet adjectif est une injustice, l’obscurantisme qui y est relié n’est qu’un poncif, et les massacres, dogmatismes religieux et autres inhumanités sont largement exagérés. Son ouvrage Dix idées reçues sur le Moyen Âge, tout juste réédité en poche aux Éditions Flammarion, vient réhabiliter cette période comme elle le mérite.
L’épouvantail des Lumières
Mais d’abord, cette question impérieuse : pourquoi parle-t-on d’un Moyen Âge alors qu’ils sont au moins trois, très différents les uns des autres ? À savoir : le haut Moyen Âge qui commence en 476, à la chute de Rome ; le Moyen Âge central, situé autour de l’an mil ; et enfin le Moyen Âge tardif, qui couvre les XIVe et


XVe siècles. « Les gens de la Renaissance étaient très empreints de civilisation gréco-romaine, ils ont voulu revenir aux sources pour redécouvrir l’Antiquité et ont créé cette grande parenthèse dite sombre. Plus tard, les Lumières ont cherché un épouvantail pour affirmer leurs nouvelles idées : elles voulaient faire du passé table rase et ont mis le gothique, le féodalisme et tout le reste dans le même panier », résume notre professeur.
Période féministe
Sa mission pour combattre les clichés l’a emmené sur toutes sortes de terrains. Celui-ci, par exemple : non, le Moyen Âge n’a pas cantonné les femmes au ménage et à la cuisine. Elles furent nombreuses à avoir leur patrimoine propre, nombre de responsabilités et une culture
générale largement supérieure à celle des hommes. Certaines ont même occupé les plus hautes fonctions en imposant leur autorité à des hommes alors bien soumis. Deux exemples de femmes puissantes : la reine Urraque et Aliénor d’Aquitaine, épouse de Henri II d’Angleterre, dont Martin Aurell vient de publier la biographie définitive (Souveraine Femme, chez Flammarion).
Quant à l’inhumanité supposée de ces temps-là… « Il y avait parfois des massacres, oui. Des guerres meurtrières, aussi, notamment la guerre de Cent Ans, très moderne avec son sentiment national et son artillerie. Mais la cruauté des invasions germaniques a été très exagérée, analyse Martin Aurell. C’était une période où les combattants appartenaient à la noblesse et à l’aristocratie, il y avait un grand respect entre eux. Ils se rançonnaient, car cela rapportait beaucoup plus de capturer des prisonniers plutôt que de les tuer. Ils les libéraient et attendaient le paiement, sur parole. Car ils avaient un grand sens de l’honneur et remboursaient leurs dettes. »
Racisme inconnu
De même que le Moyen Âge ne promeut pas les croisades xénophobes – il s’agissait d’abord de récupérer les lieux saints et d’une quête de salut éternel plutôt qu’assouvir la soif du sang –, il connaîtra peu de génocides, une notion bien plus moderne que médiévale. « Oui, la notion de race est peu présente au Moyen Âge comparé à nos jours, où elle devient obsessionnelle. Je ne nie pas les clivages religieux, mais le racisme est peu marqué.
La réduction systématique des Noirs en esclavage n’arrive qu’au XVIe siècle », argumente l’historien. Qui remet une pièce dans sa machine à nuancer. « Le ‹ raffinement › dans les exécutions publiques et les tortures ne viennent qu’à la fin du Moyen Âge avec la redécouverte du droit romain, très autoritaire, pour le meilleur et pour le pire. Alors qu’au début de la période, on a tendance à s’arranger entre familles, avec un système de compensation pécuniaire pour arrêter les conflits. La peine de mort n’est vraiment pas répandue. »
La Renaissance et les Lumières comme premiers coupables du déclassement,
d’accord, mais d’autres ont entretenu la mauvaise réputation. Martin Aurell est peut-être cinéphile. Dommage, car nous n’avons pas d’autre choix que de l’amener sur ce terrain un peu boueux : Les Visiteurs, le film à succès avec Jean Reno et Christian Clavier qui n’a pas fait beaucoup pour éclairer les ignorances, non ? Voilà qui l’amuse et provoque cette réponse presque surprenante. « Ah, ces caricatures avec le seigneur et son serf, la saleté, oui, mais à côté de ça, les gens ont beaucoup ri et les ont trouvés sympathiques. La scène où Clavier crie ‹ Messire, un Sarrasin ! › peut paraître déconcertante, mais on appelait les musulmans comme ça au Moyen Âge. Et les chevaliers teutoniques utilisaient aussi ce terme à propos des Baltes païens quand ils partaient en Lituanie. Franchement, je préfère Les Visiteurs à Kingdom of Heaven de Ridley Scott, par exemple, des scènes de batailles superbes, d’accord, mais avec une vision tellement négative de l’emprise du clergé et des royaumes latins de Jérusalem. Ou Le Nom de la Rose, et son casting avec les types les plus laids de la planète pour les mettre dans un monastère. Ils ont fait plus de mal que Les Visiteurs, je trouve. »
Et les séries du XXIe siècle, avec leur manichéisme quasi systématique ? Les scénaristes ne sont pas vraiment historiens, dirait-on – ou alors ils l’ont oublié. « J’ai un ami qui est conseiller historique de Ridley Scott, il est très prudent parce que le réalisateur britannique renvoie facilement ses experts quand ils ne lui disent pas ce qu’il veut entendre. C’est le dilemme entre la création et la vérité, l’équilibre à trouver entre l’exactitude historique et ce qui va toucher nos contemporains. Mais il est vrai que tous les poncifs sont là, souvent. »
Lunettes et imprimerie
Chacun trouvera chapitre à son âme dans Dix idées reçues. On a, par exemple, beaucoup aimé l’un des passe-temps les plus prisés de la noblesse médiévale : débattre en vers sur un sujet imposé devant un public attentif. Comme quoi les Ligues d’improvisation des temps modernes n’ont rien inventé. « C’était une civilisation bien plus orale que la nôtre, avec davantage de mémoire. Ils étaient plus
doués que nous pour manier la langue » , répond Martin Aurell. Ou la production de manuscrits à la chaîne, bien avant l’arrivée de l’imprimerie, qui développera ainsi des pratiques de « lecture pour soi » qui n’existaient pas auparavant. « C’est comme aujourd’hui avec les tablettes qui n’ont pas encore fait disparaître les livres imprimés, donc les deux coexistaient. Le papier était devenu très bon marché aux XII et XIIIe siècles, comparé au parchemin. Ce qui a déclenché une production colossale qui a duré jusqu’au XVIIe » Martin Aurell, né en 1958, sourit encore quand on lui demande son coup de cœur personnel sur la période. « Comme tout le monde, je suis devenu presbyte passé les 40 ans. Alors je suis très sensible au fait que les lunettes aient été inventées en 1270. » Et de revenir sur cette phrase qui dit tout du travail de l’historien : « L’histoire ne fait pas de l’éthique. Plutôt que de juger, il lui revient d’essayer de comprendre et d’expliquer dans le contexte », écrit-il dans son ouvrage. Qui fait également la meilleure des conclusions, empreinte de sagesse et de hauteur. « Car on doit poser un regard anthropologique. On imagine mal Claude Lévi-Strauss donner des leçons aux Amazoniens pour leur dire comment s’habiller, se marier ou guerroyer. Il veut comprendre, entrer dans ces pensées dites sauvages. Ce qui est permis aux anthropologues doit l’être aussi aux historiens médiévistes : on respecte notre période, on doit faire un effort de dépaysement et ne pas faire la morale. »

Martin Aurell, Dix idées reçues sur le Moyen Âge, Éd. Flammarion, collection Champs histoire, 224 pages
«
Le métal jaune n’en finit pas de battre des records cette année. L’économiste François Savary explique pourquoi cette fièvre de l’or n’est pas près de retomber.
Propos recueillis par Thierry Oppikofer
Un proverbe français l’exprime de façon prosaïque : « L’âge d’or sera celui où l’or ne régnera pas. » Le moins que l’on puisse affirmer, en cet an de grâce 2024, c’est que l’âge d’or en question paraît encore assez lointain, puisque l’or n’a probablement jamais été autant à l’honneur. Certes, il ne s’agit plus de se précipiter vers le Klondike ou la Guyane, barbe au vent et tamis à la main, ni d’écumer les vitrines des grands bijoutiers ; ces derniers se placent d’ailleurs un peu en retrait, effrayés par la hausse accélérée des cours du métal jaune. Il s’agit d’investir, de stocker, de se protéger contre les incertitudes des temps et – pour nos amis chinois parmi d’autres – contre les velléités dominatrices de l’oncle Sam.
Selon une récente étude de l’Université de Saint-Gall, les citoyens suisses possèdent, bien cachés et parfois enterrés dans leur jardin, quelque deux cents tonnes d’or en pièces et lingots. Un petit magot représentant, au cours actuel, plus de 15 milliards de francs. La grande
majorité de ces discrets détenteurs expliquent qu’ils ne comptent vendre leur or qu’en cas d’extrême nécessité, même si l’envolée des cours et l’absence de taxation des plus-values réalisées auraient de quoi ébranler la résolution du pire Harpagon.
L’économiste François Savary, à la tête de la société de gestion Genvil après des années couronnées de succès dans des établissements financiers genevois – ce qui lui a valu le statut d’interlocuteur de référence des médias romands – commente l’actuelle « folie de l’or » : la cote du lingot d’un kilo a grimpé de plus de 30% entre janvier et octobre 2024, tandis que la demande mondiale – notamment chinoise – s’emballait.
Comment expliquer cette « ruée vers l’or » en 2024 ?
J’y vois la combinaison de plusieurs phénomènes. Le premier est la volonté de nombreuses banques centrales de diversifier leurs réserves de change, dans la foulée des mesures prises par les États-Unis et la Banque
centrale européenne après l’attaque de l’Ukraine. La Chine, dont l’excédent des comptes courants en dollars est chronique, mise logiquement sur l’or en prévision d’éventuelles tensions avec Washington. Le second est lié au retour de l’inflation après le Covid, l’or étant évidemment une valeur refuge. Le troisième est l’abondance de liquidités après ladite période de pandémie. Les investisseurs cherchent des actifs décorrélés de leurs positions en actions ; les obligations ne jouent plus ce rôle dans un contexte d’inflation ; l’or est donc très séduisant.
L’essor de l’intelligence artificielle et des technologies joue-t-il un rôle ?
Il faut en effet de l’or pour les semiconducteurs, mais c’est un facteur marginal. Il est plus marquant pour l’argent métal, par exemple, et pour d’autres composants.
Décelez-vous dans cette montée des prix un facteur irrationnel ?
L’économie de marché suppose un équilibre instable entre l’offre et la demande, qui concourent à la fixation du prix. Le contexte géopolitique actuel (ProcheOrient, Ukraine) et la conjoncture économique ne portent pas à l’optimisme ! Il est possible que ces éléments aient stimulé la demande au-delà du raisonnable, mais même si une correction devait intervenir, elle serait minime.
Quel serait le pourcentage idéal d’or dans un portefeuille ?
Un investisseur avisé doit mener une réflexion stratégique à deux, trois ou cinq ans : quel poids l’or, actif inerte, doit-il peser dans mon portefeuille ? Le quota usuel est de 5%. Sur le plan tactique, étant donné que la montée des prix a fait passer ces 5% à 6% ou 7%, il peut être indiqué de pratiquer une prise de profit partielle.
Pourrait-on imaginer que des barrières soient mises aux transactions des privés sur l’or ?
Cela s’est produit dans les années 30 aux États-Unis. Roosevelt avait interdit le commerce de l’or aux privés, le
réservant exclusivement à l’État. Les temps ont changé : l’étalon-or n’est plus qu’un souvenir et je doute de la capacité des Américains à imposer aux Chinois ou aux Indiens, entre autres, ce type de restrictions.
Dans les années 70, avec la crise du pétrole, l’or était monté en flèche, pour redescendre en quelques mois au niveau antérieur et ne plus évoluer significativement durant un demi-siècle. Ce scénario pourrait-il se reproduire ?
Il faut remonter un tout petit peu plus dans le temps, à la fin des années 60. De Gaulle décide de convertir en or les réserves en dollars de la France. Le président Nixon, confronté à une surchauffe en pleine guerre du Vietnam, abandonne le système des taux de change fixe et l’étalon-or. On vit depuis lors dans un système de taux semi-flexibles et de contreparties basées sur les dépôts auprès de la Fed et des autres institutions centrales.
Acheter de l’or en masse comme le font les Chinois est donc une bonne stratégie?
Disons qu’en observant la situation du monde, on n’a pas l’impression d’aller vers le mieux ! La Chine réduit ses réserves en dollars, achète de l’or et recourt à des systèmes de contreparties de type Clearstream dans l’idée de dépendre le moins possible de la Fed et des ÉtatsUnis ; cela devrait continuer. Plus généralement, je ne suis pas convaincu que l’inflation soit vraiment et durablement maîtrisée. Il y a aussi l’accumulation monstrueuse de la dette, notamment aux États-Unis où on frôle les 130% et où les intérêts coûtent un trillion de dollars par an… Alors je pense qu’en effet, l’or a de très beaux jours devant lui.

C’est la merveilleuse dédicace, aussi poétique que reconnaissante, qui vient ouvrir « Les clés du champ », le dernier ouvrage de François Parcy. Directeur de recherche au CNRS de Grenoble, ce chercheur en biologie des plantes s’est donné pour mission de faire comprendre au grand public comment elles fleurissent et comment leur histoire a pu s’écrire d’une aussi belle façon. À travers le récit de leur domestication, il souhaite aussi raconter celui, passé et à venir, de l’humanité. Par Philippe Chassepot
On aimerait croire que tout est beau et propre dans la nature, mais vous le rappelez très vite dans votre ouvrage : la pomme de terre a d’abord été toxique, tout comme les noyaux de pêche et l’amande. C’était la nature qui se défendait ? J’ai voulu commencer par ça, car il existe encore cette idée que la nature est bonne, qu’il ne faut pas y toucher, car elle est là pour nous nourrir. C’est une idée fantasmée, pas réelle du tout. Les plantes intéressent tout le monde, car elles sont le grand moyen sur terre de capter l’énergie du soleil et de créer la vie. Elles sont le début de la chaîne alimentaire, de la chaîne trophique et font l’objet de toutes les tentations. Tout le monde veut les manger, et celles qui sont vivantes aujourd’hui le sont parce qu’elles ont réussi à se défendre. Par divers moyens : les épines, les substances toxiques, les graines difficiles à ouvrir… Les plantes ne sont pas là pour nourrir les hommes et les animaux. Il fallait donc vite préciser que naturel ne veut pas forcément dire bon pour la santé ou l’alimentation. Le plus souvent, c’est même plutôt le contraire.
Comment ces fruits et légumes désormais courants sont-ils devenus consommables ?
On n’a pas la réponse pour tout, mais on sait quand même qu’il y a une grande diversité dans la nature : des pêches plus ou moins toxiques, idem pour les amandes, ou du sorgho plus ou moins amer. Les populations humaines ont pioché dans cette diversité, en sélectionnant petit à petit ce qui était le moins dangereux, ou
c’était obligatoire pour la survie de l’humanité, ou au moins son développement ?
Non, il n’y avait rien d’obligatoire ici. On constate a posteriori que les humains ont fait le choix de passer de chasseurs-cueilleurs à agriculteurs, puis à industriels et aujourd’hui à humains connectés. On aurait pu rester chasseurs-cueilleurs pendant deux millions d’années de plus, mais une fois que le virage est pris, le retour est impossible. On abîme peut-être la planète avec notre agriculture intensive et un puisement excessif dans nos ressources, mais on ne va pas revenir en arrière. Des facteurs historiques et climatiques ont fait que les choses se sont passées ainsi, des livres entiers ont été écrits là-dessus, notamment Homo domesticus de James C. Scott, sur la création des États pour protéger les récoltes. Ça ne s’est pas fait du jour au lendemain, il y a eu des allées et venues entre la cueillette et le champ. Avec aussi des expériences assez parallèles qui se sont produites en même temps dans des civilisations différentes. Est-ce vraiment un hasard si la domestication a eu lieu en Amérique du Sud et dans le Croissant fertile ? Ces populations ne se connaissaient pas et ont pourtant fait la même chose, alors…
Vous utilisez cette image aussi drôle que pertinente quand vous dites que le maïs, c’est le caniche des plantes. Car le caniche descend du loup et le maïs de la téosinte, une variété de graminées très endémique. Le champ, c’est finalement comme le salon : on y a supprimé la notion de compétition. J’étais très content de trouver cette analogie, parce qu’il est facile de comprendre que nos chiens de salon ne sont pas adaptés à la nature. On les soigne, on leur fournit la nourriture, on les protège. C’est moins évident quand on le dit pour les plantes. J’ai quand même lu dans des journaux très sérieux que si on fabriquait de nouvelles plantes cultivées, elles allaient devenir invasives et entrer en compétition avec la nature. Dire qu’on va éradiquer la diversité naturelle, c’est montrer une méconnaissance totale des mécanismes qui font qu’une plante domestiquée est une plante affaiblie. Alors que ça devient plus simple une fois qu’on imagine les caniches, car on se doute bien qu’ils ne représenteraient aucun danger si on les relâchait en Amazonie ou dans une forêt sibérienne – ils disparaîtraient tous en trois générations. Quand vous vous promenez dans la nature, vous ne voyez jamais de plantes déborder du champ. Les tomates ou le maïs n’envahissent pas les bois et les prairies – il y a vaguement le colza qui s’évade un peu dans les fossés, mais rien de plus.
ce qui se défendait le moins. Elles l’ont fait pendant des millénaires sans toujours le savoir, un peu les yeux bandés. On n’est pas au courant de ce qui s’est mal passé, mais on peut imaginer que certains individus se sont intoxiqués, même s’il y avait des observations évidentes. Peut-être, par exemple, qu’ils avaient remarqué des rongeurs et des oiseaux davantage présents sur certains amandiers pour mieux les choisir.
Vous définissez la domestication comme le fait d’adapter les plantes naturelles pour les cultiver. La maîtrise du champ,
C’est la domestication qui fait que l’Islande est devenue un gros producteur de bananes ?
Je l’ignorais, mais ça soulève justement un autre point important : dans le passé, on n’a jamais eu peur de transporter les végétaux, alors que certains débats contemporains affirment parfois qu’il ne faut rien bouger des régions d’origine. Si on n’avait pas fait venir des tomates de Bolivie ou d’Équateur voilà des siècles, on n’aurait pas d’espèces méditerranéennes chez nous aujourd’hui.

Mutations. Voilà un mot qui fait peur, parfois. Mais vous dites : « Ce sont des phénomènes naturels, ni maléfiques ni dangereux, qui ont toujours existé. » Et sans lesquelles il n’y aurait pas eu la vie sur terre ! Si les espèces existent, s’il y a diversité, c’est grâce aux mutations. Sans cela, la machine nous reproduirait à l’identique et nous serions une armée de clones. Une vie figée dans une sorte de perfection éphémère qui aurait disparu au moindre changement. On aurait pu dominer momentanément, à la moindre évolution d’environnement, on n’aurait pas su s’adapter. Les mutations sont merveilleuses, mais le cinéma a joué un grand rôle dans leur image. Il a connoté le mot. Pour les gens, introduire des mutations est, a priori, quelque chose de mal. A priori… Alors qu’ils ne savent sans doute pas que dans chaque hectare de blé, il y a des milliards de mutations qui sont introduites naturellement, car la nature ne reproduit pas à l’identique. Il y a aussi cette idée qu’une mutation naturelle ne serait pas grave, alors que la mutation choisie par l’humain serait beaucoup plus maléfique parce que choisie, justement. Il y a quelque chose derrière tout ça, je ne sais pas, peut-être la morale judéo-chrétienne. Trop toucher, c’est un peu jouer à Dieu, et donc prendre des risques.
De fait, les risques existent, non ? Penser ainsi, c’est ignorer les dix mille ans d’agriculture où on a beaucoup tenté les yeux bandés ! Quand on a croisé les agrumes, par exemple, alors qu’ils n’avaient aucune chance de le faire entre eux naturellement. Car, avant, il n’y avait pas de clémentines, ni d’oranges, ni de citrons… J’aimerais vraiment dédramatiser cette notion de mutation. C’est la source de la diversité. Il n’y avait qu’une plante à fleurs voilà 150 millions d’années, on ne sait même pas où, ni exactement quand d’ailleurs, mais elle a donné naissance à plus de 300’000 espèces de plantes à fleurs. Grâce aux mutations. Donc merci à elles…
Vous préférez utiliser le terme « transgénique » plutôt que « OGM », l’acronyme pour organisme génétiquement modifié. Pourquoi ?
OGM, c’est trop vague, avec le cadre européen qui en régule certains et pas d’autres. Ça complique le débat, donc je préfère dire « transgénique » pour définir les plantes dans lesquelles on a introduit de l’ADN étranger avec des techniques de biologie moléculaire.
Et pourquoi cette peur qui semble ne jamais vouloir s’évaporer ?
Deux raisons, selon moi. D’abord, c’est très largement entretenu par des groupes de pression dont c’est un peu le gagne-pain, même si je devrais peutêtre le dire autrement. Jeune, j’étais très partisan de Greenpeace et d’autres associations, et j’en suis revenu, car ils disent beaucoup de choses qui sont scientifiquement fausses. Dès qu’on a choisi un cheval de bataille, même si le contexte a changé, que certaines questions ne se posent plus de la même façon qu’il y a trente ans, ces groupes de pression ne vont pas dire du jour au lendemain : « Les OGM c’était mal, mais maintenant, les nouvelles, c’est bien. » Et pourtant, je pense qu’il faut d’abord faire des raisonnements scientifiques. Prenez le nucléaire : c’est certes des milliers de morts ici et là avec les accidents, mais ce qu’on crame en charbon et énergies fossiles, là, ça se chiffre en millions de victimes. Alors on choisit quoi ? Et c’est encore pire pour le sujet des OGM, car je ne connais pas le moindre accident qui y soit lié.
Et la deuxième raison ?
Si le grand public voyait un intérêt évident pour lui, alors il changerait peut-être de point de vue. Quand on dit « attention, le téléphone portable, ça donne le cancer du cerveau » , est-ce que c’est vrai ou pas, je ne sais pas, mais il nous rend des services inouïs et on ne pourrait plus vivre sans. Alors on se dit que, peut-être, il existe une chance infime de tomber malade, mais nos vies en ont tellement été changées que tout le monde prend le risque. Mais quand on dit : « Hé, si on met un gène de résistance aux insectes, alors plus besoin de pesticides ! » ça parle aux paysans, mais le grand public s’en fout. Alors on continue à s’insurger parce qu’on n’imagine pas vraiment que notre agriculture est peut-être en grand danger. Le réchauffement climatique, l’eau, l’injonction à utiliser moins d’engrais, les gels tardifs et les dégels précoces : je ne veux pas agiter le chiffon rouge, mais les menaces sur la sécurité alimentaire sont là.
Il n’est pas garanti qu’on ait toujours des
champs qui produiront abondamment des fruits et des graines. Les plantes sont des senseurs de l’environnement, elles passent leurs temps à percevoir la durée du jour et de la nuit, les températures, la qualité et la direction de la lumière… Les rendements ont été optimisés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais ce n’est pas acquis si on les bouscule.
Les plantes transgéniques restent-elles les meilleures alternatives aux pesticides, selon vous ?
C’est plus complexe que ça. Prenons, par exemple, un champ de soja qui résiste au glyphosate : on l’asperge une
vendeurs de semences, mais est-ce que les agriculteurs argentins les écoutent, avec leurs deux ou trois générations de maïs ou de soja par an ? Donc on ne doit pas diaboliser la plante, car elle dépend des pratiques agricoles.
Pourquoi a-t-on besoin d’autant de soja ?
C’est pour nourrir nos animaux, vaches à lait, cochons et bœufs à viande. C’est très facile de se dédouaner en accusant Monsanto d’être le méchant, car on a des choix de consommateurs et de société à faire. C’était la motivation de ce livre : montrer qu’on pouvait faire différemment.
Il faut toujours un méchant dans une histoire…
fois et toutes les plantes meurent, sauf le soja. C’est merveilleux pour le paysan, c’est pour ça que sa culture s’est autant développée en Argentine, par exemple. La pratique agricole, c’est d’utiliser toujours le même herbicide au même endroit, et la répétition va favoriser l’apparition de résistances et de compensations. Pareil pour les insecticides introduits dans la plante, même quand ils sont bio comme le BT : d’autres insectes vont alors se retrouver sans concurrence et peut-être en profiter pour devenir envahissants. La technologie doit être utilisée intelligemment, avec des zones refuges dans le champ. C’est préconisé par les
On exploite ce concept, car on vit dans une société qui a besoin de cibles. Pour défendre une cause, on tape sur d’autres gens. Beaucoup sur les paysans, notamment, ce qui est une injustice profonde alors que leur population n’est pas homogène du tout. Autre sujet polémique en France : les mégabassines. Pour moi, être contre, ça n’a pas plus de sens que d’être contre les OGM en général. Il existe des endroits où les nappes se remplissent en début d’hiver et débordent pendant des semaines : y stocker de l’eau ne pose pas de problème. Il y a d’autres endroits où c’est une véritable bêtise. Alors oui c’est vrai, certaines plantes transgéniques seraient dangereuses pour l’environnement parce qu’elles laisseraient disséminer des gènes de résistance aux herbicides dans la nature ; mais à certains endroits, ça ne comporterait aucun risque. Il y a de la science derrière tout ça, des spécialistes ont théorisé là-dessus, on n’a pas besoin de dogmes pour opposer les gens alors qu’il y a un chemin. Les OGM sont une technologie. Ce n’est pas elle qu’il faut réguler, mais son produit. C’est l’exemple classique du couteau : avec, je pèle ma pomme ou j’égorge mon voisin. Est-ce qu’on juge le couteau ? Non, on estime un bénéfice-risque.
L’Europe a toujours semblé freiner aussi fort que possible dans cette affaire… Jusqu’à présent, elle a régulé la seule
technologie : si la plante est faite avec une technologie transgénique, alors on interdit sa culture – même si on en importe et qu’on en consomme abondamment, il faudra m’expliquer la logique… Elle ne fait que du global, jamais du cas par cas, ça n’a pas de sens. Même l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (ANSES) en France dit qu’il faut regarder au cas par cas, c’est essentiel. Mais on est peut-être en train d’ouvrir cette porte.
Pour contrer tout ce qui est réchauffement climatique, appauvrissement des sols, manque d’eau, etc., la génétique s’annonce comme la première des solutions ?
Non, je dirai plutôt les habitudes de consommation. Par exemple : dès que vous diminuez la consommation de viande, vous diminuez la production de protéines végétales. Le levier de la consommation est vraiment gigantesque. Je suis devenu flexitarien avec le temps : je n’achète de la viande qu’une fois par semaine, je ne vais pas dire non à l’agneau chez mes parents, ce genre de choses. Mais quand j’étais interne, à l’adolescence – je suis né en 1968 –, c’était protéines animales midi et soir, avec parfois du pâté en entrée. La société a bien évolué et ça peut aller plus vite qu’on ne le croit. Regardez le tabac : les TGV avaient des wagons fumeurs, on pensait que les bars et restaurants allaient fermer si on l’interdisait, et finalement, quelle souplesse ! Flexitarien, ce n’est pas compliqué, mais je fais là du militantisme lambda. Sur la technologie CRISPR, acronyme de Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, soit la possibilité de couper des séquences d’ADN où on le veut, je peux développer plus d’arguments.
Sauriez-vous nous expliquer la révolution amenée par cette technologie, en restant accessible aux non-spécialistes ?
Déjà, revenons à la base : domestiquer, c’est sélectionner des plantes différentes, car elles possèdent des variations qu’on appelle mutations. Comment se produisent-elles ? Naturellement, avec
les effets du soleil, les erreurs inhérentes à la nature, etc. Il existe plusieurs façons de sélectionner ces mutations par les activités humaines, mais depuis CRISPR, on sait non pas faire plein de mutations au hasard et chercher la bonne, mais directement introduire les deux ou trois qui nous intéressent. Exemple : disons qu’on sait que le grain de riz reste attaché à son épi en changeant la base C en base A dans tel gène. Va-t-on attendre que ça arrive par hasard ? Non, car la chance reste infime. Avec CRISPR-Cas9, c’est comme dans une meule de foin où on cherche un petit brin : au lieu d’y aller au hasard en espérant un coup de bol, on utilise un petit GPS – là, c’est CRISPR – qui amène les ciseaux – là, c’est Cas9 – pour vous amener exactement au bon endroit. C’est magique.
Et très récent, donc ?
Jennifer Doudna et Emmanuelle Charpentier ont obtenu le Prix Nobel pour cette découverte en 2020, oui. On peut ajouter que c’est une technologie « naturelle », puisque c’est celle utilisée par les bactéries pour se défendre contre les virus. Ces derniers les envahissent, et quand la bactérie arrive à survivre, elle garde un morceau du virus en réserve en se disant : « Ça, c’est un morceau de virus, la prochaine fois que je le vois, je le coupe en tranches. » Lors de l’infection suivante, sa mémoire envoie le GPS avec les ciseaux et elle coupe.
On sent que vous avez une tendresse particulière pour cette technologie-là, n’est-ce pas ?
Je l’adore, oui. Prenez l’exemple de la banane. Dans les années 50, on trouvait la variété Gros Michel partout dans le monde, puis elle a disparu à la suite d’une maladie fongique. La variété Cavendish, en provenance d’Asie, a pris le relais et le monde entier s’y est converti. Cavendish est aujourd’hui menacée, et peut-être qu’on n’en parlera plus dans cinq ans. Elle a déjà tenu septante ans, et c’est quand même pas mal. Si aujourd’hui on découvre le nouveau pathogène qui la menace et qu’on est capable d’enlever le gène de susceptibilité par mutation pour créer une nouvelle
Cavendish résistante et que ça dure encore septante ans, ce serait bien, non ? Attention, encore une fois, ce n’est pas la panacée : c’est parfois ultra-efficace, et dans d’autres cas, la bactérie peut muter pour devenir résistante et attaquer de nouveau.
Le monde actuel vit en grande partie sur le triptyque riz-blé-maïs. Quelles évolutions semblent se profiler à court terme ?
Il est vrai que ces trois plantes ont été choisies comme de grands leaders parce qu’elles ont eu de grands avantages à un certain moment. D’autres plantes ont été plus discrètes, d’autres abandonnées, j’ai eu une sorte de vertige quand j’ai lu cet article dans la revue Science qui m’a appris que trois mille plantes avaient nourri les humains à travers l’histoire. Aujourd’hui, on en utilise seulement quelques dizaines. Pour des raisons parfois incroyables, comme l’amarante : les Hispaniques l’ont bannie il y a cinq cents ans, car les Incas s’en servaient lors de sacrifices humains ! Alors que c’est un supermarché sur tige tellement on peut tout consommer. C’est désormais une réalité en France : on trouve de plus en plus de champs de sorgho et de quinoa. Peutêtre qu’on peut les aider à améliorer leur productivité, car on a des moyens fabuleux. J’assume une certaine naïveté, mais je me prends à rêver devant notre patrimoine et sa diversité : toutes ces plantes qui sont là, pourquoi s’en priver ?

François Parcy, Les clés du champ, 2024, Éd. humenSciences, 345 pages

En 1972, Nando Parrado avait 22 ans lorsque l’avion qui le transportait avec son équipe de rugby s’écrasa dans les Andes. Survivant de cette tragédie épouvantable, il raconte sur scène comment lui et ses 16 compagnons ont bravé la mort pendant septante-deux jours à 3600 mètres d’altitude. Une leçon de vie. Par Emmanuel Grandjean

« Je ne devrais pas être avec vous ce soir. En fait, je ne devrais pas être vivant. »
Sur la scène de l’hôtel Président Wilson à Genève où il répond à l’invitation de la SPG, Nando Parrado raconte une histoire tragique qui a déjà fait l’objet de plusieurs livres et de deux films. Celle de son équipe de rugby à XV de Montevideo, en Uruguay, qui prend un avion pour rejoindre le Chili où elle va disputer un match.
Le 13 octobre 1972, le Fairchild F-227 embarque 45 passagers. Son plan de vol doit contourner la barrière infranchissable de la cordillère des Andes. Sauf que le pilote va foncer droit dedans. L’appareil se casse en deux en heurtant la montagne. La partie arrière se fracasse dans les rochers. L’avant atterrit sur la neige et glisse sur 400 mètres avant de s’arrêter au milieu d’un cirque blanc. Dans la carcasse, on dénombre plusieurs morts, parmi lesquels le pilote et le copilote, mais aussi 29 survivants « dont 24 n’ont pas une égratignure », raconte Nando Parrado. Nous étions tous des jeunes d’une vingtaine d’années qui vivions dans un pays tropical. Notre quotidien, c’était la mer et la plage. Aucun de nous n’avait vu la neige. Nous étions habillés comme pour l’été. Nous n’avions aucune chance de nous en sortir. »
Esprit d’équipe
La chance, justement. C’est d’elle que Nando Parrado parle pour expliquer le miracle. « Ce n’était pas un vol commercial. Chacun entrait dans l’avion et choisissait sa place. Moi, j’étais assis devant, au rang 9, dans la partie qui a survécu à l’accident. La chance, c’est aussi que nous soyons une équipe de rugby avec un leader, Marcello notre capitaine, qui a tout pris en main aussitôt que l’avion s’est écrasé. Nous aurions embarqué sur un vol normal, avec des passagers d’âge, de culture et de religion différents, nous serions tous morts, c’est sûr. Le rugby a sauvé nos vies. »
L’accident a eu lieu au milieu de l’après-midi, à 3600 mètres d’altitude, dans une cuvette cernée de sommets perchés à 6000 mètres. Marcello comprend que les secours ne se hasarderont pas dans le secteur pendant la nuit. Le fuselage éventré fera office d’abri contre le froid et le vent. Le capitaine fait le tri entre les morts, les blessés et les indemnes. Il sort les premiers de la carlingue, aménage les espaces les plus chauds à l’intérieur pour les seconds et donne à ceux qui peuvent encore le supporter les places le plus exposées à des températures qui peuvent atteindre –50 degrés. « Nous aurions dû tenir trente-six

Nando Parrado aujourd’hui. (Fernando Parrado)
heures grand maximum, nous ont expliqué, plus tard, les experts. Nous avons survécu septante-deux jours. »
Pacte magnifique
Tous ces détails, Nando Parrado ne les a pas vécus. Gravement commotionné, il a émergé de son coma trois jours et demi après le crash. Ce qu’il découvre est terrifiant : sa mère est morte et sa sœur se trouve dans un état désespéré. Elle agonisera dans ses bras. « Je me suis senti en colère, non pas de les avoir embarquées avec moi dans cette tragédie, mais parce que je ne ressentais ni rage ni peine. On m’a expliqué que dans ce genre de situation, les émotions s’effacent pour faire place à la force mentale qui fait ce qu’elle doit faire pour vous maintenir en vie. »

deux ou trois jours, c’était faisable. » Ils ignorent que le pilote n’a pas du tout suivi la bonne route. Et que les survivants se trouvent en fait à 100 kilomètres du village le plus proche.
La survie, c’est surtout les vivres. À bord du vol il n’y en a pas, enfin il n’y en a plus. Les deux tablettes de chocolat et les cacahuètes ont été englouties. Pour l’eau, les 29 survivants mâchent de la neige, « mais ce n’est pas comme boire. Au bout d’une semaine, ça vous déchire la gorge et vous craquèle les lèvres. » Restent les cadavres qui seront le seul apport de protéines. « Nous avons conclu un pacte magnifique. Nous avons décidé que chacun d’entre nous qui mourrait donnerait son corps pour sauver la vie des autres. Revenus cinquante-deux ans en arrière, nous créions alors sans doute la première association officielle de donneurs d’organes. »
Erreur de calcul
Nando Parrado parlait de chance, mais le sort s’acharne aussi sur le petit groupe. Une avalanche va bientôt emporter et enterrer le fuselage sous trois mètres de neige. Elle fait huit victimes supplémentaires, dont Marcello. Trois jours pour creuser un tunnel, trois ou quatre autres pour dégager la carlingue. Il reste 19 personnes qui comprennent, grâce à un petit transistor encore en ordre de marche, que les secours, après dix jours de recherche, ont abandonné tout espoir de trouver le moindre survivant. C’est l’abattement. « Je répétais : ‹ Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. › Je me suis alors souvenu des paroles de mon père : ‹ La panique tue, la peur sauve. › Nous avions trouvé le plan de vol dans le cockpit. Nous étions des universitaires qui avions appris les maths et la physique. On a pu déterminer que nous nous trouvions à 8 kilomètres du premier signe de civilisation. C’est là que Roberto Cassena et moi avons décidé de partir chercher des secours. Il fallait juste franchir le sommet du glacier. On s’était dit qu’en
Marcher jusqu’à la mort Cela valait sans doute mieux. Le 12 décembre, Nando et son compagnon se lancent dans l’ascension du glacier sans aucun équipement. En 2006, la revue National Geographic a envoyé trois alpinistes chevronnés refaire le trajet suivi par les deux hommes. « Ils n’ont toujours pas compris comment nous y étions arrivés. » Au sommet de la montagne, aucun village en vue, juste des cimes enneigées à perte de vue. « Là on s’est dit qu’on était vraiment foutus. » Mais un instinct plus fort que la mort surgit. Les survivants décident de descendre de l’autre côté. « Marcher jusqu’à en mourir. C’était comme courir un Iron Man, mais sans s’arrêter. Vous êtes dans un état où votre corps n’existe plus, c’est votre cerveau qui vous fait avancer. Dix jours plus tard et 25 kilos en moins, à bout de force j’ai vu un homme à cheval de l’autre côté d’une rivière. Il m’a lancé une pierre à laquelle il avait attaché de quoi écrire. Il nous a dit de ne pas bouger, qu’il reviendrait le lendemain avec des secours, car son village se trouvait à dix heures de route. C’est aussi là qu’on a appris qu’on était passés en Argentine. » Nando et Roberto sont envoyés à l’hôpital de San Fernando. Les hélicoptères partent sauver les 14 rescapés toujours coincés dans le cirque blanc.
Nando Parrado a ensuite continué ce qu’il appelle la deuxième partie de sa vie. Il a repris l’entreprise de son père, a été pilote automobile et producteur de télévision en Uruguay. « J’ai eu de grands succès dans mes affaires, mais quelle importance ? Mon héritage, c’est ma femme, mes deux filles et mes petits-enfants. Dans cet avion, il y a cinquante-deux ans, je me disais que jamais je ne ressentirais l’amour d’une famille. Pourtant, j’y suis parvenu. Nous sommes 16 survivants, mais notre histoire ne raconte pas une tragédie ni une aventure. Ce n’est pas un récit de courage et d’héroïsme, mais de vie et d’amour... Et vous savez quoi, ça en valait vraiment la peine. »

Cléo Döbberthin et Lorenzo Lo Schiavo sont artistes et designers. Ensemble, ils ont créé à São Paulo Palma leur studio de design. À Genève, le duo présentait en mai sa deuxième collection, Bingo, qui joue sur la forme, les matières et les références esthétiques. Par Emmanuel Grandjean
Leurs noms de famille ne le disent pas, mais Cléo Döbberthin et Lorenzo Lo Schiavo sont brésiliens. La première est artiste, le second architecte. Les deux se sont retrouvés sur les bancs de l’Université d’architecture de São Paulo « où la vision de la modernité était à ce point rigide qu’elle nous a traumatisés. Ça nous a rapprochés », se souvient Lorenzo Lo Schiavo, cofondateur en 2019 de Palma, le studio du tandem. Une vraie gageure dans un pays où, d’Oscar Niemeyer à Jorge Zalszupin, le mouvement moderne européen a durablement marqué les architectes et les designers. Plus que n’importe où ailleurs en Amérique latine. « J’ai connu Cléo lorsque j’habitais au Brésil, explique Laura Baer cofondatrice, avec Boris Liger, de la galerie de design Domum qui représente Palma à Genève. Elle était sculptrice et j’ai tout de suite adoré son travail. J’ai ensuite rencontré Lorenzo qui revenait de Londres après avoir terminé ses études à l’Architectural Association School. Revenue à Genève, j’ai appris qu’ils s’étaient associés pour produire des objets design. J’étais curieuse de voir ce que donnerait la réunion de leurs deux talents. Et c’était magnifique. En tant qu’architecte, j’ai toujours été sensible à tout ce qui touche à la géométrie, au travail de la ligne. Eux parviennent à donner de l’émotion et de la poésie à des formes très simples. Des sentiments exacerbés soit par la matérialité, soit par le travail sur les proportions. »
Comme ce jeu d’échecs dont toutes les pièces sont en fait des versions miniatures de la plupart des objets exposés chez Domum. Tout Palma en version mini. Un clin d’œil à Marcel Duchamp aussi, grand amateur d’échecs et auteur de la « Boîte en valise », musée portatif qui contient l’ensemble de
ses œuvres en taille réduite. « On a baptisé notre deuxième collection Bingo parce qu’elle tourne autour du jeu, continue Lorenzo Lo Schiavo. Vous trouverez des motifs de damier sur nos fauteuils et nos tables d’appoint. Il y a aussi un mikado dont les baguettes constituent une de nos lampes et un miroir en forme de jeu de l’oie inspiré par le disque de Phaistos, un trésor archéologique découvert en Crète au début du XX e siècle. Il porte, gravés dans l’argile, des hiéroglyphes que personne n’est encore parvenu à déchiffrer. Nous avons remplacé ces idéogrammes par les nôtres : un soutien-gorge, une abeille ou encore un poisson. »
Le jeu c’est aussi cette table basse spectaculaire en faux marbre où ce sont des incrustations d’aluminium qui imitent en trompel’œil les veines de la pierre.
Coquilles écrasées
Autre sujet d’admiration pour Laura Baer et Boris Liger : le fait que les deux designers fabriquent tout eux-mêmes. Comme ces carreaux qui recouvrent les faces de leurs fauteuils
Page précédente : Lorenzo Lo Schiavo et Cléo Döbberthin, le tandem à la tête de Palma (Anouk Schneider)
Ci-contre: Une lampe avec son abat-jour en mosaïque de coquilles d’œufs et ses pieds en baguette de mikado. (Anouk Schneider)


cubiques. Ils présentent une alternance de carré découpé dans des paillassons usagés soigneusement rasés à la main et de mosaïques de coquilles d’œufs écrasées. « Nous aimons expérimenter des techniques inattendues comme celleci. Surtout au Brésil où nous ne sommes pas familiers avec ce genre de tradition artisanale », observe Cléo Döbberthin. C’est d’autant plus vrai que les pièces de cette collection n’évoquent en rien le pays d’origine de leurs auteurs. Comme cette lampe dont le cache en verre peint ressemble au profil d’une petite montagne. Il vient en fait d’un dessin de 1911 pour une coupe à glace de Josef Hoffmann, le maître décorateur de la Sécession viennoise. « Nous l’avons reproduit en volume et nous nous en sommes servis ensuite pour imaginer un luminaire. Nous aimons aussi beaucoup transformer une image en objet. »
À l’imparfait
Il y a surtout les boutons des lampes de Cléo et Lorenzo, qui rendent Boris Liger extatique. Ils sont faits à la main en laiton, chacun signé et numéroté. « Ce soin au niveau de détail amène une vibration, une dynamique incroyable dans leur travail. Observez cette patine. Ou plutôt non, la patine c’est de l’usure. Ici c’est complètement autre chose. » Cléo Döbberthin abonde et reprend : « Cela raconte aussi le Brésil. Il est relativement difficile de se procurer des interrupteurs de qualité chez nous. Et
Le disque de Phaistos a servi de modèle pour ce miroir en forme de jeu de l’oie. (Anouk Schneider)


puis, dans le temps c’était un détail sur lequel les designers portaient une vraie attention. Plus maintenant. C’est pourquoi nous avons décidé de les fabriquer avec la même passion que pour n’importe laquelle de nos créations. C’est comme pour le cuir et les paillassons. Chez nous, il est compliqué de se fournir en beaux tissus comme on en trouve en France ou en Italie. Cependant, notre pays produit en abondance des peaux de très bonne qualité. »
« Une autre approche qui nous touche beaucoup avec Laura, c’est que Palma ouvre la porte au défaut dans le travail du
design, continue Boris Liger. Nous passons nos journées à vendre des produits fabriqués en série que l’on renvoie parce qu’ils ont été abîmés pendant leur transport alors qu’ils seraient faciles à réparer. Cléo et Lorenzo sont extrêmement précis, mais intègrent l’imperfection dans leur démarche. Cela nous donne à réfléchir, à nous poser des questions sur notre niveau d’exigence absurde. Une pièce design doit-elle être absolument parfaite ? Est-ce que l’imperfection ne peut pas être quelque chose de beau et d’émouvant ? Quelque chose qui peut aussi nous raconter une histoire. »

Discrètement installée depuis dix ans à Genève, la Fondation Etrillard se donne pour mission de conjuguer au présent les trésors du passé. Dans cette optique, elle a lancé un concours pour revisiter un fauteuil rare du XVIII e siècle provenant de ses collections.
Par Emmanuel Grandjean
L’objet est un siège français en acajou du XVIIIe siècle. Une pièce unique à la provenance prestigieuse – il appartenait au mobilier du château d’Anet construit par Henri II pour Diane de Poitiers – mais dont on ignore tout de son auteur. « Il s’agit de l’œuvre d’un ébéniste de grand talent. À cette époque, il n’y en a que deux : Jean-Baptiste-Claude Sené et Georges Jacob. Il s’agit très certainement du dernier » , explique Sophie Mouquin historienne de l’art, spécialiste des arts décoratifs, maître de conférences à l’Université de Lille et consultante auprès de la Fondation Etrillard, à qui le meuble appartient.
Version mouton
Si l’experte se retrouve dans les bureaux de cette institution, c’est parce que cette dernière, discrètement installée
à Genève depuis dix ans, a décidé de sortir du bois avec un concours. Elle a invité des artisans, des artistes et des designers suisses et français à revisiter son précieux meuble aussi appelé « bergère du débotté ». Il y a là des projets de chaises en verre soufflé, un autre, plus enfantin, en fer forgé en forme de mouton – « il pleut, il pleut bergère » –, mais le plus souvent, les propositions sont plutôt fabriquées en bois.
Sophie Mouquin fait ainsi partie du jury qui va départager les cinq dossiers retenus pour la première édition du Prix Âmes d’œuvres. La réinterprétation doit rester fidèle à l’usage du modèle original : à savoir, de permettre à celui ou celle qui s’y installe d’enlever ses bottes sans difficulté. « Le gagnant ou la gagnante recevra 40’000 francs pour mener à bien son projet. Il aura ensuite une année pour
le réaliser et nous le présenter. Nous étudierons alors la possibilité de l’exposer à travers de grands salons. » Après une journée de délibéré, c’est au menuisier en sièges Louis Monier qu’est revenu la récompense. Baptisée Artémis, sa pièce est d’une extraordinaire complexité « qui réside dans le fait que tous les éléments qui la constituent sont courbes, explique l’artisan parisien, élu Meilleur ouvrier de France. C’est à la fois très délicat et très technique, de faire en sorte que le jeu des lignes et des courbures entre en harmonie avec le volume globale du siège et que le message que l’on souhaite évoquer dans cette œuvre transparaisse dans sa forme. » Et pourquoi lui avoir donné le nom de la déesse de la chasse ? « C’est à la fois un clin d’œil au registre de la vènerie qui est représenté sur la bergère du débotté et une


Ci-contre : Guéridon aux griffons, attribué au bronzier François Rémond, vers 1785-1790.
(Collection Fondation Etrillard, Droits réservés)
Ci-dessus : Manufacture de Beauvais, tapisserie « L’Audience de l’empereur », vers 1700.
(Collection Fondation Etrillard, Droits réservés)
référence à celui ‹ à l’antique › très souvent présent dans l’œuvre de George Jacob, continue Louis Monier. Et puis dans le mythe d’Artémis, beaucoup de choses font le lien avec ma démarche : elle est à la fois déesse de la chasse mais aussi protectrice de la nature sauvage – ce que mon siège cherche à inspirer –, elle est pure et vierge mais aussi déesse de la fécondité et protectrice des femmes enceinte. Il y a donc l’idée d’une certaine transition, à l’âge adulte, comme celle d’un jeune apprenti menuisier devenant confirmé. Mon siège Artémis est donc une réinterprétation à la fois fougueuse et pleine d’humilité à l’égard de la bergère du débotté de George Jacob. Comme je le suis, à titre personnel, au regard de l’œuvre du plus grand menuisier en sièges de tous les temps, tant par son génie créatif que par sa considérable production. »
Traverser le temps
« Notre mission est de participer à la réconciliation des arts du passé avec ceux du présent, poursuit Gilles Etrillard, banquier d’affaires passionné d’art et de musique, pour définir la mission de l’institution qui porte son nom et dont il est le président. Le passé n’est pas une référence absolue. Nous sommes aussi intéressés par le futur et en quoi le présent augure de ce dernier.
Parcourir ainsi le temps, nous montre qu’il existe des valeurs immuables qui sont le beau et le vrai. Et que la distance qu’on ressent envers elles représente un éloignement qui nous fait sombrer dans des attitudes préjudiciables à la vie en commun et à la vie sociale. C’est pour cette raison que notre fondation s’attache à avoir dans sa collection des objets qui traverse le temps. » Un temps long qui va du Moyen Âge à la fin du XIXe siècle, avec une prédilection pour la tapisserie. La Fondation Etrillard possède ainsi une centaine de pièces qu’elle expose en partie dans ses bureaux qui bordent le parc des Bastions. « Notre collection est encore modeste, mais elle s’agrandit. Notre objectif est d’un jour pouvoir la monter au grand public. On nous demande aussi beaucoup de prêts. Une de nos croix reliquaire va bientôt partir au Musée de Cluny qui monte une exposition sur l’influence du Moyen Âge chez les romantiques », reprend Miguel Perez de Guzman, délégué général de la fondation.
Palais vénitien
Lui est espagnol, diplômé en management culturel et auteur d’une recherche sur l’influence de la peinture dans la photographie, notamment dans l’œuvre de l’Italien Luigi Ghiri. « Ses


images sont comme des tableaux. Sa connaissance de l’histoire de l’art était immense. Il a participé à la reconnaissance de la photographie en couleurs qui était, à son époque dans les années 60, considérée comme une photo d’amateur. J’ai émis l’hypothèse que Ghiri essayait ainsi de la légitimer comme une forme d’art puisqu’il s’inspirait du clair-obscur, du trompe-l’œil, du flou, bref de tout ce qu’on trouve dans la peinture. C’était drôle de me retrouver ici, où cette démarche de valoriser le passé avec la création du présent est exactement similaire. »
Un lien que la fondation aborde sur plusieurs plans et dans plusieurs domaines. Il y a la réinvention contemporaine d’un meuble ancien, on l’a vu. Laquelle passe aussi par une revalorisation de l’artisanat d’art à travers le soutien à l’École Boulle de Paris et une collaboration avec l’ECAL de Lausanne. « Des étudiants sont partis à Murano pour collaborer avec des maîtres verriers. Leurs créations ont ensuite été exposées à l’occasion de la Glass Week à Venise l’année dernière dans notre espace d’exposition du Palazzo Vendramin Grimani », continue Miguel Perez de Guzman.
La Joconde des manuscrits
Du côté du soutien à la musique, l’autre axe fort de la fondation, on joue une partition très ancienne. « Celle de la musique médiévale que nous soutenons depuis quatre ans en association avec la fondation Royaumont, la référence en France en la matière. Elle accueille des musiciens en résidence, des chercheurs et développe les moyens de transmettre les sources de cette musique méconnue aux générations d’aujourd’hui, y compris avec l’aide des nouvelles technologies. »
La fondation s’occupe également de la Joconde des manuscrits. On veut parler des Très riches heures du duc de Berry, sublime livre de prières richement enluminé vers 1410 et conservé au musée Condé au château de Chantilly. Toujours présenté fermé en raison de sa fragilité à la lumière, rares sont ceux à avoir pu le feuilleter. « À l’issue de sa restauration, dont nous sommes sponsors, il sera présenté les feuillets détachés. Et ce sera une première. »
On n’a pas encore parlé de la nature éclectique de cette fondation qu’on pourrait croire enfermée dans la chose muséale. Pour elle, l’héritage culturel n’est pas que l’affaire d’objets inanimés,
« La bergère du débotté », attribuée à George Jacob, 1775. C’est elle que les designers du concours ont réinventée. (Christophe Fouin)


quand bien même ils auraient une âme. Etrillard finance ainsi un Prix du patrimoine naturel qui offre 30’000 francs à un projet de réhabilitation paysagère, en France ou en Suisse, dans une démarche d’agriculture biologique ou de permaculture. « C’est Flore-Alpe, merveilleux jardin alpin valaisan, qui a obtenu la récompense cette année. Dans la foulée du concours de meuble, nous sommes
aussi en train de mettre sur pied un nouveau prix dans le champ des arts numériques, explique le délégué général. Alors oui, c’est vrai que nos intérêts sont très variés. Mais nous y voyons une continuité, une suite logique. Nous ne sommes pas des nostalgiques du passé, mais pas des aventuriers du futur non plus. Notre but reste de voir comment ces périodes peuvent dialoguer entre elles
En 1936, la Carrozzeria Touring de Milan invente le terme « Superleggera » pour qualifier sa technique de carrosseries superlégères. Depuis, le mot désigne aussi une chaise iconique, une moto mythique et la dernière édition d’Allure, le parfum pour homme de Chanel.
Fondateur de la Carrozzeria Touring en 1926, l’ingénieur milanais Bianchi Anderloni dépose en 1936, le brevet d’une méthode révolutionnaire de carrosserie superlégère. Inspirée par la construction aéronautique, elle consiste à l’assemblage, autour d’un châssis en bois, de tubes et de plaques d’aluminium. Plébiscité par les constructeurs automobiles, Touring va ainsi accorder sa licence à Alfa Romeo, Aston Martin, Lancia (le modèle Flami nia, voir photo), Lamborghini, Ferrari, Maserati ou encore BMW. L’entreprise ferme ses portes en 1966, mais renaît en 2006 sous l’impulsion d’un petit groupe industriel.

En Ligurie, on fabrique depuis le début du XIXe siècle une chaise typique appelée Chiavari, du nom de la ville où elle est produite. En 1955, après six ans d’étude, l’architecte et designer Gio Ponti proposait une version revisitée de ce trésor de l’artisanat italien : la Superleggera, chaise toute simple aux pieds fins et ne pesant que 1,7 kilo. Pour prouver l’efficacité de son design, Pon ti laissa tomber sa chaise du 4e meuble. L’objet rebondit sur le sol, comme une balle, sans aucun dommage.

Le flacon porte la signature « Superleggera » historique de la carrosserie Touring. Une manière d’affirmer à la fois le côté fringant du parfum Allure Homme Sport de Chanel dont c’est la cinquième déclinaison, mais aussi son côté frais et aérien avec ses notes de pamplemousse et d’ambre boisé.


Cadre, bras oscillant et jantes : chez elle, toutes les structures portantes du châssis sont en matériaux composites. De quoi réduire son poids de 6,7 kilos et d’être la seule moto homologuée du monde dans ce cas. La Superleggera V4 du fabricant de Bologne Ducati n’a été produite qu’à 500 exemplaires. Le prix de l’exclusivité.


Le photographe Paolo Woods expose à Renens des photographes de mariage venus des quatre continents. Des images pleines de bonheur qui sont aussi les témoins de leur temps. Par Richard Malick
Si on devait absolument le qualifier, on dirait qu’il se situe à la marge entre l’artiste et le journaliste. Depuis plus de vingt ans, le photographe Paolo Woods raconte les grands écueils qui bousculent notre société - l’évasion fiscale, le pharma-business, l’expansion spectaculaire de la Chine en Afrique ou encore l’île de Haïti où il a grandi – avec les codes conceptuels de la photographie contemporaine. Surtout, il entretient un lien fort avec la Suisse où il a travaillé en collaboration avec les journalistes Serge Michel et

Pages précédentes : Mariage en miroir en Haïti par la photojournaliste suisse Valérie Baeriswyl. ( Valérie Baeriswyl)
Ci-dessus : un mariage palmé en Suisse par Valérie Baeriswyl. ( Valérie Baeriswyl)
Ci-contre : Une pluie de pétales s’abat sur un couple indien photographié par le duo de Bombay, Sam & Ekta (Sam & Ekta)
Arnaud Robert avec lesquels il a cosigné plusieurs livres et expositions à succès. En 2021, Paolo Woods exposait avec ce dernier, à la Ferme des Tilleuls de Renens, Happy Pills, reportage en textes et images à la recherche de la pilule du bonheur. Le revoici trois ans plus tard au même endroit, mais cette fois pour présenter le travail des autres. Le photographe, qui vit et travaille à Florence, a choisi pour thème la photographie de mariage, ce genre censé fixer pour l’éternité le plus beau moment d’une vie, mais que la profession méprise. Paolo Woods a sélectionné huit professionnels de la prise de noce d’hier et d’aujourd’hui venant d’Inde, d’Italie, d’Espagne, d’Arabie saoudite, de Suisse, de Chine ou encore du Ghana. Et montre que loin du kitsch de la robe à voilette et de la pièce montée, la photographie de mariage est un style qui témoigne de l’évolution des mœurs et des modes à travers le temps.
« Oui je le veux ! », jusqu’au 15 décembre 2024, Ferme des Tilleuls, Renens, fermedestilleuls.ch



Précipitation nuptiale par le photographe espagnol

Ci-contre : En Arabie Saoudite, les règles interdisent de montrer le visage des femmes. Manal Alhumeed procède à un caviardage artistique et doré de ses clichés de mariage. (Manal Alhumeed)



Le 15 octobre 1924, André Breton publiait le « Manifeste du Surréalisme ». Cent ans plus tard, le Centre Pompidou retrace ce mouvement hautement poétique en convoquant ses mégastars, mais aussi en mettant à l’honneur les femmes artistes qui y ont participé. Par Emmanuel Grandjean

La guerre de 1914 n’a pas seulement laminé les vieux empires qui régnaient sur l’Europe. Elle a également douché les espoirs d’une génération d’artistes pour qui le premier grand conflit mondial était l’assurance de voir naître un monde nouveau sur les cendres de l’ancien. Les avant-gardes du début du XXe siècle vont largement être décimées sur les champs de bataille. Des futuristes italiens qui partirent la fleur au fusil en 1914, il n’en reste pratiquement plus aucun quatre ans plus tard. L’armistice signe la fin du massacre. Dans les villes, le retour à la vie normale
est difficile. Les blessés de guerre exhibent dans les rues les stigmates d’une boucherie qui fit 19 millions de morts. En art, l’expressionnisme allemand cède la place à une forme de réalisme social. Du côté des vaincus, les peintres de la Neue Sachlichkeit (la Nouvelle objectivité) montrent les gueules cassées et les amputés qui font la manche. Cent dix ans après Goya, Otto Dix grave sa version des horreurs de la guerre.
Esprits hagards
Du côté des vainqueurs, c’est l’esprit nouveau qui souffle. En France, le prix de la victoire est lourd, certes, mais il

pousse les expériences artistiques nées pendant la guerre – comme Dada qui veut tout renverser – dans d’autres retranchements. André Breton, qui a été affecté au centre neuropsychiatrique de Saint-Dizier dès 1916, soigne les soldats traumatisés de retour du front. Des esprits hagards qui fixent le vide, les yeux exorbités, ou sont pris de tremblements si violents qu’ils ne peuvent plus marcher. C’est aussi là que l’étudiant en médecine, bientôt écrivain, découvre les théories de Sigmund Freud. S’ouvrent alors à lui les portes de l’inconscient, de l’imaginaire et du rêve. Il en fera la matière puissante du surréalisme, dont il publie le manifeste le 15 octobre 1924. Il y a donc pile cent ans.
Un anniversaire que fête en ce moment le Centre Pompidou avec une fantastique exposition dans laquelle les visiteurs pénètrent en traversant une reproduction de la porte de l’Enfer, celle


Ci-dessus : « Sans titre (Main-coquillage) », une photographie de 1934 de Dora Maar. (Centre Pompidou, MNAM-CCI/Jacques Faujour/Dist. RMN-GP © Adagp, Paris, 2024)
Ci-contre : « Papilla estelar » de 1958 par l’artiste espagnole Remedios Varo. (FEMSA Collection © Adagp, Paris, 2024)

du cabaret situé juste en dessous de l’appartement de Breton et qui sera, pour lui, une source d’inspiration. Ce n’est pas la première fois que le musée présente ce mouvement dont les intervenants mettent le psychisme à l’œuvre. Ses deux commissaires, Didier Ottinger et Marie Sarré, ont choisi de mettre en lumière les acteurs, et surtout les actrices, qui ont poussé dans l’ombre de ces grands noms. « La dernière fois que le surréalisme a été exposé ici, c’était en 2002, rappelle Didier Ottinger. Il ne s’agissait pas de refaire la même exposition. » Il a donc fallu opérer des choix pour cet

accrochage de haute voltige dont la banque genevoise Mirabaud est l’un des sponsors principaux.
Magritte, Dali, Ernst et les autres
Les meilleures toiles de Magritte sont là, tous comme celles de Max Ernst, de Victor Brauner, de De Chirico, de Tanguy ou de Dali. Ou encore les photos en noir et blanc de Man Ray et les prises de vue de Paris la nuit de Brassaï. Leur nombre, volontairement restreint, permet aux visiteurs de découvrir les pépites de ce mouvement dont on pensait, depuis le temps, qu’on en avait fait le tour.
Notamment chez les femmes dont peu, comme Dora Maar, ont fait leur chemin dans l’histoire de l’art. Une situation paradoxale : les femmes avaient bien pris leur place dans le surréalisme, mais d’abord comme sujet. Elles sont les objets du fantasme érotique dont Hans Bellmer fabrique des poupées monstrueuses et désarticulées. On les retrouve aussi dans les figures d’Alice, celle du Pays des merveilles, et de Mélusine, créature mifemme, mi-serpent née au Moyen Âge et dont André Breton réveille le mythe pour en faire un être poétique « en communication providentielle avec les forces
élémentaires de la nature. » Et bien sûr dans celle de Gala, la muse adorée de Dali, omniprésente, nue languide ou habillée, dans les peintures du Catalan.
Messages oniriques
Sur les cimaises de Pompidou, le visiteur découvre cette fois les artistes féminines du mouvement. Les longues concrétions de pierre peintes par la Britannique Ithell Colquhoun ne laissent aucun doute sur l’interprétation de ses paysages inventés. L’Espagnole Remedios Varo représente des scènes d’intérieur étranges, remplies de symboles

magiques et de personnages-animaux nimbés dans un cosmos fortement inspirés par la peinture ancienne. Un théâtre de l’intime et du désir que l’on retrouve chez l’Américaine Dorothea Tanning, notamment dans son autoportrait que Max Ernst, son futur mari, intitula Birthday. Elle se peint, à moitié dénudée, dans un décor de portes ouvertes à l’infini avec, à ses pieds, un succube ailé à tête de lémurien. Un petit marsupial qui hante également les dessins troublants de Valentine Hugo, qui représente scrupuleusement ses rêves en y mettant bien en évidence sur la feuille de
« L’Empire des lumières » de 1954 par René Magritte.
(Bruxelles,
papier la date de ces messages oniriques. « Transformer le monde, a dit Marx. Changer la vie, a dit Rimbaud : ces deux mots d’ordre, pour nous, n’en font qu’un », écrivait André Breton dans son discours Position politique du surréalisme prononcé en 1935 au Congrès des écrivains. Le surréalisme pour transformer le monde ? On ne sait pas. Mais pour changer la vie, ça oui c’est certain. Allez à Pompidou pour vous en convaincre.
« Surréalisme. Le surréalisme d’abord et toujours », exposition jusqu’au 13 janvier 2025. Centre Pompidou, Paris, centrepompidou.fr

Avec son enneigement garanti, la station valaisanne attire une clientèle sportive et plutôt jeune. Propriétaire de Besson Immobilier, partenaire exclusif de SPG One-Christie’s International Real Estate, Rachel Besson explique les atouts de la station et analyse ses perspectives d’avenir. Par Marine Cartier





Sur cette page et la suivante: vues du penthouse Mettaney, un attique de 5 pièces, dont 4 chambres, sur deux niveaux. Installé dans les combles d’un immeuble de standing, cet appartement de 285 m2 au décor alpin typique est situé à 500 mètres à pied de la piste de ski du Rouge. (DR)
On sait le défi que doivent relever les stations de ski, de Suisse ou d’ailleurs. On veut parler du réchauffement climatique qui rend l’abondance des chutes de neige aussi fiable que la lecture de l’horoscope. Les villages alpins multiplient les parades en cas d’hiver sans manteau blanc. Elles ont aussi pris le pli de profiter de l’air frais de l’altitude, lorsqu’en plaine tout le monde étouffe en été. Juché à 1500 mètres, Verbier attire encore et surtout les skieurs. « L’altitude de la station et de son domaine combiné à la capacité des remontées mécaniques contribuent à garantir un bon enneigement », observe Rachel Besson, directrice de l’agence Besson Immobilier, partenaire exclusif à Verbier de SPG One-Christie’s International Real Estate. « Nos clients recherchent avant tout à faire un investissement immobilier où la pratique du ski perdurera. Ces dernières années, ils ont également ciblé des lieux offrant un éventail plus large d’activités de loisirs et des stations très animées
pendant les mois d'été. Verbier répond à tous ces critères, notamment à travers le Verbier Festival qui fait accourir, chaque mois de juillet depuis dix ans, les mélomanes de tous les pays. Et c’est pourquoi le marché de la vente est ici très dynamique. »
L’effet Weber
À chaque station sa petite particularité. À Gstaad, ce sont les boutiques chics et l’art contemporain avec ses galeries prestigieuses (Gagosian, Hauser & Wirth, Almine Rech, Patricia Low) et son salon Art Gstaad. À Crans-Montana, c’est aussi le luxe et l’art (la Fondation Opale est une voisine), mais avec un beau et vaste domaine skiable. Et Verbier ? Le village organise aussi son Verbier Art Summit, qui réunit chaque année le monde de l’art. « Globalement, Verbier attire une clientèle plus sportive, très bonne skieuse, vu la difficulté de ses pistes. Et donc relativement jeune, même si toutes les classes d’âge s’installent aussi ici, reprend
Double page précédente: Par sa situation près des alpages, ce chalet de prestige offre une vue à couper le souffle sur les Combins. Construit sur 4 étages, il compte 5 chambres à coucher en suite. Vieux bois, pierre, crépis et plancher à l'ancienne lui confèrent une atmosphère à nulle autre pareille. Il est également équipé d’un jacuzzi, d’un sauna, d’un hammam, d’un large vestiaire ski room et peut accueillir cinq voitures en extérieur, sous couvert ou à ciel ouvert. (DR)

Rachel Besson. En cela, Verbier a su cultiver l’image d’un village authentique de montagne grâce aux petits commerçants, aux bars et restaurants qui entretiennent cette ambiance chaleureuse. Pour combien de temps encore ? C’est un autre vrai défi. » D’autant plus que, comme souvent, l’offre immobilière dans les stations suisses tend à se raréfier, alors que la demande reste très soutenue. En 2012, le peuple acceptait la Lex Weber qui fixait à 20% la limite du parc de résidences secondaires pour chaque commune. « Douze ans après son acceptation par le peuple, la loi déploie aujourd’hui tous ses effets. Pour le bien de certaines communes les plus touchées par les restrictions, elle continue d’évoluer afin de s’adapter à leurs


Réalisation contemporaine de standing, le chalet Le R est composé de 7 pièces pour une surface totale de 510 m2 répartie sur trois niveaux. Construite avec des matériaux haut de gamme, la propriété dispose également d'un bel espace détente, avec sauna, hammam et salle de sport ainsi qu'un jacuzzi. Un home cinéma, une buanderie, un garage-box, un local à skis, 4 places de parcs couvertes et 1 place de parc extérieure viennent compléter ce bien unique. (DR)

Le chalet Tsappoïou. Niché sur un promontoire offrant une vue panoramique à couper le souffle sur le Val de Bagnes, ce chalet de 5 pièces, typique des Alpes valaisannes, a su préserver son charme et ses atouts d'antan. Construit sur un terrain de 590 m2, il est susceptible d’être agrandi. (DR)
besoins. À Verbier, elle a produit un effet pervers en contribuant à accélérer de manière significative la hausse des prix des résidences secondaires. Parce que devenus rares, ces objets existants ont naturellement pris de la valeur. »
Maîtrise de la spéculation
L’inflation, la force du franc suisse et l'incertitude générale quant à l'évolution de la géopolitique ont-elles eu un impact sur la demande ? « On a constaté une très légère conséquence indirecte de freinage de la demande sur le marché immobilier des résidences secondaires jusqu’au
printemps 2024, observe Rachel Besson. Un effet compensé par la baisse de 0,25 point à 1,5% du taux directeur de la BNS, qui a quelque peu relancé les projets d’investissement. »
En ce qui concerne l’avenir, l’agente immobilière du Val de Bagnes reste confiante. Mais ce futur radieux est soumis à certaines conditions. « Une destination n’est viable que s’il existe un certain équilibre entre les résidences secondaires et les lits touristiques (hôtellerie et parahôtellerie). Comme pour toutes les autres stations de ski, Verbier a autant besoin de propriétaires que de
vacanciers. La spéculation immobilière, si elle n’est pas maîtrisée, peut finir par tuer le tourisme. Il revient donc aux acteurs du développement touristique de trouver l’équilibre et aux acteurs de l’immobilier d’éviter d’entrer dans la ronde des prix hautement spéculatifs et de garder la tête froide. »
Pour tout renseignement sur les biens présentés dans ces pages, veuillez contacter SPG One-Christie’s International Real Estate, +41 58 861 31 00, spgone.ch ou contact@spgone.ch ou Besson Immobilier, +41 27 775 30 62, vente@besson.ch

Le guillochage, c’est l’art de faire vibrer le motif d’un cadran grâce à une technique traditionnelle de gravure minutieuse et complexe. Menacé de disparaître, le procédé revit avec l’ouverture d’une école de formation installée dans le Val-de-Travers.
Par Richard Malick

Il est Finlandais et considéré comme l’un des grands maîtres horlogers contemporains. Kari Voutilainen a fait du sauvetage du guillochage une affaire personnelle. Au point d’avoir ouvert cette année dans le Val-de-Travers une école qui forme à ce savoir-faire qui a failli disparaître dans les années 20. « Je dirais que c’est une technique perdue aujourd’hui, car il n’y a plus de formation. L’industrialisation fait qu’elle n’a pas complètement disparu, mais rien ne remplace la beauté du trait réalisé lors du guillochage à la main », observait l’horloger à la RTN, la chaîne de radio privée neuchâteloise. Problème : plus personne ne fabrique de guillocheuses depuis la fin des années 50. Il faut donc frapper aux portes des derniers grands maîtres qui en possèdent et qui eux seuls sont capables de les utiliser, de les réparer et, surtout, de transmettre leur savoir-faire. C’est ainsi que Georges Brodbeck a cédé ses machines à Kari Voutilainen en lui assurant son concours pour transmettre ses connaissances. On a déjà parlé dans ces colonnes d’Abraham-Louis Breguet, horloger génial, inventeur en 1801 du tourbillon
La Vingt-8 de l’horloger finlandais du Val-de-Travers
Kari Voutilainen. (Voutilainen)
qui permettait alors aux montres de poche de rester à l’heure. C’est le même qui, en 1786 alors jeune horloger neuchâtelois installé à Paris, s’intéresse au guillochage, vieille technique décorative dont les origines se perdent dans la nuit des temps. Le procédé, qui consiste à graver des réseaux de lignes – droites, courbes ou brisées – dans la matière, donne à l’objet qui le porte (boîtes à bijoux, boîtes à tabac) une esthétique originale et élégante. Mais pas seulement. Il est aussi le meilleur moyen de protéger les surfaces polies des rayures et du ternissement.
Clou de Paris
Le processus laisse une grande part de liberté créatrice. Breguet l’adapte à ses cadrans et crée une liste de motifs qui vont durablement marquer l’histoire horlogère : le fameux « clou de Paris » et ses picots en formes de pyramides immédiatement reconnaissables, mais aussi la crémaillère, le flinqué, le grain d’orge, le grain de riz ou encore le vieux panier. À partir du XIXe siècle, la manufacture va généraliser sa
Ci-dessous à gauche : La montre Colombes de Vacheron Constantin avec ses oiseaux guillochés. Inspirée par un dessin de Maurits Cornelis Escher, cette pièce unique a été proposée à la vente aux enchères Only Watch de 2011. (Vacheron Constantin)
Ci-dessous à droite : Un décor guilloché « clou de Paris » habille les flancs la Calatrava référence 5226 de Patek Philippe. (Patek Philippe)
production de cadrans guillochés, au point de supplanter ceux en émail. Et en faire sa marque de fabrique, encore aujourd’hui.
On l’a dit, l’histoire de la technique remonte à un passé lointain. Impossible d’attribuer à un auteur en particulier la création de ces motifs géométriques que l’on retrouve déjà dans l’Antiquité. Même l’étymologie du terme « guillochage » est sujette à interprétation. Il proviendrait du mot français « guilloche », qui fait référence à des motifs répétitifs et entrelacés gravés sur une surface. On le dit aussi inspiré par les décorations architecturales sous forme de gouttes d’eau fabriquées en pierre par des artistes italiens au XVIe siècle. La gocciolare (goutte) ayant ensuite donné naissance à ghiocciare, un terme ancien traduit par « guillocher ». Il pourrait également provenir d’un ouvrier français de la fin du XVIIIe siècle, un certain Guillot, inventeur
d’une machine-outil à pédale conçue pour graver dans l’ivoire et le bois les courbes entrelacées parfaitement adaptées à la décoration des montres.
Autre époque
La machine justement. Ceux qui ont déjà visité une manufacture qui pratique ce type de décors sont toujours surpris de constater que les outils ont finalement peu changé depuis le XIXe siècle. La précision et la minutie requise par la gravure sur une surface de la taille d’une pièce de 2 francs réclament le travail de la main et l’œil affuté du guillocheur ou de la guillocheuse sur des outils d’une autre époque. Des machines, il en existe ainsi de toutes sortes : tours à flinquer pour dessiner des secteurs réguliers, guillocheuses à ligne, guillocheuses dites « à tapisserie » avec lesquelles il est possible de créer des fleurs sculptées en profondeur ou des décors à trois dimensions.


D’autres moyens, disons plus industriels, permettent d’obtenir un résultat identique. Le décor des cadrans de la Nautilus de Patek Philippe, par exemple, sont emboutis par pression sur une matrice guillochée. Certaines fabriques font appel à des machines numériques. Reste qu’il y a toujours un guillocheur derrière la CNC pour la programmer.
Le tram qui vibre
Revenons à la main et à l’œil. Le tour à guillocher est généralement posé à l’horizontale. Il se compose d’un imposant cylindre métallique, appelé l’arbre, cerné d’un empilement de cames qui présentent le motif à graver. L’artisan actionne une manivelle qui fait lentement tourner l’arbre. De son autre main,

il pose délicatement le burin, fixé sur un chariot, qui va creuser la surface à guillocher. Et réitérer ainsi l’opération autant de fois que nécessaire, parfois plus d’un millier. Pour dire que le travail requiert non seulement une grande précision, mais aussi une concentration de tous les instants : une ligne qui part de travers et tout le dessin est à recommencer.
Silence de rigueur et vibration proscrite, donc. Dans sa manufacture de Plan-lesOuates, Vacheron Constantin a installé ses ateliers de guillochage en fonction de la ligne du tram qui passe sous ses fenêtres, histoire de ne pas subir les vibrations occasionnées par le convoi. Comme Breguet, la manufacture genevoise se fait fort de perpétuer une
tradition dont elle a, elle aussi, écrit l’histoire en inventant le guilloché figuratif capable de dessiner des objets sophistiqués comme des fleurs ou des animaux. Le guillochage est ainsi redevenu la marque d’excellence des grandes manufactures, un art gage d’authenticité et de qualité. Mais où les prix sont aussi élevés que le travail pour y parvenir est long et minutieux. Sur le marché il existe un segment moins cher qui s’y intéresse aussi beaucoup. En 2021, Louis Érard lançait son modèle Excellence Guilloché Main affichant un motif de cubes en trompel’œil bluffant proposé à un tarif défiant toute concurrence : 3900 francs. Les 99 exemplaires ont, bien entendu, tous été vendus.


La plus ancienne montre de poche en or de la collection privée de Vacheron Constantin à présenter un travail guilloché sur le cadran et le boîtier. Elle date de 1780. (Vacheron Constantin)
Breguet Classique Chronométrie.
Le fondateur de la marque a été l’un des pionniers dans le guillochage horloger (Breguet)


Ouverte en 2014 à la Chaux-de-Fonds, la Maison des métiers d’art Cartier fête cette année ses 10 ans. Son but ? Préserver et enseigner des techniques horlogères et joaillères menacées de disparition.
Par Emmanuel Grandjean

Création de microbilles en or, une technique appelée aussi granulation étrusque. (DR)
C’est une grosse ferme typique des campagnes neuchâteloise et bernoise. Un bâtiment rustique du XVIIe siècle de trois étages, à l’intérieur duquel on conserve des savoir-faire en péril. Mieux dit, c’est ici qu’on perpétue la vivacité et l’enseignement de métiers d’art rares. Cette initiative, on la doit à Cartier qui, en 2011, achetait à la Chaux-deFonds cette bâtisse de 1500 mètres carrés qu’il a ensuite fallu rénover pour la transformer en atelier.
Le cabinet A&A Atelier et Gilles Tissot, spécialiste dans la restauration de fermes anciennes, ont ainsi complètement recomposé les espaces tout en respectant la volumétrie et la forme originelles de l’édifice. D’où cette alliance réussie entre le vernaculaire (sol en pierre, portes d’époque et cheminée) et les exigences contemporaines du projet. La lumière, notamment, devait impérativement y entrer généreusement. Un puits central qui traverse tous les étages garantit un éclairage naturel indispensable aux artisans horlogers et joaillers qui travaillent ici.
Fourrure de diamants
Dès le départ, l’idée de cette Maison des métiers d’art est d’y développer une production de collections de prestige faisant appel à des techniques de l’horlogerie et de la joaillerie. Comme le serti pelage, propre à Cartier, qui consiste à assembler des pierres minuscules en donnant à l’ensemble l’aspect de la fourrure. Ou encore cette granulation étrusque, qui signifie pour le maître artisan de fabriquer à la main des billes d’or de tailles différentes et de les déposer une à une sur les motifs en creux d’un cadran. Ces grains précieux peuvent ainsi composer tout en nuances la tête d’une panthère, le félin fétiche de la marque. Et la montre devient un bijou.
Ces procédés forment l’ADN de la maison de haute horlogerie et de joaillerie. Pour elle, leur préservation est plus
qu’une mission : c’est un devoir et les enseigner le moyen d’assurer la pérennité d’entreprises plus que centenaires. Il y a trente ans, Cartier ouvrait son Institut horlogerie à Couvet, à quelques kilomètres de la Maison, pour former ses apprentis. Ils sont aujourd’hui entre 150 et 200 à étudier les arts du feu, du métal et de la composition.
Microfluide et impression 3D
Faire vivre le passé, c’est bien. Mais partir de ce dernier pour développer de nouvelles techniques, peut-être appelées à devenir des classiques, c’est encore mieux, voire indispensable. « L’esprit de ce lieu est unique : préserver et transmettre des métiers d’art souvent oubliés ou peu pratiqués, dans une dynamique où l’innovation a toute sa place et vient nourrir la créativité sans limites de Cartier, abonde Karim Drici, directeur industriel de la marque. Nous sommes convaincus que c’est ce dialogue entre tradition et modernité qui permettra aux métiers d’art de traverser le temps et de demeurer un patrimoine plus vivant que jamais. » C’est là qu’on parle des microfluides, ceux qui font apparaître ou disparaître le motif de la montre Révélation. Soit le dessin d’une panthère, constitué de 650 diamants qui se déplacent au gré du mouvement du poignet, mais qui, au repos, doivent revenir à leur place. La nature du liquide qui régule la vitesse de déplacement des brillants est une innovation qui a fait l’objet d’un dépôt de demande de brevet. Autre exemple : la montre Coussin. Sa boîte est constituée d’une trame quadrillée composée de mailles d’or, pavée de pierres de couleur et de diamants, qui reposent sur une structure centrale souple. C’est à partir de l’impression 3D utilisée dans les technologies médicales que les artisans ont pu déterminer les contours, juste pour que la boîte se déforme et se retende. Pour ainsi retrouver sa forme d’origine.
En haut: La charpente de l’ancienne ferme du XVIIe siècle a été conservée. (DR)
En bas: Le boîtier souple de la montre « Coussin » a été inspiré par les technologies 3D utilisées en médecine. (DR)


Chez le constructeur de Molsheim, en Alsace, produire des voitures pour enfants est une tradition qui remonte aux années 20. En 2024, sa nouvelle Bugatti Baby II s’inspire de La Tourbillon, son dernier hyperbolide.
Par Cora Miller

Elle rappelle les voitures à pédales de nos grands-parents. Mais en version superluxe, la petite auto portant sur ses roues le monogramme « EB » d’Ettore Bugatti. Cette Bugatti Baby II Tourbillon Edition sera produite à 500 exemplaires. Son prix ? Mystère. Prévoyez large pour Noël, la Tourbillon, dernière-née des hypersportives du mythe automobile, et dont ce modèle reprend la palette de couleurs, s’échangeant quand même aux alentours de 4 millions de francs. Sachant aussi que la petite merveille, entièrement fabriquée à la main, nécessite 200 heures de travail.
Le constructeur alsacien perpétue en cela une tradition qui remonte à 1926, lorsque le fondateur de la marque et son fils Jean offrirent à Roland, le fils de celui-ci, une petite Bugatti pour l’anniversaire de ses 4 ans. Le succès auprès des clients fut tel que les Bugatti décidèrent de commercialiser ces minisbolides
jusqu’en 1936. Aujourd’hui, ce sont les Anglais de Hedley Studios à qui la marque française délègue le soin de fabriquer ces Bugatti, pas forcément destinées aux enfants d’ailleurs, l’habitacle pouvant facilement contenir un gabarit d’adulte. Voiturette électrique capable de monter à 70 km/h, elle reprend la ligne de la légendaire Bugatti Type 35 dévoilée au Grand Prix de l’Automobile Club de France de 1924 à Lyon, mais à une échelle réduite de 25%. Montés sur un châssis en bois, les panneaux en aluminium de l’auto sont martelés à la main. Dans le cockpit, c’est le cuir qui domine. Tandis que sur le tableau de bord, les indicateurs historiques de pression de carburant et de niveau d’huile ont été remplacé par des jauges de puissance et de batterie.
Bugattibaby.com


David Pearson est « winemaker » pour Joseph Phelps, domaine californien de Napa Valley récemment acquis par Moët Hennessy. Rencontre avec un œnologue délicieux et franc, comme un bon cabernet Par Emmanuel Grandjean
Il fait tourner dans son verre une cuvée 2021 d’Insignia, le cru premium de Joseph Phelps, assemblage de cabernet sauvignon, cabernet franc et malbec. Joseph Phelps ? Le nom ne vous dit peut-être rien. Normal. C’est que ce vin vient de loin. De cette Napa Valley californienne qui, depuis quelques années, se fait gentiment un nom chez les amateurs de bonnes bouteilles. « Les tanins sont présents tout en restant souples. Le millésime 21 est considéré comme très qualitatif. Cette année-là a été chaude, mais sans canicule. La sécheresse a produit des raisins petits avec des sucres très concentrés, analyse David Pearson, le nouveau winemaker follement sympathique de ce domaine acquis, en 2022, par le groupe LVMH. Ici en Europe, vous n’avez pas l’habitude de boire des vins aussi jeunes. J’essaie de convaincre les gens que c’est tout à fait possible. »
Le pape de Napa
Le vigneron embraie ensuite avec une note historique. « Joseph Phelps a fait fortune dans la construction, mais rêvait de produire son propre vin. En 1972, il achète 200 hectares sur lesquels il plante des vignes. En 74, il sort son premier millésime. » Et déroule dans la foulée son CV de passionné de vin au point d’en faire son métier : diplôme d’œnologie à University of California, Davis en 1984, vigneron stagiaire sur la côte Ouest, puis séjour obligatoire en France durant un an. Avant de faire un break pendant six ans. « Je détestais l’aspect commercial de ce métier. À l’époque aux ÉtatsUnis, les services marketing n’y connaissaient absolument rien. Un jour, un type m’a demandé combien de fois par an je vendangeais mes vignes. Vous voyez le niveau. » David Pearson, dès lors, bifurque et se lance dans la recherche d’analyse sensorielle pour une boîte qui possède aussi des domaines dans la Napa Valley, dont le château Inglenook aujourd’hui propriété de la famille Coppola. « Ça m’a remotivé.
J’ai décroché un MBA en marketing du vin. Un jour, un chasseur de têtes m’appelle pour me dire que Robert Mondavi nourrissait un grand projet en France. » Autant dire que le pape de Napa cherche à étendre son empire au Vieux-Continent. Le genre d’offre impossible à refuser.
Traumatisme profond
Le vigneron de San Diego se lance dans l’aventure. On est en 2000. L’idée ? Faire émerger de la petite commune d’Aniane, dans le Languedoc, un grand vignoble. David Pearson a trouvé les terres. Le maire socialiste de l’époque signe une convention au terme de laquelle Mondavi pourra exploiter pendant cinquante ans, et contre un loyer annuel, ces 50 hectares de terrain. En contrepartie, l’homme d’affaires américain promet d’investir 60 millions de francs et d’associer les coopératives dans ce projet dont le succès est promis à l’échelon mondial. Mais au bout de quatre ans, l’ancien maire est remplacé par un nouveau qui, jugeant le loyer de 35’000 francs ridiculement bas, fait capoter l’affaire. Dans la région, les pro– et les anti-Mondavi se déchirent. Le roi de Napa et son vigneron baissent les bras et rentrent aux États-Unis. Jonathan Nossiter utilisera cette déroute comme trame de son documentaire Mondovino, présenté au Festival de Cannes en 2004. Le film rencontrera un franc succès, plongeant David Pearson dans un profond traumatisme. « Ça a été terrible. J’ai eu l’impression qu’on m’arrachait mon enfant. J’ai vu le pire et le meilleur de la France. Un jour, j’écrirai un livre sur cette histoire. » Retour à la Valley, donc, et à ses 450 kilomètres carrés de vignes. « Je suis devenu CEO d’Opus One, le domaine du baron Philippe de Rothschild et de Robert Mondavi. Au bout de seize ans à ce poste, je me suis dit qu’il était temps de concrétiser mon vieux rêve de produire mon propre vin. » La blessure française s’étant refermée, c’est vers l’Hexagone que le mène son cœur



d’œnologue. Mais le rêve attendra. Il y a un peu plus d’un an, Moët Hennessy, propriété du groupe LVMH, frappait à sa porte pour dorloter le domaine Joseph Phelps. « J’ai accepté tout en précisant que je continuerais à travailler à mon projet personnel. Le CEO, Philippe Schaus, a tout de suite adhéré », continue David Pearson en invitant à déguster un deuxième cru.
Sol vivant
Ce n’est pas qu’on avait un a priori sur ces vins américains que l’on connaît finalement assez mal. Quoique si, quand même un peu. On s’attendait à un jus surpuissant et sucré, dans le genre de ceux que Robert Parker a longtemps promus dans son fameux guide, au point de changer durablement la face du monde viticole, notamment du côté de Bordeaux. On goûte en fait tout le contraire : un vin pas trop boisé, pas trop « confituré ». Un excellent cabernet sauvignon de 2019. « Avant d’entrer chez Phelps, j’étais très intéressé par les nouvelles approches en viticulture comme la permaculture, la polyculture ou encore l’agroécologie, reprend le vigneron californien en reposant son verre. J’ai découvert cette dernière technique en France, à Cheval Blanc où depuis dix ans ils faisaient pousser leurs vignes au milieu des arbres. Pas n’importe lesquels. Les chênes, par exemple, entreraient en concurrence avec les ceps. L’érable ou les fruitiers, en revanche, vivent très bien avec la vigne. Ce sont des espèces qui ont coévolué et dont les racines sont connectées grâce au mycélium. »
Et la biodynamie ? « C’est différent, c’est fondé sur les racines, le palissage, des cornes qu’on enterre et les cycles de la lune. J’ai essayé, mais pour moi c’est à moitié de l’astrologie. L’objectif est de rendre le sol vivant, de faire en sorte que la vigne puisse vivre cent ans. L’agriculture est une lutte permanente avec et contre la nature. Avec, parce qu’elle nous apporte des produits
fabuleux pour peu qu’on la soigne. Contre, parce que des insectes et des virus attaquent sans arrêt les vignes, réduisant nos efforts à néant. Je pense que l’agroécologie est la bonne réponse à ces problèmes. »
Vin bizarre
Il y a une chose, en revanche, qui ne passe pas chez David Pearson : le vin orange. Très à la mode en ce moment, cette méthode de vinification ancestrale venue de Géorgie donne des vins troubles et âpres. « Alors oui, je comprends que les goûts changent, que les jeunes cherchent d’autres expériences, mais je suis complètement perdu par cet engouement. En Ardèche, il y a un ancien sommelier du restaurant Noma de Copenhague qui a tout quitté pour s’installer là-bas avec femme et enfants. Il m’a fait goûter son vin orange, un assemblage de gewurztraminer et de cabernet. J’ai trouvé ça vraiment très bizarre. Peut-être que je suis en train de passer à côté de quelque chose, mais je suis un peu de la vieille école. Je me pose souvent la question de savoir si à l’époque de l’impressionnisme, je me serais rangé du côté de ceux qui auraient adoré ou qui auraient détesté. J’aime à croire que j’aurais appartenu à la première catégorie. » Les jeunes justement. En France, les viticulteurs sont à la peine, leurs vins ne se vendant plus aussi bien qu’avant. La faute à la nouvelle génération qui préfère la bière et les cocktails au sang de la terre. « C’est normal. Ils vivent l’hédonisme de l’instant. Quand vous leur dites qu’il faudra attendre vingt ou trente ans avant de déguster une grande bouteille, ils vous regardent avec des yeux ronds. Le vin, c’est du storytelling. C’est le plaisir d’écouter un vigneron qui vous raconte comment s’est déroulée son année, de partager les souvenirs d’une personne qui, un jour, a bu un vin magnifique. C’est un produit magique, le seul que je connaisse qui suscite cette extraordinaire convivialité. »

Verbier
Niché au cœur des alpages, ce bien unique de 7 pièces vous séduira par ses espaces généreux et conviviaux. Bâtie sur 4 étages, la propriété bénéficie de 5 belles chambres ainsi que d’un espace wellness composé d’un jacuzzi, d’un sauna et d’un hammam. Le chalet a été soigneusement décoré et offre une vue époustouflante sur les montagnes avoisinantes.
+41 22 849 65 07 contact@spgone.ch | spgone.ch
En partenariat avec Besson Immobilier SA

650 m² habitables
5 chambres
5 salles de bains
2’468 m² de parcelle Prix sur demande



Cette maison de maître bénéficie de 10 pièces et offre un emplacement idéal pour les amateurs de tranquillité et de nature. Un projet de rénovation intérieure ainsi qu’une extension des deux ailes du bâtiment sont disponibles.
350 m² 4 4 3’000 m²
CHF 12’900’000.–

Cette somptueuse villa contemporaine offre des volumes exceptionnels, un jardin bien entretenu, une piscine avec pool house ainsi qu’une magnifique vue sur le lac, le Jura et les montagnes environnantes.
350 m² 6 5 3’323 m²
+41 22 849 65 09 contact@spgone.ch | spgone.ch
CHF 20’000’000.–

Cologny
Érigée sur une parcelle joliment arborée, cette sublime demeure de 14 pièces offre de beaux volumes et une piscine intérieure. Elle bénéficie d’une magnifique vue sur le lac, le Jura ainsi que sur son noble jardin à la française agrémenté d’un bassin. 560 m² 7 6 3’200 m² Prix sur demande
+41 22 849 65 09 contact@spgone.ch | spgone.ch

Cologny
Située dans une impasse et à l’abri de toutes nuisances, cette magnifique maison de 9 pièces bénéficie de grands volumes.
Son vaste jardin agrémenté d’une belle piscine offre une vue exceptionnelle sur le lac. 320 m² 6 5 1’271 m² Prix sur demande

En plein cœur de la campagne genevoise, ce splendide domaine offre un cadre de vie exceptionnel. Composé de plusieurs bâtiments, il jouit d’une belle bâtisse datant du XVIIIe siècle et d’une ancienne écurie reconvertie en piscine intérieure. 1’020 m² 8 6 6’027 m² Prix sur demande
+41 22 849 65 09 contact@spgone.ch | spgone.ch



Jouissant d’une vue dégagée et d’un environnement calme, cet attique en duplex de 5 pièces est baigné de lumière grâce à ses grandes baies vitrées ouvertes sur une terrasse de 52 m 2. Une cave et un box complètent ce bien d’exception. 188 m² 2 2 Prix sur demande
+41 22 849 65 09 contact@spgone.ch | spgone.ch

Cette somptueuse maison de maître a été construite en 1800. Répartie sur 3 niveaux, elle jouit de 18 belles pièces et d’une vue imprenable sur le lac. Une dépendance attenante à la propriété peut accueillir le personnel de maison.
740 m² 11 8 6’000 m² Prix sur demande
+41 22 849 65 08
contact@spgone.ch | spgone.ch

Givrins
Cette sublime maison individuelle de 9.5 pièces a été entièrement rénovée en 2021. Son jardin bucolique avec sa belle piscine ainsi que ses larges terrasses jouissent d’une vue panoramique sur le lac et les montagnes environnantes.
370 m² 5 5 2’089 m²
Prix sur demande

Caux
Sise sur les hauteurs de Montreux, cette magnifique propriété est répartie sur 3 niveaux et se démarque par son charme unique ainsi que son jardin agrémenté d’une superbe terrasse et d’un jacuzzi avec vue imprenable sur le lac.
800 m² 5 6 1’760 m²
+41 22 849 65 08 contact@spgone.ch | spgone.ch
Prix sur demande
Bénéficiez de notre accompagnement pour votre projet immobilier à l’international. En partenariat avec Christie’s International Real Estate et ses 138 affiliés, SPG One vous ouvre les portes des plus belles propriétés à travers le monde. À la montagne, au bord de la mer ou dans les villes les plus influentes, découvrez une sélection de nos résidences de rêve parmi plus de 25’000 propriétés référencées.

ÉTATS-UNIS - New York
Villa de 929 m² • 59’000’000 USD

- Cascais
Townhouse de 509 m² • 15’076’485 EUR

JAPON - Chitose
Appartement de 477 m² • 3’255’500 JPY

MAROC - Marrakech
Maison de 500 m² • 4’950’550 DH

AFRIQUE DU SUD - Le Cap
Propriété de 635 m² • 5’497’751 ZAR

THAÏLANDE - Phuket
Résidence de 1’863 m² • 6’800’000 THB
SPG ONE SA
Case postale 6255 - 1211 Genève 6 +41 22 849 65 06 | contact@spgone.ch | spgone.ch




