

































































































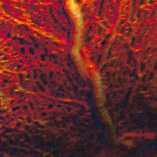





ROMAN TRADUIT DE L’AMÉRICAIN PAR SERGE CHAUVIN


Fille d’un ingénieur canadien collaborant avec le commandant Cousteau, Evie a douze ans lorsqu’elle attrape le virus de la plongée et décide de consacrer sa vie à l’exploration des fonds marins.
Ina, une artiste polynésienne, compose des sculptures avec des déchets plastiques qu’elle glane sur les plages. Peu à peu, une étrange créature prend forme.
Todd et Rafi, deux lycéens américains que tout oppose, cimentent une intense amitié autour du jeu de go ; l’un se perdra dans la littérature, l’autre révolutionnera l’intelligence artificielle.
Avec la virtuosité qu’on lui connaît, Richard Powers met en scène une poignée de personnages à différentes périodes de leur vie, avant de les réunir à Makatea, île du Pacifique ravagée par des décennies d’extraction minière, où se joue la prochaine grande aventure de l’humanité : la construction de villes flottantes.
Mêlant science, écologie et poésie, Un jeu sans fin sonde les mystères de l’océan et les potentialités infinies des nouvelles technologies pour célébrer la beauté et la résilience de la nature.
“Lettres anglo-américaines”
Né à Evanston, dans l’Illinois, en 1957, Richard Powers est l’auteur de quatorze romans, dont, au Cherche-Midi, Trois fermiers s’en vont au bal, Le Temps où nous chantions, La Chambre aux échos (National Book Award 2006), L’Arbre-Monde (prix Pulitzer 2019) et, chez Actes Sud, Sidérations (finaliste du National Book Award et du Booker Prize 2021)
TROIS FERMIERS S’EN VONT AU BAL, Cherche-Midi, 2004 ; 10/18 n° 3887.
LE TEMPS OÙ NOUS CHANTIONS, Cherche-Midi, 2006 et 2013 ; 10/18 n° 4053.
LA CHAMBRE AUX ÉCHOS, Cherche-Midi, 2008 ; 10/18 n° 4269.
L’OMBRE EN FUITE, Cherche-Midi, 2009 ; 10/18 n° 4317.
GÉNÉROSITÉ, Cherche-Midi, 2011 ; 10/18 n° 4577.
GAINS, Cherche-Midi, 2012 ; 10/18 n° 4720.
LE DILEMME DU PRISONNIER, Cherche-Midi, 2013 ; 10/18 n° 4839.
ORFEO, Cherche-Midi, 2015 ; 10/18 n° 5104.
L’ARBRE-MONDE, Cherche-Midi, 2018 ; 10/18 n° 5475.
OPÉRATION ÂME ERRANTE, Cherche-Midi, 2019 ; 10/18 n° 5573.
SIDÉRATIONS, Actes Sud, 2021 ; 10/18 n° 5841.
Titre original : Playground
Éditeur original : W. W. Norton & Company, New York © Richard Powers, 2024
Publié avec l’accord de Melanie Jackson Agency, llc par l’intermédiaire d’Anna Jarota Agency
Photographie de couverture : © Getty images, 2025
© ACTES SUD, 2025 pour la traduction française
ISBN 978-2-330-20038-1
roman traduit de l’anglais (États-Unis)
par Serge Chauvin
Pour Peggy Powers Petermann (1954‑2022), qui m’avait offert un livre sur les récifs coralliens quand j’avais dix ans.
Et pour RayRay, mon vieil ami : Sept cent cinquante mille mercis –Allez, on arrondit à un million.
Avant la terre, avant la lune, avant les étoiles, avant le soleil, avant le ciel, avant même la mer, il n’y avait que le temps et Ta’aroa.
Ta’aroa créa Ta’aroa. Puis il créa un œuf qui l’abriterait. Il fit tournoyer l’œuf dans le néant. Blotti au sein de l’œuf tournoyant, suspendu dans ce vide sans fin, Ta’aroa attendit.
À force d’attendre éternellement dans ce temps sans fin, Ta’aroa se lassa d’être niché dans son œuf. Alors il secoua son corps et fendit la coquille et se glissa hors de cette prison qu’il s’était faite.
Au-dehors, tout était silencieux et figé. Et Ta’aroa vit qu’il était seul.
Étant artiste, Ta’aroa joua avec ce qu’il avait. Son premier matériau fut la coquille d’œuf. Il l’émietta en innombrables morceaux qu’il laissa retomber. Les miettes de coquille se déposèrent pour former les fondations de la Terre.
Son deuxième matériau, ce furent les larmes. Il pleura d’ennui et de solitude, et ses larmes nourrirent les océans de la Terre et ses lacs et tous les fleuves du monde.
Son troisième matériau, ce fut l’os. Il se servit de sa colonne vertébrale pour créer des îles. Des chaînes de montagnes surgirent partout où ses vertèbres émergeaient des flaques de ses larmes.
La Création devint un jeu. Avec ses ongles de mains et de pieds, il façonna les écailles des poissons et les carapaces des tortues. Il s’arracha les plumes pour les transformer en arbres et en buissons, qu’il peupla d’oiseaux. Avec son propre sang, il déploya un arc-en-ciel dans les nuées.
Ta’aroa convoqua tous les autres artistes. Et les artistes vinrent à lui avec leurs paniers remplis de matériaux : du sable et des galets, de l’herbe et des feuilles de palme et des fils tissés des fibres de mille plantes. Et de concert avec Ta’aroa, les artistes façonnèrent et sculptèrent Tāne, le dieu des forêts et de la paix et de la beauté et de toutes choses construites.
Alors les artistes firent exister les autres dieux – par dizaines. Des dieux bons et des dieux cruels, des dieux amoureux, des dieux ingénieux, des dieux facétieux. Et ces dieux emplirent le reste du monde naissant en lui apportant la couleur, le trait et les créatures de toutes espèces – créatures de la terre, des airs et de la mer.
Tāne décida de décorer le ciel. Il joua avec les possibilités, parsemant tout ce noir de points de lumière qui tournoyaient en un grand carrousel autour du centre de la nuit. Il créa le soleil et la lune, qui partagèrent le temps entre jour et nuit.
À présent qu’il y avait des jours et des mois, à présent que le monde était animé d’une vie qui foisonnait et se ramifiait, à présent que le ciel lui-même était une œuvre d’art, il était temps pour Ta’aroa de terminer son jeu. Il modela et divisa le monde en sept couches, et à la dernière des couches inférieures il plaça les humains – enfin des compagnons avec qui jouer.
Il regardait les humains déchiffrer le monde et cela le ravissait. Les humains se multiplièrent et peuplèrent la couche inférieure comme des poissons peuplent un récif. Les humains découvrirent des plantes et des arbres et des bêtes et des coquillages et
des roches, et avec toutes ces découvertes ils créèrent des choses nouvelles, tout comme Ta’aroa avait créé le monde.
À force de se multiplier, les hommes se sentirent confinés. Alors, quand ils découvrirent le portail qui menait au niveau supérieur – ce seuil que Ta’aroa leur avait caché exprès –, ils en forcèrent l’ouverture, le franchirent et se répandirent de plus belle, une couche plus haut.
Et c’est ainsi que les humains continuèrent à peupler et à grimper, à peupler et à grimper. Mais chaque couche nouvelle appartenait encore à Ta’aroa, qui avait mis toutes choses en mouvement du fond de son œuf tournoyant.
Il a fallu qu’une maladie me ronge le cerveau pour que j’arrive à me souvenir.
Tous les trois, on rentrait du campus un soir de décembre, il y a près de quarante ans. C’était l’année où pour la première fois Ina avait mis le pied sur un continent. On venait de voir La Tempête interprétée par une troupe d’étudiants, et elle avait sangloté pendant tout le dernier acte. J’étais bien incapable de comprendre pourquoi.
Avec Rafi, on l’a raccompagnée à son foyer, à une dizaine de rues du centre du campus. Ina n’avait pas l’habitude des rues quadrillées. Elle s’y perdait. Tout l’en détournait, tout la déconcentrait et la figeait sur place. Un corbeau. Un écureuil gris. La lune de décembre.
On essayait de la réchauffer, Rafi et moi, chacun d’un côté d’elle, chacun presque deux fois plus grand. Le premier hiver de sa vie. Le froid était assassin. Elle répétait sans cesse : “Mais comment les gens peuvent vivre là dedans ? Comment font les animaux pour survivre ? C’est insensé ! C’est de la folie pure !”
Et puis elle s’immobilisa sur le trottoir et nous tira par les coudes. Son visage rougi était tout rond de saisissement. “Oh, mon Dieu. Regardez moi ça. Non mais regardez ça !” Aucun de nous deux n’avait la moindre idée de ce qu’elle pouvait voir.
Des petites particules dégringolaient dans l’air pour atterrir sur l’herbe avec un cliquetis. Elles collaient à la pointe des brins d’herbe gelés telles des fleurs blanches et humides. Je ne les avais même pas remarquées. Pas plus que Rafi. On était deux gars de Chicago, éle vés au climat du lac.
Ina n’avait jamais rien vu de semblable. Elle regardait des miettes de coquille d’œuf tomber du ciel pour créer la Terre.
Pétrifiée sur le trottoir métallique, elle nous insulta, morte de froid, folle de joie. “Vous avez vu ça ? Non mais regardez‑moi ça ! Espèces de petits cons ! Pourquoi vous ne m’avez pas parlé de la neige ?”
Ina Aroita descendit à la plage un samedi matin en quête de jolis matériaux. Elle emmena avec elle Hariti, sa fille de sept ans. Elles laissèrent à la maison Afa et Rafi, qui jouaient à même le sol avec des robots transformables. La plage n’était pas loin à pied de leur bungalow voisin du hameau de Moumu, sur la petite colline coincée entre falaises et mer de la côte est de l’île de Makatea, dans l’archipel des Tuamotu, en Polynésie française, aussi loin de tout continent qu’une terre habitable pouvait l’être – une poignée de confettis verts, comme les Français qualifiaient ces atolls, perdus dans un champ de bleu sans fin.
Née à Honolulu d’un père hawaïen sous-officier et d’une mère tahitienne hôtesse de l’air, élevée dans des bases navales à Guam et à Samoa, formée dans une gigantesque université du Middle West américain, Ina Aroita avait travaillé pendant des années comme femme de ménage dans un grand hôtel de Papeete avant de parcourir cent trente milles nautiques jusqu’à Makatea pour y jardiner, y pêcher, tisser et tricoter un peu, élever deux enfants et tenter de se rappeler pourquoi elle vivait.
C’est à Makatea que Rafi Young avait fini par la rattraper. Et c’est sur cette île qu’ils s’étaient mariés et qu’ils avaient entrepris de mener une vie de famille, loin de la tristesse croissante du monde réel.
Quatre ans sur Makatea avaient convaincu Ina Aroita qu’elle ne vivait que pour goûter la présence de son lunatique mari et de leurs deux enfants, Afa, son enfant-crabe, et Hariti, sa timide danseuse. Elle faisait pousser des choses : des ignames, du taro, de l’arbre à pain, du châtaignier, de l’aubergine, de
l’avocat. Elle fabriquait des choses : des sculptures en coquillages, des paniers de pandan, des cailloux peints de mandalas. De temps à autre, un des rares touristes venus en voilier visiter les légendaires ruines de Makatea ou en escalader les spectaculaires falaises achetait un objet ou deux.
Ina Aroita confectionnait ses assemblages de glaneuse dans son jardin, transformant la frange de jungle derrière son cottage restauré en musée de plein air pour un public inexistant.
Des vrilles d’Homalium et de Myrsine poussaient par-dessus ses œuvres et les recouvraient de vert, tout comme la jungle de l’île ensevelissait les carcasses de machinerie rouillée et les vestiges de voie ferrée remontant à l’époque des mines de phosphate.
Ce samedi-là, mère et fille ratissèrent l’estran, en quête de fortune. Le butin était abondant : coquilles de palourdes et d’escargots, carapaces de crabes, jolis morceaux de corail et d’obsidienne polis par la houle implacable. Elles franchirent les rochers éclaboussés de sel pour atteindre l’endroit où se brisaient les vagues. Partout des trésors incroyables se dissimulaient à la vue de tous.
Hariti trouva une pierre plate et bleue qui scintillait quand elle la mouillait.
“Maman, c’est une pierre précieuse ?
Bien sûr qu’elle est précieuse. Comme toi !”
La fillette conclut qu’elle avait le droit de rire. Elle fourra la pierre dans un sac filet pour la rapporter à la maison. Plus tard, elles décideraient ensemble quoi faire de toutes leurs trouvailles lisses, mouchetées, brillantes.
Tout en glanant, Ina Aroita racontait à sa fille l’histoire de Ta’aroa.
“Tu te rends compte ? Il a construit le monde avec les bouts de sa coquille d’œuf !”
Ina avait appris cette légende de sa propre mère, à la paillote de Waikiki Beach, trois kilomètres en contrebas de Diamond Head, quand elle avait sept ans. Et à présent elle la transmettait à cette artiste de sept ans, aussi neuve qu’étrange, qui avait bien besoin de mythes d’audace créatrice. Le monde, dans toute sa profusion splendide et surprenante, était né de l’ennui et du vide. Tout commençait par l’attente et l’immobilité. L’histoire parfaite à raconter à une enfant si sombre et si anxieuse.
Ina arrivait à son passage favori, celui où Ta’aroa mobilise l’aide de tous les artistes, quand Hariti laissa échapper un cri glaçant. Ina escalada les rochers en direction de sa fille, cherchant partout le danger. Avec Hariti, il y avait toujours un danger. Ses parents biologiques étaient morts juste au moment où elle atteignait l’âge de s’en souvenir, et elle n’avait jamais oublié que le monde était perpétuellement aux aguets pour tout vous arracher. Quel que puisse être le danger cette fois, Ina ne parvenait pas à le distinguer. Rien sur cette longue étendue de plage n’avait le pouvoir de leur faire du mal. Tout était calme à l’horizon, littéralement, tout au long du rivage incurvé et, par-delà les caps, jusqu’à la colonie fantôme de Teopoto à la pointe nord de l’île. Et pourtant la fille d’Ina, si impressionnable, restait figée sur place à gémir.
La terreur s’étendait à deux pas des petits pieds nus de Hariti. Dans un petit creux du sable gisait le cadavre d’un oiseau. Les ailes molles et repliées, les pattes écartées, la tête pendante, vaincue : un albatros, mort depuis longtemps. Et mort avant d’être adulte, car l’envergure des ailes d’un albatros adulte aurait fait deux fois la taille d’Ina Aroita. N’empêche que cet oiseau s’étendait sur la plage, presque aussi grand que Hariti.
Les parties tendres du corps s’étaient désintégrées en un contour doré sur le sable gris. Les restes pennés des ailes putréfiées ressemblaient à des feuilles de palmier séchées. Deux grands bâtons – les humérus de l’animal – saillaient des clavicules vides. La silhouette luttait encore pour se relever et s’envoler.
Un bout de sternum et les fines bandes brunes de côtes friables recouvraient ce qui restait de l’abdomen. À l’intérieur de cette cage thoracique, invulnérables à la décomposition, nichaient deux poignées de morceaux de plastique.
Hariti hurla de nouveau et projeta du sable sur cette chose morte à grands coups de pied. Elle fit un pas dégoûté vers la charogne, comme pour en piétiner les restes, les réduire en poussière et les mêler à la plage. Sa mère la tira en arrière, trop fort. Mais le choc d’être brusquée et enserrée mit fin aux cris de la fillette.
“Qu’est-ce qui lui est arrivé ? Pourquoi y a ce machin à l’intérieur ?”
Elle posa ces questions en anglais, une habitude nouvelle qu’Ina Aroita s’efforçait de briser.
“Il a mangé un truc qu’il n’aurait pas dû, répondit-elle en français.
Tu veux dire, de la malbouffe ? Oui.
Pourquoi ? Pourquoi il a mangé de la malbouffe, maman ? C’est un oiseau. Les oiseaux mangent de la bonne bouffe. Il s’est trompé.”
Chaque réponse d’Ina rendait le monde plus terrifiant. La petite fille enfouit sa joue mouillée contre la cuisse nue de sa mère.
“C’est flippant, maman. Fais-le partir.
C’était un être vivant, Hariti. On devrait lui offrir un bel enterrement.”
L’idée séduisit la fillette, qui adorait à la fois les rituels et farfouiller dans le sable. Mais alors que Hariti commençait à jeter sur le cadavre des poignées de corail et de coquillages effrités, Ina Aroita l’interrompit de nouveau. Ina plongea la main dans la poitrine de l’oiseau pourrissant et en retira deux bouchons et un téton de bouteille, le tube noir d’un étui de pellicule photo qui devait avoir au moins quinze ans, un briquet jetable, plusieurs mètres de monofilament emmêlé, et un bouton en forme de pâquerette.
Elle balança ce butin coloré dans leur sac résille, avec le reste de leur pêche miraculeuse.
“Nous pouvons faire quelque chose avec ceux‑ci”, dit-elle en français.
Mais elle ne voyait vraiment pas quoi.
Elles façonnèrent une tombe en forme de monticule rond et lisse. Hariti voulait la surmonter d’une croix, comme celles des deux cimetières de l’île. Alors elles en confectionnèrent une avec des branches d’hibiscus et la plantèrent dans le sable. Puis elles bordèrent le monticule de coquilles de limaces vertes et de petits cailloux jaunes.
“Dis une prière, maman.”
Ina hésita sur le choix de la langue. Cet oiseau égaré pouvait très bien être venu de l’Antarctique, via l’Australie ou le Chili. Il avait passé presque toute sa vie sur l’eau. Ina dit quelques mots en tahitien, parce que ni le français ni l’anglais ne lui semblaient
appropriés, et qu’elle connaissait trop mal les diverses nuances de la langue des Tuamotu pour dire quoi que ce soit de pertinent. Un quart d’heure après cette brève cérémonie, la fille d’Ina gambadait de nouveau jusqu’aux vagues et dénichait de nouveaux joyaux, comme si la mort par ingestion de plastique n’était qu’un mythe indéchiffrable parmi tant d’autres, aussi mystérieux qu’un dieu niché dans un œuf tournoyant avant le commencement du monde.
Fille d’un ingénieur canadien collaborant avec le commandant Cousteau, Evie a douze ans lorsqu’elle attrape le virus de la plongée et décide de consacrer sa vie à l’exploration des fonds marins.
Ina, une artiste polynésienne, compose des sculptures avec des déchets plastiques qu’elle glane sur les plages. Peu à peu, une étrange créature prend forme.
Todd et Ra , deux lycéens américains que tout oppose, cimentent une intense amitié autour du jeu de go ; l’un se perdra dans la littérature, l’autre révolutionnera l’intelligence arti cielle.
Avec la virtuosité qu’on lui connaît, Richard Powers met en scène une poignée de personnages à di érentes périodes de leur vie, avant de les réunir à Makatea, île du Paci que ravagée par des décennies d’extraction minière, où se joue la prochaine grande aventure de l’humanité : la construction de villes ottantes.
Mêlant science, écologie et poésie, Un jeu sans n sonde les mystères de l’océan et les potentialités in nies des nouvelles technologies pour célébrer la beauté et la résilience de la nature.
Né à Evanston, dans l’Illinois, en 1957, Richard Powers est l’auteur de quatorze romans, dont, au Cherche-Midi, Trois fermiers s’en vont au bal, Le Temps où nous chantions, La Chambre aux échos (National Book Award 2006), L’Arbre-Monde (prix Pulitzer 2019) et, chez Actes Sud, Sidérations ( naliste du National Book Award et du Booker Prize 2021).
Photographie de couverture : © Getty images, 2025
www.actes-sud.fr
DÉP. LÉG. : FÉV. 2025 / 23,80 € TTC France