LOURDES ARIZPE | JÉRÔME DUVAL-HAMEL ET LE COLLECTIF DE L’ART FABER


LOURDES ARIZPE | JÉRÔME DUVAL-HAMEL ET LE COLLECTIF DE L’ART FABER

QUAND LES BEAUX-ARTS ET LES MONDES
ÉCONOMIQUES SE RENCONTRENT
QUAND LES BEAUX-ARTS ET LES MONDES
ÉCONOMIQUES SE RENCONTRENT

 À Jean Clair
À Jean Clair
INTRODUCTION
LA LONGUE HISTOIRE DE L’ART FABER
1. Premières présences
2. L’envol
3. Le grand siècle
4. Le temps des amplifications
5. Un nouveau millénaire
UN ART FABER DE GRANDE VALEUR
1. Réellement artistique
2. Une portée sociétale majeure
PAYSAGES ET ARCHITECTURES D’HOMO FABER
1. Le spectacle de la nature faberienne
De l’harmonie avec la nature aux premières tensions
L’emprise de la révolution industrielle sur l'environnement
Des paysages à l’image de la modernité
2. La question environnementale : des paysages en crise
1. La galerie des portraits
Les agriculteurs et les pêcheurs
Le forgeron, mythe et réalisme
Les gens du textile
Marchands et banquiers en majesté
Les ouvriers, héros de l’Art faber
Les entrepreneurs et l’entreprise
L’avènement des “cols blancs”
Le consommateur : une nouvelle facette de l’acteur économique
2. La question sociale sur le devant de la scène
Les conditions de travail
Des laissés-pour-compte
Les luttes sociales
1. Un répertoire coloré
L’activité agricole
Le commerce
L’activité industrielle
Les activités de service
Les économies aux marges de la société
2. La représentation politique des activités économiques
Glorification et critique de la valeur travail
Art faber et propagandes
La critique des systèmes économiques
1. La mise en scène des produits d’Homo faber
L’accès à la dignité artistique
Une montée sur scène engagée
2. Portraits d’objets : les produits phares
Les grandes productions technologiques
Les produits technologiques du quotidien
Les simples objets du quotidien
ÉPILOGUE
Sous la bannière de l’Art faber, concept développé dans le Petit Traité de l’Art faber1, sont regroupées les œuvres ayant pour thèmes les mondes du travail, de l’entreprise et, plus globalement, les mondes économiques. Ces œuvres forment un ensemble important et pourtant encore bien peu connu et promu, regrettaient Umberto Eco2 et Patrick Ricard, président du groupe et de la fondation éponymes, tous les deux soutiens pionniers de notre projet. C’est à cette méconnaissance que veut remédier cet ouvrage consacré aux expressions de l’Art faber dans les beaux-arts.
L’origine du terme “Art faber” ? Fédérateur, lisible internationalement, ce néologisme a été créé au Centre Pompidou par un collectif de personnalités issues des mondes artistique, économique et académique3. Il évoque Homo faber et, ainsi, le travail, le monde économique, productif et commercial. Il renvoie aussi aux approches conceptuelles, notamment philosophiques et anthropologiques, du faber, qui enrichissent sa portée4.
Le périmètre de l’Art faber embrasse tous les domaines artistiques (littérature, poésie, beaux-arts, musique, photographie, cinéma, spectacle vivant, bande dessinée…) et tous les mondes économiques (secteurs primaire, secondaire et tertiaire à travers leurs activités et problématiques).
Qualifier une œuvre d’Art faber ? Certains s’étonneront peut-être de nous voir classer des œuvres, souvent a posteriori et parfois au-delà des intentions explicites de leurs auteurs, dans le champ de l’Art faber. Pourtant, cette catégorisation est une grande tradition des arts et des lettres. “L’œuvre d’art est un message fondamentalement ambigu […]. Toute œuvre d’art alors même qu’elle est une forme achevée […] est ouverte au moins en ce qu’elle peut être interprétée de différentes façons, sans que son irréductible singularité soit altérée. Jouir d’une œuvre d’art revient à en donner une interprétation, une exécution, à la faire revivre dans une perspective originale”, affirmait Umberto Eco dans L’Œuvre ouverte5 .
Estampiller un tableau, une sculpture, une photographie “Art faber” n’exclut pas, bien entendu, que ces œuvres bénéficient d’autres classifications. Le grand poète grec Constantin Cavàfis ne nous rappelle-t-il pas qu’une œuvre d’art est “comme une amphore, elle peut recevoir plusieurs explications6” ?
La catégorisation en Art faber enrichit l’histoire des arts d’une classification complémentaire et propose une nouvelle approche des mondes économiques.
De grands noms de l’Art faber beaux-arts parmi tant d’autres…
ALBRECHT DÜRER • PIETER BRUEGHEL L’ANCIEN
JAN VAN EYCK • JEAN FOUQUET
ANTOINE LOUIS ET MATHIEU LE NAIN
DIEGO VÉLASQUEZ • JOHANNES VERMEER
• CANALETTO • FRANCESCO GUARDI
FRANCISCO DE GOYA • JOSEPH WRIGHT OF DERBY
PEHR HILLESTRÖM • JOSEPH VERNET
WILLIAM TURNER • JEAN-FRANÇOIS MILLET
CARL WILHELM HUBNER • ROSA BONHEUR
IGNACE-FRANÇOIS BONHOMMÉ
GUSTAVE COURBET • FORD MADOX BROWN
CLAUDE MONET • CONSTANTIN MEUNIER
GUSTAVE CAILLEBOTTE • ANTÓNIO CARVALHO
DA SILVA PORTO • DÓRDIO GOMES
AIMÉ-JULES DALOU • AUGUSTE RODIN • JAMES TISSOT
HONORÉ DAUMIER • VINCENT VAN GOGH
KÄTHE KOLLWITZ • EUGÈNE LAERMANS
HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC
PAUL FRIEDRICH MEYERHEIM
ADOLPH VON MENZEL • JULES ADLER
MAX LIEBERMANN • MAXIMILIEN LUCE
FERNAND PELEZ • HANS BALUSCHEK
THÉOPHILE STEINLEN • EDVARD MUNCH
FRANTIŠEK KUPKA • JOSÉ URÍA Y URÍA
PABLO PICASSO • GEORGES BRAQUE
GIORGIO DE CHIRICO • OTTO GUTFREUND
SONIA DELAUNAY • ROBERT DELAUNAY
OTTO DIX • GEORGE GROSZ • CARL GROSSBERG
MARCEL DUCHAMP • GIACOMO BALLA
UMBERTO BOCCIONI • FRANCIS PICABIA
KURT SCHWITTERS • SALVADOR DALÍ
ALEXANDRE RODTCHENKO • GERD ARNTZ
FRANZ WILHELM SEIWERT • AUGUSTIN TSCHINKEL
FRANS MASEREEL • DIEGO RIVERA • BEN SHAHN
THOMAS HART BENTON • MARION GREENWOOD
RICHARD GESSNER • YOURI PIMENOV
FERNAND LÉGER • FRANCISKA CLAUSEN
CHARLES SHEELER • CHARLES DEMUTH
GEORGIA O’KEEFFE • EDWARD HOPPER
LAURENCE STEPHEN LOWRY • SÁNDOR BORTNYIK
RAYMOND ROCHETTE • ROY LICHTENSTEIN
ANDY WARHOL • JASPER JOHNS
BARBARA KRUGER • EDUARDO ARROYO
ERRÓ • WOLF VOSTELL • CLAES OLDENBURG
NIKI DE SAINT PHALLE • SIGMAR POLKE GERHARD RICHTER • ARMAN • CÉSAR
JOSEPH BEUYS • MARIO MERZ • THOMAS BAYRLE
DUANE HANSON • TOM WESSELMANN
TERENCE CUNEO • BEN • AI WEIWEI
DAVID HOCKNEY • JANNIS KOUNELLIS
DAVID LACHAPELLE • SYLVIE FLEURY
DAMIEN HIRST • BERTRAND LAVIER
JEFF KOONS • BANKSY…

La rencontre des arts et des mondes économiques s’inscrit dans une double dynamique. Dans le premier mouvement, les artistes s’inspirent de ces mondes pour en faire le sujet de leur œuvre – l’Art faber – quand, dans le second mouvement, ce sont les acteurs économiques, notamment les entreprises, qui mobilisent les artistes pour enrichir leur production par l'intermédiaire des arts appliqués ou du design.
L’Art faber rassemble donc les œuvres nées de cette première dynamique “d’inspiration économique pour une expiration artistique7”.
Dans le présent ouvrage, nous aurons à cœur d’aborder les représentations artistiques des mondes économiques que nous offrent les beaux-arts. Ce spicilège est publié au début de nos recherches consacrées au patrimoine de l’Art faber8. Il relève d’une démarche assez inédite par ses dimensions internationale et pluridisciplinaire. Aussi le lecteur voudra-t-il bien nous pardonner certains raccourcis et certaines faiblesses, qui seront corrigés lors de nos futurs travaux.
L’histoire de l’Art faber nous montrera que ce champ s’est construit pas à pas, en résonance avec le développement des mondes économiques, emmené par des artistes souvent audacieux qui n’ont pas eu peur de lutter contre les a priori et les interdits dictés par les tenants de l’académisme.
La valeur de ces œuvres à thématique économique a longtemps été contestée voire décriée, pour être finalement de plus en plus reconnue, tant dans sa dimension artistique que dans sa portée sociétale, l’Art faber se révélant même façonneur des mondes économiques et sociaux.
Quant au patrimoine de l’Art faber dans les beaux-arts, notre recensement montre qu’il est considérable. Il aborde l’intégralité des mondes économiques en suivant les contours qu’en donnent les économistes… et même parfois au-delà ! Pour vous en convaincre, une promenade parmi une sélection d’œuvres vous est proposée. Puisse-t-elle vous procurer plaisir, émotions et étonnements, voire de nouvelles compréhensions…
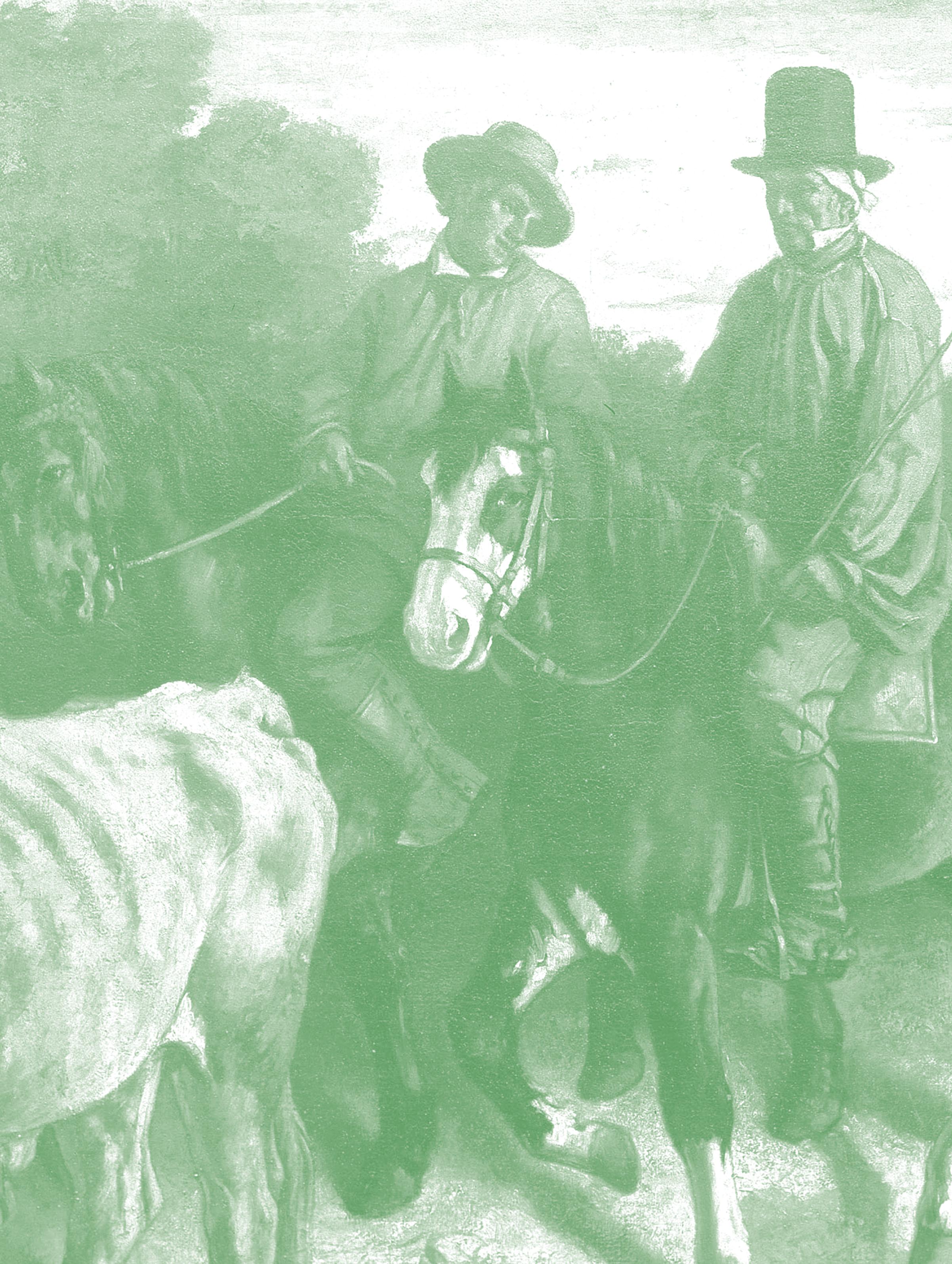


La présence de l’Art faber dans les beaux-arts s’est intensifiée au fil des siècles, surmontant les nombreuses oppositions qui lui ont été faites pour finalement constituer un ensemble important, mais qui n’a pas encore reçu l’hommage qu’il mérite.
Georges Bataille témoigne dans ses écrits de la présence de la thématique de l’Art faber dans les grottes de Lascaux9. Une fresque de la tombe de nuit à Thèbes (Égypte, 16e-14e siècle avant J.-C.) montre déjà une scène agricole. L’Antiquité romaine et grecque n’est pas avare de références. La célèbre première ekphrasis de l’histoire de l’art – la description du bouclier d’Achille par Homère dans l’Iliade (8e siècle avant J.-C.) – fait une large place à l’action des laboureurs, des moissonneurs, des botteleurs et des vignerons. Certaines fresques retrouvées à Pompéi illustrent les activités d’un boulanger, quand le décor d’une coupe kylix (480-470 avant J.-C.), conservée au British Museum, représente un cordonnier affairé à la réalisation de chaussures. Ce ne sont là que quelques exemples parmi tant d’autres, qui prouvent l’existence d’une très ancienne tradition de la représentation du travail dans les arts.
Des siècles plus tard, nombre d’enluminures médiévales documentent la maîtrise des bâtisseurs, maîtres maçons, tailleurs de pierre, constructeurs navals… métiers souvent associés dans ces images à la représentation des grands chantiers bibliques (la construction de la tour de Babel, l’édification du Temple de Jérusalem, la construction de l’Arche de Noé…). Artiste majeur de la Renaissance allemande, Albrecht Dürer dessine quant à lui à plusieurs reprises les paysans dont il donne une vision plurielle : Paysans au marché, Paysans conspirant, Paysanne qui pleure, etc.
Ces exemples, si probants soient-ils, ne doivent pas faire oublier que les mondes économiques, jusqu’à la première moitié du 18e siècle,
demeurent le plus souvent considérés comme un non-sujet. Au mieux, ils sont présents dans les arts sur un mode mineur, secondaire et furtif.
Les motifs religieux, la représentation des grands mythes, celle des faits historiques et la célébration du pouvoir temporel sont alors privilégiés. Par ailleurs, si le travail concerne une part importante de la population, celui-ci est peu valorisé socialement. De ce fait, si des peintres comme le Tintoret ou Vélasquez dépeignent la forge et le forgeron, c’est en déclinant l’image de Vulcain : la référence mythologique légitime ce sujet trivial du travail du métal.
Quelques exceptions viennent infirmer cette pratique. Pieter Brueghel l’Ancien peint son célèbre tableau La Moisson (ou Les Moissonneurs) [ill. p. 182-183] en 1565, représentation d’un épisode essentiel de la vie des champs. Ce faisant, le peintre répond à un marché de l’art alors dynamique aux Pays-Bas, porté par un public qui réclame des scènes du quotidien en nombre. L’essor du protestantisme contribue à cette évolution en plaçant le travail, l’économie et l’ardeur à entreprendre au cœur des fondements de cette société devenue bourgeoise. Le Prêteur et sa femme [ill. p. 213] de Quentin Metsys, peint en 1514, en est une autre illustration et marque aujourd’hui encore l’histoire de l’Art faber. Tout au long du 17e siècle, les artistes de ces provinces florissantes poursuivent la réalisation d’œuvres sur les thématiques commerciales et maritimes sans nécessairement faire des références religieuses, mythologiques ou historiques. En atteste le succès rencontré au même moment en Hollande par le genre des natures mortes, dans lesquelles sont souvent mis en scène les objets quotidiens d’Homo faber10 . En France, le sujet économique attire parfois l’attention royale. C’est à ce titre que le peintre Jean-Baptiste de La Rose reçoit une commande du gouvernement de Louis XIV pour exécuter une série de marines vantant l’intense activité des ports de France, libres de toutes ces références traditionnelles. Ces œuvres sont aussi un exemple précoce d’un Art faber mobilisé dans le but d’exalter la puissance économique d’un État. À la même époque, le théâtre comique, à l’inverse des grandes scènes classiques, ose lui aussi accueillir des sujets faberiens, comme le travail et le commerce, et cela de manière explicite.
À partir de la seconde moitié du 18e siècle, avec les prémices de la révolution industrielle, les activités économiques se diversifient. Les centres d’intérêt changent, les codes sociaux évoluent, notamment sous l’influence des Lumières et de leur esprit d’ouverture. Les circonstances sont dès lors propices aux artistes pour qu’ils se saisissent plus amplement de la réalité des mondes économiques. Le sujet faberien gagne en légitimité. Littérature et beaux-arts en sont les principaux modes d’expression. Jean-Baptiste Siméon Chardin et Jean-Baptiste Greuze s’y illustrent. Le petit peuple laborieux de Paris fait l’objet de nombreuses gravures et estampes contemporaines, à l’instar de celles dessinées par le sculpteur du roi Edmé Bouchardon.
Les artistes s’engagent plus résolument encore dans cette voie à la fin du 18e siècle quand ils commencent à peindre les premiers pas de la révolution industrielle. Le peintre qui va le mieux saisir les prémices et le développement de cette grande révolution faberienne est, sans aucun doute, l’Anglais Joseph Wright of Derby avec une œuvre prolifique et de belle facture. En cette période, certains souverains, notamment ceux de Suède et de Russie, achètent des œuvres inspirées du monde productif naissant. L’envol de l’Art faber est amorcé.
En Angleterre, le développement économique connaît une brusque accélération à partir de 1780, en rupture avec les progrès lents et incertains des périodes antérieures. Les changements affectent tous les domaines, même s’ils ne se produisent pas au même rythme ni avec la même intensité. L’adoption de nouvelles méthodes agricoles améliore le rendement des terres ; il faut de moins en moins de main-d’œuvre pour nourrir une population croissante, libérant ainsi des ressources pour une industrie en pleine métamorphose. Des innovations techniques majeures sont diffusées : la mécanisation de la filature et du tissage, la production de la fonte au coke, la machine à vapeur.

L’Art faber réunit des œuvres ayant pour thèmes les mondes du travail, de l’entreprise et, plus largement, les mondes économiques. Il forme un corpus en grande partie méconnu, “trop beau et trop puissant pour rester si peu célébré”, regrettait Umberto Eco, soutien pionnier de la promotion de l’Art faber.
Les beaux-arts offrent l’un des ensembles les plus représentatifs de la richesse et de la diversité de l’Art faber, qui se nourrit de courants les plus divers et témoigne sans discontinuer des traditions et des modernités.
À travers des thèmes tels que le paysage agricole ou industriel, l’acteur économique et ses activités ou encore les produits, ce livre offre un regard nouveau sur des artistes célèbres. Il permet aussi d’introduire des figures moins connues, voire oubliées, dont l’apport à l’Art faber comme à l’histoire de l’art n’en est pas moins important.
Mais les peintres, sculpteurs, dessinateurs et autres plasticiens ne se contentent pas de raconter les mondes économiques : ils les façonnent aussi, influençant leur évolution, comme en témoignent de nombreux exemples présentés dans ce spicilège.
Illustration de couverture réalisée à partir du tableau de Marie Petiet (1854-1893), Les Blanchisseuses (ou Les Repasseuses), 1882. Dép. lég. : octobre 2023