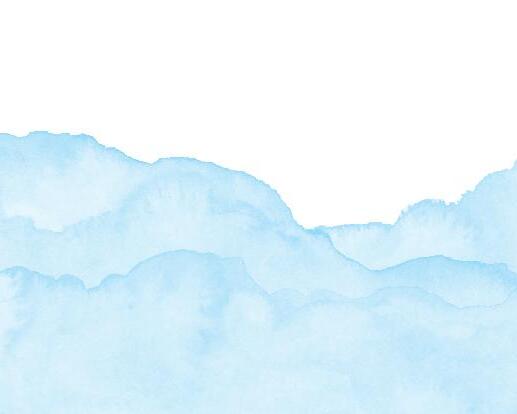Frère François d’Assise
MOINE BÉNÉDICTIN DE KERGONAN
et porte-la au monde ! Cherche la paix

Appelez le bonheur sur Jérusalem : « Paix à ceux qui t’aiment ! Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais ! »
À cause de mes frères et de mes proches, je dirai : « Paix sur toi ! »
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien1.
Le développement personnel est à la mode. Trouver la sérénité tout en valorisant ses potentialités, être performant tout en restant « zen », devenir soi en se libérant du stress… Notre société du bien-être, paradoxalement si anxiogène, sait nous proposer des solutions alléchantes, qui trouvent dans les sagesses orientales anciennes ou dans les plus récentes avancées des sciences psychologiques quelques authentiques bonnes recettes. Hélas, elles tendent souvent à nous renfermer sur nous-mêmes, à nourrir notre individualisme ! Si elles nous font goûter une certaine forme d’apaisement, n’est-ce pas au prix d’une anesthésie face au monde ? Pendant ce temps, ce dernier est toujours aussi peu en paix… Et nous nous réveillons, tout surpris et désemparés devant
les nouveaux périls de notre époque, le cœur saisi d’inquiétude. Nous nous sentons bien incapables de nous hisser au nombre de ces « artisans de paix » que Jésus a proclamés pleinement « heureux » (Mt 5, 9) dès maintenant.
N’est-ce pas le moment de découvrir ou de réaccueillir le projet que Dieu a pour nous de toute éternité, et qui demeure aujourd’hui ?
Mes pensées pour vous sont des pensées de paix et non d’affliction, pour vous donner la prospérité et l’espérance1.
Dieu, qui est si bon, nous a créés pour la paix. Il nous invite à entrer dans sa volonté de paix, individuellement et collectivement. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » (Jn 14, 27), nous dit Jésus. Mais ce n’est pas à la manière du monde qu’il nous la donne.
Ce don de la paix – à recevoir activement ! – me vient de Dieu, ce Dieu qui ne se dévoile qu’aux amis de la paix, à ceux qui le cherchent. « Quaerere Deum », chercher Dieu, tel est le point de départ de toute la tradition monastique :
Au milieu de la confusion de ces temps où rien ne semblait résister, les moines désiraient la chose la plus importante : s’appliquer à trouver ce qui a de la valeur et demeure toujours, trouver la Vie elle-même. Ils étaient à la recherche de Dieu2
C’est de cette quête première qu’a jailli, depuis les milliers de monastères qui ont couvert l’Europe, la culture de notre Occident.
Qui goûte à la paix goûte à Dieu lui-même, et la recherche plus encore. Cette paix est si essentielle à saint Benoît que la tradition bénédictine en a fait sa devise : « PAX ». Dès le prologue de sa Règle1, le père des moines exhorte tout commençant qui entreprend l’aventure spirituelle par ces mots du psaume 33 :
Poursuis la paix, recherche-la2.
En réalité, la devise bénédictine traduit un mot de la tradition des anciens Pères du désert d’Égypte, hésychia.
Ce terme désigne le repos ou la sérénité qui vient de l’absence d’inquiétude, la stabilité de l’âme toute confiante et abandonnée face à l’adversité du monde. C’est la paix qui découle de cette confiance que nous demande Jésus avec insistance : « Ne vous souciez pas […] Ne vous faites pas de souci pour demain : demain aura souci de lui-même ; à chaque jour suffit sa peine » (Mt 6, 25.34). Cette confiance dans la bonté du Père et dans sa providence rend l’âme « indestructible dans la tranquillité [hésychia] et la paix » (1 P 3, 4). Elle est la source de cette sérénité que nous recherchons tous.
Pour autant, la paix de saint Benoît n’est pas un idéal épicurien de retranchement de tous les ennuis. Elle consiste encore moins en une fuite des réalités. Cette méprise est fréquente chez ceux qui 1• S. Benoît, Règle, Prologue, 17. 2• Ps 33 (34), 15.
approchent les monastères : « Quel calme ! Quelle paix on trouve ici ! Loin du bruit, loin des tracas, loin des disputes et des soucis… »
Mon maître des novices disait : « Tout ce que l’on fuit en entrant au monastère, on le retrouve infailliblement, et démultiplié ! »
La paix n’est pas fruit d’une dérobade, ni devant le monde ni devant soi-même. Elle est recherche active : « Poursuis la paix. » Chez saint Benoît, cette quête est une course, et même un combat « par les glorieuses armes de l’obéissance ». Elle n’a rien de l’oisiveté, qui est « ennemie de l’âme1 ». Car chercher la paix signifie justement accepter la grande confrontation avec le réel, avec tout le réel, mais en y découvrant, sous la rude écorce, le don de la paix que Dieu nous y prépare, pour devenir un témoin extraordinairement contagieux de cette paix.
Acquiers la paix intérieure, et des foules d’hommes seront sauvés autour de toi2 !
L’état stable de paix auquel j’aspire, et toute la terre avec moi, est à la fois le résultat d’une quête qui me met en mouvement actif, et un don gratuit de Dieu, qui demande mon ouverture et ma confiance.
1• S. Benoît, Règle, 48, 1.Pour me mettre activement à la recherche de la paix, je suis invité à plonger d’abord dans la Bible, pour croire plus profondément au don que Dieu me fait de sa paix. « Demandez que ma paix et ma foi durent. Elles vont ensemble1 », disait le curé d’Ars.

Plus je serai enraciné dans la foi au « Christ, notre paix », vrai Roc dans les sables mouvants de notre marche terrestre, plus je serai en mesure de me laisser entraîner, pleinement lucide sur le réel, vers le plein abandon. Cet abandon, loin d’être une démission, est au plus fort des maux : accueil, consentement, offrande.
Cette consolidation dans la paix du cœur, dans la vraie sérénité de l’Esprit, me permettra peu à peu de devenir témoin du royaume de Dieu, qui est « justice, paix et joie dans l’Esprit Saint » (Rm 14, 17).



Croire au don de la paix qui m’est fait

CRÉÉ POUR LA PAIX
Quand j’ouvre la Bible, je peux être un peu déconcerté par tous les récits de guerre et de violence qui s’y étalent, parfois justifiés au nom de Dieu. Pourtant, le Dieu que les Écritures révèlent est un Dieu infiniment pacifique : « Le Seigneur est paix » (Jg 6, 24), dit le guerrier Gédéon dans le livre des Juges ! Et ce Dieu veut me faire le don de la paix, à moi et au monde, dans une immense bénédiction : « Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix » (Ps 28 [29], 11). Il m’appelle à être, à mon tour, messager de cette bénédiction que doivent s’échanger les fils d’Israël :
Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix1 !
Le livre de la Genèse raconte comment Dieu crée, à l’origine, un monde tout d’harmonie et de beauté, un paradis de paix. Si « la paix est la tranquillité de l’ordre2 », ainsi que l’écrit saint Augustin, qu’y a-t-il de plus paisible que le cosmos, son ordre admirable et ses lois parfaites ? L’univers est comme un reflet de la splendeur du visage de Dieu, qui se penche vers nous pour nous infuser sa perfection immuable et paisible.
1• Nb 6, 26.
2• S. auguStIn, La Cité de Dieu, XIX, 13.
Dans la suite du récit, Dieu façonne l’homme à son image et à sa ressemblance (cf. Gn 1, 26). Il les fait homme et femme, les appelant à la communion. Ainsi, la paix que Dieu donne n’est pas seulement celle de l’ordre cosmique et de la beauté de la nature, mais une paix d’amour qui lui ressemble, lui qui est Être de communion par excellence. Le Christ a révélé la profondeur infinie de cette communion d’amour en Dieu entre le Père, le Fils et l’Esprit Saint : harmonie parfaite de relations entre les personnes divines, unité insurpassable de l’unique nature divine.
Une fois la création du monde achevée, le Seigneur rend manifeste son dessein de paix par le repos du septième jour : il conclut l’œuvre qu’il a faite en sanctifiant et bénissant ce jour (Gn 2, 1-3). Son repos est jouissance de la vision de son œuvre, qui est belle et bonne. À son tour, l’homme peut entrer dans ce repos en contemplant cette beauté et en adorant, à travers elle, la perfection divine. Seule créature raisonnable et consciente, sa vocation est d’entraîner la création tout entière dans cette louange. À l’écoute de Dieu et à son exemple, il doit exercer, en nommant les animaux et en cultivant la terre, une « domination » de paix sur le monde matériel pour l’orienter vers Dieu. Voilà son appel. Pour y répondre, l’homme est créé libre ; il lui suffit de vouloir l’ordre paisible tel que voulu par Dieu et de le servir en obéissant à sa voix, c’est-à-dire en l’écoutant (ob-audire ), comme le disent le premier et le dernier mot de la Règle de saint Benoît : « Écoute… et tu parviendras. »
Hélas ! Le livre de la Genèse se poursuit en racontant comment
Adam et Ève n’écoutent pas « l’ordre » de Dieu ; ils tombent ainsi dans le « désordre », entraînant avec eux l’ensemble de la création. L’homme et la femme se détournent de Dieu, source d’unité, de bonheur et de paix, pour s’éprouver indépendants. Ils ne veulent plus trouver en Dieu leur principe de vie. Le meurtre d’Abel par Caïn manifeste l’ampleur de la perte de la paix originelle (Gn 4). Caïn, pris de peur après son crime, est décrit comme le premier « constructeur de villes » : il espère ainsi se protéger de l’hypothétique vengeance du « premier venu ». Après lui, les grandes cités deviennent de grands empires, tels Babel ou l’Égypte, qui poursuivent, par la guerre et l’oppression, une paix illusoire.
Le péché de l’homme n’efface pas pour autant les traces du grand dessein de paix que Dieu a laissées dans le cosmos, nom qui signifie en grec « beauté, harmonie ». Ces traces de l’ordre intime des choses, de leur bonté, beauté et vérité, je peux les discerner, les contempler, et elles inspirent ma recherche de la paix.


Témoignage : Philippe, 54 ans, père de famille

Dès le lycée, mû par la recherche de la vérité, j’ai poursuivi, parallèlement à des études musicales, des études de philosophie. La voie de l’art dans laquelle je me suis engagé m’a ouvert au sens de la beauté tout en me laissant insatisfait. Après plusieurs années d’enseignement musical et de concerts, j’ai finalement pris la décision de suivre mon attrait intérieur de toujours : devenir paysan. Me mettre à cette école de bon sens et de sagesse qu’est la vie de la nature m’a procuré l’ancrage dans le réel à partir duquel peut maintenant s’élever, sainement, ma spéculation intellectuelle et artistique. C’est ainsi que j’ai trouvé la paix intérieure et l’équilibre entre mon métier d’éleveur paysan, mon travail philosophique et mon engagement musical. La devise de Jean-Sébastien Bach que je fais mienne, « Pour la plus grande gloire de Dieu », dit la cohérence paisible de ma vie : le fait de me savoir à ma place, humble et petit devant le mystère de la création, mais capable de collaborer à sa beauté.
Dieu a créé pour moi le monde dans l’ordre et la paix, et il a voulu que je coopère à son dessein pacifique.
La désobéissance de nos premiers parents a introduit dans mon cœur le trouble et la méfiance, qui me font souvent perdre le chemin de la paix.
La contemplation de la beauté dans la nature et dans ses lois ordonnées reste pourtant toujours, pour moi, source de pacification.

UN PEUPLE SIGNE DU DON DE LA PAIX
Si l’homme s’est détourné de Dieu, le Seigneur ne renonce pas pour autant à lui faire le don de sa paix authentique. Il appelle un petit clan nomade, opprimé en Égypte, pour lui proposer son « alliance de paix » (Nb 25, 12) et en faire son « peuple particulier ». Israël, délivré de l’esclavage par la traversée de la mer Rouge lors de la Pâque, doté de la Loi révélée à Moïse, doit s’installer sur la terre promise de Canaan, en s’écartant du mode de vie des nations païennes. Ainsi le sabbat, ce repos hebdomadaire qui lui est prescrit, lui rappelle-t-il le repos du septième jour de la création et le primat de Dieu sur les activités profanes. Il garantit aussi la justice sociale, en prévenant l’exploitation des hommes et des bêtes, afin que « justice et paix s’embrassent » (Ps 84 [85], 11). Le culte, avec ses « sacrifices de paix », a lieu au temple de Jérusalem, cité qui porte la paix dans son nom ( shalom ). Dieu lui-même est le garant de la paix du peuple.
Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai, je mettrai mon sanctuaire au milieu d’eux pour toujours.
Ma demeure sera chez eux, je serai leur Dieu
et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que Je suis le Seigneur1 .
Pour que cette protection spéciale du Seigneur puisse s’exercer et son dessein de paix se réaliser, le peuple élu doit s’abandonner avec confiance à Dieu, qui est son roc et sa citadelle. C’est ainsi qu’un jour où la nation est attaquée par une grande conjuration d’ennemis, elle s’entend dire par un homme inspiré : « Ce combat n’est pas le vôtre mais celui de Dieu. » Alors, le peuple sort à la rencontre des ennemis, mais en mettant les chantres en tête, entonnant les louanges de Dieu : « Car éternel est son amour… » À leur arrivée dans la plaine, les ennemis, inexplicablement, ont déjà tous péri (cf. 2 Ch 20).
Pour faire à l’humanité le don de sa paix malgré la révolte originelle, Dieu scelle son alliance avec le peuple d’Israël afin qu’il vive, non plus dans la peur, mais dans l’abandon à son Créateur.
À mon tour, je peux m’appuyer sur la promesse de Dieu pour vivre mes combats dans la confiance que Dieu agit.
Je peux, dès maintenant, entrer dans la louange pour la victoire du bien sur le mal, qui hâte la venue du Royaume.