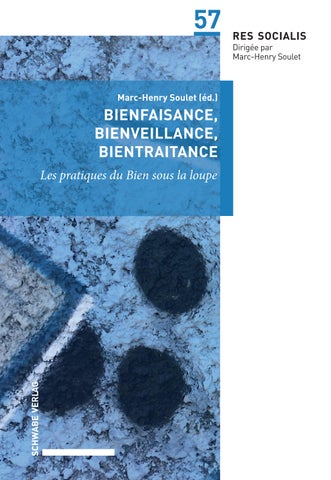BIENVEILLANCE,BIENFAISANCE,(éd.)BIENTRAITANCE RES
Marc-Henry Soulet SOCIALIS
Dirigée Marc-Henrypar Soulet 57 Les pratiques du Bien sous la loupe
Vol. 57 Res DirigéeSocialisparMarc-Henry Soulet
Les pratiques du Bien sous la loupe
Schwabe Verlag
Marc-Henry Soulet bienveillance,Bienfaisance,(éd.)bientraitance
Cet ouvrage a été publié avec le soutien de l’Université de Fribourg
ISBN eBook (PDF) 978-3-7965-4144-5
La Deutsche Nationalbibliothek a répertorié cette publication dans la Deutsche Nationalbibliografie; les données bibliographiques détaillées peuvent être consultées sur Internet à l’adresse http://dnb.dnb.de.
DOI L’e-book10.24894/978-3-7965-4144-5estidentiqueàlaversion imprimée et permet la recherche plein texte. En outre, la table des matières et les titres sont reliés par des hyperliens.
Impression: CPI books GmbH, Leck
MIX Papier aus tungsvollenverantwor-Quellen FSC® C083411
Cette œuvre est protégée par le droit d’auteur. L’œuvre ne peut être reproduite de façon intégrale ou partielle, sous aucune forme, sans une autorisation écrite de la maison d’édition, ni traitée électroniquement, ni photocopiée, ni rendue accessible ou diffusée.
®
Illustration couverture: © Vivianne Châtel, Fribourg
Information bibliographique de la Deutsche Nationalbibliothek
Conception de la couverture: icona basel gmbh, Basel Composition: Doris Gehring, Fribourg
www.fsc.org
Information bibliographique de la Deutsche Nationalbibliothek
et du Conseil de l’Université de Fribourg.
DOI L’e-book10.24894/978-3-7965-4548-1estidentiqueàlaversion imprimée et permet la recherche plein texte. En outre, la table des matières et les titres sont reliés par des hyperliens.
Relecture: Marc-Henry Soulet, Fribourg
ISBN eBook (PDF) 978-3-7965-4548-1
© 2019 Schwabe Verlag, Schwabe AG, Basel, Schweiz
publié avec le soutien de l’Université de Fribourg
MIX
et du Conseil de l’Université de Fribourg.
Cetwww.schwabe.chrights@schwabe.chouvrageaété
ISBN Livre imprimé 978-3-7965-4097-4
Printed in Germany
Conception de la couverture: icona basel gmbh, Basel
Cette œuvre est protégée par le droit d’auteur. L’œuvre ne peut être reproduite de façon intégrale ou partielle, sous aucune forme, sans une autorisation écrite de la maison d’édition, ni traitée électroniquement, ni photocopiée, ni rendue accessible ou diffusée.
© 2022 Schwabe Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel, Schweiz
La Deutsche Nationalbibliothek a répertorié cette publication dans la Deutsche Nationalbibliografie; les données bibliographiques détaillées peuvent être consultées sur Internet à l’adresse http://dnb.dnb.de.
www fsc.org
®
Illustration couverture: © Vivianne Châtel, Fribourg
Couverture: Kathrin Strohschnieder, Zunder & Stroh, Oldenburg
Impression: CPI books GmbH, Leck
ISBN Livre imprimé 978-3-7965-4303-6
Printed in Germany
www.schwabe.chrights@schwabe.ch
Relecture: Marc-Henry Soulet, Fribourg
Composition: Doris Gehring, Fribourg
Papier aus tungsvollenverantworQuellen FSC® C083411
Bienveillance et vulnérabilité
...............................................................................
Quand s'émouvoir c'est faire Marc Henry Soulet 95
.............................................................................
Partie 2 : Le Bien en question ......................................................................127
Pour une société bienveillante plutôt qu'inclusive. Comment définir le « bien » qu'on voudrait pour l'autre sans être ni naïf ni paternaliste ?
Sebastian Moser et Paul Loup Weil Dubuc....................................... 65
La tyrannie du « bienvieillir » Michel Billé 147
Table des matières
Partie 1 : L'heure du bien................................................................................ 29
Danilo Martuccelli 31
...........................................................................
Marc Henry Soulet 7
Nathalie Zaccaï Reyners................................................................... 129
Auprès de Mariette. Voyage au cœur de l'accueil institutionnel
Philanthropie et démocratie Alexandre Lambelet 81
.......................................................................................
Le bien à l'œuvre. Des bonnes intentions aux bonnes pratiques
L'impossible fondation d'une éthique de la bienveillance
..............................................................................
Michel Terestchenko 57
............................................................................
Vulnérabilité et effondrement compassionnel Ari Gounongbé .................................................................................. 167
.....................................................................
La bienveillance : une fausse évidence ? Vivianne Châtel 209
................................................................................
Heurs et malheurs de la bientraitance Philippe Svandra............................................................................... 191
Présentation des auteur e s 267
Tragédie et sacrifice : anamorphoses de la politique et du salut Jacques Athanase Gilbert.................................................................. 243
Le bien à l ' œuvre Des bonnes intentions aux bonnes pratiques
Marc Henry Soulet
Le Bien est de retour ! Depuis quelques années déjà, il n'est pas un programme d'intervention publique, pas une action bénévole ou humanitaire, dans les domaines de la santé, de l'éducation ou du social, qui ne réfère à la bonne intention de l'activité entreprise et au profond respect de la dignité de la personne considérée. Que signifie ce recours au bien vouloir et au bien agir dans la qualification des actions entreprises, si ce n'est afficher qu'il n'en a pas toujours été ainsi ? Quelle est en fait la valeur ajoutée de cette mobilisation générale du Bien dans les référentiels de l'action sur ou avec Autrui ? S'agit il d'une traduction pratique de l'exigence éthique qui traverse tous les champs de l'action, publique comme bénévole, aujourd'hui ? S'agit il davantage d'une conséquence de l'obligation de transparence et d'évaluation qu'imposent à tout programme d'intervention les nouvelles formes de management ? S'agit il au contraire d'une disposition prudente des institutions et des associations devant la montée en puissance des usagers/bénéficiaires tout aussi soucieux d'être considérés dans leur singularité que prompts à faire recours en cas d'insatisfaction ? S'agit il encore d'un argument « commercial » dans un univers, fût il celui de l'action publique ou bénévole, fortement traversé par des logiques concurrentielles ? Quelle que soit la réponse à ces questions, et il est probable qu'elle se tienne à mi chemin de celles ci, il convient de s'interroger sur l'impact concret de cette référence au Bien dans les pratiques des professionnels et de se demander jusqu'où elle infléchit la philosophie générale de leurs interventions, elle marque les principes de leurs codes déontologiques et, aussi, elle affecte la nature de leur relation avec les bénéficiaires usagers.Lebien est de retour, donc, certes mais pour quoi faire ? Il n'est pas en effet sans intérêt de s'interroger sur ce que produit la référence au Bien au sein de l'action publique, particulièrement sanitaire et sociale. Portée par la vague
1. En page d'accueil de la Lindsey Vonn Foundation, lindseyvonnfoundation.org.
Tout d'abord, l'exemple de Lindsey Vonn (un exemple parmi tant d'autres dans les milieux des grands sportifs) qui, à l'approche d'une fin de carrière exemplaire (elle, avec ses 82 victoires en coupe du monde de ski alpin à quatre unités du recordman, Ingemar Stenmark, qui se classa troisième aux championnats du monde de descente d'Äre en 2019 malgré une attelle à un genou), a décidé de créer une fondation aux États Unis d'Amérique afin de « décerner des bourses et de soutenir des programmes pour l'éducation, le sport et le développement personnel afin de donner aux générations futures les outils dont elles ont besoin pour atteindre leurs objectifs et découvrir leur courage ». 1 Elle qui déclara, là aussi emblématique des nouvelles formes de philanthropie : « C'est ce qui m'est arrivé de mieux dans ma vie, dit elle. J'ai un réel impact sur la vie des gens ».
2 Il n'est qu'à voir Mariette, le documentaire tourné par Christophe Reyners sur sa grand mère en établissement d'accueil pour personnes âgées. Archives Sonuma Reportages société : « Mariette », de Christophe Reyners sur Auvio (rtbf.be).
8 Bienveillance, bienfaisance, bientraitance
Prenons trois illustrations pour donner corps à cette question.
Deuxième cas, l'explosion des formations à la bientraitance pour les personnes travaillant dans des lieux d'accueil de personnes dépendantes (en EMS notamment) ; il en coûte ainsi aujourd'hui à la Croix Rouge genevoise CHF 2'700 pour 10 heures de cours pour apprendre à reconnaître la maltraitance et à lutter contre elle. Ainsi donc, la bientraitance, comme pilier de leur profession, n'est pas spontanément intériorisée par les soignants et les accompagnants 2, mais encore elle n'est pas inhérente à la nature humaine, puisque non naturellement mise en œuvre, à un point tel qu'il faut explicitement se
du care et toutes les notions qui l'accompagnent (le prendre soin, la sol licitude, le souci…), elle révèle une modification profonde de l'attention portée aux plus démunis, aux malades, aux handicapés, aux dépendants, manifestant une exigence éthique jusque là absente devant les perspectives d'une prise en charge technique et objectiviste. Dans ce même mouvement, une tout autre vague, néo managériale et rationalisatrice, fait sentir l'exigence de bonnes pratiques, efficientes et, donc, soucieuses de transparence, de satisfaction de l'usager et de contention des deniers publics. Comment penser la compossibilité de ces deux figures du bien agir ? En d'autres termes, les bonnes intentions sont elles solubles dans les bonnes pratiques ?
Enfin, Emmanuel Macron, tout nouvellement élu Président de la République Française le dimanche 24 avril 2022 après l'exercice d'un premier quinquennat, prône-t-il la bienveillance dans son allocution de remerciement à la population française sur l'Esplanade du Champ de Mars et s'engage-t-il à traiter chacun avec respect pour lutter contre la fracturation politique qui a traversé le pays. Cet affichage public de bienveillance, par delà les stratégies politiciennes qui le nourrissent, souligne combien cette dernière est devenue un ressort langagier ordinaire du champ politique pour plaider le souci pour autrui et la bonne intention de ne pas lui nuire.
« Il n'est de pire tyrannie que de vouloir le Bien de l'autre », cette sentence apocryphe attribuée à Emmanuel Kant situe déjà l'enjeu puisque, ce faisant, je maintiens l'autre dans la dépendance. Avec une telle prémisse, l'affaire
1. L'évidence du Bien. Le Bien est bien par nature. Il ne peut nuire ; même la fessée de mon enfance était pour mon bien, même si, loin de là, je n'en avais pas conscience (ce sont les mystères de la pédagogie noire 3).
L'évidence du Bien
3 Miller A , C'estpourtonbien, Paris, Éditions Aubier, 1985.
Le bien à l’oeuvre. Des bonnes intentions… 9 former pour remplir ce qui est devenu aujourd'hui un standard de la prise en charge de personnes dépendantes.
Quoi de commun entre ces trois exemples ?
2. Le statut du bénéficiaire. Il est, et doit être, déficitaire, faible ou vulnérable. Avec en arrière fond une philosophie de la dépendance, de la domination, du care, peu importe, mais ayant en commun l'idée que l'autre est, momentanément ou durablement incapable, impuissant à agir efficacement et significativement par lui même.
3. Lamontéeenpolitiqued'unevertu. Celle ci est perceptible, notamment, avec l'appel à une société décente 4 et la prégnance de la référence à la dignité au sein des politiques publiques. Essayons donc pour introduire cet ouvrage d'éclairer le bien à l'œuvre en revenant sur ces trois propriétés communes de la bienfaisance, de la bientraitance et de la bienveillance.
4. Margalit A., LaSociétédécente, Paris, Librairie Flammarion, 2006.
La tyrannie du Bien, c'est aussi le travail sur soi que nous impose la société contemporaine nous enjoignant à la fois à la performance et au bien être, à la forme et au bien vivre, ce que nous rappelle avec force Michel Billé dans sa contribution à cet ouvrage en soulignant la dimension paradoxale d'une telle double injonction pour les personnes vieillissantes condamnées à une performance toujours en déclin et à un bien être s'érodant en raison d'une dégradation physique et mentale inexorable. Une tyrannie donc pour notre Bien, mais qui se refuse à considérer le propre du vieillissement, celui d'une réduction progressive (et parfois brutale) des capacités. 6
Par ailleurs, les effets ne sont pas toujours au rendez vous. Donner un sac de riz pour nourrir cent enfants évite d'aborder des questions délicates. Le Bien ne règle rien, au mieux il est aveugle : qui est responsable de la famine de ces cent enfants ? Que sera leur vie une fois sauvés de la famine ? Pensons aussi au cynisme des French doctors et de la loi d'oppression minimale de leur humanitaire altruiste, cet impératif absolu de sauver à tout prix des victimes innocentes aujourd'hui, même si l'on sait très bien que, demain, certaines seront des tyrans. Pensons encore à la critique violente de l'État Providence que faisait Philippe Bénéton, pointant les effets contreproductifs du volontarisme social en prenant l'exemple des politiques sociales américaines du début des premières décennies de la deuxième moitié du XXième siècle, et venant illustrer, avec force concept sociologique à l'appui (le célèbre « effets pervers » de Raymond Boudon), l'idée selon laquelle les bonnes intentions ne peuvent garantir de bons résultats 7
7 Bénéton P., Le Fléau du Bien.Essaisurlespolitiques sociales occidentales 1960 1980, Paris, Éditions Robert Laffont, 1983.
10 Bienveillance, bienfaisance, bientraitance
6. Cf. aussi Billé M., Martz D. & Dagognet F., LaTyranniedubienvieillir. Vieilliretrester jeune, Toulouse, Éditions Érès, 2018.
5. Gran I., « La Tyrannie du Bien » in LesTempsmodernes, vol. 627, n° 12, 2006, p. 115.
s'engage mal ! Et cela continue avec l'entrée en jeu de la susceptibilité de ceux dont on veut le Bien. « Comment aider, se demande Iegor Gran, sans froisser la dignité de ceux qui sont ainsi réduits à la dépendance ? » 5
Et puis, les bienfaiteurs ne sont pas toujours en cohérence avec leurs propres principes. On peut porter le Bien comme un étendard et ne pas toujours bien se comporter, voire contrevenir aux belles idées que l'on promeut. Il n'est qu'à regarder l'ouvrage, quelque peu pamphlétaire, d'Iegor Gran,
11. McCann I.L. & Pearlman L.A., « Vicarious traumatization : A framework for understanding the psychological effects of working with victims » in JournalofTraumaticStress, n° 3, 1990.
10. Gounongbé A., Fatiguedelacompassion, Paris, Presses universitaires de France, 2014.
9 Zawieja P., « Fatigue compassionnelle » in Zawieja P. & Guarnieri F., Dictionnaire des risquespsychosociaux, Paris, Éditions du Seuil, 2014.
Faire le Bien ne va donc pas de soi et, qui plus est, est usant. On pointe ainsi depuis quelques temps déjà l'érosion graduelle de l'empathie 9, la fatigue de la compassion des intervenants qu'a fort bien documentée Ari Gounongbé dans son livre éponyme 10 et qu'il exemplifie dans sa contribution au présent ouvrage, ou bien encore le traumatisme vicariant 11 en raison du contact prolongé avec la souffrance d'autrui qui peuvent générer des phénomène psychotraumatiques chez les aidants professionnels, se marquant notamment par un phénomène d'épuisement physique et émotionnel. Même aussi les bonnes volontés les plus spontanées finissent par s'user comme en témoigne la (rapide) lassitude de certaines familles d'accueil en Suisse à la suite de l'exode de familles ukrainiennes, en raison de lourdeur, des coûts, des difficultés de communication et des différences de valeurs, de pratiques et de culture entre accueillants suisses et accueillis ukrainiens 12.
12 « Des problèmes de part et d'autre. Des familles d'accueil suisses veulent déjà se débarrasser des réfugiés » in Blick, consulté le 03.04.2022.
8. Gran I., ONG!, Paris, Éditions P.O.L, 2003.
ONG! 8, mettant en scène deux organisations non gouvernementales, l'une environnementale, l'autre en santé publique, qui partagent un même immeuble et dont ce voisinage, justement, les fait se déchirer aux noms des buts aussi grandiloquents que concurrentiels qu'ils supportent et les fait sombrer sans retour dans la violence. Ce petit ouvrage nous révèle sans pitié un petit monde des faiseurs de Bien qui s'entretuent, actualisant, pour justifier la défense absolue de leur cause, les principes mêmes qu'ils s'emploient officiellement à combattre. On trouverait sans trop de difficulté, pour qui a côtoyé le terrain humanitaire, des exemples bien réels, par exemple, pour n'en citer qu'un seul, la guerre (le mot n'a presque pas besoin d'être euphémisé) que se sont livrée les ONG médicales sur le territoire haïtien à la suite du séisme de 2010 et des catastrophes naturelles qui s'y sont succédées.
Le bien à l’oeuvre. Des bonnes intentions… 11
12 Bienveillance, bienfaisance, bientraitance
13 . Faure A., « L'intelligence des pauvres » in Collectif, Démocratie et pauvreté. Du quatrièmeordreauquartmonde, Paris, Éditions Quart Monde/Albin Michel, 1991.
S'agit il de ce que je pense bien pour l'autre en fonction de la représentation que j'ai de lui, que je le pense mon semblable ou que je le considère comme un autre différent qui m'est aussi étrange qu'étranger à qui, par souci d'« humanité », je vais conférer quelques bienfaits qui m'apparaissent souhaitables ou convenables. Des bienfaits qui prendront bien souvent un format réduit de ce que je pense être Bien pour moi, comme l'ont fait les conquérants espagnols lors de l'évangélisation des Indiens au Mexique en les regroupant dans des villages, « des réductions » (le nom est suffisamment évocateur), conçus pour encourager un analogon du mode de vie espagnol et lutter contre l'éparpillement de la population ?
C'est toute la démarche de la philanthropie et du paternalisme social au cours du XIXième siècle, qui a poussé Caritas, dès sa création à la fin de ce siècle en Allemagne par Lorenz Werthmann, à affiner cette intelligence des pauvres en postulant la nécessité de connaître scientifiquement la pauvreté (les fameuses Caritaswissenschaften) afin de pouvoir alléger le sort des plus défavorisés et de soigner la misère de leur âme et de leur corps.
S'agit il d'une posture d'hospitalité qui prendrait l'autre comme il est, accepterait ses fonctionnements au sens d'Amartya Sen 14 et, donc, faciliterait
14 Revenons sur deux notions d'Amartya Sen pour bien comprendre l'enjeu de cette posture. Par fonctionnements, il entend des façons d'agir et d'être. Une vie menée par une personne consiste en la combinaison de ses fonctionnements : faire (se nourrir, se soigner,
S'agit il davantage de mobiliser « l'intelligence des pauvres » 13, des souffrants, des malheureux, c'est à dire être en capacité de comprendre sans la vivre ou sans l'avoir vécue la condition des pauvres, des malheureux, des souffrants et de saisir grâce à elle leurs intérêts objectifs afin de pouvoir les aider.
Mais, si la mobilisation du Bien pour considérer et/ou agir sur le monde semble s'imposer d'elle même, même si elle est moins évidente qu'elle n'y paraît, reste encore à définir ce que ce Bien peut être. S'agit il d'un Bien dont je décide moi même la nature à partir de mes propres représentations et certitudes ? Je veux pour l'autre ce qui est bien pour moi ; je deviens alors la référence à l'aune de laquelle ce Bien peut être qualifié (parce que je l'ai expérimenté directement ou parce qu'il correspond à mes valeurs).
Le bien à l’oeuvre. Des bonnes intentions… 13 la réalisation de ses préférences. Je m'annule comme sujet de vouloir pour l'autre, je ne suis qu'une opportunité de réalisation, qu'un facilitateur d'ac complissement. Mais comment l'être humain peut il savoir ce qui est bien/bon pour lui ? Paradoxalement en effet, quand la logique argumentative d'Amartya Sen, en définissant la capabilité par la liberté réelle de pouvoir faire ce que nous préférons en fonction de nos potentialités, semble accorder toute l'importance au pouvoir faire, à la capacité d'action, elle place en fait au centre la question de l'élaboration des préférences, celle du vouloir. Et, en cela avant que d'être libertarienne, elle est libérale puisqu'elle repose sur l'idée selon laquelle l'homme est capable d'émettre des préférences par nature. Cette vision hyperlibérale de l'homo desirans qui sait ce qui est bon pour lui, dont le modèle parfait est l'homoeconomicus, pose trois problèmes au moins : a) Celui de la limitation des préférences. Je veux ce que je sais pouvoir faire, le rabattement en quelque sorte sur une naturalité des différences de préférences (ce dont on est porteur en fonction des dispositions personnelles) oubliant la dimension sociale de leur formation. vivre dignement…) et être (bien intégré, reconnu…) qui correspondent à des accomplissements élémentaires ou complexes. Par capabilité, il signifie la liberté réelle (effective) d'accomplir des fonctionnements que l'on a des raisons de valoriser. Au centre donc, la liberté réelle de réaliser des fonctionnements choisis. La capabilité dépend 1) de la capacité d'agir des individus elle même décomposée en des ressources à dispositions (les capitaux par exemple) et en des facteurs de conversion (opérateurs de transformation) i.e. ce qui permet de transformer les ressources en capacité d'agir, pouvant être personnelles (physiques, cognitives comme les compétences) ou extérieures à la personne (il s'agit ici d'opportunités ou de possibilités ouvertes auxquelles les personnes ont accès, i.e. sociales comme le capital social, les biens publics, ou environnementales comme la capacitation spatiale par exemple l'accessibilité pour un handicapé) ; 2) de la liberté que les personnes ont d'utiliser leur capacité à agir d'une manière conforme à ce qu'elles ont choisi de valoriser. Chez Amartya Sen, est ainsi au centre une conception réalisatrice de la liberté. La capabilité d'une personne représente l'ensemble des fonctionnements effectifs ou potentiels qu'elle est capable d'accomplir sur la base de ses caractéristiques propres et des opportunités qu'elle rencontre par rapport au type de vie bonne qu'elle entend mener. Elle résulte de son aptitude à transformer des ressources et à saisir des opportunités. Sen A., UnNouveau modèleéconomique:développement,justiceetliberté, Paris, Éditions Odile Jacob, 2000 [1999].
b) Soit l'accent est mis sur la liberté réelle de faire valoir ses choix, l'enjeu est alors d'ouvrir les dispositifs existants à la différence. Les politiques
c) Celui de la transformation des préférences. Un tel modèle n'envisage pas d'externalité éducative venant informer, dynamiser, orienter les préférences (car ce serait une rupture avec l'idéal libertarien) ce qui marque un renoncement à la dimension transformatrice des politiques sociales qui ne sont plus alors qu'un facilitateur de réalisation des choix de vie. Cela condamne d'une part, par ce refus de l'hétéromobilité des préférences, les politiques sociales à un rôle d'étayage en chemin, d'accompagnement en quelque sorte, d'autre part, en privilégiant l'automobilité, i.e. la transformation des préférences à partir de soi même, à consacrer la théorie du débordement interne. L'accumulation des petits gains ouvre des perspectives et appelle de nouvelles préférences. Le capital expérientiel devient alors l'élément central de la transformation des préférences. Quand on examine de près la nature des politiques publiques qui ont, par mission, la tâche de produire du Bien pour la chose publique, deux grandes options peuvent en fait être distinguées.
a) Soit l'accent porte sur les fonctionnements de base, pour reprendre une formulation senienne, l'important est alors de créer des opportunités pour les réaliser. Les politiques s'orientent ainsi vers une instauration « dirigiste » de dispositifs d'équipements collectifs facilitant la réalisation de ces fonctionnements minimaux. « Dirigistes » car loin de la dimension libertarienne des préférences, mais fortement réductrices des inégalités de capabilité même si celle ci est elle même limitée et prédéfinie. Ces politiques sociales dessinent un État social dévelopemental créant des opportunités de capacitation limitée (par une conception minimale de la vie bonne) mais semblable.
b) Celui de la compossibilité des préférences individuelles avec celles des autres acteurs, i.e. le problème de leur recevabilité sociale (aller surfer sur la vague à Malibu toute sa vie ou transformer son existence en une dégustation œnologique permanente qui peuvent être, comme d'autres, des façons de concevoir une vie bonne pour soi). En outre, en consacrant le principe de différence des préférences, elle condamne la puissance publique à une mission d'arbitrage et d'entretien de la compossibilité de choix différents, voire divergents.
14 Bienveillance, bienfaisance, bientraitance
15 Kundera M., L'Insoutenable légèreté de l'être, Paris, Éditions Gallimard Folio, 1984 [1982], p. 431.
Le statut du bénéficiaire et de l'action
Le statut du bénéficiaire, celui à qui l'on fait ou à qui l'on veut du Bien, est paradoxal. Pour qu'il soit destinataire de l'attention ou de l'action d'autrui, il se doit d'être à la merci d'autrui, à tout le moins d'en être dépendant en ce qui concerne, tout au moins, l'action ou l'intention visée, ce que nous rappelle avec une grande lucidité Milan Kundera. « La vraie bonté de l'homme ne peut se manifester en toute pureté et en toute liberté qu'à l'égard de ceux qui ne présentent aucune force. » 15 Le Bien ne peut s'exercer, en quelque sorte, que quand le pouvoir sur est absolu, ne fût ce que circonstanciellement, quand l'autre est à la merci d'une aide que seul un tiers peut lui apporter gratuitement, sans retour. Nous sommes très loin du don maussien, car ici la vraie bonté c'est quand il n'est pas possible de rendre, de quelque ordre que ce soit. En d'autres termes, c'est quand l'autre est nécessairement demandeur et entièrement tributaire de moi que la bienveillance et la bientraitance peuvent pleinement s'exprimer. Examinons cet étrange constat pour chacun des termes sur lesquels nous nous penchons.
Le bien à l’oeuvre. Des bonnes intentions… 15 sociales doivent en ce cas soutenir l'expression et la réalisation de choix et de préférences différents. Il ne s'agit pas tant de mettre à disposition des équipements facilitants, mais bien d'atténuer le pouvoir contraignant de ceux qui existent et de les ouvrir à la diversité des usages pour des fins différentes (des droits buts en quelques sorte indiquant en quoi les institutions peuvent permettre aux individus de développer leurs propres potentialités, de faire des choix), de lutter contre leur pouvoir décapa citant, car impliquant une conception unique de la vie bonne. Ces politiques sociales expriment un État social régulateur créant et gérant des opportunités de capacitation diversifiée mais limitée par la compossibilité même de ces conceptions différentes. Rien n'est moins simple, on le voit, que de définir ce que le Bien peut être et que de décider par quelle procédure le qualifier.
1. La bienfaisance. La bienfaisance est différente de la charité. La première (portée sur les fonts baptismaux par l'Abbé de Saint Pierre au XVIIIième)
16 Lambelet A., « Faire de la philanthropie stratégique. Étude des transformations des discours et des pratiques dans une fondation privée en Suisse » in Ethnographiques, n° 30, 2015, p. 2.
16 Bienveillance, bienfaisance, bientraitance
caractérise une action sur le monde dont la récompense se trouve dans l'utilité sociale ; elle s'inscrit dans une perspective téléologique puisqu'elle vise à produire du Bien pour autrui. C'est en ce sens qu'elle est toujours une action politique. La charité, quant à elle, est égoïste, ne fait du bénéficiaire qu'un moyen pour le donateur de gagner son salut ; au mieux, elle n'est faite que par amour du divin. « Historiquement, nous explique Alexandre Lambelet, la philanthropie s'est construite contre la charité. À la charité qui représente le souci de venir en aide aux plus malheureux en leur accordant tantôt un toit, un bol de soupe ou du réconfort, les philanthropes se sont construits comme groupe sur un programme différent : l'usage de la raison et de la science pour répondre aux causes mêmes de ces malheurs, l'objectif n'étant plus tant d'aider les personnes dans le besoin que de résoudre les problèmes sociaux à l'origine de ces besoins. La philanthropie s'est ainsi développée sur un projet fort : par le progrès de la connaissance, éliminer les problèmes qui touchent des groupes sociaux particuliers. Contestant le monopole de l'État sur l'action publique et revendiquant leur propre légitimité à agir dans le domaine de l'action sociale, les philanthropes ont ainsi appelé à des investissements massifs dans l'éducation, la science et la technologie ; ils ont conçu ce qu'ils appelaient une « philanthropie scientifique » » 16. La bienfaisance, c'est littéralement faire le Bien, c'est à dire le produire par son action. La bienfaisance porte ainsi explicitement sur la fin de l'action. La bonté des bienfaisants/bienfaiteurs réside dans le résultat de l'action, pas dans l'action elle même. Ce qui compte, c'est le résultat, la procédure importe peu. Pensons à Robin des Bois. Il était bienfaisant mais pas bientraitant, pour les enrichis bien sûr, mais même aussi pour les manants auxquels il redistribuait les biens volés, tout simplement parce que, comme tout bienfaisant/bienfaiteur, il était omnipotent et dominant. Il décidait de l'objet du bienfait et du destinataire. Il procurait un bien au bénéficiaire auquel ce dernier n'aurait pas pu accéder par lui même. Il n'était en fait
Le bien à l’oeuvre. Des bonnes intentions… 17
2. La bienveillance renvoie à l'idée de bien vouloir, de bon vouloir, de bonne volonté. Elle réfère à l'intention, pas à ce qui est visé ni à la manière d'agir. Il s'agit d'une disposition morale, loin de l'idée d'action. Je peux être bienveillant et ne rien faire. Je ne cherche pas d'emblée à transformer autrui ou à agir sur lui, ni même à lui fournir un bien manquant. Je veux simplement son Bien. Il y a d'abord l'idée de ne pas nuire, c'est à dire que prime, avant tout, une bonne intention. C'est une notion marquée par la passivité comme le terme attitude bienveillante le laisse poindre ; le bienveillant n'est pas forcément un acteur. « L'acte de tendre vers ce qui pour l'autre est le convenable, donc ce qui donne un contenu à son propre « être tendu vers », nous l'appelons bienveillance » 17 Il existe, par ailleurs, un lien étroit entre bienveillance et vulnérabilité. Je suis bienveillant envers un autrui non parce qu'il est démuni, mais parce que je le reconnais comme vulnérable. Encore faut il voir de quelle vulnérabilité il s'agit ou plutôt quel statut on accorde sociétalement à cette dernière. Danilo Martuccelli nous rappelle dans sa contribution combien cette notion a varié dans son acception et, du coup, comment elle a pu servir, ou non, de support à un travail de la société sur elle même en fonction de la considération (bienveillante ou non) que l'on accordait aux Pourvulnérables.labienveillance, enfin, plus qu'agir, il s'agit d'accueillir (presque au sens de l'hospitalité) un autre fragile. Au cœur, il y a le respect de l'autre tel qu'il est, dont Nathalie Zaccaï Reyners nous montre bien dans sa contribution, en prenant appui sur le film réalisé par son frère sur sa grand mère
pas bien différent de Lindsey Vonn ou de tous ces sportifs et artistes contemporains qui font le Bien en créant leur fondation bienfaitrice. Le bénéficiaire n'est ici envisagé que comme le destinataire, le récepteur de l'action. Il est considéré comme un être déficitaire, incapable ou demi capable, impuissant à agir par lui même. Il n'est même pas nécessaire qu'il existe une relation entre le bienfaiteur et le bénéficiaire ; l'autre peut même être concrètement absent. Ce qui compte, c'est le résultat car celui ci subsiste une fois l'action bienfaitrice achevée.
17. Spaeman R., Bonheuretbienveillance.Essaisurl'éthique, Paris, Presses universitaires de France, 1997.
18. Garrigue Abgrall M., « Critique de l'usage du concept de bientraitance » in Éthique& Santé, n° 2, 2005, p. 133.
L'autre est par définition structurellement vulnérable, car dépendant de la manière dont j'agis. « Traiter donc, c'est d'emblée se mettre en relation avec un autre que soi toujours sur le mode de l'action, pas pour un échange car la relation est nécessairement asymétrique » 19. Traiter, c'est en somme agir sur quelqu'un (éventuellement avec lui) et celui qui traite/intervient est toujours en position de supériorité par rapport à l'autre, celui qui est traité, et qu'il traite donc. La traitance, comme le traitement, mauvaise ou bonne, est toujours faite sur un être dépendant, plus que vulnérable ou fragile, car il s'agit avant tout d'un être passif qui subit l'action de l'autre, comme j'essaie de l'expliciter dans
19 Hourcade Sciou A., « Bientraitance et prise en compte de la vulnérabilité » in Les ateliersdel'éthique, vol. 12, n° 2 3, 2017, p. 208.
18 Bienveillance, bienfaisance, bientraitance
Mariette « accueillie » en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, combien cela peut être une tâche aussi ingrate qu'insurmontable. La bienveillance est loin d'être une évidence, comme nous le rappelle Vivianne Châtel dans sa contribution à cet ouvrage, contrairement à ce qu'il semble de prime abord ; au mieux, dit elle, on peut y voir une forme d'agir en mode travesti. Pourtant, Sebastian Moser et Paul Loup Weil Dubuc, dans leur texte infra, y voient un référentiel symbolique du vivre ensemble, appelant ainsi de leurs vœux l'instauration d'une société bienveillante, à leurs yeux bien plus prometteuse que celle d'une société inclusive qu'on promeut aujourd'hui.
3. La bientraitance porte sur la manière d'accomplir une tâche plus que sur la nature du but que la tâche permet d'atteindre (comme l'illustre le dispositif d'accompagnement de la mort volontaire assistée médicalement). A contrario, on peut maltraiter en pensant bien faire, par inattention, par négligence, par précipitation… La bientraitance porte sur la manière d'agir sur un autre en position de dépendance par rapport à moi qui suit tout puissant et sur lequel j'ai donc une emprise. Elle comporte un aspect éminemment relationnel, interindividuel même 18. Il y a un autre concret, tangible, agissant et réagissant qui peut être affecté positivement ou négativement par l'action que je déploie à son endroit. La bientraitance porte sur la manière d'agir sur un alter en position de dépendance par rapport à un ego, ainsi tout puissant.
21. De son point de vue, la projection de la morale du soin dans la politique n'humanise pas la politique, mais la dissout dans la morale. Michaud Y., Contrelabienveillance, Paris, Éditions Stock, 2016, p. 170.
La montée en politique d'une vertu
Les philosophes écossais du XVIIIième siècle (David Hume, Francis Hutcheson, Adam Smith…) nous avaient pourtant avertis. S'ils reconnaissaient les sentiments moraux et leur importance, ils s'en méfiaient aussi comme de la peste. On ne fonde pas une politique, disaient ils, sur de bons sentiments mais sur des principes de justice 20 . Yves Michaud s'élève aussi contre la volonté d'étendre la bienveillance à la sphère de la politique, car, à ses yeux, comme à ceux des philosophes écossais du « sentimentalisme moral », elle doit demeurer confinée à la sphère des relations personnelles. 21 On n'ose pas penser ce
20 Idée que l'on retrouvera chez les solidaristes du début du XXième siècle, notamment dans leur intention de distinguer exigence morale et obligation sociale en matière de solidarité ou bien encore chez Hannah Arendt pour laquelle la politique de la pitié a tué la Révolution Française en s'intéressant à la souffrance du peuple. Arendt H., Essai sur la révolution, Paris, Éditions Gallimard, 1967 [1963].
Mais, dans tous les cas, il n'y a pas modification de la position d'asymétrie. L'un peut, l'autre pas. Il y a simplement refus d'abuser de cette position. Et dans tous les cas, la bientraitance n'est pas un absolu. Elle est toujours contextuelle et relative. C'est bien pour cela aussi que bien faire pour faire le Bien peut être usant puisque cela suppose simultanément un contrôle de soi et une considération de la situation.
Le bien à l’oeuvre. Des bonnes intentions… 19 ma contribution sur la compassion qui joue de la dialectique passivité/activité (cf. infra). Être dépendant, c'est donc être susceptible d'être maltraité : la traitance contient la possibilité d'un abus, qui peut ne pas être volontaire, en raison d'une position ou d'un statut dominant. C'est dans le choix délibéré de se garder d'avoir recours à cette position dominante que réside l'attitude bientraitante. En ce sens, il ne peut pas y avoir de bientraitance sans bienveillance, mais il n'est pas nécessaire d'être en sympathie avec la personne traitée. C'est en cela que la bientraitance renvoie fortement à la sphère professionnelle. La bientraitance interroge directement la question du soin, de la prise en charge, de l'accompagnement, bref du traitement de l'autre.
Il existe ainsi un lien étroit entre humanitaire et diplomatie, entre humanitaire et action politique. L'humanitaire permet d'intervenir et d'agir officieusement quand le politique ne peut pas agir officiellement (par exemple, ouvrir un cordon humanitaire marque le début des tractations politiques comme au Vénézuéla de Nicolas Maduro à la fin de la décennie précédente ou le chassé croisé de la création de tels cordons aujourd'hui en Ukraine). Les frontières ente humanitaire, prosélytisme et politique se dissolvent parfois au point de ne plus savoir à quoi, ni à qui, on a à faire.
22 Giridharadas A., Winnerstakeall.TheEliteCharadeofchangingtheWorld, New York, Penguin Random House, 2018.
Pour certains, comme Alexandre Lambelet le rappelle dans sa contribution à cet ouvrage, la bienfaisance contemporaine est un mode d'action des élites face aux institutions démocratiques qui les privent d'influence politique directe ; la philanthropie devient alors une arme pour mettre en œuvre leur propre programme (cf. Georges Soros aujourd'hui). On peut parler là de philanthropie stratégique. Anand Giridharadas, quant à lui, enfonce le clou plus profond lorsqu'il évoque la logique du gagnant gagnant des philanthropes contemporains qui proposent de changer le monde sans changer le système, ces élites, « faiseuses de Bien », qui détournent la volonté de changement qui anime les société contemporaines pour servir leurs propres intérêts et, surtout, qui disqualifient la capacité des institutions publiques et démocratiques à opérer des transformations systémiques ; changer sans bouleverser pourrait ainsi être leur mot d'ordre 22.
20 Bienveillance, bienfaisance, bientraitance
Pourtant, il est tout à fait possible de considérer que faire le Bien, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens, à tout le moins, que faire le Bien est saturé d'enjeux politiques. Par exemple, la philanthropie est à la fois un complément de l'action publique (les Restos du cœur en France ou les Frères musulmans en Égypte) et un perturbateur de celle ci (l'humanitaire dans la Bande de Gaza ou à Haïti, après les catastrophes naturelles de la deuxième décennie du XXIièmesiècle).
que pourrait être une politique du salut. Et pourtant c'est à un examen critique de celle ci, à la lumière de deux confrontations socio historiques différentes, que nous invite Jacques Gilbert dans sa contribution à cet ouvrage.