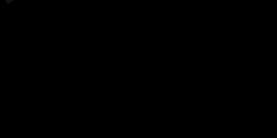A L' OCCASION DE LA SORTIE DE SON PREMIER ROMAN, LE PAPE DU TRASH S' INFILTRE DANS NOS RUBRIQUES
Journal cinéphile, défricheur et engagé, par > no 196 / avril 2023 / GRATUIT










PAUL B. PRECIADO
Le philosophe adapte Virginia
Woolf pour plaider la fluidité p. 4

JEANNE DIELMAN
Le chef-d’œuvre féministe de Chantal Akerman ressort en salles p. 46
GREGG ARAKI



Entretien somme avec le chef de file du New Queer Cinema p. 32
MK2 INSTITUT
John Waters vient présenter son premier roman, Sale menteuse p. 18


NIELS SCHNEIDER ARIANE LABED SOUHEILA YACOUB
UN FILM DE ALICE ZENITER ET BENOIT VOLNAIS
AU CINÉMA LE 19 AVRIL


ELZÉVIR FILMS PRÉSENTE
EN BREF

P. 4 L’ENTRETIEN DU MOIS – PAUL B. PRECIADO
P. 10 RÈGLE DE TROIS – JULIE DOUCET
P. 14 LES NOUVELLES – LAURA THOMASSAINT & MAÏTÉ SONNET
CINÉMA
P. 18 EN COUVERTURE – JOHN WATERS, LA VÉRITÉ CRUE
P. 28 PORTRAIT – LA RÉVÉLATION FRANZ ROGOWSKI
P. 30 L’INTERVIEW ENGAGÉE – DOONA BAE
P. 42
PORTFOLIO – SIMON RIETH DÉVOILE LES DESSOUS DE NOSCÉRÉMONIES
P. 48 CINEMASCOPE : LES SORTIES DU 29 MARS AU 3 MAI

ERRATUM
Dans notre numéro précédent, dans notre rubrique « La Nouvelle », nous avons écorché le nom de Gala Hernández López, réalisatrice de La Mécanique des fluides. Toutes nos excuses à l’intéressée.
TROISCOULEURS

éditeur MK2 + — 55, rue Traversière, Paris XII e — tél. 01 44 67 30 00 — gratuit directeur de la publication : elisha.karmitz@mk2.com | directrice de la rédaction : juliette.reitzer@mk2.com | rédactrice en chef : time.zoppe@mk2.com | rédacteurs : quentin.grosset@mk2.com, josephine.leroy@mk2.com, lea.andre-sarreau@mk2.com | directrice artistique : Anna Parraguette | graphiste : Ines Ferhat | secrétaire de rédaction : Vincent Tarrière | renfort correction : Claire Breton | stagiaire : Clémence Dubrana Rolin | ont collaboré à ce numéro : Margaux Baralon, Julien Bécourt, Xanaé Bove, Renan Cros, Camille Dumas, Marilou Duponchel, Julien Dupuy, David Ezan, Franck Finance-Madureira, Adrien Genoudet, Anaëlle Imbert, Corentin Lê, Damien Leblanc, Copélia Mainardi, Belinda Mathieu, Thomas Messias, Laura Pertuy, Raphaëlle Pireyre, Perrine Quennesson, Cécile Rosevaigue, Hanneli Victoire & Célestin, Adèle et Alexandre | photographes : Ines Ferhat, Julien Liénard | illustrateurs : Sun Bai, Michael Dunbabin, Jules Magistry | publicité | directrice commerciale : stephanie. laroque@mk2.com | cheffe de publicité cinéma et marques : manon.lefeuvre@mk2.com | responsable culture, médias et partenariats : alison.pouzergues@mk2.com | cheffe de projet culture et médias : claire.defrance@mk2.com
Illustration de couverture : Michael Dunbabin pour TROISCOULEURS

Imprimé en France par SIB imprimerie — 47, bd de la Liane — 62200 Boulogne-sur-Mer

TROISCOULEURS est distribué dans le réseau ProPress Conseil ac@propress.fr
CULTURE
P. 80 DÉCRYPTAGE – L’EFFERVESCENCE DES EXPOS COLLECTIVES
P. 83 BD – LES PISTES INVISIBLES DE XAVIER MUSSAT
Pop et pervers. Ce sont les deux mots, un peu bizarres une fois réunis, qui nous viennent quand on pense au cinéma de John Waters. Son œuvre est particulièrement séminale pour les membres de la rédac, sans doute parce qu’elle mélange joyeusement tout ce qui nous transporte : l’expérimentation formelle, la transgression, l’outrance… Mais aussi, tapies derrière les perruques infernales, les maquillages hallucinés, les imprimés léopard et les homards géants, une force de vie furieuse déployée par ces femmes au foyer déglinguos, ces filles-mères enragées et autres misfits fétichistes pour transcender leur condition et se


révolter contre les carcans sociaux. Au cœur de la débâcle, en reine incontestée de la débauche, l’extraordinaire drag-queen Divine qui, de son apparition en Jackie Kennedy dans le court métrage Eat Your Makeup en 1968 à Hairspray en 1988 en passant par les cultissimes Pink Flamingos (1972) et Female Trouble (1974), a incendié tous les codes de la féminité traditionnelle et a pulvérisé la bienséance à jamais. Peut-être que son nom ne vous dit rien – il s’agit du cinéma le plus vicieux et underground, après tout –, mais son visage, si, à coup sûr : il a inspiré celui d’Ursula, la sorcière des mers dans La Petite Sirène (1990). Une drôle d’infiltration de la marge dans l’univers policé de Walt Disney, comme une discrète traînée de poudre contestataire. En apprenant que John Waters venait en France présenter son premier roman, Sale menteuse, lors d’une conférence exceptionnelle le 27 avril à l’invitation de mk2 Institut,
nos cœurs ont bondi. L’occasion rêvée de lui poser toutes nos questions tordues et de lui permettre de pervertir le numéro avec ses recommandations hors norme, qui ont nourri nos rubriques traditionnelles (« Scène culte », « La sextape », « Sélection culture » ou même « Coul’ kids »). De Baltimore, où il vit depuis sa naissance en 1946 et a fait tous ses films jusqu’au dernier en date, A Dirty Shame (2005), le pape du trash nous a répondu avec son humour décapant. À l’image de son œuvre, traversée par l’obsession de bousculer le statu quo, poussant l’immoralité jusqu’à faire revivre les morts et jouer avec les ordures pour mieux souligner, par contraste, le bonheur d’être en vie et la seule injonction que l’on devrait accepter : en profiter.
TIMÉ ZOPPÉ
03 © 2018 TROISCOULEURS — ISSN 1633-2083 / dépôt légal quatrième trimestre 2006 Toute reproduction, même partielle, de textes, photos et illustrations publiés par mk2 + est interdite sans l’accord de l’auteur et de l’éditeur — Magazine gratuit. Ne pas jeter sur la voie publique. Sommaire
+ UN CAHIER MK2 INSTITUT DE 10 PAGES EN FIN DE MAGAZINE
P. 86 PAGE JEUX
avril 2023 – no 196
Le philosophe signe son premier film, Orlando. Ma biographie politique, présenté à la Berlinale en février, et en clôture du festival Cinéma du réel le 2 avril. Un essai très libre, entre fiction et documentaire, qui imagine d’autres manières d’envisager la transidentité – et l’identité tout court –en s’inspirant du roman Orlando de Virginia Woolf, publié en 1928. À Berlin, on a discuté avec Paul B. Preciado de cette œuvre politique et poétique, qui bouscule les codes en douceur et propose de nouvelles utopies.
Comment avez-vous découvert Orlando, le roman de Virginia Woolf ?
Quand j’étudiais la littérature anglaise à l’école. On ne nous parlait pas du tout de la question du changement de sexe, qui est pourtant au cœur du livre [qui suit le périple d’un noble anglais qui traverse les époques et les continents et se réveille en femme au milieu du récit, ndlr]. Je suis né en Espagne dans les années 1970, cette possibilité existait peut-être dans mes rêves, mais elle n’était pas réelle. Le fait que Virginia Woolf l’écrive, ça m’a fait comprendre que c’était possible. Orlando est devenu pour moi un livre fétiche, mais je ne suis pas dans une espèce d’adoration naïve de Woolf. Je pense que ce n’était pas quelqu’un de sympathique, qu’elle était très bitchy. Avec aussi un background très colonial. Elle faisait partie de cette espèce de nouvelle bourgeoisie anglaise. Il y a beaucoup de raisons qui font que je ne me sens pas l’Orlando de Virginia Woolf.
Le film travaille justement la question de savoir qui serait Orlando aujourd’hui…
Quand j’ai eu envie de lui écrire cette lettre filmée, c’était pour dire à Virginia Woolf :
« Ton Orlando n’est pas exactement ce que tu avais imaginé. » Il est certes né dans l’Angleterre coloniale du xvie siècle, mais aujourd’hui il serait certainement autre chose. Pas blond, pas bourgeois, pas unique [dans le film, plusieurs personnes de tous genres, tous âges et tous vécus incarnent successivement le personnage d’Orlando, ndlr].

Woolf imaginait un passage de la masculinité à la féminité, mais pour moi ce qui est plus intéressant encore, c’est la transition d’un régime binaire à non binaire. En relisant le livre du point de vue d’Orlando, je me suis rendu compte que, si elle vivait aujourd’hui, peut-être que Virginia Woolf se dirait non binaire. Je pense qu’elle avait beaucoup de mal avec la position de la féminité traditionnelle. Sauf qu’en 1928 il n’y avait pas de politique non binaire. C’est aussi ça que j’ai essayé de faire, une sorte d’adaptation du livre de ce point de vue. C’est pour ça que les Orlando du film ne sont pas racontés, comme dans la plupart des films sur les trans, selon une trajectoire entre un « avant » et un « après ». Il n’y a pas d’avant et d’après mais tout le temps quelque chose qui échappe au binarisme.
Toute l’idée du film, notamment les dialogues qui mêlent l’expérience réelle des acteurs et actrices et des passages du livre de Woolf, et la mise en scène qui entremêle les époques, est de dépasser l’expérience individuelle de la transidentité et de la non-binarité au profit d’une expérience collective qui transcende le temps et l’espace. Qu’est-ce qui vous plaît dans cette idée ? Ce cadre, cette chronologie, c’était une des choses qui m’ont donné envie de travailler sur Orlando. C’est d’ailleurs ce qui m’a questionné au départ. En m’imaginant m’attaquer à cette adaptation, je me suis dit : « Oh mon Dieu, je me suis mis dans mon propre Fitzcarraldo [épopée de Werner Herzog sortie en 1982 dont le tournage dans la forêt amazonienne a été long et éprouvant, ndlr]… Quelle idée ! » Quatre cents ans, les voyages… Mais ce qui me plaisait beaucoup dans cette chronologie, c’était que ça permettait de sortir de l’idée que la biographie commence quand on naît et finit quand on meurt. Ce que je voulais raconter, c’est ce qui m’a permis à moi d’être la personne que je suis. Pour ça, j’ai besoin de Christine Jorgensen [une Américaine qui fut la première personne à avoir fait une chirur-
gie de réassignation sexuelle, mondialement médiatisée, dans les années 1950, ndlr], de Marsha P. Johnson [militante trans américaine, figure des émeutes de Stonewall en 1969 puis de la lutte contre le sida avec Act Up, ndlr], de Virginia Woolf, mais j’ai aussi besoin d’Éléonore et de Ruben, qui dans mon film ont 8 et 14 ans [et incarnent aussi des versions d’Orlando, ndlr]. Je sens que ce sont beaucoup plus mes contemporains que certaines personnes de mon âge. Il y a Jenny Bel’Air, qui est une figure historique du mouvement trans et de la nuit en France [elle a notamment été physio au Palace pendant des années, ndlr], mais il y a aussi Lilie, une enfant médiatisée en France depuis un ou deux ans parce qu’on lui a refusé un changement de prénom. Toutes ces personnes font partie de ma biographie.
Le 16 février, l’Espagne, pays où vous avez grandi, a voté une loi permettant le changement de genre librement dès 16 ans sur simple déclaration administrative. Comment avez-vous accueilli la nouvelle ?
C’est complexe. D’un côté, je me dis que c’est génial. Mais c’est un espace que je connais,
no 196 – avril 2023 04 Cinéma > L’entretien du mois
© Pierre et Gilles / Paul B Preciado
Pierre et Gilles, Sunset on Uranus, 2022
je sais que ça va dépendre beaucoup de la volonté des administrations et des médecins. Aujourd’hui, on nous prête beaucoup d’attention mais, en même temps, on est objets de violences quotidiennes… En Espagne, ça a généré un backlash extraordinaire. Surtout, pour moi, la véritable avancée, ça serait d’arrêter d’inscrire l’identité sexuelle sur les papiers d’identité. Ne pas mettre « masculin/féminin/ autre », ne rien mettre. C’est une forme de discrimination juridique. Ça nous paraîtrait insensé aujourd’hui de mettre sur la carte d’identité « juif » ou « musulman ». On a besoin de se permettre de regarder le monde autrement. Pour moi, c’est
pas comme un réalisateur –, celle qu’on puisse changer le nom de toutes les choses en permanence. Si on perd cette plasticité, on perd la liberté politique, mais aussi le rapport à la vie. Car la vie, c’est la possibilité que les choses soient en mutation, polysémiques, se transforment, se métamorphosent. J’avais toujours pensé que le changement de prénom légal était politique. Mais, quand j’ai changé de prénom, je me suis rendu compte que c’était une révolution poétique. Le fait d’être appelé par un nom différent, de l’entendre prononcé collectivement par les autres, c’est un moment incroyable. Un acte de création. C’est réenchanter le
filmer ça, et en même temps je savais que je ne voulais pas faire de scènes traditionnellement porno graphiques, parce que les personnes trans sont représentées soit dans des films d’horreur, soit de manière exotico-pornographique. Je voulais que les personnes dans le film soient représentées exactement comme elles le souhaitaient. Ne pas imposer de codes particuliers. C’est l’acteur, Oscar, qui a décidé comment faire l’amour avec l’arbre après avoir lu la scène.
Vous parlez dans le film de votre rapport au sommeil, en expliquant que c’est là, dans ces phases où vous dormez beaucoup, que vous pouvez projeter d’autres choses sur le monde…
jusqu’au 22 avril / Odéon 6e
Othello
de William Shakespeare mise en scène Jean-François Sivadier
jusqu’au 21 avril / Berthier 17e
Némésis
d’après le roman de Philip Roth mise en scène Tiphaine Raffier création
9 – 26 mai / Odéon 6e

Daddy
texte de Marion Siéfert, Matthieu Bareyre mise en scène Marion Siéfert
réducteur d’être devant quelqu’un et de devoir d’emblée dire si c’est un homme ou une femme. Dans le film, il y a cet horizon utopique dans lequel Virginie Despentes incarne une juge qui octroie des nouveaux papiers d’identité sans mention du genre. « Non binaire », pour moi, ce n’est pas une identité, c’est « beaucoup plus », « au-delà de », c’est une possibilité infinie.
Vous dites en voix off dans le film que, pour vous, être trans, c’est devenir poète…
Je trouvais intéressant de travailler avec Virginia Woolf pour échapper à cette colonisation du langage sur notre corps, sur le désir, sur la sexualité, par les discours psychologique, médical, psychiatrique, psychanalytique. Quand on parle de nous et de nos désirs, la terminologie qu’on utilise est issue de la psychopathologie du xix e siècle. C’est quand même terrifiant… Dans Orlando, il y a comme un principe poétique qui traverse tout. C’est l’idée d’un écrivain – et c’est peut-être pour ça aussi que ça me touche, parce que j’ai fait le film comme un philosophe,
quotidien. Oui, on peut changer le nom des choses. Ce qui était beau, quand on a travaillé sur Orlando, c’est qu’à un moment, entre nous, on parlait à peu près comme Virginia Woolf. Après avoir passé notre vie à utiliser le langage de la psychopathologie, de la psychanalyse, c’était soudain une liberté incroyable.
La nature est importante dans le roman de Woolf, ce que vous transposez dans certaines scènes du film. Est-ce que vous aviez l’idée de réenchanter aussi le lien entre nature et transidentité ?
Quand j’ai relu le livre pour l’adapter, je me suis rendu compte que ça commençait par une scène écosexuelle – même si c’est une notion qui a été inventée plus tard par Annie Sprinkle et Beth Stevens, pour désigner cette capacité à être dans un rapport érotique, sensuel, avec tout être vivant, et pas simplement avec les humains dans des relations hétérosexuelles.
C’était une surprise, j’avais totalement oublié. Le livre commence par une scène dans laquelle Orlando fait l’amour avec un arbre. Je me suis demandé comment
Tous les jours, il nous arrive quelque chose d’assez incroyable : pendant plusieurs heures, on arrête d’être conscients et on entre dans un nouvel univers qu’on ne contrôle pas, on ne sait pas exactement ce que c’est. On est en transition. Dans le roman, Orlando dort tout le temps. Il s’endort même pendant des années. Parfois, socialement, je trouve qu’on est un peu endormis, comme si on était anesthésiés par la dépression néolibérale. Je trouve qu’on vit un moment où il faut se réveiller. Les Orlando ont toujours été là, mais avant iels étaient endormi•es parce qu’iels ne pouvaient pas exister. Les rêves m’intéressent énormément, en tant que philosophe. Les rêves pris en dehors de la lecture psychanalytique. Ça fait des années que je tiens un carnet de rêves, ils m’ont toujours surpris. Et je crois au cinéma comme à une technologie de production de rêves collectifs. C’est comme si on entrait dans la salle et qu’on dormait ensemble pendant une heure quarante.
Orlando. Ma biographie politique de Paul B. Preciado (1 h 38)
•
Projection en clôture du festival Cinéma du réel, le 2 avril à 19 h 30 au Centre Pompidou
PROPOS RECUEILLIS PAR TIMÉ ZOPPÉ
12 mai – 9 juin / Berthier 17e
Hedda
variation contemporaine d’après Hedda Gabler d’Henrik Ibsen
texte de Sébastien Monfè, Mira Goldwicht mise en scène Aurore Fattier
7 – 18 juin / Odéon 6e
Sur les ossements des morts
[ Drive Your Plow Over the Bones of the Dead ]
d’après le roman d’Olga Tokarczuk un spectacle de Complicité mise en scène Simon McBurney en anglais, surtitré en français
avril 2023 – no 196 05 L’entretien du mois < Cinéma
« Être appelé par un nom différent réenchante le quotidien. »
EN BREF

L’ethnie Wayúu au cœur des Oiseaux de passage (2019) est la plus importante de Colombie et ne risque pas particulièrement de disparaître car ses coutumes et sa langue, le wayúunaiki, utilisée dans le film, sont encore bien vivaces. Mais, pour les cinéastes Ciro Guerra et Cristina Gallego, raconter cette histoire de naissance d’un cartel avec un certain réalisme magique était une manière de faire découvrir cette communauté repliée sur elle-même, qui a su se préserver de l’influence occidentale.
Infos graphiques
TIREZ LA LANGUE LEWAYÚUNAIKI
Phénomène outre-Manche, où il a caracolé en tête du boxoffice, The Quiet Girl de l’Irlandais Colm Bairéad (sortie le 12 avril) est quasi entièrement dialogué en gaélique, idiome devenu langue officielle dans l’Union européenne seulement en 2022. Tour d’horizon de la manière dont le septième art s’est fait le relais de langues régionales, pour des raisons politiques, de représentativité ou simplement pour garder la trace d’une culture menacée.
LE CAKCHIQUEL





S’il ne veut pas limiter ses personnages à des fonctions documentaires, le réalisateur guatémaltèque Jayro Bustamante propose avec Ixcanul (2015) un portrait très précis, à la limite de l’ethnographie, de l’ethnie cakchiquel. Ces descendants des Mayas vivant dans les montagnes de l’ouest du Guatemala parlent une langue du même nom et semblent isolés hors du temps. Principalement paysans, ils sont victimes de discrimination et d’exaction, comme le vol de bébés, que le réalisateur dénonce ici.

LEFRIOULAN ETLEVÉNÈTE L’INUKTITUT


Quand Zacharias Kunuk réalise son premier long métrage, Atanarjuat. La légende de l’homme rapide (2002), il a un objectif bien précis : préserver la culture inuite à travers l’un de ses quatre grands ensembles dialectaux, l’inuktitut. Inspiré par une légende locale, entre amour, chamanisme et survie dans une communauté de l’Arctique, le cinéaste ne s’est pas contenté de tourner son film dans sa langue natale, mais a également engagé une équipe d’acteurs et de techniciens composée quasi totalement d’Inuits.
raconte l’arrestation de six jeunes femmes accusées d’avoir participé à une cérémonie diabolique au xviie siècle, dans un Pays basque français où officiait le terrible juge Pierre de Lancre. Récit féministe et historique, c’est aussi un récit géographique. Très fortement lié à la mythologie basque, le film a été tourné dans la partie espagnole de ce territoire. Entièrement dialogué en basque, il trouve ainsi une cohérence et folklorique, et territoriale.

Piccolo corpo (2022), tragique histoire du deuil impossible d’un enfant mort-né par sa jeune mère, est entièrement tourné en frioulan et en vénète, idiomes parlés dans la région du nord-est de l’Italie où l’action se déroule. Pour la réalisatrice, Laura Samani, cette décision politique, apparue dès le début du projet, est une manière à la fois de coller à l’époque du film (le début du xxe siècle), mais aussi de rendre hommage à ces langues aux influences slaves interdites par le fascisme, qui prônait la suprématie de la langue italienne.

En bref no 196 – avril 2023 06
PERRINE QUENNESSON
The Quiet Girl de Colm Bairéad, ASC (1 h 36), sortie le 12 avril
Ça tourne
AUDREY DIWAN
Asseyez-vous confortablement dans votre fauteuil Pomare – siège en rotin emblématique du nanar érotique culte Emmanuelle de Just Jaeckin, sorti en 1974. La réalisatrice de L’Évènement, Lion d’or à Venise en 2021, va revisiter cette œuvre aussi célèbre que problématique dans un remake.
C’est Noémie Merlant qui prêtera ses traits à l’héroïne, autrefois campée par Sylvia Kristel. Sans en sacrifier le côté sulfureux, Audrey Diwan devrait, on en est sûrs, se débarrasser de l’exotisme et de la naïveté du film originel.
XAVIER LEGRAND
Jusqu’à la garde, son thriller familial oppressant, a été l’une des découvertes les plus puissantes de 2018. Xavier Legrand prépare Le Successeur.
D’après Variety, le film suivra le « directeur artistique nouvellement nommé d’une célèbre maison de couture parisienne » qui « commence à ressentir des douleurs à la poitrine » et doit se rendre à Montréal « pour organiser les funérailles de son père ». Il « découvre qu’il a peutêtre hérité de bien pire que le cœur fragile de ce dernier ». Marc-André Grondin, révélé dans C.R.A.Z.Y. de Jean-Marc Vallée en 2005, incarnera le personnage principal.
LUCA GUADAGNINO
Après son teen movie vampirique Bones and All (2022), Guadagnino va adapter Queer de William S. Burroughs, sur l’errance d’un homme dans le Mexique du début des années 1950, entre fêtes imbibées dans des bars gays et découverte d’une plante hallucinogène qui offrirait un pouvoir télépathique. Tenez-vous bien : c’est l’ex-007 Daniel Craig qui campera le héros. Un choix pas si étonnant : d’après une étude sérieuse du magazine The Grocer, le James Bond version Craig, adepte des Vesper Martini, est, de loin, celui qui a la plus belle descente.
SAMUEL THEIS
De l’alcool, toujours, mais cette fois dans Je le jure, le prochain long métrage de l’acteur et réalisateur lorrain (Petite nature, 2022). D’après son synopsis, le film suivra Marco, un trentenaire porté sur la bouteille, employé dans une recyclerie de Forbach, et tiré au sort pour être juré d’assise afin de juger le cas d’un jeune pyromane accusé d’homicide involontaire Au casting : Antoine Reinartz, Anaïs Demoustier et Valeria Bruni Tedeschi.
KIRSTEN JOHNSON
Comme nous l’apprend le site Internet ScreenDaily, Kristen Stewart va incarner la romancière et activiste queer Susan Sontag (autrice, disparue en 2004, du célèbre Notes on Camp, publié en 1964) dans un film réalisé par la cinéaste et chef-op américaine Kirsten Johnson (collaboratrice de Laura Poitras et de Michael Moore). À mi-chemin entre documentaire et fiction, il a en partie été tourné pendant la Berlinale, où Stewart était présidente du jury. On a hâte de voir comment l’œuvre révolutionnaire de Sontag va infuser cet intrigant projet.
JOSÉPHINE LEROY
Après PHILOMENA
Le nouveau film de Stephen FREARS
Sally HAWKINS Steve COOGAN
Son histoire a changé l’Histoire
PATHÉ BBC FILM INGENIOUS MEDIA ET CREATIVE SCOTLAND PRÉSENTENT
AVEC LA PARTICIPATION DE CANAL+ ET CINÉ+ UNE PRODUCTION BABY COW UN FILM DE STEPHEN FREARS
SALLY HAWKINS STEVE COOGAN HARRY LLOYD MARK ADDY “THE LOST KING”

CASTING LEO DAVIS ET LISSY HOLM REPÉRAGES LLORET MACKENNA DUNN MIx SON STUART BRUCE
1ER ASSISTANT RÉALISATEUR DAVID CRABTREE RESPONSABLE MAqUILLAGE MA xINE DALLAS

COSTUMES RHONA RUSSELL MUSIqUE ALEx ANDRE DESPLAT MONTAGE PIA DI CIAULA ACE, CCE
DÉCORS ANDY HARRIS DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE ZAC NICHOLSON BSC
COPRODUCTEUR WENDY GRIFFIN PRODUCTEURS DÉLÉGUÉS CAMERON MCCRACKEN JENNY BORGARS
ROSE GARNETT ANDREA SCARSO JEFF POPE PHILIPPA LANGLEY
PRODUIT PAR STEVE COOGAN CHRISTINE LANGAN DAN WINCH D APR S LE LIVRE “THE KING’S GRAVE:
THE SEARCH FOR RICHARD III” DE PHILIPPA LANGLEY ET MICHAEL JONES
SCÉNARIO STEVE COOGAN ET JEFF POPE RÉALISÉ PAR STEPHEN FREARS
En bref avril 2023 – no 196 07
© PATHÉ PRODUCTIONS LIMITED AND BRITISH BROADCASTING CORPORATION 2022 TOUS DROITS RÉSERVÉS. le
au cinéma
29 mars
John Wate rs présente
On a sondé John Waters sur sa scène de sexe préférée. Il nous a parlé de Mademoiselle de Tony Richardson, écrit par Jean Genet, où Jeanne Moreau en institutrice perverse allume des feux juste pour voir un bel Italien porter secours aux villageois et mater ses muscles saillants rougir dans les brasiers.

Pendant notre première interview avec John Waters, en 2019, il nous avait parlé de sa rencontre avec Jeanne Moreau à la projection de son film A Dirty Shame en 2005. « J’étais ultra nerveux et j’ai sorti : “Euh, on a eu quelques problèmes de censure.” » Là, elle m’a répondu : “Pourquoi ? C’est de la poésie.” » L’actrice voulait sûrement parler
The Milton Berle Show (1948-1956)
Milton Berle, c’est un peu l’équivalent de Michel Drucker ou de Guy Lux à la télé américaine. L’animateur de Texaco Star Theater sur NBC, émission plus tard renommée le Milton Berle Show sur ABC, a été l’une des premières stars du petit écran, surnommé Mr. Television. Dans cette suite de sketchs et de variétés musicales dont Milton était le fil rouge, les Américains ont pu voir l’une des premières performances d’Elvis Presley, ou d’autres invités comme Jayne Mansfield. John Waters nous a cité ce show car « ils avaient Dagmar, la première présentatrice genre strip-teaseuse plantureuse que j’ai aimée ». Lui qui dans ses films a tant joué des protubérances troublant les genres a sûrement apprécié la manière mutine de l’actrice Jennie Lewis de détraquer le stéréotype de la dumb blonde girl.

des impressions bizarres que l’on ressent parfois devant les films de Waters. Et c’est bien ce que l’on éprouve devant Mademoiselle, un sommet de perversité. Moreau y interprète une institutrice qui commet toutes sortes de méfaits incognito, puisqu’elle sait bien, vu la xénophobie qui règne dans son village, que l’on accusera le bûcheron italien, Manou, qu’elle désire sèchement. L’air de rien, elle le regarde sauver des gens dans les incendies qu’elle provoque. Elle ressemble un peu à la serial mom (lire p. 12) de Waters qui elle aussi commet des crimes sans être inquiétée, son statut de mère de famille parfaite la protégeant. À mesure que ses attentats s’intensifient, la tension sexuelle entre elle et le bûcheron grandit. Lors d’une de leurs premières rencontres clandestines dans la forêt, tout est dans le non-dit, le symbole phallique. Mademoiselle est toute raidie, sans expression, tandis que, dans un contrechamp subjectif, elle regarde le bûcheron manipuler sa grosse tronçonneuse. Il lui parle de son fils, qu’elle a en classe, et on voit bien qu’elle
ne l’écoute pas. La caméra isole, fétichise une partie du corps de l’Italien, son bas-ventre. Les bruits de hache et des animaux de la forêt créent une sensualité étrange, biscornue. Il retire un peu son tee-shirt. « La puttanella », dit-il, découvrant une vipère logée au-dessus de sa ceinture. Retour sur le visage de Mademoiselle, toujours plus pincé, bien que l’on sente le feu qui monte en elle. Le serpent s’entortille autour des mains viriles de Manou. « Vous avez peur ? » lui demande-t-il. « Vous avez tort, il est gentil », ajoute-t-il, comme une invitation. « Touchez. » La ride du lion de Mademoiselle se plisse, elle n’en peut plus. Alors, très doucement, il lui prend la main, et elle touche tout à la fois son sexe, le danger, la tentation, le crime. Elle reste coite. « C’est la première fois que nous nous voyons », lui dit Manou. On sait déjà que ce ne sera pas la dernière.
Le pape du trash nous a parlé de ses trois shows préférés – on l’imagine les regarder dans sa jeunesse sur sa petite télé à Baltimore avant que ces shows parfois kitsch n’infusent ses films.
Lie Detector (1983)
L’émission était animée par l’avocat pénaliste F. Lee Bailey (qui a entre autres défendu le meurtrier Sam Sheppard ou Albert DeSalvo, l’« étrangleur de Boston »). Des personnalités répondaient à des questions, puis on passait leurs déclarations au polygraphe – un détecteur de mensonges basé sur les réactions électrophysiologiques. John Waters a certainement été galvanisé par l’atmosphère d’interrogatoire, lui qui a assisté à beaucoup de procès. Et ce jeu de la vérité a peut-être aussi inspiré l’héroïne mytho de Sale menteuse, son premier roman (lire p. 18). Car, dans le genre mensonges gonflés, on a pu voir dans ce show un pompiste faire avaler que Howard Hughes lui avait légué toute sa fortune, ou le coiffeur de Ronald Reagan tenter de convaincre que celui-ci n’avait jamais fait de teinture.
The Buddy Deane Show (1957-1964)

« C’était une émission de danse diffusée sur une chaîne locale, je m’en suis inspiré pour Hairspray ! » nous a confié Waters. Dans son film sorti en 1988, peut-être son plus populaire, il suit les aventures de Tracy, jeune fille replète qui tente un concours de danse country et rock ’n’ roll pour ados, dans le contexte de la ségrégation raciale aux États-Unis. Le cinéaste s’est souvenu du racisme ambiant qui avait conduit la chaîne WJZ-TV à déprogrammer le Buddy Deane Show, car elle ne voulait pas y voir de danseurs noirs. L’animateur y jouait aussi de la musique dédaignée par les autres émissions de ce type, parce qu’elle sonnait « trop noire ». En hommage, Waters fera apparaître Buddy Deane, le temps d’un caméo, dans Hairspray, où il incarnera un journaliste qui interviewe un gouverneur assailli par des manifestations pour les droits civiques.


no 196 – avril 2023 8 En bref
Ligne de dialogue de la drag-queen Divine dans le rôle de Babs Johnson, autoproclamée personne la plus répugnante sur Terre, dans Pink Flamingos (1972) de John Waters.
08
QUENTIN GROSSET
© D.R. © D.R. © D.R. © D.R. La sextape La phrase Petit écran TV
QUENTIN GROSSET
“
Mademoiselle” de Tony Richardson (1966)
« Le stupre, c’est ma politique ! Le vice, c’est ma vie ! »
L’AMOUR ÉGARÉ DE MORGAN SIMON












Dans un appart à Romainville, notre journaliste a assisté au tournage de scènes de L’Amour égaré, deuxième long métrage de Morgan Simon, six ans après le puissant drame père-fils Compte tes blessures. Une plongée dans la relation claustro d’une mère (Valeria Bruni Tedeschi) et de son fils (Félix Lefebvre) entre Noël et le Jour de l’An.

« J’ai essayé de reconstituer l’ambiance de l’appart où j’ai grandi, à Créteil », précise Morgan Simon en nous faisant visiter le décor principal du film, un appartement de banlieue parisienne à la déco chargée. « L’Amour égaré, c’est Compte tes blessures version mère-fils sans les tatouages et la musique hardcore. » Son premier long décrivait les relations complexes d’un chanteur de posthardcore (Kévin Azaïs) avec son père (Nathan Willcocks) et la nouvelle petite-amie de celui-ci (Monia Chokri). Ici, dans la chambre du fils, Félix Lefebvre et Valeria Bruni Tedeschi, qui incarnent cette micro-famille, alternent complicité autour d’une manette de PlayStation et conflit larvé quand elle fait ses comptes et qu’il tente des dunks dans son panier de basket. « Le scénario a un geste simple, fort et nécessaire, presque évident. J’aime les personnages qui n’ont pas de pouvoir, ce sont les plus beaux, les plus émouvants », confie la comédienne, vêtue d’un jean à fleurs et d’un tee-shirt noir au motif léopard doré et qui balance, d’une scène à l’autre, entre exubérance et dépression. Pour ce portrait d’une quinqua qui doit s’extirper de sa relation exclusive avec son fils [le film est coproduit par Trois Brigands Productions et Wild Bunch et sera distribué en salles par Wild Bunch, ndlr], le réalisateur n’hésite pas à laisser tourner la caméra, à parler à ses comédiens pendant les prises, à leur souffler des répliques, des idées. Félix Lefebvre est en immersion totale dans cette chambre d’ado, il lui arrive même de passer la nuit sur le décor (« Ça évite aussi des heures de trajet ! » s’amuse-t-il). Suivra un plan de Valeria Bruni Tedeschi seule, constatant les dégâts d’un réveillon de Noël qui a mal tourné, mis en boîte quelques jours avant. Elle se saisit d’un morceau de miroir cassé, s’assied à la table, le geste lent, le visage grave. Une chorégraphie du désespoir, une cigarette au bout des doigts. Le tournage se poursuivra quelques semaines à Bagnolet, à Créteil et dans le décor du bar tenu par le troisième personnage important du film, campé par Lubna Azabal. Personnage qui parviendra, peut-être, à mettre un terme à la toxicité de cet amour dévorant.
Benjamin Voisin Noémie Merlant
Un film de André Téchiné


En bref avril 2023 – no 196 09 FRANCK FINANCE-MADUREIRA
Infiltré CRÉATION CURIOSA FILMS présente Audrey Dana André Marcon SCÉNARIO DE ANDRÉ TÉCHINÉ ET DE CÉDRIC ANGER LES ÂMES SŒURS
LE 12 AVRIL AU CINÉMA AVEC ALEXIS LORET IMAGE GEORGE LECHAPTOIS MONTAGE ALBERTINE LASTERA MUSIQUE ORIGINALE MATHIEU LAMBOLEY SON VINCENT GOUJON LOÏC PRIAN CYRIL HOLTZ DÉCORS CARLOS CONTI COSTUMES KHADIJA ZEGGAÏ 1ER ASSISTANT RÉALISATEUR MICHEL NASRI SCRIPTE MITSUKO JURGENSON RÉGISSEUR GÉNÉRAL CHRISTOPHE VIALARET DIRECTEUR DE PRODUCTION BRUNO BERNARD DIRECTRICE DE POSTPRODUCTION SUSANA ANTUNES COPRODUCTRICE ANNE DERRÉ PRODUCTRICE EXÉCUTIVE CHRISTINE DE JEKEL PRODUCTEUR ASSOCIÉ ÉMILIEN BIGNON PRODUIT PAR OLIVIER DELBOSC UNE COPRODUCTION CURIOSA FILMS ARTE FRANCE CINÉMA LEGATO FILMS HBB 26 AD VITAM AVEC LA PARTICIPATION DE CANAL+ ARTE FRANCE CINÉ+ AVEC LE SOUTIEN DE LA RÉGION OCCITANIE EN PARTENARIAT AVEC LE CNC DISTRIBUTION FRANCE AD VITAM VENTES INTERNATIONALES PLAYTIME © 2022 CURIOSA FILMS - ARTE FRANCE CINÉMA - LEGATO FILMS - HBB 26 - AD VITAM
Règle de trois
JULIE DOUCET

3 films de votre jeunesse qui ont été déterminants ?
Flash-back
LESALAIREDELAPEUR
Sorti il y a soixante-dix ans, le détonant film d’aventure d’Henri-Georges Clouzot demeure un classique indéboulonnable du cinéma français, malgré son accouchement insolite et complexe.
Sorti en France le 22 avril 1953, Le Salaire de la peur remporta cette même année la Palme d’or cannoise et l’Ours d’or berlinois, un doublé possible à l’époque. Le chemin fut pourtant semé d’embûches pour ce film dans lequel quatre Européens échoués en Amérique centrale – dont Mario (Yves Montand) – acceptent la dangereuse mission de conduire deux camions remplis de nitroglycérine afin d’éteindre un puits de pétrole en feu. « À l’issue de la Seconde Guerre mondiale, il y a une cinématographie française à reconstruire, et Clouzot en est une figure reconnue », confie Chloé Folens, autrice des Métamorphoses d’Henri-Georges Clouzot (Vendémiaire, 2017).
« Le cinéaste lance au début des années 1950 un projet qui fait grand bruit : un documentaire au Brésil censé s’inventer au fur et à mesure du tournage. » Mais ce périple
en Amérique latine se solde par un échec. « Clouzot n’avait pas anticipé toutes les difficultés logistiques, comme la nécessité d’emporter partout son propre carburant pour se déplacer, et ce documentaire reste inachevé. Mais quand le cinéaste rentre en France il n’a pas abandonné l’idée de mettre en scène les impressions recueillies au Brésil. » Clouzot décide alors d’adapter le roman de Georges Arnaud Le Salaire de la peur, et tourne en Camargue. « Clouzot avait croisé en Amérique latine des personnes déracinées qui hantaient les petites villes, cette réalité sociologique a rencontré son goût pour les personnages gris aux motivations amorales. » Il en résulte une œuvre brute et grinçante. « Le film a connu un grand succès en France, mais il a fait lever des sourcils aux États-Unis, où la presse a considéré que c’était un pamphlet anticapitaliste par son portrait d’une société pétrolière américaine abusive. » Un remake signé William Friedkin, Le Convoi de la peur, voit le jour en 1977, mais fait un flop au box-office ; preuve que Clouzot avait réussi un exploit en tirant le meilleur d’une aventure si mouvementée.
DAMIEN LEBLANC
Sacrée Grand Prix du festival d’Angoulême 2022 pour son fanzine déglingué Dirty Plotte, publié dans les années 1980-1990, l’autrice québécoise Julie Doucet revient (alors qu’elle avait décidé d’arrêter la BD) avec Suicide total (L’Association), une fresque vertigineuse sur sa correspondance avec un jeune lecteur français. Elle répond à notre questionnaire cinéphile.
Il y a d’abord Stranger Than Paradise de Jim Jarmusch, que j’ai vu à sa sortie en version originale sans sous-titres. Mon anglais étant loin d’être parfait à l’époque, j’en ai fait une lecture, disons, très personnelle. C’était la première fois que je me sentais comprise, voyant ma génération représentée sur un grand écran. J’y avais vu des jeunes gens déboussolés, désœuvrés, cherchant une issue. Cette issue étant de faire ses valises et de partir. Le film ne raconte pas tout à fait ça… Mais ça reste un portrait fidèle de cette période, d’une certaine scène artistique qui ressemblait assez à celle de Montréal. Et puis il y a La Maman et la Putain de Jean Eustache. Je l’ai vu pour la première fois à la Cinémathèque québécoise, lorsque j’étais étudiante. J’ai adoré voir Paris et son milieu intello-hippie -branché des années 1970. Bien sûr, il y a la superbe performance des trois interprètes ; le texte fleuve ; le personnage de Jean-Pierre Léaud en jeune homme oisif, qui vit aux crochets de sa copine, quel bonimenteur ; les archétypes… La démonstration est parfaite. Les Ailes du désir de Wim Wenders, que j’étais allé voir avec ma mère en 1987. J’avais été émue aux larmes par ce portrait de Berlin, très beau, en noir et blanc. L’atmosphère générale, plutôt sombre, me plaisait beaucoup.
3 films dans lesquels vous retrouvez l’ambiance de votre fanzine lancé en 1988, Dirty Plotte ?
Le Cabinet du docteur Caligari de Robert Wiene pour ses décors tout de travers, pour l’absence de perspective, l’effet cauchemardesque général. Ça me rappelle mes premières bandes dessinées. Au clair de la lune d’André Forcier, un film tourné à Montréal en 1983 dans lequel on voit la ville l’hiver, ses ruelles, ses petits coins sombres habités par toute une brochette de personnages plus ou moins marginalisés. Le style de Forcier est toujours très poétique, sombre mais merveilleux. C’est à peu près l’époque où j’ai commencé à dessiner des bandes dessinées, c’est le Montréal de mes années d’étudiante. Subway de Luc Besson, parce qu’il se passe dans les années 1980, qu’il est très urbain et que j’ai dessiné plusieurs histoires qui se passent dans le métro et qui impliquent toutes sortes de personnages bizarres.
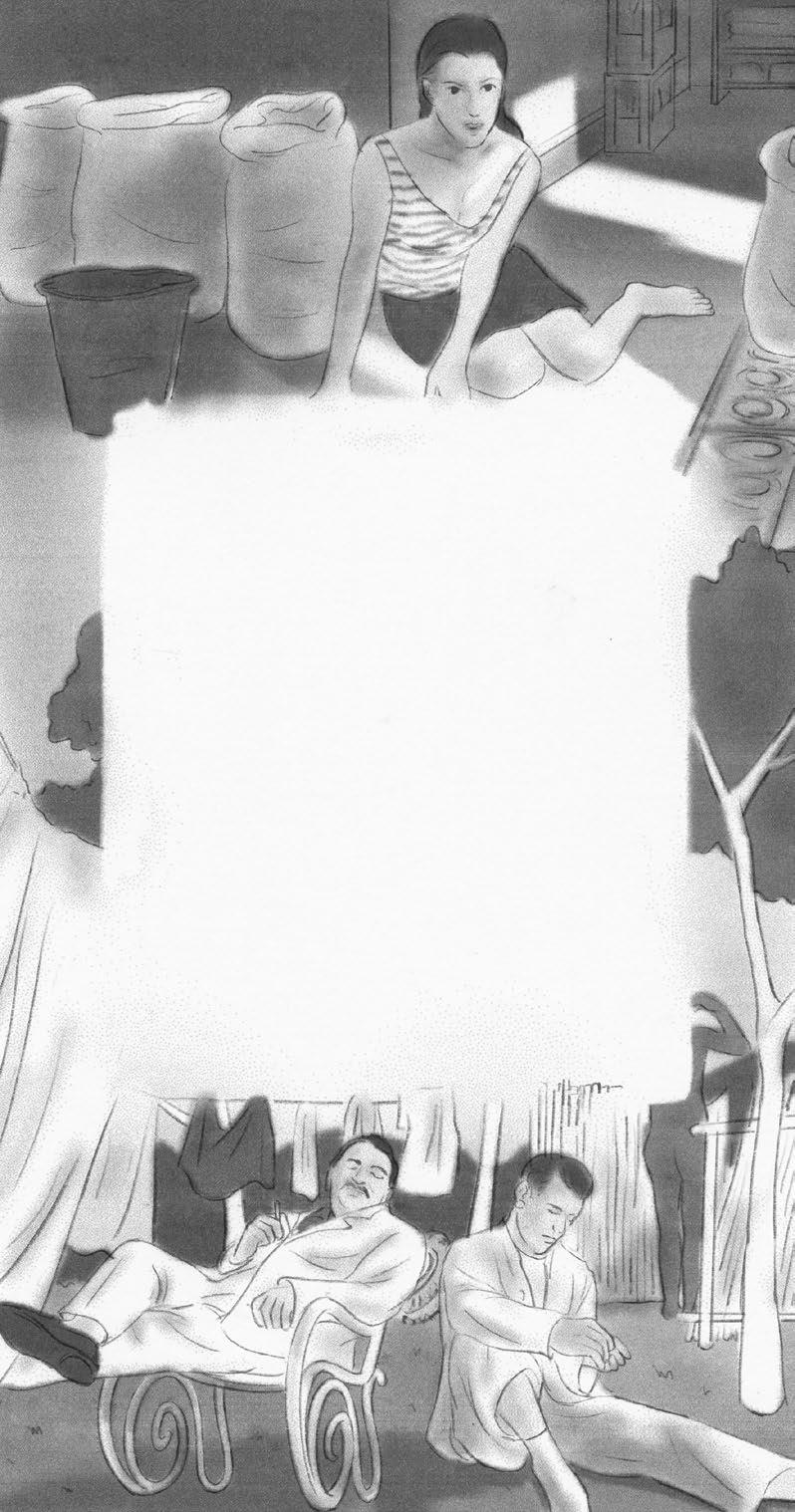
En bref 10 no 196 – avril 2023
Illustration : Sun Bai pour TROISCOULEURS
© Kate Mada
3
Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles de Chantal Akerman [lire p. 46, ndlr] est un incontournable. J’ai vu il y a un an pour la première fois Sois belle et tais-toi ! de Delphine Seyrig. Ça fait mal à regarder et à écouter. Le Bonheur d’Agnès Varda. Ce film à l’allure paisible, tout en couleurs pastel et en décor champêtre… Le drame est amené comme un non-événement ou presque, rien n’est grave. Et la femme disparue est vite oubliée, remplacée par une autre. C’est un film qui m’a toujours fait assez froid dans le dos.

J’adore tous ces films en Technicolor des années 1940-1950. Les Chaussons rouges de Michael Powell et Emeric Pressburger. C’est visuellement époustouflant. Le Secret magnifique de Douglas Sirk, avec Rock Hudson et Jane Wyman – tout les sépare, mais ils tombent amoureux. Un sacré ramassis de clichés en couleurs sur-saturées. Un vrai bonheur. La Mémoire des anges de Luc Bourdon. C’est un assemblage d’archives et d’extraits de films produits par l’Office national du film du Canada qui nous montre le Montréal des années 1950 et 1960. Il n’y a pas de commentaire, seules les images parlent. C’est comme un long et doux poème. La meilleure des berceuses.
Je pourrais être Cecilia dans La Rose pourpre du Caire de Woody Allen, car je suis comme elle, une incorrigible rêveuse. Leopoldine
Dieumegarde dans Au clair de la lune d’André Forcier, cette petite fille timide, qui n’a plus que son père, garagiste de son métier. Solitaire, elle passe ses soirées à crever des pneus de voiture. Enfin Ada, dans La Leçon de piano de Jane Campion, qui ne parle pas depuis l’âge de 6 ans. Moi qui ne parle pas beaucoup, j’aime bien ce personnage buté.
L’AFFAIRE QUI A BOULEVERSÉ LA CORÉE ARIZONA DISTRIBUTION présente KIM SI-EUN DOONA BAE AVEC HOE-RIN JUNG HYUN-OH KANG WOO-YOUNG BAHK SOO-HA JUNG HEE-SEOP SIM HEE-JIN CHOI PRÉSENTÉ PAR SOLAIRE PARTNERS LLC PRODUCTION EXÉCUTIVE PYUNG-HO CHOI, CHUL-WOO KIM, DONG-HA KIM UNE PRODUCTION TWINPLUS PARTNERS INC., CRANKUP FILM PRODUCTION DONG-HA KIM, JI-YEON KIM (P.G.K) SCÉNARIO ET RÉALISATION JULY JUNG IMAGE IL-YEON KIM (C.G.K) LUMIÈRE MIN-JAE KIM DÉCORS IM CHOI COSTUMES HAKYOUNG KIM MAQUILLAGE CHANG-RYEOL OH ÉCORS PLATEAU GIGYEONG SON MACHINERIE SANG-HOON LEE (FIRST MOTION) CASCADES GWANG-RAK CHOI, CHAI KIM EFFETS SPÉCIAUX JANG-PYO HONG EFFETS VISUELS SEONG-UK JEONG MONTAGE YOUNG-LIM LEE, JI-YOUN HAN MUSIQUE YOUNG-GYU JANG, TAE-HYUN CHOI SON PILSOO KIM, MINJOO CHUNG (LEAD SOUND) POST PRODUCTION TAE-SIK UM (U5K IMAGEWORKS) VENTES INTERNATIONALES FINECUT DISTRIBUTION ARIZONA DISTRIBUTION ©2023 TWINPLUS PARTNERS INC. & CRANKUP FILM ALL RIGHTS RESERVED. Arizona Distrib. un film de JULY JUNG AU CINÉMA LE 5 AVRIL
3 films à regarder à 3 heures du matin, une nuit d’insomnie ?
Décrivez-vous en 3 personnages de fiction.
PROPOS RECUEILLIS PAR QUENTIN GROSSET
films féministes importants pour vous ?
Suicide total de Julie Doucet (L’Association, 144 p., 65 €)
Scène culte
“Serial Mom”
de John Waters (1966)

Quand on a demandé à John Waters quelle était la séquence dont il était le plus fier, il nous a parlé d’un de ses films hollywoodiens tardifs, Serial Mom. Et de cette scène, pour lui la plus drôle de tout son cinéma, dans laquelle la mère de famille coquette et respectable, Beverly, se transforme en apôtre du vice et harcèle sa voisine au téléphone, avant de prendre goût au meurtre et de terroriser Baltimore.



La scène
Beverly Sutphin est dans sa chambre. Son sourire bon enfant se teinte de vice tandis qu’elle compose un numéro de téléphone. En split screen apparaît sa voisine Dottie Hinkle, qui n’a pas l’air sereine lorsqu’elle entend la sonnerie. Elle décroche.
Dottie Hinkle : Allô ?
Beverly Sutphin : JE SUIS BIEN CHEZ LA SUCEUSE DE BITES ?
D. H. : Nom de Dieu ! ARRÊTEZ D’APPELER ICI !
B. S. : JE NE SUIS PAS AU 42 15 CHATTE ?

D. H. : Espèce de salope !
B. S. : LAISSEZ-MOI VÉRIFIER LE NUMÉRO – JE NE SUIS PAS AU 212 VA TE FAIRE FOUTRE ?
[…]
D. H. : La police est en train de tracer ce numéro en ce moment même.
B. S. : COMMENT ÇA SE FAIT QU’ILS NE SOIENT PAS LÀ ALORS, FACE DE RAT ?
D. H. : VA TE FAIRE FOUTRE !
Dottie raccroche brutalement. […] Beverlys’esclaffeet recompose immédiatement le numéro. Dottie décroche le combiné.
D. H. : T’AS PAS ENTENDU ? VA TE FAIRE FOUTRE !
B. S. : Je vous demande pardon ?
D. H. : Qui est-ce ?
B. S. : Madame Wilson, de votre compagnie téléphonique. J’ai cru comprendre que vous étiez harcelée par une personne qui vous abreuvait de propos obscènes.
D. H. : Oui… C’est vrai… Je suis désolée, madame Wilson. Ça me rend folle. J’ai déjà changé deux fois de numéro. […] Aidez-moi, s’il vous plaît ! […]
B. S. : Qu’est-ce que cette personne dérangée vous dit exactement ?
D. H. : Je ne peux pas le dire à voix haute. Je n’utilise pas de mots grossiers.
B. S. : Je sais que c’est difficile, mais nous avons besoin des mots exacts.
D. H. : D’accord… je vais essayer… «Suceuse de bites.» C’est comme ça qu’elle m’appelle.
B. S. : ÉCOUTE-TOI, AVEC TA SALE GUEULE, PUTAIN DE PUTE !
D. H. : PUTAIN DE MERDE !
© D. R. © D. R. © D. R.
John Wate rs présente
L’analyse de scène
Plus sobre, moins surexcité que dans ses premiers films, mais du coup bien plus insidieux et dérangeant, John Waters filme Kathleen Turner comme s’il saisissait une mue en loup-garou. Quand elle compose le numéro de sa voisine dans sa chambre pastel tellement normcore qu’elle en devient inquiétante, une ombre discrète projetée sur elle semble un mauvais présage. Turner convulse presque de plaisir, grimaçant d’un sourire maléfique et d’un jeu de sourcils alarmant. Celle qui a déjà l’air d’une victime, Dottie Hinkle, apparaît à gauche de l’écran, dans un split screen cruel de contrastes. Elle est jouée par l’extravagante Mink Stole, habituée du cinéma de Waters, dont le cinéaste retient, comprime le jeu, pour qu’elle ait l’air d’un pauvre oiseau perdu, blessé. Dottie décroche. Là, Turner se contorsionne, et du plus profond de ses entrailles surgit la voix caverneuse du mal : au téléphone, elle lui débite les pires insanités avec le même flow que le diable dans L’Exorciste. « JE SUIS BIEN CHEZ LA SUCEUSE DE BITES ? » dit-elle, les dents blanches, et le brushing toujours impeccable.





Serial Mom de John Waters (1994)
BURNING DAYS
UN FILM DE EMİ N ALPER


13 avril 2023 – no 196
LE 26 AVRIL AU CINÉMA
Emin Alper fait fonctionner avec brio l effroi politique et les menaces qui pèsent sur la démocratie turque. POSITIF
QUENTIN GROSSET
En bref
LES NOUVELLES
1
Avec son magnétisant premier moyen métrage S’il-vous-plaît arrêtez tous de disparaître (vu au festival de Brive 2022 puis au festival de Clermont-Ferrand en janvier), l’artiste entame une recherche vertigineuse autour du deuil. Comme un cri, un appel qui laisse intranquille.
« J’ai la mort en héritage », nous dit-elle cash. La première fois qu’on l’a croisée, elle portait pourtant la version lesbienne du tee-shirt d’Act Up « Danser = Vivre ». Née en 1993, Laura Thomassaint s’est construite sur un manque de récits sur sa famille. « Ma mère est andalouse, mes grands-parents, analphabètes, travaillaient dans les champs. Avec leur éducation catholique et paysanne, le rapport à la parole est compliqué. » De là, l’artiste tient son don de repérer quiconque a des fantômes. De là encore vient S’ilvous-plaît arrêtez tous de disparaître, dont le titre invocatoire appelle les défunts autant qu’elle-même,


Maïté
qui aime parfois s’éclipser sans prévenir. Elle y raconte le lien trouble entre Ferdinand, qui a perdu son petit frère, et Elliott, un ado rencontré sur un tchat qui lui propose d’incarner le disparu. « Ado, dans ma cité du Val-d’Oise, dès que tout le monde dormait, je tchattais. Mon transfuge de classe est d’abord lié à l’ordinateur. » Elle commence par des mises en scène au théâtre, milieu qu’elle trouve trop bourgeois. Aujourd’hui physio du club LGBTQ parisien L’Œil, elle organise l’une de ses soirées ravageuses, baptisée Vengeance lesbien·ne, comme un cri de ralliement. Son prochain long, Faire ça la nuit sur le parking de l’usine, a ce désir de transformer les terrains de jeu intimes et politiques, imaginant une histoire de deuil et de cruising lesbien dans une usine autogérée par des femmes. « Quand j’avais 15 ans, je faisais des tours de bagnole en banlieue. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait le parking des pédés et pas le parking des gouines. Je n’ai jamais entendu parler de Monique qui va se faire sucer avant de rentrer du boulot et de faire à manger. Je sens que ça m’anime. »
QUENTIN GROSSET
2
En deux excellents moyens métrages (Massacre, Des jeunes filles enterrent leur vie) dans lesquels dialoguent les genres, la réalisatrice néo-aquitaine de 29 ans raconte les détours de l’enfance comme de l’adolescence. Rencontre avec cette impétueuse écoféministe.
La malice à chaque coin de phrase, Maïté Sonnet, aussi réservée que pétulante, colore son élégant sarcasme de rires tintinnabulants. Avec leur allure de conte, les deux premiers moyens métrages de cette scénariste de formation voyagent dans les genres pour relever l’étrangeté des relations et des rites qui jalonnent la vie. « Tout le monde est perdu face à la question de l’amour et de l’engagement ; j’ai eu besoin de concentrer ce chaos dans le film », nous dit-elle à propos de son mélancolique et facétieux Des jeunes filles enterrent leur vie, sélectionné à la Quinzaine des cinéastes en 2022. Rongée par une rupture, une jeune femme participe au week-end prénuptial de sa sœur dans une station thermale
En bref 14 no 196 – avril 2023
Photographie : Julien Liénard pour TROISCOULEURS
Sonne t
JOAQUIN PHOENIX DANS LE NOUVEAU FILM DE ARI ASTER



isolée. « On a filmé les bains de manière très morbide, comme un tombeau, tout en accompagnant la mélancolie de l’héroïne au montage son pour qu’elle contamine tout. » Une révérence à son premier film, Massacre (2019), dans lequel deux jeunes sœurs contraintes de quitter l’île de leur enfance élaborent un « virus » pour éliminer les touristes. S’y déploie le motif de la sorcellerie comme grande libération. « J’avais envie de filmer les petites comme les druidesses bretonnes avec leur grande robe blanche, ces sorcières de la mort qui gardaient l’île quand les marins partaient en mer. J’aime mélanger magie et éléments très contemporains. » Après Filles du feu, une minisérie sur la chasse aux sorcières, qu’elle a coécrite pour France 2 et dont le tournage s’est achevé en début d’année, cette prêtresse du spleen s’apprête à rassembler sa « meute » – une équipe technique essentiellement féminine – pour son premier long, Tu feras tomber les rois, dans lequel deux adolescentes endeuillées se lient d’une ensorcelante amitié.


En bref 15 avril 2023 – no 196
©CARACTÈRES CREDITS NON CONTRACTUELS
26
AVRIL
LAURA PERTUY
Photographie : Julien Liénard pour TROISCOULEURS
L’interview
parAdele et Alexandre d Elise V
Tout doux liste par
Kiddie Flamingos [film]
Pour son expo « Beverly Hills John », en 2015, John Waters a réalisé un remake de son classique trash Pink Flamingos, mais avec des enfants ! Affublés de perruques, les bambins en font une lecture kids-friendly, et il faut voir comme ils sont surex de réincarner les « personnes vivantes les plus répugnantes ». • Q. G.
Kiddie Flamingos de J ohn Waters (2015)
Adèle, 16 ans, et Alexandre, 14 ans, ont rencontré la directrice de casting Élise Vogel, qui a collaboré au Monde de demain, série phénomène qui raconte la naissance du mouvement hip-hop en France dans les années 1980 à travers les débuts de la danseuse et graffeuse Lady V, du DJ Dee Nasty et des rappeurs NTM.
Alexandre : Comment es-tu devenue directrice de casting ?
J’ai commencé par être technicienne sur les plateaux, comme assistante caméra, puis en renfort à la mise en scène. Finalement, je me suis dirigée vers le casting. J’ai commencé par m’occuper de trouver les figurants, puis les interprètes des petits rôles.
Adèle : Pourquoi as-tu choisi cette voie ?
Hairspay [film]
Sorti en 1988, c’est le seul film de John Waters qu’on peut conseiller à des enfants. Body positive et rock ’n’ roll, cette comédie musicale (plus tard adaptée sur scène et remakée avec John Travolta) dans laquelle une ado participe à un concours de danse est aussi une folle satire du racisme. • Q. G.
Hairspray de John Waters (1988)


Le poste de directrice de casting me permet de partager des propositions artistiques sur l’œuvre. Un réalisateur vient te chercher pour ton regard sur les comédiens, les personnages, la société. Les réalisateurs ont des désirs plus ou moins précis ; à toi de les traduire le plus fidèlement possible en proposant des comédiens pour interpréter les personnages de leur film.
Al. : Quelles sont les qualités requises ? Pour faire ce métier, il faut être sensible et curieuse de ce qui se passe artistiquement autour de soi, sur les planches, au cinéma, dans les écoles de théâtre, dans la rue.
Ad. : Comment ton travail s’articule concrètement avec celui du réalisateur ?
Au départ, on défriche les rôles, on parle précisément de chaque personnage. Et puis je fais passer des essais, que je
Alvin and The Chipmunks [musique]
« Ils ont tout fait ! Du punk, du Noël, du rap… », nous a dit John Waters. Le groupe fictif de tamias à la voix suraiguë existe depuis 1958 et a composé une quarantaine d’albums. John Waters goûte sûrement cette musique pour son côté ultra irritant pour les parents. • Q. G.
The Chipmunk Song de The Chipmunks (Liberty, 1958)
SÉANCES BOUT’CHOU ET JUNIOR [CINÉMA]
Des séances d’une durée adaptée, avec un volume sonore faible et sans pub, pour les enfants de 2 à 4 ans (Bout’Chou) et à partir de 5 ans (Junior).
samedis et dimanches matin dans les salles mk2, toute la programmation sur mk2.com
montre régulièrement au réalisateur. S’il est intéressé par un comédien, il le reçoit en call back – une séance de travail approfondie avec le réalisateur. Cela peut déboucher sur la validation du rôle ou sur un deuxième tour de call back . En fonction des réalisateurs, il peut y avoir beaucoup de tours !
Ad. : Tu travailles toujours avec des comédiens professionnels ?
Non, pour certains films, je fais des castings sauvages. C’est presque un travail journalistique. Pour trouver l’interprète du rôle, tu vas enquêter sur la nature du personnage, chercher là où tu pourrais le croiser, avec qui il traînerait. C’est intéressant de s’immerger dans des réseaux qui ne sont pas du tout les tiens et de rencontrer des gens que tu n’aurais jamais côtoyés. Faire du casting, ce n’est pas de tout repos, encore plus en sauvage. Tu y penses tout le temps. Au café, avec des amis, parfois je n’écoute rien de la conversation, je regarde autour de moi si je ne trouve pas ce que je cherche.
Ad. : C’était aussi le cas pour Le Monde de demain ?
C’était un casting hors norme, dense et formateur. On a vu beaucoup de gens en
La critique de Célestin, 9 ans
(Le film pour enfant préféré de John Waters )



sauvage, on voulait faire émerger de jeunes talents, des inconnus pour des rôles importants. Alors, on a cherché des personnes qui savaient rapper, danser, jouer. On avait peu de chance de trouver des gens qui allaient cocher toutes les cases. Par exemple, Melvin Boomer, qui interprète JoeyStarr, est un danseur, mais il dansait au sol, il breakait, alors que JoeyStarr danse debout. Anthony Bajon, qui interprète Kool Shen, était déjà comédien, et il a été coaché en danse.
Al. : JoeyStarr et Kool Shen ont-ils eu leur mot à dire sur le casting ?
Ils n’avaient pas de droit de veto, mais ils ont été consultés très régulièrement et ils ont rencontré les acteurs en amont du tournage.
Al. : Qu’est ce qui t’a donné envie de faire ce métier ?
Un air de famille de Cédric Klapisch, que j’ai vu au cinéma à 12-13 ans. Ce huis clos m’a beaucoup marquée. C’était au mk2 Gambetta. Il y avait un McDo à côté et, à l’époque, c’était un rituel kiffant d’enchaîner cinéma et McDo avec mes parents !

PROPOS RECUEILLIS PAR ADÈLE ET ALEXANDRE (AVEC CÉCILE ROSEVAIGUE)
Photographie : Ines Ferhat pour TROISCOULEURS


« Dorothée est une ado qui a gardé son cœur d’enfant. Elle vit dans un monde comme le nôtre, mais pas de notre temps, et une tornade l’emmène dans un monde merveilleux. Il y a un lion qui parle, un épouvantail qui est toujours content et un homme de fer tout rouillé. Ensemble, ils doivent combattre une sorcière. Elle est verte, ce qui la rend plus méchante. On a un automatisme à se dire que les sorcières sont vertes à nez pointu, alors que je pense que les vraies sorcières sont plus normales, pour qu’on ne les repère pas. Les décors ne sont pas très réalistes : des fois, on a l’impression qu’ils ne sont
pas en relief ; les ruisseaux, on voit que c’est une piscine ; et la route jaune ne s’intègre pas trop bien. Mais je m’en moque de tout ça, parce que, déjà, on est dans un monde magique, et puis quand je suis plongé dans le film, eh bien… je suis plongé dans le film ! Moi, si j’allais dans le pays d’Oz, je me la jouerais plus cool : je me baladerais, le reste m’intéresse moins. Ils n’ont qu’à affronter leur sorcière méchante euxmêmes ! »
Le Magicien d’Oz de Victor Fleming (1939)
PROPOS RECUEILLIS PAR JULIEN DUPUY

16
© D.R.
En bref > La page des enfants
ogel









































Le réalisateur des légendaires Pink Flamingos, Female Trouble, Cry-Baby ou Hairspray publie son premier roman, le dément Sale menteuse (Gaïa). L’histoire rocambolesque d’une mytho sadique, Marsha Sprinkle, pourchassée par une horde de désaxés. Fans inconditionnels de son cinéma glam, outrageant et queer, on a sauté sur l’occasion pour soumettre le dandy trash à une implacable interview vérité, à laquelle il a répondu avec son tout aussi implacable sens du style. En attendant sa venue à Paris, fin avril, pour une rencontre exceptionnelle en public avec l’écrivaine Hélène Frappat, à mk2 Institut.

Sale menteuse n’est pas votre premier livre, mais c’est votre premier roman. Comment en êtes-vous venu à choisir cette forme ?
Eh bien, j’aime me lancer des défis. Vous savez, à 66 ans, j’ai traversé toute l’Amérique en auto-stop pour écrire un livre intitulé Carsick. À 70 ans, j’ai repris du LSD pour voir ce que ça donnait, avec mon amie Mink Stole [l’une des actrices de sa troupe, les Dreamlanders, ndlr], ce que j’ai raconté dans mon bouquin Monsieur Je-Sais-Tout [paru en 2021 chez Actes Sud, ndlr]. Je me suis dit : allez, osons, essayons d’écrire un roman. J’ai imaginé un million de fictions pour mes films. Dans la première partie de Carsick, il y avait déjà une partie fictionnelle, car j’imaginais les pires et les meilleurs périples que j’allais pouvoir réaliser. Mais je n’avais jamais commencé de roman. J’avais cette idée qui me venait de loin pour un film éventuel, celle d’une femme qui vole des valises dans les aéroports. Je l’ai reprise pour en faire quelque chose de complètement différent dans Sale menteuse.
Qu’est-ce qui vous intéresse dans la mythomanie de l’héroïne de votre livre, Marsha Sprinkle ?
J’ai toujours été fasciné par les gens que je ne peux pas comprendre. Et Marsha est vraiment folle, elle est très méchante, je veux dire, c’est une psychopathe. Mais j’aime être en sa compagnie, et je pense que mes lecteurs aussi. Bien sûr, ils ne souhaiteraient pas traîner avec elle dans la vraie vie, mais, dans un livre que vous lisez au moment de vous endormir, c’est la compagne idéale.
En couverture <----- Cinéma
PROPOS RECUEILLIS PAR QUENTIN GROSSET
19 avril 2023 – no 196
Illustration : Michael Dunbabin pour TROISCOULEURS
1
Marsha Sprinkle est aussi une klepto compulsive, qui vole les bagages des passagers à l’aéroport de Baltimore. Est-ce l’un de vos fantasmes ?
Oh non. Mais, à un moment de ma vie, je me rendais au Festival de Cannes avec Pat Moran, l’une de mes plus chères amies [l’une des Dreamlanders, ndlr]. Et elle a accidentellement pris la mauvaise valise. On montait l’escalator quand son propriétaire s’est mis à littéralement hurler, ce qui l’a mortifiée. Moimême, j’ai plusieurs fois failli me tromper de valise. Je ne sais pas ce qu’il en est en France, mais, aux États-Unis, autrefois, lorsque vous récupériez vos bagages, des employés en surveillaient les étiquettes pour vérifier que c’était bien les vôtres. Ce n’est plus le cas dans les aéroports américains. Donc il est assez facile, aujourd ’hui, d’imiter Marsha. Depuis que j’ai écrit ce livre, l’un des fonctionnaires de l’administration Biden [Sam Brinton, secrétaire adjoint au ministère de l’Énergie, ndlr] a été accusé d’avoir volé des bagages dans plusieurs aéroports. Je me demande toujours s’il a pris modèle sur Sale menteuse.
Je vous sais très fan de Jean Genet. Sale menteuse est-il votre réponse à son Journal du voleur ?
Je ne pense pas. Mon vrai hommage à Jean Genet, ça a été de baptiser Glenn Milstead « Divine » [le nom d’un personnage du roman Notre-Dame-des-Fleurs, ndlr] pour tous les films qu’on a faits ensemble [des sommets
underground comme Multiple Maniacs, Pink Flamingos, Female Trouble, mais aussi des films plus populaires comme Hairspray, ndlr]. Chaque fois que je me rends à Paris, je m’arrête un moment à l’hôtel où Genet a fini sa vie [le Jack’s Hôtel, dans le XIIIe arrondissement, ndlr]. C’est l’un de mes auteurs de livres dirty préférés, ils sont aussi très érotiques.

La biographie que lui a consacrée Edmund White est un livre brillant [Jean Genet, paru en 1993, ndlr]. Pour moi, la sainte Trinité, c’est Jean Genet, Pier Paolo Pasolini et Andy Warhol. Ils ont répondu à mes prières.
Voyez-vous Sale menteuse comme un manuel pour apprendre à voler ?
Ce qui est sûr, c’est que tout ce que commet Marsha dans le livre, vous pouvez vousmême le faire. Je veux dire, avec mes standup [This Filthy World qu’il fait évoluer depuis 2006, A John Waters Christmas. It’s a Yuletide Massacre pour les fêtes de fin d’année, ou False Negative depuis 2021, ndlr], je prends l’avion presque tous les jours. C’était donc facile pour moi d’observer, d’effectuer des recherches pour ce livre. Il y a longtemps, j’avais une amie qui avait pris l’habitude de voler le portefeuille d’hôtesses de l’air – elles le gardent toujours dans le même petit coin à l’entrée de l’appareil… Depuis que le livre est sorti, j’ai été arrêté pour des fouilles aléatoires par la sécurité bien plus souvent qu’auparavant. Je ne sais pas si c’est lié. C’est peut-être juste ma paranoïa.

Qu’a-t-on à apprendre de quelqu’un comme Marsha Sprinkle ?
Avons-nous besoin de tout apprendre ? Je n’aime pas prêcher, mais je pense que, dans tout mon travail, dans tous mes films, dans tous les livres que j’ai écrits, la leçon à rete-
que j’ai adoré – il y a une expression pour désigner ça aux États-Unis, « the green room perjury » [« Le parjure de la salle verte », ndlr]. Ce n’est pas un mensonge très grave. Après, quand j’étais jeune, j’ai volé des trucs. Voler, c’est mentir, pas vrai ?
nir c’est qu’il ne faut pas juger les gens tant qu’on ne connaît pas leur histoire. Et Marsha a un sacré background ! Elle a raison d’être en colère. Oui, c’est une raison ridicule [on ne veut pas vous spoiler, mais ça a à voir avec des anus, ndlr]. Ce que nous pouvons apprendre d’elle, c’est qu’il faut toujours surveiller ses arrières. Parfois, les gens les plus abîmés peuvent être les plus intéressants. Il faut essayer de les comprendre, tout en se réjouissant de ne pas être eux.
Quel est votre plus grand mensonge ?
Moi-même, je ne mens pas beaucoup. Mais je suppose que c’est quand je vais dans la loge d’un artiste que je connais, après son spectacle que j’ai détesté, et que je lui dis
Le prénom de votre héroïne m’évoque l’insurgée Marsha P. Johnson, une activiste trans qui a participé aux émeutes de Stonewall. Qu’y a-t-il de révolutionnaire dans le parcours de Marsha Sprinkle ?
Il l’est parce que je vous demande de soutenir une méchante. Dans tous mes films, le héros ou l’héroïne serait hyper antipathique dans la vie réelle, et serait probablement le méchant ou la méchante dans les autres films. Marsha est une personne vraiment terrible, mais vous l’encouragez dans ce sens. Et je pense qu’au fond vous aimez la façon dont elle agit.
Quelle est votre routine d’écriture ?
J’écris tous les matins, du lundi au vendredi. Je me lève à 6 heures, je lis mes journaux,
no 196 – avril 2023 Cinéma > En couverture 20
« Une fois qu’il y a eu “Avatar”, un pénis qui parle, c’est rien ! »
AMOUR LIBERTÉ JOIE ROMANESQUE SORORITÉ


AU CINÉMA LE 5 AVRIL APSARA FILMS PRÉSENTE
2

je consulte mes mails, et j’écris de 8 heures à 11 h 30 environ. Vous savez, il faut écrire tous les jours. J’aimerais trouver les moyens de faire autrement, mais je n’y arrive pas. J’ai mis à peu près trois ans à écrire chacun de mes livres, de l’idée aux dernières corrections, jusqu’à pouvoir les éditer. D’autres gens doivent prendre le bus pour se rendre à leur job. Moi, j’ai la chance de pouvoir entrer dans mon atelier d’écriture en portant n’importe quelle fripe.
Ça a été facile de trouver votre style ?
J’ai écrit tellement de films, de livres. Et j’ai un spectacle de spoken word, que je réécris
Il ne nous a jamais rappelés. Tout le monde va croire qu’on l’a buté. En même temps, je trouve mon livre assez politiquement correct – d’une manière tordue, certes.
Ah oui, dans quel sens ?
Parce que les gentils gagnent à la fin ! Enfin, non, non, c’est la méchante qui gagne. Mais Marsha apprend à dire la vérité, elle trouve l’amour, une sorte de félicité, comme dans un film hollywoodien ridicule.
Pour le livre de photographies Place Space, Todd Oldham vous a fait poser devant votre bibliothèque, qui a l’air de regorger de rare-
ensemble, elle ne l’était pas encore. Elle était géniale dans mes films, mais elle était encore meilleure en tant qu’autrice. Les gens la redécouvrent aujourd’hui. J’aimerais qu’elle soit en vie pour le voir, ses livres sont réédités, sa carrière est en train de se réinventer longtemps après sa mort [en 1989, ndlr]. Mon meilleur souvenir de Cookie, c’est qu’elle avait l’habitude de sniffer du café instantané parce qu’elle n’avait pas le temps de faire du vrai café.
Une partie de Sale menteuse se passe à l’aéroport de Baltimore. Dans votre précédent livre, Monsieur Je-sais-tout, vous écriviez que le principal objectif que l’on devrait avoir dans la vie est de voyager en première classe. Mais vous jugiez aussi les passagers de première classe comme généralement très laids. Devons-nous choisir entre la richesse et la beauté ?
Ça dépend ! Si vous voulez vous envoyer en l’air, ce sera techniquement plus facile de le faire en première classe – c’est l’idée du mile high club [qui réunit les personnes qui ont des rapports sexuels dans les avions, ndlr]. Mais, vraiment, vraiment, les gens sont beaucoup plus cute en autocars.
dont les activistes ne se déplacent qu’en sautillant ou, parfois, en vibrant. Pour vous c’est un horizon politique désirable ?
Non, pas tellement, car j’ai fait la satire d’une secte. J’ai fait beaucoup de recherches. Il y a vraiment des tarés qui sont fans de trampoline, qui croient que faire des bonds est super bon pour la santé et tout. Bon, dans le livre, c’est un peu exagéré, mais quand même.
À un moment, le partner in crime de Marsha, Daryl, est aux prises avec un fétichiste des chatouilles qui ne veut pas le laisser partir. Vous avez vu le documentaire Tickled (2016) de David Farrier et Dylan Reeve, sur des compétitions de chatouilles qui cachent un empire criminel dans lequel tombent de jeunes hommes ?
deux fois par an. J’ai donc l’habitude. Non, ça n’a pas été si difficile de trouver ma voix. Je pense qu’il suffit de ne pas se décourager. Lorsque je termine le premier jet – c’est le plus compliqué –, je ne le relis pas de manière obsessionnelle. Je poursuis l’écriture. C’est en réécrivant, en coupant aussi, que l’on devient bon. J’ai trois générations de femmes qui travaillent pour moi. Elles sont un peu mes sensitivity editors [professionnels de l’édition chargés de repérer tout ce qui pourrait heurter certaines sensibilités dans les manuscrits, ndlr], un terme redouté en Amérique. Je ne sais pas si vous en avez dans l’édition française. On nous en a trouvé un officiel pour chapeauter Sale menteuse.
tés. Dans cette immense collection, quel est votre livre le plus dirty ?
Ça, je le donne aux Français ! Je pense que le Marquis de Sade l’emporte haut la main. Il a inventé le concept même de livre immonde. J’ai toujours voulu me rendre sur les ruines de son château en France. Il faut que je l’ajoute à ma liste d’endroits à visiter.
L’une des Dreamlanders, Cookie Mueller, était aussi une écrivaine de génie (Traversée en eau claire d’une piscine peinte en noir).
En plus d’avoir été votre amie, et actrice, est-elle une inspiration littéraire pour vous ?
Cookie, j’aurais aimé qu’elle devienne écrivaine plus tôt parce que, quand on traînait
Dans Monsieur Je-sais-tout, vous écriviez aussi qu’en avion vous pouviez parfois être impoli avec les passagers qui vous excèdent. Ce que je ne supporte plus, en avion, c’est quand les gens parlent fort dans leur portable, ça me tape sur les nerfs. Et la façon dont les gens s’habillent dans les avions en Amérique est vraiment choquante. Je veux dire, pourquoi un homme adulte de 50 ans porte-t-il un short ? Je ne veux pas que ses petites jambes galeuses frôlent les miennes ! Pourquoi tout le monde se met à poil dans les avions, maintenant ? Je suis content que vous soyez à l’aise avec votre corps, mais je n’ai pas à subir ça !

La fille de Marsha Sprinkle, Poppy, appartient au mouvement radical du trampoline,
Oh oui, j’adore ce film ! Je pense que je vais le programmer cette année au festival international du film de Provincetown [fief underground où John Waters passe ses étés depuis les années 1970, et au festival duquel il est invité résident, ndlr]. C’est formidable, vraiment étonnant. Je n’étais vraiment pas au courant de ce truc avant de l’avoir vu. Je ne comprends toujours pas, mais j’adore l’idée que tous ces hommes hétérosexuels aient été piégés pour se faire ça, se chatouiller les uns les autres, sans avoir compris que c’était érotique et que les gens allaient se branler devant leurs vidéos ! C’est tellement ahurissant qu’ils soient tombés dans le panneau, j’ai trouvé ça fascinant. Les gens fétichisent n’importe quel comportement auquel on ne pense même pas. Pourquoi les chatouilles seraient-elles érotiques ? Je capte pas. Je détestais les chatouilles quand j’étais enfant. C’est une sorte de nouveau SM, du SM light.

Il paraît que vous allez bientôt adapter Sale menteuse au cinéma ? Ce serait votre grand retour, car vous n’avez pas réalisé de film depuis A Dirty Shame (2005). Qu’est-ce qui vous a donné envie de ce come-back ?
Une production a mis une option sur le livre, et on m’a engagé pour écrire le scénario
no 196 – avril 2023 Cinéma > En couverture 22
3
« Cookie avait l’habitude de sniffer du café instantané, elle n’avait pas le temps de faire du vrai café. »
Un film de GIACOMO ABBRUZZESE


AU CINÉMA LE 3 MAI


FILMS GRAND HUIT présente
FRANZ ROGOWSKI MORR NDIAYE LAETITIA KY
“ENVOÛTANT” TROIS COULEURS
– c’est ce que je faisais ce matin avant l’interview. Moi, j’ai toujours voulu revenir. J’ai eu des contrats pour quatre films depuis A Dirty Shame : on m’a payé pour les écrire, mais ils n’ont jamais vu le jour. J’avais toujours un pied dans l’industrie du cinéma. J’avais l’idée d’un film d’aventures de Noël pour enfants, Fruitcake. Et aussi de trois suites à Hairspray : un film, une comédie musicale et un show télé.
Si vous adaptez Sale menteuse, je me demande bien comment vous ferez pour donner vie à Richard, ce personnage de pénis qui parle.
Je ne peux pas encore vous en dire plus, c’est vrai qu’on me pose beaucoup la question. Mais vous avez vu le nouvel Avatar ? Une fois qu’il y a eu Avatar, un pénis qui parle, c’est rien ! Le personnage de Richard est intéressant. Daryl, le complice de Marsha, est hétéro. Mais son pénis, qui porte le nom de Richard, devient gay ! Daryl est hétéro au-dessus de la ceinture et gay en-dessous. C’est une question géographique. Est-ce qu’un « non » signifie « non » quand la moitié de la personne dit « non » ?

Dans Sale menteuse, vous écrivez beaucoup sur la chirurgie esthétique pour animaux de compagnie, comme sur le potentiel révolutionnaire des chiens. Votre film Pink Flamingos (1972) faisait aussi honneur aux canidés avec la célèbre séquence où Divine mange une crotte qu’un bichon vient tout juste de faire. Quel est votre rapport aux chiens ?
Dans mon livre, les chiens sont condamnés à une vie de caresses humaines. Pour eux, c’est une véritable course pour s’échapper en meute et mordre tous les maîtres. Je n’ai pas de chien parce que je ne suis pas seul, mais je ne les déteste pas. En revanche, je refuse de les toucher.
Marsha Sprinkle est traumatisée par son ex-mari, devenu un activiste de l’anulingus, et qui organise la pride de l’anulingus à Provincetown, cette ville côtière à l’extré-
mité du cap Cod où vous passez toutes vos vacances depuis longtemps. Vous êtes déjà allé à ce festival ?
Il n’y a pas encore de festival de l’anulingus à Provincetown, mais il y a chaque été une journée de la famille gay, une journée des pilotes gays… Il y a plein de sous-catégories. Donc la rimming pride, c’est juste la prochaine étape.
Provincetown est-elle toujours cette ville sexuellement à l’avant-garde, comme elle l’était dans les années 1970 ?
Oui, c’est toujours très gay, mais il y aussi des hétéros. On a le Dick Dock ici, qui est un célèbre endroit de cruising. Mais, comme partout, ce n’est plus aussi radical qu’avant.
Dans les sixties et les seventies, les gens baisaient avec un partenaire différent tous les
Trois pépites recommandées par John Waters
The World’s Greatest Sinner
(1962)

DE TIMOTHY CAREY
Un assureur quitte son travail monotone pour se lancer dans une aventure plus réjouissante : gourou. Il prêche alors l’idée que l’homme peut vivre éternellement. Miracle : il est suivi par une horde d’adeptes… À travers ce choix, on reconnaît l’intérêt de John Waters pour les dérives sectaires – par exemple Babs Johnson dans Pink Flamingos (1972), autoproclamée être le plus répugnant de la terre, entourée de ses sujets. C’est aussi un film très rockabilly (une passion de jeunesse pour le cinéaste), avec les compos d’un jeune Frank Zappa.
soirs. Ça ne se reproduira probablement pas de votre vivant, quel que soit votre âge. Je suis content d’avoir connu ça.
Voyez-vous Sale menteuse comme une quête de vérité ?
Je serai plus humble que ça en disant que mon livre dit la vérité. Et la vérité est parfois bien plus intéressante que le mensonge.
Avez-vous trouvé votre vérité ? Je pense. J’aurai 77 ans le 22 avril. J’ai eu longtemps un bon psy, mais je ne l’ai pas vu depuis quarante ans. Il m’a dit récemment : « Pourquoi tu reviendrais me voir ? La dernière fois que tu es venu, tu avais 30 ans. Mais, maintenant que tu as plus de 70 ans, pourquoi on chercherait à te comprendre ? »
Boom!
(1968) DE JOSEPH LOSEY
Flora Goforth (Elizabeth Taylor), milliardaire isolée sur une île de Sardaigne, fait vivre l’enfer à ses domestiques, qui cèdent à toutes ses extravagances. Un visiteur (Richard Burton), à la réputation louche (ses dernières conquêtes richissimes sont mortes dans des conditions obscures), s’immisce peu à peu dans son quotidien… Un chef-d’œuvre camp où Liz Taylor brille : dans une improbable tenue kabuki, elle joue une drama queen au max de son drama grimaçant, se gargarisant d’elle-même tout en flippant à mort de vieillir.

Divine dans Pink Flamingos (1972)
© Criterion Collection
John Waters et ses acteurs sur le tournage de Multiple Maniacs (1970) © Lawrence Irvine / Courtesy of the Criterion Collection
1 2 Cookie Mueller, Divine et Susan Walsh dans Female Trouble (1974) © Criterion Collection

« Rencontre avec le cultissime John Waters. » Entretien de l’autoproclamé pape du trash avec la romancière et critique de cinéma Hélène Frappat, suivi d’une signature, le 27 avril au mk2 Bibliothèque à 20 h tarif : 15 € | étudiant, demandeur d’emploi : 9 € | − 26 ans : 5,90 € | carte UGC/mk2 illimité à présenter en caisse : 9 €
• Sale menteuse de John Waters (Gaïa, 256 p., 22,80 €), sortie prévue en mai


On a demandé au réalisateur de projeter son outrageante lumière sur des films qu’il jugeait trop méconnus.

Butt Boy (2021) DE TYLER CORNACK
Chip découvre que se mettre des objets dans le derrière lui procure un état d’exaltation immense. Il tombe dans une frénésie et s’insère des chiens, des bébés, des humains… Un détective mène l’enquête, avant de se retrouver lui-même dans le cul de Chip !… John Waters nous conseille cette série B qui nous faire sentir, par-delà l’écran, des odeurs nauséabondes. Un peu comme son film Polyester (1981), dont les spectateurs grattaient une carte correspondant à des parfums du film – putois, W.-C., beuh… • Q. G.
no 196 – avril 2023 Cinéma > En couverture 24
3
4 4 © D.R © D.R © D.R
Edith Massey et John Waters sur le tournage de Female Trouble (1974) © Bruce Moore / Courtesy of the Criterion Collection – John Waters
TS PRODUCTIONS
PRÉSENTEDU

ALICE ISAAZ ADAM BESSA
LE PRIX PASSAGE
UN FILM DE THIERRY BINISTI
CATHERINE SALÉE ILAN DEBRABANT ILIAS LE DORÉ NELSON DELAPALME RALPH AMOUSSOU FARID LARBI OUDAY EL KHOUMISTI SCÉNARIO SOPHIE GUEYDON ET PIERRE CHOSSON D’APRÈS UNE IDÉE ORIGINALE DE SOPHIE GUEYDON

AU CINÉMA LE 12 AVRIL
Comment devient-on les êtres les plus répugnants de la Terre ? Ce titre a été revendiqué par John Waters et sa folle créature, la drag-queen Divine. Rentré dans l’histoire du cinéma underground avec Pink Flamingos (1972), dans lequel Waters a filmé Divine manger une vraie crotte de chien, Female Trouble (1974) ou encore Hairspray (1988), le duo avait commis bien d’autres méfaits auparavant. Retour sur un roman d’amitié.


Divine n’a pas toujours été débauchée, et il faut bien trouver quelques excuses à John pour être devenu aussi cinglé. Les deux grandissent dans les années 1960 à Lutherville, une banlieue pavillonnaire au nord de Baltimore. Quand son père l’emmène en voiture à l’école, John aperçoit un jeune homme seul
Alors qu’eux l’imaginaient briller dans le sport, John, avec son physique malingre, se montre plus intéressé par tout ce qui a trait à la destruction. Il est fasciné par le feu, les ouragans, les miniatures de maisons hantées qu’il construit dans le garage. Un jour, il tanne sa mère pour qu’elle l’accompagne visiter un cimetière de voitures, et celle-ci s’inquiète de voir son rejeton s’exciter pour des carambolages et de la tôle broyée. Ado, fuyant la pression de devoir vite se marier (John sait déjà qu’il est gay), il prend soin de sortir avec des filles, les plus laides qu’il puisse trouver. Lui-même redouble d’effort pour paraître le plus repoussant possible, en teignant ses cheveux d’un orange des plus douteux. Il commence à s’intéresser au cinéma : au cours de religion du dimanche, il se passionne pour la liste des films interdits – Et Dieu… créa la femme de Roger Vadim ou Baby Doll d’Elia Kazan, par exemple –distribuée par une bonne sœur. On lui dit que, s’il regarde ces films un jour, il ira en enfer. « Génial », se dit-il. Pendant ce temps, Glenn pense devenir coiffeur. Un jour, une cliente médisante avec des bigoudis dit à ses patrons : « Il coiffe bien, mais… il est homo. » Pourtant, Glenn se donne du mal pour réunir tous les traits du futur gendre idéal bien hétéronormé : il a même une petite-
à l’arrêt du bus, qui semble introverti et complexé. Il s’appelle Glenn Milstead, et, même s’il ne paye pas trop de mine, c’est bien lui, la future Divine. Glenn passe tout son temps avec papa et maman, très fiers de lui parce qu’il adore aller au catéchisme. Mais seul le soir, après l’école, il fouille en cachette dans la penderie de sa mère pour se parer de ses plus belles robes, peut-être pour ressembler à Elizabeth Taylor, son idole absolue. Au lycée, une bande de brutes attend Glenn à la sortie pour le tabasser. Ils le traitent de gros lard, de tapette, ça vire au harcèlement. Au fond de lui, il sait déjà qu’il est la plus belle femme du monde. Il faut juste attendre que quelqu’un d’un peu tordu vienne l’aider à se révéler de la manière la plus éblouissante possible.
À quelques maisons de là, John espionne souvent ses parents, caché en haut des escaliers. Il entend sa mère dire : « Qu’est-ce qu’on peut faire de ce canard boiteux ? »
amie, la ravissante Diana Evans. Au bal du lycée, le couple s’attire toutes les jalousies. Sur une photo, on le voit vêtu d’un costume blanc piqué d’une rose rouge. Glenn est le plus élégant, le plus resplendissant de tous les garçons. Mais, sur la photo, son regard a quelque chose d’un peu éteint.
The Queen
Un jour, il rencontre un collègue coiffeur allumé, David Lochary. David devient son premier vrai ami, et Glenn en délaisse un peu Diana. David l’encourage à se travestir, et ils commencent à fréquenter la scène drag de Baltimore. Glenn s’y épanouit en portant les tenues les plus incandescentes, mais il se lasse assez vite du sérieux des autres dragqueens. Il se met à parodier les mines défaites de ses rivales, qui n’apprécient guère.
Cinéma > En couverture 26 no 196 – avril 2023 Divine dans Female Trouble (1974) © Criterion Collection
Une icône glamour, une icône grosse, une icône queer, une icône trash.
Un soir, l’une d’entre elles s’empare d’une bouteille et la jette sur Glenn. Une rixe de queens éclate, et les perruques se mettent à voler dans un nuage de paillettes. À peu près au même moment, au détour d’une conversation, John apprend que l’ado rondouillard n’est rien de moins qu’accusé de meurtre. Il aurait tué une jeune fille nommée Sally. Il est bien sûr innocenté, mais l’affaire ne sera jamais résolue… Il n’en fallait pas plus pour attirer l’attention de John. Les deux larrons se rencontrent un peu plus tard, lors d’une beuverie dans les bois. La petite bande de John y prend du LSD volé à l’hôpital. John sympathise avec Glenn, qui le surprend en imitant Dionne Warwick chantant « Once in a Lifetime ». Une amitié est née. Les deux copains se mettent à voler ensemble des perceuses, des tronçonneuses, de la marijuana…

John rêve de cinéma. Sa grand-mère lui offre une caméra 8 mm pour ses 17 ans : elle ne sait pas encore que son petit-fils va imprimer sur bobines la débauche la plus inimaginable. Il fonde les Dreamland Studios dans le pavillon familial, ses amis deviennent ses acteurs. Glenn est forcément de la partie, mais… il manque quelque chose. Un nom à sa mesure, colossal, babylonien. John pense soudain à « Divine », un nom tiré de Notre-Dame-desFleurs de Jean Genet. Ce baptême marque le début d’une carrière qui fera de Divine une icône glamour, une icône grosse, une icône queer, une icône trash. Et dire que, jusqu’ici, Glenn n’avait joué que le rôle d’un castor dans une pièce niaise pour l’école.
Mondo Trasho
Le vrai premier hit de John Waters et Divine, c’est le dément Mondo Trasho en 1969, un hommage à l’un des réalisateurs favoris de John, Russ Meyer. Le synopsis est compliqué : une jeune fille qui prend l’autobus se fait violer par un fétichiste des pieds avant de rencontrer une dame obèse ressemblant à Jayne Mansfield. Les deux finissent à l’asile psychiatrique, où sont organisés des combats dans la boue avec des cochons et des figures religieuses. Toutes les projections dans l’enceinte sacrée de l’Emmanuel Church – on ne sait pas comment John s’est débrouillé pour qu’elles aient lieu dans une église – font salle comble, et le film commence à voyager à travers les États-Unis : il est programmé dans des séances de minuit à New York, à L.A… Partout, il fait sensation. Divine est prête pour la célébrité. Avec l’aide de son maquilleur et ami Van Smith, elle met au point un look infernal : on lui rase le devant du crâne pour laisser plus de place au maquillage sur les yeux. Divine a l’air d’un monstre extrême et magnifique, le temps de son règne est venu. À San Francisco, elle rejoint la troupe des Cockettes, des drag-queens camées et psychédéliques tombées amoureuses d’elle en la voyant dans Multiple Maniacs (1970) – au scénario, Waters voulait lui faire porter le chapeau du meurtre de Sharon Tate. Lors de sa première apparition sur scène, elle défie la foule avec un air de dédain triomphant. Divine s’exclame sobrement : « Je suce les tueurs en série et je mange du sucre blanc. »
FRANÇOIS KRAUS ET DENIS PINEAU-VALENCIENNE
APRÈS
VINCENT MACAIGNE
AÏSSA MAÏGA
UN FILM DE ANDRÉA BESCOND ET ERIC METAYER
EVELYNE ISTRIA CHRISTIAN SINNIGER KRISTEN BILLON MARIE GILLAIN CAROLE FRANCK ERIC METAYER

LE 26 AVRIL AU CINÉMA
En couverture < Cinéma 27 avril 2023 – no 196
CRÉATION © 2022 LES FILMS KIOSQUE PHOTOS RENAUD KONOPNICKI
PRÉSENTENT
ADVITAMDISTRIBUTION #QUANDTUSERASGRAND QUENTIN GROSSET
TRANSE EN DANSE
FRANZ ROGOWSKI
L’acteur allemand nous a littéralement mis en transe en légionnaire possédé dans Disco Boy de Giacomo Abbruzzese, Ours d’argent à Berlin, qui sort en salles le 3 mai. À la Berlinale, il brillait aussi dans le sublime Passages d’Ira Sachs (en salles le 28 juin) dans le rôle d’un cinéaste naviguant entre un homme et une femme. Son air éthéré et sa silhouette gracile lui donnent la versatilité pour saisir tous les glissements de ses personnages.
Dans la première séquence de Passages, le beau film d’Ira Sachs sur lequel nous reviendrons largement dans un prochain numéro, Franz Rogowski, 37 ans, incarne un réalisateur qui n’arrive pas à obtenir ce qu’il veut d’un acteur. Ce dernier doit juste descendre des escaliers, ça n’a pas l’air bien compliqué. Le réalisateur s’énerve : ce qu’il cherche, c’est la transition, la bascule, quelque chose d’indéfinissable, de tremblant. D’un coup, ça paraît plus difficile. La scène met le doigt sur ce qui fait la beauté du jeu de Franz Rogowski, d’une sensualité troublante avec son visage rêveur, sa lèvre fendue par une cicatrice et sa diction fuyante. Une sorte de sixième sens pour capter et exprimer des sentiments fugaces, l’air de rien, parfois juste en se déplaçant. Pas étonnant alors que les cinéastes lui donnent souvent à jouer des personnages pris dans des moments charnières, des instants d’incertitude autour desquels il serpente. Dans le fascinant Disco Boy de Giacomo Abbruzzese, en salles le 3 mai, ça prend même des proportions mystiques. Il y joue un Biélorusse exilé en France, en deuil et sans repères. Son personnage s’engage dans la Légion étrangère – au bout de cinq ans, cela lui donnera automatiquement le droit d’obtenir un pas-

seport français. En attendant, il est ce mercenaire à l’identité errante qui se prépare docilement au combat. On a d’abord l’impression qu’il a remisé sa conscience, il n’est plus que muscles et entraînement – mais Abbruzzese filme son visage marmoréen tel qu’on ne sait pas si Rogowski ne laisse rien passer ou, au contraire, tout passer. Cette retenue, cette rigidité dans la posture se dissipera au cours du film dans des scènes de boîte de nuit. Rogowski, possédé par l’esprit d’un ennemi que son personnage de soldat a tué au Nigeria, y danse de sa silhouette fuselée avec une légèreté, un lâcher-prise, un vertige qui nous font entrer dans une autre dimension, aussi étrange qu’introspective. Il s’évanouit alors dans les mouvements, les lumières et les sons.
UNE FIGURE DANS L’ESPACE
Et cette force d’abstraction portée par l’acteur, Giacomo Abbruzzese comme Ira Sachs nous en ont tous les deux parlé. « Avec lui, je peux travailler comme un sculpteur », dit le premier ; quand le second le voit, le
filme « comme une figure se mouvant dans l’espace ». Franz Rogowski serait donc cet acteur-glaise auquel on pourrait donner toutes les formes, et qui même permettrait de toucher à l’informe. « C’est quelqu’un d’extrêmement précis, il a la capacité de se faire instrument », ajoute Giacomo Abbruzzese, « mais il est aussi capable d’inventer des gestes. Je pense à cette scène dans la boîte de nuit où il trinque à son ami mort. Il a eu cette idée de boire son verre de bordeaux en une seule gorgée. Ça raconte mille choses, et c’est juste un geste. » Ira Sachs précise : « Il a une liberté, une volonté de prendre des risques sur le plan émotionnel. Je pense qu’il est aussi très à l’aise avec son corps, le sexe, la sexualité. » À en croire Rogowski lui-même, cette aisance que lui prête Sachs ne va pourtant pas de soi. « Je ne suis pas du tout le genre de mec à faire des pompes », assure-t-il lorsqu’on lui parle au téléphone de la musculature charpentée qu’il a dû se bâtir pour interpréter un soldat dans Disco Boy. Sur sa prétendue confiance en lui, il en remet une couche, désarçonnant : « Quand je vais en boîte, je dois carrément prendre des tranquillisants pour chevaux. J’ai honte quand je danse en club. Pourtant, en tant qu’artiste, j’ai déjà dansé
Cinéma > Portrait
« Pour moi, le langage du corps a quelque chose de guérisseur, de vrai. »
1 28 no 196 – avril 2023
sur scène devant plus de mille personnes et je me sentais moins exposé. » Le mystère de la danse. Cette idée toute à la fois de maîtrise et d’abandon, de contrainte et de flottement. Lui qui est né à Fribourg-en-Brisgau et a grandi dans la petite ville universitaire de Tübingen, dans le Bade-Wurtemberg, Land du sud de l’Allemagne, a commencé par là. « J’ai étudié la danse contemporaine à Salzbourg, en Autriche, et à Berlin. Puis j’ai travaillé en tant que performeur, danseur et chorégraphe pendant sept ans. C’était le début de ma vie berlinoise. J’ai rencontré la plupart de mes amis au cours de ces premières années sur scène – aussi un peu en club. Après ces années de formation, j’ai ressenti le besoin de quelque chose de nouveau dans ma vie. Certains de mes amis qui étudiaient le cinéma m’ont donné des petits rôles dans des courts métrages. C’est comme ça que je suis devenu acteur. » Fils d’un pédiatre et d’une sage-femme, Franz croit beaucoup aux pouvoirs thérapeutiques de son art. « Je trouve qu’on est submergés de psychologie. Pour moi, le langage du corps a quelque chose de guérisseur, de vrai. » Ce refus de la psychologisation à outrance pour ses personnages, Rogowski se l’applique aussi à lui-même. Lorsqu’on lui pose des questions sur sa famille ou sur son passé, il est assez peu bavard : « J’ai grandi dans un environnement très protégé. Mes parents nous préparaient de bons petits plats et nous lisaient des livres. J’ai eu de la chance. » Au bla-bla donc, Rogowski privilégie la corporalité – ce qui donne lieu à des fulgurances. Par exemple dans Happy End (2017) de Michael Haneke, où il incarne le mouton noir d’une grande famille bourgeoise dont la fortune s’est faite sur le dos des travailleurs sans papiers à Calais : celui-ci vient tout juste de se faire casser la gueule qu’il va tout donner sur le dancefloor. Il faut voir cette scène dans laquelle il fait éclater toutes les fêlures et les frustrations de son personnage sur le morceau de Sia, « Chandelier ». Dans un déchaînement gracieux qui contraste avec la fixité gênée de la caméra, il apparaît comme une réminiscence contemporaine de Denis Lavant dans la scène de fin dansée de Beau travail (2000) de Claire Denis. Avec Lavant, il partage cette virtuosité dans le mouvement, le même attrait pour l’acrobatie et la pantomime.
ESPACES LIMINAIRES
Cette manière d’appréhender ses rôles d’abord par la physicalité, Franz Rogowski l’explore depuis l’un de ses premiers rôles marquants au cinéma, dans Love Steaks (2014) de Jakob Lass. Celui d’un masseur réservé, dans un hôtel de luxe. On le voit prodiguer des soins apaisants, apprendre, répéter des gestes, qu’une riche cliente veut interpréter bien malgré lui comme une invitation au sexe, dans une sorte de zone grise. « J’ai toujours été intéressé par les espaces non définis. Par ces personnages de fiction qui n’ont pas besoin de justifier où ils vont, d’où ils viennent. On les voit juste respirer, plutôt que de les regarder aller d’un point A à un point B pour atteindre un point C. Je ne sais jamais vraiment qui sont mes personnages. Je ne peux pas savoir


ce qu’ils pensent, je peux seulement avoir accès à ce que je ressens en étant dans leur peau. » Les cinéastes ont alors souvent projeté Rogowski dans des seuils, des purgatoires, manière parfois pour eux d’incarner, de travailler les traumas de l’histoire allemande. Dans Transit (2018 ), Christian Petzold l’imagine tenter de fuir Marseille, de nos jours, alors que des pans entiers – non définis – de la population sont traqués et déportés, comme les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. En plein flou temporel donc, il est ce héros qui doit se faire fantôme, et continuellement changer d’identité pour pouvoir vivre. Dans The Great Freedom (2022), l’un de ses rôles les plus forts, le réalisateur autrichien Sebastian Meise retranscrit la persécution des gays, criminalisés par la loi, dans la société allemande d’après-guerre. Rogowski y joue un homme déterminé à vivre ses amours et sa sexualité comme il l’entend, quelle que soit sa peine. En prison, où se déroule la majeure partie du film, son personnage a beau être malmené, brutalisé, il lance encore des œillades suggestives à tout va, il élabore des stratégies rocambolesques pour retrouver ses amants. Rogowski donne à son personnage d’insatiable et lumineux dragueur sa volupté émancipatrice, ce feu nécessaire pour finalement faire tomber les murs du bagne. L’élan sans cesse ondoyant de l’acteur lui permet surtout de toucher à une fluidité très contemporaine, une masculinité au spectre toujours changeant. « Je pense qu’on est encore loin d’un monde où la masculinité est quelque chose d’ouvert. Je ne me réfère pas seulement à moi et à ma bulle berlinoise de gens fluides et woke. Je vois bien qu’il y a beaucoup de gens qui grandissent dans un environnement hétérosexuel avec des injonctions à la force, à la puissance que je trouve plutôt toxiques, qui n’aident pas à vous sentir vous-mêmes ni à expérimenter d’autres choses. Personnellement, je découvre chaque jour de nouvelles parts de moi-même en tant qu’homme. Mais je ne pense pas à mes personnages comme à des personnages queer ou gays ou fluides, je me concentre surtout sur ce qu’ils ressentent, leurs relations. » Ce qu’il y a alors de très beau dans Passages, c’est qu’Ira Sachs choisit aussi de ne pas mettre de mots sur ce que vit le personnage joué par Rogowski qui, en couple avec un homme, tombe amoureux d’une fille. Au contraire, il regarde juste cet amour évoluer, prendre de nouvelles formes. « Ce que j’aime avec le cinéma, c’est qu’il peut capter l’entre-deux », nous dit Ira Sachs. Et ces moments où l’acteur arrive à nous plonger dans les interstices, les ballottages secrets du désir, ce sont les scènes de danse de nuit. Habillé d’un haut moulant en résille, il lui suffit de quelques balancements infinitésimaux du bassin pour faire chavirer le cœur d’une scène. La danse devient du sexe, puis juste après le sexe devient de la danse. Avec Franz Rogowski, on ne peut de toute façon plus faire la distinction.

Portrait < Cinéma
Disco Boy de Giacomo Abbruzzese, KMBO (1 h 31), sortie le 3 mai
QUENTIN GROSSET
4 2 3 4 29 avril 2023 – no 196
Disco Boy de Giacomo Abbruzzese 1 2 3 Passages d’Ira Sachs © Paname
DOONA BAE
En France, son visage nous a frappé : il est celui de la révolution dans Cloud Atlas (2013) des sœurs Wachowski et de Tom Tykwer. L’actrice sudcoréenne Doona Bae a bâti une sacrée carrière depuis ses rôles chez Bong Joon-ho dans les années 2000 jusqu’à About Kim Sohee, le nouveau drame sensible de July Jung (en salles le 5 avril), en passant par Hirokazu Kore-eda et la série Sense8. On a voulu savoir ce qui guidait l’actrice vers des choix aussi forts.
On avait d’abord repéré son air intrépide et son beau visage de chat dans The Host (2006) de Bong Joon-ho, où elle jouait une tireuse à l’arc luttant contre un monstre sévissant à Séoul, puis dans Air Doll (2010) de Hirokazu Kore-eda, où elle campait avec panache une poupée gonflable qui prenait vie. Alors qu’elle étudiait à l’université Hanyang, à la fin des années 1990, Doona Bae a commencé à jouer dans des séries télé coréennes et en parallèle sur le grand écran avec le remake coréen de Ring, et surtout le premier long de Bong Joon-ho, le déjanté Barking Dogs Never Bite, en 2000. Elle avait alors le visage poupon de ses 21 ans, mais déjà ses airs de rebelle attachante. Pas étonnant que les sœurs Wachowski l’aient choisie pour incarner, dans l’épopée Cloud Atlas (2013), l’emblématique Sonmi~451, un clone esclave dans une Corée futuriste, qui retranscrit sa vision métaphysique à la télévision pour guider la révolution. Elle a depuis retrouvé les
mondes alternatifs profondément humains des sœurs américaines avec un petit rôle dans Jupiter. Le Destin de l’univers en 2015, mais surtout en intégrant la joyeuse mêlée de « sensitifs » queer connectés à travers l’espace-temps de la série Sense8 (2015-2018).
Dans un registre plus sobre, elle était impressionnante de justesse dans A Girl at My Door (2014) de July Jung, dans lequel elle campait une inspectrice de police mutée dans un bled en Corée pour fuir un scandale aux relents homophobes. Dans l’édifiant

About Kim Sohee de la même réalisatrice, elle reprend son insigne et le flambeau de la narration à la moitié du film pour enquêter sans relâche sur la jeune femme qui en mène la première moitié, une étudiante exploitée dans un centre d’appels. Un nouveau rôle à sa mesure, qui démontre sa capacité à captiver dès qu’elle apparaît à l’écran et son inlassable engagement à travers des rôles qui font bouger les lignes. De bon matin
– décalage horaire oblige –, on a échangé à distance avec Doona Bae, charismatique et rayonnante même en petit, dans une fenêtre de l’application Zoom.
D’où vient votre engagement ? De votre famille ?
Ma famille n’était pas du tout engagée, c’est un choix personnel. J’essaie de faire un peu de tout, des films commerciaux [en France, on a notamment pu la voir au côté d’Alain Chabat dans #JeSuisLà d’Éric Lartigau, en 2020, ndlr], mais, tous les cinq ou dix ans, j’essaie de faire un film indépendant qui porte un message social. Quand July Jung m’a proposé A Girl at My Door, je voulais la soutenir et porter son très beau scénario. J’aime les films qui font rire, qui sont légers et gais, mais je pense aussi que ceux qui font réfléchir, qui permettent de voir la réalité et de saisir les problèmes sociaux sont importants.
30 no 196 – avril 2023 1 Cinéma > L’interview engagée
1
« J’ai une amie qui travaille dans un centre d’appels, elle est très stressée, c’est un peu pour elle que j’ai fait About Kim Sohee. »
2
About Kim Sohee (2023) de July Jung
Cloud Atlas (2013) de Lana & Lilly Wachowski et Tom Tykwer © Warner Bros.
Dans A Girl at My Door, vous interprétez une commissaire lesbienne alors que l’homosexualité est plutôt taboue en Corée du Sud. Est-ce qu’à ce moment-là, en 2014, vous preniez un risque par rapport à votre image ?
Je ne prenais aucun risque à l’époque parce qu’en Corée du Sud il y avait beaucoup de films qui en parlaient, les gens n’étaient pas complètement ignorants. Mais les personnages LGBT étaient exagérés, comiques, ça ne reflétait jamais la réalité. Quand je vivais en Europe, notamment en Angleterre, j’avais des amis LGBT loin des clichés. Je voulais montrer que ces personnes ne sont pas toujours caricaturales. J’ai aussi une amie qui travaille dans un centre d’appels, je la vois souvent très stressée à cause de son travail, c’est un peu pour elle que j’ai fait About Kim Sohee. Ce sont mes amis qui me confrontent à la réalité et me permettent d’évoluer.
Dans ce nouveau film de July Jung, vous jouez de nouveau une commissaire en rébellion contre sa hiérarchie, cette fois-ci contre la société tout entière. Qu’est-ce qui vous a plu dans ce rôle ?
Pour A Girl at My Door, c’était moi qui voulais absolument le rôle de Youngnam. Pour About Kim Sohee, il me semblait que d’autres actrices pouvaient très bien jouer l’enquêtrice, mais la réalisatrice tenait à ce que ça soit moi. July Jung a un univers construit, il y a des liens entre ses deux films. Dans About Kim Sohee, on en apprend beaucoup sur Sohee [une étudiante exploitée dans un centre d’appels, campée par Kim Si-eun, que l’on suit pendant la première moitié du film, ndlr] mais peu sur Yoo-jin [la commissaire enquêtant ensuite sur Sohee, jouée par Doona Bae, ndlr], son histoire est plus esquissée. Mais comme c’est le
même univers de July Jung, je me suis dit que Yoo-jin était en quelque sorte la prolongation du personnage de Youngnam, en un peu plus âgée. En y songeant de ce point de vue, je me suis dit que c’était mieux que ce soit moi qui joue ce prolongement. C’est pour ça que j’ai accepté le rôle.
En 2000, pour Barking Dogs Never Bite de Bong Joon-ho, qui était seulement votre deuxième rôle au cinéma, vous avez accepté de jouer sans maquillage, ce qui est rarissime pour une actrice coréenne. Pourquoi avez-vous fait ce choix à l’époque ?
C’est Bong Joon-ho qui m’a demandé de ne pas me maquiller. C’était son premier film, il avait l’air d’être très intelligent, donc je me suis dit « si je fais ce qu’il dit, le film sera bien ». Je l’ai suivi – j’aime me mettre au service des cinéastes. J’avais à peine une vingtaine d’années et j’avais une image fabriquée, j’apparaissais très maquillée. Les adolescents m’aimaient justement beaucoup à cause de cette image un peu cyber, robotique. Mais
Bong Joon-ho m’a dit : « Si tu veux faire le film, il faut te débarrasser de cette image pour ne garder que l’aspect cru, sans maquillage. » J’étais jeune, ma peau était un peu trop belle par rapport au rôle, j’ai dû appliquer des produits pour m’enlaidir légèrement.
Vous parlez de l’image un peu artificielle de vos débuts, et quelques années plus tard, en 2009, vous avez carrément joué une poupée gonflable qui prend vie, dans Air Doll de Hirokazu Kore-eda. Le film explorait un tabou lié au sexe d’une manière très poétique. C’était un choix audacieux, qui a marqué votre carrière.

J’ai beaucoup hésité avant d’accepter, et puis j’ai décidé de prendre le risque. À
l’époque, il n’y avait pas beaucoup d’acteurs et d’actrices sud-coréens qui tournaient au Japon… encore moins pour incarner une poupée gonflable ! Je me demandais ce que les spectateurs coréens allaient en penser. J’ai fini par accepter, car c’était Hirokazu Kore-eda, que j’aimais beaucoup, je voulais vraiment travailler avec lui. Je ne le regrette pas du tout aujourd’hui, parce que le film est très beau et qu’il m’a montrée sous un beau jour. Les difficultés que j’ai rencontrées étaient plutôt liées au jeu. C’est une poupée qui a un cœur mais pas d’âme, c’était compliqué de ne pas faire sentir l’âme alors que le personnage ressentait quelque chose. Et puis la façon de parler, de bouger, ne devait bien sûr pas être naturelles.
Quelle est votre relation avec les sœurs Wachowski, quelle place ont-elles dans votre vie aujourd’hui ?

Elles sont comme mes mamans de cinéma. J’ai commencé à tourner avec elles dans les années 2010, ça faisait déjà dix ans que j’avais commencé ma carrière en Corée du Sud. Ce sont elles qui m’ont amenée à Hollywood, qui m’ont pris sous leur aile et m’ont traitée comme un membre de leur famille. J’apprends beaucoup à leur côté, je me sens bien avec elles. L’an dernier, j’ai joué dans Rebel Moon de Zack Snyder [qui devrait sortir cette année sur Netflix, ndlr], à Hollywood. C’était la première fois que je tournais là-bas sans elles, j’ai beaucoup pensé à elles.
About Kim Sohee de July Jung, Arizona (2 h 15), sortie le 5 avril
PROPOS RECUEILLIS PAR TIMÉ ZOPPÉ
31 L’interview engagée < Cinéma
2 avril 2023 – no 196
GREGG ARAKI
En janvier dernier, Gregg Araki projetait au festival de Sundance la version restaurée de son culte The Doom Generation (1995) – ou la folle cavale de Jordan (James Duval), un fan de Nine Inch Nails, de sa copine Amy (Rose McGowan), fumeuse irascible, et de leur crush mystérieux, Xavier (Johnathon Schaech). On s’entretient avec le réalisateur sur cette période furieuse, celle du New Queer Cinema, et de sa Teen Apocalypse Trilogy (Totally Fucked Up, The Doom Generation et Nowhere). À 63 ans, il nous parle aussi de ce qui reste de l’esprit queercore.

En plus de la version director’s cut montrée à Sundance, il existe deux autres versions de The Doom Generation. Qu’est-ce qui change entre les trois ? Et laquelle avait-on vue en France en 1995 ?
Le director’s cut est la version originale, celle qui a été projetée à Sundance il y a vingt-huit ans. Le film avait légèrement été censuré en Amérique, à cause des distributeurs. Et il y a une autre version qu’on trouve parfois en ligne, que je désapprouve totalement, classée R [les mineurs devaient être accompagnés d’un adulte pour le voir, ndlr] et coupée par Blockbuster Video [une chaîne de locations de VHS, ndlr] Elle est complètement pourrie, ça n’a aucun sens car le film est amputé d’au moins vingt minutes. Je serais content que la restauration 4K la fasse disparaître. En France, il me semble que vous avez vu la même version que celle exploitée aux États-Unis – c’est fondamentalement la même que le montage qu’on vient de réaliser, à laquelle il manque non pas des séquences entières mais quelques moments, en particulier dans la dernière bobine, celle du climax. Ça a à voir avec l’intensité de cette scène [dans laquelle des néonazis coupent le pénis d’un des trois héros, Jordan, avec une cisaille, ndlr]. Elle s’inspire d’un fait divers qui s’est réellement passé quand j’étais au lycée, près de ma ville natale, Santa Barbara. Ça m’avait beaucoup marqué.
The Doom Generation est accompagné d’un sous-titre, « un film hétérosexuel de Gregg Araki », ce qui bien sûr est ironique vu le contenu très queer du film. C’était une sorte de sarcasme. Ça faisait un clin d’œil au premier film de la Teen Apocalypse Trilogy, Totally Fucked Up [sorti en 1993 aux États-Unis, ndlr], qui lui s’ouvrait par la mention « another homo movie by Gregg Araki ». Et il y avait aussi un producteur qui m’avait lancé un défi quand j’écrivais The Doom Generation. Il m’avait dit : « Tu fais des films gays qui offensent les gays, parce qu’ils les trouvent trop punk. Alors, si un jour tu fais un film hétéro, je te produis. » Et donc je l’ai pris au mot. Mais c’est le film hétéro le plus bizarre qui soit, comme un cheval de Troie qui cache bien son contenu queer et subversif.
Pendant le tournage, en 1994, un tremblement de terre a touché le quartier de Northridge à Los Angeles, où vous tourniez. Comment ça vous a impacté ?
C’était mon premier grand film en 35 mm tourné avec une équipe complète. Je n’avais pas l’habitude de travailler avec un directeur photo, un chef-déco. C’était différent et très excitant, je pouvais d’autant plus affirmer ma vision du monde. Mais ça a été chaotique et fou. Le deuxième jour, le tremblement de terre de Northridge a détruit tout notre dé-
cor, et les répliques nous noyaient constamment dans un grand nuage de poussière. Et, dès le premier jour, il y a eu un accident de laboratoire, on a perdu toutes les images qu’on avait tournées, on a dû tout refaire. C’était un tournage très difficile, on travaillait beaucoup la nuit, il faisait très froid.
Le petit-ami de Rose McGowan s’est fait assassiner juste avant le tournage. Vous pensez que cet événement tragique a eu un effet sur son rôle d’Amy Blue, sa colère, sa force ?
Rose a toujours eu une personnalité très forte… Quand j’y repense, le tournage de The Doom Generation a été une expérience très intense pour tout le monde. J’ai découvert quelques années plus tard, en fait très récemment, que Johnathon Schaech [qui joue Xavier, ndlr] avait été agressé sexuellement sur le plateau du film dans lequel il avait joué juste avant [en 2018, il a déclaré avoir été abusé sexuellement par le réalisateur Franco Zeffirelli lors du tournage de son film Sparrow, sorti en France en 1995, ndlr]. Il en a parlé dans la presse à la suite de #MeToo. James Duval traversait aussi une période difficile. Donc tout le monde était sur la brèche.
À votre avis, qu’est-ce que la génération d’ados d’aujourd’hui partage avec Amy,
32 no 196 – avril 2023
Jordan et Xavier, les protagonistes de The Doom Generation ?
À Sundance, pour la projection de la version restaurée, je m’attendais à ce que le public soit composé de fans de la première heure. Avant la projo, j’ai demandé au public combien de personnes avaient déjà vu le film. Finalement, 85 % de l’audience ne me connaissait pas, une bonne partie était très jeune, voire n’était même pas née au moment de sa sortie en 1995. Et ça les a vraiment touchés ! Je pense que, si le film résonne encore,
c’est parce qu’il parle de se sentir outsider, de faire son propre chemin dans un monde hostile. J’ai l’impression que The Doom Generation parle aux kids de manière très puissante.











Vos films étaient plus queer que gays, au sens où ils attaquaient la société américaine homophobe et sérophobe du début des années 1990, tout en critiquant l’uniformisation de la culture gay bourgeoise. Certains hommes gays étaient scandalisés. Quand The Living End [sur deux











amants gays et séropos qui tuent un punk homophobe puis partent en cavale, ndlr] est sorti [en 1992 aux États-Unis, ndlr], c’était très polarisant. J’ai entendu des histoires de bastons qui ont éclaté dans des bars gays après la projection de ce film qui énervait tellement. Vous savez, j’ai grandi avec les films de Jean-Luc Godard, donc j’ai toujours pensé le cinéma comme une provocation. C’est hyper excitant pour moi de soulever des réactions intenses ; le pire, c’est qu’on dise qu’un de mes films est juste OK, comme si sa vision

























création
Amos Gitai jusqu’au 13 avril spectacle en anglais, arabe, français, hébreu, yiddish surtitré en anglais et en français
création

Julien Gaillard jusqu’au 15 avril

Wajdi Mouawad 10 mai – 4 juin spectacle en français et en libanais surtitré en français

Anaïs Allais Benbouali 23 mai – 18 juin















Emma Dante 8 – 28 juin deux spectacles en napolitain surtitrés en français

33 avril 2023 – no 196
L’entretien face caméra < Cinéma
2 1
Rose McGowan dans The Doom Generation (1995)
© Haut et Court
Rose McGowan et Johnathon Schaech dans The Doom Generation (1995)
© Haut et Court
Nowhere (1997)

© Haut et Court
Craig Gilmore et Mike Dytri dans The Living End (1992)

© Strand Releasing
n’avait aucun impact. The Doom Generation a poussé tellement de gens à bout. Je veux dire, il a des fans loyaux, très dévoués ; mais aussi beaucoup de détracteurs, ce qui m’a toujours convenu. C’est comme avec la musique indé : beaucoup de groupes que j’écoute n’ont jamais été populaires. Mais ils signifient tellement pour moi. Et c’est durable : il y a un culte, une intensité dans la connexion avec ce genre de musique qui, je pense, la fait vivre pour toujours.
En France, vos deux premiers films, Three Bewildered People in the Night (1987) et The Long Weekend (O’ Despair) (1989), ne sont jamais sortis. Comment appréhendiez-vous le cinéma quand vous avez débuté ?
Ces films ont été très inspirés par Jim Jarmusch. Je me souviens avoir été époustouflé, stupéfait, par Stranger Than Paradise, que ça puisse exister au cinéma. Comme mes films d’après, ils étaient très reliés à ce qui se passait dans ma vie. Il y avait toujours un héros gay artiste avec sa meilleure amie, ce qui se retrouvera dans beaucoup de mes films, même ma série Now Apocalypse [sortie en 2019 sur le service Starzplay et disponible sur MyCanal, ndlr].
The Living End a été controversé parce que, en pleine crise du VIH-sida, il comportait
une scène de sexe non protégé entre Jon et Luke. Quelle était votre intention ?
The Living End était comme mon journal intime livré sans filtre, un mélange d’émotions et de pensées sur la crise du sida, ces sentiments d’impuissance, de confusion, cette colère. L’idée n’était vraiment pas de faire la pub du sexe non protégé. Pour moi, c’était plus une expression poétique du désespoir des personnages.
Dans Totally Fucked Up, l’un des ados de la bande porte le tee-shirt « read my lips » du collectif de graphistes Gran Fury, proche d’ACT UP New York. Comment la lutte contre le VIH-sida a marqué votre cinéma ?
Elle m’a beaucoup influencé. The Living End, Totally Fucked Up et The Doom Generation sont sortis pendant cette période où ce nuage noir du sida était accompagné d’un sentiment de fatalité. Ça a pesé très, très lourd pour ma génération. Mes personnages sont un reflet de cette époque, ils se sentent perdus, aliénés, sont traversés par une incertitude. Même Nowhere se termine sur cette note incertaine, car c’était une émotion très partagée à l’époque. La fragmentation de mes récits, leur nature militante, ça venait de cette envie de faire quelque chose de nouveau, de différent, en réponse à la crise du VIH-sida.
Totally Fucked Up représentait non pas une subculture, mais une « sub-subculture », le queer post-punk. Comment vous avez connecté avec ce monde ?
Totally Fucked Up parlait de se sentir aliéné par la culture hétéro comme par la culture gay mainstream. Par rapport à ça, le postpunk et le queer sont entrés dans ma vie presque simultanément. Ce sont deux contre-cultures qui partagent beaucoup : le sentiment d’être différent, de se construire contre le tout-venant, de faire partie d’un
monde d’outsiders… C’est un peu comme l’apparition du New Queer Cinema. Avec d’autres cinéastes [Todd Haynes, Tom Kalin, Cheryl Dunye, Marlon Riggs ou encore Monika Treut, ndlr], on nous a présentés comme une vague de nouveaux auteurs queer. Mais on n’a jamais fait une réunion pour imaginer une campagne stratégique dans le but de bouleverser les codes du cinéma traditionnel. C’est juste que tous ces cinéastes, qui travaillaient indépendamment, étaient affectés en même temps par la crise du VIH-sida et exprimaient leurs émotions ou leurs sentiments à ce propos.
Il y a quelques années, James Duval m’avait parlé en interview d’une fin alternative à Nowhere. Vous pouvez développer ?
Dans le script original, Dark va se coucher, et ça se termine par un monologue dans lequel il se dit seul et perdu. À l’origine, ce qui suit était prévu après le générique, comme le font aujourd’hui les films Marvel pour faire rester les spectateurs jusqu’au bout ! Donc le blondinet Montgomery vient se coucher tendrement auprès de Dark avant d’exploser parce qu’il a un alien en lui. Mais cette scène a été déplacée, parce que ça faisait une meilleure conclusion, un peu amère. Ce que Jimmy évoque, ce n’est pas vraiment une autre fin, c’est plus qu’au départ j’ai pensé Nowhere comme une série. Pour moi, c’était une réponse à Twin Peaks. Fire Walk With Me, le préquel de la série de David Lynch et Mark Frost, qui est sorti au cinéma. Je voyais Nowhere comme la genèse d’une prochaine série. Le personnage de Montgomery revenait sous forme de double maléfique, et portait le nom de Clift [comme l’acteur Montgomery Clift, ndlr].
Pensez-vous que les représentations queer deviennent trop lisses, plus assez mena -
çantes envers la société straight, le capitalisme, le patriarcat ?
Quand The Living End est sorti, ça a tellement scandalisé, c’était considéré comme explosif et provocateur, notamment à cause de cette scène de sexe gay bareback [sans préservatif, ndlr] sous la douche. Et puis, quand on l’a remasterisé, je crois que c’était en 2008, j’ai revu le film et je me suis dit : « Mais… c’est hyper doux et hyper tendre en fait. » C’est juste que, en 1992, le simple fait de voir deux mecs s’embrasser ou se tenir la main, beaucoup de gens trouvaient ça choquant… Je pense que mon intérêt pour la sexualité et la queerness n’a pas trop à voir avec l’idée de choquer. Je n’ai jamais voulu faire de porno par exemple – mais si vous voulez en voir, regardez-en, je ne suis pas contre, en plus c’est tellement répandu maintenant. J’ai toujours voulu comprendre ce qui se passe entre les personnages, leurs relations à un instant T. Quand je commençais à faire des films, j’étais inspiré par les films des années 1980 de Pedro Almodóvar, surtout Matador et La Loi du désir, qui étaient très colorés et très intenses dans leur représentation de la sexualité. Mais la façon dont Almodóvar abordait la sexualité était toujours reliée à des moments de vérité de ses personnages. C’est quelque chose qui m’a toujours passionné, quand on a l’impression d’aller au-delà de notre enveloppe corporelle, comme une révélation. Quelqu’un qui arrive à faire ça aujourd’hui, c’est Mike White. Je suis très fan des deux saisons de sa série The White Lotus [diffusée sur OCS dès 2021, ndlr]. Il ose explorer la sexualité de manière très franche, et montre comment elle peut devenir un espace de créativité.
La fluidité sexuelle que vous avez toujours défendue dans vos films est aujourd’hui beaucoup plus présente au cinéma comme
34 no 196 – avril 2023
Cinéma > L’entretien face caméra 3
« J’ai toujours pensé le cinéma comme une provocation. »
© Xxxx
4
1 2
3
4
dans la société. Comment voyez-vous cette évolution ?

J’ai lu un article l’autre jour qui parlait de ça. Je ne sais plus si ça concernait juste les États-Unis ou si c’était plus global, mais ça disait qu’environ 20 % des jeunes de la génération Z s’identifiaient comme LGBTQ+, et surtout en tant que personnes bi. Cette idée qu’il y a autant d’ouverture, c’est presque déroutant pour quelqu’un qui a vécu les années 1990. Et, en même temps, il y a toujours les suprémacistes blancs, les néonazis, Donald Trump, la culture hyper répressive dans laquelle nous vivons. Et puis il y a la technologie, le fait que les gens sont tellement déconnectés les uns des autres. J’ai lu encore un autre article super dérangeant : apparemment beaucoup de jeunes ne font pas l’amour et n’ont aucune relation. Je pense que je suis plus vieux, que j’appartiens à une génération différente, mais pour moi c’est tellement problématique. C’est le thème central de tous mes films : cette recherche de sexe, cette connexion. C’est très important pour moi. C’est la force motrice de l’être humain.
« L.A., c’est comme nulle part. Tout le monde est perdu ici », disait Dark au début de Nowhere. Vous le ressentez toujours comme ça ?
Je ne suis plus perdu comme je l’étais plus jeune. Mais je vois beaucoup de gens qui le sont. Le monde dans lequel nous vivons est bien plus chaotique, étrange et aliénant que dans les nineties. Pour moi, c’est la même folie en pire.
PROPOS RECUEILLIS PAR QUENTIN GROSSET
Illustration : Jules Magistry pour TROISCOULEURS
20 JANVIER 1942, VILLA DE WANNSEE
LES DEUX HEURES
QUI ONT FAIT BASCULER L’HISTOIRE
UN FILM DE MATTI GESCHONNECK
GLOBAL SCREEN présente une production CONSTANTIN en co-production avec ZDF en association avec ORF et CONSTANTIN FILM VERLEIH
“LA CONFÉRENCE” PHILIPP HOCHMAIR JOHANNES ALLMAYER MAXIMILIAN BRÜCKNER MATTHIAS BUNDSCHUH FABIAN BUSCH JAKOB DIEHL LILLI FICHTNER GODEHARD GIESE PETER JORDAN ARND KLAWITTER FREDERIC LINKEMANN THOMAS LOIBL SASCHA NATHAN MARKUS SCHLEINZER FREDERIK SCHMID SIMON SCHWARZ
RAFAEL STACHOWIAK directrice de casting SIMONE BÄR maquillage NICOLE FÖRSTER JEANNE GRÖLLMANN costumes ESTHER WALZ décors BERND LEPEL montage DIRK GRAU directeur de la photographie THEO BIERKENS directrice de production UTE SCHNELTING producteur executif STEFFEN GÜNTHER responsable de production TIM GREVE responsable de production ZDF STEFAN ADAMCZYK co-producteurs FRANK ZERVOS STEFANIE VON HEYDWOLFF
LE 19 AVRIL AU CINÉMA

35 avril 2023 – no 196
écrit par MAGNUS VATTRODT PAUL MOMMERTZ producteur délégué OLIVER BERBEN producteurs REINHOLD ELSCHOT FRIEDERICH OETKER réalisateur MATTI GESCHONNECK © 2021 CONSTANTIN TELEVISION ZDF. 2023 CONDOR DISTRIBUTION SAS. TOUS DROITS RÉSERVÉS
Création Kévin Rau TROÏKA
L’entretien face caméra < Cinéma
PRISES ÉLECTRIQUES
RAPHAËL QUENARD
Après l’avoir découvert dans des seconds rôles de doux dingues, on espérait voir enfin l’acteur dans un premier rôle. C’est chose faite avec Chien de la casse, le subtil et mélancolique buddy movie de Jean-Baptiste Durand, dans lequel il joue un showman un peu paumé mais d’une fidélité à toute épreuve. Portrait de l’acteur, dont le début de carrière laisse augurer d’autres grands moments de cinéma déglingué.

Il voulait venir à notre rencontre avec « une perruque de femme blonde » ou en « Père Noël », mais son entourage l’en a dissuadé. Dommage pour nous, il est beaucoup plus sobre, mais pas normie non plus, n’abusons pas : une couleur blonde peroxydée, gardée d’un tournage bordelais dont il revient à peine, et des petites mèches qui piquent dans tous les sens et apportent un éclat au-dessus de son visage anguleux. Voilà un petit moment que l’on voit Raphaël Quenard traîner son air un peu toc toc dans des courts métrages (le chouette Les Mauvais Garçons d’Élie Girard, 2020), des séries (Family Business) et des longs (Mandibules et Fumer fait tousser de Quentin Dupieux, sortis en 2020 et 2021 ; Coupez ! de Michel Hazanavicius, en 2022…) dans lesquels il reste sagement (mais pas trop non plus) au second plan. Ce qui, pour ce qui nous concerne, a allumé l’étincelle, c’est la série HP d’Angela Soupe et Sarah Santamaria-Mertens, diffusée sur OCS en 2018. Il y joue un interne débordant d’empathie, cinglant dans sa repartie, et glissant lui-même sur le sinueux terrain de la folie. Le rôle de Mirales dans Chien de la casse offre enfin un espace suffisant à son talent. Le film raconte l’amitié entre deux jeunes (Mirales donc, et Dog, incarné par Anthony Bajon),
perturbés par l’arrivée d’une fille, Elsa (Galatea Bellugi), dans le petit village du Pouget, dans l’Hérault, où ils traînent leurs galères été comme hiver. Mirales, c’est le genre à masquer ses failles et sa peur du vide ou du silence en faisant le show, en faisant dérailler les conversations, tout en fumant des splifs. Tous les cinéastes ou presque qui ont embauché Raphaël Quenard, à qui la voix traînante donne un petit air d’habitué du P.M.U., ont tiré cette ficelle comique, en cherchant aussi parfois la mélancolie plus sourde qui pouvait se loger dans cette profusion de gestes, de mots qui sautent à la gueule. Comme si, depuis le début, l’acteur ne jouait qu’un seul et même rôle : lui, en XXL.
CHIEN FOU
On en a fait l’expérience dès le début de l’entretien. Quand on lui a demandé sa date de naissance, il nous a rétorqué, l’œil malicieux et le sourire aux lèvres, comme pour nous narguer : « Entre les années 1990 et 2000. J’vais te donner que des informations approximatives comme ça, ça va être un portrait “à peu près”. » Le concept nous branchait bien, mais on l’a quand même poussé
à en dire plus. Beau joueur, il nous a raconté avoir grandi à Gières, près de Grenoble – il est le deuxième enfant d’une fratrie de trois ; son père est chercheur en matériaux d’isolation thermique et sa mère est employée à la MACIF. Au collège, déjà, il aimait le zbeul – il était bon élève, mais se faisait souvent exclure de cours. Il décroche le Bac S, puis ça part dans tous les sens. Il se convainc qu’il veut rejoindre l’École des pupilles de l’air, une prépa aux écoles militaires ; puis non, en fait, des études de chimie – au bout de cinq ans, il obtient un master. Ensuite, il se dit qu’il ferait bien de la politique. Il écrit aux 577 députés, se fait embaucher pendant six mois par l’une d’entre eux. La politique est un spectacle du réel qui le fascine complètement (« Écoutez Mme Laclais, j’vais vous dire une chose », dit-il en mimant la voix et le roulement d’épaule de Nicolas Sakorzy). Il est « magnétisé » par les vidéos de femmes et d’hommes politiques, mais s’occuper des affaires locales, très peu pour lui. Il quitte l’Isère et monte à Paris, voit des pièces de théâtre à la chaîne et finit par rencontrer JeanLaurent Cochet, grande figure du théâtre disparue en 2020, qui a notamment formé Isabelle Huppert, Fabrice Luchini ou Emmanuelle Béart. Il enchaîne les cours amateurs
36 no 196 – avril 2023
Cinéma > Portrait
« J’me sens pas “border”, mais amoureux de la transgression. De la transgression consciente. »
(« peut-être trente, quarante. À l’époque moi je distribuais les CV à toutes les projections, comme un raclo » ). Il fréquente quelque temps l’association 1 000 visages, fondée en 2006 par la cinéaste Houda Benyamina pour favoriser l’insertion dans le cinéma de jeunes venus de milieux populaires C’est dans ce cadre (et un petit peu hors de lui aussi) qu’il rencontre une série de cinéastes talentueux mais débutants : Élie Girard, Émilie Noblet, Emma Benestan, puis Jean-Baptiste Durand. Quand le magazine Sofilm fait son portrait dans son numéro d’été 2021, « bam, bam, bam », la machine est déjà lancée.
FEUX D’ARTIFICE
Parmi les acteurs qui l’ont influencé, il nous cite pêle-mêle Cate Blanchett, Gérard Depardieu, Benoît Poelvoorde, Benoît Magimel… Les dimanches, il adore aller dans des grosses salles de ciné, où ça se bagarre gentiment comme pour One Piece ou plus récemment Creed III – il aimerait bien que, dans les salles obscures, « ça s’jette des clémentines ». De toutes ses (pas si) discrètes apparitions au cinéma, on retiendra celle de Coupez !, qui raconte le tournage pourri d’un film de zombies. Dans plusieurs plans de la première séquence, il est relégué au fond, assis sur le côté – la caméra ne daigne même pas s’intéresser à lui. Le moment de gloire arrive avec une scène scato d’anthologie, ultra explosive (on n’en dira pas plus, pour ne pas gâcher le plaisir de la découverte). Quand on lui demande pourquoi à son avis il se fond si bien dans un cinéma du débordement, et pourquoi il joue autant de personnages qui ont un pète au casque, il nous répond : « J’sais pas. J’me sens pas “border”, parce que c’est péjoratif, mais amoureux de la transgression. De la transgression consciente. » Pendant l’interview, il n’arrive pas à rester en place : il nous checke, tape du poing sur la table, s’avance et recule par mouvements secs. Il sort aussi beaucoup d’hyperboles, et de surprenantes mais jolies punchlines. On le découvre ultra sensible quand il parle de ses grandes passions. Le foot (il en a fait pendant seize ans et voue un culte à Zlatan Ibrahimović) : « Ça m’agite les tripes. Si le Très-Haut m’offrait un retour en arrière de vingt ans, je consacrerais chaque seconde de ma vie à devenir footballeur. » Ou le rappeur marseillais Jul : « Il dégage tellement d’amour, de simplicité, de pureté, d’authenticité. Pas un jour n’est passé depuis 2013 sans que je ne l’écoute. Quatre fois j’ai eu le rideau [il a pleuré, ndlr] en écoutant son morceau “Perdu”. » Un titre dans lequel Jul rappe : « Et j’me fais des films / Je m’aperçois que le temps défile / Le bonheur n’est que de passage / Mais suffit d’un rien pour finir sur les cimes. » On trouve que ça colle bien à ce personnage de fou rêveur.
Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand, Bac Films (1 h 33), sortie le 19 avril
JOSÉPHINE LEROY
37 avril 2023 – no 196
TS PRODUCTIONS présente
Un film de Nicolas Philibert
“
” ★★★★
19 auAvril
D’un lieu de fragilités, Nicolas Philibert fait un royaume.
LE MONDE
cinéma
Portrait < Cinéma
Photographie : Julien Liénard pour TROISCOULEURS
CAMÉRA SENTIMENTALE
Tout d’abord pourquoi ce titre, L’Amitié ? Mon amicale caméra peut tenir dans une seule de mes mains. Elle est si discrète. Elle est toujours à mes côtés, dans un sac ou sur une table près de mon lit. J’adore aller passer le temps avec mes amis. Je sais qu’ils ont confiance en mon regard et que je peux les filmer sans les troubler. Avec ceux qui m’ont aidé à faire des films et qui sont devenus des amis [le parolier Boris Bergman, le producteur Maurice Bernart et le coursier Thierry Labelle, ndlr], l’abandon est encore plus grand. Ce sont des complices bienveillants, généreux et en même temps curieux de ce que ma cam é ra fait d’eux. J’en ai choisi trois pour célébrer l’amitié dans ce film.
les filmer qu’ils devinaient ce que je cherchais chez eux et me l’offraient parfois sans que je m’en aperçoive, au moment de la prise de vue. Ces cadeaux m’ont enchanté jusqu’à m’amener à me d é couvrir moimême et renforcer le jeu amical.
Dans un autre de vos films, Être vivant et le savoir (2019), vous dites : « Nous, cinéastes, sommes des primitifs… »
Louis Lumi è re, inventeur de la premi è re projection publique, est n é la m ê me année que mon grand-père. Je fais partie de la troisième génération de ciné astes et je suppose que le cinéma n’est encore qu’un gros b é b é. On le traite à é galité avec la litté rature, la musique, la peinture… Alors
satisfait et l’acteur non plus. Je lui imposais des gestes qui ne convenaient pas à sa nature. D’un côté comme de l’autre, il y avait une gêne suivie d’un échec.
Vous avez tout de m ê me tourn é avec Vincent Lindon dans Pater, en 2011… Mais il n’y avait ni scénario écrit ni équipe. Aucun témoin de notre travail. Nous avancions en tâtonnant. Et cela pendant un an, dans les temps libres de Vincent entre ses tournages. Nous faisions un effort formidable pour assurer une mission politique bas é e sur la r é duction de l’é cart entre ceux qui gagnent beaucoup d’argent et les autres. Vincent et moi étions nous-mêmes et par moments Premier ministre et président de la Ré publique. C’était une folie qui me laisse encore dans la stupeur, et aussi dans le ravissement. J’y secouais mes certitudes ; je les ai retrouvées enrichies par cette escapade.
Filmer la vie, selon vous, cela empêche-t-il de la goûter ?
ALAIN CAVALIER
Du haut de ses 91 ans, Alain Cavalier a tout filmé : des grands acteurs de sa génération à l’ouvrier du bas de la rue, en passant par les oiseaux qui peuplent son jardin ; de La Chamade (1968) aux 24 portraits d’Alain Cavalier (1987 et 1991) en passant par Le Paradis (2014). Dans L’Amitié, il renoue avec sa veine portraitiste et signe une ode au compagnonnage, élaborée au gré d’affectueuses rencontres avec trois amis proches. On l’a rencontré dans son atelier parisien en forme de boîte à trésors, où les feuilles qu’il a cueillies dans la cour côtoient ses petites caméras numériques.


Ce qui est bouleversant, c’est votre capacit é d’é tonnement face à ce que les adultes ne regardent plus d’habitude. D’où vous vient ce pouvoir ?
J’ai commencé par filmer surtout des visages et des corps d’acteurs. La séduction qu’ils exerç aient sur les spectateurs me passionnait, je faisais tout pour la mettre en valeur. Puis j’ai découvert que les fruits, les oiseaux, la couleur du ciel, tout ce que vous voulez, avaient autant d’importance que cette tyrannie du visage humain dont parle Charles Baudelaire [dans son poème « À une heure du matin », ndlr] et que ne peuvent éviter les films de fiction pilotés par les stars. À pas l é gers, j’ai quitté les plateaux de tournage, les équipes, les plans de travail et l’é criture de scé narios. Pour filmer seul, en toute liberté, la vie en direct. Sous toutes ses formes et pour un prix raisonnable.
Vous n’êtes pas si seul : Fran çoise Widhoff et Michel Seydoux figurent à vos génériques depuis trente ans. Tous les deux sont indispensables à la fabrication de mes films. Françoise m’accompagne dans la vie et dans la mise en forme de ce qu’enregistre ma caméra. Mon amitié avec Michel Seydoux fait qu’il me conseille dès le premier montage et introduit le film dans le paysage cinématographique jusqu’à la salle. J’ajoute que les personnes que je montre dans L’Amitié m’ont si bien regardé
que nous, nous n’avons rien : ni vocabulaire, ni grammaire, ni notes. Seulement une confusion, un désordre d’images et de sons qu’il faut faire semblant d’organiser. En fait, cette enfance est une aventure magique, difficile à raconter en m ê me temps que nous la vivons.
Cueillir la vie n’est-il pas plus difficile que de réaliser une fiction ?
Je suis n é avec une telle attirance pour tout évé nement vital que je me suis toujours méfié de mon imagination. Quand je reproduisais avec les acteurs une séquence de ma vie, je ne parvenais pas à retrouver l’éblouissement de l’original. Je n’étais pas
Je me suis pos é la question pendant des années ; en fait, c’est le contraire. Lorsque je vois se dérouler quelque chose d’étonnant dans le viseur de ma cam é ra, mon é motion est multipliée par le fait que je garde une trace de ce bonheur offert par la vie. Quand je filmais les actrices, il y a longtemps, j’en étais, comme tous les cinéastes, légèrement pincé. J’aimais beaucoup laisser les grosses caméras de l’époque enregistrer sur la pellicule les discrètes preuves de mon émoi. Romy, Léa, Catherine, Camille, Isabelle, une deuxième Catherine… C’était l’amitié aussi.
L’Amitié d’Alain Cavalier, Tamasa (2 h 04), sortie le 23 avril
38 no 196 – avril 2023
Cinéma > Entretien
« À pas légers, j’ai quitté les plateaux de tournage, pour filmer seul, en toute liberté, la vie en direct, sous toutes ses formes. »
PROPOS RECUEILLIS PAR DAVID EZAN
Alain Cavalier, 2022
© Philippe Lebruman / Festival La Rochelle Cinéma / Camera One
Critique
L’AMITIÉ
Bricolé avec les mains et le cœur, le nouvel opus d’Alain Cavalier est un voyage amical dans lequel s’entrecroisent les vies de trois de ses proches et collaborateurs d’un jour. De quoi réaffirmer son statut d’éternel « filmeur », mais aussi la beauté d’un art, celui du portrait, qu’il a conduit jusqu’à ses plus folles extrémités.
« J’ai crevé l’oreiller / J’ai dû rêver trop fort… » Les paroles du Vertige de l’amour d’Alain Bashung s’écrivent à même une feuille posée sur la table, caméra rivée à la main qui les couche. Un instant fugace, un « micro-événement » comme Alain Cavalier aime à les immortaliser depuis toujours ; et plus encore depuis qu’il a opté pour un cinéma artisanal, tourné sur le fil – ou plutôt le feu – du présent. Ce jour-là, il rend visite à son ami Boris Bergman (parolier célèbre pour sa collaboration avec Bashung) et sa femme, Mako. Une visite amicale qui se prolonge, dans le chaleureux bazar de l’appartement du couple. Ce sera bientôt au tour de Maurice Bernart (qui a produit Thérèse en 1986, le plus gros succès d’Alain Cavalier) et son épouse, l’écrivaine Florence Delay. Sans oublier le coursier Thierry Labelle, que le cinéaste a filmé dans Libera me il y a trente ans… À l’action situationnelle des Six Portraits XL (2018), Cavalier privilégie cette fois la pure gratuité affective, au gré des hasards et d’un ennui propices à l’inspiration. « C’est un beau silence. Tu le prolonges ? » demande-t-il malicieusement, caméra au poing, à un Bergman pensif. Le film se fait à deux, à trois, dans un jeu du chat et de la souris entre filmeur et filmés. Un jeu qui permet toutes les espiègleries, fort d’amitiés longues de plusieurs décennies. C’est bien la clé d’un tel degré d’intimisme, offert au spectateur comme une fenêtre sur trois existences tout à la fois si inconnues et si familières ; trois existences et autant de « royaumes » à visiter, tel que Maurice Bernart surnomme la petite chambre où il se retire pour rêvasser. La caméra cavalière d’Alain ne fait que ça : brosser un portrait comme on pénètre un royaume fait d’objets entassés et de signes à décrypter. Un travail de fourmi, taillé sur mesure pour la patience et la curiosité du cinéaste : un air de musique, un oranger au soleil ou un poisson fumant suffisent ainsi à susciter l’émerveillement. Surtout, ils forment la constellation presque sensuelle de ces portraits « faits maison » et dont la généreuse profusion constitue peut-être la plus belle preuve d’amitié.

39 avril 2023 – no 196
Entretien < Cinéma
DAVID EZAN
MOTS-CROISÉS
Ingrid Bergman

PHILIPPE KATERINE



Dans Voyages en Italie de Sophie Letourneur, Philippe Katerine interprète un Parisien émoussé qui part passer quelques jours de vacances en Sicile avec sa compagne. Sans ses enfants, mais avec des soucis logistiques de tous ordres, le couple va se livrer à un état des lieux de ses sentiments et de ses désirs. Relecture contemporaine du Voyage en Italie de Roberto Rossellini, cette séduisante comédie nous a donné envie de faire réagir le comédien chanteur à des citations ayant trait au tourisme et à l’amour.
« Dans le film, mon personnage n’est pas au mieux physiquement. Toutes les montées et ascensions qu’il effectue péniblement peuvent d’ailleurs rappeler Stromboli [film de Roberto Rossellini sorti en 1950, ndlr], justement avec Ingrid Bergman. Et, dans l’ascension, il y a une quête, et l’idée qu’on peut se sauver. Avec l’âge, est-ce que la vue est meilleure ? Il faut l’espérer, mais je ne ferais personnellement pas trop de généralités là-dessus. Espérons que, quand on vieillit, on ait des révélations. Nos personnages de Voyages en Italie suivent un vrai parcours existentiel, ils ne se laissent pas tranquilles, ils essaient chaque jour de s’améliorer, ils ratent puis ils réessaient. C’est la recherche qui est passionnante dans la vie, et pas tellement ce qu’on obtient. Car ce qu’on obtient la plupart du temps, au final, on le sait, c’est la mort. Mais le chemin de ce couple pour arriver jusqu’au dernier plan du film, et cette façon si spéciale qu’ils ont de se mettre en scène, c’est une belle recherche. »
« Le tourisme est l’industrie qui consiste à transporter des gens qui seraient mieux chez eux, dans des endroits qui seraient mieux sans eux. »
Jean Mistler dans Faubourg Antoine (1982)
« On est toujours un peu ridicule quand on est touriste. Après, on peut l’assumer, ou pas. Moi, je suis un très mauvais touriste, je n’y arrive pas du tout. Je préfère voyager dans ma tête et imaginer ce que ça pourrait être. Quand on fait du tourisme, on est une pièce rapportée, on n’est que de passage, et mieux vaut donc accepter cette part de grotesque. Le couple du film a un côté assez pathétique, avec ce Guide du routard
auquel ils obéissent scrupuleusement. Mais ils essaient en même temps de sublimer cette expérience en tentant de trouver de la magie dans l’extrême quotidien. Et c’est à force de précision, comme se demander où sont passées les clés, que cet hyperquotidien devient quelque part sublime Ça rappelle la pissotière de Marcel Duchamp : des choses qu’on ne voyait jamais dans un musée pouvaient tout d’un coup devenir de l’art et l’ordinaire se muer en extraordinaire De la même façon, si ça m’ennuie en théorie de sortir de chez moi, j’étais bien content avec Voyages en Italie de voyager dans un autre cinéma et d’arpenter une terre artistique nouvelle. »
« Le cinéma est aussi un microscope : quelle que soit la minceur apparente du sujet, un film cherche avec conviction à démêler un petit bout de la vérité. »
(1984)
« Il y a quelque chose de cette idée, mais ça dépend aussi de comment c’est fait. Moi, je ne pense pas que Sophie Letourneur soit dans une optique scientifique : c’est un cinéma débridé, elle a un côté punk et propose des trucs qui ne se font plus trop aujourd’hui. Par exemple, tous les gens qu’on voit en figuration en Sicile ne savaient pas qu’ils étaient filmés. J’ai adoré ça, parce que des accidents peuvent arriver à tout moment. On est dans un cinéma de liberté, qu’on avait pu connaître avec Jacques Rozier [réalisateur des Naufragés de l’île de la Tortue ou de Maine Océan, ndlr] et quelques autres qui tournaient avec une équipe très réduite et des moyens limités. C’est beau quand la vie rentre dans le cinéma, sans qu’on voie tout l’attirail plombant qu’il y a autour et sans qu’on ait besoin d’arrêter la circulation et la marche des gens. Chez Sophie Letourneur, on est certes dans l’observation, mais surtout dans la vie qui se poursuit. Aucune prise ne se ressemble, on est toujours dans l’imprévisible. Avec ce couple qui erre et ne sait pas trop où aller, elle s’éloigne donc du microscope, mais se rapproche d’une liberté qui avait un peu été abandonnée dernièrement au cinéma. Et c’est une voie qui, contrairement à ce qu’on peut penser, n’est pas sans issue. Il y a de quoi reprendre le flambeau ! »
« Cela rend modeste de voyager ; on voit quelle petite place on occupe dans le monde. »
Gustave Flaubert dans Correspondance (1850-1854)

« Le voyage rend obligatoirement modeste, oui, parce qu’on est confronté à nos limites. Déjà, on franchit une limite, qui est celle de la frontière. Car il y a dans la vie les frontières qu’on s’impose, mais aussi celles qui existent vraiment. Et se retrouver face à la barrière de la langue et au fait de ne pas connaître les us et coutumes d’un pays, ça occasionne souvent des situations d’échec. Ces situations peuvent être drôles à vivre si ça se passe bien, mais on reste généralement souffrant en pays lointain. Si on sort de chez soi en vainqueur, on risque en tout cas de grandes désillusions. C’est pour ça que je fais partie de ces personnes qui pensent au pire plutôt qu’au mieux ; je n’ai ainsi que de bonnes surprises après ! Dans le film, on voit les galères que rencontre ce couple, ne serait-ce que pour organiser son voyage depuis Paris, trouver des solutions pour la garde des enfants, se mettre d’accord sur la destination… Ils pensent à l’Espagne ou à la Lozère, avant de choisir l’Italie. Alors c’est certes un problème de riches, mais devoir choisir c’est déjà rentrer dans des interrogations dont on pourrait très bien se passer en restant chez soi. »
Samuel Johnson dans Histoire de Rasselas, prince d’Abyssinie (1759)
« Dans Voyages en Italie, ce sont des gens qui tiennent l’un à l’autre et qui veulent vivre pleinement cette expérience du couple. Les histoires d’amour sont en effet des petites batailles de chaque jour qui peuvent faire souffrir, mais c’est aussi ce défi qui est intéressant. Mais bon, « le célibat n’offre aucun plaisir », je ne dirais pas ça non plus. (Il prend une voix chantante et amusée.) Celui qui a dit ça n’avait pas l’air très en forme ce jour-là, hein ! Dans un couple, on est sans cesse face

40 no 196 – avril 2023
« Vieillir c’est comme escalader une montagne ; vous êtes un peu essoufflé, mais la vue est bien meilleure ! »
Roberto Rossellini dans Le Cinéma révélé
« Le mariage occasionne de multiples douleurs mais le célibat n’offre aucun plaisir. »
© D.R
Cinéma
à des questions auxquelles on doit répondre à deux. Et comme y répondre tout seul n’est déjà pas si facile, c’est encore autre chose à deux… Comme le raconte Sophie Letourneur, sauvegarder le désir conjugal est une sorte d’équation complexe. Un couple qui part en vacances, ça passe ou ça casse : certains se séparent immédiatement après leur premier voyage car ils ont été confrontés au quotidien et sont sortis de l’illusion. Dans le film, aucune de ces situations banales n’est épargnée au couple que je joue avec Sophie Letourneur. Leur amour vit un test fort mais touchant. »
Félicien Marceau
« Quand on se retrouve en Italie, comme le montrait déjà le film de Roberto Rossellini Voyage en Italie, on est confronté à l’histoire de l’humanité. C’est bien sûr le cas pour tous les pays, mais il y a en Italie beaucoup de traces du passé glorieux. On fait face à la grandeur et à la décadence de ce qu’on pourrait appeler l’Empire romain. Et on se trouve du coup face à notre propre grandeur éventuelle et à notre propre décadence éventuelle. L’Italie nous fait éprouver le passage du temps et regretter des choses. D’autant qu’on en vient : on a été envahis par les Romains et on reconnaît en quelque sorte davantage l’endroit. Voilà pourquoi le choix de la Sicile était judicieux dans le film. Sophie Letour neur est parfaitement consciente de ce que dégagent les décors de volcans siciliens, elle sait mettre en place les éléments et les ingrédients pour que l’émotion fonctionne. Elle fait ça avec une innocence apparente, mais au fond, comme chez tous les grands cinéastes, il y a chez elle comme une petite perversité envers les personnages. Et heureusement d’ailleurs ! »


Voyages en Italie de Sophie Letourneur, Météore Films (1 h 31), sortie le 29 mars

















PROPOS RECUEILLIS PAR DAMIEN LEBLANC



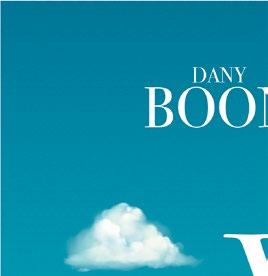
41 avril 2023 – no 196 Cinéma
© D. R. ; © D. R. ; © D. R. ; © Bridgeman ; © D. R. ; © D. R.
« Un homme qui n’aime pas l’Italie est toujours plus ou moins un barbare. »
SIMON RIETH
Grande claque de la Semaine de la critique au Festival de Cannes l’an dernier, Nos cérémonies est le premier long métrage du jeune cinéaste de 27 ans. Simon Rieth y raconte l’histoire de deux frères, Tony et Noé, qui se retrouvent à Royan (commune du sud-ouest de la France), où ils passaient plus jeunes tous leurs étés, jusqu’à ce qu’un accident bouleverse leur vie et les éloigne de ce lieu sacré. Entre réalisme et fantastique, rythme lent et couleurs ultra saturées, ce retour en terre d’enfance, ponctué d’étranges et fascinants rituels que partagent les deux frères, est filmé avec une intensité impressionnante par Simon Rieth, qui a puisé dans ses propres souvenirs estivaux et familiaux la matière de ce conte à la fois noir, violent et étonnamment vivant, lumineux. On a demandé au cinéaste de nous envoyer quelques images clés de préparation du film, mais aussi une photo personnelle, qui disent toute la singularité de son projet.
Les frères Baur
Photo de tournage (© Juliette Gamblin)
Simon Rieth et son petit frère

Photo de famille (© Simon Rieth)
(Photo de gauche) « On voit Simon et Raymond Baur, les deux acteurs principaux du film. Ils me font rire avec leur posture de boxeurs ! Ils ont passé toute leur vie à s’entraîner ensemble. Ce sont des champions d’arts martiaux de très haut niveau – ils ont été au championnat du monde de kung-fu. Je les avais vus pendant des répétitions, et je les avais trouvés magnifiques. Il y a quelque chose de très doux entre eux. La tendresse, la manière qu’ils ont de se regarder, de se toucher… Toute cette partie-là est vraie dans le film. Ce qui fait que je n’avais pas à tricher là-dessus. Avec eux, ça a été un très long travail, déjà pour les trouver, et ensuite pour les répétitions qui ont duré sept mois, parce que je voulais adapter le film à ce qu’ils sont. Il y a ce mélange entre eux de caresses et de coups – les gars se frappent quand même pendant tout le film ! J’ai remarqué que si au scénario j’avais tout fait pour les différencier, au montage je n’ai cessé de les rapprocher. En tout cas, j’ai essayé de faire en sorte qu’il n’y ait pas un bourreau et une victime, mais deux bourreaux et deux victimes. Et j’ai pu tourner des scènes de fou grâce à eux, des plans-séquences de coups sans coupe. »
(Photo de droite) « Je suis avec mon petit frère, Hugo, qui est à gauche, et qui a un an de moins que moi – je devais avoir 5 ou 6 ans. La photo a été prise sur la plage de Pontaillac, qui apparaît dans

le film. Avec Nos cérémonies, je voulais raconter une histoire d’amour fraternelle. Je suis parti de ce qu’il y a de plus personnel. Avec mon frère, on a une relation un peu particulière : je l’ai fait jouer dans presque tous mes courts [ Feu mes frères, 2016 ; Sans amour, 2019 ; Marave challenge, 2019, ndlr]. C’est la première fois qu’il ne joue pas pour moi. Depuis que je suis tout petit – à mon avis depuis cet âge-là –, j’ai toujours voulu être réalisateur. Il y a environ deux ans, j’ai retrouvé des vidéos où, enfant, je mettais en scène mon frère avec une caméra de famille. C’était fou. Je n’en ai même pas le souvenir. C’étaient toujours des films de shérifs, d’extraterrestres, de robots… Des trucs d’enfants, quoi. J’ai toujours mis en scène mon frère et, le jour où j’ai fait Nos cérémonies, il n’a pas joué le rôle principal. Peut-être que justement j’avais besoin de prendre cette distance-là. »
Les acteurs interprétant la bande de jeunes, sur la côte sauvage de Royan
Photo de tournage
(© Wenael Dard)
« On a coupé cette séquence, mais dans le film j’ai quand même voulu que la jeunesse apparaisse. On a vu plus de 1 500 jeunes, donc c’était un énorme casting. On a constitué cette bande, et j’ai pris chacun pour ce qu’il est. Il y a un aspect documentaire, et c’est ce qui me permet aussi de jouer sur les contrastes, j’aime beaucoup ça. C’est un film qui est habité par la mort, et ces jeunes y apportent de la vie, de l’amour, du désir, leur manière d’être qui est tellement vivante et puissante que, au final, c’est aussi ça qui reste beaucoup. Avec Nos cérémonies, il y avait un truc de réaction contre certains films sur les jeunes : je m’étais dit que, quand je ferais mon premier long métrage, je réaliserais un film de vrais jeunes. Pas une jeunesse idéalisée – ce n’est pas le teen movie merveilleux, avec des scènes de soirée où il y a tout le temps de la musique electro, des jeunes en train de fumer des joints au ralenti avec des néons roses… Je ne suis jamais allé à une soirée comme ça – peutêtre qu’on ne m’a jamais invité. C’est pour ça que j’ai fait ma propre scène de soirée, dans une maison qui est baignée dans une lumière un peu verdâtre, avec des jeunes les uns sur les autres et un truc un peu dérangeant, malaisant, des gars qui étalent leur virilité et les filles un peu plus sur le côté. J’en ai vécu plein, des soirées comme ça, à Montpellier [où le cinéaste a vécu, ndlr]. J’ai commencé à écrire le film quand j’avais 23 ans. Je sortais juste de l’adolescence, j’étais pion dans un lycée à Paris, où je suis arrivé après le bac. J’étais proche des jeunes et je me suis énormément nourri de ça. »
42 no 196 – avril 2023 Cinéma > Portfolio
1 1 2 2








































43 avril 2023 – no 196 13 au 22 avril © Roméo Ricard S T É O RÉ É PhilippeDecouflé Cie D C A Danse Musique Présenté avec Réservez sur MC93.COM En partenariat avec Portfolio < Cinéma © Bridgeman Images © Shawn McBride
Storyboard de la scène de pendaison (© Dethvixay Banthrongsakd)

« C’est exactement la maison de ma grand-mère, à Royan – on allait chez elle tous les étés, mon frère et moi, quand on était petits. Il y avait une fenêtre qui donnait sur un arbre. Cette séquence de la pendaison [une des « cérémonies » du film, rituels lors desquels les deux frères jouent avec la mort, ndlr], c’est la première image que j’ai eue en tête, avant l’écriture du scénario. J’imaginais un cadre extrêmement précis, avec une caméra qui rentre, ressort. J’avais l’idée d’un cadre dans le cadre. Et, surtout, j’avais l’idée de filmer une pendaison en plan-séquence. Ce qui me semblait ne pas exister au cinéma. Pour moi, c’est un plan qui est ultra important : c’est le pacte avec le spectateur. Dans le film, la violence est toujours là, mais je ne voulais pas que ce soit une violence qui ait des éclats. Je voulais qu’elle soit filmée dans une certaine banalité. »
Nos cérémonies de Simon Rieth, The Jokers / Les Bookmakers (1 h 44), sortie le 26 avril
44 no 196 – avril 2023 Cinéma > Portfolio
3
3
JOSÉPHINE LEROY

45 avril 2023 – no 196 APRÈS FIRST COW , LE NOUVEAU FILM DE KELLY REICHARDT
naît
Adaptation AU CINÉMA LE 3 MAI
MICHELLE WILLIAMS L’art
du chaos.
JEANNE DIELMAN


Sacré meilleur film de tous les temps par l’influente revue britannique Sight and Sound en 2022, Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles de Chantal Akerman ressort ce mois-ci, après une sortie chahutée en 1976. Cette œuvre de jeunesse implacable, confondante de maturité, continue à nous interroger sur la condition féminine et le refoulement de la liberté.

« Dans ce film, un suspens est introduit, parce qu’il y a une pomme de terre qui brûle. C’est peut-être la première fois que ça arrive dans l’histoire du cinéma. » Face aux journalistes condescendants du Masque et la Plume, qui peinent à saisir l’ampleur politique de son film Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles, Chantal Akerman ne se démonte pas. Infiltrée incognito dans le public de la célèbre émission radiophonique, elle saisit le micro pour défendre sa vision : son héroïne n’est pas une « schizophrène », mais une femme au foyer aliénée par l’ordre inébranlable du quotidien. La séquence est impressionnante – elle dit la capacité d’Akerman à faire trembler le boys club très fermé qu’était alors la critique française. Qu’est-ce qui a pu leur faire si peur, dans
l’œuvre de cette jeune cinéaste belge de 25 ans, à l’insolence tranquille ? Sans doute le fait que Jeanne Dielman exhibe, sur une durée éreintante (3 heures et 18 minutes), un impensé social, en mettant en scène les gestes sisyphéens d’une veuve (Delphine Seyrig) qui se prostitue pour payer ses factures, et dont la vie s’organise comme un ballet mécanique. Peut-être aussi la déflagration qu’il provoque au Festival de Cannes, où il est présenté à la Quinzaine des réalisateurs en 1975. Adoubé par Marguerite Duras, papesse de la littérature moderne (« À la sortie de la projection, Duras a dit, en parlant du personnage, “Cette femme est folle”, ce qui dans sa bouche constituait le plus grand des compliments », racontera Akerman), le film est conspué par les critiques conservateurs. Ils pressentent sans doute que Jeanne Dielman n’est pas seulement un geste esthétique fou, expérimental. Il inaugure aussi une nouvelle façon de faire du cinéma, plus inclusive – son équipe est presque entièrement féminine (Évelyne Paul, Corinne Jenart et Liliane de Kermadec à la production, Babette Mangolte à la photographie, Bénédicte Delesalle et Nicole Geoffroy au cadrage, Patricia Canino au montage). C’est un film fait par des femmes, qui parle des femmes – et interpelle des hommes tentés de détourner le regard.
LES FEMMES INVISIBLES
Pour créer le personnage de Jeanne, Chantal Akerman convoque des images de son enfance bruxelloise – plus particulièrement de sa mère et de ses tantes, silhouettes toujours de dos, penchées, sans visage, affairées à porter des paquets. La servitude de leur quotidien, imprégné des rituels juifs, a inspiré la trame du film, jusqu’à contaminer sa forme : l’écriture d’Akerman obéit à la discipline du Nouveau Roman, se concentre sur les effets plutôt que sur les affects. Dans le making of de Sami Frey consacré au tournage du film, on s’étonne de la désinvolture avec laquelle Akerman, alpaguée par Seyrig pour connaître les
motivations de son personnage, rejette tout storytelling psychologique : « Mais on s’en fout, Delphine. Tu coupes des patates, point. » Ce qui importe, c’est que chaque geste soit décrit chirurgicalement, que chaque action soit enregistrée dans une durée proche du temps réel pour faire émerger cette idée : la femme au foyer n’est qu’une mortifère construction sociale au service de l’ordre patriarcal. Si l’ordinaire robotique de Jeanne résonne comme celui de toutes les femmes, c’est aussi grâce à son interprète, Delphine Seyrig, et au contreemploi génial qu’en fait Chantal Akerman. Lorsqu’elle sollicite la réalisatrice pour obtenir le rôle, après avoir dévoré le scénario, l’actrice bénéficie d’une aura sophistiquée, façonnée par ses collaborations avec Alain Resnais, François Truffaut et Jacques Demy. Or Akerman la dépouille de cette aura séduisante à des fins politiques : « Chantal Akerman aurait pu choisir une actrice de la classe populaire belge, comme sa mère, qui correspondait aux codes du naturalisme. Mais elle se dit : si cette femme-là, avec ce corps, cet habitus social, est à la place de l’asservissement absolu, ça va être insupportable à tout le monde. Tout à coup cette place devient invivable, bien plus que si on y mettait une femme dont tout le dressage social a travaillé, conspiré à lui faire tenir cette place-là », nous confie JeanMarc Lalanne, qui publie un livre dédié à l’actrice, Delphine Seyrig. En constructions
46 no 196 – avril 2023 Cinéma > Histoires du cinéma
(Capricci). Choisir Delphine Seyrig, c’est rendre visible l’invisible, rendre insupportable aux yeux de tous ce qui paraissait parfaitement tolérable dans l’anonymat.
ENTENDRE LE SILENCE

Voir Jeanne Dielman est d’abord une expérience organique et sonore. La rareté et le laconisme des dialogues en font un film de sons plus que de langage – Delphine Seyrig y est d’ailleurs presque réduite au mutisme, privée de sa voix intimidante. Le bruit d’une porte qui claque comme un adieu discret au monde, des clés qui tournent dans les serrures sans ouvrir sur rien, la musique triste du robinet qui coule, l’orchestre produit par les cliquetis de la vaisselle… Jeanne Dielman est la gardienne de ce tombeau muet. Ce silence humain ne sera brisé qu’à la fin, par le cri d’un client que Jeanne tue d’un coup de ciseaux. Le motif du crime ? Il l’a fait jouir, et Jeanne doit faire taire la petite voix du plaisir qui vient d’ouvrir une brèche dans son univers désincarné : « C’est la défection, l’ébranlement de l’ordre symbolique qui la protège. Cette jouissance crée une peur panique, qu’elle ne peut pas supporter. Il n’est pas indifférent qu’elle le tue avec une paire de ciseaux, l’outil de montage avant le numérique. Ces ciseaux sont une manière de couper la scène, d’introduire un cut dans ce plan séquence qui a filmé en continu l’intolérable de la jouissance », explique Jean-Marc Lalanne. Il plane tout de même un doute sur ce geste. On pourrait y lire, plutôt qu’une abnégation, les effets d’une liberté désespérée. Jeanne « tue le phallus », pour reprendre une déclaration de Chantal Akerman à la sortie du film. Elle esquisse pour la première fois une action qui lui appartient. Ce n’est pas pour rien que la réalisatrice laisse son héroïne s’absenter dans des angles morts. Jeanne excède les limites du cadre, sans que l’œil fixe de la caméra ne la suive. Comme si Akerman lui permettait de conjurer son destin, de passer d’objet à sujet du regard. Jeanne Dielman est entré dans l’histoire. Non pas grâce à l’assentiment de Sight and Sound, ni parce qu’il est le premier film d’une femme cinéaste à glaner cette place, mais parce que les bruits de la prison domestique de Jeanne résonnent pour toujours dans nos oreilles.
Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles de Chantal Akerman Capricci Films (3 h 18)

• Delphine Seyrig. En constructions de Jean-Marc Lalanne (Capricci, 184 p., 17 €)
"UN CHOC, D’UNE PUISSANCE RARE"
Jérôme Garcin - L’Obs
ÉCRIT ET RÉALISÉ PAR STEFFI NIEDERZOLL
LE 29 MARS AU CINÉMA

47 avril 2023 – no 196 Histoires du cinéma < Cinéma
REYHANEH JABBARI, 19 ANS, SON COMBAT POUR LA VIE
Meilleur Film Prix de la Paix Prix Compass - Perspektive LÉA
ANDRÉ-SARREAU
LE GUIDE DES SORTIES CINÉMA PAR
Après son beau néo-western
First Cow, l’Américaine Kelly Reichardt retrouve son actrice fétiche Michelle Williams pour une quatrième collaboration des plus fructueuses. Aussi modeste que puissant, Showing Up détaille les affres de la création et les limites du care à travers le portrait d’une sculptrice farouche qui prépare sa prochaine expo.
SHOWING UP
Lizzy (Michelle Williams), artiste solitaire, vit en coloc avec son chat roux. Alors qu’elle doit finir en quelques jours les sculptures de sa nouvelle exposition, elle fait face à des microproblèmes qui pèsent pourtant lourd : sa voisine, propriétaire et collègue d’atelier, Jo (Hong Chau), traîne la patte pour réparer son chauffe-eau, ce qui l’oblige à prendre des douches froides ; quand son chat attaque un pigeon, Lizzy tente de se débarrasser du corps, qui lui revient le lendemain par le biais de Jo, avant que l’une et l’autre ne se partagent la garde de l’animal convalescent ; le frère de Lizzy (John Magaro) sombre lentement dans la paranoïa et le complotisme, sans que l’artiste ne parvienne à mobiliser leurs parents divorcés. Comme toujours chez

Kelly Reichardt, les émotions et les réflexions sont à trouver dans les détails, les gestes, la distance ou la proximité des êtres, le ton employé pour s’adresser à l’autre. La cinéaste prend soin de nous y rendre sensibles, d’ouvrir notre attention par un travail sur les atmosphères et les sons : lumières douces et caressantes, caméra posée et cadres délicatement composés, bruits ambiants rassurants (on entend souvent le ronronnement d’un avion qui passe au loin, typique des banlieues occidentales tranquilles). Ainsi mis en condition, nous pouvons porter toute notre attention sur les vibrations des êtres, et surtout sur la manière qu’a Lizzy de composer avec son dilemme : se concentrer égoïstement sur sa création, ou bien prendre sur le
peu de temps qu’il lui reste avant le vernissage pour s’occuper des autres ? Avec l’apparente simplicité des grands maîtres, Kelly Reichardt pose nonchalamment – et comme aucune autre – de profondes questions existentielles. Et a visiblement trouvé pour ellemême des réponses, puisqu’elle parvient à se créer les conditions nécessaires pour façonner des œuvres si abouties.
48 no 196 – avril 2023 Cinéma > Sorties du 29 mars au 3 mai
SORTIE LE 3 MAI
ZOPPÉ
Showing Up de Kelly Reichardt, Diaphana (1 h 48), sortie le 3 mai
TIMÉ
PAR


Buddy movie flirtant avec le conte, Grand Paris suit deux potes qui traînent leurs galères et leurs rêves dans des communes de banlieues. Espiègle, drôle et touchant, ce premier long conduit par Martin Jauvat, 26 ans seulement, dégage une grande fraîcheur.

Avec leur survêt rose ou bleu (à l’effigie du PSG ou de Manchester), sous la grisaille francilienne, on ne peut pas louper Renard (Martin Jauvat, également derrière la caméra) et Leslie (Mahamadou Sangaré, repéré dans Le monde est à toi de Romain Gavras en 2018). Alors qu’ils se croisent à un arrêt de bus, ce dernier propose au premier de l’aider à exécuter un deal à SaintRémy-lès-Chevreuse, soit à l’autre bout de l’Île-de-France. Le plan périclite. Les deux comparses décident de partir à l’aventure
GRAND PARIS
SORTIE LE 29 MARS
et trouvent dans une forêt un artefact (datant de l’Égypte antique ou, encore mieux, d’origine extraterrestre, s’imaginent-ils) qui, ils en sont persuadés, devrait leur rapporter gros… C’est le point de départ de ce road movie banlieusard parsemé de références aux films d’aventures et de science-fiction américains (la saga Indiana Jones en tête) qui va chercher le merveilleux au milieu des travaux tentaculaires du Grand Paris ( « le métro du futur, gros »). Dans ce tour de l’Île-de-France, ces deux potes aux personnalités divergentes (blond peroxydé, Renard a une tchatche hallucinante ; plus discret, Leslie est taciturne, mais ses regards veulent tout dire) vont se frotter à une série de personnages bédéesques : un grand dadais au look hawaïen qui malgré son air teubé se révèle être diplômé de Sciences Po ; un livreur du fast-food Chicken 3 000 (génial William Lebghil), amateur de joints, qui se balade fièrement à bord de sa caisse tunée ; un conducteur RATP weirdo et complotiste (tout aussi génial Sébastien Chassagne)… Ces étapes ouvrent en fait la porte à un voyage plus intérieur : au fil d’un périple de plus en plus fantastique, bardé
de punchlines qui font mouche ( « pas de violence, c’est les vacances »), on comprend que c’est moins la thune qui obsède les deux amis que leur désir d’évasion, leur envie d’échapper à un quotidien morne, à un avenir bouché. Un besoin de réappropriation du récit politique aussi, face à un chantier urbanistique qui exclut les premiers concernés. Face aussi à une règle tacite qui veut qu’entre mecs, de banlieue de surcroît, on ne parle jamais de ses sentiments – le film, au contraire, en déborde.
50 Cinéma > Sorties du 29 mars au 3 mai no 196 – avril 2023
Grand Paris de Martin Jauvat, JHR Films (1 h 11), sortie le 29 mars
JOSÉPHINE LEROY
Au fil du récit, on devine que c’est moins la thune qui obsède les deux amis que leur désir d’évasion.

UN FILM DE OLIVIER BABINET UN FILM AU GRAND CŒUR ! PREMIÈRE POÉTIQUE, ÂPRE ET DRÔLE L’OBS 05 AVRIL
Benoît POELVOORDE Justine LACROIX
SEPT HIVERS À TÉHÉRAN
SORTIE LE 29 MARS
Pour son premier long métrage, Steffi Niederzoll réalise un important film d’enquête, intime et politique, sur l’affaire Reyhaneh Jabbari, cette jeune Iranienne pendue en 2014 pour le meurtre d’un homme qui avait tenté de la violer.

Le premier long métrage de l’actrice allemande Steffi Niederzoll (aperçue chez Angela Schanelec) pose cette épineuse question : que peut le cinéma face au réel ? Le film est en partie constitué d’images et de sons enregistrés en Iran sans autorisation, fait passible d’au moins cinq ans de prison. Des documents qui proviennent pour beaucoup de la famille de Reyhaneh Jabbari, cette jeune femme iranienne emprisonnée à 19 ans et exécutée sept ans plus tard, dont l’histoire avait connu à l’époque un important retentissement. Sa faute ? Avoir riposté avec un couteau à l’attaque d’un homme qui,
après lui avoir tendu un piège, tentait de la violer. Si l’existence même du film dépend pour beaucoup de son statut de témoin, de cette importante mission qu’il se donne (comme celle dont s’était investie la mère de la victime au moment des événements, puis auprès d’autres femmes dans la même situation en Iran) de mener l’enquête et de faire connaître l’affaire, d’agiter sa vérité aux yeux du monde entier, Sept hivers à Téhéran parvient aussi à s’extirper de son devoir cicatriciel, de cette exemplarité (la jeune femme est devenue l’emblème de la sauvagerie du régime iranien) qui vise à afficher l’évidence de l’horreur. Si le film n’échappe pas totalement à un certain formatage télévisuel, il parvient, par un sens aigu du portrait, à embrasser collectivement les paroles des membres de la famille impactés par cette histoire, que la cinéaste interroge un à un. Sa pertinence de regard et d’écoute tient aussi à cette façon de nous rendre si proche Reyhaneh Jabbari, de la faire exister en lui redonnant voix, notamment par l’omniprésence, en off, de ses mots à elle, ceux qui disent son martyre, l’injustice de sa condition, sa vie en prison, mais aussi
les rencontres avec d’autres femmes et la puissance sororale de ces liens. Surtout, le film n’est jamais plus percutant que quand il fait pleinement confiance à la puissance d’évocation de ces images issues d’un caméscope de famille qui ne racontent rien d’autre que la banalité des moments de vie, cette harmonie anti-spectaculaire brutalement rompue et volée.
Sept hivers à Téhéran de Steffi Niederzoll, Nour Films (1 h 37), sortie le 29 mars
52 Cinéma > Sorties du 29 mars au 3 mai no 196 – avril 2023
MARILOU DUPONCHEL
Le film redonne voix à Reyhaneh Jabbari par la présence de ses mots, en off, qui disent son martyre, l’injustice de sa condition.
INFILTRÉ, IL PRÉPARE LA RÉVOLUTION
SWANN ARLAUD
L’ETABLI
MÉLANIE THIERRY OLIVIER GOURMET DENIS PODALYDÈS
sociétaire de la Comédie Française AU CINÉMA LE 5 AVRIL

© PHOTO JULIEN PANIE
UN FILM DE MATHIAS GOKALP Fabrice GOLDSTEIN et Antoine REIN présentent
LE CAPITAINE VOLKONOGOV S’EST ÉCHAPPÉ
SORTIE LE 29 MARS
En 1938, en U.R.S.S., alors que Joseph Staline a lancé de meurtrières purges contre ses propres troupes, un capitaine de l’armée sait qu’il va être arrêté malgré ses loyaux services et part se cacher dans les rues de Leningrad. Cet ancien tortionnaire est alors pris d’une vision : pour trouver la rédemption

avant la mort, il lui faut obtenir le pardon des familles de ses victimes… À travers le récit d’une chasse à l’homme, Natalia Merkoulova et Alexeï Tchoupov (qui ont aussi réalisé L’Homme qui a surpris tout le monde en 2019) signent une parabole politique aux impressionnantes visions chaotiques et à l’humour très noir. Démarrant par des images d’officiers désœuvrés qui jouent au volley-ball à l’intérieur d’un somptueux palais russe déserté, le film insiste sur les sensations de destruction généralisée engendrées par un système totalitaire. Dans le rôle de ce capitaine traqué qui tente de sauver son âme, Yuriy Borisov (acteur principal de Compartiment no 6) fait passer sur son visage les violentes contradictions d’un être qui comprend qu’il se trouve, comme son pays, au bord du gouffre, et que l’oppression à laquelle il a participé mène à une impasse métaphysique qui va tout emporter avec elle.
LOS REYES DEL MUNDO
SORTIE LE 29 MARS
Cet intense deuxième long métrage de la cinéaste colombienne Laura Mora (après Matar a Jesús en 2019) suit le voyage éprouvant, de Medellin à l’arrièrepays, de cinq adolescents à la recherche d’une terre promise. Avec en filigrane un regard sévère porté sur la Colombie, pays pétri par les inégalités et la violence.


Los reyes del mundo commence dans une ville déserte, nimbée de bleu, qui semble s’éveiller doucement. Jusqu’à ce qu’un métro traverse l’image à toute berzingue et que le vacarme de la ville fasse vriller les tympans. Cette ville, c’est Medellin. Orphelin, Rà s’y balade sur une mobylette défoncée, toujours la machette à portée de main. Lorsque le garçon reçoit une lettre du gouvernement lui annonçant qu’il va pouvoir récupérer la terre qui appartenait à sa grand-mère, autrefois
préemptée par des milices paramilitaires, il embarque quatre amis pour traverser le pays. L’odyssée sera surprenante et périlleuse. Derrière le destin de ces héros qui n’en sont pas, se dessine tout un pays, fascinant et dangereux, perclu d’inégalités, dans lequel les jeunes hommes semblent ne pouvoir hériter que de la violence. Laura Mora préserve quelques instants suspendus, qui empêchent son film de sombrer dans le dolorisme. Il y a cette escale dans une sorte de maison close au milieu de nulle part, où les ados trouvent des bras réconfortants pour les enlacer. Cet espoir aussi, symbolisé par un mystérieux cheval, qui les pousse toujours plus loin sur la route. Ce jeu sur les changements d’atmosphère répond à celui sur le son. Et l’on sait d’avance que, après le silence cotonneux, le chaos reprendra ses droits.
54 Cinéma > Sorties du 29 mars au 3 mai no 196 – avril 2023
Situé pendant la Grande Terreur et centré sur un officier qui cherche la rédemption, ce thriller historique parcouru de visions époustouflantes brosse un tétanisant portrait en creux de la violence contemporaine et de la Russie d’aujourd’hui.
On sait d’avance que, après le silence cotonneux, le chaos reprendra ses droits.
MARGAUX BARALON
Los reyes del mundo de Laura Mora Rezo Films (1 h 51), sortie le 29 mars
Le Capitaine Volkonogov s’est échappé de Natalia Merkoulova et Alexeï Tchoupov, KinoVista (2 h), sortie le 29 mars
DAMIEN LEBLANC
DANCING

UN FILM DE FLORIAN HEINZEN-ZIOB AU CINÉMA LE 12 AVRIL



ELLE A RÉVOLUTIONNÉ LE MONDE DE LA DANSE FONTÄNE FILM ET DULAC DISTRIBUTION PRÉSENTENT
NORMALE
Chelles, à une époque ni actuelle ni lointaine. Lucie, 15 ans, noircit ses carnets d’écrits romanesques où sa vie prend une allure hollywoodienne, tandis que son père s’affaisse dans la maladie. La visite prochaine d’une assistante sociale fait redouter à ce duo bringuebalant mais terriblement complice une douloureuse séparation… Dans un entre-deux-mondes caractéristique du cinéma d’Olivier Babinet
– les yeux tournés vers le mythe américain et le cœur qui voyage en France flanqué d’une certaine « belgitude », incarnée par un Benoît Poelvoorde sur le fil –, Normale parvient à capter un air du temps mâtiné de mélancolie. Déjà, avec son flamboyant documentaire Swagger (2016), le réalisateur filmait l’adolescence comme une puissante fabrique à histoires auprès de collégiens d’Aulnay-sous-Bois. Il adapte ici Monster in The Hall du dramaturge écossais David Greig, pièce construite autour d’un atelier mené avec des adolescents s’occupant d’un parent malade, et célèbre le pouvoir du récit comme barrage contre la mort. En lisant, en écrivant, en chantant son monde – comme celui des autres –, Lucie (épatante Justine Lacroix, découverte dans C’est ça l’amour de Claire Burger en 2019) le fait furieusement exister, tout comme Olivier Babinet enrichit sans relâche son langage de cinéma.
À MON SEUL DESIR
Après Fidelio. L’Odyssée d’Alice (2014) et Chanson douce (2019), Lucie Borleteau signe avec À mon seul désir un troisième long sur le monde du strip-tease, sans voyeurisme ni outrance.

Lascives et brûlantes, les danseuses jouent des regards, font tomber les étoffes et enflamment le public chaque soir dans un strip-club. Dans les coulisses, on enlève les faux cils, on discute, on s’applaudit et on se réconforte face aux agressions subies et aux déboires amoureux. Aurore, ancienne étudiante en thèse un peu perdue, débarque dans ce milieu souterrain trop souvent mal dépeint. Elle y rencontre Mia, danseuse envoûtante et aspirante actrice. Ici, on ne retrouve ni le poncif de la fille abusée ou prolétaire ni celui de la jeune bourgeoise ou artiste qui veut s’encanailler.
Après une première heure plutôt sage de
découverte d’un nouveau monde, À mon seul désir prend un tournant inattendu. Émergeant au fil des performances et des extras d’escortes à deux, le désir qui se noue entre les deux héroïnes apporte une fraîcheur queer à un canevas classique du film d’apprentissage. L’amour qui éclot apporte ses affres et ses blessures, mais trouve une issue inattendue par rapport au traitement habituel des passions lesbiennes au cinéma. Mené par les talentueuses Zita Hanrot et Louise Chevillotte et étoffé de caméos de Melvil Poupaud ou Félix Maritaud, À mon seul désir trouve aussi son souffle grâce à son électrisante B.O., composée par Rebeka Warrior.


À mon seul désir de Lucie Borleteau, Pyramide (1 h 57), sortie le 5 avril
HANNELI VICTOIRE
56 Cinéma > Sorties du 29 mars au 3 mai no 196 – avril 2023
Inclassable conteur dont l’imaginaire emprunte aux codes du cinéma américain, du drame social belge et de l’heroic fantasy, Olivier Babinet revient avec un quatrième film où s’agite un truculent vivier d’histoires.
Le désir qui se noue entre les héroïnes apporte une fraîcheur queer à un film d’apprentissage classique.
LE 5 AVRIL
SORTIE
LE 5 AVRIL
SORTIE
Normale d’Olivier Babinet, Haut et Court (1 h 27), sortie le 5 avril
LAURA PERTUY
JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES
Peut-on (re)créer du lien entre des auteurs de violences et des personnes qui en ont subies ? Réunissant un impressionnant casting (dont Leïla Bekhti, Miou-Miou et Adèle Exarchopoulos), Jeanne Herry (Pupille) filme ce pari insensé et à l’issue incertaine.


Pratique peu répandue en France, la justice restaurative consiste à mettre en contact des victimes de crimes ou de délits et des coupables d’infractions similaires. Objectif : installer un dialogue très cadré, afin que chacun puisse exprimer ses traumatismes et ses incompréhensions, mais aussi en-


Trois questions


Comment fait-on pour équilibrer ce double récit ?


Je ne voulais pas choisir entre les deux grands dispositifs de la justice. Ça offrait des possibilités différentes en matière d’enjeux et de géométrie. C’était bénéfique que le film ne soit pas qu’un huis clos, que chaque partie permette à l’autre de respirer. Mais ça a été un souci de l’écriture au montage, car l’une démarre par un climax tandis que l’autre est un crescendo.
tendre le vécu de l’autre. Pour raconter comment se met en place ce processus si complexe et fragile, Jeanne Herry a choisi deux histoires : elle suit le travail préparatoire mené par une jeune femme (Adèle Exarchopoulos) avec la juriste qui l’accompagne (Élodie Bouchez), en vue d’une médiation avec le frère qui l’a violée toute son enfance ; et elle nous fait intégrer un cercle de rencontres dans lequel, chaque semaine, trois détenus (dont le doué Dali Benssalah) et trois victimes (Leïla Bekthi, Miou-Miou et Gilles Lelouche) viennent se raconter et s’écouter, sans mâcher leurs mots. En épousant aussi le point de vue de celles et ceux qui encadrent ces groupes de parole, Je verrai toujours vos visages ne cache rien de ce qui s’apparente à un numéro de trapèze volant : même quand tout semble fonctionner, la plus grande des prudences s’impose – sinon c’est la chute. La justice restaurative est davantage affaire de lien social que de thérapie, mais ce que décrit le film ressemble à ce qui peut se produire sur un divan de psy :
À JEANNE HERRY
Les quatre coupables de crimes ou de délits sont des hommes. Volonté ou hasard ?
Pour Pupille, j’avais écrit un personnage d’assistant familial masculin [Gilles Lellouche, ndlr] alors que 98 % sont des femmes. Mais ici ça m’aurait embêtée d’aller à l’encontre des statistiques.

Il n’y a même pas 4 % de détenues en France… Et puis ça permet de souligner que dans ce monde masculin de la délinquance la parole est disqualifiée : c’est de la fragilité, de la trahison.
prendre la parole est souvent difficile, les silences sont fondamentaux, et on ne repart pas forcément avec ce qu’on venait chercher. Cet état d’incertitude crée une émotion intense, qui n’a nullement besoin d’artifices pour se développer. La mise en scène attentive de Jeanne Herry fait exister tous les personnages à parts égales, sans manichéisme ni sensationnalisme. Avec une attention bien particulière portée sur la temporalité : préparer pendant des semaines le face-à-face le plus important de sa vie, sans savoir s’il durera plus d’une poignée de minutes ou s’il aura même lieu, c’est une terrible épreuve de plus.
Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry, StudioCanal (1 h 58), sortie le 29 mars
THOMAS MESSIAS
Le film travaille la temporalité, on y sent l’importance de l’attente et des silences…
On a besoin de temps long, de nuance, de progresser petit à petit. J’avais envie d’un film qui prenne son temps, avec des silences de qualité. D’ailleurs, je me suis posé la question : fallait-il faire un film ou une série ? Un format plus long m’aurait donné la possibilité de déployer tous les personnages et tous les enjeux. Finalement, j’ai fait des choix.

57 Sorties du 29 mars au 3 mai <---- Cinéma avril 2023 – no 196 A U C I N É M A L E 1 2 A V R I L " U n e f a b l e r e m a r q u a b l e e t é t o n n a n t e s u r l e c a p i t a l i s m e " L E M O N D E " D é l i c i e u s e m e n t e n v o û t a n t " L E S I N R O C K U P T I B L E S " U n p o r t r a i t é c o l o g i q u e d e l a p e n s é e , u n r é s e r v o i r d e p o s s i b l e s " C A H I E R S D U C I N É M A U N A U T R E M O N D E U N A U T R E M O N D E E S T P O S S I B L E E S T P O S S I B L E
LE 29 MARS
SORTIE
L’ÉTABLI
Après le déjà remarquable Rien de personnel en 2009, qui traitait des rapports de classe de façon ludique, Mathias Gokalp confirme son talent pour s’emparer de sujets engagés en adaptant ici le célèbre ouvrage du sociologue et philosophe Robert Linhart sur son expérience dans une usine Citroën.
À la fin des années 1960, plusieurs milliers d’étudiants, d’intellectuels et de militants d’extrême gauche s’enrôlèrent dans les usines. Ils comptaient comprendre le travail de l’intérieur et préparer clandestinement une révolution qu’ils estimaient imminente. Le normalien Robert, incarné corps et âme par Swann Arlaud, fut un « établi » comme eux. Ce beau film âpre et chaleureux raconte cette expérience à la fois unique et collective en nous
faisant partager ses doutes et leur lutte. Un réel esprit de troupe irrigue la mise en scène : les collègues du héros sont tous singuliers dans leur écriture et dans leur incarnation. Gokalp nous rend aussi sensible à la position fragile qu’occupe Robert, intellectuel parmi les prolétaires, se battant à leurs côtés, tout en appartenant à la classe dite bourgeoise, pointant sa maladresse autant que la dangerosité du travail. Il sait rendre fascinante une séquence de chaîne de montage d’une 2 CV, jouant avec une bande-son littéralement industrielle et une lumière douce, nonobstant la dureté de la tâche. Ce retour nécessaire et tonique sur une page d’histoire importante résonne d’autant plus fortement aujourd’hui, alors que la réforme des retraites est contestée et la pénibilité du travail pointée.
L’Établi de Mathias Gokalp, Le Pacte (1 h 57), sortie le 5 avril
Robert, intellectuel bourgeois parmi les prolétaires, occupe une position fragile.

KOKON
La cinéaste allemande

Leonie Krippendorff signe un teen movie délicat en adoptant le point de vue d’une adolescente berlinoise de 14 ans. Un portrait doux et sensible, reflet, le temps d’un été caniculaire, d’une jeunesse désœuvrée.

C’est l’été des premières fois. Premières règles, premières amours, premiers déboires – premières canicules aussi, dans un Berlin démuni face à ces records de température. Le bras en écharpe à la suite d’une partie de pouilleux massacreur qui a dérapé, Nora suit sa grande sœur, Jule, comme son ombre, jour
et nuit. Au lycée, à la piscine ou dans les rues de ce quartier populaire de Kreuzberg, elle observe ses aînés et ce monde d’injonctions sans les faire vraiment siennes, et tente de manœuvrer dans cette jungle de rapports sociaux d’une brutalité aussi désarmante que l’étrange douceur qui en découle… Sensible et acéré, le regard que pose Leonie Krippendorff sur ces ados ne verse jamais dans la mièvrerie ou la condescendance et évite les clichés souvent plaqués sur cette période retorse, qui s’échappe à mesure qu’on tente de la saisir. Kokon brûle de toute l’intensité de cet âge où rien ne se fait à demi : c’est un film qui se vit par le corps, où tout pulse, vibre et bouillonne. Le temps de quelques semaines durant lesquelles tout va trop vite, Nora finira par éclore, capturée par une caméra qui, sans sous-texte ni morale, parvient à restituer le quotidien dans toute sa dimension à la fois ordinaire et éminemment fondatrice.
58 Cinéma > Sorties du 29 mars au 3 mai no 196 – avril 2023
SORTIE LE 5 AVRIL
SORTIE LE 5 AVRIL
XANAÉ BOVE
Kokon de Leonie Krippendorff, Outplay (1 h 35), sortie le 5 avril
COPÉLIA MAINARDI
ADILA BENDIMERAD
MOHAMED TAHAR ZAOUI
IMEN NOEL
Taj Intaj & Agat Films
présentent
DALI BENSSALAH
NADIA TERESZKIEWICZ
YANIS AOUINE
ALGER, 1516
Un film de DAMIEN OUNOURI & ADILA BENDIMERAD

LA DERNIERE REINE AU CINÉMA LE 19 AVRIL
RELAXE
SORTIE LE 5 AVRIL
Premier long métrage d’Audrey Ginestet, qui en assure aussi une partie de l’image et du son, le documentaire Relaxe impressionne par son mélange de frontalité et de douceur pour revenir sur l’affaire Tarnac, qui a secoué la France à la fin des années 2000.
En 2008, dix jeunes gens sont arrêtés par la police antiterroriste, suspectés d’avoir saboté des lignes de TGV. En incriminant ce groupuscule dit d’ultragauche, la ministre de l’Intérieur de l’époque, Michèle
ALMA VIVA
SORTIE LE 12 AVRIL
Délicat, le premier film de la Franco-Portugaise Cristèle Alves Meira, présenté à la Semaine de la critique 2022, prend le temps de l’observation à hauteur d’enfant. Et célèbre la force inébranlable d’une lignée de femmes.



Salomé, une fillette d’une dizaine d’années vivant en France, passe ses vacances d’été dans le village portugais où vit sa famille maternelle, dont une grand-mère adepte de rites magiques et autres conversations avec les défunts. Quand celle-ci s’éteint mystérieusement, Salomé (extraordinaire Lua Michel, fille de la réalisatrice) pense à un empoisonnement orchestré par une voisine acariâtre et se met à développer des comportements étranges, comme habitée par l’esprit de son aïeule… « Tôt ou tard, toutes les femmes in-
dépendantes se font traiter de sorcières », assène son oncle malvoyant – figure de tragédie grecque s’il en est – alors que la famille se déchire autour des questions d’héritage. Outre une puissante réflexion sur l’enfance et le deuil (quelle(s) absence(s), de soi, des autres, la mort d’un proche révèlet-elle ?), Cristèle Alves Meira ouvre des pistes sur la protection et la transmission au sein d’un gynécée moderne, où jalousies et vanités se dressent parfois comme d’infranchissables murs. Héritière du matrimoine familial, Salomé fait sillonner ses proches vers une guérison, avec l’idée d’une lignée féminine à la puissance implacable.
Alliot-Marie, entend condamner un certain mode de vie autonome. Aucune preuve ne sera trouvée. Accidentellement témoin privilégiée car belle-sœur de l’une des accusées, Manon, Audrey Ginestet s’empare de sa caméra à l’approche du procès, qui a lieu dix ans après les faits. Alternant des séquences de répétition de la défense de Manon et sa gracieuse filature, Relaxe conjugue admirablement l’intime et le collectif. En bonne équilibriste, la cinéaste (qui est par ailleurs bassiste au sein du groupe Aquaserge) parvient à suivre son héroïne sans être intrusive ni verser dans le film à thèse. Relaxe est avant tout un acte de cinéma et un manifeste pour les personnes qui, selon les mots de la réalisatrice, « construisent une existence en dehors des impératifs dominants, cherchent des pratiques quotidiennes qui ouvrent sur d’autres possibles ».
60 Cinéma > Sorties du 29 mars au 3 mai no 196 – avril 2023
« Tôt ou tard, toutes les femmes indépendantes se font traiter de sorcières », assène un oncle malvoyant.
Alma viva de Cristèle Alves Meira, Tandem (1 h 28), sortie le 12 avril
LAURA PERTUY
Relaxe d’Audrey Ginestet, Norte (1 h 32), sortie le 5 avril
XANAÉ BOVE
Dans une horlogerie suisse, en 1870, une ouvrière fait face à une réorganisation compétitive du travail et découvre le mouvement local d’horlogers anarchistes… Avec Désordres, Cyril Schäublin réalise un grand film minimaliste et politique sur la naissance du mouvement anarchiste confronté à la montée en puissance des lois d’un temps capitalisé.








Implanté dans une horlogerie suisse de la fin du xixe siècle, Désordres se situe à l’orée de plusieurs croisements. Il y a d’abord une rencontre, celle entre Joséphine, ou-

Trois questions












































Pourquoi avoir situé le récit à cet endroit et à cette époque ?

Ma famille travaillait dans la même usine d’horlogerie. L’époque du film est spéciale : c’est à ce moment qu’est apparue l’identité anarchiste. Se pose la question de comment les technologies peuvent créer des communautés ? On pourrait poser la même aujourd’hui. Je crois que les anarchistes à cette époque voulaient appréhender l’être humain et la classe ouvrière comme un territoire.
DÉSORDRES
vrière qui fabrique des balanciers, pièce maîtresse de la mécanique horlogère, et Pierre Kropotkine, personnage inspiré de cette figure clé de l’anarchisme, géographe venu dans la vallée pour en compléter la carte. Désordres se place aussi à la jointure de plusieurs composants : l’artisanat des horlogers d’un côté, les avancées technologiques et les nouveaux systèmes de pensées capitalistes qu’elles engendrent de l’autre ; enfin, en réaction à la nouvelle compétitivité imposée, la naissance d’un mouvement local d’anarchistes dans ce lieu devenu l’épicentre de ce courant révolutionnaire. À ces bouleversements et affrontements philosophiques, Cyril Schäublin répond par un film élégant, qui suit une logique de déconstruction sans que l’entreprise ne se transforme en un vain exercice de style. Au milieu des plans larges (quelque chose de La Sortie de l’usine Lumière à Lyon apparaît ici comme un idéal de cinéma), des obstacles viennent obstruer le centre, et les personnages, incarnés par des non-professionnels (qui
À CYRIL SCHÄUBLIN














Le film développe l’idée que le temps serait une invention capitaliste… C’est comme l’idée de la nation, c’est une construction. Le temps reste encore un mystère dans le domaine de la physique. Sa mesure existait avant le xixe siècle mais à l’époque, avec les moyens du capitalisme, il a été possible de créer du temps « plus parfait ». La question qui se pose, c’est : qui a le pouvoir de dire « maintenant on va décider quand vous allez travailler, dormir… » ?



































donnent au film un élan antinaturaliste, doux et instinctif) sont relayés au bord du cadre. Il faut alors bien diriger son regard pour les voir. Par ce simple jeu de cachecache, Désordres devient un grand film politique : une œuvre anarchiste et déréglée sur les lois (le petit village est soumis à plusieurs fuseaux horaires) et l’emprise du temps capitaliste sur nos modes de vies d’hier et d’aujourd’hui. Et si Désordres regarde le passé, c’est pour mieux prendre le temps (sans impératif de calcul et de profit) de l’appréhender au-delà des histoires dominantes, refuser les règles classiques de la fiction, la hiérarchie d’une narration pour bousculer l’ordre.

Désordres de Cyril Schäublin, Shellac (1 h 33), sortie le 12 avril










































Pouvez-vous me parler du procédé de mise en scène très singulier du film ?
Je voulais jouer avec les centres et les marges pour montrer qu’il est impossible de montrer le passé tel qu’il était. Dans l’historiographie, il y a toujours une décision : de quoi parler ? Par exemple, dans les archives suisses, il y a peu d’informations sur les ouvrières du xixe siècle. Il y en a sur les ouvriers, sur les bourgeois ; alors que, dans l’industrie horlogère, les femmes étaient très importantes.
61 Sorties du 29 mars au 3 mai <---- Cinéma avril 2023 – no 196
EXPOSITION
Conception graphique : La Cinémathèque française / Mélanie Roero - OSS 117 : Le Caire, nid d’espions Michel Hazanavicius © 2005 –Gaumont/SND/M6 Films / La Mort aux Trousses Alfred Hitchcock ©1959 Turner Entertainment Co., a Time Warner Company.
BILLETS CINEMATHEQUE.FR et
CINÉMA ET ESPIONNAGE 21.10.22> 21.05.23
SORTIE LE 12 AVRIL
MARILOU DUPONCHEL
LOUP & CHIEN
SORTIE LE 12 AVRIL
Ana parcourt à moto l’île de São Miguel, où elle vit depuis toujours, échappant aux prétendants et aux complications du quotidien. L’arrivée de l’extravertie Cloé met en émoi cette adolescente réservée, tandis que son meilleur ami, Luis, navigue entre affirmation et tensions familiales. Autour d’eux évolue une communauté queer dont la présence chahute l’attribution des rôles très genrée qui
gangrène les lieux… De son expérience du documentaire, la réalisatrice portugaise Cláudia Varejão – qui avait notamment mené une enquête sur les ama, une communauté de plongeuses japonaises des années 1950 – a conservé une proximité sidérante avec son sujet et la nature environnante, à l’écoute de leurs moindres oscillations. Le monde intérieur d’Ana se répercute dans l’atmosphère mélancolique des endroits qu’elle traverse et se raconte dans le petit boulot qu’elle s’est trouvé sur un ferry touristique depuis lequel elle observe les baleines. Insaisissables, ces colosses marins disent une liberté à laquelle aspire la jeune femme, un déplacement fluide dans lequel explorer son désir, un vaste espace où se célébrer. Et la cinéaste, installée entre « chien et loup », sans assignation précise, de regarder à travers son héroïne le monde se doter d’un nuancier plus riche de couleurs.
SUZUME
SORTIE LE 12 AVRIL
Une lycéenne découvre que le monde des morts menace d’engloutir celui des vivants. Après Your Name et Weathering With You, Makoto Shinkai signe Suzume, ravissant récit d’aventure qui fait la part belle à l’émerveillement, en Compétition à la Berlinale en février.


Un embryon de romance et un découpage emphatique qui exacerbe la sensualité d’un univers étincelant mais hanté par des cataclysmes passés : le beau début de Suzume, du nom de la lycéenne qui croise près de chez elle la route de l’énigmatique Sōta, a tout du film de Makoto Shinkai pur jus. La suite du récit portera l’adolescente le long d’une aventure fantastique, dans laquelle elle devra, au gré des circonstances, refermer différents portails laissant s’échapper, sur le monde des vivants, des entités cataclysmiques. Le film
nous fait ainsi traverser le Japon du sud vers le nord en rejouant plusieurs fois la partition chère au cinéaste, qui s’est fait pour spécialité d’exalter la dynamique cosmique du mélodrame, entre attraction et éloignement des astres, que ce soit le foudroiement d’une rencontre, ou le déchirement d’une séparation entre deux univers. Dans Suzume, dont la candeur à toute épreuve a tendance à déconcerter, voire à aplanir un peu les changements de tons, cette danse astrale tient en partie à l’existence d’un monde parallèle partageant, avec la réalité des personnages, une même splendeur. C’est peut-être d’ailleurs la raison pour laquelle ses protagonistes cherchent à empêcher la catastrophe : chez Shinkai, préserver l’environnement revient à préserver l’émerveillement.

Chez Shinkai, préserver
62 Cinéma > Sorties du 29 mars au 3 mai no 196 – avril 2023
Avec pour captivant décor une lointaine île des Açores, Cláudia Varejão signe un premier film de fiction où se rencontrent les genres, où tambourinent les luttes queer et où elle fait rugir sa pleine liberté de cinéaste.
l’environnement revient à préserver l’émerveillement.
CORENTIN LÊ
Suzume de Makoto Shinkai, Eurozoom (2 h 02), sortie le 12 avril
Loup & chien de Cláudia Varejão, Épicentre Films (1 h 51), sortie le 12 avril
LAURA PERTUY
“Une histoire d’amour belle et puissante”


LEÏLA BEKHTI KARIM LEKLOU LOUISE BOURGOIN AVENUE B PRODUCTIONS présente UN FILM DE GUILLAUME BUREAU © 2023 - AVENUE B PRODUCTIONS - FRAKAS PRODUCTIONS - RTBF AVENUE B PRODUCTIONS présente
LE FIGARO MAGAZINE
5 AVRIL AFFICHE © JEFF MAUNOURY POUR METANOÏA © ALEX PIXELLEPIXELLEPHOTO.FR CREDITS NON CONTRACTUELS
LE
AVANT L’EFFONDREMENT
SORTIE LE 19 AVRIL
L’écrivaine Alice Zeniter signe son premier film, coréalisé avec Benoît Volnais. Reflet de son époque, Avant l’effondrement met en scène les dilemmes d’une jeunesse tiraillée par une foule de questionnements politiques et sociaux.

Peut-on refuser la fin du monde sans minimiser les aléas climatiques ? Faut-il croire aux thèses collapsologistes ? continuer d’investir les institutions démocratiques, ou mener la révolution ? Ce film se fait le reflet d’une jeunesse parisienne confrontée à son époque. Tristan, 35 ans, directeur de campagne d’une

BLUE JEAN
SORTIE LE 19 AVRIL
Premier long métrage prometteur et à rebours des clichés d’une jeune réalisatrice britannique, Georgia Oakley, Blue Jean est une plongée aussi tendre qu’amère dans la vie d’une enseignante lesbienne dans une petite ville anglaise sous l’ère Thatcher, en 1988.
Le bleu de Blue Jean est d’abord celui de la crème décolorante de son héroïne, Jean, prof de sport dans un lycée anglais, en plein dans les eighties de Margaret Thatcher. Une loi vient juste d’y être votée interdisant toute mention positive de l’homosexualité auprès des enfants. C’est aussi la couleur du blues, celui du mal-être de Jean, écartelée entre les journées mornes auprès de ses collègues et les nuits festives dans un bar lesbien, entourée de copines joyeuses dont Viv, son amoureuse. L’arrivée d’une nouvelle lycéenne, Loïs,

lesbienne, oblige Jean à faire un choix : la défendre lorsqu’elle se fait harceler, ou ne rien faire de peur d’être démasquée. On pourrait croire au scénario éculé et problématique de l’amour interdit entre une étudiante et sa professeure, il n’en est heureusement rien. Jean n’a aucune vue sur Loïs, et cherche même à l’éviter. À l’incompréhension de Viv – « Quel modèle positif lui donnes-tu, à cette jeune fille de 15 ans ? » –, Georgia Oakley nous offre une tranche d’histoire alternative, celle des minorités homosexuelles qui s’aiment et doutent en même temps. Porté par des représentations de lesbiennes butchs, rares au cinéma, Blue Jean nous montre que, si l’amour ne gagne pas forcément, la force de la communauté, elle, l’emporte toujours.
candidate (de gauche) aux législatives, voit sa vie basculer : quelques jours avant les élections, il reçoit un test de grossesse anonyme positif, et l’idée de transmettre une maladie génétique héréditaire dont il craint d’être atteint l’obsède. Avant l’effondrement brasse des thèmes qui irriguent le débat public – et l’œuvre d’Alice Zeniter (notamment son dernier roman, Toute une moitié du monde). Elle transpose ces réflexions sociales et politiques à l’écran pour la première fois, y ajoutant au passage une foule d’autres plus intimes – sur la parentalité, la maladie, la mort, l’amour, l’amitié… Un résultat convaincant (même si la multitude des thématiques abordées donne parfois le tournis) grâce à une énergie communicative, des choix de montage originaux, un joli casting (Niels Schneider, Ariane Labed, Souheila Yacoub) et une justesse dans la mise en scène des dilemmes que doit affronter cette jeunesse plus si jeune.
Avant l’effondrement d’Alice Zeniter et Benoît Volnais, Pyramide (1 h 40), sortie le 19 avril
64 Cinéma > Sorties du 29 mars au 3 mai no 196 – avril 2023
Jean est écartelée entre la morosité au travail et les nuits festives dans un bar lesbien.
Blue Jean de Georgia Oakley, UFO (1 h 37), sortie le 19 avril
HANNELI VICTOIRE
COPÉLIA MAINARDI
UN FILM ÉCRIT ET RÉALISÉ PAR ÈVE DUCHEMIN


KARIM LEKLOU ISSAKA SAWADOGO JAROD COUSYNS
AU CINÉMA LE 3 MAI
KWASSA FILMS PRESENTE EN COPRODUCTION AVEC LES FILMS DE L’AUTRE COUGAR
Après son teen movie turbulent de 2014, La Crème de la crème, Kim Chapiron fait son grand retour au cinéma avec ce film plus sage, à la fois sec et profond. Entre thriller et récit initiatique, il raconte la quête de paix d’un jeune homme, entre la France et le Mali.
Après une pause hors des circuits cinématographiques, Kim Chapiron (Sheitan, 2006, Dog Pound, 2010, et donc La Crème de la crème) revient avec Le Jeune Imam L’histoire d’Ali, jeune habitant de la cité des Bosquets à Montfermeil (d’où la famille du cinéaste est originaire, comme son ami Ladj Ly, qui cosigne avec lui le scénario, aux côtés de Dominique Baumard et Ramzi Ben Sliman). À la suite d’un vol qu’il a commis, sa mère l’envoie dans une école coranique, au Mali (d’où elle vient), pour le remettre sur le droit chemin. Après une ellipse qui
LE JEUNE IMAM
laisse s’écouler plusieurs années, Ali revient en France, monte un business d’import-export foireux et en vient à se rapprocher de l’imam du quartier. Sur le départ, celui-ci lui propose de prendre sa relève. De plus en plus populaire auprès des fidèles du quartier, Ali se lance dans une nouvelle affaire, qui part bientôt en sucette : l’organisation de voyages groupés pour des pèlerinages à La Mecque… Le pitch pourrait faire craindre un film maladroit sur la religion. Ou qui utiliserait la banlieue pour en faire le terrain d’un film d’action surexcité, viriliste, qui surferait sur notre époque crispée – l’énergique séquence d’ouverture, en forme de chasse à l’homme, nous a d’abord induits faussement dans ce sens. C’est toute la subtilité du récit que de nous faire croire qu’on ira à tel endroit, pour finalement nous déplacer vers des coins inattendus. Comme dans le chapitre malien du film : une parenthèse douce, apaisée, éclairée d’une lumière un peu bleutée, entre deux parties urbaines bien plus frémissantes. À la fois ancré dans son temps – Ali est un imam nouvelle génération, qui maîtrise les réseaux sociaux – et hors du temps, le film joue sur plusieurs tableaux à la fois. Ce qui se sent également dans
l’écriture des personnages, observés avec un regard tendre mais jamais doucereux. D’Ali (Abdulah Sissoko), on se demande toujours s’il est le fils prodige ou prodigue, l’enfant béni ou dilapidateur. De sa mère (magistrale Hady Berthe, une actrice non professionnelle – comme tout le casting –qui nous éblouit), on se dit qu’elle est une redoutable femme d’affaires et matriarche en même temps qu’une femme inquiète, aux gestes d’affection non pas absents mais pudiques. Comme dans La Crème de la crème, où trois étudiants de H.E.C. masquent derrière une combine bien huilée leur quête d’amour, les ruses de ce jeune imam ne sont qu’une façade pour cacher le même besoin simple, pur, mais difficilement avouable, de (re)connexion à l’autre.

Le Jeune Imam de Kim Chapiron, Le Pacte (1 h 38), sortie le 26 avril
JOSÉPHINE LEROY
Trois questions
Quel a été le point de départ du film ?
Un fait réel qui nous a scotchés, Ladj et moi : une histoire d’arnaque au pèlerinage – on a ensuite découvert que ça se passait à plein d’endroits. La genèse du film, c’est cette question : comment la personne la plus aimée d’un groupe va devenir la plus haïe ? Et comment la filiation affecte nos choix, nos vies ? Ce qui est intéressant, avec un fait divers, c’est ce que ça génère d’inextricable.
Vos précédents films s’inscrivaient dans une veine moins réaliste et intimiste. Ça faisait longtemps que j’avais envie de faire un film comme ça. Il y a un genre japonais que j’aime beaucoup, le shomingeki,
À KIM CHAPIRON
qui filme les gens ordinaires, s’intéresse aux non-dits – avec des réalisateurs comme Yasujirō Ozu ou Mikio Naruse… Mes films précédents s’intéressaient à la famille qu’on se crée. Là, c’est la famille qu’on ne choisit pas. Un endroit où il n’y a pas de masque, où on est dans la vérité des cœurs, de l’âme.
Les dialogues sont émaillés de références à des légendes mythiques, religieuses.
En Afrique de l’Ouest, l’art du récit est ancré depuis un sacré bout de temps. J’ai eu la chance d’y aller une vingtaine de fois et d’y avoir rencontré d’autres points de vue sur le monde. L’amour que ces gens ont pour la narration me bouleverse. Moi-même, j’aime beaucoup raconter des histoires à mes enfants.
66 Cinéma > Sorties du 29 mars au 3 mai no 196 – avril 2023
SORTIE LE 26 AVRIL







































REMORQUES
RESSORTIE LE 19 AVRIL
André Laurent (Jean Gabin), capitaine du remorqueur Le Cyclone, assiste avec son équipage à la noce d’un de ses marins, avant d’être appelé en urgence pour secourir les passagers d’un cargo, dont Catherine (Michèle Morgan), la femme du commandant. Coup de foudre : commence une liaison… Ce drame nocturne, tourné sur les côtes de Brest et de Guissény, étonne par sa capacité

à synthétiser harmonieusement des imaginaires mythologiques et des esthétiques composites. Grand plasticien, Jean Grémillon filme l’appareillage du Cyclone comme une bataille épique et avec une modernité percutante. Sous son réalisme symbolique oscillant entre noir et blanc austère (la photographie signée Armand Thirard sublime des décors brumeux, presque expressionnistes) et saillies poétiques (les séquences diurnes sur la plage où Jean Gabin et Michèle Morgan entrevoient un apaisement), pointent les thématiques obsédantes de l’adultère et de l’érosion conjugale, qui reviennent en ritournelles amères dans la bouche des personnages. Signés Jacques Prévert, ce sont ces dialogues presque musicaux qui donnent à ce drame très simple une dimension romantique déchirante, matérialisant les impasses sentimentales de personnages dont les solitudes peinent à s’accorder.
BURNING DAYS
SORTIE LE 26 AVRIL
Film noir maîtrisé de bout en bout, le quatrième long métrage d’Emin Alper s’attaque avec vigueur à la corruption et au conservatisme de la Turquie actuelle.


Dans la petite ville de Yaniklar, en Anatolie, on a l’habitude de pourchasser le sanglier en voiture dans les rues. Fraîchement arrivé d’Istanbul, le nouveau procureur, Emre, n’hésite pas à convoquer les deux instigateurs de la chasse, le fils du maire et son ami, pour leur rappeler qu’il est interdit de faire rugir leur carabine en pleine ville. Mais il est dangereux de chercher à bousculer le désordre établi des institutions locales, surtout à la veille des élections… Le cinéaste turc Emin Alper parvient à instiller autant de tension poisseuse dans un dîner que dans une course-poursuite nocturne. Le danger est partout, dans les maisons
biscornues envahies par les rats, dans la moindre poignée de main ou le début d’un regard. La bourgade (fictive) de Yaniklar devient le miroir de la Turquie tout entière, déchirée entre ses envies de modernité, qu’incarne le procureur, bien décidé à assainir la politique locale, et son conservatisme homophobe et sexiste, soutenu par une corruption endémique. Emin Alper clôt son film comme il l’ouvre, avec une séquence aussi sublime qu’angoissante, qui sonne comme un avertissement : il n’en faut jamais beaucoup, en Turquie comme ailleurs, pour que le populisme rampant fasse replonger tout un village dans la violence la plus primitive.
68 Cinéma > Sorties du 29 mars au 3 mai no 196 – avril 2023
L’un des chefs-d’œuvre du réalisme poétique, réalisé par Jean Grémillon et dialogué par Jacques Prévert, ressort en salles, porté par les immenses Jean Gabin et Michèle Morgan et habité par l’imaginaire de la mer.
Le danger est partout, dans les maisons biscornues envahies par les rats, dans la moindre poignée de main.
MARGAUX BARALON
Burning Days d’Emin Alper, Memento (2 h 08), sortie le 26 avril
Remorques de Jean Grémillon, Carlotta Films (1 h 30), ressortie le 19 avril
LÉA ANDRÉ-SARREAU
LE JEUNE IMAM
un film de kim chapiron
abdulah sissoko hady berthé
AU CINÉMA LE 26 AVRIL

Lyly Films et Srab Films présentent inspiré d’une histoire vraie
Création Benjamin Seznec TROÏKA
STARS AT NOON
Après la science-fiction (High Life), le polar (Les Salauds) ou la comédie romantique (Vendredi soir), Claire Denis réinvente le film d’espionnage à l’aune de ses obsessions avec Stars at Noon. Un film déroutant sur l’amour comme monnaie d’échange.

Le cinéma de Claire Denis est une vision pessimiste du monde, une façon de raconter l’impossible fusion des corps, de toujours filmer le désir contrarié au plus près de la peau. Une sorte de cinéma préliminaire dans lequel l’orgasme est impossible. Parce qu’il y a une cruauté, une crudité même chez Claire Denis.
BONNE CONDUITE
SORTIE LE 29 MARS
Au carrefour du thriller automobile et de la comédie satirique, Bonne conduite plonge Laure Calamy dans la peau d’une femme qui tue des chauffards pour faire de la prévention routière. Avec ses nombreuses références sous le capot, ce film décalé trace sa route.


Le thriller de vengeance est-il soluble dans la comédie française ? Oui, répond Jonathan Barré (réalisateur de La Folle Histoire de Max et Léon et des Vedettes) avec ce décoiffant polar burlesque où Laure Calamy incarne une formatrice dans un centre de stages de récupération de points. Défendant la prévention routière le jour, mais se transformant la nuit en tueuse en série de chauffards antipathiques, cette femme solitaire pense avoir trouvé là une bonne manière de venger le
souvenir de son compagnon, jadis fauché par un chauffard. Mais tout se complique quand l’un des mauvais conducteurs (Tchéky Karyo), qu’elle a jeté du haut d’une falaise, survit miraculeusement et la fait chanter en lui proposant un marché criminel. Avec son sens du gag décalé, son héroïne obsessionnelle, ses clins d’œil amusés à Usual Suspects ou à Fargo, son truculent duo de flics interprétés par les deux comparses du Palmashow, Grégoire Ludig et David Marsais, et sa musique planante (composée par Charles Ludig) qui pastiche furieusement les partitions de John Carpenter, cet audacieux objet filmique réussit sa greffe entre le Drive de Nicolas Winding Refn et l’humour franchouillard
Tout est affaire de transaction, de compromis. Cette vision noire du monde, elle la partage avec le romancier américain Denis Johnson, dont elle adapte ici le roman éponyme paru au cœur des années 1980. Transposée dans le Nicaragua de 2020, en pleine épidémie de Covid-19, cette rencontre entre une journaliste trouble (Margaret Qualley, révélation) et un homme d’affaires anglais pas si net (Joe Alwyn) prend la forme d’une échappée impossible. Le récit d’espionnage, traversée de paranoïa et de violence, crée une menace nébuleuse qui pousse les corps à se rapprocher, à espérer trouver dans l’autre une issue de secours. Claire Denis filme ici la romance supposée naître du danger comme un échange pour la survie, le sexe comme une transaction financière. Hypnotique par la grâce de sa mise en scène très sensorielle, le film nous oblige à nous cogner à ces deux héros cyniques mais terriblement humains.
70 Cinéma > Sorties du 29 mars au 3 mai no 196 – avril 2023
Bonne conduite de Jonathan Barré, Pan (1 h 35), sortie le 29 mars
DAMIEN LEBLANC
SORTIE LE 3 MAI
Laure Calamy défend la prévention routière le jour, se transforme en tueuse en série la nuit.
Stars at Noon de Claire Denis, Ad Vitam (2 h 17), sortie le 3 mai
RENAN CROS



























SUR L’ADAMANT
RESSORTIE LE 19 AVRIL
Le réalisateur d’Être et avoir inaugure un triptyque documentaire sur la folie avec ce doux portrait de groupe, qui a décroché l’Ours d’or à la Berlinale en février. Il a embarqué sa caméra sur l’Adamant, une péniche amarrée quai de la Rapée, à Paris, qui accueille un centre de jour hors du commun.

Chaque matin, les volets de sa partie en silo se relèvent doucement pour laisser entrer la lumière. L’Adamant, bateau unique en son genre, est prêt à accueillir soignants, référents et surtout patients autour d’un café, d’une
cigarette ou d’une activité thérapeutique – souvent artistique. Ce qui frappe d’abord, c’est la chaleur du lieu : boiseries, éclairage naturel dû aux nombreuses fenêtres, coursive qui donne sur la Seine. À dix mille lieues de l’ambiance d’hôpital, avec sa froideur et ses néons angoissants, l’Adamant fait figure de havre de paix, lors des réunions qui voient patients et référents discuter des activités, chacun accoudé à sa table. Le centre de jour accueille depuis 2010 des patients adultes des quatre premiers arrondissements de Paris. Nicolas Philibert en croque une poignée, aussi lucide qu’attachante. Le Nancéien s’inscrit ainsi dans le sillage des grands documentaristes ayant filmé la folie : Frederick Wiseman dans Titicut Follies (1967), Raymond Depardon et Sophie Ristelhueber dans San Clemente (1982), Wang Bing dans À la folie (2015). On prend déjà nos tickets d’embarquement pour les deux prochains volets.
DANCING PINA
SORTIE LE 12 AVRIL
Florian Heinzen-Ziob interroge la manière dont perdurent et se transmettent les chorégraphies
légendaires de Pina Bausch. Un documentaire tout en délicatesse, qui rend un hommage aussi joyeux qu’émouvant à l’une des figures-phares de l’histoire de la danse contemporaine.
C’est un film sur la transmission, sur la puissance d’un héritage éphémère, immatériel. Au Semperoper en Allemagne et à l’École des sables au Sénégal, de jeunes danseurs apprennent et s’approprient deux œuvres légendaires de la célèbre chorégraphe Pina Bausch. D’un côté, une pièce qui célèbre la puissance du collectif, la dissolution de l’individu dans le groupe : le légendaire Sacre du printemps, revisité par les danseurs de
Dakar. De l’autre, en miroir, solos et lente gestation de trajectoires individuelles : Iphigénie en Tauride. La plupart des interprètes que l’on voit à l’écran ne viennent pas de la danse contemporaine, mais du hip-hop, du ballet et des danses africaines. Sans avoir à renier leur formation ou leur identité, ils sont guidés par d’anciens danseurs de Pina, qui tentent de leur transmettre le sens présent au fond du mouvement, la profondeur des intentions, les désirs et les limites du geste. Au bout de ce parcours qui dépasse le seul apprentissage, ces jeunes sont autant transformés par l’œuvre qu’eux-mêmes l’ont modifiée. À la fin, le constat est double : la force avec laquelle Pina Bausch a imprégné ceux qui l’ont côtoyée est impressionnante… Et, quinze ans après sa mort, elle n’a visiblement pas fini de marquer le spectacle vivant.

Quinze ans après sa mort, Pina Bausch n’a pas fini de marquer le spectacle vivant.

72 Cinéma > Sorties du 29 mars au 3 mai no 196 – avril 2023
COPÉLIA MAINARDI
Dancing Pina de Florian Heinzen-Ziob, Dulac (1 h 56), sortie le 12 avril
Sur l’Adamant de Nicolas Philibert, Les Films du Losange (1 h 49), sortie le 19 avril
TIMÉ ZOPPÉ

FLUXUS FILMS ET MIDAS FILMES PRÉSENTENT
NOÉMIE DIT OUI
La cinéaste québécoise
Geneviève Albert jette
l’héroïne de son premier long métrage dans le grand prix de formule 1 de Montréal, où se déploie le temps de quelques jours une débauche masculine décomplexée de sport mécanique et de tourisme sexuel.
Dans le teen movie, le motif de l’adolescence livrée à elle-même fait office de sous-genre. Dans le sillage des frères Dardenne ou d’Andrea Arnold, à qui elle rend un hommage discret, Geneviève Albert capte dans le portrait de son héroïne Noémie une faiblesse

MAD GOD
Film d’animation image par image réalisé durant trente longues années par un grand spécialiste des effets spéciaux, Mad God est une déambulation cauchemardesque dans l’esprit tourmenté d’un artiste à la fois acteur et victime des mutations de son médium.


Amoureux fou des films magiques de Georges Méliès, de Karel Zeman et de Ray Harryhausen, Phil Tippett fut l’un des grands artisans de la renaissance des effets spéciaux qui aboutit à la révolution numérique des années 1990. Déchiré entre ses amours de jeunesse et l’inévitable évolution de son art, Tippett souffrit d’une sévère dépression alors qu’il délaissait ses marionnettes pour concevoir les dinosaures numériques de Jurassic Park. Une dépression dont il s’extirpa en prenant à bras-le-
corps les nouveaux outils à sa disposition (il est notamment le créateur des hordes d’aliens de Starship Troopers ), mais aussi en se lançant dans un film d’animation au long cours. Ce projet, Mad God, est donc une œuvre thérapeutique dans laquelle Tippett a, en totale autarcie, compilé toutes les images qui hantaient ses rêves à l’aide de techniques majoritairement pré-numériques. C’est à la fois la force et la limite de ce film unique qui suit les déambulations d’un personnage mutique dans un grand fourre-tout post-apocalyptique. Conçu de façon erratique et sans structure narrative, Mad God est un film décousu et inégal. C’est aussi, et surtout, une œuvre habitée unique et un cri d’amour déchirant pour un cinéma d’un autre temps.
Une œuvre thérapeutique
mêlée d’opiniâtreté. Kelly Depeault tient le rôle de cette fille de 15 ans, qui s’enfuit du foyer dans lequel elle vit dans une perpétuelle colère incandescente. Après un trait d’union euphorique, la prostitution lui apparaît comme une issue. Lors du grand prix de Montréal, Noémie enchaîne les passes à une cadence industrielle orchestrée par son petit-ami, qui s’improvise mac dans sa version uberisée. La chambre d’hôtel impersonnelle, dans laquelle des dizaines d’hommes rejoignent successivement Noémie, laisse entendre les moteurs tout proches des courses automobiles, transformant les clients en chimères mi-mâles mi-mécaniques vrombissantes. Et, de fait, ils imposent leur masculinité comme une sexualité de la performance.
Geneviève Albert trouve le fragile équilibre pour ne pas se dérober à filmer les passes, mais sans dégrader son personnage féminin et surtout sans érotiser la prostitution.
74 Cinéma > Sorties du 29 mars au 3 mai no 196 – avril 2023
DUPUY
Mad God de Phil Tippett, Carlotta Films (1 h 24), sortie le 26 avril JULIEN
SORTIE LE 26 AVRIL
SORTIE LE 26 AVRIL
dans laquelle le cinéaste a compilé toutes les images qui hantaient ses rêves.
Noémie dit oui de Geneviève Albert, Wayna Pitch (1 h 56), sortie le 26 avril
RAPHAËLLE PIREYRE


AU CINÉMA LE 26 AVRIL
CALENDRIER DES SORTIES
MARS 29
Ailleurs si j’y suis de François Pirot UFO (1 h 43)

Alors que sa famille et son métier le mettent sous pression, Mathieu, sur un coup de tête, s’enfonce dans la forêt devant chez lui. Et y reste. Et s’il avait raison ?
Bonne conduite de Jonathan Barré Pan (1 h 35)
Pauline a une méthode bien à elle pour faire de la prévention routière : formatrice dans un centre de récupération de points le jour, elle se transforme en tueuse en série de chauffards la nuit.
Le capitaine Volkonogov s’est échappé de Natalia Merkoulova et Alexeï Tchoupov KinoVista (2 h 05)

lire p. 54
U.R.S.S., 1938. Joseph Staline opère des purges dans les rangs de ses partisans. Se sachant condamné, le capitaine Volkonogov s’échappe en vue de se confronter aux familles de ses victimes et d’obtenir leur pardon.
Grand Paris de Martin Jauvat JHR Films (1 h 11)

Leslie et Renard trouvent un mystérieux objet sur un chantier de la future ligne de métro du Grand Paris. Persuadés d’avoir trouvé la poule aux œufs d’or, ils mènent l’enquête.
Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry StudioCanal (1 h 58)
En France, la justice restaurative propose à des victimes et des auteurs d’infraction de dialoguer dans des dispositifs sécurisés, encadrés par des professionnels et des bénévoles.
The Lost King de Stephen Frears Pathé (1 h 49)


Philippa Langley, passionnée d’histoire, décide, malgré l’incompréhension de ses proches et la défiance du monde universitaire, de rétablir la vérité autour de Richard III.
Los reyes del mundo de Laura Mora Rezo Films (1 h 51)

lire
Le jeune Rá galère avec ses amis dans les rues de Medellin. Leur espoir renaît lorsque le gouvernement promet à Rá de récupérer un terrain duquel sa famille avait été chassée…
Sept hivers à Téhéran de Steffi Niederzoll Nour Films (1 h 37)

En 2007 à Téhéran, Reyhaneh Jabbari, 19 ans, tue l’homme sur le point de la violer. Elle est accusée de meurtre et condamnée à mort. Sa famille s’est ensuite battue pour la sauver.
Voyages en Italie de Sophie Letourneur Météore Films (1 h 31)

Une escapade romantique peut-elle raviver la flamme dans un couple ? Elle a réussi à le convaincre de partir quelques jours sans enfants. Lui a dit oui, tant que ce n’est pas en Italie.
AVRIL 05
About Kim Sohee de July Jung Arizona (2 h 17)

Une suite d’événements suspects survenus au sein d’une entreprise éveille l’attention des autorités locales. Chargée de l’enquête, une inspectrice est ébranlée par ce qu’elle découvre.
À mon seul désir de Lucie Borleteau Pyramide (1 h 57)
Vous n’avez jamais été dans un club de strip-tease ? Mais vous en avez déjà eu envie, au moins une fois, sans avoir osé franchir le pas. Ce film raconte l’histoire de quelqu’un qui a osé.

C’est mon homme de Guillaume Bureau Bac Films (1 h 27)




Julien Delaunay a disparu durant la Grande Guerre. Quand la presse publie le portrait d’un homme amnésique, sa femme le reconnaît. Mais une autre le réclame comme son mari.
Cœur errant de Leonardo Brzezicki Optimale (1 h 52)
Santiago, un père gay, déambule entre anciens amants, chemsex et plans à trois pour essayer de combler son manque affectif à la suite d’une rupture et du départ de sa fille du foyer.
L’Établi de Mathias Gokalp Le Pacte (1 h 57)

Après Mai-68, Robert, militant d’extrême gauche, décide de s’infiltrer chez Citroën pour raviver le feu révolutionnaire, mais les ouvriers ne veulent plus entendre parler de politique.
Kokon de Leonie Krippendorff

Outplay (1 h 35)
Premières amours et premiers déboires : Nora, berlinoise, cherche sa voie entre une mère absente et une grande sœur protectrice. Elle veut vivre, briser son cocon et prendre son envol.
Normale d’Olivier Babinet Haut et Court (1 h 27)
Lucie vit seule avec son père, qui lutte contre la sclérose en plaques. La visite d’une assistante sociale les force à redoubler d’inventivité pour donner l’illusion d’une vie normale.

76 no 196 – avril 2023 Cinéma > Sorties du 29 mars au 3 mai
lire
lire
lire
lire
p. 56 lire p. 30 lire p. 52
p. 40
p. 58
p. 58
p. 54
lire p. 50
lire p. 57 lire
lire p. 70
p. 56
Relaxe d’Audrey Ginestet Norte (1 h 32)
lire p. 60
Ce documentaire suit l’une des accusées à l’approche du procès de Tarnac, dans lequel neuf personnes sont accusées d’avoir participé à une entreprise terroriste pour des sabotages sur des lignes TGV.
Super Mario Bros
Le film





d’Aaron Horvath et Michael Jelenic

Universal Pictures (1 h 32)
Un film basé sur l’univers du célèbre jeu : Super Mario Bros.

Les Trois Mousquetaires
D’Artagnan de Martin Bourboulon Pathé (2 h 01)



Dans un royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, des hommes et des femmes vont croiser leur épée et lier leur destin à celui de la France.
AVRIL
Alma viva de Cristèle Alves Meira Tandem (1 h 28)
Comme chaque été, la petite Salomé retrouve le village familial, dans les montagnes portugaises. Mais sa grand-mère adorée meurt subitement, et Salomé est hantée par son esprit.
Les Âmes sœurs
d’André Téchiné

Ad Vitam (1 h 40)



David, lieutenant des forces françaises engagées au Mali, devient amnésique à la suite d’une explosion. On le rapatrie en France. Sa sœur tente de raviver sa mémoire, sans grand succès.
La Colline de Denis Gheerbrant et Lina Tsrimova

Les Films d’ici (1 h 18)
Sur une colline au cœur du Kirghizistan se trouve une déchetterie où, de jour comme de nuit, des hommes, des femmes et des enfants aux différents destins interrogent leur vie.
Dancing Pina de Florian Heinzen-Ziob Dulac (1 h 56)
lire p. 72

Ce documentaire suit de jeunes danseurs en Allemagne et au Sénégal qui, guidés par d’anciens membres du Tanztheater de Pina Bausch, revisitent ses chorégraphies légendaires.

Désordres de Cyril Schäublin Shellac (1 h 33)
lire p. 61

Dans une horlogerie suisse au xixe siècle, une jeune ouvrière fabrique le balancier, véritable cœur des mécanismes, et se mêle à un mouvement local d’horlogers anarchistes
Loup & chien de Cláudia Varejão Épicentre Films (1 h 51)



lire p. 62
Née sur une île religieuse, Ana embarque pour un voyage libérant de nouveaux désirs alors qu’elle rencontre la rayonnante Cloé et se lie d’amitié avec la communauté queer locale.
Le Prix du passage de Thierry Binisti Diaphana (1 h 40)
Natacha est une mère célibataire. Walid est un migrant qui souhaite rejoindre l’Angleterre. Tous les deux aux abois, ils improvisent une filière artisanale de passages clandestins.
The Quiet Girl de Colm Bairéad ASC (1 h 36)

Irlande, 1981, une jeune fille négligée par sa famille est envoyée vivre auprès de parents éloignés. Mais, dans cette maison en apparence sans secret, elle découvre une vérité douloureuse.
Une histoire d’amour
d’Alexis Michalik
Le Pacte (1 h 30)
Katia et Justine tombent amoureuses. Malgré la peur de l’engagement et le regard des autres, elles décident de faire un enfant, laissant le hasard décider de qui le portera.
Suzume de Makoto Shinkai Eurozoom (2 h 02)

EP 7 TITRES DISPONIBLE INCLUS LES SINGLES
« Superbe clip cinématographique »

lire p. 62
Dans une petite ville paisible de Kyushu, une jeune fille de 17 ans, Suzume, rencontre un homme qui dit voyager afin de chercher une porte. Elle décide de le suivre et entame un périple.
« A dark tale of smartphone culture, (…) a unique video! »

77 Sorties du 29 mars au 3 mai <---- Cinéma
lire p. 6 lire p. 60
12 avril 2023 – no 196
Avant l’effondrement d’Alice Zeniter et Benoît Volnais Pyramide (1 h 40)
Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles de Chantal Akerman

Capricci Films (3 h 18)
Le quotidien d’une mère de famille qui se livre occasionnellement à la prostitution.
lire p. 64
Tristan, directeur de campagne d’une candidate aux législatives, reçoit un courrier anonyme contenant un test de grossesse positif. Est-ce une blague morbide, ou une manœuvre politique ?
Blue Jean de Georgia Oakley UFO (1 h 37)
lire p. 64
1988, en Angleterre, Jean, professeure d’éducation physique, est obligée de cacher son homosexualité. C’est sans compter sur une nouvelle étudiante qui menace de révéler son secret…
Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand Bac Films (1 h 33)

Dog et Mirales sont amis d’enfance. Leur amitié va être mise à mal par l’arrivée au village d’une jeune fille, Elsa, avec qui Dog va vivre une histoire d’amour.
La Conférence de Matti Geschonneck Condor (1 h 48)

Au matin du 20 janvier 1942, quinze dignitaires du IIIe Reich doivent se mettre d’accord avant midi sur un plan d’élimination du peuple juif, appelé « solution finale ».
La Dernière Reine de Damien Ounouri et Adila Bendimerad Jour2fête (1 h 53)
Algérie, 1516. Entre histoire et légende, le parcours de la reine Zaphira raconte un combat, des bouleversements personnels et politiques endurés pour le bien d’Alger.

Habib
La grande aventure de Benoît Mariage KMBO (1 h 28)
Habib rêve de faire du cinéma. Un jour, il décroche un petit rôle de gigolo aux côtés de Catherine Deneuve. C’est le début de la grande aventure, mais aussi le début des problèmes…
lire p. 46
La Plus Belle pour aller danser de Victoria Bedos Universal Pictures (1 h 32)


Marie-Luce, 14 ans, se rend à la soirée du collège habillée en homme. On la prend pour un garçon, que l’on regarde et qui plait. Elle décide alors de s’inventer un double masculin prénommé Léo.
Remorques de Jean Grémillon
Carlotta Films (1 h 30)
lire p. 68
André Laurent, capitaine d’un remorqueur, tombe follement amoureux de Catherine, l’épouse du commandant, tandis que sa femme lui dissimule sa maladie et le supplie de prendre sa retraite.

Sur l’Adamant de Nicolas Philibert
Les Films du Losange (1 h 49)







lire p. 72
L’Adamant, bâtiment flottant édifié sur la Seine, accueille des adultes souffrant de troubles psychiques en leur offrant un cadre de soins et en les aidant ainsi à retrouver un peu d’élan.

La Vie pour de vrai de Dany Boon Pathé (1 h 50)
Tridan Lagache a passé sa vie dans un Club Med mexicain. À 50 ans, il démissionne du club de vacances, bien décidé à retrouver, quarante-deux ans plus tard à Paris, son grand amour d’enfance, Violette.
AVRIL 26
L’Amitié d’Alain Cavalier Tamasa (2 h 04)
lire p. 38
« J’ai intensément partagé le travail cinématographique avec certains, jusqu’à une amitié toujours vive. Filmer aujourd’hui ce lien sentimental est un plaisir sans nostalgie. » Alain Cavalier
Beau Is Afraid d’Ari Aster ARP Sélection (2 h 59)
Beau tente désespérément de rejoindre sa mère. Mais l’univers semble se liguer contre lui…
La Belle Ville de Manon Turina et François Marques Jour2fête (1 h 25)
Ce documentaire propose une vision de la belle ville de demain, à travers la rencontre, aux quatre coins du monde, de personnes ordinaires aux initiatives révolutionnaires.


Burning Days

d’Emin Alper Memento (2 h 08)
lire p. 68
Un jeune procureur turc déterminé et inflexible se heurte aux notables locaux bien décidés à défendre leurs privilèges par tous les moyens, même les plus extrêmes.
Dirty, Difficult, Dangerous de Wissam Charaf JHR Films (1h 23)

Ahmed, réfugié syrien, espérait trouver l’amour en Mehdia, une femme de ménage éthiopienne. Mais, à Beyrouth, cela semble impossible…

Le Jeune Imam de Kim Chapiron Le Pacte (1 h 38)
Amel et les fauves de Mehdi Hmili
La Vingt-Cinquième Heure (2 h 02)
Un homme tente d’abuser d’Amel, une ouvrière tunisienne. La police les surprend, mais c’est Amel qui est finalement déclarée coupable d’attentat à la pudeur et d’adultère.
lire p. 66
Au Mali, Ali devient l’imam d’une cité. Adulé de tous et poussé par ses succès, il décide d’aider les fidèles à réaliser le rêve de tout musulman : faire le pèlerinage à La Mecque.
Hokusai de Hajime Hashimoto
Art House (1 h 30)
Japon, xviiie siècle. Alors qu’une censure règne sur le travail des artistes, personne n’imagine que le jeune Shunrō deviendra Hokusai, célèbre auteur de La Grande Vague de Kanagawa.
78 no 196 – avril 2023 Cinéma > Sorties du 29 mars au 3 mai
AVRIL 19
lire p. 36
Carlotta Films (1 h 24)

lire p. 74
Une plongée dans les bas-fonds d’un monde en ruines où l’on suit L’Assassin. Ses sombres desseins se perdent dans un labyrinthe de paysages étranges, repaire d’une faune inquiétante.
Misanthrope de Damián Szifron Metropolitan FilmExport (1 h 59)

Eleonor, jeune policière perturbée, est recrutée pour aider le FBI à traquer une tueuse en série.
Noémie dit oui de Geneviève Albert Wayna Pitch (1 h 56)
lire p. 74
Noémie, 15 ans, fugue d’un centre de protection de l’enfance. Sa copine Léa lui présente une bande de délinquants, parmi lesquels Zach, qui lui propose d’être escort-girl le temps d’un week-end.

Quand tu seras grand d‘Andrea Bescond et Éric Métayer Ad Vitam (1 h 39)

Le réfectoire d’un EHPAD doit être partagé avec une classe d’enfants. Leur arrivée ainsi que celle de son animatrice, Aude, va bousculer le quotidien de tous et surtout des résidents…
Nos cérémonies de Simon Rieth
The Jokers / Les Bookmakers (1 h 44)
Royan, 2011. Deux frères, Tony et Noé, jouent au jeu de la mort et du hasard, jusqu’à l’accident qui changera leur vie à jamais. Désormais adultes, ils continuent de cacher un secret…
La Gravité de Cédric Ido

Alba Films / Trésor Cinéma (1 h 26)


Un alignement des planètes embrase le ciel et inquiète tous les habitants d’une cité. Une bande d’adolescents voit cet événement planétaire comme la possibilité d’une nouvelle ère…
Showing Up de Kelly Reichardt Diaphana (1 h 48)



Avant le vernissage de son exposition, le quotidien d’une artiste et son rapport aux autres, le chaos de sa vie va devenir sa source d’inspiration…
Stars at Noon de Claire Denis Ad Vitam (2 h 17)

Une journaliste américaine en détresse, bloquée sans passeport au Nicaragua en pleine période électorale, rencontre un Anglais qui lui semble être l’homme rêvé pour l’aider à fuir le pays.
Temps mort d’Ève Duchemin
Pyramide (1 h 58)
Pour la première fois depuis longtemps, trois détenus se voient accorder une permission d’un week-end. Quarante-huit heures pour atterrir, renouer avec leurs proches et tenter de rattraper le temps perdu.
Les
Âmes
perdues
de Stéphane Malterre et Garance Le Caisne Dulac (1 h 44)
Ce documentaire suit les rebondissements d’enquêtes et de procédures à la suite d’une divulgation en 2014, de milliers de photos des victimes du régime syrien, morts sous la torture.

Disco Boy de Giacomo Abbruzzese KMBO (1 h 31)

Trenque
Capricci Films (2 h, 2 h)
Une femme disparaît. Deux hommes partent à sa recherche aux alentours de la ville de Trenque Lauquen, en Argentine, et découvrent alors des circonstances plus étranges que prévu.
lire p. 28
Dans la jungle du Niger, Aleksey, un légionnaire biélorusse, et Jomo, un jeune révolutionnaire, croisent leurs rêves et leur destin.
79 Sorties du 29 mars au 3 mai <---- Cinéma
Mad God de Phil Tippett
avril 2023 – no 196
lire p. 48
lire p. 70
03
lire p. 42
MAI
Lauquen I & II de Laura Citarella
Synopsis officiels
CULTURE
Expos
« Au-delà », « Avant l’orage », « Exposé·es »… En ce début de printemps, les expositions collectives ont le vent en poupe. Rituels occultes, sanctuarisation de la nature, déconstruction du genre ou obsolescence de l’humanité : l’art y reflète le changement d’ère et un désir de réinvention du monde, toutes générations confondues.
Ça ne s’arrête plus ! En l’espace de quelques années, et en dépit de l’effondrement brutal du marché durant la crise du Covid-19, tout le monde s’accorde à dire que Paris est redevenu le centre de gravité du monde de
des cartes : les monographies patrimoniales sont à la traîne, tandis que les expositions collectives fleurissent comme des boutons d’or au printemps. Transdisciplinaires et transhistoriques, elles se présentent comme des vitrines de la création contemporaine, tout en exhumant des œuvres issues de collections privées.

CHAUDRON MAGIQUE
De mars à septembre, c’est une véritable corne d’abondance. Sous la direction artistique de Rebecca Lamarche-Vadel, l’exposition « Au-delà » se déploie sur les trois niveaux de la fondation Lafayette Anticipations, transformée en chaudron magique où résonnent les bourdons d’orgue de la compositrice américaine Kali Malone. Sous-titrée « rituels pour un autre monde » et se présentant comme « un voyage qui invite à la métamorphose », elle rassemble des artistes de toutes générations et de toutes obédiences. Du rituel païen au culte vaudou, l’exposition englobe d’un seul tenant l’archaïque et le
l’art. La célèbre foire Art Basel s’y est même délocalisée (avec Paris+), se substituant à la FIAC et pulvérisant tous les records de chiffre d’affaires lors de sa première édition en 2022. Conséquences de ce rebattage
contemporain, et aligne côte à côte vestiges archéologiques et pièces contemporaines réalisées in situ. Les végétaux cristallisés de Bianca Bondi et les armures de textile de Jeanne Vicerial y avoisinent une pein-
ture de Wifredo Lam, un rituel filmé d’Ana Mendieta ou une stèle punique. Un étage plus haut, les piliers de résine d’Eva Hesse côtoient une sculpture cronenbergienne d’Ivana Bašić et les captations vidéo des cérémoniaux de Romeo Castellucci. Certaines pièces, splendides, pâtissent néanmoins un peu de la scénographie, dont la théâtralité – drone, pénombre et solennité emphatique – résiste mal à la configuration du lieu. À quelques foulées de là, la Bourse de Commerce s’attache au déclin de l’humanité à l’âge du « capitalocène ». « Avant l’orage » accueille sous son dôme les sublimes installations de Danh Vō, Tacita Dean, Pierre Huyghe, Diana Thater ou Hicham Berrada, puisées par Emma Lavigne dans la collection Pinault. La prise de conscience du dérèglement climatique y prend les atours d’une beauté tragique, où l’on contemple entre émerveillement et effroi des troncs d’arbres, prisonniers d’un échafaud de bois, un singe à masque humain livré à lui-même dans la zone contaminée de Fukushima, des paysages de précipités chimiques en transformation perpétuelle ou de majestueuses volutes de fumée accomplies à la craie sur un tableau noir. Tout aussi sidérants, les immenses panneaux tachés de jaune de Cy Twombly livrent une interprétation de la rotation du Soleil, en hommage aux dieux de la Grèce antique. Il règne sous la rotonde une étrange sérénité de fin du monde, où la menace est d’autant plus prégnante qu’elle demeure invisible. Nul doute que le philosophe Gaston Bachelard, source d’inspiration pour maints plasticiens et maintes plasticiennes, aurait apporté des réponses métaphysiques à cette résurgence de motifs eschatologiques. Pour les soixante ans de sa disparition, agnès b. lui consacre précisément un hommage, à travers une sélection d’œuvres de sa collection. Les jeunes pousses (Emma Charrin, Caroline Corbasson, Adrien Degioanni…) y côtoient
des artistes plus établis, donnant corps à sa « poétique de l’espace » ou à sa « psychanalyse du feu ». Une fois avoir célébré la messe noire et s’être offert le frisson d’un monde sans humains, on peut s’offrir un détour par le Mac/Val de Vitry-surSeine. C’est là que l’exposition « Histoires vraies » ouvre ses portes et poursuit les questionnements sur l’identité déjà soulevés avec « Lignes de vies » en 2019. Pour ce deuxième volet, la fiction et l’onirisme empiètent sur le réel et génèrent des récits joyeusement excentriques – des films Super 8 de Marie Losier aux installations de Jean-Charles de Quillacq, en passant par les contes fantastiques d’Alice Brygo ou les entités spectrales de SMITH. Orchestré par Frank Lamy, ce raout collectif témoigne notamment de la vitalité de l’esthétique camp, kitsch et tapageuse. L’exposition est foisonnante et offre un généreux espace d’expression à des artistes émergents, au risque que les œuvres s’entredévorent à force de saturation.

CORPS COLLECTIF
Au Palais de Tokyo se fait jour une proposition bouleversante, aux enjeux viscéralement politiques : « Exposé·es ». Face à l’épidémie de sida dans les années 1980-1990, le militantisme n’est pas un choix mais un acte de survie. Conçue par François Piron à partir du livre Ce que le sida m’a fait. Art et activisme à la fin du xxe siècle de l’écrivaine et critique d’art Élisabeth Lebovici, l’exposition réunit de grandes figures de la lutte contre le sida : Nan Goldin, Felix González-Torres, Hervé Guibert, Guillaume Dustan, David Wojnarowicz, Jesse Darling, Derek Jarman ou encore le collectif de lesbiennes- activistes Fierce Pussy. Mon-


80 Culture no 196 – avril-2023
L’activisme et la pratique artistique sont indéfectiblement liés.
Gwendoline Robin, Cratère no 6899, 2016, dans l’exposition « Bachelard contemporain »
Danh Vō, Tropeaolum, 2023, dans l’exposition « Avant l’orage »
James Nares, Desirium Probe, 24 janvier 1978, dans l’exposition « Who You Staring At? »
Anne Brégeaut, Mes insomnies 34, 2022, dans l’exposition « Histoires vraies »
trées ainsi d’un seul tenant, les œuvres forment un chœur autant qu’un corps collectif, et ravivent la flamme d’un art offensif dont on ressent plus que jamais le besoin. La colère et l’urgence restent aujourd’hui intactes, démontrant que l’activisme et la pratique artistique sont indéfectiblement liés. Même constat en traversant l’exposition « Who You Staring At? » au Centre Pompidou, qui revient sur une période fertile de l’avant-garde newyorkaise et invite à se pencher sur le courant no-wave des années 1970-1980, versant radical et conceptuel du mouvement punk. En rupture avec les circuits de l’art contemporain et de l’industrie musicale, sa posture dilettante continue de faire des émules.
« Au-delà. Rituels pour un nouveau monde », jusqu’au 7 mai à Lafayette Anticipations
•
« Avant l’orage », jusqu’au 11 septembre à la Bourse de Commerce
– Pinault Collection


•
« Bachelard contemporain », jusqu’au 30 avril à La Fab.
•
« Exposé es », jusqu’au 14 mai au Palais de Tokyo
•
« Histoires vraies », jusqu’au 17 septembre au Mac/Val (Vitry-sur-Seine)

•
« Who You Staring At? », jusqu’au 1er mai au Centre Pompidou
81 Culture avril-2023 – no 196
BELL T
• JULIEN BÉCOURT
© J. De La Torre Castro ; © Photo Marcia Resnick ; © Tadao Ando Architect & Associates, Niney et Marca Architectes, agence Pierre-Antoine Gatier. Photo : Aurélien Mole. Courtesy Pinault Collection ; © Adagp, Paris 2023 ; Courtesy AIDS and Society Research Unit (University of Cape Town) et Bambanani Women’s Group
Nondumiso Hwlele (Bambanani Women’s Group), Body Map, 2002, dans l’exposition « Exposé·es »
SÉLECTION CULTURE
Expos
L’ARGENT DANS L’ART
BASQUIAT SOUNDTRACKS

ZANELE MUHOLI
La Monnaie de Paris accueille l’exposition « L’Argent dans l’art », un comble ! Quelque deux cents œuvres d’art, dont celles d’Auguste Renoir, d’Edgar Degas ou d’Andy Warhol, ainsi qu’une sélection de films permettent de décrypter la corrélation entre argent et artistes, intriqués depuis l’Antiquité. • Clémence Dubrana Rolin > jusqu’au 24 septembre à la Monnaie de Paris
On lie Jean-Michel Basquiat à la peinture, aux esquisses et aux couleurs. Mais il y a aussi eu la musique, notamment le jazz, dans la vie du New-Yorkais. Pour explorer cette relation, la Philharmonie dévoile une centaine d’œuvres de l’artiste, ainsi que des archives rares, le tout accompagné d’une bande-son éclatante. • C. D. R. > du 6 avril au 30 juillet à la Philharmonie de Paris

FABRICE HYBER. LA VALLÉE
Les salles de classe vous manquent ? Fabrice Hyber y remédie en proposant une déambulation artistique dans des salles qui ravivent des souvenirs. Ici, on s’assoit sur une chaise d’écolier non pas pour écouter le maître, mais pour regarder une soixantaine de ses tableaux sur la forêt qui elle aussi a tant à nous apprendre. • C. D. R. > jusqu’au 30 avril à la Fondation Cartier pour l’art contemporain



Soleils brillants de la jeunesse
Roman autobiographique de cet auteur qui a subi un accident de vélo et en a été blessé à vie, ce livre raconte l’éveil vers la déviance et la perversité d’un gamin rêveur qui s’imagine dans le donjon d’un roman victorien. En plus d’être l’un des livres préférés de Waters, c’est l’une des plus grandes influences de William S. Burroughs. • Q. G.

> de Denton Welch (1945 ; Viviane Hamy, 1997)
La Disparition
Deux femmes mariées très bien mises de l’upper class américaine font vriller les conventions, l’une tombant amoureuse d’une prostituée, et l’autre d’un clochard. On reconnaît là le goût du cinéaste pour les bourgeoises ou les mères de famille détraquées, comme la Francine de Polyester, ou la Beverly de Serial Mom. • Quentin Grosset
> de Jane Bowles (1943 ; Gallimard, 1969)
« J’ai beaucoup de respect pour lui », nous a dit John Waters à propos de Georges Pérec. Et pour cause : tout son roman La Disparition est écrit sans la lettre e. Le choix extrême de chaque mot amène alors le romancier dans des directions sens dessus dessous. Une coquetterie aussi chic qu’absurde. • Q. G.
> de Georges Pérec (Denoël, 1969)
Le travail photographique de Zanele Muholi est présenté pour la première fois en France. L’occasion de découvrir une œuvre engagée et intimiste, au cœur des populations noires LGBTQ d’Afrique du Sud.

Puissants, chaleureux, apaisants, les clichés de Zanele Muholi dévoilent un univers intimiste quasi exclusivement peuplé de sujets noirs. Photographe et activiste non binaire originaire d’Afrique du Sud, artiste reconnu sur la scène internationale, Muholi fait l’objet pour la toute première fois d’une rétrospective en France. Cette exposition de plus de deux cents photos nous plonge avec grâce au sein des communautés noires LGBTQ sud-africaines. Dans ce pays marqué par l’apartheid, un régime politique instauré en 1948 qui brutalisait les personnes noires et les excluait de la société, Muholi documente plus spécifiquement les vécus des per-
Spectacles
Une mer de plastique qui redessine le paysage, contamine les corps, monstre rampant et volant fait de milliers de sacs de couleur. Cette entité, inquiétante et fascinante, est à la fois décor et costume du dernier spectacle de Tidiani N’Diaye, qui prend la forme d’un ballet manifeste écologique. • Belinda Mathieu

> Mer plastique de Tidiani N’Diaye, les 20 et 21 avril au Théâtre de la Cité internationale (1 h)


sonnes LGBTQ à partir des années 2000. Si l’apartheid a été aboli en 1994 et si la nouvelle constitution, promulguée en 1996, condamne les discriminations liées à l’orientation sexuelle, les populations marginalisées restent la cible de crimes de haine. Enterrements, viols… Certains sujets traités sont particulièrement durs, mais le regard politique et bienveillant de Zanele Muholi nous offre des clichés sensibles, loin de la surenchère dramatique. Profondément empathique et engagé, son travail est mis à l’honneur dans une médiation claire, en écriture inclusive, mêlant explications artistiques, définitions lexicales et informations historiques. On en ressort touchés mais aussi réparés, et c’est bien là le cœur de cette belle rétrospective : nous rendre la fierté d’être qui l’on est. • Hanneli Victoire > jusqu’au 21 mai à la Maison européenne de la photographie
Elle incarne une série de personnages, d’Angela Merkel qui porte d’énormes rochers sur la tête à un hydrothérapeute canin, dans cette enquête décalée sur un meurtre dans un centre de thalasso. La circassienne Vimala Pons déploie un monde pop étrange fait de confusion et de métamorphoses. • B. M.
> Le Périmètre de Denver de Vimala Pons, du 12 au 23 avril au Centre Pompidou (1 h 30)
82 Culture no 196 – avril-2023
La sélection livres par
Gagnez des places en suivant TROISCOULEURS sur Facebook et Instagram
N’DIAYE
TIDIANI
VIMALA PONS
Philippe Halsman, Dalí, Why Do You Paint?
Because I Love Art, 1954
© Philippe Halsman Estate 2023, Image rights of Salvador Dalí reserved, Fundació Gala –Salvador Dalí
Jean-Michel Basquiat, Toxic, 1984,
Vue de l’exposition © Cyril Marcilhacy –Lumento
Fondation Louis Vuitton, Paris © Estate of Jean-Michel Basquiat. Licensed by Artestar, New York
Zanele Muholi, Sebenzile, Parktown, 2016 Courtesy of the artist and Stevenson, Cape Town/Johannesburg and Yancey Richardson, New York
© Zanele Muholi
© Dorothée
© Makoto Chill Ôkubo
Zanele Muholi, Katlego Mashiloane and Nosipho Lavuta, Ext. 2, Lakeside, Johannesburg, 2007 Courtesy of the artist and Stevenson, Cape Town/Johannesburg and Yancey Richardson, New York © Zanele Muholi
Thébert
Deux dames sérieuses
La sélection musique par
Aretha Franklin
Chet Baker

Nino Rota
John Waters était dans le public des concerts d’Aretha Franklin au Fillmore West, célèbre salle de San Francisco, en mars 1971. La géniale chanteuse souhaitait alors toucher le public hippie en reprenant certains de leurs hymnes et des morceaux des Beatles. Bizarre, car le cinéaste détestait les hippies – mais la voix d’Aretha permet de dépasser tous les a priori. • Quentin Grosset
> Aretha Live at Fillmore West (Atlantic, 1971)

Jeu vidéo
Dans son livre Monsieur Je-Sais-Tout (Actes Sud, 2021), John Waters nous explique : « Si vous êtes un junkie, le jazz est fait pour vous. Le be-bop est le son de l’héroïne, pas vrai ? Tout simplement. Tous les maîtres du jazz que j’ai aimés étaient des toxicomanes. » Et de citer Chet Baker, dont le pianiste Hal Galper définissait le style comme « le junkie beat ». • Q. G.

> Chet (Riverside, 1959)
Dans sa jeunesse, John Waters écoutait toujours la B.O. de 8 ½ (1963) de Federico Fellini, composée par Nino Rota, alors qu’il était sous LSD avec la bande des Dreamlanders. Le côté fanfare de la musique qui accompagne les visions folles du personnage de cinéaste désabusé joué par l’acteur italien Marcello Mastroianni devait les mettre dans des états bien high. • Q. G.
> Federico Fellini’s 8 ½ (RCA, 1963)
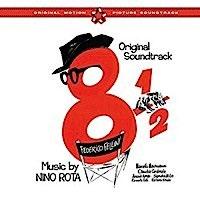
SEASON. A LETTER TO THE FUTURE
Développé par un petit studio québécois, ce jeu d’exploration à vélo fait de l’apocalypse une étonnante matière poétique.

Alors que j’arpente à vélo les chemins d’une superbe vallée, un champ de blé aux reflets d’or m’émerveille au point que je sors mon Polaroid pour l’immortaliser.
BD
Disparaître sans laisser de traces, littéralement, en pleine forêt. Dans un récit où les sens éclatent à chaque planche, la nouvelle création de Xavier Mussat sidère de page en page.
Si l’époque favorise les histoires dans lesquelles se mêlent écologie et retour à la nature, rares sont celles qui se vivent au niveau, mêlé, des sensations. Xavier
Plus loin, les trilles mélodieux d’un oiseau me poussent à faire de même avec mon magnétophone. Ces souvenirs sont consignés dans un journal de bord que je compose au fil de mes flâneries. Mais les apparences sont trompeuses : ce monde, si beau et si serein, est appelé à disparaître, et je suis son dernier témoin. Season. A Letter to the Future nous met dans la peau d’Estelle, jeune habitante d’un univers au rituel implacable : chaque changement de saison signifie la fin du monde en place, avant sa renaissance sous une autre forme. Notre rôle : capturer, sous forme de photos, de croquis, d’extraits sonores, tous les vestiges qu’elle trouve en chemin, afin
LES PISTES INVISIBLES
Mussat, auteur de l’inoubliable Carnation, paru chez Casterman en 2014, s’approprie un fait divers oublié : un homme, Christopher Thomas Knight, a disparu entre 1986 et 2013 ; il vivait en fait dans les forêts du Maine, sans laisser de traces. Partant de cette ligne narrative, Mussat s’engouffre dans un travail graphique inouï. Au lieu de s’intéresser, narrativement et visuellement, à une sorte de reconstitution de la vie de cet homme, il décide de se confronter à tous les points de fuite possibles : c’est-àdire aux pistes invisibles laissées par les sensations, les multiples expériences sensorielles qui traversent cet homme pendant sa vie effacée, perdu au milieu des arbres. Le résultat, en bichromie

de les transmettre aux générations suivantes. Libre à nous de nous balader à vélo dans ce petit monde ouvert, de sélectionner les artefacts qui nous plaisent et de composer nos pages à la façon d’un scrapbooking virtuel. Si le jeu bouleverse, c’est d’abord par son rejet du cliché post-apocalyptique, ici remplacé par une sérénité aussi visuelle qu’atmosphérique ; mais aussi par son immédiateté à faire nôtre cette quête existentielle. Face à la catastrophe imminente, notre seule raison d’être devient la sauvegarde d’une civilisation, par des bribes qui sont d’abord le reflet de notre propre monde intérieur. • Camille Dumas > (Scavengers Studio | PC, PS4, PS5)
MAUD LE PLADEC
COUNTING STARS WITH YOU (MUSIQUES FEMMES)

Artiste majeure de la scène chorégraphique, Maud Le Pladec signe une œuvre puissante dédiée aux femmes compositrices.
serrée, est tout simplement saisissant. En suivant les pensées du personnage, son avancée lente, profonde, dans la forêt, ses petits vols dans des résidences secondaires parfois inhabitées, ses souvenirs confus de sa vie passée, Xavier Mussat nous invite à contempler, page après page, la tablature sensorielle du narrateur. Effleurements, sons alentour, couleurs matinales, mirages dans les roches : chaque planche compose et décompose la vie intérieure de cet homme en fuite. Et, in fine, on croit ressentir une forme de réconfort. Mieux : le bruissement d’une invitation à suivre cette piste. • Adrien Genoudet > de Xavier Mussat (Albin Michel, 176 p., 29,90 €)
83 Culture avril-2023 – no 196
La Société Publique Locale Le CARREAU DU TEMPLE », N°SIRET 789 772 571 00020 APE 9103 Z, N° licences n° 1 1068243, n°2 1068240, n°3 1068241 Bermudas © Andrea Macchia Scènes étranges dans mine d’or © Studio Pantom 6 • Graphisme Et d’eau fraîche RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION SUR WWW.LECARREAUDUTEMPLE.EU LE CARREAU DU TEMPLE EST UN ÉTABLISSEMENT CULTUREL ET SPORTIF DE LA VILLE DE PARIS. 14 & 15 AVRIL
Chaque semaine, une sélection de films en streaming sur mk2curiosity.com



MK2 CURIOSITY SE RÉINVENTE
La plateforme vidéo de mk2 (qui édite ce magazine) fait sa révolution et devient un vrai « club-ciné ». En plus des trois films gratuits par semaine, place à une offre de plus de quatre cents films, choisis par les journalistes et les programmateurs du groupe.
Pour inaugurer la toute nouvelle formule de mk2 Curiosity lancée début mars, Alain Chabat est venu présenter Hamburger Film Sandwich de John Landis, un de ses films de chevet, au mk2 Bibliothèque. Un long métrage à sketchs déjanté qui fait partie des quelque quatre cents films du monde entier désormais disponibles sur la plateforme. Agnès Varda, Xavier Dolan, François Truffaut, Abbas Kiarostami, Hong Sang-soo, Laura Poitras, George A. Romero… les plus beaux noms du catalogue mk2 côtoient les films de distributeurs indépendants tels que Carlotta Films, Art House, UniversCiné et bien d’autres. Au-delà des trois films gratuits par semaine dont vous avez l’habitude depuis le lancement de mk2 Curiosity il y a trois ans, vous avez désormais accès à une nouvelle offre de S.V.o.D. premium qui vous permet de visionner des centaines
Conférences, débats et cinéma clubs
LA NATURE N’EST-ELLE PAS DÉJÀ TROP HUMANISÉE ?
Après son autopsie des occasions perdues de lutter contre le changement climatique dans Perdre la Terre, le journaliste américain Nathaniel Rich (lire p. II), qui publie son nouveau livre Un monde dénaturé (Éditions du sous-sol), se demande non plus comment retrouver le monde que nous avons perdu, mais comment trouver celui dans lequel nous souhaitons vivre.
> le 3 avril, au mk2 Bibliothèque à 20 h

RENCONTRE AVEC UNE ICÔNE LITTÉRAIRE, HÉLÈNE CIXOUS
Dramaturge et écrivaine, Hélène Cixous est l’autrice d’une œuvre inclassable qui explore la mémoire familiale, l’exil et les questionnements de son temps : féminismes, genres, identités. Elle revient, le temps d’une soirée, sur ses séminaires philosophiques et ses deux dernières fictions : Ruines bien rangées (Gallimard) et Mdeilmm (Gallimard).
> le 6 avril au mk2 Odéon (côté St Michel) à 20 h
de films, de documentaires, de courts métrages… Toutes ces propositions de cinéma sont accompagnées de nombreux articles, d’interviews, de textes et de vidéos, et d’une newsletter hebdomadaire pensée comme un journal de cinéma. L’abonnement de 5,99 euros par mois sans engagement (2,99 euros jusqu’au 1 er juin) donne par ailleurs accès à des événements exclusifs pour les membres du club, des ciné-clubs en salles et d’autres avantages. À partir du 30 mars, vous pourrez par exemple regarder gratuitement le machiavélique Merci pour le chocolat de Claude Chabrol avec la géniale Isabelle Huppert, ou encore le drolatique court métrage Le Marin masqué de l’impudente Sophie Letourneur, invitée de mk2 Curiosity à l’occasion de la sortie de son nouveau long métrage, Voyages en Italie (lire p. 40). Une programmation événement autour de la figure de la bad girl, avant un grand rendez-vous avec Nicolas Philibert qui proposera plusieurs de ses courts métrages pour célébrer la sortie en salles de Sur l’Adamant (lire p. 72), sacré Ours d’or à Berlin en février. • TRISTAN BROSSAT > mk2 Curiosity, 2,99 € par mois sans engagement jusqu’au 1er juin, 5,99 € par mois ensuite²

Retrouvez tout le catalogue mk2 Curiosity ici :

SUR LES TRACES DE SALMAN RUSHDIE
Trente-quatre ans après la parution des Versets sataniques, Salman Rushdie continue de vivre sous la menace d’une fatwa. Que s’est-il passé d’irrévocable avec ce roman pour que les vengeurs de la divinité outragée s’autorisent à frapper sans relâche ? Une discussion avec Fethi Benslama, psychanalyse et essayiste, auteur du Sacrifice de Rushdie (Seuil).
> le 13 avril au mk2 Bibliothèque à 19 h 30
Retrouvez toute la programmation de mk2 Institut ici :

84 no 196 – avril-2023 Les actus mk2
ABONNEZ-VOUS DU 5 AVRIL AU 9 MAI 2023*

D’ENGAGEMENT 3 MOIS & FRAIS D’ADHÉSION
OFFERTS



UGC ILLIMITÉ UGC ILLIMITÉ UGC ILLIMITÉ UGC ILLIMITÉ UGC ILLIMITÉ UGC ILLIMITÉ UGC
UGC ILLIMITÉ * Offre valable pour tout abonnement UGC Illimité souscrit du 05/04/2023 au 09/05/2023. 3 mois d’engagement au lieu de 12 mois, sous réserve de résiliation avant le 20e jour du 3e mois complet de l’abonnement. Voir conditions de l’offre sur ugc.fr ou en flashant le QR code ci-dessus.
ILLIMITÉ UGC ILLIMITÉ
FLASHEZ-MOI POUR PLUS D’INFOS UGC CINÉ CITÉ –RCS de Nanterre 347.806.00224 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine –Capital social 12.325.016€Imprimeur HighCoEDITING
Page jeux

LES MOTS CROISÉS par Anaëlle Imber t - ©Les Mots, la Muse
Les mots croisés ciné
Ce mois-ci, c’est évidemment le réalisateur américain John Waters, roi incontesté du mauvais goût qui orne notre couverture (lire p. 18), que l’on célèbre dans notre grille de mots croisés.



HORIZONTALEMENT 1. Salle d’opération. Entre trois et quatre. 2. Souvent sur les dents. Fait un article. Possessif. Siffla. 3. Climat chaud et humide. Dans ce film de 1990, John Waters offre au jeune Johnny Depp l’un de ses premiers rôles au cinéma. 4. Drag-queen iconique du cinéma de Waters incarnée par Harris Glenn Milstead. Coupai court. Peut être n’importe qui. 5. Découpés sur le bord. Affaires de mœurs. Fait le fier. 6. Arbre tropical. Dans l’obscurité. Ça pour une surprise ! Situé. 7. Sciencefiction. Queue de poulpe. 8. Nouer. Pourrir. 9. Adoré même s’il cognait ! Journal ou télévision. Musée new-yorkais ayant inclus Pink Flamingos dans sa collection permanente. 10. Bouleversée. Sport collectif. 11. Attache. Obtenue. Ferment l’abbaye. Le mou de la ficelle. 12. Le premier d’une longue série. Qualificatif parfait pour le trublion du Maryland. 13. Endroit de passage. Milieu de gamme. Tout va bien ! Erbium. 14. Désordre très familier. Ville natale du cinéaste, dans laquelle il a tourné la plupart de ses films. 15. Ouest-sud-nord. Dont les pages sont numérotées. 16. Du cœur au rein. C’est un drame au Japon ! Rayon de lumière. 17. Do usé. Somme qui est en reste. Vite au cœur. À la mode. 18. Œuvre de 1974 participant à façonner la renommée de Waters en tant qu’artiste trash et underground. 19. Déchets organiques. 20. Planter. 21. Dans le plus simple appareil. Espèce disparue. 22. Il a sa clef. Elle emportait nos ancêtres. 23. Apparus. Vaut trois points. 24. Se trouve à la réception. En outre.
VERTICALEMENT A. Bijou sans valeur. B. Donne de la fièvre. Mises en route. C. Enjolivées. Parcouru à nouveau. Bovin. Mot d’enfant. D. Pamphlet aussi violent qu’outrageant marquant le début de la reconnaissance pour le réalisateur. Il est personnel et réfléchi. Il relève ce qui est plat. E. Connue pour son huile. Son drapeau est étoilé. Finit dépouillée. Les nôtres. F. Film sorti en 2000, avec Melanie Griffith pour tête d’affiche. Un aller dans le futur. Sans valeur. G. Cancres. Après le do. Disque court. Sacrément préféré ! H. Article défini. Équipe fidèle de collaborateurs avec laquelle Waters a tourné ses films. I. Avant un joint. Point bariolé. Dégustée. J. Peuvent être de vrais navets. Préfixe multiplicateur. Ancienne unité de centrale. K. Pris au sérieux. Qui laissent bouche bée. L. John Waters en est incontestablement le pape. ULM mis en pièces. Se plaint. Arrive en deuxième position. Un homme fort aux cartes. M. État. Premier film de l’histoire du cinéma en odorama. Vieille vache. N. Grand récipient. Poncées. Répulsif pour vampires. Il a le cœur chaud. O. Réalisé en 1988, ce long métrage a vu son remake (avec John Travolta et Michelle Pfeiffer) sortir en salles en 2007. Compte sept jours. Cette chose-là. P. Café anglais. Cri de douleur. Bigleux. Q. Fait un avoir. Arbre à fruits rouges. R. Venu au monde. Emploie le personnel. Fait ici et maintenant.
• PAR ANAËLLE IMBERT – © LES MOTS, LA MUSE
Les différences
no 196 – avril 2023 86 En bref Les solutions ici :
À gauche, une image du film Female Trouble de John Waters (1974). À droite, la même, à sept différences près.
© Criterion Collection
LES MO par Anaëlle Imber
Découvrez dans les salles mk2 nos conférences, débats et cinéma clubs
L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art.




> no 06 / avril 2023 / gratuit magazine
 Nathaniel Rich
Nathaniel Rich
Comment raconter le désastre écologique ?
Claire Marin
Commencer, recommencer : qu’est-ce qu’un début dans la vie ?
SÉLECTION LIVRES
Les meilleures sorties du mois d’avril
«
»
Robert Filliou
ENTRETIEN Nathaniel Rich
Dans son beau livre
Un monde dénaturé, le journaliste américain
Nathaniel Rich publie plusieurs de ses reportages, dont celui qui a inspiré le film Dark Waters de Todd Haynes. En visio depuis La Nouvelle-Orléans, le reporter a répondu aimablement à nos questions… et nous a même montré une méduse « immortelle ».

Un homme qui veut ressusciter une espèce de pigeon, un lapin fluorescent génétiquement modifié, une énorme fuite de méthane… Quel est le point commun entre toutes les histoires publiées dans votre livre ? Elles parlent toutes de personnes ordinaires qui ont pris conscience de la transformation dramatique de notre monde, et qui réfléchissent à la manière dont nous devons changer pour non seulement survivre mais aussi préserver notre humanité. C’est une
l’activité humaine est responsable, provoque en nous. Comment cela change-t-il nos vies quotidiennes ? Comment cela affecte-t-il nos prises de décisions pour le futur ? Dans quel monde voulons-nous vivre ? En fait, l’idée avec ces reportages est d’essayer de comprendre comment nous naviguons au sein de notre époque si étrange. Et de montrer à quel point cela implique des choix, mais aussi des réponses difficiles, complexes, audelà des discours classiques sur qui sont les gentils et qui sont les méchants.
On parle beaucoup de crise écologique ou encore d’urgence climatique. De votre côté, vous parlez d’« effondrement civilisationnel ». Pourquoi ?
Nous sommes depuis des siècles englués dans l’idée selon laquelle nous serions extérieurs à la nature : cette dernière serait une ennemie qu’il s’agirait de contrôler et d’assujettir. Pourtant, en tant qu’humains, nous faisons partie d’un écosystème, et nous sommes partie intégrante de la nature. Et, quand l’écosystème dans lequel nous évoluons change, se dégrade, nous nous transformons nous aussi avec. La grande menace à laquelle nous faisons face n’est donc pas la fin du monde, mais l’effondrement de l’architecture de notre société, car celle-ci est basée sur des conditions environnementales et climatiques que nous avons prises pour acquises. Or, prendre
Vous vivez à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Vous montrez qu’il s’agit d’un territoire paradigmatique des effets dévastateurs et injustes du changement climatique. Il s’agit de fait d’un territoire du futur : ses habitants expérimentent déjà une dure réalité climatique, qui sera bientôt celle de l’ensemble de la planète. Aux États-Unis, il y a souvent l’idée qu’il suffirait d’aller vivre un peu plus au nord pour échapper au changement climatique. Mais, évidemment, la situation n’est pas aussi simple : toutes nos sociétés sont basées sur des conditions environnementales qui sont aujourd’hui ébranlées. Cela renvoie en outre à la cruauté du changement climatique, qui exacerbe toutes les inégalités qui sévissent déjà au sein de nos sociétés : tout le monde ne peut pas déménager, sachant par ailleurs qu’au final il n’y a pas d’échappatoire possible ! Il est essentiel de rappeler que le changement climatique n’est pas un enjeu politique parmi d’autres, mais bien qu’il a des effets sur tous les autres sujets : les inégalités économiques, raciales… Tout est changement climatique ! Et il a déjà des effets sur nous.
Le Japonais Shin Kubota, génial chercheur – et chanteur ! –, qui étudie les méduses « immortelles », dit dans votre livre qu’un « changement spirituel est nécessaire ».
Quelle forme celui-ci devrait-il prendre ?
Shin Kubota m’a dit ça, j’ai été très ému. C’était un magnifique moment. Par changement spirituel, il veut surtout parler de changement culturel. La première étape de celui-ci serait de comprendre notre fragilité en tant qu’humains, ainsi que celle des autres écosystèmes dont nous dépendons. Et la nécessité de les respecter, plutôt que de vouloir les dominer. La Terre est notre maison, notre cœur ; c’est tout ce que nous aimons et ce à quoi nous sommes attachés. Évidemment, il existe déjà des traditions indigènes et différentes cultures qui appréhendent leur relation à la Terre de cette manière. Mais il faudrait que cela se développe de façon plus universelle… ou du moins chez une majorité d’électrices et d’électeurs dans les pays démocratiques ! Cela dit, ça a déjà commencé : depuis 2018 et le mouvement mondial de la jeunesse pour le climat, il y a eu une vraie évolution. Des années 1990 à 2010, le discours écologiste reposait sur un argument de raison, avec l’idée de dire qu’il serait vraiment stupide de ne pas agir. Mais ce n’est pas suffisant, et, aujourd’hui, c’est un argument moral qui est avancé : non seulement ne pas agir, par exemple en ne mettant pas fin aux énergies fossiles, est stupide, mais cela relève en outre d’une faillite morale, d’une trahison de toutes les valeurs fondamentales de l’être humain : l’égalité, la justice, le fait de prendre soin des plus précaires.
idée commune à tous mes articles : je m’intéresse autant aux effets du changement climatique qu’aux reconfigurations intimes, morales et émotionnelles que ce phénomène, dont
soin de la nature, c’est aussi prendre soin de notre identité et de ce qu’il y a de beau en nous en tant qu’êtres humains. Nous devons prendre nos responsabilités vis-à-vis de cela.
Regardez, j’ai une photo d’une de ces méduses ! (Nathaniel Rich, tout sourire, se déplace de son bureau pour nous la montrer.)
C’est mon reportage préféré du livre : quand
Dans le livre, vous faites beaucoup référence à la pop culture. En quoi les arts et les imaginaires peuvent-ils nous permettre de
no 06 – avril 2023 II mk2 Institut
« Tout est changement climatique ! Et il a déjà des effets sur nous. »
© Pableaux Johnson
rattraper ce que vous nommez notre « retard de l’âme » à propos de ces enjeux ?
Il existe de nombreuses œuvres dystopiques concernant ces sujets, ce qui est une bonne chose. Mais il est également essentiel pour les arts, la culture, mais aussi pour le journalisme d’aborder la question de façon plus complexe, notamment en explorant notre réponse émotionnelle à cette crise que nous vivons toutes et tous à divers niveaux. Quand je rencontre des scientifiques, ils me disent qu’il faut absolument parler de tel ou tel sujet. Il est en effet essentiel d’informer le public. Mais, au-delà de dénoncer tel ou tel scandale, la culture, les arts et le journalisme ont un autre rôle important : celui de permettre de se confronter à tous ces sujets d’une façon plus personnelle, émotionnelle – d’où cette idée de « retard de l’âme », que j’emprunte au romancier William Gibson. J’ai le sentiment qu’il existe un réel désir chez les gens d’appréhender cela d’une manière plus intime. Et les films, les livres ou encore le journalisme narratif peuvent les aider en ce sens.
D’ailleurs, en 2020, Todd Haynes a adapté au cinéma l’un des articles publiés dans votre livre : Dark Waters. Comment ce projet a-t-il vu le jour ?


Avant de figurer dans ce livre et d’être adapté au cinéma, mon article avait été publié dans le New York Times Magazine. J’y racontais le combat de l’avocat Robert Bilott contre la multinationale DuPont, qui, en utilisant une substance chimique cancérigène [le PFOA, ndlr], a provoqué un scandale sanitaire et écologique au niveau mondial. Ça a été l’article du magazine le plus lu en 2016. J’en ai ensuite vendu les droits à Participant Media, une société qui produit des films à messages sociaux. Le comédien et militant écologiste Mark Ruffalo a été le premier à s’impliquer dans le projet. J’ai ensuite consulté un scénariste, et j’ai été extrêmement heureux quand Todd Haynes, l’un de mes cinéastes favoris, a accepté de réaliser le film. Je n’ai pas collaboré avec lui directement, mais les acteurs et actrices et lui-même ont fait un travail fantastique. Dans Dark Waters, ils racontent cette histoire d’une façon très juste et très fine, avec une grande puissance dramatique : ils montrent de façon très belle les bouleversements intimes provoqués par ce scandale. Ça a été un vrai cadeau de voir mon travail si bien adapté, d’autant que le film semble avoir eu une influence majeure.
« Nathaniel Rich – Comment retrouver le monde que nous avons perdu ? »
Rencontre modérée par le journaliste Thibaut Sardier (Libération), le 3 avril au mk2 Bibliothèque à 20 h tarif : 15 € | étudiant, demandeur d’emploi : 9 € | − 26 ans : 5,90 € | carte UGC/mk2 illimité à présenter en caisse : 9 € | séance avec livre : 23 €
•

12 avril → 5 juillet 2023
images...
Un monde dénaturé de Nathaniel Rich (Éditions du sous-sol, 336 p., 23 €)

• PROPOS RECUEILLIS PAR AMÉLIE QUENTEL
forumdesimages.fr
avril 2023 – no 06 Design graphique : ABM Studio –Visuel Pleasure © Paltform Production / Le Violent ; Blade Runner © Collection Christophel Portrait de une ville entre rêve et cauchemar
Angeles III mk2 Institut
cinéma, bande dessinée, jeu vidéo, nouvelles
Los
ENTRETIEN Claire Marin

Qu’est-ce qu’un début dans la vie ? Quelles formes épousent tous les commencements qui rythment notre existence, de la naissance d’un amour à la perte d’un être cher ?
Dans une réflexion lumineuse et labyrinthique, aussi intime qu’universelle, Claire Marin interroge cette expérience fondatrice, durant laquelle nos affects s’intensifient. Les Débuts marque l’accomplissement du travail sensible de la philosophe, dans lequel chaque lecteur reconnaît ses propres expériences.
La vie n’est-elle qu’une succession infinie de débuts ?
Elle n’est pas infinie, et c’est précisément à mesure que l’on en prend conscience que l’on prête attention aux débuts, à leur
grands débuts (une nouvelle amitié, un autre amour, un changement de vie) qu’ils resurgissent et nous surprennent. Je crois qu’au fond de nous il y a toujours cet espoir d’un nouveau début ou d’un recommencement, cette attente d’un autre printemps. On espère revivre cette émotion de l’inédit, cet enthousiasme.
Vous faites une distinction conceptuelle et sensible entre le début et le commencement, en notant que le début tranche, interrompt le temps, « là où le commencement s’y écoule paresseusement ». En quoi le début est-il une étincelle, une puissance explosive qui brise le cours des choses ? Certains débuts sont une réelle interruption du cours des choses. Ils marquent l’entrée dans une nouvelle période de notre existence, la validation d’une étape, la reconnaissance ou la prise de conscience, parfois soudaine, d’éléments importants de notre identité. Ils relèvent alors d’une logique de l’instant décisif. Dans le commencement, le rapport au temps me paraît différent, s’inscrivant d’emblée dans une durée qui s’étire, là où le début nous tombe parfois dessus comme la foudre. C’est cette fulgurance-là qui est assez fascinante, qu’elle soit excitante ou dramatique. La manière dont elle redessine nos parcours, trace des lignes inattendues, la part de surprise dans nos vies, c’est passionnant et inquiétant à la fois.
est impossible de réduire le début à une seule expérience ? Oui, il y a des débuts qui s’imposent à nous, des coups de foudre amicaux ou amoureux, des révélations intérieures de l’ordre de la vocation par exemple. Mais il y a aussi, dans les apprentissages, des essais, des tentatives qui ne mènent nulle part. Du moins au premier abord, car il y a peut-être des débuts avortés qui poursuivent leur chemin de manière moins consciente et qui continuent en nous pour réapparaître plus tard.
Dans votre essai, vous écrivez ceci : « On peut parler d’un début quand le monde paraît changé, quand je ne le regarde plus de la même manière. » Serait-ce cela, la matrice d’un début : le moment d’une transformation de soi, une exaltation intense, un sentiment de vivre vraiment ?
intensité, qu’on essaie de la retrouver ou que l’on se réjouit d’assister aux débuts des plus jeunes autour de nous. C’est parfois quand on croit que l’on ne vivra plus de
Vous distinguez différents types de débuts : ceux qu’on décide, ceux qu’on improvise, ceux qui ravissent, ceux que l’on rate… Cette variation signifie-t-elle qu’il
Il n’y a pas nécessairement une transformation de soi radicale, elle peut être un infime décalage, mais il se produit une modification de notre représentation du monde, des autres ou de nous-même. On change légèrement d’angle, et cela suffit pour nous permettre de regarder autrement ce qui était devenu trop familier et faussement évident. Cela produit une nouvelle curiosité, un appétit, un élan neuf et, en effet, un sentiment plus intense d’exister. C’est aussi, dans certains cas, le point de départ d’un affranchissement ou d’un accomplissement de soi jusqu’alors impossible, l’expression de ce qui germait en nous sans réussir à s’affirmer. Il y a des instants libérateurs.
Spontanément, l’idée de début renvoie aux histoires d’amour, aux apparitions comme
chez Gustave Flaubert, ou à l’amour maternel comme chez Romain Gary, à la nostalgie que leur amorce suscite. N’aimer que les débuts : comprenez-vous cette tentation qui se transforme souvent en amertume ? Je la comprends, et c’est un vrai problème. J’adore les moments où l’idée créatrice, le sentiment passionné, surgit, où ça se précipite en nous, alors que la suite de l’histoire ou l’achèvement du projet, même s’ils sont heureux ou satisfaisants, n’ont pas cette même intensité. Plutôt que de parler d’amertume, j’évoquerais la nostalgie, qui est liée à cette puissance des sentiments du début, à l’excitation, à la fébrilité qu’ils produisent, à l’imaginaire délirant qu’ils peuvent enclencher. On a le souvenir de ces premiers moments qui nous laissent comme assoiffés, selon la métaphore de Romain Gary. Ces débuts sont des promesses jamais entièrement tenues, qui nous condamnent à la déception réitérée, mais qui peuvent aussi enclencher un dynamisme par la trace d’absolu qu’ils laissent en nous.
Peu d’entre nous connaissent dans leur vie de grands débuts, selon vous ; on commence discrètement, modestement, on s’inscrit dans un mouvement plus large que nous. Gilles Deleuze dit qui l’on ne commence jamais par le début mais par le milieu. Diriez-vous qu’en dépit du déroulement continu de la vie, défendu par Henri Bergson, vous avez éprouvé des débuts tranchants, des brisures, à la manière de Gaston Bachelard, qui parlait de la « réalité décisive de l’instant » ?
Chacun d’entre nous est capable d’identifier des moments tranchants, où le monde se
no 06 – avril 2023 IV mk2 Institut
« Au fond de nous, il y a toujours cette attente d’un autre printemps. »
© Céline Nieszawer
•
dédouble, où l’on bascule dans une autre réalité, exaltante ou tragique. Une parole, un geste, une décision et on peut vivre dans l’irréparable ou, au contraire, ouvrir un champ de possibles jusqu’alors inimaginables. Une déclaration d’amour, une annonce de diagnostic, un coup de fil dans la nuit, il y a les débuts, heureux ou catastrophiques, qui tracent la ligne entre la vie désormais et celle d’avant. Pour ma part, les premières années de ma vie d’étudiante, le premier manuscrit accepté ou la naissance de ma fille en constituent le versant lumineux.
Existe-t-il des instants précis durant lesquels vous avez décidé d’être celle que vous êtes devenue ?
Je dirais que choisir la philosophie était un pari et le début, sans que je m’en rende vraiment compte à l’époque, d’une direction assez différente de celles qui m’étaient familières. S’il faut identifier des instants précis, ce serait plutôt dans des paroles, prononcées peut-être un peu à la légère par des professeurs ou des inconnus surpris de me voir passer des heures à écrire, et qui m’ont encouragée sans le savoir à continuer à noircir des cahiers. Puis des rencontres avec des éditeurs qui sont autant de nouvelles étincelles.


L’une des belles idées de votre livre est de suggérer qu’une existence est une impulsion plutôt qu’un tout, que quelque chose persévère obstinément en nous, même après l’effacement. Être à sa place, pour reprendre le titre de votre précédent livre, est-ce accepter l’idée de mobilité et de plasticité de cette place, que notre place n’existe qu’à la mesure de nos déplacements constants et des promesses qu’ils annoncent ?
Oui, nos places sont mouvantes, ne serait-ce que dans l’intériorité de notre conscience, nous vivons des tremblements intérieurs.



C’est ce qui fait aussi l’intérêt de l’existence : expérimenter d’autres places, voir ce qu’elles révèlent de nous, ce qu’elles mettent à l’épreuve, se découvrir différent de celui qu’on croyait être, capable de ressources insoupçonnées. Mais cela n’est pas sans risque, on peut se perdre aussi à virevolter d’une place à l’autre.


« Claire Marin – Commencer, recommencer : qu’est-ce qu’un début dans la vie ? » Rencontre modérée par le journaliste

Jean-Marie Durand (Philosophie magazine), suivie d’une signature, le 11 avril au mk2 Bibliothèque à 20 h tarif : 15 € | étudiant, demandeur d’emploi : 9 € | − 26 ans : 5,90 € | carte UGC/mk2 illimité à présenter en caisse : 9 € | livres en vente à l’issue de la séance
•


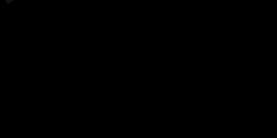







Les Débuts. Par où commencer ? de Claire Marin (Autrement, 160 p., 19 €)

Le 13 avril en librairie et en livre audio sur ecoutezlire.fr












avril 2023 – no 06
V mk2 Institut
Graphisme & illustration : Lionel Avignon / Hartland Villa
PROPOS RECUEILLIS PAR JEAN-MARIE DURAND
SÉLECTION LIVRES
Tous les mois, mk2 Institut sélectionne des essais faisant l’actualité du monde des idées. Des recommandations de lecture sur des questions essentielles, qui animent nos sociétés et parfois les divisent.

L’INVENTION DE LA SURVEILLANCE
« La visibilité est un piège », disait Michel Foucault dans Surveiller et punir. Naissance de la prison. En deux siècles à peine, nous sommes passés d’un monde discret, où l’individu, à moins d’être glorieux, menait une existence invisible, à une société de l’hypervisibilité et de la surveillance permanente. Comment et pourquoi en sommesnous arrivés là ? Quel est l’avenir de la surveillance ? Peut-on y résister ? Dans ce « cinéphilo », le philosophe Ollivier Pourriol interroge notre réalité à travers l’histoire du cinéma contemporain. Un livre qui permet de (re)découvrir, aux côtés de Michel Foucault et de Jean-Jacques Rousseau, Minority Report, The Truman Show, Papillon, Orange mécanique, 1984

PETITES VENGEANCES

d’Ollivier Pourriol (Le Pommier, 120 p., 15 €)
NOUS COLONISONS L’AVENIR
Réveiller l’autre en faisant mine d’être désolé, passer l’aspirateur pendant un match de foot à la télé, ne pas remplacer le rouleau de papier toilette vide, ne pas ranger les affaires de l’autre au bon endroit… Et si on se vengeait secrètement de notre partenaire pour l’aimer davantage ? Pour le sociologue Jean-Claude Kaufmann, il ne s’agit pas de faire du mal à l’autre, mais bien de se faire du bien et donc d’en faire indirectement à son couple. Les petites vengeances secrètes se présentent ainsi comme une alternative majeure aux crises ouvertes et aux séparations, une salutaire thérapie de couple ! Un examen minutieux et amusant durant lequel l’auteur ausculte tous ces petits gestes qui oscillent entre la « petite gentillesse, juste pour rire » et la « vengeance molle » d’un « Machiavel en pantoufles ».
RIEN N’EST DIT
L’époque voudrait nous convaincre que la modernité, c’est fini. Qu’il faut en revenir aux canons et au bon vieux récit, celui qui plaît, celui qui enchante le public. Comme si rien ne s’était passé, précisément, dans ces avant-gardes dont on ne peut pourtant contester qu’elles ont animé le xxe siècle. L’écrivain et essayiste Philippe Forest retrace et analyse la façon dont, ces dernières décennies, s’est imposée l’idée que la littérature doit se réconcilier avec elle-même afin de se réconcilier avec le monde. Décréter la fin du moderne est un acte qui emporte avec lui toutes sortes de conséquences dont nous ne mesurons qu’à moitié les effets plus généraux. Un essai pour questionner le moment présent et découvrir les conditions de possibilité d’une parole littéraire qui refuse de se résigner à l’académisme ambiant. de David Van Reybrouck (Actes
Dans la lignée de Contre les élections (2014), David Van Reybrouck écrit ici un plaidoyer en faveur de la justice climatique. Un constat sans appel qui se transforme en leçon d’optimisme et qui propose des solutions politiques aptes à renouveler la vie démocratique. Dans ce nouvel essai, l’historien propose quatre modes d’action susceptibles d’impliquer les citoyens dans les processus de décision. Parmi ceux-là, en dernier recours, la désobéissance civile, mais une désobéissance organisée : les citoyens pourraient refuser de payer un certain pourcentage de leurs impôts, correspondant à la part du budget national que les États affectent aux ressources fossiles. Une réflexion méthodique, généreuse de solutions pour l’humanité, par l’action.

no 06 – avril 2023 VI
Sud, 64 p., 8,90 €)
de Philippe Forest (Seuil, 496 p., 23,50 €)
mk2 Institut
de Jean-Claude Kaufmann (Éditions de l’Observatoire, 200 p., 19 €)
• UNE SÉLECTION DE JOSÉPHINE DUMOULIN ET GUY WALTER
d’Annie Le Brun (Flammarion, 128 p., 23,90 €)

LA VITESSE DE L’OMBRE
Ce qui n’a pas de prix, ce sont les choses qui nous font vivre : le rêve, l’amour, la passion, l’art, la profondeur… Tout ce qui est en train de disparaître, aussi, sous le poids d’une marchandisation effrénée à laquelle plus rien n’échappe, pas même la beauté. Comment résister à l’asservissement de nos consciences et à l’extinction de nos vrais désirs ? Peut-on encore sauver l’imagination dans ce déferlement d’images ? Dans cet essai, la poétesse et écrivaine Annie Le Brun poursuit sa réflexion sur la beauté comme geste politique. À travers son regard, le lecteur découvre des rapprochements inattendus, des paysages inexplorés : un voyage au cours duquel surgissent nos désirs ensevelis, une liberté nouvelle et d’autres utopies.
CHANGER LA VIE PAR NOS FICTIONS ORDINAIRES

Raconter des histoires, interpréter un personnage de théâtre, un rôle social, mentir, rêver, parler aux fantômes ou aux anges, jeter des sorts, écrire des romans… On pourrait penser qu’il existe une nette différence entre toutes ces pratiques. Leur point commun est qu’il y est fait usage de la fiction. Souvent perçues comme une échappatoire au réel, ces opérations mentales nous permettent de « savoir » et d’« agir » sans utiliser les moyens ordinaires d’information. Elles ont la faculté de faire advenir des possibles, le futur, par expériences de pensée. Dynamitant la valeur purement esthétique attribuée à la fiction, citant aussi bien Agnès Varda que Calvin et Hobbes, ce livre détourne malicieusement la rhétorique des guides de développement personnel pour proposer un entraînement à la fiction performative.
LA DERNIÈRE ARTISTE SOVIÉTIQUE

de Victoria Lomasko (The Hoochie Coochie, 296 p., 26 €)
JOURNAL D’UNE INVASION

Née en 1978 en U.R.S.S., Victoria Lomasko interroge, trente ans après la partition du bloc de l’Est, les vestiges de cet empire, autant en Russie que dans les nouveaux États apparemment indépendants. Et tandis que la pandémie de Covid-19 bouscule ses plans, le livre se mue en un témoignage d’une époque qui a vu le plus vaste pays du monde passer d’un sordide régime autoritaire à une effrayante dictature. Les dernières lignes du livre furent écrites au début de l’exil de l’autrice, en mars 2022. Fidèle à la tradition littéraire russe où un livre ne traite que rarement d’un sujet unique, Victoria Lomasko dépeint à travers La Dernière Artiste soviétique le portrait populaire d’un monde en équilibre précaire autant qu’elle interroge le statut de l’artiste.
d’Igort (Futuropolis, 168 p., 24 €)
Igort a vécu dans le Donbass, en Ukraine, au début des années 2010. Une partie de sa famille continue d’y vivre. Dès le début de la guerre, il appelle les siens. Choqué par leurs premiers témoignages, il a voulu mémoriser leurs voix en une sorte de chronique dessinée. Ce récit, écrit en temps réel de l’actuelle guerre russo-ukrainienne, raconte, au fil des cent premiers jours de l’invasion, une fresque désolante et terriblement humaine qui montre la vie de misère et de privation, le cauchemar, l’horreur… et puis la résistance ukrainienne, la détermination d’un peuple qui souffre mais ne cède pas. Igort inscrit aussi son récit dans l’histoire, en revenant sur les relations entre les deux pays sous l’ère de Joseph Staline puis celle de Vladimir Poutine. L’espoir, la désillusion, la fierté et la solidarité construisent la structure dramatique de ce nouvel ouvrage bouleversant.
avril 2023 – no 06 mk2 Institut
VII
de Nancy Murzilli (Premier Parallèle, 200 p., 18 €)
CE MOIS-CI CHEZ MK2 INSTITUT
> LUNDI







3 AVRIL
LUNDIS PHILO DE CHARLES PÉPIN
« Faut-il vraiment être “aligné” ? »
> mk2 Odéon (côté St Germain), à 18 h 30
NATHANIEL RICH – COMMENT RETROUVER LE MONDE QUE NOUS AVONS PERDU ?
Une rencontre modérée par le journaliste Thibaut Sardier (Libération)
> mk2 Bibliothèque, à 20 h
> MARDI 4 AVRIL
AVANT-PREMIÈRE D’ALMA VIVA
CASSENOISETTE
D’APRÈS LE BALLET-FÉERIE DE TCHAÏKOVSKI
DIRECTION ARTISTIQUE
KARL PAQUETTE, DANSEUR ÉTOILE DE L’OPÉRA DE PARIS ADAPTATION DU LIVRET CLÉMENT HERVIEU-LÉGER, DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE CHORÉGRAPHIE ET MISE EN SCÈNE FABRICE BOURGEOIS, MAÎTRE DE BALLET DE L’OPÉRA DE PARIS
Projection en avant-première d’Alma viva de Cristèle Alves Meira, en présence de la réalisatrice et en partenariat avec le collectif 50/50.
> mk2 Quai de Seine, à 20 h
MICHEL PASTOUREAU – DEPUIS LE PREMIER LIVRE : UN HISTORIEN ET SON HISTOIRE
Une rencontre modérée par le journaliste Olivier Pascal-Moussellard (Télérama), suivie d’une signature.
> mk2 Bibliothèque, à 20 h
> JEUDI 6 AVRIL
HÉLÈNE CIXOUS – UNE ICÔNE LITTÉRAIRE
Une rencontre modérée par Marta Segarra, éditrice et professeure d’études de genre.








> mk2 Odéon (côté St Michel), à 20 h
AVANT-PREMIÈRE DES COMPLICES
Projection en avant-première des Complices de Cécilia Rouaud, en présence de l’équipe du film.
> mk2 Bibliothèque, à 20 h 15
> MARDI 11 AVRIL
CLAIRE MARIN – COMMENCER, RECOMMENCER : QU’EST-CE QU’UN DÉBUT DANS LA VIE ?
Une rencontre modérée par le journaliste Jean-Marie Durand (Philosophie magazine), suivie d’une signature.
> mk2 Bibliothèque, à 20 h
> JEUDI 13 AVRIL
FETHI BENSLAMA – LE SACRIFICE DE RUSHDIE
Une rencontre modérée par le journaliste Jean-Marie Durand (Philosophie magazine). En partenariat avec les Éditions du Seuil.
> mk2 Bibliothèque, à 19 h 30
—> SAMEDI 15 AVRIL
CULTURE POP ET PSYCHIATRIE AVEC LE DR JEAN-VICTOR BLANC « La schizophrénie : le Black Swan de la pop culture. »
> mk2 Beaubourg, à 11 h
DERNIÈRES NOUVELLES DU COSMOS AVEC CHRISTOPHE GALFARD « À la recherche des mondes invisibles. »
> mk2 Bibliothèque, à 11 h
—> DIMANCHE 16 AVRIL
DERNIÈRES NOUVELLES DU COSMOS AVEC CHRISTOPHE GALFARD « À la recherche des mondes invisibles. »
> mk2 Odéon (côté St Germain), à 11 h
VOTRE CERVEAU VOUS JOUE DES TOURS AVEC ALBERT MOUKHEIBER « Sea, sexe and neurosciences. » Aurore Malet-Karas, docteure en neurosciences,






sexologue et thérapeute.
> mk2 Bibliothèque, à 11 h


> LUNDI 17 AVRIL
LUNDIS PHILO DE CHARLES PÉPIN « Qu’est-ce qui distingue l’instinct de l’intuition ? »
> mk2 Odéon (côté St Germain), à 18 h 30
SCIENCES SOCIALES ET CINÉMA Projection de JSA (Joint Security Area) de Park Chan-Wook, commenté par l’historien Alain Delissen, spécialiste de la Corée.
> mk2 Bibliothèque, à 19 h 45
AVANT-PREMIÈRE DE SUR L’ADAMANT
Projection en avant-première de Sur L’Adamant de Nicolas Philibert, en présence du réalisateur et de Linda de Zitter, psychologue clinicienne et psychanalyste, membre de l’équipe de l’Adamant.
> mk2 Quai de Loire, à 20 h

LE CINÉMA SOUS LE REGARD DE LA BIOLOGIE
Projection de The Truman Show de Peter Weir : les processus mentaux et leurs dysfonctionnements, avec Karim N’Diaye, ingénieur de recherche CNRS à l’Institut du cerveau.
> mk2 Nation, à 20 h
> JEUDI 27 AVRIL
RENCONTRE AVEC LE CULTISSIME
JOHN WATERS
Entretien de l’autoproclamé pape du trash avec la romancière et critique de cinéma Hélène Frappat, suivi d’une signature.
> mk2 Bibliothèque, à 20 h
MK2 INSTITUT MAGAZINE
éditeur MK2 + — 55, rue Traversière, Paris XII e — tél. 01 44 67 30 00 — gratuit

directeur de la publication : elisha. karmitz@mk2.com | directeur de mk2 Institut : guy.walter@mk2.com | rédactrice en chef : joséphine.dumoulin@mk2.com | directrice artistique : Anna Parraguette | graphiste : Ines Ferhat | coordination
éditoriale : juliette.reitzer@mk2.com, etienne.rouillon@mk2.com | secrétaire de rédaction : Vincent Tarrière | renfort correction : Claire Breton | stagiaire mk2 Institut : Marguerite Patoir-Thery | ont collaboré à ce numéro : Jean-Marie Durand, Amélie Quentel | publicité | directrice commerciale : stephanie. laroque@mk2.com | cheffe de publicité cinéma et marques : manon.lefeuvre@ mk2.com | responsable culture, médias et partenariats : alison.pouzergues@
mk2.com | cheffe de projet culture et médias : claire.defrance@mk2.com



Imprimé en France par SIB imprimerie — 47, bd de la Liane — 62200 Boulognesur-Mer

no 06 – avril 2023 VIII
mk2 Institut
© Illustration Sara Andreasson –Direction artistique Base Design –Licences N° L-R-21-4095 / L-R-21-4060 / L-R-21-4059

UNIS PAR LA VENGEANCE

UNE SÉRIE Ý
SEULEMENT
© Drama Republic, Eight Rooks & All3Media International.
DÈS LE 30 MARS
SUR














































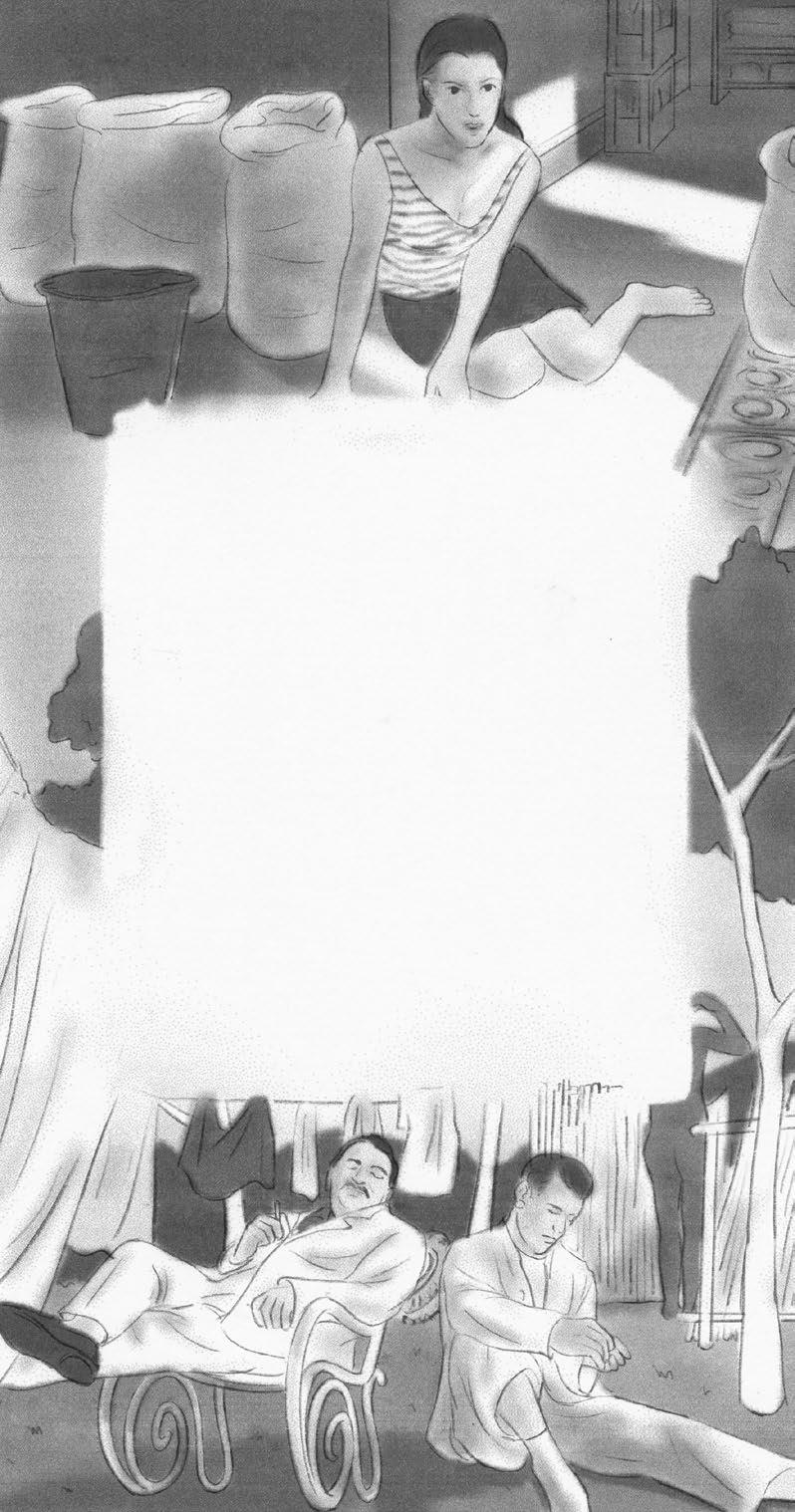
















































































































































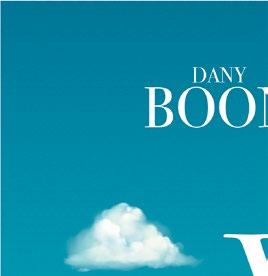
















































































































































































































































































































































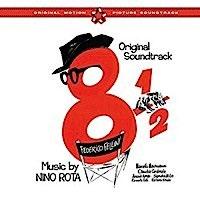




















 Nathaniel Rich
Nathaniel Rich