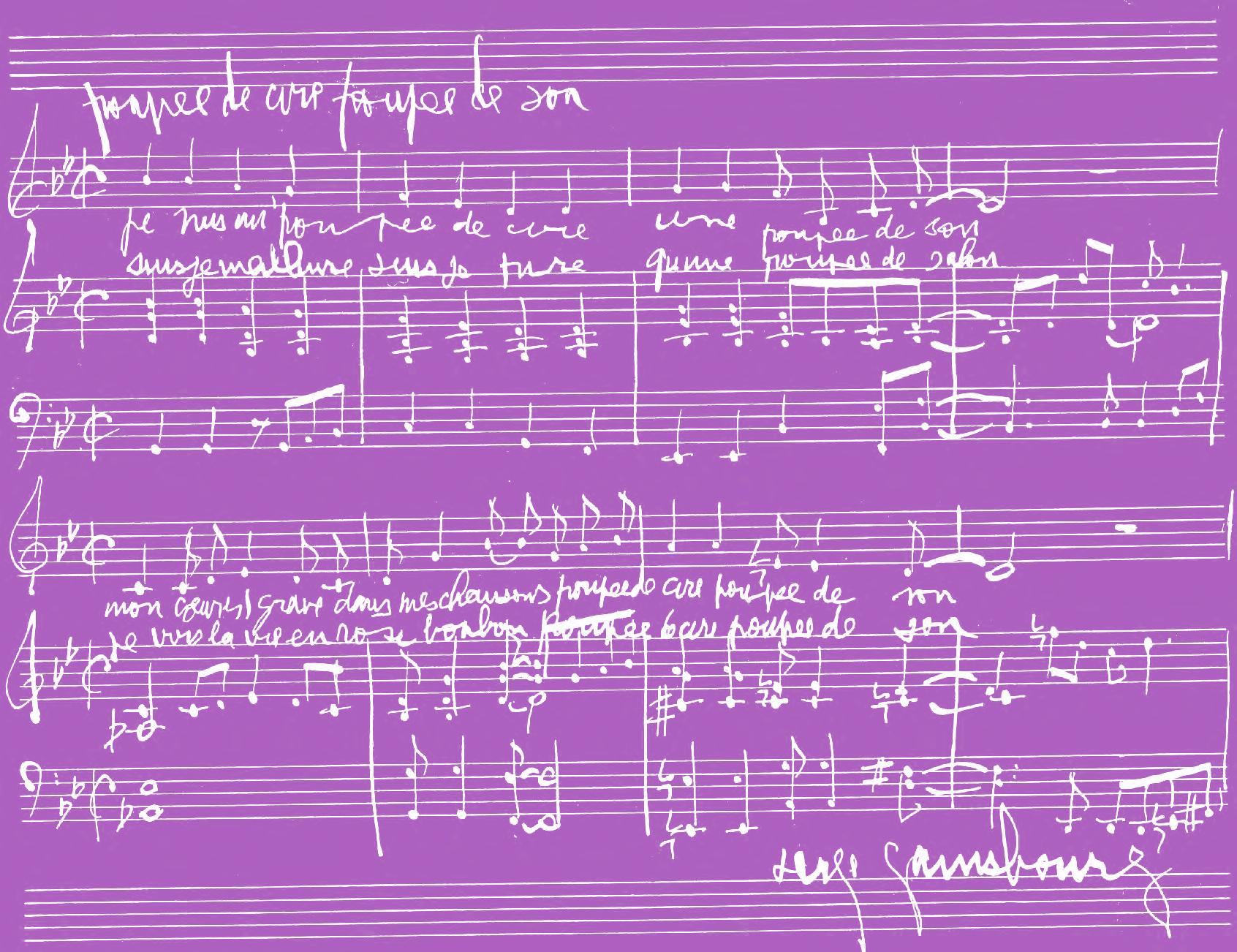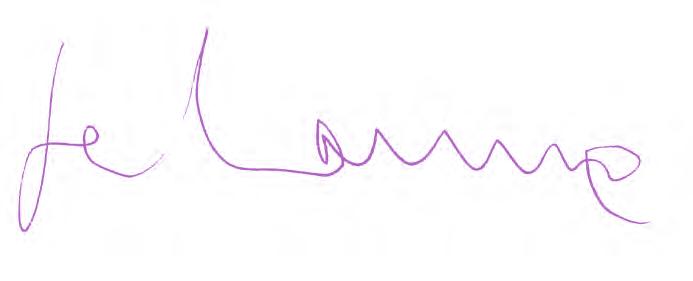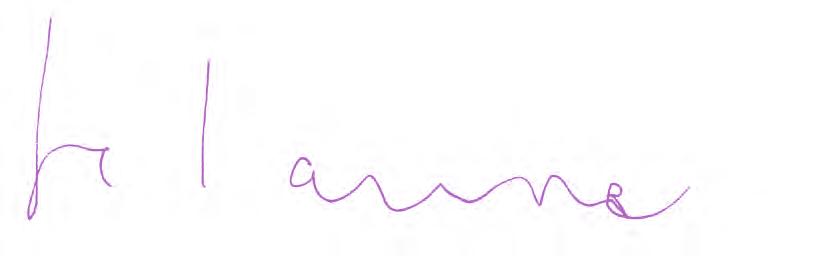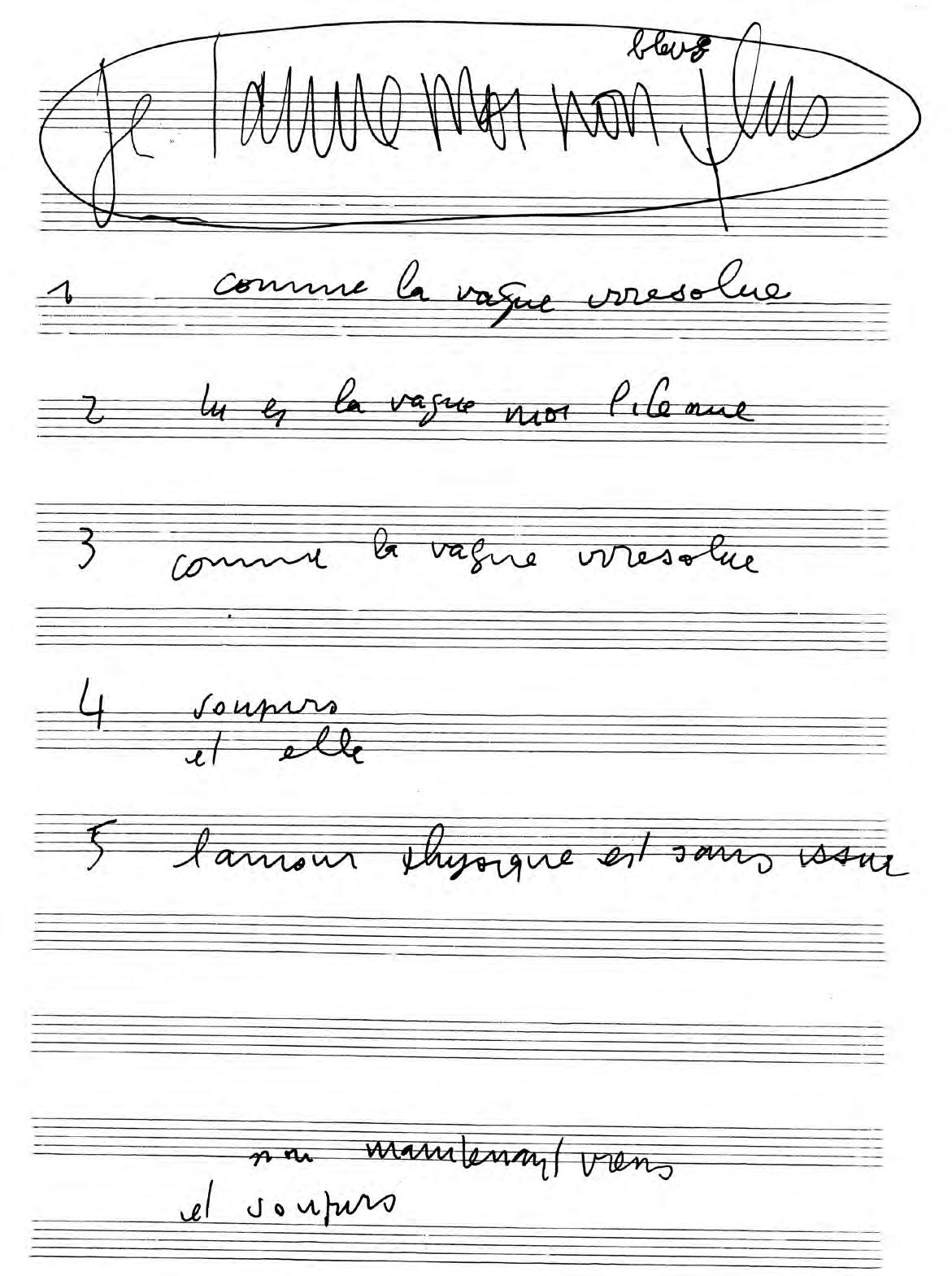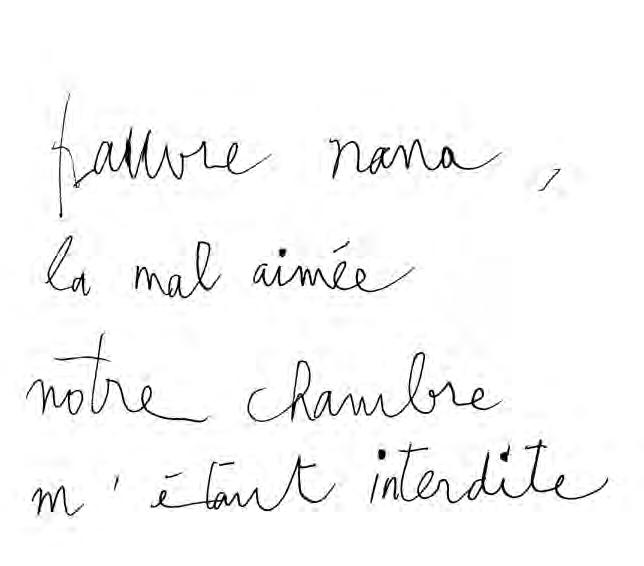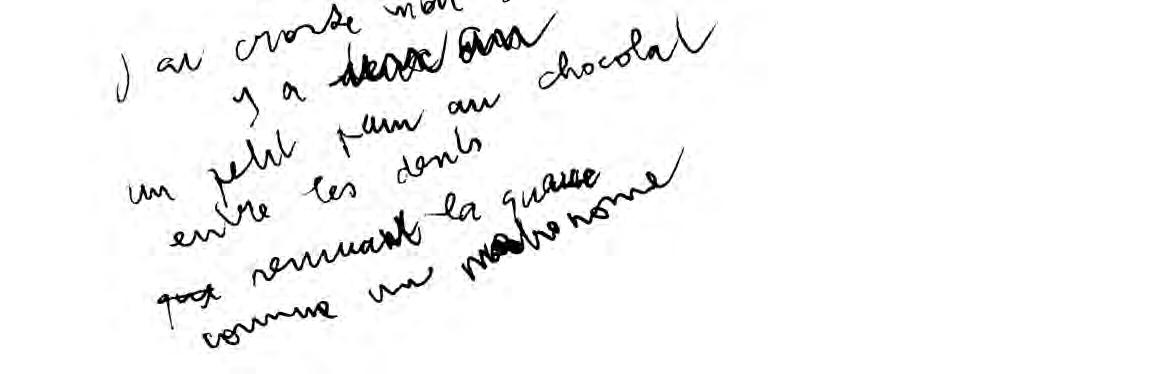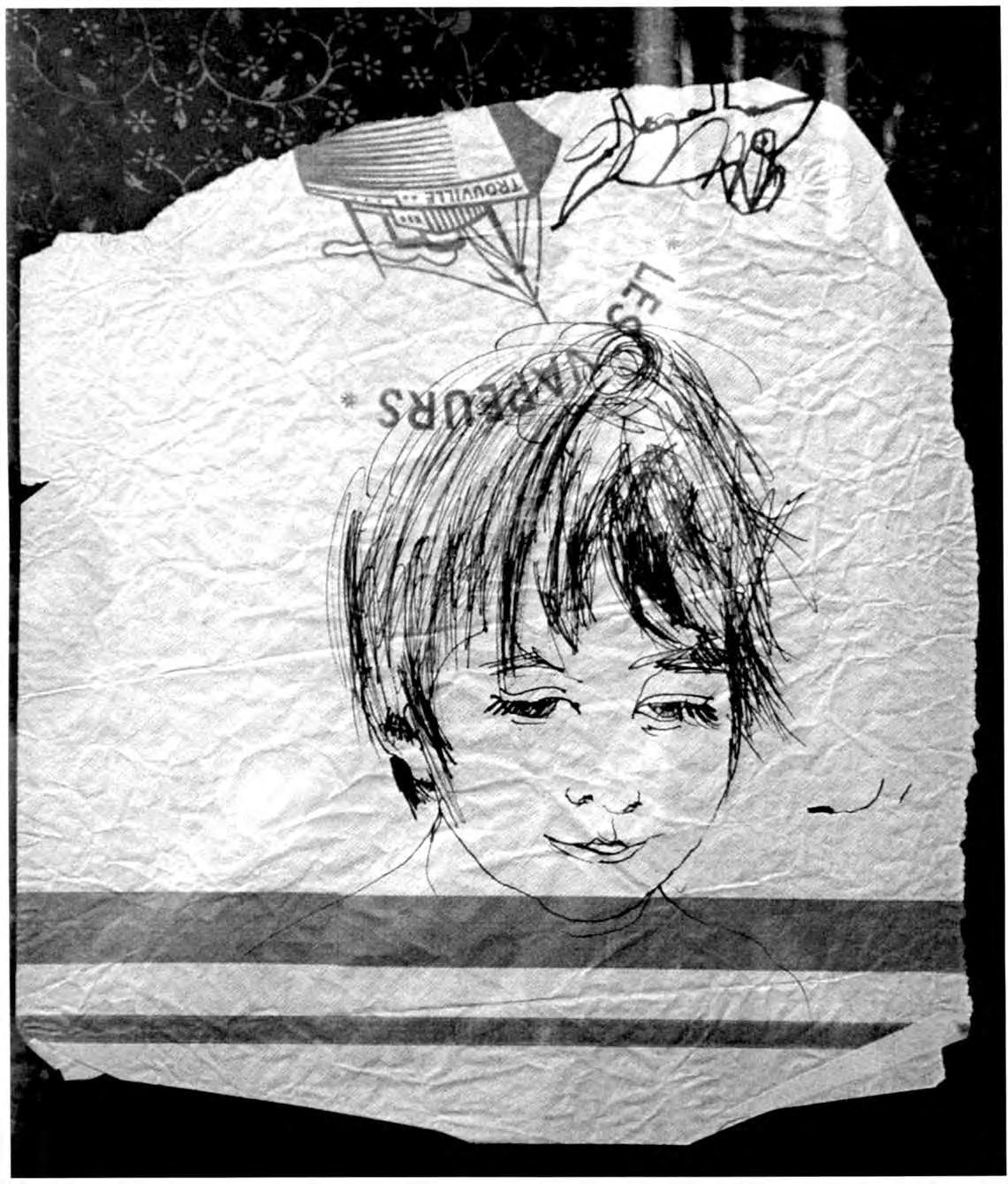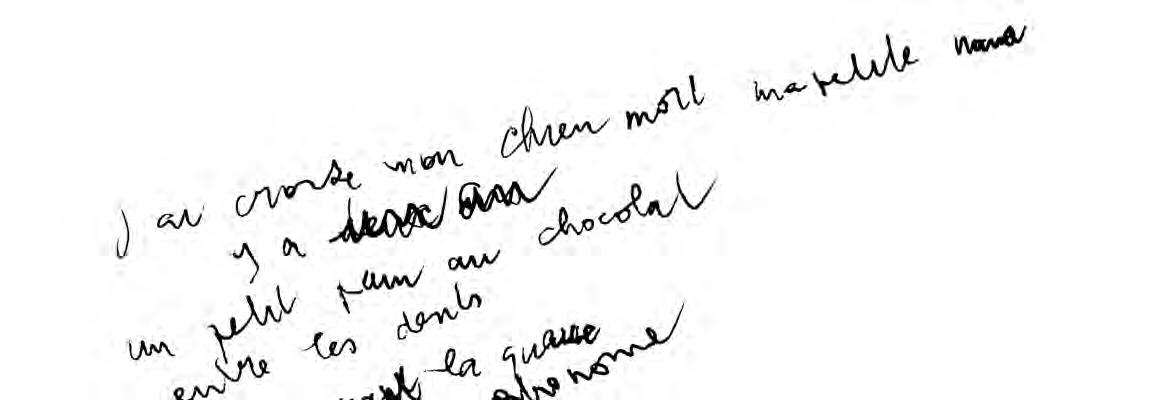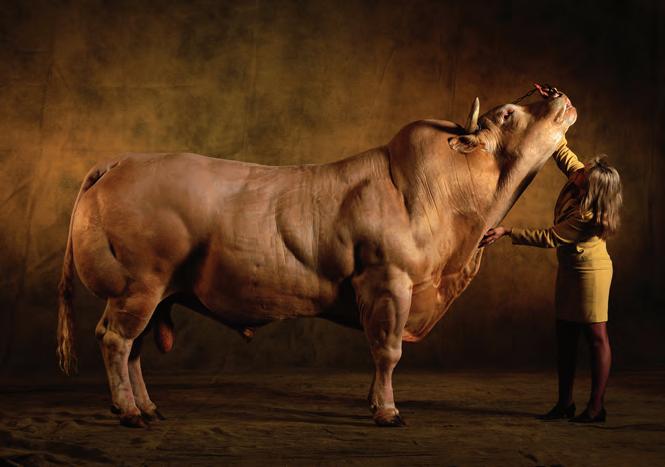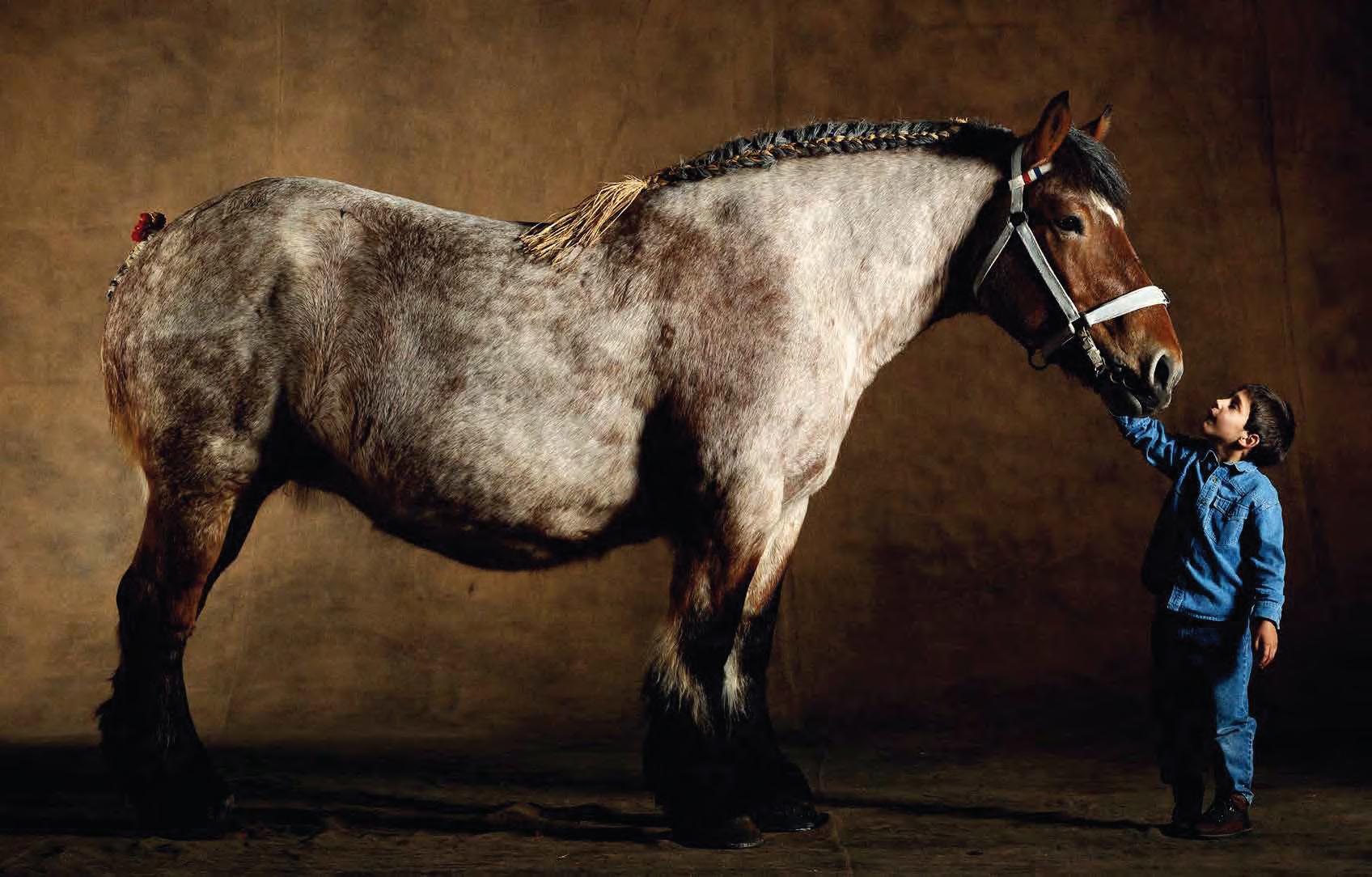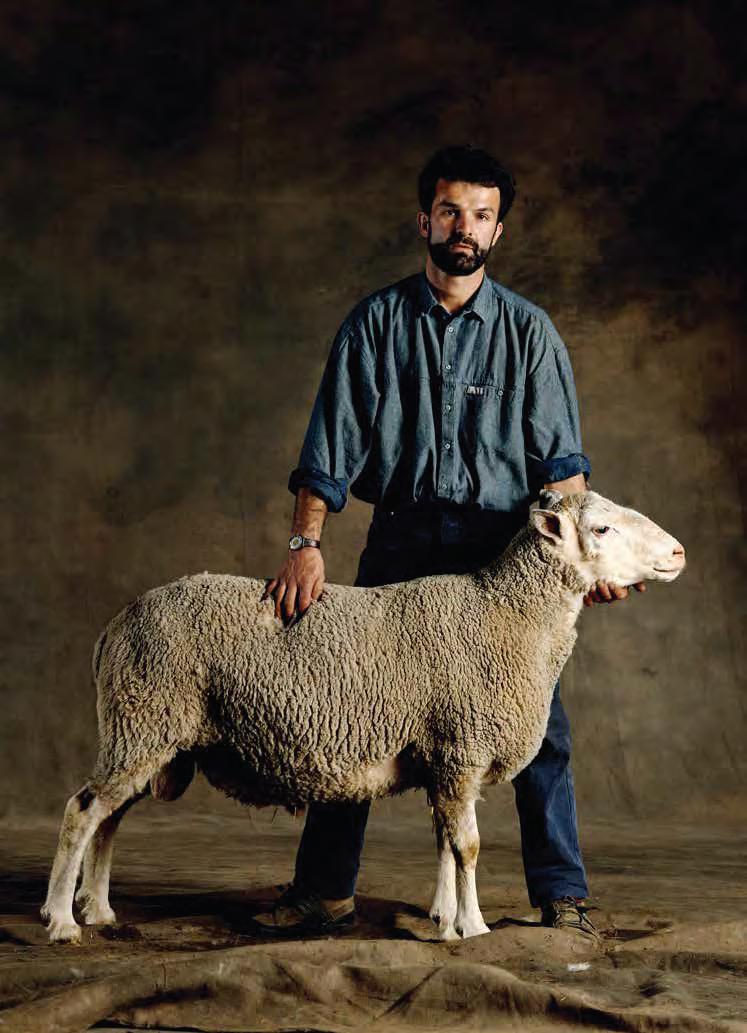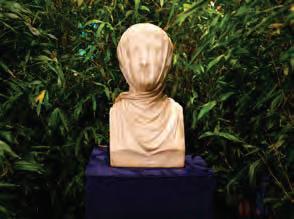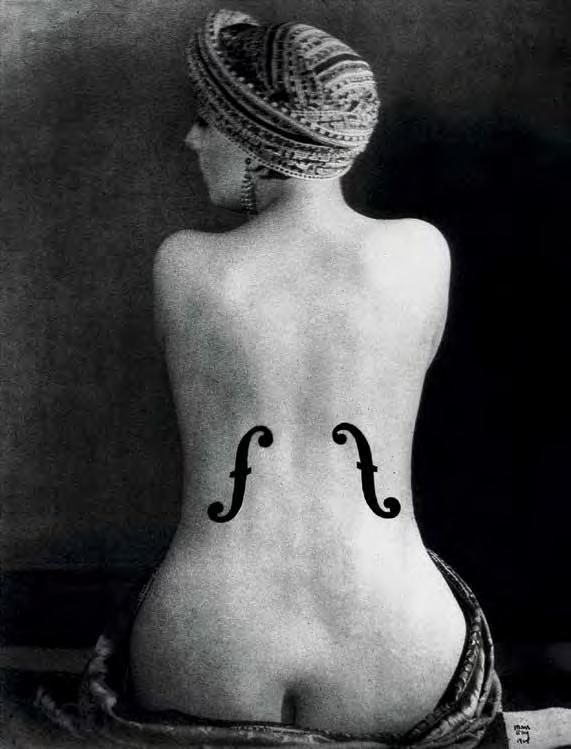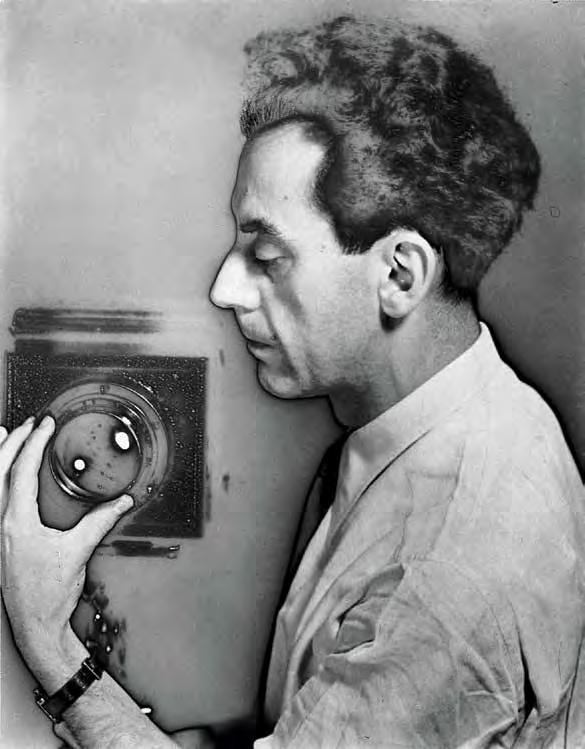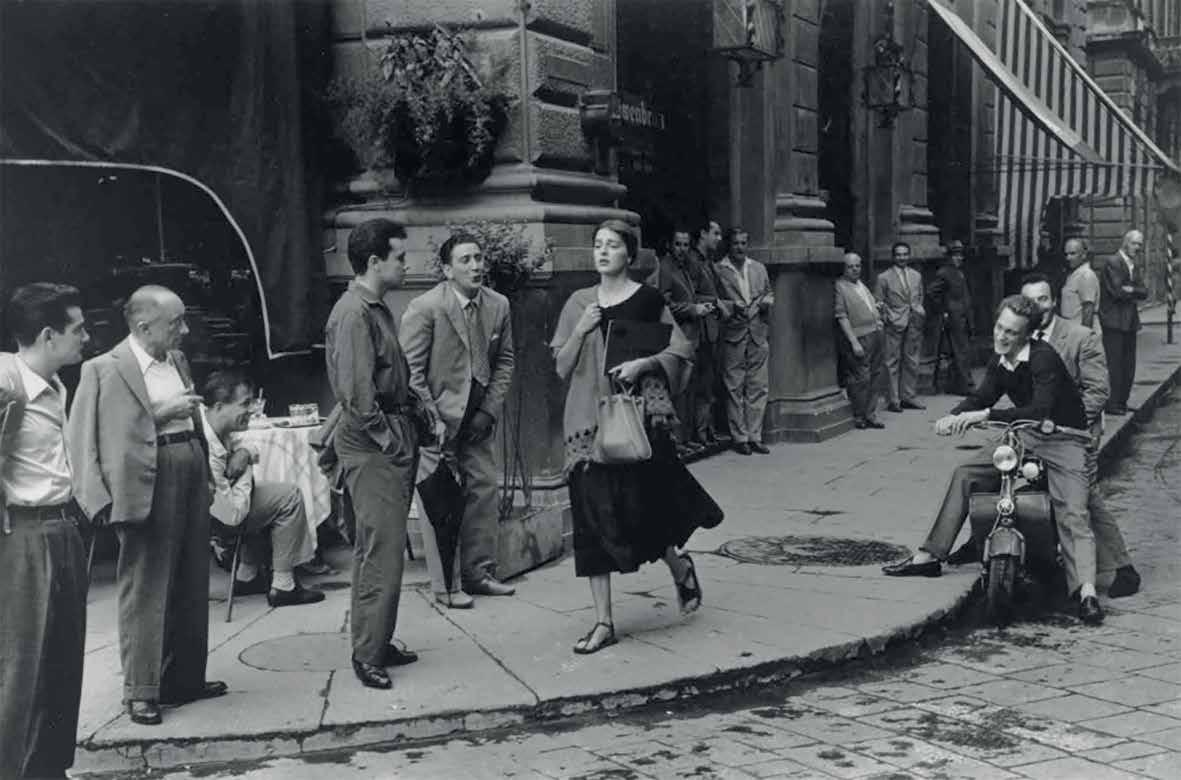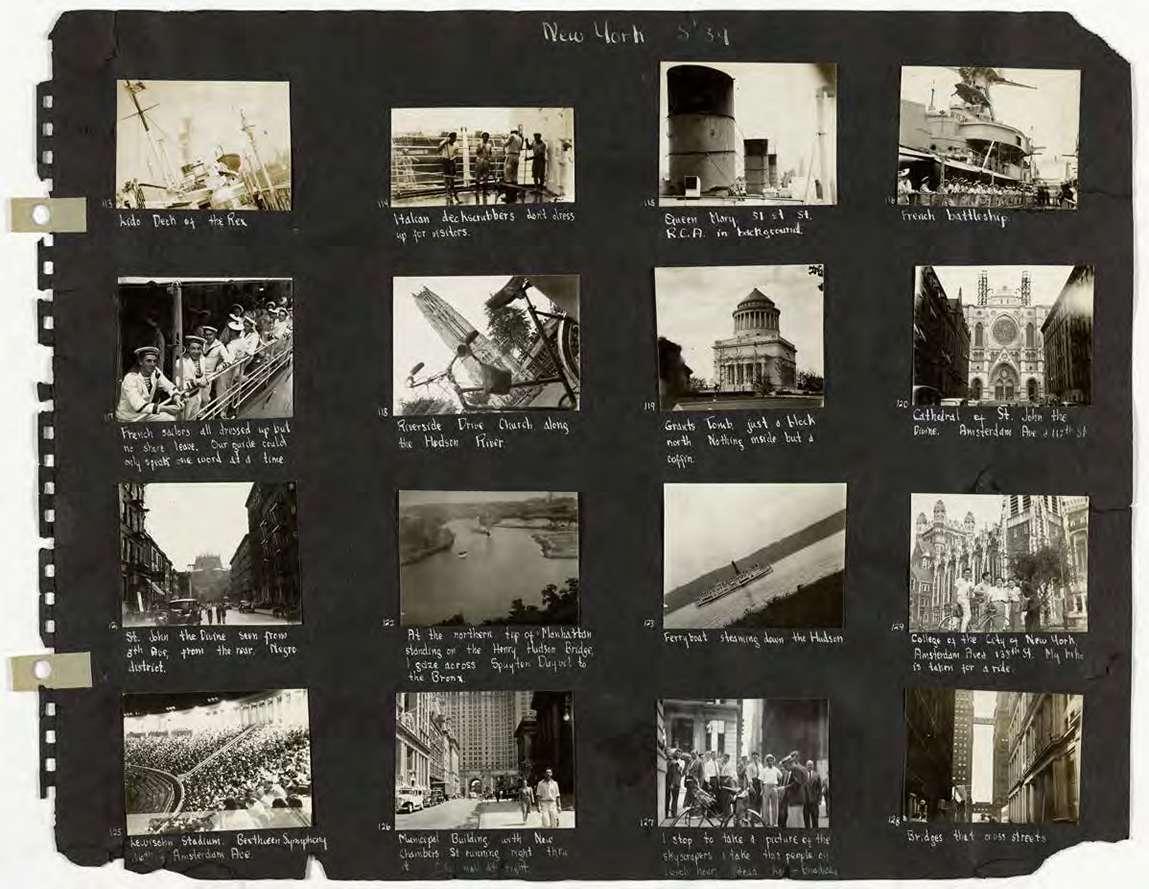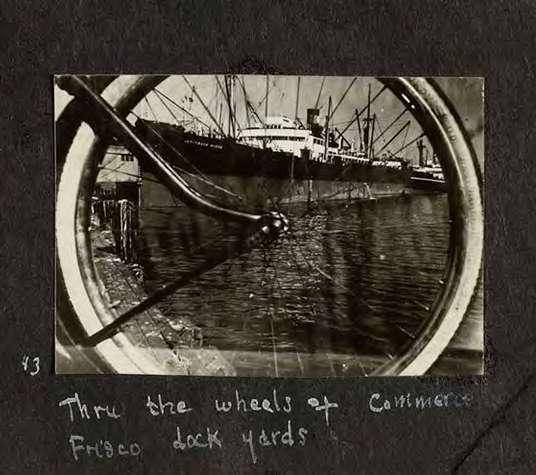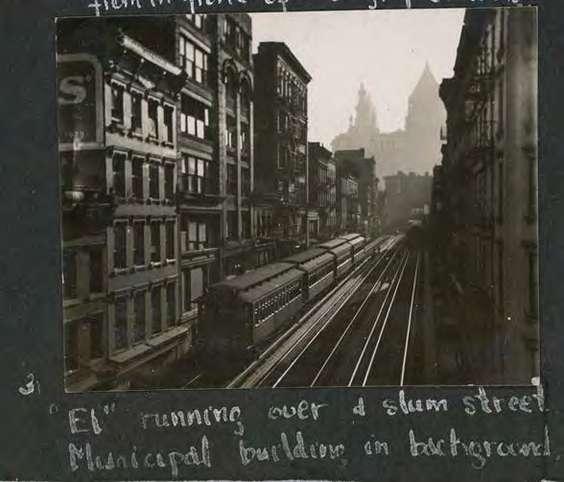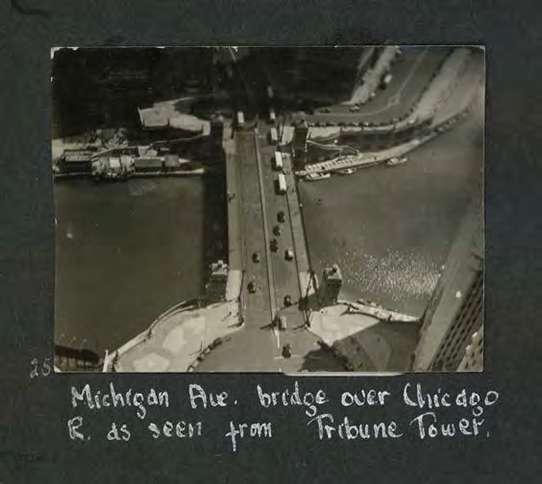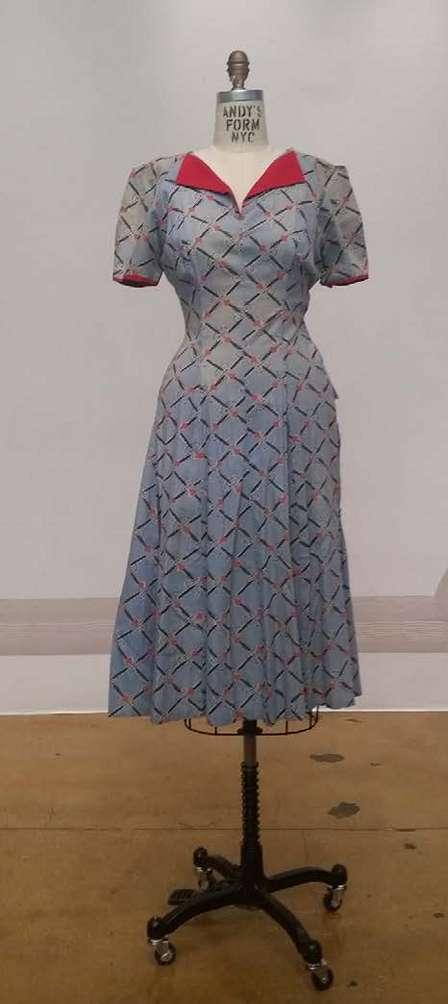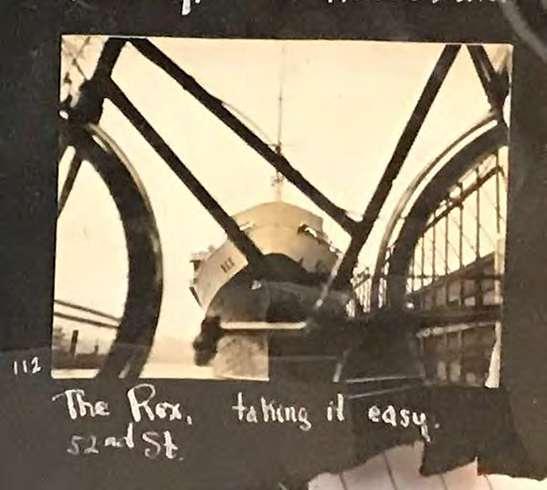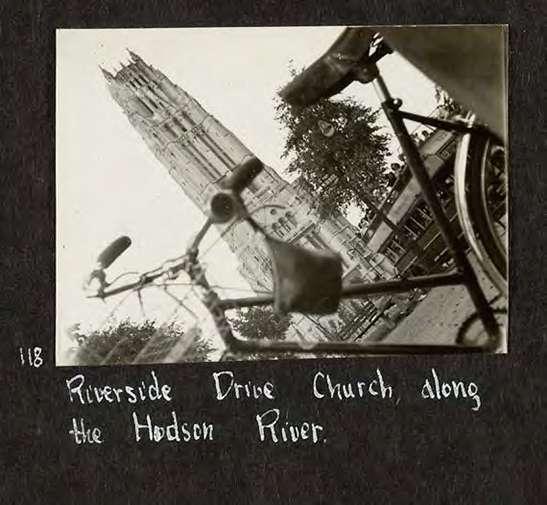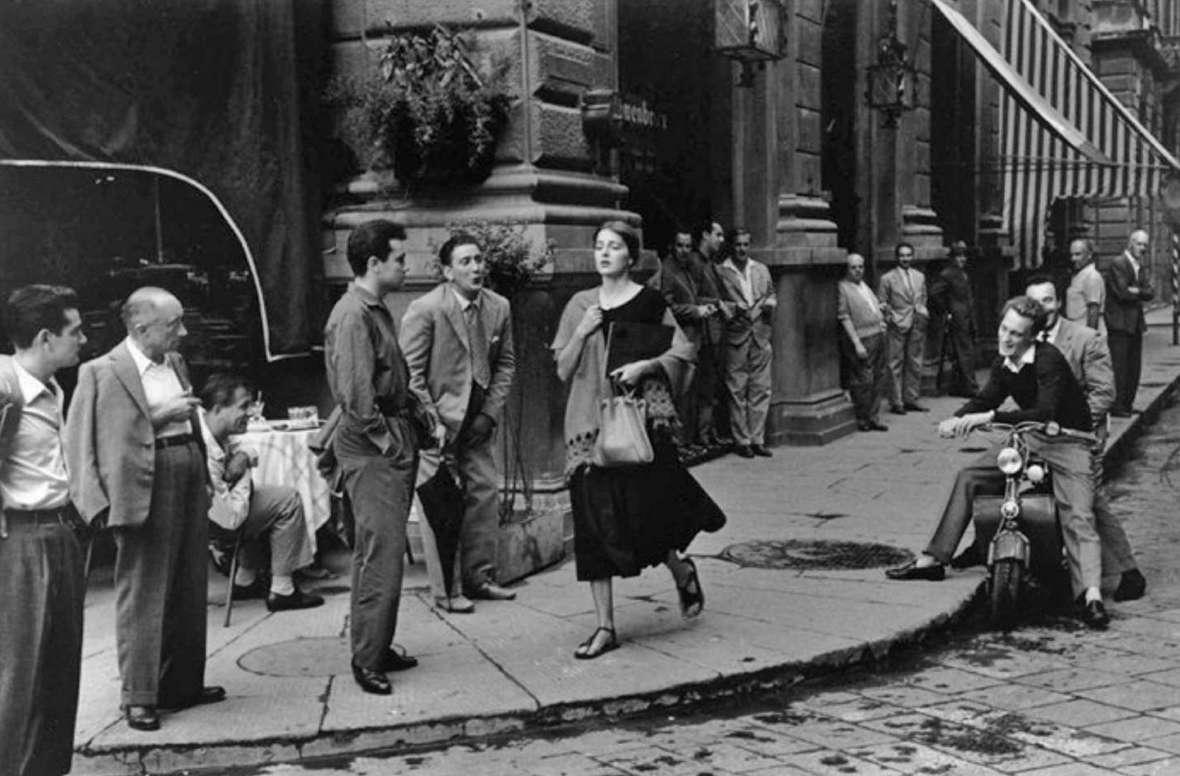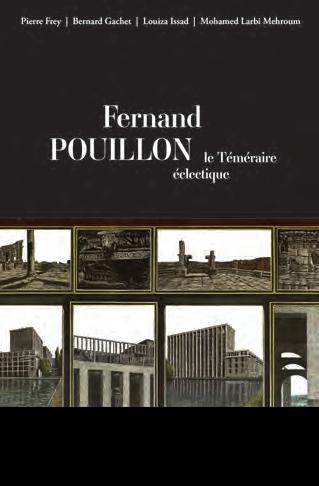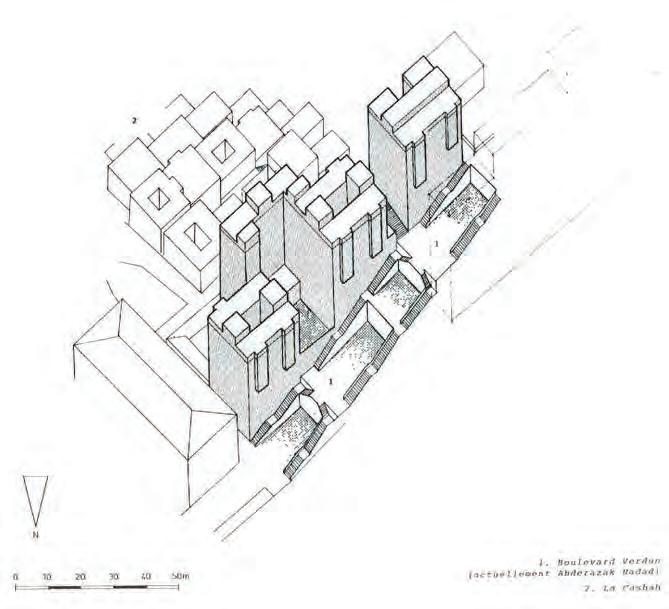Diffusion ACTES SUD
Août septembre 2023
Beaux-livres

TOUS LES VISUELS PRESENTÉS DANS CE DOCUMENT SONT PROVISOIRES & PEUVENT NE
PAS REFLÉTER LA FINALITÉ DES PROJETS ÉDITORIAUX
Les visuels qui n’apparaissent pas sont toujours en cours de développement
LA FINANCE AU SECOURS DE L’ÉCOLOGIE

Regards croisés sur la finance durable
Dominique Bourg et Philippe Zaouati Entretien mené par Anne-Cécile Bras
Comment la finance, de simple outil qui facilite le commerce, est-elle devenue, ces cinquante dernières années, le mastodonte que l’on connaît, déconnecté de toute réalité matérielle ? Aristote, premier philosophe de l’économie, alertait déjà sur la différence entre l’échange économique de biens et l’échange chrématistique, c’est-à-dire le commerce dans le seul but d’accumuler le plus d’argent possible. Avec l’invention de la monnaie est née la tentation de la démesure, de l’enrichissement infini et de la toute-puissance qui lui est associée. À tel point que l’on est en droit de se demander qui, du pouvoir politique ou du pouvoir économique, est véritablement aux manettes aujourd’hui.
Croissance et finance s’autoalimentent dans un mouvement perpétuel que rien ne semble pouvoir arrêter. Pourtant, si les zéros peuvent s’ajouter à l’infini sur les écrans des traders, les ressources de la planète sont, elles, limitées. Devant l’urgence écologique, la finance peut-elle jouer un autre rôle que celui du pompier pyromane ? Si l’ambition sincère de la finance durable est de dépasser le greenwashing pour atteindre les objectifs du développement durable, en a-t-elle réellement les capacités ? Quels sont ses outils pour y parvenir ?
Le financier met en garde : “Nous ne pouvons pas nous contenter de discuter entre professionnels de la façon d’utiliser tel ou tel critère environnemental et social pour sélectionner nos investissements. Si on ne parvient pas à « dézoomer » en adoptant une réflexion un peu plus macroéconomique, on devient des techniciens qui parlons à d’autres techniciens. C’est à mon avis le danger principal de la généralisation de la finance durable que l’on observe aujourd’hui.” Qu’en pense le philosophe ? La prise de recul est effectivement nécessaire et il est intéressant de remettre en perspective les ambitions de l’homme depuis le mécanocène, pour mieux comprendre ce qui l’a conduit à cette obsession d’aller toujours plus vite, plus loin, plus fort : “Avec l’avènement de la physique mécaniste moderne, le monde finit par apparaître comme un simple agrégat de particules distribuées de façon continue. […] Déchue du statut de déesse à celui de pure matière, la nature n’aura d’autre vocation que celle de ressource vouée à une exploitation sans fin, de ressource destinée à la création de valeur économique via le travail humain.” Il paraît dès lors urgent de redonner sa primauté au vivant. Mais alors que le réchauffement climatique est déjà en marche, la question de l’action juste se pose : faut-il se radicaliser ou est-il finalement plus pertinent de réformer le système en place ?
À travers leur échange, Dominique Bourg et Philippe Zaouati brossent un état des lieux sans concession du système financier actuel et de sa capacité à faire évoluer l’économie dans le bon sens. Avec une certitude commune :
Repères
Points forts
• Un décryptage de qualité des enjeux de la finance contemporaine.
• Des prises de position sur la nouvelle réglementation européenne.
• Deux auteurs très impliqués dans le débat écologique.
• Parution au moment du festival Agir pour le vivant, fin août à Arles.
Philosophe francosuisse, Dominique Bourg est professeur honoraire à l’université de Lausanne. Spécialiste des questions de durabilité et de démocratie écologique, il a fait partie de la commission Coppens qui a préparé la charte de l’environnement en 2005, et a présidé le conseil scientifique de la Fondation Nicolas-Hulot pour la nature et l’homme. Il a publié de nombreux articles et livres, dont Primauté de vivant (Puf, 2021) avec Sophie Swaton, et Science et prudence (Puf, 2022) avec Nicolas Bouleau.
Diplômé de l’École nationale de la statistique et de l’administration économique, Philippe Zaouati est le fondateur de Mirova, société de gestion d’actifs reconnue comme l’un des pionniers de la finance verte et durable. Fortement impliqué dans le débat public, il a contribué à la création de labels et de normes de transparence sur le climat, et a été membre du Groupe d’experts de haut niveau européen (hleg) sur la finance durable. Auteur d’essais et de romans, il intervient dans plusieurs écoles et universités.
Visuel provisoire - Diffusion Actes Sud société
10 × 19 cm 144 pages
provisoire
15 €
“Même si nous pensons la catastrophe inéluctable, nous devons continuer à agir.”
ouvrage broché isbn : 978-2-330-17868-0 août 2023 prix
:
9:HSMDNA=V\][]U:
250 illustrations en couleur isbn : 978-2-330-18137-6
GUIDE DE L’ÉGYPTE ANCIENNE
[Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée]
Aude Gros de Beler
Jean-Claude Golvin
Voyager à travers l’Égypte ancienne en regardant les villes, les temples ou les pyramides tels qu’ils étaient au temps de leur splendeur devient un rêve accessible. Ce guide offre la combinaison unique du talent de Jean-Claude Golvin, premier spécialiste au monde de la restitution par l’image des grands sites de l’Antiquité, et des connaissances de l’égyptologue Aude Gros de Beler, pour un guide à la fois savant et superbement illustré. Si les magnifiques aquarelles nous présentent les sites au temps des pharaons, l’ouvrage, dans un souci de précision archéologique, propose également des plans des tombes et des temples, des cartes, des photographies de l’intérieur des sépultures (civiles et royales), au total plus de deux cent cinquante images pour illustrer le propos. Le guide permet ainsi d’appréhender clairement les sites anciens, et de constituer une base solide de connaissances avant même d’être sur place, puis d’accompagner de manière circonstanciée les excursions. En plus de la description détaillée des sites, un texte les replace dans leur contexte religieux, économique et historique, et des conseils de visite sont donnés pour chaque lieu visité.
Cet ouvrage constitue le compagnon indispensable du voyageur désireux de comprendre le secret des vestiges qui, souvent dénaturés par le temps, s’offrent sous un jour nouveau à ses yeux.
Jean-Claude Golvin est architecte dplg et directeur de recherche au cnrs. Il a dirigé pendant dix ans le Centre franco-égyptien de Karnak. Il est l’auteur de très nombreux ouvrages, notamment la série des “Voyages” aux éditions Errance & Picard.
Aude Gros de Beler est égyptologue, chargée de cours à la faculté Vauban (Nîmes), éditrice aux éditions Actes Sud.
Elle a écrit une quinzaine d’ouvrages sur l’Égypte (jeunesse et adulte).
Tous deux sont coauteurs de L’Antiquité retrouvée (Errance, 2023, 5e édition).
Repères
Points forts
• Un guide complet, par une autrice égyptologue qui a travaillé sur les sites pendant de nombreuses années.
• Une invitation au voyage avant même d’être arrivé sur place.
• Les aquarelles de Jean-Claude Golvin, ainsi que de nombreux éléments d’iconographie (plans, cartes), pour un ouvrage précis et esthétique.
Mots clés
• Égypte – Archéologie – Temples – Voyage – Guide –Aquarelles




Visuel provisoire - Diffusion Actes Sud
14 × 19 cm 272 pages
2023 prix provisoire : 25 €
août
’ - 9:HSMDNA=V]VX\[:
Le site de Medinet Habou sous le règne de Ramsès III
du sanctuaire 12. Lac artificiel 13. Écuries et hangars pour les chars 14. Temple de la XVIIIe dynastie, dit temple “des Thoutmosis” 15. Lac sacré 16. Bosquet 17. Constructions administratives 18. Habitations et locaux réservés aux prêtres 19. Rempart bastionné en brique crue
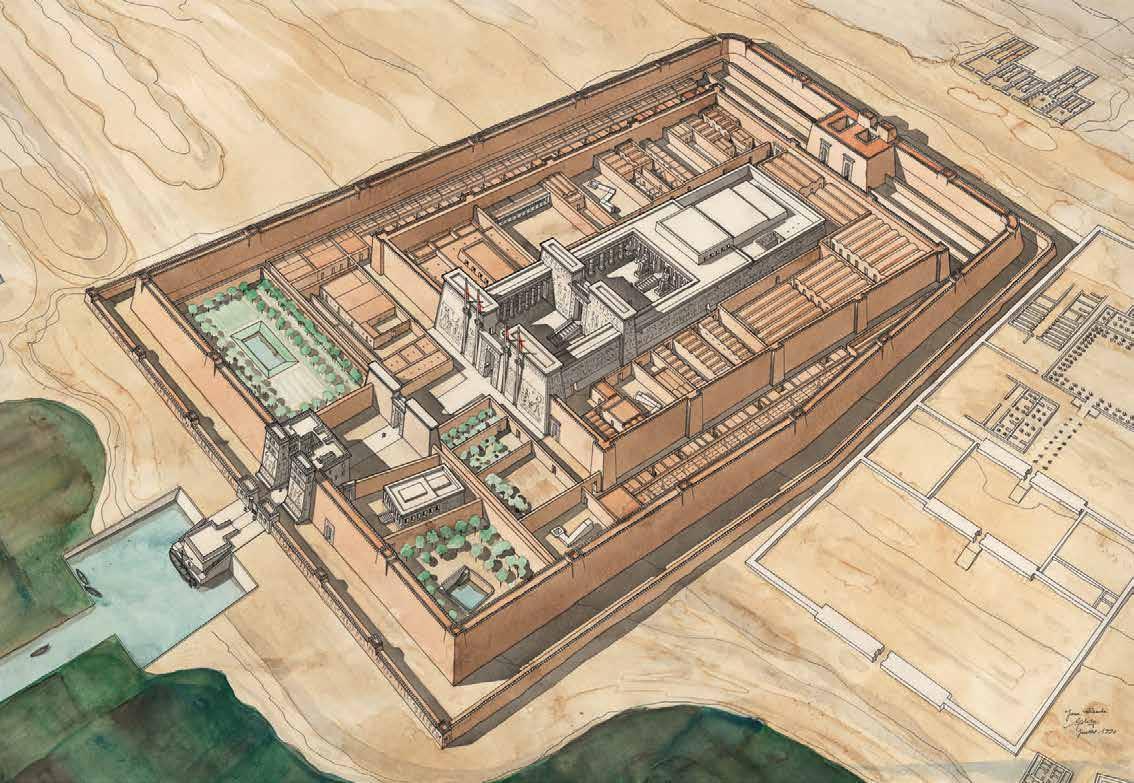
(1184-1153 ..-.)
1. Débarcadère 2. Enceinte extérieure en pierre de taille 3. Temple funéraire d’Ay et Horemheb 4. Enceinte intermédiaire en brique crue 5. “Migdol” de l’est adoptant la forme d’une tour de garde asiatique 6. “Migdol” de l’ouest (disparu) 7. Premier pylône 8. Temple funéraire de Ramsès III 9. Palais royal 10. Entrepôts et réserves 11. Porte aménagée dans l’axe
1 2 4 5 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 044/065•Digest 2023.indd 50-51 09/03/2023 21:12
Thèbes
La région thébaine
Très bel ensemble d’édifices, le mieux conservé des sanctuaires de ce type sur la rive ouest de Thèbes ; certaines parties, notamment les plafonds, linteaux et portiques de la deuxième cour, possèdent encore leurs couleurs d’origine. Demander au gardien de monter dans le “migdol” (pavillon royal) qui présente des scènes aussi originales que charmantes et ne pas oublier de faire le tour du temple car les murs extérieurs sont parfois ornés de scènes grandioses: en témoigne, sur le revers du premier pylône, la célèbre chasse aux taureaux sauvages conduite par le roi lui-même.
La reconstitution montre comment, sous le règne de Ramsès III, s’organisait le site de Medinet Habou. Parmi les structures qui apparaissent sur le dessin, certaines ont disparu et d’autres restent visibles, entières ou fragmentaires.
On arrive à Medinet Habou par un canal artificiel reliant le Nil à un débarcadère (1) dominé par une tribune permettant d’accéder, par deux volées de marches, aux bateaux amarrés le long des quais. Construite dans l’axe du temple, cette tribune rejoint une première porte percée dans un mur en pierre de taille, de faible hauteur et non bastionné, entourant l’ensemble des édifices cultuels et faisant office d’enceinte extérieure (2). À mi-course, sa face nord accuse un changement d’orientation de quelques degrés à cause de la présence du temple funéraire voisin (3), construit par Ay et Horemheb à la fin de la XVIIIe dynastie. À peine quelques mètres séparent le muret extérieur de l’enceinte intermédiaire (4). Celle-ci, construite en brique crue, culmine à 20m de hauteur et s’inspire de modèles profondément asiatiques. Et pour cause: lors de ses campagnes en Syrie et en Palestine, largement représentées sur les parois de son sanctuaire, Ramsès III n’a cessé de côtoyer ce type de rempart avec chemin de ronde, tourelles, créneaux et portes fortifiées. À Medinet Habou, tous ces éléments apparaissent, y compris les fameuses tours de garde, couramment désignées sous le terme sémitique de “migdols” (5 et 6).
Seul celui situé à l’est (5) est bien conservé: il marque l’entrée du temple de Medinet Habou. Il devait en exister un équivalent à l’ouest (6), mais il n’en reste plus rien. La présence d’une telle construction dans le temple funéraire de Ramsès III doit être interprétée comme une porte d’entrée triomphale devant rappeler la victoire de Pharaon sur les peuples étrangers. En effet, les décors extérieurs présentent de nombreuses scènes où le roi, en taille héroïque, exécute des captifs devant les divinités du panthéon égyptien. De même, chaque tour est ornée d’une file de sept prisonniers ligotés qui symbolisent les ennemis héréditaires de l’Égypte. Ainsi, lorsque l’on pénètre à l’intérieur de la forteresse, composée de pièces réparties sur deux étages, on est surpris par le changement total de registre iconographique. Ici, ni sacrifices, ni guerres, ni victoires, ni pharaons glorieux. Les reliefs sont aimables et présentent le
Medinet Habou
roi, confortablement installé, qui se restaure, respire des fleurs ou joue au senet (sorte de jeu de dames) avec ses filles. Sans doute ces images doivent-elles nous éclairer sur la réelle fonction de ce bâtiment qui, en fait, devait servir de lieu de détente où, à l’occasion, le roi venait se reposer, se distraire ou se restaurer en compagnie de ses courtisans, de sa proche famille ou des femmes du harem.
“Migdol ouest” (détruit)
Campagne en Nubie
Calendrier des fêtes
Sanctuaire (détérioré)
Plan du temple de Ramsès III à Medinet Habou.
Thèbes
Première campagne en Libye Campagne contre les Peuples de la Mer, an 8
Fête de Sokaris (registre supérieur)
Palais royal Chapelles des Divines Adoratrices
2e cour 1re cour
Pylône
Chasse aux taureaux sauvages
Sortie de Min (registre supérieur)
Deuxième campagne en Libye, an 11 (scène finale)
Temple de la XVIIIe dynastie
Deuxième campagne en Libye, an 11 (registre inférieur) et campagne douteuse en Asie (registre supérieur)
“Migdol” est
Petit temple
52 53
:
1184-1153 Vers 1295
+ p. 50-51 et p.53
044/065•Digest 2023.indd 52-53 09/03/2023 21:12
Thèbes
La région thébaine
1279-1212
La nécropole des artisans de Deir el-Medina Située à l’ouest du vallon, elle abrite les sépultures des ouvriers et des fonctionnaires de l’Institution de la Tombe qui, pendant près de cinq siècles, ont œuvré dans la Vallée des Rois. Aménagées suivant un modèle composite, tenant à la fois de la pyramide héliopolitaine et de l’hypogée libyen, ces tombes présentent une véritable unité de structure (cour, chapelle, puits et caveau) même si, dans la composition finale, certains détails varient en fonction du rang du propriétaire ou de l’époque.
Ainsi, l’accès à la tombe s’effectue par un pylône d’entrée donnant sur une cour bordée de murets blanchis à la chaux. Au fond, s’ouvre la chapelle funéraire précédée d’un péristyle et ornée d’une petite pyramide dont la hauteur dépasse rarement 7 à 8 m. Ici, deux possibilités peuvent être envisagées. Soit la pyramide couvre la chapelle, soit elle l’inclut: dans le premier cas, la pyramide est pleine, en pierre ou en brique, et comblée de gravats; dans le second, elle est creuse et en brique. Quelle que soit la solution adoptée, ses faces sont blanchies à la chaux et le sommet orné d’un pyramidion en pierre décoré de bas-reliefs. C’est dans cette cour, lieu public par excellence, qu’ont lieu les funérailles ainsi que la Belle Fête de la Vallée du désert, grande fête des morts qui se déroule chaque année.
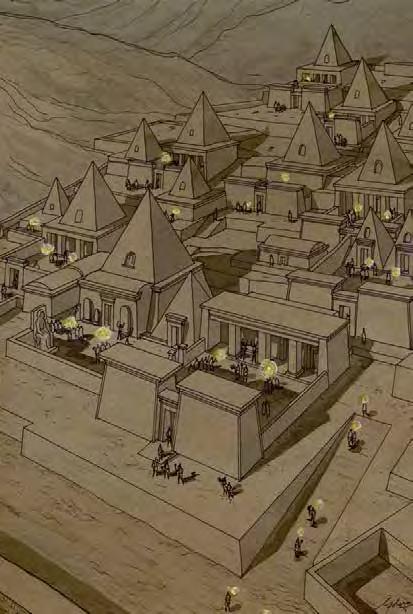
De part et d’autre de la porte ou sur les murs de la cour se trouvent des stèles et des statues du défunt devant lesquelles on vient déposer des offrandes et faire des fumigations d’encens ou des libations d’eau. On pénètre alors dans la chapelle aux parois décorées d’images du défunt et de sa famille car, très souvent, ces tombeaux sont collectifs. Le mur du fond est orné d’un petit naos où, généralement, se tient la statue du propriétaire. Le puits, creusé dans la cour ou dans la chapelle, conduit aux appartements funéraires dont les pièces, parfois nombreuses, sont voûtées, blanchies à la chaux et peintes de couleurs vives ; les scènes, fortement influencées par le décor des hypogées royaux pour lesquels les artisans travaillent, présentent des extraits du Livre de la sortie au jour (improprement appelé “Livre des morts”).
Parmi les cinquante-trois tombes décorées de Deir el-Medina, dont la plus grande majorité remontent au règne de Ramsès II, seulement quelques-unes sont ouvertes à la visite: généralement, Sennedjem (TT 1), Inerkhâou (TT 359), Irynefer (TT 290) et Pached (TT 3). Contrairement aux autres sépultures civiles de la nécropole thébaine (Cheikh Abd el-Gourna, Assassif, Dra Abou el-Naga…) où l’on visite généralement la chapelle funéraire, ici ce sont les caveaux qui s’ouvrent à nos yeux. Ils sont de petite taille, mais l’état de conservation des peintures qui ornent les parois et le plafond voûté est étonnant.
Thèbes
72 73
La nécropole de Deir el-Medina. 066/089•Digest 2023.indd 72-73 09/03/2023 21:13
Deir el-Medina

Temple de Louxor Thèbes ville Thèbes-Ouest Palais d’Amenhotep III Amenophium Vallée des Reines Deir el-Medina Temples funéraires Cime thébaine
Domaine de Montou [2] Domaine d’Amon [3]
Vallée des Rois Temple d’Hatshepsout Temple de Sethy Ier Thèbes-Est, Thèbes-Ouest au IIe siècle
10 9 7 8 4 5 6 3 2 11 15 12 13 14 18 16 17 19 Thèbes-Est 1 010/043•Digest•2023.indd 12-13 09/03/2023 21:12
Domaine de Mout [4] Temple d’Amon-Kematef [5] Temple de Khonsou [6]
apr.J.-C.
Le Ramesseum, le temple funéraire de Ramsès II
 (1279-1213 ..-.)
(1279-1213 ..-.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 044/065•Digest 2023.indd 56-57 09/03/2023 21:12
1. Débarcadère (relié au Nil par un canal), tribune et allée processionnelle permettant d’accéder à l’enceinte sacrée 2. Temple funéraire de Thoutmosis IV (XVIII e dynastie) 3. Temple funéraire de Siptah (XIX e dynastie) 4. Enceinte extérieure en pierre 5. Enceinte intérieure en brique crue (l’espace compris entre les deux enceintes est occupé par un dromos de sphinx) 6. Premier pylône 7. Première cour 8. Deuxième pylône 9. Deuxième cour 10. Grande salle hypostyle 11. Saint des saints 12. Petit temple de Touy, mère de Ramsès II 13. Magasins et entrepôts du sanctuaire 14. Palais royal
TT 40 - Houy
Vice-roi de Kouch, Gouverneur des Pays du Sud. XVIIIe dynastie, règnes d’Akhenaton (1349-1333 av. J.-C.) et de Toutânkhamon (1330-1320 av.J.-C.)
Outre la qualité incontestable de la représentation et du style, l’intérêt de cette sépulture réside dans son thème iconographique : en tant que vice-roi de Kouch – c’est-àdire gouverneur de Nubie –, Houy vient présenter à Toutânkhamon le tribut annuel du Sud.Ainsi, on assiste à l’arrivée des bateaux chargés de produits exotiques et de métaux précieux et au défilé des différentes provinces de Nubie (Kouch au sud et Ouaouat au nord) déposant leurs présents au pied de Pharaon.
TT 276 - Amenemopet
Surveillant du Trésor d’or et d’argent, Juge, Surveillant du Cabinet. XVIIIe dynastie, règne de Thoutmosis IV (?) (1398-1388 av.J.-C.)

S’il ne fait aucun doute que les peintures ne témoignent pas d’un style éclatant, on reste toutefois admiratif devant certaines images de cette tombe où, notamment dans les scènes de chasse dans le désert, l’artiste a su parfaitement saisir les expressions de terreur ou de torpeur des animaux traqués, puis emmenés par les chasseurs.

TT 277 - Ameneminet
Père divin de la Maison d’Amenhotep III, XIXe (1295-1188 av.J.-C.) ou XXe dynastie (1188-1069 av.J.-C.), règne non déterminé


Si la qualité d’exécution n’est pas exceptionnelle, les scènes présentées dans cette sépulture sont assez rares. On y voit, notamment, la procession des statues royales d’Amenhotep III et de la reine Tiyi, qui sont déplacées en traîneau, se dirigeant vers le lac sacré du sanctuaire, escortées par des prêtres et des flabellifères.

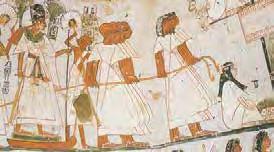
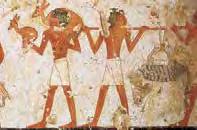
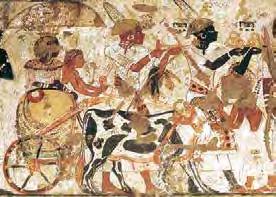

88 89 La région thébaine
89 88
Thèbes Thèbes
-
La Vallée des Nobles
066/089•Digest 2023.indd 88-89 09/03/2023 21:13
Instantanés sereins

Joseph-Antoine d’Ornano
Langue d’origine : français
1eк office septembre 2023 / 9782355970597
12 euros / 50-60 p. / 15 x 13 cm


Des mots sépia, noirs et blancs, en couleur, à l’instar des tableaux de l’auteur, dont la visée est l’apaisement pour l’artiste et pour le lecteur-contemplateur. Bref, des « Instantanés sereins »

Il ne s’agit pas, comme dans La grâce ou l’éloge du commencement, du déroulement d’un unique texte, mais de brefs poèmes, cependant l’esprit est le même. On y retrouve, en plus marquée, la soudaineté et la fugacité d’impressions – de celles, souvent indéfinissables, qui vous font brusquement interrompre un geste ou une parole.
De tableau en tableau, de livre en livre, Joseph-Antoine d’Ornano tente de capturer ces « instants de vie secrète » pour les poser sur la toile ou le papier.
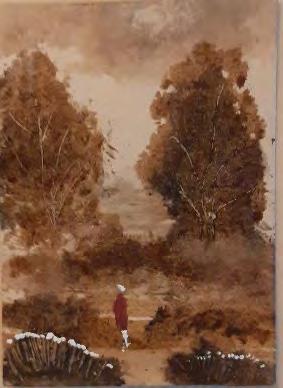
Ici l’image d’une robe jaune ou blanche et de ballerines ; là, la tristesse du soir que « connaissent les fleurs » ; ailleurs encore un « jour de semaine ordinaire / Où rien vraiment ne s’est passé / Rien qui vaille la peine », mais dont on se souviendra peut-être, à l’heure du départ ultime, « comme d’un jour heureux ».
Nostalgie, dira-t-on ? Non point. Douceur, luminosité, mystère aussi, seraient des mots plus appropriés. Au lecteur-contemplateur d’apprécier les deux premières et d’essayer de saisir, s’il le souhaite, la clef du dernier. « Tout n’est pas donné », aime à répéter Joseph-Antoine d’Ornano.
Olivier Besancenot est historien de formation Facteur de profession, il a été deux fois le candidat de la LCR aux élections présidentielles (2002 et 2007) avant d'être jusqu'en 2011 le porte-parole du NPA. Il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages sur l’histoire du mouvement ouvrier et des luttes sociales.
SEPTEMBRE ROUGE
Le coup d’État au Chili du 11 septembre 1973
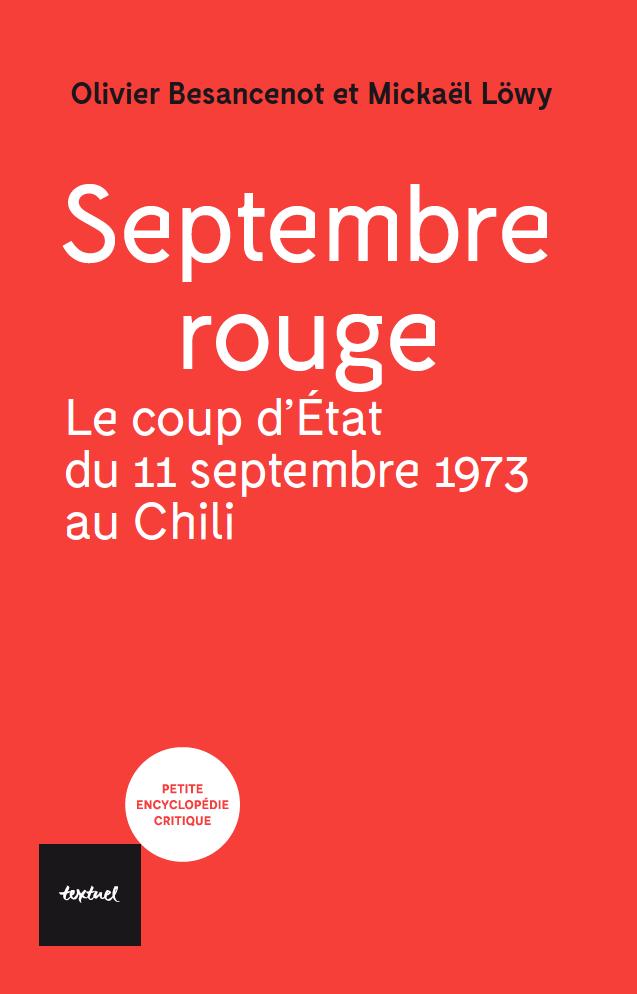 Olivier Besancenot et Michaël Löwy
Olivier Besancenot et Michaël Löwy
Cinquantième anniversaire du coup d’état de Pinochet au Chili.
Cette fiction historique basée sur des faits réels rend hommage aux militants qui ont affronté, le 11 Septembre 1973, le coup militaire sanglant du Général Pinochet et de ses troupes. Ni livre d’histoire, ni essai théorique, ce récit politique romancé traite de la conspiration putschiste et de cette journée du 11 septembre.
Cette séquence historique est revisitée à travers le point de vue d’acteurs et actrices de la gauche chilienne de l’époque qui ont résisté en combattants, les armes à la main. Parmi eux, celui qui a refusé de capituler jusqu’à son dernier souffle : Salvador Allende. Alors qu’il représentait l’espoir de la gauche de tout un continent, il se donne la mort peu avant que les putschistes tentent de s’emparer de lui. Symbole de la vague d’autoritarisme anticommuniste que connut l’Amérique du sud durant les années 70, le coup d’État de la junte militaire intervient dans un contexte de guerre froide Il a été rendu possible par le soutien des Etats-Unis qui dès le début de la présidence d’Allende organise un boycott des prêts internationaux plongeant le Chili dans une grave crise économique.
• Un parti-pris original, celui d’un récit romancé fondé sur une solide enquête par deux voix importantes de la gauche contemporaine.
• Un hommage à Salvador Allende dont le terrible destin a profondément marqué la gauche française, passionnée par la gauche latinoaméricaine.
• Le récit implacable de la liquidation d’un État de droit sur l’autel du capitalisme.

Michael Löwy, est sociologue, philosophe marxiste et écosocialiste francobrésilien. Il est directeur de recherches émérite au CNRS et enseigne à l’EHESS. Il a cosigné chez Textuel Luttes écologiques et sociales dans le monde (2020) avec Daniel Tanuro.
La France, elle, fait face au coup d’État en ouvrant les portes de son ambassade à près de 800 réfugiés qu’elle exfiltrera, leur permettant d’échapper aux camps et à la torture.
50 ans du coup d’État de Pinochet au Chili le 11 septembre 2023.
6 septembre 2023 • Histoire • Récit • Politique 13 x 19,8, broché 160 pages, 17,90€ 9782845979642
Sociologue, Charles BosvieuxOnyekwelu est chargé de recherche au CNRS. Ses travaux portent sur la sociologie des élites, du travail et des professions ainsi que sur les études de genre Il s’intéresse en particulier aux différentes manières par lesquelles les élites justifient les inégalités et leur domination sur le monde social. Il a notamment publié Croire en l’État : une genèse de l’idée de service public en France (18731940) (éditions du Croquant, 2020)
PRÉCARITÉ GÉNÉRALE TÉMOIGNAGE D’UN RESCAPÉ DE L’UNIVERSITÉ
 Charles Bosvieux-Onyekwelu
Charles Bosvieux-Onyekwelu
L’université, un navire en train de couler.
La précarité vampirise l’enseignement supérieur et la recherche Plus de 50% des enseignements sont assurés par des personnels non-titulaires. À l’indétermination de l’avenir s’ajoutent l’injonction à la mobilité, l’instabilité géographique et le silencieux chantage au poste qui conduit les postulants à tout accepter.

En s’appuyant sur les travaux sociologiques traitant de la mise en faillite des services publics, ce livre analyse les causes et les effets de la précarité grandissante qui sévit dans le secteur de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche La précarisation des universitaires s’inscrit dans un contexte plus large, marqué par la fragilisation de l’emploi public et la mise en cause du statut des fonctionnaires.
C’est en lien avec ces évolutions délétères pour tous et toutes que prennent sens les diverses mobilisations qu’a connues l’Université depuis une quinzaine d’années, mobilisations qu’on ne peut déconnecter de la constitution d’un service public de l’enseignement supérieur et de la recherche, c’est-à-dire de l’idéal d’une éducation et d’un savoir accessibles au plus grand nombre.
• Une analyse minutieuse des réformes néolibérales imposées à l’université depuis une vingtaine d’années et de leurs effets: développement de la recherche sur projet, recours massif aux vacataires pour l’enseignement, turnover permanent du personnel administratif, etc.
• Un témoignage vécu de l’intérieur des absurdités, des souffrances et du gâchis que constitue cette précarisation délibérée de l’université.
• Une mise en perspective sociologique de l’inscription de la faillite de l’Université dans celle plus large des services publics.
13 septembre 2023 • Société • Université 13 x 19,8, broché 160 pages, 17,90€ 9782845979635
EMBARQUEMENTS IMMÉDIATS
De la préhistoire à la Renaissance
Didier Huon de Kervadec
Repères
Points forts
Ainsi parlait saint Augustin d’Hippone, théologien chrétien romain du ive siècle. Combien connaît-on de maximes sur le voyage, toutes plus sérieuses, profondes et évocatrices sur l’envie, la nécessité, parfois la peur de parcourir le monde ? Ce livre retrace l’histoire du voyage et des déplacements de populations. Départ à la Préhistoire, arrivée dans le monde moderne ! Comme une dynamique déambulation, l’auteur nous guide sur les pas de l’Homme et de ses incessantes pérégrinations. Première étape, les hommes préhistoriques, en constant mouvement dans des conditions hostiles pour assurer leur survie, trouver de quoi se nourrir et se protéger. Puis au fil de son développement, il s’installe et crée de grandes civilisations dont les frontières s’étendent autour des premières aires urbaines. Qui dit frontières dit guerres de territoires, dont nous suivons les armées lancées au galop pour s’approprier l’espace de l’ennemi. L’avènement des religions monothéistes apporte aussi son lot de mutations, en raison des missionnaires, croisés et autres prosélytes envoyés parfois à l’autre bout du monde pour convaincre de la foi à adopter – ou l’imposer par la force. La curiosité grandit à mesure que les limites du monde s’étendent ; et les grands voyageurs l’explorent, parfois par intérêt pour la géographie et les civilisations, comme Ibn Battuta ou Zheng He, parfois par attrait commercial, comme Marco Polo qui en tire ses Carnets de la route de la Soie. S’ouvre ensuite l’ère des conquêtes occidentales, avec pour chefs de file les colons débarquant en Amérique, qui l’envahiront du détroit de Béring au cap Horn.
Entre périodes troubles et joies de la découverte, ce livre enjoué ouvre les horizons, éclaire les motivations
le monde d’hier et d’aujourd’hui.
• Un ouvrage ambitieux sur un sujet original : l’histoire du voyage des Hommes depuis la Préhistoire jusqu’à l’époque moderne.
• Un récit qui nous emmène sur les pas de voyageurs aussi bien mythiques qu’inconnus du grand public, tout autour de la terre.
• Un style enlevé et dynamique, rendant la lecture accessible.
Mots-clés
• voyage – histoire – géographie – migrations – récit
Ancien sportif de haut niveau et retraité d’une carrière dans l’immobilier, Didier Huon de Kervadec se passionne pour la géographie et l’histoire. Ses nombreux voyages l’ont mené sur les cinq continents.

ACTES SUD Visuel provisoire - Diffusion Actes Sud
“Le monde est un livre, et ceux qui ne voyagent pas n’en lisent qu’une page.”
14,5 × 24 cm 592 pages ouvrage broché isbn : 978-2-330-17948-9 juin 2023 prix provisoire : 30 €
humaines pour le voyage et retrace les itinéraires qui ont façonné
EmbarquEmEnts immédiats
9:HSMDNA=V\^Y]^:
didiEr Huon dE KErvadEc
978-2-330-18109-3
provisoire : 29 €
VOYAGE SUR LA MÉDITERRANÉE ROMAINE
[Troisième édition, revue et corrigée]
Jean-Claude Golvin et Michel Reddé
Jamais dans l’histoire la Méditerranée et les terres qui la bordent ne se sont trouvées unies au sein d’un même ensemble politique, sinon sous l’autorité de Rome, pendant les quatre premiers siècles de notre ère. Or la mer est source de profits infinis pour celui qui sait la dominer et mettre en relation des mondes étrangers. La Méditerranée est ainsi le centre et l’émanation du plus vaste et durable empire de l’Europe, le lien entre des pays encore plus différents à cette époque qu’ils ne le sont aujourd’hui.
Ce livre nous invite à un grand voyage entre les rivages de cette mer intérieure qui unit l’Orient et l’Occident, l’Europe et l’Afrique. Alexandrie, Athènes, Pouzzoles, Rome, Arles, Carthage, Leptis Magna… sont autant d’escales où le talent de Jean-Claude Golvin nous permet d’accoster. Jean-Marie Gassend illustre la manœuvre des voiliers à l’aide d’aquarelles qui donnent envie de s’embarquer et de suivre le vent. Michel Reddé nous décrit la navigation de ces milliers de bateaux qui sillonnent sans cesse les vastes étendues liquides pour assurer le transport du blé, de l’huile, du vin et ravitailler les grandes villes du monde romain, tandis que les flottes militaires assurent la paix sur une Méditerranée que les Romains ont faite leur pour régner sur le monde. Mare nostrum, “c’est notre mer”, disent-ils alors en parlant d’elle.
Michel Reddé est archéologue et historien ; ses spécialités sont l’armée romaine, les camps militaires et la marine militaire romains. Ancien professeur des universités à l’université de Nantes, il est désormais directeur d’études émérite à l’école pratique des Hautes Études.
Jean-Claude Golvin est architecte dplg et directeur de recherche au cnrs. Il a dirigé pendant dix ans le Centre franco-égyptien de Karnak. Il est l’auteur de très nombreux ouvrages, notamment la série des “Voyages” aux éditions Errance & Picard.
Repères
Points forts
• Le travail commun d’un historien et d’un illustrateur et archéologue, pour un ouvrage à la fois érudit et superbement illustré.
• Une source unique sur le fonctionnement et l’architecture des ports à l’époque romaine.
• Les magnifiques aquarelles de Jean-Claude Golvin pour replonger le lecteur les temps antiques.
Mots clés
• Méditerranée – Port – Rome – Antiquité – Histoire –Archéologie – Aquarelles
Visuel provisoire - Diffusion Actes Sud
21 × 28 cm
prix
152 pages 70 illustrations en couleur isbn
septembre 2023
9:HSMDNA=V]VU^X:
On considère, traditionnellement, qu’il s’agit là du port commercial. Il donnait accès directement à la mer, par un goulet.
En apparence, ces deux bassins furent assez peu endommagés lors de la destruction de Carthage et les fouilleurs américains et britanniques ont retrouvé les quais et les installations sous une couche de débris de la cité punique, utilisés comme remblais par les Romains. Les deux bassins furent réutilisés après la refondation augustéenne, mais avec des fonctions différentes. L’ancien port de guerre perdit son rôle militaire, mais il n’accueillit sans doute pas des bateaux de fort tonnage, en raison d’une profondeur trop faible. Il fut, sous l’Empire, bordé d’une colonnade qui ouvrait sur des entrepôts, et abritait un temple dans l’îlot central, lui aussi entouré d’un portique. L’avant-port rectangulaire fut bordé lui aussi de magasins et de quais. Sa forme fut modifiée dans le courant du iie siècle de notre ère, les angles étant coupés, ce qui donna à ce plan d’eau un aspect qui rappelait celui du Portus Traiani, à Ostie. La capacité de la darse, toutefois, était assez faible, le tirant d’eau toujours insuffisant, et on peine à imaginer que c’était là le grand port par où transitait l’annone d’Afrique, où, selon une loi du Code Théodosien (XIV, 25), devait être concentré tout le ravitaillement de la province. Déjà Cicéron, vers la fin de la République, disait que la Carthage punique était succincta portibus, “entourée de ports” (De lege agraria, II, 32, 87). Quand, en 383 apr. J.-C., le futur saint Augustin s’embarqua pour Ostie, ce n’est sans doute
pas ce bassin qu’il utilisa. Mais seule l’archéologie pourra éventuellement, un jour, résoudre le problème des autres ports de Carthage, que nous ne connaissons pas encore.


L’autre production africaine : l’huile
Vers la fin du ier siècle de notre ère, les exportations africaines concernaient surtout les céréales ; on ne parlait guère de livraisons d’huile, car celle-ci n’avait pas encore très bonne réputation à Rome, au dire de Pline et de Juvénal. Cent ans plus tard, les choses avaient bien changé. L’huile d’olive constitue, on le sait, un produit de base de l’agriculture méditerranéenne. Corps gras essentiel, elle entre évidemment dans l’alimentation, et constitue une composante indispensable de nombreuses recettes culinaires. L’olive se consommait aussi, comme aujourd’hui, sous forme de fruits qui offrent un fort pouvoir énergétique. C’est aussi un produit indispensable aux soins du corps, il sert de base à de nombreux onguents et aux parfums. Avec le développement massif de l’usage des thermes, sous l’Empire, on en fit une consommation effrénée,
puisqu’on s’enduisait pour se faire masser. C’est encore une plante médicinale, en même temps qu’un combustible pour l’éclairage. Naturellement, il existait des variétés très importantes d’olives et d’huiles, ainsi que d’autres plantes grasses, et on ne les utilisait pas de manière indifférente : chacune avait sa fonction, sa qualité, son prix. L’Italie était un gros producteur d’huiles d’excellente qualité, fort estimées sur le marché de la capitale. Sous la République, les oliveraies étaient particulièrement développées en Sabine, dans le Samnium, la Campanie, l’Apulie et suffisaient largement à la consommation de la Péninsule, qui était exportatrice, même vers l’Orient. L’accroissement considérable de la population romaine, au dernier siècle avant notre ère, devait, comme pour le blé, inverser ces courants d’échanges. Si les olives et les huiles produites en Italie même continuèrent d’alimenter les grandes villes, en sus de la consommation locale, les quantités requises dépassaient désormais les possibilités de la métropole. Il fallait donc importer, d’autant que les prix, dans les provinces, étaient sans doute inférieurs, malgré le coût du transport. Désormais, c’étaient le sud de l’Espagne (Bétique), l’Istrie, l’Afrique (Tunisie) et la Tripolitaine qui allaient dominer le marché. On a ainsi estimé à 53 millions le nombre d’amphores vides déversées sur le Testaccio, à Rome ; encore ne s’agit-il là, probablement,
que d’une partie de la consommation romaine. Comme pour le blé, le commerce maritime destiné à la capitale s’effectua d’abord sur la base de contrats entre les gros producteurs et l’État, mais l’administration romaine s’assura progressivement de l’approvisionnement de ce produit indispensable. Sous Hadrien, l’annone semble englober non seulement la fourniture de blé mais aussi d’huile et, en 166, on voit apparaître un agent du préfet de l’annone, chargé de recenser l’huile d’Afrique et d’Espagne (CIL, II, 1180). À partir du règne de Septime Sévère (193211), on assiste aux premières livraisons gratuites, et à des achats sur le marché de Tripolitaine (A. E., 1973, 76). Mais il s’agissait de l’annone de la capitale. Ailleurs, pour les villes de moindre importance, la part de l’initiative privée resta sans doute longtemps prépondérante. C’est seulement vers la fin du iiie siècle et au Bas-Empire que l’on vit apparaître une véritable fiscalisation des livraisons d’huile ; encore ne fut-elle sans doute jamais généralisée. Le pouvoir se contentait de prélever, en nature, sous forme d’impôt, ce qui était nécessaire aux distributions gratuites, au ravitaillement des grandes villes, à l’armée. Mais, à côté de ces réquisitions subsistait évidemment un marché privé, libre.
84 85
Pressoirs à huile comme on en trouve fréquemment en Afrique : un bras de levier, ancré dans le mur du fond, est abaissé progressivement grâce à un treuil, de manière à écraser les “scourtins” (paniers) remplis d’olives. L’huile coule alors dans des bassins où elle est récupérée.
L’entrée du port de Leptis Magna, avec son phare, à droite.
aurait pris trois mois pour regagner, non sans peine, l’Italie, après avoir été dérouté tantôt vers les îles Gymnésies, tantôt vers la Sardaigne, tantôt même vers différents points de la côte libyenne vis à vis de ces îles. On exporte de Turdétanie [Bétique] du blé et du vin en grande quantité, ainsi qu’une huile dont l’excellence égale l’abondance. On en fait venir également de la cire, du miel, de la poix, quantité de graines d’écarlate et un cinabre qui ne le cède en rien à la terre de Sinope.” (III, 2, 6, trad. Les Belles Lettres)
Les découvertes archéologiques illustrent ici, mieux que partout ailleurs, la véracité des propos de Strabon. Les prospections qui ont eu lieu dans la vallée du Guadalquivir ont en effet montré la densité des vestiges agricoles de cette région, mais aussi la réalité d’une production locale d’amphores à huile bien caractéristiques, dont différents ateliers ont pu être identifiés. On retrouve ces amphores sur le marché romain, au Testaccio, dans tout l’Occident, en particulier dans la vallée du Rhône et jusque sur les sites militaires de la frontière de Rhénanie et de GrandeBretagne, ainsi que sur toutes les côtes atlantiques de la Gaule : leur présence est la marque de ces relations maritimes à longue distance, si fréquentes et si variées. Les “Dressel” 20, ainsi nommées selon la première typologie qui a été dressée par le savant allemand H. Dressel, à la fin du xixe siècle, présentent en effet une forme caractéristique qui les fait reconnaître entre toutes : leur panse quasi sphérique, sans épaulement marqué, ne comporte, à la base, qu’une très petite pointe ; leur col, court et étroit, porte deux anses courtes, solides, avec un timbre (marque de fabrique) inscrit dans leur pâte. L’épaisseur de la pâte, la taille du conteneur, jusqu’à 70 litres, entraînait un poids total très important, de l’ordre d’une centaine de kilos. On est assez bien renseigné sur la circulation de ces amphores grâce aux marques peintes sur le col, et qui se déclinent sur quatre lignes, que les spécialistes indiquent avec des lettres grecques :

1. Poids de l’amphore vide (en moyenne 30 à 35 kg) ;
2. Nom de l’exportateur (mercator) ;
3. Poids de l’huile contenue dans l’amphore (autour de 70 litres) ;
4. Nom du producteur ou du domaine, éventuellement date consulaire (à partir du iie siècle), port d’embarquement, parfois marque de contrôle douanier.
Les lagunes et la configuration du littoral narbonnais sous le Haut-Empire. 1. Narbo Martius (Narbonne).
2. L’Atax (aujourd’hui l’Aude). 3. Lac Rubresus (bassins lagunaires partiellement colmatés). 4. Île SaintMartin avec présence probable de la capitainerie du port. 5. Port-la-Nautique, avant-port de Narbonne de 30 av. J.-C. jusqu’à la fin du ier siècle apr. J.-C.
6. Mandirac-Castélou. L’embouchure de l’Atax est canalisée par deux digues dès le milieu du ier siècle de notre ère. 7. Port fluvial de Narbo Martius, quai d’Alsace.
Grâce à ces indications précises, une étude récente effectuée sur les sites militaires de la frontière de Germanie a pu ainsi mettre en évidence l’importance des circuits commerciaux, mais aussi l’existence de fournisseurs privilégiés, site par site, au IIe siècle de notre ère.
Une autre découverte extraordinaire est venue confirmer la richesse de la Bétique, la variété de ses exportations en même temps que le texte de Strabon : une épave, trouvée au large de Port-Vendres, dans le Languedoc (“PortVendres II”). L’épave, qui avait coulé à l’entrée du port, dans les années 40 de notre ère, a été fouillée de 1974 à 1984. C’est le chargement qui est intéressant, plus que la coque, qui a pratiquement disparu. On y a en effet reconnu plusieurs lingots d’étain blanc pur, provenant des mines d’Estrémadure, des lingots de cuivre, de plomb extrait dans la Sierra Morena, des amphores “vinaires” qui contenaient du defrutum – une sorte de vin cuit – de la meilleure qualité (c’est l’inscription qui le dit), des amphores contenant des saumures de maquereau, et des amphores à huile. Les marques peintes, très nombreuses, permettent d’identifier au moins neuf marchands, qui avaient réalisé un transport en commun, sans doute en affrétant un navire auprès d’un armateur (naviculaire). Un de ces négociants vendait à la fois de l’huile et du vin. Les timbres amphoriques permettent d’identifier au moins dix ateliers. On perçoit avec cette épave que le chargement devait être complexe et que l’idée qu’on se fait parfois d’une monoculture des grandes régions exportatrices ne correspond pas nécessairement à la réalité. Il est possible en effet – mais non certain – que les propriétaires de Bétique aient pratiqué à la fois la culture céréalière, celle de la vigne, celle de l’olivier. C’est toutefois cette dernière qui était la plus rentable, en terme de surplus commercial, alors que celle du vin était probablement secondaire. La région oléicole n’était pas limitée à un étroit couloir dans la vallée du Guadalquivir, mais correspondait à une vaste zone, qui utilisait les affluents du fleuve pour descendre les produits jusqu’à Hispalis (Séville), véritable port de mer à l’intérieur des terres. C’est là qu’on chargeait les bateaux, et l’État se préoccupa naturellement, à partir du IIIe siècle de notre ère, de surveiller ce commerce en nommant un procurator ad ripam Baetis, un agent impérial chargé du district douanier du Bétis
Une fois à l’embouchure du Guadalquivir, les navires de commerce trouvaient, selon Strabon, “la tour de Caepio, construite sur un rocher battu des flots, ouvrage admirable qui, pareil au phare, a été conçu pour la sauvegarde des navigateurs. En effet, comme les alluvions déposées par le fleuve provoquent la création de hauts-fonds et que la mer, devant son embouchure, est semée de récifs, il fallait un signal bien visible” (Strabon, III, 1, 9, trad. Les Belles Lettres). Après quoi, on passait devant Cadix, l’antique Gadès, en grec Gadeira, qui constituait un très grand port d’escale, en raison de sa position près du détroit de Gibraltar.
95
FRÉJUS
Créée entre 31 et 27 av. J.-C. pour accueillir des vétérans de la VIIIe légion et abriter les navires d’Antoine pris à Actium, la colonie romaine de Fréjus (Octavanorum colonia, quae Pacensis appellatur et classica, d’après Pline, H. N., III, 35) prenait la suite d’un premier établissement fondé par César (Forum Iulii). La présence d’une escadre semble attestée au moins jusqu’au début du Ier siècle de notre ère, et la vocation navale de Fréjus devait durer jusqu’aux guerres civiles qui suivirent la mort de Néron. La ville fut alors un enjeu stratégique entre les Vitelliens et les Othoniens. Après cette date, nous n’en entendons plus guère parler dans les sources. Jusqu’à une époque récente, notre connaissance des infrastructures de Fréjus était tributaire des fouilles menées avant la Seconde Guerre mondiale. Celles-ci avaient révélé un bassin portuaire de forme polygonale, d’environ 22 ha de superficie, aujourd’hui complètement envasé, même si ses môles, bien conservés par endroits, sont encore visibles dans le paysage actuel. Il est vraisemblable que ce port, installé au sud-est de la ville antique, a réutilisé une ancienne lagune, bien que de très importants travaux de dragage aient été nécessaires. Ses quais se développent sur une longueur d’environ 2 km. Celui du sud avait une largeur de 4 m, une longueur de 540 m. Il était surmonté par un rempart crénelé, haut de 4 m. Au nord et à l’est, les quais, moins bien connus, forment un rentrant dans le port, ménageant une sorte de goulet qui conduit à la mer libre, vers l’est, sans qu’on sache bien où se trouvait exactement le trait de côte antique. On connaît malheureusement assez mal les installations portuaires et il faut beaucoup se méfier des attributions traditionnelles des monuments de Fréjus. L’identification de la Lanterne d’Auguste, grande tour qui flanque le quai sud, du côté du goulet, et où l’on reconnaît d’ordinaire un phare, reste très improbable. Vers le nord-ouest, la colonie de Fréjus est installée immédiatement en bordure du port, mais les études récentes montrent qu’elle fut construite beaucoup plus progressivement qu’on ne l’a dit. Deux “plates-formes”, parfois considérées comme bastions, n’ont sans doute aucune fonction militaire : au sud, la butte Saint-Antoine abritait une villa, peut-être pour des fonctions officielles. Quant à l’enceinte urbaine, elle est usuelle pour une colonie romaine, mais n’a pas été construite telle que nous la connaissons aujourd’hui dès le début du règne d’Auguste.
Au sud-ouest de la ville, des fouilles menées dans les années 1970 ont permis de mettre en évidence les vestiges probables de casernements militaires, sans doute ceux du camp augustéen de la flotte, ce qui conduit actuellement à penser qu’un port primitif, non localisé avec exactitude, existait sans doute dans l’estuaire de l’Argens, au sud de la ville. C’est au mieux dans les premières décennies de notre ère (vers 30 ?) que le bassin fortifié, à l’est de la colonie, fut creusé. Peut-être abrita-t-il alors les vaisseaux de l’escadre, mais ce n’est pas sûr. Les vestiges d’un phare ont été découverts au large de Fréjus, sur l’îlot du “lion de mer”.

124 125
la capitale, à la fin de la République, donnée qu’on peut comparer à celle que les sources nous fournissent pour Paris, vers la fin du xviiie siècle (730 000 hl). Sans doute faut-il prendre ces chiffres avec prudence : ils offrent au moins un ordre de grandeur. Ajoutons à cette première raison l’appel que constituait désormais le marché des Italiens installés dans les provinces, négociants, mais aussi soldats, qui formaient une clientèle importante. Enfin, et surtout, le goût immodéré pour le vin de certains peuples barbares a favorisé la production massive de vin de qualité courante. L’archéologie, à la suite des textes littéraires, met aujourd’hui au jour le faste des grands aristocrates gaulois qui offraient volontiers à toute leur clientèle, parfois des milliers d’hommes, de gigantesques banquets dans lesquels le vin, produit étranger de grand luxe, coulait à flot. “Aimant le vin, ils s’emplissent de celui qu’apportent les marchands sans le mélanger d’eau et leur passion les poussant à utiliser la boisson dans toute sa violence, ils s’enivrent et sombrent dans le sommeil ou dans des états délirants. Aussi beaucoup de marchands italiens, en raison de leur amour du gain, tiennent-ils pour une aubaine le penchant des Gaulois pour le vin : apportant le vin soit par bateaux en utilisant les cours d’eau navigables, soit par charrois à travers la plaine, ils en tirent un prix incroyable : en échange d’une jarre de vin, ils reçoivent un esclave en échange de la boisson.” C’est ainsi que Diodore de Sicile, au début de l’époque augustéenne, décrit les mœurs gauloises (V, 25-27). Il est très vraisemblable que les marchands italiens ne se contentaient pas d’esclaves, encore que ce fût là un marché lucratif. Mais on a remarqué qu’en Gaule, les plus importants stocks d’amphores
Reconstitution d’une installation viticole, avec ses pressoirs à levier, ses fouloirs, ses chais.
Un atelier de fabrication d’amphores d’après l’exemple de Sallèles-d’Aude, au milieu du ier siècle.

vinaires provenaient de régions riches en minerai, notamment dans la région de Toulouse. Les Gaulois n’étaient d’ailleurs pas les seuls à aimer le vin et à le troquer contre des produits de grand prix : les Illyriens, par exemple, pratiquaient un commerce de même nature, si l’on en croit Strabon, à peu près pour la même époque (V, 1, 8). Ils se rendaient en effet à Aquilée, où du vin était apporté par mer, afin d’être transvasé dans des tonneaux que les Barbares remportaient chez eux, en contrepartie de peaux, de bétail et… d’esclaves.
Au dernier siècle de la République, le vin italien était donc exporté en très grande quantité dans tout l’Occident, y compris sur les lointains oppida de la Bretagne celtique. On suit sa trace grâce à la carte des amphores qui le véhiculent alors, les Dressel 1, et dont on trouve de nombreux témoignages sur tous les sites terrestres, mais aussi dans les épaves (44 recensées en 1986) qui jalonnent les côtes de Provence ou le nord de l’Espagne. L’une d’entre elles a été fouillée au large de la Madrague de Giens, de 1972 à 1992. Outre les informations essentielles que ce chantier, l’un des plus importants jamais réalisés en archéologie sous-marine, a apportées pour la connaissance des navires de cette époque, la cargaison a pu être estimée à environ 6 000 à 6 500 amphores de type Dressel IB, disposées en quinconce sur trois couches superposées, soit 3 m de hauteur.
Un tel chargement représente au minimum entre 120 000

102

Gaule pour réduire les partisans de Vitellius. “La menace dirigée par la flotte d’Othon contre la Narbonnaise, qui avait prêté serment à Vitellius, fut annoncée à Fabius Valens [un des généraux de Vitellius] par des messagers tout effarés ; auprès de lui se trouvaient déjà les délégués des colonies implorant du secours [il s’agit des colonies du sud de la Gaule]. Valens leur envoya deux cohortes de Tongres [Belges], quatre escadrons de cavalerie, toute la cavalerie auxiliaire des Trévires [habitants de la région de Trèves] que commandait Julius Classicus ; mais une partie de ces forces fut retenue à Fréjus ; car si toutes s’étaient portées vers la route de terre, il était à craindre que la mer ne demeurât libre, ce qui eût hâté la manœuvre de la flotte d’Othon. Douze escadrons de cavalerie et l’élite de l’infanterie auxiliaire marchèrent à l’ennemi, et on leur adjoignit une cohorte de Ligures, familiarisés de longue date avec le pays [la Ligurie recouvre toute la région littorale, depuis Marseille jusqu’au golfe de Gènes], et cinq cents Pannoniens [peuples de la rive droite du Danube, de Vienne à l’embouchure de la Save] non encore encadrés. La bataille s’engagea aussitôt, et dans cet ordre : une fraction de soldats de marine mêlés d’indigènes était étagée sur les hauteurs voisines de la mer ; tout l’espace
compris entre les hauteurs et le littoral, c’est-à-dire tout le terrain plat, était occupé par les prétoriens, dont sur la mer la flotte prolongeait en quelque sorte la ligne, les vaisseaux prêts au combat ayant tous l’avant tourné vers la terre devant laquelle ils formaient un front menaçant. Quant aux Vitelliens, moins forts en infanterie, mais possédant une cavalerie solide, ils font prendre position aux Alpins sur les montagnes voisines et derrière leur cavalerie ils rangent leurs cohortes en ordre serré. Les escadrons des Trévires, qui se gardaient mal, s’offrirent aux coups de l’ennemi dont les vétérans l’accueillirent de face, tandis qu’en flanc ils étaient accablés sous une grêle de pierres lancées par la bande d’indigènes tout à fait aptes à ce genre de combat et qui, répandus parmi les troupes régulières, montraient, braves ou lâches, une égale résolution dans la victoire. Les Vitelliens étaient ébranlés ; la flotte mit la terreur à son comble en se portant sur leurs derrières. Entourée de tous côtés, l’armée entière eût péri
Entrée de l’empereur par la porte d’Auguste dans la ville de Ravenne, avant son départ avec la flotte pour une expédition dans les Balkans. L’arrivée du “maître” donne toujours lieu à une cérémonie officielle au cours de laquelle la foule vient acclamer le souverain.

Dans un port italien les troupes qui accompagnent l’empereur s’embarquent pour une expédition dans les Balkans. La colonne Trajane, à Rome, qui figure les expéditions de Trajan contre les Daces, montre des scènes de ce type.
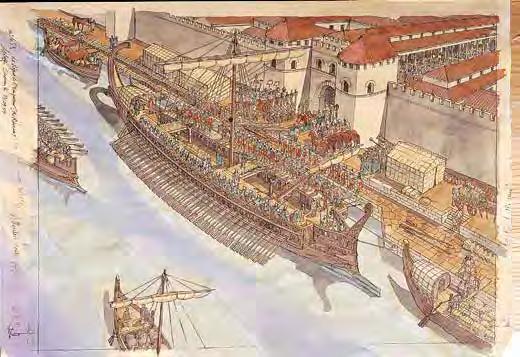
si l’obscurité de la nuit n’avait arrêté le vainqueur et masqué la retraite” (Trad. H. Goelzer, Les Belles Lettres). Dans le chapitre suivant, nous apprenons que la Corse et la Sardaigne ont été maintenues dans l’obéissance à Othon grâce à la flotte. On voit ainsi que celle-ci constitue une force militaire non négligeable. D’ailleurs les Vitelliens prennent bien garde de ne pas dégarnir le port de Fréjus, qui constitue, dans cette région, un point d’appui important dont le contrôle paraît toujours essentiel. C’est là, en effet, qu’Auguste, tout de suite après Actium, avait détaché les bâtiments et les équipages pris à Antoine, créant ainsi, en Méditerranée occidentale, un grand port de guerre. Tacite qualifie toujours la ville de “clef de la mer” en 69 (Hist., III, 43).
La logistique de l’armée et les grandes expéditions
Alors que les rhéteurs du iie siècle, Aelius Aristide en tête, vantaient, dans des discours académiques, la prospérité et
la paix de l’Empire, ce dernier connaissait une activité militaire quasiment ininterrompue. Non que la pax romana fût un mythe. Mais elle ne signifie pas que Rome n’avait plus d’adversaires. Le principal d’entre eux était le grand rival parthe, contre lequel plusieurs expéditions durent être menées, ce qui n’empêcha pas le danger de s’accroître considérablement au iiie siècle avec l’arrivée d’une nouvelle dynastie, celle des Sassanides. Au nord de l’Europe, le monde barbare exerçait une pression de plus en plus forte sur le Danube, depuis le milieu du iie siècle de notre ère. Ne parlons pas des guerres de pure conquête voulues par Trajan, comme celle de Dacie. En Afrique n’existait aucune menace majeure mais des troubles éclataient de temps en temps, comme ce fut le cas en Maurétanie Tingitane (l’actuel Maroc) sous Antonin.
Si le cœur de l’Empire était en paix, sa périphérie était donc confrontée à la guerre, sinon de manière permanente et généralisée, du moins épisodiquement. Mais l’armée ne disposait pas de force de réserve qui pût intervenir ici ou là. Quand on voulait monter une expédition ou, tout simplement, faire face à une menace qui dépassait les seules forces disponibles localement, il fallait dégarnir provisoirement un secteur calme pour acheminer des renforts. On observe ainsi, à travers les inscriptions, le déplacement de très nombreuses troupes, d’un bout à l’autre de l’Empire. Le soldat romain marchait beaucoup, changeait d’ailleurs
126 127
408 pages
32 illustrations en couleur isbn : 978-2-330-17947-2
septembre 2023
LA GUERRE DES GAULES
[Nouvelle édition]
Louis-Napoléon Bonaparte
Napoléon III était fasciné par Jules César et avait entrepris d’en rédiger la biographie ; mais très vite, la période de la guerre des Gaules devint le vrai sujet de son livre. L’originalité de celui-ci réside dans sa volonté de retrouver sur le terrain les traces du conflit. Pour ce faire, il a réuni les meilleurs historiens de son époque et fait appel à des officiers brillants pour entreprendre des recherches sur les lieux décrits par César, et les résultats se sont avérés stupéfiants. De Gergovie à Alésia, les fouilles ont permis de confirmer chaque épisode des batailles et des sièges, tout en suivant les mouvements de troupes. En cela, Napoléon III est l’un des fondateurs de l’Archéologie nationale ; entouré des meilleurs savants de son époque, il a mis en œuvre la fantastique énergie des érudits locaux à travers toute la France, envoyant des troupes pour vérifier certains itinéraires des légions de César ou faire reconstruire les machines de guerre romaines pour les expérimenter. Pionnière, cette fantastique aventure collective nous étonne, tant par les moyens dont elle put disposer en son temps que par les progrès scientifiques qu’elle a suscités, et que nul ne saurait aujourd’hui renier.
La lecture que fait Napoléon III du Bellum Gallicum de César reflète le constant souci de l’empereur de ne négliger aucun des aspects nécessaires à la compréhension du texte, des faits, de la politique et des hommes.
Loin d’être un objet de curiosité, cet ouvrage reste, par les informations qu’il nous livre, un document d’actualité. En effet, l’archéologie a confirmé depuis l’extrême justesse des études sur lesquelles il repose. C’est un document fondamental pour tous ceux intéressés par l’histoire et la guerre des Gaules.
Un atlas de trente-deux cartes est reproduit, et il est complété par les commentaires de Napoléon Ier à Sainte-Hélène, rédigé par l’un de ses aides de camp, sur la tactique militaire de Jules César.
Repères
Points forts
• La réédition d’un ouvrage méconnu et fascinant, qui montre la continuité entre les chefs de guerre antique et moderne.
• Un livre dont la rédaction a donné lieu aux débuts de l’archéologie telle qu’on la connaît aujourd’hui.
• Un atlas de trente-deux cartes pour situer mieux encore le contexte de l’ouvrage.
Mots clés
• Napoléon III – Jules César – Guerre – Gaule –Archéologie
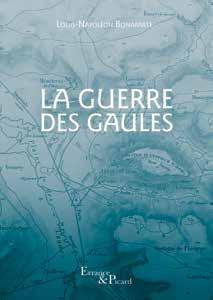
Visuel provisoire - Diffusion Actes Sud
17 × 24 cm
39 €
prix provisoire :
9:HSMDNA=V\^Y\W:

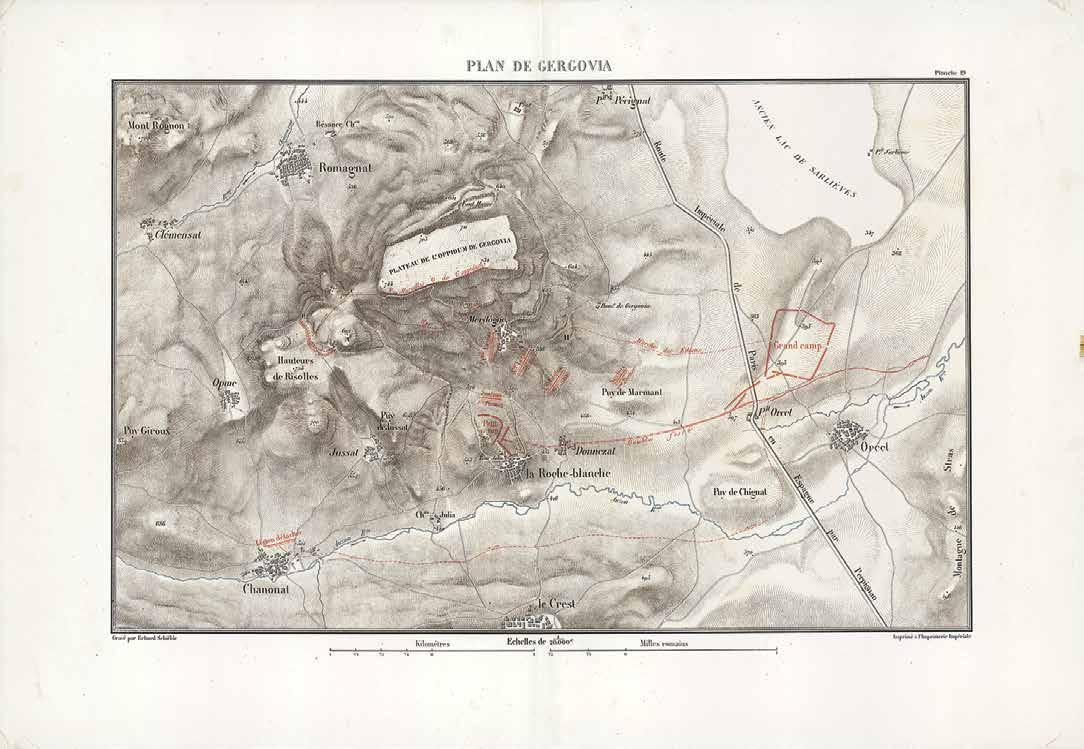

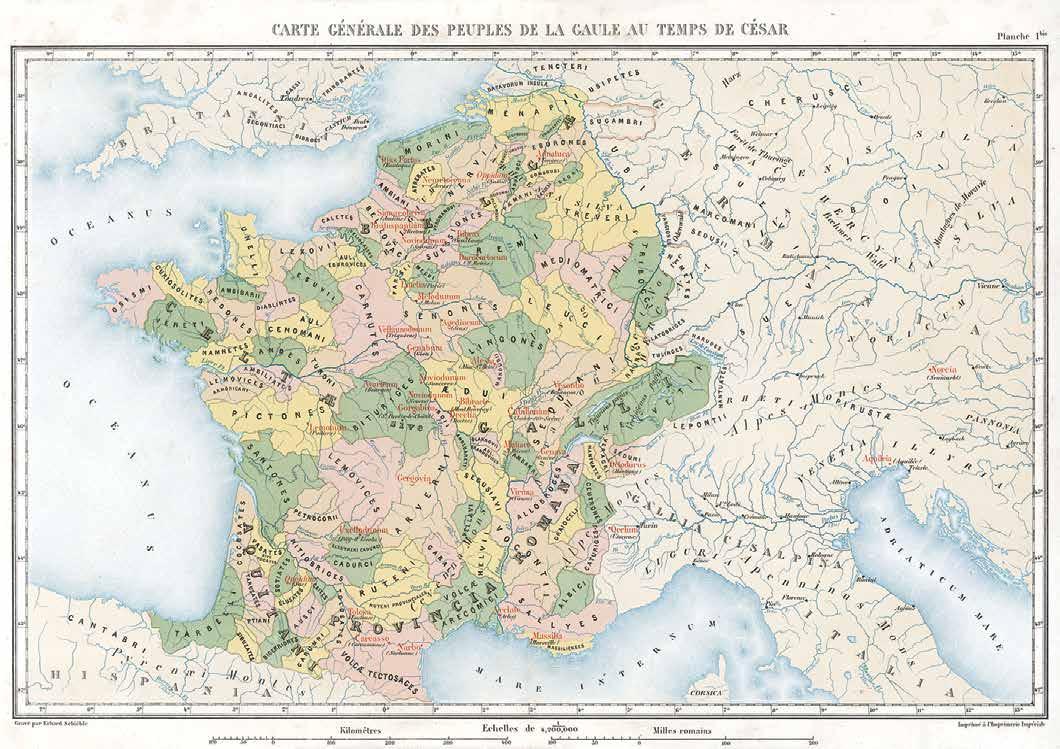
DE VIE À TRÉPAS
DE VIE À TRÉPAS
Présence de la mort dans les noms de lieux
Stéphane Gendron

Le langage pour évoquer la mort sous toutes ses formes est d’une très grande richesse. C’est sans doute l’un des domaines qui a suscité le plus de créativité. Mais qu’en est-il de la toponymie ?
Dans quelle mesure les noms de lieux qui nous entourent sont-ils liés à cette préoccupation fondamentale qu’est la mort ?

Les cimetières et autres lieux d’inhumation en lien avec les découvertes archéologiques ont fait l’objet de nombreuses recherches, ainsi que le domaine judiciaire, les lieux d’exécution et leurs désignations.
Repères
Points forts
• Une étude complète des toponymes macabres, en lien avec les récentes découvertes archéologiques.
• Un travail linguistique qui permet de questionner le rapport de l’humain à la mort.
• Des cartes qui illustrent et permettent de situer visuellement les phénomènes toponymiques.
Mots clés
• Linguistique – Toponymie – Géographie –Archéologie – Noms – Mort
16 x 24 cm
144 pages
20 illustrations en noir et blanc isbn : 978-2-330-18111-6
septembre 2023
prix provisoire : 24 €

Pourtant, lorsque l’on consulte une carte géographique, la mort ne semble pas être le thème le plus fréquent dans la toponymie. Rares sont les communes qui en portent le souvenir. C’est surtout en regardant du côté de la microtoponymie – les lieux-dits et noms de parcelles cadastrales – que l’on trouve l’essentiel du corpus étudié dans le cadre de cette étude. Autrement dit, la mort est souvent écartée de la proximité des vivants, de leur lieu d’habitation, et se trouve reléguée à des espaces plus éloignés, par conséquent plus discrets. Il paraît important de reprendre ces recherches et de les confronter aux récentes découvertes archéologiques. La toponymie témoigne assez abondamment des situations qui provoquent la mort, l’ordonnent, lui confèrent un caractère officiel (les lieux de justice). Elle évoque régulièrement la crainte de la mort en situation de crise (maladies, épidémies), et parfois garde la trace d’événements macabres (massacres, meurtres). La conjuration de la mort est également un aspect non négligeable dans ces désignations. Ainsi, cet ouvrage questionne de manière nouvelle un certain nombre de toponymes ou de familles toponymiques dont la fixation est essentiellement due aux relations que les hommes entretiennent avec la mort.
Stéphane Gendron est spécialiste de toponymie, président de la société française d’Onomastique (Archives nationales, Paris). Dans ses publications, il s’attache à faire connaître ce versant d’un patrimoine parfois oublié, souvent négligé, que sont les noms de lieux de nos régions.
Visuel provisoire - Diffusion Actes Sud
STÉPHANE GENDRON PRÉSENCE DE LA MORT DANS LES NOMS DE LIEUX 9:HSMDNA=V]VVV[:
22 x 27 cm
96 pages
env. 80 illustrations en noir et blanc et quadri
ISSN : 0007-4730
ISBN : 978-2-36919-202-2
Parution : septembre 2023
Prix : 20 €
Mots-clés : Lozère, maisons médiévales, Aquitaine, xiie siècle, art cistercien, décor peint, xviiiesiècle, sculpture, Louis XIV, fonte de fer.
BULLETIN MONUMENTAL
T. 181-3
Publication de la Société française d’archéologie, le Bulletin monumental s’attache, depuis 1834, à proposer des études de référence sur l’architecture et le patrimoine, du Moyen Âge au xxe siècle, qui s’adressent aussi bien aux spécialistes qu’aux amateurs.

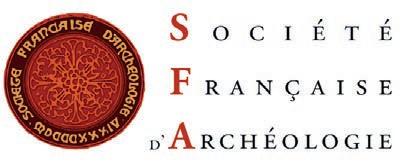
Chaque livraison est richement illustrée et offre des études de fond inédites complétées par des rubriques d’actualité sur des découvertes récentes et de comptes rendus sur les parutions importantes en France et à l’étranger.
Sommaire
Martin Mallard et Clémence Dequaire, « Approche du castrum de La Garde-Guérin et de ses maisons médiévales »
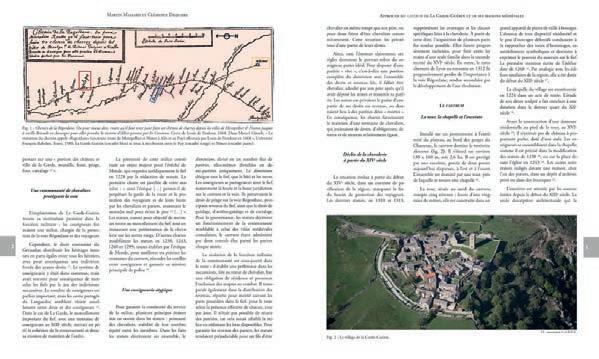
Jean-Baptiste Javel, « Les enduits gaufrés et les décors peints non historiés de l’église abbatiale de Cadouin (Le Buisson-de-Cadouin, Dordogne) »
Daniel Bontemps, « La statuette équestre de Louis XIV et les débuts de l’art de la fonte de fer ornée vers 1700 en France »

NAVIGUER
NAVIGUER SUR LES SENTIERS DU VENT
Olivier Le Carrer
Préface d’Isabelle Autissier
Illustrations de Sybille Le Carrer
“
C’est peut-être loin du rivage que je me sens le plus solidement ancré dans notre planète”, confie le navigateur Olivier Le Carrer dans cet ouvrage qui invite à écouter la voix de l’eau. De la Bretagne à la Polynésie, des mers du Nord aux baies du Sud, l’auteur nous embarque au gré des vents et des mots, avec poésie et sagesse, dans un voyage atemporel, là où les mers voient défiler des générations d’aventuriers, de James Cook à Bernard Moitessier. Au fil de l’eau, Olivier Le Carrer revisite des rencontres historiques entre Européens et Océaniens, ravive des journaux de bord oubliés et témoigne de ses étonnantes expériences personnelles, comme la rencontre exceptionnelle avec des dauphins messagers.
Il dévoile un lien sensible et intime à la mer, aux vents, aux astres et à tous les vivants qui cohabitent dans ce milieu océanique. Comme en amour, la passion porte ses adeptes vers l’émerveillement, vers ses déboires aussi. Car les forces de la nature rappellent sans cesse au marin qu’il n’est pas maître des lieux. “Apprivoiser en somme l’art de composer avec l’incertitude, sans doute le meilleur des vaccins contre cette crise de la sensibilité qui anesthésie nos sociétés. Un art dont les marins sont dépositaires depuis toujours et qu’il ne tient qu’à eux de préserver. Quel que soit le support, aller sur l’eau sans autre source d’énergie que le vent, les vagues ou son propre corps va de pair avec regarder, écouter, sentir et essayer de comprendre. Regarder intensément, à la façon du poète.”
Si l’appel du large invite à l’humilité, il transporte aussi les voyageurs vers de nouveaux horizons culturels. On découvre par exemple comment les peuples de Polynésie chantent avec les étoiles et fusionnent avec la mer, ou comment le surf avait à Tahiti une origine rituelle, ludique et sacrée. Pour initiés ou novices, ce récit s’adresse à tous ceux qui sauront tendre l’oreille pour écouter les voix de la mer.



Olivier Le Carrer est journaliste et navigateur, ancien rédacteur en chef du magazine Bateaux pour lequel il a testé des milliers de voiliers de toutes tailles aux quatre coins du monde. Il a publié plusieurs ouvrages sur la mer et l’histoire des voyages, dont Océans de papier (Glénat, 2017), Beauté mer (National Geographic, 2018) et Une histoire de la voile (Glénat, 2020).
Repères
Points forts
• “Voix de la Terre” : une collection qui explore les façons dont les hommes appréhendent et habitent un espace pour y vivre en société et surtout en harmonie avec l’environnement qui les entoure.

• Olivier Le Carrer (qui réside en Bretagne) parcourt les mers du monde depuis plus de quarante ans.
• Auteur de nombreux livres concernant l’art de la navigation, dont Partir autour du Monde (Glénat, 2019), 69 année héroïque (Éditions Paulsen, 2017), Trouver le Nord (Delachaux et Niestlé, 2016), Atlas des lieux maudits (Arthaud, 2013), La Mer expliquée aux terriens (Glénat, 2012), Le Rêve d’une île (Glénat, 2010).
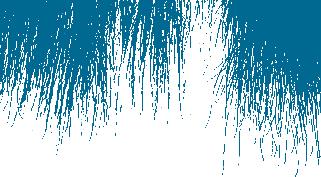


• Préface d’Isabelle Autissier / Nombreuses illustrations poétiques de Sybille Le Carrer.

voix de la terre Visuel provisoire - Diffusion Actes Sud
11,5 × 21,7 cm 240 pages 20 illustrations en noir et blanc et en couleur ouvrage broché isbn :
septembre 2023 prix provisoire : 21 €
978-2-330-18143-7
SUR LES SENTIERS DU VENT Voix de la Terre ACTES SUD OLIVIER LE CARRER 9:HSMDNA=V]VYX\:

ouvrage broché
isbn : 978-2-330-18083-6
coédition actes sud/terre de liens
septembre 2023
prix provisoire : 23 €
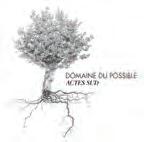
LES LIENS DE LA TERRE
Entre propriété et usage, un enjeu démocratique
Véronique Duval
Parmi toutes les questions qui déterminent notre avenir commun, celle du devenir des sols et de l’accès à la terre agricole est l’une des moins visibles dans le débat public. Pourtant, elle est vitale : notre alimentation dépend des sols et du travail des agriculteurs, autant que de l’eau. Comment nous nourrirons-nous demain ? Depuis les années 2000, de moins en moins de nouveaux agriculteurs parviennent à s’installer. Le nombre d’exploitations a été divisé par cinq en soixante ans. Dans le même temps, et alors que la surface agricole totale décroît, la surface moyenne par ferme ne cesse de grandir. Un nouveau cycle de concentration foncière est en œuvre, qui fait monter le prix des terres. Vers quelle(s) agriculture(s) ces tendances nous mènent-elles ?
Une enquête sur l’accès à la terre et le renouvellement des générations agricoles, de nos jours. Et une quête des porteurs de solutions qui permettent de produire localement, pour aujourd’hui et pour demain, l’alimentation dont nous avons besoin, en préservant des structures de production à taille humaine.
Il s’ouvre par un voyage dans le temps, pour poser quelques jalons et comprendre d’où nous venons. Puis il part à la rencontre de ceux qui font bon usage de la terre aujourd’hui, dans la Marne, au Larzac, au Pays basque ou au sein de l’association Terre de liens, qui rachète des fermes pour les sortir définitivement du marché spéculatif et y installer des jeunes paysans et paysannes en bio. Comment passer de l’expérimentation à une véritable transformation de notre modèle agricole ? Comment enfin peser sur l’action publique ? Comment faire de la terre un bien commun ?
Telles sont les pistes qu’explore l’ouvrage dans sa dernière partie. Alors que nous sommes dans une période décisive pour l’agriculture, il nous invite à réfléchir à l’usage de la terre que nous souhaitons et à nous engager en conséquence.
Véronique Duval vit en Charente-Maritime. Journaliste, réalisatrice de documentaires, animatrice d’ateliers d’écriture, cofondatrice d’une jeune maison d’édition, elle a notamment publié Rencontre avec des paysans remarquables. Cinq fermes biologiques et paysage (éditions Sud-Ouest, 2017).
Repères
Points forts
• Actes Sud a publié un certain nombre de livres sur l’agriculture, axés sur les méthodes à mettre en œuvre. Les Liens de la terre aborde la question du foncier, rarement traitée et pourtant fondamentale.
• Un texte vif, mêlant réflexions et témoignages, et qui s’appuie sur la riche expérience de l’association Terre de liens.
• Ce livre paraît alors que l’association Terre de liens, coéditrice, fête ses vingt ans d’existence et organise depuis le printemps 2022 des manifestations et événements en lien avec la question des terres agricoles.
• Il existe des rapports d’associations sur la question foncière ainsi que des livres à destination des professionnels, mais aucun ouvrage qui s’adresse au grand public.
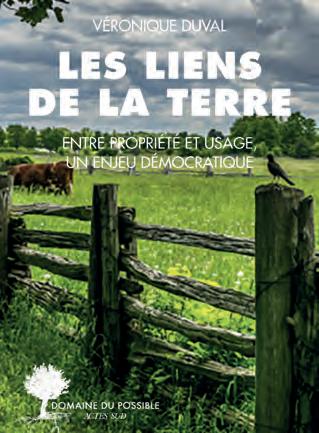
domaine du possible Visuel provisoire - Diffusion Actes Sud
Ce livre est une enquête autant qu’une quête.
14 × 19 cm 336
pages
9:HSMDNA=V]U]X[:
160 pages
80 illustrations en bichromie
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-16888-9
septembre 2023
prix provisoire : 29 €
LORENZO Black & White
Entretiens menés par Luisina Dessagne
Photographies d’Heini Heitz
Depuis tout jeune, Lorenzo, debout sur ses chevaux, enchante le public avec ses spectacles qui ne ressemblent à aucun autre. Au fil des années, de plus en plus de chevaux, des noirs, des blancs, l’accompagnent à un rythme endiablé auquel se mêle une grande poésie. Et à la fin, les spectateurs sont debout et applaudissent à tout rompre. Car ce qu’ils ont vu, ce ne sont pas seulement des prouesses techniques, mais aussi une complicité unique entre l’artiste et ses chevaux. À travers le regard sensible du photographe suisse Heini Heitz, suivons Lorenzo dans sa Camargue secrète et aussi en spectacle. Écoutons-le nous parler de sa relation unique avec ses chevaux. Comment il les amène à évoluer à seize en totale liberté pour réaliser ces incroyables figures. Comment il commence à travailler avec les jeunes, mais aussi comment il vit avec eux, ce qu’ils deviennent quand ils sont à la retraite… Découvrons enfin le Lorenzo qui enseigne la voltige à des jeunes de plus en plus nombreux, tout en ne cessant d’inventer de nouvelles figures pour continuer à nous émerveiller en spectacle.
Luisina Dessagne, qui dirige la collection “Chevaux et cavaliers” d’Actes Sud, est journaliste dans la presse équestre française et cavalière. Elle est l’autrice de Lorenzo (Actes Sud, 2006).
Heini Heitz, photographe suisse, est aussi instituteur et musicien. Les oiseaux, les animaux et la nature en général sont ses thèmes de prédilection. En particulier le monde des chevaux, les Saintes-Maries-de-la-Mer et ses taureaux, qu’il a découverts il y a quelques années grâce à des cavaliers et des manadiers qui lui ont ouvert leurs portes.
Repères
Points forts
• Entretiens.
• Le parcours d'un cavalier artiste, à travers se numéros de voltige équestre, les portraits de ses chevaux, son itinéraire et son univers personnel, le quotidien de l'entraînement et des soins, la transmission de son art, en toute harmonie, de la Camargue jusqu'à ses spectacles internationaux.

arts équestres Visuel provisoire - Diffusion Actes Sud 1470
28 × 22 cm
ACTES SUD LORENZO BLACK & WHITE seque dollaboribus dovolessusdam a autem BLACK & WHITE LORENZO 9:HSMDNA=V[]]]^:




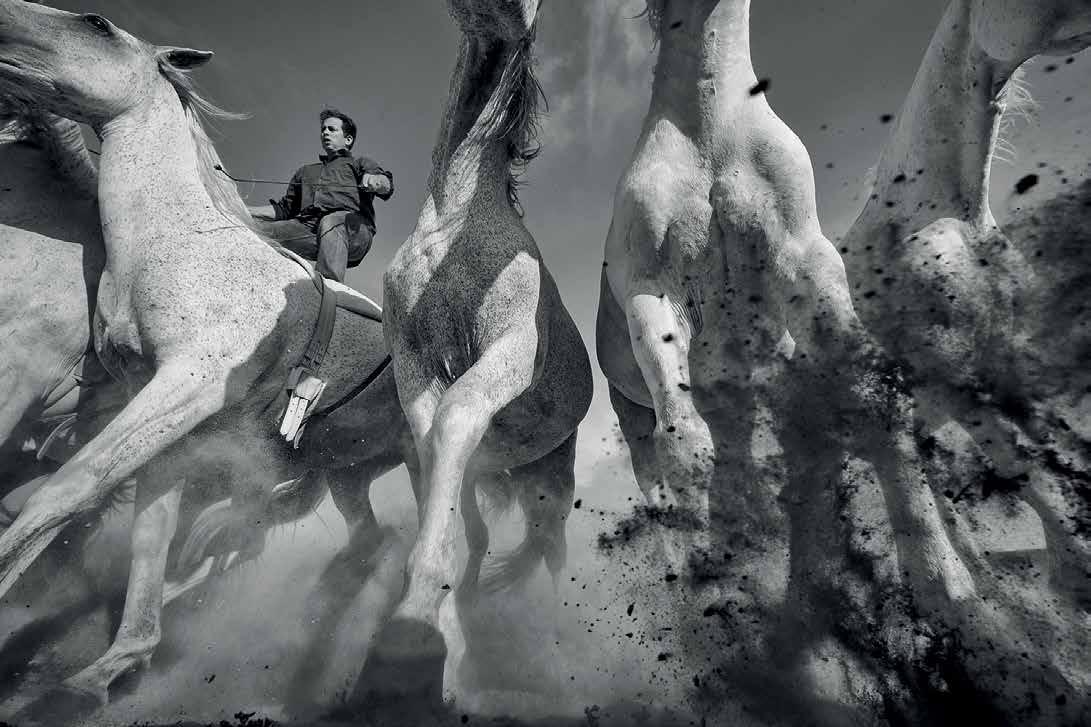

RÉENCHANTER
RÉENCHANTER L’EAU
Plaidoyer anthropologique
Claudine Brelet
Une invitation à revisiter l’eau, celle qui nous fait vivre, qui vit en nous, à faire ressurgir notre imaginaire ancestral étiolé, à se plonger dans les rêves et les espoirs des sociétés non industrialisées qui ont préservé des liens éthiques et affectifs avec l’eau de leurs paysages. Cet ouvrage a pour objectif de la réenchanter par sa dimension culturelle, souvent oubliée depuis que les sociétés modernes l’ont réduite à une molécule parmi d’autres : h2o. Ce livre entraîne le lecteur dans le temps du rêve des Aborigènes australiens lorsque, pendant la saison des pluies, se célèbrent les noces des eaux douces et salines avec la terre rouge de ce vaste continent. Il navigue en pirogue sur l’immense fleuve Niger, le Djoliba du Mali, pour écouter les Bozos “maîtres des eaux” et découvrir les savoirs d’initiés bambaras dont les secrets remontent à la Préhistoire. Il pénètre ensuite dans les profondeurs du Nigeria, au cœur de la forêt sacrée d’Osogbo où les prêtresses d’Oshun, la déesse de l’amour, de l’eau et de l’abondance chez les Yorubas, continuent de bénir les femmes en mal de maternité sur les sables de la rivière qui porte le nom de cette protectrice des enfants. Aujourd’hui, l’eau se raconte encore chez quelque 370 millions de personnes appartenant aux peuples autochtones, qui dépendent encore directement des ressources de leur environnement naturel. Présents dans quatre-vingt-dix pays, ils protègent aujourd’hui 80 % de la biodiversité subsistant sur notre planète, mais font partie des 15 % des populations les plus pauvres… Ce qui pose la question du droit à l’eau, concept très récent dans le monde moderne. Il n’a été reconnu qu’en juillet 2010, par l’assemblée générale de l’onu. Le respect que les traditions des sociétés animistes accordent depuis toujours aux esprits et divinités de l’eau et de la nature commence à trouver sa traduction juridique.
Repères
Points forts
• Un essai anthropologique qui traverse les siècles et les cultures.
• Une écriture dynamique, qui entraîne le lecteur sur les pas de peuples autochtones aux mythes parfois millénaires.
• Un sujet qui aborde des questions multiples : écologiques, juridiques et sociales.

Mots clés
• Anthropologie – Eau – Mythologie – Autochtones –Écologie – Climat

ouvrage broché isbn : 978-2-330-18110-9
septembre 2023
Claudine Brelet, anthropologue et femme de lettres, s’est consacrée à la santé humaine et environnementale en militant pour des technologies localement appropriées dès les années 1970. À l’oms puis à l’Unesco, elle défend la diversité culturelle et de la biodiversité, la sagesse des peuples-racines et le droit universel à l’accès à l’eau.
Visuel provisoire - Diffusion Actes Sud
12,5 × 19 cm 220 pages
Cet ouvrage constitue un plaidoyer anthropologique passionnant, qui aborde de nombreux enjeux contemporains, climatiques et sociaux.
prix provisoire
25 €
:
CLAUDINE BRELET 9:HSMDNA=V]VVU^:
L’EAU
ROYAL DE LUXE 2012-2023, TOME 3

Jean-Luc Courcoult
Textes de Jean-Pierre Marcos
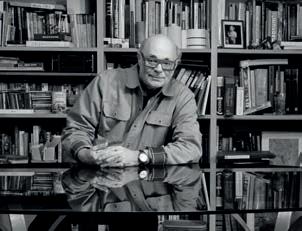
Voilà plus de quarante ans que Royal de Luxe, une des plus importantes troupes de théâtre de rue en Europe, voyage avec son grand théâtre à travers le monde. Actes Sud a déjà publié deux livres sur les dernières décennies de la compagnie : Royal de Luxe 1993-2001 et Royal de Luxe 2001-2011. En douze ans, d’autres spectacles ont été créés, d’autres Géants sont nés, d’autres voyages ont été faits. Toujours aussi réjouissants, inattendus, sans cesse renouvelés. Les voici présentés dans ce beau livre avec près de trois cents documents iconographiques et des textes de Jean-Pierre Marcos et Jean-Luc Courcoult.
Le livre revient évidemment sur la Saga des Géants, une aventure démarrée en 1993 lorsque la compagnie décide de construire un géant de 10,50 mètres dans un spectacle intitulé Le Géant tombé du ciel. Depuis 1993, d’autres personnages hors normes (la Petite Géante, le Scaphandrier, le Xolo, la Grand-mère géante ou encore le Bull Machin), soutenus par une machinerie titanesque, ont été créés et investissent les rues pour faire vivre les villes. Des histoires poétiques sont racontées, chaque fois ancrées dans les récits fondateurs des villes et pays où ils voyagent : L’Odyssée de la mer à Liverpool en 2012, Le Mur de Planck à Nantes en 2014, L’incroyable et phénoménal voyage des Géants à Perth en Australie en 2015, Les Géants à Anvers la même année, Franciscopolis au Havre en 2017, etc.
Parallèlement à la Saga des Géants, la compagnie poursuit son travail de création théâtrale. D’autres spectacles, du théâtre de rue, ont été créés et parcourent le monde : Rue de la chute en 2012, Dakar-Dakar en 2014 et Miniatures en 2017.
Royal de Luxe s’est également installée en 2019 dans le quartier de Bellevue à Nantes et SaintHerblain. Une invitation de Nantes Métropole sur un temps long pour accompagner le renouvellement urbain du quartier. De nombreux spectacles et personnages, M. Bourgogne ou encore Mémé Rodéo et même une œuvre pérenne, Le Réverbère à nœud, sont nés de cette résidence.

Une frise dessinée par Phéraille, véritable chronologie exhaustive des spectacles de la compagnie, rappelle également les aventures antérieures à 2012.
Repères
Points forts
• Nouveau spectacle de géants de la compagnie à Nantes du 22 au 24 septembre 2023.
• Les tomes 1 et 2 ont été vendus respectivement à 15 000 et 11 500 exemplaires.
• Royal de Luxe est une compagnie de théâtre de rue française jouissant d’un rayonnement international (plus de 27 millions de spectateurs dans le monde).
Mots-clés
• Royal de Luxe / théâtre de rue / marionnettes / spectaculaire / rétrospective / urbanisme
Royal de Luxe est fondée par Jean-Luc Courcoult en 1979 à Aix-en-Provence. La compagnie commence par récupérer et détourner des objets du quotidien. Le Royal continue son exploration de différentes formes de théâtre de rue : spectacles de quinze minutes, spectacles de place, spectacles de vitrine, situations imaginaires. Dès 1987, la troupe commence à se construire un réseau de diffusion à l’étranger, notamment grâce au succès du spectacle Roman-photo créé en 1987. En 1989, Royal de Luxe lance un appel dans la presse nationale pour trouver un lieu. Le Maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault, y répond et met à disposition un hangar de 10 000 m². Depuis, Royal de Luxe a créé plus de 83 spectacles, donné plus de 1 500 représentations, vues par près de 27 millions de spectateurs dans 220 villes de 43 pays sur les 5 continents.
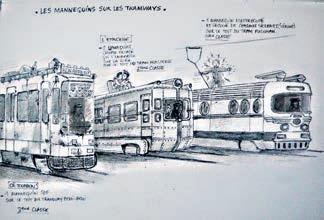
ACTES SUD Visuels provisoires - Diffusion Actes Sud arts du spectacle
22 x 28 cm 272 pages 300 illustrations en quadri ouvrage relié isbn
septembre 2023 prix provisoire : 40 €
: 978-2-330-18150-5
© Patrick Garçon
© David Bartex
© Gilles Michallet
© Serge Koutchinsky
Jean-Luc Courcoult, fondateur de Royal de Luxe, chez lui.
Spectacle Le Bull Machin à Villeurbanne, 23-25 septembre 2022.
Projet perdu : investir trois tramways dans la ville de Nantes.
19,6 × 25,5 cm
320 pages
250 illustrations en couleur
ouvrage relié
isbn version française : 978-2-330-18082-9
isbn version anglaise : 978-2-330-18211-3
coédition actes sud/alliance for european flaxlinen & hemp

septembre 2023
prix provisoire : 42 €
LE LIN, FIBRE DE CIVILISATION(S)
Ouvrage collectif sous la direction d’Alain Camilleri
Agriculture, arts du feu, artisanat : l’histoire des techniques est largement documentée, mais elle ne suffit pas à rendre compte de l’étendue du génie humain. Une autre approche est possible, celle qui, avant le geste, s’intéresse aux matières. Le lin, par exemple, fibre végétale textile dont l’Europe est le premier producteur mondial, a traversé toutes les époques et autant de cultures, mêlant depuis toujours pratiques religieuses et légendes, savoir-faire agricoles, innovations textiles et révolutions technologiques. Cependant, cette riche histoire demeure largement méconnue. Quand l’homme a-t-il compris que le lin sauvage qui l’entourait pouvait se cultiver, se transformer et le servir ? Pourquoi les Égyptiens l’ont-ils utilisé comme réserve de valeur et monnaie d’échange, lui réservant un statut particulier dans leur économie et leurs rites funéraires ? Plus près de nous, comment a-t-il séduit autant de générations de stylistes et de créateurs de mode, leur permettant d’associer dans un même vêtement le style et la fonction ? De quelles propriétés dispose-t-il pour avoir fait une entrée remarquée dans l’univers si exigeant des composites à haute performance ? À ces questions, et à bien d’autres encore, Le Lin, fibre de civilisation(s) apporte des réponses argumentées en faisant appel à des archéobotanistes, historiens, scientifiques, designers ou industriels qui cumulent leurs expertises pour nous entraîner à la découverte du lin, de ses territoires et des hommes qui les font vivre.
À destination du grand public, cette saga textile, richement illustrée, est unique par son approche plurielle. Elle décrit un dialogue original entre passé et présent, entre savoir-faire, intelligence et capacité d’adaptation, en phase avec les attentes des consommateurs qui sont aujourd’hui en quête d’éthique et de ressources locales et renouvelables.
Consultant et médiateur culturel sur le lin, Alain Camilleri a été directeur de la communication de l’Alliance for European Flax-Linen & Hemp de 2009 à 2018.
Repères
Points forts
• Proche de la collection “Savoir & Faire” (Le Bois 4 000 ex. vendus, La Terre, 2 500 ex. vendus, …), cet ouvrage encyclopédique très illustré s’intéresse au lin en tant que matière et aux savoir-faire mis en œuvre pour l’utiliser.
• Par l’alternance d’articles de fond et d’encadrés ou de portfolios présentant les œuvres de stylistes, de designers, d’artistes ou d’artisans travaillant le lin, ce livre est accessible à un large public, aussi bien aux amateurs curieux d’en savoir plus sur le lin qu’aux spécialistes qui souhaitent enrichir leur domaine d’expertise.
nature Visuel provisoire - Diffusion Actes Sud
ACTES SUD / ALLIANCE FOR EUROPEAN FLAX-LINEN & HEMP le Lin
Sous la direction d’Alain Camilleri le Lin 9:HSMDNA=V]U]W^:
fibre de civilisation(s)
une exception européenne
Pascal Prevost - Président de la promotion de l’Alliance for European Flax-Linen & Hemp Avec la contribution de François Bert, - Directeur des programmes, Arvalis – Institut du végétal
une culture de terroirs
De la Normandie à la région des Hauts-deFrance, des Flandres françaises et belges jusqu’à Amsterdam, 85 % du lin mondial est cultivé en Europe de l’Ouest ; la France en est le premier producteur. Cette exception territoriale, animée par un réseau de 12 000 exploitations agricoles et d’une soixantaine d’unités de teillage exclusivement dédiées à sa première transformation, nécessite une importante main-d’œuvre locale, cinq fois plus que pour la production de céréales à paille, dans le respect des règles du Bureau international du travail.
un partenariat agriculteur-teilleur
Entre respect des traditions et innovation, le rôle du binôme humain agriculteur-teilleur est essentiel, créant l’alchimie nécessaire à une conduite optimisée de la récolte. Du semis à l’arrachage, du rouissage à l’enroulage, chaque intervention est déterminante et se décide dans un sur-mesure où chaque parcelle est un cas unique. Cette association de compétences est essentielle pour le teilleur – elle lui assure la régularité d’un approvisionnement en matière première transformable – comme pour le producteur auquel elle garantit de nombreux services (renseignements culturaux, teillage des pailles, qualification des fibres, commercialisation de tous les produits obtenus après teillage…). Ce contexte dote l’Europe de l’Ouest de la meilleure productivité linière mondiale et engendre une dynamique de filière unique.

33 - UNE EXCEPTION EUROPÉENNE 32
entre belgique et france : la lys, la “golden river” du lin

musée Texture, Courtrai Nicolas Smaghue - Historien
La Lys est une rivière qui traverse la Flandre depuis Lisbourg en France jusqu’à Gand en Belgique, où elle rejoint l’Escaut : longtemps elle a constitué, entre Armentières et Halluin, la frontière entre les deux pays. Peu de pentes, une stagnation importante des eaux et de vastes marécages ont formé des barrières naturelles pour les populations humaines qui en ont modelé les paysages : alternance de becques (fossés de drainage), de fosses, de mares
de prairies, de champs bombés. Ses 143 kilomètres de méandres parcourent une vaste et large plaine peuplée et urbanisée dès l’époque médiévale, période durant laquelle des défrichements et des assainissements majeurs sont réalisés. Son tracé naturel court jusqu’à Airesur-la-Lys, et des canaux adjacents constituent alors des voies qui ouvrent largement la rivière aux échanges canal de la Nieppe, Lawe, Bourre, canal de la Deûle, becque de Steenwerck, de Schipdonk… L’eau est un élément structurant dans l’histoire de cette vallée au caractère profondément rural, où se confondent une activité agricole dominée par le lin et une industrie florissante dès le xve siècle.
l’usage de la lys dans la transformation du lin
Longtemps, les propriétés chimiques mal connues de la Lys ont construit une véritable
légende sur la puissance et les qualités de son eau celle “qui donnait à la vieille plante textile une douceur impossible dans aucune autre eau du monde1”. Les fibres de ce lin, réputées pour leur finesse et leur blancheur extrême, ont été surévaluées de 25 à 35 % tout au long du xixe et jusqu’au milieu du xxe siècle. La qualité organique de l’eau de la Lys, ses bactéries et un courant assez lent permettaient en effet une dégradation rapide des ciments cellulosiques qui lient les fibres entre elles dans le processus de fermentation appelé “rouissage”. Superposées en couches et légèrement inclinées, les bottes de lin étaient placées dans de vastes caissons en bois que l’on immergeait dans des routoirs pendant huit à quinze jours suivant la température de l’eau et la nature du lin. Le rouisseur, ou hekkenier, se livrait alors à un véritable travail d’orfèvre : il devait prendre garde à ne pas laisser le lin baigner trop longtemps afin de ne pas en altérer la qualité. Au xixe siècle, la surface du routoir était recouverte de mottes

177 - UNE AGRICULTURE ET UNE INDUSTRIE ATTENTIVES ET RESPONSABLE 176
Lys tranquille, Lys douce et lente Dont le vent berce, aux bords, les herbes et les plantes, Vous entourez nos champs et nos hameaux, là-bas, De mille et mille méandres Pour mieux tenir serrée, entre vos bras, La Flandre.
Émile Verhaeren, “La Lys”, Toute la Flandre, E. Deman, Bruxelles, 1904-1911.
Sylvie De Coster - Conservatrice,
Rouissage à l’eau. Vue de la Lys à Courtrai, vers 1910-1920. Les bottes de lin sont immergées dans des routoirs lestés de pierres.
Vue sur la Lys entre Bissegem et Courtrai, vers 1910-1920. Des milliers de routoirs en bois, plusieurs centaines de meules de lin et, au centre du cliché, une maison typique servant d’entrepôt pour le matériel.
vêtements de travail

Si les chemises en lin blanc dominaient la mode masculine des cols blancs qui avaient les moyens de les acheter et de les entretenir, le lin a également joué un rôle important dans l’habillement des hommes des couches inférieures de la société occidentale. Il est à noter que ces formes de vêtements de travail ont plus largement influencé la mode masculine dans son ensemble. Adoption du pantalon, progrès du prêt-à-porter et évolution du formalisme des styles : les vêtements de travail et les uniformes sont devenus des archétypes de la garde-robe masculine et les créateurs y font fréquemment référence. Le

lin fait partie intégrante de cet aspect de l’habillement masculin en raison de son usage très répandu.
Beverly Lemire a reconstitué la fascinante progression des pantalons masculins, “d’objet d’affiliation ouvrière vers 1700 à vêtement favori des officiers de marine, des colons et des fashionables en 1800”, une transformation dans laquelle les pantalons en lin blanc ou rayé des uniformes de marins jouent un rôle central2. Les pantalons en lin blanc de la première moitié du xixe siècle, comme la paire en toile serrée du Westminster Menswear Archive, figurent dans de nombreuses collections de musées (fig. 2) Ils ont constitué un élément notable du vestiaire masculin de l’époque,

visible dans les représentations contemporaines telles que les dessins satiriques de George Moutard Woodward au début du siècle. Dans l’une de ces caricatures datant de 1807, Woodward dépeint un officier et de simples marins en pantalon à bord d’un bâtiment de la marine, ces derniers ayant complété leurs pantalons à rayures rouges et blanches par de courtes vestes bleu foncé 3. Les créateurs contemporains continuent à s’inspirer de cette allure distinctive, comme on peut le constater chez Ann Demeulemeester dans sa collection homme du printemps 2014, où les pantalons en lin à rayures étaient omniprésents4 Au fil du xixe siècle, tandis que les pantalons devenaient le bas standard de la tenue masculine, les hommes des milieux aisés ont adopté les pantalons et costumes en lin clair pour l’été et les loisirs.
Dans toute l’Europe, les vêtements de travail des hommes incluaient également des chemises simples ou des tuniques en laine. Sous le nom de smock, sarrau ou biaude, celles-ci se portaient aussi bien comme vêtement de dessus que comme sous-vêtement (fig. 3) Pour les hommes travaillant à l’extérieur et dans les champs, et dans les régions les plus chaudes d’Europe, les chemises en lin étaient fraîches, confortables et simples d’usage pour le travail manuel5. La blouse teinte en bleu indigo, en France, en est un exemple particulièrement remarquable6. En Angleterre et dans certaines parties de la Grande-Bretagne, les chemises de travail, surtout dans les régions rurales, étaient également appelées frocks. Du xviiie jusqu’au milieu
191 - UNE AGRICULTURE ET UNE INDUSTRIE ATTENTIVES ET RESPONSABLE UNE AGRICULTURE ET UNE INDUSTRIE ATTENTIVES ET RESPONSABLE - 190
du xixe siècle, les travailleurs revêtaient le smock frock dans toute la campagne anglaise7. Cette biaude se portait
Pantalon à pont en toile de lin blanche à boutons de cuivre, 1800-1830. Westminster Menswear Archive, université de Westminster, WMA.2020.24.1. - Smock anglais du xixe siècle, en lin et coton épais, usé et reprisé. Westminster Menswear Archive, université de Westminster, WMA.2021.7.2.
Veste Linoflax C. P. Company. Westminster Menswear Archive, université de Westminster, WMA.2017.046.
la maille de lin
Le lin a une main réputée sèche. C’est mal connaître toutes les possibilités d’une matière si versatile. Après plusieurs années d’investissements en recherche-développement, les filateurs et tricoteurs européens ont réussi à améliorer le titrage des fils et à faciliter le tricotage pour donner naissance à une nouvelle génération de fils extra-fins, réguliers et lisses, capables de glisser entre les aiguilles. Ces recherches ont permis de compenser les comportements naturels du lin, son faible allongement à la rupture, son manque de gonflant et d’élasticité.
Authentique et rustique, avec des patines ou des prélavages, ou volontairement sophistiquée, la maille de lin est devenue un territoire d’expression qui autorise tous les effets. La pluralité des ennoblissements surprend l’œil, à partir de fils simples, retors, câblés, moulinés, guipés, vrillés, flammés, bouclés, frisés… des fils qui peuvent être cirés, laqués, tweedés. Ces qualités s’enrichissent selon que le lin est “filé au sec” ou “filé au mouillé”. Dans le premier cas, il permet de créer des jeux de volumes et de reliefs, des jacquards, des effets 3D ; dans le second, il se révèle d’une finesse extrême et apporte transparence et raffinement, en maille jersey pour les t-shirts et la lingerie.
La large gamme de titrages se prête à tous les possibles sur des métiers rectilignes, circulaires, Jacquard, Rachel, dans diverses jauges et structures : jersey, côtes, maille piquée, molleton, maille éponge, double face…
Quant à l’aspect parfois irrégulier de certains fils de lin, il se vit désormais comme un atout, une authenticité qui joue les métissages avec des fibres naturelles, artificielles ou synthétiques, se lie –en mélanges intimes, retors ou guipés – au coton, à la soie, au cachemire, au lurex, au polyamide, à la viscose, à l’élasthanne, à la laine pour de nouveaux tricotages aux touchers différents.
Léger, le jersey de lin associe toutes les propriétés originelles de la fibre (pouvoir absorbant élevé, thermorégulation) et les caractéristiques de la maille (souplesse, élasticité, infroissabilité, facilité d’entretien car ne nécessitant pas de repassage), et lui confère une personnalité unique dans les secteurs du vêtement casual ou sportswear



Les propriétés empiriques du lin ont été démontrées scientifiquement par l’étude Confort et Performance réalisée par le Centre d’essais textiles lorrain Cetelor en novembre 2014. Les textiles 100 % lin obtiennent les meilleurs résultats en termes de ventilation et de respirabilité (suivis respectivement par la viscose et le coton) et offrent une isolation intermédiaire (notion de chaleur douce sans excès), gages de thermorégulation. Ils présentent l’absorption la plus efficace et favorisent une bonne évacuation de l’humidité, efficace pour le linge de bain comme pour des mailles jersey dédiées à l’athleisure, au confortwear et au sport1. Enfin ils présentent le meilleur indice de confort, c’est-à-dire le meilleur rapport entre isolation et respirabilité.
Marie Demaegdt, directrice Textile et RSE, Alliance for European Flax-Linen & Hemp
1- Compositions testées 100 % lin Nm39, fibre longue préparation maille 100 % coton Nm40, ring, torsion knitting, paraffined 100 % viscose Nm 40 ring, torsion knitting, paraffined 100 % PES Nm40, ring, torsion knitting, paraffined. - La fiche de synthèse de l’étude est disponible sur news.europeanflax.com/wp-content/uploads/2021/05/ETUDE-CONFORT-ET-PERFORMANCE.pdf.
Tricot intarsia qui joue les contrastes d’un dessin placé fond soyeux et effet velours animé d’un fil reliéfé – 81 % lin, 13 % soie et 6 % polyester. Bonneterie Cousy. Fils de lin mélangés Jos Vanneste.

Jersey en mélange de matières, de couleurs et de titrages – 93 % lin, 4 % coton, 3 % lurex. Fils lin Safilin, teinture certifiée Oeko-Tex Decoster, tricotage MCF, finitions TAC.
Maille arachnéenne réalisée dans un fil pur lin au titrage d’une extrême finesse (Nm 78). L’impression de légèreté est accentuée par un ajouré à effet “échelle”. Fil Linificio E Canapificio. Création Daniel Henry.
Un dessin géométrique en maille vanisée (effet positif/négatif) avec fil lin-cachemire (Iafil) et fil lin-alpaga (Michele Solbiati) de couleur contrastée – 50 % lin, 25 % cachemire, 25 % alpaga. Tricotage rectiligne. Bonneterie Cousy.
231 - UNE AGRICULTURE ET UNE INDUSTRIE ATTENTIVES ET RESPONSABLE UNE AGRICULTURE ET UNE INDUSTRIE ATTENTIVES ET RESPONSABLE - 230
Diverses applications de composites de lin dans le nautisme.




A Baltic Yachts Pink Gin Verde (Café Racer) (ampliTex™ par Bcomp) ; b Greenboats Flax 27 (renfort ampliTex™ par Bcomp) ; c : catamaran We Explore par KaïrosOutremer, Route du Rhum 2022 (Biorenforts par Terre de Lin) ; d : planche de surf Notox.





283 - UNE AGRICULTURE ET UNE INDUSTRIE ATTENTIVES ET RESPONSABLE UNE AGRICULTURE ET UNE INDUSTRIE ATTENTIVES ET RESPONSABLE - 282
DE CIVILISATION(S)
9782330182113 LE LIN, FIBRE
VA
21 x 24 cm
504 pages
220 illustrations en quadri
ouvrage relié
isbn : 978-2-330-05329-1
coédition hermès/actes sud
octobre 2015
prix provisoire : 49 euros
Savoir & faire : le bois

Collectif, sous la direction d’Hugues Jacquet
Au travers d’approches complémentaires, cet ouvrage encyclopédique regroupe, de l’amont à l’aval de la filière, tous les aspects du matériau “bois”. Depuis l’histoire et la géographie des forêts jusqu’à l’utilisation des nanoparticules du bois, Savoir & faire : le bois couvre les dimensions esthétiques, scientifiques, symboliques, historiques et socioéconomiques de l’un des premiers matériaux utilisés par l’homme.
Cinq grands chapitres permettent de mieux comprendre le contexte et l’actualité du matériau : les fondamentaux (physique, chimie, mécanique du bois, son histoire et sa symbolique, la géographie des forêts ainsi que le commerce du bois), l’usage durable de la ressource, les outils et les gestes, matière et techniques (évolution de l’usage du bois dans l’histoire et ses applications contemporaines dans l’industrie, le design, l’artisanat et la construction), avant de conclure par une approche reposant sur les sens : le bois dans la facture instrumentale, la parfumerie ; le bois que l’on goûte (les épices et le vin) ; sans oublier le regard des artistes contemporains sur ce matériau. Universitaires, chercheurs, artisans, forestiers, designers, historiens, géographes, sommeliers, artistes, ingénieurs, architectes, parfumeurs… Plus de trente contributeurs abordent chacun ce matériau en regard de leurs savoir-faire pour aboutir à une somme de connaissances, unique par sa complémentarité, associée aux grandes problématiques qui vont placer le bois et la forêt au cœur d’enjeux contemporains, tant pour la préservation de la ressource que pour montrer la diversité renouvelée de ses champs d’application. Au travers d’articles et d’entretiens, cet ouvrage rassemble la parole et les écrits d’individus connus et moins connus au sein d’un beau livre où le fond est indissociable de la forme : Michel Pastoureau, Giuseppe Penone, Raymond Guidot, les frères Bouroullec, Olivier Roellinger, Patrick Jouin, Yves Weinand, Françoise-Hélène Jourda, Stefano Micelli… Cet ouvrage s’adresse à l’amateur, qui aime et souhaite découvrir plus avant le matériau, autant qu’au spécialiste qui viendra compléter son domaine d’expertise par d’autres regards, points de vue et connaissances. Coédité avec la Fondation d’entreprise Hermès, il fait suite à la première Académie des savoir-faire : “Xylomanies ! Explorer les savoir-faire du bois”, un programme inscrit dans l’axe “Savoir-faire et transmission” de la Fondation.
Diplômé en sciences politiques, en histoire de l’art et en développement durable, Hugues Jacquet est socio-historien. Il est spécialisé dans les savoir-faire, leur évolution dans l’histoire et l’actualité de leurs apports esthétiques et socioéconomiques. Il est l’auteur de L’Intelligence de la main (L’Harmattan, 2012) et de nombreux articles sur le sujet. Il conduit ses recherches en France et à l’étranger (Inde), en cherchant à montrer la complémentarité et l’influence mutuelle entre les œuvres de la main et celles de l’esprit.
• L’ouvrage encyclopédique Savoir & Faire : le bois couvre les dimensions esthétiques, scientifiques, symboliques, historiques et socio-économiques de l’un des premiers matériaux utilisés par l’homme.
nature ACTES SUD Visuel provisoire - Diffusion Actes Sud
130
écorce aubier
d’où son nom de bois de compression. Il soutient par-dessous comme le ferait un étai. Pour les feuillus, plus récents dans l’histoire de l’évolution, le bois de réaction est constitué de cellules installées au-dessus de la charge, avec des parois contenant plus de cellulose efficace en tension et en flexion, d’où son nom de bois de tension. Il soutient par-dessus comme le ferait un hauban.


l e bois sous toutes ses facettes
Comment les cellules formant le xylème sontelles organisées à l’intérieur de l’arbre ?

1, 2, et 3 : bois de fil parallèle au tronc, dans l’axe de l’arbre.
1 plan longitudinal tangentiel, tangent aux cernes, dessin en forme d’ogive ou de flamme. coupe sur dosse.
2 plan intermédiaire. coupe sur faux quartier
3 plan longitudinal radial, perpendiculaire aux cernes, dessin avec des lignes parallèles. coupe sur quartier.
4 : plan transversal, perpendiculaire à l’axe du tronc, dessin avec les cernes concentriques. coupe en bois de bout.
Lors de la croissance de l’arbre, le cambium forme des couches de nouvelles cellules entre le bois et l’écorce. La nouvelle couche est déposée vers l’intérieur en suivant la forme de la plante. Le bois élaboré par l’arbre prend différents aspects macroscopiques selon les trois plans d’observation tangentiel, radial et transversal.


Le bois entre L’écorce et L a moe LL e
L’observation d’une coupe transversale (fig. 5) permet de distinguer : une écorce externe, une écorce interne, une zone de bois clair appelé aubier, le bois de cœur éventuellement plus sombre, appelé aussi duramen, et enfin la moelle. Le bois de l’aubier comme le bois de cœur peuvent être divisés en bandes alternatives claires et sombres ce sont les cernes annuels de croissance.
L’écorce et L e cambium
L’écorce externe ou rhytidome, produite par un méristème secondaire spécifique, est un tissu mort qui assure la protection contre la prédation, les chocs thermiques
duramen
moelle écorce externe écorce interne bois initial bois final cerne annuel
et mécaniques. À l’intérieur de l’écorce externe se trouve le liège, qui est constitué par une fine couche de cellules aux parois cellulosiques imprégnées de subérine, une substance assurant l’étanchéité.
Sous l’écorce, le cambium génère les tissus conducteurs de sève. Vers l’extérieur, le cambium produit le phloème secondaire ou liber, qui constitue l’écorce interne et dont la fonction est de distribuer la sève élaborée. Vers l’intérieur, le cambium produit le xylème secondaire dont la fonction primordiale est de conduire la sève brute vers les feuilles. Ce xylème secondaire est le bois. Année après année, il s’accroît de nouvelles couches de cellules qui se superposent et augmentent la circonférence et le diamètre des racines, du tronc et des branches.
L’aubier et L e duramen
Les couches ligneuses les plus récentes participent activement aux fonctions vitales de l’arbre, en particulier pour le transport en périphérie de la sève brute et pour le stockage des substances de réserve.
Au fur et à mesure, les couches les plus internes cessent d’être impliquées dans ces fonctions. Les parenchymes, cellules stockant les substances de réserve, se dévitalisent et meurent. Ils subissent alors des changements biochimiques qui participent en partie à la consolidation du bois de cœur. Ces cellules contribuent à la préservation du bois de cœur par la diffusion de tannins. Jouxtant l’aubier blanchâtre, et en raison des substances colorantes contenues dans les tannins, le bois de cœur peut être plus coloré et plus ou moins foncé. Ce processus de transformation est nommé duraminisation Dans tous les arbres, la couleur blanchâtre de l’aubier sous l’écorce est due à la constitution de la paroi cellulaire
coNNaître, recoNNaître et Nommer le bois | 33 32 | racineS
fiG 4 – les plans d’observation de la structure du bois dessinés sur une sculpture pyrogravée en tilleul, Tilia sp.
1 2 3 4
f G 5 – coupes transversales du pin laricio, Pinus nigra subs p. laricio (à gauche), et du chêne, Quercus s p. (à droite), et zooms au niveau de l’écorce.
sont disposés des pavillons en bois qui accueillent les chambres des patients. Ils n’ont pas du tout été choqués de se retrouver dans des bâtiments en bois.
Nous avons fait le maximum en bois en regard de réglementations qui sont très strictes en milieu hospitalier. Les gens montent dans les étages après leur admission au rez-dechaussée. Ils sont opérés au premier avant de monter dans le jardin pour leur convalescence. Ça leur plaît beaucoup de voir d’autres bâtiments en bois depuis leur fenêtre. Je pense que c’est très réconfortant. Au Canada, une étude montre que dans un hôpital ou une clinique en bois les gens guérissent plus vite que dans un hôpital en béton. Je pense que
c’est assez juste parce que le bois a différentes qualités. C’est un matériau qui respire et qui traite l’air. C’est un matériau qui rayonne tendrement pour les gens qui sont dans ces espaces. Je pense que les gens s’y sentent mieux et, quand on se sent mieux, on guérit plus vite, c’est normal.
pouvez-vous revenir sur le projet de la halle pajol dans le 18e arrondissement de paris ?

Bien avant le concours, une association de quartier était venue me voir pour me montrer les plans d’urbanisme et ce qui était prévu dans ce secteur du 18e arrondissement de Paris, notamment pour la halle industrielle
existante sur le site. Ils souhaitaient avoir mon avis sur ce projet précis. De toute évidence, il fallait couvrir la halle de panneaux photovoltaïques. Ils connaissaient le projet fait en Allemagne et c’est pour cette raison qu’ils m’avaient approchée. À la demande de l’association, j’ai fait un rapport à la Ville de Paris en leur disant ce que je pensais. Je l’ai signé. J’ai ensuite été convoquée par la Ville qui me demandait de quoi je me mêlais. Je leur ai répondu que je donnais mon avis à une association de quartier. Quelques années après, la Ville de Paris m’a demandé de déposer ma candidature pour l’appel à projets de la halle Pajol. Quand j’ai répondu au concours, j’ai voulu pousser le bouchon le plus loin possible

coNstruire eN bois aujourd’hui | 155 154 | Pour un uSage durable de la reSSource
ceci est une longue légende. sur deux lignes.
ceci est une longue légende. sur deux lignes.
222 matière et tecHniqueS Hier, auJourd’Hui et demain
l e savoir-faire de l’ É b ÉN iste : r É alisatio N d’u N cabi N et P laqu É e N É bè N e bla N c du l aos
cÉ cile Gilbert- byl
Historienne de l’art
r omai N Gilbert
hÉ ritière d’u N e lo NG ue traditio N remontant à la Renaissance, l’ébénisterie contemporaine a conservé sa vocation première, celle de créer des meubles d’exception magnifiant les essences de bois et les matériaux précieux. Les ébénistes du xxie siècle ont en commun avec leurs prédécesseurs, les “menuisiers en ébène”, des techniques celles du placage, de la marqueterie, de l’incrustation… Les matériaux et procédés contemporains leur permettent d’enrichir, de transformer et de renouveler la création de mobilier, qui revêt aujourd’hui des facettes extrêmement multiples.
Romain Gilbert, ébéniste créateur, s’est formé au sein de l’atelier d’ébénisterie familial. C’est en côtoyant des pièces exceptionnelles, réalisées pour des décorateurs ou des designers, qu’il s’est passionné pour la création contemporaine et a imaginé ses premières collections. Privilégiant les formes simples, les lignes sobres et pures, il cherche à mettre en valeur les matières, à exploiter les qualités propres des essences de bois qu’il utilise. Pour lui, le savoir-faire doit être
Ébéniste au service de l’objet et non une fin en soi ou une démonstration technique. Attachant une grande importance au détail, il aime créer des surprises, des subtilités qui ne se percevront pas forcément au premier regard mais qu’on découvrira avec le temps, au fur et à mesure. Visible ou invisible, il prend un soin minutieux à ce que chacune des étapes de la fabrication soit parfaitement exécutée, le résultat final tenant pour lui tout autant au dessin qu’à la qualité de la réalisation. Ses ouvrages sont des pièces uniques ou des séries limitées dont la conception peut naître d’une rencontre, de la découverte d’un matériau exceptionnel, de lectures ou de l’observation de la nature…
Nous allons suivre pas à pas la fabrication d’une de ses créations : une armoire basse plaquée d’ébène blanc du Laos.
Lorsqu’il a élaboré cette pièce, Romain Gilbert souhaitait créer un meuble au caractère sobre et dépouillé mais également précieux et raffiné, évoquant les meubles de voyage. Il a ainsi imaginé un caisson, ouvrant par des portes “en L”, à la manière d’un coffret posé sur un socle léger et indépendant.
l’ É tude et le choix des mat É riaux
Pour habiller le corps de l’armoire, il a choisi d’employer l’ébène blanc du Laos. Rare et précieuse, cette essence à la texture et au grain très fins présente une couleur crème marbrée de veines noires et grises semblables à des motifs réalisés à l’encre de Chine. D’un arbre à l’autre, la veinure peut être très différente les zones noires sont parfois très présentes, parfois beaucoup plus discrètes, droites ou sinueuses, formant des taches évoquant des motifs propices à la rêverie.
Pour concevoir le socle et les poignées, l’ébène du Gabon, bois sombre au grain très fin et au poli parfait, semblait idéal, se mariant harmonieusement avec les veines noires de l’ébène du Laos. L’étain a été choisi pour réaliser les plaques décoratives destinées à apporter une touche d’éclat au centre du meuble et à mettre en valeur les poignées.
Afin d’enrichir discrètement les façades, des filets d’étain et d’ébène du Gabon disposés en
alternance ont été introduits à la manière de lignes d’horizon.
Enfin, pour habiller les intérieurs, un placage de chêne à grain très fin uniforme, légèrement maillé et peu veiné, dont la teinte discrète s’associait parfaitement avec l’ébène blanc, a été retenu.
Après avoir esquissé à la main plusieurs croquis, Romain Gilbert réalise la totalité de ses dessins sur ordinateur. Chaque détail est étudié, puis tracé. La plupart de ses créations de meubles ou d’objets sont précédées de maquettes dont les proportions seront retravaillées jusqu’à obtenir la composition et le volume souhaités.

Puis, pour chacune des matières retenues, des essais et des recherches de finition sont menés et des échantillons sont réalisés et disposés côte à côte pour en vérifier l’harmonie. Ce sont également ces expérimentations sur le traitement des bois et des matériaux, les vernis, les teintes, les oxydations, qui nourrissent la créativité, permettent d’innover, de découvrir parfois par hasard un procédé qui sera à l’origine d’un futur projet.

| 223
choix des essences de bois.
sélection des matériaux d’incrustation.

| 379
frères chapuisat, Résidence secondaire vercorin, 2012.
à droite Giuseppe Penone, Albero-porta – cedro (Arbre-porte – cèdre) 2012. bois de cèdre. 316 x 105 cm (diamètre). vue de l’exposition, versailles, 2013. ci-dessus Giuseppe Penone, Continuera a crescere tranne che in quel punto (Il poursuivra sa croissance sauf en ce point) 1968. acier, arbre. documentation de l’état de croissance en 1978.

et j’ai trouvé une coïncidence : l’arbre avait 22 cernes de croissance et c’était aussi mon âge. J’ai continué par la suite avec cette idée de créer une forêt qui sortirait des poutres, d’un produit transformé par l’homme. Il y a autre chose que je dois dire à ce propos. À cette époque, dans les années 1960, l’art était très minimal et beaucoup d’artistes utilisaient des éléments industriels. Avec cette œuvre, j’avais la prétention de créer un dialogue ou, en tout cas, d’être dialectique par rapport à cette façon de travailler. À l’intérieur de la matière, il y avait quand même une forme qui n’était pas la forme industrielle donnée par l’homme. La matière gardait quand même son identité.

pourquoi montrer ce qui est caché ?
C’est un propos de la sculpture. Faire réfléchir à des formes qui existent, en cherchant à les révéler. La sculpture est une indication, elle indique une forme. Cela peut être fait seulement avec des mots ou cela peut avoir la forme d’un objet qui est fabriqué avec les mains ou avec d’autres moyens, mais la sculpture est toujours une indication. Il s’agit de rendre visible la réalité qui nous entoure. C’est fondé sur l’étonnement. Les arbres sont de tailles différentes, ils peuvent être gigantesques ou infimes. Je voulais faire un travail sur un tronc très grand et j’ai eu l’opportunité d’acheter un cèdre qui a été abattu dans le parc du château de Versailles par la tempête de 1999. À partir de ça j’ai fait le Cèdre de Versailles
votre œuvre est souvent au plus près de la nature mais avant tout des arbres. comment expliquez-vous ce tropisme pour les forêts et les arbres ?
L’arbre est un être vivant qui fossilise sa forme dans sa structure. Chaque cellule de l’arbre a été produite en fonction de sa vie.
| 383 382 SenSuelleS eSSenceS
21 x 24 cm
512 pages
400 illustrations en quadri ouvrage relié
isbn: 978-2-330-06850-9
coédition actes sud/fondation d’entreprise hermès
OCTOBRE 2016
prix provisoire : 49 euros
Savoir & faire : la terre

Collectif, sous la direction d’Hugues Jacquet
Deuxième volume de la collection “Savoir & faire”, cette encyclopédie embrasse, à travers six grands chapitres, toute la diversité que recouvre le mot “terre”. Céramistes, plasticiens, designers, sculpteurs introduisent cet ouvrage et montrent l’extraordinaire profusion des usages de ce matériau, que l’homme a commencé à transformer il y a plus de vingt-cinq mille ans. Les deux chapitres suivants déploient les grandes étapes de l’évolution historique, technique et esthétique des céramiques. Suit un volet consacré aux architectures de terre à travers le monde, auquel succède un panorama des céramiques techniques et de leurs usages grandissants dans une gamme toujours plus importante de secteurs d’activité. Enfin, sont abordées les grandes thématiques qui lient l’avenir des sols à celui de notre planète: microbiologie des sols, concurrence foncière et étalement urbain, dépollution, évolution des pratiques culturales…
Miquel Barceló, Mario Botta, Claude et Lydia Bourguignon, Pierre Charpin, Anna Heringer, Jean Girel, Andy Goldsworthy, Kristin McKirdy, Gilles Tiberghien… Plus de trente contributions ont été réunies pour aboutir à cette somme alternant articles de fond et entretiens avec les grands acteurs de notre temps. Abondamment illustrée, elle explore ainsi l’usage de la terre sur l’ensemble des continents d’un point de vue artistique, technique, environnemental et historique, afin de mieux donner à comprendre la beauté et la richesse tant d’un matériau que de notre planète.
Diplômé en sciences politiques, en histoire de l’art et en développement durable, Hugues Jacquet est sociohistorien. Il est spécialisé dans les savoir-faire, leur évolution dans l’histoire et l’actualité de leurs apports esthétiques et socioéconomiques. Il est l’auteur de L’Intelligence de la main (L’Harmattan, 2012) et de nombreux articles sur le sujet. Il a dirigé l’ouvrage Le Bois, premier volume de la collection “Savoir & faire”
Cet ouvrage fait suite à la deuxième Académie des savoir-faire organisée par la Fondation d’entreprise Hermès: “Terre!”
Repères
L’existant :
2014 - Céramique : Vocabulaire technique, Patrimoine Centre des monuments nationaux, 429 p., 60 €
2012 - Manuel du porcelainier, du faïencier et du potier de terre, BNF - Hachette, 376 p., 20,30 €
À paraître : Rien n’est annoncé pour le moment
Actes Sud :
2016 - Sol y sombra
2016 - Construire en terre allégée
2016 - Architectures de terre
2016 - Les Benchs
2015 - Savoir & Faire : Le bois
nature
Visuel provisoire - Diffusion Actes Sud
ACTES SUD
119
industrielle. Miquel Barceló aime, comme tous ceux qui ont beaucoup observé, voir dedans, voir au-delà. Il vient sucer la moelle de la matière quand d’autres se contentent de son écorce. “La volonté de regarder à l’intérieur des choses rend la vue perçante, la vue pénétrante. Elle fait de la vision une violence. Elle décèle la faille, la fente, la fêlure par laquelle on peut violer le secret des choses cachées. Sur cette volonté de regarder à l’intérieur des choses, de regarder ce qu’on ne voit pas, ce qu’on ne doit pas voir, se forment d’étranges rêveries tendues, des rêveries qui plissent l’intersourcilier 25.”

LA PENTE, LE PLAN, L’ENVOL
Au centre de l’île, non loin du village de Vilafranca, se trouve l’atelier dans lequel Miquel Barceló transforme la terre 26 déforme des briques en faciès d’animaux ou en figures humaines, des pots en colonne sans in, les déchire, les transperce de lèches, de roches, de restes, renvoie la
25. Gaston Bachelard, La Terre et les rêveries du repos Paris, Corti, coll. “Les Massicotés”, 2010 (1948), p. 14.
26. “C’est une ancienne briqueterie ou tuilerie – teulera en majorquin – qui réalise des briques et des tuiles. Les artisans qui y travaillaient n’étaient pas capables de faire autre chose que des tuiles […]. Dans cet atelier, on utilise deux fours un qui doit avoir une centaine d’années et un autre des années 1960. L’ancien, je l’ai recadré [et] adapté à la taille de mes œuvres. […] Je me suis dit qu’il fallait utiliser ce que nous avions et j’ai commencé à utiliser ces briques j’ai remis la machine en marche et j’ai commencé à refaire fonctionner l’usine. J’ai pensé que personne ne serait meilleur que nous pour faire des briques et que c’était un grand avantage. J’ai alors engagé les deux potiers de l’entreprise qui avait fermé. Voilà le point de départ : telle est la manière dont ces briques se sont transformées en têtes.” Catalogue Terramare op. cit., p. 221.

56 LA TERRE, MATIÈRE À CRÉATION
Ci-dessus et page suivante Miquel Barceló, Le Grand Verre de terre (verrière de l’atelier de céramique, Vilafranca, Majorque), argile sgraffitée sur verre, détail, 2015.
122 | LA TERRE, MATIÈRE À CRÉATION

Takuro Kuwata, Sans titre porcelaine, 2014




Sans titre porcelaine, 2014 ; Bol porcelaine, 2014 Bol porcelaine, 2014.
“Takuro Kuwata a une trentaine d’années et c’est vraiment, à mon avis, la personnalité la plus fascinante du paysage céramique japonais de la nouvelle génération. Dans cette dernière, je le considère vraiment comme un petit génie. l est extrêmement érudit. Il connaît très bien l’histoire de la céramique, il connaît tous les trésors nationaux vivants, il sait reconnaître dans le moindre restaurant d’où vient tel bol ou telle assiette, quel type de terre ou d’émail a été utilisé, que ce soit des choses qui proviennent d’un petit atelier ou qu’elles soient industrielles. La céramique est dans ses gènes ; il est érudit et très respectueux du passé, il va puiser dans ce dernier, le passe à son filtre et retourne tout. C’est vraiment de l’ordre d’un génie, il est lui aussi sur la corde raide. Au niveau esthétique, sa production peut heurter – tout cet or, ces couleurs, cette exubérance – mais en réalité nous sommes dans un langage qui est très abouti, très raffiné, très sophistiqué, et qui fonctionne très bien, par exemple, avec des objets plus classiques. C’est là aussi que l’on comprend que l’œuvre tient, quand elle est mise en parallèle avec un objet classique et qu’elle tient la comparaison haut la main. Il domine de haut sa génération, et pas uniquement au Japon.”
Fuku Fukumoto, Tukikage (Clair de lune) céramique, 2011.
“Fuku Fukumoto est caractéristique d’une tradition très japonaise, j’entends ici que, quand un artiste a développé une technique ou une forme d’expression, elle va être sa signature tout au long de sa vie. Vous retrouverez ce principe chez tous les artistes japonais que je défends. Elle travaille avec ces trois coupes en porcelaine qu’elle va émailler dans différents types de bleus et de céladons, jouant très subtilement d’une couleur à l’autre, un travail très féminin, très élégant. Il y a quelque chose chez elle de gracieux et de très délicat. Cette dimension de son travail m’a touché, de même que son rapport à la couleur. Elle a un panel restreint de couleurs, des verts d’eau, des céladons, des bleus et, d’une pièce à l’autre, elle arrive à garder une douceur et une sensualité qui, petit à petit, révèlent un univers très personnel.”
Vue de l’exposition de Yoshiro Kimura à la galerie Pierre-Marie Giraud, Bruxelles (mai-juin 2009).
“Yoshiro Kimura a environ soixante-dix ans. C’est un travail qui ramène à la contemplation, sentiment que l’on retrouve chez d’autres artistes de sa génération. Il a trouvé un langage, un médium et un mode d’expression à travers ce médium. De même, il a trouvé une couleur et il n’en changera pas. Il est très difficile de parler de son travail parce qu’il faut le voir et, quand on e regarde, on n’a pas envie d’en parler, on a juste envie de l’admirer. C’est de la contemplation pure.”

UNE ŒUVRE SINGULIÈRE, ÉLÉGANTE ET PRÉCISE | 123
qui se succèdent pendant trois siècles, diffusent dans tout l’Empire romain et même au-delà cette céramique, la première produite à une échelle véritablement industrielle.
Lors de la décadence de l’inluence romaine, les potiers gaulois abandonnent la couleur rouge de la sigillée, qui est la couleur de l’Empire, pour retourner à des goûts plus celtes de poterie noire ils cuisent alors cette sigillée à la même température, mais en atmosphère enfumée, et obtiennent une céramique à relets métalliques, dite métallescente. Mais cette production sera de courte durée et signera la in de la pratique des vernis d’argile en Occident.
Il est intéressant de noter que dans l’Amérique précolombienne, qui décore sa poterie à l’aide d’engobes et souvent de pigments posés après cuisson, une poterie à vernis rouge ou à métallescence a été pratiquée aux environs de l’an mille, tout à fait analogue dans sa technique à ses équivalents occidentaux. Cette céramique fut d’ailleurs baptisée à tort “plumbate”, tant l’aspect de sa vitriication pouvait la faire passer pour une céramique glaçurée au plomb.
L’INVENTION DES GLAÇURES
À la in du Ve millénaire, dans une période où l’Égypte fabrique une poterie rouge à bords noirs luisante par polissage, une technologie d’un type entièrement nouveau apparaît sous la forme de petits ornements, perles et pendentifs, recouverts d’un revêtement vert et brillant. Ceux-ci
ne sont pas façonnés dans l’argile, mais taillés dans une pierre tendre, la stéatite, un minéral utilisé depuis longtemps dans la fabrication d’outils et de vases, pierre dont la taille est facilitée par un chauffage préalable. Est-ce cette pratique de la chaufe du minéral qui, provoquant un jour par hasard un début de fusion de sable et de cendre à sa surface, va donner le déclic de cette invention qui signe la création de la première glaçure ?
Le procédé apparaît simultanément dans trois régions très distinctes : en Mésopotamie, en Égypte et dans la vallée de l’Indus. Le but commun est l’imitation de pierres précieuses, turquoise et lapis-lazuli, mais le modus operandi est spéciique
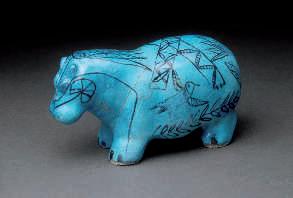

à chaque région. Il s’agit donc d’une invention conjointe sans qu’il y ait eu transfert de technologie. En efet, l’Égypte invente la glaçure en mélangeant du sable, un sel de soude d’origine lacustre très commun sur place et un minerai de cuivre ; en Mésopotamie, ce sont des cendres végétales qui fournissent le fondant qui, là, est potassique, tandis que, dans la vallée de l’Indus, la silice est apportée par une marne silico-calcaire. Le point commun de ces trois glaçures est la présence de cuivre, son emploi étant dicté par la volonté d’imiter la turquoise et son approvisionnement facile : on est dans la période du Chalcolithique. Dès que le principe de la glaçure est dominé, d’autres supports que la stéatite
vont être utilisés pour la mise en œuvre de ces objets glaçurés. Le moulage de roches siliceuses broyées, agglomérées par un liant organique, autorise une grande vitesse d’exécution, et le quartz ou le silex dont elles sont constituées est soudé par un lux vitreux. La silice favorise l’obtention du bleu, imitant le lapis-lazuli, alors que la présence de magnésie dans la stéatite conduisait plutôt à des verts. L’hippopotame turquoise du musée du Louvre, datant du IIe millénaire, témoigne de la maîtrise du procédé et de l’usage du manganèse pour les dessins en noir.
Cette glaçure peut être appliquée sur le corps de l’objet, ou être mêlée à la pâte et se rassembler à sa surface par elorescence, ou même être obtenue par cémentation, l’objet étant alors cuit dans un mélange poudreux se vitriiant à sa surface lors de la chaufe.
D’autres colorants que le cuivre sont déjà adoptés au IIIe millénaire : l’antimoniate de plomb pour la couleur jaune et l’antimoniate de calcium pour le blanc. La technologie de ces objets, que l’on nomme à tort faïences, précède le verre et en permet l’invention au IIe millénaire. À la différence de ces pâtes, qui sont façonnées avant d’être glaçurées, le verre, lui, est d’abord fondu et sa forme est obtenue pendant sa phase de refroidissement, au moment où il devient suisamment visqueux pour prendre et garder forme. Dans son état liquide, le verre se prête à tout un tas de mélanges, d’expérimentations, donc de trouvailles qui en retour vont augmenter les possibilités chromatiques des glaçures.
Frise des Archers (détail), pâte siliceuse, palais de Darius er, Suse, vers 510 av. J.-C. Musée du Louvre, Paris.
LES “ÉMAUX” | 303 302 | ORNER ? LE GOÛT ET LES COULEURS
Hippopotame, faïence égyptienne, Moyen Empire (vers 2033-1710 av. J.-C.). Musée du Louvre, Paris.
CONSTRUIRE EN TERRE, CONSTRUIRE UN SAVOIR-FAIRE ADAPTÉ : UNE APPROCHE NOVATRICE DU DÉVELOPPEMENT
L’ASSOCIATION LA VOÛTE NUBIENNE (avn) œuvre pour la diffusion en Afrique d’une technique millénaire de construction en terre, la voûte nubienne. Celle-ci permet la mise en œuvre de structures voûtées bâties en briques et en mortier de terre crue sans coffrage. Cette proposition se pose en alternative aux toitures traditionnelles qui nécessitent l’emploi de ressources ligneuses locales (bois de brousse) devenues rares et à l’usage de matériaux modernes importés, tôle et béton, largement inadaptés et à forte empreinte carbone.

Participant aux réponses apportées aux déis environnementaux, le concept de la voûte nubienne renforce aussi les enjeux socioculturels car il permet une réappropriation des “archicultures” communautaires et des modes constructifs participatifs. Son usage induit la création d’emplois et
Avec la précieuse collaboration d’Amarys Preuss.
la réinjection des flux financiers de la construction dans les économies de proximité qu’il pérennise 2. À cela s’ajoutent ses grandes qualités de confort et sa durabilité.
En mettant en œuvre un programme de vulgarisation de cette architecture, avn, présente en Afrique sahélienne depuis 2000, développe une ilière de construction adaptée et favorise ainsi l’accès rapide et pérenne, pour le plus grand nombre, à un habitat de qualité.
La terre est un matériau de construction local, souvent largement disponible et qui possède de bonnes performances thermiques passives. Comme elle est modulaire et permet des bâtiments de toute nature, son utilisation s’inscrit facilement dans les économies de proximité. Déjà
2. Pour une description exhaustive des étapes de construction d’un ouvrage bâti avec une voûte nubienne et des retombées socioéconomiques pour les communautés locales en Afrique occidentale, le lecteur peut se reporter au site très complet de l’association http://www.lavoutenubienne.org/fr.
largement usité, ce matériau participe à la réponse qui peut être apportée aux besoins en habitat de millions de familles dans de nombreuses régions du globe.
Il peut exister chez certains une propension à sacraliser la terre et à la proposer comme étant, en elle-même, une “panacée”, une réponse universelle. avn défend une position différente, dans laquelle la terre est à considérer comme un matériau de grande qualité, mais qui doit avant tout servir des techniques et des savoir-faire constructifs appropriés.
Les savoir-faire eux-mêmes doivent être appréciés comme un domaine en évolution. Une approche par trop patrimoniale des connaissances vernaculaires peut avoir pour conséquence de figer la nécessaire transformation de celles-ci. La validation des propositions techniques qui découlent de cette adaptation passe par leurs appropriations massives par les populations.
THOMASGRANIER
Cofondateur et directeur général de l’Association La Voûte nubienne 1
1.
– Le traitement des eaux pluviales pour réalimenter nos nappes naturelles, nos rivières, nos lacs et nos océans ;
– La réparation de sols industriels pollués pour permettre la création d’espaces verts “régénérateurs” en milieu urbain ou industriel
– La création de sites conservatoires pour le futur afin que la biodiversité s’y renouvelle (à destination notamment de la faune et de la lore en voie de disparition).


Au départ, notre équipe travaillait surtout dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques car ces milieux sont très
médiatisés, contrairement à ceux de l’air et du sol. Cet état de fait est regrettable car les urgences écologiques concernant l’air et les sols sont tout aussi, voire plus importantes. La Bioferme a donc été créée en 2006 pour s’attaquer directement au problème de la restauration des sols en France. Traiter les boues urbaines issues des stations d’épuration, les sédiments de lacs et de rivières, les vases des canaux pour en faire des composts normés, ain de faire de cet endroit un lieu démonstratif fort, était un objectif qui nécessitait la création d’un “démonstrateur” à une échelle industrielle indiscutable. Dans la
Bioferme, 30 000 tonnes par an de matières organiques redeviennent des fertilisants pour les sols au lieu d’être brûlées ou enfouies. Elles sont transformées en 3 000 tonnes de compost normé. Nous les valorisons sur 400 à 500 hectares de terres agricoles autour de la Bioferme, tout en créant de nouveaux itinéraires de culture à partir de plans expérimentaux pour réduire l’usage des engrais chimiques et des produits phytosanitaires. Pour que cette démonstration intéresse le plus grand nombre, notamment dans le monde agricole, je me suis dit qu’il fallait créer cette ferme pour que l’expérience se multiplie
d’elle-même. Située en Seine-et-Marne, celle-ci utilise le compost issu de boues et de sols pollués pour produire du blé sans les engrais et produits phytosanitaires chimiques habituels, et son fonctionnement montre aux exploitations agricoles voisines, à travers cette expérience première, que cela peut marcher. Nous devons garder en tête qu’un hectare de blé consomme de 10 à 15 tonnes de matières organiques par an. Or, cela fait des dizaines d’années que nous ne réintroduisons plus dans nos champs la matière organique consommée lorsque nous nous alimentons. En raison du recours massif, depuis les années 1950, aux solutions ofertes par la chimie (engrais, pesticides, etc.), nos sols agricoles n’ont cessé
de s’appauvrir. La solution est bien de restaurer les matières organiques des boues urbaines, des vases, des sédiments de nos villes et usines pour qu’elles retournent dans nos champs. Hélas, la généralisation des solutions de restauration écologique des sols est encore loin, dans cette époque où triomphent les incinérateurs industriels en charge de faire disparaître nos ennemies : “les pollutions”. Quel gâchis ! Il faut avoir conscience que la dégradation des sols en France est peut-être aujourd’hui une problématique plus importante que celle de la pollution des eaux. Notre équipe défend une approche “non traditionnelle” de la vie des sols et des plantes. Elle ne considère pas la
plante comme un outil qui absorbe la pollution, mais comme un “architecte” du sol. Notre objectif est donc que la plante reste “non polluée”, à l’inverse d’une approche en phytoremédiation où la plante est vue comme “mangeuse de pollution”, et qu’elle soit utilisée, au contraire, comme un élément qui permet de “phytolaver” les métaux lourds, les pollutions incassables, et de “phytodégrader” les pollutions cassables (comme les hydrocarbures et toutes les pollutions organiques). La plante peut alors être valorisée car elle n’est pas polluée. Une des particularités de Phytorestore est, à ce propos, la part de son chifre d’afaires consacrée à la recherche et développement (20 %). Environ dix programmes de recherches scientiiques sont en cours avec l’inra et le cnrs Des projets de recherche ont aussi été créés à l’étranger (en Chine et au Brésil). Le sujet principal de ces programmes est d’améliorer la résistance des plantes aux pollutions et la valorisation économique de ces plantes dépolluantes, pour un jour rendre accessible à tous le service dépollution “payé” en retour par la valorisation de la biomasse de la partie aérienne des plantes dépolluantes. C’est un long chemin dont nous ne voyons pas encore la in.
Sur les 105 hectares cultivables de la Bioferme, il y a des locaux de recherche avec un laboratoire équipé d’appareils qui permettent l’analyse de tous les types de polluants. Une pépinière y est aussi installée ain de produire les plantes dépolluantes pour l’ensemble de nos projets en France. Même si la réglementation
DÉPOLLUER LA TERRE AUTREMENT LES JARDINS FILTRANTS | 433 432 | QUELLE TERRE POUR DEMAIN ?
Ci-dessus et ci-contre Ville de Nanterre, parc du Chemin-de-l’Île, Jardin filtrant créé en 2006.
304 pages
90
REGARDS
REGARDS SUR LE MOBILIER ET DÉCORS ASSO -

CIÉS AUX LIEUX DE VIE ET DE PRODUCTION
Ouvrage collectif
Entre musée et œuvre d’art en soi, les maisons d’artistes, les lieux de vie ou de travail où le temps semble figé procurent au visiteur ce sentiment unique de pénétrer l’intimité de la personne.

L’ouvrage issu de ces journées traite de ces maisons “pleines”, des lieux de vie et de travail qui ont gardé leur décor, leur mobilier et leurs objets usuels. Que ce soient des habitations, des maisons d’artiste ou des lieux publics, ces œuvres “totales et immersives” posent de nombreuses questions aux conservateurs qui ont en charge leur connaissance, leur protection et leur préservation. Cet ouvrage s’attache à rendre compte de ces différents types de lieux et de leurs problématiques spécifiques : des maisons d’artiste, pensées et vécues comme des environnements propices à la création ou comme des écrins pour la monstration d’œuvres ; des maisons d’architecte ou de designer, conçues pour exprimer de nouvelles façons de vivre ; des maisons de collectionneurs, reflet des préoccupations, de l’environnement et des modes de vie de leur auteur ; enfin, des ensembles mobiliers formant décor, présents dans les institutions et lieux de pouvoir.
Tous ces lieux, souvent encore habités ou en usage, montrent une continuité des pratiques, une mémoire toujours vivante et une adaptation à de nouveaux usages d’ouverture vers les publics. Ces maisons sont autant d’invitations à découvrir des univers singuliers, conçus avec leurs propres codes, depuis la maison du peintre Foujita dans l’Essonne, celle du sculpteur Gaston de Luppé à Arles, de l’architecte Edmond Lay dans les Hautes-Pyrénées ou les décors de l’abbaye de Fontfroide dans l’Aude, réalisés par Odilon Redon pour Gustave Fayet. Des univers fragiles aussi, complexes à préserver, à l’exemple de la maison de Pierre Loti à Rochefort.
La
isbn : 978-2-330-18118-5
septembre 2023
Repères
Points forts
• Un ouvrage pour une réflexion multidisciplinaire sur les maisons d’artistes, qui met en valeur leur complexité.
• Une iconographie enrichissante, montrant la diversité de ces lieux.
• Une collection aux intervenants multidisciplinaires, dont la qualité et la modernité du propos sont constantes au fil des ans.
Mots clés
Visuel provisoire - Diffusion Actes Sud
24 cm
question se pose alors : comment conserver, restaurer, rendre accessibles au public ces espaces uniques et originaux, sans en modifier “l’esprit des lieux” ?
13 ×
illustrations en couleur
€
prix provisoire : 25
• Musée – Maison d’artiste – Mobilier – Décor –Mémoire – Conservation SUR LE MOBILIER ET DÉCORS ASSOCIÉS AUX LIEUX DE VIE ET DE PRODUCTION REGARDS SUR LE PATRIMOINE MULTIPLE ERRANCE & PICARD / ACTES SUD / ACAOAF ERRANCE & PICARD / ACTES SUD / ASSOCIATION DES CONSERVATEURS DES ANTIQUITÉS ET OBJETS D’ART DE FRANCE 9:HSMDNA=V]VV]Z:
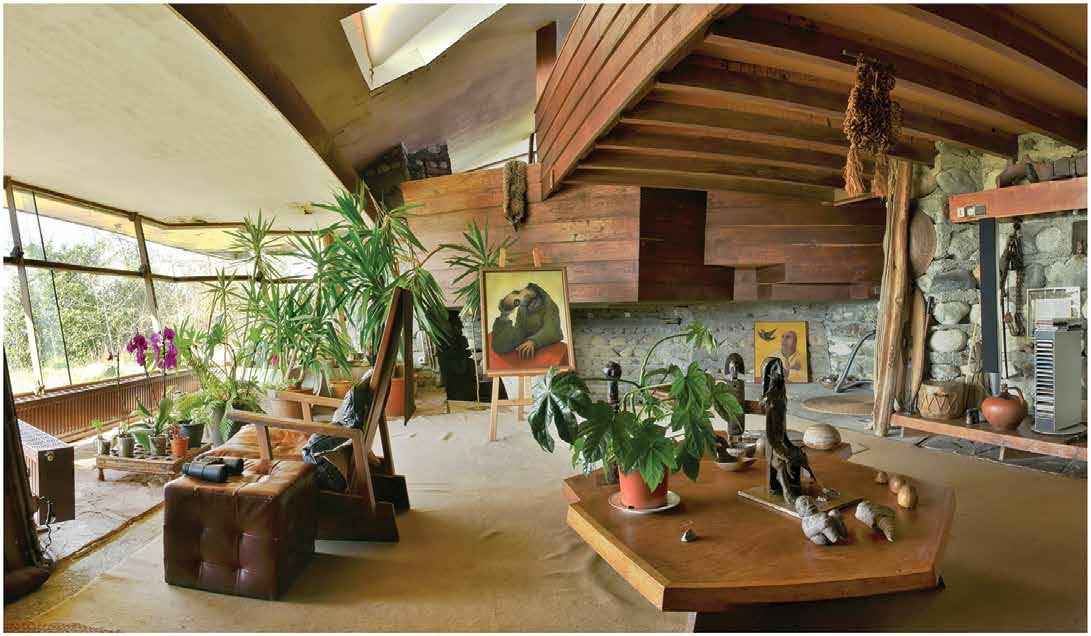
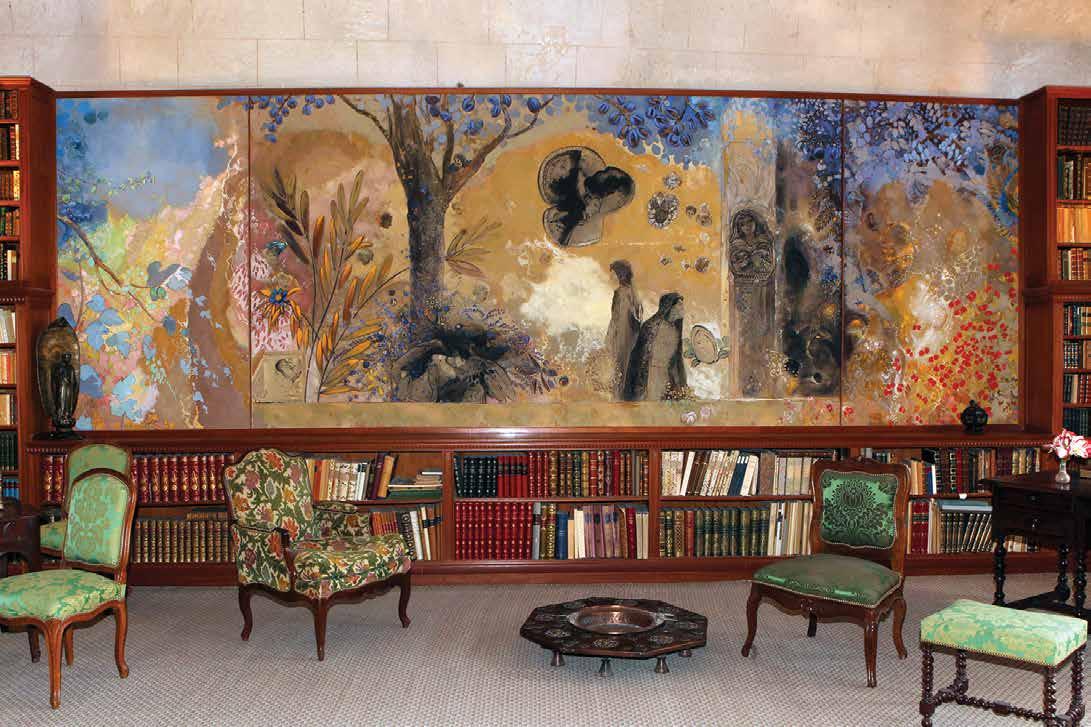


POSITIF N 751
9782330182120
Jean-Jacques Groleau
Callas M aria
MARIA CALLAS
 Jean-Jacques Groleau Préface d'André Tubeuf
Jean-Jacques Groleau Préface d'André Tubeuf
Maria Callas ? Une cantatrice à la voix phénoménale mais étrange, qui capte l’attention de l’auditeur dès la première inflexion. Un météore vocal. Une diva assoluta, peut-être la seule du xxe siècle. Une femme qui, de son vivant, était déjà devenue un mythe, bien au-delà des frontières de l’art lyrique.
La Callas fut cet objet fantasmagorique né de la seule volonté de fer d’une jeune fille décidée à prendre sa revanche sur la vie.
Était-ce parce qu’elle “souffrait d’un complexe d’infériorité surhumain”, comme l’a expliqué son producteur, Walter Legge ? Jamais Maria ne fut en paix avec elle-même, jamais elle ne put se satisfaire de ce qu’elle avait accompli. Elle voulait chaque jour prouver – se prouver – qu’elle pouvait encore mieux chanter, être plus belle, incarner avec toujours plus de vérité les personnages qu’elle sut pourtant faire vivre de l’intérieur comme nulle autre avant elle. Pour le centenaire de la naissance de Maria Callas, Jean-Jacques Groleau rend hommage à la femme autant qu’à l’artiste. Ce récit vif et limpide tente de retracer avec un grand réalisme la vie d’une chanteuse entièrement dévouée à son art. Il aidera ceux qui ne la connaissent pas encore à entrer dans les méandres de sa sidérante carrière.
Agrégé de lettres classiques, Jean-Jacques Groleau a été directeur de l’administration artistique de plusieurs grandes institutions lyriques françaises (Opéra national du Rhin, Opéra Orchestre national de Montpellier, Capitole de Toulouse). Il a collaboré a de nombreux ouvrages collectifs (Tout Bach, Tout Mozart, Tout Verdi, L’Univers de l’Opéra, Dictionnaire Wagner) et publié chez Actes Sud deux biographies, celles de Rachmaninov (2011) et Horowitz (2017).
Repères
Points forts
• Un récit factuel, sans interprétation, d’une lecture aisée.
• Un livre qui s'appuie sur une documentation fiable (lettres) et des études musicologiques.
: 978-2-330-18217-5
Visuel provisoire - Diffusion Actes Sud musique
10 × 19 cm 208 pages ouvrage broché isbn
septembre 2023 prix provisoire : 19 €
9:HSMDNA=V]WV\Z:
Préface d’André Tubeuf
Laurent Balandras est éditeur musical. Il a publié chez Textuel La Marseillaise de Serge Gainsbourg. Anatomie d’un scandale (2015) et Les Manuscrits de Claude Nougaro (2005).
LES PETITS PAPIERS DE SERGE GAINSBOURG

Laurent Balandras
Une nouvelle édi,on enrichie de nouveaux manuscrits pour l’ouverture du musée Gainsbourg.
« Un volume magnifique et captivant.» Le Monde « Un ouvragecollector» Le Parisien
« Sans technique, undon n’est rien qu’une sale manie », chantait Georges Brassens. Serge Gainsbourg quiaimait faire croire qu’il «balançaitseslyrics»avecfacilité ne le savait que trop En témoignent ici les fac-similés de ses manuscrits,raturés,corrigés, pleinsde biffures,découverts engrandepartiepar Charlotte Gainsbourg rue de Verneuil. Ouvragesomme pour œuvre monument, ponctuéd’extraits de scénarios, departitions annotées, depagesde roman, d’aphorismes,d’œuvres de jeunesse, de rares dessins, de reproductions de ses agendas Hermès où les séances d’enregistrementcôtoient des recettes de cuisine…celivre est unobjet collector, une mine où fourmillent rimes complexes, jeux de mots, doubles sens,licences poétiques etérotiques.
De nouveauxmanuscrits de chansonsretrouvés récemmentcomme Les P’tits Papiers, La Gadoue,Il s’appelleReviens, L’Ami Caouette, Overseas Telegram, Love on the Beat, Dis-lui toi que je t’aime viennent compléter les brouillonsde chansonsmythiquescomme Je t’aime… moi non plus, La Javanaise, Initials B.B. ou L’Homme à tête de chou…

• Cet ouvrage patrimonial s’adresse à un large public : ce sont désormais plusieurs générations d’afficionados qui partagent cette passion pour une œuvre qui défie les modes et demeure incandescente.
• L’ouverture du musée rue de Verneuil sera orchestrée par un plan média très ambitieux. Quatre lieux vont être inaugurés : la maison et en face un musée à vocation pédagogique, un restopiano-bar «Le gainsBar », une boutique où une sélection serrée d’ouvrages seront proposés à la vente dont celui-ci bien sûr.
Évènement : ouverture de la Maison Gainsbourg dans la maison de Serge rue de Verneuil le 20 septembre 23.
20,5 x 28,5, relié
528 pages, 59€
9782845978980
REV 13 septembre
•
2022
Musique
LES PTITS PAPIERS, enregistrée par Régine en 1965.
Ce manuscrit, d’un esthétisme graphique parfait, laisse imaginer que le texte est accouché en une seule fois.
On y trouve des listes de matières en papier dont certaines sont immédiatement insérée dans le texte. Malgré le désordre apparent, la chanson est pratiquement lisible dans son intégralité et ne subira à l’enregistrement que quelques modifications mineures.

Laissez parler
Les ptits papiers
(Biffé : papier carton)
À l’occasion
Papier chiffon
Un jour ça puisse
Papier maïs
Vous consoler
À l’occasion
Papier chiffon
Puissent-ils un soir
Papier buvard
Laissez brûler
Les ptits papiers
Papier de riz
Ou d’Arménie
Qu’un (Biffé : jour) soir ils puissent
Papier maïs
Vous réchauffer
(Remarques Gainsbourg
2 fois début et fin
Ils puissent un jour
Papier velours)
(Biffé Aston martin
Machin machine
Papier machine
Un verre au bar
Papier buvard)
(Biffé Machin machine
Papier machine
Ecoutez-les
Les ptits papiers)
Machin machine
Papier machine
Faut pas s’leurrer
Papier doré
Celui qui touche
Papier tue mouche
Est moitié fou
C’est pas brillant
Papier d’argent
C’est pas donné
Papier monnaie
Ou l’on en meurt
Papier à fleurs
Ou l’on s’en fout
(Biffé Les sentiments
Papier collant
Ça tient à quoi
Papier de soie
Ça tient à quoi
Papier de soie)
C’est du cafard
Papier de square
Avant longtemps
(Biffé Un peu d’cafard
Papier buvard)
Un peu d’amour
Papier velours
Et d’esthétique
Papier musique
Et ça suffit et ça suffit
Un point c’est tout
Et puis du vent
C’est pas marrant
C’est amusant
Laissez glisser
Papier glacé
Les sentiments
Papier collant
Ça impressionne
Papier carbone
Mais c’est du vent
(Biffé Ça n’est rien Ça prouve rien)
(Biffé C’est délicat Chacun pour soi Papier de soie)
C’est des regrets
Papier monnaie
Avant longtemps
Pour y voir clair
Papier de verre
C’est du (biffé cafard) chagrin
Papier (biffé : buvard) dessin
Avant longtemps
(Notes : Ça tient à quoi
Papier de soie
Papier journal
Papier à lettre
De désespoir
Papier maché
Laissez glisser
Papier glacé)
1950/1968 UN ART MINEUR 100 101
POUPÉE DE CIRE, POUPÉE DE SON, extrait de la partition, enregistrée par France Gall en 1965.
Je suis une poupée de cire Une poupée de son Mon cœur est gravé Dans mes chansons
Poupée de cire poupée de son Suis-je meilleure suis-je pire Qu’une poupée de salon Je vois la vie en rose bonbon Poupée de cire poupée de son Denis Bourgeois, éditeur de la chanson et ancien directeur artistique de Serge, est à l’origine de sa rencontre avec France Gall.
C’est lui qui a l’idée de demander à Serge de retranscrire cet extrait de la partition de la chanson victorieuse du concours de l’Eurovision 1965, pour la reproduire au dos d’une pochette qu’il fait imprimer pour les marchands de « petits formats ».
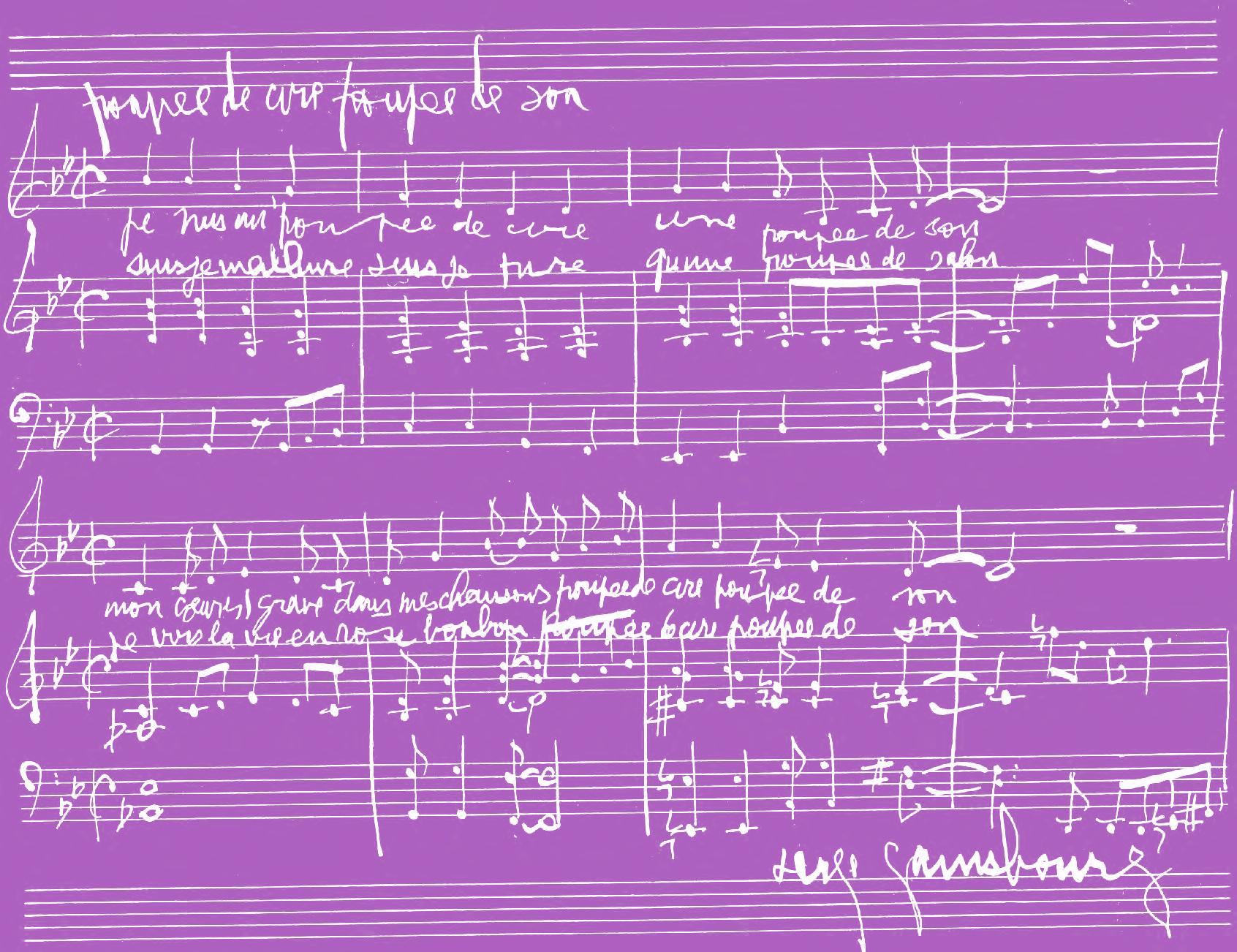
Les petits formats sont des partitions qui proposent généralement une version simplifiée de la chanson, dont la première page est illustrée d’une photo de l’interprète.
Seul moyen de pouvoir apprendre une chanson entendue à la radio avant l’apparition du microsillon, ils sont encore d’usage dans les années 1960.
1950/1968 UN ART MINEUR 106 107
T’AIME… MOI NON PLUS,
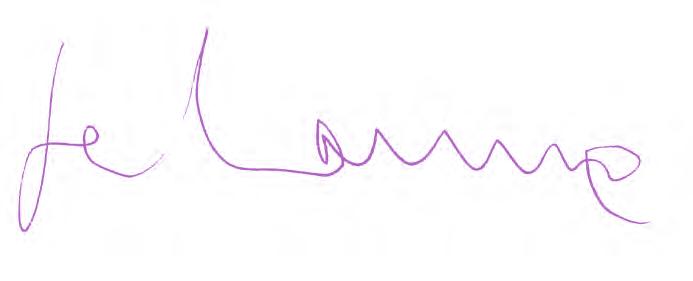


Je t’aime
Je t’aime
Je t’aime
Je t’aime
1 Comme la vague irrésolue
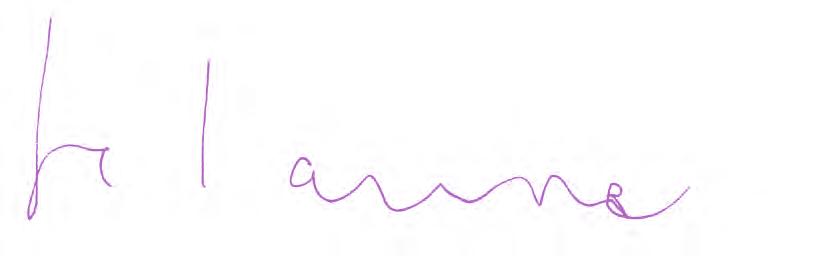
2 Tu es la vague moi l’île nue
3 Comme la vague irrésolue
4 Soupirs et elle
5 L’amour physique est sans issue non maintenant viens et soupirs
Ce document est probablement un pense-bête de Serge qui connaît suffisamment bien son texte pour n’avoir pas besoin de le consulter dans sa totalité.
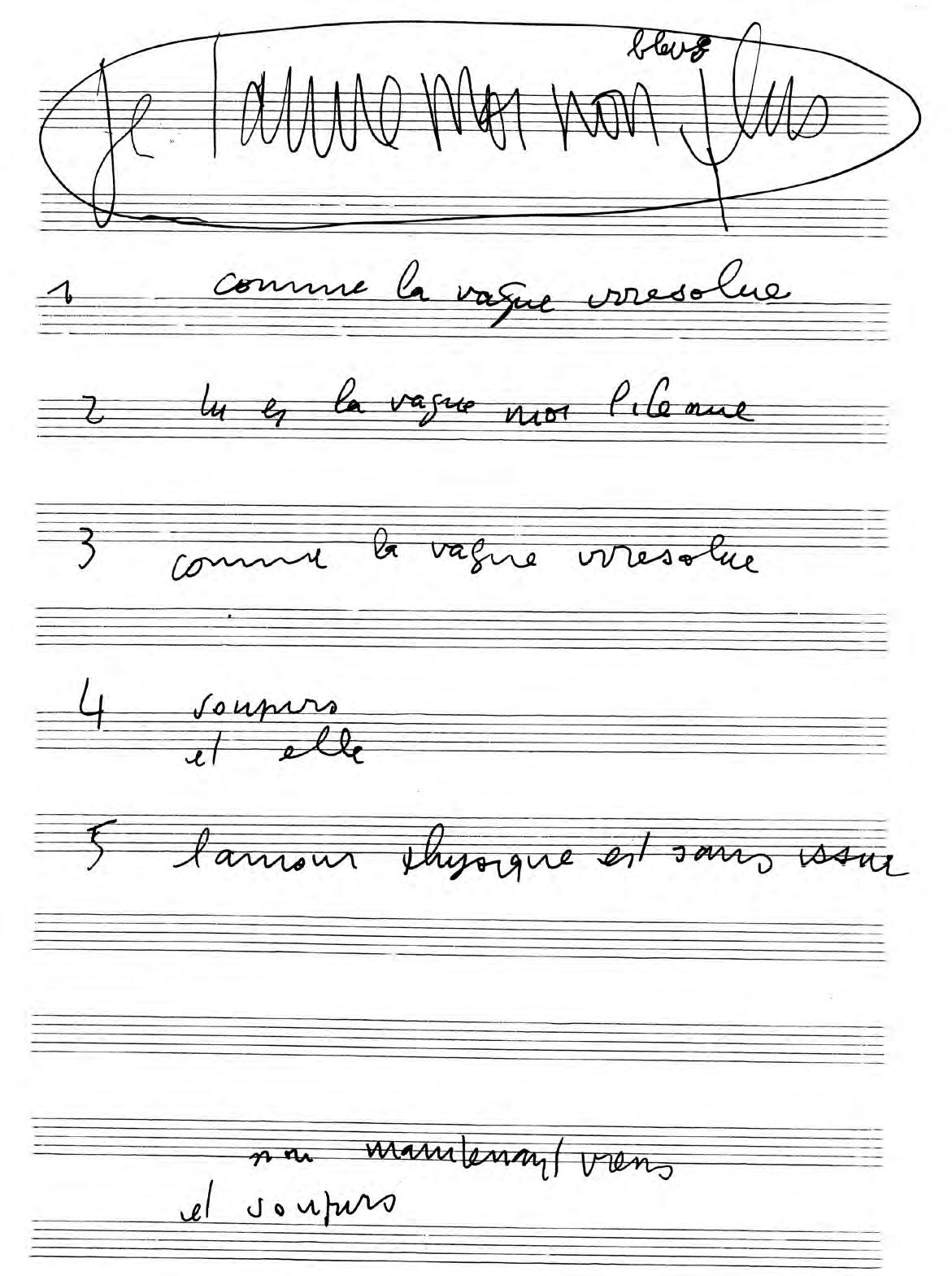
1968/1979 UN DANDY AUX DENTS DE LOUP 204 205
JE
enregistrée par Jane Birkin et Serge Gainsbourg en 1968.
NOTE, 1978.
J’ai croisé mon chien mort Ma petite nana
Y’a un an
Un petit pain au chocolat Entre les dents
Remuant la queue Comme un métronome Serge est très affecté par la mort de sa chienne, Nana.
Il l’avait mise en scène dans le film Je t’aime moi non plus et lui faisait prendre la pose quand les photographes venaient faire un portrait de la famille Birkin-BarryGainsbourg. Il lui rendra hommage dans la chanson Des laids des laids en 1979 :
Pauv’ toutou, c’est moi qui bois Et c’est lui qu’est mort d’une cirrhose
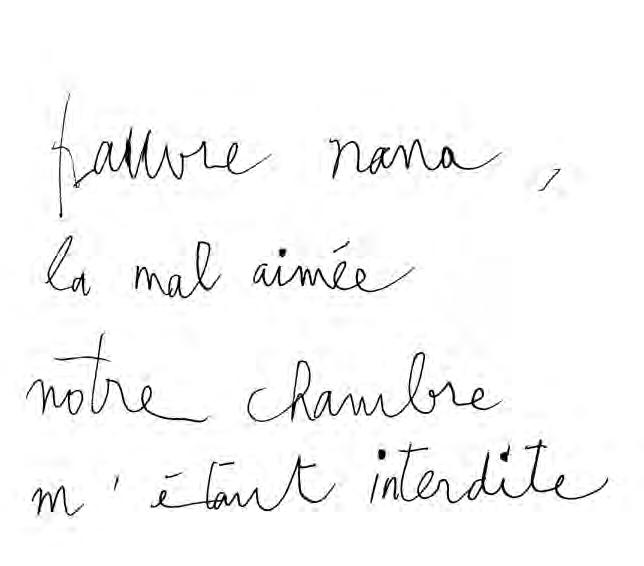
Peut-être était-ce par osmose Tellement qu’il buvait mes paroles
PORTRAIT DE CHARLOTTE, dessin à la plume de Serge Gainsbourg sur la nappe du restaurant Les Vapeurs, 1978.
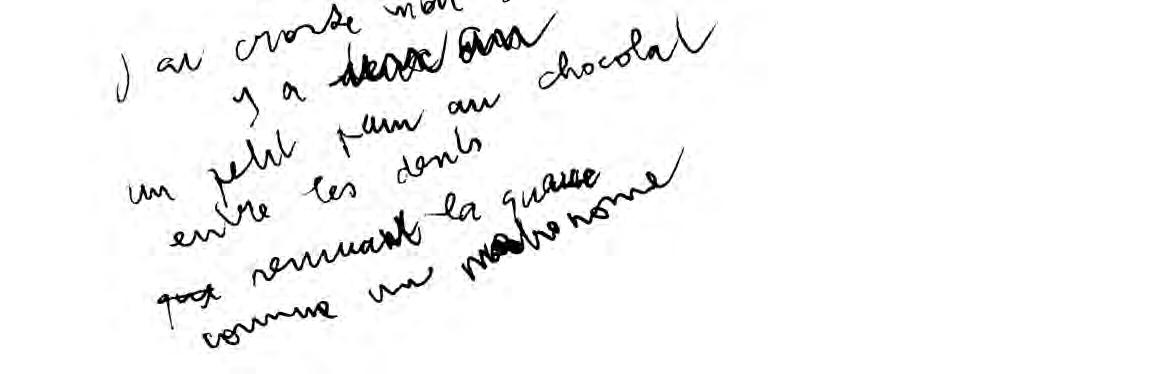
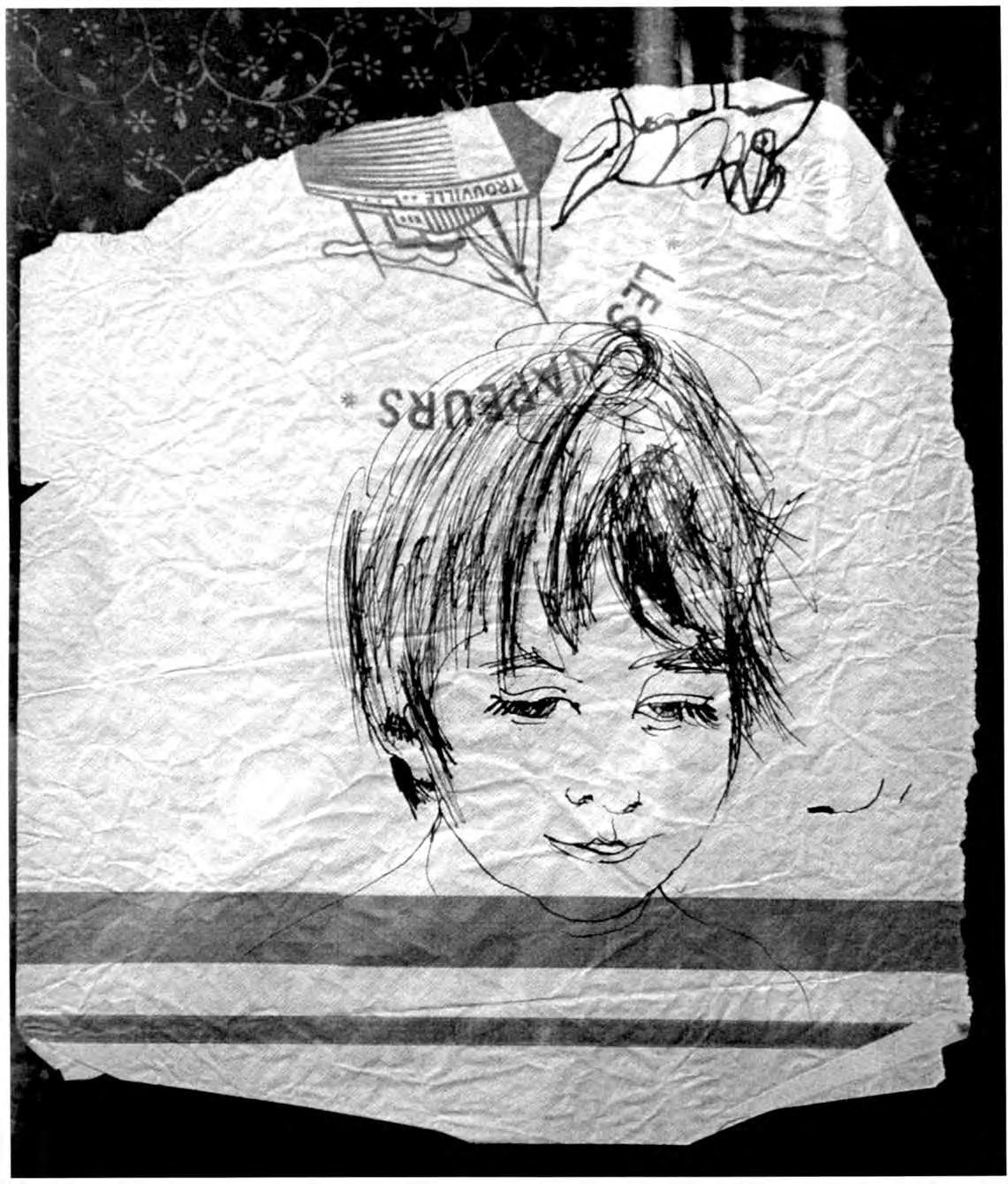
Jane se souvient que ce dessin a été réalisé peu de temps après la mort de Nana. Charlotte est donc âgée d’à peine sept ans.
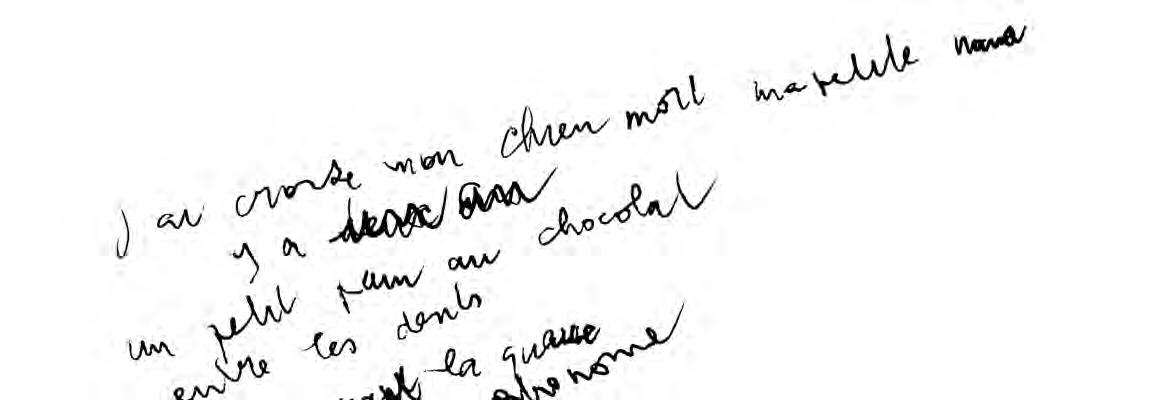
1968/1979 UN DANDY AUX DENTS DE LOUP 304
: 978-2-330-16609-0
LA FABRIQUE DES ANIMAUX COLLECTION “CAHIERS
DE L’ART FABER”
Photographies de Yann Arthus-Bertrand
Textes de Lourdes Arizpe, Jérôme Duval-Hamel, Yann Arthus-Bertrand, avec Éric Baratay, Catherine Briat, Jean-Marc Dupuis, William Kriegel, Jean-Pierre Marguénaud, Olivier Vigneaux
L’Art faber rassemble les œuvres d’art – picturales, littéraires, photographiques, musicales, cinématographiques… – ayant pour thèmes le travail, l’entreprise et plus globalement les mondes économiques.
Après le Petit Traité de l’Art faber, paru en mai 2022, qui présente le concept de l’Art faber, Les Cahiers de l’Art faber proposent d’aborder des thèmes de l’actualité économique en mobilisant artistes contemporains et experts. Cette série des Cahiers complète la collection anthologique et historique des Spicilèges de l’Art faber, dont le premier ouvrage, Spicilège beaux-arts de l’Art faber, paraîtra à l’automne 2023.
Si Homo faber est un fabricant d’outils, de machines, de produits de consommation, il est aussi, de manière plus surprenante peut-être, un cocréateur du vivant, notamment animal. Ceux qui pratiquent l’élevage ont au cours du temps domestiqué les animaux en les transformant et même en créant de nouvelles variétés mieux adaptées aux besoins du marché. Cette fabrication du vivant soulève depuis plusieurs décennies de nombreuses questions, notamment écologiques, économiques et éthiques avec une attention toujours plus grande portée à la santé animale et humaine. Ce premier Cahier de l’Art faber propose un dialogue inédit entre l’art et l’économie sur ce sujet au cœur du débat contemporain : la fabrique des animaux. Identifié par une grande enquête menée auprès de mille personnes, comme un pionnier et une référence sur les questions environnementales et animales, le photographe Yann Arthus-Bertrand a accepté de participer à ce premier numéro. Entre ses pages, il présente une sélection originale de photographies tirées de ses séries “Bestiaux” et “Chevaux”. Aussi puissants qu’émouvants, ces portraits évoquent les liens entre éleveur et animal, la complexité de leur situation, et composent une œuvre à la fois esthétique et sociologique majeure. Ces clichés sont accompagnés d’un entretien inédit dans lequel le photographe livre ses motivations, expose sa démarche artistique ainsi que sa vision de la problématique de la fabrication des animaux et des enjeux écologiques contemporains.
Cette approche artistique est enrichie d’un regard pluridisciplinaire porté sur le sujet par des experts, éleveur, juriste, économiste, historien et spécialiste du marketing.
La collection des Cahiers de l’Art faber est codirigée par Jérôme Duval-Hamel et Laurent Pfister. Les photographies sélectionnées par Yann Arthus-Bertrand et présentées dans cet ouvrage sont issues de la collection du Fonds de dotation la Cense. Cet ouvrage est porté par le Lab. Arts & Entreprises de l’université Paris-PanthéonAssas. Pour plus d’informations : www.artfaber.org.
Repères
Points forts
• Une analyse artistique, économique, juridique et sociétale de la fabrique des animaux.
• Une relecture inédite d’une série majeure de Yann Arthus-Bertrand, à la fois esthétique et sociologique.
Mots-clés
• Art faber / Yann Arthus-Bertrand / bestiaux / chevaux / races animales / éleveur / élevage / activité économique / droit animal / écologie / photographie
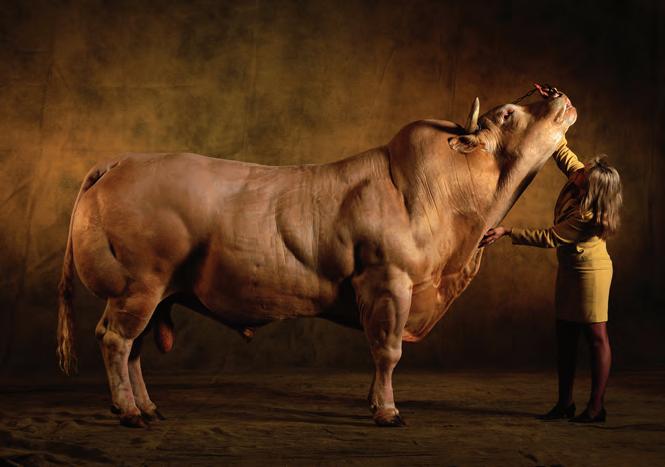
arts Visuel provisoire - Diffusion Actes Sud
21,5 × 31,5 cm 128 pages 52 illustrations en couleur ouvrage broché coédition actes
faber isbn
septembre
prix provisoire : 25 € Lourdes Arizpe, Jérôme Duval-Hamel et le Collectif de l’Art faber La fabrique des animaux The animal factory LA FABRIQUE DES ANIMAUX 2023 France www.actes-sud.fr 9:HSMDNA=V\VWZY: The Animal Factory LES CAHIERS DE L’ART FABER ACTES SUD LES CAHIERS DE L’ART FABER | ACTES SUD avec Yann Arthus-Bertrand 9:HSMDNA=V[[U^U:
sud/art
2023
6-9
Lourdes Arizpe et Jérôme Duval Hamel
Art Faber et la fabrique des animaux Traduction en anglais à venir
10-19
Éric Baratay
Des bêtes et des hommes, une longue histoire Traduction en anglais à venir
20-111
Yann Arthus-Bertrand Séries “Bestiaux” et “Chevaux” Traduction en anglais à venir
84-85
Yann Arthus-Bertrand et Catherine Briat Conversation autour du portfolio Traduction en anglais à venir
112-113
Jean-Marc Dupuis Bestiale, l’économie des hommes ?
Traduction en anglais à venir
114-117
William Kriegel
Un nouveau partenaire pour l’animal Traduction en anglais à venir
118-121
Jean-Pierre Marguénaud Animaux, de quel droit ? Traduction en anglais à venir
122-125
Olivier Vigneaux
Les lendemains de l’animal Traduction en anglais à venir

126
CONTRIBUTEURS TRADUCTION À VENIR
LES LIVRES DU COLLECTIF DE L’ART FABER TRADUCTION À VENIR
(© Fonds de dotation la Cense / Photographies Yann Arthus-Bertrand)
(© Fonds de dotation la Cense / Photographies Yann Arthus-Bertrand)
Pimprenelle, jument Auxois âgée de quatorze ans, fille de Glorieux et de Jonquille, championne de sa race, présentée par Romaric, le petit fils de Roger Dubois, France. Salon de l’agriculture, Paris, mars 1995.
Pimprenelle, jument Auxois âgée de quatorze ans, fille de Glorieux et de Jonquille, championne de sa race, présentée par Romaric, le petit fils de Roger Dubois, France. Salon de l’agriculture, Paris, mars 1995.
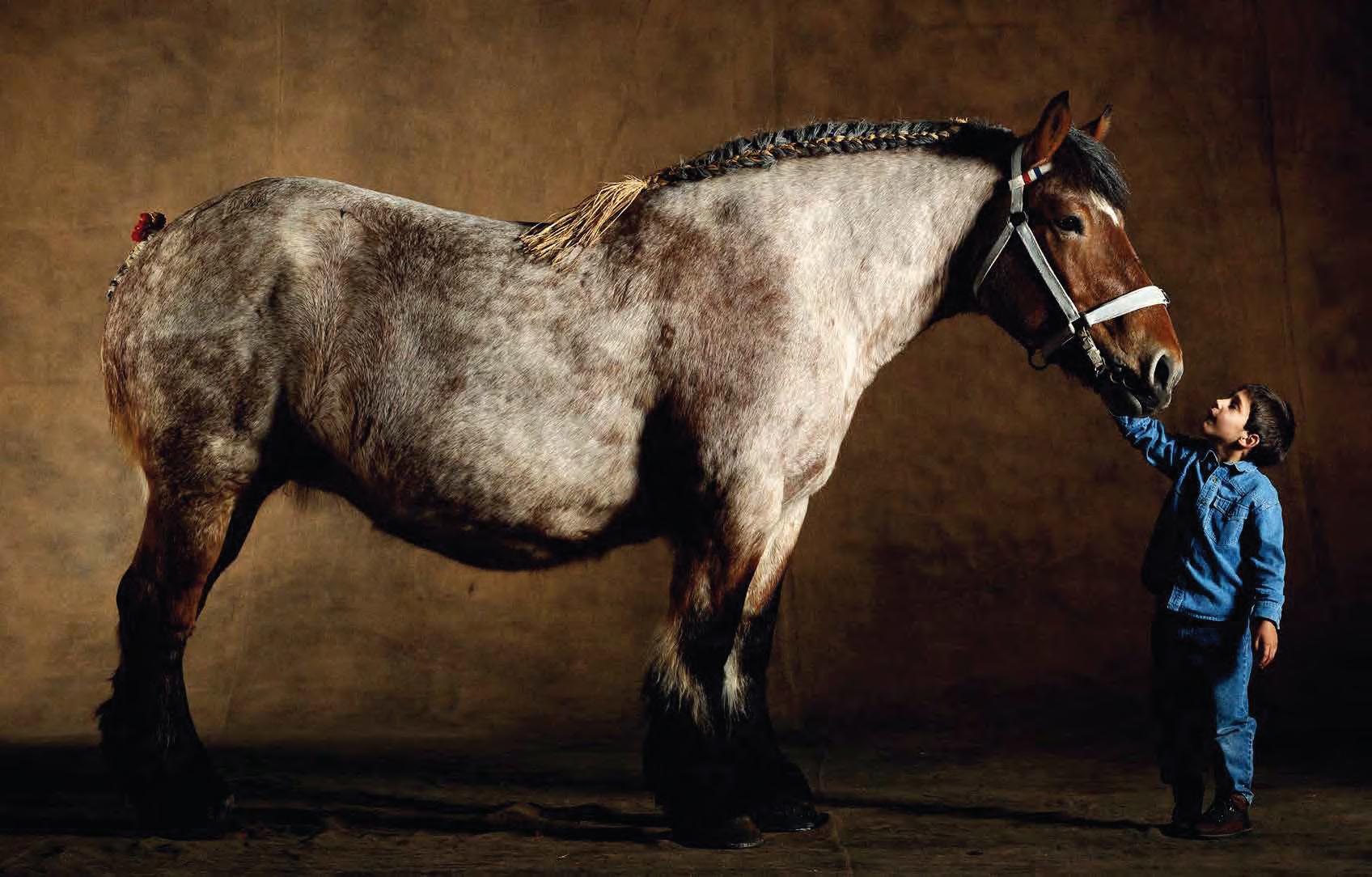
97 AUXOIS
Bestiaux Good Breeding
PHOTOGRAPHIES DE YANN ARTHUS-BERTRAND
PHOTOGRAPHIES DE YANN ARTHUS-BERTRAND
Pendant presque vingt ans, du début des années 1990 à la fin des années 2000, Yann Arthus-Bertrand a photographié éleveurs et bestiaux aux Salon de l’agriculture à Paris et un peu partout dans le monde. À travers ces images et la sélection qui nous est ici présentée par l’artiste, c’est aussi ce lien si particulier entre l’homme et l’animal, cette relation intime qu’il nous est donné à voir, autant que la fabrique des animaux d’élevage considérés parmi les plus beaux spécimens de leurs races.
Ces photographies sont aujourd’hui la propriété du fonds de dotation la Cense, que nous remercions chaleureusement pour son soutien lors de la réalisation de cet ouvrage.
Pendant presque vingt ans, du début des années 1990 à la fin des années 2000, Yann Arthus-Bertrand a photographié éleveurs et bestiaux aux Salon de l’agriculture à Paris et un peu partout dans le monde. À travers ces images et la sélection qui nous est ici présentée par l’artiste, c’est aussi ce lien si particulier entre l’homme et l’animal, cette relation intime qu’il nous est donné à voir, autant que la fabrique des animaux d’élevage considérés parmi les plus beaux spécimens de leurs races.
Ces photographies sont aujourd’hui la propriété du fonds de dotation la Cense, que nous remercions chaleureusement pour son soutien lors de la réalisation de cet ouvrage.
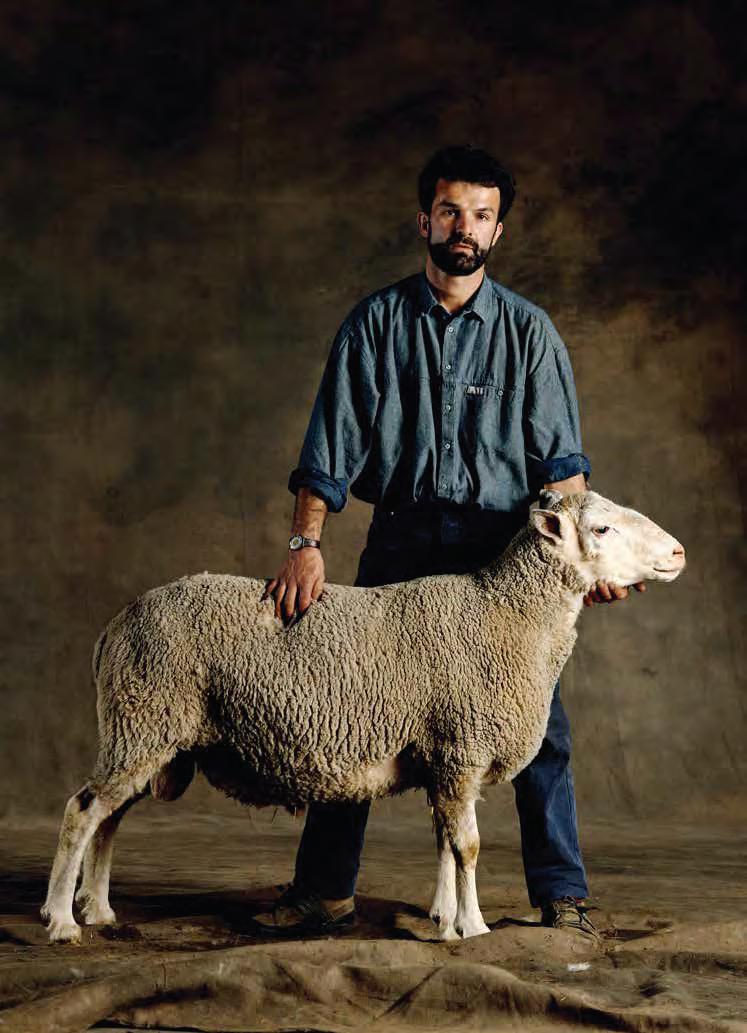
21
INRA 401
Bélier INRA 401, présenté par Didier Perreal et appartenant au Géode (Génétique ovine et développement), Montmorillon. Salon de l’agriculture, Paris, mars 1992.
(© Fonds de dotation la Cense / Photographies Yann Arthus-Bertrand)
Bélier INRA 401, présenté par Didier Perreal et appartenant au Géode (Génétique ovine et développement), Montmorillon. Salon de l’agriculture, Paris, mars 1992.
Des histoires vraies
DES HISTOIRES VRAIES
[Nouvelle édition]
Sophie Calle

Publié pour la première fois en 1994 et régulièrement réédité et enrichi depuis, Des histoires vraies revient cette année pour la huitième fois, augmenté de trois récits inédits. Sophie Calle continue à nous raconter ses histoires, dans un langage précis et sobre, avec le souci du mot juste. Tantôt légères et drôles, tantôt sérieuses, dramatiques ou cruelles, ces histoires vraies, toutes accompagnées d’une image, livrent dans un work in progress les fragments d’une vie. Du même auteur aux éditions Actes Sud :
• Des histoires vraies, coédition galerie Sollertis, 1994 ; Actes Sud, réédition 2002, 2011, 2012, 2013, 2016, 2018, 2021
• L’Erouv de Jérusalem, 1996, 2002

• Doubles-jeux (coffret de sept livres), 1998
• L’Absence (coffret de trois livres), 2000
• Les Dormeurs, 2001
• Douleur exquise, 2003
• En finir, 2005
• Prenez soin de vous, 2007
• Où et quand ? (coffret de trois livres), 2009
• Aveugles, 2011
• Fantômes, 2013
• Voir la mer, 2013
• Tout, 2015
• Que faites-vous de vos morts ?, 2019
• L’ascenseur occupe la 501, 2022
• Sophie Calle, Photo Poche, 2022
Repères
Points forts
• Des histoires vraies, c’est déjà 47 500 ventes.
• Sophie Calle a acquis une renommée internationale dans les années 1990, en France et aux États-Unis, par la publication de nombreux livres chez Actes Sud. Elle fait désormais partie de plus grandes artistes de la seconde moitié du xxe siècle.
10 x 19 cm
152 pages
66 illustrations en couleur ouvrage relié
isbn version française : 978-2-330-18247-2
isbn version anglaise : 978-2-330-18246-5
septembre 2023
prix provisoire : 20,50 €
Depuis la fin des années 1970, Sophie Calle fait l’objet de nombreuses expositions à travers le monde. Tour à tour décrite comme artiste conceptuelle, photographe, vidéaste et même détective, elle a développé une pratique immédiatement reconnaissable, alliant le texte à la photographie pour nourrir une narration qui lui est propre. Elle fait désormais partie des plus grandes artistes du xxie siècle.
arts Visuel provisoire - Diffusion Actes Sud
ACTES SUD SOPHIE CALLE SOPHIE CALLE Des histoires vraies A CTES SUD 9:HSMDNA=V]WY\W:
La famille
Lorsque j’avais quatre ans, mon rituel préféré était la cérémonie funéraire de mes poissons rouges. J’ai de qui tenir : ma grand-mère maternelle avait choisi un cimetière avant de choisir une maison. “Le docteur m’a conseillé d’aller vivre sur la Côte d’Azur. J’hésite, j’ai décidé d’aller voir d’abord le cimetière de Cannes. Là, je pourrai me rendre compte.” Moi, c’est Montparnasse. Dans le ventre de ma mère déjà, je parcourais ses allées, puis c’est en landau que je l’ai traversé. En 1992, avec mon père, nous avons décidé d’y élire domicile et il est devenu propriétaire d’une concession dans la 9e division. Puisque nous y passerions notre mort, je souhaitais me familiariser avec le quartier, et les années suivantes il m’a parfois accompagnée lors de ces visites de voisinage. Il y avait de la place pour trois dans notre demeure. Ma mère, qui n’avait pas les moyens de financer un projet immobilier et craignait de finir dans son caveau familial, en banlieue, à Bagneux, proposa sa candidature. Hors de question pour mon père. C’est alors que j’appris que dans la famille Calle recomposée allaient cohabiter le père, la fille, la belle-mère. Pour moi, cela n’avait aucun sens. J’ai résolu de déménager



143
Collection Jean Lafont


Durant plus de cinquante ans, lors de mes fréquents séjours en Camargue, Jean Lafont m’a logée dans un mazet, à cent mètres de sa maison, et j’ai pris mes repas chez lui. À sa mort, trois cent dix-huit lots firent le voyage à Drouot pour y être dispersés. La chaise cannée que j’occupais à table (66), la desserte (79) qui me faisait face, l’Allégorie de la foi, figure voilée en marbre blanc (12), Eberhard le Larmoyeur (163)…, je connaissais intimement les objets de sa vie. Lors de leur exposition, à la veille de la vente, il régnait un désordre inhabituel : la desserte tournait le dos à un inconnu qui occupait ma place coutumière dans la cuisine, le bureau (50) était nu, amnésique, le regard de marbre avait perdu sa transparence. Une dernière fois, je me suis assise à cette table, assurément celle qui m’avait le plus souvent accueillie, devant la cheminée en céramique (120), sur l’indiscret (13) de la véranda. Le lendemain, je n’ai pas pu enchérir. J’ai salué, en partant, les quatre chaises bleues (205) qui attendaient leur nouvelle histoire sur le trottoir.

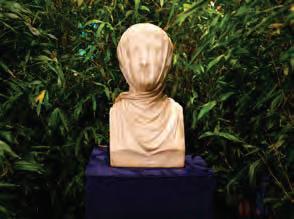
145
Légende de l’artichaut
Mon grand-père a fui la Pologne vers 1910. Direction l’Amérique. Première étape : Paris, gare de l’Est. Il s’est arrêté dans le restaurant le plus proche, il ne parlait pas la langue, il a mis son doigt au hasard sur la carte. Quand on a posé sur la table l’artichaut qu’il venait
de commander, couverts en main, il a observé cet étrange légume sans savoir par quel flanc l’attaquer. Le serveur s’est aperçu de son embarras et lui a montré comment l’effeuiller pour atteindre son cœur. Et mon grand-père de mimer les gestes délicats de cet inconnu qui aidait un étranger, un juif… “Je reste !” Il est resté.

146 147
12,5 × 19 cm
144 pages
64 photographies en noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-7427-4961-4
juin 2023
prix provisoire : 13,90 €
MAN RAY [Réimpression]
Photographies de Man Ray

Introduction de Merry A. Foresta
Repères
Points forts
Poche cette collection a l’ambition d’offrir des livres de photographies soigneusement imprimés, maniables par leur format, accessibles par leur prix, à tous ceux que passionne un moyen d’expression dont on reconnaît l’importance. Si l’on veut en couvrir tous les champs, la photographie offre une matière inépuisable. Monographies, sujets
thématiques ou
à l’infini
qui
Pionnier de la peinture moderne, du cinéma et de la photographie, Man Ray est un artiste américain d’avant-garde, figure importante des mouvements dadaïste et surréaliste. Il prétendait que la peinture lui servait à fixer les images de la réalité consciente et que la photographie était le mode d’expression du fantastique. Pour lui, il n’existait pas de frontière entre les divers modes d’expression artistique ; tous étaient des outils à employer dans le processus de la création.
au fil des jours 10. Robert Frank 11. Le Grand Œuvre 12. Duane Michals 13. Étienne-Jules Marey 14. Bruce Davidson 15. Josef Koudelka 16. Eugène Atget 17. André Kertész 18. L’Opéra de Paris 19. Mario Giacomelli 20. William Klein 21. Weegee 22. Autochromes 23. Alexandre Rodtchenko 24. Le Nu 25. Werner Bischof 26. Helmut Newton 27. Du bon usage de la photographie 28. Brassaï
Né à Philadelphie en 1890, Man Ray grandit à New York. Il y rencontre Alfred Stieglitz, photographe d’avant-garde et premier marchand d’art à exposer des photographies à côté de peintures modernes. En 1920, il visite, dans son atelier new-yorkais, son ami Marcel Duchamp, qui l’amènera à intégrer le mouvement dada et à créer de nombreux ready-made.
Man Ray arrive à Paris à l’été 1921 avec une malle pleine de ses œuvres, qui lui valent d’être chaudement accueilli par les cercles dadaïste et surréaliste. Lié d’amitié avec André Breton, Paul Éluard, Salvador Dalí, Jean Arp, Max Ernst, et grâce aussi à la muse de l’avant-garde Kiki de Montparnasse, il se spécialise dans les portraits d’artistes et signe les œuvres photographiques centrales du surréalisme (Le Violon d’Ingres, 1924). Ses collaborations avec Vanity Fair font de lui un célèbre photographe portraitiste, de même que les magazines comme Vogue et Harper’s Bazaar, qui font également appel à lui dans les années 1930 pour ses images surprenantes. Parallèlement à la photographie de mode qui le fera connaître du grand public, il poursuit durant toute sa vie, entre Hollywood et Paris, des expérimentations variées : solarisation, épreuve négative, distorsion, image floue ou encore photographie sans appareil, obtenue dans l’intimité de la chambre noire à partir d’objets posés directement sur la surface sensible du papier. À cette dernière invention, il laissera son nom, le rayogramme.
Née 1949, Merry A. Foresta est une photographe et historienne d’art. Elle a rejoint le Smithsonian American Art Museum en 1977 et a été nommée conservatrice en chef du département Photographie en 1983. Merry A. Foresta est consultante pour plusieurs universités et musées, notamment l’Université de Virginie, l’Université de l’Ohio et le Museum of Photographic Arts à San Diego. Elle est l’auteure de nombreux essais et articles sur l’art et la photographie américains.
• Man Ray est un pilier de l’art du 20ème siècle aux côtés des grandes figures dada et surréalistes parisiennes.
• Photo Poche Man Ray : 8500 ex. vendus chez Actes Sud / Babel Autoportrait : 14 600 ex. vendus / À mettre en lien avec Photo Poche La Photographie Surréaliste : 4 500 ex. vendus.
• Exposition Man Ray (1890-1976) Maître des Lumières, au Palais Lumière (Évian), du 1er juillet au 5 novembre 2023.
photographie Visuel provisoire - Diffusion Actes Sud
PHOTO POCHE
“Pour moi, une chose est sûre – j’ai besoin
d’expérimenter, sous une forme ou une autre.”
33 MAN RAY PHOTO
POCHE
PHOTO POCHE
Man Ray
techniques
de
PHOTO POCHE 1. Nadar 2. Henri Cartier-Bresson 3. Jacques Henri Lartigue 4. Amérique Les années noires 5. Robert Doisneau 6. Camera Work 7. W Eugene Smith 8. Nicéphore Niépce 9. L’Amérique
29. Lee Friedlander 30. Le temps des pionniers 31. Photomontages 32 Édouard Boubat 33. Man Ray 34. La photographie britannique 35. Elliott Erwitt 36. Robert Capa 37. Marc Riboud 38. De la photographie comme un des beaux-arts 9. Étranges Étrangers 40. 41. 42. Histoire de voir Coffret de 3 volumes 1839/1880 - 1880/1939 - 1930/1970 43. Edward S Curtis 44. Josef Sudek 45. Walker Evans 46. Willy Ronis 47. Images d’un autre monde La photographie scientifique 48 Norbert Ghisoland 49. Joel-Peter Witkin 50. Lewis W. Hine 51. Louis Faurer 52. Agustín V Casasola 53. Don McCullin 54. Dieter Appelt 55. Sebastião Salgado 56. Edward Steichen 57. Felice Beato 58. L’Orientalisme 59. Izis 60. Bill Brandt 61. Berenice Abbott 62. Alain Fleischer 63. Seydou Keïta 64. August Sander 65. Charles Marville 66. Umbo 67. Peter Beard 68 Eugene Richards 69. Magnum Photos 70. Dmitri Baltermants 71. Robert Demachy 72. Jacob A. Riis 73. Gilles Caron 74. Photogrammes 75. Lewis Carroll 76. Louis Stettner 77. László MoholyNagy 78. Sarah Moon 79. René Burri 80. La nature morte 81. Raymond Depardon 82. Albert Londe 83. L’homme transparent L’imagerie biomédicale contemporaine 84. Bruno Barbey 85. Claude Cahun 86. Araki 87. Ralph Eugene Meatyard 88 Frank Horvat 89. Renger Patzsch 90. Leonard Freed 91. Hippolyte Bayard 92. Frantisek Drtikol 93. Maurice Tabard 94. Alvin Langdon Coburn 5. Martín Chambi 96. Mary Ellen Mark 97. La photographie astronomique 98. Anders Petersen 99. La nature dans l’art 100. Je ne suis pas photographe… 101. (à paraître) 102. Gianni Berengo Gardin 103. Pentti Sammallahti 104. Les Krims 105. Séeberger Frères 106. Christer Strömholm 107. agence VU’ galerie 108. Harry Gruyaert 109. Guy Bourdin 110. Michel Vanden Eeckhoudt 111. Martine Franck 112. Post mortem 113. Saul Leiter 114. Le sténopé 115. Ferdinando Scianna 116. La photographie surréaliste 117. Shoji Ueda 118. Stanley Greene 119. Autoportraits de photographes 120. Joan Fontcuberta 121. Patrick Zachmann 122. Mike Disfarmer 123. Georges Rousse 124. Julia Margaret Cameron 125. Jane Evelyn Atwood 126. La photographie sociale 127. Ernst Haas 128. Jean Gaumy 129. Paul Starosta 130. Paolo Pellegrin 131. Paul Strand 132. Tendance Floue 133. Paolo Roversi 134. L’objet photographique 135. (à paraître) 136. Graciela Iturbide 137. Manuel Álvarez Bravo 138. David Seymour 139. Lucien Hervé 140. Roger Ballen 141. Daido Moriyama 142. Françoise Huguier 143. Anon. Photographies anonymes 144. Ragnar Axelsson 145. Malick Sidibé 146. L’un par l’autre 147. Gordon Parks 148. Bruce Gilden 149. Henri Huet 150. Jean-Louis Courtinat 151. David Goldblatt 152. Gabriele Basilico 153. Roman Vishniac 154. (à paraître) 155. Flor Garduño 156. Lucien Clergue 157. Gilbert Garcin 19/07/2017 11:31 9:HSMHOC=\Y^[VY:
Photo
historiques,
varient
une iconographie
est restée jusqu’à présent inédite en livres
poche.

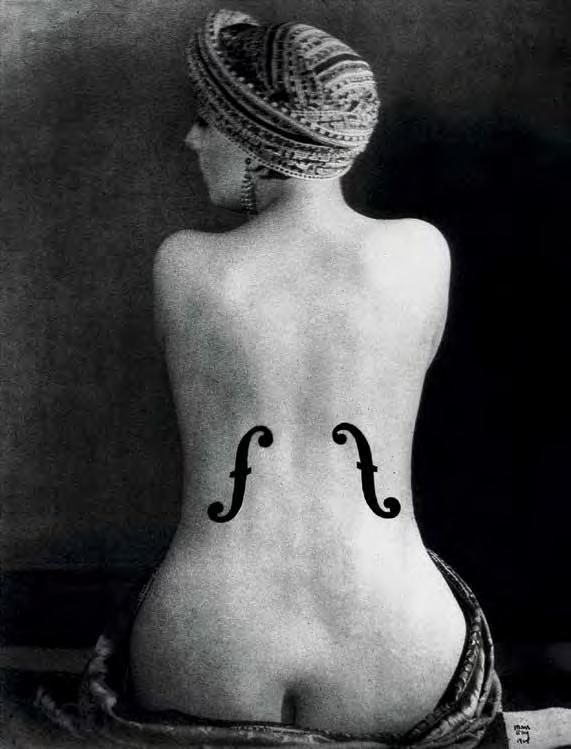

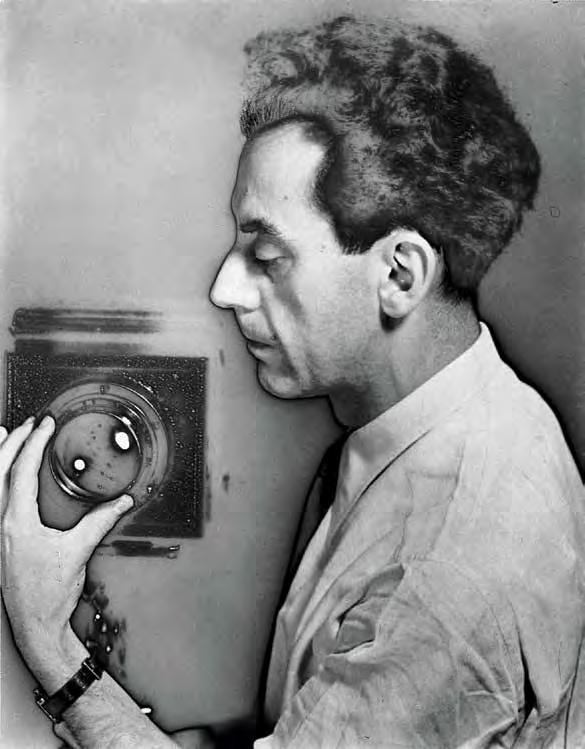
12,5 × 19 cm
144 pages
65 photographies en noir et blanc et couleur
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-18208-3
septembre 2023
prix provisoire : 13,90 €
RUTH ORKIN
Photographies de Ruth Orkin
Introduction d’Anne Morin
Ce qui passionne Ruth Orkin, c’est le cinéma, c’est l’image-mouvement, c’est le temps. Née en 1920, fille unique d’une actrice de films muets, Ruth Orkin fréquente de nombreux plateaux de tournage pendant son enfance, baignée dans l’univers d’Hollywood. Mais entreprendre une carrière de cinéaste est alors un chemin parsemé d’embûches pour une femme. Ruth Orkin les contourne et invente un langage visuel à la croisée de la photographie et du cinéma. Au-delà de l’image en mouvement et en deçà de l’image fixe, son écriture photographique imbrique constamment ces deux temporalités.
À l’âge de 19 ans, elle réalise ce qui aurait pu être son premier road movie (Bicycle trip, 1939), une traversée des États-Unis à bicyclette, de Los Angeles à New York, sous forme de journal. Ruth Orkin place l’image photographique dans un schéma de progression cinématographique. En 1938, elle s’installe à New York, où elle travaille pour de grands magazines et rejoint la Photo League. Fascinée par les mouvements de la ville, elle photographie les passants, le flux des citadins, en adoptant les points de vue avant-gardistes. Elle devient l’une des signatures féminines du moment et est reconnue comme une photojournaliste de référence.
Pendant les années 1950, la dimension cinématographique de son travail s’affirme avec la série “American Girl in Italy”, mettant en scène l’actrice Jinx dans un registre empruntant au roman-photo.
Captivée par ces petites choses qu’elle glane dans les rues, Ruth Orkin filme avec son appareil photographique. Elle induit l’idée de saccade, de fragmentation et compte sur le regard du spectateur pour reconstituer les histoires qu’elle raconte.
Anne Morin (née à Rouen en 1973) est historienne de l’art et directrice de diChroma photography. Elle a été commissaire de nombreuses expositions de photographes prestigieux tels que Berenice Abbott, Vivian Maier, Robert Doisneau, Jacques Henri Lartigue et Pentti Sammallahti. En 2022, elle est désignée “Curator of the year” lors des Lucie Awards au Carnegie Hall de New York pour son travail sur l’exposition de Vivian Maier, Unseen, au musée du Luxembourg.
Repères
Points forts
• Redécouverte d’une figure américaine de la photographie et du cinéma, des années 1930 aux années 1960.
• Ruth Orkin a participé à l’exposition historique The Family of Man d’Edward Steichen au MOMA en 1955 (exposition inscrite au registre de la Mémoire du monde de l’UNESCO – Roland Barthes lui a consacré un article dans le cadre de ses Mythologies / Elle a contribué au film Le Petit Fugitif (1953), précurseur de la Nouvelle Vague selon François Truffaut.
• Exposition de Ruth Orkin à la fondation Henri-Cartier Bresson (Paris), de septembre 2023 à janvier 2024 / Exposition itinérante de Ruth Orkin : Turin (Italie), de mars 2023 à juillet 2023 - Budapest (Hongrie) d’octobre 2023 à janvier 2024 - Cascais (Portugal), d’avril 2024 à juillet 2024.

événement
Exposition à la Fondation HenriCartier Bresson de septembre 2023 à janvier 2024.
photographie Visuel provisoire - Diffusion Actes Sud
PHOTO POCHE
9:HSMDNA=V]WU]X:


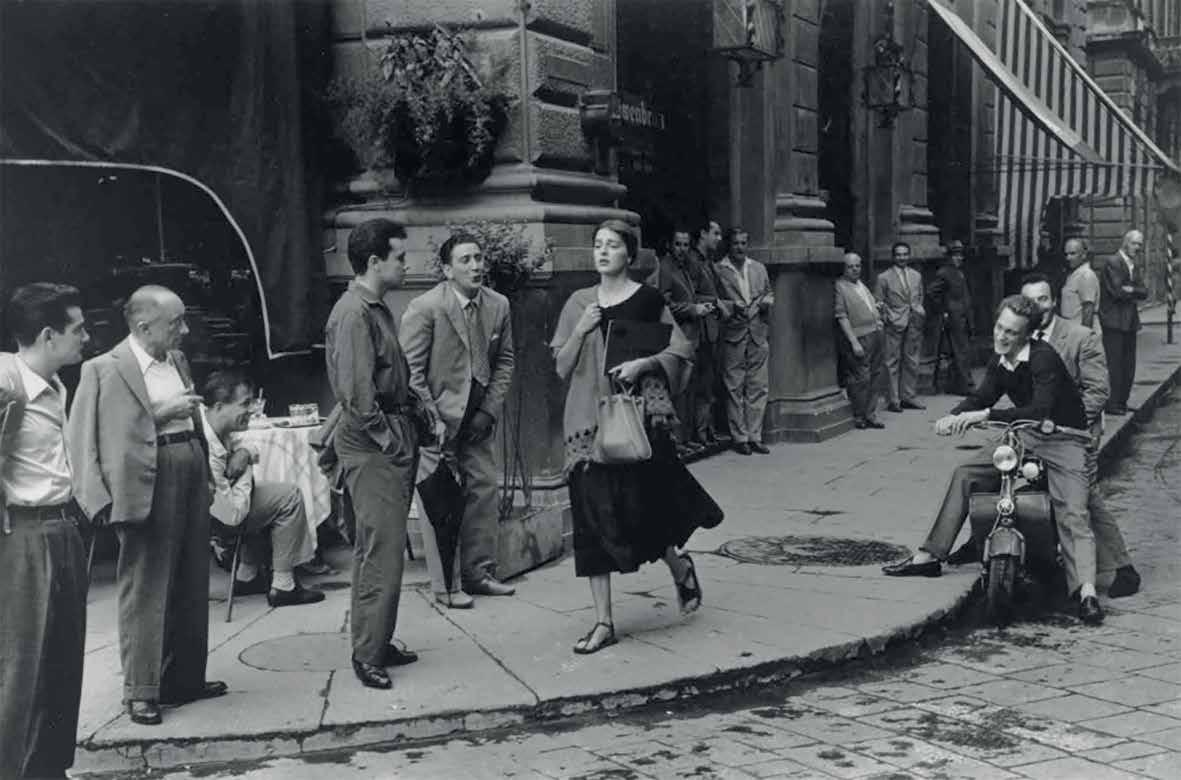

ClémentChéroux estdirecteurde laFondationHenriCartier-Bresson (Paris).Ilaauparavantdirigéles départementsdelaphotographie duCentrePompidou(Paris),du SFMOMA(SanFrancisco)etdu MoMA(NewYork).Historiendela photographieetdocteurenhistoire del'art,ilaétélecommissaire d'unetrentained'expositionsdont larétrospectiveHenriCartierBressonauCentrePompidouen 2014.
RUTH ORKIN, BIKE TRIP, 1939 Clément Chéroux

RuthOrkin(1921-1985)n’aque17anslorsqu’elle enfourcheen1939sabicycletteetinaugureun«bike trip»àtraverslesEtats-Unis,lamenantdeLosAngelesà NewYorkoùellecomptevisiterl’expositionuniverselle. Satraverséeetsonaudaceassezinhabituellepour l’époquesuscitentd’ailleurslacuriositédelapresse localequiluiconsacredenombreuxreportageslorsde sonpassage.Cetteépopéevélocipédiqueprendles allurespourlajeunefemmed'unvoyageinitiatiqueau coursduquelelleesquisselesprémicesdesonécriture photographique.Sesphotographiesdescènesderue,de bâtimentsdécoupéspardesjeuxsubtilsdelumière,ses imagespoétiquesettouchantes,danslesquelleselle n’hésitepasàmettreenscènesondestrierdemétal, serontmontréespourlapremièrefoisenFranceà l’occasiond’unexpositionàlaFondationHenriCartierBresson.

En1951,devenuephotographeprofessionnelle(après avoirétécoursièrepourlesstudiosMGM!),RuthOrkin réaliserasonimagelapluscélèbre, AmericanGirlinItaly, (1951)montrantunefemmequivoyageseule,sousles regardsdeshommesquil’entourentetoccupentl’espace public,commeunclind’œilàsonexpériencepersonnelle. Constituéedephotographies,depagesscrapbook, d’extraitsdesonjournaldevoyage,decartesetde documentsdivers,l’ouvragerévèlel’extraordinaire aventured’unedesgrandesfemmesphotographesdu XXe siècle.
• Une épopée photographique et vélocipédique audacieuse qui brosse le portrait d’une artiste méconnue en France.
• Un corpus totalement inédit, parfois proche des avant-gardes, spontané et inventif.
• Un petit livre objet proche du carnet de bord, avec une couverture toilée qui reproduira le motif d’une de ses robes.
• Ouvrage introduit par un texte de Clément Chéroux, l’un des plus brillants historiens de la photographie.
• Textuel continue de révéler les travaux méconnus des femmes photographes.
Exposition à la Fondation Henri Cartier-Bresson du 19 septembre 2023 au 14janvier 2024.
13 septembre 2023
17 x 24, relié, toilé
128 pages
40€ 9782845979659
• Photographie
• Etats-Unis
• Féminisme
L’extraordinaire voyage initiatique d’une des grandes photographes du XXe siècle révélé pour la première fois.
Visuel provisoire

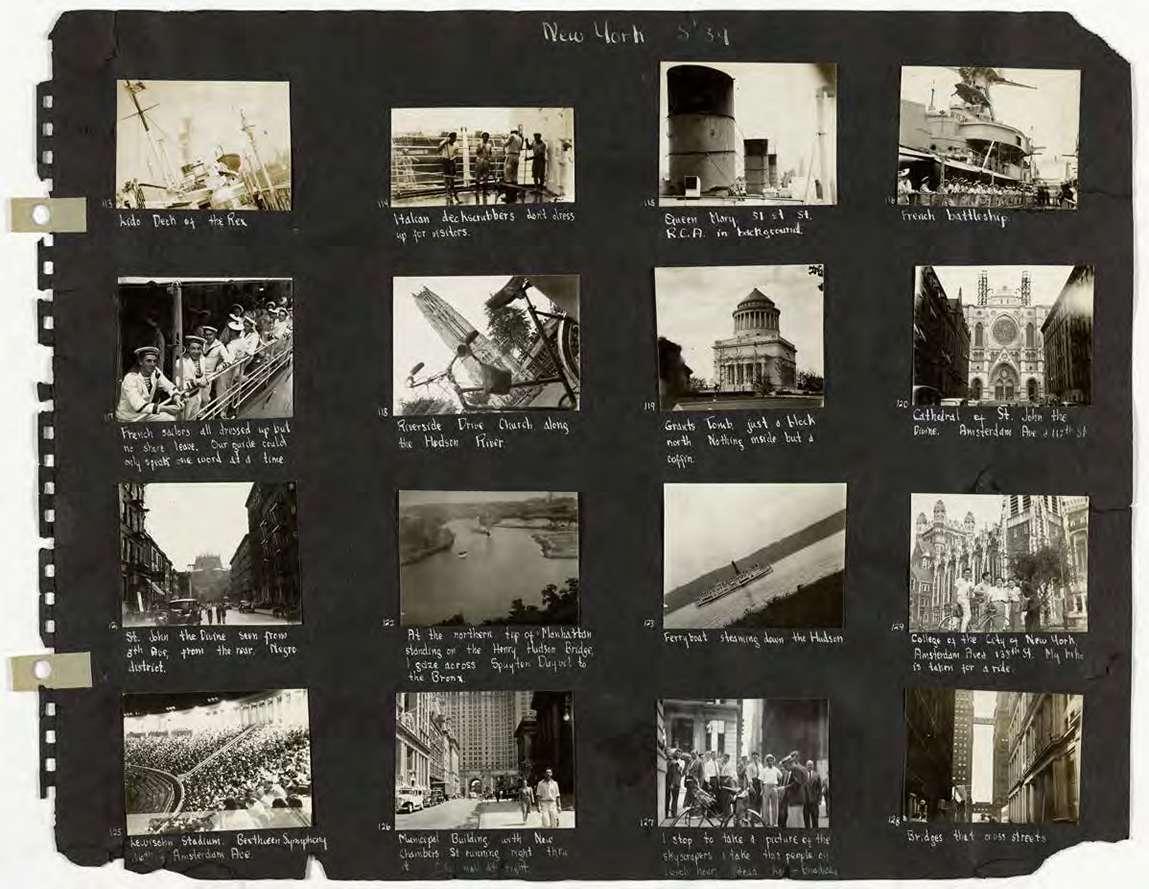



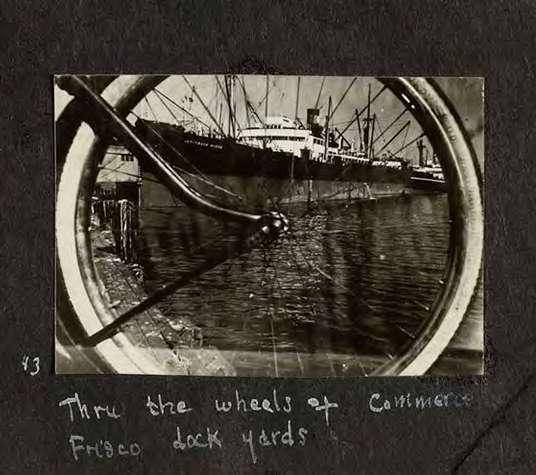


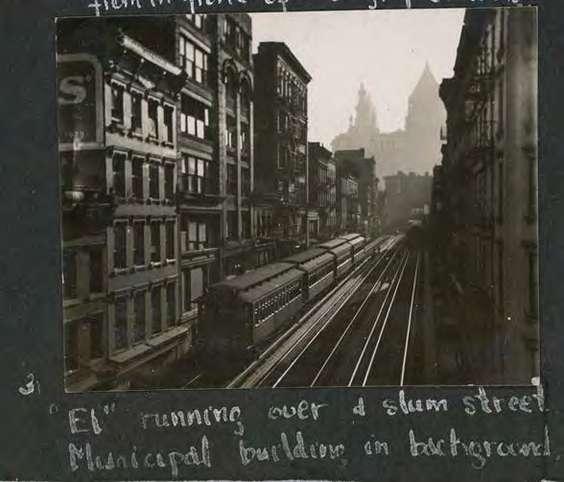
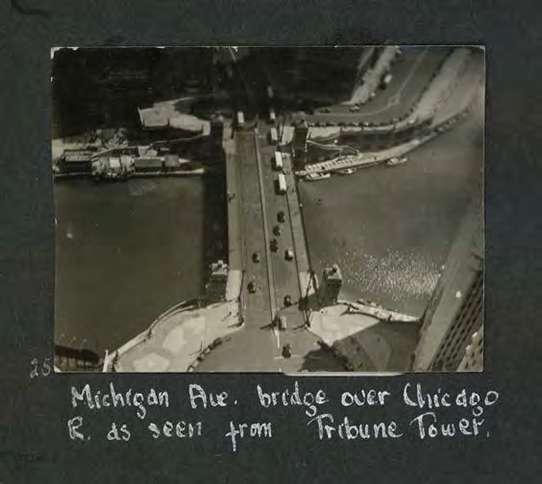
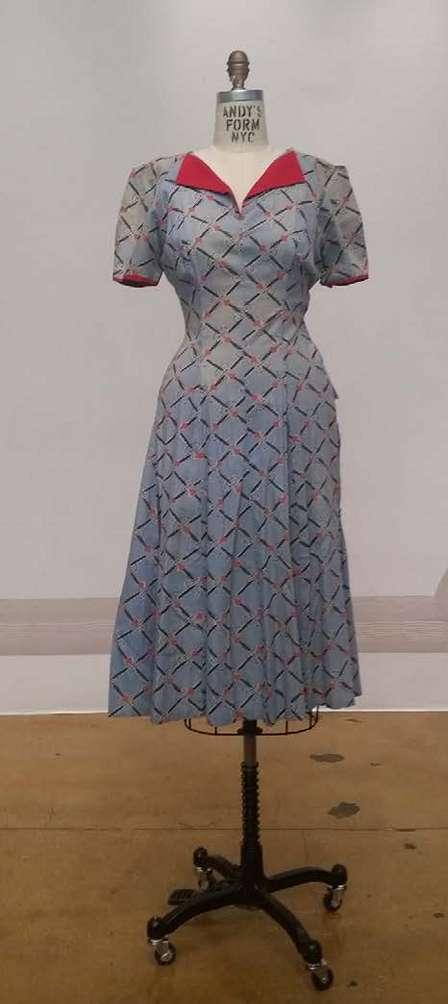
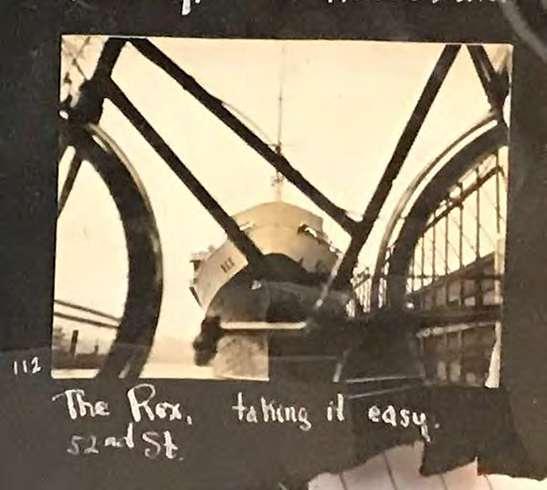
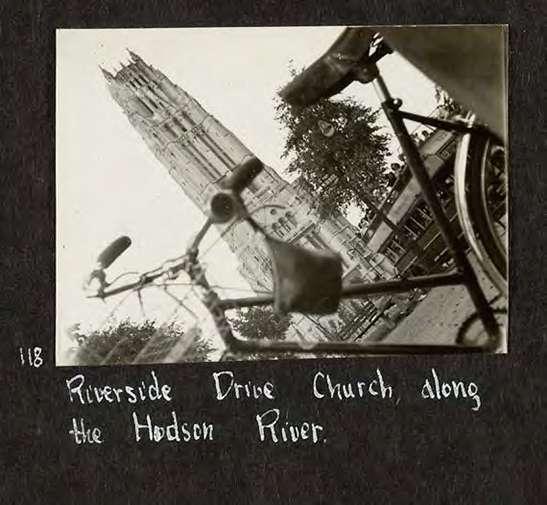
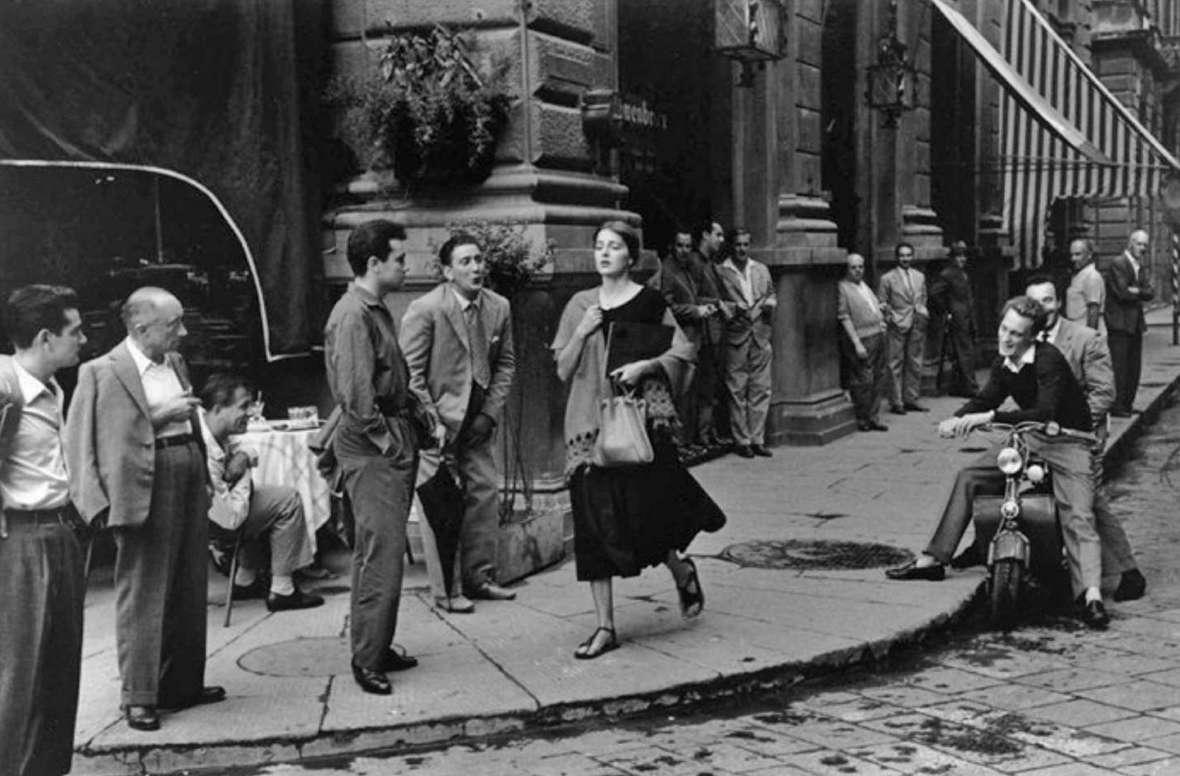
19,6 × 25,5 cm
368 pages
200 ilustrattions en noir et blanc
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-17535-1
septembre 2023
prix provisoire : 42,90 €
FERNAND POUILLON
Le Téméraire éclectique
Pierre Frey, Bernard Gachet, Louiza Issad, Mohamed Larbi Merhoum Postface d’Abdelkader Damani
L’architecte Fernand Pouillon (1912-1986) a réalisé une œuvre exceptionnelle par son ampleur, en France mais aussi en Algérie. Cependant, sa personnalité hors normes et les controverses auxquelles il a été mêlé ont souvent masqué ce qui fait l’originalité et la valeur de son travail. Aujourd’hui, le recul du temps permet de réinterroger l’œuvre de Pouillon à l’aune des problématiques contemporaines : intérêt pour l’architecture vernaculaire et les techniques durables (climatisation, isolation…), pour les matériaux naturels ou locaux, et pour la façon d’habiter les logements.
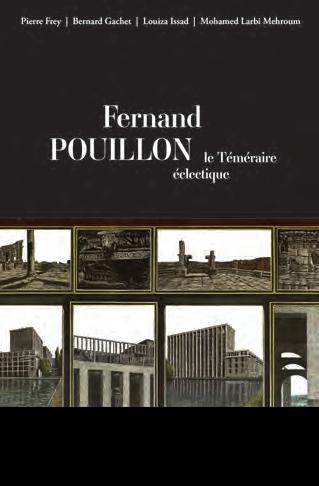
Les auteurs de cet ouvrage se sont principalement intéressés aux réalisations de Pouillon après la Seconde Guerre mondiale, en France (lotissement à Ozoir-la-Ferrière, cité universitaire à Aix-en-Provence), mais aussi en Algérie (grands ensembles algérois, cités universitaires et complexes touristiques). Un long travail de recherche dans les archives puis sur le terrain leur a permis de produire des informations inédites, qui apportent un nouvel éclairage sur l’œuvre de l’architecte.
Cet ouvrage ne se limite pas à présenter les réalisations de Pouillon, il les replace dans le contexte historique où elles s’inscrivent (la reconstruction de l’après-guerre, la décolonisation). Il aborde aussi des sujets peu souvent traités : le rôle de l’architecte, les chantiers et la maîtrise d’œuvre, la réception de l’œuvre de Pouillon par ceux qui habitent ses réalisations. Enfin, il met l’accent sur la dimension humaine du parcours de l’architecte.
Ces différentes approches construisent un ensemble riche et complet, accessible aussi bien aux professionnels qu’à tout lecteur désireux de mieux connaître la production architecturale de la seconde moitié du xxe siècle.
Pierre Frey, historien de l’art et professeur honoraire à l’École polytechnique de Lausanne, est notamment l’auteur de Learning from Vernacular (Actes Sud, 2010, Grand Prix du livre d’architecture 2011).
Bernard Gachet, architecte, voyageur et dessinateur, est l’auteur de Regards dessinés sur le monde (Actes Sud, 2018).
Louiza Issad, architecte-urbaniste et chercheuse, travaille sur le lien entre qualité urbaine et grands projets immobiliers.
Mohamed Larbi Merhoum, architecte à Alger, est considéré comme l’un des principaux acteurs contemporains du paysage architectural algérien.
Repères
Points forts
• L’ouvrage se base sur des recherches approfondies et livre de nombreuses informations inédites.
• Une approche multiple : architecturale, historique, humaine…, qui renouvelle le genre du livre d’architecture et le rend accessible aux non-spécialistes.
• Un livre qui fait le choix d’une iconographie de qualité exclusivement en noir et blanc, en privilégiant le dessin qui montre plus que la photographie.
• Les monographies existantes sur Fernand Pouillon datent, et sont lacunaires, elles n’abordent pas toute l’œuvre qu’il a réalisée en Algérie entre 1960 et 1980.
architecture Visuel provisoire - Diffusion Actes Sud
9:HSMDNA=V\ZXZV:
SOMMAIRE \ NOMENCLATURE
LA PHOTOGRAPHIE D’ARCHITECTURE PROVOQUE D’IMMENSES DÉCEPTIONS”
Fernand Pouillon
INTRODUCTION
Pierre Frey
Partie 1
QUESTIONS D’HISTOIRE
LE GÉNIE MILITAIRE, LE GÉNIE CIVIL, L’OCCUPATION DU SOL, L’URBANISME ET L’ARCHITECTURE
Pierre Frey
BÂTIR POUR LES HUMAINS OU SE RÊVER PROTAGONISTE D’UNE “HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE” ?
Pierre Frey
ÉPILOGUE AU POINT DU JOUR, FRAGMENTS 1
France Arudy et Fernand Pouillon
Partie 2
QUESTIONS D’ARCHITECTURE
ENTRE IBN KHALDÛN ET IVAN ILLICH, LOGEMENT, TRADITION, CULTURE, TYPE ET PLAN
Pierre Frey et Bernard Gachet
SINAN IBN ABDULLAH ET FERNAND POUILLON, ARCHITECTES ET CONVERTIS
Bernard Gachet et Pierre Frey
“L’ARCHITECTURE NOUS FAIT MEMBRES D’UNE MÊME LIGNÉE”
Bernard Gachet
MARSEILLE 1943, L’ENTRÉE EN LICE D’UN PROTAGONISTE REDOUTABLE
Pierre Frey
À Berlin, à la même époque, Alvar Aalto parvient par d’autres chemins à une solution analogue. À Oran et à Alger, presque simultanément et de façon indépendante, une coopérative et son maître d’œuvre arrivent sensiblement au même résultat.




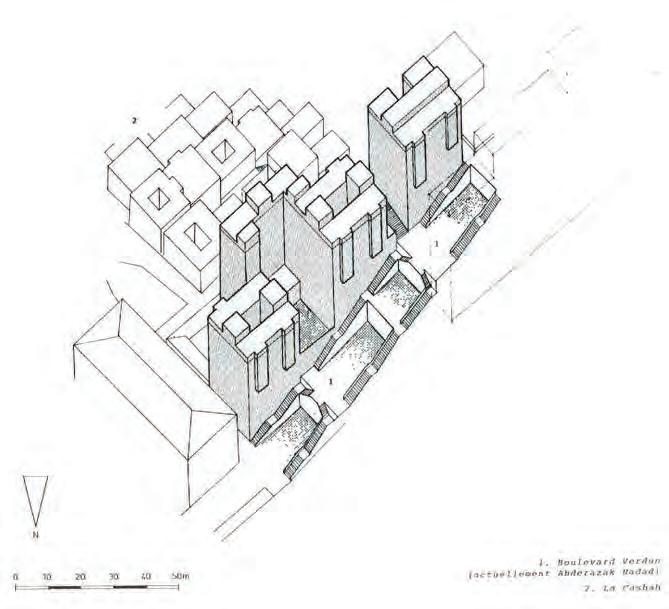
95 ⁄ 95
HBM boulevard Verdun (actuellement boulevard Abderazak-Hadad), Alger, François Bienvenu architecte, 1935. Ensemble destiné à être loué exclusivement à des familles indigènes. Plans européens standard, appartements ouvrant sur des paliers-coursives sur cours intérieures, volumes arabisants, adossés à la Casbah.








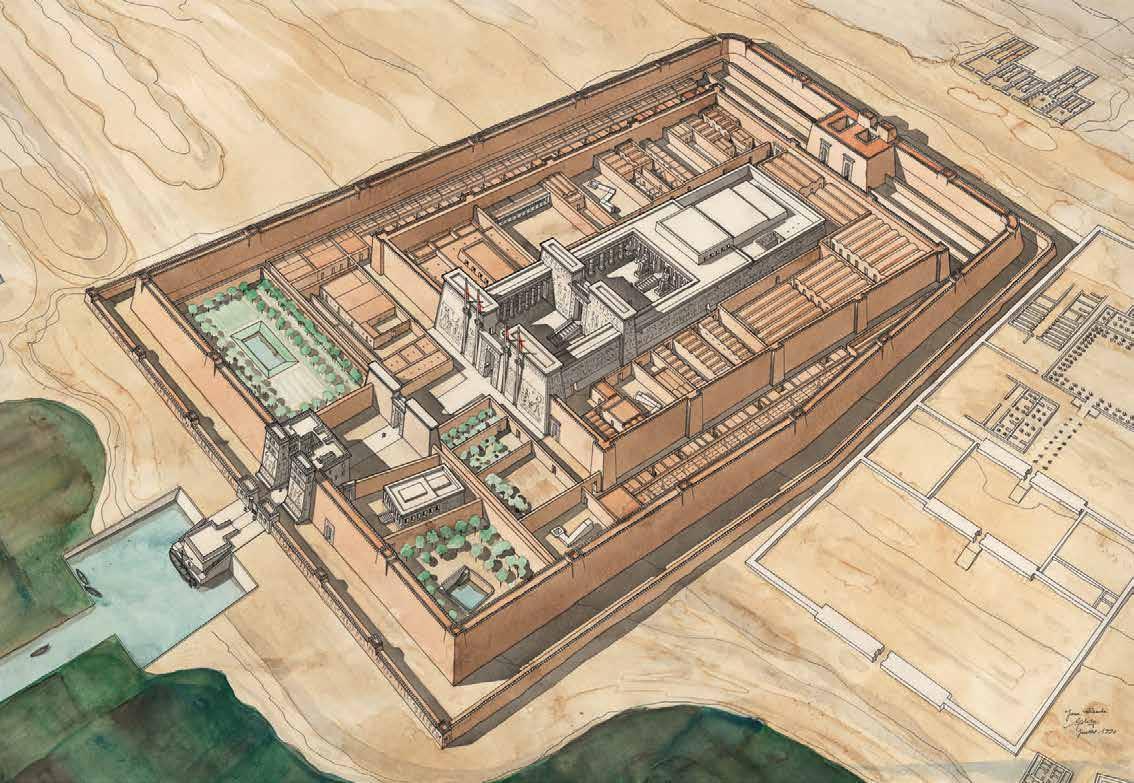
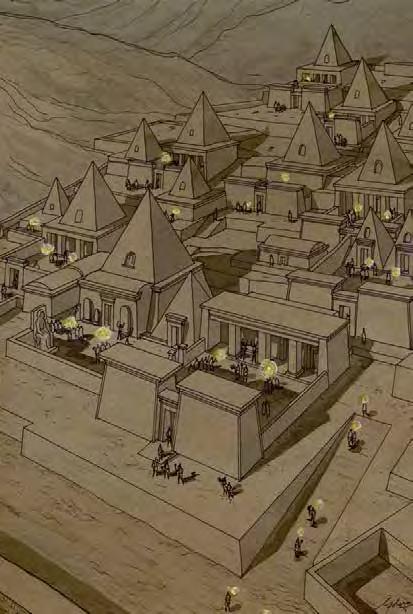

 (1279-1213 ..-.)
(1279-1213 ..-.)





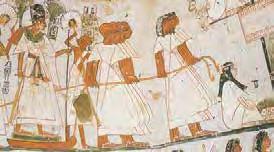
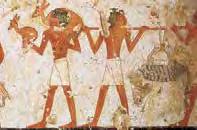
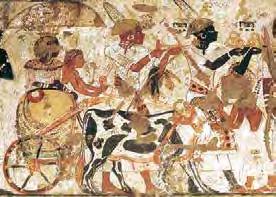





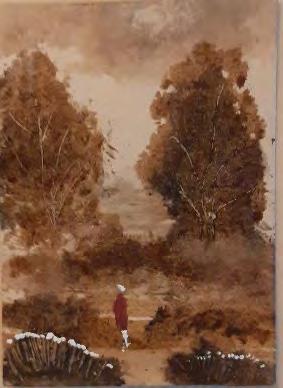
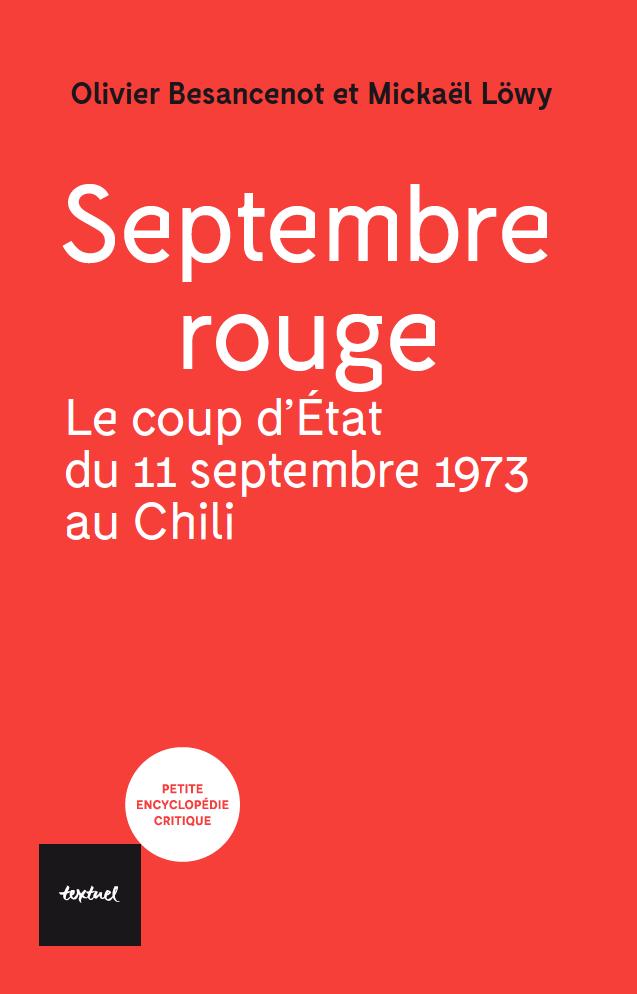 Olivier Besancenot et Michaël Löwy
Olivier Besancenot et Michaël Löwy

 Charles Bosvieux-Onyekwelu
Charles Bosvieux-Onyekwelu









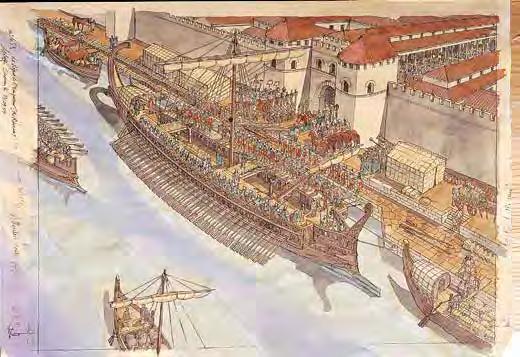
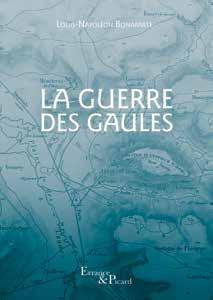

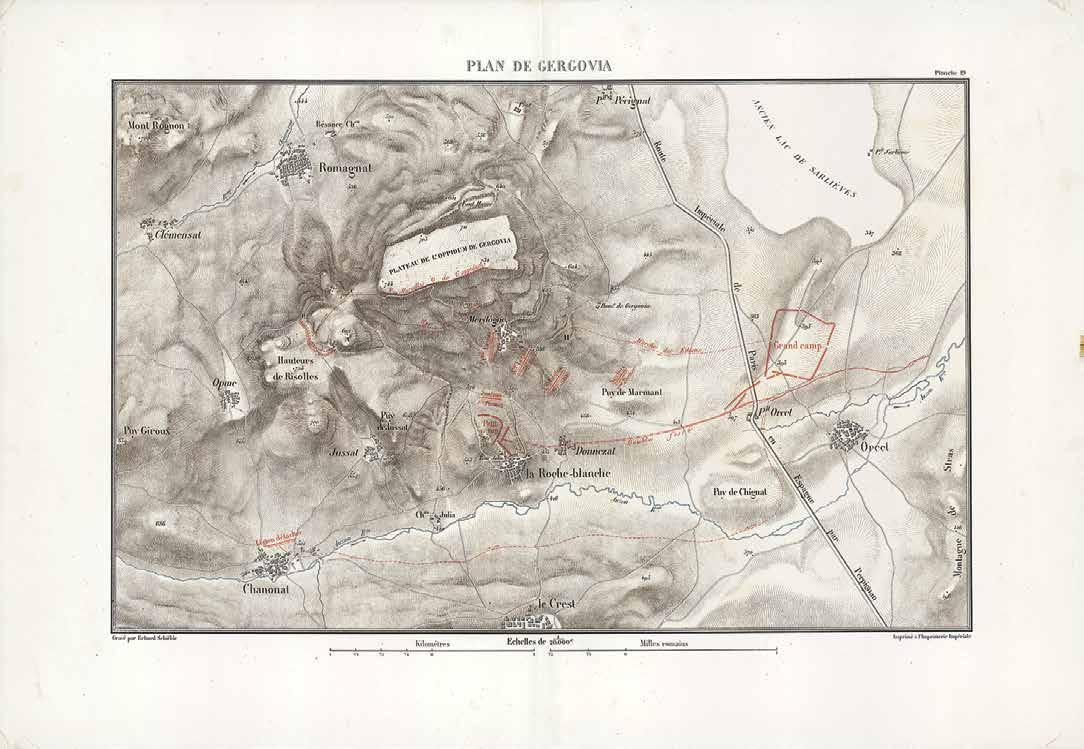

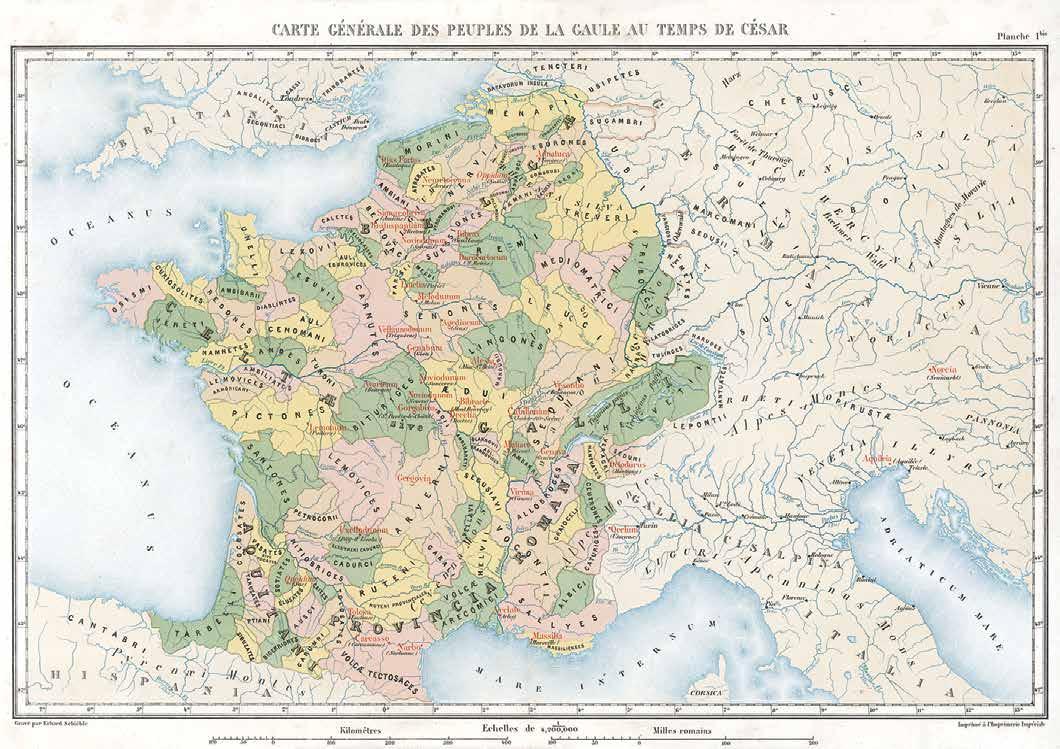



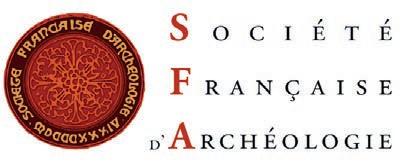
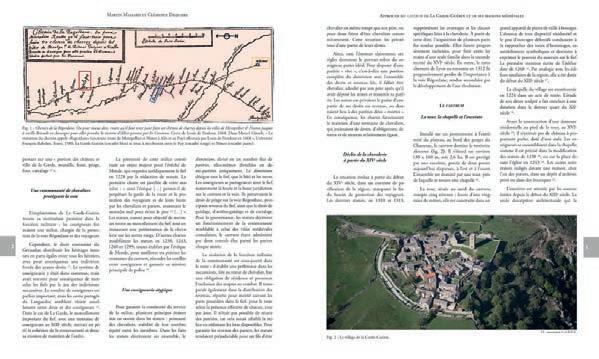





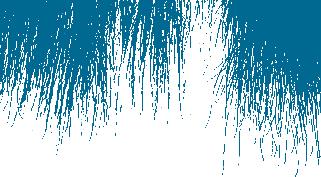



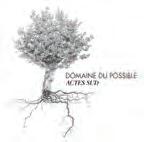
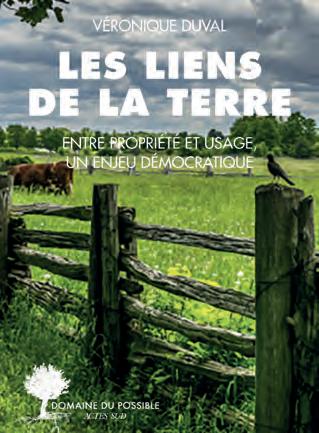





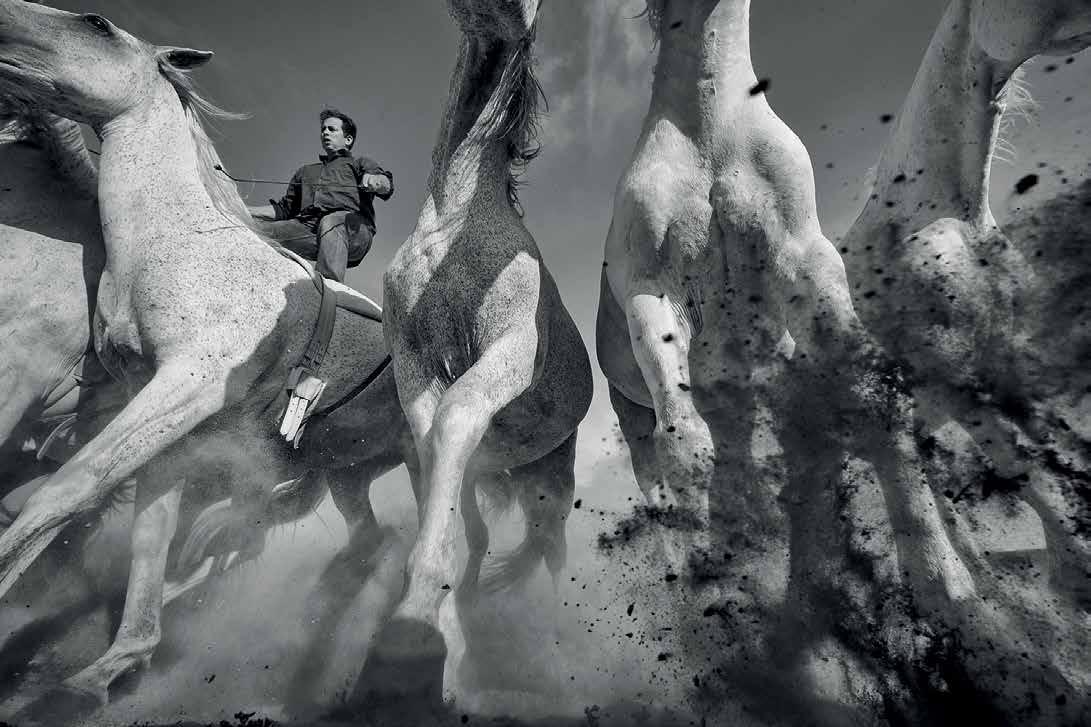



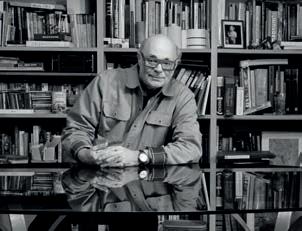

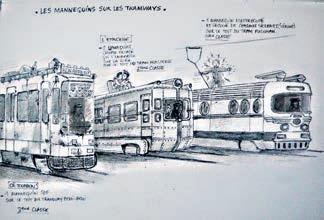










































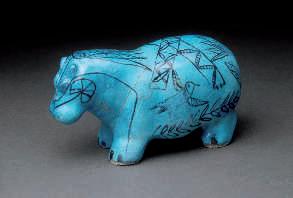






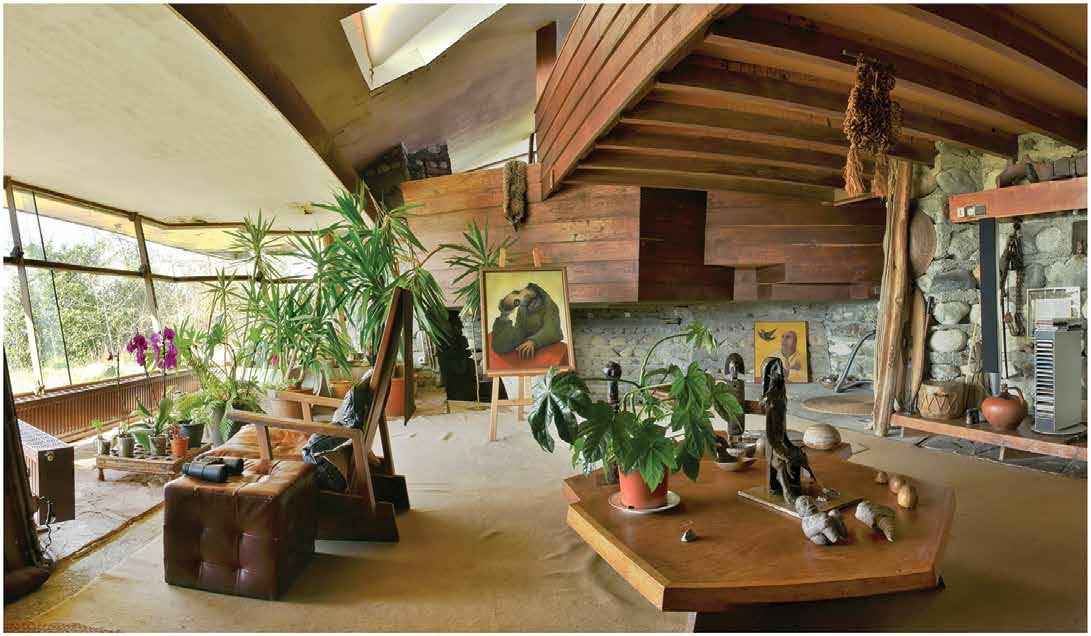
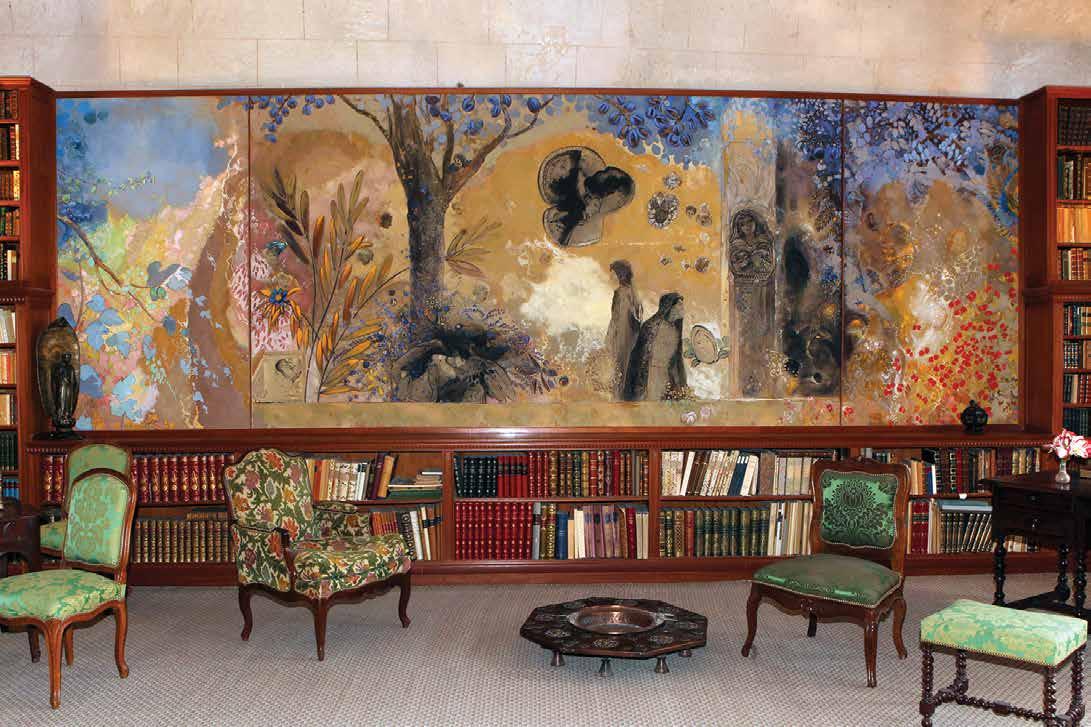


 Jean-Jacques Groleau Préface d'André Tubeuf
Jean-Jacques Groleau Préface d'André Tubeuf