ISABELLE PELOUX ET
ANNE LAMY

ANNE LAMY


La crise profonde que connaissent nos sociétés est patente. Dérèglement écologique, exclusion sociale, exploitation sans limites des ressources naturelles, recherche acharnée et déshumanisante du profit, creusement des inégalités sont au cœur des problématiques contemporaines. Or, partout dans le monde, des hommes et des femmes s’organisent autour d’initiatives originales et innovantes, en vue d’apporter des perspectives nouvelles pour l’avenir. Des solutions existent, des propositions inédites voient le jour aux quatre coins de la planète, souvent à une petite échelle, mais toujours dans le but d’initier un véritable mouvement de transformation des sociétés.
Isabelle Peloux et Anne Lamy, L’École du Colibri. La pédagogie de la coopération, Actes Sud, 2014.
Isabelle Peloux, Comprendre les enfants pour mieux les éduquer, Actes Sud, 2019.
Collection créée par Cyril Dion en 2011.
© Actes Sud, 2024
ISBN 978-2-330-19463-5 www.actes-sud.fr
Les différents profils d’élèves différents
L’exigence, au bon endroit, pour cet enfant-là
Jongler sans cesse entre trop d’exigence et trop peu
Que nous apprennent les enfants à la marge ?
Une école de moins en moins ouverte sur l’extérieur
Printemps 2020, retour vers le dehors
élèves coupés de la nature
L’école du dehors, c’est risqué
Quand la sanction est nécessaire
L’accompagnement de l’enfant vers l’autonomie, un chemin parfois douloureux
À plusieurs, on est plus forts pour éduquer un enfant ! 171
La confiance enseignant/parents, dans la relation individuelle 173
La confiance enseignant/parents, dans la relation collective 174
Écouter ce qu’il y a derrière les mots de l’enfant 175
Nous, parents et enseignants, ne voyons pas le même enfant 177
Le poids particulier de la parole de l’enseignant
Écoles publiques ou privées, instruction en famille : pouvoir choisir !
Égalité des chances, vraiment ?
Une vision “comptable” du métier
Adapter l’école au monde de demain, est-ce un mal ?
Une éducation toujours “trop” ou “pas assez” !
La dictée/l’orthographe : attention, sujets explosifs !
la formation
Oser critiquer l’institution : une saine colère !








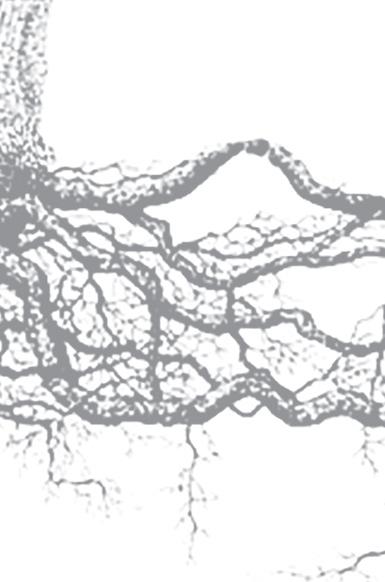

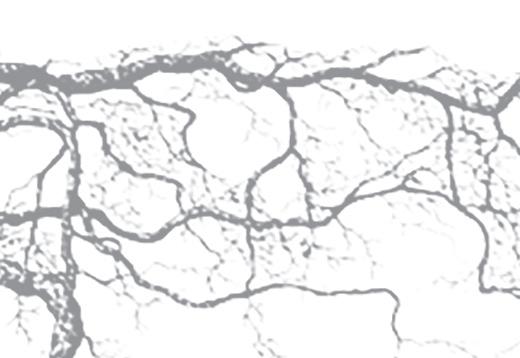










En 2006, j’ai eu la chance de fonder l’école du Colibri, une petite école primaire de 40 enfants, dont 7-8 en situation de handicap. En 2014, nous avons obtenu le statut d’école privée laïque sous contrat ; cela signifie que le ministère de l’Éducation nationale reconnaît que nous suivons les programmes officiels, et finance le salaire de l’enseignant (puis celui du second poste d’enseignant, attribué en 2018), les parents payant le reste à charge.
En 2022, au moment de prendre ma retraite et de passer la main à d’autres enseignants, la question de la transmission des valeurs de l’école s’est posée.
Avec tous ceux engagés à nos côtés (enseignants, parents d’élèves, membres de l’association des Amanins à laquelle l’école du Colibri appartient), nous avons réfléchi pour identifier les “fondamentaux” de l’école du Colibri. Cet ADN, notre socle de base, n’empêche ni l’inventivité ni la créativité, puisque je défends depuis toujours la liberté pédagogique. Il repose sur une posture de chercheur qui permet à l’enseignant de trouver comment accompagner cet enfantlà, dans cette situation-là, aussi haut qu’il peut aller, quel que soit son point de départ !
En 2014, nous avions écrit avec la journaliste Anne Lamy un premier livreI sur la naissance de l’école, mes convictions éducatives et leur genèse. Dix ans plus tard, j’aurais pu en faire une nouvelle version, mais en le relisant, je n’avais rien à changer, juste envie de partager la suite de cette aventure et mes explorations : ce que j’ai découvert au fil de ces années, ce que j’ai expérimenté de nouveau depuis l’écriture du premier livre, ce qui m’apparaît de plus en plus important, ce qui me met en colère et dont je peux – enfin – parler ouvertement, maintenant que je suis en retraite et que je me sens plus libre de donner mon avis. Dans ce livre, je reviens donc sur le fruit de mes observations et recherches de terrain, ainsi que mes prises de position sur des thèmes liés à l’éducation, qui me sont chers.
I. L’École du Colibri. La pédagogie de la coopération, Actes Sud, 2014.
Dans les premiers chapitres, je détaille mes découvertes autour de “l’apprendre à apprendre”, qui est, faut-il le rappeler, le rôle premier de l’école. Je décris ensuite ce fameux socle de base qui définit l’école du Colibri, une école où le projet d’apprendre à coopérer a pris de plus en plus d’ampleur avec les années, pour que le monde dans lequel grandiront les élèves soit plus solidaire ; une école inclusive où la différence est vue comme une complémentarité ; une école au milieu de la ferme agroécologique des Amanins, dans la Drôme, où les enfants ont un lien particulier au vivant et à la nature.
Ensuite, j’expose mes convictions et mes connaissances à propos de la responsabilité de tous les éducateurs – parents et enseignants –pour qu’ils soient au service des enfants que nous accompagnons vers le meilleur d’eux-mêmes. Dans cette époque troublée, les enfants d’aujourd’hui ont besoin d’adultes qui s’engagent à leurs côtés, pour s’épanouir et façonner, chacun à son échelle, le monde de demain !











































Mon métier, c’est d’enseigner : les mathématiques, le français, l’histoire, les sciences, le savoir-vivre avec les autres, etc. L’un des premiers et plus précieux apprentissages que je puisse apporter à un élève, c’est de lui expliquer ce qui se passe dans sa tête lorsqu’il apprend. Plus les sciences cognitives progressent, plus elles viennent confirmer ce que des pionniers de la pédagogie proposaient. Nous sommes désormais mieux renseignés sur la façon dont fonctionne le cerveau, sur les chemins qu’emprunte un nouveau savoir avant d’être acquis, et sur l’importance de ce que ressent et expérimente alors l’enfant dans son corps et pas simplement dans sa tête.
Ce que ces dernières années m’ont appris
Ma façon d’enseigner a évolué tout au long de ma carrière – et plus encore cette dernière décennie. En effet, on ne s’est jamais autant qu’aujourd’hui intéressé à ce qui se passe dans le cerveau, le corps ou le cœur de l’enfant lorsqu’il apprend. Les recherches en neurosciences, en éducation ou en psychologie de l’enfant ont contribué à mettre des mots sur ce que je faisais en classe. Souvent, elles sont venues confirmer mes intuitions, et m’ont permis de formaliser ce que je repérais sur le terrain. Je me souviens d’avoir assisté à des conférences de Philippe Meirieu et de m’être dit, en l’écoutant détailler une théorie de l’apprentissage : “Ah mais oui, c’est cela que je fais en classe !”
Tout ce que j’expérimentais avec les élèves s’est peu à peu affiné. J’ai vérifié qu’accompagner un enfant, c’est d’abord attendre et créer un lien de confiance avec lui. Sans ce lien, je parle dans le vide ! Attendre, donc, observer l’enfant, le voir se tromper s’il se trompe, pour savoir d’où vient son erreur, plutôt que d’essayer d’en deviner l’origine ou d’anticiper sur ce qui pourrait lui poser problème. Cela m’oblige à changer de posture et ce n’est pas simple. Car mon principal défaut – partagé par beaucoup d’enseignants –, c’est de vouloir
trop aider l’enfant. Je suis tellement contente de pouvoir lui rendre service en lui disant ce que je sais que je le guide trop. Or, les neurosciences le montrent bien, ce n’est pas ainsi que l’enfant apprend le plus efficacement. Ce n’est pas à moi de lui apporter mon savoir, mais à lui d’exprimer une demande. Je ne peux pas devancer cette dernière, elle arrive au rythme de ce que j’écoute, observe et vois émerger chez lui. Je le laisse me montrer ce qu’il croit savoir faire ou sait déjà faire, afin de me mettre à son niveau et de suivre le fil de sa pensée pour comprendre où il en est. Cette posture-là, subtile, est plus difficile à adopter que le comportement que j’ai eu en début de carrière. Elle m’oblige à faire taire mon ego, la partie en moi qui a très envie d’expliquer à l’enfant, parce que c’est agréable qu’il comprenne grâce à moi ! C’est valorisant pour moi, oui. Mais ce n’est pas de cela dont l’enfant a besoin. On le voit nettement en sport : je peux expliquer à un enfant comment on pédale mais vient un moment où c’est lui qui doit monter sur son vélo, se lancer, perdre l’équilibre et trouver par lui-même comment avancer.
C’est tout cela que le terrain m’a appris, et que j’appelle ma posture de chercheuse : attendre, observer, proposer, me tromper, savoir lâcher et chercher avec l’enfant ce qui peut l’aider. Cette posturelà exige d’avoir acquis quantité d’expériences, de disposer de nombreux outils méthodologiques et d’avoir assimilé les résultats des récentes recherches en sciences de l’éducation ou en neurosciences. Sans cela, si je ne sais pas comment faire apprendre une poésie à un élève, alors je vais le faire comme moi j’ai appris. Cela conviendra aux enfants qui fonctionnent comme moi, mais pas aux autres. C’est auprès de ceux-là que je dois rester disponible. Je ne suis pas la seule à l’être, car la grande trouvaille du travail en coopération, c’est qu’on ajoute les enfants dans la boucle. Ils vont s’expliquer entre eux comment ils travaillent, et progresser ensemble, grâce à ce que chacun apporte aux autres.
Si mon travail s’est enrichi grâce au travail des chercheurs, au fil du temps, ces derniers ont également affiné certaines théories, par
exemple les huit formes d’intelligence d’Howard Gardner, arrivées en France autour des années 1990. Ce que décrivait ce psychologue du développement nous soulageait : nos élèves ne se résument pas à ce qu’ils savent en maths et en français. Nous qui les avions toute la journée, nous voyions bien qu’ils avaient quantité d’autres compétences ! Mais comment rendre compte, à l’école, du talent d’un enfant très doué dans sa relation aux autres ? Le travail d’Howard Gardner sur les huit intelligences a ensuite été critiqué par d’autres chercheurs : désormais, on parle de talent plutôt que d’intelligence. Il n’empêche que je me suis servie de ce travail pour dire à des élèves qui n’étaient pas à l’aise en maths et en français à quels autres endroits ils étaient bons. Et puis, à l’école du Colibri, on va dans la nature, on fait des arts, du sport. En coopération, on parle tout le temps des compétences intra- et interpersonnelles. Autrement dit, on laisse s’épanouir ces talents si divers, mis en lumière et en mots par Howard Gardner. En classe, je les avais toujours à l’esprit, pour garder une vue globale des potentiels de chaque élève, et ne pas le réduire à ses résultats dans les matières académiques. Cet exemple reflète bien ce qui s’est passé en moi. Il ne s’est pas produit de révolution entre l’enseignante que j’étais au moment du premier livre et celle que je suis devenue, aujourd’hui. Bien sûr, la culture générale que j’ai acquise autour de l’éducation (psychologie, neurosciences, etc.) éclaire ce que je vis sur le terrain. Mais au fond, les batailles théoriques m’intéressent modérément : je compose mon patchwork de savoirs, en piochant ici et là, dans chaque pédagogie ce qui m’aide en classe ! Je retiens de ces méthodes pédagogiques ce qui reste ouvert, et j’élimine tout ce que je trouve enfermant, dogmatique. Car alors, la pédagogie devient une recette de cuisine, la même pour tout le monde, et il y a de fortes chances qu’elle ne marche pas car dans une classe de 28 élèves, il y a 28 façons d’apprendre ! Au fil du temps, j’ai procédé en classe comme je fais avec une recette de cuisine. Au début, je la suis à la lettre. Et peu à peu, je me fais confiance, j’affine, je simplifie, j’enlève les
ingrédients inutiles. Accéder à la simplicité en classe, c’est paradoxalement le plus difficile, car je ne peux le faire que si j’ai au préalable testé d’autres manières d’enseigner, que si je me suis rendu compte que telle méthode semait les enfants en route ou que telle autre les induisait en erreur. D’ailleurs, cette attention portée à la façon dont notre cerveau fonctionne inconsciemment et nous fait commettre des erreurs à notre insu est précieuse en classe. Le plus bel exemple pour s’en convaincre, c’est ce qui se passe en nous avec les biais cognitifs, dont je suis devenue une grande chasseresse ! Voilà typiquement un sujet dont on ne m’a pas parlé pendant ma formation d’enseignante, que l’on connaît mieux aujourd’hui qu’il y a dix ou trente ans, ce qui permet de mettre des mots sur les situations (au moins certaines d’entre elles) dans lesquelles les élèves se trompent.
Débusquer les biais cognitifs
Je ne devrais pas dire que les élèves se trompent. En réalité, ils se font plutôt “berner” par leur propre cerveau ! Voici pourquoi. Pour traiter rapidement la masse d’informations qu’il reçoit, le cerveau a besoin d’être stratégique. Il va chercher à être efficace, à donner du sens, à éliminer les données qu’il ne trouve pas utiles, et à aller à l’essentiel. Alors, pour gagner du temps, il se réfère toujours à ce qu’il connaît, aux connexions et/ou collections qu’il a déjà créées.
Il prend alors des raccourcis qui lui font commettre parfois des erreurs de raisonnement. Elles portent un nom : ce sont les biais cognitifs. Il en existe plus de centI et, chaque jour, nous les utilisons inconsciemment et “tombons dans le panneau”, sans même nous en rendre compte ! Le seul fait de connaître leur existence va éviter
I. Racky Ka-Sy, “Les biais cognitifs sont-ils (in)évitables ?”, SynLab, https://ecolhuma. fr/wp-content/uploads/2021/07/Note_biais_misenpage_V2.pdf.
bien des ratés aux élèves ; c’est ce que l’on appelle le discernement. Les enfants adorent débusquer ces malentendus ou ces “pièges” que nous tend sans le vouloir notre cerveau. Voici les trois biais cognitifs qu’il est précieux de faire repérer aux enfants lorsqu’on est en classe.
Le biais d’automatisation
Vu le nombre de choses qu’un élève apprend, son cerveau traite une partie des données qui lui arrivent en pilotage automatique. C’est le cas avec tout ce qu’un enfant doit apprendre par cœur, les tables de multiplication pour commencer. Savoir que 6 ∑ 8 = 48, sans avoir besoin de décomposer l’opération, c’est une automatisation qui rend bien service ! Ce processus s’étend souvent au-delà de ce qu’on sait par cœur. Par exemple, l’enseignant explique que pour multiplier un nombre par 10, on ajoute un zéro à la fin. Rapidement, par automatisation, le cerveau ne se demande plus pourquoi il faut mettre un zéro : il l’ajoute d’office. Automatiser la réponse n’est pas spécifique aux mathématiques, un élève peut aussi le faire en français. Ainsi, il peut se souvenir que pour signaler le pluriel, on met un s : un lapin, des lapins. Mais en maths comme en français, l’automatisation n’est pas toujours pertinente ! Par exemple, doit-il répondre oui ou non à la question : “Est-ce que j’entends le son [o] dans « bateau » ? dans « cadeau » ? dans « girafe » ?” ? Etc. L’automatisation n’a aucun intérêt, dans ce cas précis. S’il ne comprend pas le sens de la question, il peut répondre un coup oui, un coup non et il risque de s’appuyer sur la statistique qu’induit l’automatisation, et se dire : “J’ai répondu trois « oui » à la suite ; je dois sûrement répondre « non » à la prochaine question.”
Autre exemple, de nouveau du côté des mathématiques. Un jour, j’apprends aux élèves la technique opératoire pour effectuer une division. J’ai écrit l’opération au tableau. Me regardant faire, certains enfants activent en eux ce biais d’automatisation ; ils le font inconsciemment, simplement pour être efficaces. “Qu’est-ce que je dois
mémoriser ? Quelle information puis-je ne pas retenir, pour ne pas m’encombrer le cerveau inutilement ?” Il se passe alors quelque chose que je n’ai pas anticipé. Sur les quelques divisions écrites au tableau, le reste est toujours 2 ; c’est un pur hasard. Quand je demande aux élèves s’ils ont des questions sur cette opération, l’un d’eux répond : “J’ai repéré que le reste, c’est toujours 2.” En automatisant son raisonnement, il commet une erreur, sans s’en rendre compte. Il a bien fait de prendre la parole, car sinon, il se serait dit : “La division, c’est facile, on met toujours 2 à la fin.” Et il n’aurait pas forcément saisi d’où venait l’erreur d’aiguillage dans son raisonnement lorsqu’il fait une division. Cette quête d’automatismes, je l’ai observée de près avec une fillette de l’école que j’accompagne en soutien. Elle est dyslexique, et la multiplication à deux chiffres lui donne du fil à retordre : quand on multiplie un nombre par 82 il faut d’abord multiplier par 2, puis multiplier par 8 qui est en fait 8 dizaines donc 80. Il faut donc décaler le résultat d’un rang par rapport au rang précédent. Une opération complexe, pour l’enfant dyslexique qu’elle est ! Je lui fais donc travailler les opérations en ligne. Je détaille la marche à suivre : “Tu lis la réponse de gauche à droite mais au moment d’écrire ton opération, tu commences par écrire, à droite, les unités puis les dizaines puis les centaines. Tu te souviens ? Il t’arrive d’oublier cette consigne, parfois.” Pour une enfant dyslexique, je le reconnais, c’est une vraie gymnastique d’intégrer cet aller-retour. Je lui prépare donc plusieurs opérations, avec des ∑ 10, ∑ 20, ∑ 30. Pour cerner d’où viennent ses difficultés, j’ajoute un ∑ 12 et un ∑ 11. Puis je la regarde travailler ; je vois qu’elle bloque sur ces deux dernières opérations. Elle est désemparée : elle a cherché à automatiser l’opération mais là, elle ne sait pas quoi faire. On peut imaginer son débat intérieur : “Isabelle m’a dit d’ajouter un zéro… mais où dois-je le mettre, pour l’opération 4 ∑ 11 ?” Elle décide de l’écrire devant le nombre 44. Son cerveau a trop souvent tendance à faire appel à des automatisations, elle cherche toujours le “truc”, l’astuce pour trouver la bonne réponse. C’est un réflexe que j’ai fréquemment remarqué
chez l’enfant en difficulté scolaire. À force d’automatiser, il court le risque de ne pas donner de sens à ce qu’il est en train de faire. Si l’enseignant ne prend pas le temps de mettre au jour ce qui se passe dans la tête de l’enfant – ce qu’on appelle sa stratégie mentale –, il ne peut pas débusquer l’obstacle contre lequel celui-ci bute. Faire observer que l’automatisation ne marche que parce que le nombre finit par un zéro permet à la fillette de donner du sens à ce qu’elle fait, donc d’éviter ce type d’erreur. Dans cet exemple, il était intéressant de constater qu’elle ne s’était pas trompée (4 ∑ 11, ça fait bien 44) mais elle était tombée dans ce piège de l’automatisme, malheureusement induit par la forme scolaire. Si elle avait activé son esprit critique plutôt que cet automatisme, son raisonnement, fondé sur ses connaissances, l’aurait amenée à décider que ce n’était pas utile d’ajouter un zéro dans cette multiplication. J’ai fréquemment remarqué que, mal enseignées, les mathématiques engendrent beaucoup d’automatisations non pertinentes…
Le gagner-rester/perdre-changer
Voilà comment résumer ce biais : j’ai tendance à répéter toujours la même action, si elle est efficace, et à en changer, quand elle ne l’est pas. Ce biais est un piège fréquent pour un élève à haut potentiel intellectuel (HPI). Comme il a l’habitude d’avoir bon (de “gagner”, pour reprendre les termes de ce biais), quand il trouve une stratégie qui marche, il la reproduit sans cesse, sans plus se poser de questions. Il est donc familier du “gagner-rester”, quitte à s’entêter les (rares) fois où il se trompe. À l’inverse, le “perdre-changer” est une stratégie fréquemment utilisée par l’enfant en difficulté. Il suffit de lui signaler qu’il s’est trompé pour qu’aussitôt il se dise : “Oups, je dois changer de stratégie.” Si, en plus, cet élève qui se sait fragile travaille avec un copain réputé fort, et que tous deux ne trouvent pas la même réponse, alors il lui faut vraiment du courage pour penser qu’il a bon. Depuis le temps que je remarque ce biais à l’œuvre,
je l’annonce aux élèves avant un exercice : “Attention, vous vous souvenez ? On tombe souvent dans ces biais.” Je me souviens de Juliette, une fillette fragile en mathématiques, travaillant avec un Léo surdoué dans cette discipline. À la fin de l’exercice, alors qu’ils étaient parvenus tous deux à un résultat différent, elle a réussi à se persuader qu’elle avait la bonne réponse et lui dit : “Je crois que tu t’es trompé, là.” Léo se met aussitôt en colère : se tromper, lui ? Sûrement pas… Pourtant, Juliette avait raison. Elle aurait facilement pu adopter la stratégie du “perdre-changer” qui lui était si familière mais elle connaissait le biais et était passée par l’explication de son raisonnement, avec bon sens. L’avertissement vaut aussi pour les élèves moyens ; car automatiser un geste mental leur permet de récolter des notes très correctes sans forcément trouver beaucoup de sens à l’exercice qu’ils effectuent.
Lorsque j’ai débuté, je ne comprenais pas assez la didactique des mathématiques, donc j’utilisais beaucoup l’automatisation avec mes élèves. J’étais toujours perplexe lorsque je les regardais travailler. Ils savaient poser mécaniquement des opérations mais ne savaient pas choisir la bonne opération pour résoudre un problème ! Les choses ont heureusement changé lorsque j’ai rencontré le pédagogue et mathématicien Rémi BrissiaudI. Il a donné un tout autre relief à mes acquis dans cette discipline. J’ai pu enseigner en comprenant la différence entre compter et calculer, en sachant mieux quelles sont les connaissances à savoir par cœur (compter) et les raisonnements qui permettent de donner du sens à ce que l’on fait (calculer). J’ai pu constater qu’enseigner sur ces bases permet aux élèves de faire preuve de discernement quant à leurs résultats, soit en choisissant la bonne opération, soit en constatant que leur réponse est incohérente. La didactique permet d’associer ces deux compétences : le savoir et la réflexion.
I. Rémi Brissiaud, “J’apprends les maths”, Retz.
Isabelle Peloux a fondé en 2006 l’école du Colibri, une école élémentaire accueillant une quarantaine d’enfants au sein du centre agroécologique des Amanins, dans la Drôme. En 2021, elle prend sa retraite et se saisit de l’occasion pour regarder en arrière et réexaminer les bénéfices de la coopération, pédagogie au cœur de son projet éducatif. À l’école du Colibri, elle a, en effet, instauré des temps spécifiques pour que les enfants apprennent à vivre ensemble, débattent des grands ou petits sujets du quotidien, comprennent comment réfléchit l’autre et s’enrichissent de ceux qui ne pensent pas comme eux.
Dans ce nouveau livre, Isabelle Peloux, en plus de revenir sur les approches pédagogiques innovantes mises en place dans son école, nous montre comment les neurosciences l’ont éclairée sur la façon dont les enfants apprennent – ou n’apprennent pas, parfois –, mais aussi comment sa pratique auprès des enfants différents s’est affinée ces dernières années.
L’autrice profite également de cet ouvrage pour, de sa voix libre et engagée, toujours du côté de l’intérêt des enfants, laisser exploser quelques saines colères au sujet des débats qui ponctuent chaque année scolaire !
Isabelle Peloux, ancienne enseignante, chercheuse en pédagogie et en éducation à la coopération, transmet aux enfants et aux adultes les outils pratiques permettant d’éduquer à la paix.
Elle est l’autrice de L’École du Colibri (Actes Sud, 2014) et de Comprendre les enfants pour mieux les éduquer (« Je passe à l’acte », Actes Sud, 2019).
Anne Lamy est journaliste. Spécialiste en psychologie, éducation et société, elle est autrice et coautrice d’une quinzaine de livres. Elle écrit également des documentaires pour la jeunesse et des biographies.
Illustration de couverture : © Getty Images, 2024
DÉP. LÉG. : AOÛT 2024 22 € TTC France www.actes-sud.fr

ISBN : 978-2-330-19463-5