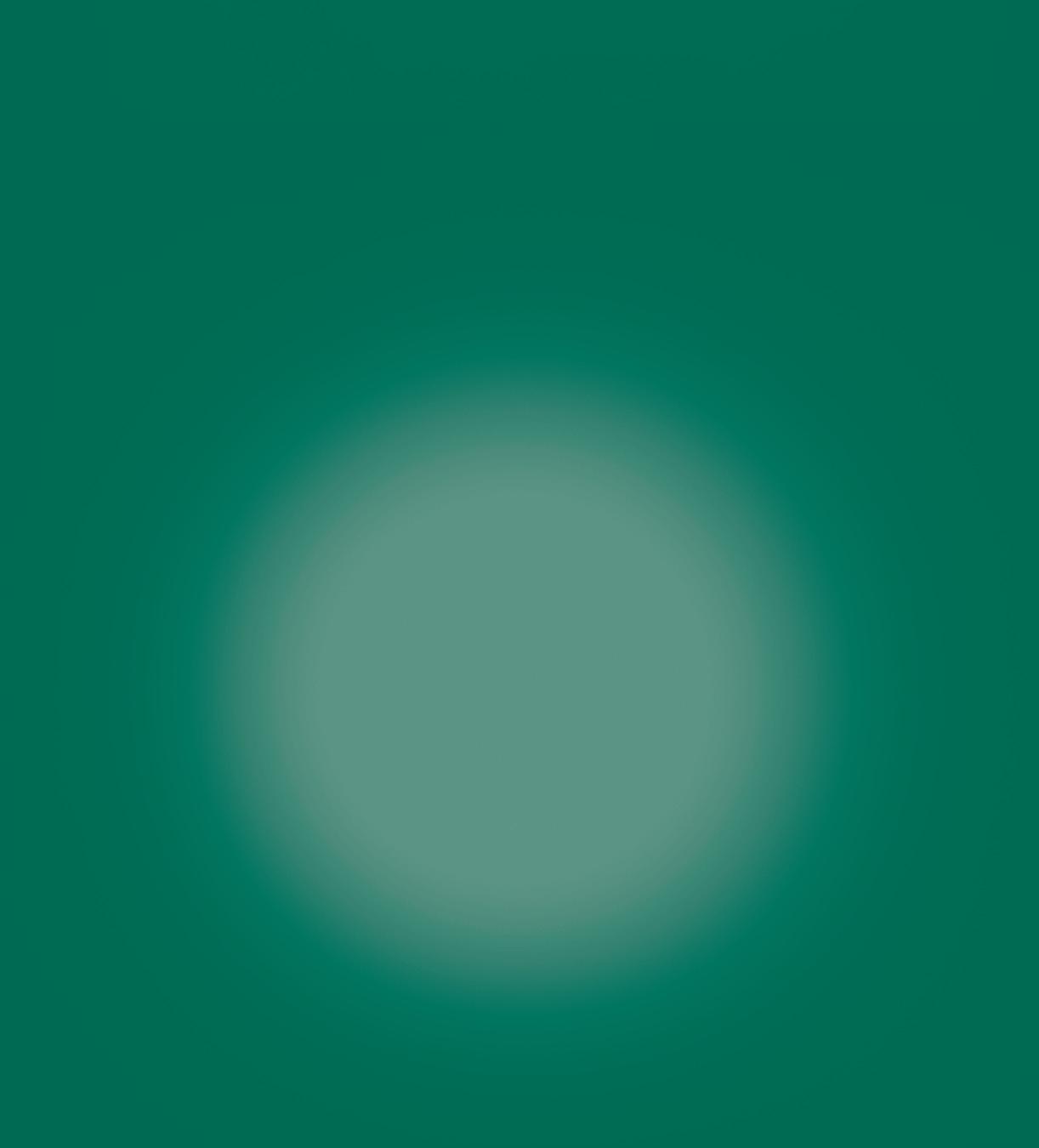Jérôme Duval-Hamel, Lourdes Arizpe et le Collectif de l’Art faber


Jérôme Duval-Hamel, Lourdes Arizpe et le Collectif de l’Art faber

Quand les poètes racontent et façonnent les mondes économiques
ACTES SUD | SPICILÈGES DE L’ART FABER

Préambule
“Mon métier préféré” – Sophie Nauleau
L’Art faber en bref
La fabrique du spicilège
Partie 1
La poésie confrontée aux mondes
d’Homo faber, une longue histoire
La timide cohabitation entre deux mondes… … qui finissent par se rapprocher pleinement
Partie 2
L’Art faber poétique : des poètes aux profils variés Recueil

Les paysages et architectures faberiens
Homo faber et ses activités
Sous la plume, les artefacts d’Homo faber
“Made in USA” : un exemple de poésie de l’Art faber
Une poésie didactique
Une poésie engagée

“Mon métier préféré”Sophie Nauleau
1. M. Deguy, “Relation d’incertitude”, Donnant Donnant. Poèmes 1960-1980, Paris, Gallimard, 2006.
Michel Deguy, en ouverture de Donnant Donnant, s’interrogeait : “Puisqu’il s’agit d’une anthologie de mes écrits, je me permets de la présenter du biais de cette question économique : la poésie, qu’a-t-elle fait de moi 1 ?” C’est une question cruciale. Que l’on ferait bien de se poser en conscience, en ces temps où l’appellation poésie recoupe des territoires si différents, et médiatiquement biaisés, que l’on s’y perd souvent. Comme sous le coup d’une sorte d’AOC insidieuse, appellation d’origine contrôlée par la notoriété médiatique ou la malédiction, qui règne encore dans la ritournelle journalistique et la bonne pensée collective. Le Printemps des Poètes n’y est pas pour rien, qui depuis plus d’un quart de siècle milite au nom de la parole donnée. Et la défense des auteurs, qui codifie les échanges selon un barème de fonctionnaire en déplacement ou représentant de commerce, avec indexation des recommandations tarifaires sur l’indice des prix à la consommation. Alors quel rapport les poètes entretiennent-ils avec la notion de travail ?
Dans l’Antiquité latine déjà, la distinction entre poète inspiré – poeta vates – et poète artisan – poeta faber – était de mise. Faber , dans Les Métamorphoses d’Ovide , est le forgeron qui trempe son fer rougi dans l’eau pour le faire refroidir, le temps d’un grésillement plus saisissant qu’un acouphène. Étrangement le cheval a sa part dans cette histoire de voleurs de feu : le verbe tripaliere est en effet dérivé du trépied qui servait aux maréchaux- ferrants, ce fameux tripalium resté synonyme d’entrave ou de torture. Un petit scarabée crépusculaire, l’ Ergates faber , a gardé ce nom de forgeron sous ses airs de coléoptère. D’où la détestation de l’idée même autant que du vocable pour la plupart des poètes : “Rien ne sert d’être vivant, le temps qu’on travaille.” Résume l’auteur de Nadja , André Breton, qui écrivait
8 avec humour dans son Premier manifeste du surréalisme , il y a tout juste cent ans :
On raconte que chaque jour, au moment de s’endormir, Saint-Pol-Roux faisait naguère placer, sur la porte de son manoir de Camaret, un écriteau sur lequel on pouvait lire : le poète travaille.
Qu’on ne s’y trompe pas, les poètes travaillent. Certes beaucoup ont le mot en horreur, tel Christian Bobin qui en use férocement, toujours avec douceur : “Comme mes frères les moineaux je travaille paisiblement à l’effondrement des banques et des maisons de retraite 2.” Ou Henri Michaux avant lui, “l’homme le plus farouchement indépendant” selon son éditeur René Bertelé, l’un des rares à refuser de percevoir des mensualités l’engageant sur plusieurs œuvres : “Or, la poésie est un cadeau de la nature, une grâce, pas un travail. La seule ambition de faire un poème suffit à le tuer 3.” Sentiment partagé par la Polonaise Wisłava Szymborska, Nobel de littérature, aux magnifiques tentatives de curriculum vitæ : “Quelle que soit la longueur de la vie, / Le C.V. se doit d’être court 4.” Ou encore la Belge Liliane Wouters qui enseignait pour vivre :
Entre naître et mourir, un temps pour vivre. Quelques heures, quelques saisons. De quel Poids pèseront nos jours ?
Lumière et givre Brillent pour tous, et sur tous mord le gel.
Ainsi de ces insectes nommées éphémères. Quid de celui qui ne fait rien, des grands travaux De l’autre, des troupeaux de bovidés, d’Homère5 ?
En terrain comptable, j’aurais pu citer l’immense Cavafis (18631933), l’employé de bureau grec qui aura passé sa vie à additionner. Voire
2. C. Bobin, Noireclaire, Paris, Gallimard, 2015.
3. H. Michaux, Panorama de la jeune poésie française, anthologie par René Bertelé, Paris, Robert Laffont, 1942.
4. W. Szymborska, “Curriculum Vitæ”, De la mort sans exagérer, traduit du polonais par Piotr Kaminski, Paris, Gallimard, 2018.
5. L. Wouters, “État provisoire”, L’Aloès, Paris, Luneau Ascot, 1983.
6. F. Pessoa, “Autobiographie sans événements”, Le Livre de l’intranquillité de Bernardo Suarès, traduit du portugais par Françoise Laye, Paris, Christian Bourgois éditeur, 1999.
7. Née en 1977 à Toulouse, Sophie Nauleau est écrivain. Docteur en littérature française et diplômée de l’École du Louvre, elle a produit pour France Culture des documentaires et émissions régulières, avant de devenir directrice artistique du Printemps des Poètes. Elle a composé de nombreuses anthologies poétiques et a notamment publié La Main d’oublies (Galilée, 2007), La Vie cavalière (Gallimard, 2015), La Voie de l’écuyer et J’attends un poulain (Actes Sud, 2017 et 2019), ainsi qu’une série de récits singuliers : La Poésie à l’épreuve de soi, Espère en ton courage, Ce qu’il faut de désir, S’il en est encore temps, Des frontières et des jours et Mais de grâce écoutez
Guillevic (19071997), plus de trente ans au ministère des Finances et des Affaires économiques, avant de prendre sa retraite d’inspecteur de l’Économie nationale, mais vous les retrouverez tous deux dans les pages qui suivent. Aussi j’opte pour Pessoa dont l’intranquillité nous tient : “Je baisse des yeux neufs sur les deux pages blanches où mes chiffres soigneux ont inscrit les résultats de l’entreprise. Et, avec un sourire que je garde pour moi, je pense que la vie – qui comprend ces pages couvertes de chiffres et de marques de tissus, avec leurs espaces en blanc, leurs lignes tracées à la règle et leur écriture calligraphiée – contient aussi les grands navigateurs, les grands saints et les poètes de toutes les époques, sans une ligne en mémoire d’eux, vaste peuple exilé de ceux qui font toute la valeur du monde6.”
C’est à cette valeur-là que j’ai voué ma vie. C’est pourquoi je peux répondre ici au petit garçon d’une école du Gard qui, m’écoutant parler de sensibilité et de poèmes, a levé la main pour demander : “C’est ton métier préféré ?” Oui, même sans l’écho de Ma saison préférée d’André Téchiné, la poésie est bien mieux qu’un métier, c’est un état d’âme et d’être.
Sophie Nauleau7
***
C’est dans l’exercice de ce métier de poète que des auteurs ont donné corps à des œuvres évoquant, parfois de manière inattendue, les mondes économiques, nourrissant ainsi l’Art faber…
1. Extrait d’une lettre du 27 mai 1952 de Nicolas de Staël à René Char, René Char, Nicolas de Staël. Correspondance, 19511954, Paris, Éditions des Busclats, 2010.
“Voilà l’aube, René, au nord de Valence. Je pense à toi parce que tu devrais écrire quelques mots sur divers éléments de ce chemin du Midi, certains à voir la nuit, d’autres au hasard. C’est peut-être idiot ce que je dis, mais, tu sais, cette masse du réservoir à gaz en sortant de Lyon, on pourrait très bien en faire quelque chose comme le château Saint-Ange, peint par Lorrain, bien sculpté en bonne pierre de taille, et graver quatre mots à toi. […]”
Nicolas de Staël à René Char1

1. L. Arizpe et J. Duval-Hamel, Affranchissements, Acting for the Advancement of Art faber, Paris, Opus Art faber, 2021.
2. D’autres ouvrages sont consacrés à l’Art faber en beaux-arts, photographie, musique, littérature, cinéma. www.artfaber.org
3. La dénomination “Art faber”, choisie par ce collectif sous la direction de Cloé Pitiot, conservatrice au centre Pompidou/ Paris, a été inscrite dans Le Manifeste de l’Art faber (BNF/ISBN 978-2-9573651-1-1) le 1er mai 2019, lors du centenaire de l’OIT (Organisation des Nations unies pour le travail), au cours d’une manifestation tenue dans l’atelier d’Édouard Manet, près de la gare Saint-Lazare, haut lieu de l’Art faber.
4. L. Arizpe, J. Duval-Hamel et le Collectif de l’Art faber, Petit traité de l’Art faber, Arles, Actes Sud, 2022.
Sous la bannière de l’Art faber, sont regroupées les œuvres ayant pour thèmes les mondes d’Homo faber, qu’il s’agisse du travail, de l’entreprise et plus globalement de tout ce qui relève de l’économie.
Ces œuvres forment un ensemble important et pourtant encore bien peu connu et promu. “Trop beau et trop puissant pour rester si peu célébré1” , regrettait Umberto Eco, soutien pionnier à notre projet de promotion de l’Art faber.
C’est à cela que veut remédier la collection de l’Art faber dont fait partie cet ouvrage consacré aux expressions de l’Art faber dans la poésie2.
Art faber : quelle origine ?
Cette expression a été créée en 2018 par un collectif international de personnalités issues des scènes artistiques et économiques3. Le concept de l’Art faber est développé en détail dans le Petit traité de l’Art faber, premier ouvrage de cette collection4.
Art faber : quel périmètre ?
Il embrasse tous les domaines artistiques (littérature, poésie, beaux-arts, musique, photographie, cinéma, spectacle vivant, bande dessinée…) et tous les mondes économiques, qu’il s’agisse d’agriculture, d’industrie ou de services.
Qualifier une œuvre d’Art faber ?
Certains s’étonneront peut-être de voir classer des œuvres, souvent a posteriori et parfois au-delà des intentions explicites de leurs auteurs, dans le champ de l’Art faber.
Pourtant, il s’agit là d’une grande tradition des arts et des lettres. “L’œuvre d’art est un message fondamentalement ambigu […]. Toute œuvre d’art, alors même qu’elle est une forme achevée […] est ouverte au moins en ce qu’elle peut être interprétée de différentes façons, sans que son irréductible singularité soit altérée. Jouir d’une
œuvre d’art revient à en donner une interprétation, une exécution, à la faire revivre dans une perspective originale”, affirmait Umberto Eco dans L’Œuvre ouverte5 .
Estampiller un poème “Art faber” n’exclut pas, bien entendu, que ces œuvres bénéficient d’autres classifications. Le poète grec Constantin Cavafis ne nous rappelaitil pas qu’une œuvre d’art est “comme une amphore, elle peut recevoir plusieurs explications ! 6” ? La classification en Art faber enrichit l’histoire des arts d’une catégorie complémentaire, et propose une nouvelle approche des mondes économiques.
5. U. Eco, L’Œuvre ouverte, Paris, Point Seuil, 1962.
6. C. Cavafis, Notes de poétique et de morale, Athènes, Aiora, 2016.

1. Des poèmes gravés sur des sièges de la ville de Paris, objets iconiques du Faber – issus de séries industrielles et de forges – et placés dans un lieu emblématique, le Palais-Royal, conçu pour certains de ses bâtiments comme un espace commercial.
Cf. J. Duval-Hamel, “Ubiquité”, in M. Goulet et F. Massut, Les Confidents, Dijon, Les Presses du réel, 2018.
2. Pour plus de précisions, voir L. Arizpe, J. Duval-Hamel et le Collectif de l’Art faber, Petit traité de l’Art faber, Arles, Actes Sud, 2022.
“Quelle drôle d’idée !”, “Ça existe ?”… Plutôt abruptes, ces réactions nées chez nombre de nos interlocuteurs à la seule évocation de la poésie dans l’Art faber !
Mais il n’en fallait pas moins pour nous motiver à franchir le Rubicon de l’a priori.
Nous respections trop le métier de poète et nous aimions trop la poésie pour ne pas partir à la recherche d’œuvres ayant pour thème Homo faber et ses mondes.
Nous étions également trop conscients des affinités entre poésie et univers économique, pour ne pas risquer cet engagement, comme nous avions osé, quelque temps auparavant, installer “Les chaises et bancs-Poèmes au Palais-Royal” à Paris1.
Le florilège de poèmes que nous proposons ici confirme l’existence d’une poésie de l’Art faber, une poésie qui évoque les mondes du travail, de l’entreprise et plus globalement les mondes économiques ; une poésie qui sait en livrer une vision originale et envoûtante grâce à l’assemblage insolite de mots, d’images, de sons et de réalités que peut-être seuls les poètes peuvent percevoir… Ils renouvellent ici notre vision des mondes faberiens et offrent une dimension inédite à la poésie. Ce spicilège démontre aussi combien leurs œuvres façonnent les mondes économiques avec un impact plus vaste que ne le soupçonnent parfois les poètes eux-mêmes.
Cette poésie de l’Art faber prend dignement sa place dans le corpus général de l’Art, et de l’Art faber en particulier2, aux côtés des autres genres littéraires, ainsi que des beaux-arts, de la
photographie, du cinéma, de la musique et des spectacles vivants.
Elle s’est construite pas à pas, en résonance avec le développement des mondes d’Homo faber, emmenée par des poètes souvent audacieux ne craignant pas de lutter contre les canons et les interdits dictés par les tenants de l’académisme.
Le patrimoine de l’Art faber poétique se révèle volumineux3. De manière étonnante, son contenu est complet : il aborde tout ce que les experts définissent comme monde économique. Si la valeur de ces poèmes à thématique économique a été parfois contestée, voire décriée, elle est aujourd’hui pleinement reconnue.
Se pencher sur les mondes d’Homo faber nous conduit à examiner sous un angle poétique un vaste écosystème traversé de forces de progrès mais aussi de crises, aux impacts multiples.
Ce livre, loin d’être exhaustif, laisse une place centrale aux mots des poètes : leurs textes4 contributifs à l’Art faber se déploient de page en page, invitant le lecteur à investir plus avant le sujet et nourrissant, nous l’espérons, ce “besoin de poésie en chaque homme 5” …
Dans cet esprit, le spicilège abrite également un recueil6 consacré au poète belge Émile Verhaeren (18551916), figure importante des arts et de la société de la fin du 19e et du début du 20e siècle, mais quelque peu oubliée aujourd’hui. Son apport au patrimoine poétique et plus particulièrement à celui de l’Art faber est pourtant considérable, méritant d’être ici honoré.
3. Notre recension porte sur les œuvres poétiques consacrées aux mondes économiques dans les pays pionniers de la révolution industrielle et de l’Art faber : le Royaume-Uni, la Belgique, la France, l’Allemagne et les États-Unis, aux 19e et 20e siècles. De futures publications enrichiront ces recensions et analyses des poésies produites dans ces pays depuis la fin du 20e siècle et dans d’autres contrées.
4. Les poèmes présentés dans ce spicilège ont été sélectionnés, dans le périmètre historique et géographique précité, par le Collectif de l’Art faber et les étudiants de l’Université ParisPanthéon-Assas (MBA). Cet ouvrage est un premier jet, un travail de passionnés plutôt que de spécialistes. Aussi, le lecteur voudra bien nous pardonner certains raccourcis, et certaines faiblesses. Celles-ci seront corrigées dans de futures publications qui nous permettront aussi d’envisager la poésie de l’Art faber sous des prismes complémentaires, en parcourant d’autres territoires ou en menant une étude stylistique de ces poèmes mis au service de l’évocation des mondes d’Homo faber
5. G. Jean, La Poésie, Paris, Seuil, 1966.
6. Cf. infra, p. 51.

L’Art faber rassemble les œuvres d’art ayant en commun la représentation du travail et plus largement des mondes économiques. Il forme un corpus en grande partie méconnu, “trop beau et trop puissant pour rester si peu célébré”, comme le regrettait Umberto Eco, un de ses soutiens pionniers. La poésie de l’Art faber n’échappe pas à ce constat. Pis, d’aucuns pensent que les poètes ne se sont jamais inspirés de ces univers d’Homo faber, ce fabricant, porteur des mondes économiques. De façon inédite, cet ouvrage illustre combien, au contraire, poètes et poétesses les ont souvent convoqués dans leurs œuvres, tant pour les raconter que pour les louer ou les critiquer, au point même de contribuer à les façonner.
À travers une sélection de poèmes anciens et contemporains, ce spicilège porte un éclairage nouveau sur des œuvres célèbres et révèle aussi au grand jour des textes oubliés mais non moins saisissants. Il présente par ailleurs un recueil de poèmes d’Émile Verhaeren, dont l’apport au patrimoine de l’Art faber est incontournable et que Stefan Zweig, admiratif, considérait comme “le plus grand de nos lyriques d’Europe”, ajoutant que “[t]outes les manifestations de l’activité moderne se reflètent dans l’œuvre de Verhaeren et s’y transmuent en poésie”.