

Illustrations d’Alain Merville Francesca Sacco


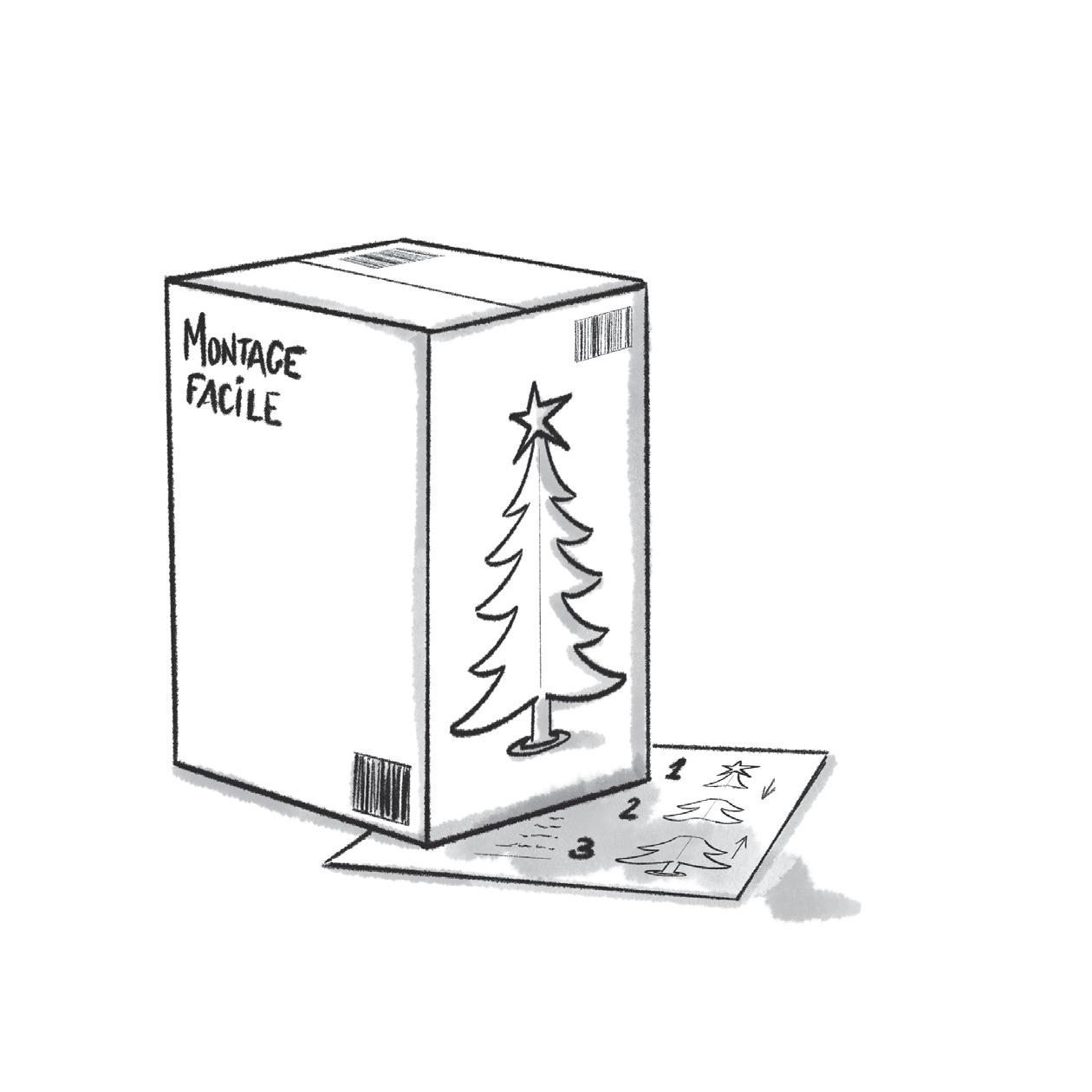



La bûche de Noël
Que serait la fête de Noël sans moi ? À ma vue, les mines se réjouissent ; j’apporte aux convives attablés de la douceur – au sens propre comme au figuré.
Au départ, je n’étais pas ce délicieux dessert que vous connaissez, mais un gros morceau de bois, ce qui ne m’empêchait pas de posséder aux yeux des hommes de grands pouvoirs. On me plaçait avec déférence dans l’âtre pour que j’illumine la fête de Noël. La façon dont je me consumais avait valeur de présage. On en déduisait que la prochaine récolte serait plus ou moins bonne, par exemple. Pour mettre toutes les chances de leur côté, les travailleurs de la terre m’aspergeaient de vin en récitant des incantations. On me disposait dans le feu à côté des tisons de la bûche précédente, en m’accompagnant d’un vœu que je portais au Ciel en me consumant. Parfois, le rite donnait lieu à un rassemblement sur la place du village, autour d’un feu. Les habitants se rendaient à la messe de minuit et regagnaient ensuite leurs chaumières avec des braises pour lancer le feu nouveau.
Mes cendres étaient conservées pour leurs vertus magiques : protection contre la foudre et les incendies, conjuration du mauvais sort, etc. On les utilisait également à des fins thérapeutiques, contre divers maux frappant le bétail ou les humains.
Aujourd’hui encore, je fais l’objet d’un rite étonnant en Catalogne. On m’apprête soigneusement chaque année à l’approche de Noël pour me transformer en tió de Nadal. On commence par me fabriquer une paire de pattes. Puis, on dessine des yeux et un sourire sur l’une de mes


extrémités, au milieu de laquelle on fixe un petit nez en bois pour me donner une expression encore plus vivante. Tous les soirs, les enfants me recouvrent d’une couverture chaude pour que je n’attrape pas froid pendant la nuit, et ils laissent un peu d’eau et de nourriture à ma disposition. Enfin, le 25 décembre, ces mêmes enfants entonnent des chants de Noël tout en me donnant des coups de bâton pour que je libère mon contenu stomacal – des bonbons, des noix et parfois des figues séchées – via le trou creusé à l’arrière de mon corps.
Oui, vous avez bien lu.
Vous direz peut-être que c’est saugrenu. Pourtant, dans certaines crèches de Catalogne, on trouve parmi les figurines traditionnelles un intrus avec le pantalon baissé jusqu’aux chevilles, accroupi dans une position qui ne laisse planer aucun doute sur le fait qu’il est en train de déféquer. Les excréments sont des engrais naturels qui présagent une bonne récolte ; ils symbolisent ainsi la fertilité de la terre. Selon un proverbe espagnol, le fumier n’est pas saint, mais là où il tombe, il fait des miracles ! Le fait qu’il existe sur internet des caganers à l’effigie de célébrités américaines –par exemple, la chanteuse Madonna – prouve que la chose prête à sourire plus qu’elle ne choque.
Du reste, la Bible dit que nous devons du respect à notre anatomie : « Les parties de notre corps dont il n’est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers dont les autres n’ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière qu’on honore davantage celles qui manquent naturellement d’honneur. » (1 Cor. 12 : 23-24)
Maintenant je sens qu’il va être difficile de changer de sujet pour revenir sur cette fameuse spécialité à la crème au beurre.
Quand, à partir du XIXe siècle, les cheminées sont remplacées par le chauffage au poêle, puis par les radiateurs électriques, mon aïeule en bois tombe en désuétude. C’est alors que des pâtissiers décident de réaliser un dessert qui la ferait revivre dans la mémoire des hommes. Je deviens un gâteau roulé à base de génoise recouverte de crème au beurre parfumée au café, au pralin, au chocolat. Mon design évolue jusque vers 1945. Après la Libération, je m’impose sur les tables de Noël.
La paternité de ma recette n’a pas formellement été établie. Pour certains, je suis née en 1834 des œuvres d’un apprenti pâtissier de Saint-Germain-des-Prés. Pour d’autres, ma création remonte aux années 1860 et elle nous mène à Lyon, dans la cuisine du chocolatier Félix Bonnat. Mais peut-être faut-il chercher du côté de la pâtisserie Quillet, à Paris, laquelle aurait inventé à peu près à la même époque un gâteau à base de génoise et de crème au beurre ? Le mystère demeure.
Sur internet, on peut trouver la recette de « La bûche de Noël parisienne » dans l’édition du 23 décembre 1934 de la revue Rustica. Il est indiqué que cette création pâtissière « se compose essentiellement d’un biscuit léger et spongieux, enduit de crème grasse et roulé sur lui-même », et qu’il est « décoré avec de la crème au beurre agrémentée de liserons en sucre. »
Dans son Dictionnaire universel de cuisine pratique daté de 1902, le cuisinier suisse Joseph Favre donne aussi une vieille recette de bûche de Noël, ou plutôt de « gâteau-bûche ». Elle ressemble beaucoup à ce qui se fait aujourd’hui, à quelques détails près. La génoise est garnie de confiture, puis roulée et coupée en tranches, qui sont ensuite tartinées de crème au moka ou au chocolat. Enfin, la bûche est recomposée et recouverte de crème au beurre aromatisée.


J’ai triomphé de tous les autres desserts sur les tables de Noël. Les étoiles à la cannelle, les bruns de Bâle, les milanais, les biscômes et les pains d’épices, le panettone italien, le stollen alsacien, les massepains et les pâtes de fruits : tous sont relégués au rang de figurants.
Preuve de mon succès, s’il en fallait encore une : les Français ont décidé d’organiser une sorte de César de la pâtisserie, à laquelle je suis naturellement invitée. Cette cérémonie se tient tout aussi évidemment à Paris. Des créations d’exception, dûment sélectionnées par un jury composé de grandes toques et de journalistes spécialisés, s’affrontent dans leurs catégories respectives. La bûche de Noël victorieuse en 2022 s’appelait Noël au Chalet. Une œuvre de l’ex-champion du monde de pâtisserie Étienne Leroy, réalisée dans un superbe décor de chalet en chocolat. Dans la catégorie « bûche de palace », c’est une création de Maxime Frédéric, chef pâtissier du Cheval Blanc, trois étoiles au Guide Michelin, qui a été sacrée.
Ces chefs-d’œuvre ne sont pas donnés. Certaines bûches de prestige coûtent 120 € pour six personnes et vous les trouvez exclusivement dans la boutique parisienne de leur créateur.
Sachez aussi qu’il existe un record mondial de la plus longue bûche de Noël. Le dernier en date a été établi en 2014 par des Français. Ils ont eu besoin de 50 000 œufs, 1500 kilos de beurre et 750 kilos de sucre pour confectionner ce serpentin de 1,4 kilomètre, dans le cadre du Téléthon.
Le sucre : en pâtisserie, vous n’y échappez pas. Il donne du croquant, du moelleux, du fondant. Il confère aux mousses leur texture aérienne. Il favorise la gélification des confitures, stabilise les préparations en empêchant la croissance des micro-organismes, augmente le volume de
la pâte et apporte aux desserts une belle couleur dorée quand il est caramélisé. De plus, il permet de fabriquer de l’alcool – typiquement le rhum, obtenu par distillation de mélasse ou de canne à sucre. Le pétillant du champagne ? C’est encore grâce au sucre.
Le problème est que les gens consomment déjà beaucoup trop de sucre, avec une moyenne pouvant dépasser 35 kilos par année et par personne dans les pays développés. Les autorités sanitaires sont unanimes sur le fait que le sucre n’est pas l’allié de votre santé. Or, dans ma version pâtissière, je vaux facilement 400 calories par tranche de 100 grammes. Les personnes soucieuses de leur ligne me choisiront préférablement sous forme de dessert glacé. Si vous remplacez la glace à la crème par un sorbet, c’est encore mieux. Le nombre de calories peut être réduit de moitié.
Un conseil : tâchez d’éviter les édulcorants artificiels. Audelà d’une certaine dose, ils provoquent des symptômes digestifs dont je vous épargne la description détaillée. Méfiez-vous aussi des bûches « sans sucre ». Il est possible qu’on ait simplement renoncé à ajouter du sucre cristallisé. La recette peut donc très bien contenir des sucres naturels, comme le fructose qu’on trouve dans le miel, par exemple.
À bon entendeur, salut !


Recette de la bûche de Noël
Pâte à génoise
• 120 g de sucre (8 c. à s.)
• 3 œufs
• 1 pincée de sel
Fouettez jusqu’au ruban dans une terrine au bainmarie : 15 min environ. Retirez de la chaleur et fouettez encore 5 min.
• 45 g de farine (4½ c. à s.)
• 45 de fécule (4½ c. à s.)
Tamisez sur la mousse. Mélangez délicatement. Versez la pâte dans une plaque à gâteau rectangulaire garnie d’un papier parchemin fortement graissé. Cuisson à four chaud : 8 à 10 min. Retournez le biscuit sur un linge de cuisine –recouvrez d’une couche de confiture – roulez le biscuit au moyen du linge – laissez refroidir – coupez les extrémités en biais – avec les restes, formez des nœuds.
Crème au beurre
• 200 g de beurre frais
Travaillez en crème dans une terrine.
• 150 à 200 g de sucre glace tamisé
Ajoutez peu à peu en remuant. Parfumez au pralin.
Pralin
• 60 g de sucre (4 c. à s.)
Caramélisez dans une casserole.
• 60 g d’amandes ou noisettes mondées
Ajoutez et mélangez 2 min environ. Versez sur une plaque à gâteau graissée. Laissez refroidir avant de moudre ou de piler.
Montage du gâteau
Prélevez ½ tasse de crème au beurre pour masquer la coupe de la bûche et le dessus des nœuds. Mélangez le parfum pralin au reste de la crème au beurre. Recouvrez toute la surface de la bûche. Posez les nœuds et garnissez-les de crème. Imitez l’écorce d’un arbre au moyen d’une fourchette ou d’un couteau. Décorez à volonté.
Tiré du livre Recettes culinaires, Mets et techniques pour toutes les occasions. Reproduit avec l’aimable autorisation des éditions Alphil.



Le conte de Noël
Il est facile de me reconnaître, car je commence ordinairement par « Il était une fois » ou « C’est l’histoire de ».
Je suis truffé de légendes – mot qui vient du latin legenda signifiant « digne d’être lu ».
J’ai un tas de choses à raconter sur la féerie de Noël et pour ajouter au merveilleux, je n’hésite pas à conférer le don de parole aux animaux, aux anges, aux lutins et même au bonhomme de neige. Je porte généralement un message d’amour et de réconciliation, sans pour autant occulter les aspects pénibles, voire cruels de l’existence humaine.
Prenez, par exemple, La Petite Fille aux allumettes de Hans Christian Andersen. C’est l’histoire d’une enfant miséreuse qui vend des allumettes dans la rue. Elle n’ose rentrer chez ses parents, car, n’ayant pas trouvé de client de toute la journée, elle sait qu’elle va se faire battre. Rencognée contre le mur d’une maison, elle craque ses derniers bâtonnets de soufre pour s’éclairer dans la nuit. Tous lui donnent des hallucinations : elle voit apparaître un bon feu de cheminée, un appétissant repas de fête, un sapin de Noël triomphant et, enfin, la seule personne qui l’ait aimée, sa grand-mère disparue. Le lendemain, on découvre la pauvre enfant sans vie, un sourire sur le visage.
Et que dire du Bonhomme de neige, conte du même auteur ? Cette créature éphémère meurt d’envie de se faufiler dans une maison pour s’installer devant le poêle, alors qu’elle est dans l’incapacité de se déplacer et que la chaleur lui est fatale. Moralité : « Quand tout concourt à réaliser nos souhaits, nous cherchons dans l’impossible ce qui pourrait arriver pour troubler notre repos ; il semble que le bonheur


n’est pas dans ce qu’on a la satisfaction de posséder, mais tout au contraire dans l’imprévu d’où peut souvent sortir notre malheur. »
À l’époque, il n’existait pas d’âge légal pour les contes de Noël, mais on peut tout de même se demander comment les gens osaient raconter des histoires pareilles aux enfants. Aujourd’hui, on voit les choses différemment. Le bonhomme de neige est inquiet à l’idée de fondre, il en tremble sous son chapeau noir et ose à peine tirer sur sa pipe en bois ; d’ailleurs le tabac tue, c’est écrit sur l’emballage. En désespoir de cause, il se roule dans la neige pour prolonger sa vie de quelques coudées. Heureusement, le père Noël intervient : il charge le pauvre bonhomme de neige sur son traîneau et l’emmène au pôle Nord pour le réparer dans son atelier magique. Récemment diplômé en chirurgie esthétique, il lui refait même un nouveau nez avec une carotte fraîche.
Souvent anonymes et difficiles à dater, les histoires que je raconte sont issues de la tradition orale, et des gens lettrés les ont ensuite couchées sur papier. Depuis l’Antiquité, les contes sont transmis par des gens du peuple – fréquemment de vieilles femmes.
D’une manière générale, il faut distinguer les contes d’auteurs et les histoires colportées pendant des générations par le bouche-à-oreille, avant d’être publiées par des collecteurs comme les frères Grimm – même si ces derniers, contrairement à ce qu’ils ont pu laisser croire, n’ont pas vraiment sillonné la campagne allemande pour récolter leurs trésors. Ils ont passablement sollicité la mémoire de leurs proches, dans laquelle certaines vieilles histoires racontées par des bonnes d’enfants, des servantes ou des domestiques avaient survécu. Ainsi, les nourrices huguenotes auraient constitué une source d’inspiration notable
des frères Grimm, dont l’œuvre reconfigure finalement beaucoup de contes français et italiens déjà existants.
On ne s’étonnera donc pas de trouver plusieurs variantes d’un même conte. Par exemple, dans certaines versions du Petit Chaperon rouge, le loup dévore la mère-grand, mais pas entièrement ; il conserve quelques restes qu’il ordonne à l’enfant d’avaler pour prendre des forces. Cette fin cannibalesque disparaît sous la plume de Charles Perrault, tout comme dans l’adaptation des frères Grimm. La quantité de retranscriptions du Petit Chaperon rouge a fait dire à Claude Lévi-Strauss qu’il n’en existait « que des variantes ».
Grâce au dessinateur français Grégoire Lecaye-Solotareff, dit Solotareff, on trouve même, depuis 1989, un Petit Chaperon vert !
Les auteurs classiques restent Jacob et Wilhelm Grimm, Charles Perrault, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Hans Christian Andersen et Charles Dickens, pour ne citer que les plus connus. Mais des écrivains comme Maupassant, Alphonse Allais, Colette et François Mauriac se sont frottés au genre. Et on continue de le dépoussiérer ! Par exemple, en 2001, cinq journaux européens, dont Le Monde, ont invité leurs lecteurs à écrire de nouveaux contes de Noël, en perspective d’une publication aux éditions Actes Sud.
Encore un mot sur les frères Grimm. Dans les Nains magiques, de petites créatures fabriquent gracieusement des chaussures pour un cordonnier pendant qu’il dort.
Devenu riche, l’artisan empli de gratitude décide avec sa femme de confectionner des habits pour les remercier. Les bienfaiteurs les prennent et disparaissent pour ne plus jamais revenir, mais le couple est heureux, et le sera pour toujours.


La collection d’histoires merveilleuses des frères Grimm aboutit, à partir de 1812, à la parution en plusieurs tomes des Contes de l’enfance et du foyer. Le succès arrive deux décennies plus tard, à la faveur de l’émergence de la classe bourgeoise. Jacob et Wilhelm Grimm se distingueront également par leurs écrits sur la linguistique allemande et les maîtres troubadours.
Détail intéressant : en 1945, l’œuvre des frères Grimm est interdite de publication par les forces d’occupation alliées en Allemagne. Motif : trop de violence. Par exemple, dans Le Conte du genévrier, un petit garçon est décapité par sa mère avant d’être cuisiné en sauce brune. Mais il ne s’agit pas que de violence au sens général. En effet, il est impossible de ne pas percevoir un relent antisémite dans Le Juif dans les épines.
Examinons maintenant l’histoire de Casse-Noisette, racontée par Piotr Ilitch Tchaïkovski. La petite Clara se voit offrir pour Noël, de la part de son oncle passionné d’automates, un pantin en bois qui permet de casser des noisettes. Une nuit, tous les jouets de sa chambre s’animent comme par magie. C’est alors que le roi des rongeurs décide de passer à l’attaque, mais le casse-noisette, transformé en prince, sauve la fillette qu’il embarque sur son bateau magique pour lui faire découvrir un monde féerique peuplé de poupées ; à la fin, c’est un peu comme s’ils se mariaient.
La fable est souvent interprétée comme une allégorie du passage de l’enfance à l’adolescence, avec en arrière-fond la sempiternelle lutte entre l’amour et les forces du mal, omniprésente dans ce genre littéraire.
La légende originelle est différente. Voici fort longtemps, un paysan acariâtre se retrouve comme d’habitude dans une complète solitude le soir de Noël, qu’il occupe en mangeant des noisettes. Fatigué par ce travail manuel, il décide d’offrir une récompense à quiconque trouvera un
moyen de décortiquer les fruits oléagineux facilement et sans effort. Beaucoup de gens défilent avec des idées saugrenues. Par exemple : tirer sur la noisette à coups de fusil, l’ouvrir avec une scie, etc. Pendant ce temps-là, un artisan travaille d’arrache-pied dans son atelier pour sculpter une figurine en bois représentant un soldat. Elle a une grande bouche, avec de puissantes mâchoires. Un mécanisme permet de les ouvrir et de les refermer pour casser des noisettes. Le paysan est immédiatement séduit ; il éprouve pour cet objet utilitaire une véritable affection et son cœur s’attendrit. Il offre ses noisettes alentour et devient l’ami des enfants.
Pour l’anecdote, le casse-noisette, ou casse-noix, est un objet connu depuis l’Antiquité. Un modèle décoratif en bronze datant de 300 avant Jésus-Christ a été découvert dans un sépulcre à Tarente, en Italie.
Je digresse un peu, excusez-moi.
Si vous pensez que je suis un peu vieillot, vous faites erreur. Je remonte peut-être aux origines de l’humanité. Mais je suis toujours vivant. Même la montée en puissance des réseaux sociaux et la déferlante des chaînes YouTube n’ont pas eu raison de ce besoin primitif d’émerveillement. Saviez-vous qu’il existe une journée mondiale du conte, le 20 mars ?
Post-scriptum
Avec le nivellement de la langue, la perte de l’habitude de lire, la réforme de l’orthographe et le débat sur l’écriture inclusive, je ne peux plus rien faire comme avant. Les grands classiques ont dû être réécrits. Voici deux exemples.


La légende de l’enfant bouilli
Version originale :
Un jour, une mère lavait son jeune enfant dans un chaudron dont elle faisait tiédir l’eau dans l’âtre. Or, ce jour-là, une fête était donnée à la cathédrale en l’honneur de saint Nicolas.
La mère s’y rendit oubliant son enfant dans la marmite qui chauffait. Quand elle revint, elle trouva son enfant qui jouait dans l’eau bouillante sain et sauf…
Version moderne :
Un jour, une mère laissait saon enfant-e dans un fauteuil du salon avec un téléphone portable neuf. Or, ce jour-là, il y avait des actions au supermarché et la maman était stressée, car elle venait de sortir du boulot et le magasin allait bientôt fermer.
La mère s’y rendit oubliant saon enfant-e dans la pièce bien chauffée.
Quand elle revint, elle trouva saon enfant-e qui jouait à des jeux vidéo, sain-e et sauf-ve…
La légende de saint Nicolas
Version originale :
Ils étaient trois petits enfants
Qui s’en allaient glaner aux champs (refrain) Tant sont allés, tant sont venus
Que vers le soir se sont perdus
S’en sont allés chez le boucher : Boucher, voudrais-tu nous loger ?
Entrez, entrez, petits enfants
Y a de la place assurément
Ils n’étaient pas sitôt entrés
Que le boucher les a tués
Les a coupés en p’tits morceaux
Mis au saloir comme pourceaux
Saint Nicolas au bout d’sept ans
Vint à passer dedans ce champ
Alla frapper chez le boucher :
Boucher, voudrais-tu me loger ?
Entrez, entrez, saint Nicolas
Y a de la place, il n’en manque pas
Il n’était pas sitôt entré qu’il a demandé à souper
Voulez-vous un morceau de jambon ?
Je n’en veux pas, il n’est pas bon
Voulez-vous un morceau de veau ?
Je n’en veux pas, il n’est pas beau
Du p’tit salé, je veux avoir
Qu’il y a sept ans qu’est dans l’saloir
Quand le boucher entendit ça
Hors de la porte il s’enfuya (sic)
Boucher, boucher ne t’enfuis pas
Repens-toi, Dieu te pardonnera
Saint Nicolas alla s’asseoir
Dessus le bord de son saloir
Petits enfants qui dormez là
Je suis le grand saint Nicolas
Et le saint étendit trois doigts
Les petits se levèrent tous trois
Le premier dit : « J’ai bien dormi »
Le second dit : « Et moi aussi »
Et le troisième répondit
« Je me croyais au paradis »


Version moderne :
Ils étaient trois petits enfants
Qui s’ennuyaient facilement (refrain)
N’ayant pas les bons souliers
Ils ont vite mal aux pieds
Et s’en vont chez leur mémé :
Peux-tu nous donner à goûter ?
Entrez, entrez, petits enfants
Y a des sucreries assurément
Ils n’étaient pas sitôt entrés
Que mémé leur a préparé
Du chocolat en p’tits morceaux
Oh comme c’est beau
Saint Nicolas au bout d’sept ans
Vint à passer là devant
Alla frapper chez la mémé :
Voudrais-tu me donner à goûter ?
Entrez, entrez, saint Nicolas
Y a de quoi manger, il n’en manque pas
Il suffit de demander
Voulez-vous un plat de légumes ?
Les enfants croient que ça donne le rhume
Voulez-vous un bol de salade ?
Ils trouvent toujours que c’est fade
Du chocolat en p’tit dés, ils veulent avoir
Qu’il y a sept ans qu’est dans l’vidoir
Quand la mémé lui dit ça
Saint Nicolas n’en revint pas
Mémé, mémé, ne désespère pas
C’est la société qui est comme ça
Saint Nicolas alla s’asseoir
Dessus le bord de son vidoir
Petits enfants qui glandouillez là
Je suis le grand saint Nicolas
Et le saint étendit trois doigts
Les petits se levèrent tous trois
Le premier dit : « J’ai trop mangé »
Le second dit : « Et moi aussi »
Et le troisième répondit
« Je crois que j’ai encore grossi »

Courrier des lecteurs
Je vous remercie pour votre intéressant chapitre sur le conte de Noël.
Mais vous avez oublié de rendre hommage aux troubadours.
En langue d’oc, trobar signifie trouver, créer, inventer. Au XIIe siècle, ce terme prend le sens de « composer quelque chose en vers ». Dans notre français moderne, un trope est une figure de style par laquelle les mots sont détournés de leur sens concret et habituel. La métaphore, par exemple, est un trope.
Attention : le troubadour est un artiste de langue d’oc ; s’il compose en langue d’oïl, c’est un trouvère ! Au féminin, on parle de troubadouresse et de trouvère.
Poètes, interprètes, chanteurs, musiciens, aventuriers, ces virtuoses de la narration et de la mise en scène s’expriment en vers réguliers (toutes les strophes sont structurées de la même façon), sur un ton librement ironique et moralisateur.
Leur art se développe initialement en Aquitaine, dans le Languedoc et en Provence, pour se répandre ensuite en Italie et en Espagne, au Portugal, en Angleterre et dans bien d’autres pays. Les cours seigneuriales raffolent de leurs chansons de geste (du latin gesta signifiant « fait, événement ») pour occuper les longues soirées d’hiver.
Nous sommes au début du XIe siècle. Le pape Urbain II vient de lancer un appel à la première croisade (neuf autres suivront) pour débloquer l’accès à la Terre sainte. Aux chevaliers qui s’enrôlent, le souverain pontife promet le pardon des péchés. L’un des troubadours les plus célèbres est le grand-père d’Aliénor d’Aquitaine, Guillaume IX de Poitiers, qui a combattu aux côtés de l’intrépide Godefroy de Bouillon lors de la première croisade.

En général, les troubadours racontent l’héroïsme chevaleresque et l’amour courtois, pur et platonique. Jacques Lacan définira cet « amour de loin » comme « le désir de désirer et non pas le désir de l’autre dans sa corporéité ».
Ici, il est tentant de faire une comparaison avec la vie moderne, dans laquelle les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) permettent de perpétuer « l’amour de loin ». Selon l’expression d’un chercheur dont le nom m’échappe, ce mode relationnel revient à « créer de la présence dans l’absence, tout en rendant l’autre suffisamment absent pour ne pas se sentir débordé par sa présence ».
Vous voyez, même si les troubadours ont disparu au cours du XIVe siècle, il en reste bien quelque chose.
Signé (Courrier accompagné du dessin ci-dessous.)




Vous venez de consulter un
EXTRAIT
d'un livre paru aux Éditions Favre.
Tous droits réservés pour tous les pays.
Toute reproduction, même partielle, par tous procédés, y compris la photocopie, est interdite.
Éditions Favre SA
Siège social 29, rue de Bourg CH – 1002 Lausanne Tél.: +41 (0)21 312 17 17 lausanne@editionsfavre.com www.editionsfavre.com
