

Harmonie littéraire
Auteurs, Textes, Contextes
PLUS
Parcours
citoyenneté
Esame di Stato
EsaBac
Atelier des compétences
Conoscere gli obiettivi dell’Agenda 2030 per un futuro sostenibile
Il 2030 è la data che l’ONU ha indicato come traguardo per il raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame nel mondo, il contrasto al cambiamento climatico, la parità di genere, l’istruzione di qualità – per citarne solo alcuni. ‘Obiettivi comuni’ significa che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità.
Nei volumi del Gruppo Editoriale ELi le tematiche legate all’Agenda 2030 vengono affrontate in modo coinvolgente e costruttivo, attraverso testi, attività, video e immagini volti a sensibilizzare la classe a una comprensione più attenta e critica di ciò che succede nel mondo.
L’attenzione alle competenze, cognitive e non cognitive (soft skills), completa il nostro impegno nella formazione di cittadine e cittadini consapevoli e responsabili di uno sviluppo sostenibile.
La parità di genere è il quinto dei diciassette obiettivi dell’Agenda 2030 e mira a ottenere la parità di opportunità tra donne e uomini nello sviluppo economico, l’eliminazione di tutte le forme di violenza nei confronti di donne e ragazze e l’uguaglianza di diritti a tutti i livelli di partecipazione.
Il Gruppo Editoriale ELi in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Macerata ha creato un programma di ricerca costante mirato all’eliminazione degli stereotipi di genere all’interno delle proprie pubblicazioni.
L’obiettivo è di ispirare e ampliare gli scenari delle studentesse e degli studenti, del corpo docente e delle famiglie fornendo esempi aderenti ai valori di giustizia sociale e rispetto delle differenze, favorendo una cultura dell’inclusione.
Ci impegniamo a operare per una sempre più puntuale qualificazione dei libri attraverso:
CONTENUTI attenzione ai contenuti al fine di promuovere una maggiore consapevolezza verso una scenario più equilibrato da un punto di vista sociale e culturale;
IMMAGINI valutazione iconografica ragionata per sensibilizzare a una cultura di parità attraverso il linguaggio visivo;
LINGUAGGIO utilizzo di un linguaggio testuale inclusivo, puntuale e idoneo a qualificare i generi oltre ogni stereotipo.
Il nostro impegno per l’inclusione, le diversità e la parità di genere
Harmonie littéraire PLUS
Volume 1
Du Moyen Âge au XVIIIe siècle
Volume 2 XIXe, XXe et XXIe siècles
Ampio quadro dello sviluppo storico-sociale e artistico-letterario francese nel tempo Approfondimenti, confronti con altri contesti culturali e rimandi all’attualità.

Tematiche di tipo filosofico-letterario, sociale, culturale con un’attenzione agli obiettivi dell’Agenda 2030 e attività di preparazione alla prova EsaBac e all’Esame di Stato.
Percorsi di Educazione Civica attraverso temi di attualità, in un costante confronto tra passato e presente.
Per capire l’epoca
Ogni capitolo, suddiviso in Dossier, si apre con: mappa riassuntiva dei contenuti
introduzione al contesto storico, sociale, artistico e letterario, accompagnata da due linee del tempo che sintetizzano le date e gli eventi fondamentali del periodo storico e culturale.
La période
Histoire Société Art Littérature

1 Du Baroque au Classicisme La littérature évolue du Baroq exprime un mond en mouvement, au Classicisme qui exige des règles ixes et qui voit le monde soumis à a o nté ivine. Théophile de Viau Œuvres poétiq François de Malherbe Co ti à M D Péri Blaise Pascal es e sées René Descartes Discours de la

méthode
Dossier 2 Le roman entre rêve et réalité rande variété s’offre nous et d du rêve d M d qui est fortement ancré dans la société de son temps.
M de Scudéry Artamène ou le Grand Cy Paul Scarron Le Roman com que

Dossier 3 Le triomphe du théâtre e théâtre a connu pendant tout e siècle un épanouissement et et Racine, le genre de la tragédie s’impose.
Pierre Corneille L Cid Ci Jean Racine Andromaque Phèdr

Dossier 4 Le génie Molière Les pièces de Molière peignent les vices et les mœurs de son é le rire est par ois amer et, même si la comédie init bien les vices des hommes restent. Ce théâtre est g Molière Les Précieuses ridicules Tartuffe Le Ma ade Imaginaire
Per sviluppare la competenza letteraria
Ciascun Dossier contiene: generi e movimenti letterari
autori e opere: ampia scelta di autori e brani accompagnati da attività mirate alla comprensione, all’analisi, alla riflessione e alla produzionescritta produzione scritta.
Connaître la littérature
M de Scudéry (1607-1701)
Dossier 5 Images de la cour production littéraire des auteurs qui ont re ardé les hommes avec un leurs caractères leurs vices et leurs é auts. M de Sévigné ett M de La Fayette La Princesse de Clè Jean de La Bruyère Les Caractère Jean de La Fontaine es ables
À LA LOUPE… a langue au XVIIe si ’Académie français a morale de la énérosité Deux voix tragiques et un mê sujet : Bérénice de Racine et Tite et érénice de Corneill e syst me dramatique de Racine et a Quere Modernes À LA UNE re est-il toujours d’actualité À L’ÉCRAN Vers l’ESABAC LIRE LES IMAGES La Colonnad du Louvr ESPACE THÉMATIQUE g SUJET ESABAC La ja
Histoire XVI siècle Le siècle de l’absolutisme Classe Classeinveinversée Cli é Connaître la période La période classique Le règne de Louis XIII: le cardinal de Richelieu défenseur de l’ordre En 1610, à mort d Henr IV, assass né pa Ravaill ne Mar d Médi s, mère d Lou XIII, devient régente, car le jeune roi n’a que neu ns. Influencée ar Concini, un aventurier


italien, q d France avant d’être tué par un pi g e es, es appe e, pren re psurance. L’État est tou p g c’est pour ce moti que, en 1617 Lou XIII est amé ro En 1624, h t di de Ri h li omme chef du Conseil. Richelieu croit dans la raison d’État, tout doit être subordonné au ouvoir de l’État représenté
eLasituat e. La situationavecles ion avec les ttt protestants t est É En1630,il En 1630, il engagelaFr engage la Francedansla ance dans la guerrede guerre de T Trente ans (é (commencée 1618E en 1618 en Etrale)contr trale) contrelesHabsbo e les Habsbourgetles urg,etles urg, et les dépensescau dépenses causéesparcet sées par
Cli é


«
siècle »







-
rappellele rappelle le pp iomphe.Lef iomphe. Le ’blij n’oublieraj épreuve épreuve. 1659 la ,la PidP PaixdesPyr Paix des Pyrééénées énées marquelafi marque la fi dl ndela n de la
comédi ilég é d héâtre rréguli êle le tra ue et le comi usée (Co h 1694 D ct
Le roman entre rêve et réalité
Les différentes traditions du roman pp pl ons, ce omans de chevalerie, celle de la pastorale et celle, plus réaliste, du roman picaresque venu d’Esp gne : out le XVII èc d e roman une vér tabl ép ée en rose. L d nventé n Itali es poètes Sannazzaro et Tasso, évoque n monde aci ue où des ber ers et des ber ères occupent que d l’amour. Que ques auteurs q p p esque es personnages pp y de péripét es sans lien pparent Les romans-fleuves Les romans-fleuves fleurissent entre 1625 et 1660 d illi d rées d l’hiplagon des personnages ant ques et qu p d’Honoré d’Urfé, des bergers et gères, q g que, s trouvent séparés es uns des autres dès e d but du roman et ch h he à retrouver ensées. Ces -fleuves
Dossier 2 164 La période classique
p p p ma ecteurs passnés sont peu nombreux et enre est rapidement c t qué. Le roman précieux Le courant préc déve oppe énormément d e XVI èc e. est né d d souvent tenus par des emmes de la noblesse désipenseurs époque. Dans ces sa ons, avec eux, uent, mœurs deviennent plus raffinées et une nouvelle dimension est donnée aux ra orts amoureux. La préciosité a un grand intérêt pour les raffinements de cholo ie amoureus Cl li hi d M de Scudér Dans ce roman en di d d q y b li pli a ga préc ongue neuf sortes d’estimes, douze sortes de sopirs et huit catégories de beauté ). Ce texte, qui a eu un succès énorme, correspond bien l’attent on on porta à h e et à Face à idéalisatio de l’hu ité la éactio ait pas attendre. Dès 1623, Charles S écri Histoire comi ue de Francio où il h ne réali que pour camper des persoges de l’humanité ordinaire. Au contraire, iq un juste qblance de l’hé o me.
Sa vietocrati ue. Ses arents meurent st très eune et est un oncle ecclésiastique ui l’élève avec son frère. Il lui donne une ducation exceptionnelle (lettres, danse, que) et lui p g la suite de son rère. Son œuvre elle parlait l’italien et l’espagnol en plus du rançais) lui ermettent d’ouvrir en 1652 où elle éunit, tous les samis, dans le Marais, des ens de lettres et
Artamène ou le Grand
toutes les célébrités de l’é ue entreiennent des conversations érudites et gaAcadémie française elle a ép ues, 1649du d (16 4-1660) ; elle laissé aussi dix d onversations mora
arrachent dès leur sortie des presses, ar elle peint non seulement des caractères odernes mais aussi des personnages p Cy p utre que le grand Condé (1621-1686). Même si parfois les su ets peuvent être frivoles, ses uvres restent comme un document intessant sur la société française l’é ue où roi Louis XIV était mineur.
Cyrus 1649-1653
Artamène ou G Cy ublié entre 1649 et 1653, est le lus lon de la littérature française : 13 095 es dans l’édition ori inale, ré arties en dix tomes (ou parties), divisés chacun en trois livres
L’historie
L’œuvre Jean François de Tro (v. 1731), Berlin,
Ce roman a do ble conten narrati et de Mandane, et une série d econdaires. L’histoire rinci ale réente les péripéties qui accompagnent a conquête amoureuse d C rus qui ont d’ordre interne les réticences de p externe l’opposition parentale, puis les -
A fine volume: Afinevolume:
chant à séduire, uis retrouver Marie de conquêtes militaires qui ont, elles aussi, objet d un récit détaillé q cents personnages et l’intrigue est très istoire principa cadre et des histoires secondaires o -
-
livre, donc en trois par tome. Ce roman d’envergure n’est pas le résuune entreprise solitaire mais a té conçu et élaboré au sein un salon, énéficiant d’échanges avec le public u moment même tion. el que plusieurs éditions ans les années ccessives et les no
reuses traductions étrangères que l’on onnaît montrent que ce roman n
Le portrait de Cléomire de Scudéry, ARTAMÈNE OU LE GRAND CYRUS Le genre à la mode est celui des portraits. C’est un genre psychologique qui permet aux précieux de décrire les personnes qui fréquentent leur salon, activité qu’ils aiment pardessus tout. M de Scudéry trace dans Artamène ou le Grand Cyrus le portrait de tout son entourage et, dans ce texte en particulier, celui de Catherine Vivonne (1588-1665), actuelle de Rambouillet. Elle était née à Rome, avait épousé le Marquis de Rambouillet et avait ouvert un salon Paris après avoir quitté la cour, grossière à ses yeux.
Cadre des auteurs pivots: gli autor i più importanti, in ordine alf abetico.
La période classique 165
Panorama des littératures européennes: confronto cronologico tra le letterature europee.
Atelier des compétences
- De la communication au texte littéraire
- Études des genres littéraires: guida ai generei lttiliddit letterari con un glossario dedicato.

Du Moyen Âge au XVIIIe siècle
Cadre des auteurs pivots
AUTEURS ŒUVRES ET GENRES TEXTES POUR CONSOLIDER VOS COMPÉTENCES LITTÈRAIRES Chrétien de Troyes vers 1135-1185 de la litt re arth rienne en ncien fran ais, est un des remiers auteurs de chevalerie
du Graal Lancelot u le Chevalier p.
Quelle é p q p 3. Relevez le symbolisme de 4. attitude et les réactions de Lancelot, trouvez-vous qu il y un excès de amour courtois ou bien qu il ne respecte que le code courtois ? p p L Moyen  Pierre Corneille (1606-1684 est un dramaturge et poète qui apr tudes de droit, out en écrivant pour le théâtre, d abord des comédies, puis des ragédies.
alexandrins réguliers et principa Ses personna exceptionnelle et leur volont est capable de dominer les assions; c est un théâtre ui se ropose de susciter admiration du spectateur
p 34 Ci p. Cinn p. 75 p
Exposez le dilemme tragique de Rodrigue et Chimène. Quelles sont les qualités du héros cornélien ? À quoi aspire-t-il ? pg qg Comparez les personna es d Horace, Rodri ue et Cinna. Quels sentiments q 3. Quel accueil ce théâtre p p q p inion p ue, p 17 Denis Diderot 1713-1784 Destiné la vie religieuse, il erd bientôt la foi, m ie de boh me, finit en rison pour ses positions mat rialistes Encyclop
Dans ses œuvres de théâtre, romans, contes, ssais hiloso hi ues, il affronte tous les sujets : moraux, esthétiques, sociaux Il combat toutes les formes d intolérance et p p q g
ncyclopédie p. Lettre sur les aveu les p 292 Jacques le et aît Discours un philosophe p 298 Entretien d’un hiloso he avec la Maréchale d *** La Religieuse p. 3 res, p. 91 Joachim Du Bellay 1522-1560 Sa vie est mar uée à Rome, centre culturel de la Renaissance, où espérait trouver tout ce qu Ce voyag ne lui apportera que ceptions.
Étudiez quelles sont les motivations de l’athéisme de Diderot. our Diderot, dieu n’existe p pour Voltaire ? Et our Rousseau ? elevez la position de chacun à g 3. ur quoi est fondée la lé itimité de la monarchie selon Diderot ? Quelle st la nouveauté de sa ensée oliti ort à Montes uieu et 4. présente de g ouveautés sur les devoirs et les droits du le et du roi dites en uoi p p p p Du Bellay est considéré le maître du sonnet sa oésie, ins iration ersonnelle, semble d’une grande simplicité.
L Olive Les Regrets p. Défense et ill stration de la langue rançaise
L ret de la terre natale comparez Du Bellay (p. 112) et Charles ’Orléans (p. 56) et définissez la diversité du regret. En quoi les deux poésies sont-elles autobiographiques ? 2. L oète exilé est un oète malheureux connaissez-vous d autres textes ù exil même s mbolique devient un thème poétique ? La Renaissance, p
Contenuti digitali integrativi per lo sviluppo della competenza digitale

La Classe inversée







Presentazioni audiovisive delle sezioni di Histoire e Littérature. Linee del tempo in motion graphic, che lo studente segue mentre il testo scorre contemporaneamente alle immag ini.

Poi risponde alle domande di verifica che lo guidano alla comprensione delle informazioni
In più nel Volume 2 10 biografie di grandi autori del XIX e XX secolo raccontate attraverso video con spunti per la riflessione.
Analisi interattive
Victor Hugo (1802-1885)

Sa vie Il nait à Besançon et son père, militaire de carr rière confie éducation de ses trois enfants à sa femme.Victor Hugo vit avec sa mère à Paris, puis à Naples et il rentre à Paris en 1809. La mésentente entre ses parents porte à leur séparation qui fera souffrir le jeune enfant. De 1815 à 1818 il fréquente le ycée Louis le Grand et compose ses premiers poèmes, il écrit e veux être Chateaubriand ou rien En 1819 il fonde avec ses frères une revue Le Conservateur littéraire où il expose ses idées monarchistes et catholiques. En 1822 il épouse Adèle Foucher de laquelle il aura quatre enfants : Léopoldine en 1824, Charles en 1826,
di testi antologizzati di opere artistiche
Mappe visuali interattive
Una mappa per ciascuna epoca (Synthèse visuelle) permette di visualizzare eventi e concetti cardine. Il supporto audio prepara lo studente all’esposizione orale. Il carattere ad alta leggibilità risponde alle esigenze dei diversi stili cognitivi, garantendo una didattica realmente inclusiva. g
Nelle pagine sono inserite le seguenti icone che indicano la presenza e il tipo di contributi digitali integrativi disponibili sul libro.
Audio
Registrazione di tutti i brani antologici, delle attività di verifica e delle mappe
Classe inversée
Linee del tempo di Histoire e Littérature e biografie


Analisi interattive
Brani letterari e opere artistiche

Synthèse visuelle





Mappe interattive di fine capitolo
Trailer cinematografici

Ulteriori brani letterari e approfondimenti
Link a siti
Esercizi interattivi a risposta chiusa
Classe inversée
Cl i
Classe inversée
CAPSULES BIOGRAPHIQUES Regardez la vidéo et répondez aux questions.
arrêté. Il s impose une période d exil volontaire d abord à Bruxelles puis, en 1852, il s installe à Jersey2 où il va vivre à Marine-Terrace et compose des œuvres satiriques contre Napoléon le Petit comme il appelle Napoléon III. En octobre t 1855, l doit quitter Jersey pour Guernesey3 et il y achète une maison, Hauteville-House, d où il peut voir les côtes françaises sur l horizon. Il décide de rentrer en France au début de la guerre de 1870 et en août il est à Bruxelles et puis à Paris, le 5 septembre, le lendemain de la proclamation de la République. Son retour est triste, car la situation politique n est pas bonne : Paris est assiégé, la défaite française est proclamée. Cdétédl’AbléNtililt


I contributi digitali sono fruibili sui siti www.principato.it, www.gruppoeli.it, sull’
e con l’App libRArsi

Le Moyen Âge
4 La poésie de tradition
XVIe siècle
La Renaissance

XVIIe siècle
La période classique

XVIIIe siècle
Le siècle des Lumières
3 Diderot et l’Encyclopédie
Entre passé et présent
Parcours Citoyenneté


Le Moyen Âge
Le Moyen Âge s’étend de la chute de l’empire romain d’Occident (476) jusqu’à la prise de Constantinople par les Turcs (1453). Ces dix siècles sont l’époque des nobles,de l’Église, de la féodalité, mais aussi de l’amour courtois, des héros et de la poésie personnelle. Les institutions sociales et politiques reposent sur le lien de vassal à suzerain et dans les domaines littéraires il s’explique dans le rapport d’amour entre chevalier et dame.
Connaître la période
Connaître la littérature
Dossier 1
La littérature épique
Le protagoniste de cette production est le héros guerrier des chansons de geste, défenseur de sa foi et de sa patrie, fidèle jusqu’à la mort à son roi.
La Chanson de Roland
Dossier 2
Le récit courtois et satirique
Le rapport d’amour entre la dame et le chevalier donne naissance au modèle courtois
Thomas d’Angleterre
• Tristan et Iseut
Chrétien de Troyes
• Perceval ou le conte du Graal
Le Roman de Renart
Dossier 3
La poésie didactique et lyrique
Au XIIe siècle se développent la poésie didactique et la poésie lyrique des trouvères et des troubadours
Guillaume de Lorris
• Le Roman de la Rose
Bernart de Ventadour
• « Quand vois l’alouette mouvoir »
Christine de Pisan

• Rondeaux
Rutebeuf
• La Complainte Rutebeuf
Charles d’Orléans
• Rondeaux
Dossier 4 La poésie de tradition réaliste
s’épanouit une poésie d’inspiration personnelle. François Villon est le plus grand écrivain de cette période.
François Villon
• Le Grand Testament
Dossier 5 Le théâtre médiéval
Le théâtre médiéval a une origine religieuse, mais ce qui survit c ’est le théâtre profane et bourgeois à travers la farce.

La farce de Maître Pathelin
À LA LOUPE…
• La naissance de la langue française
• Le renard, un personnage réussi
• L’amour courtois et la poésie italienne
• La ballade : un genre à forme fixe À LA UNE
• Les troubadours étaient les rappeurs du Moyen Âge ?
• Les pendus, de Villon à De André s À L’ÉCRAN
Le roi Arthur : la légende d’Excalibur
Vers l’ESABAC
DOCUMENT 1
• Une société pyramidale
LIRE LES IMAGES
• Abbaye de Fontenay Basilique de Saint-Denis

• La tapisserie de Bayeux
ESPACE THÉMATIQUE
• Le héros, un mythe qui dure dans les siècles
SUJET ESABAC
• La chevelure
En quoi la puissance de la chevelure couvre le domaine visuel, tactile et esthétique ?
Une longue période de dix siècles


L’époque mérovingienne: du roi Mérovée à Charles Martel

Au Ve siècle les barbares envahissent la Gaule ; la tribu des Francs se fixe dans le nord du pays entre la Belgique et l’Île-de-France actuelle et fonde un royaume qui deviendra la France. C’est le roi Mérovée qui donne son nom à la dynastie, mais le roi le plus célèbre est Clovis (couronné en 481) qui conquiert une bonne partie de la Gaule. Il choisit comme capitale la ville de Paris, se convertit au catholicisme et se fait baptiser à Reims en 496. À sa mort, la puissance des rois diminue au profit des Maires du Palais, des nobles qui exercent la fonction de ministres, et on assiste à une division toujours plus grande du pouvoir. C’est un Maire du Palais, Charles Martel, qui arrête l’invasion arabe à Poitiers en 732 et cette victoire marque la fin de la période mérovingienne. En effet, Pépin III, dit le Bref, fils de Charles Martel, devenu roi en 751, fonde la dynastie des Carolingiens.
Charlemagne et la renaissance carolingienne
Charlemagne (771-814), fils de Pépin le Bref , est sans doute le roi le plus célèbre de l’époque carolingienne. Il agrandit le royaume par ses conquêtes en combattant, entre autres, contre les Hongrois et les Sarrasins (il étend son royaume à toute la Gaule, sauf la Bretagne, à une grande partie de l’Allemagne, à l’Italie longobarde et même à des terr itoires espagnols) et il est couronné empereur en l’an 800, à Rome, par le pape Léon III.



Capable de bien administrer le royaume, Charlemagne divise le territoire en comtés et il crée, aux frontières, des marches (provinces) ; les comtes et les marquis les administrent au nom du roi, ils ont tous
les pouvoirs (civil, militaire, financier et judiciaire). Charlemagne esquisse les bases d’une législation territoriale uniforme : chaque année il soumet à l’approbation de ses vassaux ses ordonnances en latin, divisées en chapitres (d’où le nom capitulaires) et, pour les faire appliquer et pour contrôler les comtes et les marquis, il se sert des missi dominici.




Enfin, on assiste pendant son règne à une renaissance intellectuelle (en effet, on parle de renaissance carolingienne) : les prêtres sont incités à ouvrir des écoles où l’instruction politique, intellectuelle et religieuse se développe (Alcuin ouvre une école, l’École Palatine, dans le palais même de Charlemagne). Après sa mort, l’empire perd de sa puissance et en 843, par le traité de Verdun, on assiste à sa division entre trois descendants de Charlemagne : la Lotharingie (la partie italienne), la France de l’est (l’Allemagne) et la France de

le
L’invasion des Vikings
Au IXe siècle, la France doit f aire f ace aux Vikings venus de Scandinavie qui, dans leur conquête, ravagent les côtes de l’ouest avant de s’établir dans l’actuelle Normandie. Leur installation est officialisée en 911 par le roi carolingien Char les le Simple qui, par le traité de Saint-Clair-sur-Epte, cède la rég ion à un chef scandinave intég ré au monde franc : Rollon. Le duché de Normandie se constitue surtout sous les successeurs de Rollon, et c’est seulement au siècle suivant, sous le règne de Guillaume le Bâtard, surnommé le Conquérant, que le pouvoir ducal est reconnu, non seulement en France mais aussi en Angleterre. En effet, en 1066, la bataille de Hastings contre le roi anglosaxon Harold marque le début de la conquête de l’Angleterre par le duc Guillaume qui devient aussi roi de ce pays.






L’époque capétienne
La dynastie caroling ienne s’éteint en 987 et Hugues Capet est élu roi : c’est le début de la dynastie capétienne. Son territoire ne correspond en réalité qu’à l’Île-de-France, parce que le reste de la France est administré par de grands seigneurs indépendants du roi. Il f aut attendre le XIIe siècle pour que les descendants d’Hugues Capet contrôlent tout le royaume. Les Capétiens renouvellent l’alliance avec l’Église de Rome. C’est à Clermont que le pape Urbain II prêche la première croisade, un pèlerinage armé destiné à reprendre, à Jérusalem, le tombeau de Jésus tombé sous le contrôle des Turcs musulmans. Ce sont surtout des chevaliers francs du nord du royaume qui conquièrent Jérusalem en 1099. Trois rois donnent à la dynastie capétienne un prestige incontesté : Philippe Auguste, Saint Louis, Philippe le Bel.
– Philippe II dit Philippe Auguste (1165-1223)
ôte aux rois d’Angleterre les provinces du nord de la France ;
– Louis IX ou Saint Louis (1242-1270), chrétien fervent, met sa vie au service de la foi, il organise et participe à deux croisades ;

– Philippe IV le Bel (1285-1314) entre en conflit avec le pape Boniface VIII et il fait nommer un pape français à Avignon qui devient le siège de la papauté de 1309 à 1377
Les Valois et la guerre de Cent ans
En 1328, meurt le dernier capétien direct et la couronne passe à Philippe de Valois, neveu du roi Philippe le Bel. Le roi d’Angleterre, fils d’une fille de Philippe le Bel, aspire lui aussi à la couronne de France et ses prétentions vont être une des causes de la guerre de Cent ans. La guerre (1337-1453) subit des phases alternes. Le roi Charles V (13641380) remporte une sér ie de victoires et en 1380 une première phase de la guerre se termine avec la victoire de la France. Le nouveau roi Charles VI est fou et les Anglais essaient de profiter de cette situation, reprenant la conquête du territoire français. Les soldats français sont battus à Azincourt (1415) et le roi d’Angleterre est reconnu comme héritier du royaume de France. Le fils de Charles VI, le futur Charles VII, est faible, sans aucune autorité, mais une jeune fille, Jeanne d’Arc, va réveiller l’honneur des Français et reg rouper une troupe autour du roi. Elle réussit à entrer dans Orléans et à faire sacrer Charles VII à Reims en 1429. Trahie, Jeanne d’Arc est condamnée par
Activités
1. Regardez la vidéo et faites les activités.
2. Observez la frise chronologique aux p. 16-17 et complétez la grille avec les éléments manquants.
481
Charles Martel arrête l’invasion arabe à Poitiers
Pépin le Bref fonde la dynastie carolingienne
les Anglais à être brûlée sur la place du marché à Rouen (1431). Malg ré cela, le mouvement d’enthousiasme qu’elle a fait naître g randit et en 1453 les Anglais sont définitivement repoussés hors de France.
Le nouveau roi Louis XI (1461-1483) assure l’unité du royaume durant son règne ; à sa mort, la féodalité est vaincue et l’unité de la France est faite.
3. En vous référant au paragraphe sur l’époque carolingienne, complétez les informations qui concernent Charlemagne.
Organisation du royaume
Renaissance culturelle
4. Répondez aux questions.
1. Comment Hugues Capet devient-il roi ?
800
Hugues Capet est élu roi
L’unité de la France est faite
2 À qui peut-on attribuer la conquête de Jérusalem en 1099 ?
3. Qu’a fait Philippe Auguste ?
4. Pourquoi la papauté s’établit-elle à Avignon ? Sous quel roi ?
1066
1099
Jeanne d’Arc est brûlée à Rouen
5. Quelles motivations sont à l’origine de la guerre de Cent ans ?
6. Quel est le rôle de Jeanne d’Arc ?
7. Quand l’unité de la France est-elle réalisée ?
Un système hiérarchisé
La vie entre foi et culture
Le système féodal qui s’est installé en Europe depuis l’empire caroling ien de Charlemagne a entraîné une décentralisation du royaume en plusieurs territoires autonomes. Ce modèle a installé durablement une hiérarchisation de la société occidentale : rois, ducs, seigneurs, chevaliers, serfs. Au début de cette période, les villes sont dépeuplées et la vie est concentrée dans les campagnes. La ferveur chrétienne s’est prog ressivement ancrée dans la France du Moyen Âge.
Le développement du commerce contr ibue à l’essor de la bourgeoisie qui prend peu à peu le pouvoir dans les villes.
La vie quotidienne oppose déjà le modèle de la vie rurale et de la vie urbaine. Cette société de type militaire et rigidement réglée accentue les particularismes et f avorise la variété des dialectes. La noblesse va devenir une caste toujours plus fermée et un fossé va se créer entre elle et les bourgeois des villes. La foi est très ardente et les croisades en sont un signe. Les premières avaient un seul objectif, celui de délivrer les lieux saints qu’occupaient les musulmans, mais elles deviendront, par la suite, des expéditions pour des conquêtes matérielles. La culture se développe et, au XIIIe siècle, naissent les premières universités. En 1200, est créée l’Université de Paris et, en 1257, Robert de Sorbon lui ajoute un collège : la Sorbonne est née
Une société réglée
La société médiévale, fondée sur la transmission héréditaire du pouvoir, des titres et de la richesse, présente donc une structure hiérarchique r ig ide. Elle est divisée en trois classes ou ordres :

– ceux qui prient, c’est-à-dire les clercs et les hommes d’Église ; –ceux qui combattent et qui dir igent, les guerr iers (chevaliers et seigneurs) ;
– ceux qui travaillent, les paysans, les artisans et les bourgeois qui habitent le bourg.
Ce monde est très cloisonné. Chacun y est le vassal, le subalterne, de quelqu’un d’autre : le serf est soumis à son seigneur ; l’écuyer, à son chevalier ; le chevalier, à son roi ; l’amant courtois, à sa dame. L’Église elle-même est calquée sur ce modèle.
C’est l’hommage qui lie les hommes entre eux. Il s’ag it d’un contrat qui unit deux personnes
par un serment de protection et de travail (le fort protège le f aible, qui travaille pour lui). En f ait, les deux personnes unies par l’hommage ont des devoirs l’une envers l’autre, elles ont des obligations réciproques. Le vassal doit à son seigneur le service d’ost (l’assistance militaire); le service de conseil (siéger à la cour ou au tr ibunal) ; l’aide aux quatre cas, c’est-à-dire une aide financière spéciale (pour la rançon, l’armement du fils aîné, le mariage de la fille aînée ou le départ pour la croisade).
Le seigneur, quant à lui, doit à son vassal la protection ; l’entretien (c’est-à-dire qu’il lui fournit de quoi vivre, le plus souvent une terre avec des paysans, un fief). Ces serments, bien sûr, ne peuvent pas être rompus, sous peine d’être accusé de félonie. Bien évidemment, le roi est au-dessus de cette organisation sociopolitique, il en est exclu puisqu’il est élu par Dieu.
Activités
1. Répondez aux questions.
1. Qu’est-ce qui a entraîné une hiérarchisation de la société ?
2. Qu’a apporté le développement du commerce ?
3. Quel est l’objectif des croisades ?
4 Qu’est-ce que l’hommage ?
Document 1 Vers l’ESABAC
Une société pyramidale
Interview à Jacques Le Goff (1924-2014), un des plus grands médiévistes français.

Quelle serait donc la juste perception du Moyen Âge?
– Selon moi, le Moyen Âge commence durant l’Antiquité tardive (II Ie-IVe V siècles) et se termine au milieu du XVIIIe siècle avec les débuts de la révolution industrielle.
Cette vision sur quatorze siècles, et non plus sur dix, est un bouleversement !
– Le Moyen Âge européen est né d’une acculturation où se sont lentement confondus les usages gréco-romains et ceux des peuples dits barbares dans le cadre progressif d’une christianisation profonde. C’est une longue période où la paysannerie europ éenne dé f riche les sols et les forêts, occu p ant les paysages avec les moulins à vent et à eau. Aux environs de l’an mille se met en place la société des trois ordres : oratore s , b e ll atore s , l a b oratore s ; ceux qu i p rient, ceux qui se b attent et ceux qui travai ll ent, s oit le clergé, l’aristocratie qui a le privilège des armes, et le peuple qui la b oure la terre. On utilise
Paysans au travail, miniature du manuscrit Queen Mary Psalter (1310-1320), Londres, British Library


avec davantage de doigté le fer. L’artisanat et la musique se développent. Les routes des pèlerinages relient villes et régions. Avec la scolastique, la pensée religieuse concilie foi et raison. Le sens de l a fête est rythmé par le calendrier liturgique. Et les nations, de même que l’ État, se constituent peu à peu dans une diversité riche et contradictoire entre Rome, centre de la chr é tient é , et le Saint-Empire romain germanique. C’est au Moyen Âge qu’est née l’Europe !
Un Moyen Âge qui a connu trois grands moments.. – Il a connu plusieurs phases, surtout trois pics, des moments d’accélération qui sont de vraies avancées : la renaissance carolingienne ( VII I e-IXe siècles) ; la renaissance du XIIe siècle avec l’essor des villes et des universités, la croissance démographique et agricole de l’Occident chrétien, l’âge des cathédrales et celui de la réforme grégorienne de l’Église ; enfin la Renaissance proprement dite, aux XVe V -XVIe siècles, qui serait de fait la dernière des renaissances médiévales, une ultime sous-période d’un long Moyen Âge
Activités
1. Lisez et indiquez si les phrases sont vraies (V) ou fausses (F), puis corrigez les fausses. V F
1. Selon Le Goff, le Moyen Âge finit au XVIIIe siècle.
2. La société des trois ordres se met en place au IXe siècle.
3. Ceux qui prient sont les laboratores.
4. L’Europe est née au Moyen Âge.
5 Au XIIe siècle, on assiste à l’essor des universités
6 Le Moyen Âge n’a pas connu de croissance démographique
Art (XIe-XVe V siècles)
Le style roman et gothique
L’art au Moyen Âge
Au XIe et au XIIe siècle l’ar t roman, caractérisé par les voûtes en berceau, des arcs en plein-cintre, des murs épais et percés de rares fenêtres, se développe. La basilique, peu éclairée, devient le centre de la vie religieuse et les pèlerins et les fidèles, qui ne savent pas lire, sont plongés dans un monde de symboles apparaissant sur les chapiteaux, les moulures et les portails. L’église devient comme un livre.


Le XIIe siècle voit la naissance de l’ar t gothique, que l’on remarque dans l’architecture des cathédrales ; celles-ci s’élancent vers le ciel comme pour tenter de s’approcher de Dieu. On utilise l’arc brisé, l’arc-boutant, des piliers très élevés ; les fenêtres sont placées en haut et décorées de vitraux polychromes. Ce style évoluera à la fin du XIVe siècle ver s le gothique flamboyant, caractérisé par une volonté d’étonner et de surprendre

La tapisserie d’inspiration profane reproduit le monde ar istocratique et nous renseigne sur les vêtements et sur la vie des cours qu’elle représente
Les manuscrits calligraphiés par des clercs sont de véritables œuvres d’art grâce à leurs enluminures nous montrant des scènes de la vie aristocratique, de
la vie des champs, de la chasse, des châteaux et tous les aspects de la vie des hommes de cette époque
C’est une pér iode de croissance, d’instabilité au cours de laquelle naîtra la tradition nationale
Activités
1. Répondez aux questions.
1. Qu’est-ce qui caractérise l’art roman ?
2. Qu’est-ce qui caractérise l’art gothique ?
3 Quelles informations nous donnent les tapisseries ?
4 Que montrent les enluminures des manuscrits ?
Vers l’ESABAC
Abbaye de Fontenay (Bourgogne)
Exemple d’ascétisme et de spiritualité, transposition architecturale des idées de Saint Bernard, l’ancienne Abbaye de Fontenay, fondée en 1118, permet d’imaginer ce qu’était, au XIIe siècle, un monastère cistercien qui vivait en autarcie, à l’intérieur de son enceinte. Elle est classée parmi les monuments du patrimoine mondial de l’Unesco



Les piliers et les contreforts sont des éléments architecturaux qui expriment la robustesse et x la solidité. Les murs épais donnent la sensation que l’église, bien plantée dans le sol, communique force et sécurité.
L’ é g lise romane n’est p as seulement une construction élevée pour la gloire de Dieu, où les fonctions religieuses sont célébrées, mais c’est aussi l’endroit où les gens se réunissent pour discuter des problèmes communs ou pour assister à des représentations sacrées. Le s p e i nture s et surtout les scul p tures i llustrent non seulement des épisodes de la Bible, mais aussi le travail, les expériences de la vie quotidienne, les rêveries et les espoirs de l’homme médiéval
Activités
1. Reliez chaque mot à son synonyme.
1 ascétisme a. rempart
2. enceinte b. colonne

3. pilier c. austérité
2. Lisez et indiquez si les phrases sont vraies (V) ou fausses (F), puis corrigez les fausses.
1. L’Abbaye de Fontenay a V F été fondée en 1118.
2. C’est un monastère cistercien.
3 Au XIIe siècle, le monastère cistercien vivait en autarcie.
4 Les contreforts expriment robustesse et solidité
5 L’église romane est une construction élevée seulement pour la gloire de Dieu.
6. Les sculptures illustrent seulement des épisodes de la Bible
Lire les images
Médiathèque ANALYSE INTERACTIVE Vers l’ESABAC
Basilique de Saint-Denis (Île-de-France)

Premier chef-d’œuvre monumental de l’art gothique et nécropole des rois de France, la b asilique de Saint-Denis est le protot y pe dont se sont inspirés les architectes des cathédrales de la fin du XIIe siècle, notamment ceux de Chartres. Elle abrite une collection de gisants et de tombeaux du XIIe au XIIIe siècle, unique en Europe.

L’église se développe vers des hauteurs incroyables pour une époque qui ne connaît pas le béton armé. C’est une construction faite de lumière, resplendissante comme la Jérusalem décrite dans l’Apocalypse de Saint Jean « semblable à une pierre précieuse, transparente comme le cristal » : c’est ce qu’a voulu faire l’abbé Suger, conseiller du roi de France. L’église gothique ne communique ni la sérénité, ni la sensation de puissance de l’église romane, mais elle exalte et entraîne le fidèle vers un règne mystérieux ; la leçon ne vient plus des chapiteaux mais des grands vitraux.

Activités
3. Reliez chaque mot à son synonyme

1 nécropole a. cimetière
2. prototype b. statue allongée
3 gisant c partie élargie située entre le fût d’une colonne et la charge
4 chapiteau d. modèle
4. Lisez et indiquez si les phrases sont vraies (V) ou fausses (F), puis corrigez les fausses. V F
1. La Basilique de Saint-Denis est une église romane.
2. Elle n’abrite aucun tombeau.
3 L’église gothique ne rejoint jamais de grandes hauteurs.
4 L’église gothique est faite de lumière.
5 Elle communique une sensation de puissance.
6 Elle a de très grands vitraux
5. Répondez aux questions sur les deux églises.
1 Comparez les deux façades et dites quels éléments rendent les deux églises si différentes.
2 Quels éléments de l’église romane et gothique ont pour but l’instruction des fidèles ?
6. Laquelle préférez-vous ? Pourquoi ?
Les origines littéraires






L’écrivain au service de la communauté
L’écrivain du Moyen Âge est intimement lié à la société dans laquelle il vit, c’est elle qui lui donne une existence et il n’est rien sans elle. C’est elle qui assure sa survie car pour un poème récité ou une composition, le jongleur ou le clerc reçoivent du seigneur ou des notables quelques pièces d’argent, un repas ou des vêtements : c’est donc la société qui assure sa survie. Bien évidemment l’écr ivain partage les valeurs, les idéaux, les croyances, les goûts de la communauté, ceux de cette minorité représentée par les seigneurs et les notables pour laquelle il compose et qui détient le pouvoir.
Les chansons de geste



Dès le XIe siècle les chansons de geste racontent les e aventures des chevaliers Le milieu où la chanson est mise en scène est celui de la société féodale de la période avec le respect absolu des engagements féodaux entre seigneur et vassal, avec sa morale chevaleresque et ses qualités guerrières au service de la foi. Le chevalier est fier de ses exploits guerriers et il obéit à un code d’honneur dans lequel toute une r communauté se reconnaît : c’est celui de la fidélité à son seigneur Dossier 1 La littérature épique .
La littérature courtoise
À partir du XIe siècle dans le sud de la France et du XIIe dans le nord, la société féodale ajoute une nouvelle valeur à l’idéal chevaleresque : c’est celui du ser vice d’amour, qui met les préoccupations amoureuses au centre de la vie. La cour imag inaire du roi Arthur, qu’on retrouve dans les romans de la Table ronde, devient le modèle idéal des cours
réelles : non seulement le chevalier est courageux (comme le chevalier des chansons de geste), mais il a aussi le désir de plaire à sa dame Pour ce f aire et pour mériter son amour, il doit essayer et surtout réussir à porter à la perfection les qualités chevaleresques et courtoises qui sont exigées. Cet idéal est bien celui des gens de cour, et c’est de là que vient le mot courtoisie. L’amour, qui dans les chansons de geste n’apparaissait guère, tient ici une place considérable et déterminante et pas seulement comme « mobile » des actions (c’est l’amour qui est à la base de toutes les aventures dans Tristan et Iseut et c’est encore lui qui règle et détermine la vie de Lancelot) Dossier 2 Le récit courtois et satirique


La littérature satirique

La littérature satirique apparaît après le succès des chansons de geste et de la littérature courtoise. Au XIIIe siècle, la société subit des changements ; à cette époque l´économie française est encore agricole et la société est divisée en classes sociales fixes, mais la population a augmenté et elle se déplace de la campagne vers les territoires urbains, elle pratique aussi le commerce et l’artisanat. Dans la ville proprement dite, vit le petit peuple et la bourgeoisie, et c’est dans ces bourgs que naît une littérature satirique et comique. Il s’agit, en général, de cour ts récits très souvent ils parodient les romans courtois ; dans aucun de ces premiers textes satiriques on ne met en discussion l’ordre établi. Les personnages de ce type de littérature ne sont pas des nobles comme dans la littérature précédente, mais ce sont des bourgeois, qui cherchent une littérature où se reflètent leurs défauts et leurs faiblesses. Ce sont eux les personnages de cette littérature qui se moquent de leur propre catégorie sociale, soit pour moraliser, soit pour échapper aux malheurs de la vie quotidienne ; c’est à travers le rire qu’ils le font. On a dans Le Roman de Renar t ou dans les fabliaux les x plus importants exemples de littérature satirique et bourgeoise Dossier 2 Le récit courtois et satirique .


La poésie lyrique et didactique
À l’origine, dès le début du XIIe siècle, dans le sud de la France, la poésie lyr ique est une poésie musicale extrêmement codifiée, et elle est accompagnée par une mélodie. Les premiers poèmes lyr iques sont de vér itables chansons avec souvent des refrains. Les thèmes les plus chantés
Scènes courtoises: paire de valves de miroirScènescourtoises:pairedevalvesdem en ivoire (XIVe V siècle), Paris, Musée du Louvre
sont l’amour pour une dame inaccessible et la souffrance que provoque cet amour. À la fin du XIIe siècle, ce type de lyrisme fait son entrée dans la France du nord, et les chansons en langue d’oïl reprennent la thématique des troubadours souvent sous une forme moins complexe avec un souci croissant de finesse et d’élégance. Si la poésie lyr ique en Languedoc est au départ populaire, la chanson d’amour au nord devient un genre noble par excellence et le service à la dame est une quête de dépassement moral.
La forme la plus ancienne de cette poésie est la chanson de toile (pour charmer les dames occupées à tisser) qui a pour thème les plaintes d’une dame en mal d’amour ; on trouve aussi la chanson à danser (brefs récits en vers) qui a pour thème l’amour, les plaintes d’une femme mal mariée ou le renouveau du printemps.
QUI SONT LES AUTEURS DU MOYEN ÂGE ?

Au Moyen Âge, une œuvre n’est pas le fait du travail d’un auteur unique. Des remaniements successifs sont dus autant aux jongleurs qu’aux copistes ou aux clercs. C’est pour ce motif que les œuvres sont anonymes. Si le jongleur produit le texte devant le public avec des variantes personnelles, si le copiste recopie et remanie le texte et si le clerc agit de la même façon, qui est donc à l’origine de l’œuvre, qui est le créateur ? Il est difficile de savoir si, à cette époque, une œuvre est la rédaction d’une légende, d’un récit populaire ou bien s’il s’agit d’une création individuelle et originale, non populaire mais savante.
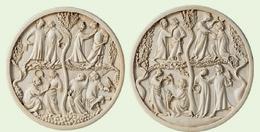
L’esprit bourgeois, au XIIIe siècle, laisse peu de place à l’amour délicat, mais il exprime plutôt la piété, la satire du temps, le lyr isme personnel et réaliste, ou l’humour gai ou amer avec Rutebeuf. Au XIVe siècle, de nouveaux genres lyriques font leur appar ition : les plus utilisés sont la ballade et le rondeau. La thématique courtoise tend à s’épuiser, une nouvelle poésie lyrique est créée par Guillaume de Machaut et poursuivie par Christine de Pisan et de nombreux autres poètes amateurs comme Charles d’Orléans par exemple.
Il n’y a guère d’œuvre littéraire de pur divertissement au Moyen Âge ; l’épopée, le conte et le roman ont tous leur morale. Les auteurs veulent faire partager un savoir ou une croyance. Ainsi, à côté de la poésie d’amour, la poésie didactique fleurit au Moyen Âge et produit des œuvres très diverses, qui ont une vocation morale. Elle se propose de dispenser un savoir, qu’il soit de nature relig ieuse, morale, philosophique, scientifique ou littéraire. Le Roman de la Rose est l’œuvre la plus importante de ce type de littérature ; il s’agit d’une composition allégorique commencée au XIIIe siècle et terminée au siècle suivant : deux parties différentes, code de l’amour courtois dans la première partie, somme des idées morales, sociales et philosophiques dans la seconde Dossier 3 y La poésie didactique et l rique
La poésie d’inspiration personnelle
La poésie de François Villon, en révolte contre la société, l’ordre établi et en général contre toutes les structures r ig ides, se démarque de la poésie de son époque. C’est un grand poète qui f ait revivre la tradition personnelle et réaliste, résume l’âme du Moyen Âge et annonce des temps nouveaux. Ses thèmes lyr iques et personnels sont la piété, la tendresse filiale, la nostalg ie, le remords et surtout la hantise de la mort. Ses qualités sont la simplicité directe, le réalisme et une g rande puissance d’évocation ; Villon se laisse rarement aller à la rhétorique qui caractérise un peu l’époque

Dossier 4 La poésie de tradition réaliste
Le théâtre au Moyen Âge
Le drame liturgique apparaît dans les églises vers l’an 1000. Ce sont de courtes pièces en latin qui sont représentées par des clercs dans le chœur ou la nef de l’église. Les Miracles racontent la vie des saints et les Mystères ont pour sujets des scènes de l’Ancien ou du Nouveau Testament. Le Mystère se joue parfois pendant plusieurs jours, aux grandes fêtes religieuses comme Noël, Pâques ou la Pentecôte. Les textes en latin sont progressi-
vement entrecoupés, farcis (d’où plus tard la farce) de passages en langue populaire et, avec cette évolution, la représentation se déplace et se joue sur le parvis de l’église et des comédiens laïcs remplacent peu à peu les clercs. Au XIIIe siècle apparaît le Jeu, qui se caractérise par l’introduction dans le thème religieux d’anecdotes ou de légendes populaires. Le théâtre, à l’origine simple illustration du culte, devient donc vers le milieu du XIIIe siècle un genre à part entière et la farce s’impose. La plus connue est La Farce de Maître Pathelin, une pièce comique qui présente des situations et des personnages ridicules, et où règnent la tromperie, les équivoques, les ruses et les mystifications. La langue utilisée est très familière, voire grossière parfois Dossier 5 Le théâtre médiéval .
Activités
1. Regardez la vidéo et faites les activités.
2. Répondez aux questions.
1 Que sont les chansons de geste ?
2. Qu’apporte de nouveau la littérature courtoise ?

3 Qu’est-ce qui caractérise la littérature satirique ?
4 Où est née la poésie lyrique ?
5. Quelle est la vocation de la poésie didactique ?
6. Quel est le plus grand représentant de la poésie réaliste ?
7. Quand le théâtre devient-il un genre à part entière ?
La naissance de la langue française
Langue d’oc
La langue d’oc s’est formée à partir d’une évolution du latin q ui é tait p arl é au sud d e l a France So n nom dérive de l’adjectif démonstratif latin hic, hæc, hoc qui signifie cela et que les méridionaux utilisaient pour répondre affirmativement. Elle a gardé des traces des langues parlées en Gaule avant la conquête romaine, qui se sont unies au latin apport é p ar les con q uêtes de Jules Cé sar et à certains termes issus des dialectes g ermaniques. C’est la langue que les troubadours utilisaient, qu’ils appel a i e nt lan g ue provençal e et dans la q uelle ils ont composé leurs œuvres. La langue d’oc s’est diversifiée avec le temps et a donné naissance à de nombreuses variantes : les langues d’oc ou l’occitan qui regroupent le provençal et ses variantes (le gascon, le languedocien, l’auvergnat) et tous les dialectes q ui sont p arlés au sud du territoire français. Ces langues ont survécu jusqu’à nos jours et, grâce à des passionnés de traditions et de redécouvertes du folklore, elles sont encore parlées et une littérature vit encore aujourd’hui. Frédéric Mistral (1830-1914) a composé des œuvres qui ont été aussi transposées à l’opéra et il a obtenu le Prix Nobel de Littérature en 1904 ; Marcel Pagnol (1895-1972) a créé des personnages qui sont devenus des types humains et il a lui-même adapté, pour le cinéma, certains de ses romans qui sont devenus des films cultes, grâce aussi à l’interprétation d’acteurs comme Raimu ou Fernandel ; q uant à Jean Gio n o ( 1895-1970 ) , ses textes ont été marqués par son profond pacifisme et sont devenus des films à succès (Le hussard sur le toit par exemple).
Langue d’oïl
La langue d’oïl est une langue romane, dérivée du latin, qui s’est développée dans la partie nord de l a France, l e sud de l a Be l gique et l es î l es ang l onormandes. Son nom dérive du latin hoc ille, utilisé pour répondre oui. En Gaule, du Ve V au IXe siècle, on parlait le gallo-roman comme l’attestent certains manuscrits, par exemple la glose de Reichenau, vulgate (texte en vulgaire) du VII Ie siècle. En 813, durant le concile de Tours, il est d é cid é que les prêtres doivent faire leurs sermons en langue vernaculaire pour être compris des fidèles. En 843, un traité conclu entre Louis le Germanique et Charles le Chauve, deux des descendants de Charlemagne, est prononcé et écrit en gallo-roman : ce sont les Serments de Strasbourg, premier texte officiel
répertorié. Le choix de la langue a été dicté par la nécessité de se faire comprendre. Il faut attendre la fin du IXe siècle pour avoir le premier texte littéraire, la Cantilène de Sainte Eulalie, et, à côté de quelques fragments, en 1050, la Vie de Saint Alexis est le premier texte important. C’est d’un des dialectes de ces langues que dérive le français. Elles ont combiné la langue des populations celtes avec le latin et le dialecte haut-allemand que parlaient les Francs L’action de ce langage francique (des Francs) a été importante sur la prononciation et sur la forme de certains mots. C’est vers 1125 que le nom ronmanz (langue vulgaire) apparaît pour qualifier cette nouvelle langue, le mot devient romans entre 1130 et 1140 et puis roman à la fin du XIIe siècle. C’est à cette même période qu ’apparaît le mot franceis ou françois Les autres dialectes se sont standardisés et sont des variétés peu différenciées

Comprendre et réfléchir
1. De quoi dérivent les termes langue d’oc et langue d’oïl ?
2. La langue d’oc a-t-elle encore une littérature aujourd’hui ?
3. Quel est le premier texte officiel répertorié d’un dialecte de langue d’oïl ?
4. Quel mot qualifie cette nouvelle langue ? Quand apparaît-il ?
5. Relevez les étapes de la naissance de la langue française.
Dossier 1
La littérature épique
Un genre populaire qui plaît aux seigneurs
Jusqu’à la fin du XIe siècle la littérature en langue vulgaire est pauvre, seulement constituée de textes qui parlent de la vie des saints. À partir de ce moment-là, une importante production épique commence et elle continuera pendant plus ou moins trois siècles. La naissance de cette production a été f avorisée par certains f acteurs :
–le régime féodal a exalté dans l’âme des seigneurs l’amour de la prouesse guerr ière et le sentiment de l’honneur, à travers les liens de vassal à suzerain ;
la première croisade a exalté la foi religieuse et patr iotique, le goût des récits héroïques et des luttes contre les infidèles. On commence à mettre par écr it des chansons de geste (du latin gesta qui signifie actions, exploits guerriers) qui font revivre des personnages du VIIIe ou du IXe siècle
Le point de départ est histor ique, mais les caractères et les f aits sont modifiés et les héros caroling iens ressemblent aux barons du XIIe siècle. Conçues comme une vér itable littérature de propagande appelant à la croisade, elles glorifient les prouesses de la chevaler ie au service de Dieu et du roi L’idéal de la société féodale est bien mis en scène dans ces chansons : respect absolu des engagements féodaux entre suzerain et vassal, morale chevaleresque, qualités guerrières au service de la foi. Le chevalier, toujours fidèle à son seigneur, obéit à un code d’honneur qui méprise la f atigue, la peur, le danger. Il vit pour la guerre, fier de ses exploits guerriers surtout parce que l’Église détourne vers la croisade l’énergie de ces hommes passionnés de combats.
La composition des chansons de geste
Ce sont des poèmes oraux, anonymes, que les jongleurs récitaient en s’accompagnant de la vielle (instrument à cordes et à archet, ancêtre de la viole). Cette oralité a déterminé des caractères précis pour la composition :
– les chansons sont divisées en laisses, des strophes de longueur inégale qui développent une seule idée ou qui racontent un seul fait ;
– le mètre utilisé est en général le décasyllabe ; – des reprises sont effectuées et ont la fonction de résumer ou de rappeler les événements qui se sont produits, de façon à tenir en éveil l’attention des écoutants.
Qui sont les auteurs des chansons de geste ? On a f ait l’hypothèse d’une création collective ; peutêtre les pèlerins qui suivaient les grandes routes de pèlerinage (vers Saint-Jacques-de-Compostelle) et les moines des monastères qui les hébergeaient au passage. Les chansons de geste étaient récitées par un jongleur itinérant qui s’accompagnait d’un instrument de musique, pendant que des saltimbanques mimaient les épisodes racontés. Le public comprenait la foule des pèlerins et les seigneurs féodaux. La Chanson de Roland, la plus ancienne des chansons de geste, remonte au début du XIIe siècle.
Les transformations des textes
À cause de leur succès grandissant, des remaniements ont été effectués et au XIIIe siècle on est passé à une forme écrite, plus complexe : le mètre utilisé est devenu l’alexandrin (vers de douze pieds, dodécasyllabe). Au XIVe siècle, on est passé à une forme en prose. Au XIIIe siècle, les chansons existantes ont été regroupées en trois Gestes ou Cycles :
Geste du roi qui reg roupe les chansons qui ont comme protagoniste Charlemagne ou les seigneurs de sa cour ;
– Geste de Garin de Monglane qui regroupe les chansons qui ont comme protagoniste Guillaume d’Orange et sont situées dans le Languedoc et en Provence ;
– Geste du Doon de Mayence qui regroupe les chansons ayant pour thème les luttes féodales.
Activités
1. Quels éléments ont favorisé la naissance des chansons de geste ?
2. Quelles sont les caractéristiques du code d’honneur ?
3. Comment les chansons sont-elles composées ?
4. Sur quoi les trois Gestes sont-elles centrées ?
Les origines
La Chanson de Roland date, sans doute, du début du XIIe siècle. Elle est connue depuis le début du XIXe siècle grâce au manuscrit d’Oxford qui a été d écrit vers 1070. C’est un poème de 4002 décasyllabes, regroupés en 291 laisses. Il est écrit en dialecte anglo-normand.
L’histoire
À la base de la chanson, il y a un texte historique en latin, la Vita Caroli écrite par Eginhard. L’épisode raconte que l’empereur Charles, qui a 36 ans, franchit les Pyrénées (printemps 778) pour venir en aide à des Arabes en lutte contre d’autres musulmans.
Il soumet Pampelune et assiège Saragosse. Rappelé en France à cause d’une attaque des Saxons et d’un soulèvement, il rase Pampelune et repasse les Pyrénées. En août 778, l’arrière-garde de son armée est massacrée par des montagnards basques, des chrétiens. Parmi les victimes se trouve Roland, comte de la Marche de Bretagne

L’épisode est transformé et embelli, et, dans la Chanson, Charlemagne a 200 ans et Roland est son neveu. L’expédition dure depuis sept ans, l’embuscade des Basques devient une attaque faite par 400 mille Sarrasins. Leur triomphe est dû à la trahison de Ganelon (personnage inventé par l’auteur, comme un autre personnage, Olivier, ami de
Roland). Charlemagne venge son neveu et écrase les Sarrasins, après quoi il punira Ganelon
Le mythe de la Chanson
La Chanson de Roland a été écrite dans une intention mythique qui justifie la présence du surnaturel ; Roland possède une épée magique, baptisée comme si elle était un être humain : son nom est Durendal. Le héros parle à Durendal qui semble le comprendre. Il possède aussi un cor en ivoire, l’Olifant, dont le son arrive à vingt lieues de distance. Roland, devant la mort de toute son arrière-garde, se décide enfin à sonner l’Olifant qui fera revenir Charlemagne. Jusqu’à présent il avait refusé de le faire, craignant de passer pour lâche, mais le moment est arrivé, car l’issue du combat ne fait aucun doute. Les Francs, très inférieurs en nombre, vont être vaincus.
Charlemagne doit être prévenu et pour cela Roland décide de sonner son cor. Il en sonne si fort qu’il rompt une veine de sa tempe, ce qui causera sa mort : du moins aucun Sarrasin ne pourra se vanter de l’avoir tué. L’histoire de Roland est comme celle d’un saint ; à sa mort, deux anges viennent chercher son âme pour la transporter au paradis. Sa mort est accompagnée de prodiges comme la mort du Christ, et Ganelon, le traître, correspond à Judas.
Lorsqu’au XIIe siècle on crée cette épopée, c’est pour glorifier la figure mythique de Charlemagne comme défenseur de la chrétienté, pour exalter l’idéal de la guerre sainte contre les infidèles à l’époque des croisades, pour vanter l’idéal chevaleresque et les liens vassaliques. Les Basques deviennent des Sarrasins et la déf aite franque s’explique par la trahison de Ganelon. Cette épopée, composée avant la première croisade (1095), fait de Charlemagne, en guerre contre les Sarrasins d’Espagne et fondateur du Saint Empire Romain, un précurseur des croisades, et de Roland un héros de la guerre sainte.
Le simple combat du VIIIe siècle devient une véritable croisade contre les Infidèles. Le problème de l’auteur de la Chanson reste entier, car même si un nom est présent à la fin du poème on ne peut savoir qui il est. Le dernier vers de la chanson dit :
ci falt la geste que Turoldus declinet1
Le problème est lié au sens du verbe declinet, qui peut signifier :
– composer (et dans ce cas Turold serait l’auteur de la chanson) ; r
– suivre (le récit et dans ce cas Turold serait le chroniqueur) ;
transcr ire (et dans ce cas Turold serait le copiste) ;
réciter (et dans ce cas Turold serait le jongleur).
Ce qui ressort du texte c’est que c’était un homme cultivé qui connaissait les poètes latins, la Bible et les rituels de prière.
Texte
1
Roland sonne du cor
LA CHANSON DE ROLAND

Médiathèque ANALYSE INTERACTIVE

CXXXIII
[...] Roland a mis l’olifant1 à sa bouche ; L’enfonce bien, sonne avec g rande force. Hauts sont les monts et la voix porte loin À trente lieues2 se répète l’écho.
5 Charles l’entend et tous ses compagnons. Le roi dit : « Nos hommes livrent bataille ! » Répond Ganelon : « Qu’un autre l’eût dit, Ces paroles sembleraient g rand mensonges ».
CXXXIV
Roland, à g rand-peine et à g rand effort,

10 À grande douleur, sonne l’olif ant Et de sa r bouche jaillit le sang clai , Et de son crâne la tempe se rompt Du r cor qu’il tient, le son porte fort loin : Charles l’entend, lui qui passe les ports3 .
15 Naimes l’entend avec tous les Français. Le roi dit : « J’entends le r cor de Roland. N’en sonnerait, s’il ne livrait bataille. »
Répond Ganelon : « De bataille, point ! Vous êtes vieux, tout fleuri et tout blanc :
20 Par vos paroles semblez un enfant.
Vous savez le g rand orgueil de Roland :
C’est merveille que Dieu le souffre encore... Pour un seul lièvre, il va sonnant du r cor ; Devant ses pairs doit encor s’amuser... »
CXXXV
25 Comte Roland à la bouche sanglante
De son crâne la tempe s’est rompue
Sonne l’olif ant à g rande douleur
Charles l’entend et ses Français l’entendent
Le roi dit : « Ce r cor a bien longue haleine ! »
2 Unité de mesure.
3 Passage qui permet de traverser les montagnes.
4 C’est l’impératif du verbe oïr qui signifie entendre, donc entendez
5 Cotte de maille, partie de la cuirasse qui protège le corps.

6 Protection de la tête.
30
Répond Naimes : « Un baron y prend peine !
C’est bien une bataille, j’en suis sûr.
L’a trahi, qui vous en veut détourner.
Armez-vous et criez le ralliement
Et secourez votre noble maison :
35 Assez oyez4 que Roland se lamente ! »
CXXXVI
L’empereur sitôt fait sonner ses cors
Les Français mettent pied à terre et s’arment
De hauber ts5 , heaumes6 , épées ornées d’or.
EUROPASS © Casa Editrice G. Principato
Comprendre
Ont des écus, de g rands et forts épieux7 , 40 Des gonf anons8 blancs et vermeils et bleus. Tous les barons montent leurs destr iers. Éperonnent au long des défilés.
D’eux tous, pas un seul qui ne dise à l’autre : « Si nous voyions Roland encore vivant, 45 Avec lui nous donner ions de grands coups. »
Mais à quoi bon ? Ils ont trop attendu.
1. Définissez le décor de la scène. Le paysage, dans cette situation tragique, a-t-il un rôle important ?
2. Pour se faire entendre, quels obstacles Roland doit-il surmonter ?
3. Quel est l’effet de l’effort de Roland ?
4. Faites le portrait de Ganelon et commentez ses deux interventions. Est-ce qu’il respecte l’empereur ?
5. Que dit-il de Roland ?
Analyser
6. Décrivez les préparatifs pour aller aider Roland. Quel changement de ton intervient dans la dernière strophe ?
7. Pourquoi ce récit a-t-il les caractéristiques d’un registre épique ?
8. Que signifie la répétition du mot olifant/cor, mise en évidence par la couleur rose ? Et celle mise en évidence par la couleur bleue ?
9. Qu’apportent les répétitions, liées au sang, mises en évidence par la couleur jaune ?
La mort de Roland
LA CHANSON DE ROLAND

Après avoir en vain tenté de briser son épée pour qu'elle ne tombe pas entre les mains de ses ennemis, Roland se prépare à mourir en chrétien. Il prie. C'est dans cette description des derniers moments de Roland que l'association entre la foi et le courage du héros, une des caractéristiques de toute l’œuvre, est la plus évidente.
CLXXIV
Roland sent que la mort le prend. De la tête au cœur elle descend : En courant il est allé sous un pin Sur l’herbe verte il s’est couché f ace contre terre
5 Sous lui il met son épée et son olif ant
Il a tourné la tête du côté des païens :
Il l’a fait parce qu’il veut vraiment
Que Charles dise, ainsi que tous les siens, Que le noble comte, il est mort en conquérant.
10 Il bat sa coulpe1 à plusieurs repr ises. Pour ses péchés il offre à Dieu son gant.
CLXXV
1 Exprime son repentir.
Roland sent que son temps est fini. Face à l’Espagne il est sur un mont à pic : D’une main il s’est frappé la poitrine :
2 Le héros appartient à une famille, à un lignage dont il doit continuer à illustrer la renommée et la gloire.
3 Il veut se soucier du salut de son âme.
4 Saint Michel Archange est honoré au Mont-Saint-Michel en Normandie sous le nom de Saint Michel du Péril de la Mer
Comprendre Analyser
15 « Dieu, je me repens, devant tes g randes vertus, De mes péchés, g rands et petits, Que j’ai f aits depuis l’heure de ma naissance Jusqu’à ce jour que je suis ici venu à ma mort ! »
Il a tendu vers Dieu son gant droit ;
20 Des anges du ciel descendent à lui
CLXXVI
Le comte Roland est étendu sous un pin, Vers l’Espagne il a tourné son visage. Il s’est pr is à se rappeler bien des choses : Tant de terres qu’il a conquises par sa prouesse,
25 Douce France, les hommes de son lignage2 , Charlemagne, son seigneur, qui l’a élevé ; Il ne peut s’empêcher d’en pleurer et d’en soupirer, Mais il ne veut pas s’oublier lui-même3 ; Il bat sa coulpe, il demande à Dieu merci :
30 « Vrai Père qui jamais ne mentis, Toi qui ressuscitas saint Lazare de la mor t Et préservas Daniel des lions, Préserve mon âme de tous les périls
Causés par les péchés que je fis en ma vie ! »
35 Il offrit à Dieu son gant droit ; Saint Gabr iel l’a pr is de sa main. Sur son bras il tenait sa tête inclinée, Les mains jointes il est allé à sa fin
Dieu lui a envoyé son ange Chérubin,
40 Et saint Michel du Péril de la Mer4 , Avec eux y est venu saint Gabriel ; Ils emportent l’âme du comte en paradis
1. Combien de personnages interviennent dans cette scène ?
2. Quelle est l’idée dominante dans les trois laisses ?
3. Relevez le système de répétitions d’une laisse à l’autre : trouvez-vous que ces enchaînements par répétitions et assonances facilitent la mémoire du jongleur, la déclamation et l’attention du public ? Pourquoi ? Quel est l’effet produit ?
4. La mise en scène : relevez toutes les indications concernant le cadre et le décor de la scène, la position du corps, de l’épée et du cor. Remplissez la grille.
Cadre et décor Position du corps Position de l’épée et du cor
5. Relevez aussi le type de verbes utilisés et dites quel est l’effet produit. Roland meurt vaincu ou maître du champ de bataille ? L’honneur de la France est-il sauf ?
Réfléchir
6. Roland meurt : a-t-il commis un péché d’orgueil en sonnant si tard son cor, ou n’avait-il pas d’autre choix ?
7. Quels sont les thèmes principaux du monologue intérieur de Roland ? Pourquoi se souvient-il de ses conquêtes ? Y voyez-vous un signe d’orgueil ? Quelle est l’importance accordée au lignage ?
8. Comment expliquer le vers 35 Il offrit à Dieu son gant droit ? La religion de Roland a-t-elle t une dimension féodale ?
Écrire
9. Résumez les détails fondamentaux de la mort héroïque de Roland.
La tapisserie de Bayeux
68,30 MÈTRES DE HISTOIRE
C’est une broderie sur toile, faite à l’aiguille avec des laines de 4 couleurs dans 8 tonalités différentes. Elle a été commandée par Odon de Conteville, évêque de Bayeux, demi-frère de Guillaume le Conquérant, et elle devait justifier l’expédition de Guillaume de l’autre côté de la Manche ; elle avait aussi un but religieux. En effet, l’Anglais Harold aurait violé le serment, prêté sur de saintes reliques, de laisser le trône d’Angleterre à Guillaume après la mort d’Édouard le Confesseur. Le parjure commis entraînait les pires conséquences pour le coupable et les siens, et Harold aurait été puni par le Ciel. En réalité, il est tué en combattant pendant la bataille d’Hastings, le 14 octobre 1066.




Un banquet est organisé et les cuisiniers préparent le repas, la troupe mange sur les boucliers retournés et les chefs sont assis à une table.
La tapisserie de Bayeux est une pièce de toile brodée qui raconte une série d’événements qui se sont déroulés de 1064 à 1066 et ont conduit à la conquête de l’Angleterre par le duc de Normandie Guillaume le Conquérant. Cette tapisserie mesure 68,30 mètres de longueur et 50 cm de hauteur et a été réalisée moins de 10 ans après la bataille d’Hastings ; elle se trouve aujourd’hui dans le « Musée de la Tapisserie » à Bayeux

La tapisserie de Bayeux est très riche et comprend 72 scènes composées
Activités
de 626 personnages, 202 chevaux et mulets, 55 chiens, 505 créatures mythologiques (oiseaux et dragons), 37 édifices, 41 vaisseaux et barques, 49 arbres et environ 2000 mots en latin. Ses bordures représentent de nombreux animaux réels ou imaginaires. La partie inférieure montre souvent les appétits et instincts bestiaux présents dans chaque homme, alors que la partie supérieure fait référence à leurs idéaux et à leur élan vers Dieu.
La tapisserie est le témoignage de faits historiques dont il ne reste que
1. Quels aliments et quels objets reconnaissez-vous sur la table ?
2. Quelle est la position du serviteur devant les convives ?
3. Les convives portent-ils des armes ? Pourquoi d’après vous ?
4. Un homme sur la gauche de la tapisserie a un objet à la bouche. Que pourrait être cet objet d’après vous ?
peu de traces. Elle est ainsi inestimable quant à la connaissance de la vie de l’époque, car elle nous renseigne sur :
l’organisation sociale de la société médiévale ;
les formes de pouvoir ; – les modes de vie des seigneurs et des paysans ;
les équipements de guerre, les vêtements des soldats, les signes distinctifs sur leurs boucliers Certains voient en elle, dans sa présentation sous forme d’images, un précurseur de la bande dessinée.
5. Quels animaux sont représentés dans la frise au bas de la tapisserie ?
6. Quels animaux sont représentés dans la partie supérieure de la tapisserie ?
7. Cette image de la tapisserie vous a-t-elle apporté d’autres connaissances sur le Moyen Âge ? Si oui, gp pp que vous a-t-elle appris ? Si non, que vous a-t-elle confirmé ?
Le héros Un mythe qui dure dans les siècles
Le Moyen Âge a exalté la première figure du héros : viril, guerrier, grand, fort mais pas invulnérable, protégé des dieux (Roland), supérieur à tous ses rivaux (les Sarrasins), capable d’affronter des dangers multiples, souvent écrasé par les forces de la fatalité et pour cela destiné à la mort, à une fin tragique. Dans la littérature d’inspiration courtoise, on trouve encore des héros guerriers, mais aussi courtois : le preux chevalier doit posséder la noblesse du cœur, la franchise; il est soucieux d’armes et d’amour. Dans la littérature de la Renaissance il y a des tentatives d’épopée pas toujours réussies, qui attestent le goût persistant pour l’héroïsme chevaleresque, mais la magnificence du héros revient avec le Grand siècle classique. L’éclipse de la littérature héroïque arrive avec le siècle des Lumières qui cesse d’admirer les prouesses guerrières. La figure du héros traditionnel revient au XIXe siècle avec les romantiques (Chateaubriand, Hugo), qui exaltent la figure légendaire de Napoléon Ier et imposent en même temps un nouveau type de héros : l’artiste, le créateur, le poète, un héros sans armes. Du XIXe au XXe siècle la figure de
Horace (1640)
Toute l’œuvre dramatique de Corneille est inspirée par une intense rêverie d’héroïsme. Le héros cornélien n’est pas simplement un homme, puisque c’est un héros. Ce n’est ni l’homme tel qu’il est, ni l’homme tel qu’il devrait être, c’est l’homme tel qu’il se rêve dans ses moments d’exaltation Dans Horace, les portraits que trace Corneille sont antithétiques, puisque le tragédien oppose les thèmes de la générosité et de l’humanité à travers les personnages d’Horace et de Curiace.
Pierre Corneille p. 171
Jeanne d’Arc retrouve la pleine lumière qu’elle avait eue de son vivant et son héroïsme devient sainteté. Elle est le symbole de la pureté, de l’innocence, c’est une sainte, une jeune fille pure et droite, au milieu d’un monde corrompu. Au XXe siècle on assiste aussi à un retour des mythes antiques et des héros classiques. Réactualisés, les mythes deviennent un moyen de déchiffrer le monde contemporain. Le XXe siècle est, plus encore que son précédent, un siècle de héros, non seulement parce que des écrivains exaltent la grandeur humaine, mais aussi parce que le cinéma est né : films d’aventure, de guerre et d’adaptations d’œuvres épiques
Horace, le héros accompli

Pierre Corneille, HORACE, ACTE II, SCÈNE 3
Dans cette scène, Curiace qui félicitait Horace d’avoir été choisi comme champion par Rome, vient d’apprendre qu’il était lui-même désigné pour l’affronter au nom d’Albe. Horace voit dans ce choix la grandeur, tandis que Curiace y voit l’horreur de la situation.
CURIACE
Il est vrai que nos noms ne sauraient plus périr, L’occasion est belle, il nous la faut chérir. Nous serons les miroir s d’une ver tu bien rare : Mais votre fermeté tient un peu du barbare.
5 Peu, même des grands cœurs, tireraient vanité
D’aller par ce chemin à l’immortalité :

À quelque prix qu’on mette une telle fumée1
L’obscurité vaut mieux que tant de renommée. Pour moi, je l’ose dire et vous l’avez pu voir, 10 Je n’ai point consulté2 pour suivre mon devoir ;
Notre longue amitié, l’amour, ni l’alliance, N’ont pu mettre un moment mon espr it en balance ; Et puisque par ce choix Albe montre en effet Qu’elle m’estime autant que Rome vous a f ait, 15 Je crois f aire pour elle autant que vous pour Rome ;
J’ai le cœur aussi bon, mais enfin je suis homme : Je voix que votre honneur demande tout mon sang, Que tout le mien consiste à vous percer le flanc ;
Près d’épouser la sœur, qu’il f aut tuer le frère, 20 Et que pour mon pays j’ai le sort si contraire.
Encor qu’à mon devoir je coure sans terreur, Mon cœur s’en eff arouche, et j’en frémis d’horreur ;
J’ai pitié de moi-même, et jette un œil d’envie Sur ceux dont notre guerre a consumé la vie, 25 Sans souhait toutefois de pouvoir reculer.
Ce triste et fier honneur m’émeut sans m’ébranler :
J’aime ce qu’il me donne, et je plains ce qu’il m’ôte ; Et si Rome demande une vertu plus haute, Je rends grâces aux dieux de n’être pas Romain, 30 Pour conserver encor quelque chose d’humain.
HORACE
Si vous n’êtes Romain, soyez digne de l’être ; Et si vous m’égalez, faites-le mieux paraître.
La solide vertu dont je fais vanité
N’admet point de faiblesse avec sa fermeté ;
35 Et c’est mal de l’honneur entrer dans la carrière
Que dès le premier pas regarder en arrière.
Notre malheur est g rand, il est au plus haut point ;
Je l’envisage entier, mais je n’en frémis point : Contre qui que ce soit que mon pays m’emploie,
40
J’accepte aveuglément cette gloire avec joie ; Celle de recevoir de tels commandements
Doit étouffer en nous tous autres sentiments.
Qui, près de le servir, considère autre chose, À faire ce qu’il doit lâchement se dispose ;
45 Ce droit saint et sacré rompt tout autre lien. Rome a choisi mon bras, je n’examine rien. Avec une allég resse aussi pleine et sincère Que j’épousai la sœur, je combattrai le frère ; Et, pour trancher enfin ces discours superflus, 50 Albe vous a nommé, je ne vous connais plus.
CURIACE
Je vous connais encore, et c’est ce qui me tue
Comprendre et réfléchir
1. Quels sont les sentiments de Curiace ?
2. À quoi Curiace réduit-il l’honneur et la gloire ? Est-ce que la gloire vaut un tel sacrifice ?
3. Horace, le héros accompli : quelle définition donne-t-il de la vertu et de l’héroïsme qui le sépare de Curiace ?


4. Curiace et Horace : deux héros, deux discours parallèles : qu’est-ce qui les oppose et les désunit ?

Texte 2
L’œuvre
Chatterton (1835)
Il s’agit d’un drame romantique en trois actes écrit par Alfred de Vigny. Dans Chatterton, il met en scène les diff ficultés et les tourments du poète qui ne parvient pas à trouver sa place dans une société matérialiste : pour cela, il s’inspire de l’histoire vraie du célèbre poète anglais Thomas Chatterton, qui a mis fin à ses jours à l’âge de 17 ans.
Chatterton, un héros romantique
Alfred De Vigny, CHATTERTON, ACTE III, SCÈNE 7
Dans la scène finale proposée, Chatterton a pris congé de ses hôtes et du lord-maire, venu lui offrir un emploi de valet, et se retire dans sa chambre dans l’intention de se tuer.
Allez, mes bons amis. – Il est bien étonnant que ma destinée change ainsi tout à coup. J’ai peine à m’y fier ; pourtant les apparences y sont. –Je tiens là ma fortune. – Qu’a voulu dire cet homme1 en parlant de mes r uses2 ? Ah ! toujours ce qu’ils disent tous. Ils ont deviné ce que je leur avouais moi-même, que je suis l’auteur de mon livre. Finesse grossière ! je les reconnais là ! Que sera cette place ? quelque emploi de commis ? Tant mieux, cela est honorable ! Je pourrai vivre sans écrire les choses communes qui font vivre. – Le quaker rentrera dans la paix de son âme

que j’ai troublée, et elle ! Kitty Bell, je ne la tuerai pas, s’il est vrai que je l’eusse tuée. – Dois-je le croire ? J’en doute : ce que l’on renferme toujours ainsi est peu violent ; et, pour être si aimante, son âme est bien maternelle. N’importe, cela vaut mieux, et je ne la verrai plus. C’est convenu... autant eût valu me tuer. Un corps est aisé à cacher. – On ne le lui eût pas dit. Le quaker y eût veillé, il pense à tout. Et à présent, pourquoi vivre ? pour qui ?... – Pour qu’elle vive, c’est assez... Allons... arrêtez-vous, idées noires, ne revenez pas... Lisons ceci... (Il lit le journal.) « Chatterton n’est pas l’auteur de ses œuvres... Voilà qui est bien prouvé. – Ces poèmes admirables sont réellement d’un moine nommé Rowley, qui les avait traduits d’un autre moine du dixième siècle, nommé Turgot... Cette imposture, pardonnable à un écolier, serait criminelle plus tard... Signé... Bale3. Bale ? Qu’est-ce que cela ? Que lui ai-je fait ? –De quel égout sort ce serpent ?
1 Lord Beckford, ami du père de Chatterton.
2 On accuse Chatterton d’avoir donné comme étant de lui des poésies qui sont l’œuvre d’un auteur du Moyen Âge
3 Un critique littéraire hostile à Chatterton.
Quoi ! mon nom est étouffé ! ma gloire éteinte ! mon honneur perdu ! – Voilà le juge !... le bienfaiteur ! Voyons, qu’offre-t-il ? (Il décachète la lettre, lit... et s’écr ie avec indignation.) Une place de premier valet de chambre dans sa maison !... Ah ! pays damné ! terre du dédain ! sois maudite à jamais ! (Prenant la fiole d’opium.) O mon âme, je t’avais vendue ! je te rachète avec ceci. (Il boit l’opium.) – Adieu, humiliations, haines, sarcasmes, travaux dégradants, incertitudes, angoisses, misères, tortures du cœur, adieu ! Oh ! quel bonheur, je vous dis adieu ! – Si l’on savait ! si l’on savait ce bonheur que j’ai... on n’hésiterait pas si longtemps ! (Ici, après un instant de recueillement durant lequel son visage prend une expression de béatitude, il joint les mains et poursuit.) Ô Mort, ange de délivrance, que ta paix est douce ! j’avais bien raison de t’adorer, mais je n’avais pas la force de te conquérir. – Je sais que tes pas seront lents et sûrs. Regarde-moi, ange sévère, leur ôter à tous la trace de mes pas sur la terre. (Il jette au feu tous ses papiers.) Allez, nobles pensées écrites pour tous ces ingrats dédaigneux, purifiez-vous dans la flamme et remontez au ciel avec moi ! [...]
Comprendre et réfléchir

1. Le monologue de Chatterton : relevez les différents états d’âme du personnage, de l’espoir au désespoir, à l’indignation, au geste final.
2. Les invectives : contre qui et contre quoi sont-elles adressées? Que souligne le jugement sévère porté sur l’Angleterre ?
3. Ce héros romantique est voué à la solitude et à l’incompréhension, à une position d’exclu et de renoncement. Voyez-vous les différences avec le héros cornélien ?
Vers l’EXAMEN

4. À partir des textes proposés (voir aussi Médiathèque), décrivez le mythe du héros en 150 mots maximum.
Médiathèque
André Malraux
• Kyo le héros positif
Réalisateur GUY RITCHIE
Année 2017
Genre FANTASTIQUE
Acteurs principaux CHARLIE HUNNAM, JUDE LAW, KATIE MCGRATH

Le roi Arthur : la légende d’Excalibur (2017)

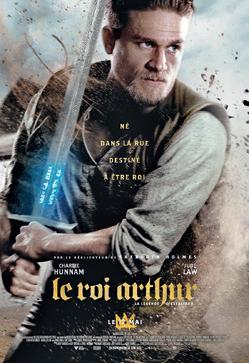
Ce film est un film fantastique d’action et d’aventure réalisé par Guy Ritchie. Le film, basé sur de nombreuses anecdotes, est sorti en 2017 et a eu un bon succès.
L’histoire racontée est celle d’Arthur, un jeune homme qui vit avec sa bande dans les faubourgs de Londres (Londonium). Un jour il s ’em p are d’une é p ée, Excalibur, s ans savoir q u’il vient de saisir, avec elle, son destin et son avenir. À partir de ce moment-là sa vie bascule et il doit faire des choix pas toujours faciles. Il rencontre
u ne jeune femme, Guenièvre, s’unit à la Résistance et doit apprendre à contrôler l’épée et tous ses démons intérieurs. Il va unir le peuple autour de sa personne pour chasser le tyran, Vortigern, qui avait usurpé sa couronne après avoir tué ses parents. Il accèdera finalement au trône
Analyser l’affiche
1. Observez et décrivez l’affiche.
2. Quelles informations donne-t-elle ?
Visionner la bande annonce
3. Comment commence-t-elle ?
4. Que présentent les images ?
5. Quel autre élément est inséré ?
6. Que se passe-t-il quand Arthur retire l’épée ?

7. Que disent les deux phrases?
8. Quelle est la particularité de cette bande annonce ?
Rédiger un article
9. Écrivez un article qui résume votre travail d’analyse.
Le récit courtois et satirique
La littérature courtoise
Vers la seconde moitié du XIIe siècle, l’ar istocratie, qui devient une classe de plus en plus fermée, se tourne vers des œuvres moins rudes que les chansons de geste Cette littérature de la cour est liée à r trois influences : l’influence antique, bretonne et mér idionale.
L’influence antique On assiste à un renouveau de la littérature latine et les « romans antiques » sont à la mode. Ces œuvres adaptent au goût du jour des légendes antiques (Roman d’Alexandre en vers de 12 pieds, d’où le terme alexandr in pour qualifier ce n vers). Transition entre l’épopée et le roman courtois, on y retrouve des batailles, des exploits chevaleresques, mais aussi des aventures romanesques et l e merve ill eux mé di éva l ( é l éments ou évén ements surnaturels, objets magiques et créatures en tout genre), l’amour et les analyses des sentiments comme dans les romans.
L’influence bretonne En 1155, Wace traduit très librement une Histor ia regum Br itanniae (Histoire des rois de Bretagne) et écrit le Roman de Brut. Il révèle la légende du roi Ar thur, un roi puissant et raffiné, qui vit dans une cour luxueuse, entouré par les Chevaliers de la Table Ronde. Cette « matière de Bretagne » va donner au roman courtois ses héros, le cadre de leurs aventures, les détails romanesques et féériques, comme dans Tr istan et Iseut
L’influence méridionale Le Midi de la France connaît une civilisation p lus ra ff inée et les se ig neurs d u su d sont h a bi tués à une v i e pl us d ouce, il s s ’ entourent d e poètes et d’ art i stes et accordent une place plus importante à la dame. Cette influence méridionale s’est diffusée grâce à Aliénor d’Aquitaine D’abord reine de France comme é p ouse de Louis VII, p uis reine d’Angleterre, après l’annulation du mar iage, comme femme de Henri Planta g enêt, roi Henri II en 1154, elle aimait les artistes et s’entourait d’une cour raffinée qui l’aurait suivie dans ses déplacements. Cette influence se serait encore plus répan-
due sous l’impulsion de ses deux filles Aélis de Blois et surtout Marie, comtesse de Champagne.
La courtoisie
Un nouvel idéal, la cour toisie, pensé pour séduire l’élément féminin, contribue à l’adoucissement des mœurs et suit des règles bien précises :
le service d’amour dicte au chevalier ses r exploits qui obéissent à la soumission absolue à sa dame et pas à Dieu ou à son suzerain comme dans les chansons ;
– ce service d’amour a des règles artificielles et charmantes : le chevalier recherche la perfection et la Dame le soumet à toutes sortes d’épreuves ; il doit savoir aimer et souffrir en silence, avec discrétion et patience et, seulement quand il aura satisfait tous les caprices de sa dame, il sera récompensé de sa constance, ennobli et payé de retour, comme dans l’œuvre de Chrétien de Troyes.
La littérature satirique
À partir du XIIe siècle, alors que la société aristocratique écoute les chansons de geste ou les romans courtois, les bourgeois sortent de leur condition misérable. Cette transformation sociale va avoir des répercussions dans la littérature. Ce nouveau public, les bourgeois enrichis capables de bien rétribuer les auteurs aiment la satire, la raillerie, le dénigrement, la gaité populaire, le cynisme. Ces thèmes entrent dans les œuvres et vont inspirer toute une partie de la littérature. C’est cet esprit bourgeois, celui du peuple, des bourgs et des villes, qui va produire des œuvres satiriques et irrévérencieuses qui sont comme une revanche des humbles et des faibles contre la société des nobles et des puissants (Le Roman de Renart).
Activités
1. Quelles sont les influences littéraires liées à la littérature courtoise ?
2. Quelles sont les règles de la courtoisie ?
3. Pourquoi la littérature satirique se développe-t-elle ?
Tristan et Iseut (env. 1172)
Ses origines
Cette légende celtique (matière de Bretagne) a connu une diffusion dans toute l’Europe. Nous n ’ en avons pas une transcription complète, mais des fragments que Joseph Bédier (professeur et philologue français, 1864-1938) a reconstitués, recomposant Le roman de Tristan et Iseut Au milieu du XIIe siècle deux auteurs, Thomas d’Angleterre et Béroul, ont écrit chacun un Tristan d’inspiration très différente. Le roman de Béroul s’adresse à un auditoire plus populaire, celui de Thomas plutôt à un public cultivé car il a vécu à la cour d’Aliénor d’Aquitaine. Ce conte d’amour et de mort peint une passion qui contrevient aux lois de l’homme chevaleresque, parce que certaines valeurs courtoises sont présentes dans le poème.
La légende d’un thème
preuve de courage, il meurt d’une blessure reçue dans un combat, mais sa légende se déroule dans le monde de la cour et l’amour de Tristan est celui d’un chevalier courtois, fidèle à Iseut la Blonde jusqu’à la mort.
Le cadre même dans lequel cet amour est vécu répond à la définition du genre courtois : l’amour adultère, la soumission du chevalier à sa dame, mais la fin’amor est un acte de raison, une rela rtion amoureuse dans laquelle on choisit d’aimer l’autre pour ses qualités, alors que Tristan et Iseut n’ont pas choisi de s’aimer, ils sont victimes du philtre, de la fatalité.
L’œuvre
Comme
Roland, Tristan est, tout au long de sa vie, un brave chevalier au service d’un suzerain, il fait
L’amour courtois doit rester secret. Ce n’est pas le cas de Tristan et Iseut : Tristan doit abandonner la cour, les deux amants sont déchirés entre cet amour interdit, mais impossible à oublier, et leurs engagements envers Marc, suzerain de Tristan et mari d’Iseut. Le thème de Tristan et Iseut a été repris par Wagner en 1859 dans son Tristan et Isolde
Le prince Tristan est élevé par son oncle, le roi Marc de Cornouaille, qui fait de lui un chevalier parfait. Tristan va chercher en Irlande la princesse Iseut la Blonde, future épouse de son oncle. Sur le bateau du retour, Tristan et Iseut boivent par erreur le philtre d’amour destiné à Iseut et au roi Marc. Ce philtre les unit d’un amour contre lequel la volonté ne peut rien. De retour à la cour du roi Marc, Tristan et Iseut continuent de vivre leur passion. Accusés d’adultère, les amants sont condamnés à être brûlés. Échappés miraculeusement à leurs gardiens, ils se cachent dans la forêt, toujours en fuite, ils acceptent enfin de se séparer. Tristan se rend en Bretagne chez le duc Hoël, accomplit des gestes mémorables et, pour le récompenser, Kaherdin, fils du duc, lui offre la main de sa sœur, Iseut aux Blanches Mains. Tristan ne peut refuser sans offenser son hôte, mais il ne consomme pas son mariage. Iseut aux Blanches Mains cherche à se venger de cet affront. Blessé par une arme empoisonnée, Tristan ne peut être guéri que par Iseut la Blonde. Il envoie Kaherdin la chercher pour la revoir une dernière fois. La réussite de sa démarche sera annoncée en hissant sur le vaisseau une voile blanche, au contraire une voile noire sera un signe d’échec. Iseut aux Blanches Mains aperçoit la voile blanche, mais pour se venger de Tristan elle lui dira qu’elle est noire. Tristan, désespéré, meurt. Iseut, retardée par une tempête, arrive trop tard et meurt de douleur sur le corps de son amant.


Comprendre
La mort de Tristan
Thomas d’Angleterre, TRISTAN ET ISEUT
C’est la scène finale : Tristan, blessé, attend la venue d’Iseut la Blonde qui seule peut le sauver. Iseut aux Blanches Mains, jalouse, lui annonce que la voile du navire est noire.
Tristan est triste et épuisé. Souvent il se plaint, souvent il soupire Pour Iseut qu’il désire tant revoir. Ses yeux pleurent, son corps se tord
5 Pour peu il mourrait de désir Dans cette angoisse, dans ce chagr in, Sa femme Iseut vient près de lui.
Ayant conçu une perfide ruse, Elle dit: « Ami, Kaherdin arr ive:
10 J’ai vu son vaisseau sur la mer Je l’ai vu faire voile à g rand-peine : Cependant j’ai si bien vu son vaisseau Que pour le sien je l’ai reconnu Dieu f asse qu’il apporte une nouvelle telle
15 Que votre cœur y trouve réconfort ! »
Tristan tressaille à cette nouvelle.
Il dit à Iseut : « Belle amie, Savez-vous en vérité que c’est son vaisseau ?
Dites-moi donc quelle est la voile ? »
20 Iseut dit ceci: « Je le sais en vérité. Sachez que la voile est toute noire. Ils l’ont montée bien haut
Parce que le vent leur f ait déf aut. »
Tr istan en a une si grande douleur,
25 Que jamais il n’en eut ni n’en aura de pire, Et se tourne vers le mur,
Et dit alors : « Dieu nous sauve Iseut et moi ! Puisque vous ne voulez venir à moi, Il me faut donc mourir pour l’amour de vous.
30 Je ne puis plus retenir ma vie ; Pour vous je meurs, Iseut, belle amie. »
« Amie Iseut » a-t-il dit trois fois, À la quatrième il a rendu l’esprit.
1.
Analyser

2. Vers 6-23 : la perfide Iseut aux Blanches Mains. En quoi son mensonge a-t-il quand même un détail de vérité ?
3. Vers 24-33 : quelles sont les dernières pensées de Tristan ?
4. La mort de Tristan. Quel est le geste qui l’exclut du monde et qui rend possible un dialogue intime avec Iseut la Blonde, comme si elle se trouvait près de lui ?
5. Tristan trouve-t-il enfin la sérénité que le destin semblait lui refuser ?
6. Qui est responsable de la mort de Tristan ? Relevez la succession des causes.
Écrire
7. Roland et Tristan : qu’est-ce qui les unit et qu’est-ce qui les diversifie ?
8. Décrivez la scène au premier plan et la scène au fond
9. Résumez les détails fondamentaux de l’histoire de Tristan et Iseut
Chrétien de Troyes (vers 1135-1185)


Sa vie
Nous ne connaissons presque rien de sa vie, les seules informations sont ce qu’il dit de lui dans ses œuvres. Nous apprenons ainsi son nom, ses œuvres et les dates entre lesquelles il a écrit ses romans. Il est né en Champagne vers 1130, peut-être à Troyes, car on trouve des traces du dialecte champenois dans ses écrits. On le considère comme le fondateur de la littérature arthurienne et comme un des premiers auteurs des romans de chevalerie. Il a été au service de la cour de Champagne, à côté de Marie (fille d’Aliénor) et ensuite aux côtés du comte de Flandre, Philippe d’Alsace. Ces deux mécènes sont des repères importants pour dater certaines œuvres de Chrétien de Troyes entre l’année de mariage de Marie de Champagne et la mort du comte de Flandre. Tout comme sa naissance, l’année de sa mort aussi est inconnue (entre 1180 et 1190).
Le contexte culturel
Les idéaux politiques et culturels du milieu pour lequel il compose se retrouvent dans ses romans. Ils sont liés à la légende du roi Arthur, leur cadre est celui du monde celtique (Irlande, Cornouaille, Pays de Galles, Armorique) qui n’a pas été complètement conquis par les Romains ou les invasions germaniques. Les chevaliers de la Table Ronde (Lancelot, Perceval) en sont les héros et des détails féériques et le merveilleux, comme dans la tradition bretonne, peuplent son récit. Tous vivent dans un milieu raffiné, les relations sont dominées par l’amour courtois et la figure de la dame. Enfin dans ses dernières œuvres, l’inspiration mystique et le Saint Graal se mêlent aux aventures romanesques
Son œuvre
Le thème du conflit entre l’amour de la dame et les aventures chevaleresques parcourt toute la
production de Chrétien de Troyes et il l’analyse sous des facettes différentes :
– dans Érec et Énide (v. 1165), le héros conquiert sa femme par ses exploits, mais ensuite il préfère vivre tranquillement et il est accusé de lâcheté. Il reprend sa vie aventureuse et oblige sa femme à le suivre ;
dans Cligès ou la fausse mort (1176), le chevalier tombe amoureux de Fenice promise à son oncle Alis. Après beaucoup d’aventures et la mort d’Alis, ils rentrent en Grèce et peuvent vivre heureux ;
dans Lancelot ou le chevalier à la charrette (1179), Lancelot sacrifie son honneur et risque sa vie pour les caprices de sa dame, la reine Guenièvre ;
dans Le Chevalier au lion (1180), Yvain choisit la vie aventureuse et sa femme le pardonnera seulement quand il vivra tranquillement chez lui ;
dans Perceval ou le conte du Graal (1181), inachevé peut-être à cause de la mort de Chrétien, le jeune chevalier doit rechercher le Graal et ses aventures se mêlent à celles d’un autre chevalier, Gauvain. Le roman s’arrête au moment où un ermite lui apprend que le Graal contient une hostie qui pourrait sauver le Roi Pêcheur
Chrétien de Troyes se reconnaît par un style personnel, léger et élégant ; il sait peindre la vie matérielle avec des détails comme un documentaire ; les dialogues sont vivants, acérés et fins. Il a observé tous les manèges de l’amour et ses analyses sont toujours d’une extrême précision. Il sait utiliser les enjambements et toutes les possibilités de la versification. Il a contribué de manière importante au triomphe du « francien1 » et on reconnaît en lui le créateur du genre du roman
1 La cheminée.
2 Mal élevé.



3 Tissu qui recouvre les tables.
Perceval ou le conte du Graal (1181)
Perceval est le premier roman où l’on mentionne le Saint Graal. Les continuateurs de Chrétien de Troyes feront de cet objet énigmatique le vase qui aurait recueilli le sang du Christ lors de son supplice sur la Croix.
Au château du Roi Pêcheur
Chrétien de Troyes, PERCEVAL OU LE CONTE DU GRAAL
Perceval, après plusieurs aventures, un soir qu’il cherchait un logis, est reçu par le Roi Pêcheur dans un château où il vit une bouleversante aventure. Pendant qu’il parle avec le roi, il est témoin d’un spectacle étrange : le cortège du Graal. Il apprendra ensuite que le Graal est porté au père du Roi Pêcheur qui se nourrit seulement de l’hostie qui vient du Graal. Si Perceval avait interrogé son hôte, sa question aurait pu guérir le roi blessé et lever la malédiction qui pesait sur ses terres. Perceval vient de subir une épreuve spirituelle et il n’a pas réussi à la surmonter. Le château, qui était animé et plein de faste, est désert quand il le quitte.
lance blanche qu’il tient par le milieu, sort d’une chambre ; il passe entre le feu1 et ceux qui étaient assis sur le lit. Tout le monde pouvait voir la lance blanche et r l’éclat de son fer Il sortait une goutte de sang à la pointe de la lance et cette goutte vermeille coulait jusqu’à la main du jeune homme. Le jeune Perceval qui vient d’arriver en ces lieux voit ce spectacle sur prenant mais r il se retient de demander comment cela p eut se p roduire, car il se ra pp elle la recommandation d e r celui qui lui a appris la chevalerie : il faut se garder de trop parle Il a donc peur, s’il pose une question, qu’on le trouve g rossier2 et c’est pour cette raison qu’il ne demande rien. Deux autres jeunes gens apparurent à ce moment qui portaient des r chandeliers d’or pu , décorés de fines incr ustations noires. Ces jeunes gens étaient d’une immense beauté. Sur chaque chandelier brûlaient au moins dix chandelles. Une demoiselle portait un graal à deux mains et s’avançait avec les jeunes gens : elle était belle, gracieuse et élégamment habillée. Quand elle fut entrée dans la pièce avec le g raal qu’elle portait, il y eut une si g rande lumière que les chandelles semblèrent plus sombres, comme les étoiles ou la lune quand le soleil commence de br iller. Une autre demoiselle venait derrière elle : elle portait un plat en argent. Le g raal qui était à la tête de la procession était de l’or le plus pur et incr usté de r pierres précieuses de toutes sortes parmi les plus riches et les plus rares qui existent sur terre et dans la mer. Les pierres précieuses du g raal dépassaient toutes les autres, cela ne f ait pas de doute. De la même manière que la lance était passée, ils passèrent devant le jeune homme pour aller d’une chambre à l’autre. Perceval vit passer les jeunes gens mais il n’osa pas demander qui l’on servait dans ce g raal, car il r pensait toujours à la recommandation du sage seigneu .
J’ai bien peur que le mal ne soit déjà f ait, car j’ai souvent entendu dire qu’on r peut parfois trop se taire, tout comme on peut parfois trop parle . Mais cependant, le jeune homme ne leur pose aucune question, ni pour son bien, ni pour son malheur.
Le seigneur donne l’ordre à ses serviteurs d’apporter de l’eau et de sortir les nappes3 . Les serviteurs font leur travail et suivent les ordres, comme ils en ont l’habitude. Le seigneur et le jeune homme se lavent les mains avec de l’eau tiède et pendant ce temps deux serviteurs apportent une grande table d’ivoire.
[...] Pendant ce temps, le graal traversa encore la salle devant eux – le jeune homme ne demanda pas qui l’on servait avec ce graal. Il s’en gardait à cause
Comprendre
du seigneur respectable qui lui avait conseillé de ne pas trop parler : ce conseil r lui reste en mémoire, il ne cesse d’y pense
Mais il est plus silencieux qu’il ne devrait l’être. À chaque mets que l’on apporte, il voit le graal repasser juste devant lui, sous ses yeux, mais il ne sait pas à qui il sert. Il voudrait bien le savoir et il se dit qu’il demandera, avant de partir du château, à l’un des serviteurs de la cour. Mais il préfère attendre le lendemain matin, quand il quittera son hôte et tout son entourage. Il remet sa question au lendemain et il s’occupe seulement de bien manger et de bien boire. D’ailleurs, il ne reg rette rien parce qu’on sert à la table des mets et des vins tous aussi délicieux que plaisants.
Chrétien de Troyes, à gauche : Perceval recevant une épée des mains du roi Pescheor ; à droite : Procession du saint Graal, tirée de Conte du Graal (1330), Paris, BnF

1. Retrouvez dans le texte l’ordre des composants du cortège et leurs actions.
2. Quelle est la réaction de Perceval ?
3. Quels sont les différents éléments mystérieux qui composent le cortège du Graal et qui font basculer la scène dans le merveilleux ?
Analyser
4. Est-ce que la scène du cortège a un caractère chrétien ?
5. Selon vous, s’il s’agissait d’une procession chrétienne, aurait-il été possible que la porteuse du Graal soit une jeune fille : Une demoiselle portait un graal à deux mains ?
6. Pourquoi un Graal et non le Graal ?
7. Décrivez le Graal. À quoi est comparée sa lumière ? D’où vient sa beauté ?
8. Quelles sont les réactions des présents à ce cortège ? Est-ce que tout le monde sait ce qu’est le Graal ?
9. Quelle est l’attitude du héros devant le cortège ? Comprend-il qu’il a affaire à une merveille ?
10. Qu’indiquent les informations mises en évidence par la couleur bleue ?
11. Observez les phrases soulignées en rose : pourquoi Perceval n’ose-t-il pas poser de questions au sujet du Graal ou de la lance ? Pourquoi reste-t-il silencieux?
Écrire
12. Perceval reste muet et il échoue dans cette épreuve à laquelle il était destiné. Imaginez que Perceval retourne au château du Roi Pêcheur et qu’il ose poser, à son hôte, des questions sur le cortège du Graal
a. Vous raconterez brièvement l’arrivée de Perceval au château
b. Vous imaginerez le dialogue entre Perceval et son hôte, en respectant scrupuleusement les contraintes d’écriture du discours direct
c. Vous décrirez la merveille dont sont témoins les personnages de la scène
L’œuvre
–
Texte
–
sources littéraires : on connaissait des fables d’auteurs grecs et latins (Phèdre, Ésope) et aussi des textes en français pour les écoles (les Ysopets) dans lesquels

les animaux se comportaient comme des hommes.
La transposition du monde animal au monde humain est parfaite : les animaux parlent et agissent exactement comme des hommes, mais parfois les instincts reparaissent et ce mélange humain-animal porte à sourire. Toute une époque apparaît avec ses mœurs et ses conditions sociales sous ces animaux, et la caricature humoristique des hommes est précise. Le succès de ce roman a été tel que le nom propre de l’animal, Renart, a fini par devenir le nom commun : renard, pour désigner l’espèce ; le nom commun goupil est devenu un terme archaïque et a disparu du vocabulaire de la langue française
Le goupil est le personnage central, qui est vaincu par les plus faibles mais qui triomphe contre les plus forts. Ce triomphe de la ruse et de l’esprit contre la force brutale peut être lu comme une revanche de la bourgeoisie et du peuple contre la noblesse qui les écrase. Nous sommes face à une société animale qui est organisée comme la société féodale. Chaque espèce animale est représentée, chacun a sa famille (avec femme et enfants), son caractère, son histoire, ses habitudes. La paix règne dans cette société où seulement Renart ne respecte pas toujours toutes les règles.
Renart et Tiécelin
LE ROMAN DE RENART
7
5 10
1 Un hêtre. 2 Maître Tiécelin. 3 Dépendance d’une
EUROPASS © Casa Editrice G. Principato

« Tais-toi, tais-toi, la vieille, » répond Tiécelin ; « quand on demandera qui l’a pris, tu diras : c’est moi, c’est moi ! car la mauvaise garde nourrit le loup »

Tiécelin s’éloigne et s’en vient percher sur le f au qui couvrait damp Renart de son frais ombrage. Réunis par le même arbre, leur situation était loin d’être pareille. Tiécelin savourait ce qu’il aimait le mieux ; Renart, également friand du fromage et de celui qui en était le maître, les regardait sans espoir de les atteindre. Le fromage à demi-séché donnait une entrée facile aux coups de bec : Tiécelin en tire le plus jaune et le plus tendre ; puis il attaque la croûte dont une parcelle lui échappe et va tomber aux pieds de l’arbre. Renart lève la tête et salue Tiécelin qu’il voit fièrement campé, le fromage dressé dans les pattes. « Oui, je ne me trompe pas ; oui, c’est damp Tiécelin. Que le bon Dieu vous protège, compère, vous et l’âme de votre père, le f ameux chanteur ! Personne autrefois, dit-on, ne chantait mieux que lui en France. Vous-même, si je m’en souviens, vous f aisiez aussi de la musique : ai-je rêvé que vous avez longtemps appr is à jouer de l’orgue ? Par ma foi, puisque j’ai le plaisir de vous rencontrer, vous consentirez bien, n’est-ce pas, à me dire une petite r itournelle. »
Ces paroles furent pour Tiécelin d’une grande douceur, car il avait la prétention d’être le plus ag réable musicien du monde. Il ouvre donc aussitôt la bouche et fait entendre un cri prolongé. « Est-ce bien, cela, damp Renart ? — Oui », dit l’autre, « cela n’est pas mal : mais si vous vouliez, vous monteriez encore plus haut. — Écoutezmoi donc. » Il fait alors un plus grand effort de gosier. « Votre voix est belle », dit Renart, « mais elle serait plus belle encore si vous ne mang iez pas tant de noix. Continuez pourtant, je vous pr ie. » L’autre, qui veut absolument emporter le prix du chant, s’oublie tellement que, pour mieux filer le son, il ouvre peu à peu les ongles et les doigts qui retenaient le fromage et le laisse tomber justement aux pieds de Renart. Le glouton frémit alors de plaisir ; mais il se contient, dans l’espoir de réunir au fromage le vaniteux chanteur. « Ah ! Dieu, » dit-il en paraissant faire un effort pour se lever, « que de maux le Seigneur m’a envoyés en ce monde ! Voilà que je ne puis changer de place, tant je souffre du genou ; et ce fromage qui vient de tomber m’apporte une odeur infecte et insupportable. Rien de plus dangereux que cette odeur pour les blessures des jambes ; les médecins me l’avaient bien dit, en me recommandant de ne jamais en goûter. Descendez, je vous prie, mon cher Tiécelin, venez m’ôter cette abomination. Je ne vous demanderais pas ce petit service, si je ne m’étais l’autre jour rompu la jambe dans un maudit piège tendu à quelques pas d’ici. Je suis condamné à demeurer à cette place jusqu’à ce qu’une bonne emplâtre4 vienne commencer ma guérison. »
Comment se méfier de telles paroles accompagnées de toutes sortes de g rimaces douloureuses, Tiécelin d’ailleurs était dans les meilleures dispositions pour celui qui venait enfin de reconnaître l’agrément de sa voix. Il descendit donc de l’arbre ; mais une fois à terre le voisinage de Renart le fit réfléchir. Il avança pas à pas, l’œil au guet5 , et en se traînant sur le croupion6 « Mon Dieu ! » disait Renart, « hâtez-vous donc, avancez ; que pouvez-vous craindre d e moi, pauvre impoten t 7 ? » Tiécelin s’approcha davantage, mais Renart, trop impatient, s’élance et le manque, ne retenant en gage que trois ou quatre plumes. « Ah ! traître Renart ! » dit alors Tiécelin, « je devais bien savoir que vous me tromperiez ! J’en suis pour quatre de mes plus beaux tuyaux ; mais c’est là tout ce que vous aurez, méchant et puant larron, que Dieu maudisse ! »
Renart, un peu confus, voulut se justifier. C’était une attaque de goutte qui l’avait fait malgré lui sauter. Tiécelin ne l’écouta pas : « Garde le fromage, je te l’abandonne ; quant à ma peau, tu ne l’auras pas. Pleure et gémis mainte-
Comprendre
nant à ton aise, je ne viendrai pas à ton secours. — Eh bien va-t-en, braillard de mauvais augure, » dit Renart en reprenant son naturel ; « cela me consolera de n’avoir pu te clore le bec. Par Dieu ! » reprit-il ensuite, « voilà vraiment un excellent fromage ; je n’en ai jamais mangé de meilleur ; c’est juste le remède qu’il me fallait pour le mal de jambes. » Et, le repas achevé, il reprit lestement le chemin des bois
1. Quel est le cadre du récit ?
2. Quelles sont les circonstances de l’action ?
3. Au premier paragraphe, quel sentiment éprouve Renart dans la plaine fleurie ? Relevez deux mots qui le montrent.
4. Qu’est-ce qui vient déranger Renart ? Relevez l’expression qui le souligne.
5. Quel personnage trouve une solution au problème qui se pose également à Renart ? De quelle façon ?
Analyser
6. Dans le troisième paragraphe, montrez que la situation de Renart et de Tiécelin est diamétralement opposée.
7. Toujours dans le troisième paragraphe, que veut Renart ?
8. Quel défaut de Tiécelin Renart exploite-t-il pour obtenir ce qu’il désire ? Citez quelques passages du texte qui le prouvent.
9. Comment Renart réagit-il lorsque le corbeau s’aperçoit du mauvais tour qu’il s’apprêtait à lui jouer ?
10. D’où vient le comique de cette histoire ?
11. Par quels moyens le renard obtient-il ce qu’il veut ?
12. La force de la parole et la flatterie sont un art : sur quoi ont-elles un pouvoir ?
Écrire
13. Dans la forme que vous préférez, en vers ou en prose, racontez la même histoire en gardant les mêmes animaux ; vous pouvez décider aussi de changer la morale de votre fable.
À la loupe...
Le renard, un personnage réussi
Le renard est, au même titre q ue l e loup, une grande figure des contes traditionnels, des fables et des histoires populaires, des romans, de la bande dessinée. Il est la métaphore du personnage rusé et il personnifie tous les défauts humains.
La Fontaine , un f abuliste du XVI I e siècle, met souvent en scène des animaux auxquels on prête les qualités et les défauts des hommes et il a choisi souvent le renard comme protagoniste de plusieurs de ses fables
Comprendre et réfléchir
1. Que représente le renard dans l’imaginaire des hommes ?
2. Dans la fable de La Fontaine, comment se comporte le renard ?
3. Quel texte avez-vous préféré ? Pourquoi ?
Le Corbeau et le Renard
La Fontaine raconte ici une histoire à peu près semblable à celle de Renart et Tiécelin (protagonistes du Roman de Renart) ; il y a la personnification des mêmes animaux et le même parallélisme dans la présentation des personnages.
Maître Corbeau, sur un arbre perché, Tenait en son bec un fromage.
Maître Renard, par l’odeur alléché, Lui tint à peu près ce langage :
5 « Et bonjour, Monsieur le Corbeau, Que vous êtes joli ! Que vous me semblez beau !
Sans mentir, si votre ramage Se rapporte à votre plumage, Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois. »
10 À ces mots, le Corbeau ne se sent pas de joie ; Et pour montrer sa belle voix, Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.
Le Renard s’en saisit, et dit : « Mon bon Monsieur, Apprenez que tout flatteur
15 Vit aux dépens de celui qui l’écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. »
Le Corbeau, honteux et confus, Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus.
La poésie didactique et lyrique
Médiathèque Thibaut de Champagne • « Je suis pareil à la licorne »
La poésie didactique
La poésie d’amour n’est pas majoritaire au Moyen Âge. Il y a un autre versant de la littérature, la poésie didactique, où les œuvres morales qui la constituent se définissent par opposition à la chanson d’amour des troubadours. La poésie didactique, constituée d’un vaste ensemble de textes et de structures, est une poésie moralisante, allégorique et d’habitude pessimiste. Politique, amour, religion et morale constituent les quatre grands complexes thématiques de cette poésie qui a le désir d’instruire et qui vise à enseigner quelque chose. L’abstrait et le concret sont souvent mêlés, les formes sont extrêmement diverses, mais dans toutes triomphe l’allégorie, un développement logique du symbole, souvent définie comme un décalage entre ce qui est dit et ce qui est signifié
L’allégorie devient un mode d’expression privilégié au XIIIe siècle parce qu’elle est en accord avec les tendances de l’art de l’époque qui passe à un code stabilisé pour comprendre les signes symboliques. L’apprentissage des deux champs sémantiques (mots et symboles) permet de décoder le texte. On part en général d’un songe ou d’une vision et des thèmes de la tradition (voyage, quête, conflit, mariage), où le dieu Amour joue un rôle de premier plan. L’espace est une figuration des obstacles que rencontre le désir et les personnifications sont un inventaire de l’univers moral et amoureux. L’allégorie est donc un art composite, un miroir, un exemple qui exprime le mieux la mentalité des hommes de cette période. Le trait le plus évident de l’allégorie est la personnification. Le chef-d’œuvre du genre est Le Roman de la Rose

Le lyrisme courtois

La poésie lyrique chante des sentiments personnels et s’en inspire. À l’origine, elle était destinée à être chantée par des jongleurs et des ménestrels, à la fois musiciens et poètes, qui s’accompagnaient de la lyre. Elle présente une grande variété de formes qui sont fixes et que le poète/musicien doit connaître. Au milieu du XIIe siècle, elle est d’inspiration cour-
toise et aristocratique et elle est l’œuvre de trouvères ou de grands seigneurs lettrés comme Charles d’Orléans. Elle a souvent la forme de la chanson de toile ou d’histoire et le nom dérive de l’occupation des femmes qui filaient la toile pendant qu’elles chantaient. Ce type de chanson est typique de la littérature du nord de la France, très différente de la littérature du sud, celle des troubadours. Elle emprunte aussi un répertoire riche et varié à la littérature méridionale.
Le lyrisme des troubadours
La poésie des troubadours (Bernard de Ventadour, Jaufré Rudel, Bertran de Born) se développe dans le Midi de la France à partir de la fin du XIe siècle. Cette poésie a instauré une nouvelle conception de l’amour qui s’est mêlée aux valeurs féodales de la chevalerie. La fin’amor reprend les structures de la société féodale, mais c’est la dame (domina en a latin) qui occupe la position du seigneur. Les textes des troubadours chantent le printemps, l’amour heureux, l’amour lointain. L’amour est souvent un amour adultère et c’est le motif pour lequel la femme n’est jamais nommée directement, mais elle apparaît dans le texte avec un senhal (nom d’emprunt ou allusion).
Le lyrisme bourgeois
Au XIIIe siècle, une évolution se vérifie avec l’introduction d’une verve satirique et réaliste qui s’unit au lyrisme et l’opposition entre l’esprit aristocratique et bourgeois s’affirme. Parmi les poètes de cette période, on cite l’œuvre très variée de Rutebeuf (v. 1280). Au XIVe et au XVe siècles, le statut du poète change : c’est un professionnel qui vit de son art. La poésie est encore l’expression de la vie courtoise mais elle devient aussi un ornement et un accessoire luxueux. On élabore une sagesse nouvelle et le lyrisme devient l’aveu d’une conscience. Les formes poétiques continuent d’évoluer et une mise au point formelle se dessine avec Guillaume de Machaut (1300-1377).
Il fixe les règles précises que les poètes doivent suivre et auxquelles les textes doivent se soumettre. On distingue entre autre :
– le rondeau : poème de 13 vers avec un refrain qui est une reprise des premiers vers à la fin de chaque strophe ; les vers ont 8 ou 10 syllabes et ils sont construits sur 2 rimes ;
– le lai : poème de 12 strophes sur 2 rimes ; la longueur peut varier ;
le virelai : poème composé sur 2 rimes ; la première strophe devient le refrain qui est repris après chaque strophe ;
la ballade : poème de 3 ou 5 strophes souvent de 10 vers, construites sur le même rythme et la même rime, et d’un envoi qui conclut le poème et qui a un nombre de vers qui est la moitié de celui de chaque strophe. Le dernier vers se répète comme un refrain
Activités
1. Lisez et indiquez si les phrases sont vraies (V) ou fausses (F), puis corrigez les fausses.
1. La poésie didactique a comme thème l’amour.
2. L’allégorie exprime la mentalité de l’époque.
3. La poésie des troubadours a instauré la fin’amor
4 Au XVe V siècle, la poésie devient une profession.
5. Pour les troubadours, l’amour est idéalisé.
2. Relevez les différences entre le lyrisme courtois et le lyrisme des troubadours.
3. Quelles sont les caractéristiques du lyrisme courtois ?
4. Qu’est-ce que la fin’amor ? r
5. Quel est le conflit toujours présent dans l’amour courtois ?
6. Que se passe-t-il aux XIVe et XVe siècles ?
7. Qu’est-ce que Guillaume de Machaut a apporté à la poésie ?

Sa vie et son œuvre Nous n’avons que très peu d’informations sur Guillaume de Lorris. C’est un trouvère célèbre qui serait né vers 1200 peut-être à Lorris, village à cinquante kilomètres d’Orléans. On a essayé de l’identifier avec Guillelmus de Lorriaco, un ingénieur qui est mentionné dans le testament du comte
de Poitiers, mais rien n’est sûr. Il devait être noble et avoir trente ans vers 1230 au moment où il a commencé à composer Le Roman de la Rose. Il a écrit environ 4000 vers et n’a pas complété son œuvre, peut-être à cause de sa mort prématurée vers 1238. Son roman a été continué par Jean de Meung une quarantaine d’années après.
L’œuvre
Le Roman de la Rose (XIIIe siècle)
Le Roman de la Rose est un poème allégorique, composé par deux auteurs différents à deux moments différents : Guillaume de Lorris et Jean de Meung. Guillaume de Lorr is, à l’âge de 20 ans, raconte qu’il a fait un rêve.
Les allégories vont lui permettre d’exprimer, d’une façon plus générale ou détaillée, tous les sentiments, toutes les qualités et toutes les manières d’être. Guillaume de Lorris ne finit pas son histoire et son rêve, mais, dans ses environ 4000 vers, il nous montre une réelle connaissance du cœur humain. Le roman est repris là où il avait été interrompu par Jean de Meung, qui y rajoute 17 722 vers.
Les deux parties se diversifient :
par la langue : raffinée chez Guillaume de Lorris, énergique et savoureuse chez Jean de Meung ;
par l’intérêt psychologique de la première, la valeur encyclopédique et intellectuelle de la seconde.
La première partie est un code de l’amour courtois, pleine de délicatesse, de raffinement et de poésie. La seconde devient une suite de dissertations sur tout ce qui
peut intéresser les esprits cultivés : de l’origine de la royauté à la vraie noblesse, au mariage, à la richesse, à la liberté, à la création, aux rapports entre les hommes et les animaux, à la place de l’homme dans le monde.
L’auteur a un véritable culte de la Nature et c’est en son nom qu’il critique le célibat des prêtres et des moines et qu’il nous donne une vision de l’amour bien différente de celle de l’amour courtois. L’amour est indispensable pour le maintien de l’espèce et la procréation, la femme n’est donc plus une idole mais il expose les défauts des femmes, leurs pièges et les moyens de les déjouer.
LeRoman de la Rose est une œuvre maîtresse du Moyen Âge ; il est riche et ample et son influence considérable a marqué la littérature. Il résume tous les thèmes de la courtoisie et de la philosophie des XIIe et XIIIe siècles et il a été traduit en italien, en anglais et en flamand. Au XVIe siècle, il a été modernisé par Clément Marot et lu par Ronsard, qui le considérait comme le monument le plus remarquable de la littérature ancienne. Le chemin que doit faire l’Amant préfigure la « Carte du Tendre » et les subtilités de la psychologie amoureuse et de la galanterie des romans précieux du XVIIe siècle.
Un matin, au mois de mai, Amant est allé se promener dans la campagne et il est arrivé à un verger qui était entouré d’un mur orné de statues très laides qui représentaient Envie, Avarice, Vieillesse. Un jeune homme, Oisiveté, lui a ouvert la porte et l’a conduit dans un p ré o ù dansent Plaisir, le dieu Amour, Beauté, Richesse. Amant admire surtout u n buisson de roses, et une fleur ( la
Texte 1
jeune fille aimée) lui semble si belle et si fraîche qu’il ne peut détacher ses yeux d ’elle. Amour le frappe de ses flèches et lui expose, en 800 vers, tout un art d’aimer sur le modèle d’Ovide L’Amant se désole mais Raison arrive et lui donne des conseils pour se d é ba rrasser des problèmes et des soucis que procure Amour.
Elle ne réussit pas à convaincre Amant,

Coup de foudre
Guillaume de Lorris, LE ROMAN DE LA ROSE
a l ors Ami arrive et l e conso l e. Amour assi è ge la tour o ù la Rose est priso nni è re avec Noblesse de cœur, Fra nchise, Largesse, Courtoisie, Abstinence, Contrainte et Faux-Semblant. C ’est après l’intervention de Nature, qui les harangue, qu’ils sont victorieux et, après l’intercession de Courtoisie, Amant peut finalement arriver à Rose
La fontaine de Narcisse contient la clé de l’œuvre. Le narrateur rêve qu’il se promène un beau jour de mai et qu’il réussit à pénétrer dans un jardin habité par de charmantes allégories. À la fin de son exploration, il arrive à une fontaine où une inscription gravée dans la pierre rappelle que Narcisse est mort ici. Le dieu Amour le guette mais, après une hésitation compréhensible, il ne peut s’empêcher de regarder dans l’eau transparente de la fontaine.
C’est le miroir périlleux1
Où Narcisse l’orgueilleux
Mira2 son visage et ses yeux,
Ce qui causa sa mort.
5 Qui se mire en ce miroir
Ne peut avoir garant ni médecin
Qui l’empêche de voir de ses yeux quelque chose
Qui l’engage aussitôt sur le chemin de l’amour.
Ce miroir a mis plus d’un homme
10 De grande vaillance en difficulté, car les plus sages, Les plus preux3 , les plus courtois
Y sont bien tôt pr is et pr isonniers.
4 Lacets
5 Demoiselles et jeunes hommes, damoiseaux était le masculin de damoiselles
6 Il ne s’agit pas de textes romanesques, mais de textes écrits en langue romane, par opposition aux ouvrages latins. Ici l’auteur proclame la supériorité de sa version.
7 Raconter.
8 Mauvaise
C’est ici que les gens tombent en proie à une rage nouvelle, C’est ici que leurs cœurs changent,
15 Ici il n’y a raison, sens ni mesure, Ici il règne seule la volonté d’aimer, Ici personne ne sait se raisonner ; Car Cupidon, le fils de Vénus, A semé ici la graine d’Amour,
20 Qui a teinte toute la fontaine, Et a posé ses lacs4 tout autour, Et ses pièges pour prendre Damoiselles et damoiseaux5 , Car Amour ne veut pas d’autres oiseaux.

25 À cause de la graine qui y fut semée
On appela cette fontaine
À juste titre la Fontaine d’Amour, Dont plusieurs ont à leur tour
Parlé dans leurs livres, en romans6
30 Mais jamais vous n’entendrez mieux décr ire
La vérité de la question
Que je ne veux vous la relater7
Là-dessus je me mis à regarder
La fontaine et à la contempler,
35 Ainsi que les inscr iptions qui m’expliquaient Cent mille choses qui y apparaissaient
Mais c’est à la male8 heure que je m’y suis miré Hélas ! j’en ai tant soupiré par la suite !
Ce miroir m’a trompé :
40 Si j’avais connu d’avance Quelles en étaient la force et la vertu, Jamais je ne m’en serais approché, Car immédiatement je tombai dans les lacs Qui ont pr is et trahi plus d’un homme.
45 Au miroir, entre mille autres choses, Je vis des rosiers chargés de roses, Qui étaient dans un massif Enclos de haies tout à l’entour ; [...]
Comprendre Analyser Écrire
1. Quel danger se cache dans cette fontaine ?
2. Qui ont été ses victimes ? Pourquoi ?
3. Expliquez l’expression « miroir périlleux » (vers 1).
4. Quelle idée de l’amour apparaît dans ce passage ? Est-il possible d’y échapper ?
5. Mais c’est à la male heure que je m’y suis miré / Hélas ! j’en ai tant soupiré par la suite ! / Ce miroir m’a trompé : quelles informations ces vers contiennent-ils concernant la suite du roman ?
6. Retrouvez dans le texte les allégories et les personnifications. Quelle réaction produit la beauté de la Dame-Rose sur l’auteur ?
7. Quelle impression produit sur vous l’usage de la métaphore dans ce roman d’amour ? Est-ce que c’est quelque chose qui vous attire ? Rappelez-vous que Le Roman de la Rose a été en quelque sorte un best-seller qui a séduit des générations de lecteurs jusqu’au début du XVIe siècle.
L’œuvre
Bernard de Ventadour (v. 1125-v. 1200)

Sa vie et son œuvre
Bernard de Ventadour est né à Ventadour (Corrèze) et mort dans l’Abbaye de Dalon (Dordogne) dans le sud-ouest de la France, en Occitanie, mais sa date de naissance et de mort ne sont pas sûres. Il serait le fils d’un homme d’armes et d’une boulangère ou peut-être le bâtard d’un grand seigneur. Après quelques pérégrinations, il a été accueilli à la cour d’Aliénor d’Aquitaine dont il tombe amoureux. Il l’aurait suivie en
Le Chansonnier (XIIe siècle)

Angleterre après son second mariage avec Henri Plantagenêt et serait rentré en France seul. On le retrouve à Toulouse au service du comte Raymond V, puis à Narbonne. En 1194, après la mort du comte, il va finir sa vie dans l’Abbaye de Dalon.
Il nous a laissé une œuvre riche de sentiments personnels, il est l’un des meilleurs musiciens de son époque et un des plus célèbres troubadours français en langue d’oc
Bernard de Ventadour laisse quarante-cinq chansons : de courts poèmes amoureux, traditionnellement divisés en trois cycles qui célèbrent trois dames différentes et expriment la puissance de ses sentiments. Il utilise des mots à la fois simples et délicats qui développent la thématique de la fin’amor propre à la poésie courtoise. Il a composé également sa propre musique, dont vingt airs sont conservés dans des manuscrits. Ces « chants » de cour ont été diffusés à leur époque dans toute l’Europe médiévale et même au delà
Texte 1
« Quand vois l’alouette mouvoir »
Bernard de Ventadour, LE CHANSONNIER
Ce poème est une plainte amoureuse, une élégie où l’amour est montré comme une illusion. Le poète dénonce l’insensibilité des femmes et décide de renoncer même à écrire.
Quand vois l’alouette mouvoir
De joie ses ailes f ace au soleil, Que s’oublie et se laisse choir
Par la douceur qu’au cœur lui va,
5 Las ! si g rand envie me vient
De tous ceux dont je vois la joie, Et c’est merveille qu’à l’instant
Le cœur de désir ne me fonde.
Hélas ! tant en croyais savoir
10 En amour, et si peu en sais
Car j’aime sans y r ien pouvoir
Celle dont jamais r ien n’aurai
Elle a tout mon cœur, et m’a tout, Et moi-même, et le monde entier,
15 Et ces vols ne m’ont rien laissé Que désir et cœur assoiffé
Comprendre Analyser
Or ne sais plus me gouverner Et ne puis plus m’appartenir Car ne me laisse en ses yeux voir
20 En ce miroir qui tant me plaît Miroir, pour m’être miré en toi, Suis mort à force de soupirs, Et perdu comme perdu s’est Le beau Narcisse en la fontaine.
25 Des dames, je me désespère ; Jamais plus ne m’y fierai, Autant d’elles j’avais d’estime Autant je les mépr iserai. Pas une ne vient me secourir
30 Près de celle qui me détruit, Car bien sais que sont toutes ainsi.
Avec moi elle ag it en femme
Ma dame, c’est ce que lui reproche, Ne veut ce que vouloir devrait
35 Et ce qu’on lui défend, le f ait. Tombé suis en male merci Car ai fait le fou sur le pont Et si cela m’est advenu C’est qu’ai voulu monter trop haut...
40 Et puisqu’auprès d’elle ne valent Pr ière, merci ni droit que j’ai, Puisque ne lui vient à plaisir Que l’aime, plus ne lui dirai ; Aussi je pars d’elle et d’amour ;
45 Ma mort elle veut, et je meurs, Et m’en vais car ne me retient, Dolent, en exil, ne sais où.
Tristan, plus rien n’aurez de moi, Je m’en vais, dolent, ne sais où ;
50 De chanter cesse et me retire, De joie et d’amour me dérobe.
L’amour frappe avec ses flèches le cœur de l’amant, peint sur un coffret en bois fabriqué en Allemagne (v. 1405)

1. Quel est le grand thème de ce texte ?
2. À quoi renvoie l’image de l’alouette dans la première strophe ?
3. Dans la troisième strophe, qu’aime faire le poète ?
4. Expliquez pourquoi ce poème est aussi une plainte amoureuse
5. Est-ce qu’on connaît l’anecdote qui est à l’origine de cet amour malheureux ?
6. Relevez l’enchaînement des métaphores.
a. À quoi le poète, compare-t-il son cœur dans les deux premières strophes ?
b. À quoi sont comparés les yeux de la femme ?
c. Dans la troisième strophe, à quoi le poète se compare-t-il ?
7. Relevez les termes du champ lexical de la souffrance du poète
8. Que retrouvez-vous de l’univers de la cour, de l’univers féodal chez Bernard de Ventadour ?
Écrire
9. Repérez les thèmes ou les motifs courtois dans cette chanson et écrivez un texte en vous appuyant sur le poème.
Christine de Pisan (1363/4 ?-1430)
Sa vie
Elle est née à Venise et morte au monastère de Poissy. Elle est la première femme écrivain qui a pu vivre de son travail. Son érudition lui donne une place à part et la distingue des écrivains de son époque. La famille va vivre à Paris, car son père, médecin fameux, y est appelé par le roi Charles V. Elle apprend la musique et le latin pour pouvoir lire des ouvrages de philosophie, d’histoire, de poésie ou de religion. Elle est bilingue, connaît le français et l’italien mais n’écrit qu’en français. Quand elle a quinze ans, son père lui choisit un mari, Étienne de Castel, savant et vertueux, âgé de vingt-trois ans. Le mariage est très heureux et trois enfants naissent, mais malheureusement son père et son mari meurent et laissent la famille dans le besoin ; de plus, Christine décide de ne pas se remarier, choisit la profession
L’œuvre
Rondeaux (1390-1400)
d’homme de lettres et, au Moyen Âge, cette prise de position est vue avec méfiance. Elle doit organiser sa fortune, essaie de constituer des revenus suffisants pour maintenir son rang et cette période difficile dure 14 ans, comme elle l’écrit elle-même.
La première femme écrivain
Elle reprend ses études et complète son éducation, elle s’intéresse à l’histoire, à la poésie savante et commence à composer des pièces lyriques qui lui procurent des commandes et la protection de grands seigneurs lettrés. Elle prend de l’assurance et s’engage dans la défense de l’image de la femme dans la littérature. Elle sait conserver les relations qu’elle a à la cour et cela lui permet d’avoir une place dans le monde des hommes cultivés de son temps. Elle devient un écrivain renommé en France et aussi à l’étranger.
Christine de Pisan a laissé une œuvre poétique abondante et variée, plus de 300 ballades et 69 rondeaux ainsi que des lais, des virelais et des complaintes.

Texte 1
Christine de Pisan, RONDEAUX
Ce texte a été écrit entre 1390 et 1400. C’est un court poème, qui a été édité dans un recueil intitulé Rondeaux, première indication sur sa forme1
Je ne sais comment je dure, Car mon dolent cœur fond d’ire2
Et plaindre n’ose, ni dire
Ma doleureuse3 aventure,
5 Ma dolente vie obscure.
Comprendre
1. Quel est le thème principal de ce rondeau ?
2. Est-ce que Christine de Pisan précise la cause de cette douleur ? Est-ce qu’on peut la deviner ?
3. Cette souffrance durable a-t-elle une issue possible ?
4. Dans le troisième quatrain, qu’estce qui rend encore plus tragique la situation de la poétesse ?
1 À l’origine, c’est une forme musicale, vocale et une danse en rond (une ronde), voir
p 48.
2 Chagrin, douleur, colère.
3 Du latin dolor
4 Par dissimulation
5 Ce que.
Rien, hors la mort ne désire ;
Je ne sais comment je dure.
Et me faut, par couverture4 ,
Chanter que5 mon cœur soupire

10 Et faire semblant de rire ;
Mais Dieu sait ce que j’endure.
Je ne sais comment je dure.
Analyser
5. Relevez le champ lexical de la douleur.
6. Qu’est-ce qui rend si musical ce poème ?
7. Du point de vue lexical et stylistique, que remarquez-vous ?
Écrire
8. Pourquoi doit-elle dissimuler sa peine ? Donnez des motivations et faites des suppositions en écrivant un court texte.
« Je ne sais comment je dure »
L’œuvre
Rutebeuf (deuxième moitié du XIIIe siècle)
Sa vie et son œuvre
On ne sait pratiquement rien de sa vie, même pas son nom, qui viendrait de son surnom « Rudebœuf » (bœuf vigoureux) qu’il utilise dans son œuvre pour parler de lui.
C’était probablement un jongleur, avec une formation de clerc, car il connaissait le latin et son origine était champenoise (il parle de guerres à Troyes dans ses écrits), mais c ’est à Paris qu’il a vécu.
Son œuvre est très variée et elle résume toutes les tendances de son époque et de son milieu (la piété, son enthousiasme pour les croisades) qu’il a exprimées avec réalisme et ironie
Son œuvre ne comporte aucune chanson d’amour selon l’idéologie courtoise, mais raconte ses problèmes personnels et ses mésaventures. Il y a un grand souci du rythme et la forme est très soignée, par fois aussi un peu artificielle.
La Complainte Rutebeuf (1261-1262?)

Ce poème évoque plusieurs thèmes éternels : les malheurs d’un poète, sa solitude, la fragilité de l’amitié, la pauvreté et la misère de l’artiste. L’emploi de la première personne, tout au long du texte, marque bien une œuvre lyrique où le poète se confie et évoque ses sentiments. Léo Ferré a chanté et mis en musique une version de La Complainte
Texte 1
Rutebeuf, LA COMPLAINTE RUTEBEUF
C’est sans doute son texte le plus célèbre. Le poète y raconte son mariage malheureux et passe en revue tous les problèmes qui l’accablent, en déplorant la perte de ses amis. Rutebeuf ne regrette pas l’amitié en tant que sentiment qui aide à vivre, mais comme soutien financier des amis, c’est-à-dire de ses protecteurs.
Les maux ne savent pas venir seuls ; Tout ce qui devait m’advenir, Est maintenant du passé. Que sont mes amis devenus
5 Que j’avais tant cultivés, Et tant aimés ?

Je crois qu’ils se sont épar pillés ; Ils n’avaient pas été bien attachés, Et ainsi ils ont f ailli.
10 De tels amis m’ont mis en mauvaise situation, Car jamais, aussi longtemps que Dieu me mit à l’épreuve De bien des manières, Je n’en vis un seul à mes côtés. Je crois que le vent les a emportés.
15 L’amitié est morte : Ce sont amis que le vent emporte. Et il ventait devant ma porte, Ainsi le vent les emporta, Car jamais aucun ne me réconforta
20 Ni ne m’apporta rien de ce qui lui appartenait Ceci m’apprend
« Que sont mes amis devenus »
1 Détenteur de l’office des vidanges à Paris, son nom est passé en proverbe pour dire : je le jette aux égouts.
Comprendre
Que celui qui a des biens, doit les prendre pour lui ; Mais celui-ci se repent trop tard
Qui a trop dépensé
25 Pour se faire des amis, Car il ne les trouve pas sincères, même à moitié
Pour lui venir en aide
Je cesserai donc de courir la fortune, Et je m’appliquerai à me tirer d’affaire
30 Si je le peux
Il me faut aller trouver mes bons seigneurs
Qui sont courtois et débonnaires
Et qui m’ont fait vivre
Mes autres amis sont tous des pourris :
35 Je les envoie à maître Orr i1
Et je les lui laisse.
On doit bien y renoncer
Et laisser telles gens à l’abandon, Sans les réclamer,
40 Car il n’y a en eux r ien à aimer
Que l’on doive juger digne d’amour.
Or je pr ie Celui
Qui fit trois parties de lui-même, Qui ne sait refuser personne
45 Qui se réclame de lui, Qui l’adore et le clame son seigneur, Et qui soumet à la tentation ceux qu’il aime, Car il m’y a soumis,
Qu’il me donne bonne santé,
50 Pour que je f asse sa volonté, De bon cœur sans m’esquiver.
À monseigneur qui est fils de roi
J’envoie ma complainte et mon dit, Car j’en ai bien besoin,
55 Car il m’est venu en aide très volontiers :
C’est le bon comte de Poitiers Et de Toulouse ; Il saura bien ce que désire Celui qui se lamente ainsi.
1. À quelle personne est écrit le poème ? Pourquoi ?
2. Que chante le poète ?
3. À partir de l’idée de la maladie est introduit le thème des amis infidèles. Quelle est la conclusion amère du poète sur l’amitié ? À quelle métaphore fait-il appel ? p
4. Après une humble prière de soumission à Dieu, comment justifiez-vous la demande d’argent et de protection, ce double recours à Dieu et au comte de Poitiers et de Toulouse, personnage influent à la cour de Louis IX ?

5. Pourquoi Rutebeuf ne dit-il pas clairement ce qu’il désire ?
6. Est-ce qu’il s’agit d’amitié au sens moderne du terme ? Quelle est la préoccupation du poète ?
Analyser Écrire
7. Étudiez la structure poétique du texte : l’alternance de vers longs et courts donne à la strophe une cadence, comme si ce vers constituait un refrain. En quoi est-elle bien adaptée à une mise en musique ?
8. Et pour vous, qu’est-ce que l’amitié ? Partagez-vous l’amertume de Rutebeuf ? Écrivez et motivez votre réponse.
Texte 1
Charles d’Orléans (1394-1465)
Sa vie

Il est né à Paris le 26 mai 1394 et mort à Amboise le 4 janvier 1465. C’était un prince important et nous avons beaucoup d’informations sur sa vie.

Son père, Louis d’Orléans, frère du roi Charles VI et chef des Armagnac, a été assassiné en 1407, et il est devenu un des chefs de ce groupe. Le désir de venger cette mort va l’accompagner pendant de nombreuses années Pendant la guerre de Cent ans, à la bataille d’Azincourt, il est fait prisonnier et emmené en Angleterre. Son emprisonnement va durer vingt-cinq ans ; il sera surveillé constamment, déplacé d’un château à un autre, sans aucune nouvelle de la France. Il a continué d’espérer dans sa libération et il en est arrivé même à reconnaître les droits du roi d’Angleterre sur la couronne de France pour l’obtenir. Finalement, en 1440, Philippe le Bon paiera une rançon de 200 000 écus d’or (une véritable fortune) et il sera libéré. Il va se retirer dans ses châteaux de Blois et de Tours dans la vallée de la Loire pour y finir sa vie, en mécène, au milieu d’une cour littéraire en composant des ballades, des chansons et des rondeaux et en protégeant des artistes.
Rondeaux (XVe siècle)
À sa cour de Blois, il a organisé des concours poétiques et on retrouve dans les manuscrits et les éditions, les textes écrits par les auteurs de l’époque qui y ont participé
Son œuvre
On peut distinguer deux parties dans ses poésies : un premier groupe constitué par les textes qu’il a écrits pendant ses 25 années de captivité et un autre qu’il a composé après son retour en France. Dans les textes écrits en Angleterre, l’allégorie mise à la mode par Guillaume de Lorris est la toile de fond, l’amour occupe une grande place et Beauté, à qui le poète s’adresse, n’est pas une femme particulière mais peut être aussi la France. Il y parle aussi de son mal du pays et du désir de la paix qu’il veut maintenir.
On y retrouve un grand naturel, une aisance infinie, une clarté et une élégance extrêmes accompagnées d’une fraîcheur et d’une délicatesse remarquables.
Dans ses autres textes, composés après 1140, il parle de sujets variés, souvent amoureux. Avec l’âge il a découvert la sagesse et sa poésie devient sincère, douce et mélancolique.
Les 344 rondeaux, écrits pour la plupart dans le milieu littéraire raffiné de la cour de Blois, à son retour de captivité, témoignent la distance qu’il prend par rapport à la poésie courtoise. Dans son œuvre, il ne reste que des traces discrètes des événements qu’il a vécus.
« En regardant vers le pays de France »
Charles d’Orléans, RONDEAUX
L’événement qui bouleverse la vie de Charles d’Orléans est sa capture par les Anglais après la bataille d’Azincourt et son emprisonnement en Angleterre pendant 25 ans. De ce long exil est né ce poème, un des plus célèbres du Moyen Âge et un des tous premiers à exprimer le regret de la patrie.
En regardant vers le pays de France, Un jour m’advint, à Douvres sur la mer, Qu’il me souvint de la douce plaisance Que je soulais1 au dit pays trouver ;
5 Si2 commençai de cœur à soupirer, Combien certes que3 grand bien me f aisait De voir France que mon cœur aimer doit.
Je m’avisai que c’était non savance4 De tels soupirs dedans mon cœur garder, 10 Vu que je vois que la voie commence De bonne paix, qui tous biens peut donner ; Pour ce, tournai en confor t5 mon penser. Mais non pourtant mon cœur ne se lassait De voir France que mon cœur aimer doit.
15 Alors chargeai en la nef d’Espérance
Tous mes souhaits, en leur priant d’aller Outre la mer, sans faire demourance6 , Et à France de me recommander.
Or nous doint Dieu7 bonne paix sans tarder !
20 Adonc8 aurai loisir, mais qu’ainsi soit, De voir France que mon cœur aimer doit.
Paix est trésor qu’on ne peut trop louer. Je hais guerre, point ne la doit priser ; Destourbé9 m’a longtemps, soit tort ou droit10
25 De voir France que mon cœur aimer doit.
Le duc d’Orléans, emprisonné dans la Tour de Londres, est en train d’écrire ses poèmes et il regarde par la fenêtre, miniature tirée d’un recueil manuscrit des œuvres du duc d’Orléans (XVe V siècle), Londres, British Library.




Comprendre

1. Quel sentiment éprouve le poète en regardant la France ? De quoi naît sa nostalgie ?
2. Dégagez l’idée essentielle de chaque strophe et de l’envoi. Que souhaite Charles d’Orléans ? Que représente la paix si désirée ?
3. En quoi le refrain que mon cœur aimer doit souligne le thème patriotique de la ballade ? t
Analyser
4. On perçoit dans la poésie la tristesse de l’exilé et son patriotisme. Charles d’Orléans se donne du courage et semble reprendre espoir. Son patriotisme est-il revanchard ? Est-ce qu’on peut aimer son pays et vouloir la paix ?
5. Observez la forme de ce texte
a. Type de vers et de strophe, organisation des rimes.
b. Disposition des vers.
6. De quelle forme poétique s’agit-il ?
Écrire et réfléchir
7. Charles d‘Orléans ne peut que détester la guerre qui l’a privé de son pays et de sa liberté. La souffrance de l’exilé est toujours de brûlante actualité. La frontière entre la paix et la guerre est aujourd’hui, une fois de plus, très fragile et les États nationaux sont encore les jp acteurs clés de l’histoire. Exprimez votre réflexion sur la situation actuelle de la pensée et de l’action pour la paix.
À la loupe...
L’amour courtois et la poésie italienne
Le modèle courtois italien
La poésie italienne en langue vulgaire naît comme poésie d’amour, et le modèle auquel elle s’inspire est celui de l’amour courtois qui subit les premières modifications à la cour de Frédéric II et surtout après dans le milieu des communes. Le changement est évident surtout dans le rituel de l’amour courtois : dans la poésie française, il était modelé sur l’hommage féodal et sur le rapport du service et de l’attente de la récompense relative, qui n’excluait pas le désir du corps de la femme pour l’amant ; dans la poésie des siciliens, le physique et le corps disparaissent, le centre de l’attention est le cœur, la femme devient un objet de contemplation mentale ou un rêve de bonheur

La femme-ange
Ce n’est pas un hasard si Guido Guinizzelli, dans sa chanson Al cor gentile rempaira sempre Amore, a jeté les bases de cette nouvelle poésie pour laquelle la valeur d’un individu vient de sa noblesse de cœur et c’est lui qui, le premier, a associé l’image de la femme aimée à celle d ’un ange. Chez Guinizzelli aussi, la femme n’est plus un objet de désir et devient femme-ange ; sa fonction est de médiation entre Dieu et les créatures humaines. Cet amour transcende la dimension terrestre pour une dimension purement spirituelle. La femme disparaît comme corps, on ne décrit plus sa beauté, mais on réfléchit sur les effets psychologiques et moraux qu’elle provoque chez les autres. Courtiser une femme n’a plus aucune raison d’être et est remplacé par un nouveau rituel, celui de la louange et de l’hommage.
Guido Cavalcanti ajoute l’amour passion et la personnification des sens, mais le véritable innovateur est Dante, qui porte à l’extrême le processus de spiritualisation religieuse de la femme, pour laquelle le poète a une véritable adoration. Elle est décrite à travers sa beauté, elle devient un idéal, comme si elle était de nature divine ; c’est la femme-ange qui devient une messagère du monde divin et, de cette image, naît le thème du salut.
Comprendre et réfléchir
1. De quoi naît la poésie en vulgaire italienne ?
2. Quelle est une des différences essentielles entre cette poésie et la poésie française ?
3. Qui a jeté les bases de la nouvelle poésie italienne ?

4. Quelle est la fonction de la femme ?
5. Qui porte à l’extrême le processus de spiritualisation de la femme ?
la une

Les troubadours étaient les rappeurs du Moyen Âge?
Troubadours et rappeurs donnent leurs lettres de noblesse à des expressions absentes de la littérature classique, au Moyen Âge comme aujourd’hui

Contrairement aux idées reçues, le Moyen Âge a été une période de très grande fécondité artistique et littéraire. Outre les récits arthuriens ou les chansons courtoises, on trouve notamment certaines formes de poésie et de musique finalement pas si éloignées du rap. D’abord on trouve les troubadours (langue d’oc) ou trouvères (langue d’oïl) qui apparaissent au cours du XIIe siècle. Le rapprochement entre ces chanteurs ambulants et les rappeurs d’aujourd’hui semble assez évident. Premièrement, d’un point de vue formel, la superposition de textes poétiques sur un fond musical est tout à fait propre à ce genre
EGOTRIP ET JOUTES VERBALES. Des punchlines au vers enflammés, de la lyre au beat-box, troubadours m é di é vaux et ra pp eurs actuels se re ssemblent à plus d’un titre. Par leur sens du rythme très développé d’abord, mais surtout par leur très grande facilité à faire de la poésie orale. À cette faculté de s’exprimer aisément à l’oral s’ajoute un autre point commun : l’intérêt porté par les troubadours au langage vernaculaire, aux expressions populaires, loin des canons académiques du latin, langue officielle à l’époque.
ART CONTESTATAIRE. Aux b an q uets des se igneurs comme sur les scènes des salles de concerts, trouvères et MC ( Maste r of Ceremonies f , dans le milieu du rap, ce terme désigne le rappeur) développent le même art contestataire ? L’article du site lerapenfrance cite notamment le cas des « sirventès », un genre musical qui « dénonce les injustices et critique les puissants ». La dimension contestataire de la musique était d’autant plus prégnante au Moyen Âge que l’art se transmettait exclusivement à l’oral parmi les classes populaires, largement illettrées. De quoi tordre le cou à l’idée établie selon



la q uelle le ra p seulement grâce ce genre musica


français est né e à l’émergence de al aux États-Unis
N AU Au développe é gartimen », genre rapproche beaus d’improvisation posentlesrappeurs


DU PARTIMEN AU CLASH. Moyen Âg e se lement le « pa musical qui se coup des joutes verbale qui opposent les rappeurs ( le c l as h ou l a b att le ). Les poètes s’aff f ro nt a i e nt l o r s des p artimen : l e p remier l ançait un thème de débat chanté ; le second improvisait ensuite sur le sujet; le troisième devait enchaîner alors en respectant la mélodie engagée
EGOTRIP ET PRÉFACES. De la même façon, les egotrips des rappeurs, ces textes destinés à se mettre en valeur, souvent au deuxième degré, peuvent se retrouver dans les préfaces des recueils de poèmes du Moyen Âge. Les premières lignes du roman de Thèbes illustrent bien ce parallèle : « qu’ils se taisent tous ceux de ma profession […] ils sont tous aussi capables de m’écouter qu’un âne de jouer de la harpe ».
Comprendre et réfléchir


1. Qu’est-ce qui rapproche les troubadours des rappeurs ?

2. Qu’est-ce qui est facile pour tous les deux ?
3. Qu’est-ce qui rapproche le partimen du clash ?
4. Quel parallèle peut-on retrouver dans les egotrips des rappeurs et les préfaces des recueils du Moyen Âge ? gppp


Dossier 4
La poésie de tradition réaliste
Le réalisme de Villon
Alors que la poésie aristocratique et savante est sur son déclin et que le changement vers le lyrisme personnel s’opère déjà avec Charles d’Orléans, un nouveau lyrisme prend forme avec François Villon, qui fait revivre la tradition personnelle et réaliste des jongleurs. Il se dresse contre le système établi, les lois et les autorités, il ne décrit pas les nuances raffinées de l’amour courtois mais il règle ses comptes avec les personnages auxquels il s’était confronté. Dans sa première œuvre, Les Lais, il s’amuse à donner en héritage à ses amis un soulier, une coquille d’œuf, des cheveux.
Le ton est satirique, mais laisse déjà entendre, face à la mort, une inquiétude que Le Testament amplifie. Villon fait un retour sur sa jeunesse et l’ensemble de sa vie ; le ton reste satirique quand il s’en prend à l’évêque qui l’a emprisonné, mais l’œuvre est le plus souvent lyrique.
Avec ses dernières poésies, dont L’épitapheVillon est la n pièce maîtresse, le ton devient vraiment pathétique.
La force de son art tient à son réalisme et s’affirme en particulier dans la ballade, où il est inimitable. Sa poésie émeut par sa sincérité et il traduit avec une sincérité frémissante de grands sentiments humains, dans une langue réaliste et pittoresque qui frappe celui qui le lit. Si les sujets abordés sont classiques (la mort, la vieillesse, l’injustice, l’amour impossible ou déçu et même l’emprisonnement, qui sont des sujets médiévaux), peu d’auteurs les ont vécus d’aussi près.
La fiction autobiographique
En effet, Villon a brûlé sa vie au fond des tavernes au milieu des gueux, des bandits et des prostituées. Il a été plusieurs fois emprisonné, a été condamné et a réellement frôlé la mort. Sa vie dissolue apparaît dans ses textes et leur donne une profondeur et une sincérité touchante.
L’œuvre de François Villon comme nous la connaissons aujourd’hui forme un ensemble complexe et presque fermé, malgré son hétérogénéité et variabilité. Cet ensemble est unique, car malgré une certaine subjectivité poétique de Villon, elle représente un microcosme de son monde, de l’automne du Moyen Âge avec ses inquiétudes, ses tensions, son système de valeurs. François Villon n’était que fils de son temps, témoin important du bas Moyen Âge. Ce qui différencie radicalement l’œuvre de Villon de toute la production poétique médiévale, c’est qu’il revendique son caractère autobiographique n . Sans être révolutionnaire, il reprend à son compte la tradition littéraire, il se l’approprie et la pervertit pour en faire un porte-voix de sa propre personnalité et de ses états d’âme.
Activités
1. Pourquoi parle-t-on d’un nouveau lyrisme avec François Villon ?
2. Quelle est la nouveauté de l’œuvre de François Villon ?
3. Pourquoi peut-on définir Villon le premier écrivain de la littérature française par rapport aux autres auteurs du Moyen Âge ? çp

L’œuvre
François Villon (1431- ?)
Sa vie
Il naît à Paris en 1431, ses origines sont humbles. Il est orphelin et il est élevé par un prêtre, Maître Guillaume de Villon, qui lui donne son nom. Il étudie à la Sorbonne, mais il songe surtout à s’amuser. Il a de mauvaises compagnies et tue même un prêtre lors d’une rixe. Il obtient des lettres de rémission pour ce meurtre, mais il continue sa vie aventureuse. Il est impliqué dans des vols et on le retrouve souvent en prison à Paris ou ailleurs en France. Le 5 janvier 1463, le Parlement de Paris annule une sentence de condamnation à mort et lui interdit de vivre à Paris pendant dix ans. Après cette date, on perd toute trace de lui
Son œuvre
Toute l’œuvre de Villon est en vers et consiste en deux grands poèmes lyriques : Le Petit Testament et Le Grand Testament,
Le Grand Testament (v. 1462)
COMPÉTENCES
qui comprend diverses ballades. La ballade des pendus ou Épitaphe Villon est écrite plus tard, au moment où le poète, condamné à la potence, s’attend à être pendu. Dans ses poèmes, Villon fait revivre la tradition réaliste et les grands thèmes lyriques comme la piété, la tendresse filiale, le patriotisme, les regrets du passé, les remords, la fraternité et la hantise de la mort. Il est toujours très sincère et se livre à nous tel qu’il a été. Il refuse de s’attendrir sur son sort et il est capable d’ironiser. L’idée de la mort est constante dans son œuvre et le hante continuellement. La langue qu’il utilise est vivante et populaire, son réalisme est puissant et il nous décrit la vérité tragique de la condition humaine. Un problème reste : qui est-il ? Peut-être la réponse est dans un de ses vers : je ris en pleurs, qui exprime bien la dualité de sa personnalité et de sa conscience.
Le Grand Testament est l’œuvre maîtresse de Villon. Il comprend deux parties : dans la première (strophes 1 à 70), le poète nous entretient de lui-même. Repassant en esprit sa vie dissipée, il prend conscience de son indignité et fait d’amers retours sur son cas. Tous, pauvres ou riches, sages ou fous, mourront. L’idée de la mort inéluctable lui inspire alors les admirables Ballades des dames et des Seii gneurs du temps jadis. Dans la seconde partie (strophes 71 à 186), il reprend son testament. Sa pensée reconnaissante est tout d’abord pour Guillaume de Villon, et pour sa pauvre mère. Puis, il songe à sa maîtresse : ce sera, pour elle aussi, une ballade (Ballade à s’amye). Le reste du poème reprend la série de ses lais fantaisistes, les uns ayant une valeur morale, les autres étant des privilèges.

Texte 1
Ballade des dames du temps jadis
François Villon, LE GRAND TESTAMENT
Ce poème est un hommage à des femmes célèbres mais il est avant tout un texte profondément lyrique, où Villon sollicite le lecteur pour lui faire partager sa mélancolie face au temps qui passe.
1 Noms de cour tisanes célèbres.
2 La nymphe Écho, amoureuse de Narcisse, finit par disparaître et il ne reste que la trace de sa voix.
3 Du passé.
Dites-moi où, dans quel pays, Est Flora la belle Romaine, Archipiades, et Thaïs1 , Qui fut sa cousine germaine,
5 Écho2, parlant quant bruit on mène Dessus rivière ou sur étang, Qui beauté eut surhumaine ?
Mais où sont les neiges d’antan3 ?

4 Héloïse, amoureuse d’Abélard, a causé la mutilation du philosophe. Son oncle l’a fait châtrer
5 Marguerite de Bourgogne qui, selon la légende, faisait jeter dans la Seine ses amants, après une nuit passée entre leurs bras.
6 Blanche de Castille, mère de Saint Louis
7 C’est la mère de Charlemagne
8 Héroïnes des chansons de geste
9 Jeanne d’Arc
Où est la très sage Héloïs4 ,
10 Pour qui fut châtré puis f ait moine Pierre Esbaillart à Saint-Denis ? Pour son amour eut cette peine. Semblablement, où est la reine5 Qui commanda que Bur idan
15 Fût jeté dans un sac en Seine ? Mais où sont les neiges d’antan ?
La reine Blanche6 comme un lis Qui chantait à voix de sirène, Berthe au g rand pied7, Biétris, Alis8 ,
20 Haremburg is qui tint le Maine, Et Jeanne, la bonne Lorraine9 Qu’Anglais brûlèrent à Rouen ; Où sont-ils, où, Vierge Souveraine ? Mais où sont les neiges d’antan ?
25 Pr ince, ne demandez cette semaine ni cette année, où elles sont ; Sans que je vous ramène à ce refrain : Mais où sont les neiges d’antan ?
Figure féminine, détail de la fresque du mois d’avvrril, Cycle des Mois de Torre dell’Aquila (XIVe V -XVe V siècles), Trente, Castello del Buonconsiglio

Comprendre Analyser
1. Quel est le thème de cette ballade ?
2. Qui sont les femmes dont Villon parle ? Remplissez la grille. Femmes Identité
3. À qui est adressé l’envoi ?
4. L’énumération des femmes célèbres suit l’ordre de l’histoire, mais aussi un ordre thématique. Quel est le thème qui se superpose à l’ordre historique ?
5. La mention de Jeanne d’Arc : à l’époque elle n’est pas encore canonisée, elle n’est pas citée comme exemple de beauté et de séduction amoureuse. Quelle est donc sa place dans cette ballade ? Comment définir son héroïsme ?
6. Rien n’est plus fragile que la neige : quel est son rapport avec toutes les dames mentionnées ?
7. Est-ce que le refrain est rattaché au sujet dominant du texte ?
8. Pourquoi Villon invoque-t-il la Vierge et non Dieu ? Et pourquoi, à votre avis, Villon a choisi comme destinataire de la ballade un prince de ce monde ?
9. L’envoi témoigne-t-il un sentiment profane ou religieux de l’existence ? « Les neiges d’antan », métaphore pour les créatures humaines, ont-elles disparu à jamais, ou bien se retrouveront-elles dans l’au-delà ? La mort est-elle disparition définitive ou y a-t-il l’espérance chrétienne de la résurrection ?
10. Quels sont les temps que Villon utilise dans cette ballade ? Pourquoi ?
11. Quels types de phrases utilise-t-il tout au long du texte ? Pourquoi ?
12. Quelle est l’originalité de Villon en exprimant son sentiment de nostalgie ?
Écrire
13. Alors qu’il médite sur la fuite du temps, il exprime son angoisse pour la dimension tragique de la condition humaine : partagez-vous son angoisse ? Avez-vous la perception de la vieillesse ? Ou bien le présent vous absorbe-t-il entièrement ? Exprimez-vous sur ce sujet.
Texte 2
Ballade des pendus
François Villon, LE TESTAMENT
Le poète, condamné à la potence, attend d’être pendu. Les pendus, à l’époque, étaient laissés au bord des routes comme exemple pour les autres. Villon imagine que son corps de pendu et ceux de ses compagnons s’adressent aux passants. Son titre authentique est Épitaphe Villon.
Frères humains qui après nous vivez, N’ayez pas vos cœurs durcis1 à notre égard, Car si vous avez pitié de nous pauvres, Dieu aura plus tôt miséricorde de vous.

5 Vous nous voyez attachés ici, cinq, six : Quant à notre chair, que nous avons trop nourrie, Elle est depuis longtemps dévorée et pourrie2 , Et nous, les os, devenons cendre et poussière. De notre malheur, que personne ne se moque,
10 Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre !
Si nous vous appelons frères, vous n’en devez Avoir dédain, bien que nous ayons été tués Par justice. Toutefois vous savez
Que tous les hommes n’ont pas l’esprit bien rassis3
15 Excusez-nous, puisque nous sommes trépassés, Auprès du fils de la Vierge Marie, De façon que sa g râce ne soit pas tarie4 pour nous, Et qu’il nous préserve de la foudre infernale. Nous sommes morts, que personne ne nous tourmente,
20 Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre !
La pluie nous a lessivés5 et lavés Et le soleil nous a séchés et noircis6 ; Pies7 , corbeaux nous ont crevé8 les yeux, Et arraché9 la barbe et les sourcils.
25 Jamais un seul instant nous ne sommes assis ; De ci de là, selon que le vent tourne, Il ne cesse de nous ballotter à son g ré, Plus becquetés d’oiseaux que dés à coudre10 Ne soyez donc de notre confrérie,
30 Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre !
Pr ince Jésus, qui a puissance sur tous, Fais que l’enfer n’ait sur nous aucun pouvoir : N’ayons rien à f aire ou à solder11 avec lui. Hommes, ici pas de plaisanter ie12 , 35 Mais pr iez Dieu que tous nous veuille absoudre.
Comprendre
1. Analysez les thèmes de la ballade

a. Le premier thème est la demande des pendus : que souhaitent-ils pour eux-mêmes ?
b. Le second thème est la leçon que les pendus offrent aux hommes : que souhaitent-ils pour les autres, les vivants ?
c. Le troisième thème est la description des cadavres pendus : comment sont-ils décrits ?
2. Parmi les détails, certains sont horribles, d’autres apparaissent sous une forme moins sérieuse, plus pittoresque. Lesquels ?
Analyser Écrire
3. Comment Villon parvient-il à associer les vivants et les morts dans une seule communauté ?
4. Comment le poète instaure-t-il une solidarité entre les pendus et le reste de l’humanité ? Le refrain n’est-il qu’une formule conventionnelle ou a-t-il une résonance plus profonde ?
5. La ballade alterne l’appel à la pitié et le spectacle de l’horreur. La condition des pendus est d’un réalisme hallucinant. Relevez les détails qui tendent à susciter l’horreur.
6. L’angoisse du poète : craint-il la mort physique ou encore davantage la mort spirituelle ?
7. Comment le destin de l’homme dans l’au-delà est-il perçu ?
8. La chanson française a une longue tradition de textes poétiques mis en musique. La Ballade des dames du temps jadis a été interprétée par Georges Brassens et la Ballade des pendus a été chantée par Serge Reggiani et Léo Ferré. La chanson se fait véhicule oral d’une tradition écrite en réintroduisant au profit d’un large public des textes parfois oubliés
a. Selon vous, quel rapport y a-t-il entre poésie et musique ? Qui gagne et qui perd dans cet échange ?
b. La chanson profane-t-elle la poésie ?
c. Si la poésie est expression de la pensée, la musique peut-elle distraire ou favoriser la méditation ?
À la loupe...
La ballade: un genre à forme fixe
La ballade au Moyen Âge
La poésie avait connu, au Moyen Âge, une véritable floraison, grâce aux poètes-musiciens qui fréquentaient les cours de France et d’Angleterre et composaient des poèmes toujours musicaux reflétant une conception nouvelle de l’amour, appelée fin’amor, qui r prônait le dévouement total de l’amant à sa dame :
c ’est l’amour courtois. Vers la fin du Moyen Âge, la décadence de cet idéal courtois, de la chevalerie et de la féodalité, favorise le développement de nouveaux genres poétiques, d’inspiration plus personnelle. Cette tendance, déjà présente chez Rutebeuf au XIIIe siècle, s’épanouit surtout au XVe siècle dans les œuvres de Charles d’Orléans et de François Villon.
C’est après Guillaume de Machaut (1300 ?-1377 ?)
q ue le texte est de moins en moins chant é , p our devenir seulement une forme poétique avec Eustache Deschamps (1346 ?-1407 ?)
La ballade est la forme poétique la plus pratiquée au cours du XIVe et XVe siècles. Elle doit son nom au provençal ballada (de balar : danser) et désigne une composition pour la danse, une chanson à danser. C’est un poème à forme fixe composé de : trois ou cinq strophes de 8 ou 10 vers construites sur les mêmes rimes et le même rythme ; un envoi composé de 4 ou 5 vers (une moitié de strophe) qui commence par une adresse à celui à qui la ballade est dédiée, en général c’est le mot « Prince »
Le dernier vers de la première strophe est repris à la fin de chaque strophe et à la fin de l’envoi. Il forme
comme un re f rain. Le vers le plus employé est le d écas y llabe, l ’octos y llabe est moins fréquent. Les contraintes de la ballade imposent au poète un jeu de trois ou quatre rimes pour l’ensemble de sa composition.
Les mêmes rimes sont reprises dans toutes l es strophes et dans le même ordre, ce qui nécessite du poète une grande richesse de vocabulaire (il existait d’ailleurs des dictionnaires de rimes pour aider cette recherche). Les 4 premiers vers de la ballade sont construits sur la même rime, en général une rime croisée : abab. Pour le huitain (strophes de 8 vers), la rime suit le schéma : ABABBCBC ; pour les dizains (strophes de 10 vers) : ABABBCCDCD ; mais il existe aussi de nombreuses variantes.
La ballade romantique
Ce poème à forme fixe n’a rien en commun avec la ballade romantique, poème de forme libre. Au XXe s i è cle , le mot ballade renvoie à u ne forme fixe et aussi à un genre qui associe la liberté de la prose et le ry thme du vers, permettant de renouer avec les sources folkloriques et légendaires de la poésie française
Comprendre et réfléchir
1. D’où vient le nom ballade ?
2. Comment est-elle composée ?
3. Pourquoi dans la ballade l’auteur peut-il exprimer un lyrisme plus personnel ?
À la une
Les pendus, de Villon à De André




Villon et De André sont liés par un fil, un rapport qui ressemble à celui qui existe entre maître et élève.

Dans la préface d’un livre des poèmes de Villon De André nous transmet l’héritage de ce grand poète, pas seulement ce qu’il a représenté pour la poésie française, mais aussi pour lui. Il nous dit qu’il doit à la Ballade des pendus le contenu de son album de 1968 Tutti morimmo a stento, qui rappelle certains aspects du texte de Villon


De André écrit :
Caro François, Nel 1963 mi capitò di leggere su un quotidiano che in Sud Africa le autorità celebravano senza saperlo il cinquecentesimo anniversario della tua scomparsa: la corte di Johannesburg aveva destinato all’impiccagione otto presunti malviventi, naturalmente neri. L’estensore dell’articolo così descriveva il disperato infantile esorcismo del loro terrore: “Ballavano e cantavano sotto le corde prima di essere appesi”. Poi si dilungava appena nel macabro dettaglio del subito dopo. “Scalciarono per un po’, alcuni sono durati un attimo, altri qualche minuto”.
Mi prese la rabbia giusta per scrivere una ballata. [ … ] Se non avessi trovato in te un così importante predecessore probabilmente la mia canzone non porterebbe il titolo che tu mi hai suggerito: finalmente trovo l’occasione per ringraziarti. Più di una volta nel chiudere il libro delle tue ballate mi sono chiesto che cos si nasconda dietro i tuoi versi: la vita inquieta e mascalzona del poeta di strada o l’astuzia premeditata del cortigiano colto che di quella vita si è appropriato per conferire una credibilità altrimenti sospetta alla propria opera poetica. Sono domande alle quali ancora oggi mi viene da rispondere con un perentorio “chi se ne frega”. Che la leggenda corrisponda a verità, che la verità si sia fatta leggenda o che infine la leggenda sia diventata verità, di assolutamente vero restano i tuoi versi. [ ]

Nel tuo testamento è sempre un regalare, anche scherzoso e crudele, qualche cosa a qualcuno, con la sgangherata prodigalità di chi è fuori da ogni casta e non appartiene a niente e a nessuno.
Così che nessuno, scrittore o poeta, pensatore o saggista, giurista o filosofo che abbia voluto trattare il dolore o la gioia del corpo e del cuore ha potuto rinnegare la tua eredità o esimersi dal confrontarsi con la magia della tua parola. [ ]
Penso a tutti i poeti francesi che sono arrivati dopo di te. [… ]

À la une
Les pendus, de Villon à De André


La Ballata degli impiccati
Fabrizio De André

Tutti mor immo a stento ingoiando l’ultima voce tirando calci al vento vedemmo sfumare la luce.
5 L’urlo travolse il sole
l’ar ia divenne stretta cristalli di parole
l’ultima bestemmia detta
Prima che fosse finita
10 ricordammo a chi vive ancora che il prezzo fu la vita per il male f atto in un’ora
Poi scivolammo nel gelo di una mor te senza abbandono
15 recitando l’antico credo di chi muore senza perdono.
Chi derise la nostra sconfitta e l’estrema vergogna ed il modo soffocato da identica stretta
20 impari a conoscere il nodo.
Chi la terra ci sparse sull’ossa e riprese tranquillo il cammino giunga anch’egli stravolto alla fossa con la nebbia del primo mattino.
25 La donna che celò in un sorriso il disag io di darci memoria r itrovi ogni notte sul viso un insulto del tempo e una scoria.
Coltiviamo per tutti un rancore
30 che ha l’odore del sangue rappreso ciò che allora chiamammo dolore è soltanto un discorso sospeso.
Analyse du texte
Dès le titre, Ballata degli impiccati, la chanson de De André fait clairement référence au poète du XVe V siècle.
En examinant le texte, nous pouvons comprendre que, pour tous les deux, le pendu n’est pas un criminel qu’il faut condamner, mais un symbole : c’est le symbole de la condition humaine qui voit l’homme comme un désespéré à l’agonie, marchant sur un fil tendu entre le mal et la mort.
Ce qui change entre les deux auteurs est la façon qu’ils ont de se comporter face à l’autre.
De André le fait avec l’invective, il souhaite au spectateur, pour qu’il comprenne, les mêmes douleurs et les mêmes sensations que celles éprouvées par le pendu ; Villon l’appelle frère et l’invite à prier pour lui et pour les autres pendus dans la miséricorde de Dieu qui aura ainsi pitié d’eux.
Si la Ballade des pendus est, sans aucun doute, un vibrant appel à la solidarité et à la compréhension humaine et divine, c’est différent pour De André. Il n’y a aucune pitié pour celui qui les a fait mourir lentement de façon atroce, non sans mal.
Les pendus de De André meurent avec la certitude qu’ils ne seront pas pardonnés ; les pendus de Villon meurent en espérant l’être.
Aucun des deux n’en est certain, mais ce qui est sûr est que la perspective est différente
Comprendre et réfléchir
1. Quels sont les points en commun aux deux textes ?
2. Entre la solidarité et l’appel à la compréhension humaine et divine de Villon et la rage des pendus de De André, que choisissez-vous ? Motivez votre réponse.
Dossier 5
Le théâtre médiéval
Le début du théâtre
L’origine du théâtre est religieuse Dès le début du Xe siècle, l’église l’utilise pour illustrer aux fidèles qui ne savent pas lire des scènes de la Bible ou de la liturgie. Le théâtre est joué en latin, par des hommes d’église, pour étendre l’influence ecclésiastique dans les populations. Dans la seconde moitié du XIIe siècle, apparaît un théâtre en langue vulgaire, autrement dit en français, et le premier drame que nous connaissons est le Jeu d’Adam (joué vers 1165). Les jours de fêtes religieuses et de foires, la population se concentre dans les cités médiévales et va voir les représentations des jongleurs qui racontent des histoires et des légendes. Le théâtre va profiter de cette situation et sortir des églises, sur le parvis, pour toucher un public plus important. On va commencer à construire les scènes et les décors pour remplacer le décor naturel constitué par la structure de l’église. Du XIIIe au XIVe siècle, les miracles et les mystères commencent à être joués, ils racontent la vie des saints et leurs actions et le plus connu est Le Mii racle de Théophile de Rutebeuf (1260). e
Le théâtre profane
Toujours à la fin du XIIe siècle, apparaît un théâtre intermédiaire entre le théâtre religieux et profane : ce sont des textes plus longs, les jeux. Les plus connus sont Le Jeu de Saint Nicolas (Jean Bodel) ou Cour tois d’Arras La ville d’Arras voit la naissance de la Confrérie des Jongleurs et Bourgeois d’Arras
qui sont des artistes qui commencent à jouer des œuvres profanes, sans rien de sacré. La première pièce de théâtre prof ane qui est arrivée jusqu’à nous est l’œuvre d’un trouvère arrageois Adam de la Halle, Le Jeu de la Feuillée de 1276. e
La naissance de la farce
À la fin du Moyen Âge, les farces et les sotties (sermons joyeux) sont les pièces les plus représentées et elles annoncent ce que sera le théâtre de Molière au XVIIe siècle. Elles ont pour thème la vie quotidienne, et le comique est simple et efficace. La plus importante est La Farce de Maître Pathelin qui date peut-être de 1465.
Dans ces pièces, les villes et les habitants servent de modèles et on y retrouve le vilain (paysan) simple et parfois rustre, le bourgeois préoccupé par son argent, le moine qui vend des reliques, le médecin (un vrai charlatan), le noble (souvent un chevalier courtois), les compagnons de beuverie et la femme infidèle. À côté de ces personnages, le fou, ou parfois la folie, est utilisé pour critiquer la société médiévale ou pour se moquer des codes des autres personnages. Le jeu des acteurs est basé sur l’exagération des mouvements du corps et du visage et on utilise sur tout la caricature des personnages. Les costumes et les accessoires sont ceux des hommes médiévaux, les décors utilisent des symboles allégoriques ou sont plutôt réalistes, et certaines pièces sont aussi chantées et dansées.
Activités
1. Lisez et indiquez si les phrases sont vraies (V) ou fausses (F), puis corrigez les fausses. V F
1. Au début, le théâtre est joué en latin
2. Le théâtre doit illustrer des scènes de la Bible et de la liturgie.

3 Les Confréries naissent à Arras.
4 . Les farces parlent des saints.
5. Les acteurs ont un jeu très simple.
2. Pourquoi le théâtre religieux est-il né ?
3. Pourquoi les décors sont-ils nés ?
4. Quels sont les thèmes et les personnages des farces ?
La Farce de Maître Pathelin (1465)

La peinture des mœurs
Plus que d’une farce il s’agit d’une comédie de mœurs et caractères, digne d’une comparaison avec les pièces de Molière. Sans autre intention que de faire rire les spectateurs avec la peinture des mœurs de la bourgeoisie et du peuple, cette farce est encore actuelle. Elle est anonyme, mais des indices font penser que les personnages
L’historie
Pathelin est un avocat sans clients. Sa femme, Guillemette, a besoin de drap et Pathelin lui promet de s’en procurer gratis. Il se rend chez un drapier et se fait donner du drap, en lui demandant de venir se faire payer à la maison. Quand le marchand arrive, Pathelin fait semblant d’être gravement malade et, avec la complicité de sa femme, il joue la
Texte 1
sont normands par les pièces de monnaie qu’ils utilisent et par la corporation des drapiers qui était très forte à Rouen, ville qui comptait aussi un grand nombre d’avocats. Il est possible que cette pièce date de 1465 environ, parce qu’on fait allusion au grand froid de l’année 1464 et, déjà en 1470, on trouve le premier emploi du verbe pateliner pour faire semblant d’être malade
comédie. Le drapier repart sans argent, convaincu de la maladie de Pathelin
Un client se p ré sente à la maison de l’avocat : c’est le berger du drapier, accusé d’avoir volé et mangé des moutons. Pathelin conseille à son client de répondre toujours Béé ! aux questions du juge. Au tri b unal, le dra p ier reconnaît en
Parlez plus bas
P athelin l’avocat q ui l’a trom p é et s ’embrouille en p assant du dra p aux moutons.
Le juge finit par le croire fou et répète sans cesse : revenons à nos moutons ! Le p roc è s termin é , Pathelin demande au berger d’être payé. Le berger répond avec B éé ! à Pa thelin. Pa thelin tro mpeur est trompé à son tour
La farce de Maître Pathelin, SCÈNE V Pathelin avec le drap est rentré à la maison et, avec Guillemette, il organise la mise en scène de la maladie.
GUILLEMETT E Que Dieu me protège ! Bas ! Si vous ne voulez qu’il ne s’éveille !
LE DRAPIER Comment « bas » ? À l’oreille ? Au fond du puits ? ou de la cave ?

GUILLEMETT E Dieu ! Quel bavard ! D’ailleurs, c’est toujours votre manière
LE DRAPIER Quand le diable y serait, maintenant que j’y pense ! Si vous voulez que je parle bas… Dites donc ! De telles discussions jamais je ne fis l’expérience. Ce qui est vrai, c’est que maître Pierre a pris six aunes1 de drap aujourd’hui
GUILLEMETT E (Élevant la voix.) Eh quoi ? Allez-vous persister toute la journée ? Le diable s’en mêle ! Voyons ! Comment, « prendre » ! Ah ! monsieur ! puisse-t-on pendre qui ment ! Il est en tel état, le pauvre homme, qu’il n’a pas quitté le lit de onze semaines ! réalisezvous ? Par les angoisses de Dieu, suis-je malheureuse ! vous déciderez-vous à vous éloigner de ma maison ?
LE DRAPIER Vous me disiez de parler si bas ! Sainte Vierge bénie ! Et vous criez !
GU ILLEMETT E C’est vous, par mon âme, qui ne faites que quereller !
LE DRAPIER Dites, afin que je m’en aille, donnez-moi…
GUILLEMETT E (S’oubliant encore et cr iant.) Parlez bas ! Enfin !
LE DRAPIER Mais vous-même allez l’éveiller ! Palsambleu2 ! Vous parlez quatre fois plus fort que moi ! Je vous somme de me payer !
GUILLEMETT E Qu’est-ce ? Êtes-vous ivre ? ou fou ? Au nom de Dieu notre Père ?
LE DRAPIER Ivre ? Mauvais gré vous en ait saint Pierre ! Belle demande !
GUILLEMETT E Hélas ! Plus bas !
LE DRAPIER Je vous demande, Madame, par Saint Georges, le prix de six aunes de drap.
3 Expression de douleur
4 Pathelin fait semblant de délirer et prononce des noms sans aucun sens.
5 Ornement sacerdotal qu’on passait au cou des possédés du démon
6 Pathelin feint de prendre le drapier pour un médecin
Comprendre
GUILLEMETT E (À part, puis haut.) Comptez là-dessus ! Et à qui avez-vous remis le drap ?
LE DRAPIER À lui-même.
GUILLEMETT E Il est bien en état d’acheter du drap ! Hélas ! Il ne bouge. Il n’a nul besoin de se faire tailler une robe. Jamais il ne revêtira une robe, sinon une blanche, et il ne quittera le lieu où il est que les pieds devant
LE DRAPIER Le mal a donc commencé au lever du soleil ? Car, sans faute, c’est bien à lui que j’ai parlé.
GUILLEMETT E (D’une voix perçante ) Vous avez la voix tellement forte ! Parlez plus bas, par charité !
LE DRAPIER C’est vous, en vérité, vous-même, sacré Dieu ! Palsambleu ! c’est vraiment beaucoup d’embarras ! si on me payait je m’en irais ! (À part.) Par Dieu, chaque fois que j’ai fait crédit, je n’ai jamais récolté autre chose.
PATHELIN N (Couché.) Guillemette ! Un peu d’eau rose ! Redressez-moi. Relevez les coussins derrière moi ! Fichtre3 ! À qui est-ce que je parle ? Le pot à eau ! À boire ! Frottez-moi la plante des pieds !
LE DRAPIER Je l’entends là.
GUILLEMETT E Bien sûr !
PATHELIN N Ah ! méchante ! viens ici ! T’avais-je dit d’ouvrir ces fenêtres ? Viens me couvrir ! Chasse ces gens noirs ! Marmara ! Carimari ! Carimara4 ! Emmenez-les moi ! Emmenez !
GUILLEMETT E (À l’intérieur.) Qu’est-ce ? Comme vous vous démenez ! Avezvous perdu le sens ?
PATHELIN N Tu ne vois pas ce que je sens. (Il s’ag ite .) Voilà un moine noir qui vole. Attrape-le ! Passe-lui une étole5 ! Au chat, au chat ! Comme il monte !
GUILLEMETT E Eh ! Qu’est ceci ? N’avez-vous pas honte ? Eh ! Par Dieu ! C’est trop remuer !
PATHELIN N (Retombant épuisé.) Ces médecins m’ont tué avec ces drogues qu’ils m’ont fait boire. Et toutefois il faut les croire ! Ils nous manient comme de la cire !
GUILLEMETTE E (Au drapier.) Hélas ! Venez le voir, cher monsieur, il est au plus mal.
LE DRAPIER Vraiment, il est malade, depuis l’instant où il est revenu de la foire ?
GUILLEMETT E De la foire ?
LE DRAPIER Par saint Jean, oui ! Je crois qu’il y est allé. (À Pathelin.) Du drap que je vous ai donné à crédit il me faut l’argent, maître Pierre !
PATHELIN N Ah ! maître Jean, plus dures que pierre j’ai chié deux petites crottes, rondes comme pelotes. Prendrai-je un clystère6 ?
1. Qui sont les protagonistes ? À quelle classe sociale appartiennent-ils ?
2. Guillemette est aussi digne comédienne que son mari : entre son rôle et celui de son époux, lequel est plus difficile à jouer ?
3. Le personnage du drapier suscite-t-il de la sympathie ? Fait-il preuve de sottise ?
Analyser Écrire
4. Relevez les différentes formes de comique de la scène :
a. comique de situation, de répétition ;
b. de mœurs, d’incohérence verbale
5. Outre les avocats et les marchands, y a-t-il la satire d’une autre classe sociale ?
6. L’intention de la farce est de faire rire et réfléchir en s’amusant. Relevez la leçon qu’on tire de l’histoire de Pathelin et dites si elle vous paraît encore actuelle
La chevelure
• En quoi la puissance de la chevelure couvre le domaine visuel, tactile et esthétique ?
La chevelure est l’un des attributs de la personne. Elle est également, autour du thème de la femme et de l’amour, à la fois symbole de beauté et signe du corps. Aussi est-elle un thème poétique par excellence : le poète y recourt pour exprimer une forme de sensualité, souligne son aspect mouvant (qui figure les vagues, les ondulations du désir et du plaisir), brillant (elle est dorée, lumineuse, moirée), note son abondance, sa douceur au toucher, la noblesse qu’elle confère. Ce lien ancestral entre la chevelure et la séduction est exprimé d’une façon directe dans l’art et la littérature. À travers les textes et les tableaux, les auteurs ont traité ce rapport et l’ont montré de diverses façons, des portraits de la littérature courtoise (DOC 1), à ceux du Dolcestilnovo DOC 3, de Baudelaire (DOC 2) à Degas (DOC 4) et à la psychiatrie (DOC 5).
Doc
16
Sandro Botticelli, Portrait d’une jeune femme (14761480), Berlin, Gemäldegalerie der Staatlichen Museen

Lancelot ou le Chevalier à la charrette (entre 1176 et 1181)
Chrétien De Troyes
Et lui, qui veut bien qu’elle ait le peigne, Le lui donne, et en retire les cheveux, Si doucement qu’il n’en rompt aucun. Jamais yeux humains ne verront
5 Honorer à ce point aucune chose, Car il commence à les adorer, Et les touche bien cent mille fois, Et les porte à ses yeux, à sa bouche, À son front, et à son visage ;

10 Il n’est aucune joie qu’il ne manifeste ; Il en est très heureux, il en est très riche ; En son sein, près de son cœur, il les range Entre sa chemise et sa chair.
Il ne prendrait pas en échange un char
Doc
15 Rempli d’émeraudes et d’escarboucles1 ; Il ne croyait pas que le chancre
Ou quelque autre mal pût le prendre, Il dédaigne le dimargateron
Et la pleuriche et la thériaque2
20 Et même saint Martin et saint Jacques : Car il a tant confiance en ces cheveux
Qu’il n’a pas besoin de leur aide ; Mais de quel prix étaient les cheveux : On me tiendra pour un menteur et un 25 Fou, si j’en dis la vérité :
Si la foire du Lendi battait son plein, Et si les marchandises y abondaient, Le chevalier ne voudrait pas les posséder Toutes, c’est la vérité,
30 Et ne pas avoir trouvé les cheveux.
Et, si vous me demandez la vérité à ce sujet, De l’or cent mille fois affiné, Et refondu autant de fois, Aurait paru plus obscur que ne l’est la nuit
35 Par rapport au plus beau jour d’été
Qu’il y ait eu cette année, Pour celui qui aurait vu l’or et les cheveux En les mettant côte à côte.
Le Spleen de Paris (1869)
Charles Baudelaire
Henri-Edmond Cross, La chevelure (v. 1892), Paris, Musée d’Orsay.

17 EUROPASS © Casa Editrice G. Principato
1 Variété de grenat rouge foncé

1. Quelle est la réaction de Lancelot dès qu’il trouve le peigne ? Comment le traite-t-il?
2. Est-ce qu’il fait une différence entre ce qui appartient à Dieu et à la femme ?
3. Est-ce que ces cheveux sont décrits ?

Laisse-moi respirer longtemps, longtemps, l’odeur de tes cheveux, y plonger tout mon visage, comme un homme altéré dans l’eau d’une source, et les agiter avec ma main comme un mouchoir odorant, pour secouer des souvenirs dans l’air
Si tu pouvais savoir tout ce que je vois ! tout ce que je sens ! tout ce que j’entends dans tes cheveux ! Mon âme voyage sur le parfum comme l’âme des autres hommes sur la musique Tes cheveux contiennent tout un rêve, plein de voilures et de mâtures; ils contiennent de g randes mers dont les moussons me portent vers de charmants climats, où l’espace est plus bleu et plus profond, où l’atmosphère est parfumée par les fruits, par les feuilles et par la peau humaine. D ans l’océan de ta chevelure, j ’entrevois un p ort fourm illant de chants mélancoli q ues, d’hommes vi g oureux de toutes nations et de navires de toutes formes découpant leurs architectures fines et compliquées sur un ciel immense où se prélasse l’éternelle chaleur.
5 10 15
Comprendre et réfléchir
1. Relevez le champ lexical de l’odorat et du parfum.
2. Précisez l’image de cette femme à travers sa description.
3. Qu’est-ce qu’est la chevelure pour le poète ?
Dans les caresses de ta chevelure, je retrouve les langueurs des longues heures passées sur un divan, dans la chambre d’un beau navire, bercées par le roulis imperceptible du port, entre les pots de fleurs et les gargoulettes rafraîchissantes. D ans l’ardent foyer de ta chevelure, j e res p ire l’odeur du tabac mêlé à l’opium et au sucre; dans la nuit de ta chevelure, je vois resplendir l’in f ini de l’azur tropical; sur les rivages duvetés de ta chevelure je m’enivre des odeurs combinées du goudron, du musc et de l’huile de coco. Laisse-moi mordre longtemps tes tresses lourdes et noires. Quand je mordille tes cheveux élastiques et rebelles, il me semble que je mange des souvenirs.
Doc 3
Canzoniere (1342)
Francesco Petrarca

Le poème joue sur le contraste entre Laure de leur première rencontre, quand elle était jeune et très belle, et Laure aujourd’hui, qui a vieilli et dont la beauté extérieure s’est fanée.
Erano i capei d’oro a l’aura sparsi che ‘n mille dolci nodi gli avolgea, e ‘l vago lume oltra misura ardea
4 di quei begli occhi, ch’or ne son sì scarsi;
e ‘l viso di pietosi color’ f arsi, non so se vero o falso, mi parea: i’ che l’esca amorosa al petto avea, 8 qual meraviglia se di sùbito arsi:
Non era l’andar suo cosa mortale, ma d’angelica forma; e le parole sonavan altro che, pur voce umana;
12 uno spirto celeste, un vivo sole fu quel ch’i’ vidi: e se non fosse or tale, piagha per allentar d’arco non sana
Au g ré du vent flottait sa blonde chevelure, Qui formait mille nœuds les plus délicieux ; Un éclat excessif brillait dans ses beaux yeux,
4 Qui maintenant en sont privés outre mesure.
Sur ses traits était peinte une pitié si pure ! Si j’ai vu bien ou mal, j’en suis encor douteux. Qui serait donc sur pris qu’aussitôt ses doux feux
8 M’aient embrasé, l’amorce étant dans ma nature :
On aurait dit un ange, et le timbre enchanteur De sa voix n’avait rien de la nature humaine, Et son port et sa marche annonçaient une reine.
12 Mes yeux virent en elle un soleil de splendeur, Un tout céleste espr it. Si maintenant moins belle Elle est, ma passion n’en est pas moins cruelle.
Comprendre et réfléchir
1. Comment les cheveux sont-ils décrits ?
2. Sur quoi se concentrent les yeux du poète ?
3. Que dit-il dans les derniers vers ?
4. Turiddu comprend-il qu’il va mourir ?

Femme se coiffant (entre 1887 et 1890)
Edgar Degas, PARIS, MUSÉE D’ORSAY
Ce tableau est un chef-d’œuvre p our la cou p e innovatrice et le rendu des couleurs. L’image représente une femme qui se peigne : la perspective est de bas en haut, et le corps féminin est partiellement caché par les longs cheveux roux et par la serviette autour de la taille. La femme est représentée dans une attitude curieuse qui la fait ressembler à un violoniste : le peigne dans sa main droite ressemble à un archet de violon, et sa main gauche semble tendue pour mieux entendre le son des notes. Les cheveux et les gestes occupent le premier plan et caractérisent la composition, alors que l’artiste efface le visage de la femme, tourné et caché dans l’ombre. La lumière, qui vient de la droite, frappe le bras plié et est concentrée sur le drap blanc autour des hanches.
Comprendre et réfléchir
1. Quelle place occupent les cheveux dans la composition ?
2. Le décor est-il bien mis en évidence ?
3. Voit-on le visage de la femme ? Pourquoi ?
Une coloration pour nous plaire et pour séduire
Certaines d’entre nous aiment changer de couleur fréquemment ; d’autres gardent leur teinte naturelle, même quand elle se pare de cheveux blancs... Pour Françoise Millet-Bartoli, psychiatre, le soin que nous apportons à colorer - ou non - nos cheveux n’est jamais anodin. Il en dit long sur le regard que nous portons sur nous-même et le message que nous voulons transmettre.
Pourquoi nous colorons-nous les cheveux ?
Françoise Millet-Bartoli Il existe toute une symbolique du cheveu, de sa longueur, de sa texture et bien sûr, de sa couleur. Nous sommes toujours fortement influencées, marquées par la connotation de la couleur que nous portons naturellement. Même s’il n’est pas possible d’établir de règle générale, nous avons plus tendance à associer le blond à notre enfance, à notre histoire familiale, tandis que le brun a plutôt une connotation plus piquante, plus séduisante. Si la couleur naturelle est importante, celle que nous choisissons dans un acte de coloration est très significative car elle fait suite à une prise de position décidée, consciente.
En changeant de couleur de cheveux, quel message cherchons-nous à transmettre ?
Françoise Millet-Bartoli L’envie d’un changement f ort, que ce soit dans la coupe ou dans la couleur, est souvent liée à des moments importants de notre vie. Difficulté, deuil, séparation, choc, changement de cap professionnel ou personnel : ces événements sont souvent à l’orig ine de cette métamor phose. C’est une façon de nous donner la force de repartir à zéro, avec une personnalité que nous voulons mieux armée pour affronter la vie, en tous les cas, différente. Les changements radicaux de couleur sont souvent un moyen de nous retrouver, d’être plus en phase avec nous-même. Nous gardons alors cette nouvelle tête, abandonnant l’ancienne à notre vie “d’avant”.
Certaines voient aussi dans le changement de couleur un moyen de choquer, se démarquer, d’annoncer un désaccord, une envie profonde de contestation. C’est souvent le cas des adolescents en pleine mutation qui s’octroient le langage des cheveux pour mieux parler d’eux-mêmes. Là, il s’agit d’un cap, d’une transition qui aboutit à autre chose de généralement plus apaisé et sage.
Qu’est-ce que le fait de changer de couleur de cheveux régulièrement dit de nous ?
Françoise Millet-Bartoli Troquer une tête pour une autre, un style pour un autre peut constituer, chez certaines d’entre nous, un rite de passage. Pour d’autres, la couleur comme la coupe, sont des accessoires. Celles qui changent en permanence, passent du châtain au roux, du roux au blond, répondent à une autre démarche psycholog ique. C’est une quête d’une nouvelle image de soi, que l’on cherche sans parfois jamais la trouver. Ces femmes sont souvent en quête d’une certaine stabilité dans leur identité, qui requiert auparavant qu’elles la testent, qu’elles la mettent à l’épreuve. Cela passe par le cor ps et par les cheveux en particulier.
C’est une démarche narcissique qui n’est pas sans révéler une certaine fragilité.
Qu’est-ce qu’une coloration apporte dans notre relation aux autres ?
Françoise Millet-Bartoli U ne nouvelle couleur de cheveux se passe avant tout entre soi et soi. Nous sommes f ace à notre miroir, chez nous ou chez le
coiffeur si nous avons préféré lui faire confiance. Puis, en sortant du salon ou en poussant la porte de la maison, nous sommes confrontés au regard de l’autre. Les y eux de l’autre constituent alors un véritable miroir de soi. Il peut être source de douleur si cette personne ne remarque pas un changement que nous a vons j ustement voulu remar q uable. Nous ris q uons alors de nous senti r absents, inexistants, non reconnus. Une nouvelle cou p e, une nouvelle couleu r vont généralement de pair. Ils ont pour but de nous mettre p lus à l’aise avec notre corps, ma i s ten d ent une perc h e à ceux qui nous regardent. On veut se pl a i re ma i s auss i sé d u i re ou, en tout cas, induire un regard sur soi différent, que ce soit dans la séduction ou dans la contestation.
Quand le résultat n’est pas celui escompté, la coloration peut donc fragiliser l’image de soi ?
Comprendre et réfléchir
1. Quel thème affronte cet article ?
2. Pourquoi changeons-nous souvent de couleur ou de coupe ?

3. Quelle est l’importance de l’autre dans notre rapport avec nos cheveux ?
Françoise Millet-Bartoli Tout à fait, nous pouvons ne pas du tout nous reconnaître quand le changement a été trop radical. Dans ces cas, un sentiment de dépersonnalisation peut apparaître, comme cela pourrait être le cas suite à une i ntervent i on d e c hi rurg i e est h ét i que. L’ avantage d e l a co l orat i on est qu ’ e ll e est toujours réversible. Toutefois, il faut garder à l’esprit que chez les femmes a imant chan g er de couleur ré g ulièrement, ce g este p eut être q uel q ue chose d’amusant mais également de très angoissant. Il n’est jamais sans impact sur l’image que nous avons de nous-même
Que dit ce changement léger de couleur de nous ?
Françoise Millet-Bartoli I l y a tou j ours, d ans ce type d e co l orat i on, une démarche de séduction. La question qu’il f aut alors se poser est « qui cherche-ton à séduire » ? Est-ce que l’on cherche à se séduire soi-même, à se plaire ? Estce que l’on veut plutôt séduire les autres ? Chacune d’entre nous a sa propre réponse
Object d’étude ESABAC
1. En rapprochant les documents 1 et 2, que pouvez-vous dire de la chevelure ?
2. Qu’ajoute le document 3 ?
3. Dans le document 4, quel est son rôle ?
4. Quel type de problème affronte le document 5 ?
5. À partir de vos connaisances personnelles et des documents proposés, exposez brièvement pourquoi la chevelure constitue l’un des traits physiques aux significations les plus complexes
Le Moyen Âge Synthèse visuelle

Littérature
1 La littérature épique
La littérature épique présente l’idéal de la société féodale, fait de courage, de fidélité et de soumission à dieu et au roi, souvent représenté par la figure de Charlemagne. Le protagoniste de cette littérature est le chevalier, un héros qui combat pour cet idéal et pour son seigneur, que La Chanson de Roland a très bien mis en scène
La Chanson de Roland (XIIe siècle)
• épopée
• honneur
• prouesse
• héroïsme
• féodalité
2 Le récit courtois et satirique
Le récit courtois, né au sein de la cour, déplace l’intérêt vers des thèmes plus appropriés aux goûts des Dames. On y parle d’amour et de la vie matérielle. Les protagonistes sont les chevaliers, et les philtres d’amour et les mages entrent dans les romans de Chrétien de Troyes qui illustrent ce nouveau genre. Le public bourgeois préfère la satire, une littérature plus réaliste, qui complète la vision du monde médiéval. Le Roman de Renart représente parfaitement ce type de récits
Thomas d’Angleterre (XIIe siècle)
• amour et souffrance
• amour et mort
• fatalité de la passion
Chrétien de Troyes (v. 1135-1185)

• esprit courtois
• chevalerie
• merveilleux médiéval
Le Roman de Renart (fin du XIIe siècle)
• littérature satirique
3 La poésie didactique et lyrique
Le Roman de la Rose, considérable par son ampleur, sa richesse et son influence est l’œuvre maîtresse de la poésie didactique. Son but est de donner un enseignement pratique, moral et scientifique. Avec la poésie lyrique, les sentimentspersonnels des auteurs deviennent le thème portant des textes. La poésie devient un métier et doit répondre à des règlesde composition
Guillaume de Lorris (1200 ?-1238 ?)

• poésie didactique
• allégorie

• l’art d’aimer
Bernart de Ventadour (v. 1125-1200)
Christine de Pisan (1363/4-1430)
Rutebeuf (deuxième moitié du XIIIe siècle)
Charles d’Orléans (1394-1465)
• poésie lyrique
• chansons d’amour

• langue d’oc
• lyrisme bourgeois
Époque Mérovingienne (Ve-VIIIe siècles)
• Le rois Clovis se convertit au catholicisme

• Charles Martel arrête l’invasion arabe à Poitiers
Époque carolingienne (VIIIe-Xe siècles)
• Charlemagne
• Législation territoriale uniforme
• Renaissance intellectuelle
4 La poésie de tradition réaliste
Avec une certaine décadence de la féodalité, les goûts du public changent. On s’intéresse aux problèmes personnels, on partage les sentiments des auteurs et Villon est le maître incontesté de cette nouvelle poésie qui affronte des thèmes macabres comme la mort, la souffrance et l’exil
Francois Villon (1431- ?)
• lyrisme personnel
• réalisme
• puissance d’évocation
• ballade
Époque Capétienne (Xe-XVe siècles)
• Hugues Capet roi
• Les Croisades et le Schisme d’Occident
• La Guerre de Cent ans
5 Le théâtre médiéval
C’est à l’intérieur des églises que le théâtre est né comme représentation du culte mais, bien vite, le genre a évolué. La représentation a eu lieu à l’extérieur et on a dû créer des décors ; les comédiens de profession sont apparus ; la farce a acquis ses lettres de noblesse et s’est conservée jusqu’à nous. La Farce de Maître Pathelin est le plus bel exemple de pièce de théâtre médiéval
La farce de Maître Pathelin (1465)
• comique
• tromperie
L’art roman domine la première partie du Moyen Âge p
L’art gothique apparaît au XIIe siècle : les cathédrales s’élancent vers le ciel
Le Moyen Âge Testez vos connaissances et compétences
Histoire et Société
1. Indiquez si les phrases sont vraies (V) ou fausses (F), puis corrigez les fausses.
1. Le Moyen Âge a été marqué par trois grandes périodes.
2. Clovis ne s’est jamais baptisé.
3. Charlemagne favorise une renaissance intellectuelle
4. Les Vikings envahissent les côtes de la Bretagne.
5. Hugues Capet hérite de la couronne de France
6. Sous Philippe le Bel, la papauté s’installe à Avignon.
7. Jeanne d’Arc a été trahie.
8. Louis XI participe à deux croisades.
9. La société est divisée en trois ordres.
10. Le seigneur doit à son vassal l’ost-assistance militaire
Art
1. Quand l’art roman se développe-t-il ?
2 Que devient l’église grâce aux symboles des chapiteaux ?
3. Pourquoi, dans l’art gothique, les cathédrales s’élancent vers le ciel ?
4. Qu’apporte en plus le gothique flamboyant ?
5. Quelle est l’inspiration des tapisseries ?
6. Qui a écrit les manuscrits ?
7. Que sont les enluminures ?
8. Quel type de tradition naît pendant le Moyen Âge ?
Littérature
3. Complétez les phrases avec les mots manquants. héros – personnages – Villon – didactique – théâtre – chevalier – poésie – farce –l’époque – ballade – littérature – satirique – rondeau – religion
1. Les chansons de geste sont une (1) ______________ de propagande
2. La littérature courtoise met au centre les aventures du (2) ______________
3. La littérature (3) ______________ naît dans les bourgs et les (4) ______________sont des bourgeois.
4. La (5) ______________ lyrique est à l’origine musicale.
5. Les (6) ______________ de Chrétien de Troyes sont des chevaliers courtois.
6. Au XIVe V siècle apparaissent la (7) et le (8)
7. La poésie (9) ______________ produit des œuvres qui ont une vocation morale.
8. La poésie de (10) ______________ se démarque de la poésie de (11) ______________
9. Le (12) ______________ est à l’origine en latin et a comme thèmes la (13)
10. La (14) ______________ s’impose au XVe V siècle.
Auteurs et œuvres
4. Complétez la grille.
Auteurs Œuvres Genres
La Chanson de Roland

Thomas d’Angleterre
Perceval ou le Conte du Graal
Roman courtois
Récit satirique
Guillaume de Lorris
Jean de Meung
Bernart de Ventadour Poésie lyrique
Rondeaux
Rutebeuf
Charles d’Orléans Ballades
Inconnu
Le point sur... François Villon
5. 20 Complétez le texte avec les mots manquants, puis vérifiez avec l’écoute.
Théâtre, comédie
nostalgie – pardon – châtiment – thème – potence – corbeaux – illustres – soleil – fuite – pluie – mort – humains – compagnons – ballades
La Ballade des dames du temps jadis a pour (1) _____________ le temps passé qui ne reviendra plus.
Villon évoque des femmes (2) et exprime toute sa (3) à l’égard du passé, de la (4) du temps et de l’inéluctabilité de la (5) La ballade des pendus ou Épitaphe Villon demeure l’une des plus célèbres de ses (6) . Le poète attend son (7) et se voit déjà, avec ses (8) d’infortune, pendu à la (9) , trempé par la (10) , desséché par le (11) , dévoré par les (12) . Il demande le (13) et la miséricorde pour lui et pour ses frères (14)
6. Préparez un exposé multimédia sur François Villon (sa vie, ses genres littéraires, ses thèmes, ses œuvres principales) et exposez-le à la classe.
Réflexion et production
7. Écrivez un compte-rendu sur Tristan et Iseut – Présentation de la période ou de l’œuvre. – Présentation et commentaire de l’œuvre et des thèmes affrontés – Considérations personnelles.
8. Préparez une description écrite du personnage de Charlemagne et n’oubliez pas de préciser le contexte historique et social.
