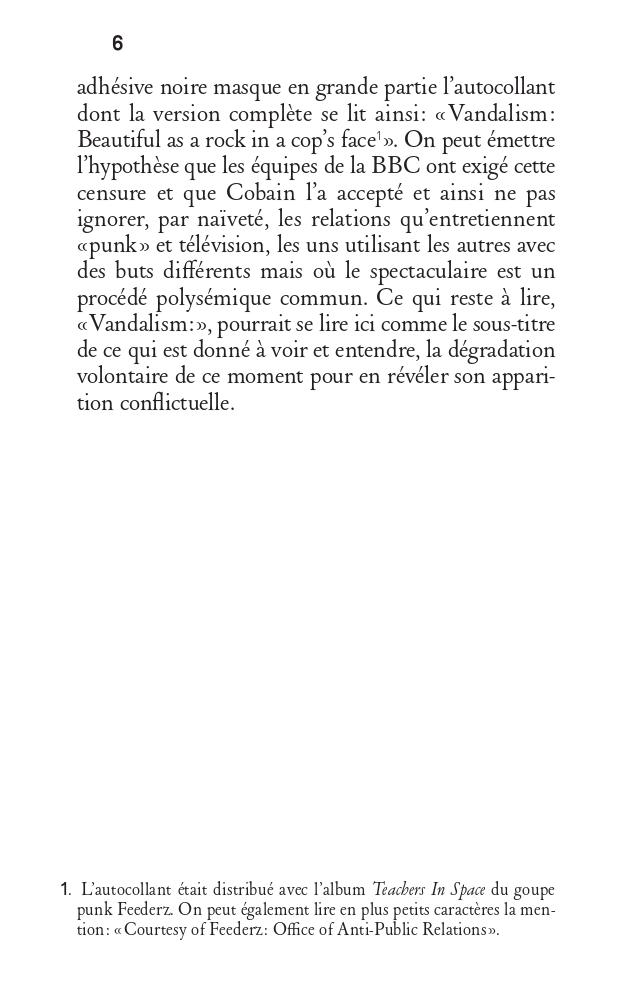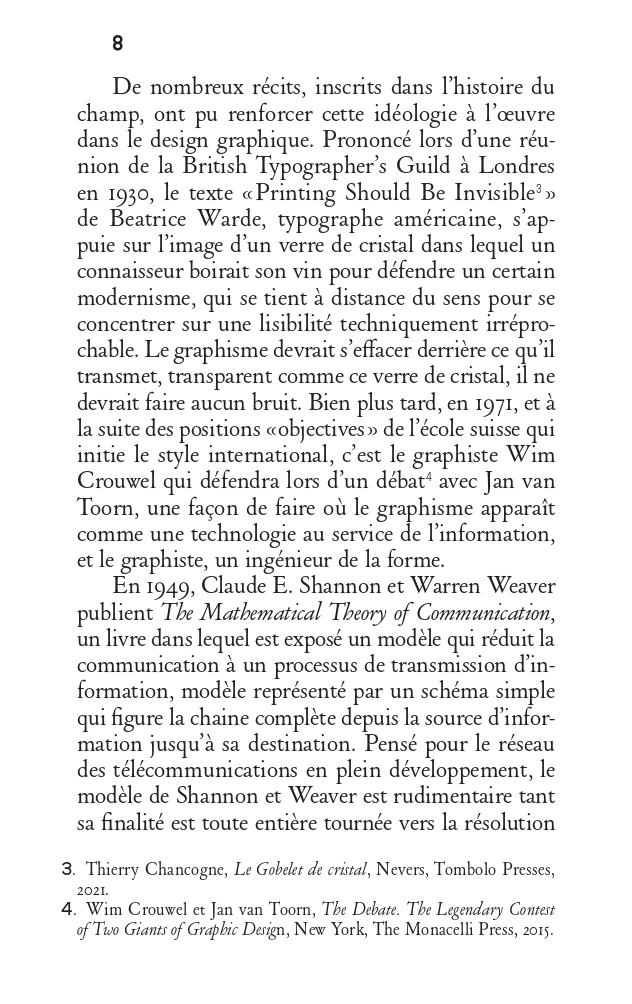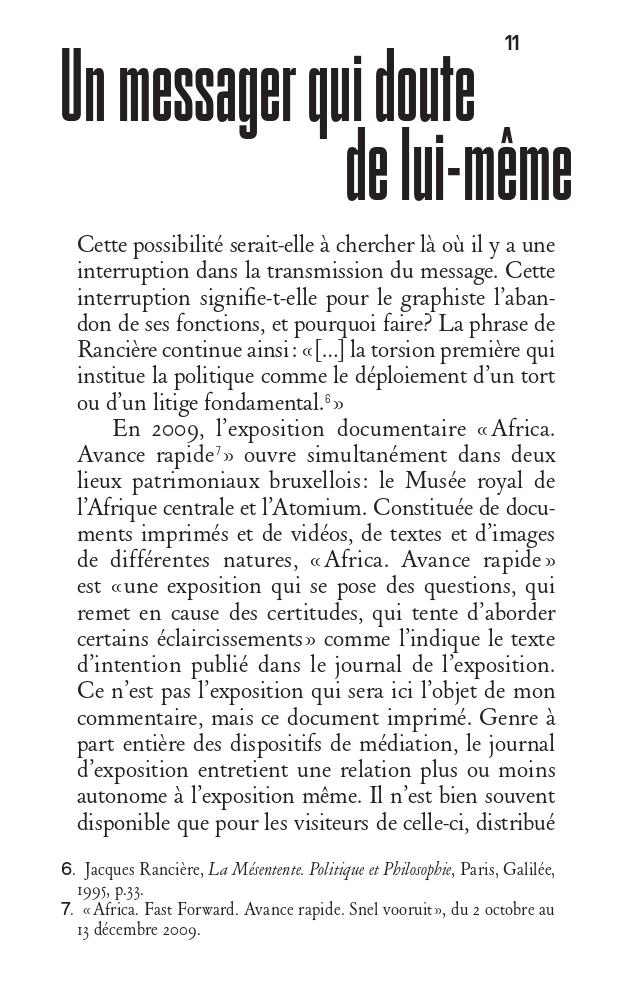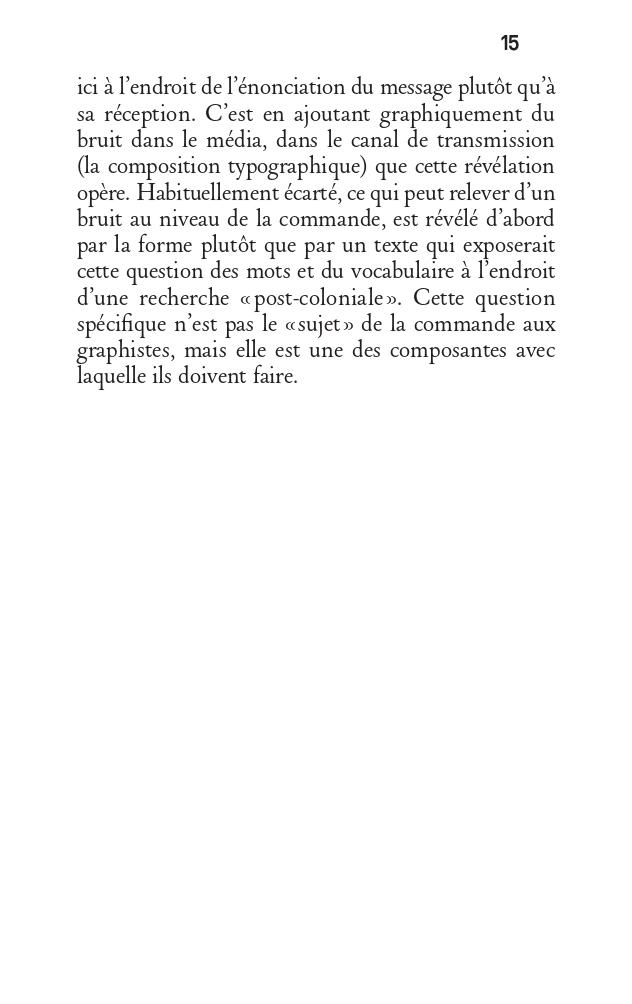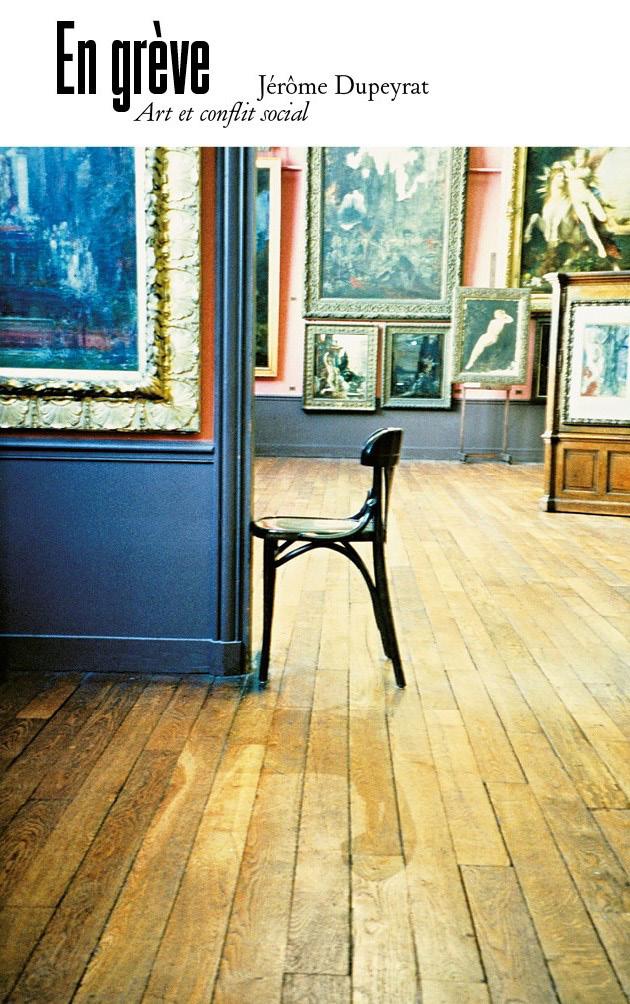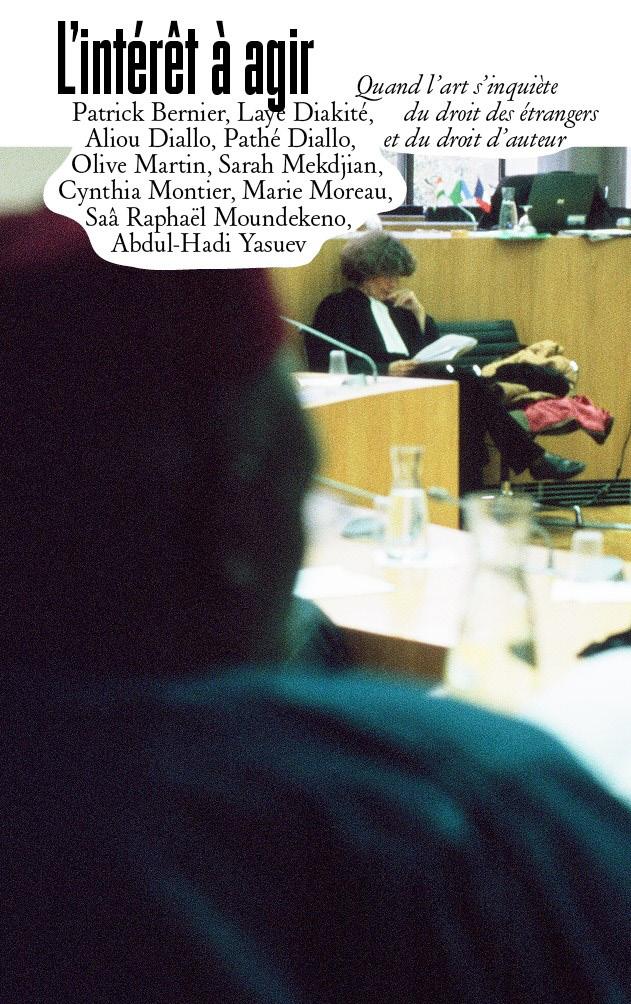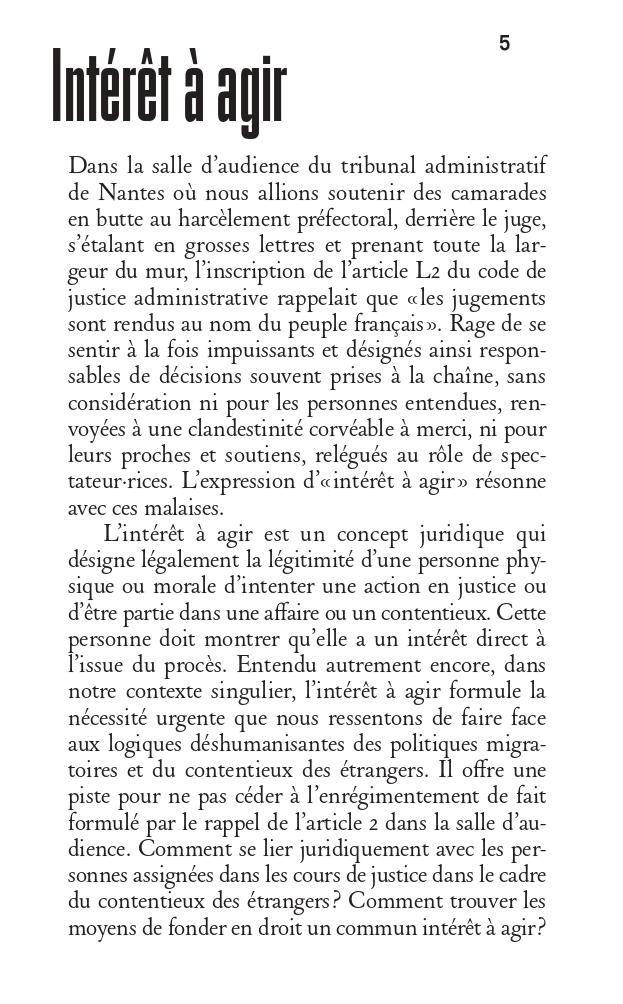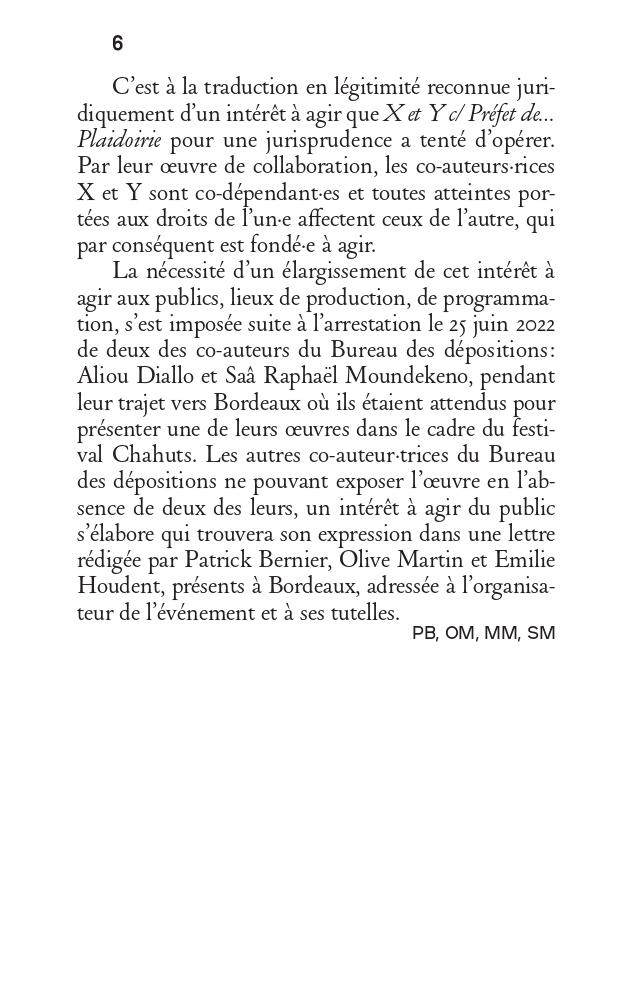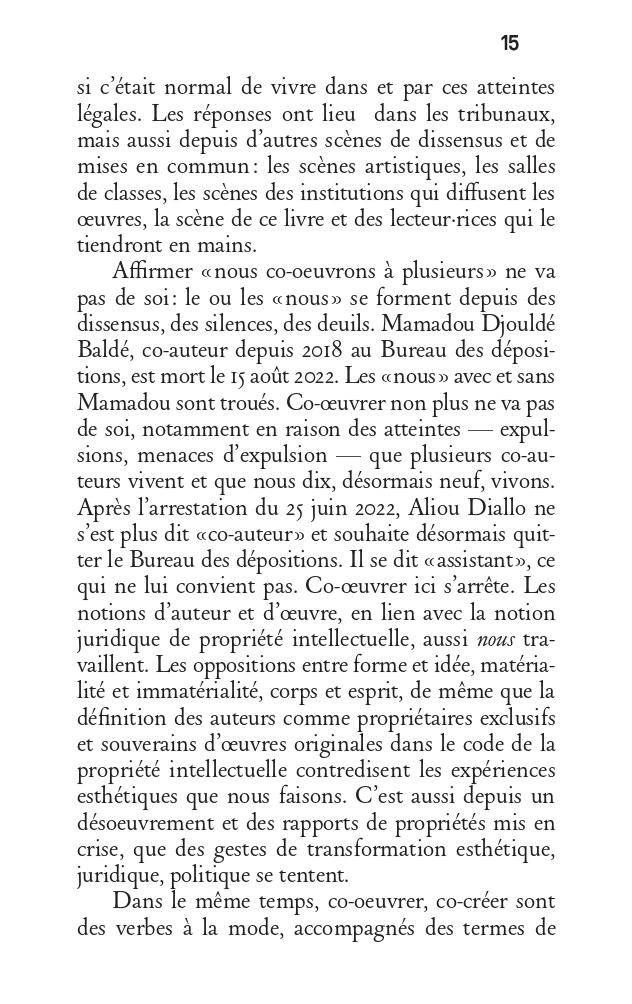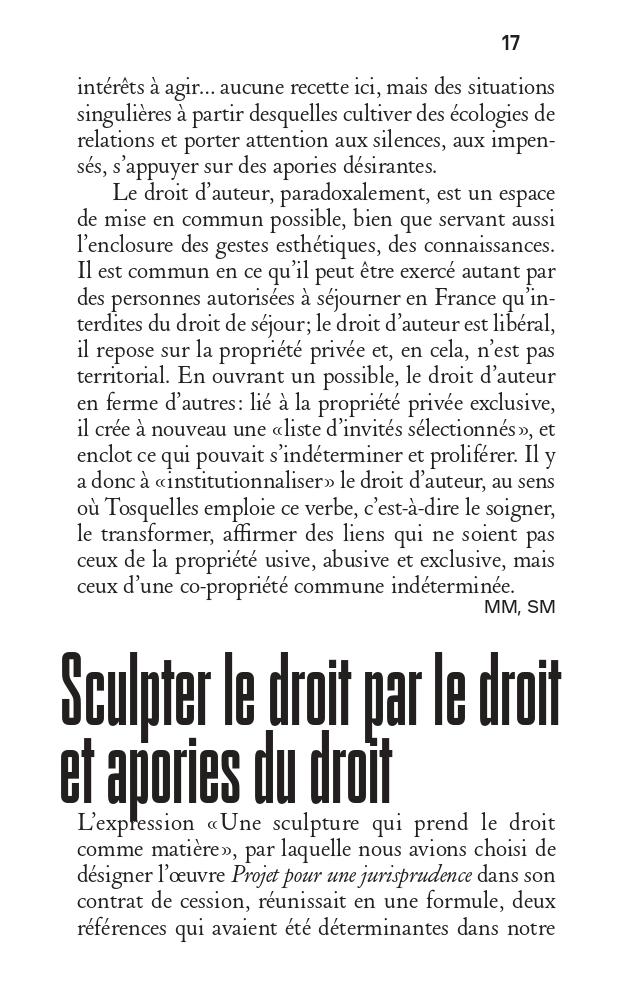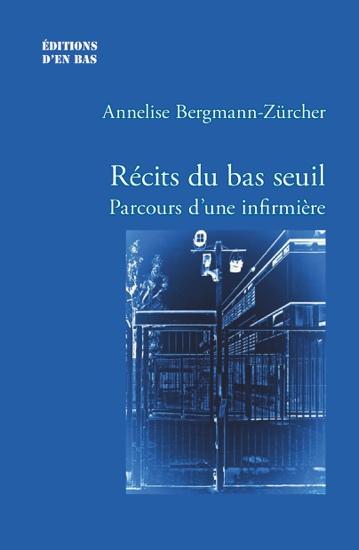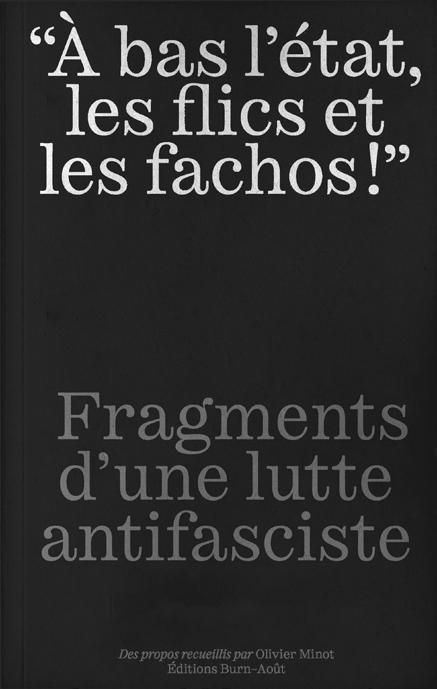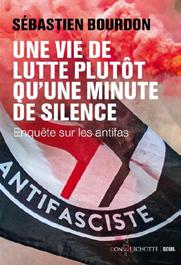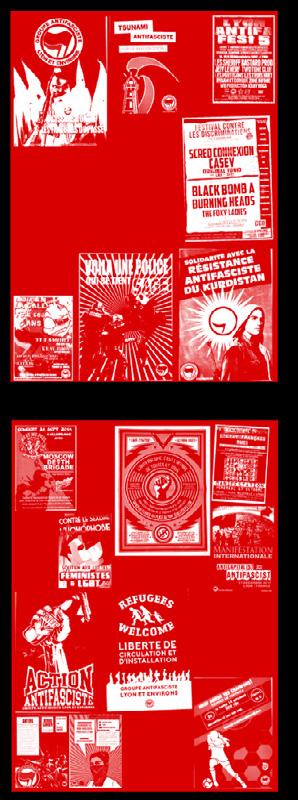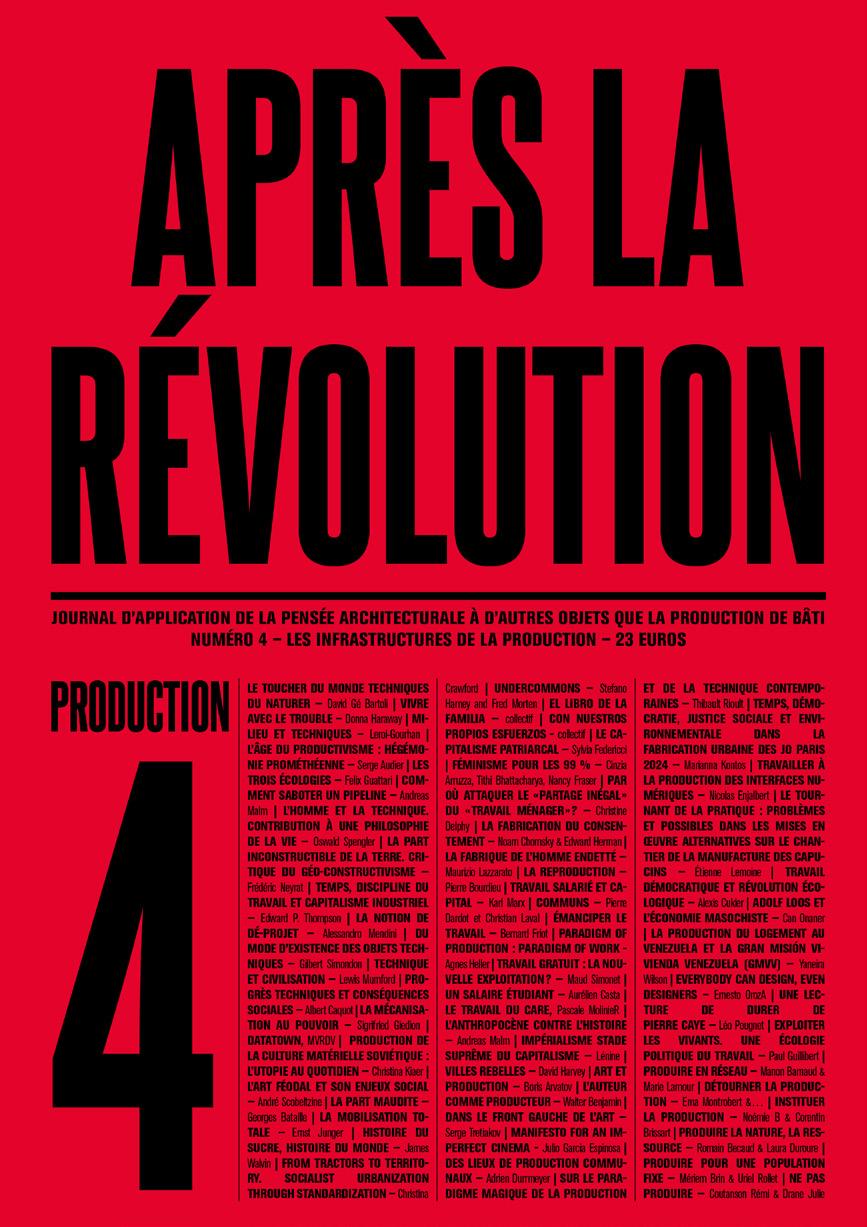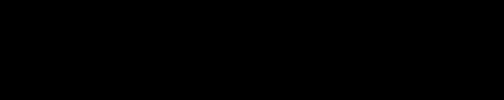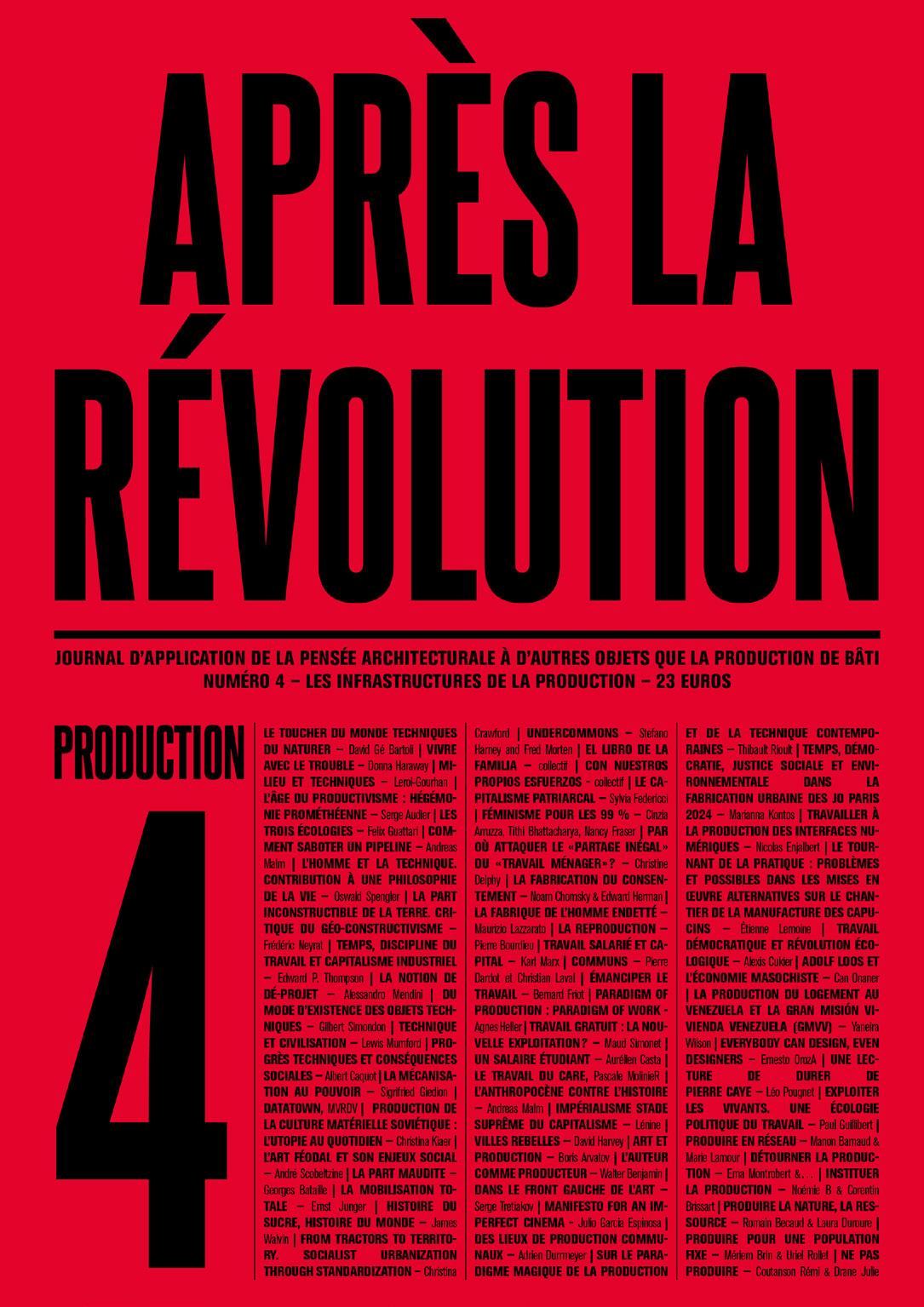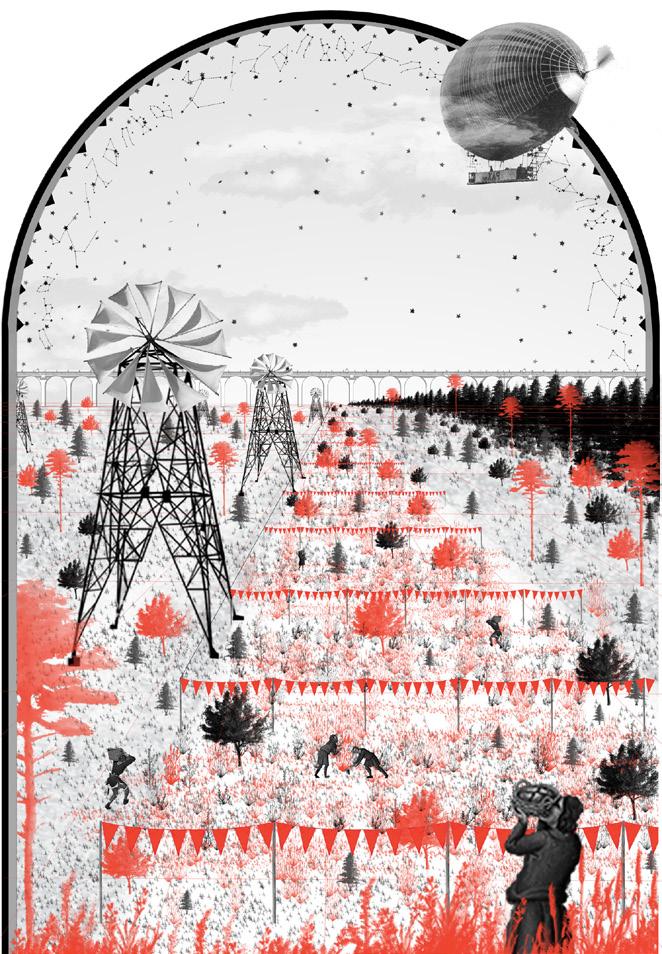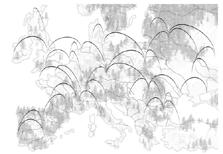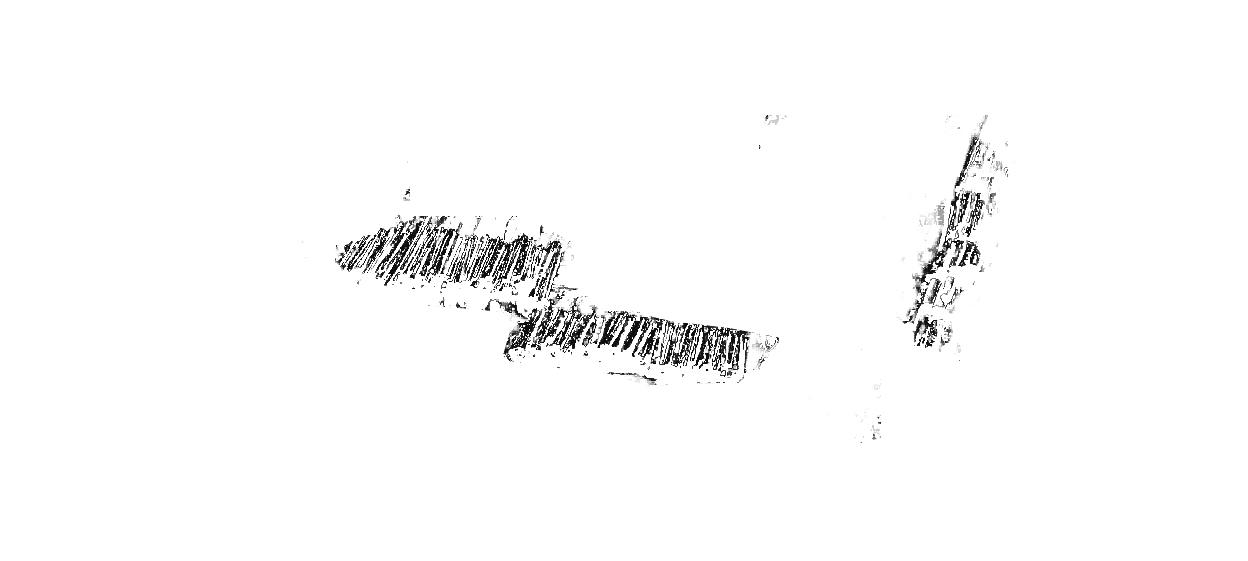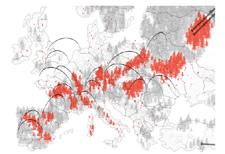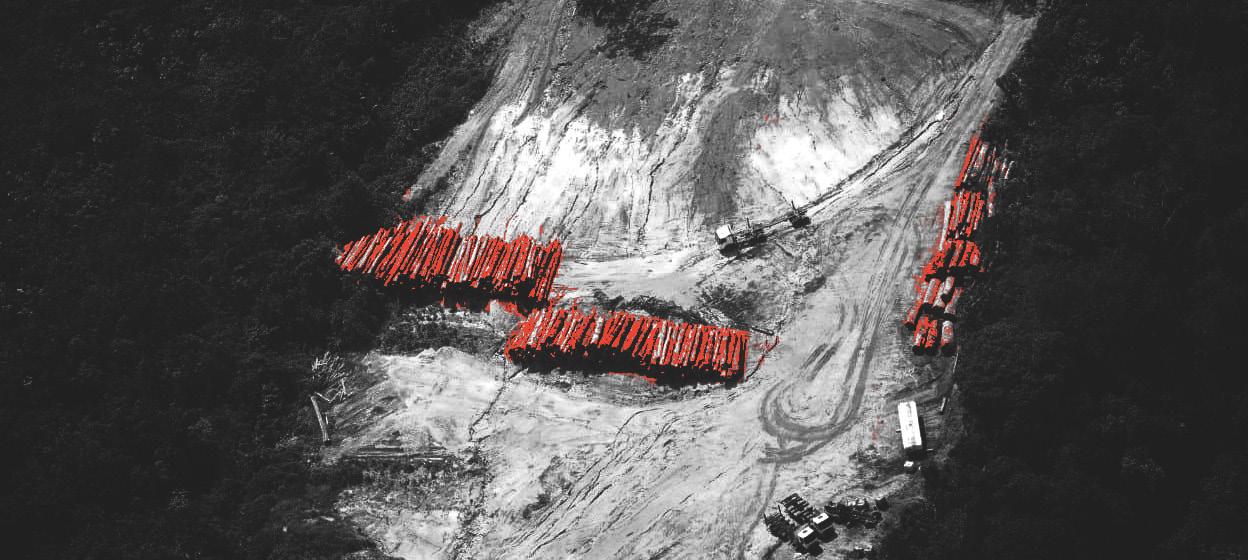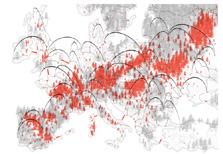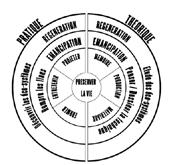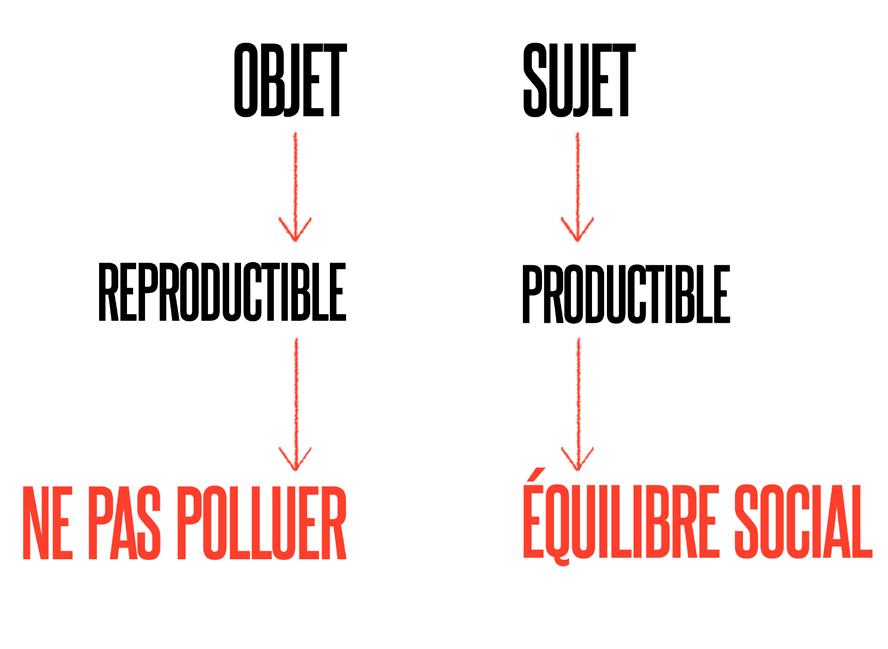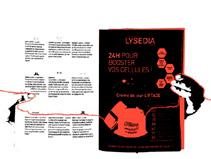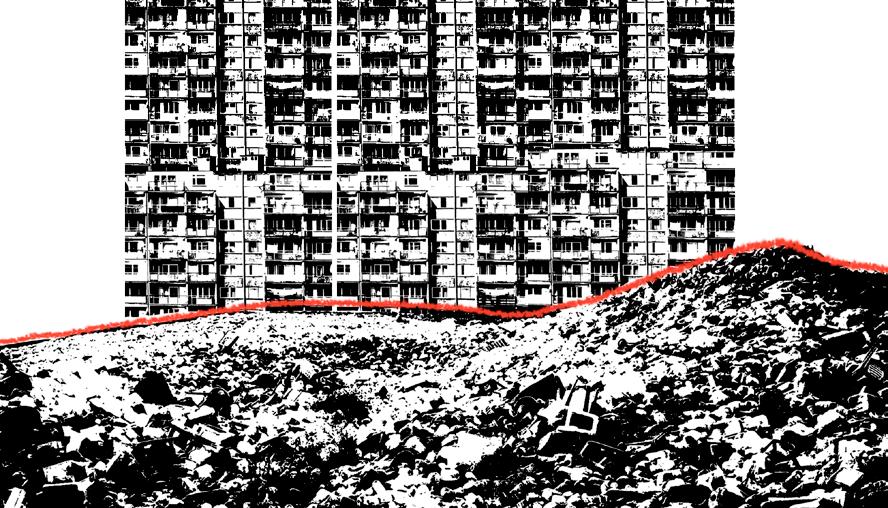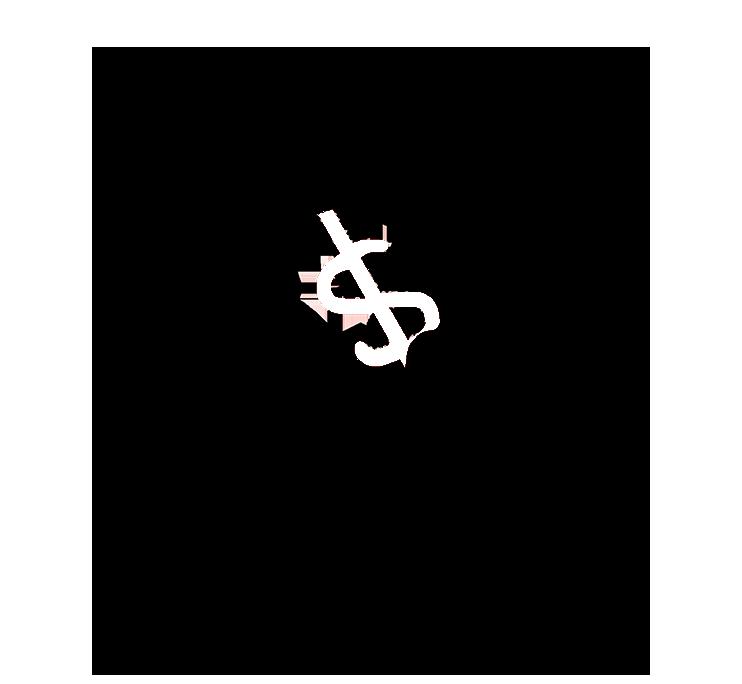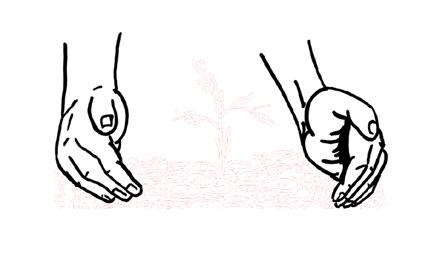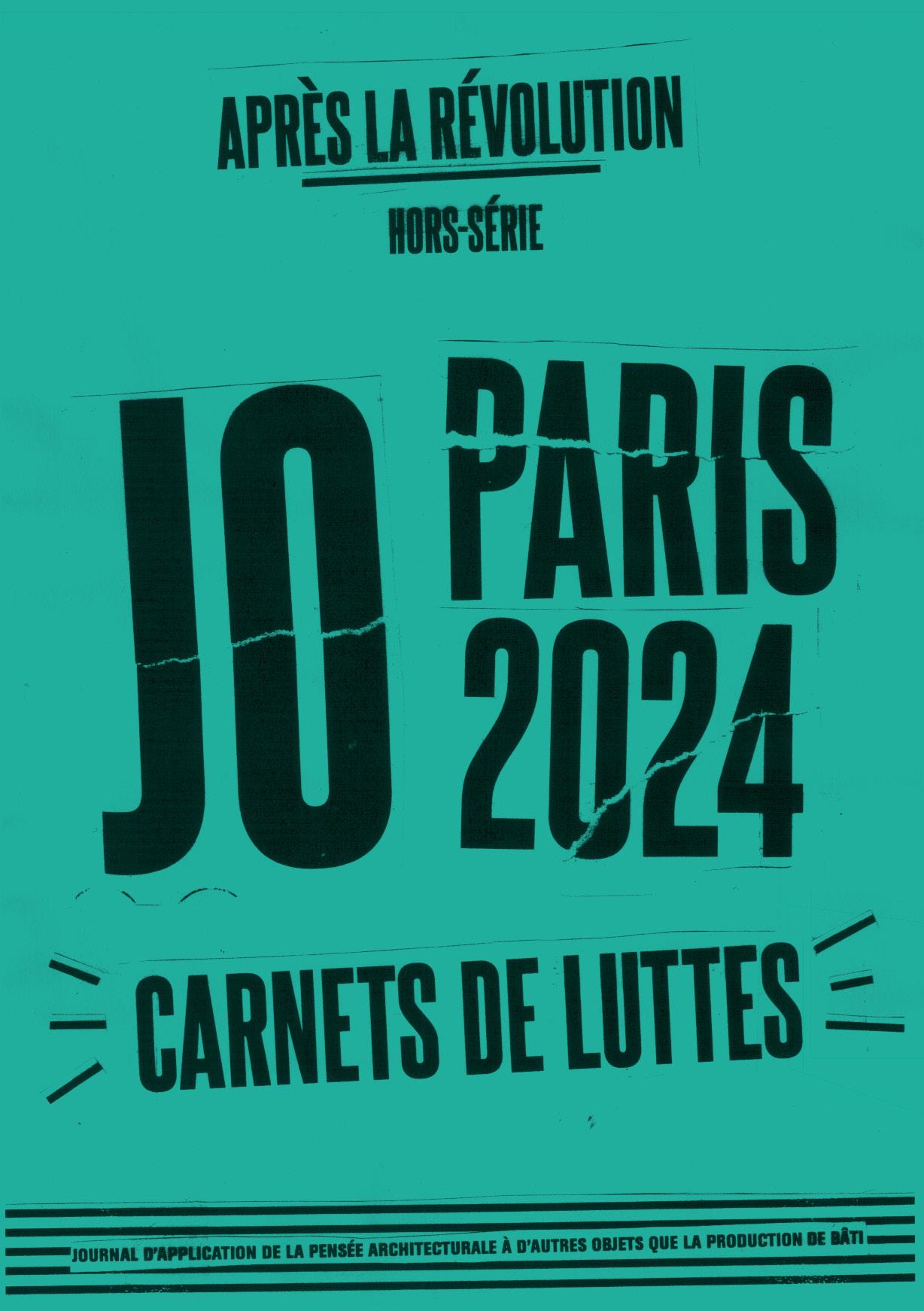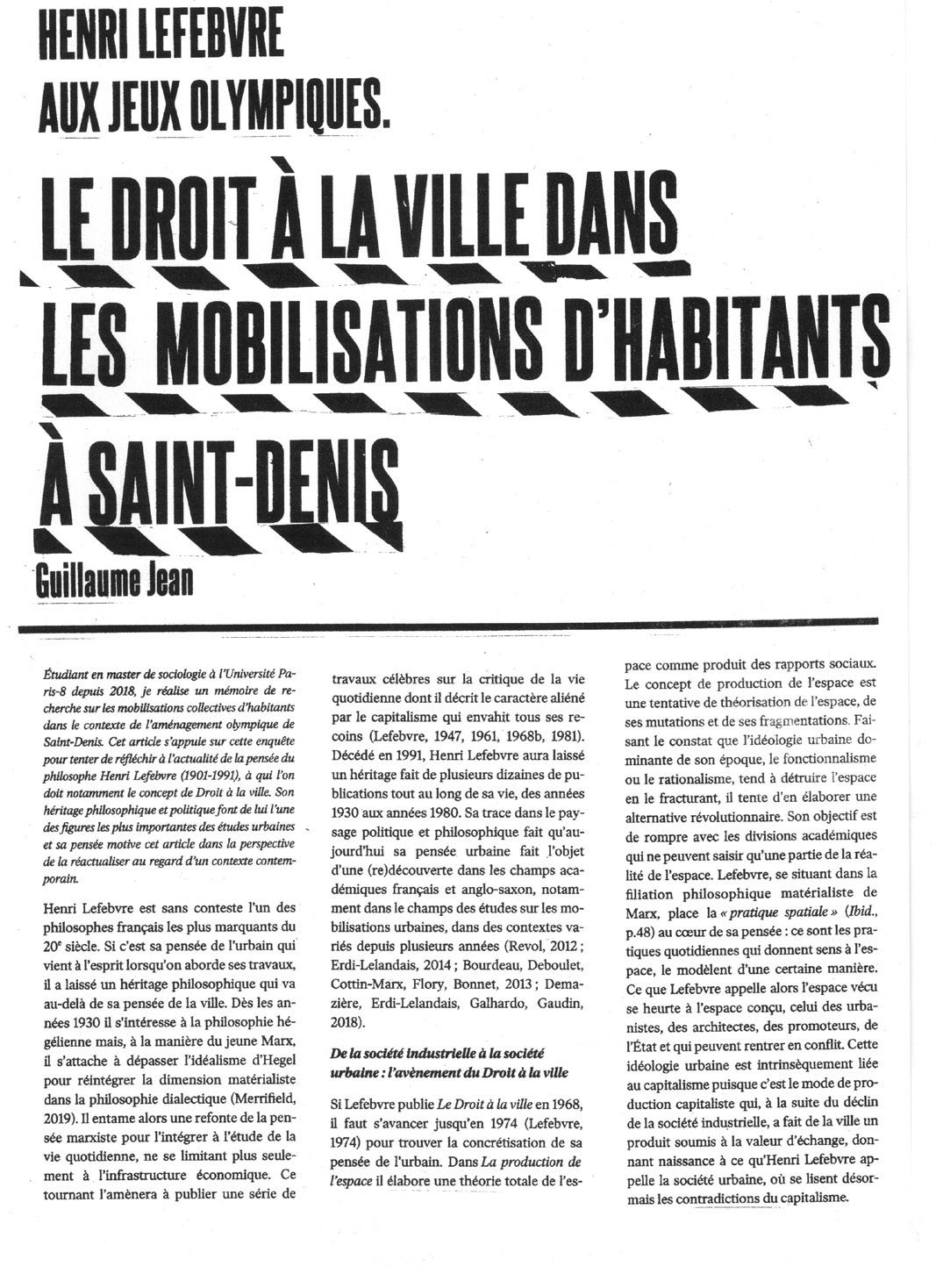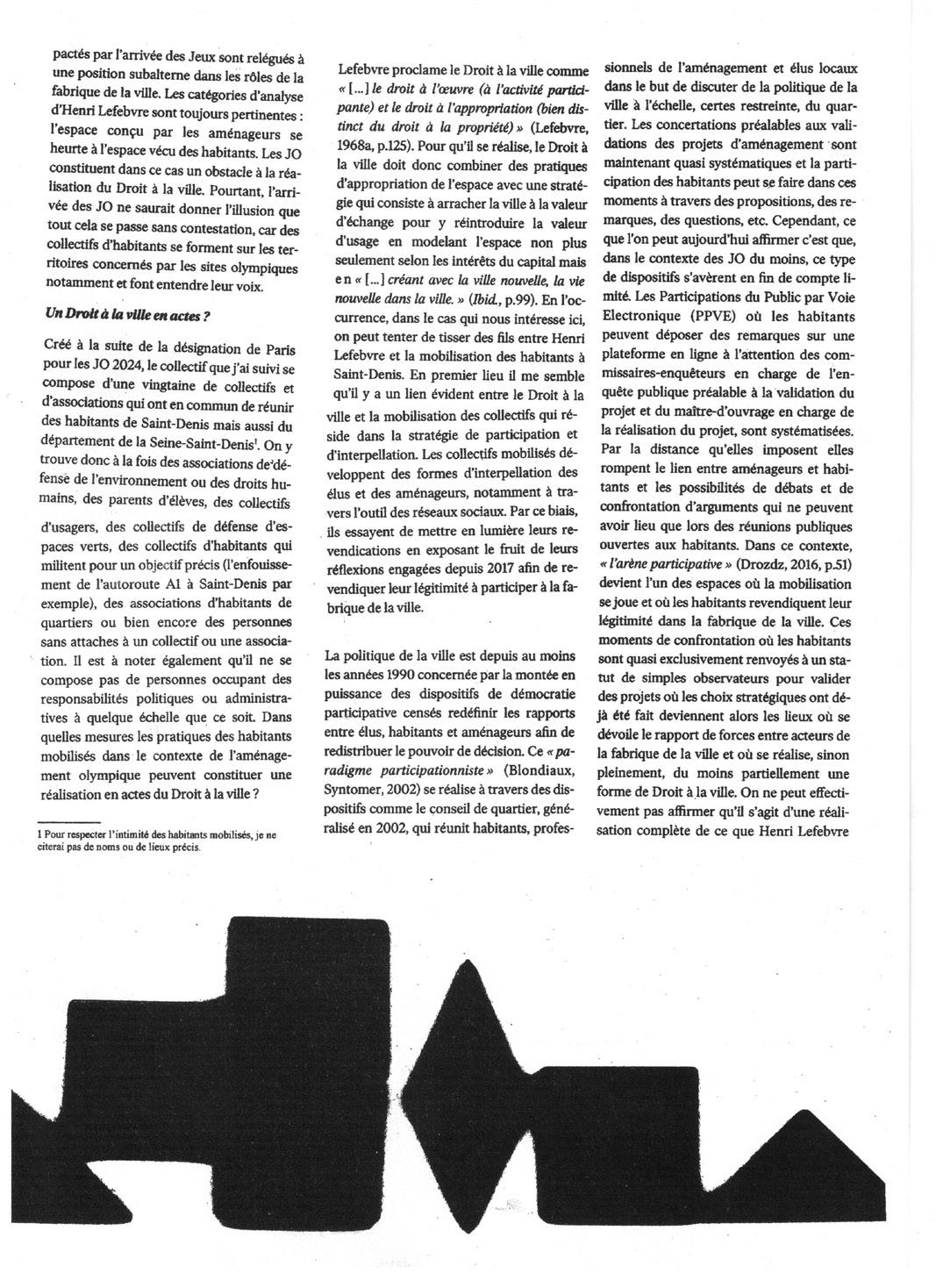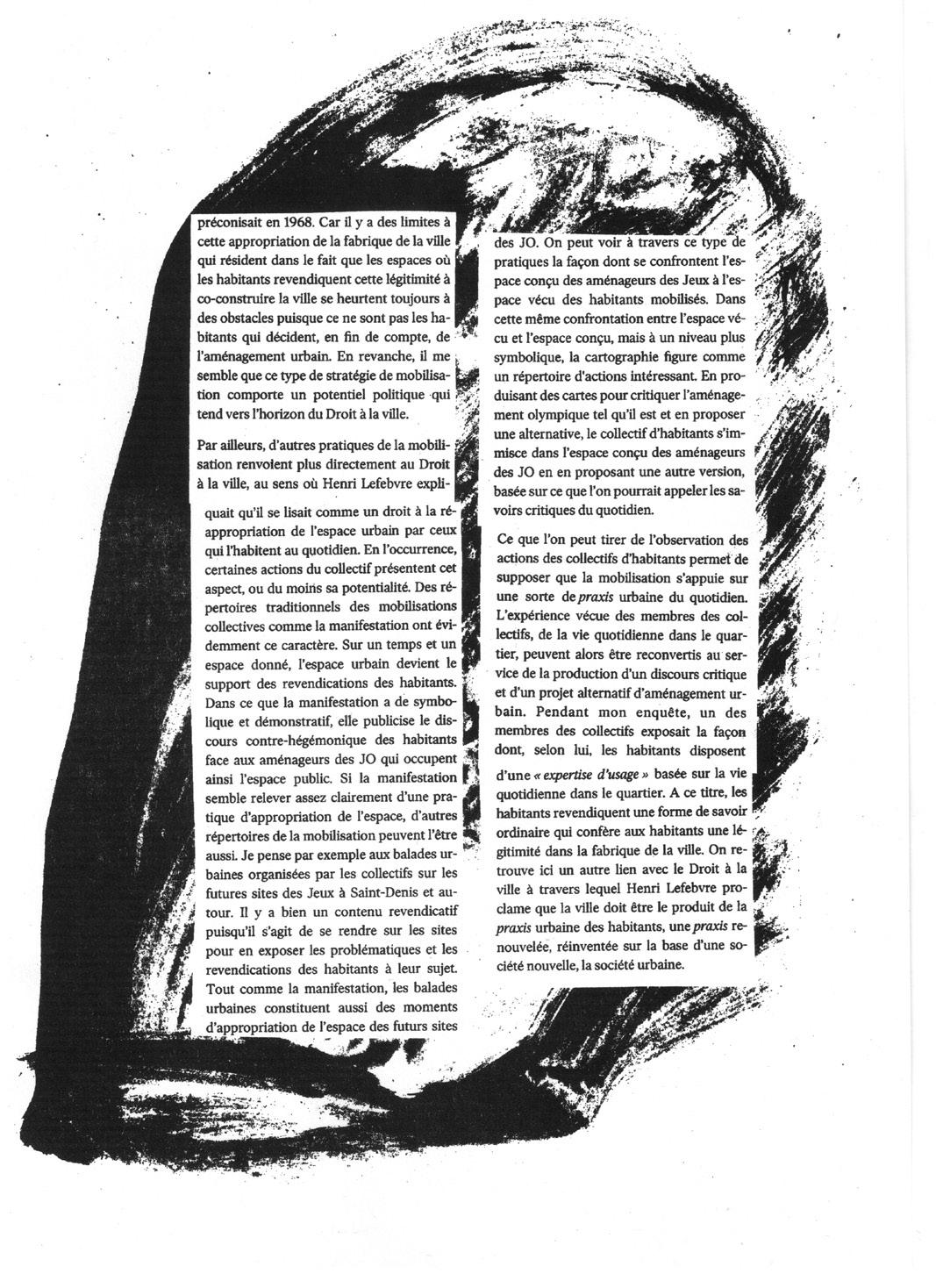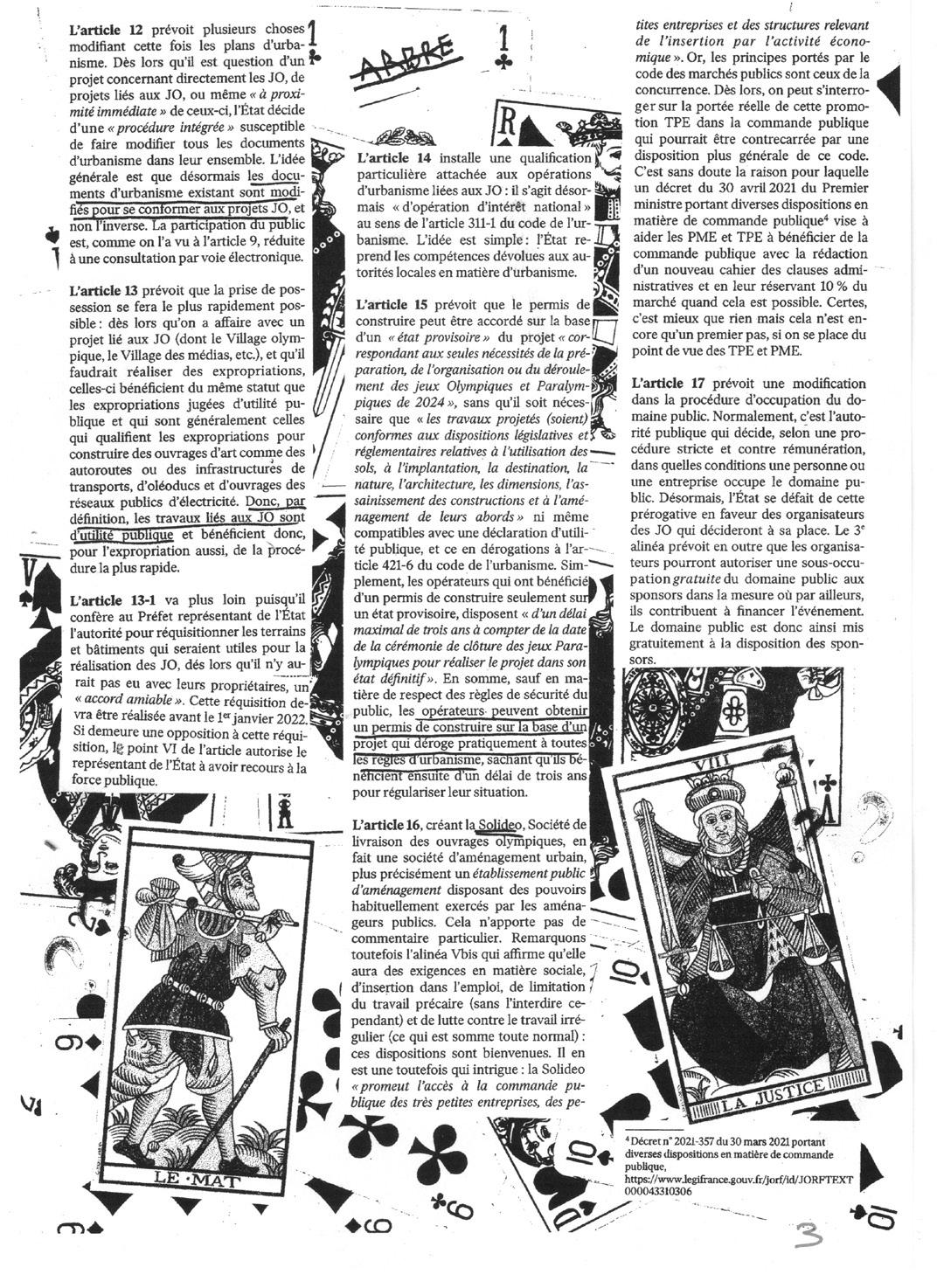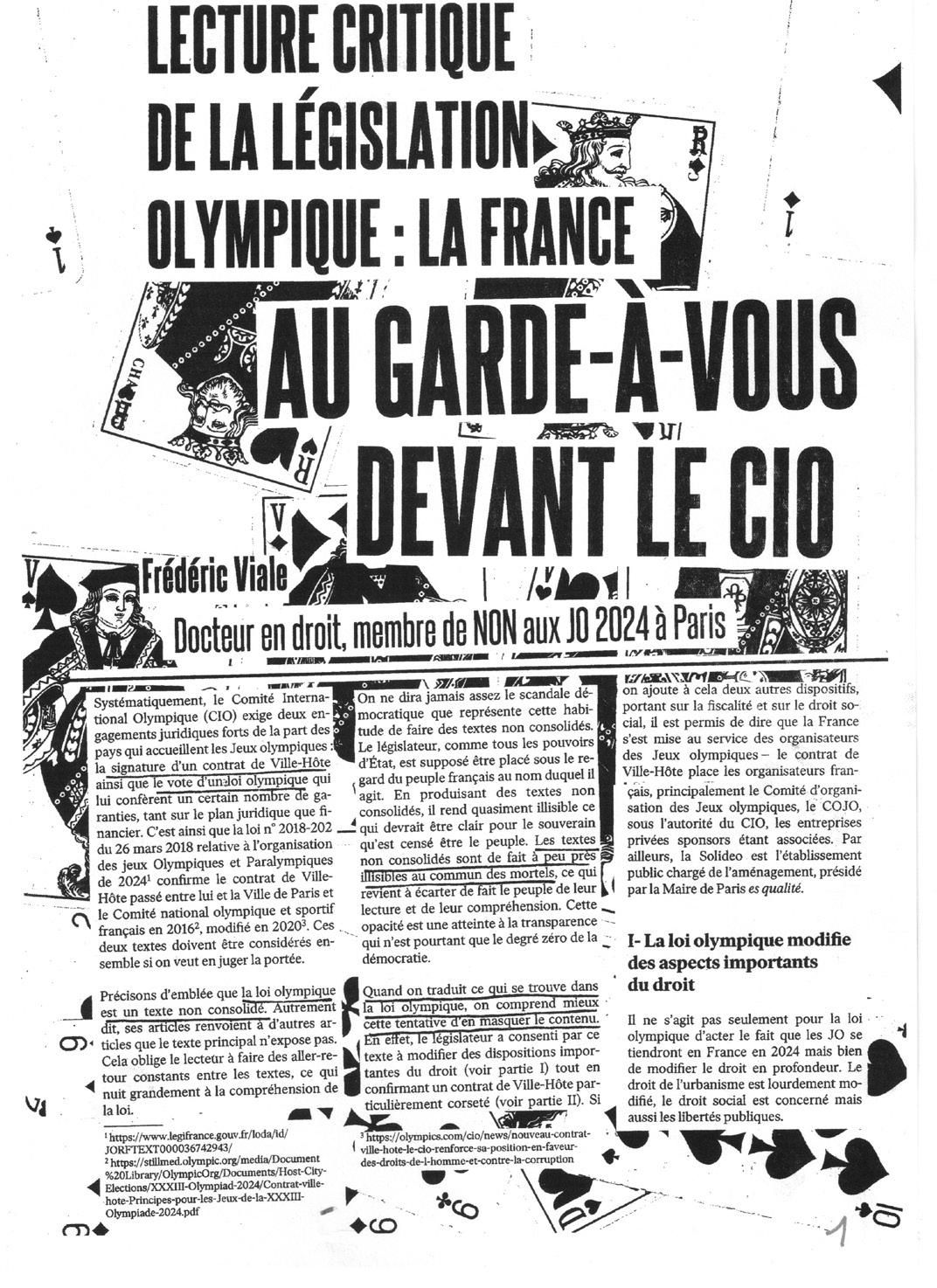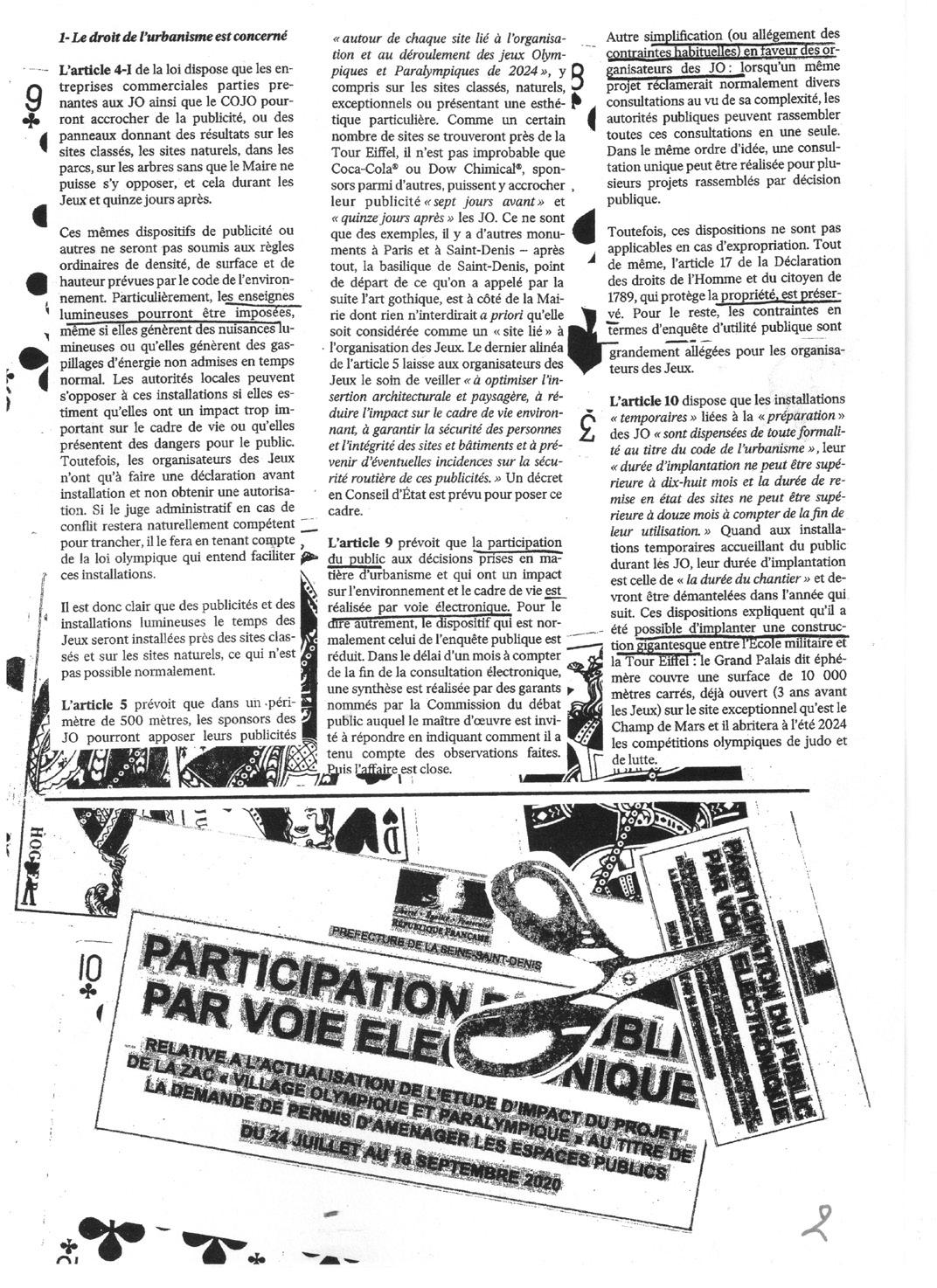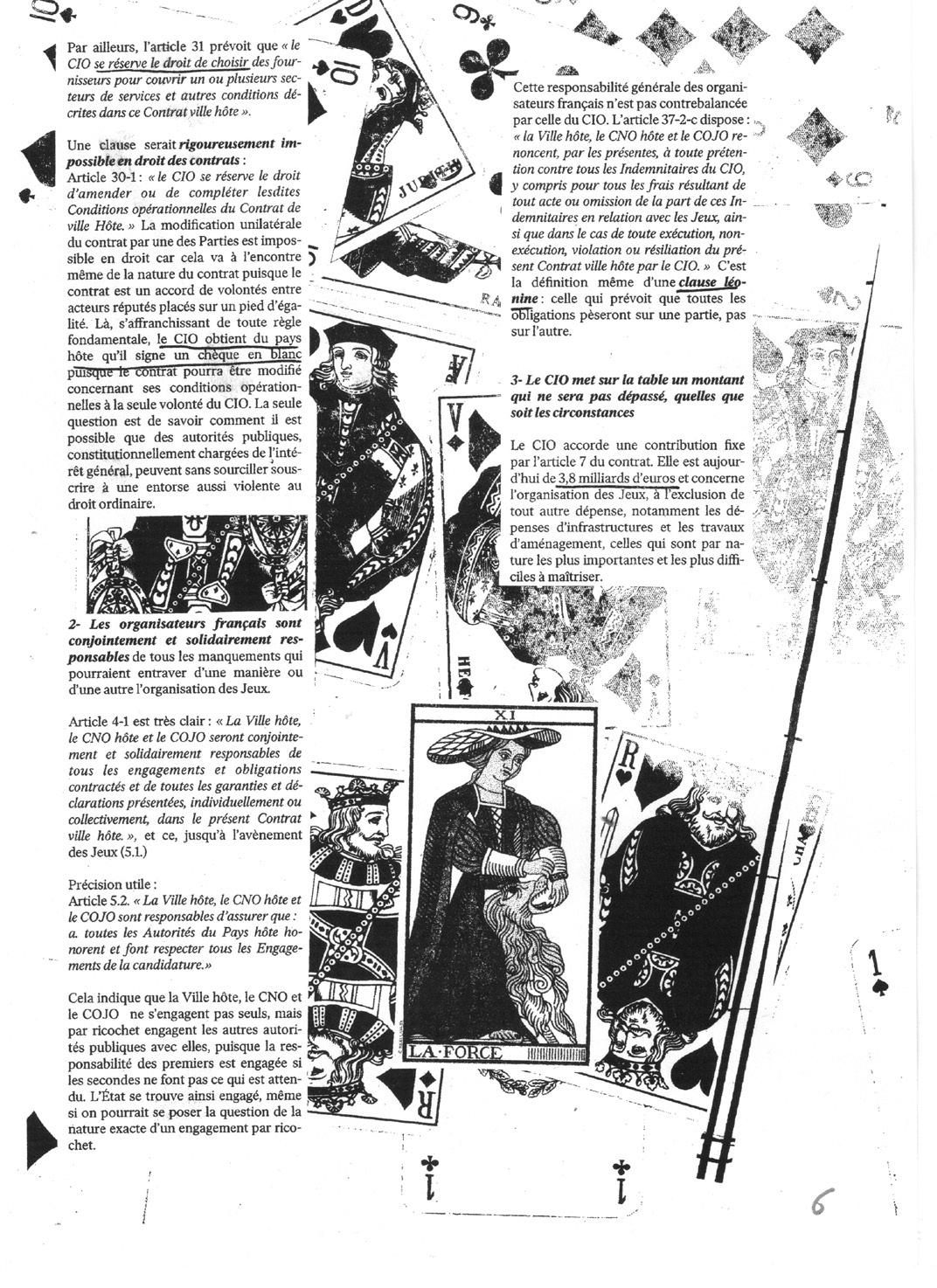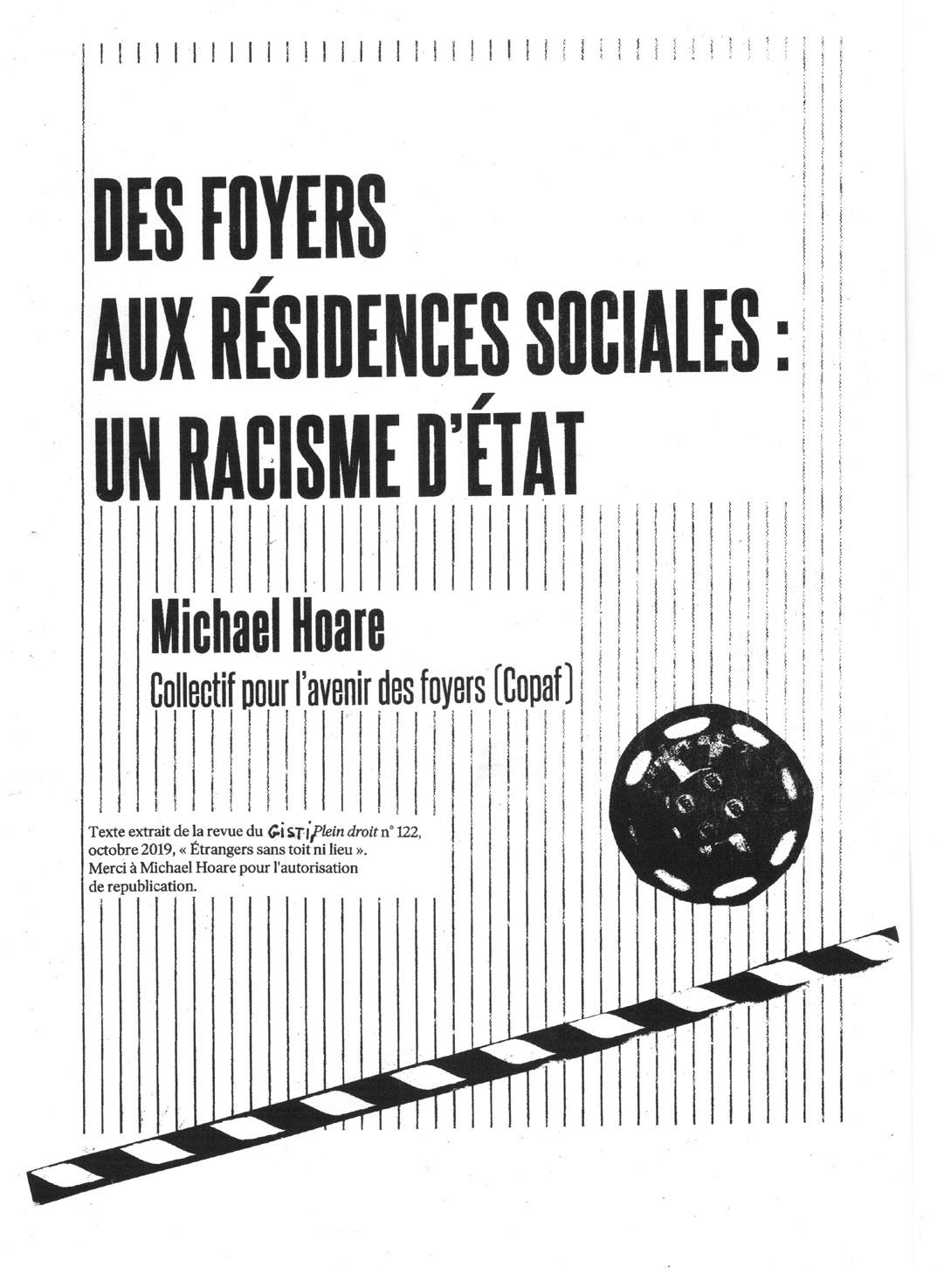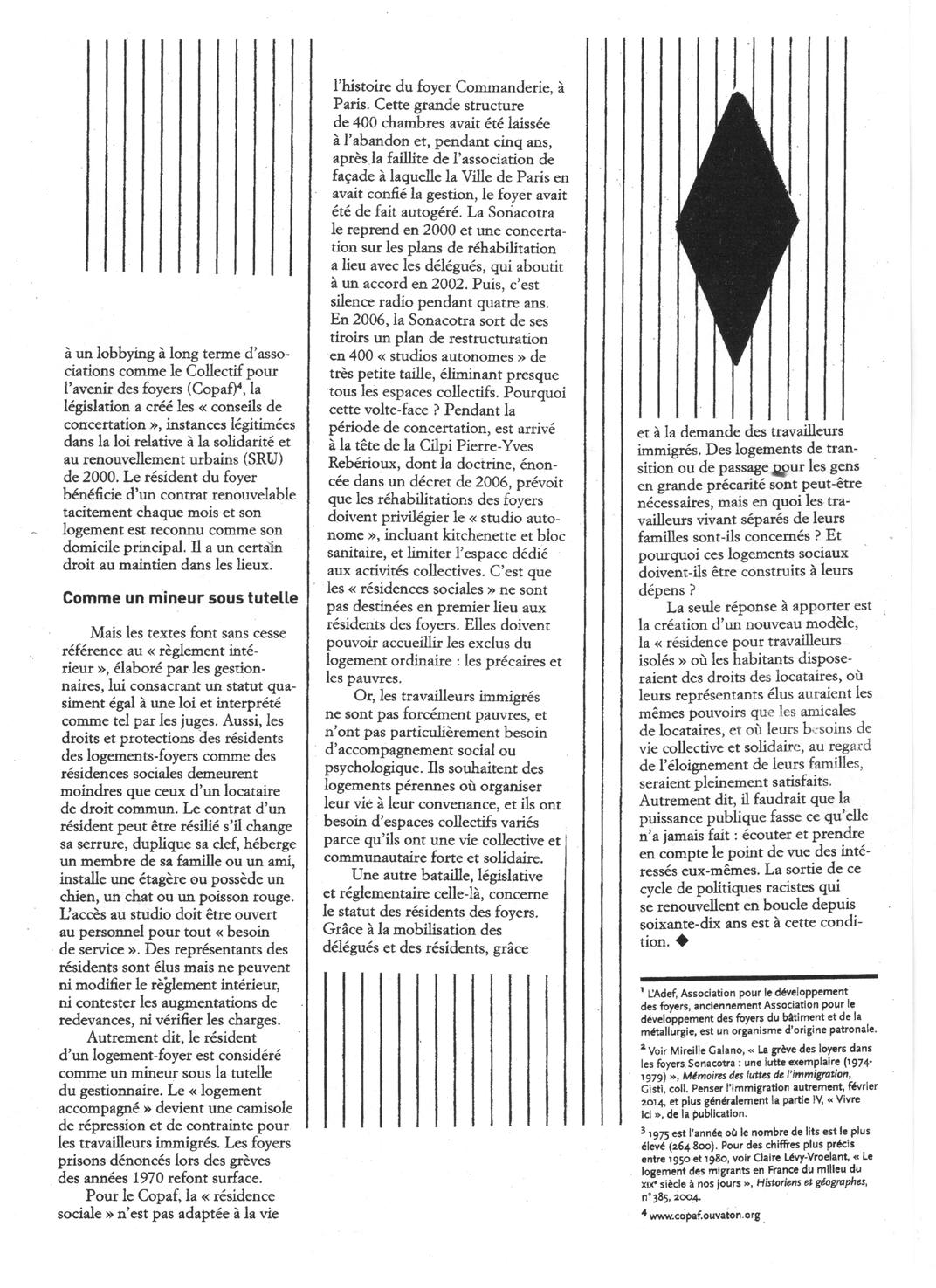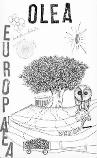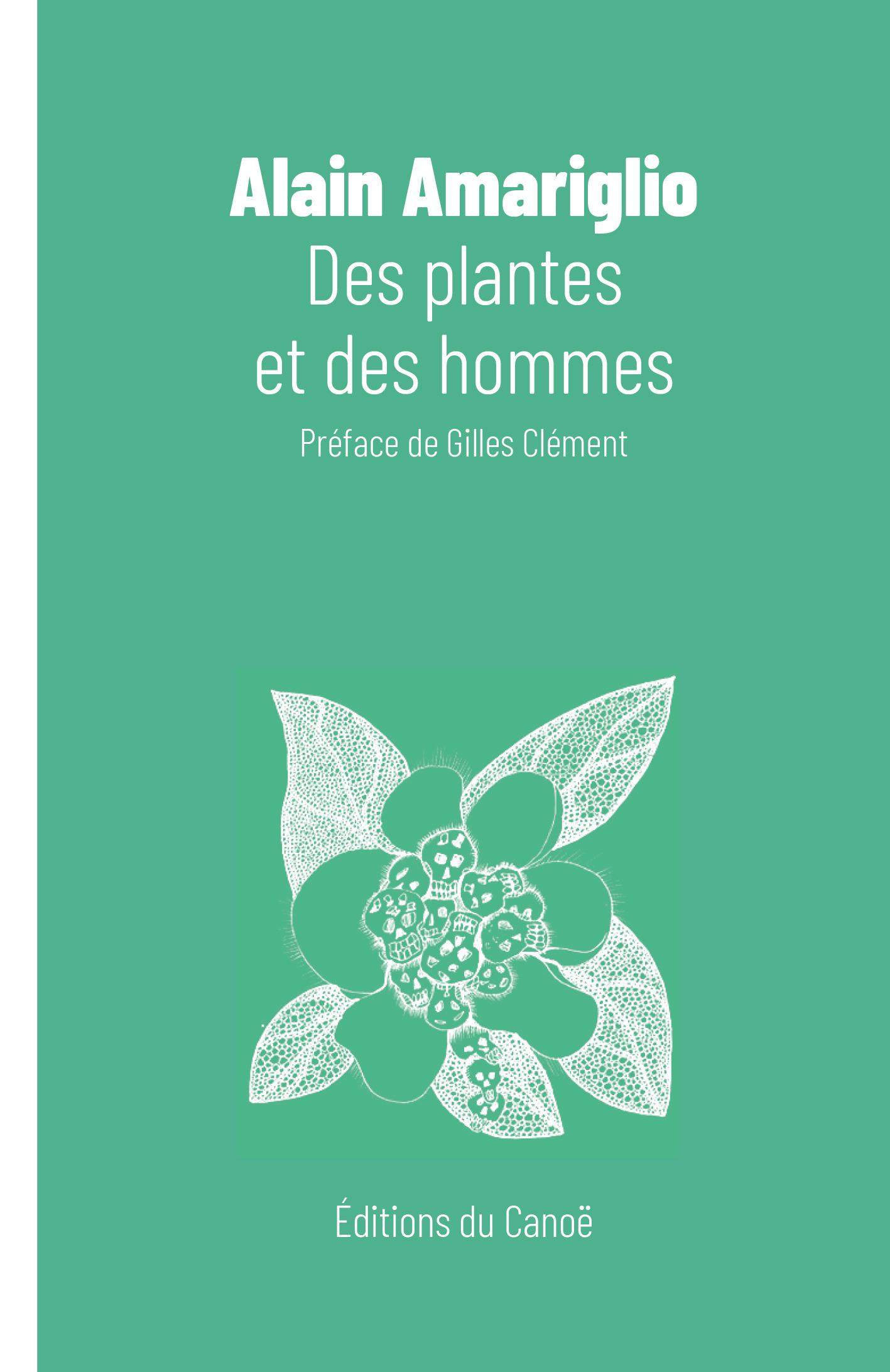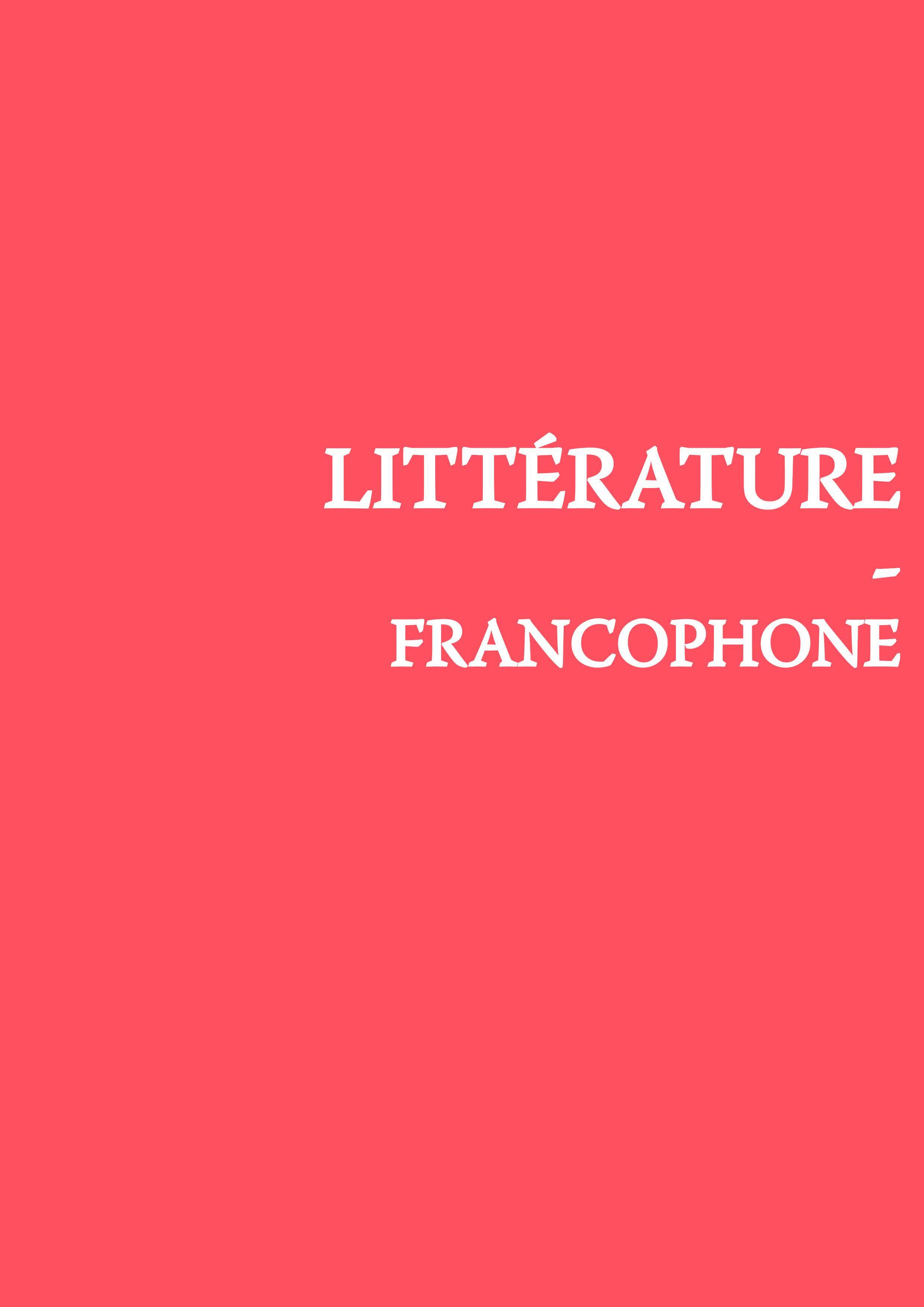

ISBN : 978-2-493205-03-2
© Perspective cavalière, 2023
Graphisme : Débora Bertol
Nathalie Rouanet
Rouge indien
Qui était Amrita Sher-Gil, cette femme au destin fulgurant née en Hongrie et morte en Inde, qui portait colliers de perles et manteaux de fourrure dans le Paris des années vingt et qui a peint la vie humble et aride des habitants de Shimla dans une œuvre aujourd’hui considérée comme majeure ?
Dans Rouge indien, Nathalie Rouanet retrace la brève vie d’Amrita Sher-Gil à la manière d’un scénario : son enfance en Hongrie puis en Inde, ses années de formation à Paris, nourries de rencontres illustres au parfum de scandale, et sa fin tragique alors qu’elle n’avait que vingt-huit ans.

Par sa création et son mode de vie, cette artiste exigeante, à la sexualité exaltée, a posé les bases de la peinture moderne et de l’émancipation féminine en Inde.
Date de publication : 30 janvier 2023
Illustration : Christophe Merlin Contact presse & librairies : Couverture souple avec rabats Étienne Gomez Antony Thalien
12,9 x 19,8 cm 0679918283 06 31 20 71 63
152 pages, 18 € editionsperspectivecavaliere@gmail.com
« Les couleurs de l’Inde l’inspirent, et sa peinture prend corps. Le talent de Nathalie Rouanet est de restituer ces couleurs, mais aussi les odeurs, les goûts, le bruit de l’Inde, et de narrer l’histoire d’Amrita comme on compose un tableau. Bref, une très belle lecture de cette rentrée de janvier ! » (Carine Chichereau)
Née en France, Nathalie Rouanet vit à Vienne. Elle est traductrice en allemand de Nina Bouraoui, d’Hélène de Monferrand et de JeanClaude Carrière, et en français de nombreux essais, catalogues d’art, scénarios et sous-titrages. Elle est aussi slameuse sous le nom de Ann Air.
Une après-midi de juillet 1948, dans une villa cossue des coteaux de Shimla, une Hongroise du nom de Marie Antoinette Gottesmann-Baktay se suicide avec le pistolet de son mari, un Indien sikh. Dans un film, cet événement tragique n’aurait lieu qu’à la fin. Et nous n’apprendrions les détails que petit à petit, comme moi qui ai fait de longues recherches et reconstitué les fragments de l’intrigue image par image, lettre par lettre, bribe par bribe. Au début, il n’y aurait aucun marqueur de temps ni de lieu. Juste :
 Photo © Maria Noisternig
Photo © Maria Noisternig
#l’incipit
On entendrait une mélodie de piano, Saint-Saëns ou Gabriel Fauré. Et le doux clapotis d’une pluie de mousson. Un plan large sur une villa à flanc de montagne, tandis qu’apparaîtrait un intertitre :
Sois heureux un instant. Cet instant, c’est ta vie.
OMAR KHAYYAM
La façade de la villa est blanche, les toits sont verts. Les fenêtres en saillie surmontées d’une coupole ressemblent à de petits mausolées. Dans le jardin, des pins de l’Himalaya, des fougères arborescentes et des rhododendrons indiqueraient aux connaisseurs, géographes ou grands voyageurs, la zone dite des « montagnes septentrionales ».
Dans la séquence suivante, la caméra balayerait un salon somptueux. De lourds rideaux et draperies aux fenêtres. Aux murs, des toiles de grand format d’un artiste encore inconnu, des photographies encadrées, des miniatures indiennes. Sur un petit bureau, une lampe Art déco, des livres et des papiers en désordre, une loupe et, dans un cadre, la photographie autochrome de deux petites filles aux coiffures des années vingt et vêtues de déguisements. On entendrait le doux bruissement d’un ventilateur de plafond et un cliquetis de vaisselle. La caméra continuerait son panoramique, puis zoomerait sur une table basse octogonale en bois de cèdre sculpté où des mains d’homme à la peau brune verseraient du thé dans une tasse en porcelaine anglaise. Notre champ de vision engloberait aussi de fins souliers de femme et les plis d’une robe en soie. Un lent travelling arrière révèle- rait alors une femme blanche élégante d’un âge avancé, la soixantaine passée, assise, non, plutôt affalée dans un profond fauteuil, le chignon défait et le visage ravagé – de chaleur, de fatigue, de chagrin ? On ne sait pas. Pas encore. (p. 9-10)
#la séance de pose avec Marie
Paris. Atelier d’Amrita. Au bout du petit matin.
Plan large. Des toiles de grand format d’Amrita, mais aussi de Boris et de Marie-Louise, sont appuyées aux murs : un torse d’homme, plusieurs nus féminins dont celui du modèle noir des Beaux-Arts, des portraits, des autoportraits, des natures mortes, des paysages parisiens, des villages de Hongrie. Amrita est au chevalet. Elle porte un ample tablier de peintre noir et des bracelets de perles qui cliquettent à chacun de ses gestes. Ses cheveux sont sommairement attachés en chignon. Le soleil du matin éclaire le fauteuil Récamier couvert d’un drap blanc, où est allongée une jeune fille appuyée sur les coudes, un livre entre les mains, nue sous une étoffe de soie où l’on devine un dragon brodé.
– Écoute ça, Amrita, on croirait qu’il l’a écrit pour toi :
Tes pieds sont aussi fins que tes mains, et ta hanche
Est large à faire envie à la plus belle blanche ;
À l’artiste pensif ton corps est doux et cher ;
Tes grands yeux de velours sont plus noirs que ta chair…
#les funérailles d’Amrita
Le bûcher a été préparé, du bois mort empilé, au sommet une litière en bambou. Les mains aimantes y déposent Amrita.
EXTERIEUR. JOUR
Les amis sont venus chargés de fleurs ; jasmin, soucis et laurier rose, poudre de santal rouge et ghee répandus sur son corps.
Puis son père accomplit le rituel. Le vieux lion, barbe et crinière blanches, calme comme la rivière, son regard noir troublé de larmes, allume le bûcher et chante le Kirtan Soliha : « Le parfum de santal venu de l’est est l’encens, le vent est l’éventail... »
Bientôt la fumée monte, le bois s’enflamme, les flammes lèchent la défunte. Rouge carmin, rouge garance, rouge indien. Puis le silence.
On n’entend plus que le crépitement du feu et les sanglots de la mère. Sa robe noire flotte dans la brise légère.
Des étincelles éclaboussent le ciel, les pétales de fleurs s’envolent. Et dans la profondeur des braises, nous entendons craquer le crâne et le bois.
Ce n’est que quelques jours plus tard qu’on rassembla ses cendres et qu’on les dispersa dans la rivière sous la lueur argentée de la lune.
Ne pleure pas les beaux jours Parce qu’ils sont passés, Souris parce qu’ils ont été.
Depuis ce 5 décembre 1941, quatre buffles noirs attendent leur dernier coup de pinceau.
Recensions :
- "Rouge indien", par Yves Mabon, Lyvres, 30/01/2023 : https://www.lyvres.fr/2023/01/rouge-indien.html
- Séries de vidéos de Nathalie Rouanet publiées sur les comptes Facebook/Instagram de Perspective cavalière, 01/2023.
- "Amrita Sher-Gil, un destin hollywodien", par Daphné Bétard, Beaux-Arts Magazine, 03/2023 : https://www.beauxarts.com/produit/beaux-arts-magazine-n465/, p. 40.
- Entretien radiophonique avec Nathalie Rouanet (et Étienne Gomez), par Sylvie Gillot, "Remue-méninges féministes", Radio libertaire, 04/04/2023 : https://www.anarchiste.info/radio/libertaire/podcast/semaine/202314.html
- Entretien avec Nathalie Rouanet, par Jean-Davy Dias pour RegArts: https://regarts.org/Interviews/Nathalie_Rouanet.php
Amrita Sher-Gil sur Arte : Amrita Sher-Gil reine de la peinture moderne (Invitation au voyage, 31/02/2022) : https://www.arte.tv/fr/videos/108267-001-A/en-inde-amrita-sher-gil-reine-de-la-peinture-moderne/ Amrita Sher-Gil, reine de la peinture moderne - Delhi, capitale de l’Inde moghole - À Pondichéry, le soleil a rendez-vous avec Vénus (Invitation au voyage, 04/02/2023) : https://www.arte.tv/fr/videos/109357-004-A/invitation-au-voyage/
Rencontres en librairie/sur des salons avec Nathalie Rouanet : Zeugma (Montreuil), 27/01/2023 ; salon Animalia/Inde (Mairie du XIXe), 29/01/2023 ; Le Tracteur Savant (Saint-Antonin-Noble-Val) ; "Resto Littéraire", Chapitre 3 (Vesoul), 13/05/2023.
Hors Collection
Saionji, l’ami japonais de Clémenceau de Philippe Pivion
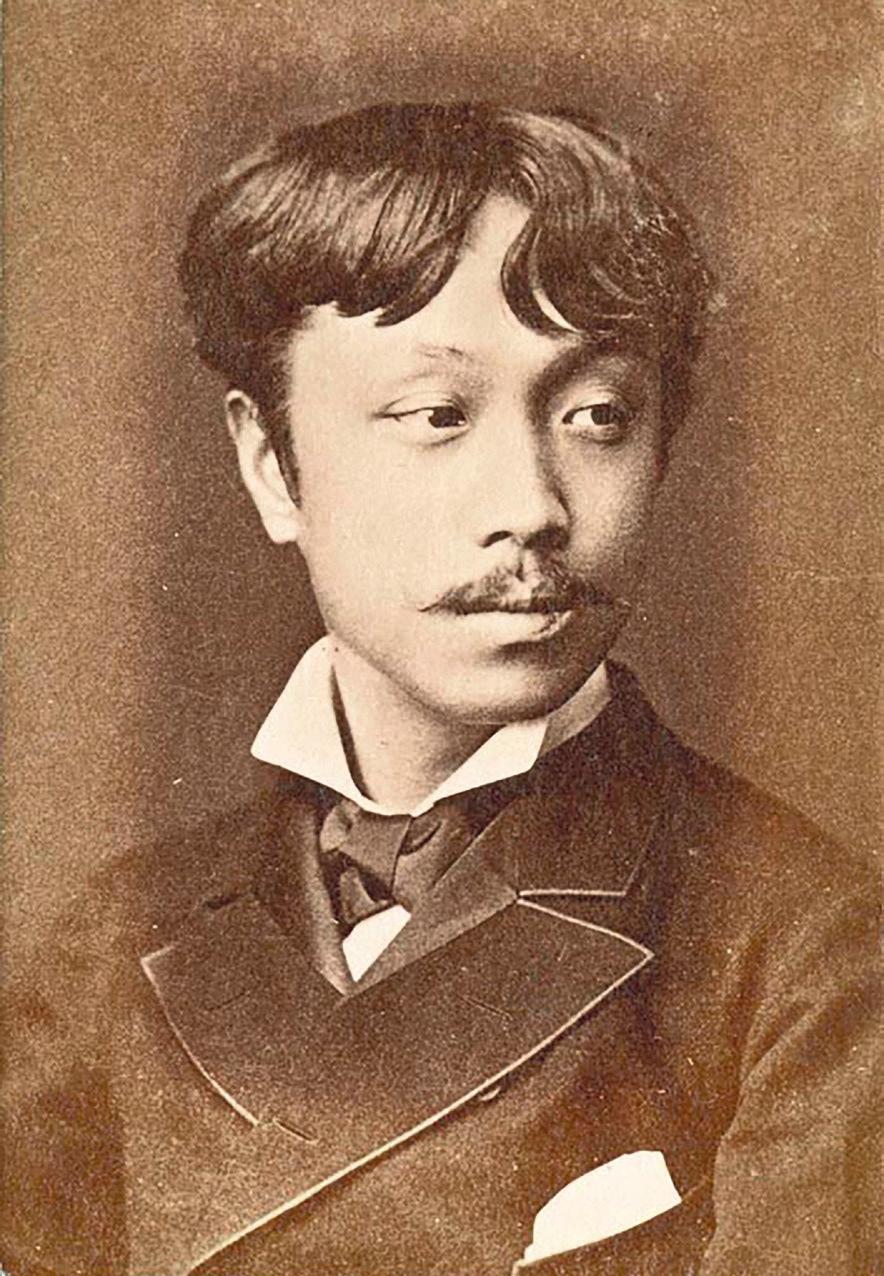
Format 14 par 21 cm Pages 254
Reliure : Dos carré collé cousu
ISBN :
Prix : 22 € / CHF.- 30
Parution : octobre 2023
Rayon : Roman Historique
MOTS CLEFS :
Commune - Guerre de 14/18 - Japon
Éditions À plus d’un titre

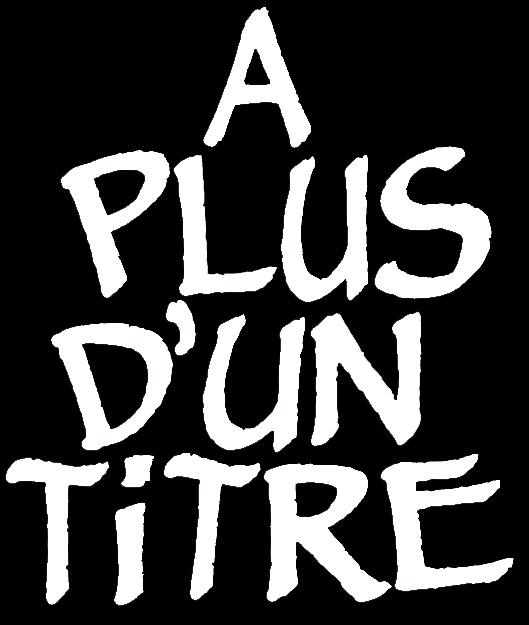
Nouveauté novembre 2023
Saionji, l’ami japonais de Clémenceau
Philippe Pivion
Durant les années d’apprentissage de Saionji, ces années parisiennes, il fut un ami fidèle de Georges Clemenceau. Les deux hommes ont eu une complicité, une intimité pourrait- on dire, dont ils ne déferont jamais. Très curieusement, nous n’avons, là encore, plus trace de leurs échanges épistolaires; ils ont, semble-t-il d’un commun accord, fait disparaître leur correspondance. Que pouvait-elle recéler qui nécessitât qu’elle fût détruite ?
Saionji et Clemenceau sont les deux personnages historiques principaux de ce récit. Il m’a paru nécessaire de cerner le contour des événements qui les conduisirent à se cramponner à certains principes plutôt qu’à d’autres. En s’imprégnant des bouleversements des années 1870, le lecteur pourra, je l’espère, déceler les ressorts de leur cheminement. Ainsi, comment expliquer que Clemenceau en 1918 se soit à ce point obstiné pour que la Conférence de Paris, destinée à élaborer le traité de paix avec l’Allemagne notamment, s’ouvrît le 18 janvier 1919 et que le traité lui-même fût signé à Versailles, si nous ne faisons pas un retour en arrière au 18 janvier 1871 ?
Ce faisant, nous nous éloignons du sujet, penserez- vous. Il se peut, mais pouvons-nous aborder l’évolution intime de ces hommes qui ont marqué l’histoire si nous ne mesurons pas les contradictions d’alors ?
Mais si se cachait aussi une autre vérité derrière le masque impénétrable des photographies officielles, un secret enfoui dans les tréfonds de l’histoire, un secret partagé avec Clemenceau ? Alors la narration peut prendre l’allure d’un puzzle, le roman devenir un récit. Le lecteur en sera peut- être troublé, décontenancé, mais c’est le choix de l’auteur, de découvrir cette autre possible vérité.
Philippe Pivion est l’auteur de :
La mort est sans scrupules (éditions du Losange), L’estafette (éditions Ramsay) Brigadistes ! (Ouvrage collectif éditions du Caïman) et, au cherche midi de la trilogie, : Le Complot de l’Ordre noir, Le Livre des trahisons et Dès lors, ce fut le feu.
Distribution pour la France : SERENDIP LIVRES : 10, rue Tesson 75010 Paris - contact@serendip-livres.fr
Fax : 09 594 934 00 /// tél. : 01 40 38 18 14 - gencod dilicom : 3019000119404
Distribution et diffusion pour la Suisse : Éditions D'en bas - Rue des Côtes-de-Montbenon 30 1003 Lausanne
Tél. +41 21 323 39 18 /// Fax. +41 21 312 32 40 - www.enbas.net
Philippe Pivion
Saionji, l’ami japonais de Clemenceau Roman
Éditions À plus d’un titre
Philippe Pivion
20/06/2023 08:50
Saionji, l ’ ami japonaisde Clemenceau
PERRINE LE QUERREC
Les pistes
Trois personnages dans 42 univers parallèles et toujours la mort, le sang, l’amour, les rêves.
Il y a Eva, il y a Piotr, il y a Tom. Une femme, un homme, un enfant. Trois personnages jetés dans 42 univers parallèles. La vie s’y manifeste, happée par la mort, l’amour tangue, la violence guette, menace, jaillit. Il y a la force du désir et celle des rêves. Ici Eva se saisit d’un verre, Piotr boutonne sa chemise, le petit Tom appuie sur les pédales de son vélo. Des gestes se font, se défont. Des sentiments naissent, meurent écrasés, survivent, s’effondrent, se métamorphosent. C’est la nuit, c’est le jour. L’avenir se joue avant le passé et le passé se vit encore au présent. Le temps se distribue dans l’univers. Fusion. Tout se répète, rien n’est identique. Une piste vaut un monde, un monde vaut ce que valent ces trois destins et les mots pour les dire. C’est la guerre, ses décombres, ses cadavres mutilés qui crient. C’est l’été, l’or en lumière et les corps qui s’aiment derrière les persiennes. Il y a du sang, des gorges tranchées. Les pistes ainsi se déclinent, les fonctions changent, l’action se diffracte. Reste l’écriture, les signes qui dansent sur la page tremblante et un écho intrigant qui s’élève.
collection ShushLarry
format 11 x 17,5 cm, broché isbn 978-2-88964-059-1

prix CHF 16.50 / € 13
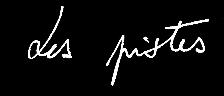
rayon littérature genre roman parution 4 janvier 2024
a&f LES PISTES Perrine Le Querrec trois mêmes l’enfant et chemise, Ève, l’écriture. Trois s’entraînent, une mulTentatives montage et démonte. ville depuis quitté vingt charnière de ces
Querrec 26.06.23 06:36 art&fiction
Fictions
ShushLarry Perrine Le
De la même autrice:
VERONIQUE BERGEN, ARTPRESS, FÉV. 2019

si vous aimez les intrigues, les jeux de piste, le sang, l’amour, les rêves. Smoking / no smoking d’Alain Resnais, Godard, et l’écriture.
Perrine Le Querrec est née à Paris et c'est dans cette ville qu'elle a écrit ses vingt premiers livres. Livres de poésie et de prose, livres graphiques aussi faits d'archives et de silences, de trous et de pliures. Où le travail sur la langue et les signes ouvre des perspectives politiques, des champs d’expérimentation. Perrine Le Querrec a notamment publié La Construction (art&fiction, 2018) qui présente les plans d'un hôpital psychiatrique mais dont le véritable architecte est le lecteur. Elle a depuis quitté la ville pour le Berry et c'est là qu'elle écrira ses vingt prochains livres. Les pistes ont été menées à la charnière de ces deux vies.
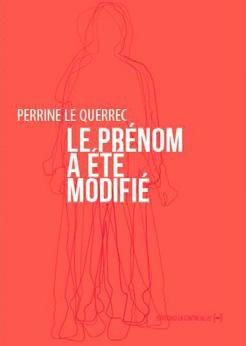

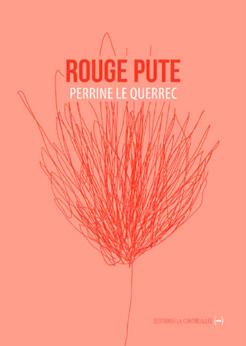
 ©
Xavier
Loira
©
Xavier
Loira
Éditions d’en bas, 2022 La Contre Allée, 2020 art&fiction, 2018 La Contre Allée, 2022
Portrait
« L’œuvre singulière de Perrine Le Querrec se donne les moyens d’une grande inventivité formelle afin de donner voix à ceux qu’on enferme. »
Souvent ils commencent de haut les films, d’en haut EN PANORAMIQUE le survol d’une forêt un désert filant le brouet des cascades, alors commencer l’écriture comme ça de haut en survol, pas même un horizon mais la page bouchée par le grand pays le grand paysage et puis descendre, fendre l’air jusqu’au trottoir, gros plan sur une petite tennis blanche sur la pédale d’un vélo, des mains d’homme qui boutonnent une chemise, une femme tenant un verre, nuque dévoilée par ses cheveux relevés, l’enfant et son vélo, la femme qui boit, l’homme devant le miroir.
Une histoire qui n’a plus rien d’une histoire, mais une masse compacte de paysages, de terres immergées – une géographie mutante.
La première piste
Sur un trottoir très noir la petite tennis blanche et le revers d’un pantalon trop grand, l’enfant pédale sur son vélo en chrome, il est très sérieux ne quitte pas le trottoir très noir des yeux il ne sourit pas ne chantonne pas, il roule aussi vite qu’il le peut, il appuie régulièrement un pied
Perrine Le Querrec | Les pistes Extraits
après l’autre de toutes les forces de ses cinq ans il quitte le périmètre de sa maison du quartier de la ville si possible, sans rien d’autre que sa volonté et son absolue incompréhension des deux adultes laissés dans la maison sous un tumulte de cris, sa mère encore ivre le verre qu’elle ne quitte plus, toujours entre elle et son fils, elle et son mari, elle et sa vie, elle et les autres, elle et elle il y a le verre plein puis vide puis plein puis les rires les larmes les mots toujours les mêmes, les violences les excuses les saletés les assiettes vides de Tom l’enfant à la bicyclette, le ventre vide de Tom le cœur vidé de Tom le ventre tordu de Tom, les yeux secs Tom roule en direction du soleil, mètre après mètre s’éloigne de cette maison où elle est tombée entre l’évier et la table le verre au-dessus de sa tête comme un trophée elle ne l’a pas renversé, et alors s’approche papa il sort de la chambre où il vient de s’habiller boutonner les mille boutons de sa chemise devant le miroir il tente d’être sourd aveugle totalement sourd totalement aveugle, ni femme ni enfant, le petit Tom devant lequel il passe à présent sans mot dire, enjambant sa femme pour se servir un café qu’il boit très rapidement devant la fenêtre, ce qui se passe dans son dos ne le concerne pas, le petit Tom espérant qu’il se retourne qu’il aide
10 PERRINE LE QUERREC
Perrine Le
|
Extraits
Querrec
Les pistes
LES PISTES 11
maman à se relever qu’il aide Tom à lacer ses tennis qu’il termine son café enjambe sa femme dans l’autre sens, décroche son manteau l’enfile et sort tandis que Tom que sa mère appelle pour qu’il vienne l’aider, lace ses tennis par des pensées magiques et sort à son tour, enfourche son vélo et quitte à jamais cette maison cette mère ce père ces inconnus qui n’ont pas lacé les deux brins blancs de ses tennis, quel dommage le lacet s’est défait et le lacet coincé et l’enfant est tombé et une voiture est arrivée.
Il faut vite prendre du recul un très large recul ne pas regarder la tennis souillée le visage de Tom son œil étonné grand ouvert sur l’azur qu’il emporte dans sa rétine, il nous faut nous échapper de la place du meurtrier vite remonter au ciel traverser les nuages s’approcher du soleil la ligne noire du trottoir n’existe plus la petite ville non plus l’écriture survole une immensité végétale, l’écriture-aigle.
La seconde piste
Envol vol survol, sous le ventre de l’aigleécriture la fourmilière ; fondre sur la page réseau serré de la ville à coups de bec déchiqueter les nœuds de l’espace, voici la ville aux millions de lumière, de fourmis, de fenêtres
Perrine Le Querrec | Les pistes Extraits
brisées par l’écriture en mille éclats elle percute les mains tremblantes de Piotr assis au bord de la table de consultation reboutonne sa chemise pâle froissée. Le médecin range ses outils ses mots ses déclarations, il a énoncé la vérité l’arrêt de mort, énumère les traitements les espoirs les possibles un à un les boutons glissent résistent refusent de plus en plus minuscules les trous possibles pour s’habiller reprendre forme humaine, les deux mains se cognent s’évitent se grimpent dessus la fente le bouton se dérapent s’évitent, Piotr de plus en plus lentement l’espoir que la voix du médecin ralentisse ne perfore plus sa vie, qu’elle s’épuise retienne la guillotine du diagnostic encore un instant avant le dernier bouton étrangleur se redresser dans la chemise froissée se relever sur deux jambes d’aplomb quand tout bascule tout a basculé la vie la mort jusqu’alors il ne les avait jamais vues comme le pile et face de la même imposture il est bien obligé à présent, Piotr enfonce sa chemise boutonnée lundi avec mardi avec mercredi avec jeudi avec vendredi avec samedi avec dimanche, chaque jour devient unique, il lui reste des jours à vivre quelques jours quelques semaines il ne pourra pas apprendre à son fils Tom à faire du vélo courir à ses côtés en tenant
12 PERRINE LE QUERREC
Perrine
Le Querrec | Les pistes Extraits
en équilibre l’enfant la bicyclette la route l’avenir et le lancer l’encourager l’applaudir tout au long de sa vie, il n’a plus que quelques jours quelques semaines pour trinquer avec sa femme cogner verre contre verre À l’amour ! À nous ! À toi ma merveilleuse ma sublime ma flamme je n’ai rien dit pas assez, pas tout de l’odeur de ta nuque sensuelle lorsque tu replies les ailes de tes cheveux ta tête s’incline vers moi ton sourire tes silences plein du monde autour de nous la danse de Tom bondissant dans ses tennis blanches qu’il refuse de quitter, il est la perfection enjouée babil incessant dans la vie de l’homme condamné sous forme d’une ordonnance de traitements palliatifs oh la douleur de l’homme arraché au monde dont il ne discerne déjà plus les détails quotidiens et merveilleux mais plane, vol bruissant plumes noires au-dessus de son propre corps couché dans le cercueil dont le couvercle se referme, la terre jetée au visage les yeux fermés par les larmes de sa femme et l’interrogation du petit Tom le visage tourné vers le ciel où on lui a dit que son père était monté, avec l’écriture gravir mot à mot le deuil par un dernier trait de plume noire se débarrasser de la gravité et planer de plus en plus haut audessus du cimetière
LES PISTES 13
Perrine
Le Querrec | Les pistes Extraits
En librairie le 17 mars 2022
Format: 14 x 21 cm
Pages: 80 p.
Reliure: broché, collé
rayon: littérature
CLIL: 3641
CULTURA: LI00AC
Prix: 12 € / 16 CHF
ISBN: 978-2-8290-0641-8
Éditions d’en bas
Rue des Côtes-de-Montbenon 30
1003 Lausanne
021 323 39 18
contact@enbas.ch / www.enbas.net
LES ALOUETTES
Perrine Le Querrec

PRÉSENTATION
Les Alouettes brisent les silences qui cadenassent les violences faites aux femmes, ces silences qui sont une autre forme de violence déjouée grâce à la force des mots, grâce à la force des femmes.
Ce livre est issu de rencontres de Perrine le Querrec auprès de femmes qui ont partagé les violences qui ont fauché leur vie. De leurs mots elle compose les textes des Alouettes.
Voici ce qu’écrira Agnès, une des participantes, à l’issue de ce travail : « … j’avais participé à quelque chose qui me dépassait. Quelque chose qui était mon histoire, mais aussi celle des autres femmes ayant pris part à l’exercice et celle de ces sœurs inconnues qui peuvent se reconnaître dans ces poèmes. La force des mots qui sont les miens, traduits sous une forme qui les rendent universels. C’est moi, oui, mais il n’est plus question de moi. Il est question, de moi, de toi, d’elle, de chacune qui a pu vivre des choses inacceptables. »
AUTEUR
Perrine Le Querrec est née en 1968 à Paris. Elle publie de la poésie, des romans, des pamphlets. Elle écrit par chocs, construit une langue et un regard à la poursuite des mots réticents, des silences résistants. L’image comme l’archive sont des matériaux essentiels à sa recherche poétique, tout comme son engagement auprès de ceux dont la parole est systématiquement bafouée. Roman chorégraphique, écriture iconographique, poésie accompagnée d’improvisations musicales, travaux d’écritures avec des photographes, des plasticiens, les champs d’expérimentation de Perrine Le Querrec s’enrichissent de tous les vocabulaires de création.
Comptent parmi ses dernières publications Bacon le cannibale (Hippocampe), Le plancher (L’Éveilleur), Les tondues (Z4 éditions), La ritournelle (Lunatique), Les trois maisons (Éditions d’en bas, 2021).

9782829006418
Format: 14 X 21cm
Pages: 144 p.
Reliure: broché, collé
Illustrations
Rayon: roman historique francophone
CLIL: 3506
CULTURA: LIVRE - LITTÉRATURE LITTÉRATURE FRANÇAISE Fiction francophone. Semi-poches texte inédit
Prix: € 17
ISBN: 978-2-8290-0610-4
PERRINE LE QUERREC LES TROIS MAISONS
ROMAN
Jeanne L’Étang naît à Paris en 1856.
Bâtarde, fille de folle, elle passe les premières années de sa vie enfer-mée dans l’étroit comble d’une maison parisienne.
Lorsqu’elle s’en échappe, c’est pour être enfermée ailleurs: la maison des folles - la Salpêtrière -, puis la maison close.
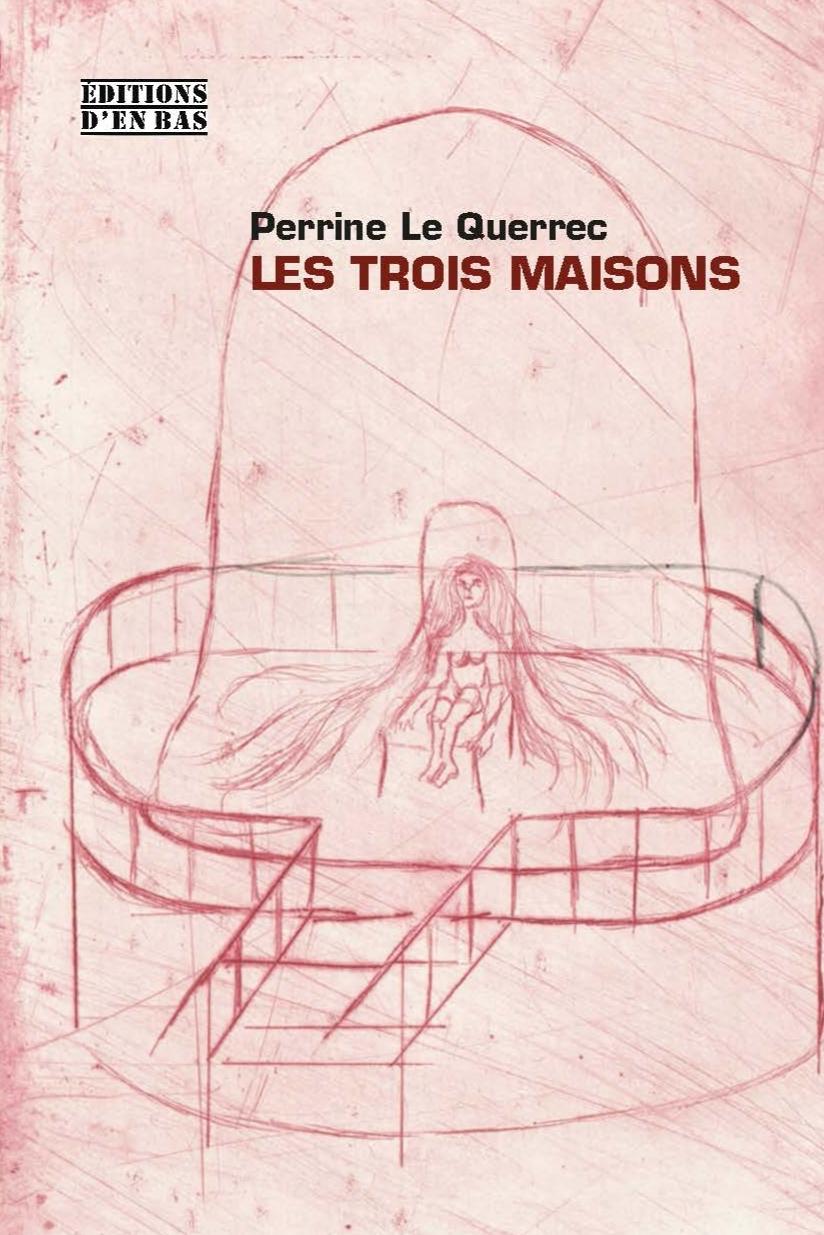
Ces trois maisons délimitent le destin de Jeanne L’Étang : à travers les murs lui parviennent l’agitation parisienne, la guerre de 1870, la Commune, les grands travaux d’Haussmann.
À l’intérieur des murs, elle rencontrera Degas, l’un de ses amants au bordel, Charcot, maître des hystériques e la Salpêtrière, Freud, son assistant pour quelques mois.
Folie et luxure, misère et vices, chaque maison possède ses propres codes, son vocabulaire, ses silences, ses issues.
Mot à mot, année après année, Jeanne L’Étang apprendra à parler ces langues.
L’AUTEURE
Ses rencontres avec de nombreux artistes dans le cadre de son métier de recherche et de documentation nourrissent sa propre création litté-raire et pluridisciplinaire, comme le fait sa fréquentation assidue des archives de toute nature.
9782829006104
MOTS-CLEFS
enfermement, folie, prostitution, exploitation des femmes
Elle publie son premier roman, Coups de ciseaux, en 2007, mais c'est surtout Le plancher, publié en 2013, qui rend le mieux compte de son ancrage profond dans la recherche documentaire (archives d’hôpitaux psychiatriques en l’espèce), et lui donnent accès à une certaine notorié-té. Dans Ruines (2017) elle se penche sur la vie d’Unica Zürn et dans Bacon le cannibale (2018), à partir d’un travail sur les archives de la Fondation Francis Bacon, elle explore le lien de l’artiste britannique à la langue poétique.
Rue des Côtes-de-Montbenon 30 | 1003 Lausanne Tél : +41.21.323.39.18/ Fax : +41.21.312.32.40 contact@enbas.ch www.enbas.net
Maria Kakogianni
Titre : Iphigénie à Kos
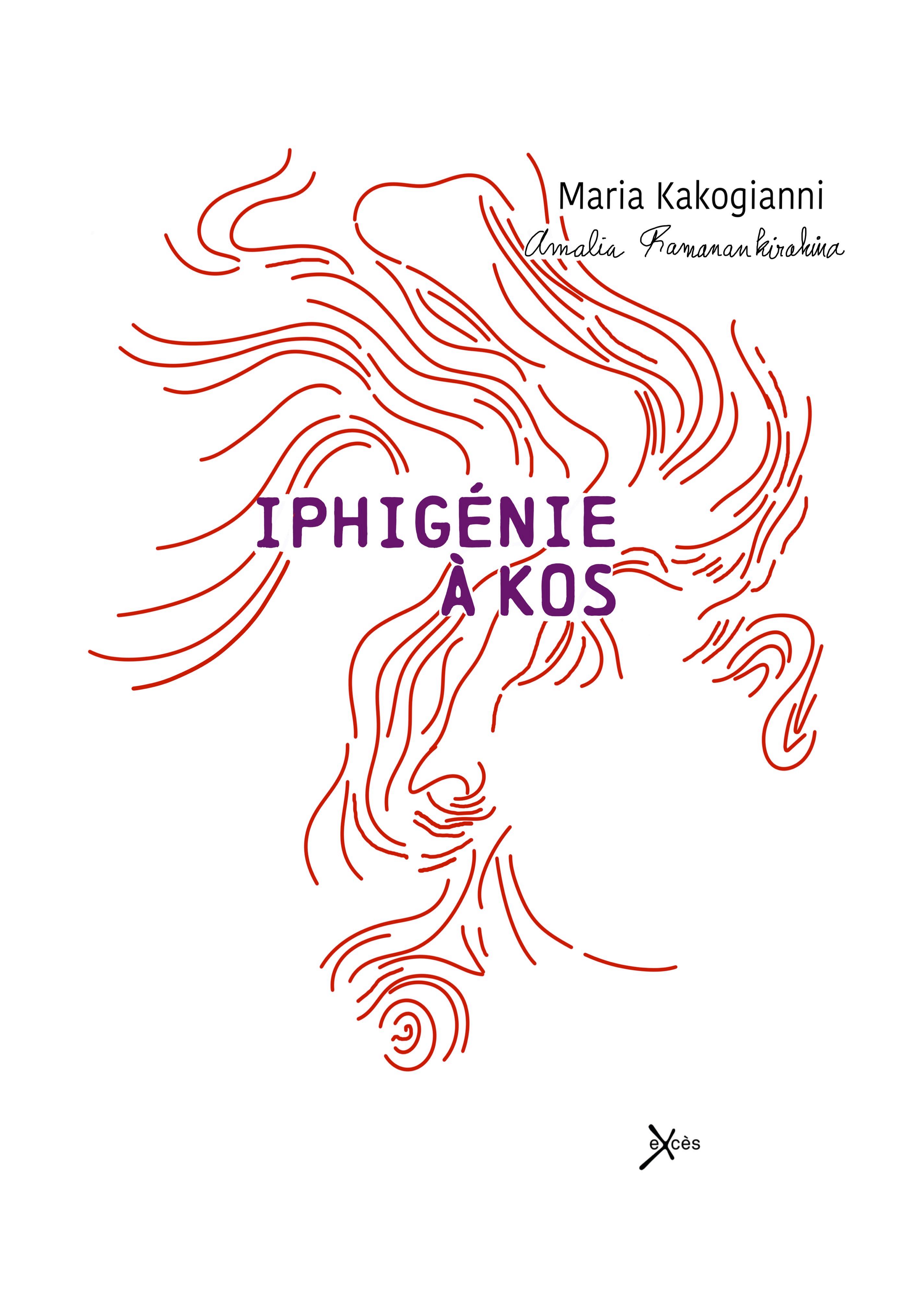
Sous titre : monologue polyphonique Collection : Traversées
Largeur : 13 cm
Hauteur : 20,5 cm
Poids théorique : 100 gr
Nombre des pages : 28
Prix : 13€
Tirage envisagé : 600
Quantité disponible pour Serendip : 250
ISBN : 978-2-9581188-8-4
9782958118884
Biographie : Maria Kakogianni est née à Athènes travailleuse du texte et philosophe. Elle a publié des ouvrages dans des domaines variés, alliant philosophie, littérature, poésie, et essai politique. Parmi ses publications
•Printemps précaires des peuples éditions Divergences, 2020, illustrations de Satya Chatillon ; Ivre décor (Hippocampe éditions 2020, Keimena books 2023) ; Surgeons et autres pousses (éditions Excès 2022), en collaboration avec Marie Rouzin et Amalia Ramanankirahina pour l'intervention graphique.
Pitch : Impatiente de partir pour Troie, l'armée grecque est retenue à Aulis. Le vent ne souffle pas. L'oracle dit qu'il faut sacrifier la jeune Iphigénie, fille du chef de l’armée. Aujourd'hui, Aulis est un paysage ravagé : les restes d’une ancienne carrière, un immense complexe industriel, fermé depuis des années, un chantier de construction naval...
Difficile d'habiter cette terre maintenant, et encore plus d’habiter nos mythes. Et si Iphigénie était une vielle sage-femme à la retraite ? Une femme enceinte venant du Cameroun attend son transfert au camp de
réfugiés de Samos, sur le palier, une vieille dame lui offre un verre d’eau, sa voisine, Iphigénie. Une femme se promène au bord de la mer. Elle nous convie dans ses errances, ses réflexions et ses affects, aussi intimes
Pendant que la catastrophe écologique et sociale fait ravage, un nouvel oracle annonce : Il n'y a pas d'alternative. Un homme d'une quarantaine d'années demande à Iphigénie du feu, mais un simple échange verbal semble impossible, empêché. La femme au bord de la mer monologue, les souvenirs de son enfance lui reviennent par bribes, confondant mythe et réalité, des voix du passé se multiplient, des hallucinations au présent aussi. Un petit vent souffle. Au rythme des vagues des questions arrivent : Qui parle ? Que peut une rencontre ? Estce que les bateaux sont partis ?
que collectifs. Dans un monologue polyphonique, au rythme des vagues, des questions arrivent : Qui parle ? Que peut une rencontre ? Est-ce que les bateaux sont partis ?

Ce texte réinvestit un genre classique, celui de la transfiguration des mythes de la littérature antique pour en donner à la fois une autre forme et un autre contexte. Un texte à la fois poétique et politique. Il a été mis en scène à Avignon dans le Off en 2023 après avoir reçu le soutien du programme des résidences écrivains Seine Saint-Denis, et d’une résidence d’écriture à La Maison du Spectacle
– La Bellone (Bruxelles.)
« Un ancien mythe grec raconte qu’il fallait sacrifier la jeune Iphigénie à Aulis, afin que les bateaux partent pour la guerre de Troie. Les restes d’une ancienne
carrière, une usine à produire du béton, une usine de traitement de déchets chimiques, un chantier de construction naval. Voici Aulis aujourd’hui, de guerre lasse.
Entre deux camps de réfugiés, sur l’île de Kos, Iphigénie, une sagefemme à la retraite, aide une femme enceinte venant du Cameroun à accoucher. Chaque jour, d’autres bateaux partent vers le pays de la ville légendaire de Troie. Ce sont plutôt des embarcations de fortune, de canots de sauvetage sans moteur, chaque jour repoussés en pleine mer.
Un ancien mythe grec raconte qu’il

Au point de départ de ce projet, il y a cette double question qui lie la dévastation des milieux de vie, la construction des refuges pour les humains et les non-humains et la nécessité d’autres manières de faire histoire et cultiver des récits. Dans la mythologie grecque, Iphigénie est une figure de sacrifice. Moins connue qu’Œdipe
qu’elle veut, ce qu’elle peut, ce qu’elle doit. Le sacrifice chez elle semble moins lié à un choix dramatique qu’à tout ce que l’absence de choix organise comme tragédie.
Que faire ? Il n’y a pas d’alternative. Quelque chose de ce qui organise notre présent semble aux prises avec les cauchemars d’Iphigénie. Cette Iphigénie qui erre non pas entre différents choix mais dans cet espace infiniment plus petit et plus vaste entre choix et non-choix. Elaborée à partir d'entretiens auprès des personnes parlant plusieurs langues, qui ont des langues maternelles égarées, adoptives, de substitution, « Iphigénie à Kos » n’est pas un récit documentaire qui remplace le mythe, elle ruisselle entre les deux.
Aujourd’hui tout annonce qu’il n’y a pas d’alternative, que même les alternatives existantes seront toujours avortées et les corps qui les auront portées, abîmés.
qui fait un choix aveugle, inconscient, moins exaltée qu’Antigone qui érige un choix fort refusant les lois de la cité, Iphigénie est celle qui hésite, celle qui change d’avis, celle qui semble ne pas pouvoir devenir actrice devant ce
Et pourtant Le réel n’est jamais ce qui se donne comme réalité. Et rien n’a jamais empêché l’histoire de bifurquer, de disjoncter.
Extraits :
Ère d’encre.
L’heure où le merle chante au milieu des conquêtes et des migrations.
(Aulis, 2019)
Iphigénie à Kos A la frontière du documentaire et du mythe
L’heure où la réalité dépasse la fiction et celle-ci sort ses griffes. Le soleil est en train de croquer la ligne ondulante d’horizon. Les couleurs font tâche sur tout ce qui voudrait être ou avoir une limite. Chair et pierre, corps, viande, esprit.
Il y a un enfer fêlé pour chaque amour empêché, chaque enfant qui n’arrive pas à dormir, et chaque monde qui n’en finit pas de finir.
Je marche pieds nus au bord de l’eau, la bagnole est garée là-haut.

Je l’ai vue en arrivant, il y avait une enseigne en néon « Iphigénia : εθνικές µεταφορές », dixit « métaphores nationales », c’est une boite de transport, en grec on les appelle métaphores aussi, la boutique était fermée. L’usine de béton aussi, le chantier de construction navale tourne au ralenti. Corps-paysage décrit ravages. Il y a une ancienne carrière, une usine de traitement des déchets aussi. La légende dit que c’est ici, à Aulis, qu’il fallait sacrifier la jeune vierge Iphigénie pour que les bateaux partent ainsi pour la guerre de Troie. Mais Aulis ? Pourquoi on l’a sacrifiée elle ? Comment habiter cette terre maintenant ? Et nos mythes.
Depuis peu, un petit théâtre a été aménagé entre les collines de sable de l’ancienne carrière. La roche précédemment abattue forme l’hémisphère où sont maintenant accueillis les gradins des spectateurs. Je ne sais pas pourquoi, ce qui m’a pris de venir ici me promener aujourd’hui. Cela n’a rien à voir avec le théâtre, je le sais, c’était une excuse. Cela fait des années que je suis partie, je fais partie de ceux qui ont pu partir. Ce matin, en me réveillant, sous un air de confusion, je me suis sentie en mission, tiens je vais aller voir le théâtre qu’ils ont construit. Une mission c’est bien, ça occupe. - Je donne mon corps à la Grèce. Sacrifiez Iphigénie, allez détruire Troie ! Voilà les monuments que je léguerai à la longue mémoire des siècles ; ce sont là mes enfants, mes noces, ma gloire. Ce n’est pas moi, c’est Iphigénie qui parle, mais je ne crois pas un mot, surtout ici. On lui annonce une noce avec un beau gosse, Achille, c’est finalement un sacrifice pour que les bateaux partent à la guerre. Au début elle refuse, elle veut vivre, puis elle accepte. Quelle mouche l’a piqué ? L’exaltation patriotique ne me convient pas. Elle n’a pas légué ça à la mémoire des siècles. Ça doit être autre chose, mais quoi ? Iphigénie, de quelle lutte serais-tu le nœud ?
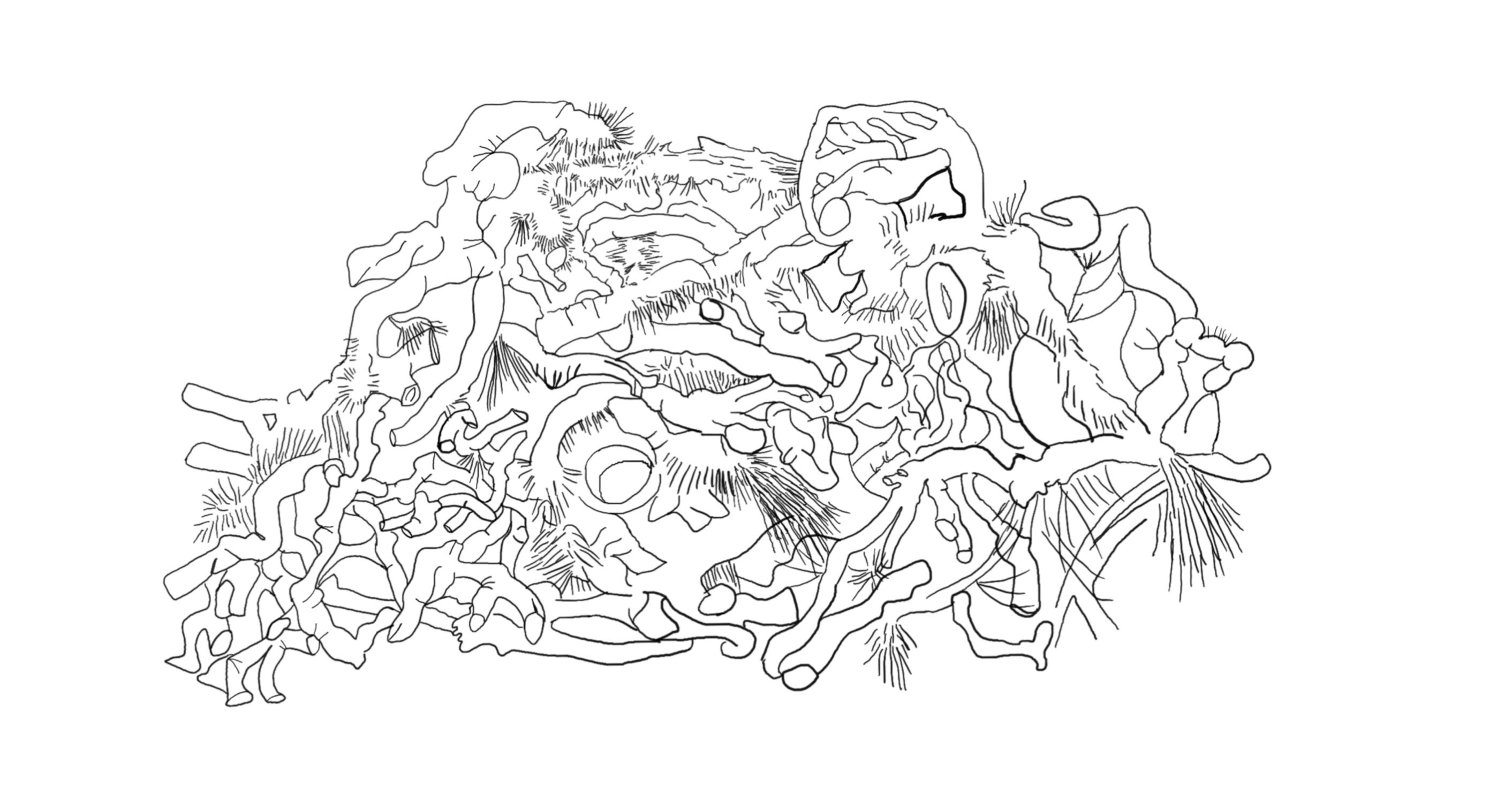
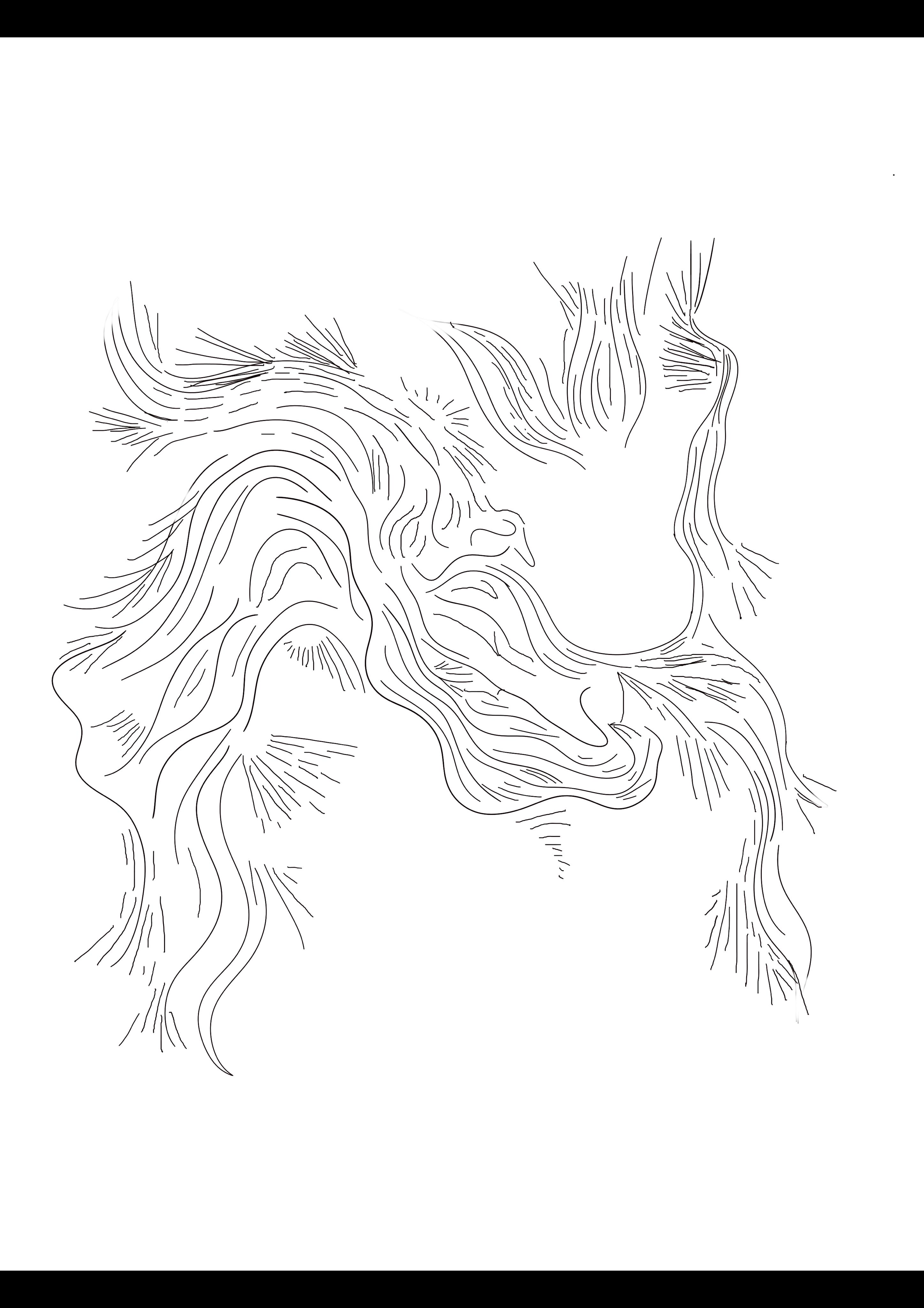
Michel Serfati

Genre : roman
Format : 12 x 18,5 cm
Pages : 240
Prix : 18 €
ISBN : 978-2-490-251-83-4


Né en 1953 à Belfort, Michel Serfati entre en littérature avec Finir la guerre, sélectionné au Festival du Premier roman de Chambéry en 2016. Il publie ensuite, toujours chez Phébus, L’Enfant de la colère en 2020.
Qui est Ismène ? Fille de Jocaste et de Œdipe, sœur d’Antigone, d’Étéocle et de Polynice, que savons-nous d’elle en dehors des illustres membres de sa famille ? Rien, sinon qu’elle n’existe que comme reflet du destin tragique de sa sœur. Michel Serfati lui invente une vie après la mort d’Antigone, l’imagine quittant Thèbes avec sa servante Philarète, découvrant Athènes, rencontrant Sophocle à qui elle raconte le drame de sa famille les Labdacides, revenant à Thèbes pour assister à la mort de Créon puis, prenant définitivement le large pour mener une Odyssée au féminin, perdant, dans son exil, son statut de princesse. Le charme de ce livre est que l’auteur s’amuse avec la mythologie, nous dresse le portrait d’une femme belle et aventureuse qui se délie des liens ataviques qui la gardaient prisonnière pour inventer sa vie et découvrir le monde.

Janvier
Contact : colette.lambrichs@gmail.com Téléphone : 06 60 40 19 16 Diffusion et distribution : Paon diffusion.Serendip Relation libraires : jean-luc.remaud@wanadoo.fr Téléphone : 06 62 68 55 13 Éditions Du Canoë : 9, place Gustave Sudre Local parisien : 2, rue du Regard 33710 Bourg-sur-Gironde 75006 Paris c/o Galerie Exils Éditions du Canoë 2024
XVI
Elle voulait retrouver Sophocle, dont la réputation était maintenant établie bien au-delà de l’Attique. On venait de loin entendre et voir ses tragédies dont certaines avaient déjà été couronnées aux Grandes Dionysies. Ismène regrettait-elle d’avoir, des années plus tôt, peutêtre par vanité aristocratique, repoussé les avances de l’homme, pourtant bien fait de sa personne, si doux aussi ? Voulait-elle se donner à elle-même et donner à celui qui était maintenant parvenu à une gloire certaine une nouvelle chance ? Elle ne le savait trop, la pensée l’avait effleurée, mais elle avait un autre objectif en tête. Elle renoua d’abord avec Lampros, son ancien maître de musique. Le vieil homme tout grisé témoigna toute sa tendresse à l’égard de la jeune femme que, comme chacun, il savait profondément blessée. Leur première rencontre fut l’occasion d’un chant partagé qu’il lui proposa immédiatement, et la magie de leur communion vocale fut instantanée.
Y a-t-il plus belles retrouvailles que de chanter ensemble ? Ton timbre n’a rien perdu de son élégance,
3
tu as encore gagné en tessiture, en amplitude aussi, et je suis frappé de voir combien ton corps, que j’ai senti un peu contraint au premier regard, s’est instantanément déployé au moment où tu as libéré ta voix, c’est tout simplement magique.
Chanter, chanter encore, seule le plus souvent, est une des choses qui me font la vie belle par instants, même si j’ai parfois du mal à me tenir droite.
C’est à lui qu’elle s’adressa pour reprendre contact avec Sophocle qu’elle n’osait solliciter directement. Le vieux maître invita le tragédien pour, lui avait-il fait dire, une belle surprise. La rencontre entre Ismène et Sophocle eut lieu un après-midi dans le jardin de l’hôte, qui rapidement s’éclipsa, prétextant une leçon. Sophocle, dont la cinquantaine n’avait pas altéré le charme malgré quelques rondeurs, ne masqua pas sa surprise devant celle qu’il appela la princesse de Thèbes, mais il sembla lui aussi sur une certaine réserve. Était-ce l’étonnement qui créait cette imperceptible retenue, était-ce l’invisible voile de drame qu’elle portait malgré elle, ou le souvenir d’une humiliation ancienne, fruit de la distance qu’Ismène avait su lui imposer il y avait si longtemps ? L’homme de théâtre se montra cependant courtois, prévenant, curieux de ce qu’elle devenait.
Cher Sophocle, tu sais que j’ai toujours admiré ton génie, la manière dont tu parviens à si bien mettre en scène les passions humaines, et celles qui le sont moins. Partout on vante tes mérites et ton talent.
Rien ne m’a été offert par ma naissance, je n’étais
pas d’une grande famille, comme d’autres, mais mon père m’a fait donner une belle instruction que je tente maintenant de faire fructifier, avec beaucoup de travail, en observant sans relâche les hommes, en écoutant aussi, autant qu’il est possible, la voix des dieux. Je n’ai rien oublié de ton séjour à Athènes, de la manière céleste dont tu as rayonné devant tout le groupe de jeunes gens que vous formiez autour de Lampros. Et je constate avec un grand plaisir que, malgré les deuils si insupportables qui t’ont frappée, tu n’as rien perdu de ta beauté.
— C’est de ces deuils dont je veux t’entretenir. Tu connais la malédiction qui frappe toute ma lignée…
J’en connais ce qui s’en raconte…
Mais justement, chacun raconte ce qu’il veut, ce qui l’arrange. Je voudrais te la narrer dans les moindres détails, et qui mieux que moi, seule survivante de ce carnage, peut le faire ?
Certes. Et qu’attends-tu de moi ? Car tu attends quelque chose de moi, n’est-ce pas ?
Oui, je voudrais que tu en écrives l’histoire, celle d’Œdipe mon père et frère, de Jocaste ma mère, celle de mes frères, celle d’Antigone, la mienne aussi. Toi seul sauras rendre la vérité qui est due à chacun. Ce que tu écriras restera fixé une bonne fois pour toutes dans l’histoire et traversera les siècles, j’en suis certaine, car je sais ce que ton génie peut produire. Et peut-être cela m’aidera-t-il à m’alléger d’un poids bien trop lourd pour mes frêles épaules.
4 5
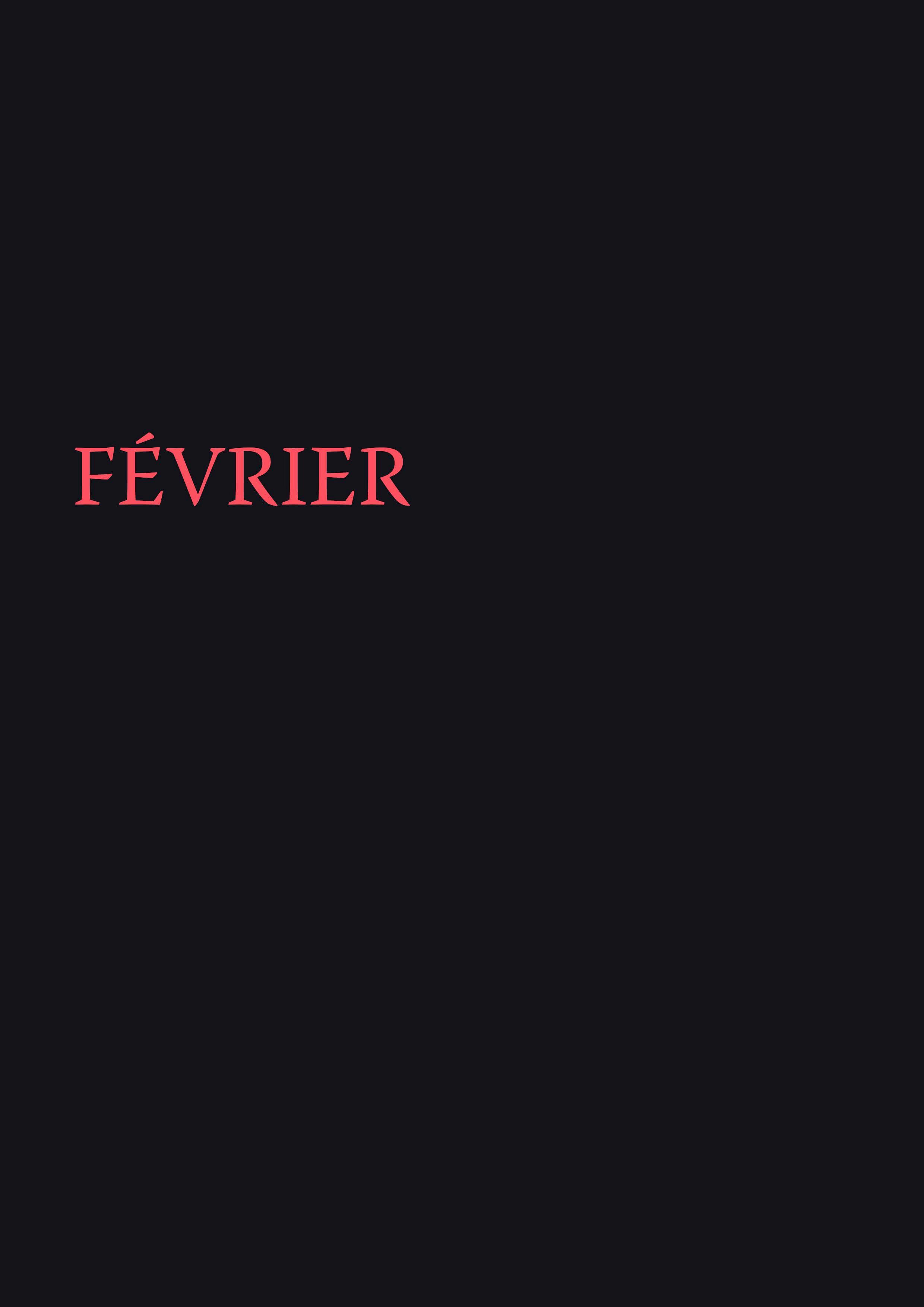
COMME ALMANACH
Marie-Jeanne Urech
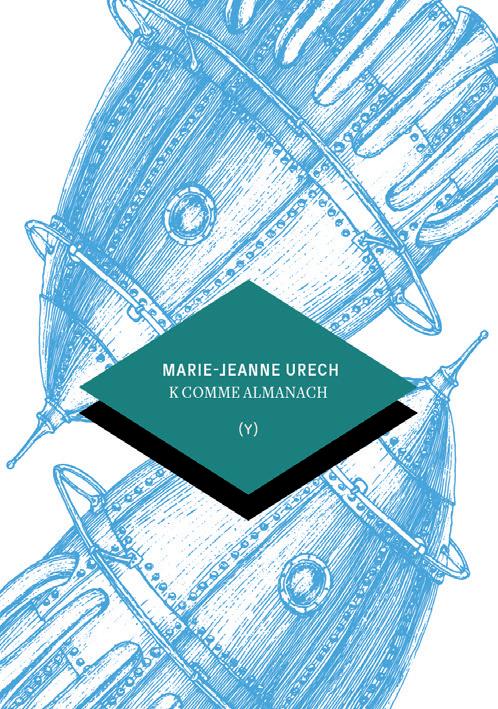
Chaque soir, Simon allume à l’aide de sa perche les lampadaires de la ville. Alors que la population se déporte en masse vers l’idéalisée Belgador pour ne jamais en revenir, lui s’évertue à contenir l’inévitable progression de l’obscurité. Autour de lui, les immeubles se fissurent, la ville est rongée par une végétation suffocante, les denrées viennent à manquer et l’espoir s’amenuise. Un jour, Simon recueille près du Lacmer un perdu-retrouvé, un jeune enfant recraché par les flots, traumatisé, colérique et mutique. Il prend alors la tâche de lui apprendre le langage et le soin du monde.
Après la Terre tremblante, paru en 2018, Marie-Jeanne Urech interroge à nouveau les fragilités de nos quotidiens, nos abandons, et le difficile exercice d’animer un monde tout en le transmettant avec une passion ingénue. Avec K comme Almanach, ainsi qu’un troisième roman en cours d’écriture, MarieJeanne Urech prévoit un cycle de textes sur la mise en mot de notre monde qui se détricote.
Sur l’autrice
Née un 4 juin 1976 entre 5h42 et 21h21, à Lausanne, Marie-Jeanne Urech profite de cette longue journée ensoleillée pour écrire romans et nouvelles dont Les Valets de nuit, prix Rambert 2013, et Des accessoires pour le Paradis, prix Bibliomedia 2010. Traduites en allemand, italien, anglais et en roumain, ses histoires se lisent aussi la nuit.
Hélice Hélas Editeur
Rue des Marronniers 20
CH-1800 Vevey
Tél.: ++41 21 922 90 20
litterature@helicehelas.org
www.helicehelas.org
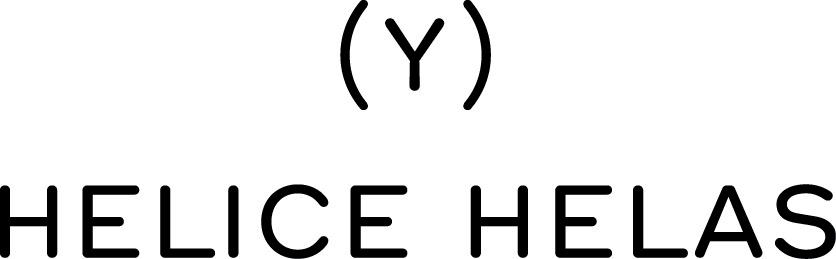
> litterature@helicehelas.org
Distribution Suisse :
Servidis
Chemin des Chalets 7
CH-1279 Chavannes-de-Bogis
Tél.: ++41 22 960 95 10
www.servidis.ch
> commande@servidis.ch
Distribution France - Belgique :
Serendip-Livres
21bis, rue Arnold Géraux FR - 93450 L’Île-St-Denis
Tél.: ++33 14 038 18 14
www.serendip-livres.fr
Collection : Mycélium poche
Genre : Roman Sujets abordés : Amour, couple, passion, fêtes foraines
Format 11.5x16.5 cm, 168 pages
ISBN : 9782940700486
CHF 16/EUR 12
Parution février 2023
K
De sa fenêtre, Simon ne voyait ni mer ni lac, mais une colline rabotée, lyophilisée à grands frais afin d’y construire une muraille et un complexe hôtelier. La muraille pour décourager les étrangers et le complexe hôtelier pour en accueillir d’autres. Enfant, par cette même fenêtre, il avait vu les bulldozers arracher buissons de genêts et arbres noueux, les pulvérisateurs répandre leur chimie et le temps assécher la colline. Il avait vu les nuances de vert s’affaiblir, pâlir, puis se dissoudre tout à fait. Et enfin les pierres s’ériger à des hauteurs inhumaines. Il restait quelques vestiges de ces constructions pharaoniques, jamais rentabilisées à cause de la soudaine découverte de Belgador. Aux jumelles et avec un peu de persuasion, on distinguait à présent quelques pousses vertes se frayer un chemin, repeuplant cette colline mutilée de rares poils, comme ceux qui donnent aux éléphants des têtes si émouvantes.
21 ***
Un cri suivi d’une secousse réveillèrent Simon. Tous deux venaient des profondeurs de l’immeuble, là où Madeleine maintenait, plus fortement que du béton armé, les fondations de l’immeuble. Simon dévala les escaliers, croisant sur leur palier ceux que le séisme avait inquiétés. Madeleine était courbée par une crampe au mollet, les bras résolument tendus vers un plafond qui menaçait de l’écraser.
Pousse sur ma jambe, vite !
Laquelle ?
La gauche. Comme ça ?
Madeleine se redressa, le plafond reprit de la hauteur et la maison cessa de trembler.
Ouvre une bouteille !
Celle-ci ?
N’importe laquelle ! Ce sont toutes les mêmes.
C’est quoi ?
22 ***
Du magnésium.
C’est bon ?
Comme du ciment. Je dois en prendre tous les jours. A cause de mes crampes.
C’est pour ça que tu as une collection de tire-bouchons ?
Chaque dimanche, les locataires de l’immeuble se retrouvaient chez Madeleine pour un repas. Aucun n’avait d’enfants, l’église ne les attirait pas, ils avaient passé l’âge de se reposer, alors jamais ils ne manquaient le rendez-vous dominical. Seul Monsieur Samson restait à l’étage, infortuné prisonnier de petite ou grande guerre, auquel on servait la soupe, le gibier et l’omelette sur un plateau comme au parloir. Les discussions étaient animées, joyeuses, familiales. Et même si Georgette n’entendait plus grandchose, elle souriait dans le vague, comblée par le repas et la bonne compagnie. Quand Simon quittait les convives pour éclairer la nuit, il regrettait toujours les conversations manquées. On avait beau le retenir, jamais il ne manquait l’heure.
23
***
9 782940 522811
LA TERRE TREMBLANTE

Marie-Jeanne Urech
2e édition (poche)
Dans La Terre tremblante, le lecteur verra que ce qui se cache derrière une montagne, c’est une autre montagne, et ainsi de suite. Son père tout frais enterré, Bartholomé de Ménibus fuit l’archétype du village dans la vallée — sa laiterie, son abattoir et son café — pour aller voir à quoi ressemble l’autre versant de la montagne. Dans le pays d’à-côté, les routes asphaltées crachent des engins et, sur un banc, les vieux se languissent et attendent leurs enfants qui les ont abandonnés pour partir en vacances. Les vaches portent des hublots pour qu’on jauge : « C’est une vitrine sur le produit » explique le paysan. Bartholomé décide de poursuivre et d’enjamber la montagne suivante. La Terre tremblante est un ouvrage troublant. Paradoxes et autres perles d’inventivité ouvrent la voie à une sagesse plus profonde : si les montagnes se ressemblent et mènent apparemment à d’autres montagnes, chaque ville rencontrée par Bartholomé est unique, aux prises aux rapports de production effrénés ou à la gestion des déchets ou à des impuretés à cacher ou enterrer. La Terre tremblante pourrait passer pour une fable écologique. Ce serait s’arrêter à la première couche de cette œuvre riche et exponentielle. Au milieu de son écorce revient inlassablement la question du peuplement du monde par les humains, puis, comment ils le quittent. Derrière le style énigmatique et proprement urechien, on découvre une tendresse ingénue et un humanisme poétique.
Diffusion :
Paon diffusion
44 rue Auguste Poullain +93200 Saint-Denis www.paon-diffusion.com
Hélice Hélas Editeur
Rue des Marronniers 20
CH-1800 Vevey
Tél.: ++41 21 922 90 20
litterature@helicehelas.com
bd@helicehelas.com www.helicehelas.org

Sur l’auteur : Née un 4 juin 1976 entre 5h42 et 21h21, à Lausanne, Marie-Jeanne Urech profite de cette longue journée ensoleillée pour écrire romans et nouvelles dont Les Valets de nuit, prix Rambert 2013 et Des accessoires pour le Paradis, prix Bibliomedia 2010. Traduites en allemand, italien et roumain, ses histoires se lisent aussi la nuit, grâce à une autre source lumineuse, la fée électricité.
Collection : Mycélium et mi-raisin
Genre : roman, conte absurde
Sujets abordés : écologie et production, anthropologie et croissance
Format 11.5x16.5, 152 pages
ISBN 978-2-940522-81-1
CHF 16/EUR 12
Parution janvier 2020
ÉRIC PESTY ÉDITEUR
Michel Falempin
Funérailles
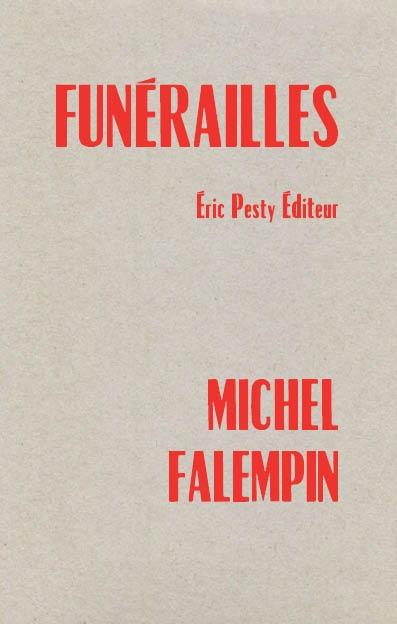
« un jour, dans les parages d’un simple tas de débris végétaux, émergea l’ombre solitaire d’un jeune homme, je l’entraperçus : ce qu’elle faisait, dans cette partie à l’abandon du sanctuaire où elle cachait son vice, j’hésite à en faire part, mais tant pis : cette ombre lisait ! / Faulkner ? Sans vergogne, je l’aurais juré. »
Funérailles s’ouvre sur un pastiche du roman de Faulkner intitulé Sanctuaire : une description en négatif et en pied de l’héroïne prénommée Temple, à laquelle fera écho une seconde description de jeunes femmes, plus proches de la Temple originale, à la toute fin de ce texte bref.
Le narrateur (je) se rend au cimetière du Kremlin-Bicêtre (le « sanctuaire ») pour accomplir ses devoirs filiaux et croise tour à tour deux cortèges funéraires : l’un accompagnant l’enterrement d’une jeune femme sans doute prostituée ; l’autre accompagnant l’enterrement d’une haute dignitaire communiste russe. La rencontre incongrue de ces deux cortèges amène à la chute du récit – littéralement en fait de chute : au sortir du cimetière le narrateur se tord la cheville et réussit à se rétablir in extremis provoquant la moquerie (mélange de gaieté et d’insolence) de trois jeunes femmes apparues : « Vous avez manqué tomber, Monsieur, je vous ai vu, je vous ai vu. » Le narrateur de conclure, rappelant les deux cortèges rencontrés : « c’est pour moi comme si cette gaieté, cette insolence, lançaient sur l’Amour [représenté par la prostituée mise en bière] et sur la Cité Juste [la haute dignitaire communiste] une ultime et insouciante pelletée de terre ».
Michel Falempin est né en 1945. Il est retraité de ses emplois de bibliothécaire à la bnF et conservateur à la Bpi, centre Pompidou.
Il est l’auteur d’une œuvre discrète mais reconnue, puisque son écriture rencontre, depuis sa première publication en 1976, successivement des maisons d’édition prestigieuses comme la collection « Digraphe » et la collection « Textes » chez Flammarion, la collection « Littérature » à l’Imprimerie Nationale, les édition Ivrea.
En 2019, nous publiions en co-édition avec Héros-Limite : Affaire de genres et autre Pièces de fantaisies – regrougant les Pièces de fantaisie n°15, 10, 5, 3 et 14.
Funérailles est la vingt-quatrième pièce de cet ensemble.
(COUVERTURE PROVISOIRE)
Parution : février 2024
Prix : 10 €
Pages : 16
Format : 14 x 22 cm
EAN : 978-2-917786-88-8
Collection : agrafée
Rayon : Poésie
CONTACT PRESSE ET LIBRAIRE
Éric Pesty : contact@ericpestyediteur.com
Voici un personnage littéraire. Mais aussitôt choisi, il faut le reconnaître : cette jeune femme ne porte pas, flanqué sur son bras (à la diable, précise l’original), un manteau. Ses jambes ne sont pas longues, ça non, mais robustes, écartées de surcroît et puis découvertes plus qu’en partie. Une hâte fébrile ne les agite pas ; elle est assise, placide, prenant sur le sol (ciment) un appui qui paraît ferme. Il est clair, avec cela, que sa silhouette courtaude ne se profile pas en coup de vent et pas question non plus qu’elle s’évanouisse dans l’ombre : le côté de l’avenue où elle se tient est implacable, ce jourlà, quant au soleil (l’ombre est en face, il faut traverser l’avenue, ce n’est pas sans l’observation d’un certain nombre de règles, ce sera pour plus tard). De la jupe minimale et noire ne déborde aucun dessous féminin. Elle n’est pas poudrée : enfarinée, plutôt. Sa face, tragique (théâtrale), artificiellement crayeuse, est endeuillée : sourcils refaits charbonneux, bouche noire, les ongles aussi, mais, je note, écaillés. La tête d’une messagère qui n’apporte pas une bonne nouvelle. Point
1
de jeux de lumière dans une chevelure légèrement rousse dont les boucles pendraient : la touffe volumineuse a connu l’eau oxygénée. Néanmoins, pour n’importe qui passe, il y a bien une vision de flanc et de cuisse mais qui n’a rien de fugitive : elle insiste, presque elle provoque. Puisque l’original ne dit rien du buste, je précise : décolleté, pas en vain. Surtout, rien ne permet d’avancer qu’elle s’appelle Temple. Pourtant, elle a déjà, alors qu’elle est assise, qu’elle paraît attendre, placé dans son giron, quelque chose : un épi de maïs. Manquent quelques grains grillés qu’elle a dû mordiller avant de le nicher en haut de sa jupe noire, là où le chemisier en partie déboutonné, déborde sur le haut du ventre replet. C’est seulement à cause de la place de cette céréale, qu’un passant, qui a lu, pense à Faulkner. Nous sommes à l’endroit où le côté ensoleillé de l’avenue (comme s’intitule à peu près une célèbre chanson américaine) donne sur une brève allée qui emprunte son nom à sa destination : elle est dite « du cimetière ». Deux comparses s’approchent de la terrasse où se tient ce personnage littéraire devant un gobelet de carton duquel émerge la paille coudée et l’accostent.

LUC MARELLI
Tendresses après la pluie
Luc Marelli a l’habitude de sauter par-dessus les frontières. « Depuis l’enfance », dit-il. Un carnet, sac au dos, il dessine dans le train, dans les villes, dans les champs. En quelque point de chute ses peintures attendent d’être reprises. Un de ses derniers chemins le conduit en Finlande, dans une résidence d’artiste, pour plusieurs séjours. C’est la matière de Tendresses après la pluie. L’observation d’un ailleurs et de soi-même – que fait au peintre un soleil si bas ?
Après une première prise de repères, Luc Marelli élargit le cercle. Marches dans le froid, rencontres près d’une voie désaffectée, amitiés liées dans les gares et discussions. Musées et bibliothèques pour l’histoire de l’art. Il y fait chaud. Puis le cercle s’élargit dans le temps. Des personnages racontent l’histoire du pays. Celle, récente, de l’abandon de la voie ferrée. Celle, plus ancienne, d’un morceau de territoire perdu lors d’une guerre. Cette fois, c’est une frontière qui saute par-dessus les vies et les villages. Par la parole, les témoins s’aventurent dans ce no man’s land où flottent encore leur enfance, leurs ancêtres.
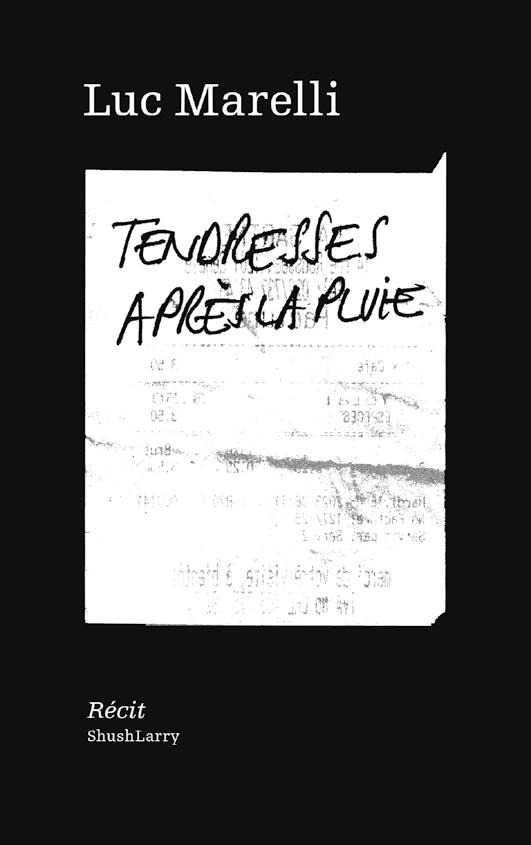
collection ShushLarry
format 11 x 17,5 cm, 124 p., broché isbn 978-2-88964-065-2
prix CHF 16.50 / € 13
rayon littérature genre récit parution 8 mars 2024
« La journée commence par un coucher de soleil. » C’est un peintre qui part en Finlande. Il décrit ce qu’il voit et s’invente des témoins pour raconter plus loin l’histoire de cette terre.
art&fiction
LA FINLANDE, LE VOYAGE, LA PEINTURE, JOHN BERGER, «LE LIÈVRE DE VATANEN»
D’ARTO PAASILINA, AKI KAURIMSÄKI, MARIO RIGONI STERN
Luc Marelli (*1958) est né à Athenaz, dans le canton de Genève. Il a passé plusieurs années dans des villes européennes: Berlin, Munich, Rome et Bruxelles. Au début des années 1990, il a installé son atelier en Bourgogne du Sud, en France.
Il peint dans la nature, à la lumière du jour, influencé par les saisons. Depuis une dizaine d’années les forêts, la lumière et la palette de couleurs de l’Europe du Nord le fascinent. Plusieurs séjours en Finlande et en Scandinavie nourrissent son inspiration. Parmi de nombreux prix, il a remporté par deux fois les Bourses fédérales en peinture.
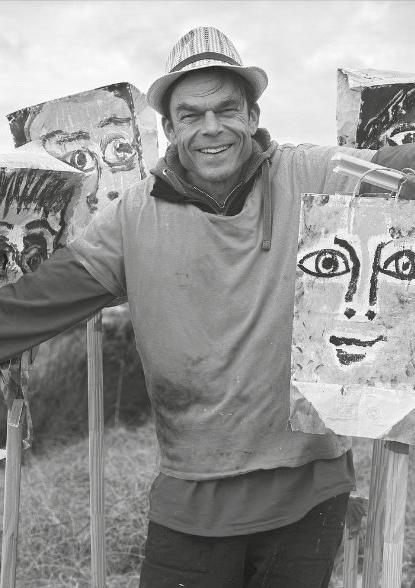
L’écriture de Luc Marelli est chargée de sensations –visuelles, tactiles – de goûts et d’odeurs. Elle croise tous les thèmes chers à son travail de peintre : les baies, les fruits, les plantes aromatiques, les abeilles, les ruches et le miel, les nichoirs pour oiseaux.
SI VOUS AIMEZ
Portrait
JE ME SOUVIENS . À mon arrivée elle me proposa de participer à une séance de dessin d’académie avec un modèle. Je répondis que j’étais fatigué par le voyage et tirai ma valise dans l’escalier raide, à l’étage, vers le studio mansardé que j’allais apprivoiser six semaines durant. En mon for intérieur je n’avais nulle envie de tromper mes errances à venir, le long de la frontière russe, avec des croquis de nus le jeudi soir. Lorsque j’étais dans les environs, il m’arrivait même, de laisser glisser les heures où avaient lieu ces séances de dessins, au bar vitré de la gare centrale. Mes bouffées de mauvaise conscience étaient vite effacées par des dessins, sur le vif, dans ce refuge d’alcooliques, en attente de trains fantômes.
J’ÉTALE MON MATÉRIEL sur une grande table. Je peindrai au sol. Patience. Plastique de protection fin sur un lino constellé de taches. Eclats d’inspirations passées ? Calmer la hâte. J’échafaude. Pour ne pas m’y tenir, pour oublier le motif de mon séjour. Pour me libérer des tentations. Je pose un programme au stylo sur un grand morceau de papier.
Luc Marelli | Tendresses après la pluie Extraits
Les petits pots de couleurs glissent de leur sachet d’emballage. Inventer une palette. Apprécier l’attente. La brosse de tapissier, épaisse me plaît. Elle se gorge d’eau, de jus, de couleurs. Dispense. Retient, déverse. Garde en réserve des indices colorés qui se retrouvent et se marient dans ses poiles. Inventer. Tout recouvrir d’un brouillard blanc. Danse autour des feuilles de papier. Je me détends. Ma soupe glisse son odeur. Lâcher les pinceaux. Des feuilles humides couvrent le sol. Par petits sauts, les évitant, je gagne la cuisine.
Dehors, passants aux chiens, fantomatiques. Le jour nous fausse déjà compagnie. Ensuite. Les pinceaux poisseux. Des couleurs couvrent les feuilles. J’ai laissé un peu de moi-même. Que suis-je venu découvrir ? Je sors en déroute. Le froid violente le sol gelé. Le lièvre blanc détale. Je marche jusqu’à la cheminé de briques.
PARLER DE CES PASSAGES D’UN LIEU À
L’AUTRE et des sédiments enfouis dans les illusions, qu’ils laissent sur le corps et l’âme. Les jours par glissements successifs parviennent à une lumière silencieuse.
Prendre l’enfilade sous gare qui scinde la ville telle une tranche de gâteau, posée sur des colliers de rails ou scintillent, boutiques,
10 LUC MARELLI
Luc Marelli | Tendresses après la pluie Extraits
restaurants, bars, ou des glissades d’escalators, conduisent aux façades en fête, allumées de géométries variables. S’extraire de cette forteresse urbaine, retrouver un indice de nature sous la forme d’une rivière énergique le temps d’un jour et avant que le froid, étrange dans l’obscurité, ne la change en glace.
À ces journées, toutes particulières, les arbres racontent l’année écoulée. Quelques feuilles jaunes, glissent et éclairent le sol. Phosphorescence et scintillement dans une lumière qui hésite.
D’abord le temps s’étire vers l’horizon, ankylosé de pluie et ces feuilles mortes, comme des cartes de géographie usées miroitent lorsque l’obscurité domine et me guident jusqu’à la maison grise. Ensuite un vent glacial balaie sans répit la cité moderne. Réfugié dans une bibliothèque, j’ouvre, exalté et curieux, des livres au hasard. Je note les noms d’inconnus, envisage de les rencontrer ou tout du moins de défricher ce qu’ils ont laissé comme iconographie publique. L’utilisation, à mes yeux magique, des matériaux à disposition dans une nature, ici immense, me laisse songeur et affamé. Des sensations enfouies surgissent. Je pense à la précision requise, au fil des saisons, face aux changements brutaux des conditions
T ENDRESSES APRÈS LA PLUIE 11
Luc Marelli | Tendresses après la pluie Extraits
Basso / Godefroy
Genre : beau livre / essai
Format : 13 x 21 cm
Pages : 240 pages en couleurs
Préface de Mireille Calle-Gruber
Prix : 24 €
ISBN : 978-2-490251-85-8


Doctorante en littérature française au sein de l’équipe Handling, Pauline Basso prépare une thèse autour des gestes d’assemblages d’écrivains (Michel Butor, Marguerite Duras et Claude Simon) et de leurs processus créatifs.

Adèle Godefroy est photographe, enseignante et chercheuse. À la suite de sa rencontre avec Michel Butor en 2013, elle a fait une thèse sur l’étude des interactions entre la pratique photographique du poète et son écriture. Elle anime régulièrement des ateliers d’écriture créative tout en poursuivant sa pratique personnelle de la photographie.


C’est à Albuquerque, lors d’une tournée de conférences aux ÉtatsUnis, que Michel Butor délaisse la photographie qu’il a pratiquée de 1951 à 1961 pour s’adonner aux assemblages de cartes postales qu’il adresse à ses divers correspondants. Commencés comme un amusement, ils deviennent, au fil du temps, de plus en plus élaborés et se diversifient selon les destinataires.
Pauline Basso les a étudiés avec une grande attention et Adèle Godefroy en a fait de merveilleuses photographies. Cette activité parallèle à l’œuvre du grand écrivain est montrée pour la première fois dans cet ouvrage. Mireille Calle-Gruber s’attache à mettre l’accent sur l’importance de la correspondance dans l’œuvre de Michel Butor, qui est encore – à elle seule – un continent inédit.
Mars
Éditions du Canoë 2024 Contact : colette.lambrichs@gmail.com Téléphone : 06 60 40 19 16 Diffusion et distribution : Paon diffusion.Serendip Relation libraires : jean-luc.remaud@wanadoo.fr Téléphone : 06 62 68 55 13 Éditions Du Canoë : 9, place Gustave Sudre Local parisien : 2, rue du Regard 33710 Bourg-sur-Gironde 75006 Paris c/o Galerie Exils
Michel Butor et Carlo Ossola
Genre : dialogue
Postface de Carlo Ossola
Format : 12 x 18,5 cm
Pages : 64
Prix : 10 €
ISBN : 978-2-490251-80-3


Michel Butor (1926-2016) est un des écrivains majeurs de notre temps. Après avoir été professeur de langue française à l’étranger, il entame une carrière universitaire et enseigne la littérature aux États-Unis, en France, puis à Genève. Poète, romancier et essayiste, il a exploré et expérimenté toutes sortes de formes nouvelles de représentation du monde. Il a également collaboré avec des artistes, créant de nombreux livres-objets. Les Éditions de la Différence ont publié ses œuvres complètes en 12 volumes (2006-2010).
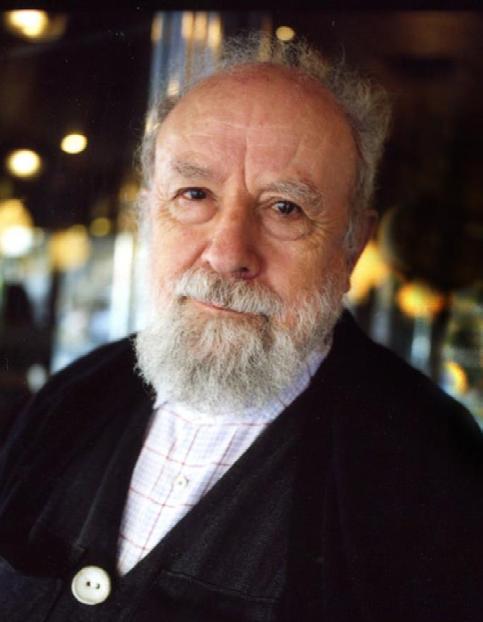
Carlo Ossola (Turin, 1946) est, depuis 1999, professeur au Collège de France, où a été créée pour lui la chaire de « Littératures modernes de l’Europe néolatine ». Il a été professeur titulaire dans les Universités de Genève (1976- 1982), Padoue (1982-1988), Turin (1988-1999). Il a été, avec Jack Ralite, à l’origine des « Lundis du Collège de France à Aubervilliers ». Il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont, récemment, Fables d’identité pour retrouver l’Europe, Paris, PUF, 2017 ; et Les Vertus communes, Paris, Les Belles Lettres, 2019.
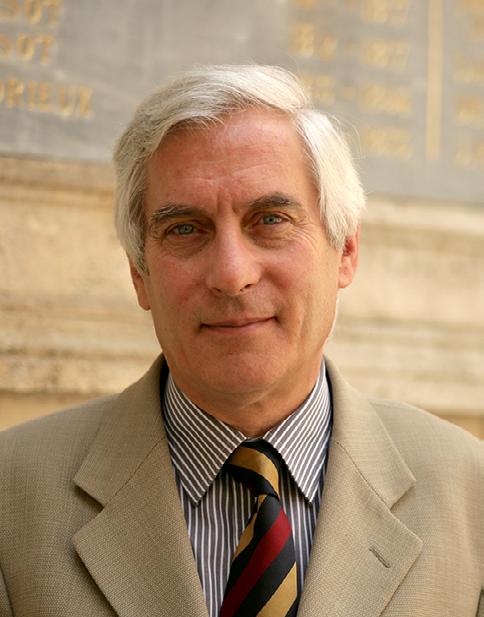
À Saint-Émilion, le 28 mai 2011, deux hommes discutent. L’un, Michel Butor, auteur sans pareil, se trouve dans une disposition étrange : l’année passée, il a perdu sa femme et vu paraître, par ailleurs, le dernier volume de ses Œuvres complètes. L’autre, Carlo Ossola, sent que le moment est flottant. Ils se trouvent dans une église désaffectée, dans les limbes en quelque sorte : il ne peut en être autrement, il sera question du temps. Des temps, plus précisément, qui traversent l’œuvre de Butor et qui se superposent, comme des strates géologiques, dans le corps et l’esprit d’un écrivain de plus de quatre-vingts ans. Qu’est-ce que relire, des décennies plus tard, l’intégralité de sa propre œuvre ? Comment un lieu, en tant que monument, permet-il de déchiffrer le temps ? Qu’est-ce que le temps une fois que l’homme n’est plus ?
Il était plus que temps – c’est le moins qu’on puisse dire – que cet entretien saisissant soit réédité.
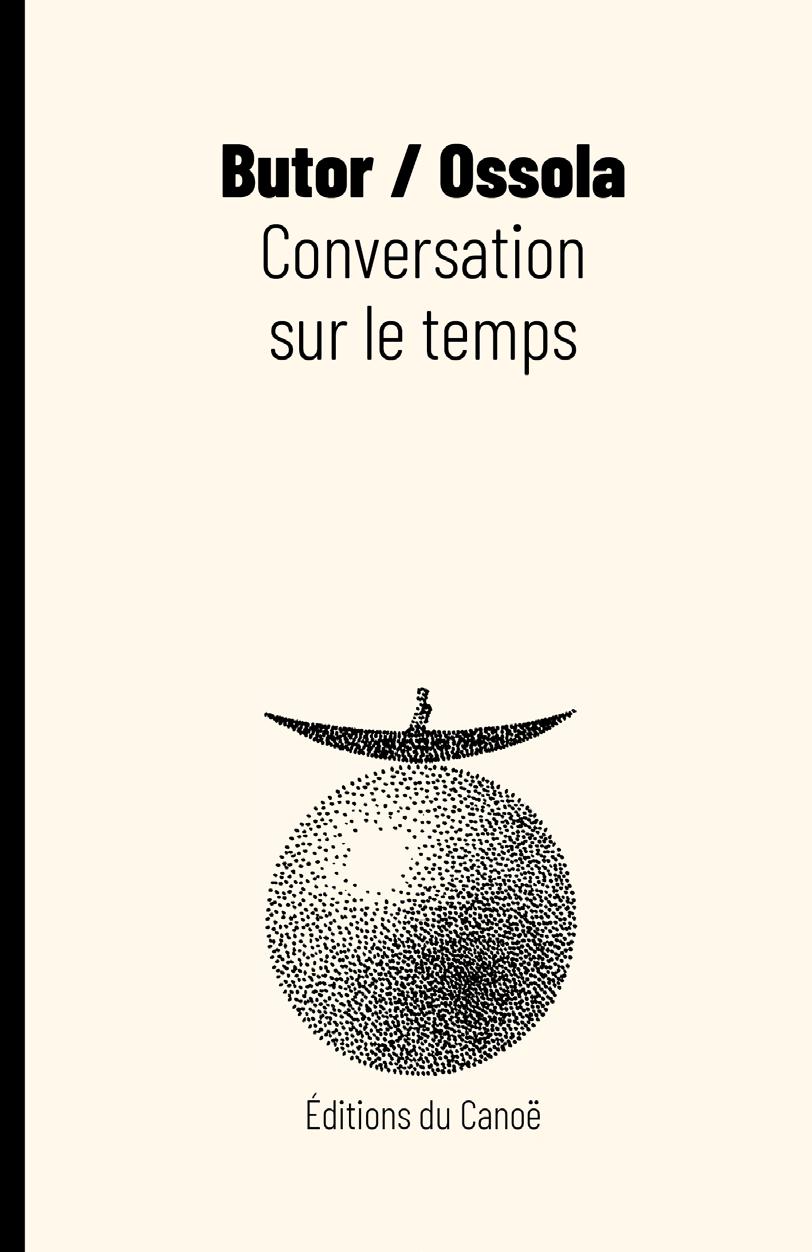
octobre
3
Contact : colette.lambrichs@gmail.com Téléphone : 06 60 40 19 16 Diffusion et distribution : Paon diffusion.Serendip Relation libraires : jean-luc.remaud@wanadoo.fr Téléphone : 06 62 68 55 13 Éditions Du Canoë : 9, place Gustave Sudre Local parisien : 2, rue du Regard 33710 Bourg-sur-Gironde 75006 Paris c/o Galerie Exils Éditions du Canoë 2023
CotCotCot Éditions
de Elisa Sartori
tous publics
ISBN 978-2-930941-67-7
format : 10,5 x 15,5 cm

coll. Baladeur, des livres qui aiment à se déplacer sans but précis couverture souple à rabats ; dos carré cousu-collé
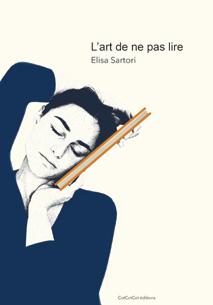
52 pages • [14,50 €]
• livre relié •
Un livre est-il le meilleur des cadeaux ? Qu’en faire lorsqu’il est cause de souffrance et de malentendus ?
Le laisser prendre la poussière ou lui trouver une utilisation ? La narratrice propose plusieurs pistes pour le moins inattendues…
Illustration : photographie + tablette graphique

Thèmes : livre
lire/lecture
dyslexie
Argumentaire :
• les jeunes et la lecture : difficultés et souffrances, malentendus ;
• thèmes plus larges autour du livre et du corps, du livre-objet, de la place de la lecture/du livre dans la société de consommation actuelle (livre devenu objet déco chez les influenceurs)
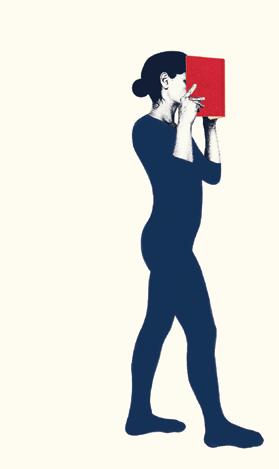
•
•
•
livre-objet
sortie le 5 jan. 2024
L’art de ne pas lire
Née à Crémone, Elisa Sartori commence ses études à l’Académie des beaux-arts de Venise pour ensuite les poursuivre à l’Académie royale des beaux-arts de Bruxelles, au sein de l’atelier d’illustration d’Anne Quévy. Son livre accordéon Je connais peu de mots (CotCotCot, 2021) lui a valu le Prix de la première œuvre en littérature jeunesse 2021, décerné par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Également paru aux éditions Thierry Magnier : Les Polis Topilins, album illustré par Nina Neuray.
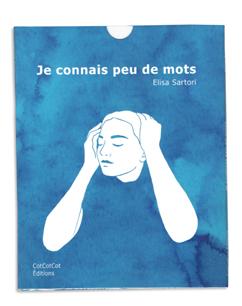

[leporello]
Je connais peu de mots
– ► Prix de la première œuvre
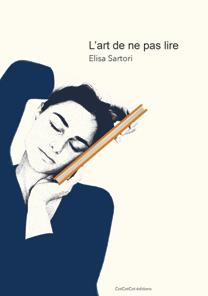
– jeunesse 2021, Fédération
– Wallonie-Bruxelles
Sortie : février 2021
[Carnet 02]
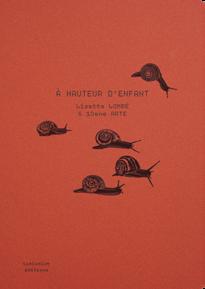
À hauteur d’enfant de Lisette Lombé & 10ème ARTE (collectif de street art composé d’Almudena Pano et Elisa Sartori)
Sortie : septembre 2023
[Baladeur 01]
à paraître en janvier 2024
Titres publiés chez CotCotCot
CotCotCot éditions | contact presse : Gabriel Lucas | gabriel.lucas@labernique.com Tél. : +33 6 15 82 58 56 | visuels : labernique.com/ressources
CotCotCot
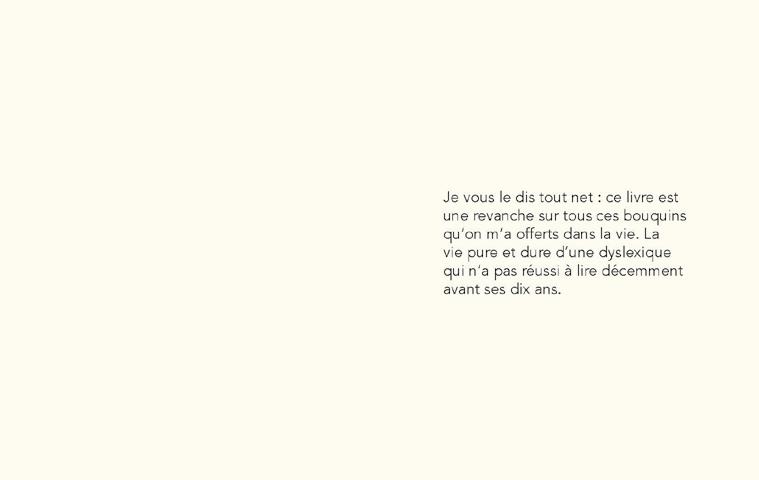



01 02 03 04

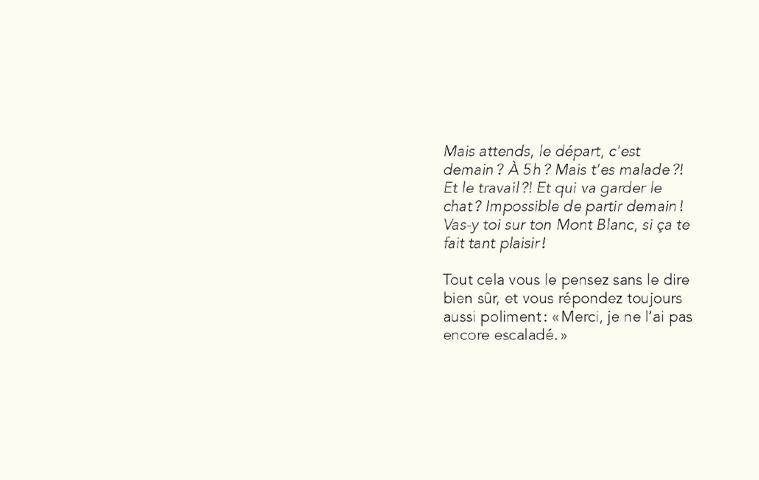
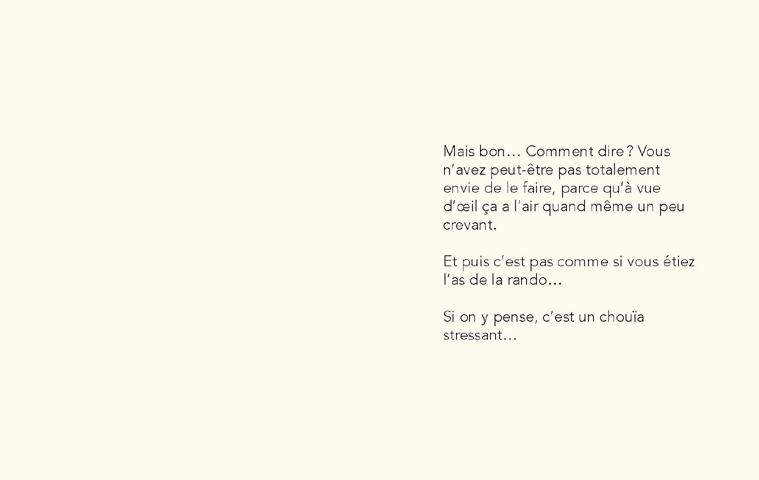

05 06 07 08
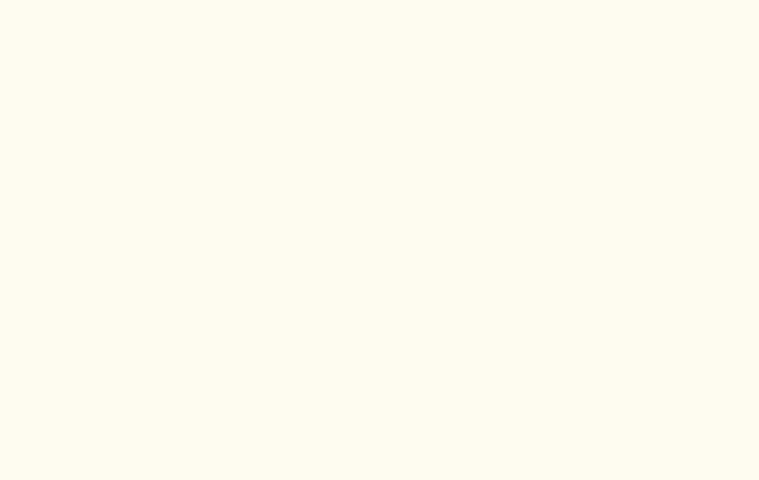
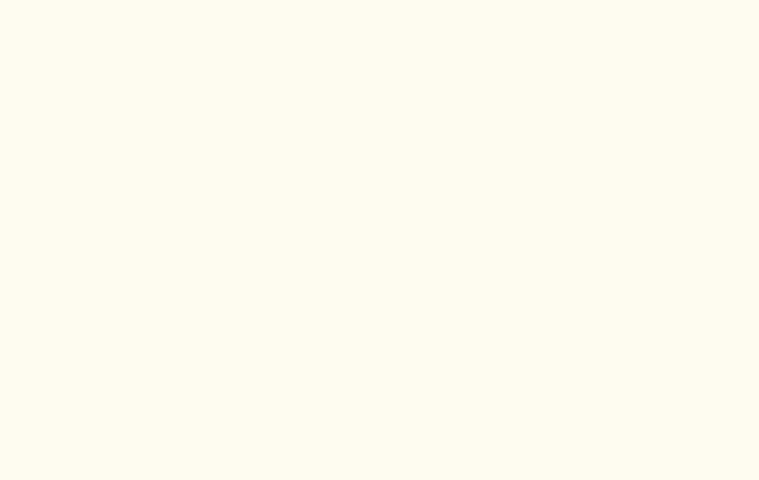
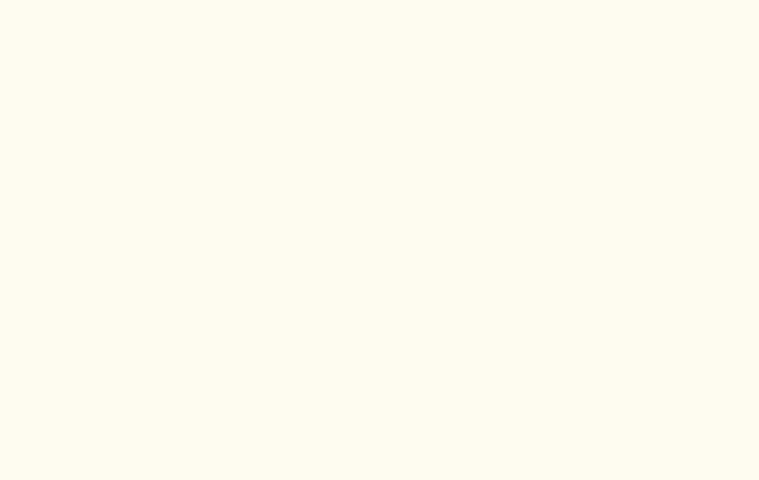
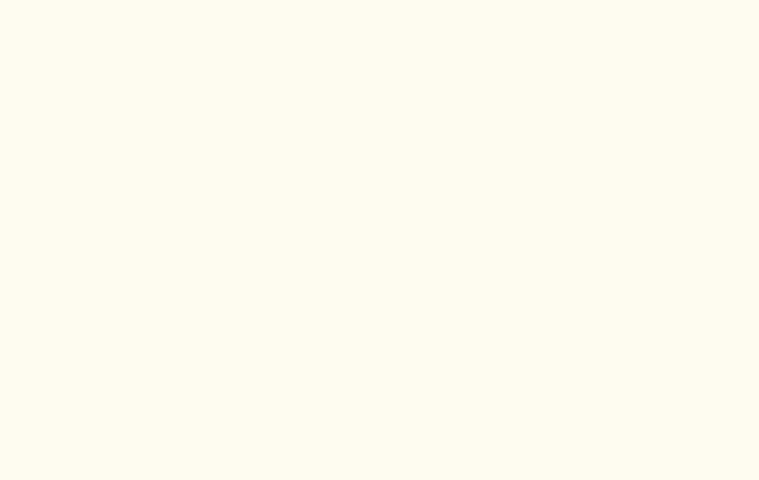
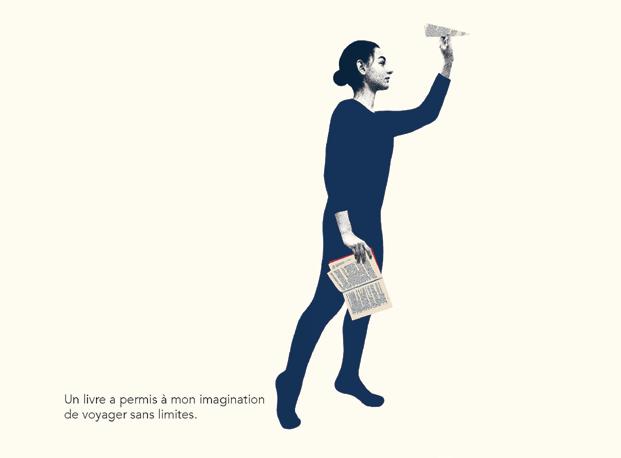

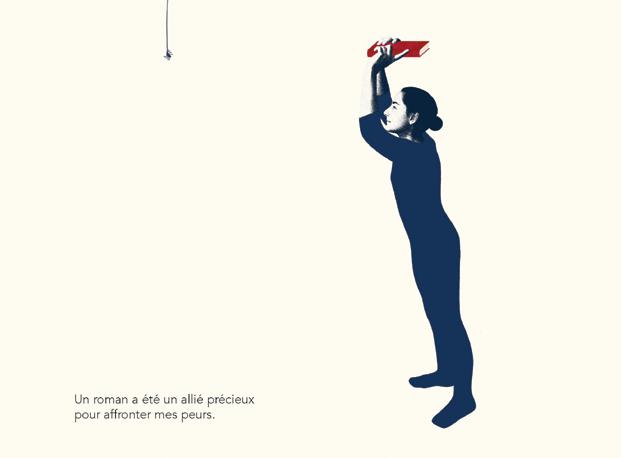
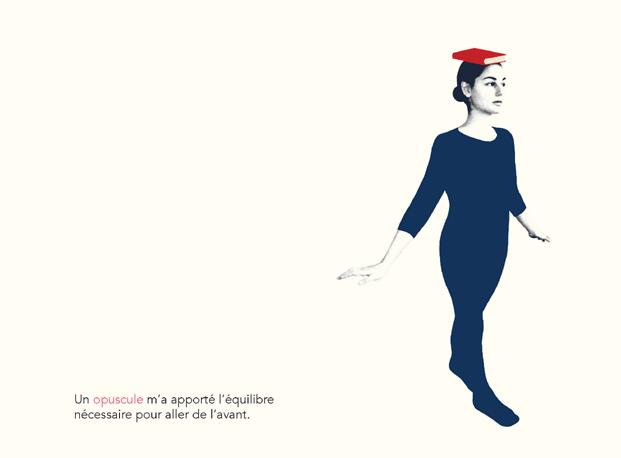
09 10 11 12
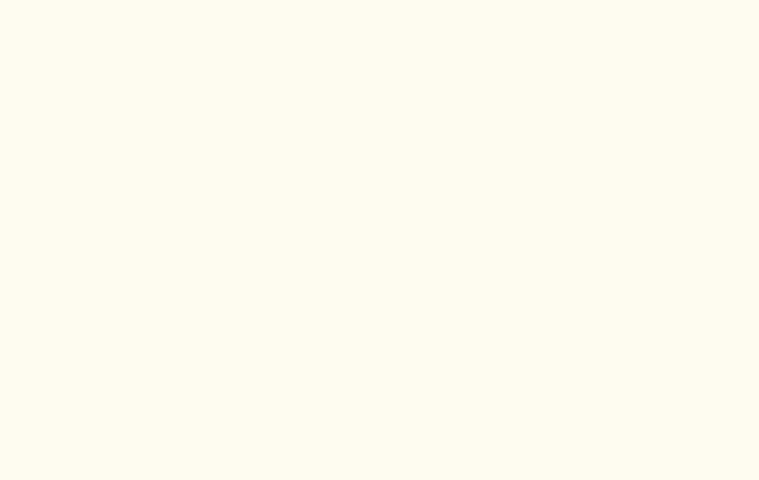
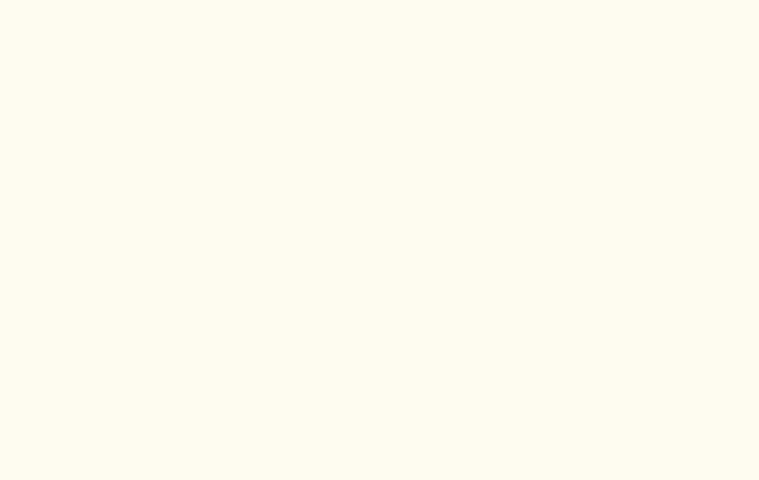
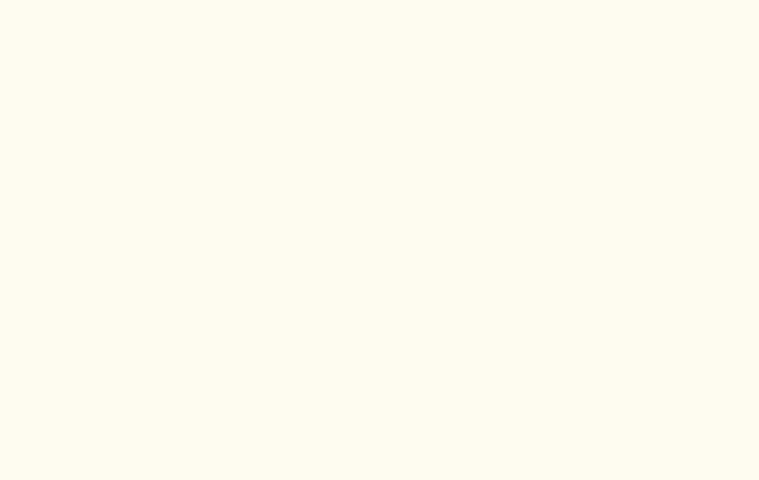
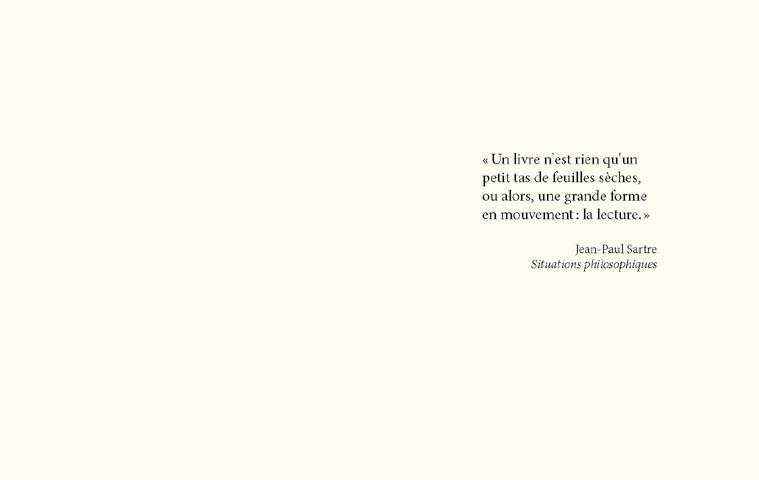
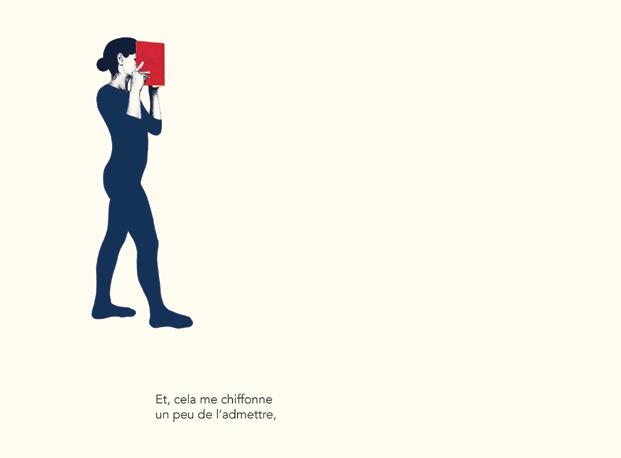
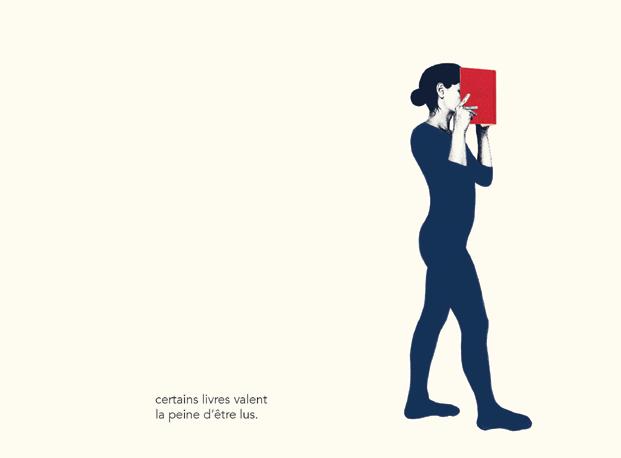

13 14 15 16
Nikos Maurice

Genre : roman policier
Préface de Roger Martin
Format : 13 x 21 cm
Pages : 288
Prix : 21 €
ISBN : 978-2-490251-84-1


Né à Paris en 1983, Nikos Maurice a passé les vingt premières années de sa vie dans le Val-de-Marne à Fontenay-sous-Bois, ville pour laquelle il travaille désormais comme journaliste. Durant ses études de cinéma et audiovisuel à Censier, il a écrit et réalisé plusieurs courts métrages autoproduits tout en écrivant des nouvelles et des romans. C’est en 2016 qu’il publie son premier livre, L’infiltré de La Havane, aux éditions de La Différence. Hollywood, les années rouges est son deuxième roman.
Harvey Zrodwayne est un jeune dramaturge et scénariste, brillant et gouailleur. Après ses premiers succès new-yorkais, son agent lui propose de rejoindre Hollywood où une carrière fulgurante l’attend. Seul hic : Harvey est communiste. Et en cette année 1951, le maccarthysme et la chasse aux sorcières battent leur plein, les têtes d’affiche tombent les unes après les autres pour « activités anti-américaines » et la méfiance est généralisée. Le héros s’en aperçoit vite, lui qui retrouve à Los Angeles son grand frère, Sam, scénariste à succès par ailleurs porté sur la bouteille qui dort avec un revolver et se sent traqué en permanence. Ce qui aurait pu relever de la paranoïa californienne se révèle peu à peu être une vaste intrigue où gravitent un psychologue anticommuniste affilié au FBI, des militants repentis et délateurs, des comédiennes talentueuses et désabusées, une mystérieuse voiture bleu clair qui disparaît sitôt qu’on s’en approche… et Sue, secrétaire pas vraiment gauchiste d’un magnat de la production cinématographique, dont Harvey s’entichera rapidement, au cours d’une éducation sentimentale autant que politique.
La façon dont Nikos Maurice nous entraîne dans l’Amérique des années cinquante tient du tour de force, tant par l’incarnation de personnages hauts en couleur et attachants que par un style qui se joue des codes, à la fois comique et trépidant. La grande famille du cinéma hollywoodien défile au passage, et le lecteur pénètre jusque dans le jardin d’un James Stewart débraillé, où s’est encastré la voiture neuve de notre héros devenu détective amateur… Un régal de suspense et de romanesque.
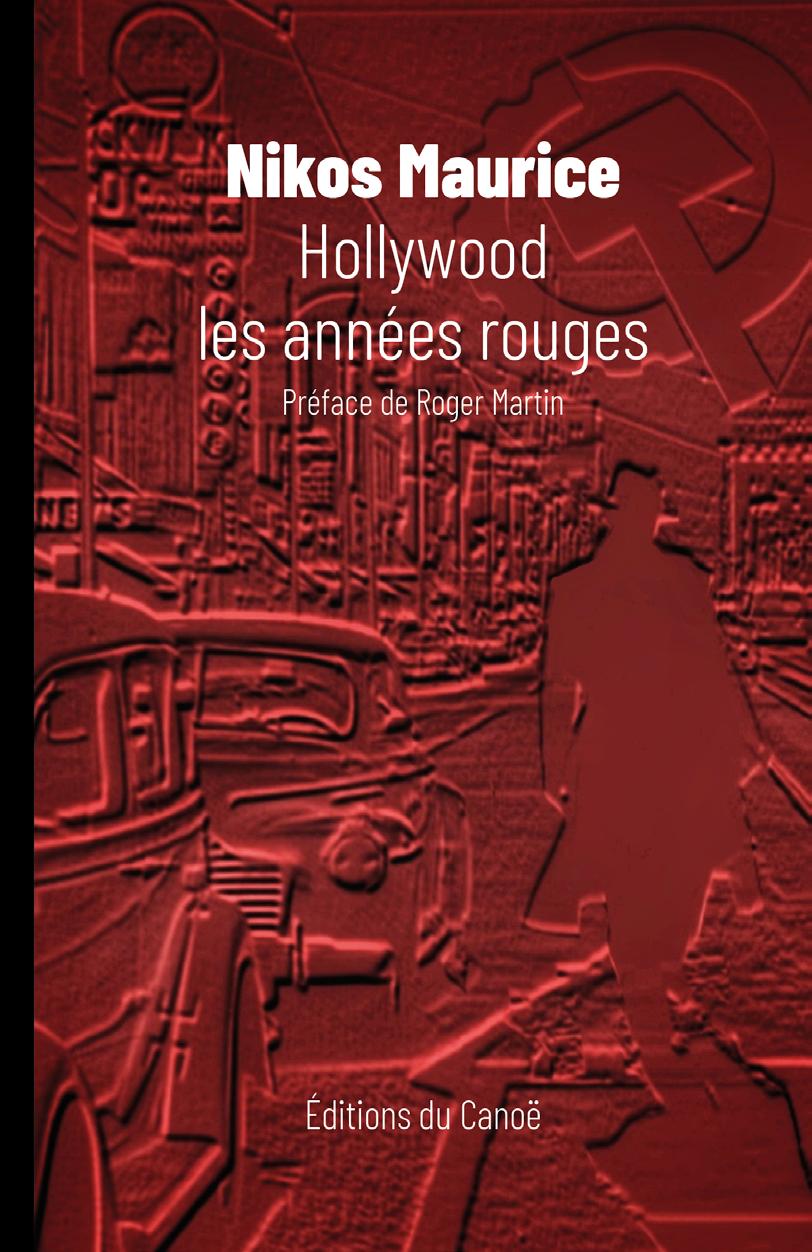
Février
Photographie : © Matthieu Regnier
Éditions du Canoë 2024 Contact : colette.lambrichs@gmail.com Téléphone : 06 60 40 19 16 Diffusion et distribution : Paon diffusion.Serendip Relation libraires : jean-luc.remaud@wanadoo.fr Téléphone : 06 62 68 55 13 Éditions Du Canoë : 9, place Gustave Sudre Local parisien : 2, rue du Regard 33710 Bourg-sur-Gironde 75006 Paris c/o Galerie Exils
CHAPITRE 12
Sam avait tenu à m’offrir cette voiture. J’avais trouvé son entêtement un peu curieux. Ce n’était pas tant son envie de me faire un cadeau d’une telle ampleur qui m’avait frappé, mais la façon qu’il avait eu de l’exprimer, sans fausse désinvolture, avec une pointe de gravité même, comme s’il voulait s’acquitter d’une dette. Du reste, il l’avait dit peu ou prou :
Il faut bien que je joue mon rôle de grand frère parfois.
La sincérité de sa remarque m’avait d’abord laissé pantois, puis j’avais rétorqué :
Qu’est-ce que tu racontes ? Ce n’est pas le rôle d’un grand frère d’offrir une voiture au petit frère. À la limite, une femme ! Mais pas une voiture ! avais-je plaisanté pour détendre l’atmosphère, étrangement sérieuse tout à coup.
— Je me rends bien compte que je n’ai pas joué mon rôle d’aîné comme j’aurais dû, m’avait-il dit alors, sur le ton d’un aveu. J’aurais aimé pouvoir te protéger en vrai grand frère.
3
Mais quand ? À quelle occasion tu ne m’as pas protégé ? lui avais-je répondu, me sentant forcé d’opposer une dénégation à ses inquiétudes.
Je ne sais pas… Dans la rue, à l’école, à la mort de papa… Je n’ai pas d’exemple précis. Mais je sais que c’était souvent toi qui me protégeais de moi-même et que ça devait être pénible.
Et d’une voix qu’il avait lancée plus haut pour qu’elle sonne enjouée, il avait ajouté :
— T’inquiète pas pour le prix, c’est pas ça qui va me mettre sur la paille ! De toute façon, j’ai beaucoup trop d’argent que je ne mérite pas…
Si par cette phrase, il avait cru égayer l’ambiance, c’était râpé ! Enfin, j’avais fini par céder, tout en brocardant sa soudaine sentimentalité qui, parce qu’elle m’allait droit au cœur, m’embarrassait :
Si je comprends bien, tu m’offres une voiture pour te racheter une conduite !
Ça l’avait fait rire, fermant ainsi la parenthèse des regrets. Et d’humeur subitement festive, il m’avait invité à dîner chez lui, ou plutôt chez eux, car il avait dit « chez nous ». L’expression incluait June, évidemment, peutêtre même Thornton Clay, que je n’avais pas recroisé depuis le jour de mon arrivée.
Il s’était trouvé que Thornton était parti chez son ex-femme voir son fils de quatre ans, aussi avionsnous dîné tous trois. Il faisait si chaud que nous avions mangé dehors, à la lueur des lampions pendus au noyer, qui décalquait sur l’herbe du soir l’ombre chinoise de ses
branches. Un disque de Django Reinhardt jouait dans la maison, portes et fenêtres ouvertes sur le jardin ; et à mesure que s’approfondissait le bleu de la nuit, s’intensifiait le jaune aurore de la lumière intérieure. La grande salade d’avocats et de crevettes, servie sur la table d’extérieur, avec la glacière pleine de bières posée sur l’herbe comme en pique-nique, accentuait ce sentiment d’été. Il était plaisant de penser qu’à New York, on boutonnait encore son manteau, on devait même relever le col et le maintenir d’une main, l’autre plongée dans la poche. Sam et moi partîmes dans une discussion qui nous entraîna loin, laissant June sur le bas-côté du débat. Nous faisions le constat de la récente mutation du capitalisme. En ce début de décennie, le développement fulgurant de la société de consommation accroissait la colonisation des esprits et des espaces, publics et privés. La publicité – via la télévision, dont le marché bondissait de mois en mois – s’invitait chez les gens, s’introduisait dans leur living pour mieux pénétrer leur cerveau. Comme disait Sam, le Capital jouait les Père Noël, à ceci près que les cadeaux étaient payants. L’émergence d’une classe moyenne de salariés-consommateurs, ayant gagné le tiercé du bonheur télévision-voiture-réfrigérateur, était un trompe-l’œil en Technicolor pour dissimuler l’exploitation.
Avec l’American Way of Life, on est au cœur de l’hégémonie culturelle dont parlait Gramsci ! s’exclamait Sam, surexcité, plongeant la main dans la glacière pour prendre une énième bouteille de Pabst Blue Ribbon.
4 5
Son exaltation de pouvoir à nouveau débattre avec moi et son insistance à dire combien ça lui avait manqué étaient un camouflet pour June, loin d’être idiote, mais d’une intelligence emmêlée faute de l’avoir exercée, incapable d’aligner trois idées sans que sa pensée trébuche. Elle boudait ostensiblement, et j’en fus d’abord très gêné, essayant de l’inclure du regard, la sollicitant par des mouvements de tête pour la faire réagir, mais rien n’y fit : elle s’était résolue à l’ennui. Tant pis ! m’agaçai-je. Sam a bien le droit de parler de ce qu’il veut avec son frère qu’il n’a pas vu depuis trois ans !
Quand June finit par ouvrir la bouche, ce fut pour lui décocher une flèche :
Enfin, ça te va bien de tenir ce genre de discours, alors que tu as une villa, deux voitures, un poste de télévision
et un grand réfrigérateur…
Mais enfin, je n’ai jamais dit que j’étais contre les biens de consommation et que les gens devaient vivre comme des pauvres ! se défendit Sam. Tout ce qu’on dit, c’est que la bourgeoisie industrielle et financière achète la paix sociale et fait croire aux salariés qu’il n’y a plus d’antagonismes de classes.
Des « antagonismes de classes » ? répéta June, irritée.
Des intérêts contradictoires entre le patronat et le salariat, si tu préfères…
C’est vrai, dis-je à mon tour, aujourd’hui, pour désunir les travailleurs et désamorcer toute revendication collective, il n’y a plus besoin de casseurs de grève…
Il suffit de leur faire miroiter une vie de petit-bourgeois. Et loin de moi l’idée de faire culpabiliser les gens ! C’est bien normal d’aspirer au confort moderne.
— Cela dit, reprit Sam, le fume-cigarette entre les dents, ses mains étant occupées à décapsuler une nouvelle bouteille, quand le mirage capitaliste ne suffit plus à calmer les travailleurs, on peut toujours compter sur le patronat et la police pour leur taper sur la gueule. Il y a deux méthodes pour endormir le peuple… avec ou sans matraque !
En somme, si j’ose dire, on a le choix entre Morphée ou morfler.
Tu viens de l’inventer, celle-là ?
J’essaie de la placer depuis 1942 !
Sam, s’esclaffant, expulsa un nuage de fumée ; puis évoqua la grande grève des décorateurs de la Conference of Studio Unions, que la police de Los Angeles et la sécurité de Warner Bros. avaient violemment réprimée lors de ce vendredi d’octobre 45, qui resta dans les mémoires comme le Hollywood Black Friday.
June campait sur sa position – assise, pour être exact, avec le coude sur la table et le menton sous la paume. Ses parents avaient dû lui apprendre qu’une jolie femme est charmante quand elle fait petite fille. Quelle mouche l’avait donc piquée ? Était-ce le fond même de notre pensée qui l’avait froissée, ou le fait de se savoir dépassée ? Était-ce habituel que Sam l’évince et dialogue seul avec l’invité ? Notre débat n’avait pourtant pas duré bien longtemps. La goutte d’eau venait peut-être
6 7
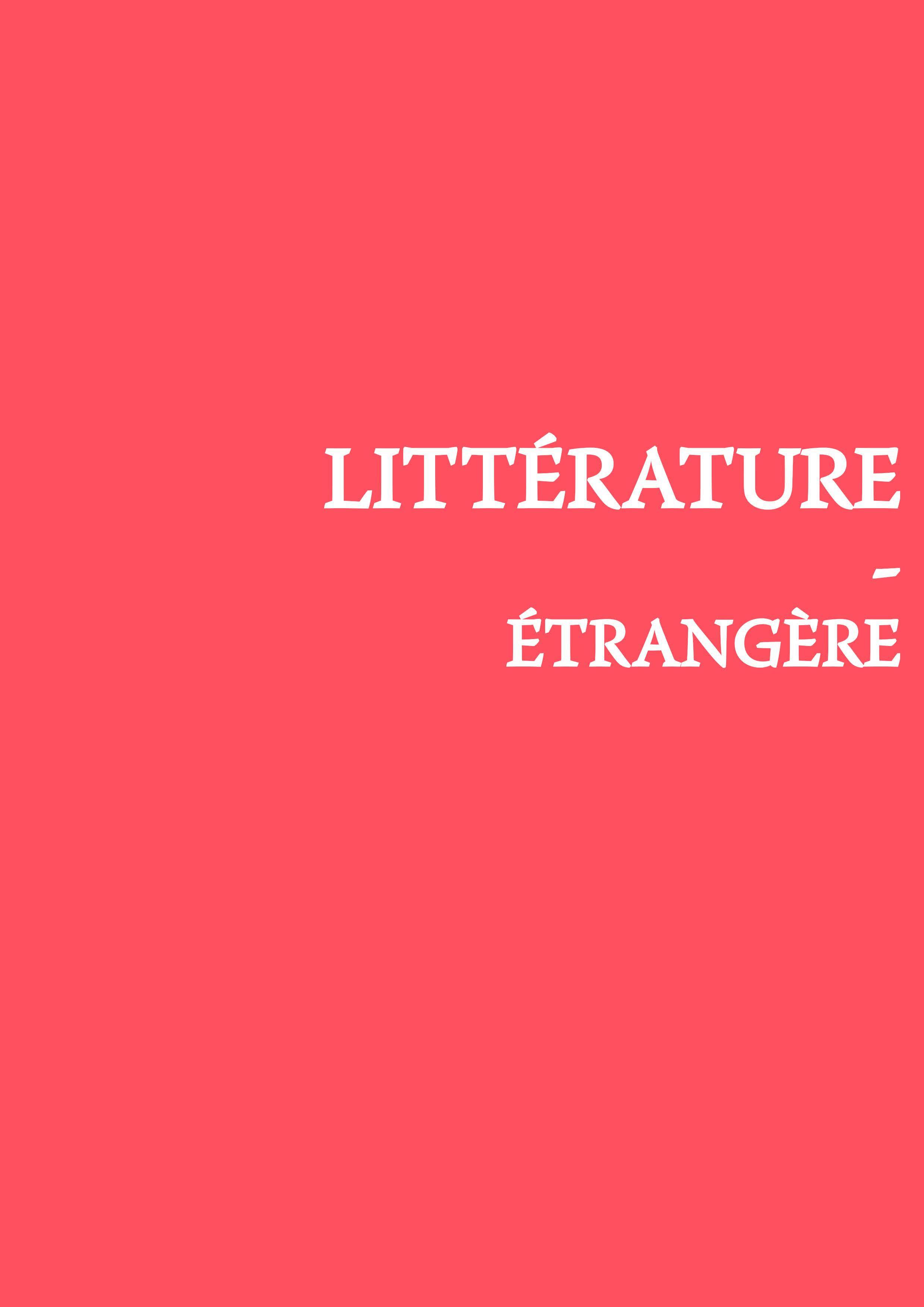
ISBN : 9782493205056
© Perspective cavalière, 2024
Graphisme : Débora Bertol
Arch Brown
Un pornographe
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Étienne Gomez, avec une préface de Jameson Currier
New York, printemps 1967. Un jeune agent publicitaire doit démissionner pour avoir soutenu un employé surpris en train de feuilleter Playboy au bureau. Au lieu de rechercher tout de suite un autre emploi, il décide de s'acheter une Bolex et de s'initier à la réalisation au cours de l'été. En arpentant Central Park et les rues de Manhattan avec sa caméra portative à la main, il ne sait pas encore qu'il va révolutionner la pornographie américaine.
Le manuscrit d'Un pornographe a été retrouvé dans les papiers d'Arch Brown après sa mort en 2012. Rédigé au milieu des années 1970 à la manière d'un bilan de carrière, ce texte inclassable est au croisement des mémoires intimes, du manuel de reconversion professionnelle et du manifeste esthétique. Car, plus encore qu'un outil de libération sexuelle, la pornographie était pour Arch Brown un instrument de connaissance.
Date de publication : 5 janvier 2024
Contact presse & librairies : Couverture souple avec rabats Étienne Gomez Antony Thalien
Illustration : Christophe Merlin
12,9 x 19,8 cm 0679918283 06 31 20 71 63
Environ 310 pages, 22 € editionsperspectivecavaliere@gmail.com
Résumé :
Après trois chapitres autobiographiques – 1. Lumière, 2. Caméra, 3. Action – sur sa jeunesse dans le Midwest, sur ses débuts dans la publicité, et sur sa reconversion dans la pornographie, Arch Brown dresse un tableau complet de la pornographie en général et à son époque en particulier.

Il définit ainsi les fantasmes fondamentaux en jeu dans l’industrie : 4. Le fantasme de la Star (il faut s’aimer soi-même et croire en soi), 6. Le fantasme du Moi (il faut aimer la caméra et le public-, 7. Le fantasme du Ça (certains ont un goût prononcé pour une partie donnée du corps), 8. Le fantasme du Jeu de rôle (certains tirent satisfaction de la possibilité offerte par le cinéma d’incarner quelqu’un d’autre).
Il dresse aussi une typologie des personnes intéressées, qui ne sont pas toutes bonnes pour l’industrie : 5. Les rôdeurs (ils n’ont rien à offrir mais veulent seulement infiltrer l’industrie du porno), 8. Les baiseurs (il sont excellents et endurants dans l’action face à la caméra comme dans la vie), 13. Les voyeurs (ils jouissent de leur propre image), 14. Le public (il vient voir les films, mais qui est-il et que cherche-t-il ?).
Enfin, il passe en revue certains aspects techniques ou esthétiques et certaines évolutions contemporaines de son époque : 10. Les gens, les lieux, les choses (sur l’importance de tout ce qui n’est pas pornographique dans les films pornographiques), 11. SM, bondage, etc. (sur l’essor des pratiques impliquant des rapports de domination), 12. Rôles discordants (sur les personnes qui ont des caractéristiques des deux genres, masculin et féminin), 15. Les films (sur le fait que les films mènent leur vie à eux, indépendamment des intentions de son réalisateur).
Bien plus qu’une incursion dans la pornographie et dans les milieux underground des années 1970, ce qui serait déjà beaucoup, ce livre inclassable jette les bases d’une véritable anthropologie de la pornographie du point de vue technique, psychologique, social, économique, etc.
#pornographie #new-york #1960 #1970 #hétéro #gay #bi #queer #bondage #SM #LGBT #sexe #amour #plaisir #cinéma #reconversion professionnelle #épanouissement personnel
extrait n°1
#les raisons d’une reconversion
Le manuscrit retrace les étapes d’une reconversion professionnelle d’une manière qui fait étrangement écho aux manuels de développement personnel d’aujourd’hui.
Un aspect de mon travail était de chercher des idées ou des sujets dans l’air du temps à partir desquels ma compagnie pourrait élaborer une campagne promotionnelle ou publicitaire. Je demandais à mon équipe de feuilleter les vieux exemplaires de journaux ou de magazines qui traînaient pour trouver des exemples de police de caractère ou de lettrage photographique qui pourraient nous servir. Un de mes employés feuilletait ainsi un numéro de Playboy lorsqu’un dirigeant entra dans nos bureaux et, le surprenant, il vit rouge. J’ignore comment ce magazine s’était retrouvé là. J’essayai d’expliquer que le jeune homme n’avait fait qu’obéir et que j’étais seul responsable de la situation. Le gars en question était gay et je savais que les photos de filles nues ne l’excitaient pas mais je ne pouvais pas dire ça. La direction décida de le renvoyer. Des cadres de mon niveau et des collègues du jeune homme se réunirent au débotté pour prendre sa défense. On était aux débuts de la libération sexuelle et un magazine comme Playboy ne justifiait pas de renvoyer un très bon employé, qui, après tout, n’avait fait que son travail. Il fut convenu qu’en cas de licenciement, nous partirions tous en même temps. Nous n’avions pas imaginé un seul instant qu’ils pourraient laisser partir deux chefs de département et plusieurs de leurs employés. Erreur ! En moins de vingt-quatre heures, la direction décida de nous laisser partir. Nous ne nous fîmes pas prier.
Je me retrouvai sans travail et, comme tant d’employés dans leur spécialité, je m’aperçus qu’il n’y avait pas beaucoup de postes disponibles. Même dans une grande ville, au-delà d’un certain niveau dans un domaine comme le mien, les opportunités sont rares et la concurrence est rude. J’envoyai des CV, consultai des agents, en vain. Personne n’avait rien à m’offrir. […]
Je touchais des allocations de chômage et, l’été arrivant, je pris la décision de ne pas m’inquiéter de mon sort. De buller. D’aller à la plage. De me dégoter une nouvelle passion. J’avais un peu d’argent de côté et l’idée d’acheter un appareil me revenait régulièrement. Pourquoi ne pas me mettre à la photographie ? […]
Après des visites dans des magasins de photo, l’idée d’une caméra me séduisit de plus en plus. Une 16 mm de seconde main avait un prix voisin de celui d’un appareil neuf et je pouvais à la fois faire des films et des photos avec les meilleurs plans. […]
Et n’aurais-je pas de quoi m’amuser pendant l’été ? Pourquoi ne pas tourner un bon film underground ? J’optai pour une petite Bolex.
extrait n°2 #un hommage à l’amour
Le premier film rémunéré d’Arch Brown est une commande privée de deux époux new-yorkais, Diana et John, qui souhaitent immortaliser leurs ébats sexuels. Cet extrait peut paraître anecdotique dans un ouvrage qui explore toutes les sexualités, homo, hétéro, bi et queer, et toutes les pratiques, notamment SM, bondage, etc., mais il en dit long sur la quête de la beauté dans la sexualité au fondement de la vision que l’auteur défend de la pornographie.
Ils commencèrent par s’enlacer tout en glissant les mains sous leurs hauts respectifs. Les vêtements avaient manifestement leur importance pour eux et ce ne fut qu’au bout d’un certain temps qu’ils les enlevèrent. John embrassait les seins de Diana à travers le tissu tandis qu’elle caressait son sexe sous son short. Finalement, il dégrafa son dos nu et libéra un sein, puis l’autre. Il lui palpa et lui lécha les seins jusqu’au moment où, parcourue d’un tremblement de tout le corps, elle ôta d’un seul geste son dos nu et sa culotte. Elle resta étendue toute frémissante sur le matelas, et il se dressa au-dessus d’elle, les jambes de chaque côté de ses hanches. Elle leva lentement les mains le long de ses cuisses puis fit glisser son short, exposant ainsi le jockstrap qui moulait son sexe. Elle changea de position et, à genoux, se mit à lécher le jockstrap avant de le faire glisser à son tour pour avaler sa bite. Elle le suça jusqu’au moment où il en eut des frissons dans les jambes, après quoi elle bascula sur le matelas, les cuisses écartées. Il enleva le peu de vêtements qui lui restaient, puis s’allongea devant elle et enfonça son visage entre ses cuisses.
J’avais du mal à croire que ces deux personnes que je venais tout juste de rencontrer puissent ainsi sortir le grand jeu face à ma caméra. Car c’était magistral. Ils avaient réfléchi à tout et ils connaissaient leur scénario sur le bout des doigts. J’avais aussi du mal à croire qu’ils puissent être d’une telle beauté. Elle avait une taille fine et délicate mais ses seins étaient ronds et amples. Sa peau était parfaitement lisse et sans un seul défaut. Elle avait les cheveux châtains et ses poils prenaient des reflets auburn à l’entrejambe. Quant à lui, il était bien plus musclé qu’on aurait pu l’imaginer à le voir habillé, et il avait les jambes, la poitrine et le ventre couverts d’épais poils noirs. Ils faisaient vingt ans de moins et seul le ventre naissant de John trahissait son âge. Son sexe était court mais très épais avec un énorme gland en champignon, et, se redressant brusquement, il le lui enfonça d’un coup. Fini les préliminaires romantiques, c’était maintenant une violente scène de sexe, à la limite du viol : à chaque assaut elle criait davantage et, plus elle criait, plus il poussait fort. Le jeu se poursuivit pendant une dizaine de minutes, augmentant peu à peu en vitesse et en intensité à mesure qu’ils approchaient de l’orgasme. Le moment venu, ils se mirent à hurler en battant le matelas et en s’empoignant sans façon. À la fin, parcourus d’intenses frissons, ils tombèrent dans les bras l’un de l’autre en riant comme des petits enfants. John redressa lentement la tête et me demanda en souriant : « C’est dans la boîte ? » Ils se remirent à rire. « Pas mal pour un vieux couple, non ? »
extrait n°3
#au carrefour des plaisirs
En théoricien de pornographie, Arch Brown affirme un credo simple : un bon film est un film où tout le monde, acteurs, réalisateur et spectateurs, peut trouver un moyen de s’épanouir.
Tous [les bons acteurs dans mes films] avaient ce rare mélange de liberté sexuelle, de maîtrise technique, et surtout de sensibilité et de réactivité face à l’objectif. La caméra était peut-être le plus important. Tous étaient excités par elle, et c’était elle qui les aidait le plus souvent à réaliser des fantasmes longuement refoulés. C’était aussi grâce à elle qu’ils pouvaient mettre de l’ordre dans ce domaine de leur vie et profiter d’un moyen unique de satisfaire leurs egos.
Je m’aperçus d’ailleurs que mes films me permettaient de satisfaire mon propre ego. Je n’aidais pas seulement les gens à réaliser leurs fantasmes, je satisfaisais aussi les miens. Mon élan sexuel diminuait au fur et à mesure, surtout si tout se passait bien et que le résultat était exceptionnel. Ce fut pour moi comme une libération. Dès lors que j’avais commencé à concevoir mes films de manière vraiment professionnelle, l’excitation sexuelle avait presque disparu. Je ressentais une sorte de satisfaction rien que d’avoir fait tourner la caméra pendant quelques heures. Après une bonne journée de tournage, si tout s’était bien passé, je me sentais comblé, heureux.
Il me semblait de plus en plus important de créer une atmosphère de réalité dans mes films. De même que je créais mes personnage en fonction des acteurs, je me mis à écrire des scénarios entiers en pensant aux capacités et aux désirs que je leur attribuais. Réunir un livreur de fruits et légumes et une ménagère crédibles était une chose, mais la qualité sexuelle du résultat dépendait avant tout des circonstances de leur rencontre et de leur attitude l’un vis-à-vis de l’autre.
Je vis un jour un film où un livreur sonnait ainsi à la porte d’une ménagère, et tout se passa bien jusqu’au moment où l’actrice entreprit de séduire elle-même le jeune homme. Au lieu de lui parler, de le draguer, de se rapprocher de lui ou encore de le caresser, elle souleva sa jupe et commença à se masturber, assise sur le plan de travail. La ménagère était devenue une pute et la scène était gâchée. La suite pouvait toujours faire mieux, ces personnages avaient perdu toute vraisemblance.
Mes films commencèrent à s’ouvrir à une autre sorte de réalité. Je m’aperçus que ceux qui m’en parlaient, que ce soient des amis ou même parfois des inconnus, avaient avant tout aimé le lien qu’ils entretenaient avec les personnages. Un hétéro moyen ne passe pas ses journées à rencontrer des stripteaseuses, des putes, des pom-pom girls et des hôtesses de l’air qui se pâment dès qu’elles les voient arriver. Ils rencontrent plutôt des secrétaires, des serveuses, des voisines, qu’ils espèrent pouvoir séduire facilement si une occasion se présente. Les homos rencontrent généralement des voisins ou d’autres homos dans les bars ou à des soirées, plutôt que des cowboys, des plombiers, des policiers et des militaires.
Mes films se concentrèrent de plus en plus sur des personnes et des situations ordinaires pour que le public moyen puisse se sentir concerné. Le fantasme de l’auto-stoppeuse lubrique en mini-jupe est peut-être universel, mais, dans la vie, la chose n’est pas fréquente. Une femme en tenue de ville et au maquillage discret me paraissait plus excitante qu’une pute en porte-jarretelles avec une masse de cheveux blond décoloré.
« Arch Brown fait quelque chose de neuf, de complexe, de crucial. La sexualité est bienvenue au cinéma. Que tous les films ne soient pas pornographiques doit être un sujet d’étonnement. Car c'est la fonction même du cinéma. Un plat se mange, un vin se boit, le sexe se filme. » — Interview, 1975
De son vrai nom Arnold Krueger, Arch Brown est né à Chicago en 1936 et a grandi dans une famille marquée par la Grande Dépression. Après une brève carrière dans la publicité, il est devenu pornographe à une époque où la pornographie hard-core devenait légale. Son pseudonyme Arch Brown associe le prénom qu’il utilisait dans les lieux de drague gay et le nom de son compagnon pendant vingt-huit années, Bruce Brown, co-fondateur de l’Arch & Bruce Brown Foundation pour la promotion de la création littéraire et théâtrale gay. Son œuvre est aujourd’hui conservée à la bibliothèque de la prestigieuse université Cornell.
 Photo © Arch & Bruce Brown Foundation
Photo © Arch & Bruce Brown Foundation
ISBN : 978-2-493205-02-5
© Perspective cavalière, 2022
Graphisme : Débora Bertol
Illustration : Christophe Merlin
Édition originale : Intolerable: A Memoir of Extremes
© Kamal Al-Solaylee, 2012, 2022
Kamal Al-Solaylee

Intolérable : Mémoires des extrêmes
Traduit de l’anglais (Canada) par Étienne Gomez
Aden, 1967. L’arrivée au pouvoir des socialistes révolutionnaires marque la fin du protectorat britannique. Pour la grande famille des Al-Solaylee, c’est le début d’un long exil à Beyrouth puis au Caire. Mohamed, ancien magnat de l’immobilier dépossédé de ses biens, tombe dans une dépression qui ne dit pas son nom, tandis que Safia, jadis bergère dans l’Hadramaout, entretient la famille jusqu’au moment du retour, inexorable, dans un Yémen transformé
Les mémoires de Kamal, dernier de onze enfants, ne retracent pas seulement l’itinéraire d’un jeune homme qui se découvre homosexuel dans un Moyen-Orient en voie de radicalisation, ils évoquent aussi le destin intolérable d’une famille restée là-bas, à l’autre extrême. L’étau ne cesse en effet de se resserrer dans ce Yémen postcolonial frappé de plein fouet par la crise du monde arabe, puis par la guerre civile et par la catastrophe humanitaire en cours.
L’édition française est complétée par une postface de l’auteur.
Date de publication : 27 mai 2022
Contact presse & librairies : Couverture souple avec rabats
HarperCollins Canada
12,9 x 19,8 cm
Étienne Gomez
0679918283
312 pages, 22 € editionsperspectivecavaliere@gmail.com
Lauréat
Globe and Mail Best Book of the Year, Toronto Book Award, Canadian Booksellers' Top Pick for LGBT Books of the Year, Amazon.ca Best Book of the Year
Finaliste
Lambda Literary Award for Gay Memoir/Biography, Edna Staebler Prize for Creative Nonfiction, Hilary Weston Writers' Trust Prize for Nonfiction, OLA Forest of Reading Evergreen Award
Sélection du CBC Canada Reads « One Book To Break Barriers »
« Un grand livre, qui raconte parfaitement le Yémen et l’effervescence d’un Orient libre, émancipé du joug colonial et faisant valoir un progressisme populaire, avant de sombrer dans les mouvements islamistes. » (Quentin Müller)

Photo © Mark Raynes Roberts
Né à Aden en 1964, Kamal Al-Solaylee a émigré au Canada en 1996 après des études de littérature anglaise à Keele puis à Nottingham au Royaume-Uni. Devenu journaliste au Globe and Mail puis professeur à l'université Ryerson de Toronto, il a publié trois ouvrages, Intolerable: A Memoir of Extremes (2012), Brown: What Being Brown in the World Today Means—to Everyone (2016) et Return: Why We Go Back to Where We Come From (2021). Il est aujourd'hui directeur de l'École de journalisme, rédaction et communication de l'université de la Colombie-Britannique à Vancouver.
#Beyrouth, 1967
« Je suis le fils d’une bergère illettrée qui fut mariée à quatorze ans et mère de onze enfants à trente-trois ans. » (p. 7)
Kamal est le fils d’une bergère et d’un gardien de sécurité devenu magnat de l’immobilier, l’une des premières fortunes d’Aden. La famille, chassée du jour au lendemain en 1967, trouve refuge à Beyrouth, où le père, qui n’a plus que son compte d’épargne en Angleterre, prend un appartement dans un immeuble nommé Yacoubian, habité par des stars de la chanson et du cinéma. Malgré les airs de paradis de ce Beyrouth d’avant la guerre civile, la situation commence à se dégrader, et les tensions montent entre druzes, chrétiens, chiites et sunnites. Aussi, lorsqu’une bombe explose dans le parking de l’immeuble Yacoubian, le père trouve la situation moins grave qu’à Aden.
Extrait n°1 :
« On lui avait donné moins de vingt-quatre heures pour quitter Aden. » (p. 48)
Son plus effrayant face-à-face avec le NLF eut toutefois lieu en novembre 1967, lorsqu’un petit groupe d’hommes masqués vint l’enlever dans son bureau, en mode gangster, avant de le séquestrer pendant trentesix heures. Nous avons entendu plusieurs versions de cette histoire, que Mohamed a répétée pendant des années à ses invités, à Beyrouth puis au Caire. Il est difficile d’en réconcilier tous les détails, mais les points principaux restent les mêmes. « Ils m’ont attaché à une chaise (là-dessus, il n’a jamais varié). J’ai demandé une cigarette (je le croyais aussi là-dessus, car il a fumé comme un pompier jusqu’en 1972). Leurs visages transpiraient l’envie », disait-il de ses ravisseurs, qui, par défi, avaient ôté leurs masques. S’il affirmait n’en avoir reconnu aucun, aux yeux de ma mère, certains étaient probablement d’anciens prestataires que sa démesure avait rendus jaloux. Le montant de la rançon pouvait augmenter ou diminuer en fonction du public, mais il se chiffrait toujours en milliers de livres sterling. Un point était incontestable. On lui avait donné moins de vingt-quatre heures pour quitter Aden. Imaginez ce que c’est que de devoir reloger en un jour une famille nombreuse (ainsi que d’autres personnes à charge) dans un nouveau pays, en laissant tout ce que vous avez, ainsi que tous les gens que vous connaissez, sans savoir si vous les reverrez. J’ai toujours cru que j’avais eu de la chance d’être trop jeune pour prendre la mesure de la souffrance d’une famille ainsi arrachée à son pays. Les pertes étaient financièrement immenses, mais émotionnellement incalculables.
#Le Caire, 1977
« Tout le monde était assis devant le poste de télévision, en train de regarder l’Egypt Air présidentiel à son atterrissage sur le sol israélien. Le seul événement comparable en Amérique du Nord serait Apollo 11 en 1969 ou l’élection de Barack Obama en 2008. » (p. 7)
Tandis que Kamal écoute de la pop occidentale et que ses sœurs choisissent leurs bikinis pour les vacances, l’Égypte entre en état d’alerte à partir de la guerre du Ramadan/Kippour en 1973, et les accords de Camp David à la fin de l’année 1977 font basculer le Moyen-Orient dans une ère de radicalisation.
Extrait n°2 :
« Depuis cet été 1977, le Moyen-Orient a changé autant que ma famille. » (p. 15)
Depuis cet été 1977, le Moyen-Orient a changé autant que ma famille. Cette année m’apparaît comme décisive du point de vue des valeurs – tolérance, curiosité, égalité, ardeur au travail et mobilité sociale – que mon père cultivé et ma mère illettrée avaient essayé d’inculquer à leurs enfants. Nous vivions dans un monde laïc où la liberté de culte – nous eûmes beaucoup d’amis et de voisins chrétiens au Caire et mon père négocia avec la petite communauté juive d’Aden – et la liberté religieuse allaient de pair, du moins en apparence. Cela faisait exactement dix ans que nous avions été chassés d’Aden à cause des sentiments et des intérêts probritanniques de mon père. Après une dizaine d’années à Beyrouth, celui-ci avait guidé son troupeau de onze enfants au Caire comme vers un havre de paix – et c’est très certainement ce que cette ville est restée jusqu’en 1977, époque à laquelle le réseau essentiellement clandestin des Frères musulmans est réapparu sur la carte sociale et politique égyptienne pour prêcher l’évangile du « retour à l’islam ». Le séjour du président Anouar el-Sadate en Israël pour négocier la paix ne fit que renforcer la détermination des islamistes à imposer leur philosophie. C’est vers la même époque que notre école, un établissement privé mixte pour la classe moyenne du Caire, recruta sa première enseignante voilée. À peine âgé de treize ou quatorze ans, comme beaucoup de mes amis égyptiens et autres expatriés arabes à l’Education Home du quartier de Dokki, je sentais qu’une évolution était en cours. Le jour où Mlle Afaf essaya de convertir les élèves au port du voile, elle provoqua une fronde chez les parents.
#Gay/Le Caire
« Mon séjour en Angleterre m’avait donné du courage et, dans un moment de confiance, j’avais appelé le numéro d’aide de Liverpool pour chercher des informations sur le milieu homosexuel du Caire. L’aimable opérateur m’indiqua, à ma grande surprise, que plusieurs bars apparaissaient dans Spartacus, le guide gay international. “Vous êtes sûr ?” lui demandai-je, incrédule. » (p. 154)
Fin 1981, alors que l’assassinat du président Sadate par les Frères musulmans accentue la contrainte du retour au Yémen, Kamal rend visite à sa sœur Faiza à Liverpool. À son retour, il commence à fréquenter le milieu gay – insoupçonné jusque-là – du Caire.
Extrait n°3 : « Le public occidental était invité par des homosexuels égyptiens. » (p. 157)
Ahmad, tailleur, et Bill, son partenaire américain professeur dans le secondaire, proches de la quarantaine tous les deux, me prirent sous leurs ailes. Ils échangeaient en anglais ou dans un arabe poussif. Ahmad, issu de la classe ouvrière, devait principalement sa maîtrise de la langue anglaise à ses liaisons avec des Américains et des Britanniques. Je leur servis parfois de traducteur. Je n’aurais pas pu être plus heureux. Ce fut grâce à eux que je découvris le véritable milieu gay du Caire – pas celui des rencontres avec des étrangers dans des hôtels –, qui se déployait autour du quartier miteux d’Haret Abu Ali. Parmi tous les chapitres de mon existence, celui-ci m’apparaît presque irréel. On aurait dit qu’une cité perdue dont je n’aurais entendu parler que dans les contes existait réellement et qu’il suffisait de monter dans un taxi pour y aller. De vieilles danseuses du ventre qui avaient connu des jours meilleurs s’y produisaient dans des cabarets devant un public de machos et d’efféminés. Le public occidental était invité par des homosexuels égyptiens, et il fallait comprendre l’arabe dialectal pour pouvoir rire des numéros ou des chansons. Si je détestais ce genre de musique, sa valeur camp et sa signification dans le milieu gay local m’apparurent sur-le-champ. J’avais toujours aimé la danse du ventre et la crise religieuse qui secouait le pays entravait de plus en plus de vocations. Ces soirées me projetaient dans le Caire de l’âge d’or, celui des années 1950 et du début des années 1960 que je connaissais grâce à la télévision. Évidemment, cela ne pouvait pas durer.
« Sanaa ? Cette cité d’allure médiévale que nous n’avions vue que dans les guides de voyage et sur les mauvaises cartes postales que nous recevions de notre famille à quelques occasions particulières ? Je compris aussitôt qu’il fallait absolument que j’évite de passer le restant de mes jours dans un pays où la charia autorisait les pendaisons publiques. » (p. 17)
Lorsque la famille est contrainte au retour au Yémen, Kamal comprend qu’il lui faut fuir en Occident, ne serait-ce que parce que parce que son propre frère Helmi s’est converti à un islamisme radical.
Extrait n°4 : « “Bien fait pour eux”, dit-il nonchalamment. » (p. 177)
La stricte adhésion à l’islam des différentes classes et catégories de la population rendait l’adaptation d’autant plus difficile. Il était impossible d’organiser sa journée sans tenir compte des cinq appels à la prière – à l’aube, à midi, dans l’après-midi, au crépuscule et dans la nuit – dès lors que tout le monde les respectait. L’islam en question était par ailleurs un zaïdisme rigoriste, appliquant la charia. Jusqu’en 1987, la pendaison ou la flagellation publique dans un lieu désigné de Sanaa passait pour un divertissement pour certains habitants. Le jour où il fut annoncé que deux hommes surpris en flagrant délit de « sodomie » devaient recevoir le fouet après les prières du vendredi, j’eus un malaise physique qui ne fit qu’augmenter quand j’entendis la réaction d’Helmi. « Bien fait pour eux », dit-il nonchalamment. Le Yémen avait durci le comportement de ce frère pratiquant et il usait aussi très activement les défenses de mes sœurs.
#Yémen : de la guerre civile à la catastrophe humanitaire
« À l’été 2001, je rentrai ainsi au Yémen. Aucune conversation téléphonique, aucune lettre n’aurait pu me préparer à ce qui m’attendait là-bas. » (p. 256)
Kamal rentre pour la première fois au Yémen juste avant le 11 septembre 2001, occasion à laquelle il entend parler pour la première fois d’Oussama Ben Laden sur la chaîne de télévision du Hezbollah. Depuis lors, à chacun de ses séjours, il suit la dégradation des conditions de vie au Yémen, jusqu’au « Printemps arabe » et au déclenchement de la guerre civile et de la catastrophe humanitaire en cours.
Extrait n°5 : « Personne ne chante pour le Yémen. » (p. 300)
Était-ce tenter le destin ?
La question revenait me tarauder pendant que j’écrivais, effaçais, réécrivais (et réeffaçais) les premiers mots de cette postface pour l’édition française que vous tenez entre les mains. Croyais-je vraiment que le Yémen ne pouvait pas connaître pire qu’en 2012, année sur laquelle se termine l’édition anglaise de ces Mémoires des extrêmes, selon le sous-titre choisi, et qu’il ne pouvait pas s’éloigner davantage du Canada où je vivais ? Je me trompais lourdement. Depuis dix ans, le Yémen est entré dans un purgatoire de violence et de destruction de masse à côté duquel les dix ou vingt années précédentes font désormais figure d’âge d’or.
Comment cela s’est-il produit ? Quel est cet univers qui laisse mourir les enfants de faim et de malnutrition, qui laisse détruire les infrastructures et ruiner l’économie d’un pays tout entier pendant que le monde regarde impuissant ou tire profit de la situation ?
#Gay/Sanaa
Je ne sais pas pourquoi je pose des questions dont j’ai déjà la réponse. Peut-être est-ce une façon de repousser, ne serait-ce qu’un instant, la douleur d’affronter les événements qui ont fait déclarer là-bas par les Nations unies une catastrophe humanitaire sans équivalent dans le monde depuis la famine en Afrique de l’Est dans les années 1980. (Sauf que cette fois, il n’y a pas eu un bataillon de stars pour entonner Do they Know It’s Christmas et We Are the World, les deux 45-tours qui, en 1984 et en 1985, ont réuni plusieurs millions de dollars pour l’action contre la faim : personne ne chante pour le Yémen.) Peut-être est-ce un moyen de laisser un espace au doute et à l’hésitation avant d’en venir à ces certitudes que sont la tragédie de ma famille et ma propre impuissance, la réaction somme toute irrationnelle que j’ai eue face à elle. […] Comme je regrette les promesses du Printemps arabe, que je préférerais encore oublier ! Comme j’aimerais retrouver l’impression que j’avais, en 2012, quand je pensais que mes inquiétudes quant à la sécurité et au bonheur de ma famille pourraient nous rapprocher, réduire le fossé entre nos extrêmes. Le fait est que, matériellement, nous sommes plus éloignés que nous ne l’avons jamais été au cours des trente dernières années.
Recensions :
Mathew Hays, The Globe and Mail : « Tant de seuils identitaires sont franchis dans Intolérable qu’on a le vertige : classe, ethnicité, genre, orientation sexuelle, nationalité, religion et degrés de pratique religieuse. Ce livre sur les rapports tourmentés d’une famille à l’Histoire – et sur les rapports délicats d’une région du monde avec la modernité – contient tous les éléments nécessaires à une grande autobiographie : il est aussi émouvant que complexe. »
https://www.theglobeandmail.com/arts/books-and-media/intolerable-by-kamal-al-solaylee/article4209631/
Adrian Brooks, Lambda Literary :
« Dans ces mémoires d’un homosexuel courageux, avec en toile de fond le conflit entre les valeurs démocratiques et l’obscurantisme d’un monde arabe en plein bouleversement postcolonial, le microcosme est surtout un reflet du macrocosme. L’histoire, douloureusement intime par moments, notamment lorsqu’elle évoque une famille qui ne peut plus supporter de regarder les photos de l’époque où elle était libre, prend des proportions épiques avec la séparation familiale et avec le tumulte du “Printemps arabe” »
https://lambdaliterary.org/2013/09/intolerable-a-memoir-of-extremes-by-kamal-al-solaylee/
Jeet Heer, The Walrus :
« Des mémoires aussi puissants qu’intimes… une lecture nécessaire. »
https://thewalrus.ca/from-the-middle-east-but-no-longer-of-it/
Diane Anderson-Minshall, Advocate :
« Intolérable est un livre complexe et stimulant, ne serait-ce que parce que l’histoire d’émancipation qu’il raconte s’accompagne d’une analyse culturelle des différences irréconciliables liées à l’ancrage moyen-oriental d’Al-Solaylee ainsi qu’à l’appel de l’Occident. »
https://www.advocate.com/print-issue/current-issue/2013/07/12/new-queer-memoirs-way-we-were
Jameson Currier
Le Troisième Bouddha
Traduit de l’anglais (État-Unis) par Étienne Gomez
Le 11 septembre 2001, Ted part à Manhattan sur les traces de son frère, courtier dans le World Trade Center. À peine rentré de Bâmiyân, Stan fuit en Inde pour une raison connue de lui seul. Jim fait un reportage sur le troisième Bouddha lorsqu’une explosion le sépare des hommes qui l’accompagnent.
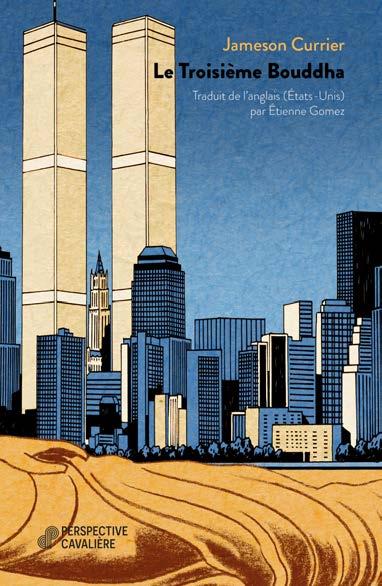
Dans ce roman complexe et lumineux, les quêtes des personnages tissent un mystérieux contrepoint dans un monde déchiré par le fondamentalisme islamiste.
ISBN : 978-2-493205-00-1
© Perspective cavalière 2021
Graphisme : Débora Bertol
Illustration : Christophe Merlin
Édition originale : The Third Bouddha
© Jameson Currier 2011
Couverture souple avec rabats
Contact presse & librairies :
Étienne Gomez
12,9 x 19,8 cm 0679918283
376 pages, 21 € epl.gomez@gmail.com
Roman du deuil et de la séparation, roman de formation et de quête de soi, Le Troisième Bouddha met en relation deux histoires différentes, quoique liées entre elles par une troisième : à New York, celle de Ted, qui fait le deuil de son frère aîné Pup en même temps que ses premiers pas dans le milieu gay ; en Afghanistan, celle de Jim, dont la nouvelle de la mort de Pup vient ébranler la relation avec Ari ; entre les deux, celle de Stan, qui a opéré Jim après l’explosion de la camionnette où il voyageait pour un reportage sur le troisième Bouddha, qui aurait échappé aux bombes de Talibans.
Le Troisième Bouddha est le premier des trois grands romans de la maturité de Jameson Currier, sur le thème de la violence meurtrière.
C’est aussi la première publication des éditions Perspective cavalière : le monde selon ses marges, avec Ali et sa mère russe d’Alexandra Chreiteh, traduit de l’arabe (Liban) par France Meyer.
« Une histoire au suspense fascinant, tant sur les épreuves de la vie que sur la force spirituelle qui permet de les traverser. Cinq étoiles ! » —Bob Lind, Echo Magazine
« Entre histoire captivante et galerie de personnages remarquables, ce roman associe une quête spirituelle à la quête ordinaire et néanmoins impérieuse d’identité et d’amour dans le monde moderne. » —Charles Green, Gay and Lesbian Review Worldwide
« Une histoire complexe, portée par ses personnages, où la quête d’autrui débouche sur une découverte de soi. »
—Ellen Bosman, Library Journal
ISBN : 978-2-493205-04-9
© Perspective cavalière, 2023
Graphisme : Débora Bertol
Nuril Basri

Le rat d’égout
Traduit de l’anglais (Indonésie) par Étienne Gomez
Roni, jeune écrivain indonésien dont le premier roman a eu un éphémère succès, tombe amoureux d’Eliot, un agent littéraire français invité pour un festival à Jakarta. Entre eux se noue une intimité ambiguë qui fait toute la matière de ce nouveau roman, écrit en partie en Europe où l’auteur part faire une tournée promotionnelle inattendue.
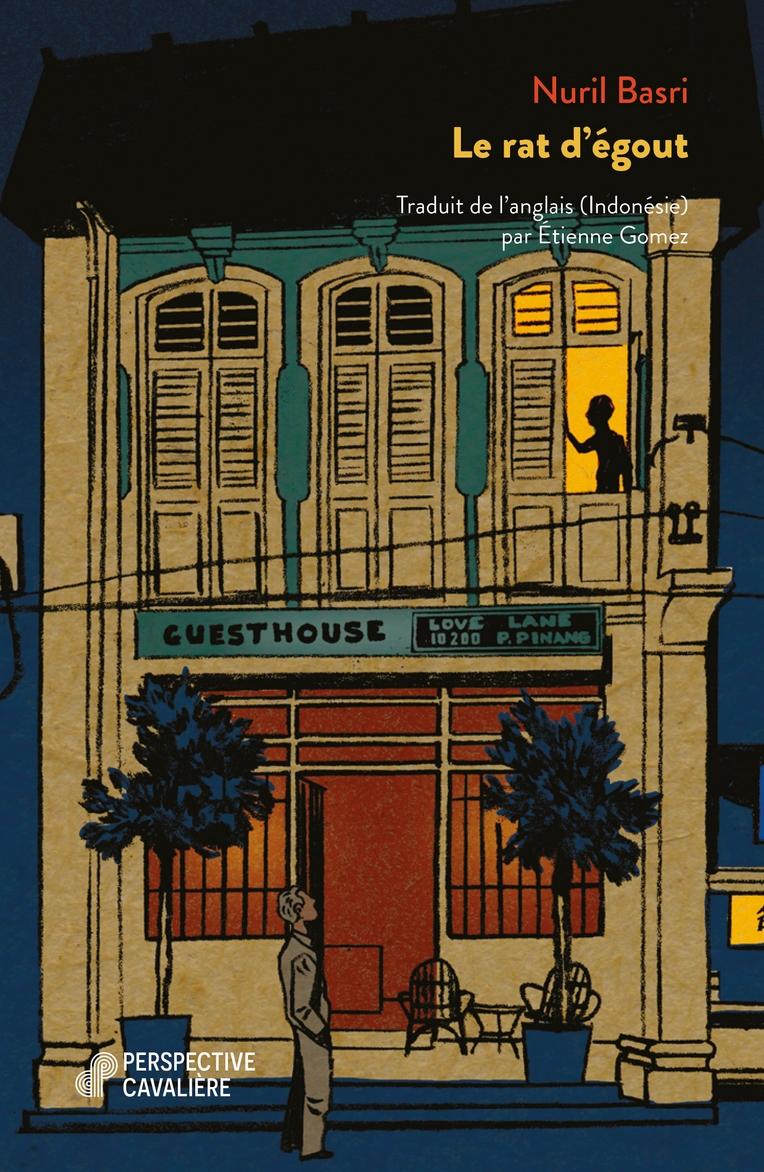
Né dans un village de Java occidental, Nuril Basri vit dans la marginalité à Jakarta. Après Not A Virgin, inspiré de sa formation dans un pensionnat islamique et publié en traduction anglaise avant l’original indonésien, Le rat d’égout évoque ses débuts en littérature. Inédit en anglais, langue où il a été écrit, ce livre est ici présenté en avant-première au public français.
#queer #asie #asiedusudest #marges #marginalité #postcolonial #decolonial
Date de publication : 30 janvier 2023
Contact presse & librairies : Couverture souple avec rabats Étienne Gomez Antony Thalien
Illustration : Christophe Merlin
12,9 x 19,8 cm 06 79 91 82 83 06 31 20 71 63
160 pages, 18 € editionsperspectivecavaliere@gmail.com
« J'ai beaucoup aimé ce court roman, vif et plus profond que Roni veut bien nous le faire croire. J'ai aimé le ton, l'humour, l'écriture libre, moderne (belle traduction d’Étienne Gomez, également l'éditeur), la concision, Nuril Basri va au plus direct ! » (Yves Mabon, Lyvres)
#la rencontre avec Eliot (incipit)
Jamais je n’avais vu Jakarta sous cet angle. De mon point de vue borné, toujours biaisé par le besoin d’être au centre de tout, ce n’était qu’une ville saturée de fils électriques où les gens se marchaient sur les pieds, quitte à s’excuser ensuite. Bon, pas toujours, mais de toute façon je m’en fichais. Je ne restais jamais longtemps et ne gardais aucun souvenir de mes allées et venues. Puis j’ai dû passer quelques nuits là-bas dans des guesthouses et j’ai compris que c’est une ville qui offre des choix. Mais ce n’est pas sur la capitale que je veux écrire. C’est sur Eliot.
Ce jour-là j’avais décidé d’aller à un petit festival littéraire. Je n’étais pas invité mais j’étais venu quand même pour observer les gens. J’aime bien ça, observer les gens. Une chose qu’il faut que vous sachiez, c’est qu’il y a quelques années j’ai écrit un roman sur un type si aigri qu’il passait sa colère sur tout. Un peu à mon image, pour la petite histoire. Mais ça plaît, les gens ont acheté le livre et il y a eu des articles dans la presse. Pas pour ça que je suis devenu une star ni l’auteur qu’on s’arrache. Un an plus tard, mon roman prenait la poussière en librairie et perdait de son écho. Maintenant que je vous ai parlé de cet unique succès, je dois vous dire pour ma défense que j’ai écrit un certain nombre de textes ces deux dernières années, pas tout à fait finis mais presque. Bientôt peut-être.
Cet événement – le festival littéraire, je veux dire – dure deux jours et il y a plein de conférences. Le plus souvent dans ce genre de manifestation je m’installe au dernier rang. Je ne juge pas ce que disent les intervenants, parce que déjà je m’en fiche et, franchement, je ne suis pas super intelligent. J’aurais bien aimé, mais je crois que ça m’aurait rendu arrogant. De toute façon je n’étais pas là pour serrer la pince à des
Photo : © Nuril Basri
auteurs connus ni pour faire la conversation. Ils ne m’intéressent pas tellement. De vrais snobs, pour certains. J’étais là pour revoir Eliot, que j’avais rencontré deux ans plus tôt. J’aimais beaucoup Eliot. Avec sa stature impeccable et son visage parfaitement symétrique, je vais le présenter comme un jeune dieu. Je l’avais rencontré à l’un de ces événements littéraires où les écrivains émergents viennent parler de leurs livres. Un grand moment dans ma vie, vous le sentez. Si vous connaissez ce monde-là, vous savez qu’il n’y a pas plus hype que la foire de Francfort. Eliot était donc là, très sûr de lui. Quand je l’ai aperçu derrière moi, je me suis dit quel dieu ! Il était un peu plus âgé que moi. Six ans, peut-être plus. Pas sûr. Maintenant j’ai vingt-six ans, si ça vous intéresse. Et il était beau- coup plus grand ! Un vrai modèle de propagande nazie : mâchoire sculptée, barbe sexy pas trop fournie, courts cheveux poivre et sel –la version blonde –, et de beaux yeux gris-verts qui paraissaient briller, peut-être à cause des éclairages. Je devais faire un peu biche dans les phares quand j’ai engagé la conversation, mais il m’a souri et il m’a tendu sa carte de visite. C’est comme ça que j’ai pu le chercher sur Facebook, car voilà ce que font les gens comme moi. Et on est devenus amis. (p. 7-9)
#la photo dans le fauteuil de Thomas Hardy
Pendant son séjour au Royaume-Uni, Roni est généreusement accueilli par Nikita. Tout se passerait au mieux si le mari « très upper class » et un peu snob de Nikita n’accueillait Roni avec un embarrassant silence…
Nikita, qui venait de déposer une tasse devant moi sur la table basse, est repartie chercher un cake que j’ai dégusté avec enthousiasme. Je me sentais un peu mal à l’aise dans ce salon, d’autant que le mari de Nikita ne s’était toujours pas présenté.
« Alors, qu’avez-vous donc écrit, comme ça ? »
Monsieur m’adressait enfin la parole.
« Un roman, William ! Je t’en ai déjà parlé. Je te l’ai même montré ! » a répondu Nikita avant de s’installer pour siroter son café
Il s’appelait donc William. Il s’est replongé dans les pages de son journal. Ne sachant quelle contenance me donner, je me suis mis à gigoter les jambes. Nikita m’a souri doucement. Moi aussi, je lui ai souri. C’était la première fois que je rentrais chez des Anglais. Il y avait des objets partout, vieux, disparates, ambiance musée. Rien de très futuriste.
« Tiens, montre-lui le fauteuil ! » s’est soudain exclamé William après deux ou trois minutes d’un silence assez gênant.
Nikita m’a demandé si je voulais le voir.
« Le fauteuil ? Quel fauteuil ? »
J’imaginais déjà un instrument de torture. Elle m’a dit de la suivre dans le bureau, une pièce qui semblait avoir résisté à plusieurs tentatives de mise en ordre. Il y avait des piles de livres et de journaux partout, et des plantes qui piquaient du nez.
« Vous voyez ce fauteuil dans le coin ? Le fauteuil isolé ?
– Oui, plus tout jeune.
– Le fauteuil de Thomas Hardy ! William en est devenu propriétaire il y a plusieurs années.
– Un si grand romancier ! »
William venait de nous rejoindre, et sa voix m’a surpris.
« Vous avez lu son œuvre ? »
Sans chercher à mentir, j’ai fait non de la tête. Je voyais déjà tomber sur moi le regard condescendant de William, mais Nikita s’est empressée d’intervenir.
« Venez, asseyez-vous dedans. Vous aussi, vous êtes romancier ! »
J’ai obéi en soupirant. Le fauteuil était vieux et plus si confortable. Nikita m’a souri, et je lui ai souri aussi.
« Vous voulez une photo de vous dans le fauteuil ?
– Oui, bonne idée », j’ai répondu en lui tendant mon téléphone.
J’ai posé le menton en l’air, genre gentleman sauf que je n’étais pas du tout à l’aise. Sur la photo j’ai l’air très malheureux mais Nikita était ravie. Puis elle a dit qu’elle devait se mettre aux fourneaux et que les invités ne tarderaient plus. C’étaient des gens qui voulaient me rencontrer.
« Des amis, ne vous inquiétez pas. »
Je n’ai rien répondu. (p. 82-84)
#le rat d’égout mange du steak
À la fin de cette rencontre, la directrice du National Centre for Writing est venue me demander ce que je voulais au dîner. Je lui ai répondu que tout me convenait. Je suis un rat d’égout ! Mais elle m’a dit que, comme c’était ma dernière soirée à Norwich et que toutes les rencontres s’étaient bien passées, il fallait fêter ça. J’ai d’abord proposé des pâtes, mais très vite, à l’idée d’être invité, j’ai changé de réponse et opté pour un steak.
« Un steak, très bonne idée ! » elle a répondu d’un air satisfait, avec un accent rauque.
Wynona – tel était son nom – aurait mérité que je la remercie de s’être aussi bien occupée de moi pendant tout mon séjour. J’aurais aimé l’avoir comme tante, ou comme grande sœur avec une grande différence d’âge, comme ça j’aurais pu lui piquer ses chouettes tailleurs ! Je pense toujours beaucoup à elle.
On est partis au restaurant à pied dans le vent froid avec un petit groupe. Nos pas claquaient doucement sur les pavés. Comme ça faisait deux ans que je n’avais pas mangé de steak, je salivais déjà. Je sentais le goût sur ma langue ! Ça fait du bien parfois de penser à la nourriture !
Le steak, énorme, est arrivé sur une ardoise chaude. C’est sans doute la viande la plus délicieuse que j’aie mangée de ma vie. J’ai savouré le tout tranche par tranche, en introduisant chaque morceau délicatement dans ma bouche. J’ai pris soin de bien mâcher, aussi. Une trentaine de fois chaque morceau !
Après le dîner, on s’est tous dit au revoir.
Dans ma chambre, j’ai fourré mes vêtements dans ma valise pour ne pas être pris par le temps le lendemain matin. Je me suis assis sur le bord du lit, la gorge sèche.
Le steak que je venais de manger avait coûté l’équivalent de plus de 500 000 roupies ! Je savais que je n’en dormirais pas de la nuit. J’étais triste et j’avais envie de pleurer. Je l’avais trouvé tellement bon, ce steak, que je me jugeais atrocement coupable de l’avoir tant savouré.
J’ai eu une pensée pour ma mère, qui n’avait jamais rien mangé de semblable. Et que dire de ces vieux qui claquaient toutes leurs économies dans leur pèlerinage ? Ou de tous ceux qui n’avaient pas les moyens de se payer à manger ? Je venais d’engloutir un steak au prix d’un mois de loyer ! J’avais l’impression d’avoir lésé tellement de monde que ça me rendait malheureux. Je me sentais mesquin, abominable. Serrant les lèvres et le cul, je me suis interdit de vomir et de chier. (p. 76-78)
Recensions :
- Yves Mabon, Lyvres : https://www.lyvres.fr/2023/02/le-rat-d-egout.html
- Guillaume Contré, Le Matricule des Anges : https://www.lmda.net/2023-03-mat24134-le_rat_d_egout?debut_articles=%4012869
- Marc Verlynde, La Viduité : https://viduite.wordpress.com/2023/03/30/le-rat-degout-nuril-basri/
Entretien avec Nuril Basri, par Jean-Davy Dias pour RegArts : https://regarts.org/Interviews/nurilbasri.php
Journées d’étude et publications académiques :
- Étienne Gomez, « Translating and publishing Asian Queer: Nuril Basri’s The Sewer Rat », Paris, Sorbonne Nouvelle, 15 mai 2023.
- Étienne Gomez, « Nuril Basri, figure de la marginalité littéraire en Indonésie », Aix-Marseille, 17-18 novembre 2023.
- Étienne Gomez, « Exister par la traduction : le cas de Nuril Basri (Indonésie) », La Main de Thôt (Toulouse Jean Jaurès), n°12, 2024 « Traduction et Résistances » (proposition en attente de réponse).
Alexandra Chreiteh
Ali et sa mère russe
Traduit de l’arabe (Liban) par France Meyer
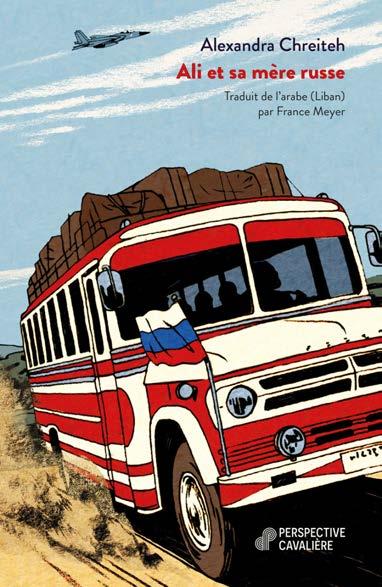
Le 12 juillet 2006, Israël frappe le Liban suite à l’enlèvement de deux soldats israéliens par le Hezbollah à la frontière. Un bus affrété par l’ambassade de Russie à Beyrouth évacue les ressortissants russes vers un aéroport syrien. Pendant le trajet, la jeune narratrice, d’origine russe, retrouve Ali, un ancien camarade de classe d’origine ukrainienne qu’elle avait perdu de vue. Pourquoi Ali fuit-il le pays qu’il s’est toujours dit prêt à défendre ?
Premier roman d’Alexandra Chreiteh traduit en français, Ali et sa mère russe confronte la société libanaise aux tabous qui la divisent.
ISBN : 978-2-493205-01-8
© Perspective cavalière 2021
Graphisme : Débora Bertol
Illustration : Christophe Merlin
Édition originale :
Date de publication : 11 janvier 2022
Contact presse & librairies : Couverture souple avec rabats Étienne Gomez
© Alexandra Chreiteh 2009
12,9 x 19,8 cm 0679918283
96 pages, 14 € epl.gomez@gmail.com
« Si vous manquez ce petit bijou, ce sera tant pis pour vous ! »
Marcia Lynx Qualey, ArabLit
« Ali et sa mère russe est centré autour de deux personnages : Ali, l’homosexuel éponyme, et la narratrice hétérosexuelle, qui ne se considère pas comme homophobe, car – vous savez – elle a des amis gays. On y retrouve l’humour et la perspicacité caractéristiques d’Alexandra Chreiteh, qui s’intéresse particulièrement aux jeunes de Beyrouth. L’homosexuel ukraino-libanais, qui panique également depuis qu’il a découvert que l’une de ses ancêtres était juive, est une merveille de haine de soi et de flamboyance mélangées. »
Marcia Lynx Qualey, ArabLit
Extrait n°1 : On finissait tout juste de déjeuner quand Israël déclara la guerre au Liban (p. 5-6)

Le 12 juillet 2006, on apprit que le Hezbollah avait kidnappé deux soldats israéliens à la frontière. Ce qui ne nous empêcha pas d’aller manger des sushis. On finissait tout juste de déjeuner quand Israël déclara la guerre au Liban. Les employés du resto se dépêchèrent de fermer et nous demandèrent de partir tout de suite. On partit tout de suite, sans payer l’addition.
Coup de bol, on avait choisi un des restos les plus chers du centre de Beyrouth. On avait bien vu ce jour-là que quelque chose clochait, mais on était sortis quand même. Les rues étaient quasi désertes, alors que d’habitude elles grouillaient de monde, quant au resto, qu’on trouvait toujours bondé, il était presque vide à part nous – ma copine Amal, son fiancé Salim et moi – et deux inconnus qui fumaient, assis à la table à côté.
L’un d’eux m’avait observée à plusieurs reprises pendant le repas. J’avais remarqué son manège dès notre arrivée, et j’avais essayé d’éviter ses regards, dont l’insolence m’embarrassait. Mais j’avais eu beau l’ignorer, ça ne l’avait pas démonté, et à peine sortait-on du resto qu’il m’accostait en souriant et m’appelait par mon prénom.
Bizarre, me dis-je. Mais plus bizarre encore, c’est qu’il m’avait parlé en russe – il se trouve que ma mère est russe et que cette langue est ma langue maternelle. Il se présenta – il s’appelait Ali Kamaleddine – et me demanda si je le reconnaissais, mais non, il ne me disait rien, et je ne sus pas quoi répondre. Voyant mon embarras, il précisa qu’une dizaine d’années plus tôt on avait été camarades de classe à Nabatieh, dans le sud, où nos familles habitaient. Il était sûr, ajouta-t-il, que ma mère n’avait pas oublié la sienne, parce qu’elle était ukrainienne ; dès qu’il me dit son nom je me souvins d’elle, puis de lui, et je fus stupéfaite de découvrir qu’il avait tant changé depuis la dernière fois que je l’avais vu – ce que je lui dis.
Ali : « une merveille de haine de soi et de flamboyance mélangées »
Ali est en vacances au Liban pour l’été au moment où la guerre éclate. Depuis plusieurs années il est parti vivre en Allemagne où il termine des études de médecine et où il vit son homosexualité au grand jour. Son amour du Liban, qu’il s’est toujours dit prêt à défendre jusqu’à sa mort, n’est pas seulement contrarié par l’homophobie régnante – en partie fantasmée – dans son pays natal, mais aussi par un antisémitisme exacerbé par la guerre, incompatible avec ses origines…
« De mémoire récente, le portrait d’homosexuel le plus saisissant dans la littérature arabe est peut-être Ali et sa mère russe (2009) d’Alexandra Chreiteh, la romancière libanaise au regard acéré et au style ultra-contemporain. […] Alexandra Chreiteh ne se contente pas de dépeindre un homosexuel émancipé : elle se moque de ses deux protagonistes comme on pourrait se moquer de soi-même. »
Marcia Lynx Qualey, ArabLit, 04/09/2015.
Extrait n°2 : Il aurait bien voulu pouvoir rentrer au Liban définitivement (p. 46-48)
Soudain il eut la larme à l’œil ; ça l’attristait vraiment, dit-il, de voir encore et toujours ravagé ce pays fabuleux.
– Quel dommage…
Il soupira, puis ajouta après un court silence qu’il aurait bien voulu pouvoir rentrer au Liban définitivement, parce que la vie était bien plus agréable à Beyrouth qu’en Allemagne. […]
– Alors pourquoi tu ne reviens pas ? m’étonnai-je. La guerre sera bientôt finie et tout redeviendra normal, comme d’hab ! Qu’est-ce qui te retient ?
– Plusieurs choses…
– Mais encore ?
Déjà, je suis gay…
Il avait dit ça comme s’il s’agissait d’une évidence, du genre « La Terre tourne autour du Soleil ». Mais moi, j’étais choquée, et Ali resta stupéfait car il pensait que je savais depuis longtemps.
Rappelle-toi la dernière fois que tu es venue chez moi… Je sus immédiatement à quoi il faisait allusion […].
Il m’expliqua qu’il avait toujours été homo sans le savoir, qu’il l’avait découvert grâce à ce qui s’était passé entre nous, et que j’étais la seule fille qu’il avait aimée avant de comprendre qu’il préférait les hommes. Et il me remercia de l’immense service que je lui avais rendu.
De rien… dis-je embarrassée.
La narratrice : « une femme dans l’histoire, une femme qui n’a que son corps »
La narratrice est l’une des nombreuses femmes à bord. Comme elle est atteinte d’une cystite, les « pausespipi » représentent autant d’intermèdes tragi-comiques au cours du voyage. Mais le thème du corps de la femme en temps de guerre est aussi développé à travers d’autres personnages comme une jeune fille qui a ses règles en arrivant à l’aéroport et une jeune femme enceinte qui accouche prématurément.
« Je voulais qu’il y ait une femme dans l’histoire, une femme qui n’a que son corps et qui ne tente pas de construire son identité contre quelqu’un ni quoi que ce soit. […] Il était très important pour moi d’aborder un certain type de discours héroïque qui intervient souvent dans les périodes de guerre. Bien sûr le corps de la femme apparaît toujours en tant que métaphore – la femme est violée, symbole de la perte de souveraineté sur la terre, ou tuée, symbole de conquête ; il y a le corps de la mère qui enfante les fils de la nation. Et puis je voulais montrer autre chose, les besoins physiques d’une personne, d’une femme qui traverse la guerre. […] Bien sûr, dans les périodes de guerre, les femmes sont les plus grandes perdantes, mais elles sont souvent réduites à des métaphores. Elles sont rarement autorisées à exister par elles-mêmes. Je me demandais toujours : quand le sang est-il pur, et quand est-il impur ?
Alexandra Chreiteh, entretien avec Rachael Daum, ArabLit
–
–
–
Extrait n°3 : « Dieu merci, je ne tomberai jamais enceinte ! » (p. 88-91)
Dans le hall de l’aéroport, Ali se cacha au milieu de la foule des voyageurs qui attendaient, assis sur leurs valises, la réouverture du guichet de contrôle des passeports et la reprise de l’embarquement. Seule une des filles de l’amie de ma mère se tenait debout, immobile, jambes serrées, et quand je lui demandai ce qu’elle avait, elle me répondit que ses règles avaient débarqué au moment même où on était entrés dans l’aéroport, qu’elle n’avait trouvé ni serviette hygiénique ni papier toilette, et qu’il ne lui restait plus qu’à essayer d’empêcher le sang de couler. À peine avait-elle dit ça qu’une goutte roula le long de sa cuisse droite, et Ali qui s’en aperçut s’écria :
– Ça te dégouline jusqu’au genou !
Il lui donna vite un de ses T-shirts pour qu’elle s’essuie.
Un moment plus tard, un des gars de l’ambassade vint demander s’il y avait une sage-femme dans la salle parce que la femme enceinte était en train d’accoucher. […] Malheureusement pour elle, il n’y avait pas de sage-femme parmi nous.
Peu après, elle se mit à hurler de douleur et ses cris résonnèrent aux quatre coins de l’aéroport, mettant tout le monde mal à l’aise.
– Dieu merci, je ne tomberai jamais enceinte ! se félicita Ali.
Une docteure proposa son aide et demanda si quelqu’un voulait bien l’assister ; Ali se porta volontaire, parce qu’il avait étudié la médecine pendant quelques mois à la fac, et qu’il avait un jour aidé une vache à mettre bas, chez sa grand-mère à la ferme. […]
Ali ne refit surface que tard dans la nuit ; le guichet de contrôle des passeports n’avait toujours pas rouvert et tout le monde s’était assoupi par terre ou sur sa valise en attendant. Il me réveilla pour me dire que la jeune femme avait eu un garçon et qu’elle l’avait appelé Ali, comme lui. Il se tapa la joue et soupira :
Pauvre gosse !
Sources :
Marcia Lynx Qualey, « Homosexualité et roman arabe : le triomphe de la moquerie », Translator’s Lodge, 18/01/2022 :
https://translatorslodge.com/2022/01/18/lhomosexualite-dans-le-roman-arabe-le-triomphe-de-la-moquerie/ Rachael Daum, « Alexandra Chreiteh : écrire sur la menstruation en arabe standard moderne », Translator’s Lodge, 11/01/2022 :
https://translatorslodge.com/2022/01/11/alexandra-chreiteh-ecrire-sur-la-menstruation-en-arabe-standardmoderne/
Rachael Daum, « La jeune romancière libanaise Alexandra Chreiteh parle du paysage littéraire arabe », Translator’s Lodge, 13/01/2022 :
https://translatorslodge.com/2022/01/13/la-jeune-romanciere-libanaise-alexandra-chreiteh-parle-du-paysagelitteraire-arabe/
Marcia Lynx Qualey, « Homosexuality and the Arabic Novel: The Triumph of Mockery », ArabLit, 04/09/2015 : https://arablit.org/2015/09/04/homosexuality-and-the-arabic-novel/
Rachael Daum, « Alexandra Chreiteh on Writing About Menstruation in Modern Standard Arabic », ArabLit, 04/12/2015 : https://arablit.org/2015/12/04/chreiteh/
Rachael Daum, « Lebanese Novelist Alexandra Chreiteh on the Arabic Literary Landscape », ArabLit, 07/12/2015 : https://arablit.org/2015/12/07/arabic-literary-landscape/
Recensions :
Lyvres (Yves Mabon) : https://www.lyvres.fr/2021/07/ali-et-sa-mere-russe.html
–
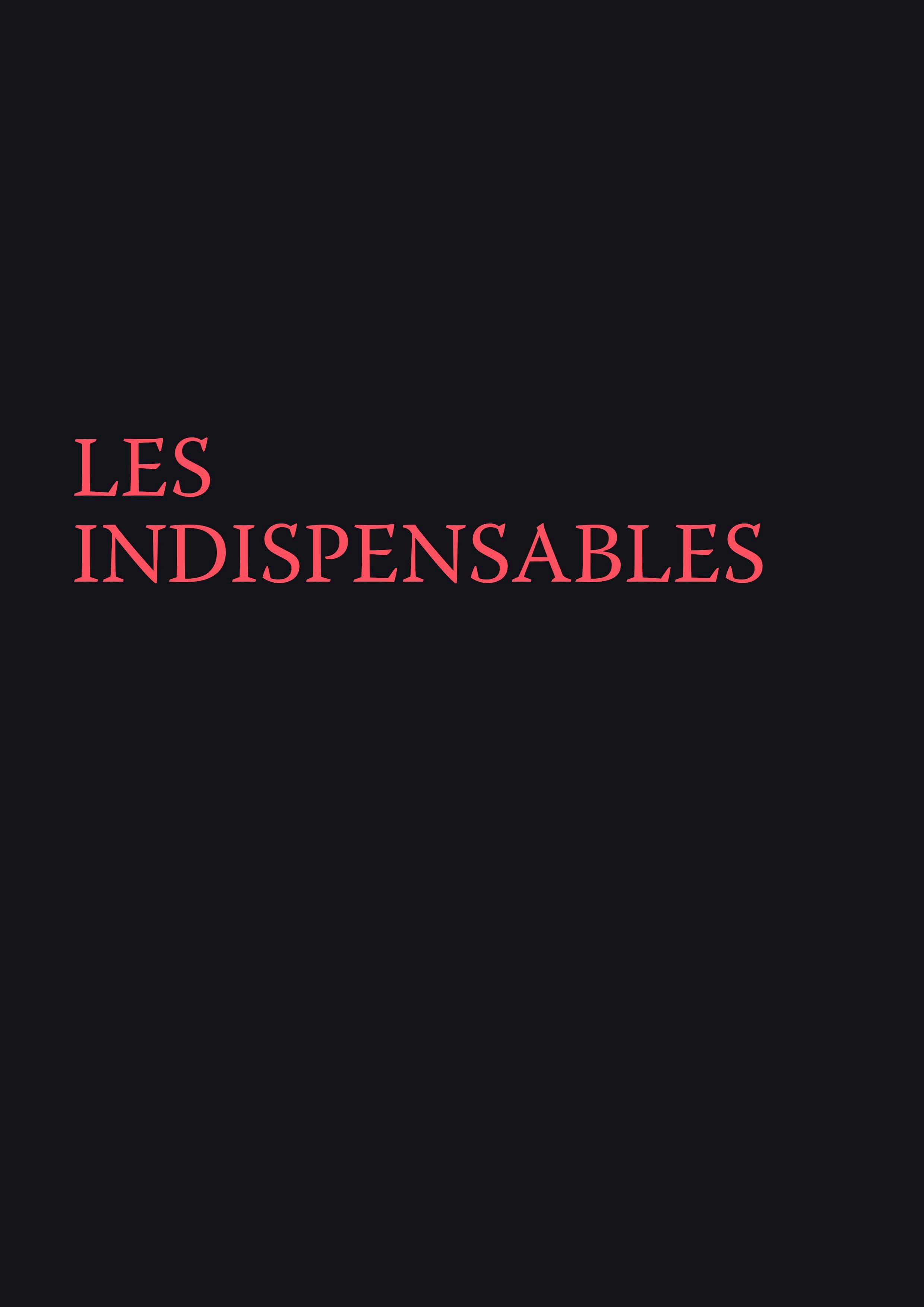
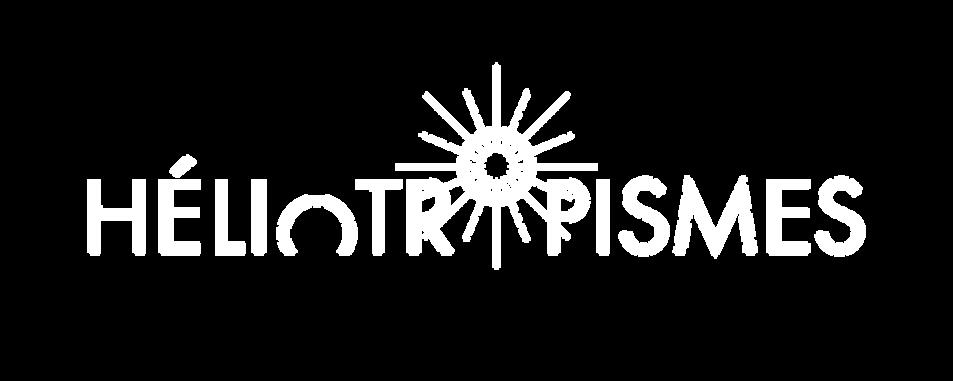
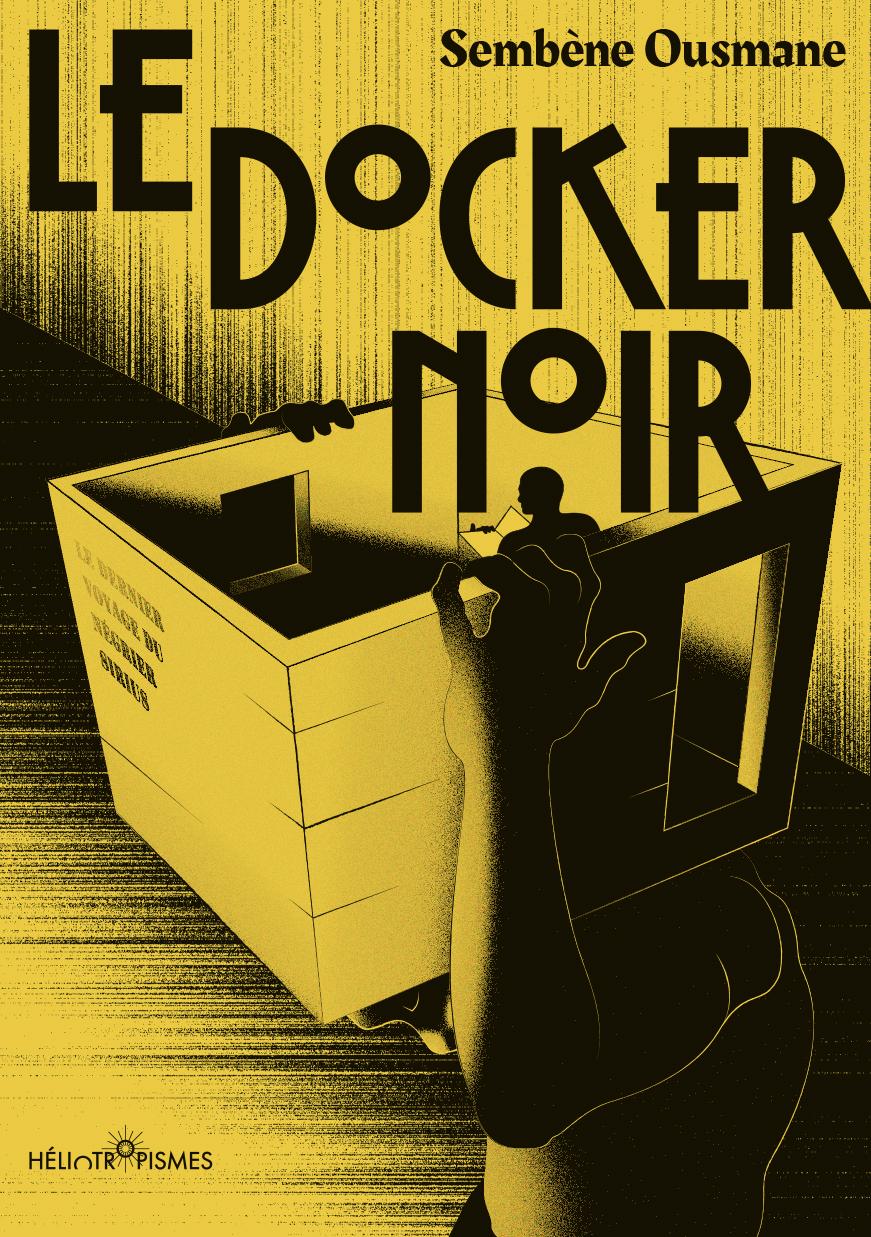
MAISON D'ÉDITION MARSEILLE www.heliotropismes.com
Au début de ce siècle, la ville de Marseille ne comptait qu'une petite douzaine d'Africains. Peu à peu, ils sont devenus plus nombreux. Aimant vivre en communauté, on les voyait en groupes sur la place Victor Gélu, dans ce qui fut le vieux quartier, avec ses rues sordides, cellulaires, en cul de sac. La Deuxième Guerre mondiale vit le vieux Marseille à moitié détruit. Quelques uns partirent pour la Grande-Bretagne. Le reste s'enfonça dans la ville? Et lorsque prirent fin les hostilités, leur nombre augmenta; de tous les côtés affluaient des hommes de couleur, poussés par les vicissitudes de la vie et de la navigation... Unis par un esprit de communauté, de solidarité, ils formèrent ce village... La plupart sont des marins accomplis, chacun ayant au moins deux tours du monde dans son sac.
RÉSUMÉ
Marseille, années 1950. Diaw Falla, docker sénégalais, vit à Belsunce, le « petit Harlem marseillais », et travaille sur le port en compagnie de nombreux ouvriers africains. Menant une existence précaire, il rêve d’écrire et de publier son premier roman, Le Dernier voyage du Négrier Sirius. Son existence bascule le jour où il confie son manuscrit à une amie écrivaine.
Publié en 1956, ce premier roman de Sembène Ousmane est un déchirant cri d’amertume qui fait écho aux romans marseillais de Claude McKay dans sa soif de liberté, sa défense des luttes sociales et son refus d’accepter l’étroitesse des préjugés raciaux. Le Docker noir résonne également avec Native son de Richard Wright et L’Étranger d’Albert Camus, dans sa description d’un personnage moins condamné pour son délit que pour ce qu’il représente aux yeux de la société française de l’après-guerre. Cette édition est enrichie d’archives, d’écrits poétiques inédits et de contes écrits par l’auteur à Marseille
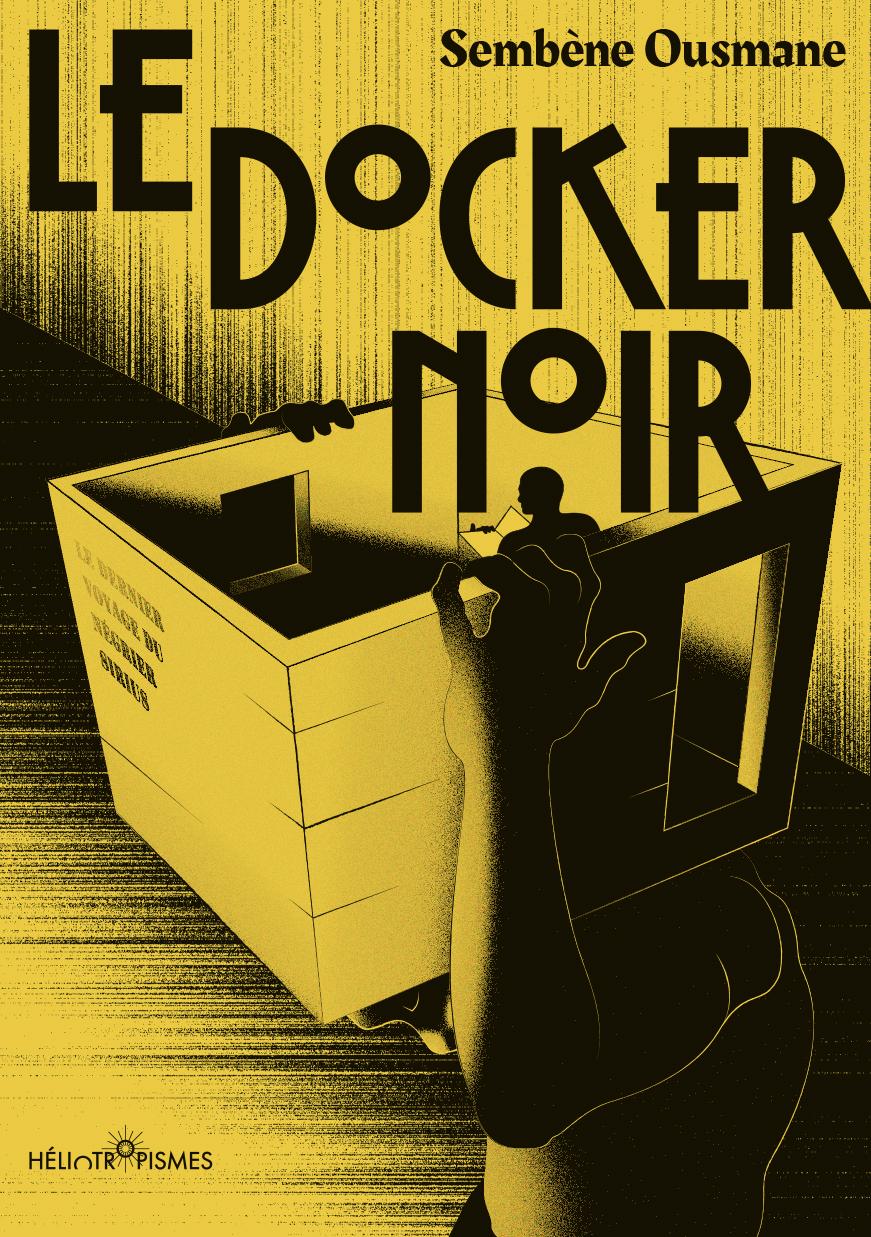

L'AUTEUR
Sembène Ousmane est né en Casamance en 1923. Tour à tour mécanicien, maçon et tirailleur dans l’armée coloniale, il débarque clandestinement à Marseille où il devient docker. Son séjour dans la ville (1946-1960) est une étape décisive d’intense activité militante et intellectuelle. Il y écrit ses trois premiers romans et participe activement aux activités de la CGT, du parti communiste, de la FEANF ou du MRAP.
Son retour en Afrique marque le début d’une riche carrière cinématographique et littéraire. Sembène Ousmane est décédé en 2007, laissant derrière lui une œuvre insoumise, au service d’une Afrique libre. .
1
Longtemps publié à compte d'auteur aux Nouvelles éditions Debresse, Le Docker noir a été réédité par Présence Africaine en 1971. Livre marginal par excellence (il est le seul dont l'action ne se situe pas en Afrique et relate l'expérience ouvrière de l'auteur en France), il n 'avait jusque là pas fait l'objet d'une étude approfondie.
Après des recherches dans plusieurs fonds d'archives (fonds du PC marseillais aux archives départementales des Bouches du Rhône, fonds méditérranéens de l'Alcazar, MRAP, IHS, etc ), nous avons retrouvé trace du parcours de Sembène Ousmane à Marseille et de son engagement politique et littéraire Cette version, qui sera préfacée par la dernière biographe de l'auteur, Valérie Berty, sera également suivie d'écrits inédits (poèmes et récits) écrits à la même période, ainsi que de documents d'archives.
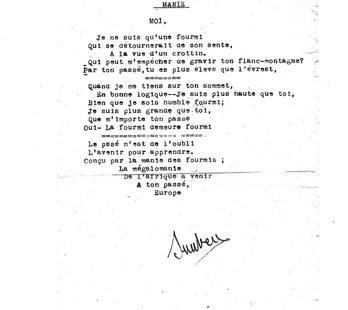

2023 marque le centenaire de la naissance de Sembène «Célèbre inconnu», il l’est encore à Marseille où il écrivit ses trois premiers romans. Un collectif que nous avons créé organise à cette occasion une série d’événements et de manifestations, tout d’abord à Marseille, puis dans d’autres villes. Présentations du livre, tables rondes, projections et rencontres croisées cinéma/littérature, lectures musicales, documentaires audio, ateliers scolaires, et autres auront lieu tout au long de l'année entre Paris (rétrospective de l'oeuvre de Sembène à la Cinémathèque française / janvier) et Marseille (grand colloque croisé McKay-Sembène Ousmane au MuceM / novembre)

Editions Héliotropismes
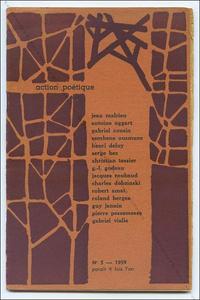
Collection : Harlem Shadows n°3
Parution : 5/5/2023
ISBN : 979-10-97210-12-0
Format : 148 x 210 mm
Prix : 22 € TTC
Préface : Valérie Berty
Dessins et graphisme : Carlos Chirivella Lopez
Directeur de collection : Armando Coxe
N E V E
O N A U G M E
U
R S I
N T É E
L E D O C K E R N O I R / S E M B È N E O U S M A N E
1 9 2 3 - 2 0 2 3 : U N C E N T E N A I R E S E M B È N E O U S M A N E
L’AUTEUR
Jean-Pierre Martinet (12/12/1944-18/01/1993) se définissait ainsi: « Parti de rien, Martinet a accompli une trajectoire exemplaire : il n’est arrivé nulle part. » On ne peut que le contredire ! Malmené de son vivant par une critique trop tiède et un lectorat effrayé par la noirceur de ses textes, il trouvera enfin la reconnaissance qui lui était dûe, mais de manière posthume, suite à la réédition complète de son oeuvre.
L’OMBRE DES FORÊTS
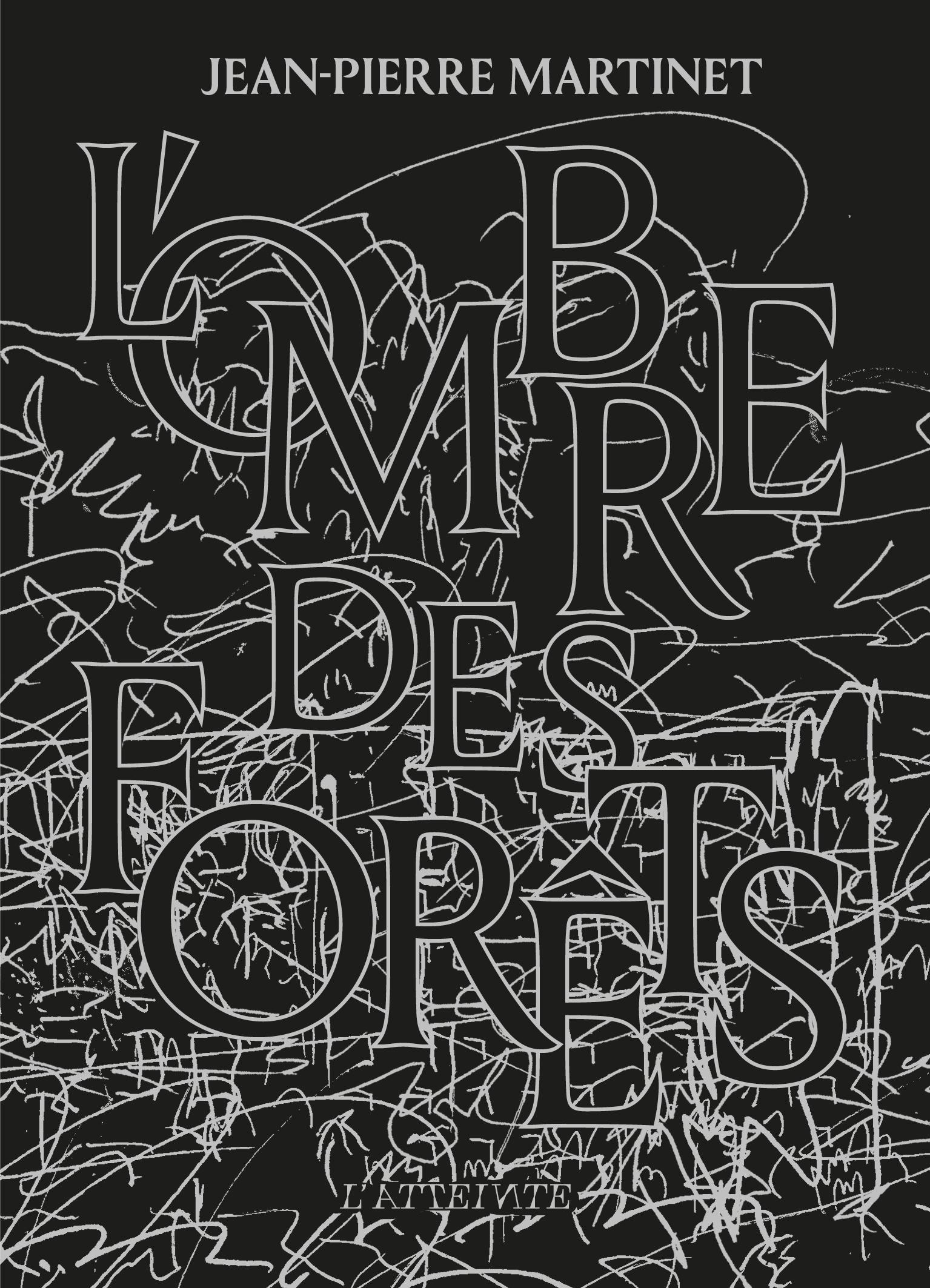 Jean-Pierre Martinet
Jean-Pierre Martinet
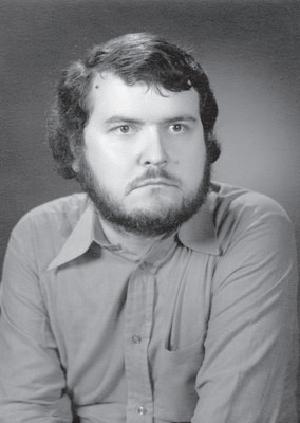
LE LIVRE
avec une nouvelle préface d’Éric Dussert, une lettre inédite de l’auteur et un dossier de presse
Un ultime roman comme dernière tentative avant d’abandonner le métier d’écrivain qui condense à lui seul tout le talent de l’auteur pour jouer avec nos émotions.
Quatre personnages : Céleste, Monsieur, le duc de Reschwig et Rose Poussière, comme autant de figures perdues dans la ville de Rowena écrasée par le soleil d’été. Ils suivront chacun leurs trajectoires incertaines, et c’est à une perdition orchestrée à laquelle on assistera, fascinés par la beauté de ce désespoir sans faille.
En s’éloignant de la monstruosité plus directe de ses premiers romans pour mieux se rapprocher de ses personnages, l’auteur distille ici une tension fulgurante, qui saura serrer le cœur des plus aguerris.
Une lecture qui ne laissera personne indemne.
INFOS
Parution : 18/01/2023
Prix TTC : 22 euros
Nombre de pages : 312
Format : 13 x 18 cm
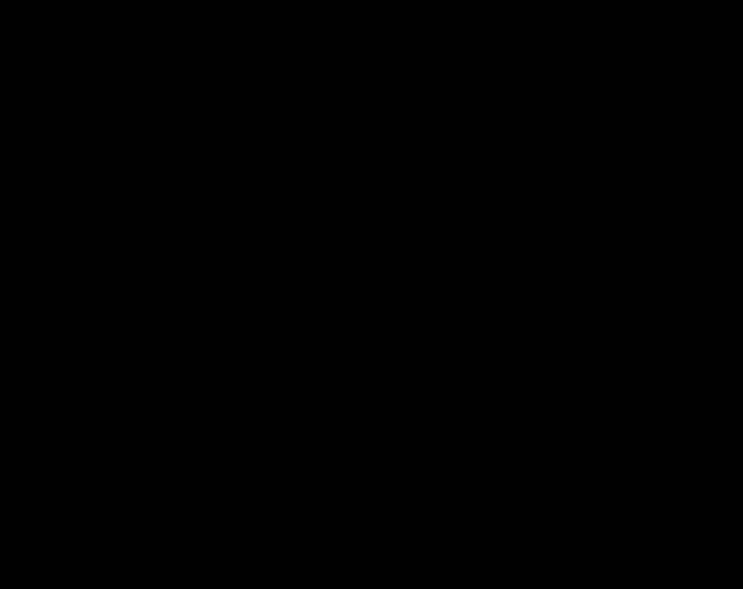
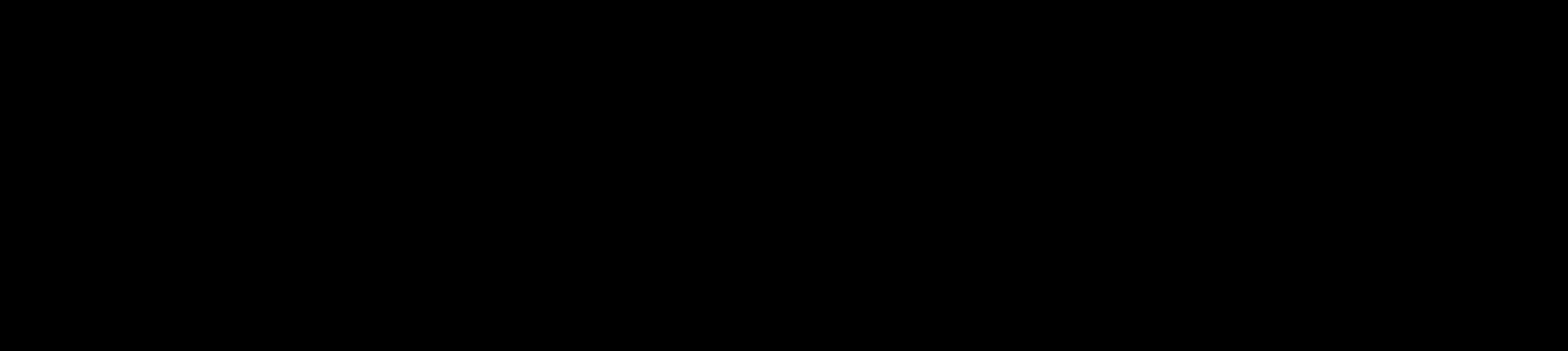
ISBN : 9782956166047
– nos livres sont distribués et diffusés par Serendip Livres.
– n’hésitez pas à nous contacter pour toute demande de service de presse ou d’organisation d’événement.
CONTACT
7 avenue de Blida 57000 Metz / camille@latteinte.com / 06 99 19 69 26
WWW.LATTEINTE.COM
Roman
« Quand viendront les grandes pluies d’automne, qu’aurons-nous fait de nos pauvres vies ? »
« Ce qui fait que L’Ombre des forêts est un livre beaucoup plus classique. C’est un livre sur des gens tourmentés, torturés, complètement tordus même, mais sans que cela transparaisse dans la forme. Je dirais que c’est un livre simple sur des gens compliqués. [...] Il y a une nostalgie infinie de l’amour. »
Jean-Pierre Martinet — entretien pour la revue Roman — 1987
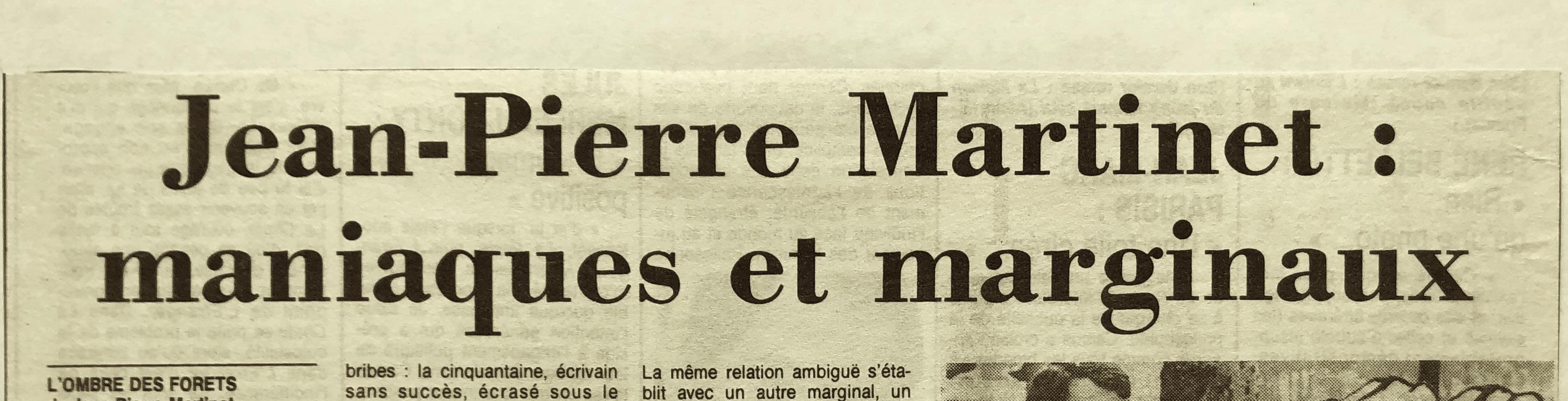
« Les traces sur le lecteur sont tenaces. »
Gérard Guéguan — Sud-Ouest dimanche — 1987
« Avec L’Ombre des forêts, Martinet achève sa trilogie des villes “absentes à la vie normale” »
Raphaël Sorin — Le Matin — 1987
« [...] un ouvrage remarquable dont la teneur littéraire relève presque de la magie. »
Serge Rigolet — Le Magazine Littéraire — 1987
« On retrouve [...] humour et désespoir dispensés d’une page à l’autre et les imprégnant d’un irrésistible charme, d’une noire tendresse [...] »
George Anex — La Gazette de Lausanne — 1987
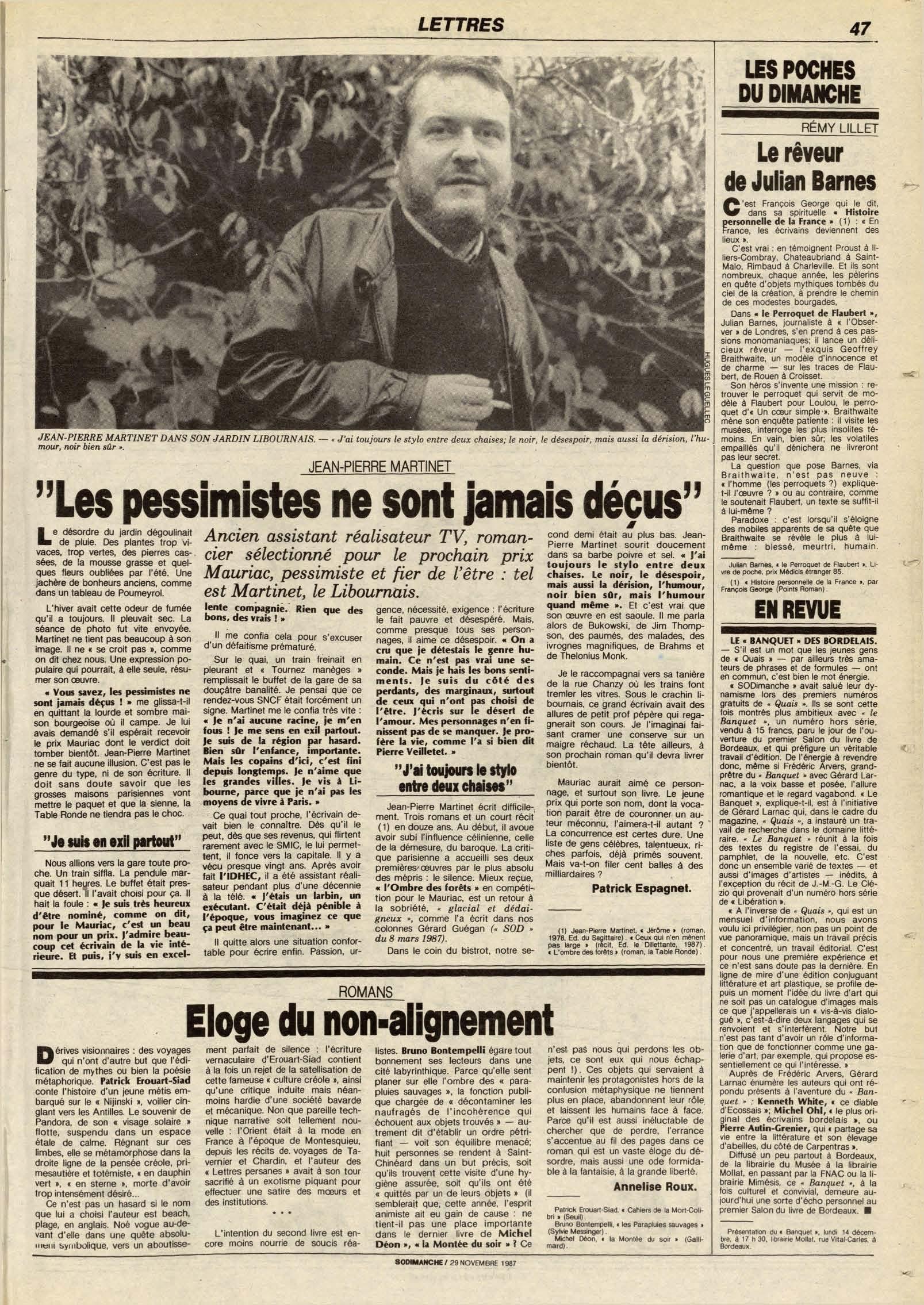
« Une réussite exceptionnelle. »
P. de V. — Marianne — 1987
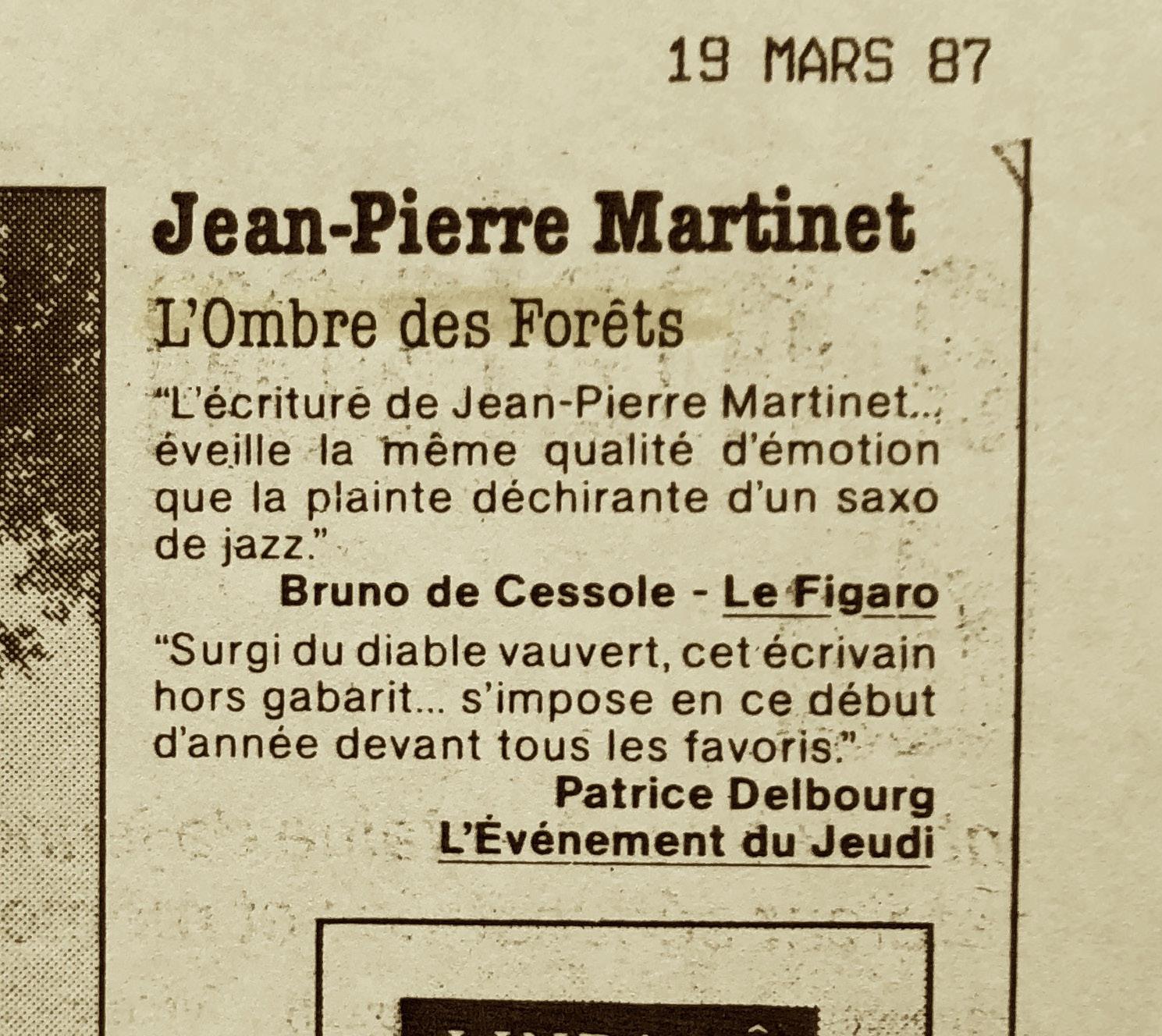
« Son écriture, sobre jusqu’au dépouillement, dessine avec une rare subtilité les méandres de l’âme humaine. »
O. le B. — Le Républicain Lorrain — 1987
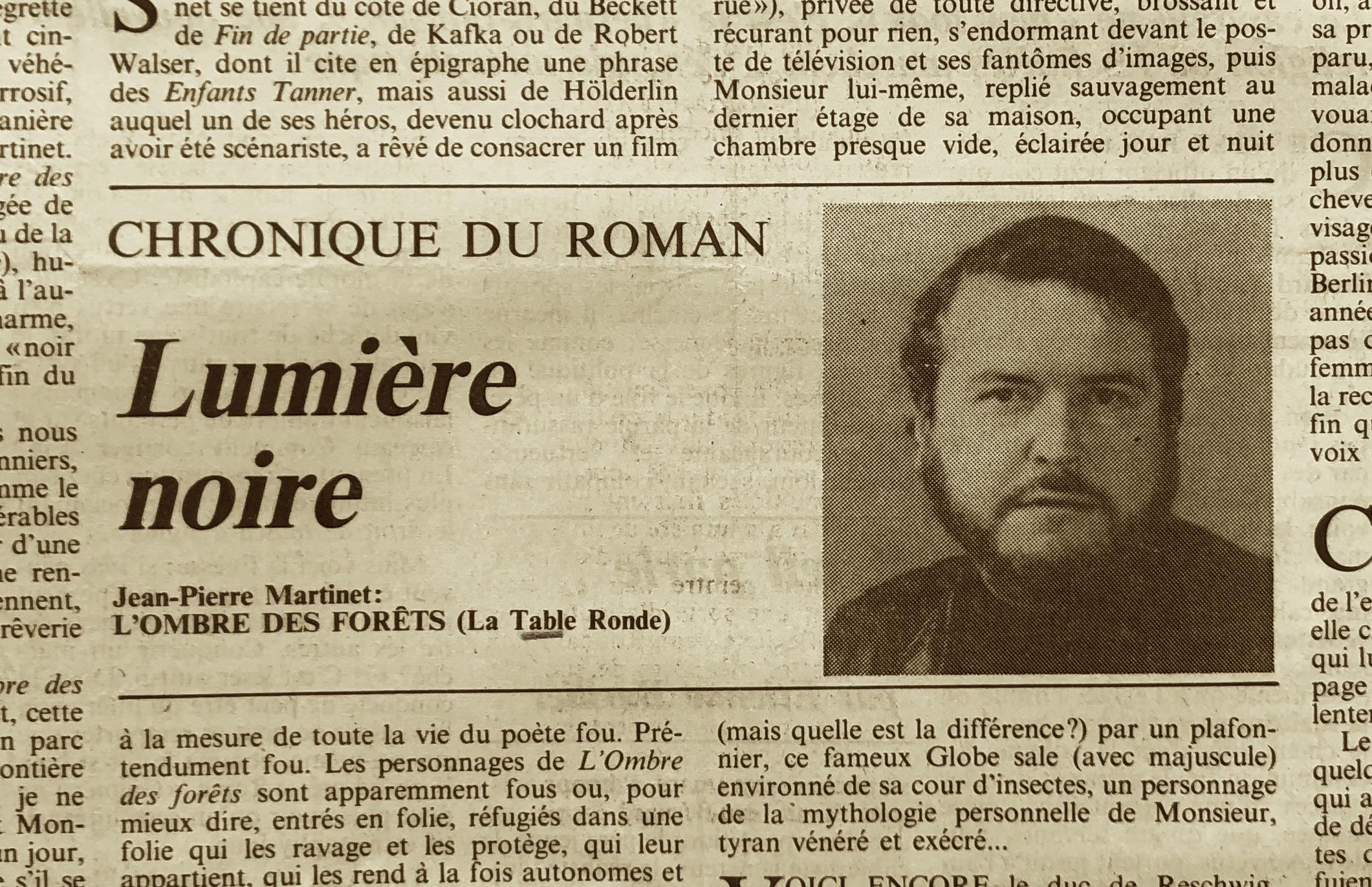
Igor Grabonstine et le Shining
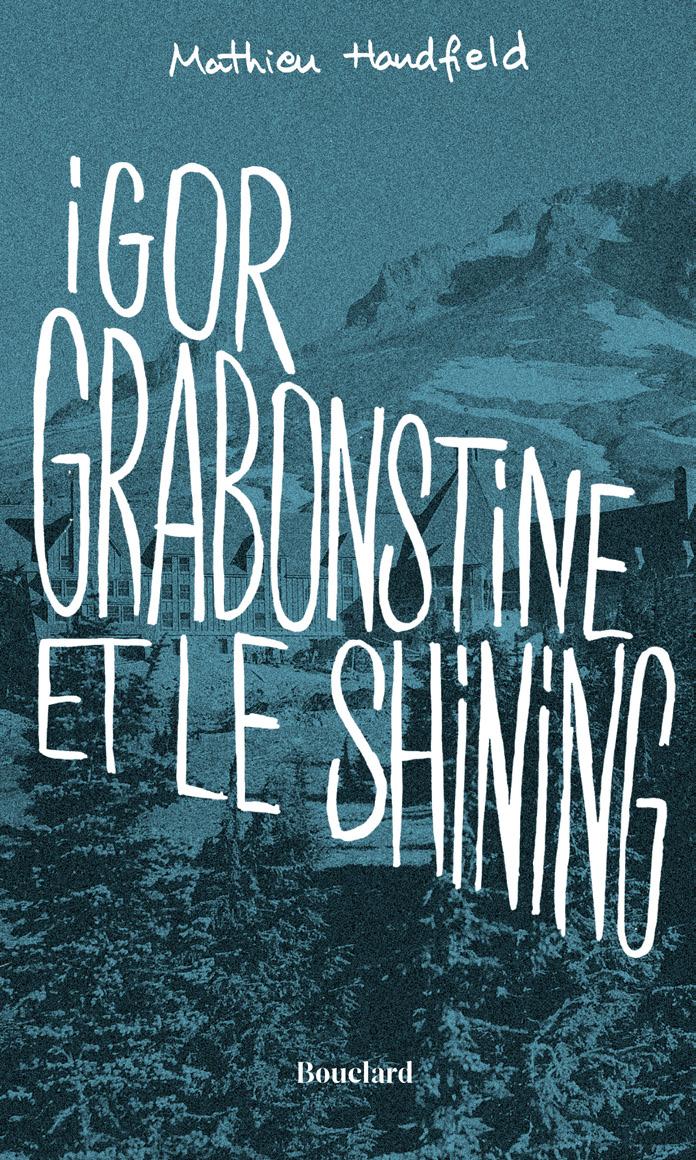
Attention récit uchronique complètement barré. Nous sommes ici sur le tournage de Shining, mais, Jack Nicholson est remplacé par Igor Grabonstine, un comédien raté de formation russe. Adepte du grand Stanislavski, il en veut à mort au petit Danny Lloyd qui ferait de l’ombre à son génie indiscutable. Evidemment, on croise aussi un Stanley Kubrick planqué derrière son assistant, un Stephen King alcoolique qui reste vissé au bar du mythique hôtel Timberline Lodge. C’est timbré, c’est amoral, mais c’est jouissif.
L’auteur : Mathieu Handfield

Diplômé en théâtre, Mathieu a fait partie de plusieurs productions importantes, autant à la télévision et au cinéma que sur scène. Il réalise maintenant, autre autres, Mouvement Deluxe, série animée (sorte de South Park québécois) dont il est aussi le concepteur. Il a publié plusieurs romans en plus d’avoir participé à de nombreux collectifs, dont Les cicatrisés de Saint-Sauvignac (publié par Bouclard en 2021), qu’il a également dirigé.
Recensions presse
Le Devoir
« Quelque part entre la glose de geeks et l’uchronie parodique, le roman de l’homme de théâtre raconte un tournage avorté, et complètement fabulé. »
Chatelaine
« Dans ce roman, deux acteurs de taille s’affrontent : Igor Grabonstine qui interprète le rôle principal et Danny Lloyd, petit garçon de 6 ans au talent remarquable et qui fait même ombrage au premier. Qui volera la vedette ? »
Bouclard éditions 7 rue de la Gagnerie 44830 Bouaye contact@bouclard-editions.fr 07 86 66 76 18 www.bouclard-editions.fr Collection 109, parution mai 2023
© Félix Renaud
et le Shining — Mathieu Handfield
qui lui furent lancés depuis l’obscurité. »
Fiche technique
Format : 176 pages, 12 x 20 cm
Tirage : 750 exemplaires
Prix de vente : 16 €
Diffusion : Serendip
ISBN : 978-2-493311-07-8
Première parution : 2014, Éditions de ta Mère (Canada)
Ce livre reçoit le soutien du CNL et de la Région des Pays de la Loire.
109 pour le youngblood, le sang neuf.
109 pour la Génération Y, la Génération youngblood.
Une collection qui défriche une nouvelle génération de jeunes romanciers/cières.
Une collection de petits formats accessibles. Sans contrainte de genre et de style. Des textes courts de fiction.
Des thématiques générationnelles mais sans prendre des grands airs intellectuels. A lire en train sur un Paris-Nantes.
« Comment avait-il pu construire une carrière aussi lumineuse, aussi exempte d’échec et aussi enviable pour la voir pulvérisée en quelques minutes par un enfant de six ans ? Il va sans dire que, dans l’état où il était, Grabonstine n’avait certainement pas envie de regagner ses appartements pour les découvrir hantés ; alors, lorsqu’il verrouillait sa porte, ce n’est pas sans une certaine irritation qu’il accueillit les mots « Bonjour, je hante votre chambre »,
Igor Grabonstine
Collection 109, parution mai 2023 Bouclard éditions 7 rue de la Gagnerie 44830 Bouaye contact@bouclard-editions.fr 07 86 66 76 18 www.bouclard-editions.fr 109
• le second roman inédit en france d’uine écrivaine majeure
• publié à titre posthume, c’est une pépite méconnue
• un chant écarlate a été traduit en 7 langues
• une préface d’axelle jah njiké, journaliste
• illustration de couverture d’elke foltz, peintre
Un chant écarlate
Une histoire d’amour impossible entre deux étudiants idéalistes, une française et un sénégalais, dans le Dakar des années 1980, où l’apprentissage de l’autre, au-delà des frontières, des cultures et des traditions, s’avère difficile.
Ousmane, jeune sénégalais de condition modeste et Mireille, française, fille de diplomate, se rencontrent sur les bancs du lycée, à Dakar. Ils se marient, au grand damn de leurs familles respectives. Mireille coupe les ponts avec les siens et se convertit à l’islam. Ousmane impose sa femme à ses parents, catastrophés. Un fils naît de cet amour, Gorgui. Mais le poids des traditions et la pression sociale et familiale aura raison de leur amour….
Mariama Bâ
une écrivaine pionnière et militante (1929- 1981)
Née en 1929, Mariama Bâ est une figure iconique de la littérature sénégalaise. Elle connaît un succès international avec Une si longue lettre, son premier roman. Issue d’une famille traditionnelle et musulmane, elle intègre une école française et devient enseignante en 1943. Femme engagée, Mariama Bâ s’engage pour nombre d’associations féminines militant pour l’éducation et les droits des femmes. Elle devient une voix importante de son pays et prend part aux débats publics. Elle meurt en 1981 d’un cancer, peu de temps avant la sortie de son second roman, Un chant écarlate, aux éditions NEAS au Sénégal.


prix : 22 €
tirage : 1000 ex.
parution : 04/02/2022

format : 14 x 20,5 cm
pagination : 320 p.
ISBN : 978-2-493324-00-9

roman
Mariama Bâ
v i s u e l n o n d é f n i t i f
Un chant écarlate le roman inédit d’une figure emblématiQue du féminisme africain
Elles parlent de Mariama Bâ ...
« Je crois que [Mariama Bâ] était la première écrivaine africaine à parler avec autant de lumière de la condition des femmes. »
Véronique Tadjo
« C’est en lisant Mariama Bâ que je deviens africaine. [...] Le roman de Mariama Bâ, considérée à juste titre comme une pionnière de la littérature féminine en Afrique subsaharienne est l’un des premiers à rompre le silence des femmes par le biais de l’écriture »
Axelle Jah Njiké, LSD, France culture
« On la soupçonne d’être influencée par les idéologies venues de l’étranger. « Si être féministe signifie révéler les tares d’une société, alors je le suis ! », réplique-t-elle aux critiques. Sa vie privée témoigne du même combat pour une vie libre, en conformité avec ses idées. »
Kidi Bebey, Le Monde
« UNE SI LONGUE LETTRE, UN VÉRITABLE LIVRE-MANIFESTE FÉMINISTE »
Kidi Bebey, Le Monde
• le premier roman best-seller de mariama bâ


• ce roman épistolaire a reçu le prix noma en 1981
• traduit en 20 langues, il est considéré comme un classiQue de la littérature féministe.
• publié en france aux éditions du rocher, il a été édité en plusieurs formats (motifs, poche)

• un roman étudié partout dans le monde, et régulièrement cité...
axelle jah njiké, la préfacière
Autrice afropéenne, podcastrice et militante féministe, Axelle Jah Njiké est l’autrice de lé série radiophonique «Je suis noire et je n’aime pas Beyoncé», dont le premier épisode est consacré à Mariama Bâ, (cf LSD, France Culture).

elke foltz, l’illustratrice (couverture)
Elke Foltz est une peintre française, née en 1990. Elle a des origines allemandes et sénégalaises. Elle vit et travaille à Berlin. Pour la couverture, elle a travaillé dans les tons ocres et rouges de la terre au Sénégal.
alexandra déglise, la comédienne
Comédienne et metteuse en scène basée en Martinique, Alexandra Déglise prête sa voix pour l’enregistrement d’extraits sonores d’Un chant écarlate, disponibles sur le site internet des Prouesses à la sortie du livre.

Un livre au cœur d’un écosystème créatif
Virgil Gheorghiu

Genre : roman
Format : 13 x 21 cm
Pages : 336
Préface de Thierry Gillyboeuf
Prix : 23 €
ISBN : 978-2-490251-73-5


Un seul livre, La 25e heure, paru en 1948, aura suffi à faire la célébrité de Virgil Gheorghiu. Né le 9 septembre 1916 à Războieni, dans le judeţ de Neamţ, Virgil Gheorghiu est l’aîné de six enfants d’un pope. À douze ans, ne pouvant aller au séminaire faute d’argent, il entre au lycée militaire de Chişinău, où il fait ses premières armes de poète, puis à la Faculté de Lettres et de Philosophie de Bucarest. Il publie plusieurs recueils de poésie, avant de devenir reporter de guerre à partir de 1941. Après l’invasion de la Roumanie par les troupes soviétiques, il choisit l’exil avec sa femme. Arrêté « automatiquement » par les autorités américaines, le couple est balloté de camp en camp pendant près de deux ans. Libérés « automatiquement », ils entrent clandestinement en France, avec le manuscrit de La 25e heure. Dès sa sortie, le livre rencontre un immense succès public et critique qui propulse Gheorghiu au premier rang des écrivains de l’immédiat après-guerre. Mais en 1952, une violente campagne est lancée contre lui par les Lettres françaises qui entachera durablement sa réputation, et nuira à la suite de sa carrière littéraire. Auteur d’une quarantaine d’ouvrages, dont une grande partie de romans, ainsi que quelques essais spirituels, Virgil Gheorghiu est ordonné prêtre de l’église orthodoxe roumaine à Paris, en 1963. En 1986, il entreprend la publication de ses Mémoires, qui devaient compter sept volumes. Après la chute du Mur de Berlin, il s’engage activement dans le combat qui mènera à la chute des Ceauşescu. Il meurt à Paris le 22 juin 1992.
Écrit en 1982, Dracula dans les Carpates est le dernier roman de Virgil Gheorghiu. Inédit en français, le manuscrit en a été retrouvé quinze ans après sa mort. Renouant avec la veine de ses grandes œuvres (La 25e heure, La Seconde Chance, Les Sacrifiés du Danube, La Cravache, etc.), Gheorghiu confronte une fois de plus la Roumanie de son enfance, une Roumanie à la fois traditionnelle et éternelle de petites gens, paysans pour la plupart, avec la violence de l’Histoire incarnée par le dernier envahisseur, l’empire soviétique. Avec un sens aigu de l’absurde kafkaïen de ce nouveau maître, Gheorghiu revient sur cette date fatidique de l’invasion russe qui fait suite à tant d’autres invasions depuis 2000 ans. Sans pour autant donner quitus aux empires concurrents, le Britannique notamment, incarné par cet Irlandais, Baldin Brendan, diplômé en vampirologie, venu dans les Carpates rechercher les traces de Dracula, Gheorghiu démonte, dans ce roman haletant et grinçant, la mécanique du totalitarisme avec sa bêtise mauvaise qu’appliquent subalternes et exécutants zélés, face aux valeurs ancestrales d’un peuple tétanisé, attaché à ses traditions, et face aux brigands, aux hors-la-loi, les haïdouks gardiens du sens, qui résistent ouvertement depuis leurs refuges montagnards. L’arbitraire règne, la rationalité n’a plus cours, la guerre des logiques contradictoires fait rage dans un climat de cocasserie et d’effroi. Avec ce roman d’une grande virtuosité, construit comme une tragédie grecque, Gheorghiu semble avoir plongé les haïdouks de son compatriote Panaït Istrati dans l’univers grotesque et inquiétant des grands romans d’Ismaïl Kadaré.
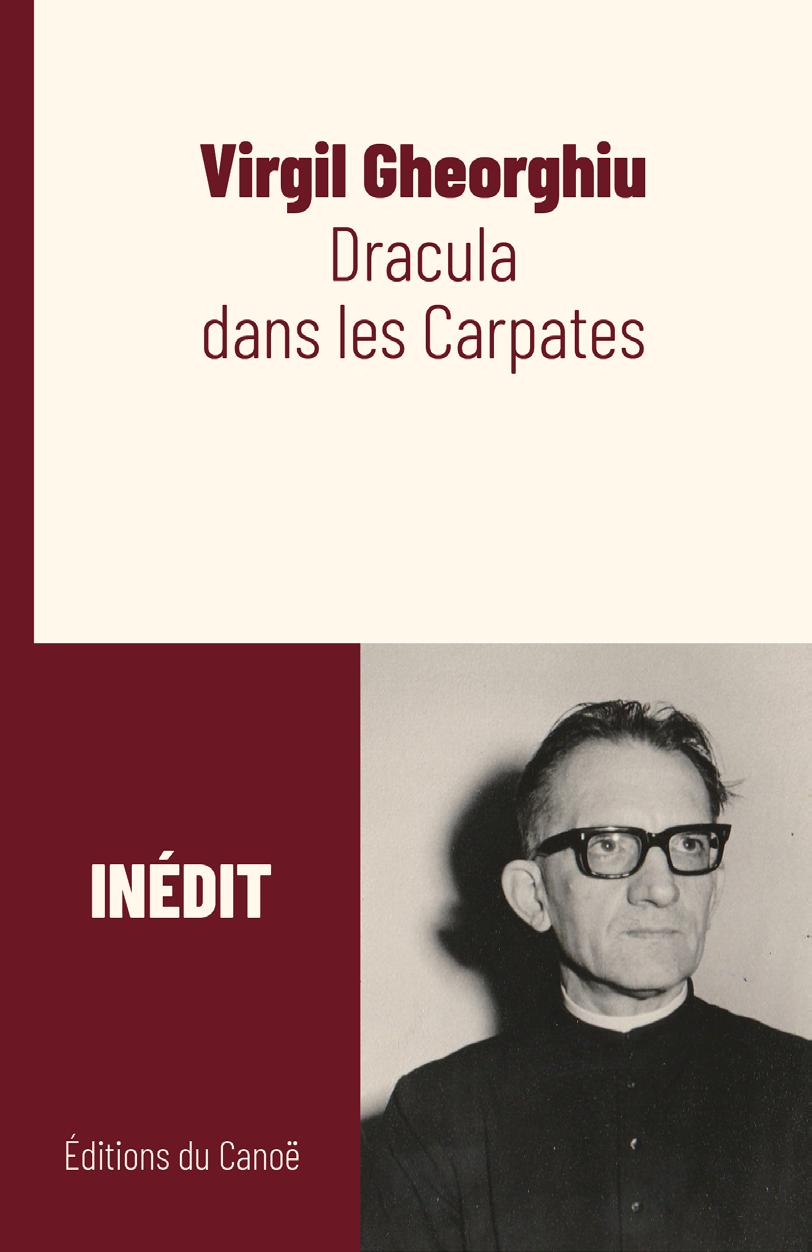
7 avril
Copyright : tous droits réservés.
Contact et libraires : colette.lambrichs@gmail.com Téléphone : 06 60 40 19 16 Diffusion et distribution : Paon diffusion.Serendip Éditions du Canoë 2023
Construit sous la forme d’un journal intime, les lecteurs et lectrices découvrent dans Vomir le témoignage d’un jeune homme ayant survécu à une prise mortelle de drogues, après une soirée ayant duré deux jours entiers. C’est au coeur des quelques semaines qui suivent cette expérience-limite qu’il nous plonge, coincés avec lui dans un lit d’hôpital. Les espaces du soin et de l’autodestruction se heurtent et deviennent le cadre propice à une réflexion à la fois poétique et politique sur l’individu contemporain et sa relation au monde. Le narrateur se confronte à son immobilité physique mais parvient à l’apprivoiser en usant de l’écriture comme technique de survie : réussir à en rire ; subir et découvrir son corps ; se confronter à sa solitude en mêlant des souvenirs intimes aux analyses cruelles d’un quotidien qui écrase. Il
y a dans ce texte de nombreux engagements et questionnements (sur la sexualité, l’amour, le capitalisme, le narcissisme, la violence) qui prennent la drogue comme prétexte (dans le sens où elle a conditionné ce qui a précédé le texte et les nombreux sujets qu’il aborde) et nous semblent représentatifs de nos temps incertains – représentatifs mais rarement dits, tant ils touchent un sentiment de dépossession commun, et comment faire face dans une volonté collective.
L’auteur:
Simon Arbez est né en 1995 et il est musicien. Il participe à de nombreux projets musicaux : films, studios, concerts. Vomir est son premier texte.
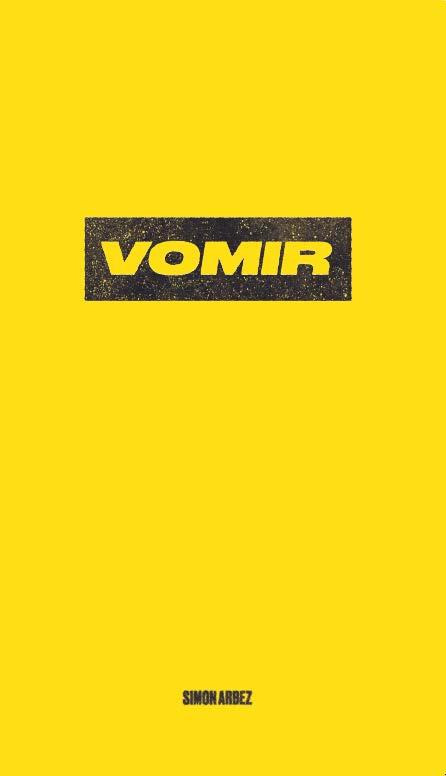
à paraître en septembre 2022
115 x 205 mm, 60 pages, 6€
Thèmes: témoignage, politique, drogue, hôpital
ISBN : 978-2-492352-09-6

Éditions le Sabot C ollection du seum VOMIR contact.lesabot@gmail.com le-sabot.fr 11 rue Gabriel Péri 59370 Mons-en-Baroeul +33 676249059
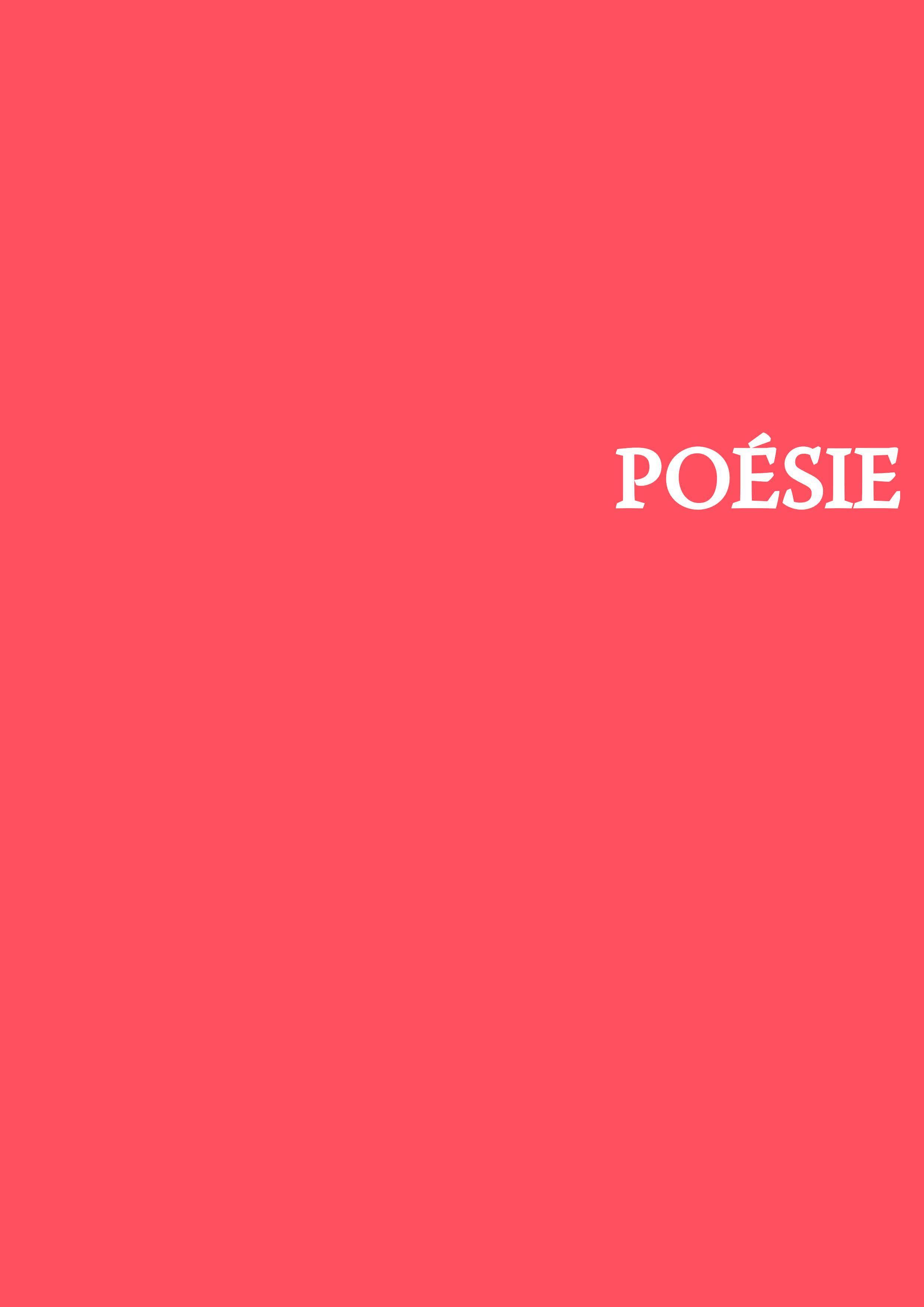
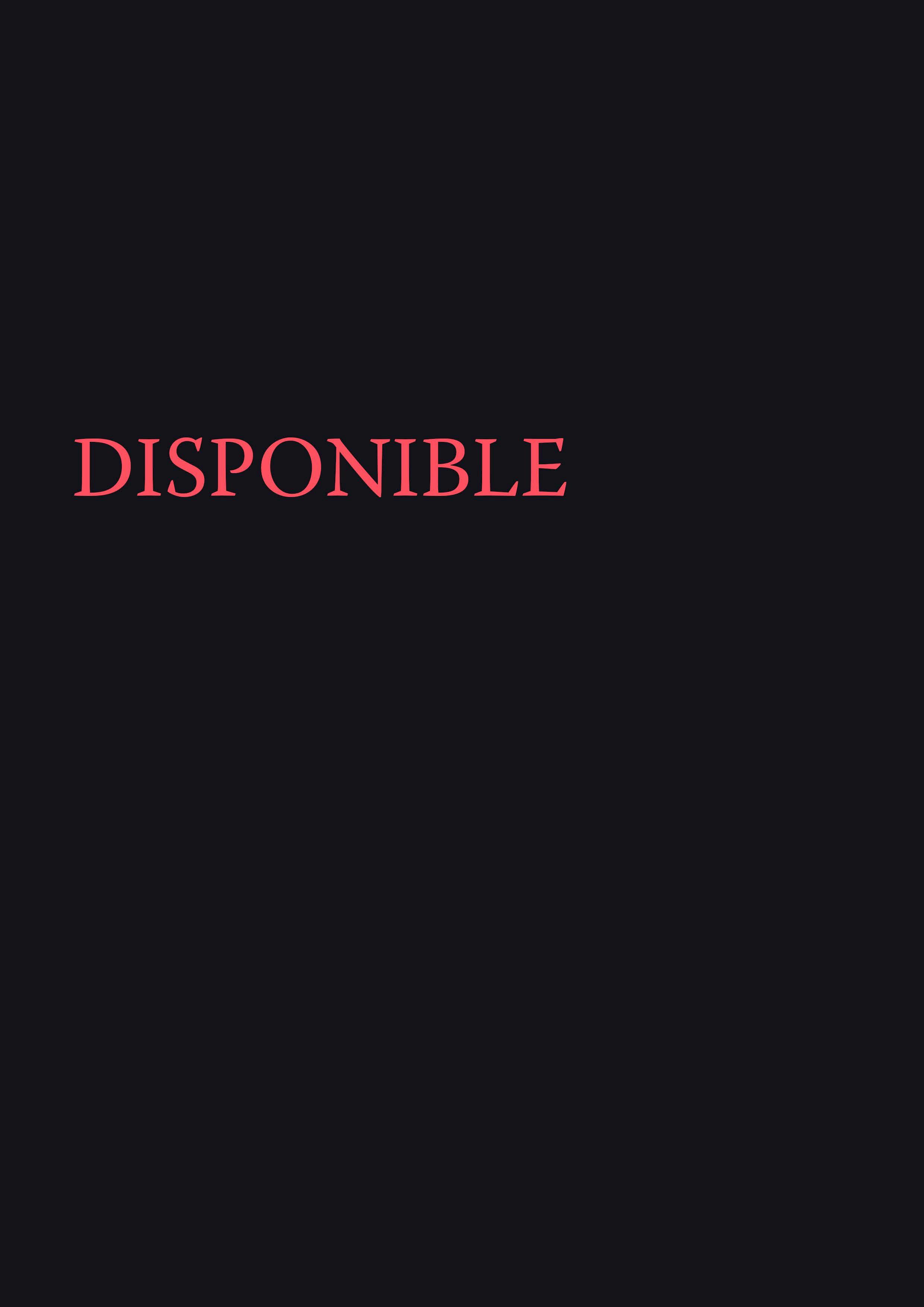
ÉRIC PESTY ÉDITEUR
Claude Royet-Journoud
La poésie entière est préposition, nouvelle édition augmentée reprend le volume publié en 2007 et réimprimé en 2009, du même auteur chez le même éditeur. Aux cinq chapitres de l’édition originale succède ainsi un entretien de Claude RoyetJournoud daté de 2008, et se conclut par un nouveau chapitre de notes : « joint / bord à bord / sans mortier », daté de 2021.
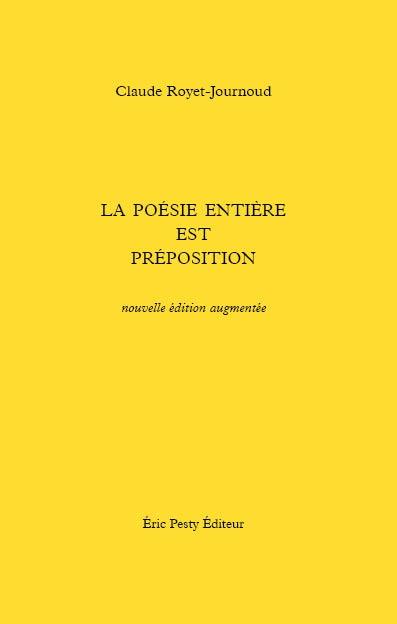
Cela dit, sous l’aspect d’une édition augmentée, c’est d’un renouvellement radical qu’il est question, tout comme les livres publiés chez P.O.L par Claude Royet-Journoud sont le renouvellement de la tétralogie parue chez Gallimard. Si en effet la première édition de La poésie entière est préposition annonçait la publication de Théorie des prépositions chez P.O.L (les deux livres ont paru à un mois d’intervalle en librairie), formant ainsi un contrepoint théorique au livre de création ; la nouvelle édition augmentée permet d’accompagner le travail le plus récent de Claude Royet-Journoud (La Finitude des corps simples, P.O.L 2016 ; L’usage et les attributs du coeur, P.O.L 2021).
Nous pouvons d’autant mieux affirmer ce renouvellement qu’Éric Pesty a consacré une thèse universitaire à la tétralogie parue chez Gallimard (sous la direction de Jean-Marie Gleize, soutenue en 2005) puis composé en typographie, lettre après lettre en caractères mobiles, le texte des nouveaux livres depuis la séquence intitulée « Kardia » (collection agrafée, 2009, épuisé –le texte est repris dans La Finitude des corps simples).
C’est pour accompagner ce mouvement que nous proposons cette nouvelle édition augmentée du seul ‘art poétique’ de Claude Royet-Journoud ; autrement dit, et pour employer son vocabulaire : le « système latéral » de son œuvre.
Né en 1941, Claude Royet-Journoud est l’auteur d’une tétralogie parue chez Gallimard : Le Renversement (1972), La notion d’obstacle (1978), Les objets contiennent l’infini (1983), Les natures indivisibles (1996).
Trois nouveaux livres ont paru ces 15 dernières années, chez P.O.L : Théorie des prépositions (2007), La Finitude des corps simples (2016), L’usage et les attributs du cœur (2021). La revue K.O.S.H.K.O.N.O.N.G. de Jean Daive a publié l’intégralité des séquences de l’écriture de Claude Royet-Journoud depuis 2012 et son numéro 1.
Parution : janvier 2024
Prix : 18 €
Pages : 96
Format : 14 x 22 cm
EAN : 9782917786864
Collection : brochée
Rayon : poésie contemporaine
CONTACT PRESSE ET LIBRAIRE
Éric Pesty : contact@ericpestyediteur.com
La poésie entière est préposition nouvelle édition augmentée
Remplacer l’image par le mot image.
ÉRIC PESTY ÉDITEUR
Roger Giroux
Journal d’un Poème (réimpression à l’identique)
Roger Giroux est né en 1925. Traducteur émérite de l’anglais (Lawrence Durrell, Henry Miller, Edna O’Brien, W. B. Yeats…), éditeur auprès de Marcel Duhamel à la « Série noire », il demeurera l’auteur de « un ou deux livres », comme il l’écrit à Pierre Rolland, un ami d’enfance, au tout début de sa carrière.
- L’arbre le temps, paru au Mercure de France, obtient le prix MaxJacob en 1964. (Le livre est réédité en 1979 augmenté de deux textes inédits au Mercure de France. En 2016, Éric Pesty Éditeur procure une troisième édition de L’arbre le temps qui restitue le format de l’originale de 1964.)
- Poème, livre resté inachevé à la mort de l’auteur, fut édité par Jean Daive au Théâtre Typographique en 2007.
A la mort de Roger Giroux en janvier 1974, Jean Daive découvre en effet deux textes dactylographiés (Lieu-Je et Lettre publiés pour la première fois à la suite de la réédition de L’arbre le temps au Mercure de France en 1979, et aujourd’hui également réédité par nos soins dans la collection agrafée), mais encore divers cahiers et carnets d’écriture, parmi lesquels se détache Journal d’un Poème. L’intuition majeure de Jean Daive est de reconnaître immédiatement dans Journal d’un Poème le négatif du livre en gestation au moment du décès de Roger Giroux, Poème, et qui en figure la prémonition.
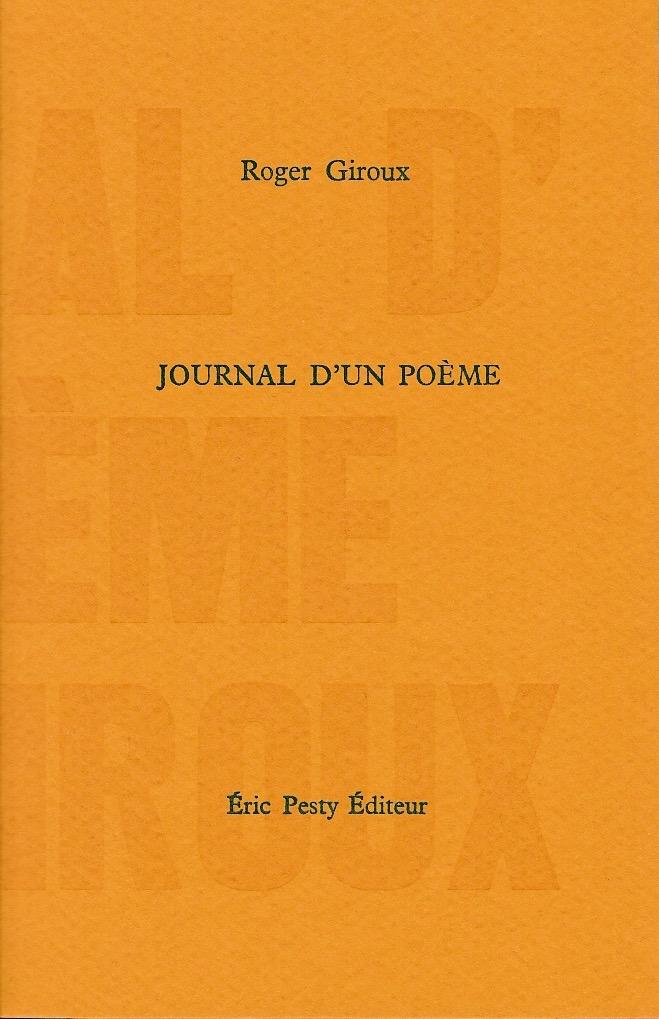
« Roger Giroux a toujours tenu un journal, parce qu’il aime regarder l’écriture en train de se faire. Les carnets intimes traitent de l’absence, de la présence, du rien et du silence, du non-être de l’esprit. Ils sont nombreux. L’écriture très particulière de Poème a suscité Journal d’un Poème, publié ici avec ses couleurs. Il est à part. Il progresse selon l’invention visuelle du poème, il en suit l’évolution, il accompagne les différentes phases de l’expérience, dévoile les enjeux de l’œuvre. C’est ainsi que Poème et Journal d’un Poème s’imbriquent parfaitement. Tout de Poème se retrouve différemment dans Journal d’un Poème. La différence est ce qui doit définir Poème et définir Journal. Car Roger Giroux a conscience que la langue n’a plus une vérité de sens (il la laisse encore volontiers au Journal), mais une vérité de signes, vérité qu’il veut inscrite, dessinée, graphique, théâtralisée, jouée dans l’espace du livre et de ses doubles pages. » (Extrait de la préface de Jean Daive.)
Edition et préface de Jean Daive (réimpression de l’édition de 2011 à l’identique)
Parution : décembre 2023
Prix : 28 €
Pages : 192
Format : 11 x 17 cm
EAN : 9782917786901
Collection : brochée
Rayon : poésie contemporaine
CONTACT PRESSE ET LIBRAIRE
Éric Pesty : contact@ericpestyediteur.com
« Le langage ainsi traité comme une foudre qui tombe est regard, capable d’atteindre l’oeil du lecteur non pour lire, mais pour voir. » (Jean Daive, préface)
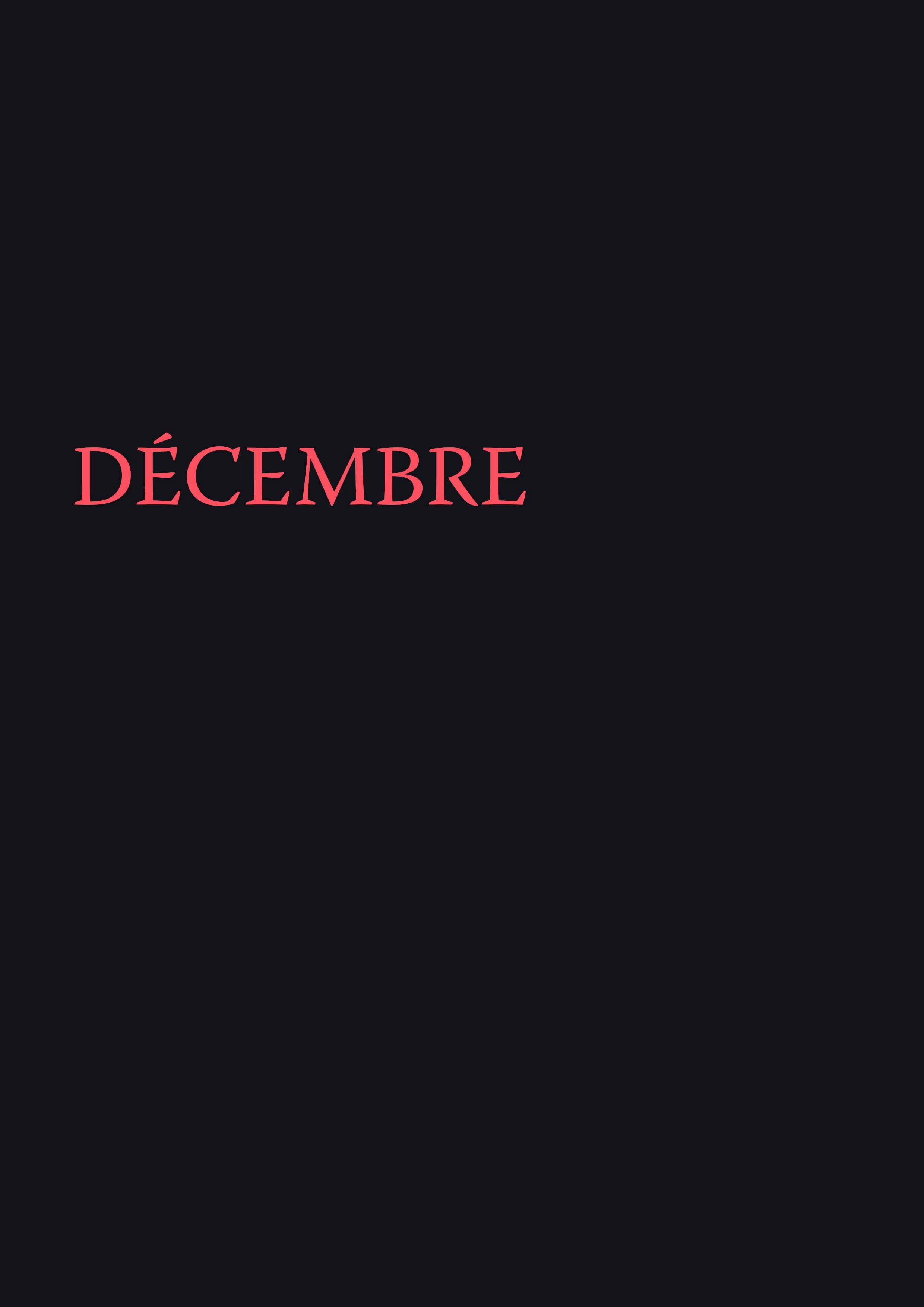
D’autres accidents de poèmes Les auteurs
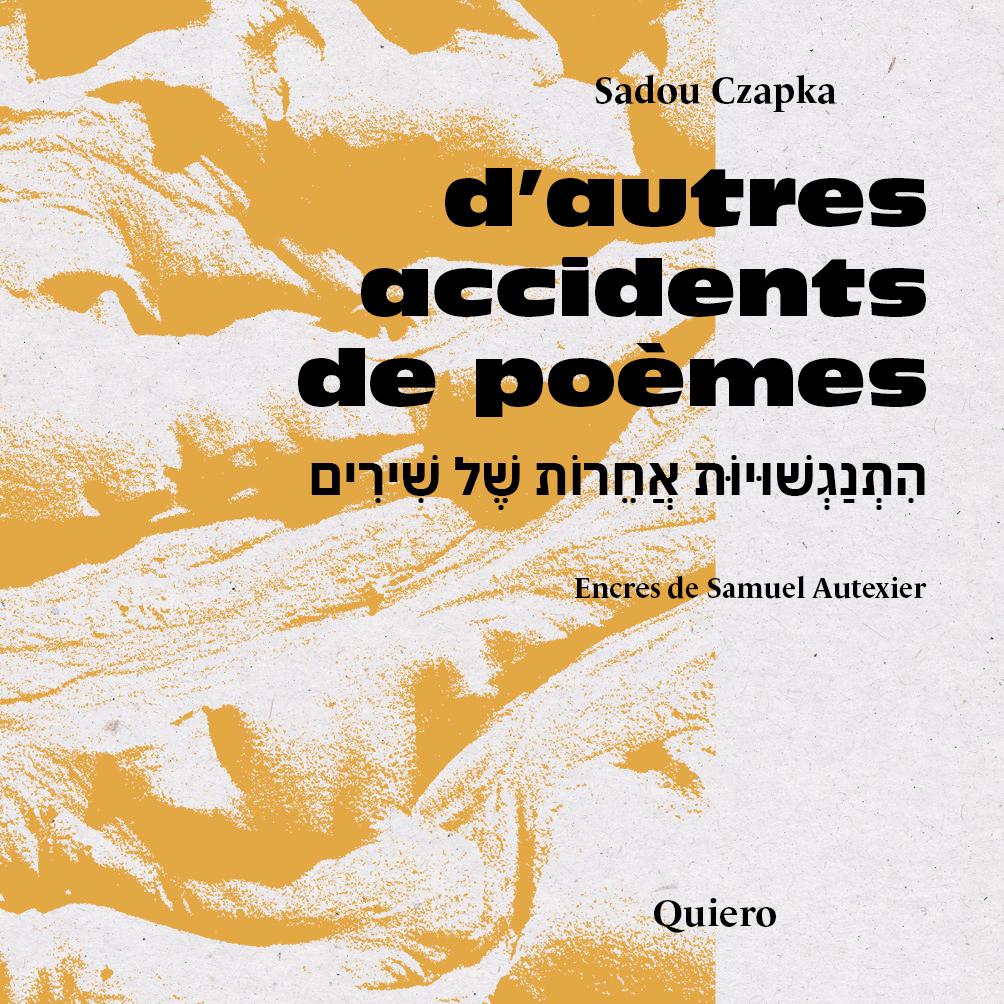
Un livre de 48 pages au format 17x17 cm. Impression typographique des pages intérieures et de la couverture avec des encres de Samuel Autexier
J’ai écrit ce texte court comme un socle venu tenir les quatre murs d’un travail poétique qui se situe dans le temps.
D’autres accidents de poèmes convoque un arrière-plan de ma pensée, une danse ancienne qui mélange les époques et les destins.
Ici, une fable étrange se déploie, qui fait appel aux symboles, à l’amnésie d’Alice, à l’enfance, aux multiples miroirs des histoires sans fin.

Le texte se partage en trois, comme trois faces d’un même objet, sa structure serrée accentue et creuse en répétant, sorte de ritournelle qui étire son mystère.
Ce poème ouvre sur des paysages en creux dont l’écho, je le souhaite, interroge.
Parution : octobre 2023
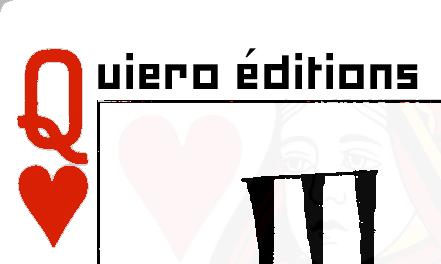
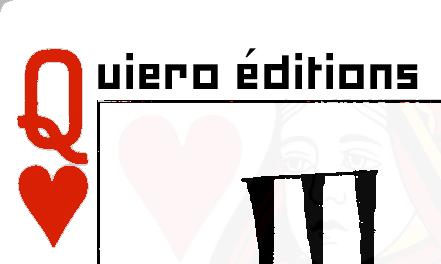
EAN : 9782914363266
Prix public : 25 €

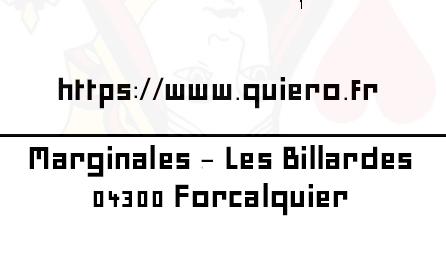
Publié avec le soutien de la Région Sud
Réalisé entièrement en typographie mobile avec des encres de Samuel Autexier, le livre tente de suivre les méandres et les fulgurances de ce texte qui explore depuis la forêt des ogres et jusqu’aux murs du désert les territoires de la séparation.
Sadou Czapka (née en 1978 à Lus-laCroix-Haute dans la Drôme).
Enfant unique de Ann et San Czapka (fondateurs de la compagnie de théâtre « Le Matin calme » dans le Var), elle commence à écrire des poèmes dès son plus jeune âge.
Son premier recueil est publié aux éditions Atelier de l’Agneau en 2000, elle reçoit en 2002 une bourse d’écriture du Centre national du livre pour le second publié en 2003 chez le même éditeur.

Elle travaille ensuite pour la compagnie de danse contemporaine Témoi à Reillanne puis comme libraire à la librairie Regain qu’elle reprend sous forme associative de 2018 à 2021. Elle mène des ateliers d’écriture depuis 2010 qui débouchent parfois sur l’édition de livre collectif.




Parutions : Les Oiseaux Conquis, Atelier de l’agneau, 2000 ; Dédales d’aubes, avec des gravures d’Agathe Larpent, Atelier de l’agneau, 2003 ; Solstice, Rafaël de Surtis, 2008 ; La Ravine, Rafaël de Surtis, 2021
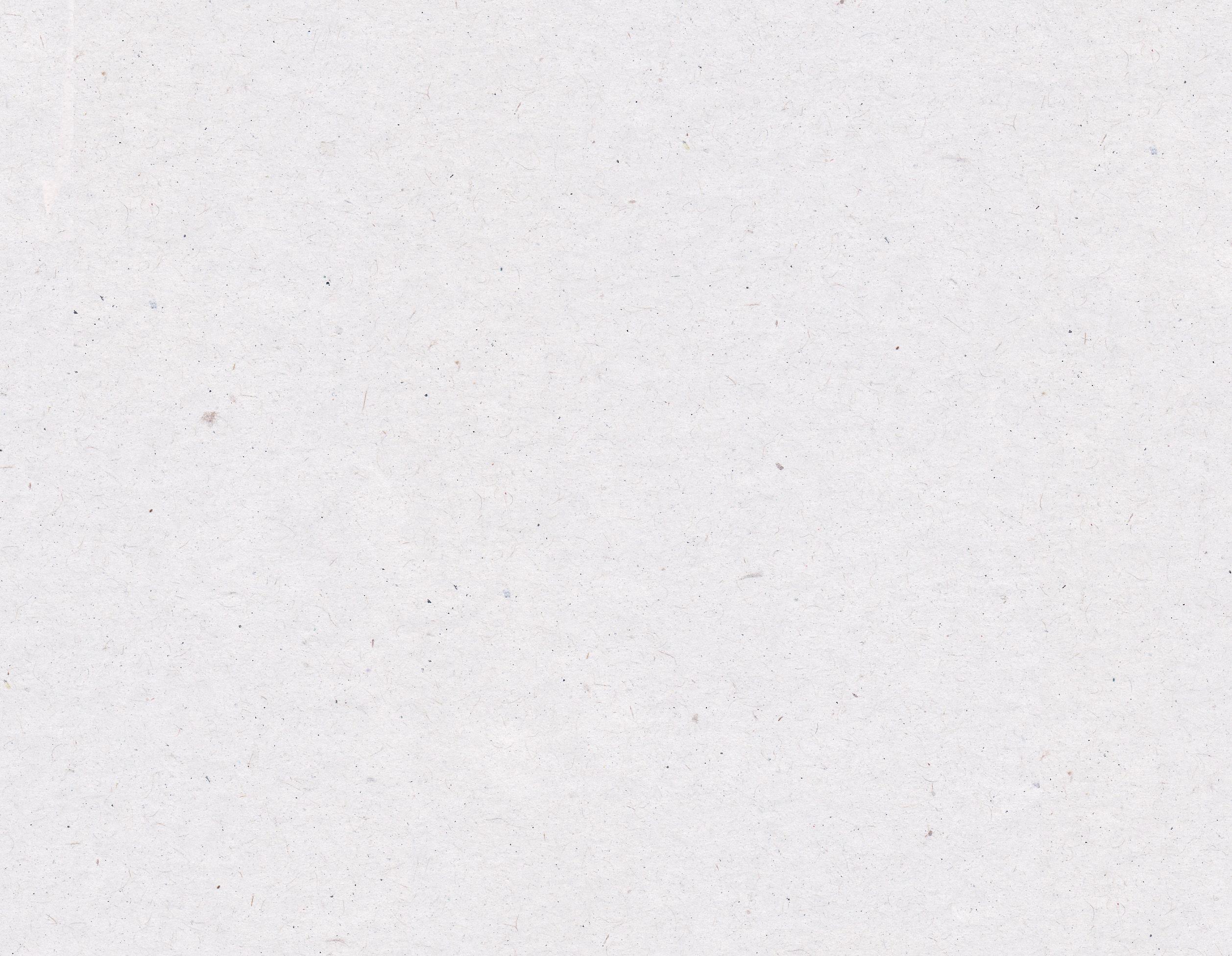
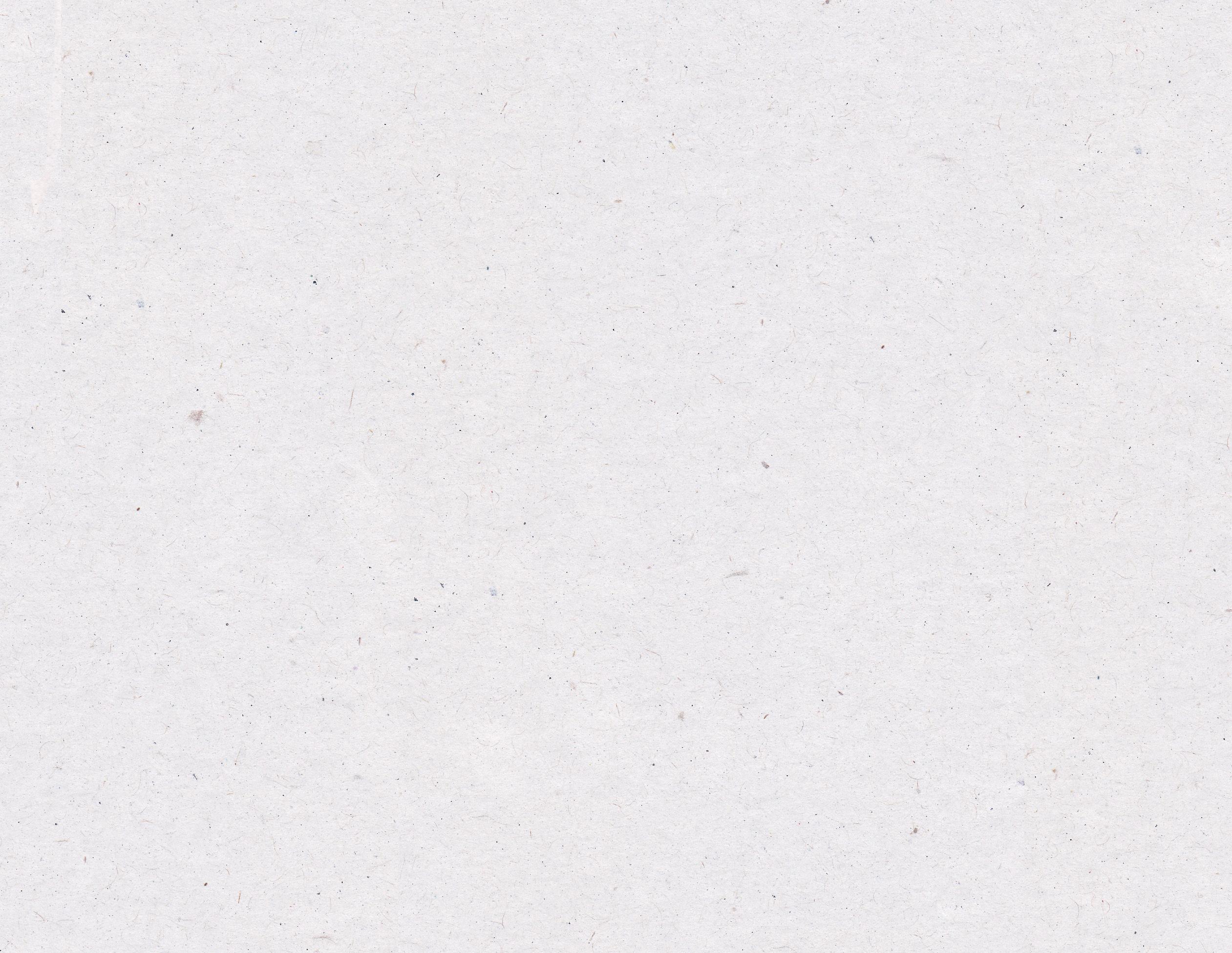
À la fin tout le monde tourne, tourne, tourne, et jette les dés.
Je ne vois plus ta présence, je veux dire...
je ne sens plus ton absence, comme un jour de grisaille, Comme le pain des pauvres, comme un peuple à bout de souffle.
Le monde tourne, tourne, et tourne.

Samuel Autexier (né en 1969 en Suisse). Il cherche d’abord à être peintre avant de devenir éditeur et typographe pour accompagner la parole des ami·es peintres & poètes.
 Encre préparatoire, composition en cours d’impression dans l’atelier et portrait de Sadou Czapka par Samuel Autexier.
Encre préparatoire, composition en cours d’impression dans l’atelier et portrait de Sadou Czapka par Samuel Autexier.
« En traversant ma nuit noire, j’ai blessé le passé. »

Une sorte de lumière spéciale
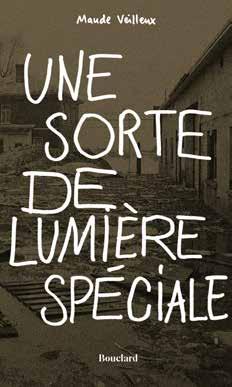
Peut-on s’extraire du terreau natal ? Le veut-on ?
« La Beauce est belle, mais les maisons sont en plastique. Les voitures rouillées. Les passe-temps dangereux. » Tout n’est que contradictions et luttes internes et même intestines chez Maude Veilleux. Seul demeure l’écriture, la colère et l’envie de comprendre.
L’autrice : Maude Veilleux
Maude Veilleux est une poète et performeuse québécoise née à Saint-Victor-de-Beauce. Elle a écrit des recueils de poésie, des romans dont un roman-web. Au fil des années, ses textes sont aussi parus dans diverses revues au Québec, en France et en Belgique. Elle développe plus particulièrement une pratique aux frontières de l’écriture, la littérature numérique et la performance. Depuis 2020, elle s’intéresse, avec le collectif Botes Club, aux robotEs et aux intelligences artificielles. Elle vit et travaille à Montréal. Chez Bouclard, elle a publié « Mettre des bombes rire nerveux » dans le deuxième numéro de notre revue.

Recensions presse
Le Devoir
« “Est-ce que les questions entourant la lutte des classes sont encore d’actualité ?”, demande Maude Veilleux dans ce recueil bouleversant et essoufflant, au cœur duquel ses déceptions et son espoir s’entrechoquent sans cesse. Une œuvre profondément politique de culpabilité, de révolte, d’abattement et d’empathie. »
La Presse
« La douleur des transfuges sociaux est au cœur de ce livre puissant qui donne envie de remercier la Beauce de nous avoir donné Maude Veilleux, parmi les poètes les plus en vue de sa génération. »
Bouclard éditions 7 rue de la Gagnerie 44830 Bouaye contact@bouclard-editions.fr 07 86 66 76 18 www.bouclard-editions.fr Collection 109, parution janvier 2024 © ?????
Une sorte de lumière spéciale — Maude Veilleux
on me
de
que ma jeunesse à servir de la bière à des monsieurs cassés en deux par la vie que mon expérience du réel ne vaut rien of course que ça ne vaut rien of course que je suis trash je m’appelle maude veilleux veilleux veilleux ma mère veilleux mon père »
Fiche technique
Format : 92 pages, 12 × 20 cm
Tirage : 1000 exemplaires
Prix de vente : 13 €
Diffusion : Serendip
ISBN : 978-2-493311-10-8
Première parution : 2019, Les Éditions de l’Écrou (Canada)
Ce livre reçoit le soutien du CNL et de la Région des Pays de la Loire.
109 pour le youngblood, le sang neuf.
109 pour la Génération Y, la Génération youngblood.
Une collection qui défriche une nouvelle génération de jeunes romanciers/cières.
Une collection de petits formats accessibles. Sans contrainte de genre et de style.
« quand on me dit que je suis trop trash
dit que mon trop peu de capital culturel que mes manières
fille de la beauce
Collection 109, parution janvier 2024 Bouclard éditions 7 rue de la Gagnerie 44830 Bouaye contact@bouclard-editions.fr 07 86 66 76 18 www.bouclard-editions.fr
109
Last call les murènes

Rupture, ennui, solitude, colère, espoirs déçus et rêve en attente. La vie, juste ça… Celle d’une fille de la Beauce, quelque part dans le Québec des rednecks, des gros chars et de l’alcool. Une vie simple, pas si simple.
L’autrice : Maude Veilleux
Maude Veilleux est une poète et performeuse québécoise née à Saint-Victor-de-Beauce. Elle a écrit des recueils de poésie, des romans dont un roman-web. Au fil des années, ses textes sont aussi parus dans diverses revues au Québec, en France et en Belgique. Elle développe plus particulièrement une pratique aux frontières de l’écriture, la littérature numérique et la performance. Depuis 2020, elle s’intéresse, avec le collectif Botes Club, aux robotEs et aux intelligences artificielles. Elle vit et travaille à Montréal. Chez Bouclard, elle a publié « Mettre des bombes rire nerveux » dans le deuxième numéro de notre revue.

Recensions presse
Le Devoir
« “Est-ce que les questions entourant la lutte des classes sont encore d’actualité ?”, demande Maude Veilleux dans ce recueil bouleversant et essoufflant, au cœur duquel ses déceptions et son espoir s’entrechoquent sans cesse. Une œuvre profondément politique de culpabilité, de révolte, d’abattement et d’empathie. »
La Presse
« La douleur des transfuges sociaux est au cœur de ce livre puissant qui donne envie de remercier la Beauce de nous avoir donné Maude Veilleux, parmi les poètes les plus en vue de sa génération. »
Bouclard éditions 7 rue de la Gagnerie 44830 Bouaye contact@bouclard-editions.fr 07 86 66 76 18 www.bouclard-editions.fr Collection 109, parution janvier 2024 © DR
Last call les murènes — Maude Veilleux
« 3 h 40 du matin en beauce
j’écoute radio-can sur le télé le channel de venus angel sur mon ordinateur et je me magasine des followers sur instagram me garder occupée pour chasser les fantômes hier, j’ai trouvé un boutte de papier collant dans mon vagin le flow est un état mental que les anxieux ne vivent pas full je ne suis plus autant déprimée qu’avant noël
lorsque je pesais 112 livres
mais engraisser me fait capoter dites-moi mon vagin est-il lousse ? »
Fiche technique
Format : 76 pages, 12 × 20 cm
Tirage : 1000 exemplaires
Prix de vente : 13 €
Diffusion : Serendip
ISBN : 978-2-493311-09-2
Première parution : 2016, Les Éditions de l’Écrou (Canada)
Ce livre reçoit le soutien du CNL et de la Région des Pays de la Loire.
109 pour le youngblood, le sang neuf.
109 pour la Génération Y, la Génération youngblood.
Une collection qui défriche une nouvelle génération de jeunes romanciers/cières.
Une collection de petits formats accessibles. Sans contrainte de genre et de style.
Collection 109, parution mai 2023 Bouclard éditions 7 rue de la Gagnerie 44830 Bouaye contact@bouclard-editions.fr 07 86 66 76 18 www.bouclard-editions.fr 109
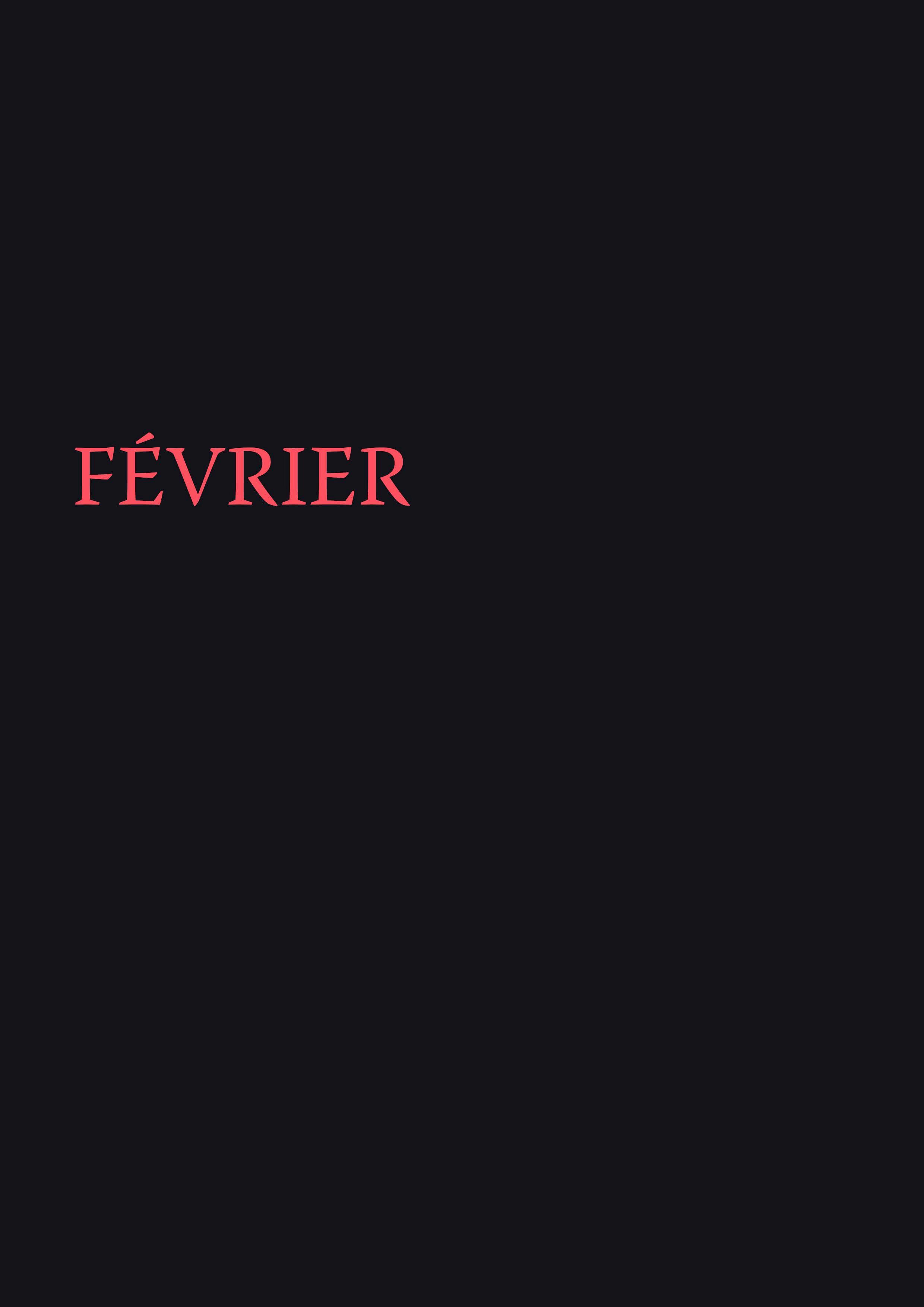
ÉRIC PESTY ÉDITEUR
Michel Falempin
Funérailles
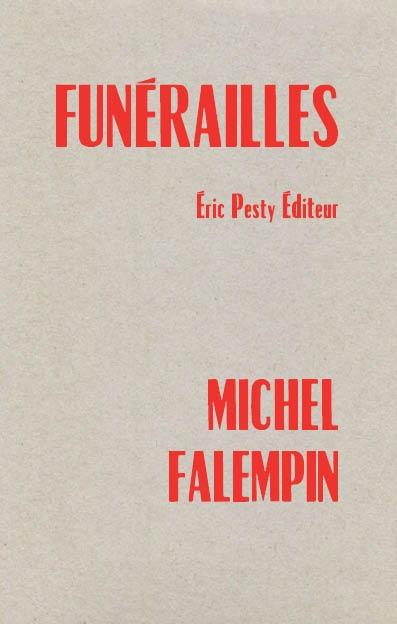
« un jour, dans les parages d’un simple tas de débris végétaux, émergea l’ombre solitaire d’un jeune homme, je l’entraperçus : ce qu’elle faisait, dans cette partie à l’abandon du sanctuaire où elle cachait son vice, j’hésite à en faire part, mais tant pis : cette ombre lisait ! / Faulkner ? Sans vergogne, je l’aurais juré. »
Funérailles s’ouvre sur un pastiche du roman de Faulkner intitulé Sanctuaire : une description en négatif et en pied de l’héroïne prénommée Temple, à laquelle fera écho une seconde description de jeunes femmes, plus proches de la Temple originale, à la toute fin de ce texte bref.
Le narrateur (je) se rend au cimetière du Kremlin-Bicêtre (le « sanctuaire ») pour accomplir ses devoirs filiaux et croise tour à tour deux cortèges funéraires : l’un accompagnant l’enterrement d’une jeune femme sans doute prostituée ; l’autre accompagnant l’enterrement d’une haute dignitaire communiste russe. La rencontre incongrue de ces deux cortèges amène à la chute du récit – littéralement en fait de chute : au sortir du cimetière le narrateur se tord la cheville et réussit à se rétablir in extremis provoquant la moquerie (mélange de gaieté et d’insolence) de trois jeunes femmes apparues : « Vous avez manqué tomber, Monsieur, je vous ai vu, je vous ai vu. » Le narrateur de conclure, rappelant les deux cortèges rencontrés : « c’est pour moi comme si cette gaieté, cette insolence, lançaient sur l’Amour [représenté par la prostituée mise en bière] et sur la Cité Juste [la haute dignitaire communiste] une ultime et insouciante pelletée de terre ».
Michel Falempin est né en 1945. Il est retraité de ses emplois de bibliothécaire à la bnF et conservateur à la Bpi, centre Pompidou.
Il est l’auteur d’une œuvre discrète mais reconnue, puisque son écriture rencontre, depuis sa première publication en 1976, successivement des maisons d’édition prestigieuses comme la collection « Digraphe » et la collection « Textes » chez Flammarion, la collection « Littérature » à l’Imprimerie Nationale, les édition Ivrea.
En 2019, nous publiions en co-édition avec Héros-Limite : Affaire de genres et autre Pièces de fantaisies – regrougant les Pièces de fantaisie n°15, 10, 5, 3 et 14.
Funérailles est la vingt-quatrième pièce de cet ensemble.
(COUVERTURE PROVISOIRE)
Parution : février 2024
Prix : 10 €
Pages : 16
Format : 14 x 22 cm
EAN : 978-2-917786-88-8
Collection : agrafée
Rayon : Poésie
CONTACT PRESSE ET LIBRAIRE
Éric Pesty : contact@ericpestyediteur.com
Voici un personnage littéraire. Mais aussitôt choisi, il faut le reconnaître : cette jeune femme ne porte pas, flanqué sur son bras (à la diable, précise l’original), un manteau. Ses jambes ne sont pas longues, ça non, mais robustes, écartées de surcroît et puis découvertes plus qu’en partie. Une hâte fébrile ne les agite pas ; elle est assise, placide, prenant sur le sol (ciment) un appui qui paraît ferme. Il est clair, avec cela, que sa silhouette courtaude ne se profile pas en coup de vent et pas question non plus qu’elle s’évanouisse dans l’ombre : le côté de l’avenue où elle se tient est implacable, ce jourlà, quant au soleil (l’ombre est en face, il faut traverser l’avenue, ce n’est pas sans l’observation d’un certain nombre de règles, ce sera pour plus tard). De la jupe minimale et noire ne déborde aucun dessous féminin. Elle n’est pas poudrée : enfarinée, plutôt. Sa face, tragique (théâtrale), artificiellement crayeuse, est endeuillée : sourcils refaits charbonneux, bouche noire, les ongles aussi, mais, je note, écaillés. La tête d’une messagère qui n’apporte pas une bonne nouvelle. Point
1
de jeux de lumière dans une chevelure légèrement rousse dont les boucles pendraient : la touffe volumineuse a connu l’eau oxygénée. Néanmoins, pour n’importe qui passe, il y a bien une vision de flanc et de cuisse mais qui n’a rien de fugitive : elle insiste, presque elle provoque. Puisque l’original ne dit rien du buste, je précise : décolleté, pas en vain. Surtout, rien ne permet d’avancer qu’elle s’appelle Temple. Pourtant, elle a déjà, alors qu’elle est assise, qu’elle paraît attendre, placé dans son giron, quelque chose : un épi de maïs. Manquent quelques grains grillés qu’elle a dû mordiller avant de le nicher en haut de sa jupe noire, là où le chemisier en partie déboutonné, déborde sur le haut du ventre replet. C’est seulement à cause de la place de cette céréale, qu’un passant, qui a lu, pense à Faulkner. Nous sommes à l’endroit où le côté ensoleillé de l’avenue (comme s’intitule à peu près une célèbre chanson américaine) donne sur une brève allée qui emprunte son nom à sa destination : elle est dite « du cimetière ». Deux comparses s’approchent de la terrasse où se tient ce personnage littéraire devant un gobelet de carton duquel émerge la paille coudée et l’accostent.
Antoine Hummel Le Club
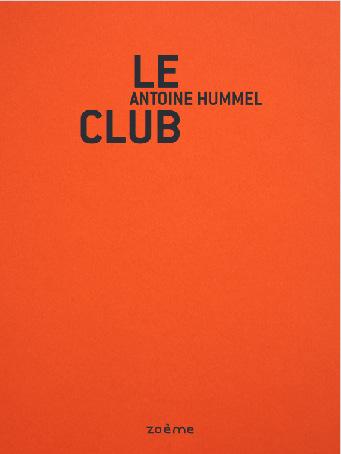
13,50 x 18 cm
96 pages 978-2-493242-????
15 € 2 février 2024
Dans la tradition de la poésie réflexive, Le Club d’Antoine Hummel tente de cerner ses propres conditions de possibilité. La singularité du livre, il faudrait la situer dans son mode d’énonciation. Qui parle dans le club ? « Le club existe / depuis que s’est constituée / en club une ancienne association de / personnes physiques isolées », lit-on dès la deuxième page. La langue semble mimer, voire parodier, la prose administrative, par exemple celle qu’on trouve dans les statuts ou les comptes rendus d’assemblée d’un club. Plutôt que l’auteur (Antoine Hummel), ce serait le club lui-même qui parle en tant qu’agencement collectif d’énonciation (Deleuze et Guattari), traquant au fil des pages l’histoire de sa propre constitution.
Mais si Le Club contient son principe de clôture, et de compréhension, ce n’est pas pour autant un texte fermé ou hermétique (le livre s’ouvre avec une « Bienvenue au club », et le club lui-même se reconnaît des jumeaux : des clubs anglais, allemands, italiens, etc). Rien n’est caché, et la parole du club décrit précisément, et avec logique, ce qui le sépare du monde, à savoir : sa propre constitution en tant que personne morale douée de parole.
Livre mélancolique, qui n’est pas sans évoquer Jules Laforgue et Fernando Pessoa, Le club est un événement de pur langage, pétition de principe dont on peine à reconnaître ou imaginer quelque effet dans le monde. Des ritournelles sont inventées (des « devises »), ainsi que des procédures (la « Journalière », les « 7 rôles tournants ») dont le rappel, jusqu’à l’absurde, n’atteste que de la solitude irrémédiable des « personnes physiques isolées » qui constituent le club. Cette « procéduriarité » lancinante ressemble au symptôme de son angoisse identitaire : solidement attaché à un temps circulaire, celui de ses rituels et protocoles, le club ne paraît relié au temps linéaire, celui de l’Histoire, que par une date unique, une date-label aussi suspecte ici que sur les étiquettes de bière industrielle : « depuis 1984 ».
Antoine Hummel est l’auteur de textes publiés dans de nombreuses revues de poésie, même si la plupart de ses textes sont écrits pour et publiés sur le web. En 2020 paraît son premier livre : Est-ce qu’il se passe quelque chose ? (8-clos, chez Eric Pesty Editeur). Il est l’auteur d’une thèse sur la « déspécialisation » de la poésie, et traduit également depuis l’anglais : Lettres révolutionnaires, de Diane di Prima, Zoème 2023).

*
De là regarde l’indigne mémoire de toute journée à laquelle il fut simplement assisté sans laisser d’affecter le club depuis l’intérieur des membres et pas la contrée de leurs instants. Ils savent bien à titre affectif que le jour n’a pas d’autre promesse que d’avoir un cours et une fin.
Les Journalières du club ambitionnent de parvenir à leur terme par une méthode objective de dramatisation qui réclame d’assigner aux membres au début de chaque Journalière
7 rôles tournants qui seront assumés tout au long de la Journalière. Parmi eux le Brise-Jet a pour fonction de couper court à la violence ou la forme des débats pour éviter les projections. Il en est de plus ou moins ajustés.
Mais trêve de discours. Un poème didactique de 1984 longtemps visible au fronton du club n’a jamais semblé cesser d’être en mesure de dire le club dans son essence la plus intime et la plus commune à la fois :
Et la Journalière s’ouvre sans présage.
C’est la journée à sa porte frappée propitiatoirement mais sans y investir partant que l’espoir placé en elle est sans appartenance. Qui espère dans la journée assiste interdit au déploiement des virtualités d’une aube selon une ligne printanière. La journée en laquelle il est espéré s’évanouit dans l’inaction.
ÉRIC PESTY ÉDITEUR
Antoine Hummel
Est-ce qu’il se passe quelque chose ? est un livre d’ondes, de signaux reçus et transcrits jour après jour. Entre le début du mois de mars et la fin du mois de mai 2020, depuis le boulevard de la Libération à Marseille, l’auteur s’est branché sur les discours ambiants, captant, copiant, mélangeant ce que des amis, des gouvernants, des prophètes, des philosophes, des marchands nous disaient, en direct ou en différé, de la période – qu’on l’appelle crise sanitaire, confinement, guerre ou vacance. Outre ces captations, le livre est traversé par deux récits : celui d’une comtesse dans un EPHAD qui demande chaque jour à la même heure s’il se passe quelque chose, et celui de l’auteur qui, alors qu’il se fait manipuler par un ostéopathe, se trouve contraint d’écouter les vues générales de celui-ci sur l’espèce humaine.
Mais Est-ce qu’il se passe quelque chose ?, s’il est bien un livre d’ondes, évoque peut-être davantage le micro-ondes que la radio de Jack Spicer (« Nous ne serons jamais que des postes à galène. » Trois leçons de poétique, trad. Bernard Rival, Théâtre Typrographique, 2013). C’est une question de fréquence : les discours reçus par l’auteur, d’origine et de fortunes diverses, sont concentrés, accélérés, recuits à grande vitesse jusqu’à confusion. Et la chaleur du livre est probablement l’acuité de sa critique, qui confond ceux qui s’occupent à « faire le rationnel ».
Auteur
Antoine Hummel est un poète et performeur né en 1984. Il vit et travaille à Marseille. Est-ce qu’il se passe quelque chose ? est son premier livre.
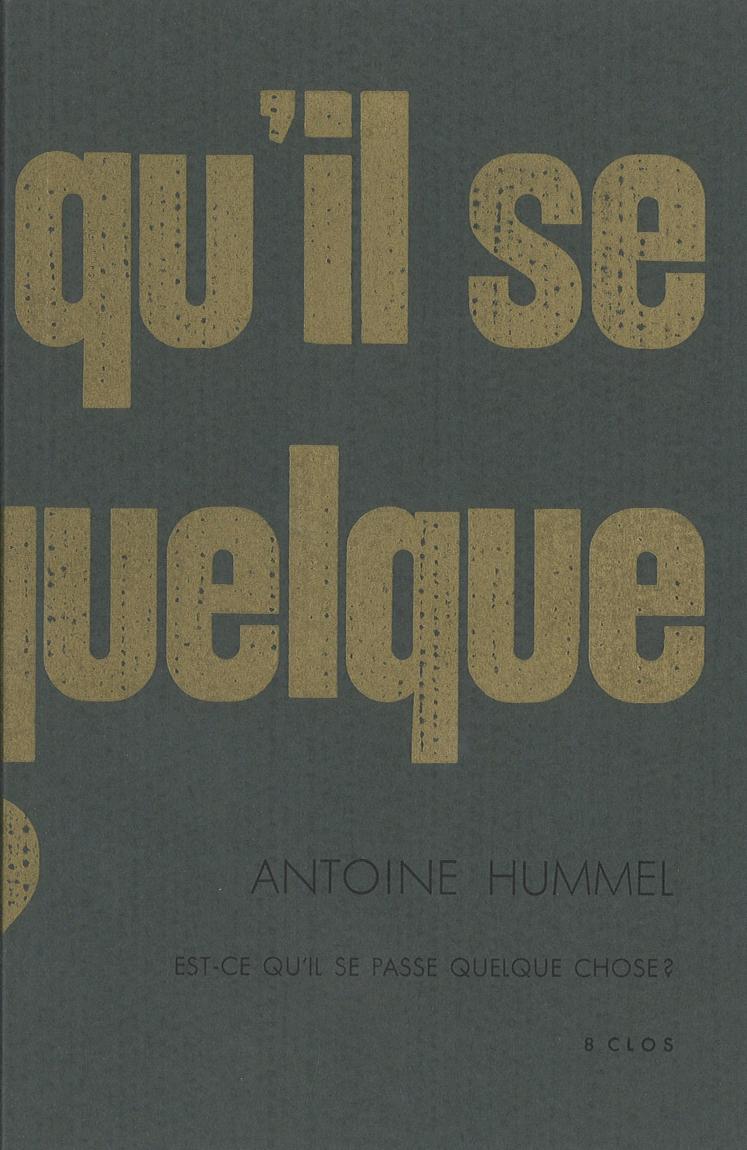
Parution : 2020
Prix : 10 €
Pages : 104
Format : 13x20
EAN : 9782957334001
Collection : 8 clos
Rayon : poésie contemporaine
CONTACT PRESSE ET LIBRAIRE
Éric Pesty : contact@ericpestyediteur.com
Est-ce qu’il se passe quelque chose ?
« Faites ce qu’il y a à faire et tout se passera rien. »

Jean Pérol Mars
Genre : poèmes
Format : 12 x 18,5 cm
Pages : 128
Prix : 15 €
ISBN : 978-2-490251-86-5


Jean Pérol naît en 1932. Après ses études supérieures, et une dizaine d’années de travail, il décide, las des querelles idéologiques françaises, de quitter la France. Il vécut à l’étranger de 1961 à 1989, au Japon (qui devint pour lui comme une seconde patrie), en Afghanistan et aux États-Unis, pays dans lesquels il a rempli diverses fonctions de professeur, d’attaché culturel, de directeur de l’Institut francojaponais de Fukuoka, puis de Tokyo. Il a collaboré, de 1968 à 1994, à la N.R.F., aux Lettres françaises et au Magazine littéraire. Il a publié plus d’une vingtaine de livres de poésie et de romans, notamment chez Gallimard et à La Différence, qui lui valurent entre autres l’obtention du prix Mallarmé en 1988 et du prix Max Jacob en 2004.
Le vieil air du monde, une fois joue l’air des malédictions qui toujours recommencent et au fond de l’homme s’acharnent, une autre celui des regrets et des nostalgies pour quelques complicités avec les splendeurs et les bonheurs qui s’effacent, ou pire, qu’un autre temps devenu fou s’entête à effacer.
Pour Jean Pérol, une fois de plus, le problème en poésie reste le même : le tout est de tout dire. Dans un complot vicieux qui ôte les sujets de la bouche, au cœur d’un monde qui ne rêve que de faire disparaître la poésie, ne pas se laisser faire reste le mot, et peu importe ce qu’en disent ceux qui, au fond, l’ont de tout temps niée et reniée.

Pérol reste un poète fidèle à ses fidélités, à une langue qui sache encore se tenir et partager, aux rythmes souterrains et aux traditions qui fondent la poésie française. Il se place, oui, assez loin d’une poésie-grenouille qui rêve de se faire plus importante que le bœuf philosophique. Assez loin aussi de la descendance mallarméenne et formaliste qui, par ses errances les plus égoïstes, est allée s’enfermer dans des hermétismes esthétiques squelettiques qui ont aussi peu ou prou contribué à la mort contemporaine de la poésie. Alors une fois de plus, Jean Pérol, dans ce nouveau recueil, se trouve confronté au réel des hommes et de la poésie du présent et, si possible, dans une transparence qu’il veut à la fois exigeante et fraternelle.
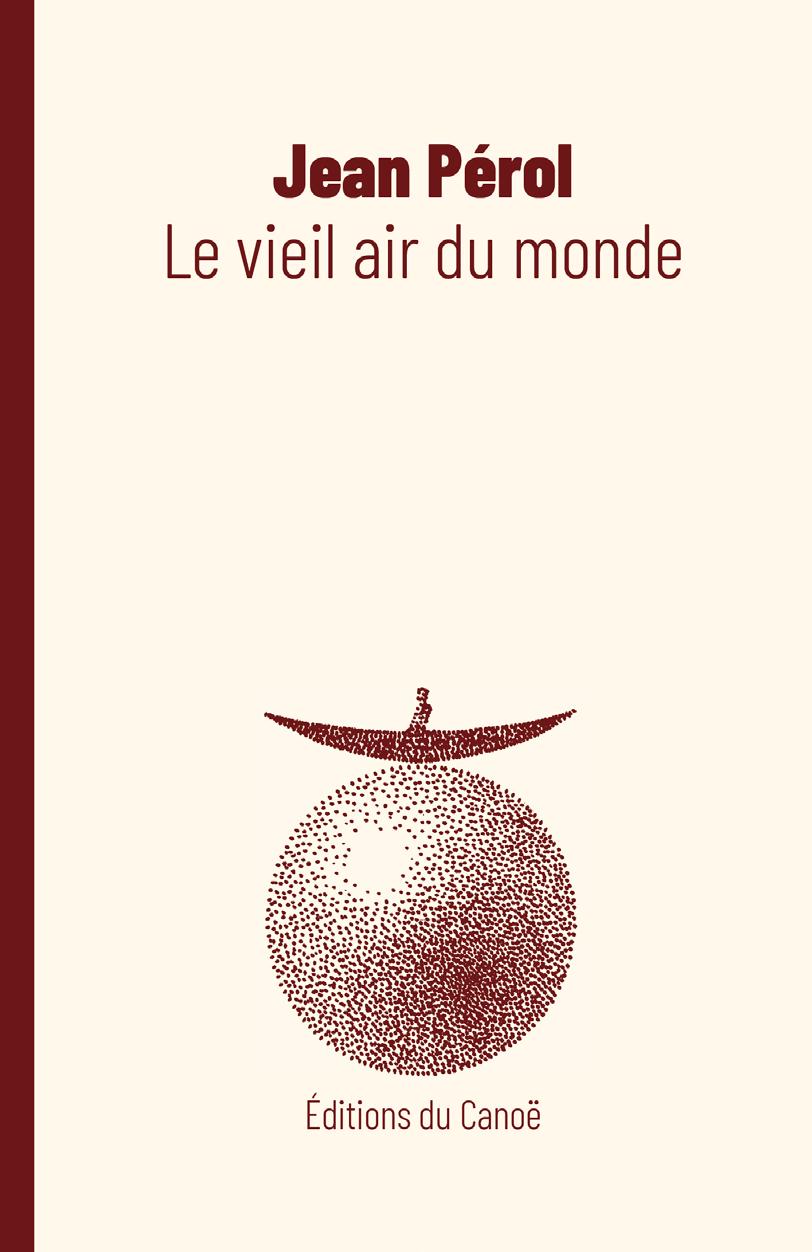
Éditions du Canoë 2024 Contact : colette.lambrichs@gmail.com Téléphone : 06 60 40 19 16 Diffusion et distribution : Paon diffusion.Serendip Relation libraires : jean-luc.remaud@wanadoo.fr Téléphone : 06 62 68 55 13 Éditions Du Canoë : 9, place Gustave Sudre Local parisien : 2, rue du Regard 33710 Bourg-sur-Gironde 75006 Paris c/o Galerie Exils
Le ciel ce soir est d’un gris bleu délavé comme tes yeux qui ont vieilli regardons-nous immobiles toi et lui lui contre moi face à ta présence que le soir rudoie espace contre regard quand s’annonce la nuit sur la crête de la montagne où se découpe l’âpre ruine d’un château
mais où sont dans le temps et la journée qui cède où sont les seigneurs et leurs petits pages en haillons les pauvres au fond des cachots
où sont les guerriers et le sang qui gicle où sont les vieux songes qui les ont nourris les chants psalmodiés aux mots oubliés orgueils et gloires des royaumes morts
que nous importent les vieux torts quand tout ne fit que de passer la vie s’efface au jeu des souffles
rien ne demeure ni ne persiste la nuit vorace lentement ronge
et soleil après soleil il ne suffit qu’un peu d’attendre
3
inutile de conserver votre ticket aujourd’hui comme hier aucun échange ne sera fait merci de votre visite adieu seigneurs adieu châteaux et à bientôt.
Les longs couchants acidulés ont des entrailles de guimauve de leurs tristesses d’en-(vous devinez) mon être entier toujours se sauve ne suis-je rien qu’à peine moi un rêve juste de travers à la marelle des émois le cloche-pied de mes revers
mensonges fins ou bien grossiers par vous passent le salut il faut se faire un cœur d’acier tant de tueurs dans l’ombre tuent finie à l’aube l’imposture
basta un soir la comédie tu l’as voulue la mélodie qui dans les cœurs à jamais dure.
4 5
À
jamais dure
À bientôt
Je n’ai jamais compris
pourquoi passent les roses je n’ai jamais compris
pourquoi les dieux se vengent et ni non plus pourquoi l’homme autant aime le mal
apprenez-moi pourquoi
le souffle se retire
apprenez-moi pourquoi
leurs faux aiment trancher
pourquoi l’homme savoure une eau toujours plus noire
pourquoi le temps n’est pas lassé de ses massacres
pourquoi les astres morts errent dans l’air glacé
pourquoi ce qui fait Dieu
n’a jamais dit : Assez ! Assez
On aura bien le temps
d’habiter le néant on aura bien le temps on aura bien le temps d’aller au bout des ans des souvenez-vous-en on aura bien le temps
de compter sur ses doigts les derniers de ses jours de partir quand on doit à la fin du séjour de faire des politesses de virer sous le vent de passer à la caisse on aura bien le temps d’être un homme docile immobile au tombeau
loin des bruits de leurs villes on aura bien le temps
dans l’obscur sous sa dalle on aura bien le temps de n’y voir plus que dalle de n’être que du temps
6 7
En librairie mars 2024
Format : 14 x 21 cm
Pages : 48 p.
Reliure : broché, collé
rayon : Littérature
Prix : 10 € / 14 CHF
ISBN 978-2-8290-0680-7
DIFFUSION ET DISTRIBUTION SUISSE
Éditions d’en bas
Rue des Côtes-de-Montbenon 30
1003 Lausanne
021 323 39 18
contact@enbas.ch / www.enbas.net
La section rythmique
Yann Bakowski
PRÉSENTATION
Bref récit en prose poétique et vers libres nous invitant à nous dégager des carcans qui nous entourent, ceux de la société et des pensées étroites, auxquelles on peut échapper grâce au rêve qui est une fuite, et s'incarne dans la force du verbe. À ce titre, le texte de Yann Bakowski invite son lecteur à un dérèglement des sens, et cela doublement : d'abord parce qu'il est poésie et sensation, incitation à l'imaginaire dans le rythme intense d'une prose enveloppante, provoquant l'inattendu ; et également car c'est la règle qui précisément, comprend-on, doit se trouver déréglée par la vision du monde offerte.
Une histoire d'amour née sur fond musical impulse ce récit et, on peut le supposer, enclenche cette vision d'un monde libéré, un monde d'aventure où le rêve laisse place à l'impromptu des situations. Ici, des scènes mettent en évidence la manière dont le règlement retrouve parfois une place alors que le sentiment de liberté avait repris ses droits. Là encore, un foisonnement d'informations sur les gens, leurs pensées même, se fait jour : on a accès à leurs idées, parfois traditionnelles, ainsi qu'aux problèmes qui régissent leurs vies.
La Section rythmique est invitation à une danse par le verbe, au rêve que la poésie est peut-être seule (avec la littérature) capable de nous restituer. Cela rappelle la phrase de Saint-John Perse dans son discours de réception au prix Nobel de Littérature : Poète est celui-là qui rompt pour nous l'accoutumance. C'est bien, ce à quoi parvient Yann Bakowski.
AUTEUR
«Yann Bakowski est né en 1988.
Il est musicien de jazz.
« La section rythmique » est son premier livre.
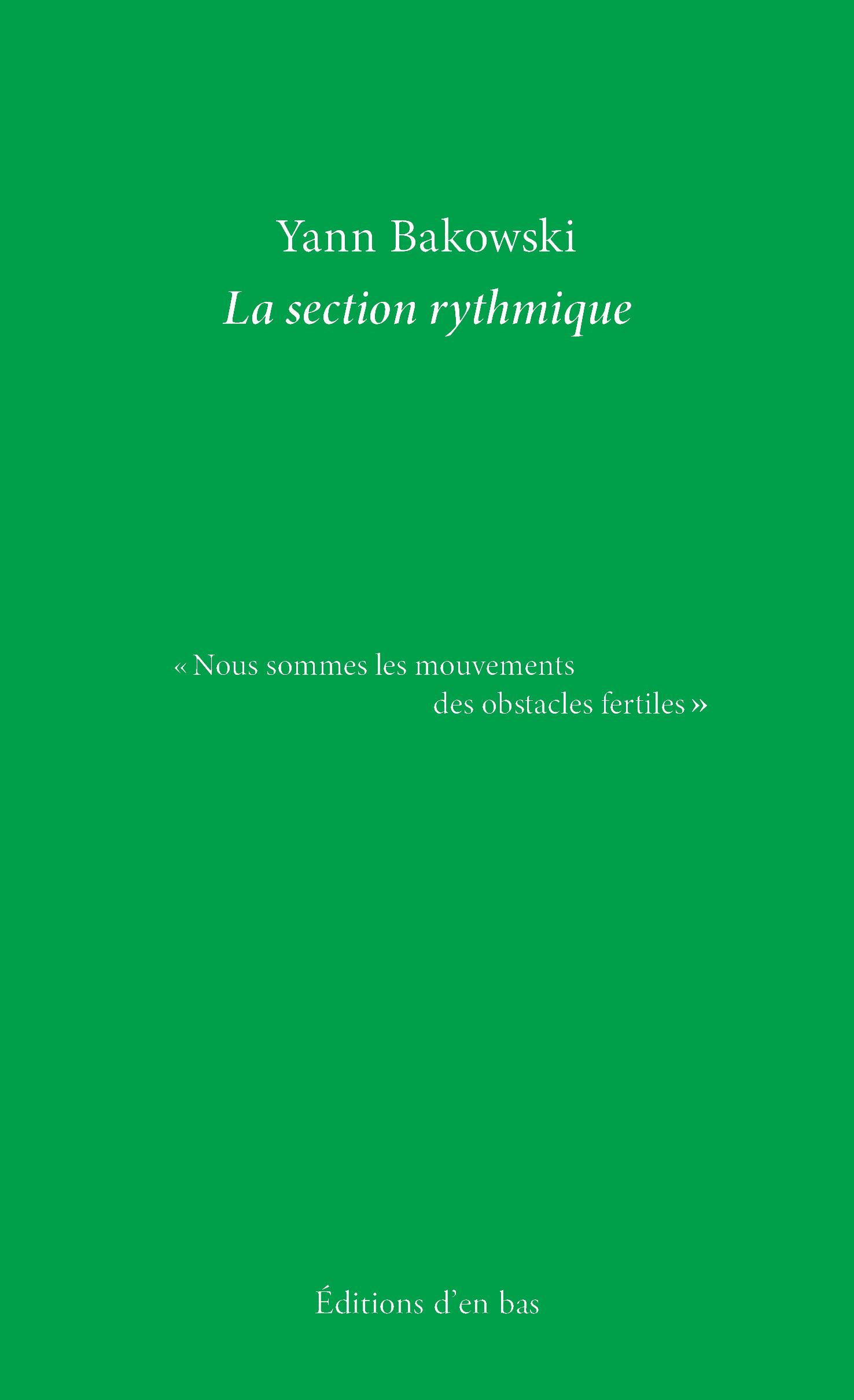
DIFFUSION ET DISTRIBUTION FRANCE
Paon diffusion/SERENDIP livres

Paon diffusion – 44 rue Auguste Poullain – 93200
SERENDIP livres – 21 bis rue Arnold Géraux 93450
+33 140.38.18.14
contact@serendip-livres.fr
gencod dilicom3019000119404

SAINT-DENIS
L'Île-St-Denis
Le décor d'une machinerie. Des machinistes acteurs. Des acteurs monotones. Un théâtre contre les lignes de fuite et de jeunesse, contre les traversées de musique.
Je suis pris dans la joie d'une diagonale.
Je m'arrête. J'encadre un relief de lumière et d'ombre, un arbre sur mon chemin, un oiseau sur une branche, un rythme de la musique...
«–C'est toi qui a peint ce portrait?
–Ce n'est pas de la peinture, c'est de la boue! Faite par un photographe. -Qui est-ce?»
Fritz Lang La Rue rouge
Le soleil embellit sa note. Nous roulons vers les fêtes de la capitale.
Mon ami se gare dans le parking d'une avenue.
Dans une ruelle, derrière l'enseigne lumineuse de L'ACCORD MAJEUR, l'exactitude de la batterie, de la contrebasse, du piano, de la trompette et de mon saxophone.
Après notre musique, la lumière de l'alcool. Nous écoutons la solidarité du jazz, les contacts de la section rythmique, les contacts de la batterie, de la contrebasse et du piano.
Une femme à la peau brûlée par le soleil, un spectacle de femme et de rouge, traverse, et aborde.
Ses grands yeux sont fermés. Elle regarde les rythmes du paysage. Une lumière orange et dure, qui souligne le contour d'une épaule, le contour d'une partie de la tête, contraste avec le dégradé
rapide de notre lumière blanche et diffuse qui modèle son visage, et ce contraste donne de la présence au volume. Au-dessus de la plage rouge, un cercle de pierre, un rivage sur la peau. Ses jambes sont longues, dynamisées par le noir. Sur les mains, une constellation bleue qui contraste avec l'énergie de l'immensité rouge.
Elle s'appelle Tiziri.
Une membre de Solidarité Sans Frontières.
Une pianiste qui sait donner du plaisir au batteur et au contrebassiste.
Une imagination originale qui n'obtiendra pas le prix littéraire des grandes écoles.
Une documentariste qui cherche des images, des contrastes, des profondeurs de rêve.
Une joueuse de poker qui se bat dans les arènes électroniques.
Son sac à dos est bleu. Le ciel d'une planète. J'ai envie de mettre la main dans le bleu.
Nous sortons du jazz. Les musiques sont obscures. Nous sommes des lenteurs de plaisir qui se promènent.
Des arbres endormis, étrangers à la ville. Le mur n'est pas très haut.
Nous sommes sur l'herbe, de l'autre côté, dehors.
L'amour nous éclaire. L'intérieur devient visible.
lumière sur lumière
elle m'envahit
Elle revient avec le trésor de son regard.
Elle m'accueille dans la chambre qui est devenue la sienne. Les films de Merzak Allouache, ses refuges de couleurs et de rythmes entre les lignes droites. Le trio de jazz de Myra Melford, ses mouvements harmoniques, ses mouvements romanesques. Je voyage dans les imaginaires de ce continent.
une musique jeune et légère sur le long sur le plat entre les musiques planes les mouvements d'un refuge
les tonalités
les crescendos les accélérations
En librairie mars 2024
Format : 12,5 x 20,5 cm
Pages : 208 p.
Reliure : broché, collé
rayon : Poésie
Collection : Collection bilingue
Prix : 18 €
ISBN 978-2-8290-0682-1
La sonàda senza nom / La sonate sans nom suivi de La pagina striàda / La page enchantée
Fernando Grignola
Traduit du dialecte d’Agno (TI) et de l’italien (Suisse)
par Christian Viredaz
Préface de Guido Pedrojetta
DIFFUSION ET DISTRIBUTION SUISSE
Éditions d’en bas
Rue des Côtes-de-Montbenon 30
1003 Lausanne
021 323 39 18
contact@enbas.ch / www.enbas.net
DIFFUSION ET DISTRIBUTION FRANCE
Paon diffusion/SERENDIP livres

PRÉSENTATION
Fernando Grignola confiait dans un entretien où on lui demandait quels étaient les sentiments les plus nettement marqués dans ses poèmes: « Sans doute la solidarité avec le monde ouvrier, et l’évidence de participer de ce monde, que j’ai connu de l’intérieur. »
Cette édition trilingue, en italien, en dialecte d’Agno et en français révèle ce lien avec l’Homme mais aussi avec la nature qui se trouve au centre de sa vie.
La traduction de Christian Viredaz donne voix à ce poète d’exception
AUTEUR
Fernando Grignola (1932-2022) a toujours vécu à Agno, petite ville du même canton, au bord du lac de Lugano. S’il a commencé par publier des poèmes en italien, c’est dans le dialecte d’Agno qu’il a écrit l’essentiel de son œuvre (quinze recueils parus entre 1963 et 2016). Il est également l’auteur de quatre recueils de récits et souvenirs et d’une anthologie des poètes dialectaux de Suisse italienne. Il a remporté le Grand Prix Schiller 1998.
TRADUCTEUR
Né en 1955, Christian Viredaz a publié cinq recueils de poèmes entre 1976 et 1996, et traduit une vingtaine d’ouvrages depuis 1981, dont aux éditions d’en bas, en italien : Giovanni Orelli. Le train des Italiennes (1998, 2022 en poche) et Alberto Nessi. Ladro di minuzie / Voleur de détails, Poesie scelte / Poèmes choisis, 1969-2010 (2018) et en allemand : Francesco Micieli. Ich weiss nur, dass mein Vater grosse Hände hat/Je sais juste que mon père a de grosses mains (2011) et Franz Hohler. Le déluge de pierres (2003)

En mars 2023 les éditions La Conférence ont publié une anthologie trilingue de Fernando Grignola, Toute la vie. Poèmes 1957-2016, traduite par Christian Viredaz.
PRÉFACIER
Guido Pedrojetta (1952), originaire du Tessin, a travaillé pendant de nombreuses années à la chaire de littérature et de philologie italiennes de l'Université de Fribourg
Paon diffusion – 44 rue Auguste Poullain – 93200 SAINT-DENIS
SERENDIP livres – 21 bis rue Arnold Géraux 93450 L'Île-St-Denis +33 140.38.18.14
contact@serendip-livres.fr
gencod dilicom 3019000119404

J’écris
« … Moi, j’écris ces poèmes parce que ce n’est pas vrai qu’en dialecte on ne voie le monde qu’en vers de mirliton »
A scrivi
«... A scrivi stì puesíi parchè l’è miga vera che ’n dialètt ur múnd ar sa veda düma in busináda!»
Scrivo
«... Scrivo queste poesie / perché non è vero / che in dialetto / il mondo lo si veda soltanto in bosinata!»
Demain on sera plus là !
« Ça vaut vraiment pas la peine de se crever la peau », qu’il me dit en me pointant sa tasse sous le nez.
« Se rendre fou pour le pognon quand une sale bête d’un jour à l’autre peut t’expédier de l’autre côté ! »
Il me jette un regard mauvais, ça lui semble pas juste, voilà, que l’histoire des gens soit suspendue à un mince fil d’espoir. On est là sur le banc du grotto plus capables d’entonner la première et la deuxième voix comme au bon vieux temps des crasses.
« Est-ce qu’on est pas tous les mêmes ? », qu’il me demande avec cette insistance qui est celle du vin et je ne peux plus me le représenter jeune maintenant que sa figure est un paquet de peines et de passions.
Dumán ga sem piü!
– «A vár miga ra pena da scarpàss giò ra pè d’adòss» – ar ma dís cu ’r tazzìn puntát cuntra ’r mè nás:
– «Divantà màtt pai danée quand che ’n màiacarlón da ’n dì a r’altru ar pò sbàttat da là! » –
Ar ma vàrda da catív, ga par miga giüst, ecco, che ra stòria di gént ra sia ligáda a ’n firìn da speránza.
Stem lì sü ra banchéta dar Grott piü bón d’intonàss da prìm e segúnd cumè ai bei témp di balossát.
– «A sem miga tücc istéss?» – ar dumánda cun quéla insistenza dar vín e pòdi piü figüràmal da giúvin adèss che ra sò fascia l’è ’n scartócc da fatígh e passión
Domani non ci siamo più!
– «Non vale la pena / di strapparsi la pelle d’addosso» – mi dice / con il tazzino puntato contro mio naso: / – «Diventar matti per i soldi / quando un “grillotalpa” da un giorno all’altro / può sbatterti di là! » – // Mi guarda da cattivo, / non gli sembra giusto, ecco, che la storia delle genti / sia legata soltanto a un filino si speranza. / Stiamo lì sulla panca del Grotto, non più capaci d’intonarci di prima e seconda voce / come ai bei tempi delle birichinate. / – «Non siamo tutti uguali?» – chiede / con quella insistenza del vino / e non posso più figurarmelo da giovane / adesso che la sua faccia / è un cartoccio di fatiche e passioni. //
Le voyage impossible
Vacances
folle envie de voyager loin, de courir le monde plantant là ton clocher comme les hirondelles, de l’autre côté de la mer.
Le voyage impossible
c’est celui pour s’éloigner des fantômes en dedans de toi.
Ur viàcc impussibil
Vacánz brama da viagià luntán, ’ndà via pa’r múnd distánt dar campanìn cumè rúndol da là dar már.
Ur viàcc impussibil
l’è quéll da sluntanàss dai fantasma denta da tì.
Il viaggio impossibile
Vacanze / brama di viaggiare lontano, / andar via per il mondo / distante dal campanile / come rondini di là dal mare. // Il viaggio impossibile / è quello di allontanarsi / dai fantasmi dentro di te.
Cent portraits vagues
ÉDITIONS LURLURE
PARUTION MARS 2024
CENT PORTRAITS VAGUES
Milène Tournier
Genre : Poésie
Collection : Poésie
Prix : 20 euros
Format : 14 x 21 cm
Nombre de pages : 160
ISBN : 979-10-95997-58-0
> Une galerie de portraits comme autant de récits de vies
> Un regard à la fois âpre et tendre sur la condition humaine
> Milène Tournier a reçu en 2021 le Prix Révélation de Poésie de la SGDL .
Elle est l’une des voix majeures de la poésie contemporaine
> LE LIVRE
Cent portraits vagues. Une galerie de portraits – femmes, hommes, enfants, adolescents, sexagénaires, vieillards ou mourants – comme autant de récits de vies… D’instantanés saisissant quelque chose de la beauté et/ou du tragique de ces histoires intimes et singulières.
« Vagues », pour laisser à chacune, à chacun, son secret – cette part d’ineffable brouillard qui échappe à nous-mêmes et aux autres. Un regard à la fois âpre et tendre pour confier cent fois notre affiliation singulière à la commune condition humaine.
Cent portraits vagues est le quatrième recueil de Milène Tournier publié aux éditions Lurlure.
> L’AUTRICE
Milène Tournier est née en 1988. Elle est docteure en études théâtrales de l’université Sorbonne Nouvelle.

Les éditions Lurlure ont déjà publié L’Autre jour (2020), lauréat du Prix
SGDL Révélation de Poésie 2021 et sélectionné pour le Prix des Découvreurs 2021 / 2022 ; Je t’aime comme (2021) et Se coltiner grandir (2022), finaliste du Prix Jean Follain 2023
Elle a également publié Ce que m’a soufflé la ville aux éditions Le Castor Astral (2023), sélectionné pour le Prix Apollinaire 2023.
Milène Tournier
l
DIFFUSION-DISTRIBUTION : SERENDIP LIVRES / PAON DIFFUSION 1 / 4
> EXTRAITS DE REVUE DE PRESSE DE L’AUTRE JOUR (Lurlure, 2020)
« Un recueil d’une grande beauté, d’une profonde justesse. »
Le Monde des livres
« Milène Tournier nous installe en un instant dans la matière vivante et plurielle de ses cheminements intérieurs. »
Lire / Magazine littéraire
> EXTRAITS DE REVUE DE PRESSE JE T’AIME COMME (Lurlure, 2021)
« Un livre foisonnant, un bouquet merveilleux et too much, une poésie obsessionnellement anaphorique et pourtant extrêmement délicate. »
Libération
« En revenant à la plus directe des sources du lyrisme, Milène Tournier tente de retrouver la beauté dans la cité. »
Le Matricule des Anges
> EXTRAITS DE REVUE DE PRESSE DE SE COLTINER GRANDIR (Lurlure, 2022)
« Cela fonctionne dès le premier mot de sa première phrase. Milène Tournier écrit dans une langue qui lui est propre et qui est devenue, de livre en livre, immédiatement reconnaissable. Un mélange entre une construction toute musicale du poème, propre à l’oralité, et une extrême disponibilité à l’émotion, qui finit même parfois jusqu’à tordre la syntaxe. »
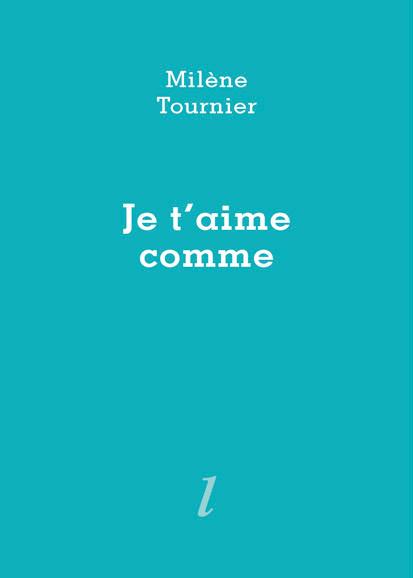
Libération
« Elle nous avait happés avec L’Autre jour, le premier recueil qui lui a valu, en 2021, le Prix SGDL Révélation de poésie. Dans ce nouveau livre intitulé Se coltiner grandir, Milène Tournier varie en douceur les formes et les rythmes – haïkus, petits contes, instants urbains dits “bains de villes” – et tisse la veine autobiographique des moments fondateurs de sa vie. »

Lire / Magazine littéraire
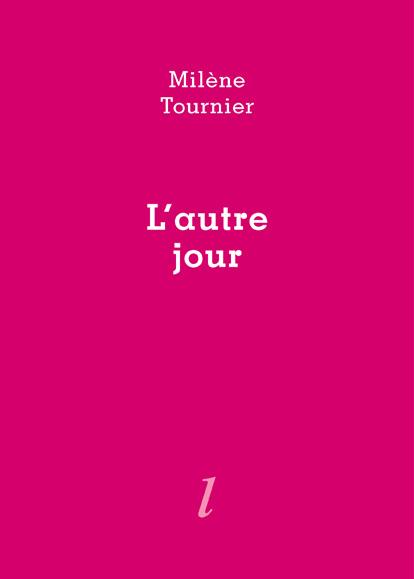
2 / 4
* * DIFFUSION-DISTRIBUTION : SERENDIP LIVRES / PAON DIFFUSION
2. Sa mère faisait le jeu de l’attraper et la chatouiller et elle riait. Le jeu se passait par terre et sous-terre, dans les souterrains du métro, le tunnel pour la 13. La petite a appris à lire entre ses genoux. C’était lire les pieds des gens, et au fur et à mesure les genoux, et encore après les visages des gens, les visages c’est fragile et ça peut faire mal. Quand il y a eu le passage de la comète, une nuit, elles sont sorties du tunnel et la mère a allongé le bras et lui a montré le ciel. Là. Regarde. Elle a appris à marcher sur la couverture, aux pieds des voyageurs et des usagers pressés. Elle a fait pipi partout dans les tunnels du métro, accroupie, d’abord sa mère la tenait et puis un jour elle a appris, seule debout c’était mieux, plus pratique. Debout comme un garçon, va tu peux aussi. Elle a grandi. Elle a mis des salopettes d’habits donnés. Elle a grossi beaucoup. Là où il n’y avait rien, il y a eu des seins, c’était comme deux étoiles qui se voient même le jour. Elle entendait de moins en moins distinctement les chansons de la mère, qui avait de moins en moins de mémoire, et c’était souvent à elle, maintenant, de les finir : les chèvres, les lunes mauves et les cœurs où vivent les amants partis, les frères morts, les fils perdus. Un jour il n’y a plus eu de chanson du tout, et elle s’est allongée, la joue sur la joue de sa mère dans le métro le tunnel vers la 13. Tout était lisible, les pieds les genoux son visage, qui disait je suis fatiguée, qui disait je veux mais je ne veux pas te laisser seule, qui disait oh, comme j’ai confiance en toi, qui disait, lis les visages et les comètes ma fille, et va dehors. Dans le ciel, au-dessus du tunnel, la lune s’est promis, ce jour-là, d’être particulièrement douce.
4. Le grand fils rabat la portière côté passager après avoir déposé sa vieille petite mère, en se tendant sur le siège à côté et en tirant la poignée, ça claque doux au milieu de la rue. Ça faisait près d’un an qu’il ne l’avait pas vue, il habite loin. Certes, elle est vieille et si petite, elle va mourir très bientôt sans doute, dans peu de temps, et quand même tout marche encore comme avant : tout le ramène à vivre, il avait oublié, depuis un an, comment on est quand on vit. Un an à s’endormir et se réveiller sur du stress. Alors tout à coup, tout à coup qu’il est vivant devant sa mère, il réalise, il faut faire quelque chose, quelque chose de tous ces matins perdus, mal levés et pénibles, sinon il va mourir, mourir même avant sa mère, qui aura elle travaillé toute sa vie mais hors de tout travail officiel, auprès de son mari et son travail de mère, et qui œuvre encore, lorsqu’elle pose ses petites fesses sur le siège passager et ses fesses sont deux fourmis laborieuses, et qu’elle s’enquiert comment tu vas, et il entend comment tu vis ? Il faut faire quelque chose de tous ces matins, mais ça y est sa mère est remontée chez elle, à tout petits pas dans le hall vers l’ascenseur. Elle a tant vieilli mais aussi tant vécu.
5. Ses mains étaient toujours plus grosses que le téléphone. Même le très gros que lui avait pris son fils, pour ses yeux. Ses mains restaient plus épaisses, faites pour le bois, et même si de sa vie il n’avait jamais taillé une bûche, peut-être jamais allumé un feu. Il jouait au solitaire, de longues parties d’index. Enfant ses mains allaient s’agripper au cou de sa mère comme deux pieds nus et mous. Adolescent, ses mains avaient lissé son sexe longuement,
3 / 4 > EXTRAITS
DIFFUSION-DISTRIBUTION : SERENDIP LIVRES / PAON DIFFUSION
tête baissée pour regarder. Parfois les yeux très fort fermés, pour encore mieux regarder. Et puis, plus tard encore, ses mains se sont penchées vers quelques sexes de fille. Les doigts à peine aventuriers, pour aller consoler cette chose-là, d’un sexe de femme qui tremble. Ses mains avaient à peine tenu l’enfant né de leurs deux sexes noués que l’enfant avait eu quinze et trente ans, et lui avait acheté un nouveau gros téléphone, plus pratique papa pour tes doigts. Mort, ses doigts étaient restés les dix seuls tendres, au milieu du corps tout endurci, avec encore leur rond d’enfance rosée, sur la dernière phalange décalottée. Les mains de sa femme étaient loin, à la fois veuves et divorcées. Les mains de son fils en deux petits oiseaux stables et chagrins, ce jour-là. Des dernières mains anonymes avaient lentement descendu son cercueil, entre corde et trou. Au-dessus, la longue main bleue du ciel.
14. C’était un de ces bateaux qu’on emprunte en vacances, pas un bateau de croisière ni un rafiot d’aventure, un bateau juste pour passer, un bateau pour remplacer un pont et traverser. C’est sur ce petit bateau alors qu’elle a soudain réalisé: sa main, la sienne, la mer devant, comme une longue lettre qu’on a pas encore lue, au-dessus le ciel et même, déjà, dans un coin, la lune comme un petit chien blanc. C’est sur la proue du bateau de passage, aidée sans doute en cela par quelque imagerie romantique qui veut que Dieu arrive par-devant, les révélations par la face, et que les vérités assaillent les visages par la mer, à la proue donc, surmontée de quelques bannières publicitaires « Lou Passagin » « la traversée à un euro », que, très loin de la brume qui d’ordinaire occupait son cerveau, la passagère a distinctement entendu dans sa tête : j’aime cet homme, je veux sa main très souvent tout près. Je veux sa main très souvent tout près.
4 / 4
DIFFUSION-DISTRIBUTION : SERENDIP LIVRES / PAON DIFFUSION
L’éternité par les arbres L’auteur

Si le poète est inventeur d’inconnu, Antoine Oleszkiewicz jardine dans les mots et sème les images. Il nous donne avec L’Éternité par les arbres un chant pour le XXe siècle. Nourri par l’utopie fouriériste, le voyageur revenu des forêts de l’Amazonie a oublié dans un carnet
ce long poème d’une simplicité et d’une densité extraordinaire.
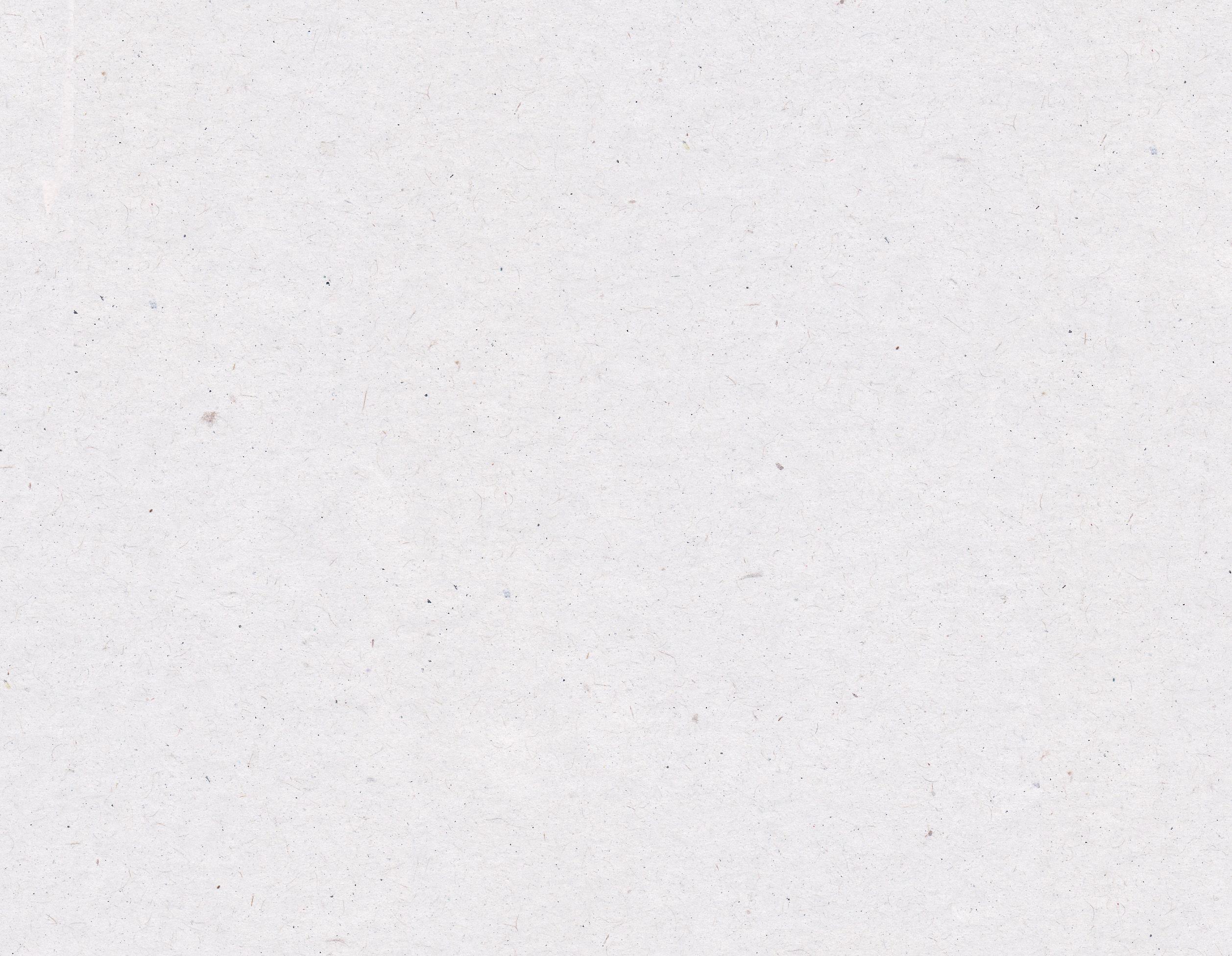
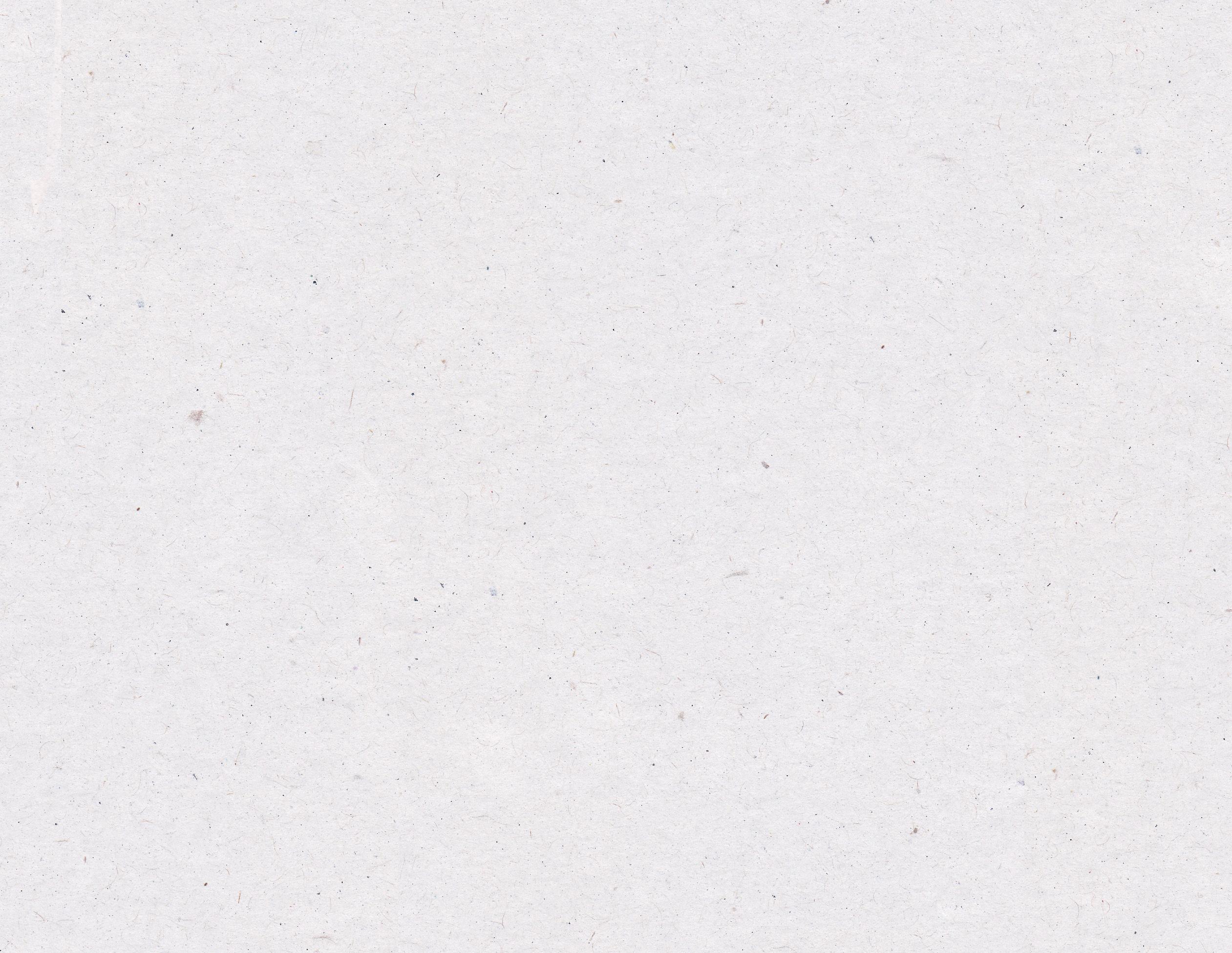
Ici poussent les visions où fleurissent les questions d’Antoine Oleszkiewicz sur la communauté, l’amour, le rêve d’une vie au jardin-paradis…
À l’égal des grands voyants, il nous adresse avec ses mots une forme nouvelle d’élégie contemporaine, un chant pour la forêt et les habitant·es de ce pays où il existe toujours plus de beauté / qu’on n’en peut désirer.


Parution : décembre 2023

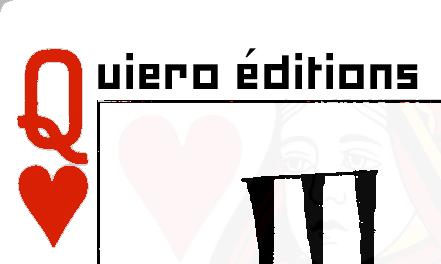
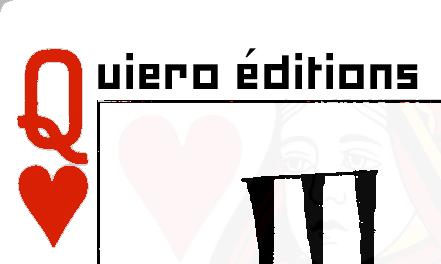
EAN : 9782914363273

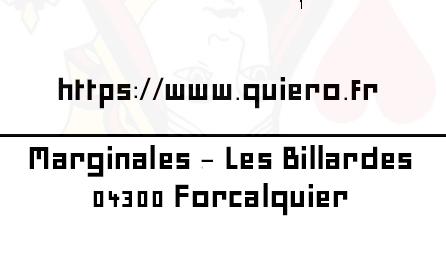
Prix public : 25 € Publié avec le soutien de la Région Sud
Réalisé en typographie mobile avec des encres de l’auteur, ce livre est la première publication de ce poète encore inconnu qui a beaucoup fréquenté le surréalisme.

Antoine Oleszkiewicz (né en 1948 à La Tronche dans l’Isère, mort à Poitiers dans les Deux-Sèvres en 2009).
Premier enfant de Simone et Ludwig
Debout-Oleszkiewicz (figures de la Résistance dans la région grenobloise),
Antoine est un enfant disposé et encouragé au génie. Fugueur à 14 ans durant des vacances d’été en Allemagne, perturbé par la maladie et le décès de son père (en novembre 1963), il décroche de la vie scolaire. Mais grâce au Collège cévenol du Chambon-sur-Lignon, il obtient son bac avec la mention très bien et revient à Grenoble pour étudier la philosophie.
Tenté par la vie en communauté et les travaux agricoles, il se lance dans cette aventure à Saint-Restitut dans la Drôme provençale puis dans une deuxième ferme en Provence, qu’il abandonne après des succès certains pour effectuer un long voyage en Angleterre.
Il part en 1974 au Portugal pendant la révolution des œillets, où il apprend le portugais. Il va ensuite au Brésil.
Tout d’abord à Rio où il s’intéressera au Candomblé et à la Capoeira des afro-brésiliens et tirera les tarots dans la rue en multipliant les rencontres et les aventures. Il fait l’experience de l’hallucinogène Ayahuasca et voyage jusqu’à l’Etat de l’Âcre au fond de l’Amazonie où il rencontre les leaders syndicalistes Chico Mendes et Marina Silva.
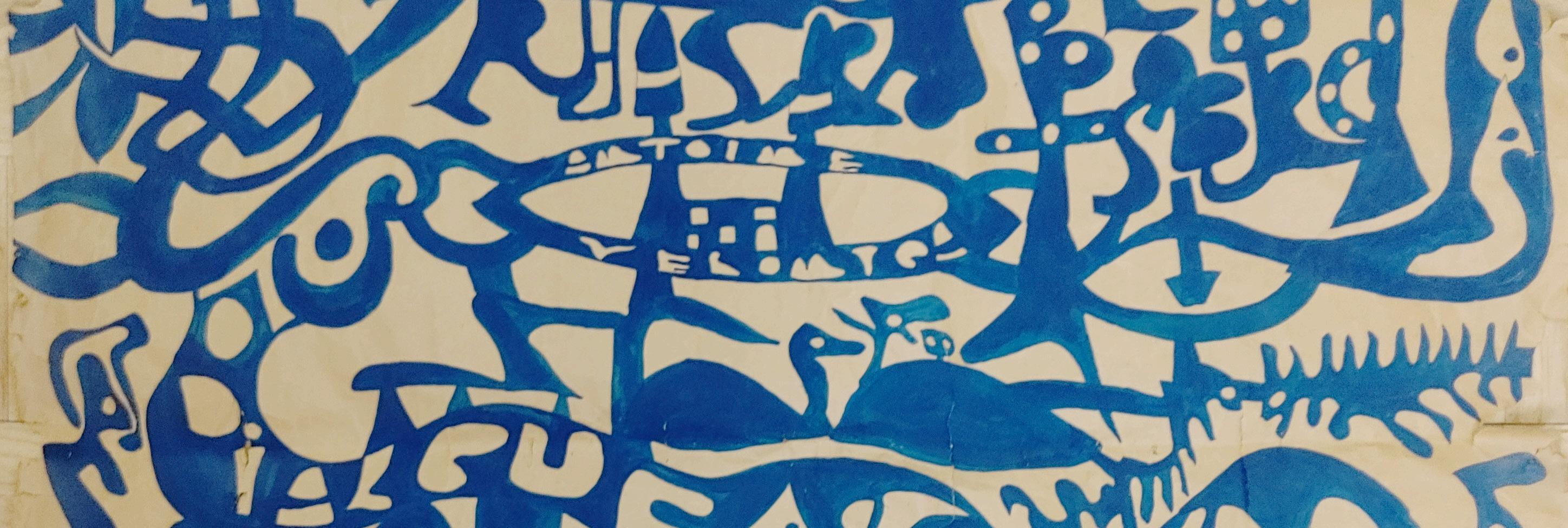
De 1980 à 2000, il alterne voyages et séjours à Paris et pratique le tarot avec Jodorowski. Il s’installe enfin dans le marais poitevin où il cultive des légumes en bio jusqu’à sa mort en 2009 suite à une leucémie aiguë.
Croyance dans la réalité enchantée croyance dans le pouvoir des chants des habitants de là de l’Incognito qui leur font courir le risque [de devenir éternels ils lisent des prières dont ils sont eux ou des végétaux sublimes royaux ou des animaux fabuleux tour à tour les lettres de chaque mot.
 Détail d’une encre d’Antoine Oleszkiewicz et composition en cours dans l’atelier…
Un livre de 48 pages au format 13x17 cm. Impression typographique des pages intérieures et de la couverture avec des encres de l’auteur
Détail d’une encre d’Antoine Oleszkiewicz et composition en cours dans l’atelier…
Un livre de 48 pages au format 13x17 cm. Impression typographique des pages intérieures et de la couverture avec des encres de l’auteur
« Lianes de la forêt travaillant comme nos muscles »
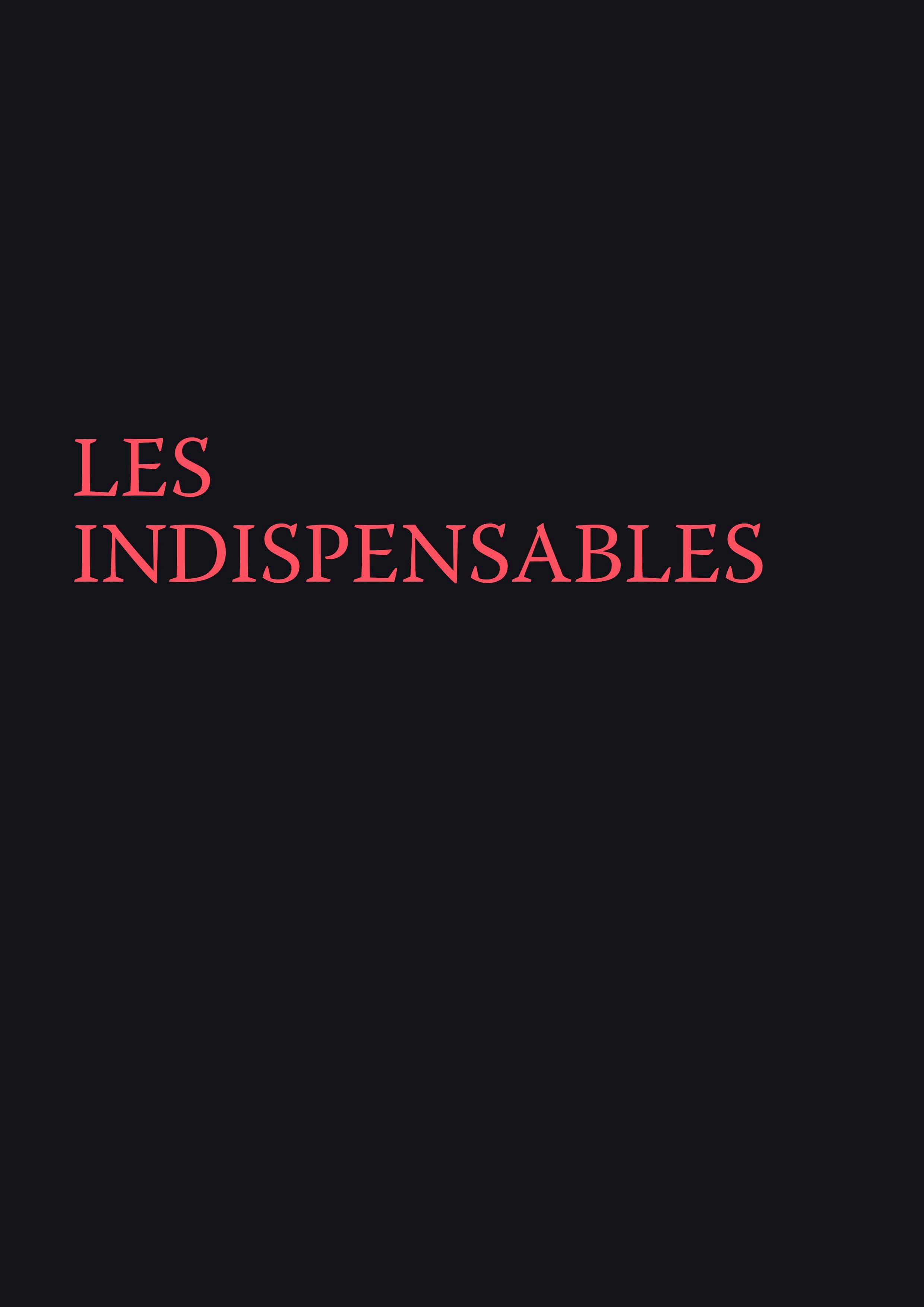
prix : 18 €
tirage : 2500 ex.
parution : 5 mai 2023
format : 14x16,5 cm
pagination : 224 p.
ISBN : 978-2-493324-02-3

Contrechant
une anthologie poétique de audre lorde, poètesse-guerrière incontournable des luttes intersectionnelles
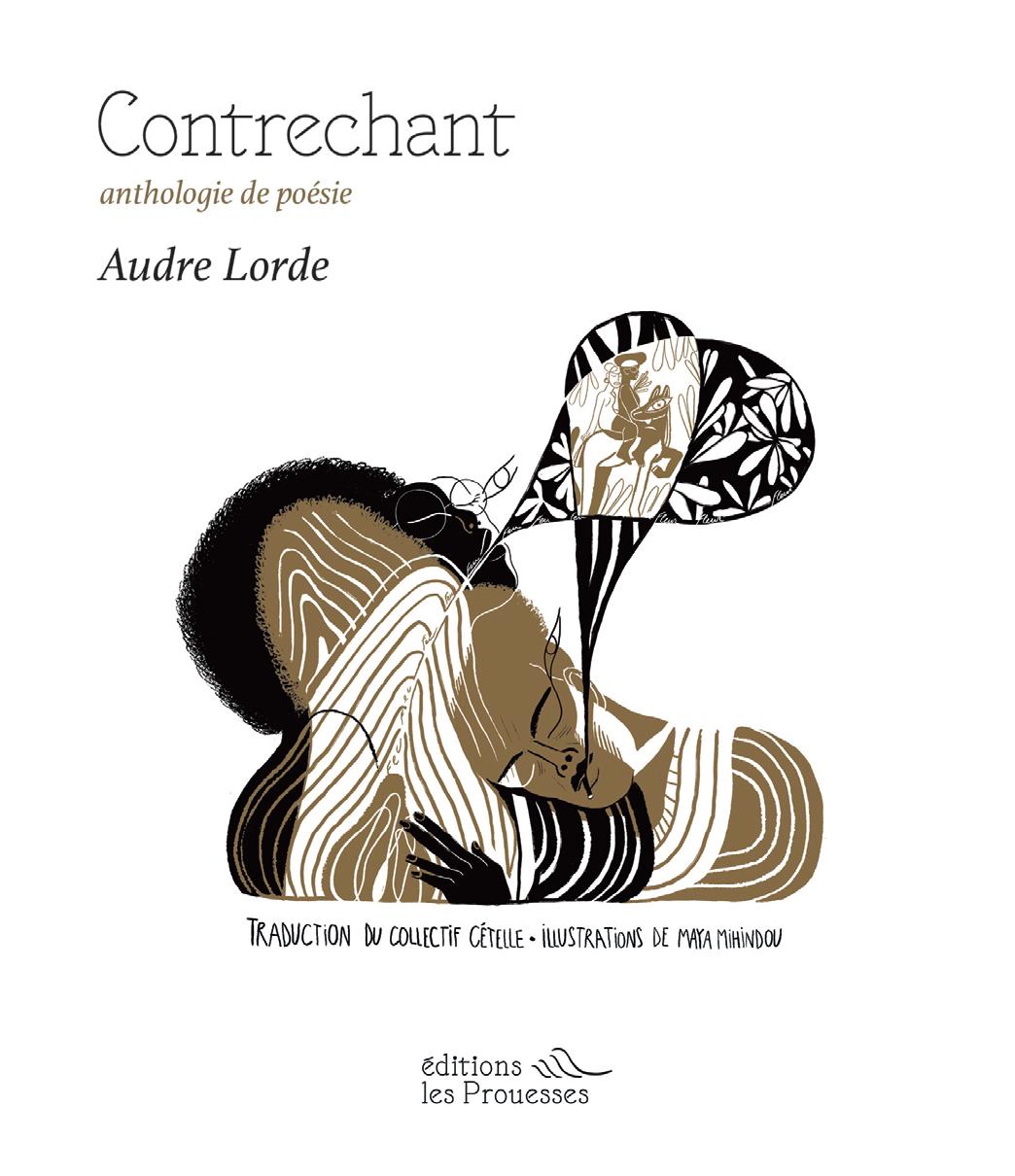
Militante, prophétique, brûlante, sensuelle : la poésie d’Audre Lorde est une explosion en plein coeur.
Ses poèmes rageurs, joyeux, âpres, érotiques sont ceux d’une traversée... Traversée d’une vie de femme, Noire, mère, amoureuse, amie, féministe, lesbienne.
Traversée d’une époque et de ses luttes qui font tant écho au présent. Traversée d’un travail poétique qui affûte la forme de ses mots et de ses idées.
• les meilleurs poèmes de audre lorde, réunis par ses soins juste avant sa mort.
• une figure incontournable des mouvements féministes et intersectionnels d’hier et d’aujourdhui.

• une œuvre poétique magistrale et puissante, encore méconnue.
• une traduction par le collectif de traducteur·ice·s cételle (nice).
• une édition illustrée par maya mihindou.
• en postface, un entretien inédit avec maboula soumahoro.
Poésie
« nos silences ne nous protègeront pas. »
Audre Lorde (1934-1992)

la voix des luttes intersectionnelles
« la poésie n’est pas un luxe, c’est une nécessité vitale. »
Née à Harlem, fille d’immigrés des Caraïbes, Audre Lorde refuse d’être réduite au silence. Bibliothécaire, enseignante, éditrice, essayiste et poétesse, elle encourage sa vie durant les femmes à « transformer le silence en parole et en acte », à puiser au cœur de leurs expériences, de leurs émotions les plus profondes, pour les sublimer grâce à l’écriture. Diplômée de l’université de Columbia, elle est professeure invitée de la Freie Universität de Berlin, donne des conférences à Zurich et acquiert dans les années 1980 une renommée importante en Europe. D’une maîtrise stylistique impeccable et d’une grande force de conviction, les écrits et les discours de Audre Lorde, ont défini et inspiré les féministes américaines, lesbiennes, afro-américaines des années 1970 et 1980.
« j’écris pour ces femmes qui ne parlent pas, pour celles qui n’ont pas de voix parce qu’elles sont terrorisées, parce qu’on nous a plus appris à respecter la peur qu’à nous respecter nous-mêmes. »
in sister outsider, ed. mamamélis, 2003
L’illustratrice : Maya Mihindou
La traduction : le collectif Cételle
Maya Mihindou est une illustratrice franco-gabonaise, photographe et journaliste née en 1984.
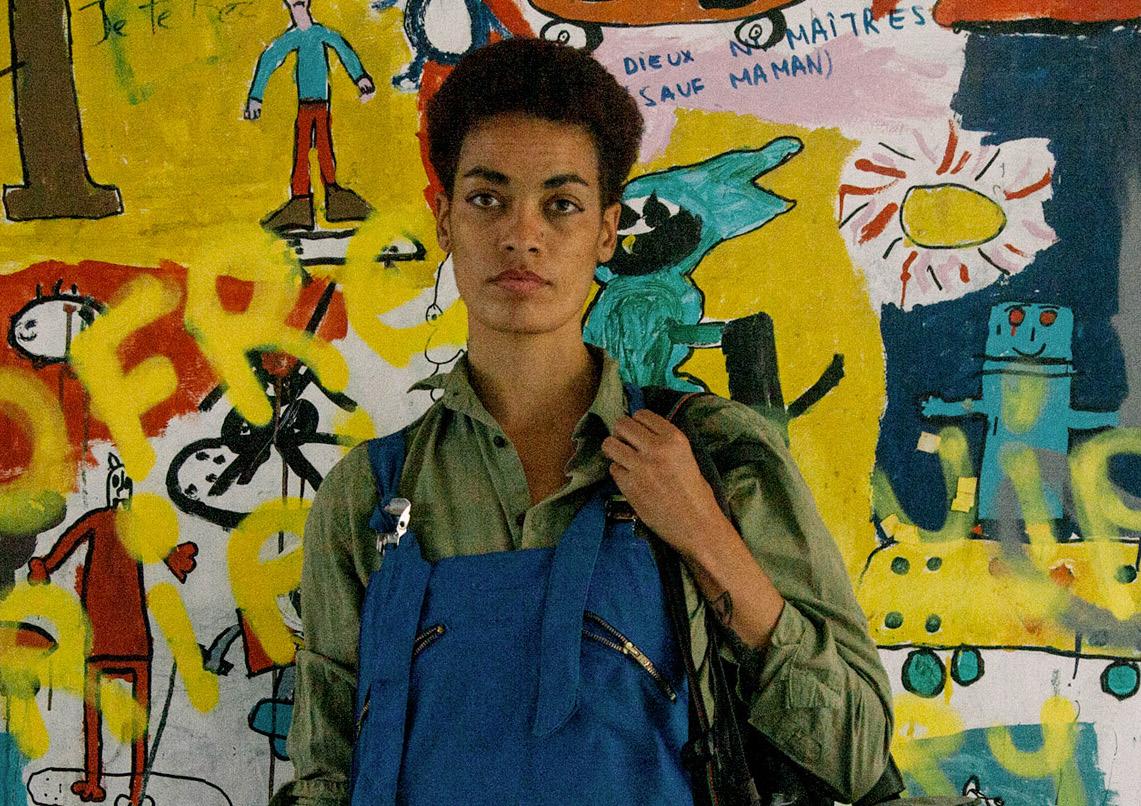
En 2014, elle cofonde la revue socialiste et féministe Ballast et réalise des reportages, des illustrations et des articles dans la presse indépendante, notamment pour les revues Panthère, Première et The Funambulist.
L’entretien inédit : Maboula Soumahoro
Maboula Soumahoro est maîtresse de conférences à l’Université de Tours et professeure internationale invitée au département des études africaines-américaines et africaines de l’Université de Columbia et au Bennington College (États-Unis).

Depuis 2013, elle préside l’association Black History Month (BHM), dédiée à la célébration de l’histoire et des cultures du monde noir.
Le collectif de traduction Cételle est un laboratoire de traduction composé de sept enseignant•eschercheur•ses.
Basé à l’Université de Côte d’Azur, ce collectif s’attelle depuis plusieurs années à traduire l’œuvre poétique de Audre Lorde (recueil Charbon à paraître chez L’Arche) et le théâtre d’Annie Baker.
En avril 2023, le collectif Cételle organise à Nice un colloque international dédié à la poésie d’Audre Lorde.
Les féministes qui ont beaucoup compté pour moi sont Audre Lorde et Monique Wittig.
Virginie Despentes
Engagée dans les différents mouvemenst sociaux, pour les droits civiques des femmes, des gays et lesbiennes, des travailleur·euses, contre la guerre) qui traversent les États-Unis, eelle choisit de ne dissimuler aucune partie d’elle-même; d’afficher dans l’espace public la «mosaïques» de ses identités.
Revue La Déferlante
Représentante de ce que l’on a appelé plus tardivement le « féminisme intersectionnel », issu du féminisme afro-américain et chicano, Audre
Lorde n’a cessé de clamer pour et avec les femmes de couleur le droit à la poésie, à la beauté du monde.
Revue Ballast
Sa prose et sa poésie, ont été de véritables catalyseurs pour les mouvements auxquels elle a appartenu : les artistes noirs, le mouvement de libération des femmes et des homosexuels et le mouvement pour les droits civiques.
Un podcast à soi
 Charlotte Bienaimé
Charlotte Bienaimé
Elles parlent d’Audre Lorde... « »
Charlotte Bienaimé Un podcast à soi
Trois typographes en avaient marre

Un livre de 64 pages au format 10,5x15 cm. Impression numérique des pages intérieures avec une jaquette de couverture en typographie

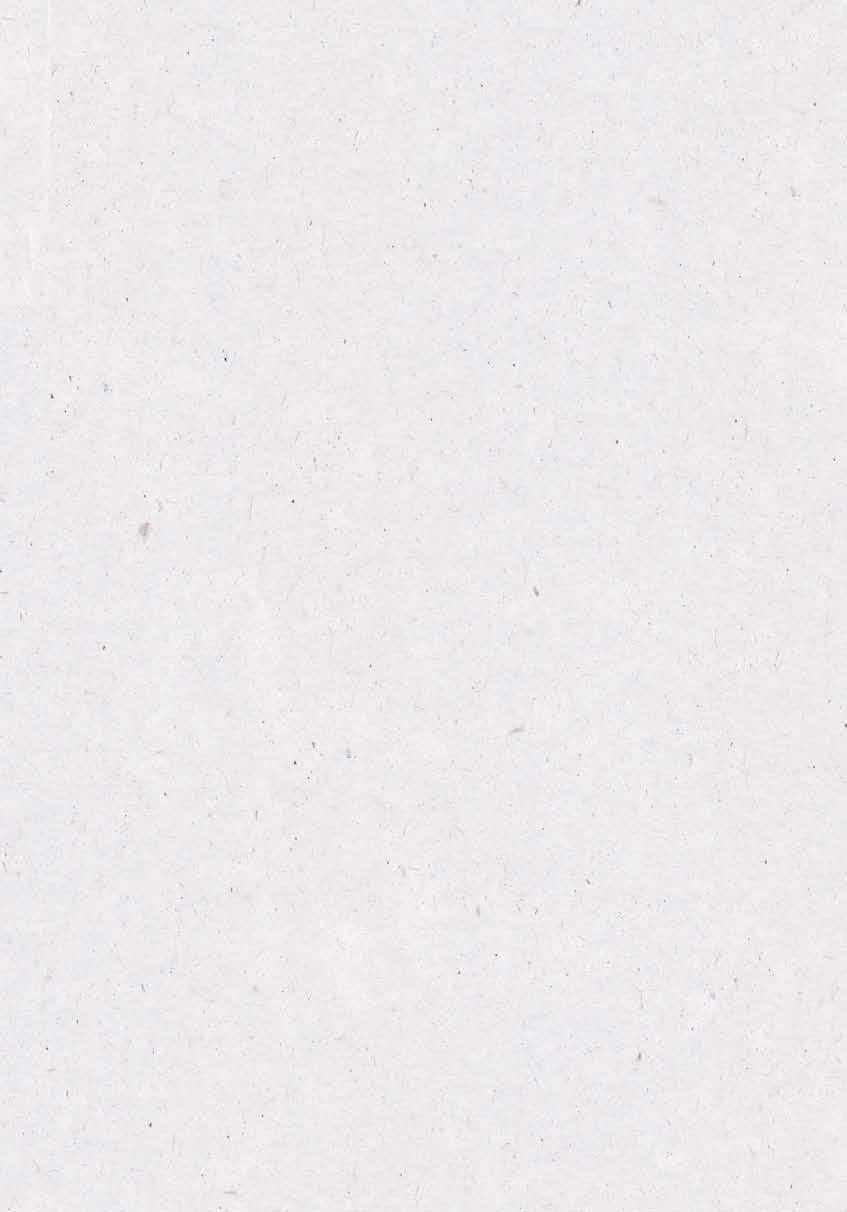
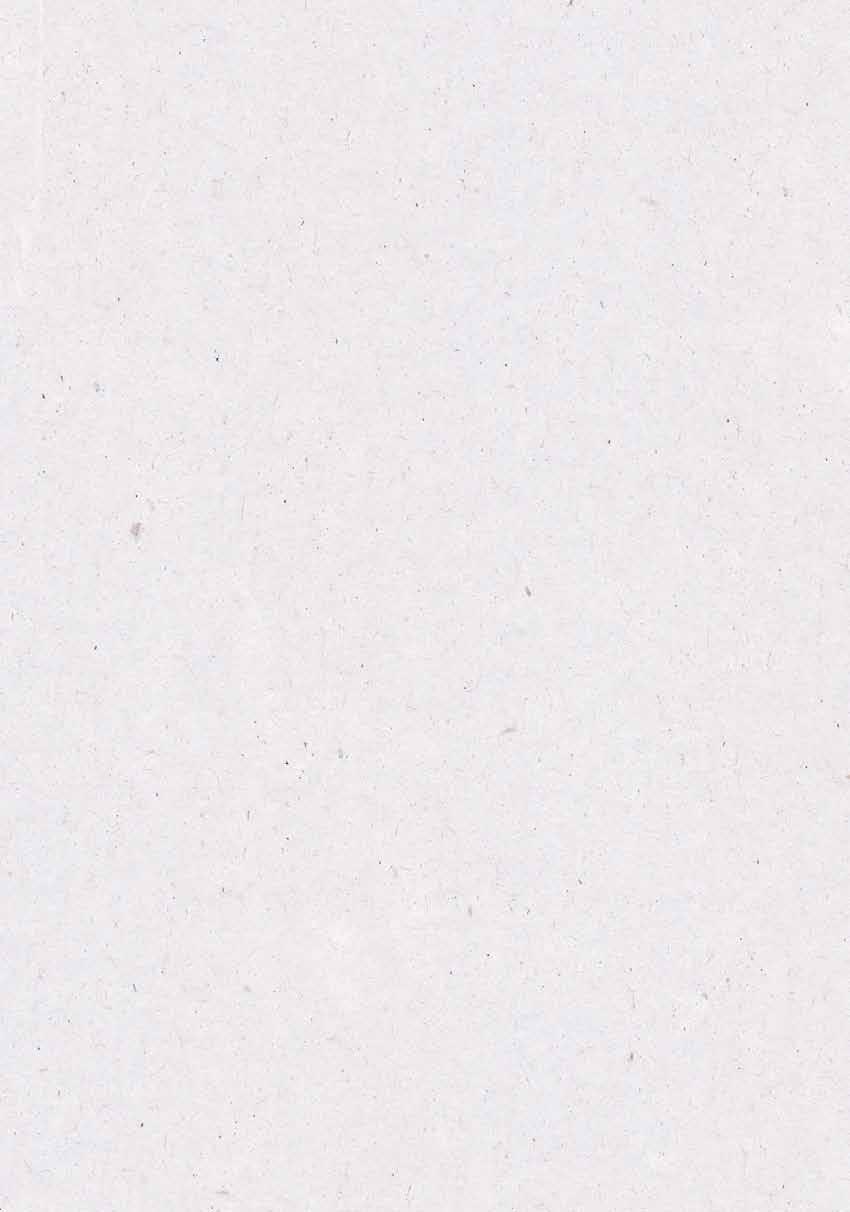
Voici la cinquième édition de ce livre mythique de Guy Lévis Mano. Édité une première fois en 1935 et réimprimé en 1967 ce long poème écrit sur le vif décrit l’ambiance de l’atelier et donne à voir, depuis les casses où gronde la révolte des caractères, la vie laborieuse des typographes et les rapports qu’ils entretiennent avec la lettre et les mots imprimés…
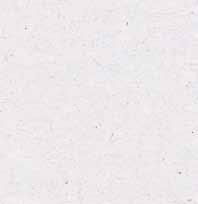
En 2011, Philippe Moreau et Samuel Autexier composent en typographie dans l’atelier d’Archétype à Forcalquier une nouvelle édition de l’ouvrage suivant la volonté testamentaire de l’auteur qui ne souhaitait pas une réédition à l’identique de ses livres. Ce projet soutenu par l’association Guy Lévis

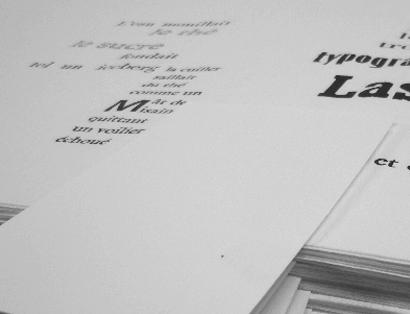
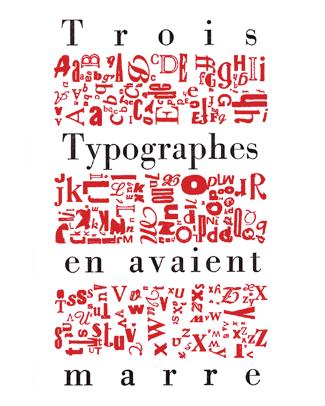
Parution : juin 2023
EAN : 9782914363280
Prix public : 13 €
Mano à Paris et Vercheny connaît un succès inattendu et est réimprimé en 2012.
C’est cette version qui fait l’objet aujourd’hui d’une nouvelle édition au format « poche » suivie d’une postface de Samuel Autexier qui présente la petite histoire de ce grand livre.
Composition de la page « i », planche en cours d’impression dans l’atelier Archétype en 2012
« La poésie nous asservit et ne nous assouvit pas »
Les auteurs

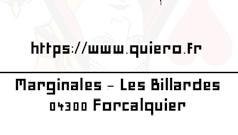
Guy Lévis Mano (1904-1980), poète, éditeur et typographe. Son œuvre poétique protéiforme se veut la plus proche possible de la rue et de la vie ouvrière qu’il fréquente. Elle est marquée dans un second temps par sa longue détention comme prisonnier de guerre entre 1940 et 1945. Son parcours d’éditeur, servi par un talent de typographe salué par tous comme un modèle de clarté et de liberté, lui a permis de donner forme entre 1935 et 1974 à plus de cinq cents ouvrages avec quelque uns des artistes les plus importants du XXe siècle (Éluard, Michaux, Breton, Jean Jouve, Jabès, Chédid, Char, Du Bouchet, Dupin, García Lorca, Kafka, Miró, Giacometti, Picasso, Man Ray, Dali, etc.).
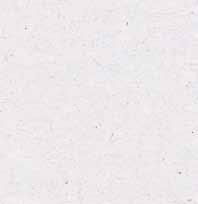
Philippe Moreau (né en 1948 à Asnières). Lithographe, typographe et imprimeur, spécialiste du livre d’artiste et des tirages limités. Il débute sa vie professionnelle à Paris chez Clot, Bramsen et Georges, avant de la poursuivre en Provence depuis 1976.




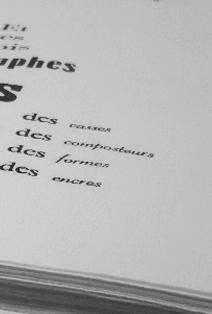
Samuel Autexier (né en 1969 en Suisse). Graphiste et éditeur, il fonde en 1993 la revue Propos de Campagne, avant de créer en 1999 la collection littéraire puis la revue Marginales chez Agone et enfin les éditions Quiero en 2010
Et le troisième dit

Nous courons sur des tumultes d’eau qui ne rafraîchissent pas les veines de notre imagination
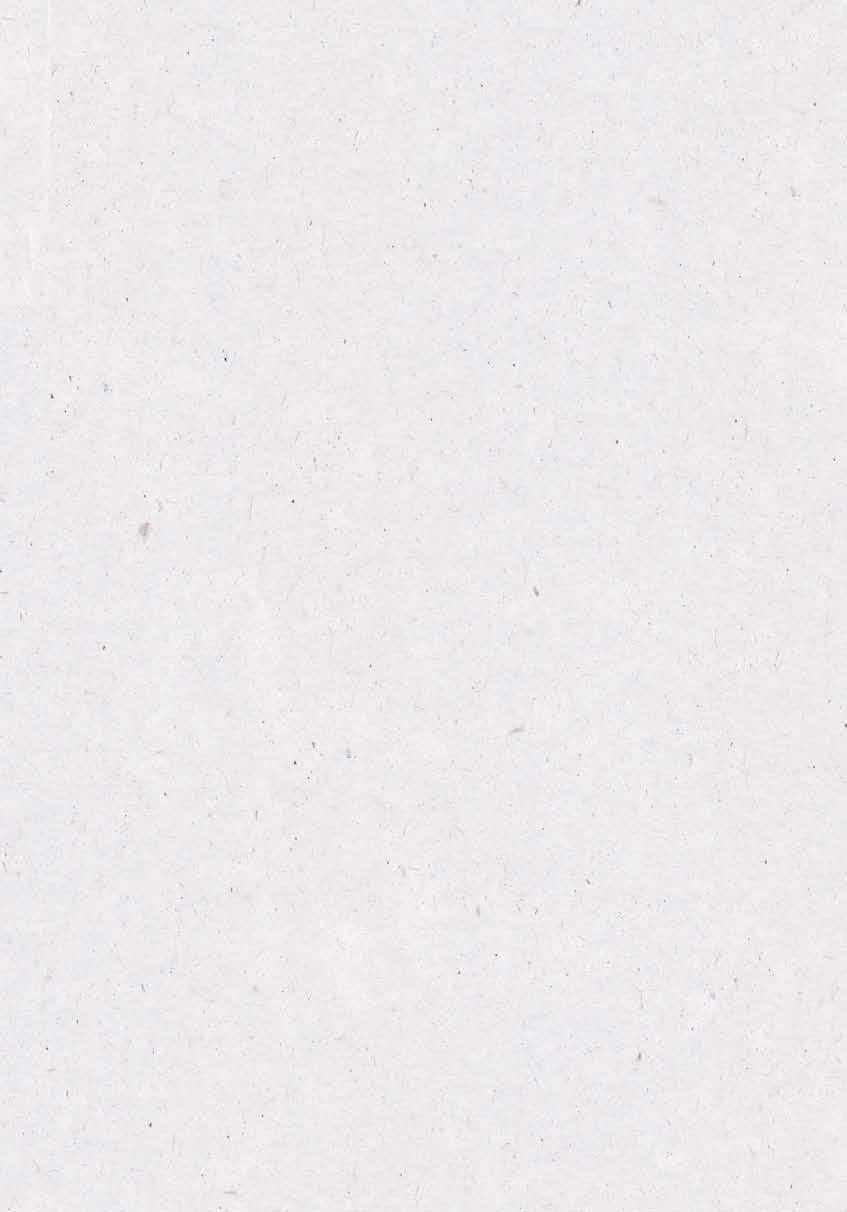
Nous attendons des robinets taris la chute polaire des eaux-de-vie qui désaltéreraient nos fuites désemparées accrochées à des nuages qui crèvent Nous cachons nos yeux dans nos poches et consultons le hasard en mélangeant Caslon Bodoni et Baskerville dans les composteurs
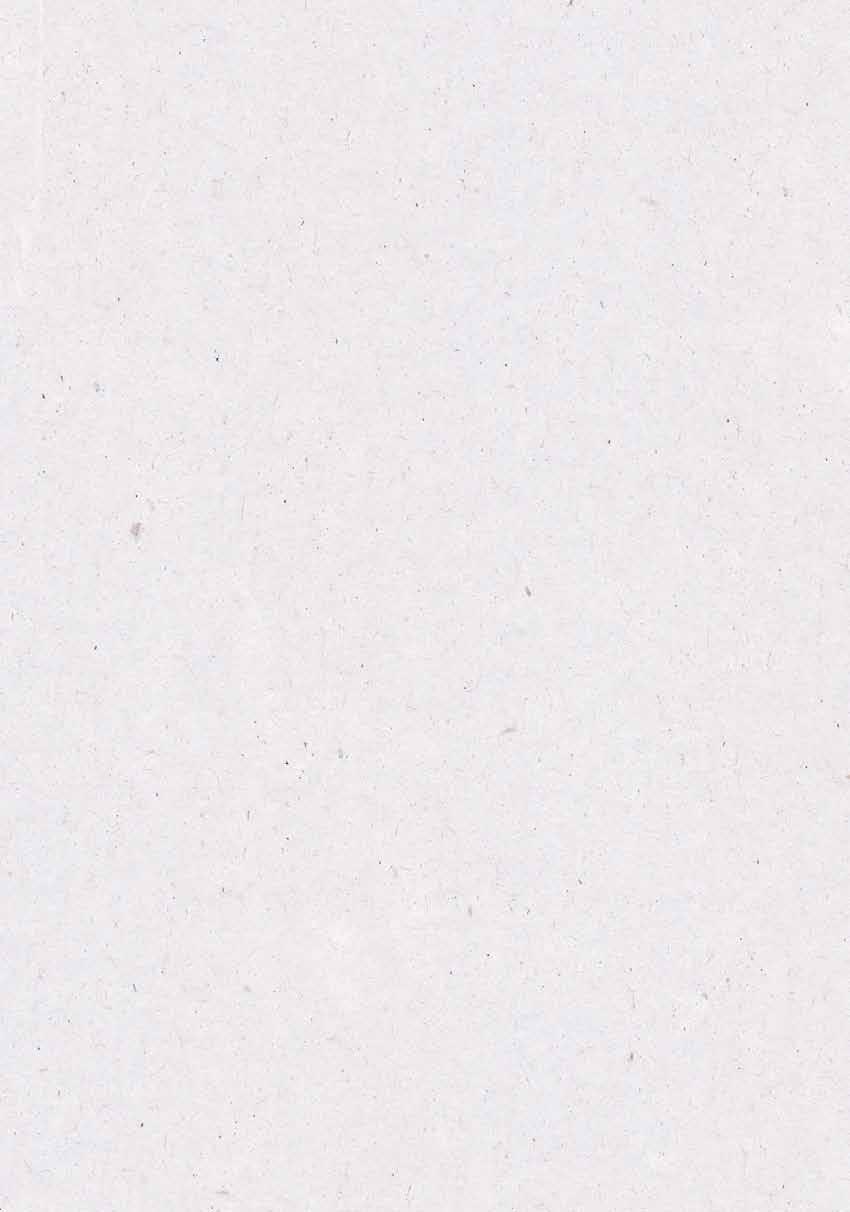 et portrait de Guy Lévis Mano par Pierre Kefer en 1935.
et portrait de Guy Lévis Mano par Pierre Kefer en 1935.
ÉRIC PESTY ÉDITEUR
Marie de Quatrebarbes
Vanités
Vanités est un texte composé de 36 scènes et demie.
Marie de Quatrebarbes le décrit comme un poème vitaliste, un livre d'histoire naturelle. « Il y est question de fleurs, de terre, d'insectes et de certaines lectures, deux auteurs surtout : Lucrèce et Michelet. C'est donc un livre matérialiste, ou sur le matérialisme ». Mais un matérialisme qui déborderait l’histoire humaine ; désignant l’élargissement du politique et de l’Histoire au « peuple » des insectes dont parle Michelet. Car en notre XXI° siècle, « Les murs de la cité volent en éclats », l’homme n’est plus au centre. De fait, par contraste avec l’auteur de l’Insecte qui, lors des sanglantes journées de juin 1848, avait pris refuge dans la forêt de Fontainebleau pour écrire son ouvrage, célébrant alors la Femme et l’Amour (hypothèse Dolf Oehler), Vanités se place ici du point de vue du « petit », de « l’innombrable » — où se révèle, par un effet d’anamorphose, la mort au premier plan : symbole de la disparition de l’homme au centre de l’événement.
« Du point de vue de la forme, il y a une recherche de régularité. Le vers est long, il poursuit son chemin vers la prose. Et la stabilité des poèmes dans la page correspond à une recherche de miniatures – que chaque page soit une petite scène, morte ou vive, ambivalente comme une vanité. »
Vanités est le deuxième livre que Marie de Quatrebarbes publie chez Éric Pesty Éditeur, après Gommage de tête en 2017, et dont il prend précisément, sinon singulièrement, la suite.
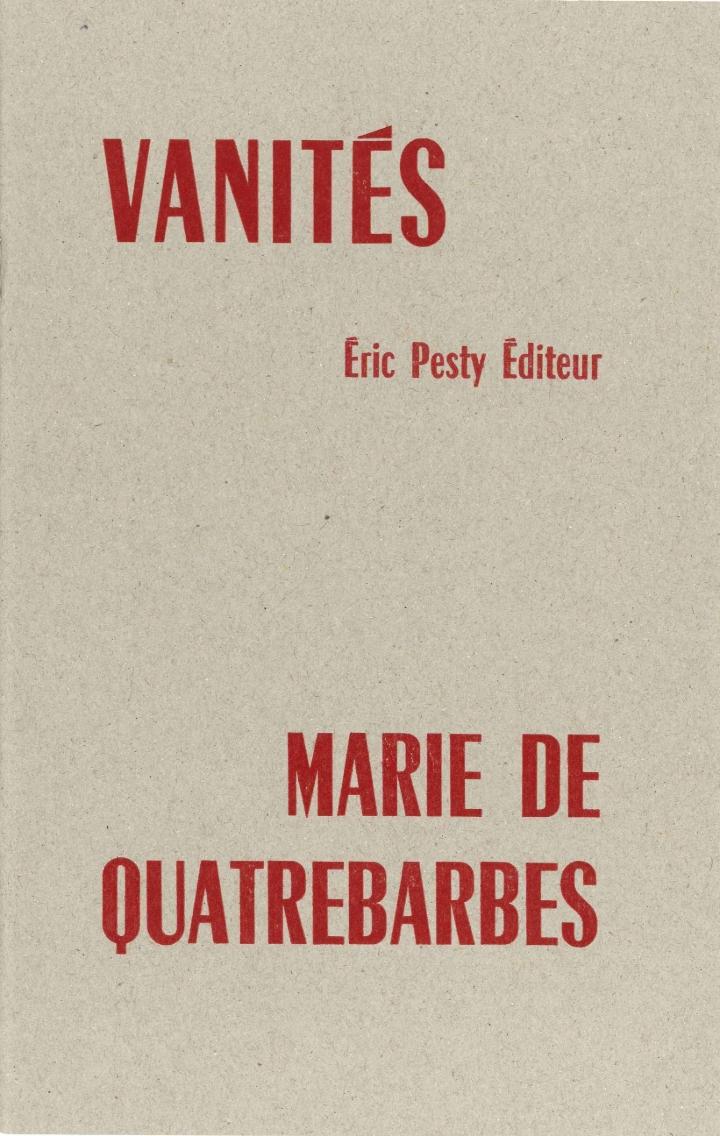
L’autrice :
Passée par l'École des Arts Décoratifs de Paris, Marie de Quatrebarbes est née en 1984. Elle a cofondé la structure éditoriale « La tête et les cornes » au sein de laquelle elle a animé la revue du même nom, et a réédité l'œuvre poétique de Michel Couturier en 2016 sous le titre : L’Ablatif absolu.
En 2019, Frédéric Boyer l'accueille au sein des éditions P.O.L avec la publication de Voguer. Deux livres ont paru depuis chez le même éditeur : Les vivres (2021) et Aby (2022).
En 2022 elle reprend avec Maël Guesdon la direction des éditions Corti.
Parution : avril 2023
Prix : 10 €
Pages : 40
Format : 14 x 22 cm
EAN : 9782917786802
Collection : agrafée
Rayon : poésie contemporaine
CONTACT PRESSE ET LIBRAIRE
Éric Pesty : contact@ericpestyediteur.com
« nous sommes seuls dans le livre dont on éteint les lampes »
éditions
genre poésie
thèmes
LGBTQIA+ intersexuation, transidentité sport, Allemagne nazie
fiche technique
112 pages offset noir brochures cousues collées
format 11x18 cm
prix 18 €
parution le 02/12/2022
contact
diffusion
Paon diffusion paon.diffusion@gmail.com
distribution
Serendip-livres contact@serendip-livres.fr
édition
Hourra contact@editions-hourra.net
Le recueil de poèmes En habits de femme nous plonge dans la vie et l’intimité de Dora Ratjen, une athlète intersexe qui a défendu les couleurs nazies dans les années 1930. Avec une sobriété dans le verbe, une écriture clinique aux allures d’archives, ce livre nous apparaît comme une enquête historique qui vient questionner aujourd’hui les injonctions normatives de genre.
Les poèmes sont accompagnés d’une très riche iconographie établie par l’auteur.
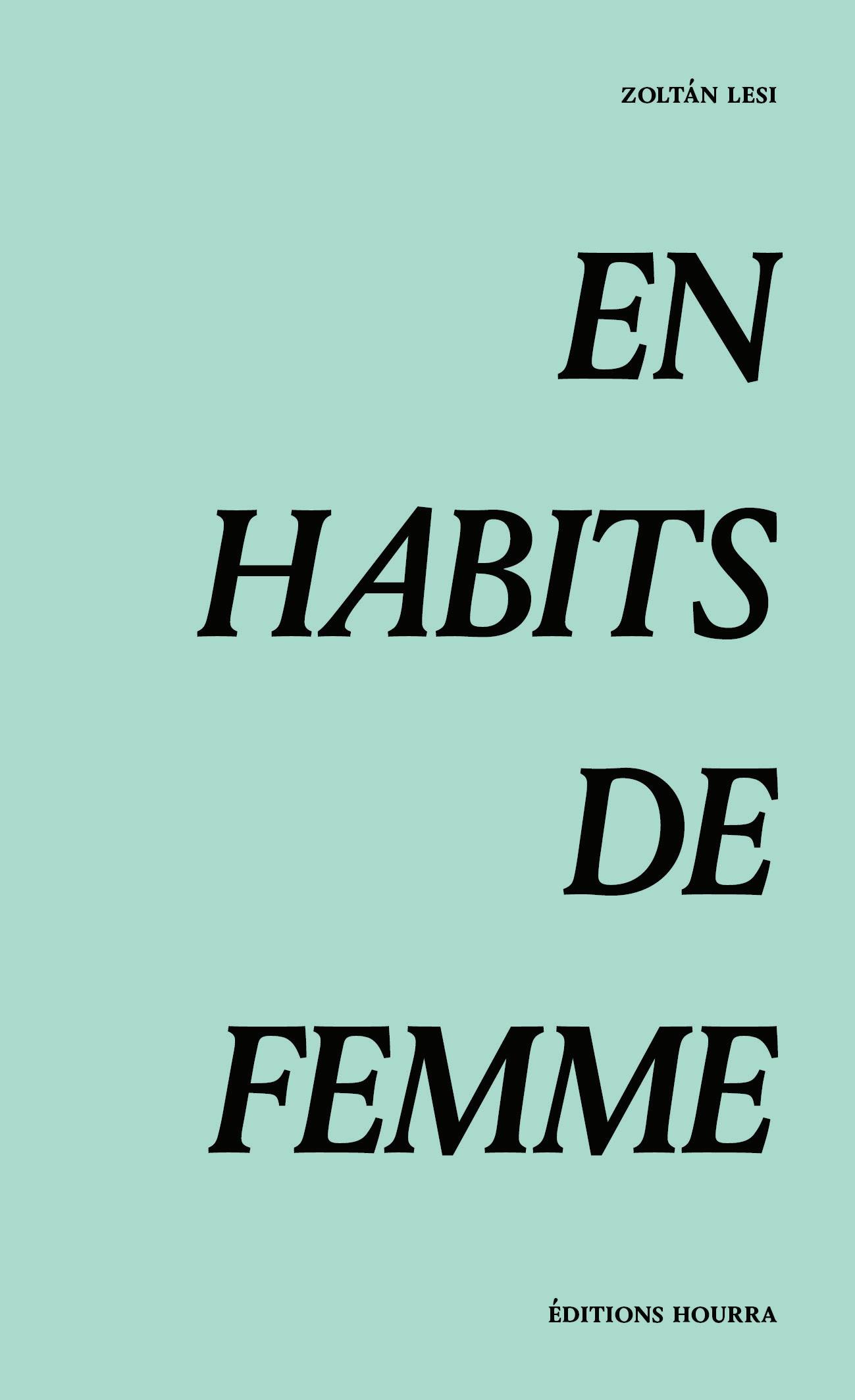
habits de femme — Zoltán Lesi isbn 978-2-491297-04-6 poésie contemporaine
Hourra En
le livre
En habits de femme est un recueil de poèmes établi par l’auteur Zoltán Lesi. Ce livre, écrit en allemand, a été publié pour la première fois en Autriche en 2019.
Ce livre est un ensemble de poèmes aux allures de documents, assemblés comme une suite de lettres et d’articles, où les destinataires sont des personnages historiques. Le lecteur est pris dans une enquête à la fois sensible et historique autour de l’histoire de Dora Ratjen, athlète intersexe qui a concouru en tant que femme pour l’Allemagne nazie.
L’ensemble poétique met en regard la biographie de Dora Ratjen avec celles de Gretel Bergmann, sa concurrente juive, Stella Walsh, une athlète intersexe américaine, ou encore Rrose Sélavy, l’alter-égo féminin de Marcel Duchamp. Dans ce livre, Zoltán Lesi a l’audace de faire parler des personnages historiques, et de provoquer des rencontres inédites.
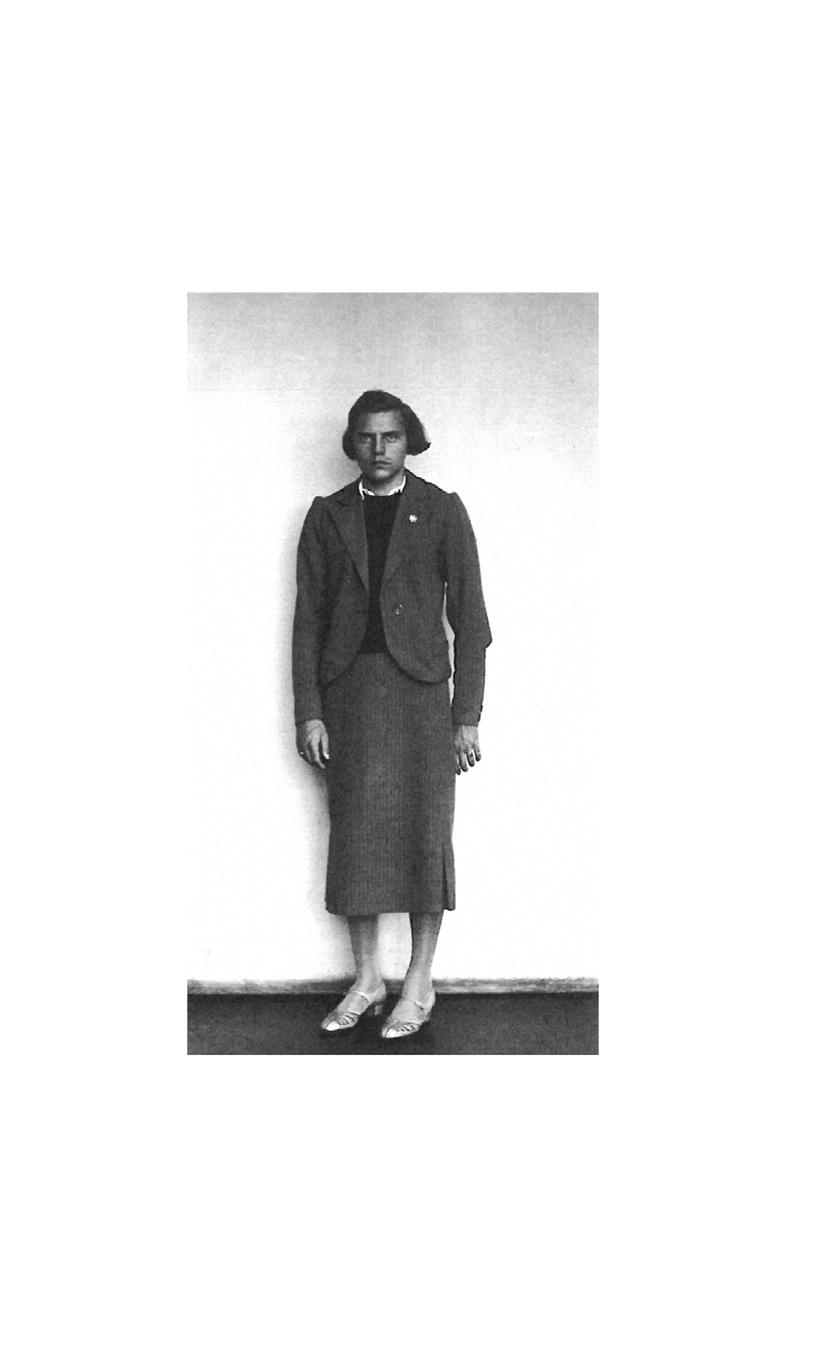
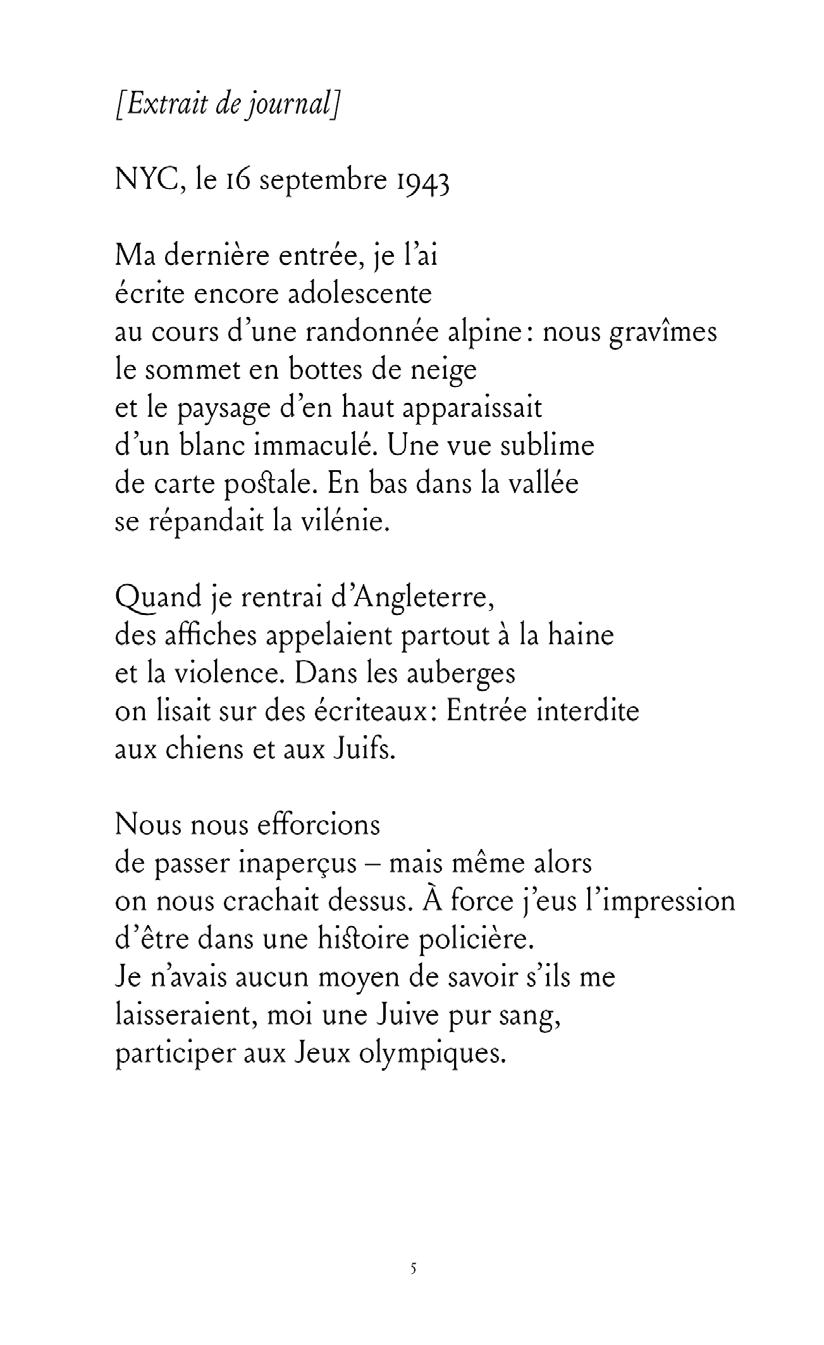
Ce livre est précieux tant il nous alerte sur la continuité historique d’une discrimination, celle des personnes intersexes, et d’une nécessité de rompre avec la binarité des institutions, ici sportives ou policières. Le texte, qui utilise un retour chariot percutant, s’affaire à créer un trouble, entre la littérature et l’histoire, entre la fiction et le documentaire, entre la poésie et l’archive, entre deux genres finalement.
Les textes sont accompagnés d’une sélection d’images d’archive choisies par l’auteur. L’iconographie mêle photographies d’époque, coupures de presse et fichiers de police. L’édition originale ayant remporté un prix national de design en Autriche, l’édition française se veut graphiquement cohérente et fidèle à l’esprit originel.
Le texte est traduit à quatre mains, depuis l’allemand (Autriche), par Christophe Lucchese et Sven Wachowiak.
l’auteur
Zoltán Lesi, né en 1982 en Hongrie, vit et travaille entre Vienne (Autriche) et Budapest (Hongrie). Il a publié plusieurs recueils de poésie et livres pour enfants, et par ses traductions, il cherche à faciliter les échanges entre la littérature autrichienne et hongroise. Son travail a fait l’objet de plusieurs traductions dans le monde.
isbn
poésie contemporaine
éditions Hourra En habits de femme — Zoltán Lesi
978-2-491297-04-6
978-2-491297-04-6
En habits de femme — Zoltán Lesi
isbn 978-2-491297-04-6 poésie contemporaine
la maison d’édition
— Honneur à celles par qui le scandale arrive !
Hourra : 1. cri de joie 2. cri de guerre
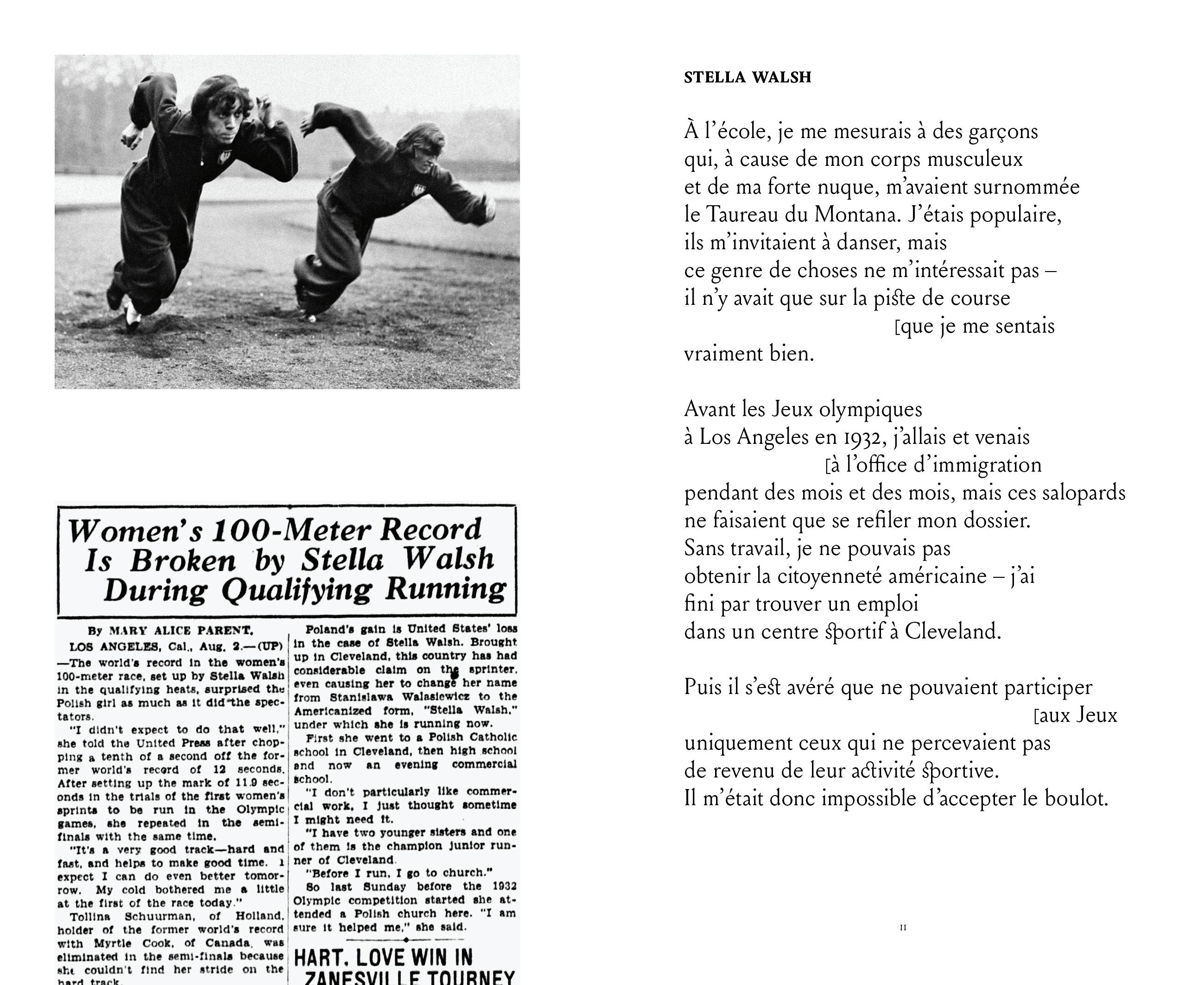
Les éditions Hourra publient de la poésie et des écrits sur l’art. Créée en 2019 sur la montagne limousine, la maison naît de l’envie de défendre des pratiques d’écritures marginales où se rencontrent le poétique et le politique. Fruit d’amitiés et d’intuitions communes, elle réunit des artistes et des autrices pour qui la révolte fait corps avec la beauté.
éditions Hourra |36, avenue Porte de la Corrèze |19170 Lacelle www.editions-hourra.net
éditions Hourra

En librairie décembre 2023
Format : 24 x 24 cm
Pages : 84 p.
Reliure : broché
Illustrations : quadrichromie
rayon : photo
Prix : 23€ / 30 CHF
ISBN 978-2-8290-0681-4

La charité, c’est noyer le droit dans la fosse à purin de la pitié
Riccardo Willig, Yann Cerf, Verena Keller
DIFFUSION ET DISTRIBUTION SUISSE
Éditions d’en bas
Rue des Côtes-de-Montbenon 30
1003 Lausanne
021 323 39 18
contact@enbas.ch / www.enbas.net
PRÉSENTATION
Pendant deux ans, le photographe Riccardo Willig a pris des photos des personnes qui se rencontrent à la Fondation Carrefour-Rue & Coulou: des « bénéficiaires », des bénévoles, des salarié:es et des donateurs. Avec le projet d'un livre, il s'est tourné vers deux spécialistes dans le domaine des pauvretés, Verena Keller et Yann Cerf. Les trois auteur:es font dialoguer les images et les mots : comment rendre compte de réalités généralement invisibles et pourtant si souvent sous les yeux de tout le monde?
Comment éviter le misérabilisme, l'intrusion, la sensiblerie ? Comment aborder la bonne conscience que confère la charité ? Comment exprimer le respect dû à des organisations qui assurent la survie de nombreuses personnes tout en s'étonnant, ou se révoltant, face à tant de pauvreté dans tant de richesse ?
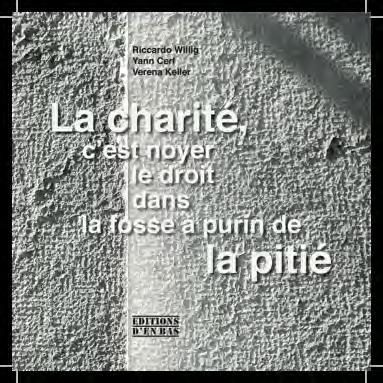
L'intention de ce livre est triple : rendre un peu plus visible une action humanitaire à Genève, montrer son contexte social et politique, interroger la tension entre charité et droits sociaux.
AUTEUR :ES
Riccardo Willig, photographe, Genève
Verena Keller, professeure honoraire Haute école de travail social et de la santé Lausanne
Yann Cerf, anthropologue, assistant de recherche Haute école de travail social Genève
DIFFUSION ET DISTRIBUTION FRANCE
Paon diffusion/SERENDIP livres

Paon diffusion – 44 rue Auguste Poullain – 93200 SAINT-DENIS
SERENDIP livres – 21 bis rue Arnold Géraux 93450 L'Île-St-Denis
+33 140.38.18.14
contact@serendip-livres.fr
gencod dilicom 3019000119404
Tél : 01.43.58.74.11 | Fax : 01.72.71.84.51 | commande@pollen-diffusion.com | Dilicom : 3012410370014

À paraître, janvier 2024
éditions Lorelei, coll. « Frictions »
60 p., 17 × 10,7 cm
ISBN : 978-2-9584193-1-8
Les designers graphiques produisent des images à l’équilibre : sufsamment visibles et séduisantes, elles doivent, dans le même temps, s’efacer derrière les informations qu’elles portent.
Les graphistes composent ainsi avec les spécifcités des « messages » qu’ils ont à charge de mettre en page et avec les nécessaires inventions formelles qu’exige leur publicité. Ils cherchent un consensus formel capable d’accorder toutes les parties, du destinateur au destinataire. Depuis ces conditions, comment agir lorsque l’énonciation du « message » à transmettre ou sa réception à venir enrayent la machine ?
Cet essai explore la possibilité pour les designers d’accueillir le confit à travers l’étude de trois projets de graphisme réalisés pour des expositions ; soient quelques afches et un journal bouleversés par l’apparition d’une situation politique qui trouve en eux une scène où se déployer.
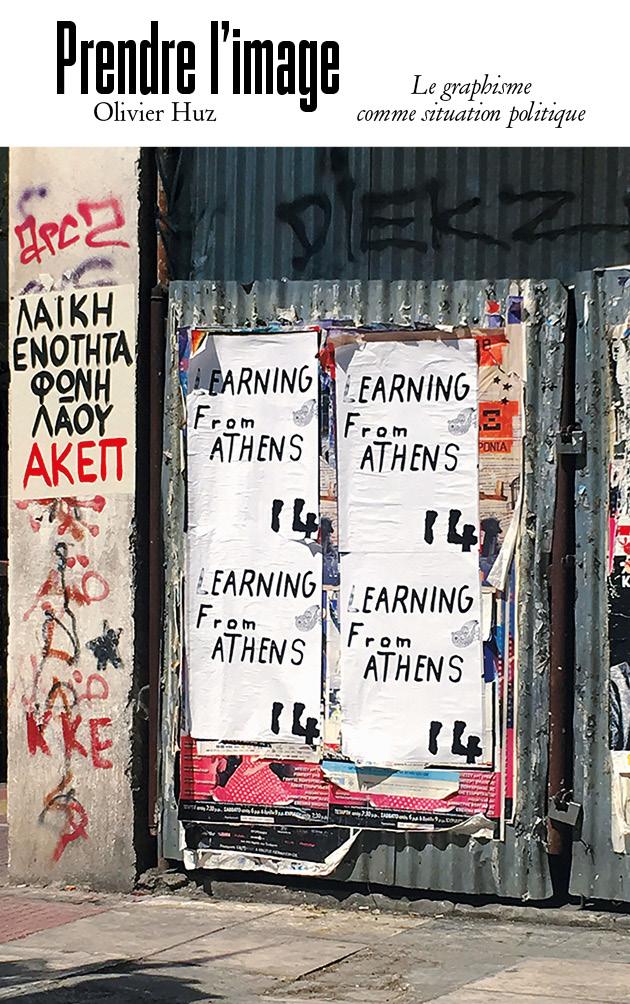 Pages suivantes : extraits [version de travail]
Pages suivantes : extraits [version de travail]

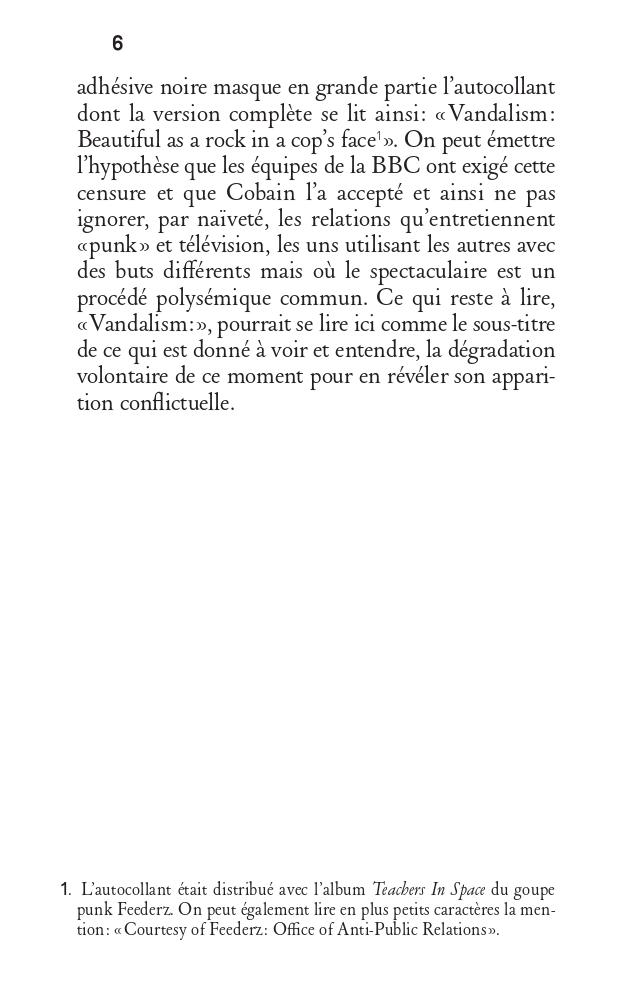

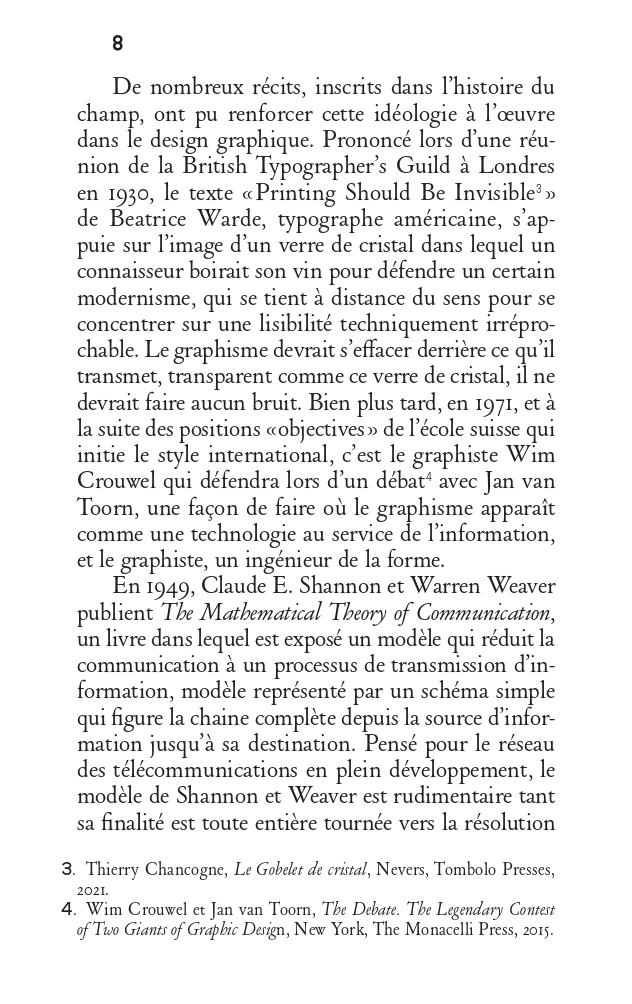


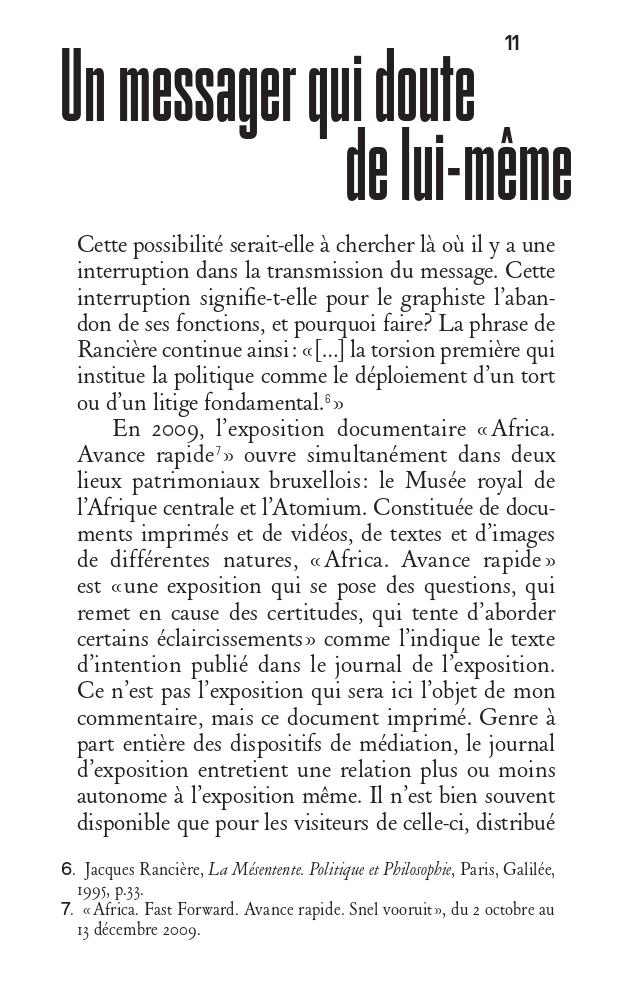



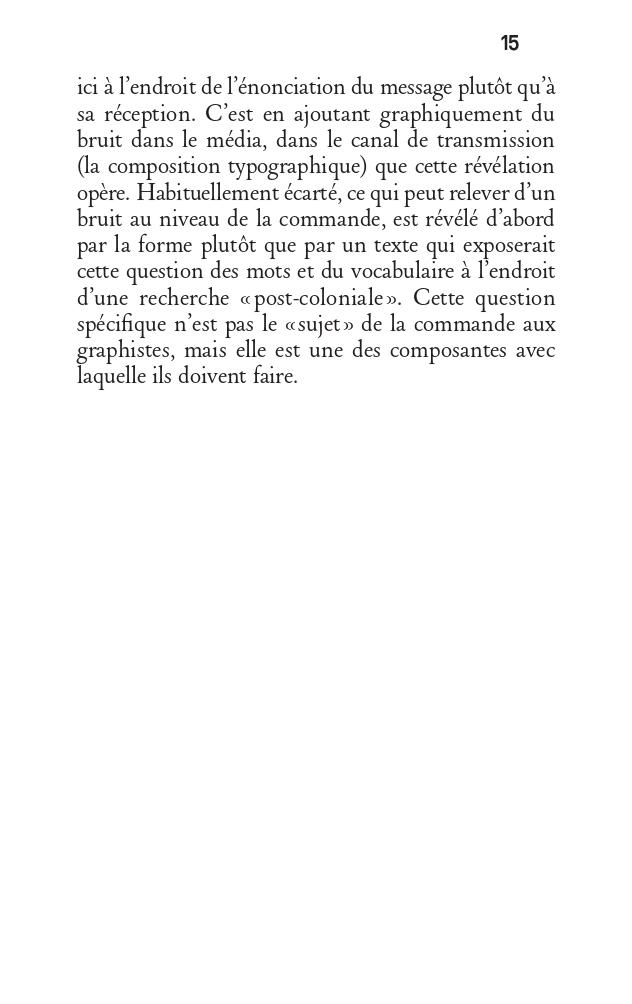
À paraître, janvier 2024
éditions Lorelei, coll. « Frictions »
60 p., 17 × 10,7 cm
ISBN : 978-2-9584193-2-5
L’art s’inscrit au sein de relations sociales interindividuelles et de rapports sociaux collectifs — il en dépend, et en produit. Pour cette raison, il est investi d’une valeur sociale, souvent appréhendée comme positive en soi selon une approche qui tend à occulter que la socialité est faite entre autres d’antagonismes, de dissensus, de confits.
Précisément, cet ouvrage chercher à penser la place du confit social en art et le rôle possible de l’art dans les confits sociaux à partir de la circonstance de la grève. De la représentation à la participation active, de la défense des conditions de travail à la remise en cause du travail lui-même, les artistes entretiennent un rapport hétérogène à la grève, ici observé à partir de quelques cas d’étude.
En pensant les articulations entre art et confictualité sociale qui se jouent là, il s’agit de se demander une nouvelle fois en quoi et de quelles manières l’art peut-il être politique.
Pages suivantes : extraits [version de travail]
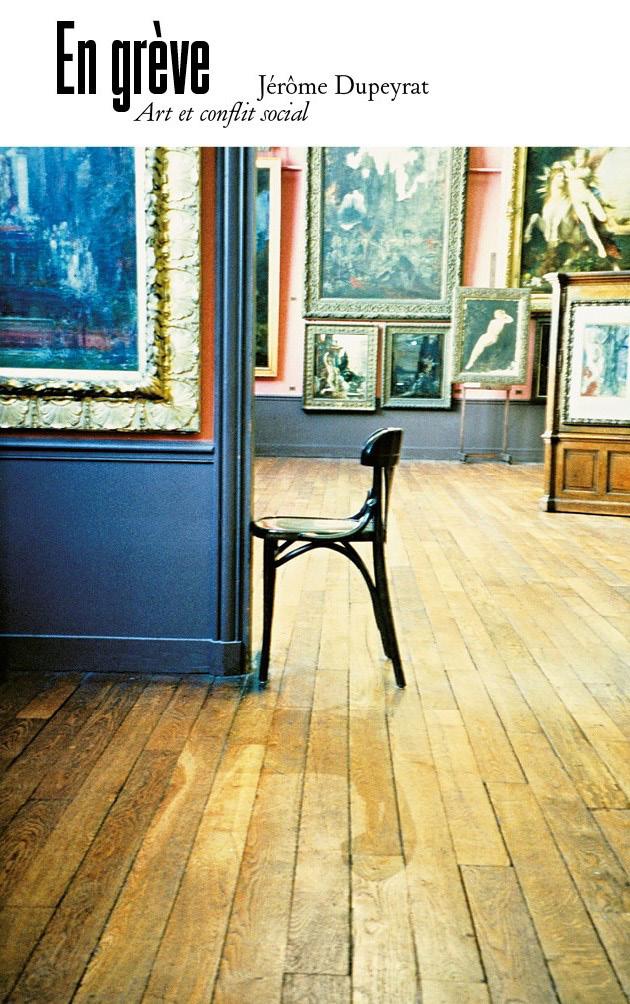
[…] Laurent Marissal mène une démarche consistant à se réapproprier un travail salarié — gardien de salle au Musée Gustave Moreau à Paris — pour en faire l'espace-temps de sa pratique artistique, position qui a pour corollaire de faire d'un engagement syndical une pratique picturale d'un nouveau genre : « Eté 1993, peintre, je suis employé comme agent de surveillance au musée Gustave Moreau. D’avril 1997 à janvier 2002, je fais de cette aliénation la matière de ma pratique. J’utilise à des fins picturales le temps de travail vendu au ministère de la culture. […] À son insu, le musée rémunère une production dont il n’aura pas la jouissance. Ce rapt est systématisé. Hiver 1998, j’ouvre une section syndicale CGT, outil administratif, pour concrétiser mon projet pictural : modifier réellement les conditions, le temps et l’espace de travail. Décembre 2001, je prends congé du ministère de la culture et quitte la CGT. Printemps 2002, je lève un coin du voile... 1 »
Ainsi, durant la période concernée, Laurent Marissal travaille pour lui : subrepticement, il remplit des carnets ; il lit des livres (ce qui, initialement, lui était interdit par sa hiérarchie) ; il réalise des actions artistiques furtives, tel que laisser la marque de ses doigts dans des encoignures fraichement repeinte, de sorte à littéralement « indexer » le musée, ou retourner une chaise de gardien, comme pour signifier une absence ou un refus, ou exposer une canette de jus d'orange sur la crédence d'une cheminée, ou encore déplacer les pièces du jeu d'échecs de Gustave Moreau, mis en vue dans l'une des salles du musée, selon un cycle défini par le son des cloches alentours. Il organise également dans le musée des expositions clandestines avec ses amis artistes, ou profite de la venue d’un photographe du Parisien Libéré pour figurer dans le champ de chacune des photos prises par le reporter. Il édite enfin un bulletin syndical intitulée Le Cartel, Livret des musées USPAC CGT , qui joue un rôle informatif auprès des syndiqués de l'ensemble des musées de la direction des Musées de France, tout en lui offrant la possibilité d'y glisser diverses interventions artistiques, sous des formes graphiques ou textuelles.
De plus, à l'issue d'une lutte syndicale qu'il initie suite à la création d'une section CGT au sein du musée — avec « grèves, manifestations, réunions houleuse, éclats de voix2 » —, Laurent Marissal et ses collègues obtiennent des transformations concrètes de leur conditions de travail : droit de discussion entre les agents, droit de lecture, réduction du temps de travail, augmentation de la salle de pause. Si les acquis profitent à tout le monde, ils se doublent pour Laurent Marissal d'une signification artistique, la transformation des conditions matérielles de travail équivalant pour lui à une action picturale menée non avec des pigments, mais à l'appui du droit du travail, et avec le temps et l'espace : « on pense trop souvent ce travail comme le fruit d'un artiste "militant" mais il est plus proche de Gordon Matta Clarck que de Maïakovski 3 », souligne l'artiste. Par là, Laurent Marissal se réfère à la pratique anarchitecturale de l'artiste états-uniens, dont l'œuvre aura reposé en grande partie sur la transformation matérielle d'espaces batis, par des gestes de découpes. Il y a une autre dimension du travail de Gordon Matta-Clark, liée à sa nature post-conceptuelle, que l'on peut également retrouver chez Laurent Marissal, à savoir la démultiplications des œuvres en plusieurs instances4. Chez le premier : interventions sculpturales in situ – traces photos et vidéos –photomontages. Chez le second : actions furtives de type performatives (bien qu'anti-spectaculaires) – témoignages photographiques, textuels et graphiques.
1 Laurent Marissal, Pinxit, 1997-2003, Rennes, Incertain Sens, 2005, p. 3.
2 Échange mail avec l'artiste, 1er février 2022.
3 Idem.
4 Sur cette notion et son application au travail de Gordon Matta-Clark notamment, cf. Peter Osborne, Anywhere Or Not at All: Philosophy of Contemporary Art , Londres, Verso Books, 2013.
À ce titre, la trace principale et, plus que cela, l'une des formes à part entière du travail mené par Laurent Marissal au sein du Musée Gustave Moreau, est le livre Pinxit – Laurent Marissal – 19972003. Cet ouvrage prend la forme d'une chronique composée de la documentation photographique de ses actions discrètes ou furtives, de notices, de notes, de récits, de paroles transcrites, de correspondances, de communiqués et de tracts, de coupures de presse. C'est par ce livre que peut se constituer un « public témoin » de l'œuvre — « public déterminé par sa connaissance du projet de l'artiste » — qui n'est pas nécessairement le même que « le public destinataire, qui se confond, lui, à l'ensemble des personnes susceptibles de rencontrer l'œuvre in vivo, en acte, ou plutôt l'une de ses manifestations5 », sans forcément avoir connaissance des implications artistiques (sans l'exclure non plus).
La lecture de Pinxit explicite en quoi le temps désaliéné, repris par Laurent Marissal à son employeur, relève pour lui d'une forme « d'action picturale », complétée par une « action picturale syndicale », car ce faisant il s'agit de transformer les conditions du sensible, considérées non comme relevant de simple facultés biologiques ou subjectives, mais comme résultants de rapports sociaux. Comme l'écrit Painterman, l'alter-ego de Laurent Marissal : « voir les antagonismes, c'est déjà peindre6 » : peindre des rapports, peindre les conditions de production de la peinture.
Au titre de l'action (picturale) syndicale, la grève est parmi d'autres modalités un outil pour l'artiste. Lui et ses collègues auront déclenché plusieurs journées effectives de grève, et utilisé sa menace comme levier à d'autres reprises. Dans Pinxit, un extrait de la plateforme de revendications réalisée avec les agents d'accueil du Musée Gustave Moreau le 4 décembre 1997 se conclue par ses mots : « Enfin nous précisons qu'aux prochaines agressions verbales, qui deviennent depuis quelques temps un mode habituel de communication utilisé par la direction, sera déposé en réponse un préavis de grève7 ». Plus loin, une double-page rubriquée sous le titre « Les grèves (Art is hostage) », propose un assemblage de documents : sur la page de gauche, deux photographies de petits formats montrent, pour l'une, les portes du Musée fermées, avec l'affichage d'un mot manuscrit signalant la grève et d'un tract syndical (visibles par un détail en pleine page à droite), et pour l'autre, des agents en train de manifester dans la cour d'honneur du Palais Royal, siège du Ministère de la Culture. Deux citations, respectivement du sociologue et philosophe Robert Linhart et du président du Medef, Ernest Antoine Seillière, sont également reproduites, ainsi que deux notes rédigées par l'artiste :
Rendre visible l'invisible
Mercredi 24 juin et lundi 6 juillet 1998
Le matin après un cours laïus où j'insiste sur la nécessaire réaction à l'aliénation, le gain symbolique, la crédibilité de l'action syndicale sur le site, les gens votent l'arrêt de travail.
Le musée n'avait jamais été fermé, de son histoire, pour cause de grève... Cette action me procure cette douce jouissance picturale : rendre visible l'invisibilité des œuvres de ce musée.
Le pli
Été 1999
Lors du mouvement contre la précarité je suis encore en formation continue. Je réalise tout de même quelques assemblées générales au musée. Ne risquant rien, n'étant pas comptabilisable comme gréviste, j'ai beau jeu d'inviter mes camarades à faire grève... Mais le pli est pris, je n'ai pas beaucoup à les convaincre : une dizaine de jours de grève les mobilisent8.
5 Partrice Loubier, « Un art à fleur de réel : considérations sur l'action furtive », Inter, n°81, printemps 2002, p. 16.
6 Échange mail avec l'artiste, 1er février 2022.
7 Laurent Marissal, Pinxit, op. cit. , p. 105.
8 Ibid., p. 116-117.
Ainsi, dans le cas de Laurent Marissal, la grève — plus largement le conflit social — ne doit pas être représentée, mais réalisée. Certes, tout artiste, par la position qu'il ou elle se trouve occuper, n'est pas toujours en position d'être gréviste. Mais il peut alors à tout le moins ne pas apaiser la porter antagonique du conflit et tâcher plutôt de le faire vivre sur son terrain d'activité. À ce titre, il est une autre grève qui aura rencontré, et même percuté, le parcours de Laurent Marissal, après la cessation de son emploi de gardien de musée.
À paraître, janvier 2024
éditions Lorelei, coll. « Frictions »
60 p., 17 × 10,7 cm
ISBN : 978-2-9584193-3-2
Avec un intérêt commun, celui d’agir depuis le champ de l’art face aux violences des politiques migratoires, les co-auteur·trices de ce livre ont élaboré des travaux performatifs qui font se répondre droit des étrangers et droit d’auteur à travers trois projets : X et Y/Préfet de. Plaidoirie pour une jurisprudence, Bureau des dépositions et karma
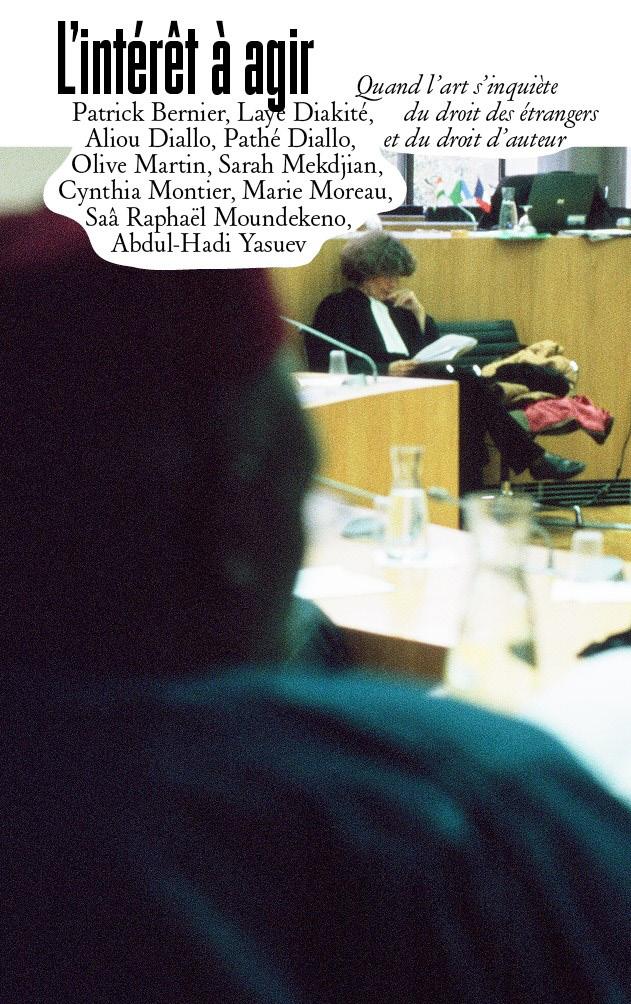
Alors que le droit des étrangers, associé à une politique des frontières, rend clandestin, exploite, laisse mourir, le droit d’auteur est ici saisi pour exercer le droit commun d’œuvrer, en défendant l’intégrité d’œuvres qui ne peuvent exister sans la présence physique de l’ensemble des co-auteur·trices qui les performent.
Ce texte choral pourrait être un geste-amorce pour élargir un intérêt à agir collectif, adressé aux institutions de l’art et de la justice, aux auteur·trices et à l’ensemble des lecteur·trices.
Pages suivantes : extraits [version de travail]
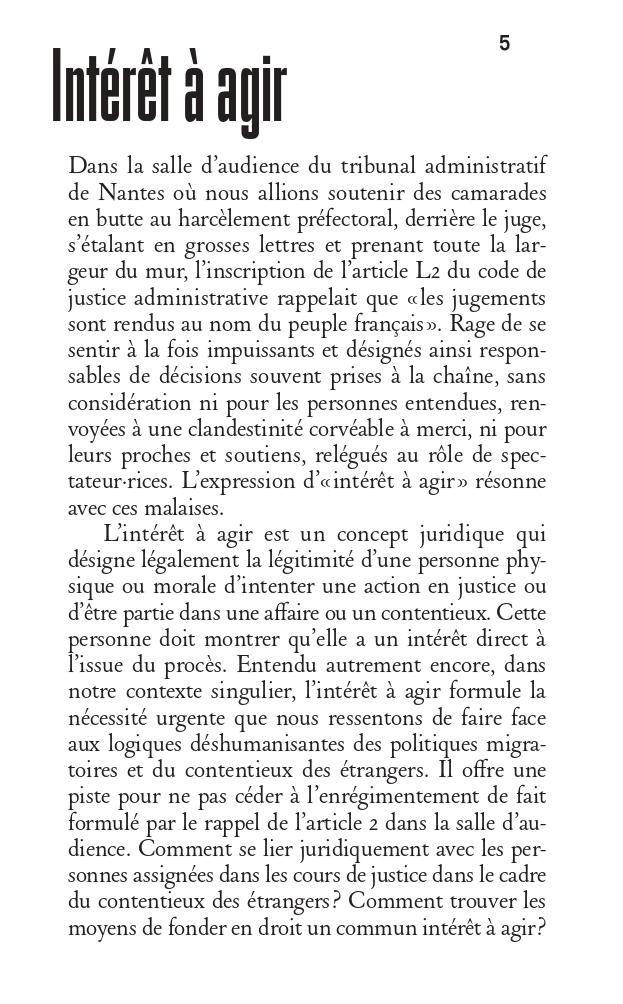
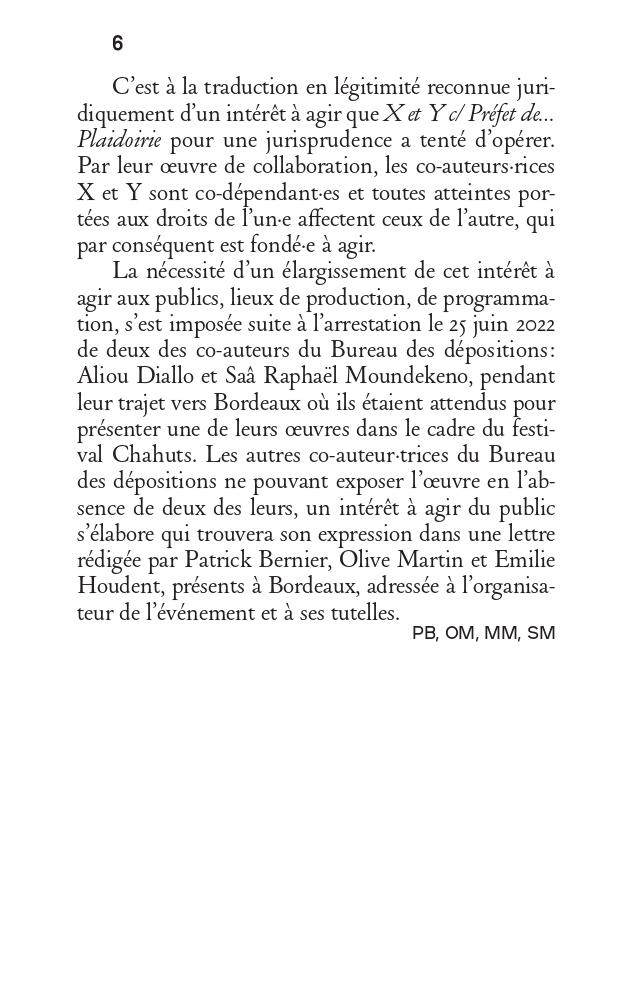

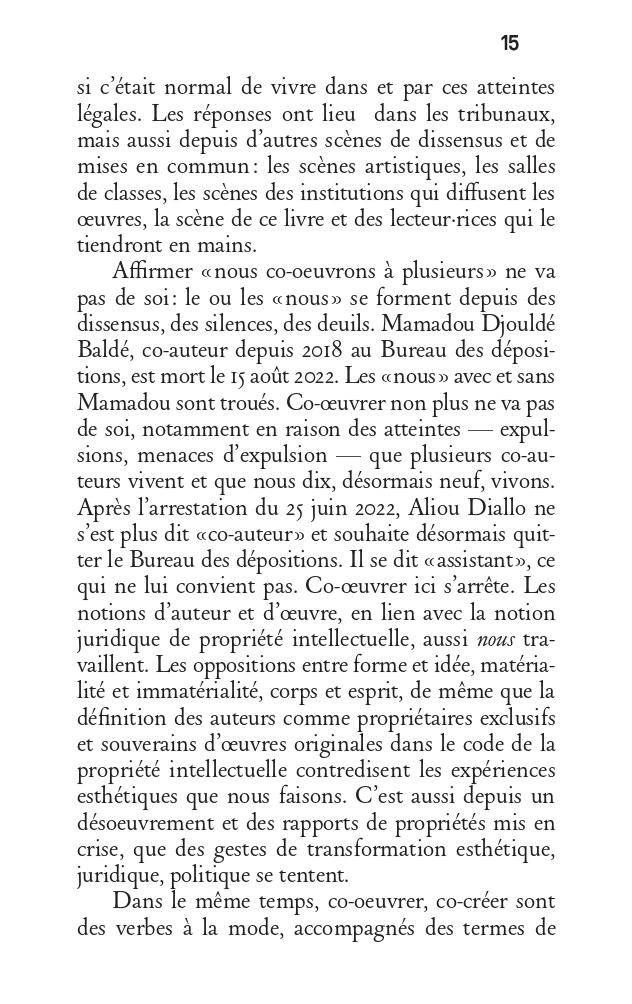

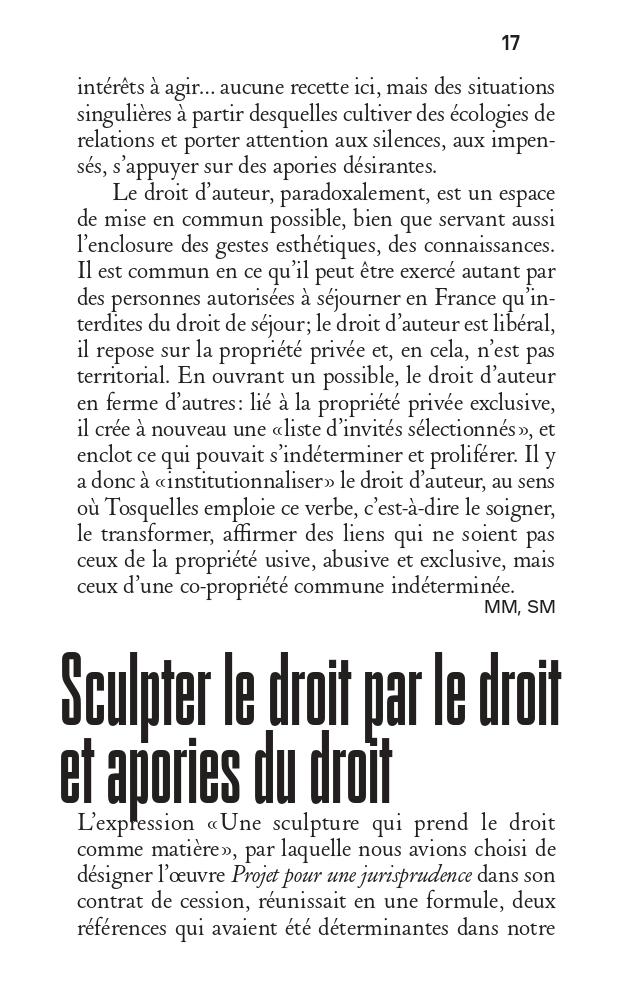


Récits du bas seuil
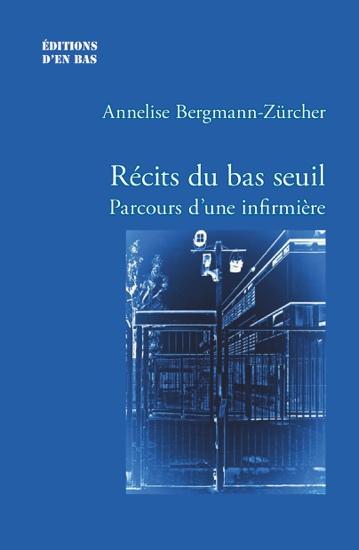
Parcours d’une infirmière
Annelise Bergmann-Zürcher PRÉSENTATION
Un livre coup de poing, coup au cœur, un témoignage d’infirmière qui a travaillé plus de dix ans dans un centre d’accueil pour requérants d’asile en Suisse. Vibrant, violent, un récit rigoureusement authentique, dur mais ménageant des espaces d’humour et de tendresse.
Le plaidoyer d’une femme, d’une mère, d’une soignante, pour faire connaître les trajectoires de nos frères et sœurs en humanité et adoucir un peu notre regard sur leur altérité.
En librairie janvier 2024
Format : 14 x 21 cm
Pages : 90 p.
Reliure : broché, collé
rayon : Littérature
Prix : 16 € / 25 CHF
ISBN 978-2-8290-0677-7
DIFFUSION ET DISTRIBUTION SUISSE
Éditions d’en bas
Rue des Côtes-de-Montbenon 30
1003 Lausanne
021 323 39 18
contact@enbas.ch / www.enbas.net
DIFFUSION ET DISTRIBUTION FRANCE
Paon diffusion/SERENDIP livres

AUTRICE
Annelise Bergmann-Zürcher est née en 1968 à Lausanne. Après un baccalauréat latin-anglais elle se forme en tant qu’infirmière. Elle choisit d’exercer son métier à temps partiel dans un parcours plutôt atypique ; des soins à domicile dans son petit village à l’accueil de nuit d’urgence en sleep-in, des visites en prison au centre d’hébergement des migrants, ou dans l’accompagnement de personnes dans la prostitution. Elle et son mari ont quatre enfants, et vivent dans la campagne vaudoise.
Paon diffusion – 44 rue Auguste Poullain – 93200 SAINT-DENIS
SERENDIP livres – 21 bis rue Arnold Géraux 93450 L'Île-St-Denis
+33 140.38.18.14
contact@serendip-livres.fr
gencod dilicom 3019000119404

population type des migrants, déjà : il y a une dizaine d’année, dans les années 2010 à 2015 environ, je voyais défiler parfois une cinquantaine de requérants par jour, mais il s’agissait principalement de jeunes hommes ou de quelques jeunes filles en relative bonne santé, qui, dans les grandes lignes, avaient été envoyés par leur communauté comme force vive, pour travailler et envoyer de l’argent au pays. Ou d’opposants politiques, d’objecteurs fuyant le recrutement militaire obligatoire, mais dont le cheminement était assez linéaire et plutôt rapide. J’entendais des histoires horribles, elles portaient sur des faits, des exactions subies par certains individus. Comme soignants nous étions beaucoup confrontés à des pathologies dues aux mauvaises conditions de voyage, ou à la promiscuité qui régnait dans les hébergements de fortune sur le trajet migratoire. Ce pouvait être de la gale, très souvent, que j’ai dû apprendre à identifier et à soigner ; ce pouvait être des ulcères sur des pieds et chevilles qui avaient été mouillés par l’eau de mer pendant des heures et des heures sur un bateau à demi immergé lors de la traversée de la méditerranée. Ce pouvait être parfois la tuberculose, à laquelle je n’avais jamais été confrontée auparavant. Elle reste endémique dans certains pays de provenance des migrants,
parfois sous des formes résistantes au traitement antibiotique usuels. Il y avait malheureusement une part importante de victimes de violences sexuelles ,jeunes femmes et jeunes hommes abusés par des passeurs ou contraints par des prétendus aidants sur leur route.
La cohorte des détresses rencontrées dans mon travail épousait assez précisément la courbe des événements géopolitiques. Nous aurions presque pu prédire une révolution, un coup d’état, une guerre, dans un pays à l’apparition de ses premiers ressortissants. Journalistes, opposants politiques, diplomates, minorités ethniques, commerçants influents, les premiers arrivés composaient souvent une certaine élite d’un pays qui devenait instable. Il était clair qu’ils avaient bénéficié d’une bonne éducation, et avaient eu un bon suivi médical jusque dans des temps très récents. Et soudain, d’un jour à l’autre, ils fuyaient pour leur vie avec si possible leur famille pour seul bagage.
Et en sus une angoisse immense, une souffrance difficile à exprimer, un long travail de deuil à commencer sur la perte de leur statut social, professionnel. J ‘ai souvent observé que ceux qui avaient beaucoup à perdre se montraient moins résilients, et plus écrasés par l’adversité. Pour mes collègues qui les assistaient au quotidien certains se
ÉRIC PESTY ÉDITEUR
Jackqueline Frost
Notes sur le tragique prolétaire expérimental
« nous proposons une modalité baroque, dont les somptueuses coordonnées établissent les dimensions d’un style tragique expérimental, en contradiction avec le fantasme bourgeois de l’austérité prolétaire. » (Traduction : Victoria Xardel.)
Notes sur le tragique prolétaire expérimental est un essai qui noue avec précision un geste politique à un geste poétique. Ce nouage passe par l’établissement d’un paradigme original, qui ouvrirait une séquence que nous aimerions intituler baroque insurrectionnel.
1. Le paradigme se construit sur la base d’une redéfinition de l’expression « poète maudit », en faisant saillir le mal dire (étymologiquement : mau-dit) au sein de la malédiction sociale ; le modèle en serait : « le juron dans la bouche du prolo ».
2. Cette base permet d’établir un rapport de classe nouveau : prolétaire expérimental versus intellectuel bourgeois.
3. Ce rapport de classe – qui est aussi un rapport de force –s’envisage depuis la position du prolétaire expérimental et se marque par le sabotage du point de vue dominant et de la langue de l’intellectuel bourgeois (voire du « gauchisme culturel » à la mode, enchérit la traductrice dans une note).
4. L’impulsion tragique passe également par le minage du sens de l’histoire dans sa linéarité : passé-présent-futur, qui conforte toujours l’origine de la classe dominante.
Jackqueline Frost
Notes sur le tragique prolétaire expérimental
traduit de l’anglais par Victoria Xardel
5. L’expérimental annonce l’avènement d’un discours nouveau et d’une séquence politique nouvelle qui auront à inventer, par-delà la catastrophe de notre temps, leur propre origine. Ces Notes appellent l’irruption d’une forme discursive et politique emportant, avec l’exigence de la tragédie, désespoir et violence : celle-là même qui est tentée, sous forme de fiction, dans Le troisième événement.
Éric Pesty Éditeur
Jackqueline Frost est née en 1987 en Louisiane et réside en France depuis une dizaine d’années. Elle est poète, historienne de la littérature et de la philosophie. Elle est l’autrice de Le troisième événement, première et deuxième parties traduit par Luc Bénazet et publié dans la collection agrafée chez Éric Pesty Éditeur en novembre 2020.
Jackqueline Frost enseigne la politique et les théories esthétiques issues de la « négritude » et de la décolonisation des Antilles à l’Université de Londres/Institut de Paris.
(COUVERTURE PROVISOIRE)
Traduit de l’anglais par Victoria Xardel
Parution : février 2024
Prix : 12 €
Pages : 24
Format : 16 x 20 cm
EAN : 9782917786895
Collection : hors collection
Rayon : Poésie
CONTACT PRESSE ET LIBRAIRE
Éric Pesty : contact@ericpestyediteur.com
Notes sur le tragique prolétaire expérimental
« Au bout du petit matin, une autre petite maison qui sent très mauvais dans une rue très étroite, une maison minuscule qui abrite en ses entrailles de bois pourri des dizaines de rats et la turbulence de mes six frères et sœurs, une petite maison cruelle dont l’intransigeance affole nos fins de mois et mon père fantasque grignoté d’une seule misère, je n’ai jamais su laquelle, qu’une imprévisible sorcellerie assoupit en mélancolique tendresse ou exalte en hautes flammes de colère ; et ma mère dont les jambes pour notre faim inlassable pédalent, pédalent de jour, de nuit, je suis même réveillé la nuit par ces jambes inlassables qui pédalent la nuit et la morsure âpre dans la chair molle de la nuit d’une Singer que ma mère pédale, pédale pour notre faim et de jour et de nuit. »
Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal
1. « La poésie est la grande chose maudite » dit Césaire, ce qui suggère que, pour lui, la poésie n'est pas simplement liée à la malédiction, mais en constituerait le grand accomplissement. Etymologiquement, maudit implique la condamnation des choses par la réprobation de Dieu ; littéralement mal/mau + dire/dit désigne l’expression du mal. Dans la tradition chrétienne, la grande chose maudite est, par référence, satanique. Ambiguïté de cette banale formule de « poète maudit » : il s’agit de comprendre si le poète est celui qui prononce la condamnation, ou celui qui est condamné par un obscur processus. Mais de quel processus parle t-on ? Mettons que la langue maudite, c'est le juron dans la bouche du prolo ; un système révélateur d’imprécations mû par une misère sociale implacable. En vue d’esquisser les contours du tragique prolétaire expérimental, un langage de damnation relie les funestes auspices d’une origine à l’histoire collective de « la maladie, du labeur et du danger ». Ces notions contaminent le monde symbolique du lieu jusqu'à ce qu'il devienne lui-même source de malédiction : dans La Chanson de Roland, « la terre maldite » ; les « badlands » ; chez Faulkner, « le comté de Yoknapatawpha ».
LES FLICS ET LES FACHOS
« À BAS L'ÉTAT, LES FLICS ET LES FACHOS »
Fragments d’une lutte antifasciste d’après des propos recueillis par Olivier Minot
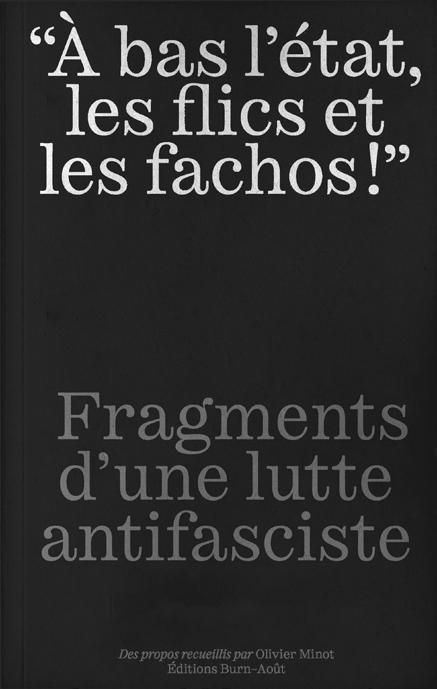
· Format (mm) 130*205
· Nombre de pages +/- 200
· Prix (€) ............................................ +/- 14
· ISBN .................................................... 9782493534040
· Parution dec. 2023
· Graphisme Service Local
· Tirage ................................................ 1000
Le Groupe Antifasciste Lyon et Environs s’est formé en 2013 à la suite de la mort de Clément Méric. En 2022, l’État enclenche une procédure de dissolution à l’encontre du groupe. Le portrait et les paroles des militant·e·s de la GALE racontent 15 ans de luttes antifascistes, anarchistes et autonomes à Lyon.
Olivier Minot retranscrit ici des entretiens réalisés avec des militant.e.s de la GALE qui racontent 15 ans de luttes antifascistes, anarchistes et autonomes à Lyon. Loin des constructions policières et des fantasmes médiatiques, loin aussi des manifestes qui font paraître les groupes pour des organisations monolithiques, il s’agit dans À bas l’État, les flics et les fachos de rendre compte d’une histoire collective à partir des récits intimes qui la traverse et de la frontière poreuse qui parfois sépare ces deux manières de se raconter. Car c’est cela que recherche Olivier Minot dans les entretiens qu’il réalise : trouver, avec les membres de la GALE, une manière de raconter une histoire à la fois intime et collective avec tout ce que cela comporte de mythification.
À propos d’Olivier Minot. « Mi-homme mi-transistor », ce radioman bricole des émissions sur cassettes au collège puis sur les fréquences associatives (Tropiques FM, Radio Néo, Radio Canut…), il a posé sa voix sur les ondes du privé (Ouï FM, Sun FM), comme du service public (RFI, France Culture). C’est sur Radio Canut à Lyon qu’il mène pendant 10 ans jusqu’en juin 2018 la pétillante Megacombi, prix découverte SCAM 2016.


































































Reporter pour l’émission Les Pieds sur Terre (France Culture) depuis 2008, Olivier Minot réalise en parallèle pour ARTE RADIO une trilogie autobiographique et sonore qui mêle récit personnel, engagement politique et passion pour la radio : son hommage à l’émission mythique de Daniel Mermet, Là-bas si j’y suis plus remporte le prix Longueur d’ondes en 2014. Deux ans plus tard, il reçoit le prestigieux Prix Italia du meilleur documentaire pour La révolution ne sera pas podcastée, trilogie s’achevant avec le mouvement social de 2016 et ses nuits debouts dans 2017 n’aura pas lieu
Il réalise ensuite pendant quatre saisons, la revue de presse déjantée Dépêche ! sur Arte Radio tout en écrivant spectacles mêlant radio et scène ( Radio Bistan avec le chanteur Reno Bistan ou J’étais déjà mort dans les années 80 avec Silvain Gire), et co-produisant l’émission La micro-sieste sur Radio Canut.
Ouvrages associés :
• Et s’ouvre enfin la maison close, l’histoire orale d’un squat au tournant du siècle, Nathan Golshem, Demain les flammes, 2022
• Raccourci vers nulle part, Alex Ratcharge, Tusitala Editions, 2022
• À l’arrache, Portraits & récits de la scène musicale underground de Lyon, 1980 — 2020, Éditions BARBAPOP, décembre 2021
• Une histoire personnelle de l’ultra gauche, Serge Quadruppani, ed. divergences, 2023

• Une vie de lutte plutôt qu’une minute de silence, enquêtes sur les antifas, Sébastien Bourdon, le seuil, 2023
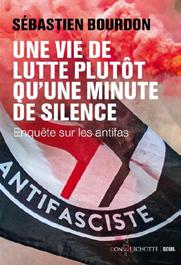

46, avenue du président Wilson 93230 Romainville éditions Burn~Août 07 50 33 63 55 dernière modification 20 juillet 2023 page 1/6 SCIENCES SOCIALES ÉDITIONS BURN~AOÛT /// À BAS
\\\ DEC. 2023
L’ÉTAT,
Couverture provisoire
Dans cet ouvrage, on peut y suivre le parcours de plusieurs militant.es qui, entre 2010 et 2023, ont croisé le chemin du collectif. Iels y racontent leur désir de révolte, leurs rêves de révolution, les amitiés et les amours qui sont le ferment des bandes affinitaires et de la volonté de continuer à lutter ; iels se confient sur la naissance de leurs engagements, font le récit de trajectoires hétérogènes : issu.es de quartiers populaires la classe moyenne, de familles politisées ou pas ; parlent de la volonté de s’organiser de façon concrète en créant un groupe qui participe à de nombreuses actions : des chasses dans les rues de Lyon, des blocages d’universités ; puis iels se découvrent en parlant de leurs doutes et de leurs peurs. Iels exposent aussi les particularités de la ville de Lyon, de sa tradition religieuse et bourgeoise encore très puissante qui se matérialise dans l’existence de nombreux groupes d’extrême droite, mais aussi, en opposition, des nombreux groupes, bandes et collectifs prônent l’émancipation en ouvrant des squats et en luttant dans la rue.
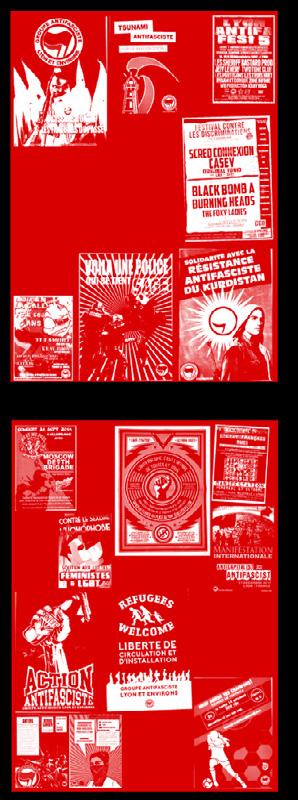
Moins que le récit d’un groupe en particulier, ce livre a pour ambition de se faire le passeur de l’histoire orale d’une bande de jeunes à l’aube du XXIe siècle. Histoire dont le témoignage est d’autant plus précieux que les événements récents montrent à quel point les voix et les gestes révolutionnaires sont toujours plus empêché.es et réprimé.es.
En tant qu’éditeurices, nous avons constaté cette dernière année une offensive répressive contre les personnes et groupes qui portent des gestes conséquents dans l’espace politique français : contre celleux qui, ces derniers mois, on prit part au mouvement contre la réforme du travail et contre le mouvement écolo’ Les Soulèvements De La Terre, lui aussi sous le coup d’une procédure de dissolution. De la même manière, nous prenons acte d’une offensive culturelle toujours plus forte contre tout ce, et tout.es celles et ceux, qui se montrent critiques à l’égard de l’ordre établi. C’est en cela que la diffusion large de ce texte nous semble importante : en se voulant honnête il déjoue le narratif du pouvoir en proposant une autre histoire.


































































À propos de Service Local Depuis leur atelier lyonnais Service Local déploie des idées, des systèmes, des mots et des images dans le champ du design graphique. Leurs collaborations prennent la forme d’éditions, d’affiches ou d’identités visuelles, et résultent de processus de création mêlant enquête et expérimentation.
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-pieds-sur-terre/l-affaire-des-sept-antifas-a-lyon-3181220


46, avenue du président Wilson 93230 Romainville éditions Burn~Août 07 50 33 63 55 dernière modification 20 juillet 2023 page 2/6 SCIENCES
ÉDITIONS BURN~AOÛT /// À BAS L’ÉTAT,
\\\ DEC. 2023
SOCIALES
LES FLICS ET LES FACHOS
L’affaire des sept antifas à Lyon Réalisée par Olivier Minot, cette émission publiée le mercredi 15 décembre 2021 sur France Culture a été le point de départ de cet ouvrage.
Tracts réalisés par Service Local pour diffuser l'appel à financement participatif du livre.
LES FLICS ET LES FACHOS
Celui qui écrit — avant-propos par Olivier Minot (mai 2023)
J’ai 41 ans et je ne sais pas me déterminer politiquement. De gauche, c’est sûr, mais c’est large et pas très excitant. Mon engagement, c’est plutôt la radio, que je pratique depuis l’âge de 12 ans, c’est elle qui m’a formé et qui est devenue mon instrument pour jouer, passer des paroles, brasser des idées, et donc faire un peu de politique.
C’est dans ce cadre que j’ai rencontré certains militants de La Gale en 2021 : après avoir assisté au procès de la fameuse « affaire des 7 », je décide de raconter cet imbroglio judiciaire pour l’émission Les Pieds Sur Terre de France Culture 1 .
Cette affaire était emblématique de l’époque et du traitement policier qu’on réserve aux militant·e·s antifascistes. Elle raisonnait avec la montée en puissance de l’extrême droite que ce soit au niveau international (Orban, Trump, Bolsonaro, Salvini et bientôt Melloni…), au niveau national, des mesures de déchéance de nationalité proposées par le PS jusqu’à la politique répressive et raciste symbolisée par le ministre Darmanin, qui qualifiait Marine Le Pen de trop « trop molle » sur un plateau télé, sans parler de l’arrivée à l’Assemblée Nationale de 88 députés d’un parti fondé par Jean-Marie Le Pen allié à un ancien Waffen SS. Et enfin, au niveau local, ma ville et mon quartier étant constamment confrontés au renforcement des groupuscules ouvertement néonazis, qui semblent avoir pris Lyon pour leur capitale.
À l’heure où j’écris ces lignes, des FAF2 défilent dans les rues de Paris et font des saluts nazis au sein même de l’espace Simone Veil, ils incendient la maison d’un maire qui assume vouloir accueillir des migrants et ils ratonnent régulièrement dans les rues du centre de Lyon. Pendant ce temps-là, les politiques, en place censées dénoncer ces attentats, les renvoient sans cesse aux « violences d’extrême gauche ». Comme si fascistes et antifascistes étaient juste deux faces d’une même pièce. Ce discours devenu dominant me désespère et c’est encore une fois lors du procès de l’affaire des 7, que la plaidoirie des avocats a fait du bien en recadrant les choses et en réaffirmant que nous sommes tous antifascistes.


































































Cependant, il faut reconnaître que parfois, certains de nos amis ANTIFA collent bien avec la caricature qui est faite d’eux : ils portent les mêmes vêtements que ceux d’en face, peuvent être aussi virilistes, bagarreurs, bêtes et méchants.
Le 1er mai 2022, comme chaque année, ce jour de « fête des travailleur·euse·s », je suis sur une place de mon quartier pour le traditionnel repas de quartier organisé par Radio Canut dont je suis animateur depuis 20 ans. C’est un moment convivial, toute la gauche et tout le quartier se retrouvent autour d’une tarte végétarienne, d’un verre de ponch’ offert par la radio, d’une chorale… Il y a des enfants, des voisins, des gens qu’on croise seulement ce jour-là, c’est comme une réunion de famille choisie à multiplies ramifications. Cette année-là, un
groupe a débarqué, masqué, menaçant, et une bagarre a éclaté. « C’est les fachos » se sont alarmées certaines voix. Non c’était un groupe Antifa qui venait se battre avec un autre groupe Antifa. Et comme après une bagarre dans une cour de récréation, chaque groupe va rejeter la faute sur l’autre, va remonter à des précédentes anecdotes de coup de pression, de tabassage sexiste, de trahison, et chacun trouvera aussi une bonne raison politique d’aller tabasser ses meilleurs ennemis. Mais ces justifications importent peu. Les 90 % des gens présents sur la place ne connaissent pas les guéguerres internes à ce milieu et ont juste vu deux groupes de gauche se foutre sur la gueule. Les fachos, qui des fois rôdent autour de ce repas de quartier ont du bien rigoler ce jour-là.
Alors quand quelques jours plus tard, une maison d’édition proche de La Gale, un des deux groupes en question, est venue me demander de travailler sur ce bouquin, j’étais partagé entre ne pas mettre mon nez dans ce nid de panier de crabes, et essayer de comprendre. Les membres de La Gale ont entendu mes critiques, mes réserves, iels ont accepté que cet ouvrage qui raconte leur histoire ne soit pas à sens unique, qu’il y ait aussi des regards extérieurs qui puissent s’exprimer à commencer par le mien.
Mes doutes sont revenus quand, en cherchant justement les bonnes personnes pour apporter quelques observations, j’ai été confronté à des peurs de réprimandes et surtout à une certaine détestation de La Gale : « pas de temps à perdre avec ces gens-là » ou plus ironique « ils sont déjà dans la merde avec leur dissolution, pas envie de les enfoncer ».
Derrière ces affrontements qui peuvent être violents se cache une fracture politique loin d’être nouvelle dans « la gauche ». Libertaires contre staliniens, insurrectionnalistes contre démocrates, avant garde contre mouvement de masse… déjà en 1970, les autonomes attaquaient le SO de la CGT. Alors assister encore à ce genre d’affrontement 50 ans plus tard confirme un conflit historique, mais relativise les postures de militant.es qui se revendiquent révolutionnaires tout en conservant ces lignes de divisions qui n’ont jamais fait une quelconque révolution. Et puis quand on veut dénoncer le stalinisme et se revendiquer de la diversité des tactiques, et qu’on est prêt à tabasser des « camarades » parce qu’ils ne sont pas tout à fait sur la même ligne, ça pose question ! C’est aussi ces réponses que j’ai voulu aller chercher, en entamant ce travail. Chaque entretien, réalisé en tête à tête avec chacun·e, a duré plusieurs heures et c’était un privilège de pouvoir écouter ces militant·e·s se raconter au calme.
Dans ce noyau dur de La Gale, il y a une diversité de classes, d’origines, d’identités, mais aussi de cultures politiques : on ne peut pas leur faire le procès d’être un groupe homogène de chasseurs de skins décérébrés ni de former une avant-garde bourgeoise de surdiplômés en sciences sociales, contrairement à que nous renvoie généralement l’imaginaire des groupes antifas ou autonomes.
46, avenue du président Wilson 93230 Romainville éditions Burn~Août 07 50 33 63 55 dernière modification 20 juillet 2023 page 3/6 SCIENCES SOCIALES ÉDITIONS BURN~AOÛT /// À BAS L’ÉTAT,
\\\ DEC. 2023
EXTRAIT 1
Tou·te·s racontent comment ils sont rentrés en politique, c’est le terme qu’ils et elles emploient. Car pour ces militant.es brillant.es, rentrer en politique, ne signifie pas prendre une carte dans un parti hiérarchisé pour devenir un professionnel qui au fur et à mesure de sa carrière mettra de côté ses idéaux pour être adapté aux postes et aux mandats prestigieux, mais rentrer en, politique, c’est lutter au quotidien, sur le terrain souvent de manière invisible. Et une fois certaines postures prétentieuses sur le reste de la gauche dépassées, on ne peut que saluer ce travail de terrain, qui vient contrecarrer un peu les médias de masse, qui fait vibrer les cœurs restants à gauche comme le mien, qui nous sort de la résignation, qui nous protège encore un peu d’un basculement plus inquiétant.
C’est cet activisme qui questionne aussi le mouvement social en le forçant à garder un cap, à modifier ses traditions et trajectoires de cortège parfois planplan… Et cet engagement leur est coûteux, harcelé·e·s par la police dans leur quartier, humilié·e·s par la presse bourgeoise, poursuivi·e·s et enfermé·e·s par l’état, et même dissous… alors ils et elles méritent d’être entendu·e·s.
Enfin et surtout, leur histoire dépasse largement le cadre d’un groupe local antifasciste. À travers ce qu’a fait La Gale (qui n’est évidemment qu’un grain de sable dans la plage qui bouillonne sous les pavés), on revivra 15 ans d’événements communs, de la mort de Clément Méric aux Soulèvements de La Terre en passant par la loi travail, les cortèges de têtes, les gilets jaunes, le confinement, les mesures sécuritaires, les dissolutions, la révolution féministe en cours, les violences policières… Beaucoup de ces lignes ont été écrites pendant le mouvement contre la réforme des retraites de Macron du premier semestre 2023, et il était étrange de retranscrire par exemple comment se sont créés les cortèges de tête en 2016 alors qu’au même moment à Lyon, ils défilaient fournis et déter’comme jamais ! Ou de raconter comment ils se sont battus contre leur dissolution alors même qu’on voulait interdire Les Soulèvements de la Terre.
Bref, voici un fragment des luttes en cours, qui n’a pas fini de raisonner.
(1) A réécouter ici : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-pieds-sur-terre/l-affaire-dessept-antifas-a-lyon-3181220
(2) FAF pour « France aux français » appellation générique des militants d’extrême droite, y compris par eux-mêmes.
EXTRAIT 2
ZEDE


































































Pendant toute une période, on allait très souvent se balader dans le Vieux Lyon le samedi, en espérant tomber sur des bandes de fafs pour leur taper dessus, leur faire comprendre qu’ils sont en sécurité nulle part, parce qu’en fait, c’est des fafs et qu’ils ne devraient pas exister ! C’était comme des sortes de maraude, qu’on appelait des chasses. Souvent on en trouvait en train de manger une glace et en général, des sympathisants à nous un peu cramés commençaient direct à sortir leur matraque en gueulant « y’a des fa, y’a des fa ». Forcément, le truc qu’on voulait discretos se transformait en une énorme esclandre au milieu des touristes où ça se gueulait dessus, ça se donnait des coups, puis on finissait par détaler quand la BAC arrivait. Et on rentrait bien content en se disant « On a chopé machin, on a défoncé machine »
LUCAS
Une fois, après une manif, on apprend qu’il y a une dizaine de fafs à Foch, on était une petite quinzaine alors on décide de foncer : on arrive super vénère sur place, et là, un pote part direct tout seul en trombe avec sa béquille pour leur sauter dessus. On se met à courir derrière lui, mais en approchant, on découvre qu’en fait, ils sont 30, ils sont immenses, ils sont hyper musclés, ils sont tous torse nu, ils ont des chaînes, des machettes, des couteaux, et ils sont tous en ligne. Ils craquent un fumi en hurlant comme des vikings et ils nous foncent dessus. Là, je me retourne et je me rends compte qu’on est plus que six, et qu’on va se faire massacrer. « vaz-y on se barre ! », gueule un pote et on se met à courir le plus vite qu’on peut. J’entendais les chaînes claquer derrière moi pendant que je courrai, ils étaient vraiment à deux doigts de m’attraper, ils nous hurlaient dessus en mode « On va t’égorger ». Il y avait des Italiens avec eux, on l’a vérifié après avec les réseaux de Casa Pound1, ils avaient ramené des chefs de Rome et moi qui parle italien, je comprenais leurs insultes : « va t’en antifa, va t’en, t’es une bête, un animal et je vais prendre un plaisir à te défoncer sale PD ! espèce de pédale, tu fuis ». Au final, on a réussi à se réfugier dans une allée, cachés derrière des portes, on entendait les fafs passer en mode veille. S’ils nous trouvaient, on était morts, on s’est vraiment cru dans un délire de film d’horreur de psychopathes et j’ai jamais eu autant peur de toute ma vie.
GRECOS
Il y a plusieurs années, on avait fait une descente au Dikkenek, un bar de la Croix Rousse, le patron nous avait appelés à l’aide genre « j’ai plein de fafs, ils sont trop nombreux, y a des discours racistes, je sais pas quoi faire ». C’était une époque où les fafs chassaient beaucoup à Croix-Rousse, et ça faisait plusieurs fois
46, avenue du président Wilson 93230 Romainville éditions Burn~Août 07 50 33 63 55 dernière modification 20 juillet 2023 page 4/6 SCIENCES SOCIALES ÉDITIONS BURN~AOÛT /// À BAS L’ÉTAT,
\\\ DEC. 2023
LES FLICS ET LES FACHOS
qu’on arrivait pas à les choper. Et là on avait une adresse ! On a débarqué à quinze dans le bar, on a allumé tous les fafs dedans, mais il y avait aussi des lambdas qui se sont pris du gaz lacrymogène et des verres qui volaient, ils ont dû avoir super peur. On a blessé pas mal de fafs et on s’est barrés, contents, genre « Ouais on les a éclaté ! » et le bar a du fermer pendant une semaine à cause des dégâts. Mais au fur et à mesure en se refaisant l’histoire, on s’est dit qu’on éviterait de recommencer des trucs comme ça, on a un peu trop abusé, ça aurait pu être très grave, et on en était pas à vouloir tuer un fasciste non plus ! On voulait juste leur dire « vous n’a rien à faire ici, venez pas intimider les gens, venez pas agresser ».
LUCAS
Moi j’ai aucun honneur dans la bagarre, les codes de bagarres, c’est des trucs de virilisme de merde ! Alors franchement défoncer un faf à dix contre un, je le fais sans souci. Mais je ne vais pas faire des écrasements de tête, je vais essayer d’éviter de toucher le visage, j’ai pas envie de les rendre tétraplégiques ni les tuer, quoi !
ZEDE


































































Je n’ai pas un tempérament à sauter à la tête de quelqu’un, même si je sais que c’est un fasciste, c’est une question de caractère, je ne peux pas attaquer quelqu’un de sang-froid comme ça, il faut que je monte en pression avant, sinon, je n’y arrive pas.
ZOE
Je m’en passerais bien, de me battre moi ! Mais en tant que femme je suis obligé, c’est pas que j’aime bien, c’est un outil que j’utilise, et avec lequel je suis à l’aise. Je fais beaucoup d’arts martiaux. Dans un combat, je suis prête à aller jusqu’à ce que je puisse m’en sortir.
LUCAS
Moi, ce qui m’a toujours fasciné à La Gale, c’est la force des meufs, quoi ! Peut-être que j’ai un truc un peu malsain d’héroïsation des meufs, mais je trouve incroyable la place qu’elles ont sur l’utilisation de la force face à des ennemis, alors que moi, j’ai toujours peur de me battre. Je pense que j’ai aussi été un peu trauma par l’histoire de Clément Méric, j’étais gamin et cette histoire de : il se prend un point — il tombe — il meurt — me revient en tête à chaque fois que je suis confronté à des bagarres.
ZOE
On a tous peur ! Ceux qui disent qu’ils n’ont pas peur, ils mentent. Et puis la violence est proportionnelle à ce qu’on a en face. Dans les années à venir, s’il y a des fafs dans la rue avec des flingues, moi je serai armée et je serai prête aussi ! Mais là, tout de suite, je vais pas te dire que je vais aller buter un faf ou un flic, autant mes potes, ils comprendraient autant l’action ne serait pas acceptée par l’opinion publique et on serait vite catalogué comme des fous extrémistes.
YASMINE
Moi, je suis une nerveuse, une vénère quoi, qui monte vraiment, mais ce qui me sauve, c’est mon côté rationnel. Dans les situations un peu chaudes, je réfléchis aux caméras, à ci, à ça, et je me fais des mégafilms sur la répression à venir, et ça me met des freins, s’il n’y avait pas tant de répression, je serai une folle ! Il y a aussi mes parents derrière, leur histoire, c’est moi qui gère pas mal de trucs pour eux comme la paperasse administrative, et qui aide mon père malade, alors je réfléchis beaucoup à eux et ça me limite pas mal.Mais j’aurais une autre situation, je ferais partie d’une autre classe sociale, je pense que je me permettrais plus de choses.
POUSSIN
Moi je fais de la boxe, des sports de combat, mais je me bats très peu. Je suis jamais dans une confrontation vraiment physique avec les gens, sauf en dernier recours. Après, il y a aussi toute une autre catégorie de violences, qui ne laisse pas de marques, mais qui peut être très humiliante, les insultes et tout ce qui est un peu plus psychologique, c’est ultra violent aussi et ça peut être pire que des coups.
LUCAS
Ça m’est déjà arrivé, quand je suis énervé, de traiter les fafs de sale PD, alors que je suis moi-même PD. J’ai déjà traité un faf de sale pute alors que j’ai envie de respecter les putes. Je dis tout le temps « Bande d’enculés ». Ce sont des trucs de langage, t’as la rage, t’as d’envie de les blesser, de les humilier, et en vrai, les insultes « safes », ça blesse pas les fafs, alors j’utilise le langage qui leur fait peur et qui les humilie. Je sais que c’est pas ouf, mais par exemple, on va défoncer un faf par terre et je vais lui dire « tu vois, tu t’es fait enculer par un PD » !
LAKHDAR
La violence en générale, certains la réduisent à un truc d’ado, à un besoin de sentir de l’adrénaline, moi, je trouve que ça peut aider aussi : briser une vitre, ça peut aussi être catalyseur d’énergie, d’émotion, c’est toute cette colère contre ce monde qui s’introduit dans un geste. C’est sur qu’on ne change pas le monde en cassant une banque, mais à un moment donné, ça fait du bien ! Nos corps subissent la société, ils sont façonnés par la société, il faut qu’on les utilise aussi pour s’en libérer !
(1) CasaPound, mouvement néofasciste italien qui nait en ouvrant des « centres sociaux » d’extrême droite avant de se muer en parti politique. Mouvement qui va inspirer en France « le bastion social »
46, avenue du président Wilson 93230 Romainville éditions Burn~Août 07 50 33 63 55 dernière modification 20 juillet 2023 page 5/6 SCIENCES SOCIALES ÉDITIONS BURN~AOÛT /// À BAS L’ÉTAT,
\\\ DEC. 2023
LES FLICS ET LES FACHOS
LES FLICS ET LES FACHOS
LUCAS
A la fin de la loi travail, je suis parti en dépression. Je n’ai pas été diagnostiqué, mais avec le recul, quand je vois l’état dans lequel j’étais, c’était n’importe quoi : je fumais énormément de shit, j’étais gazé toute la journée, tous les jours, je n’allais plus en cours, j’étais en décrochage scolaire total, c’était horrible.
ZEDE


































































On était tous un peu fanée par cette défaite cuisante, c’était déprimant pour tout le monde, c’était une gueule de bois importante parce qu’on a tenu trois mois à fond, sans dormir, à tout le temps réfléchir à ce qu’on allait faire comme connerie pour les faire chier, à quel tag débile on allait inscrire. L’été, je suis partie travailler en maison de retraite dans le village de mes grands-parents. Mais après, ça a été compliqué, je me rappelle plus trop comment on avait essayé de relancer la sauce, mais c’est à ce moment-là que je me suis investi sur des squats où il y avait de l’accueil de mineurs isolés. J’ai aussi fait ça parce que ma copine était dans ces trucs-là.
LUCAS
Je venais de connaître les quatre mois de ma vie les plus intenses, les plus fous, la période où je me suis senti le plus vivant, et là, on m’a dit qu’il fallait que je retourne à une vie normale, se lever tous les matins, aller au lycée, et ça, je l’ai pas accepté. Du coup, ça a pété avec mes parents, j’avais 17 ans, je suis parti de chez eux pour vivre en squat parce que j’avais envie de continuer à vivre ce truc. Et aujourd’hui, je cours encore après ce truc, mais je n’ai jamais réussi à le ressentir à nouveau. Même dans les mouvements sociaux d’après, j’avais toujours la nostalgie de la loi travail, je recherchais tout le temps les mêmes sensations, ça a vraiment été les plus belles années de ma vie.
YASMINE
Après la défaite, il y a eu une gueule de bois de ouf. J’avais mis beaucoup du mien : c’était ma première année, je voulais faire plein de choses, j’étais avec les sans papiers, j’étais à la fac, j’étais partout donc l’été après la loi travail, j’étais morte. À partir de ce moment-là, j’ai accepté le fait de ne pas tout faire, de plus m’engager de partout, de ne pas culpabiliser genre « putain t’es une merde t’as pas été à telle réunion, tu t’es pas engagée sur ce truc ! » Ca m’a permis de dire stop, et de prioriser en voulant rentrer dans un groupe antifa, alors je me suis mis à fond sur La Gale !
ZOE
C’est toujours ça de toute façon, tu prends un ascenseur émotionnel, t’es en haut, et après tu descends, il faut gérer ça… Et je pense que c’est à nous aussi de créer des choses pour contrer cette gueule de bois. L’aspirine ça a été par exemple, de s’implanter dans un quartier, faire un festival anti-
fa, créer des conférences, ces petits trucs pour conscientiser les gens et créer des espaces de solidarité, des choses où tu kiffes sur le moment.
LUCAS
Après ce mouvement, je suis devenu un militant et devenir un militant, c’est chiant ! Tu deviens chiant, tu deviens moribond, tu deviens aigri. Alors que pendant la loi travail, j’étais pas encore un militant, j’étais juste à fond : on partait avec nos potes le matin bloquer le Lycée, la journée on faisait des AG et des manifs, et le soir, on finissait par faire la fête à Nuit debout. On ne savait pas ce qu’on allait faire ni le lendemain, ni de nos vies, on était pleinement engagé au présent. Alors que maintenant, je me pose des questions, je réfléchis stratégie tout le temps : « est ce que ça compte, cette manif ? Est-ce que c’est vraiment intéressant ? ». J’ai été matrixé, formaté par le monde militant. Et du coup il faut rechercher tout le temps à détruire, à sortir du militantisme, ce qui ne veut pas dire sortir de la politique, mais sortir de cette posture presque carriériste, qui te fait un carré dans ta tête et où tu vois tout par le même prisme, où tes idées sont très arrêtées, où t’es moins ouvert à la rencontre… bref t’y crois moins donc ça laisse peu de place pour être étonné, pour être touché par des nouvelles choses… C’est un peu la malédiction de la gauche, le militantisme, c’est le truc qui nous poursuit tous et qu’il faut essayer de détruire, mais qui nous rattrape tout le temps.Mouvement qui va inspirer en France « le bastion social »
46, avenue du président Wilson 93230 Romainville éditions Burn~Août 07 50 33 63 55 dernière modification 20 juillet 2023 page 6/6 SCIENCES SOCIALES ÉDITIONS BURN~AOÛT /// À BAS L’ÉTAT,
\\\ DEC. 2023 EXTRAIT 3
APRÈS LA RÉVOLUTION
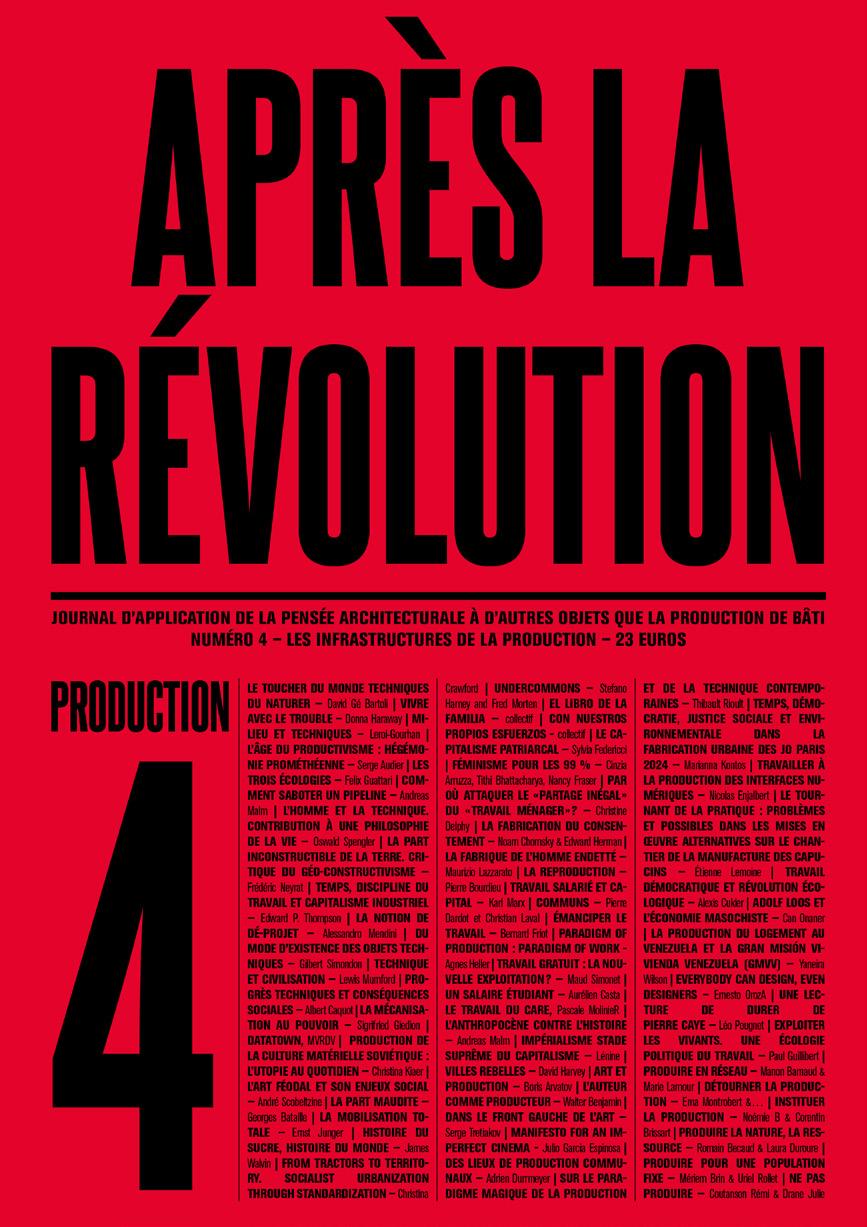
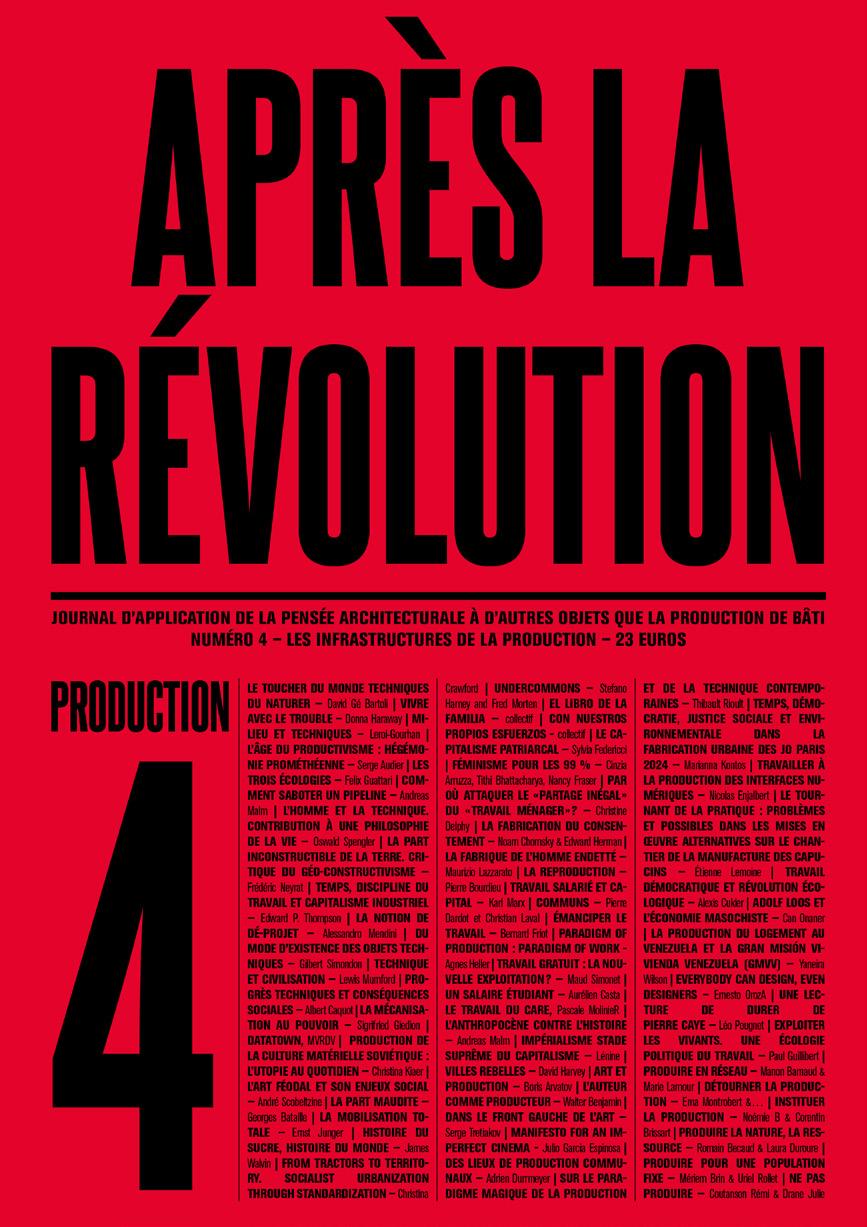
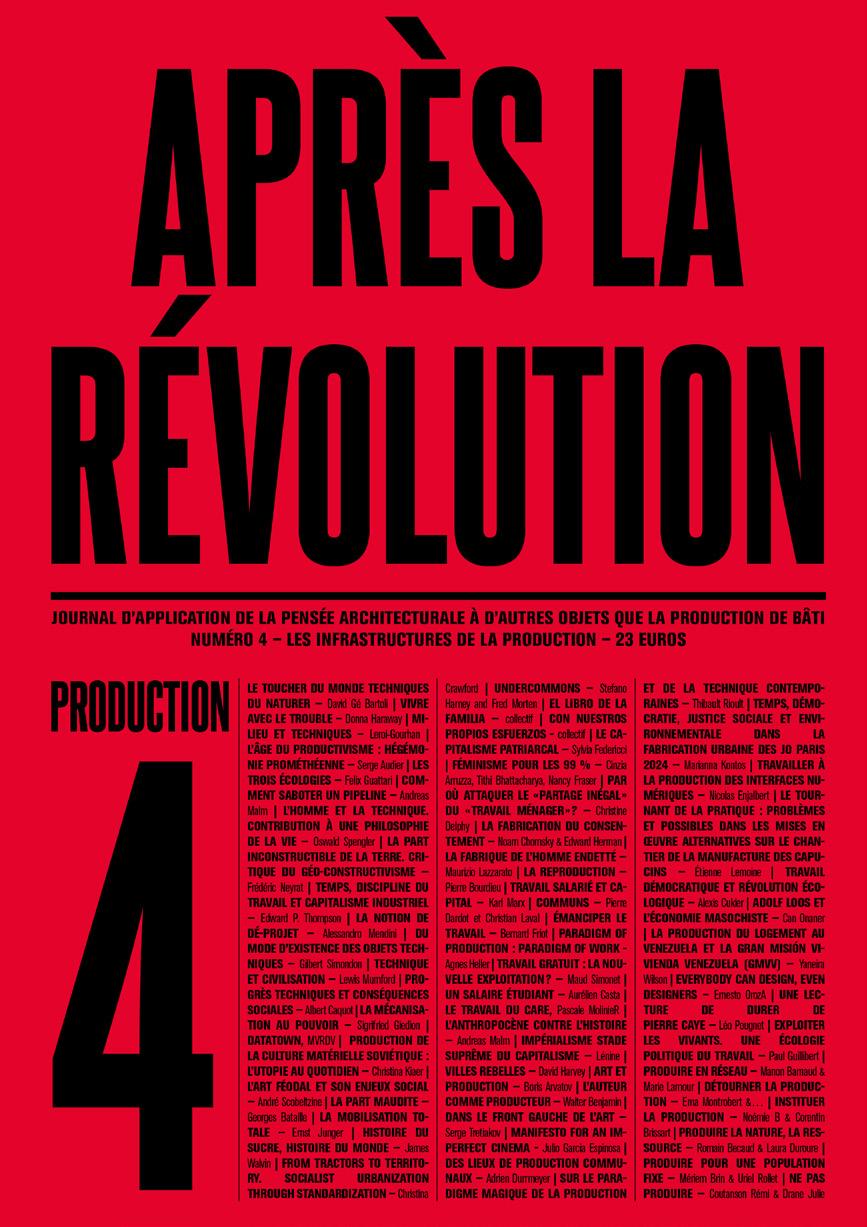
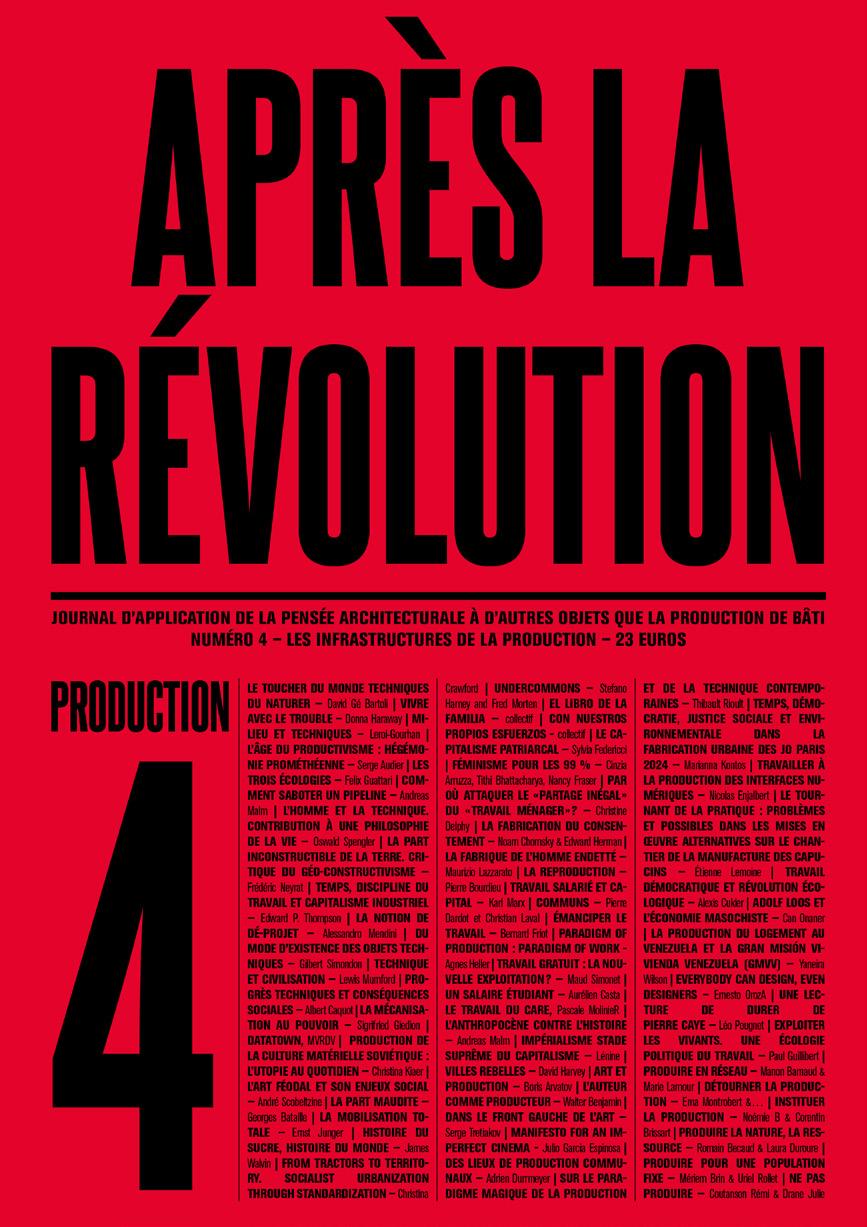
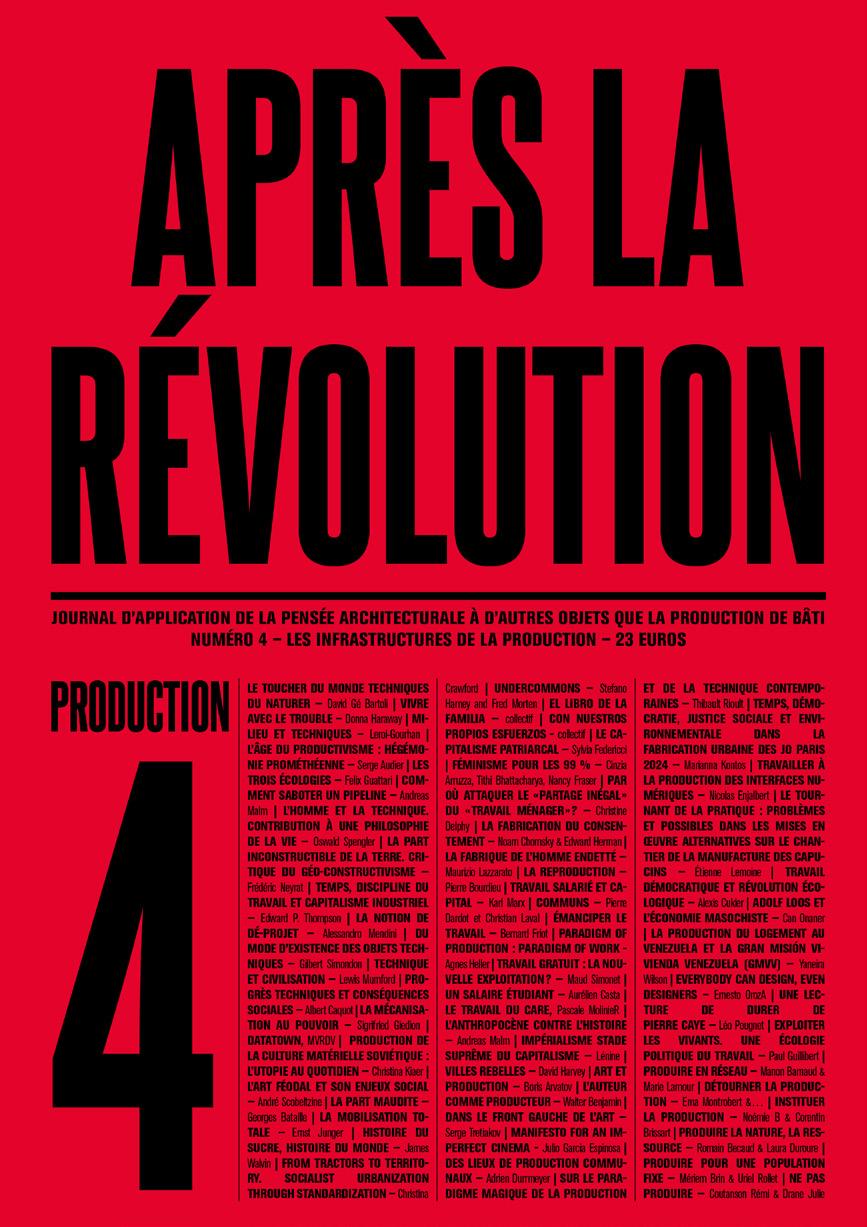
La manière, les outils et les méthodes employés pour produire les objets qui constituent notre culture matérielle contemporaine reposent sur une mobilisation totale des ressources détruisant l’ensemble des mondes vivants. Nous nommons l’ensemble de ces modes de production « l’appareil productif contemporain ». C’est cet appareil productif qu’il s’agit ici de transformer. Le journal après la révolution envisage la discipline architecturale d’une manière différente de celle à laquelle nous sommes historiquement accoutumés. Plus que la discipline en charge de la production de bâti, l’architecture pour ALR est un mode de production des sociétés. En nous appuyant sur les travaux du philosophe
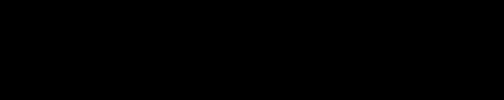
Pierre Caye nous avons décidé d’explorer l’hypothèse selon laquelle l’architecture comme savoir pourrait permette une transformation de l’appareil productif écocidaire contemporain vers des sociétés de basse énergie.
Cet énoncé a été le point de départ d’un projet quinquennal intitulé : Dessiner les sociétés de basse énergie. Après une première année portant sur l’hypothèse d’une école de réforme des moyens de production qui a été le support du numéro 3 « Pédagogie », ce numéro 4, intitulé « Production », vient affiner et approfondir ces premières hypothèses en se posant notamment les trois questions suivantes :
NUMÉRO 4 – PRODUCTION
1/ Comment penser d’une part la nécessité d’une production matérielle de la réalité et d’autre part la destruction systémique du monde opérée par les modes de production de cette culture matérielle ?
2/ Quelles politiques d’oppression et d’émancipation des populations sont à l’œuvre dans les processus de production de notre réalité ?
3/ Considérer la pensée architecturale suivant une conception Vitruvienne, c’est-à-dire en considérant que la mécanique et l’ingénierie sont une partie de l’architecture et non des savoirs
autonomes, permettrait-il de maîtriser les effets dévastateurs de la technique contemporaine ?
Comité de rédaction du journal : Manuel Bello Marcano, Adrien Durrmeyer, Anaïs Enjalbert, Émilien Épale, Marianna Kontos, Thimothé Lacroix, Léo Pougnet, Claire Thouvenot, Emma Vernet, Xavier Wrona.
Ce journal est une des activités de l’association Après la révolution, basée à Saint-Étienne. Ce numéro 4 comprend 63 contributions. Il est imprimé, relié et façonné à Saint-Étienne par les membres de l’association Après la révolution.
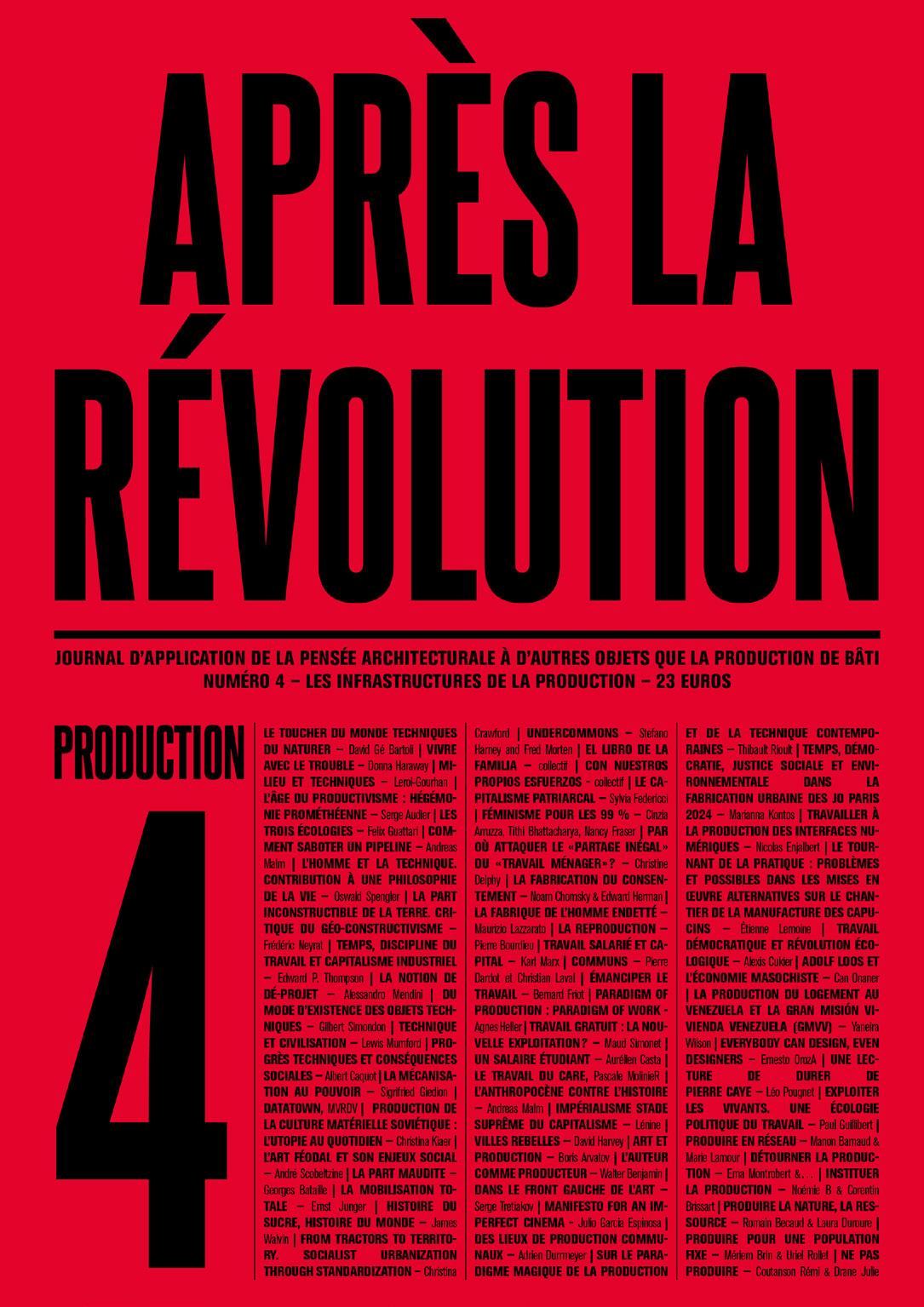
Format : 20,8 x 29,5 cm, 350 pages environ
ISSN : 2678-3991
ISBN : 978-2-493403-08-7
Prix : 23 euros
Rayons : Beaux arts / Essais
Thèmes : Architecture / Philosophie / Sciences sociales
Sortie : mars 2024
APRÈS LA RÉVOLUTION – NUMÉRO 4 – PRODUCTION
DOCUMENTS
Textes à l’étude en vue d’une éventuelle
republication :
Produire la nature, la ressource :
LE TOUCHER DU MONDE TECHNIQUES DU NATURER
— David Gé Bartoli
VIVRE AVEC LE TROUBLE – Donna Haraway
MILIEU ET TECHNIQUES – Leroi-Gourhan
L’ÂGE DU PRODUCTIVISME : HÉGÉMONIE PROMÉTHÉENNE
— Serge Audier
LES TROIS ÉCOLOGIES — Felix Guattari
Ne pas produire :
COMMENT SABOTER UN PIPELINE — Andreas Malm
L’HOMME ET LA TECHNIQUE. CONTRIBUTION À UNE
PHILOSOPHIE DE LA VIE — Oswald Spengler
LA PART INCONSTRUCTIBLE DE LA TERRE. CRITIQUE DU GÉO-CONSTRUCTIVISME — Frédéric Neyrat
TEMPS, DISCIPLINE DU TRAVAIL ET CAPITALISME
INDUSTRIEL — Edward P. Thompson
LA NOTION DE DÉ-PROJET — Alessandro Mendini
Produire pour une population fixe :
DU MODE D’EXISTENCE DES OBJETS TECHNIQUES — Gilbert
Simondon
TECHNIQUE ET CIVILISATION — Lewis Mumford
PROGRÈS TECHNIQUES ET CONSÉQUENCES SOCIALES
— Albert Caquot
LA MÉCANISATION AU POUVOIR — Sigrifried Giedion
DATATOWN – MVRDV
PRODUCTION DE LA CULTURE MATÉRIELLE SOVIÉTIQUE :
L’UTOPIE AU QUOTIDIEN — Christina Kiaer
Produire en réseau :
L’ART FÉODAL ET SON ENJEU SOCIAL — André Scobeltzine
LA PART MAUDITE — Georges Bataille
LA MOBILISATION TOTALE — Ernst Junger
HISTOIRE DU SUCRE, HISTOIRE DU MONDE — James Walvin
FROM TRACTORS TO TERRITORY. SOCIALIST
URBANIZATION THROUGH STANDARDIZATION – Christina
Crawford UNDERCOMMONS – Stefano Harney and Fred Morten
EL LIBRO DE LA FAMILIA — Collectif
CON NUESTROS PROPIOS ESFUERZOS - Collectif
Reproduction :
LE CAPITALISME PATRIARCAL — Sylvia Federicci
FÉMINISME POUR LES 99 % — Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya, Nancy Fraser
PAR OÙ ATTAQUER LE « PARTAGE INÉGAL » DU « TRAVAIL
MÉNAGER » ? — Christine Delphy
LA FABRICATION DU CONSENTEMENT — Noam Chomsky & Edward Herman
LA FABRIQUE DE L’HOMME ENDETTÉ — Maurizio Lazzarato
LA REPRODUCTION — Pierre Bourdieu
Instituer la production :
TRAVAIL SALARIÉ ET CAPITAL — Karl Marx
COMMUNS — Pierre Dardot et Christian Laval
ÉMANCIPER LE TRAVAIL — Bernard Friot
PARADIGM OF PRODUCTION : PARADIGM OF WORK
- Agnes Heller
TRAVAIL GRATUIT : LA NOUVELLE EXPLOITATION ? — Maud
Simonet
UN SALAIRE ÉTUDIANT — Aurélien Casta
LE TRAVAIL DU CARE – Pascale Molinier
Détourner la production :
L’ANTHROPOCÈNE CONTRE L’HISTOIRE — Andreas Malm
IMPÉRIALISME STADE SUPRÊME DU CAPITALISME
— Lénine
VILLES REBELLES — David Harvey
ART ET PRODUCTION — Boris Arvatov
L’AUTEUR COMME PRODUCTEUR — Walter Benjamin
DANS LE FRONT GAUCHE DE L’ART — Serge Tretiakov
MANIFESTO FOR AN IMPERFECT CINEMA - Julio Garcia
Espinosa
ÉPISTÉMOLOGIE
Aucun texte arrêté à ce jour
PÉDAGOGIE
PRODUIRE EN RÉSEAU — Manon Barnaud & Marie Lamour
DÉTOURNER LA PRODUCTION — Ema Montrobert &…
INSTITUER LA PRODUCTION — Noémie B & Corentin Brissart
PRODUIRE LA NATURE, LA RESSOURCE — Romain Becaud & Laura Duroure
PRODUIRE POUR UNE POPULATION FIXE — Mériem Brin & Uriel
Rollet
NE PAS PRODUIRE — Coutanson Rémi & Drane Julie
INTERVENTIONS
Aucun texte arrêté à ce jour
CRITIQUE
Textes à l’étude en vue d’une éventuelle publication : DES LIEUX DE PRODUCTION COMMUNAUX — Adrien
Durrmeyer
SUR LE PARADIGME MAGIQUE DE LA PRODUCTION
ET DE LA TECHNIQUE CONTEMPORAINES — Thibault Rioult TEMPS, DÉMOCRATIE, JUSTICE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE DANS LA FABRICATION URBAINE DES JO PARIS 2024 — Marianna Kontos
TRAVAILLER À LA PRODUCTION DES INTERFACES
NUMÉRIQUES — Nicolas Enjalbert
LE TOURNANT DE LA PRATIQUE : PROBLÈMES ET POSSIBLES DANS LES MISES EN ŒUVRE ALTERNATIVES SUR LE CHANTIER DE LA MANUFACTURE DES CAPUCINS
— Étienne Lemoine
TRAVAIL DÉMOCRATIQUE ET RÉVOLUTION ÉCOLOGIQUE
— Alexis Cukier
ADOLF LOOS ET L’ÉCONOMIE MASOCHISTE — Can Onaner
LA PRODUCTION DU LOGEMENT AU VENEZUELA ET LA GRAN MISIÓN VIVIENDA VENEZUELA (GMVV)
— Yaneira Wilson
EVERYBODY CAN DESIGN, EVEN DESIGNERS – Ernesto Oroza
UNE LECTURE DE DURER DE PIERRE CAYE — Léo Pougnet
EXPLOITER LES VIVANTS. UNE ÉCOLOGIE POLITIQUE DU TRAVAIL — Paul Guillibert
APRÈS LA RÉVOLUTION – NUMÉRO 4 – PRODUCTION
SOMMAIRE DU NUMÉRO
Planches extraites de la partie « pédagogie » du journal
NE PAS PRODUIRE
Coutanson Rémi & Drane Julie
CONSTAT
À l’heure de la micro-transaction, le monde se trouve régi par des rythmes incompatibles avec la vie. Nous sommes donc en conflit frontal avec le temps biologique. Ces rythmes sont ainsi dictés par un désir de production toujours plus intense. Cette société d’accroissement a poussé à accélérer les temps de production, d’échanges et de consommation. Cette cadence engendre une destruction du vivant et des écosystèmes. Elle implique également des rapports d’oppression sur les peuples. Alors, faut-il ne pas produire ? L’arrêt brutal et total d’une production semble impossible, produire occupe une place importante dans l’histoire évolutive, nous permettant de manger, s’habiller, travailler et se déplacer. En revanche, l’urgence et les dommages témoignent du besoin d’une redéfinition de notre production par un nouveau rapport au temps.



Une force destructrice provoquée par l’énergie et la technique est exercée sur l’environnement. En effet, selon Frédéric Neyrat, dans LapartinconstructibledelaTerre la nature devient de plus en plus



2 DOCUMENTS
STABILISATION
rare et c’est pourquoi certaines personnes cherchent à la recréer par synthèse. Une Terre postnaturelle reconstruite et pilotée par l’ingénierie. Cependant, toute la Terre n’est pas reproductible en laboratoire, d’où le titre du livre. Ainsi c’est par un processus émancipateur que l’humain doit comprendre qu’il n’est ni le propriétaire de la nature ni son régisseur. La politique doit être ainsi repensée en lien avec la nature, afin de mieux appréhender l’utilisation et la préservation des ressources de la Terre qui se trouvent être essentielles aux besoins des humains. C’est dans l’ouvrage L’homme et latechniqueque Oswald Spengler se questionne sur la signification de la technique. Pour lui, elle est la tactique de tout le règne vivant, l’Homme est le créateur de sa technique vitale. Depuis le XIXe siècle on assiste à une accélération de la technique, chaque siècle porte son importance, générant des techniques de plus en plus entrelacées et dépendantes les unes aux autres. Ainsi, selon l’auteur, si celle-ci s’est retrouvée source de destruction c’est par son introduction à l’échelle mondiale. Il est donc nécessaire d’adopter une approche systémique.
Fig. 15
Enfin, la troisième période, 300 ans, a pour objectif de rendre l’Europe autonome, stable, et équilibrée. Ainsi, la régénération des ressources de la Terre sera atteinte ;le cycle de l’eau, le sol, la forêt seront restaurées. Cette stabilité est assurée par les forêts qui entrelacent les territoires d’Europe, définie comme patrimoine pour de nombreux siècles. En effet, selon Colbert, l’un des principaux ministres de Louis XIV, «La forêt est un trésor qu’il faut soigneusement conserver». C’est par son action que la France a introduit la forêt comme un héritage à préserver et à gérer rigoureusement. Ainsi, cette intention est démultipliée à l’échelle du territoire de l’Europe. Le lien territorial entre les écoles est réalisé majoritairement par les forêts et à plus petite échelle par les fleuves fortement présents. Le réseau d’écoles s’intensifiera et deviendra un moteur permettant d’atteindre d’autres territoires.
PÉRENNISATION
La quatrième et dernière période se portant ainsi à plus 600 ans, signe l’apparition d’un nouvel ordre architectural. L’équilibre atteint précédemment s’est renforcé et a pour but de perdurer, les traces du passé industriel se font rares à l’échelle géologique. Ce nouvel ordre érigé au fur et à mesure mêle les techniques aux formes, loin des procédés destructeurs. Les objets et la vie sont entremêlés et se complètent, en rupture avec les schémas destructeurs passés.
Fig. 16
À la suite des quatre calendriers Tzolkin, chaque école établira ses propres sous-calendriers correspondant à chaque pratique sur un cycle d’un an. Toujours en référence aux Mayas, ces calendriers appelés Haab introduisent le processus de production. Ils seront conçus selon
les conditions environnementales de chaque territoire. Ils auront pour vocation d’être échangés entre les différentes écoles du réseau, ils pourront ainsi partager leurs arts de produire leur alimentation, vêtements ou objets. L’école prospective consiste donc en l’élaboration et la
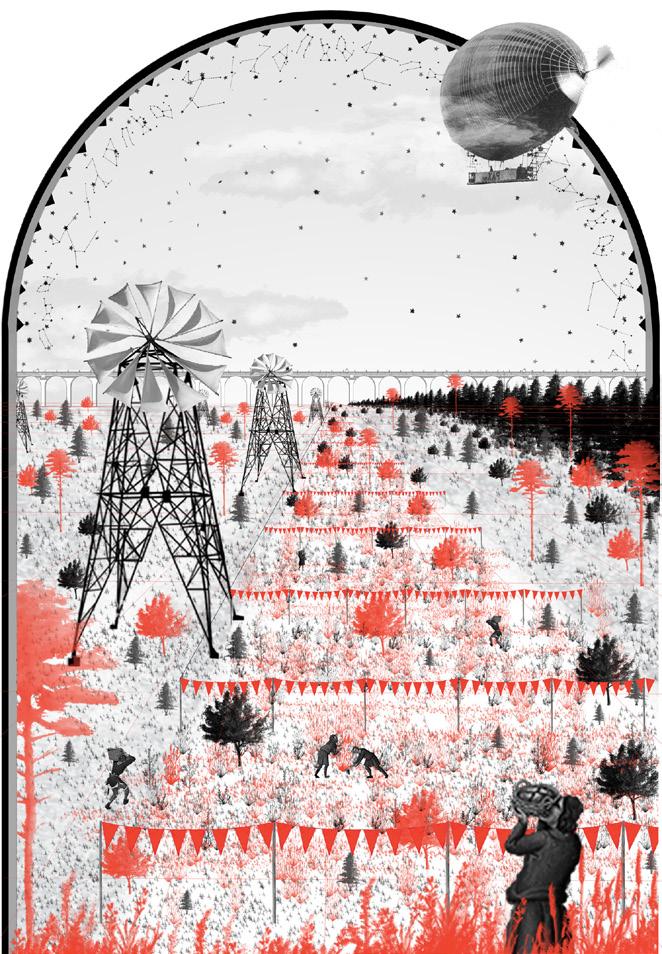


Fig. 13
compréhension de ces deux sortes de Calendriers. Deux pôles seront ainsi établis pour guider la pédagogie. Tout d’abord, le pôle théorique avec l’élaboration des calendriers par une étude des écosystèmes, de l’anthropologie locale, des cours sur l’histoire des cultures et une redéfinition du
Afin de comprendre la situation scientifique et économique, nous nous sommes basés sur différents rapports mondiaux nous permettant de démêler les conditions actuelles et futures. Tout d’abord le rapport du GIEC, anticipant un réchauffement d’environ 5°C pour l’année 2100 et une montée des eaux de minimum 1 mètre. Ensuite le Rapport Meadows, estimant par une simulation informatique, un effondrement économique aux environs de 2030, 2050, qui engendrerait une baisse démographique, une chute des ressources naturelles et un écroulement de la production industrielle.
Fig. 17
Fig. 14
Il faut donc réapprendre à vivre sur un temps long afin de contrer les tendances présentées auparavant. Comme Pierre Caye l’explique dans son livre Durer la production et les moyens de mise en œuvre doivent être pensés à long terme afin de préparer l’avenir
et assurer un patrimoine commun propice à la vie. L’émancipation développée et organisée par les écoles prospectives s’exprime donc comme réponse d’auto-soin et d’autodéfense par les habitants européens.


ICONOGRAPHIE
Fig. 1 - Techniques de l’humain
Fig. 2 - Techniques de l’humain
Fig. 3 - Techniques de l’humain
Fig. 4 - Techniques de l’humain
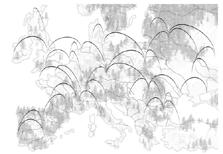
Fig. 5 - Rapport du GIEC - 2100
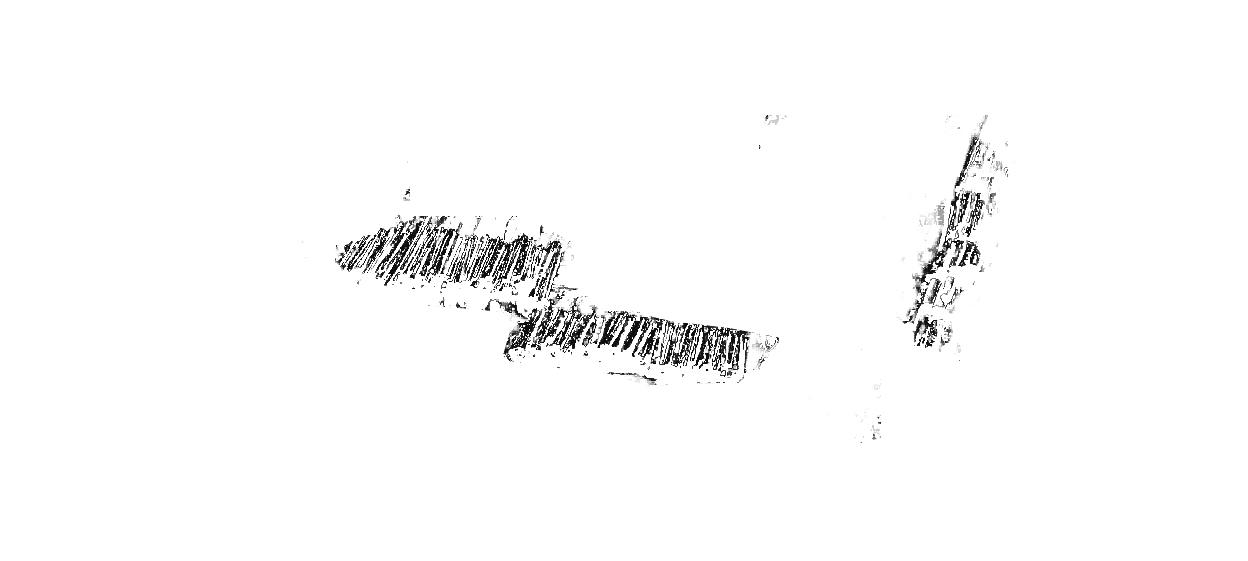
Fig. 6 Rapport Meadows, The limits to growth


Fig. 7 - Croissance industrielle
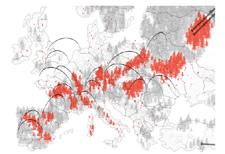
Fig. 8 Chronologie

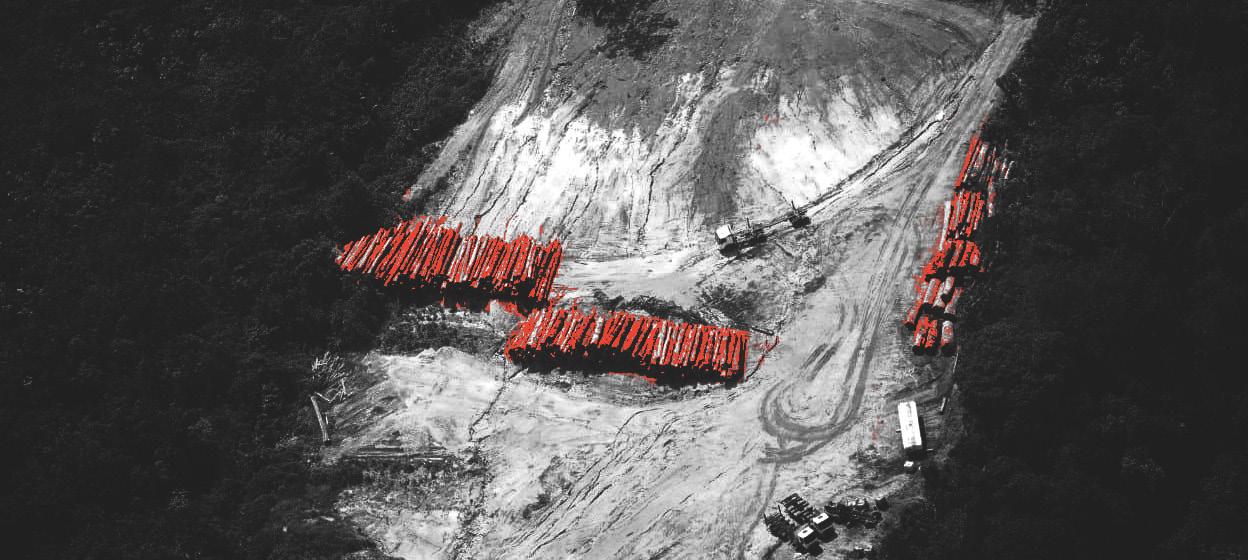

Fig. 9 Calendrier 50 ans
Fig. 10 - Calendrier 150 ans
Fig. 11 - Carte 50 ans
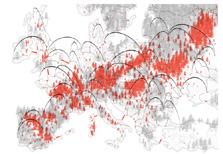
Fig. 12 Carte 150 ans
Fig. 13 - Calendrier 300 ans
Fig. 14 - Calendrier 600 ans
Fig. 15 - Carte 300 ans
Fig. 16 Carte 600 ans
Fig. 17 - Diagramme de pédagogie
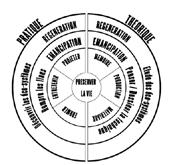
BIBLIOGRAPHIE Alessandro Mendini, La notion de déprojet, Écrits 2020 Alessandro Mendini, An 2000, de quel côté être, Écrits 2020 Andreas Malm, Comment saboter un pipeline 2020 Edward Palmer Thompson, Temps, discipline du travail et capitalisme industriel La fabrique, 1967 Frédéric Neyrat, La Part inconstructible de la Terre. Critique du géo-constructivisme Paris, Le Seuil, 2016. Godelier Maurice, Au fondement des socié é humaines, 2010 Martin Heidegger, Bâtir habiter penser, Essais et conférences 1951 Martin Heidegger, La question de la technique, Essais et conférences 1951 Oswald Spengler, L’homme et la technique. Contribution à une philosophie de la vie 1931 Pierre Caye, Durer 2020 Paul B Preciado, Fais tes cartons sans savoir où tu déménages Libération, 2016 développement d’une production. Puis un pôle pratique qui mettrait en exécution les calendriers spatialement, pour ainsi gérer, entretenir et préserver dans le but d’un processus de production raisonné à long terme.
DOCUMENTS 9

APRÈS LA RÉVOLUTION – NUMÉRO 4 – PRODUCTION EXTRAITS
2021
Fig. Fig. 2 Fig. 3 DOCUMENTS 3
Fig. 5
Fig. 6
Fig. 4
8 DOCUMENTS
Fig. 7
REFORME DES MOYENS DE REPRODUCTION
Marie Chausse et Zoé Thuillier
UNE ABONDANCE DE DECHETS DUS AUX MODES DE PRODUCTION

CAPITALISTES
Les déchets matériels dans les modes de production capitalistes Aujourd’hui, les mécanismes de production de basse qualité, d’obsolescence programmée et de surproduction propres aux modes de production capitalistes sont à l’origine de nombreux déchets irrécupérables, polluants, destructeurs des écosystèmes, des eaux et des océans. Produits de basse qualité, faits en matériaux qui ne peuvent être réutilisés, ils finissent généralement en déchet, détruit de manière polluante, jetés, conservés sous terre ou dans des décharges lointaines, polluant ainsi l’environnement qui les entoure [Fig. 1].

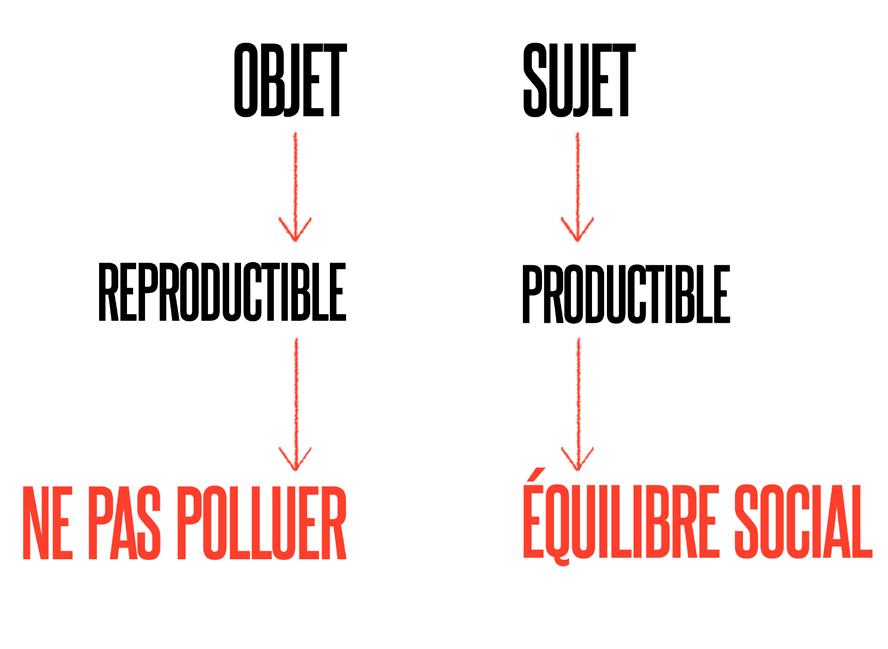
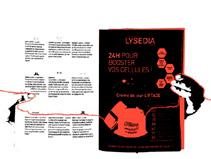
D’après l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, 354 kilogrammes de déchets seraient produits chaque année par habitant. Eurostat quant à lui calcule le nombre de déchets par habitant et par municipalité en y ajoutant les déchets communaux, les chiffres grimpent alors à 536 kilogrammes de déchets par an et par habitant. Enfin, le centre national d’information indépendante sur les déchets dénombre quant à lui 13.8 tonnes de déchets produits par an et par habitant en comptabilisant les déchets produits par le secteur professionnel.
Qu’est-ce qu’un déchet matériel ? Nous avons donc réparti les déchets en trois catégories pour les définir. Les déchets ménagers, les déchets industriels et les déchets nucléaires.
Premièrement les déchets ménagers: il s’agit principalement des emballages de produits, des objets ne fonctionnant plus ou abîmés, des objets à usage unique et des déchets alimentaires. Ces déchets sont détruits par incinération, compostage, recyclés, stockés dans des décharges contrôlées ou encore jetés dans la nature [Fig. 2].
Deuxièmement, les déchets industriels. Il s’agit soit de déchets banals ou de déchets dangereux. Ils sont traités de manière physico-chimique, incinérés ou placés dans des décharges spécialisées [Fig. 3].


Les déchets nucléaires quant à eux ne sont pas détruits, ils sont stockés en surface ou en profondeur en fonction de leur radioactivité. Ils présentent ainsi de grands risques de pollution des sols qui les entourent. En effet, d’après Roland Desbordes, ancien président de la commission de recherche et d’information indépendantes sur la radioactivité, certains sites français comme celui du Bois Noir seraient contaminés par les déchets émanant des mines d’uranium [Fig. 4].
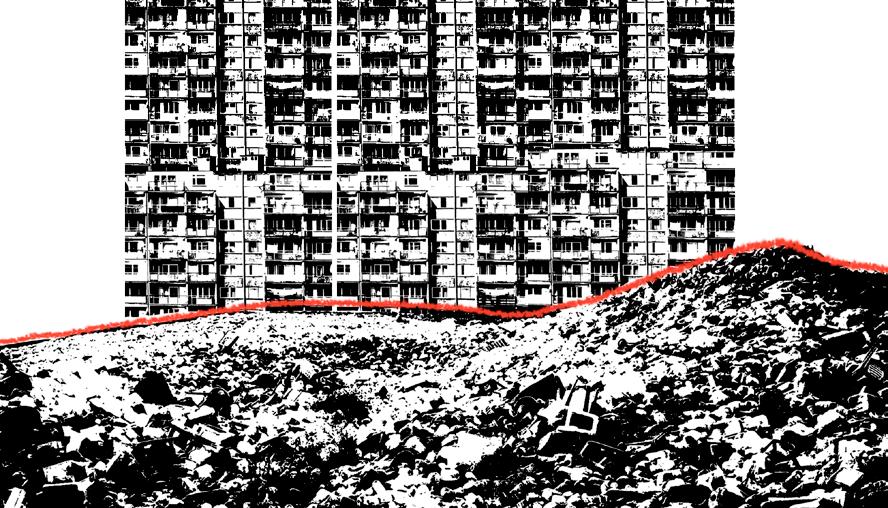
La suppression de la publicité et la réforme des médias comme émancipation et générateur d’une nouvelle économie Premièrement, la suppression de la publicité permet de consommer raisonnablement et d’éliminer la transmission de modèles sociaux.

D’après Noam Chomsky et Edward Herman dans La fabrique du consentement, la publicité pousse à la surconsommation et devient donc dangereuse pour l’environnement. Elle est aussi dangereuse socialement puisqu’elle influence l’opinion publique aux profits de ses détenteurs, riches et puissants qui souhaitent maintenir le contrôle sur les masses. Actuellement, une entreprise peut dépenser jusqu’à 55 % de son budget dans la publicité, ce coût est payé par le consommateur lors de son achat. Au sein de l’école de réforme des moyens de reproduction, ce coût est donc supprimé, et réinjecté dans le média ainsi que dans le financement de l’école.


Dans ce même ouvrage, Chomsky et Herman expliquent que les médias occidentaux sont l’outil de propagande de la démocratie. Ce modèle s’exerce à travers cinq filtres sa dimension économique, le poids de la publicité, le poids des sources officielles, les pressions exercées et le filtre idéologique de la production capitaliste [Fig. 22].
Afin de produire des individus politiques et conscients, les médias sont repensés et réformés lors d’ateliers au sein de l’institution. Pour déjouer ce modèle, un impôt est mis en place, payé par le citoyen et transféré directement aux médias. Suite à la suppression des coûts liées à la publicité, l’impôt payé par le citoyen est équilibré dans les dépenses. Par ce fonctionnement, les médias sont équitables, les sources transparentes et leur diversité permet d’avoir un regard averti sur le monde.
Par cette réforme, les individus s’émancipent des modèles sociaux transmis [Fig. 23] et une nouvelle économie est générée. Les médias ne sont donc plus un outil de propagande reproduisant des sujets, mais un outil de diffusion d’informations favorisant la productibilité d’individu conscient.

8 PÉDAGOGIE
Une émancipation pour un mode de production inclusif: libéraion collective de l’assigment de rôle et du déterminisme social Dans notre école de réforme des moyens de reproduction, nous nous émancipons de la publicité pas seulement économiquement, mais nous nous libérons aussi collectivement de l’assignation de rôle et du déterminisme social. La réforme des médias et la suppression de la publicité ont un impact sur la productibilité d’individus politiques. Elles questionnent notamment la place de la femme, chargé d’histoire dans les modes de production du capitalisme. Comme l’explique Silvia Federici dans Le capitalisme patriarcale les femmes étaient tellement abusé dans leur travail ménager, sexuel et de mère reproductrice d’enfants qu’il était plus bénéfique pour elle de se reconvertir dans le travail du



sexe. En effet, leurs tâches étaient similaires, mais en exerçant ce travail, elles devenaient libres et indépendantes financièrement. La suppression de la publicité vise donc à éliminer le modèle social dans lequel la femme a pour devoir de s’occuper des tâches liées à la reproduction et participe de manière générale à réduire les stéréotypes et les inégalités entre individus. Dans notre école de réformes des moyens de reproduction nous luttons contre le système patriarcal et l’assignation de rôle.
Les échanges réalisés au sein de cette nouvelle institution et des différents ateliers proposés permettent l’inclusion de chaque individu qui deviennent pensant et politiques.
Dans les modes de production du capitalisme patriarcal, l’homme est une main-d’œuvre pour la production de capital. Le capitalisme
a assigné à la femme le rôle de s’occuper de l’homme et du foyer, afin que celui-ci soit plus productif dans son travail. Dans notre école de réforme des moyens de reproduction, la place des hommes est également reconsidérée. Ils ne sont plus assimilés à des outils de production, pilier de leur famille, robuste et insensible, mais à des individus pensant et libres dans leurs choix.
Ces réformes permettent de se libérer des diktat de la beauté, du sexisme ordinaire, de supprimer les stéréotypes marketings entre homme et femme et d’éviter la transmission de tout autre type de modèle sociaux dans lesquels s’inscrire. L’ensemble de ces réformes ont pour but de participer à la suppression de stéréotypes et de lutter contre le sexisme, le racisme ou toutes formes d’oppressions exercées sur la production de sujets.
UNE ECOLE EN FAVEUR DE LA REPRODUCTIBILITE DES OBJETS ET DE LA PRODUCTIBILITE DES SUJETS
Au sein de l’école de réforme des moyens de reproduction, le mot déchet n’existe plus, autant dans la culture matérielle que dans l’univers social. La production des objets n’est plus un danger pour l’environnement puisqu’elle est reproductible, la reproduction des sujets n’est plus seulement biologique et envisagée comme reproduction de la force de travail, elle devient productible d’individus à part entière, de sujets politiques et pensants.
APRÈS LA RÉVOLUTION – NUMÉRO 4 – PRODUCTION
Fig. 23
PÉDAGOGIE 9
Fig. 22
2 PÉDAGOGIE
PÉDAGOGIE 3
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 4
Fig. 3
INSTITUER LA PRODUCTION
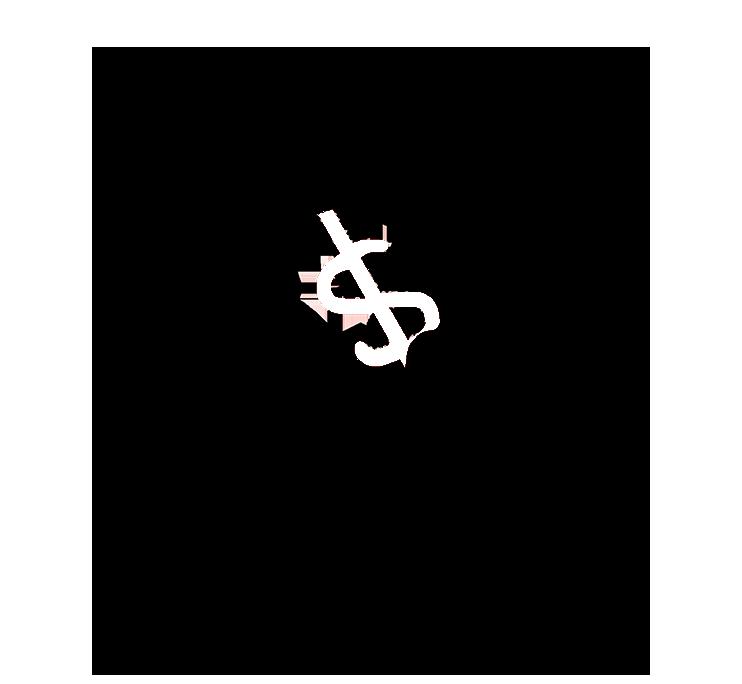
RÉFORMES DES MOYENS DE PRODUCTION
Noémie Bertrand & Corentin Brissart
CAPITALISATION DES RESSOURCES
NATURELLES Aujourd’hui, le fonctionnement de l’appareil productif est contraire au fonctionnement de la nature. Comme l’exprime Georges Bataille dans La Part Maudite “La source et l’essence de notre richesse sont données dans le rayonnement du soleil, qui dispense l’énergie sans contrepartie. Le soleil donne sans jamais recevoir” [Fig. 27]. La nature, fertile, est dans le don continu et désintéressé. A l’inverse, les modes de production capitalistes fonctionnent par l’extraction des ressources. Nous recevons sans jamais donner en retour et produisons par la destruction.Pierre Dardot et Christian Laval décrivent dans un ouvrage nommé “Commun” l’oligarchie capitaliste dans laquelle un nombre infime de personnes possèdent le pouvoir économique en tirant profit de l’appropriation, l’exploitation et la destruction des ressources naturelles qui devraient être reconnues comme «biens communs» [Fig.1]. C’est une réflexion néolibérale contre les formes d’appropriation commune, contre la capitalisation des ressources naturelles [Fig. 3].
L’aliénation du travail par les modes de production capitalistes Le paradigme du travail est supposé accomplir et libérer l’être humain [Fig.2]. Dans les faits, la mobilisation globale nous aliène et nous domine. Sous le règne de l’hyper productivité, le processus d’accroissement des capitaux est illimité et les inégalités ne cessent de s’accroître. Les classes sociales se creusent et le prolétariat est soumis à la répartition injuste des richesses [Fig.4]. Agnes Heller s’est appuyée sur les propos de Marx afin de théoriser le système de production sous le processus capitaliste comme un moyen d’aliéner et de déshumaniser le travail. Elle partage la même idée que Marx lorsqu’il compare le travail humain à celui des animaux ; instinctif, sans réflexion ni conscience, qui ne sollicite pas la capacité humaine à créer, penser et prévoir l’œuvre.





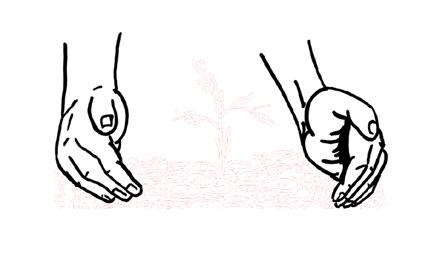



APRÈS LA RÉVOLUTION – NUMÉRO 4 – PRODUCTION
Fig.26
Fig.1
Fig.2
Fig.4
APRÈS LA RÉVOLUTION
Après la révolution est un journal d’application de la pensée architecturale à d’autres objets que la production de bâti. Ce premier hors-série traite des luttes organisées et menées à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
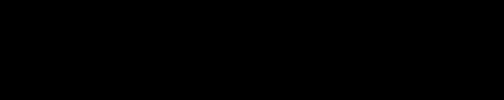
Cet ouvrage s’appuie sur le travail de thèse en cours de Marianna Kontos, coordinatrice de ce numéro, membre du journal Après la révolution et militante au sein de deux collectifs d’habitant·e·s mobilisé·e·s, le Comité de vigilance JO Paris 2024 à Saint-Denis et Saccage 2024. Ce travail propose un autre rapport à la recherche, une recherche en lutte, capable de contribuer à une mobilisation qui s’est développée ces quatre dernières années autour des aménagements liés aux JO de Paris 2024 :
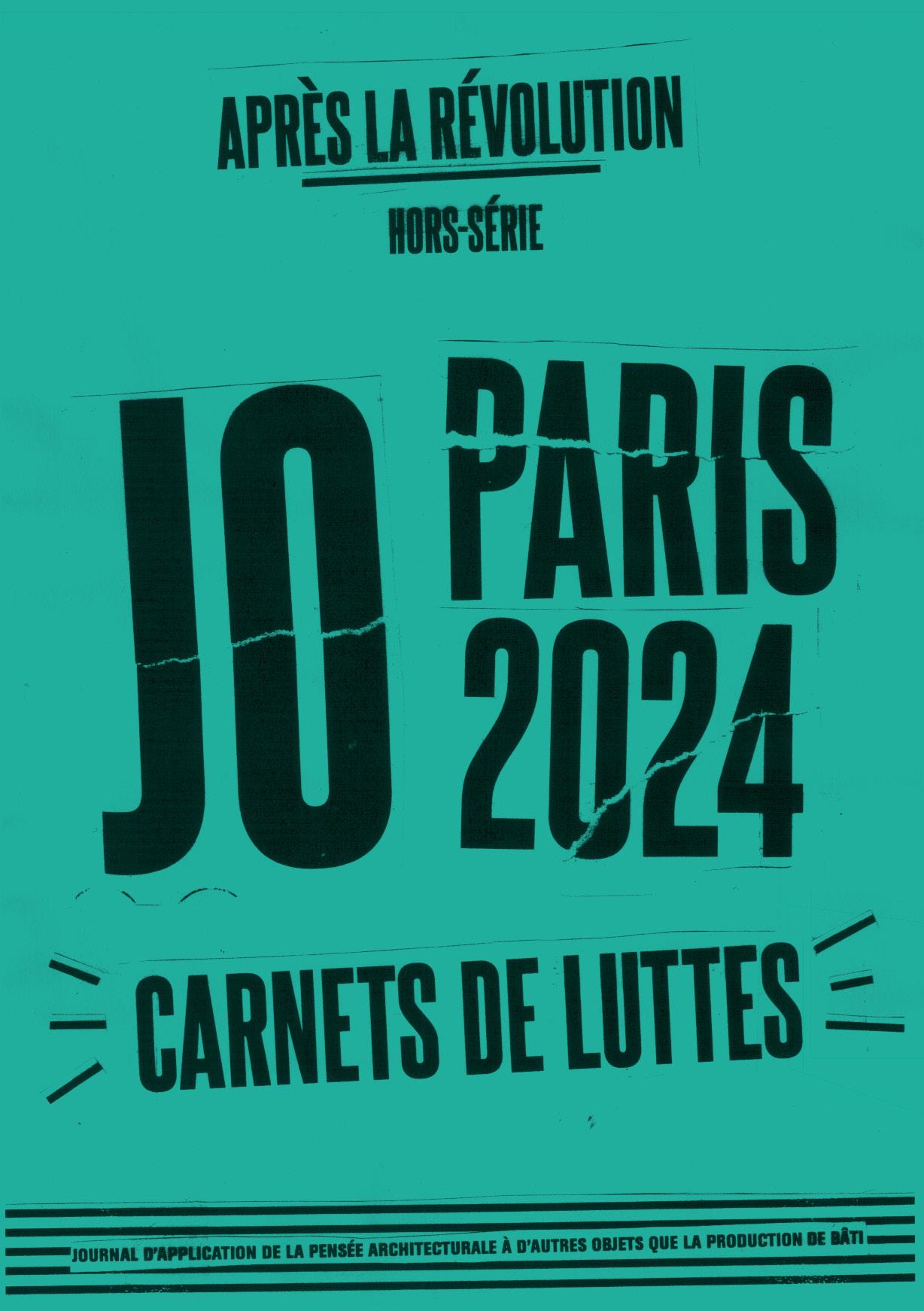
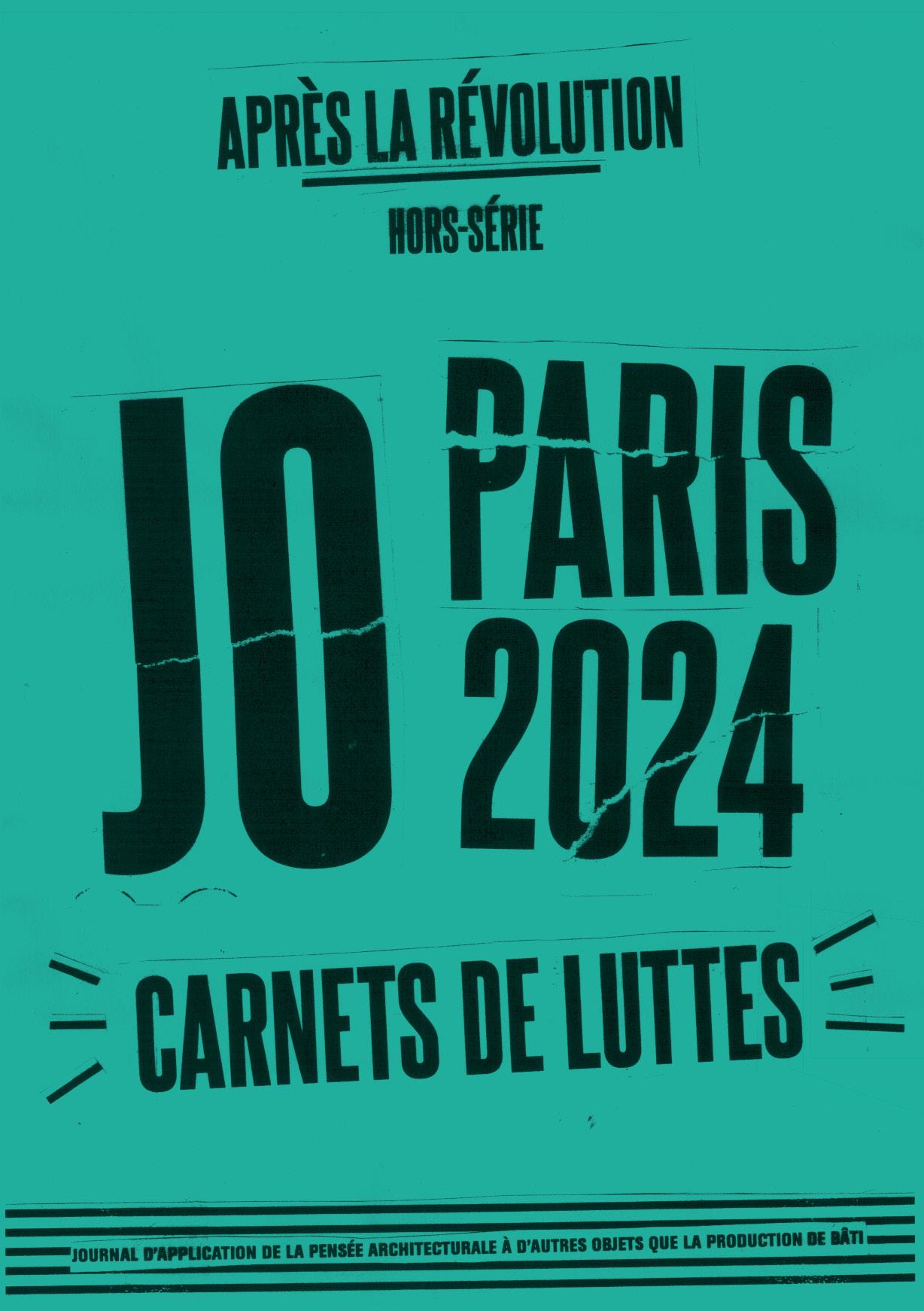
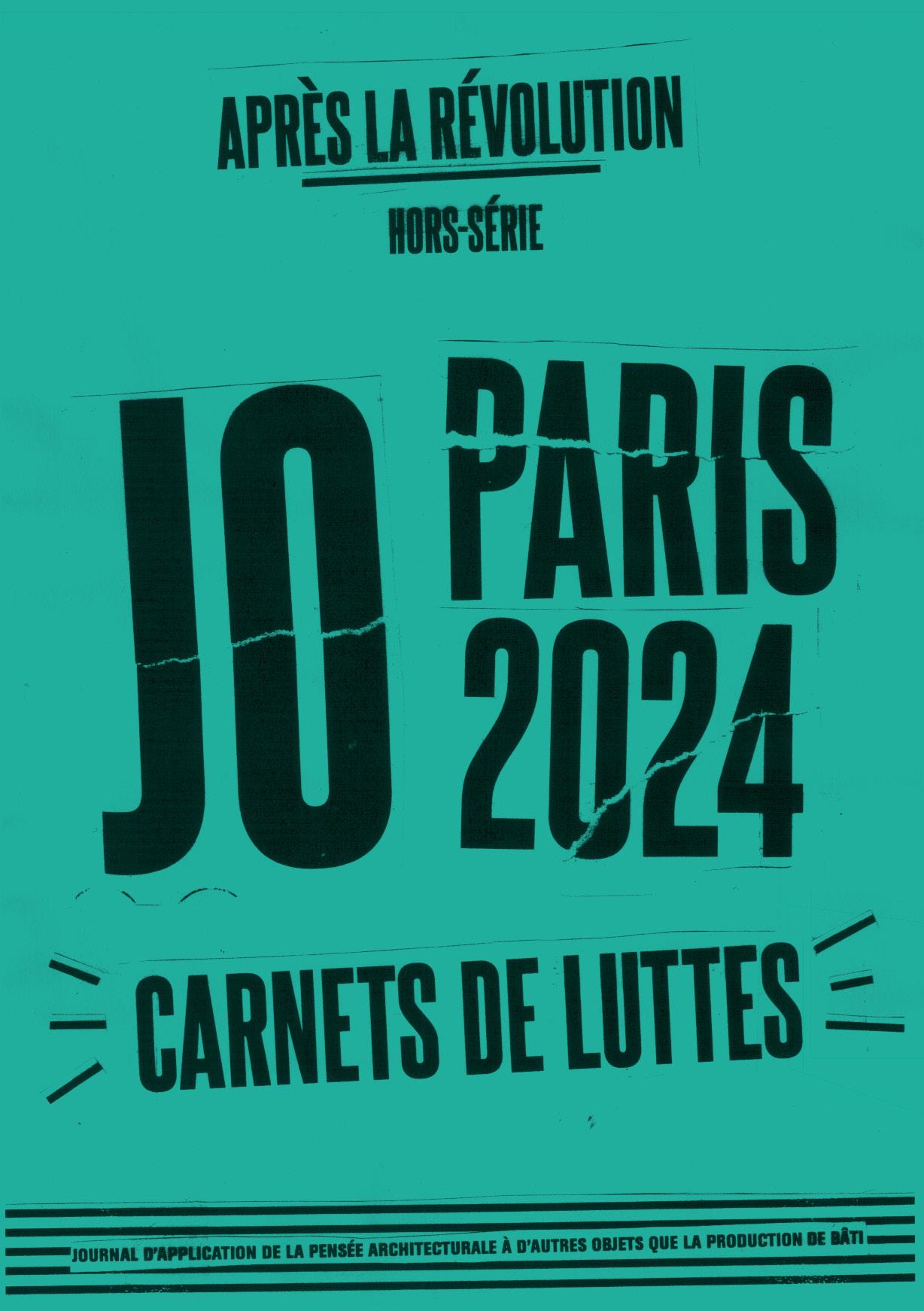
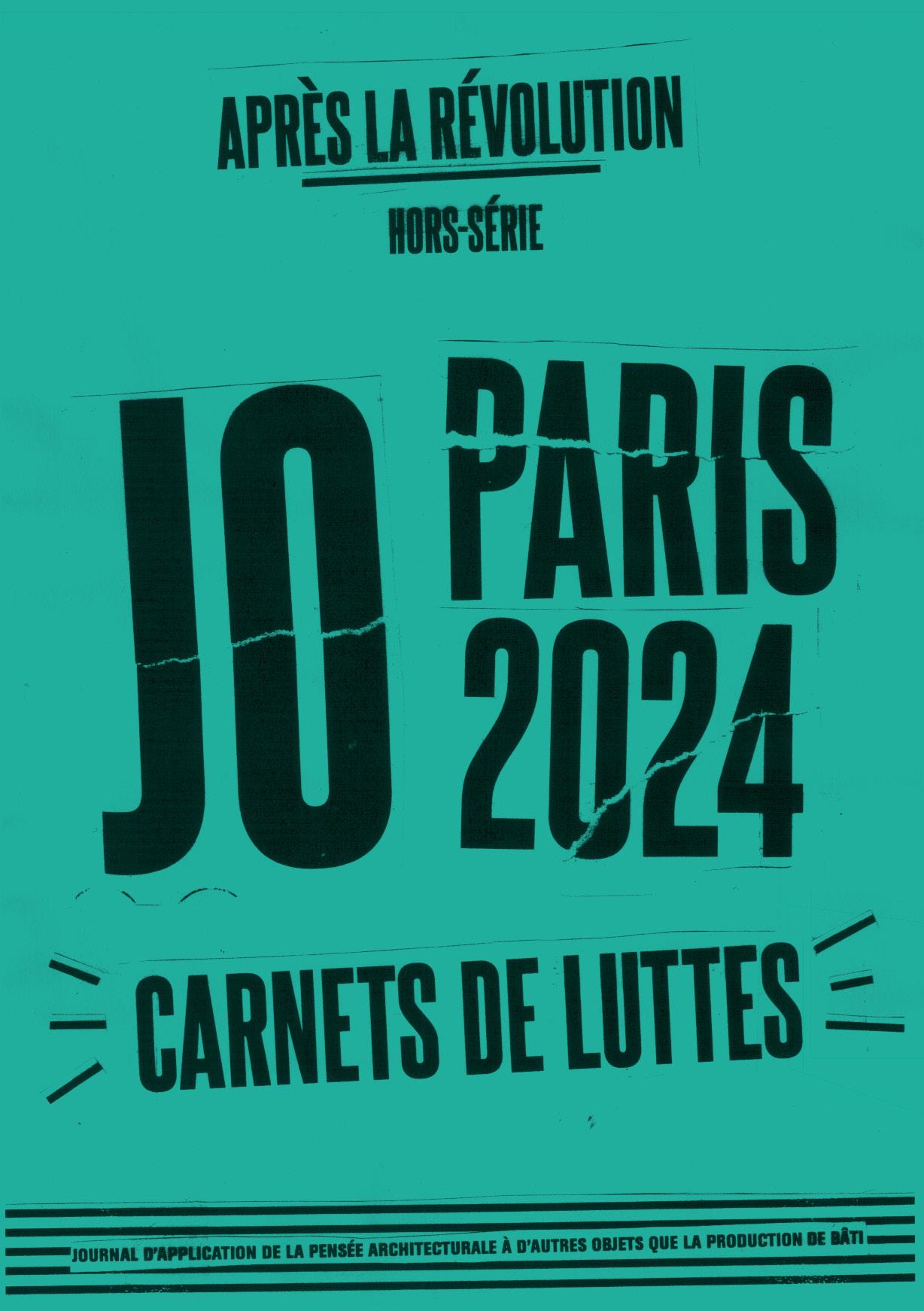
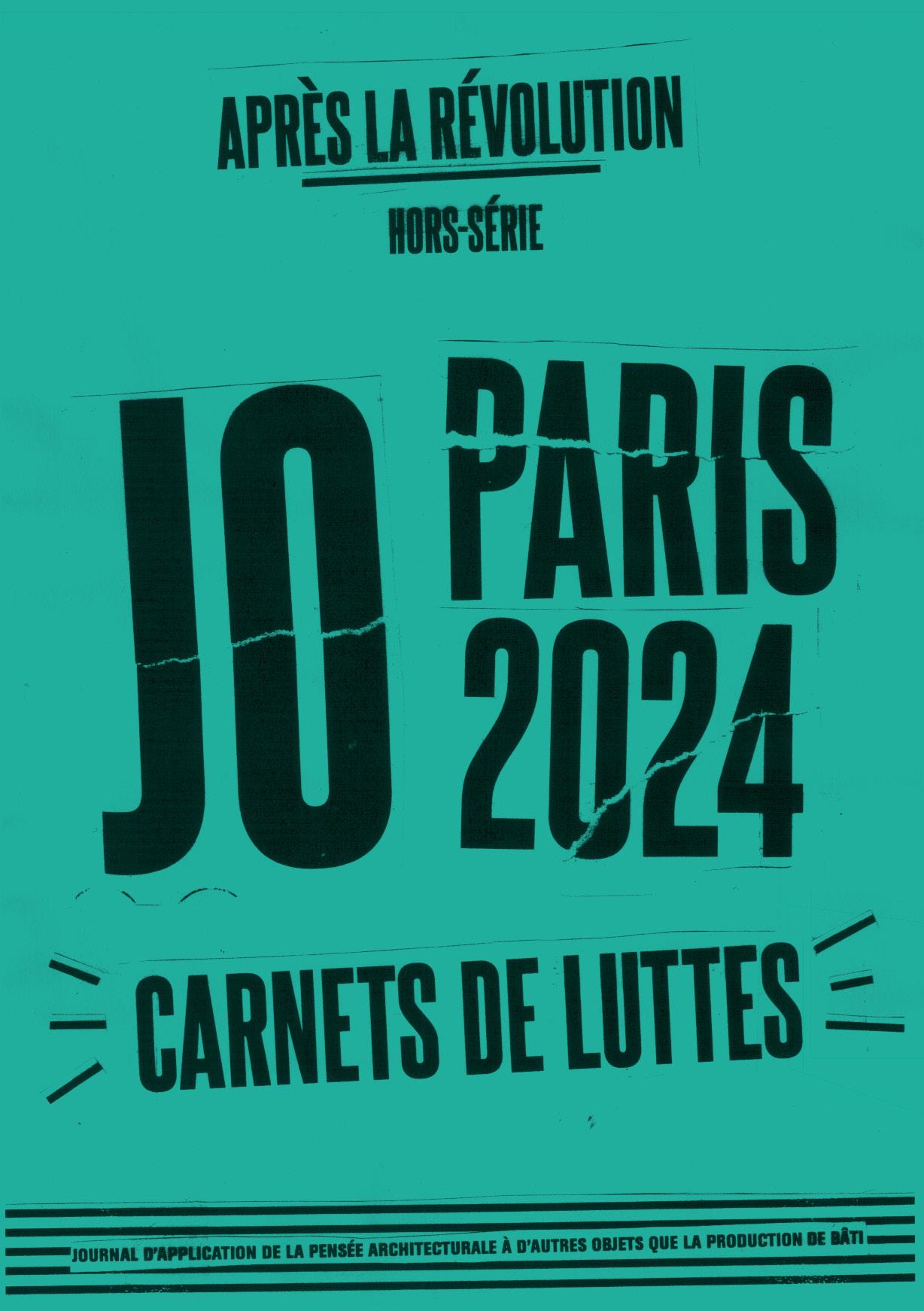 HORS SÉRIE – JO PARIS 2024. CARNETS DE LUTTES
HORS SÉRIE – JO PARIS 2024. CARNETS DE LUTTES
le projet polluant de l’échangeur autoroutier sur l’A86 pour le quartier Pleyel et les 700 enfants de l’école Pleyel Anatole France à Saint-Denis ; l’urbanisation de l’aire des vents du Parc départemental Georges Valbon ; la destruction d’un hectare des jardins ouvriers d’Aubervilliers ; l’expulsion et le relogement indigne des résidents du Foyer de travailleurs migrants ADEF de Saint-Ouen ; la programmation urbaine accélérant le processus de gentrification de la Seine-Saint-Denis et contribuant ainsi au projet du Grand Paris… C’est dans cette perspective combative que l’ouvrage s’inscrit, en donnant la parole aux habitant·e·s mobilisé·e·s, mais aussi aux chercheur·euse·s engagé·e·s et aux militant·e·s de différents pays, critiques de l’organisation de tels grands évènements mondialisés au service de la fabrication de la ville néolibérale.
Ce hors-série comprend 25 contributions et documents. Il est mis en page, imprimé, relié et façonné à Saint-Étienne par les membres de l’association Après la révolution.
Format : 20,8 x 29,5 cm, 150 pages
ISSN : 2678-3991
ISBN : 978-2-493403-00-1
Prix : 20 euros
Rayons : Beaux-arts / Essais
Thèmes : Architecture / Sciences sociales
Sortie : Mars 2022
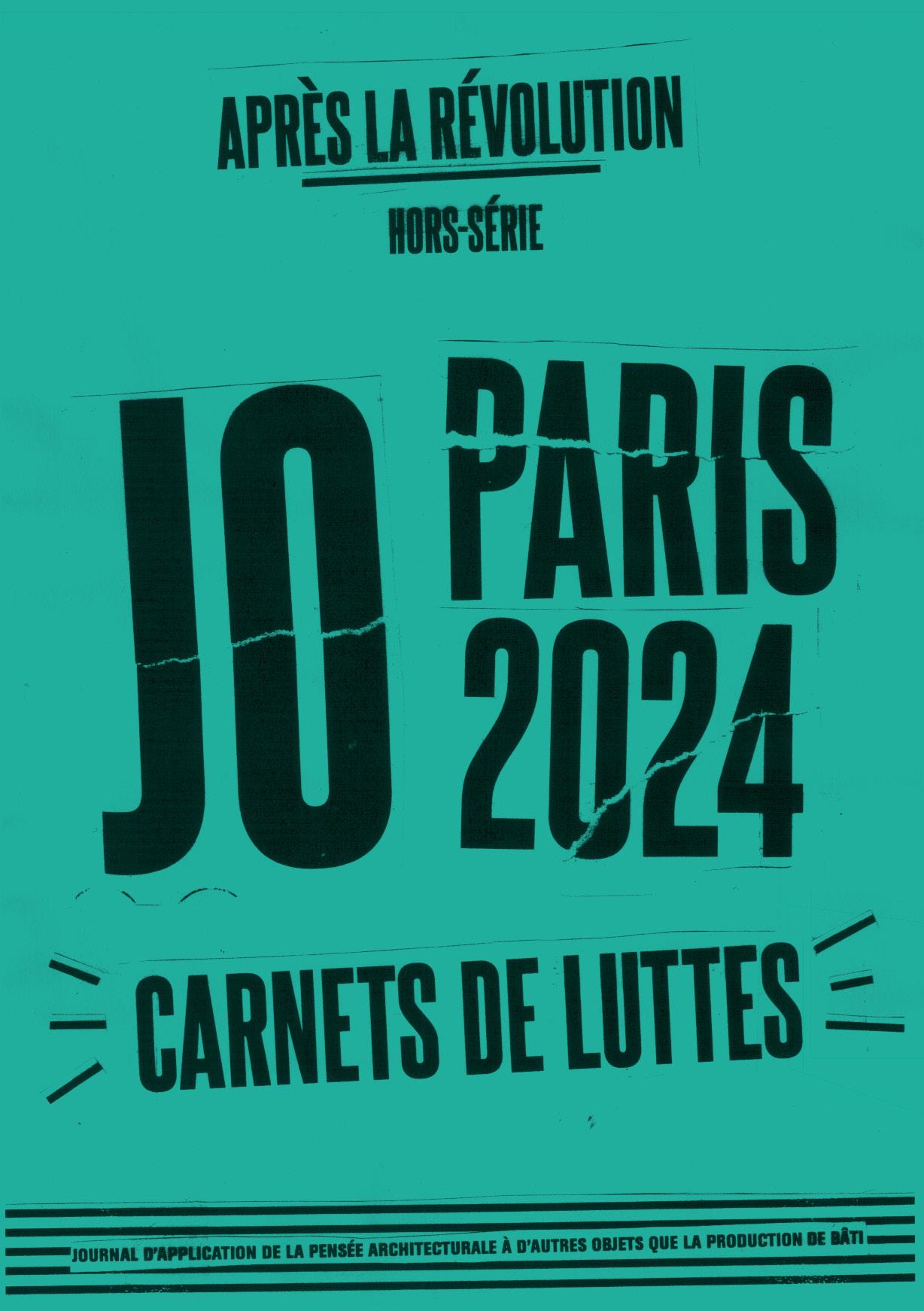
APRÈS LA RÉVOLUTION – HORS-SÉRIE – JO PARIS 2024. CARNETS DE LUTTES
ÉDITO
> POUR UNE RECHERCHE EN LUTTE – Manuel Bello Marcano, Marianna Kontos, Xavier Wrona
COMPRENDRE LE CONTEXTE DES JO DE PARIS 2024
> TEMPS, DÉMOCRATIE, JUSTICE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE DANS LA FABRICATION URBAINE DES JEUX
OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES PARIS 2024. CE QUE RÉVÈLE LA MOBILISATION DES HABITANTS DOCUMENTS : PLAN DE SITUATION DES PROJETS JO – SCHÉMA DES ACTEURS – FRISE CHRONOLOGIQUE – Marianna Kontos
> EXTRAIT DE PLAINE COMMUNE : ENTRE GENTRIFICATION ET ARTIFICIALISATION DES TERRES – Asso Appuii
> PETITE ENCYCLOPÉDIE DE L’HÉRITAGE À VENIR EN SEINE-SAINT-DENIS – Saccage 2024
> LECTURE CRITIQUE DE LA LÉGISLATION OLYMPIQUE : LA FRANCE AU GARDE-À-VOUS DEVANT LE CIO – Frédéric Viale
> JO 2024 : L’AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE PLANIFIE LA TECHNOPOLICE – Halte au Contrôle Numérique
LA MOBILISATION CONTRE LES JO DE PARIS 2024
Le comité de vigilance JO Paris 2024 à Saint-Denis
> INFORME : QUELQUES TRACTS DU TOXIC TOUR
> INTERPELLE/MOBILISE : LES CAHIERS CITOYENS/LETTRES/TEXTES/TWEETS DU COMITÉ DE VIGILANCE JO PARIS 2024
> DÉNONCE : IMAGES DE LUTTES
> PROPOSE : UN PLAN ALTERNATIF
> ENTRETIEN DE MARIANNA KONTOS AVEC HAMID OUIDIR
Saccage 2024
> INFORME : « TU VOIS LÀ, SOUS MON JARDIN, CE SERA LES QUAIS DU MÉTRO. PAROLES
DE JARDINIER·E·S D’AUBERVILLIERS ET DE PANTIN »
> DÉNONCE/MOBILISE : IMAGES DE LUTTES YOUTH FOR CLIMATE – BANDEROLES DE MANIF
– PHOTOS ET AFFICHE ANTI-PUB – TRACTS
> OCCUPE : IMAGE DE LA JAD – TRACTS DE PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS À LA JAD
> ENTRETIEN DE MARIANNA KONTOS AVEC FLEUVES ET ENTIONE
CONTRE LES JO ET LEUR MONDE
> CELEBRATION CAPITALISM AND THE POLITICS OF THE OLYMPIC GAMES – Jules Boykoff
> LA POLLUTION, UN MAL COMMUN POUR LUTTER CONTRE LES INJUSTICES ENVIRONNEMENTALES SUR LE TERRITOIRE DES JO EN SEINE-SAINT-DENIS ? – Pauline Biern
> HENRI LEFEBVRE AUX JEUX OLYMPIQUES. LE DROIT À LA VILLE DANS LES MOBILISATIONS D’HABITANTS À SAINT-DENIS
– Guillaume Jean
> DÉFENDRE LE COMMUN AU SEIN DES RÉSIDENCES SOCIALES. LE CAS DU FOYER DE TRAVAILLEURS MIGRANTS DE SAINT-OUEN – Clarisse Jouan et Célia Escribano
> L’EFFET JEUX OLYMPIQUES SUR UN FOYER DE TRAVAILLEURS MIGRANTS – Aissatou Mbodj
> DES FOYERS AUX RÉSIDENCES SOCIALES : UN RACISME D’ÉTAT – Michael Hoare
> YOU CANNOT REFORM THE OLYMPICS – NOlympicsLA
> LES JEUX OLYMPIQUE 2016 ET LES LEÇONS DU PASSÉ : L’EXPÉRIENCE PÉDAGOGIQUE DE LA VILA AUTÓDROMO ET DU MUSEU DAS REMOÇÕES – Matheus Viegas Ferrari
> OLYMPIAN APPARATUSES – Sabu Kohso
> UNE CRITIQUE URBAINE DES JO D’ATHÈNES 2004 – Maria Markou
> JO 2024 : DES ACCUSATIONS DE PROPOS RACISTES ET MISOGYNES CRÉENT UNE CRISE INTERNE
– Jade Lindgaard et Antton Rouget
> EXTRAIT DE LES MÉTROPOLES BARBARES. DÉMONDIALISER LA VILLE, DÉSURBANISER LA TERRE
– Guillaume Faburel
> EXTRAIT DE LA NATURE EST UN CHAMP DE BATAILLE – Razmig Keucheyan
APRÈS LA RÉVOLUTION – HORS-SÉRIE – JO PARIS 2024. CARNETS DE LUTTES
SOMMAIRE DU NUMÉRO
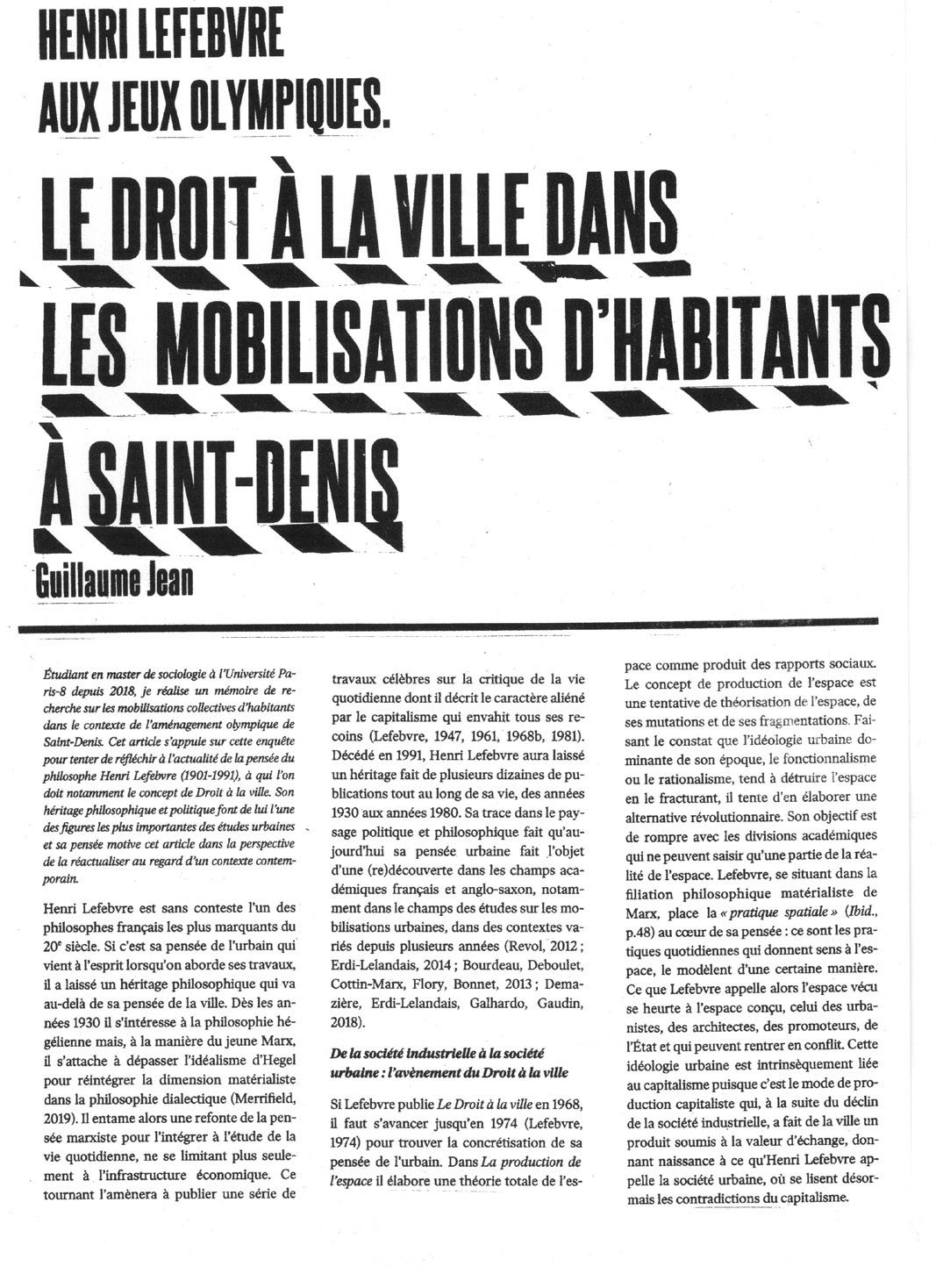

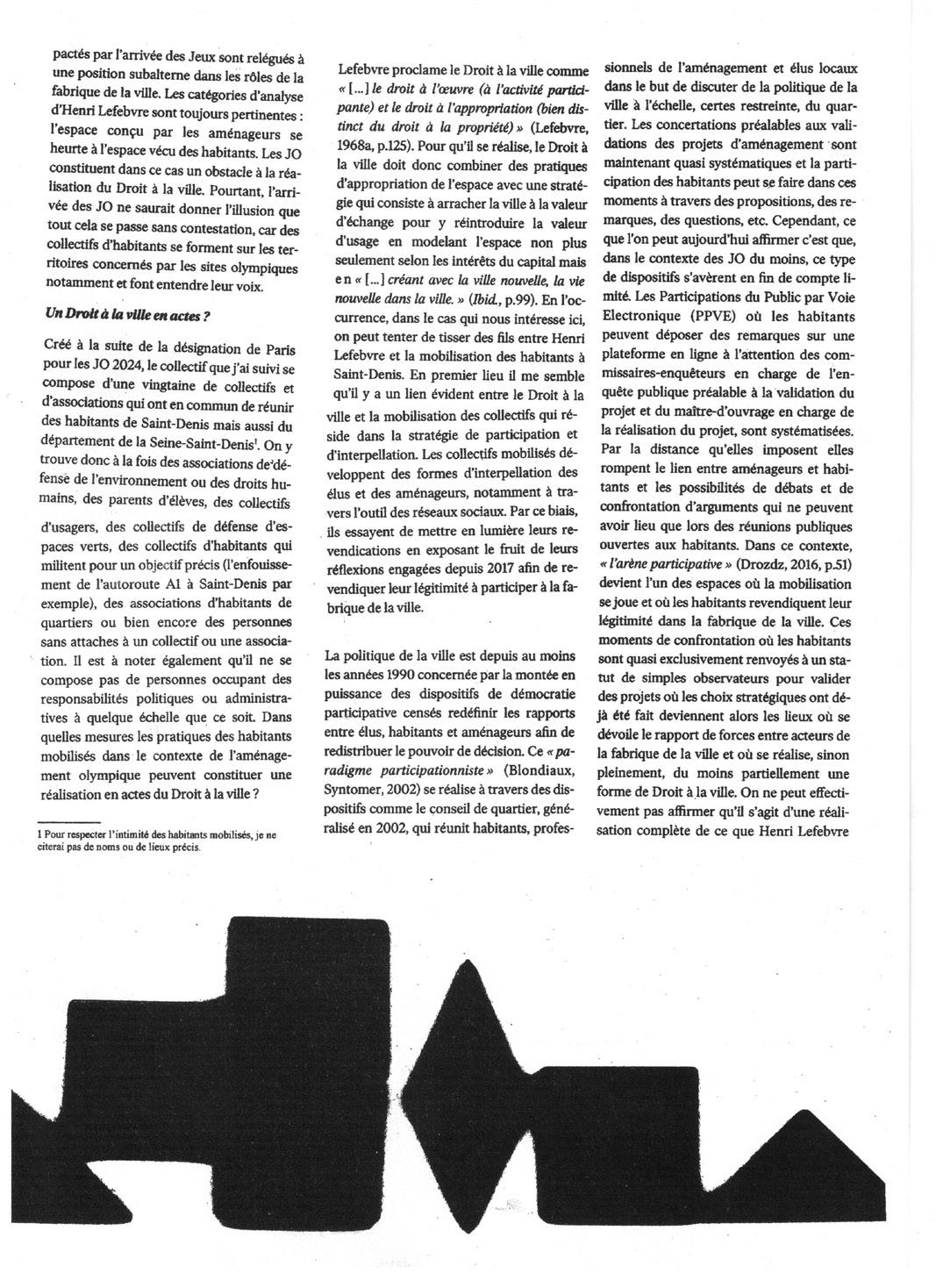
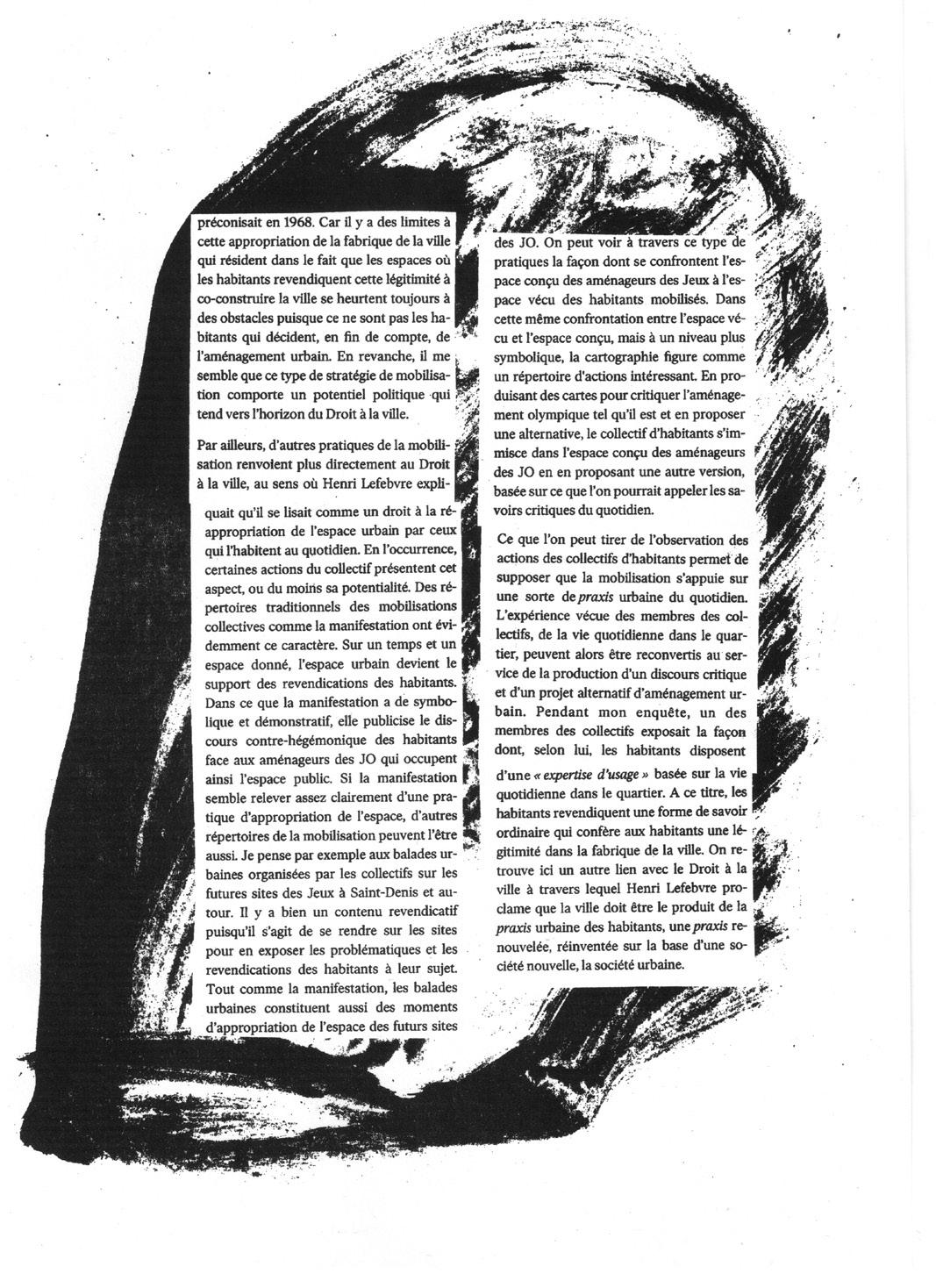
APRÈS LA RÉVOLUTION – HORS-SÉRIE – JO PARIS 2024. CARNETS DE LUTTES
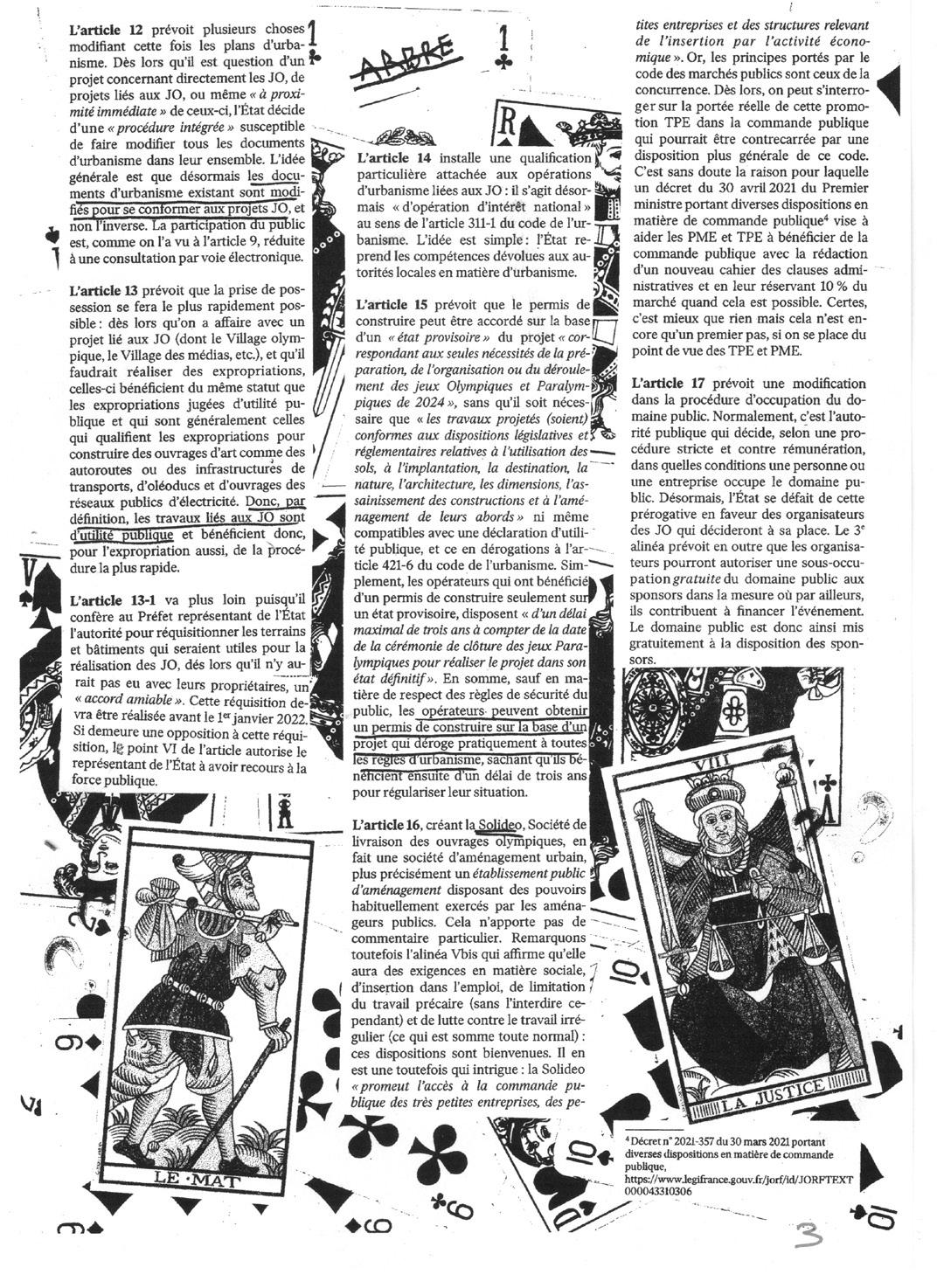
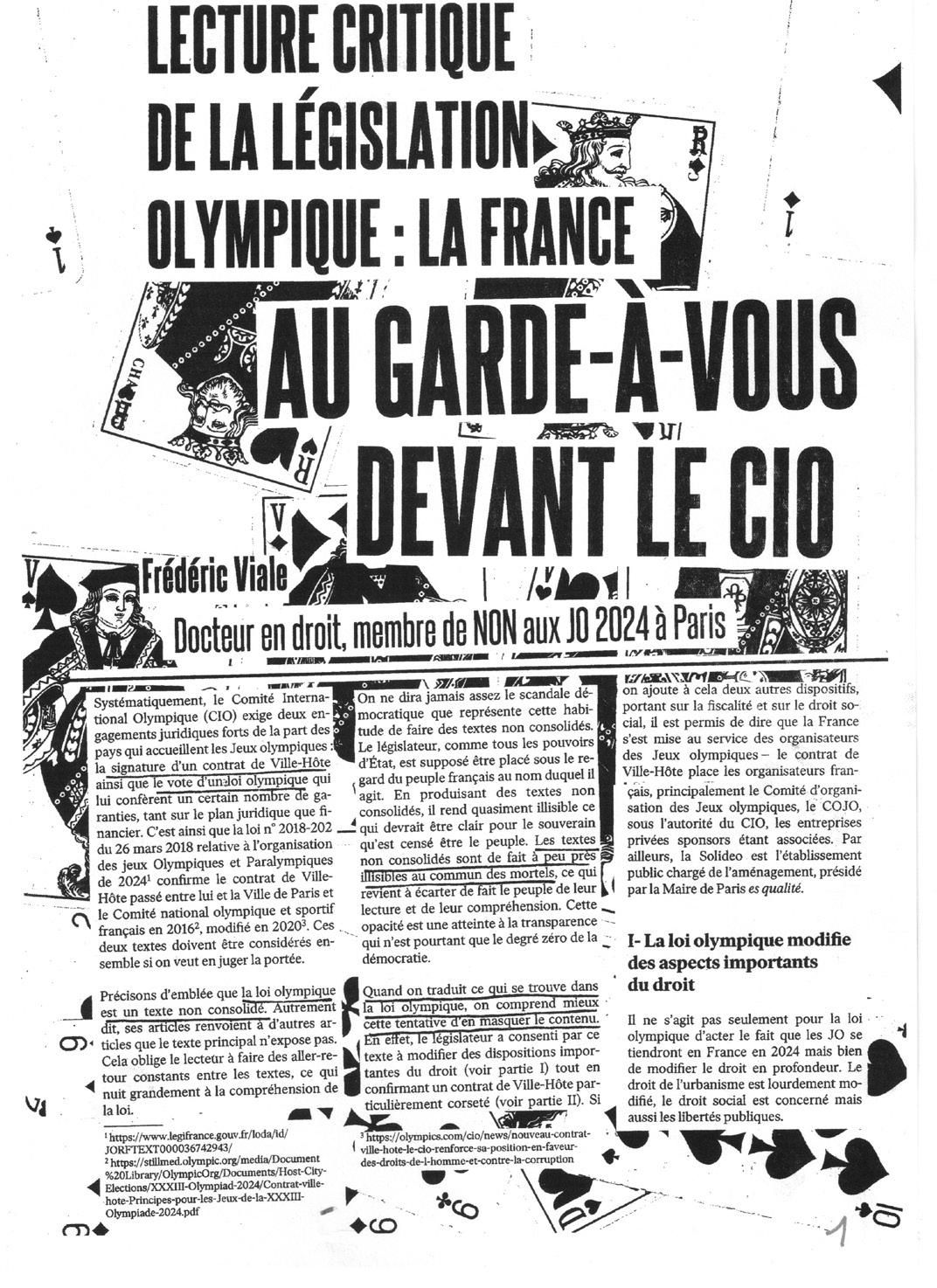
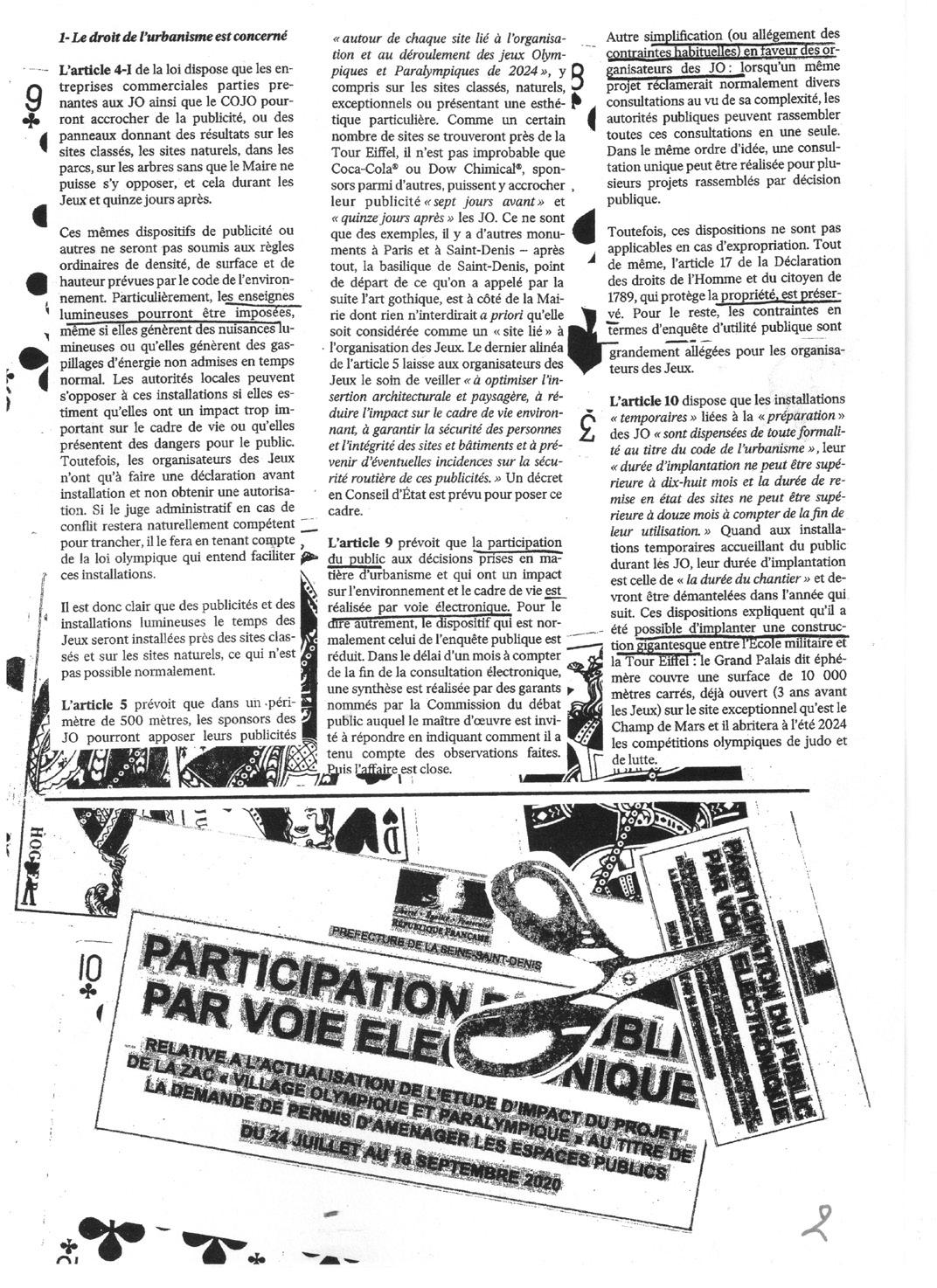
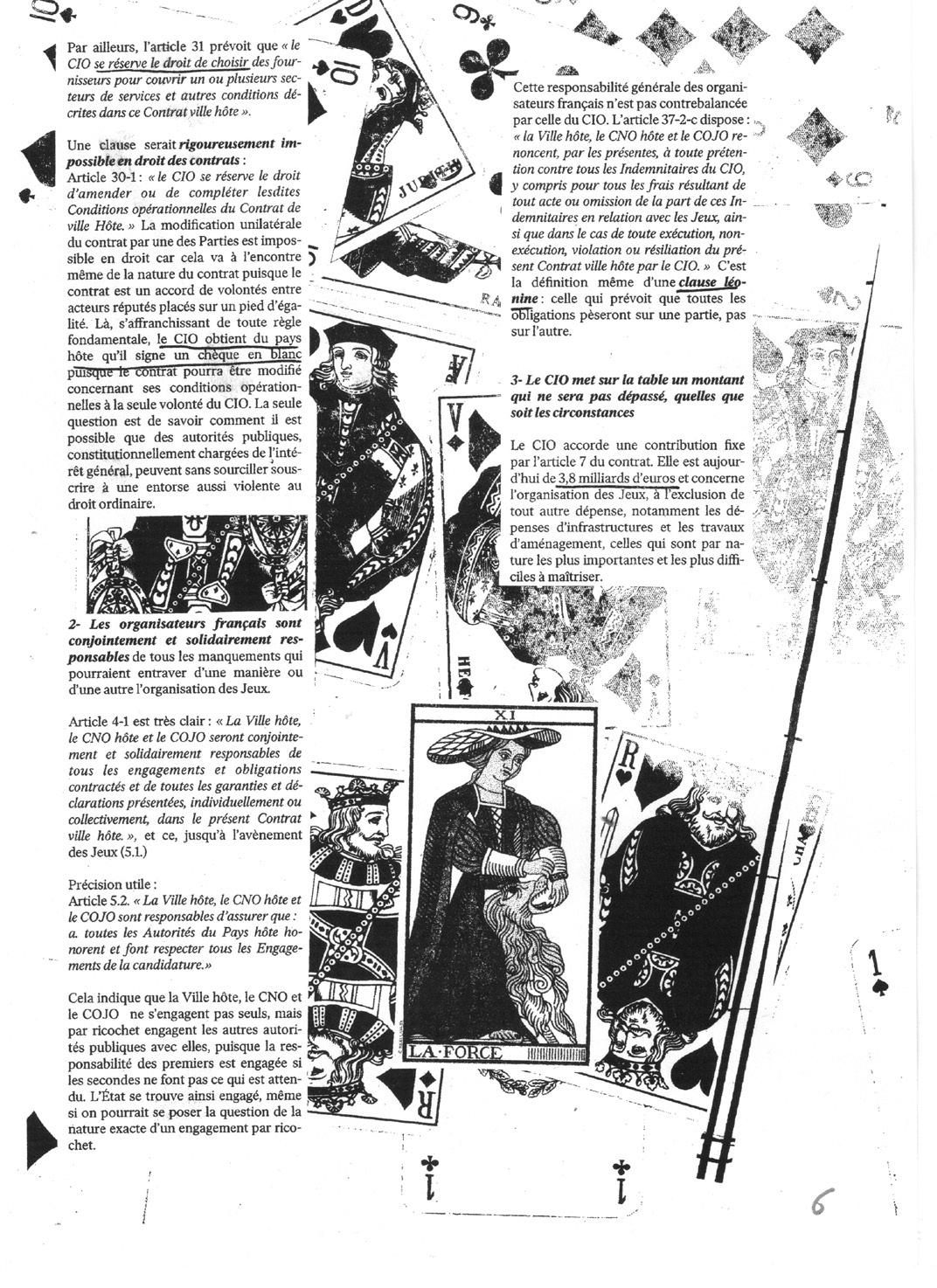
APRÈS LA RÉVOLUTION – HORS-SÉRIE – JO PARIS 2024. CARNETS DE LUTTES
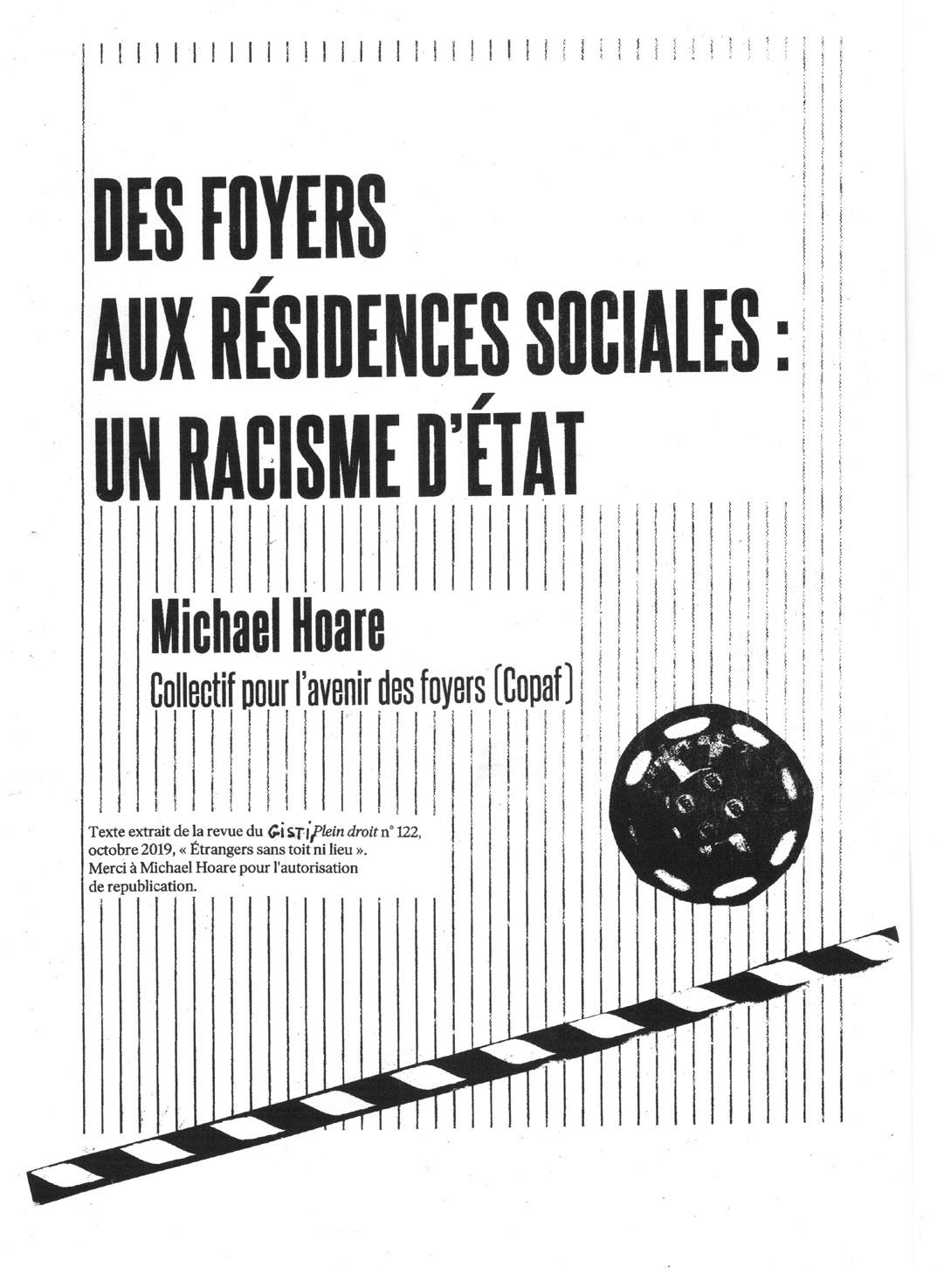


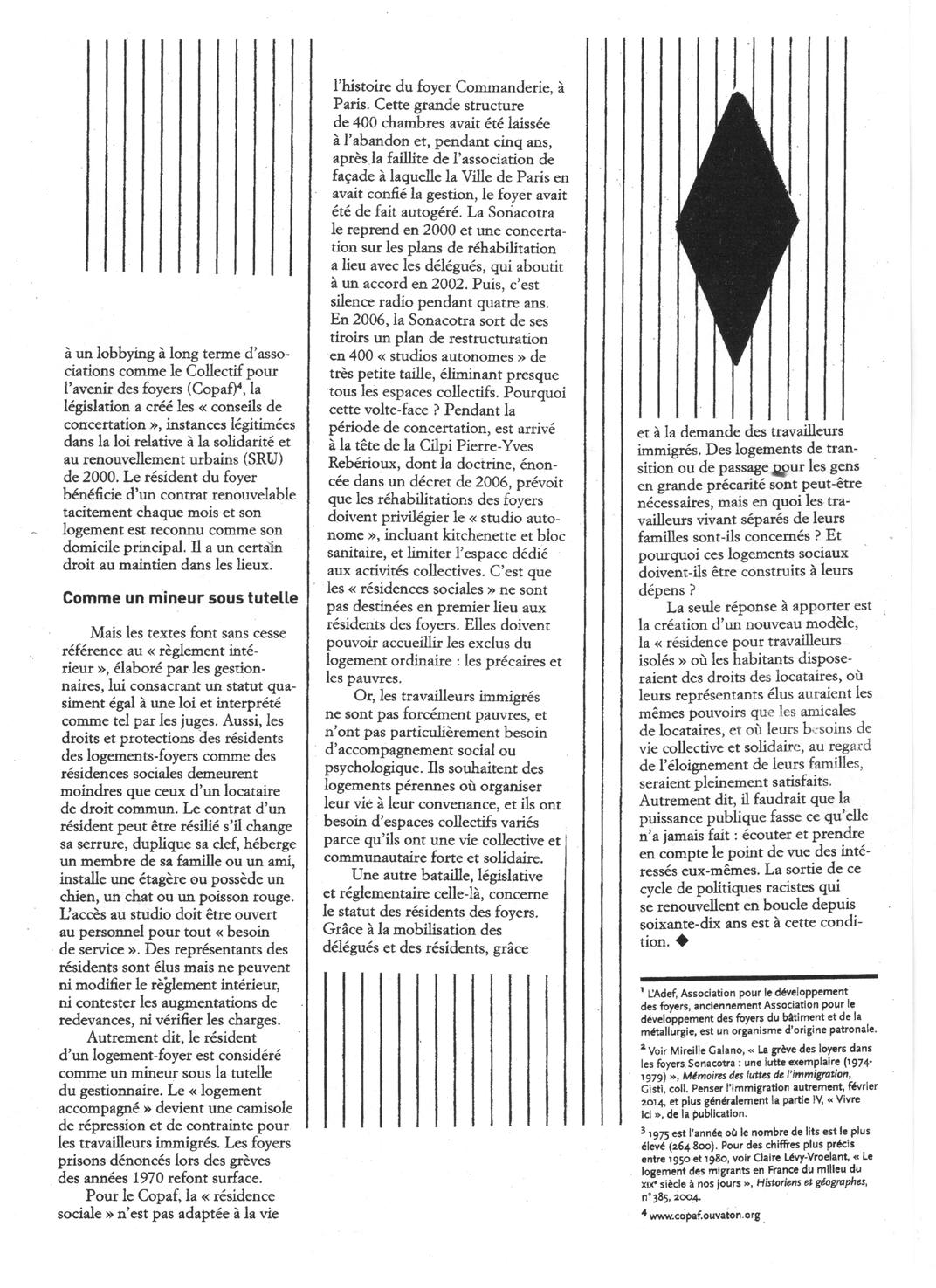
APRÈS LA RÉVOLUTION – HORS-SÉRIE – JO PARIS 2024. CARNETS DE LUTTES
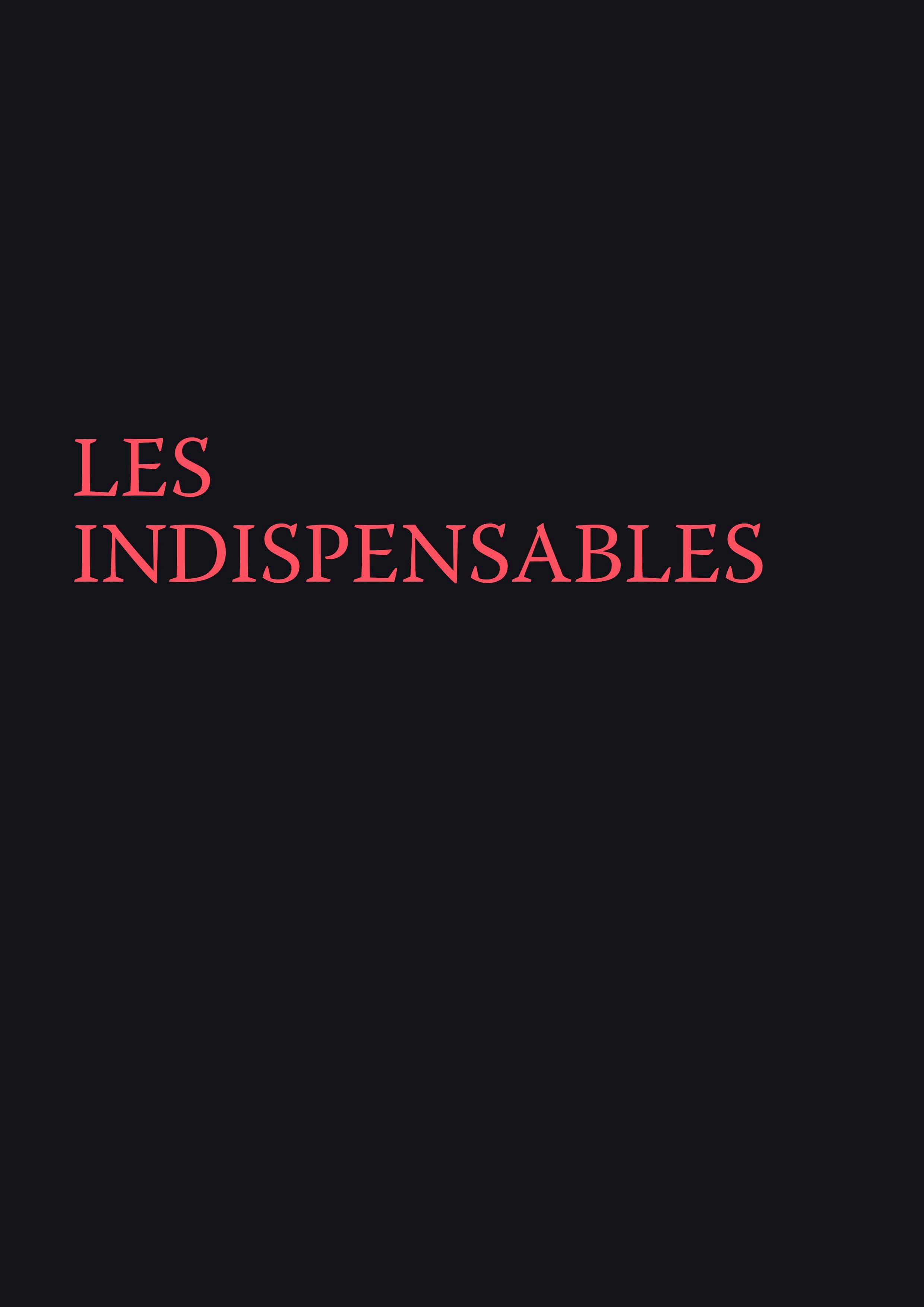
Alain Amariglio

Genre : essai
Préface de Gilles Clément
Avec 22 dessins de Alain
Cardenas-Castro
Format : 12 x 18,5 cm
Pages : 240
Prix : 18 €
ISBN : 978-2-490251-75-9


Né à Nancy, vivant à Paris et collectionnant les identités, Alain Amariglio a été ingénieur, entrepreneur dans les nouvelles technologies, enseignant, auteur et continue de penser que le métier d ’instituteur est le plus beau du monde. Il est d’autant plus sévère pour les liquidateurs de l’école, grands prédateurs ou petits chefs, et pour l’hypocrisie en général. Il s’intéresse à tout, de l’école à l’économie, de l’histoire aux sciences, le point commun entre ses livres, tous différents, se trouvant peut-être dans les enthousiasmes de l’enfance.
Les très beaux dessins de Alain Cardenas-Castro et la préface éclairée de Gilles Clément rendent ce livre beau, savoureux, intelligent.
Ce livre, ni cours, ni traité, est une promenade botanique engagée, un vade-mecum pour habitant de la Terre confronté à l’urgence écologique. Chaque chapitre est placé sous le parrainage d’une plante, célèbre ou inconnue, commune ou menacée, parfois disparue depuis longtemps, mais toujours notre parente dans le vivant. Le parcours est éclairé par les sciences, les mythes, l’histoire et parfois les fantômes de ceux qui nommèrent ces plantes et ne survivent qu’ainsi dans nos mémoires. Suivre ces fils ne nous fera pas quitter notre commun labyrinthe mais nous permettra de comprendre sa géométrie, d’appréhender sa beauté, de nous y repérer et de conserver le fol espoir d’éviter le Minotaure. Peut-être l’odeur de l’herbe fraîchement coupée, si profondément ancrée dans nos mémoires d’anciens enfants, déclenchera-t-elle un court-circuit, une émotion, un réveil salvateur. Dans le monde végétal, cette odeur est un signal de défense. Tout se tient.
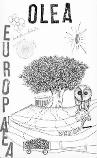
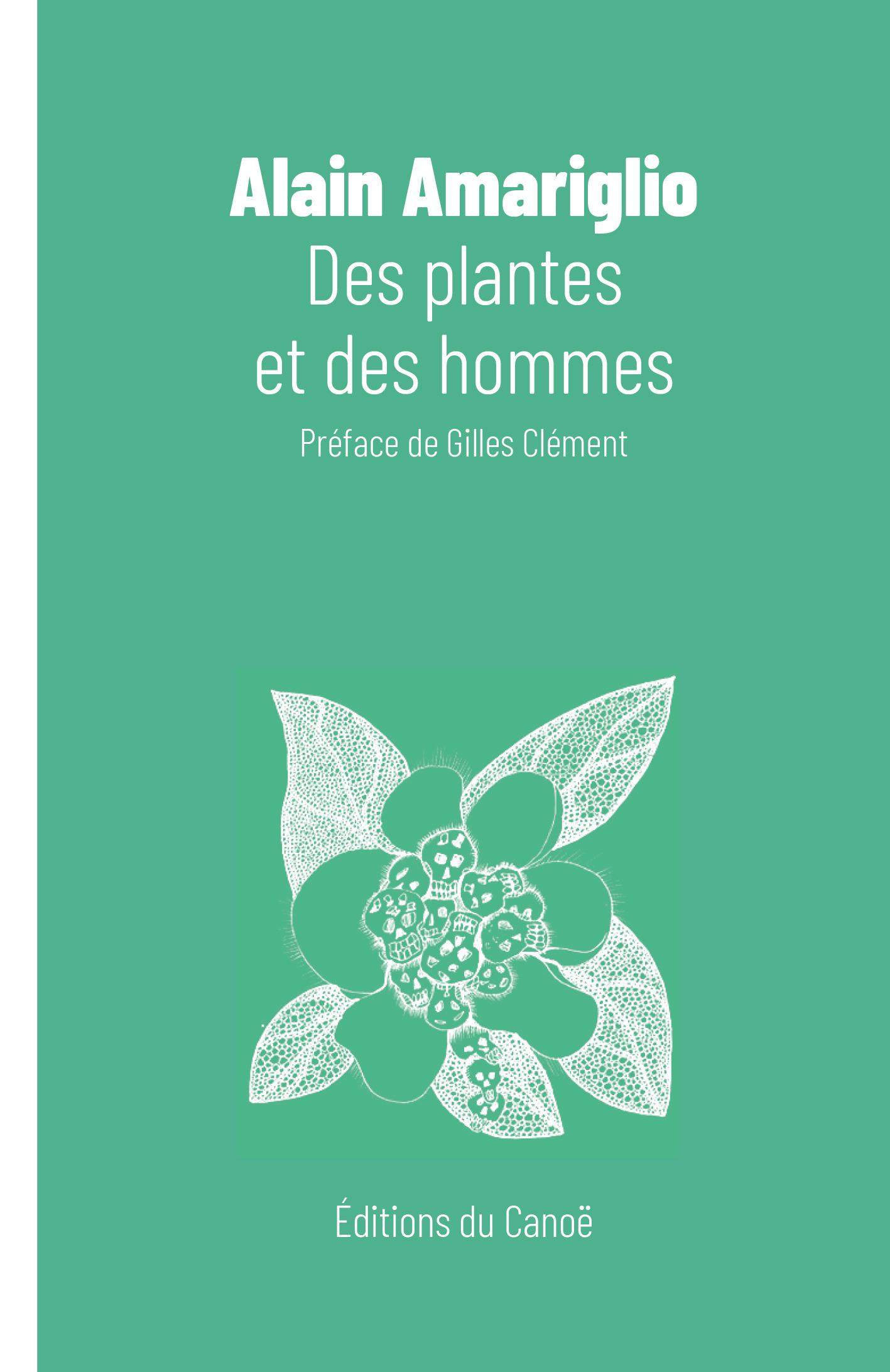
En quittant la nature, Sapiens quitte aussi sa nature, curieuse et coopérative. En plus des indispensables changements politiques, tout espoir de sauvetage réside donc dans une double réconciliation. Son avènement est incertain mais le déclic peut survenir n’importe où, dans un jardin, face à une friche, sur un trottoir. Ou dans un livre.

Mai
Contact et libraires : colette.lambrichs@gmail.com Téléphone : 06 60 40 19 16 Diffusion et distribution : Paon diffusion.Serendip Éditions du Canoë 2023
SILPHIUM
LA PREMIÈRE PLANTE ÉTEINTE PAR L’HOMME
Sur la piste de plantes insolites à qui le tiers paysage pourrait offrir son hospitalité, j’en ai trouvé une qui ressemble un peu au fenouil ou à l’anis. Je ne l’ai pas découverte dans le jardin, ni dans une friche, mais dans la bibliothèque, qui est son ultime écosystème. La plante a disparu. Son histoire ressemble à un conte oriental inutile, tombé dans l’oubli sans que jamais sa morale eût été utile à quiconque – ou à une nouvelle de Kafka.
Il était une fois une gracieuse ombellifère qui poussait dans les steppes arides du nord-est de l’actuelle Lybie, juste avant le désert. Cette plante annuelle revenait à chaque printemps. Les feuilles, discrètes, apparaissaient d’abord, puis une forte tige cannelée d’une trentaine de centimètres, enfin une ombelle dont les fleurs jaunes se transformaient en graines ailées que les vents finissaient par emporter, après quoi tige et feuilles se desséchaient, si elles n’avaient pas été entre-temps broutées par les moutons. Ils étaient toujours les premiers à remarquer la plante, dont ils raffolaient, et que leurs bêlements
3
*
signalaient à leurs bergers, ravis eux aussi. D’abord parce que, depuis la nuit des temps, ils utilisaient le végétal comme un remède guérissant à peu près tout. Ensuite parce qu’il donnait un goût exquis à la chair des moutons. Vers la fin du viie siècle avant Jésus-Christ, les Grecs débarquèrent sur ces côtes, conduits par un certain Aristotélès, incertain descendant de Poséidon. Il nomma la plante silphium, nom inspiré par celui qu’utilisaient les nomades, un mot barbare, donc. Ce terme de barbares était une onomatopée censée imiter les paroles de ceux qui ne parlaient pas grec et s’exprimaient dans des langages aussi incompréhensibles les uns que les autres1. Aristotélès fut plus intéressé par la plante que par les barbares : des barbares, on en trouvait partout, mais les Grecs n’avaient jamais vu de silphium. La plante médicinale ne poussait qu’à cet endroit précis, sur une steppe aride et caillouteuse d’environ troiscent-cinquante kilomètres sur cinquante, et nulle part ailleurs dans l’écoumène2. Les dieux avaient été économes de ce cadeau thérapeutique.
« Monopole » n’est pas un terme barbare. Il est formé des mots grecs mono, seul, et polein, vendre. Vendre seul.
1 C’est une déformation de ce mot qui conduisit à « berbères », encore utilisé pour désigner les plus anciens habitants de l’Afrique du Nord et de la Lybie – lesquels préfèrent naturellement utiliser d’autres termes, comme celui d’Imazighen.
2 Du grec ancien « habité » : monde habité par les Grecs. Le sens de ce mot s’est ensuite élargi à l’ensemble des espaces terrestres habités par l’humanité – barbares inclus.
L’idée dut frapper Aristotélès comme une évidence, à mesure qu’il découvrait les vertus de l’ombellifère que les bons bergers lui avaient offerte en hommage. Tige, feuilles, racine, tout était bon dans le silphium mais son composant le plus précieux était le suc, une résine rouge translucide qui pouvait être utilisée comme médicament, condiment de luxe ou huile essentielle. La racine, gros rhizome recouvert d’une écorce noire, regorgeait de ce suc, fortement aromatique, qui s’écoulait après incision puis se coagulait. On le stabilisait en lui ajoutant de la farine de blé pour obtenir de petites boules sèches, qui pouvaient ensuite être conservées puis, le moment venu, râpées ou dissoutes pour libérer le produit. Ayant observé tout cela, Aristotélès se souvint que l’un de ses ancêtres avait, jadis, conquis la Toison d’or. Il décida que les Libyens lui verseraient désormais un tribut annuel de silphium et fonda la ville de Cyrène, dont il devint roi sous le nom de Battos 1er. Pendant plusieurs siècles, l’expression « le silphium de Battos » serait synonyme de « tout l’or du monde ».
Seul problème : la plante ne se laissait pas cultiver et ne poussait qu’à l’état sauvage, dans l’aride périmètre qu’elle s’était choisi. C’était ennuyeux mais on verrait ça plus tard. Comme on dirait de nos jours, business first. Il semble d’ailleurs que Battos n’ait rien eu à envier aux managers contemporains. Il commença par trouver un nom commercial à ce nouveau produit : « Suc de Cyrénaïque », voilà qui sonnait bien. Vint ensuite
4 5
*
*
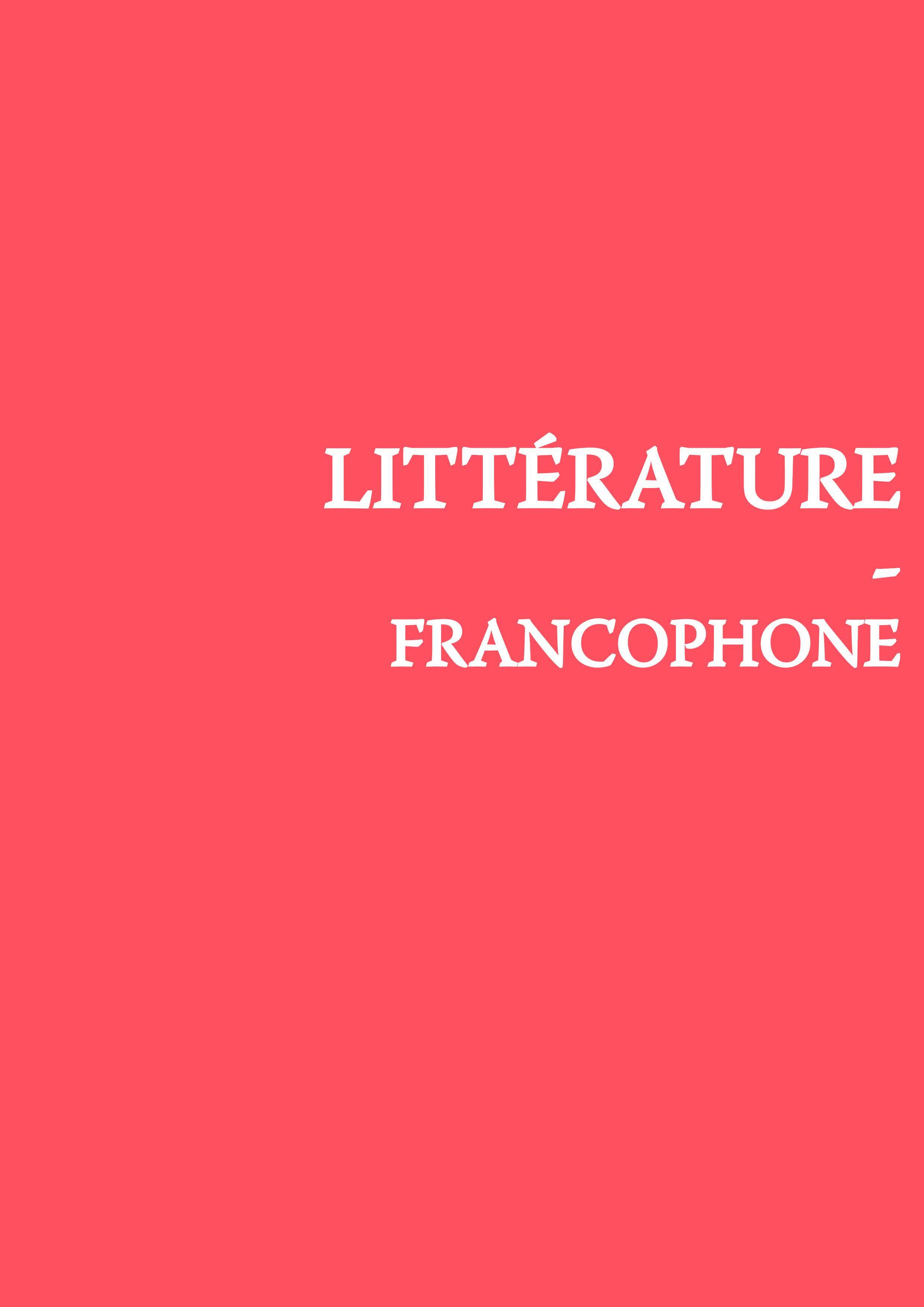


 Photo © Maria Noisternig
Photo © Maria Noisternig
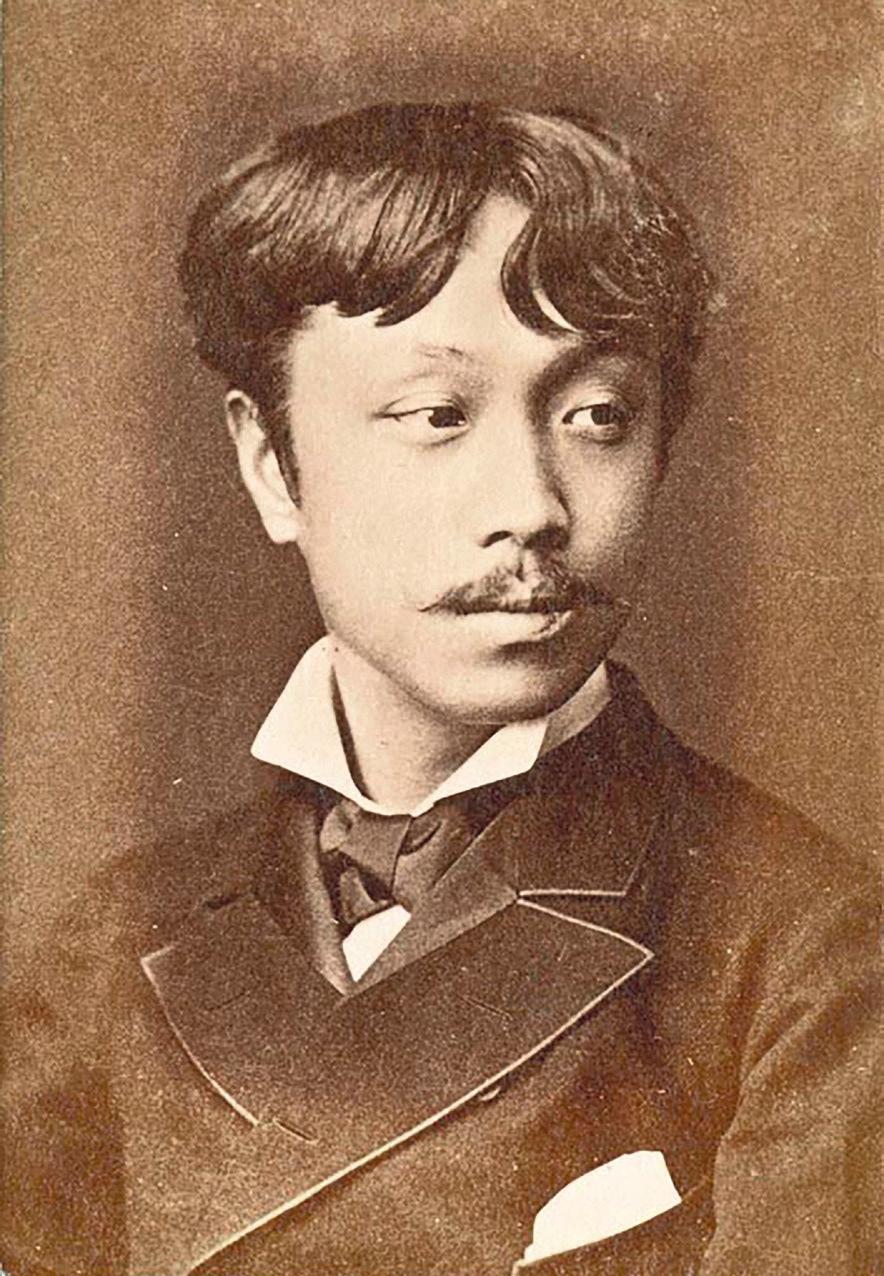

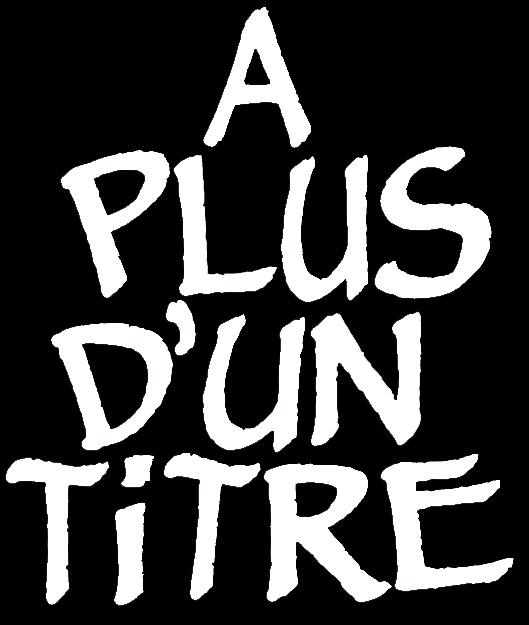

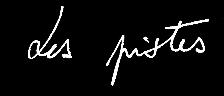

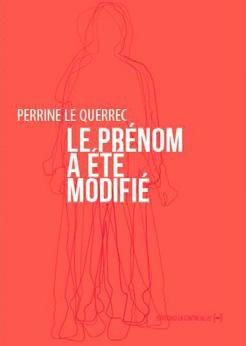

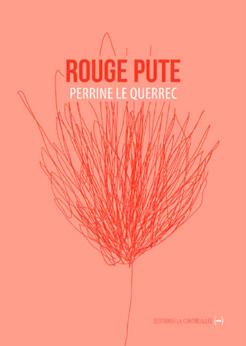
 ©
Xavier
Loira
©
Xavier
Loira



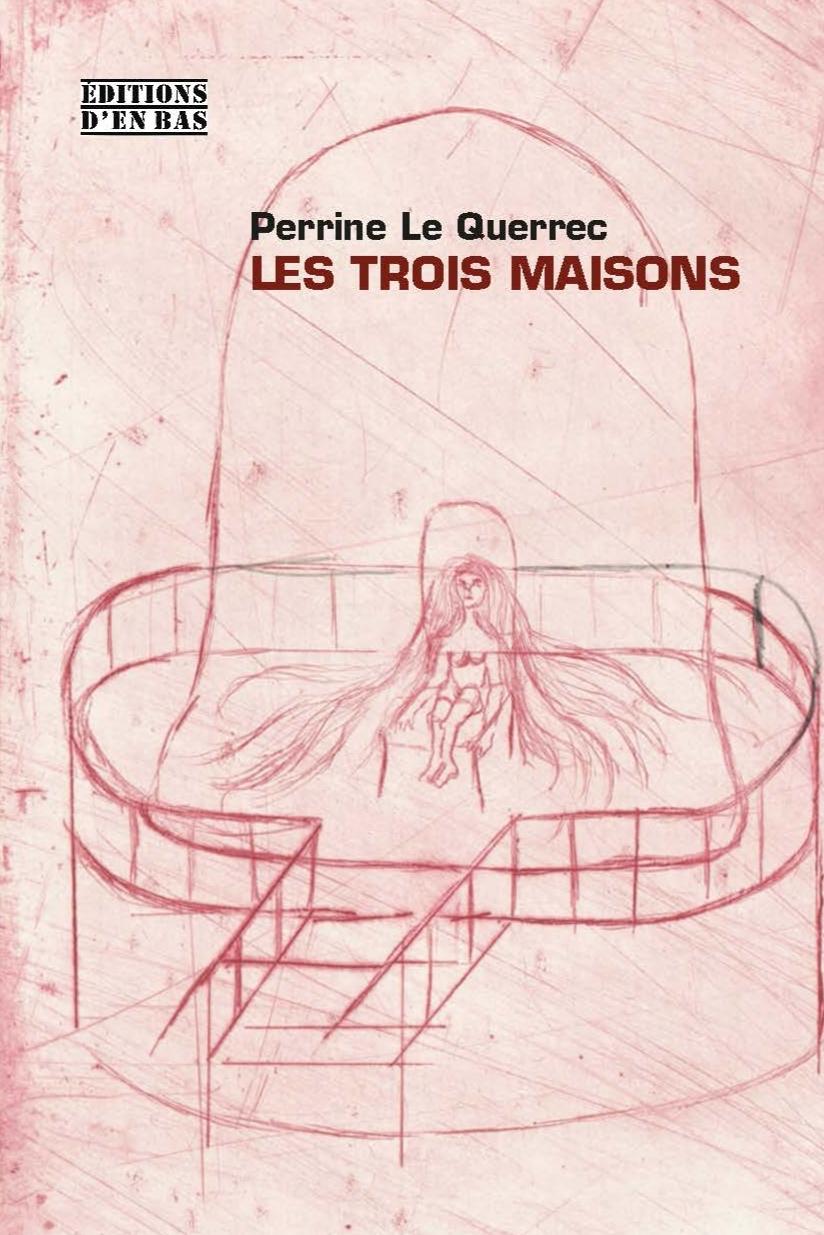
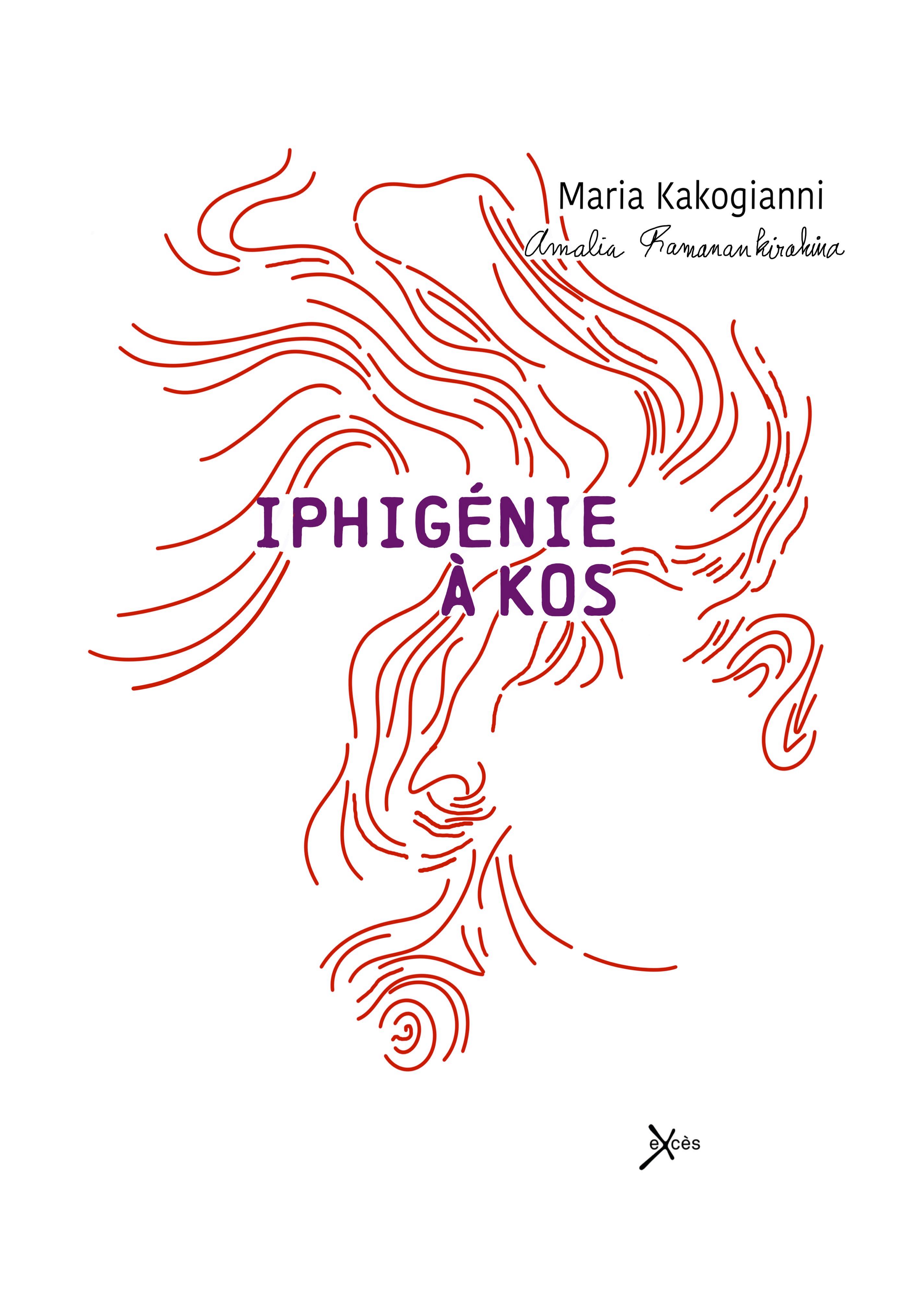



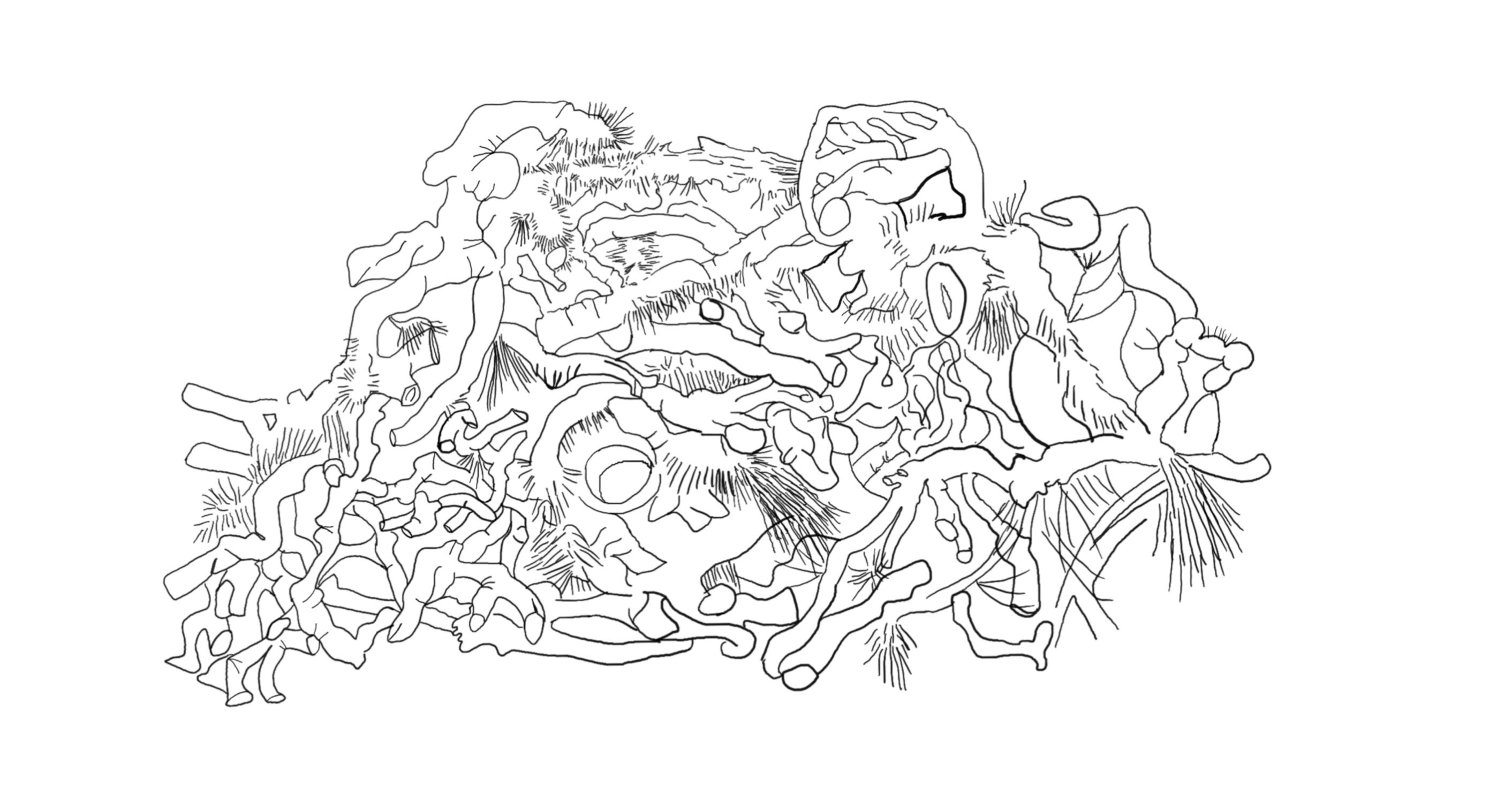
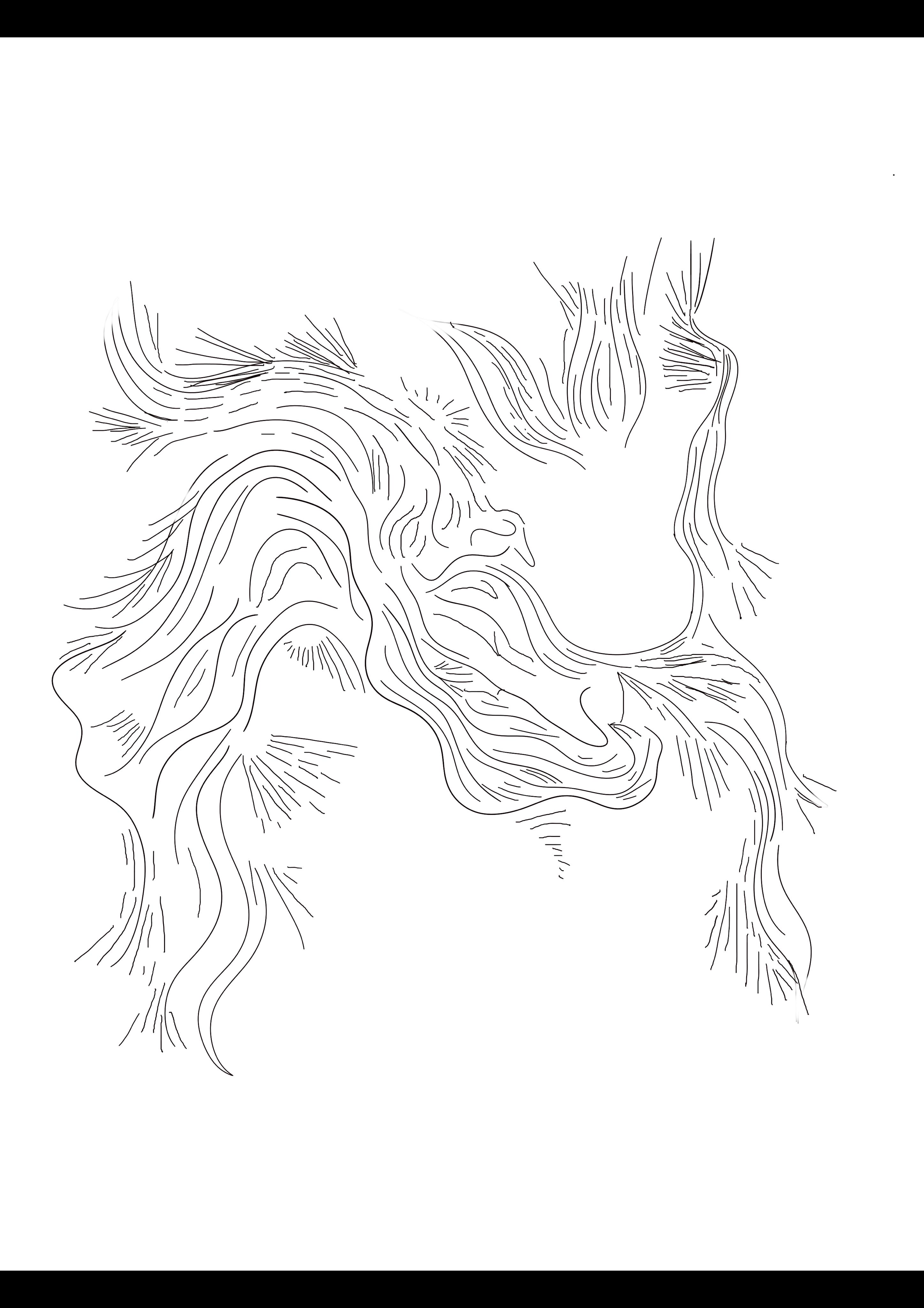




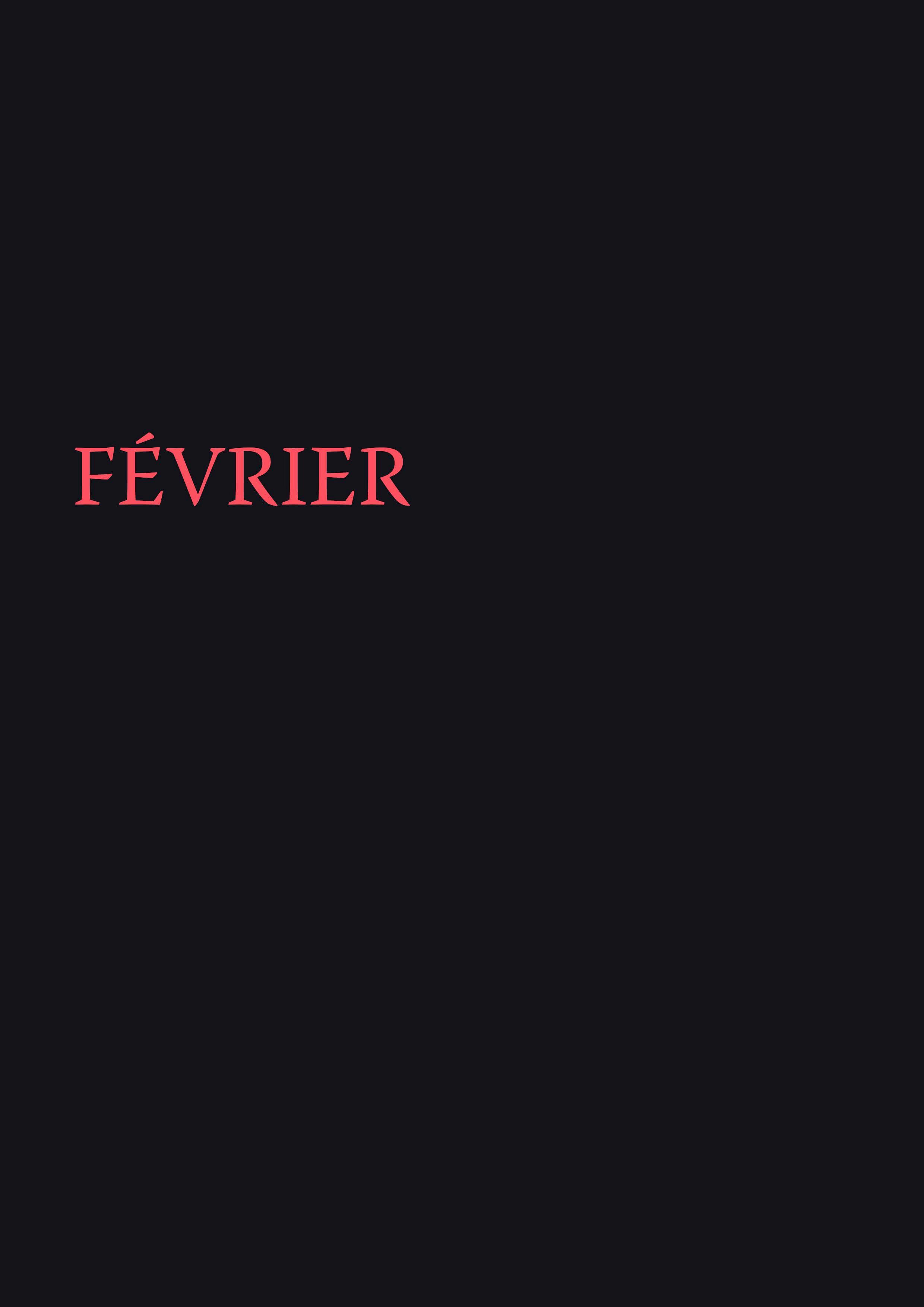
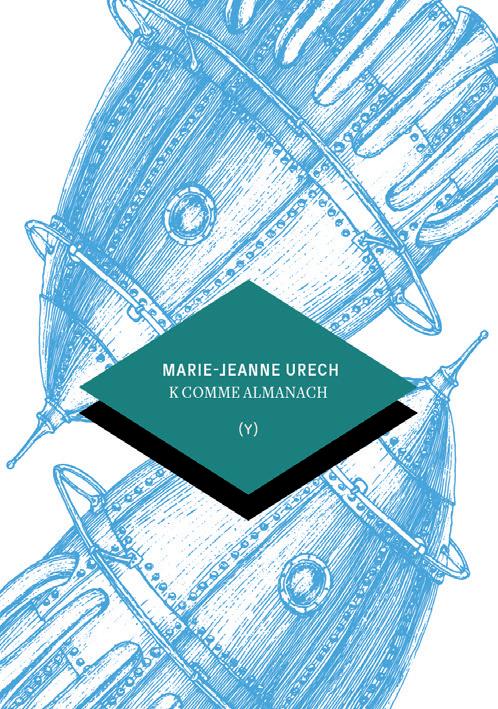
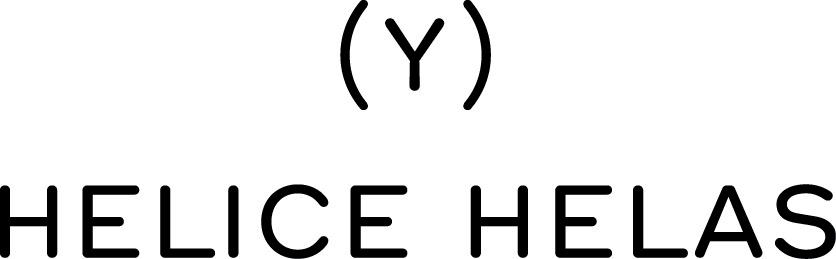


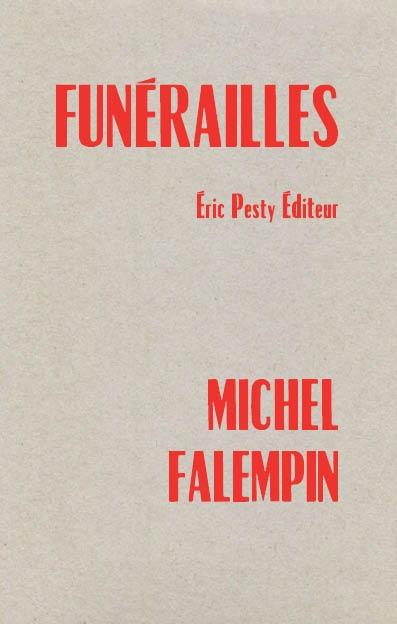

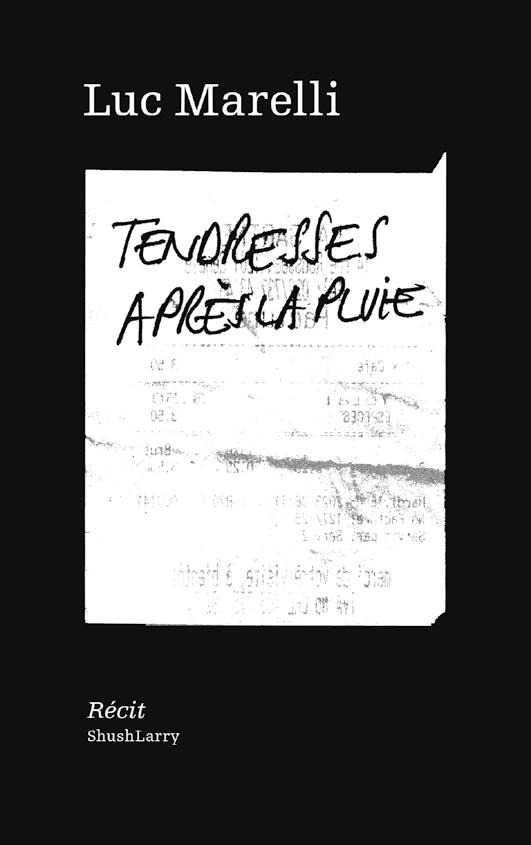
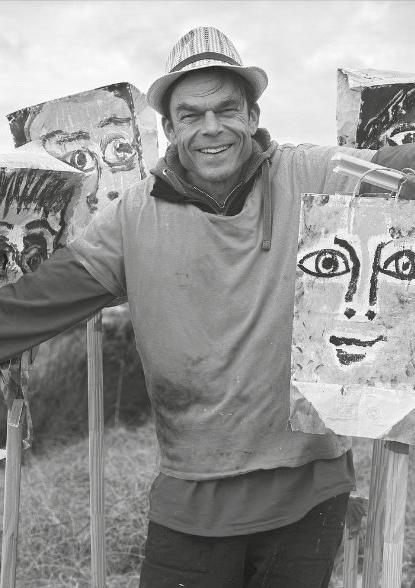






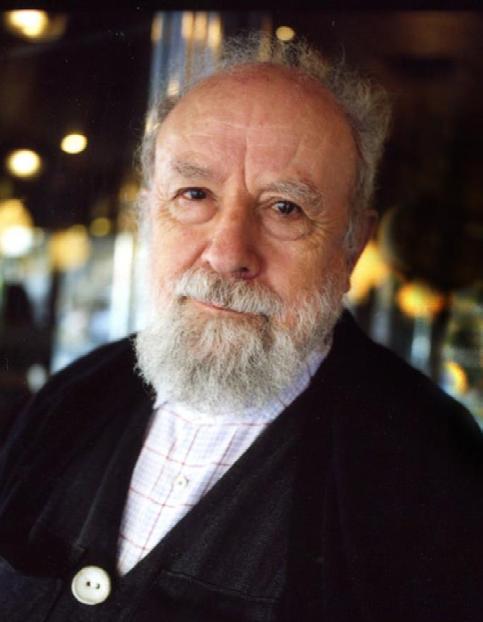
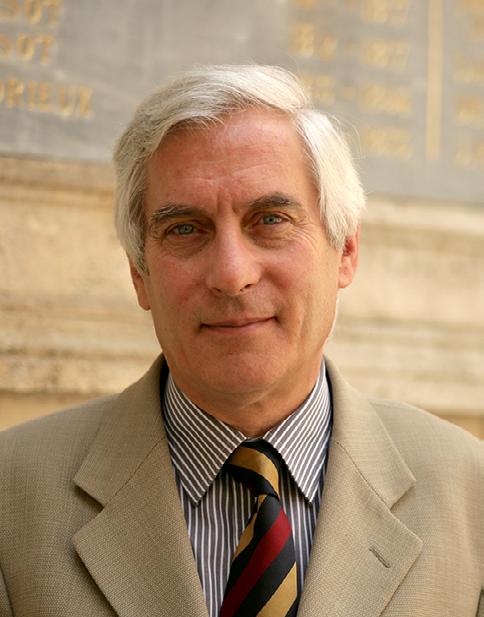
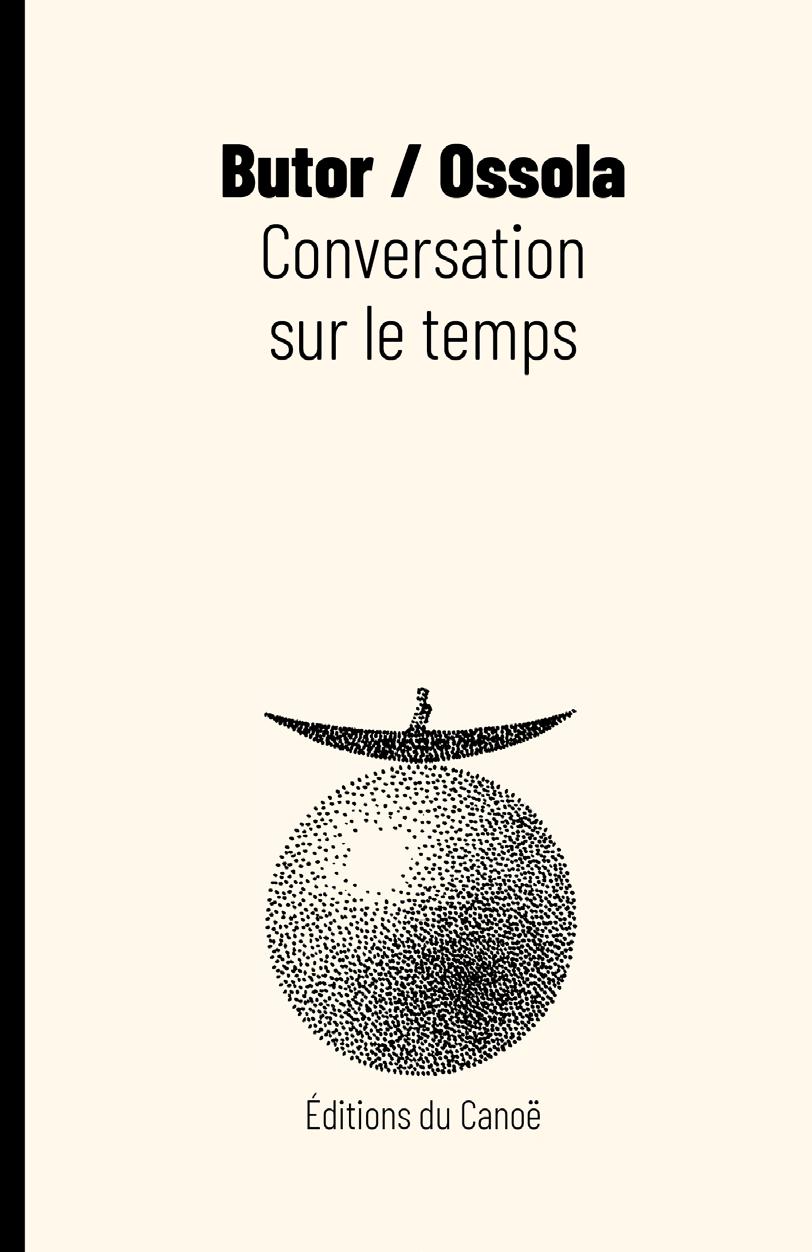

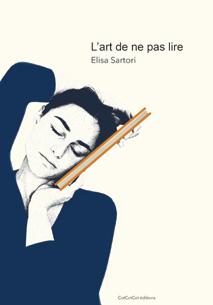

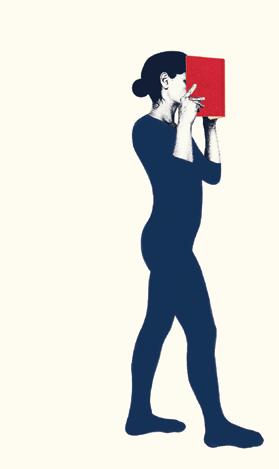
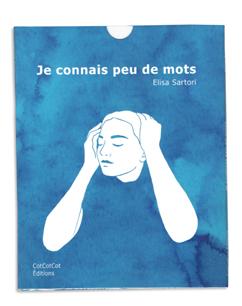

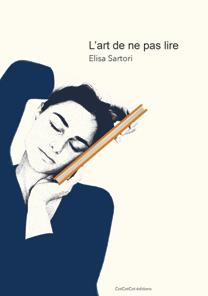
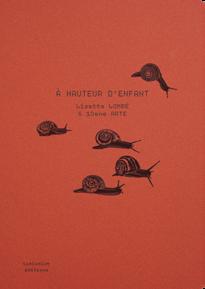
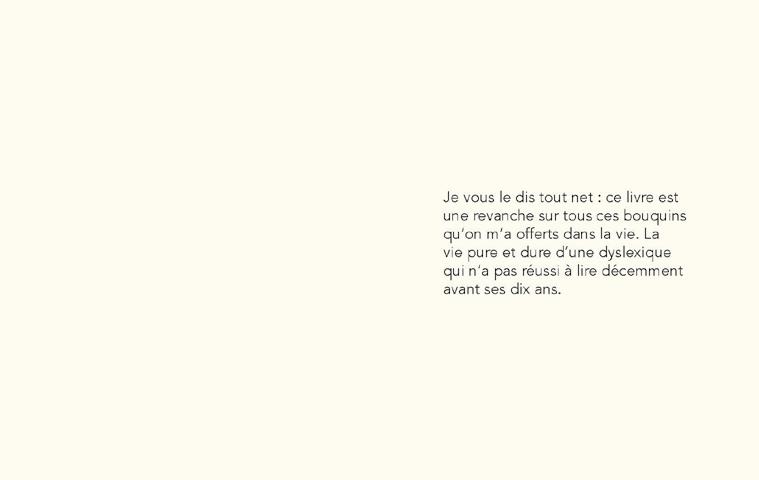




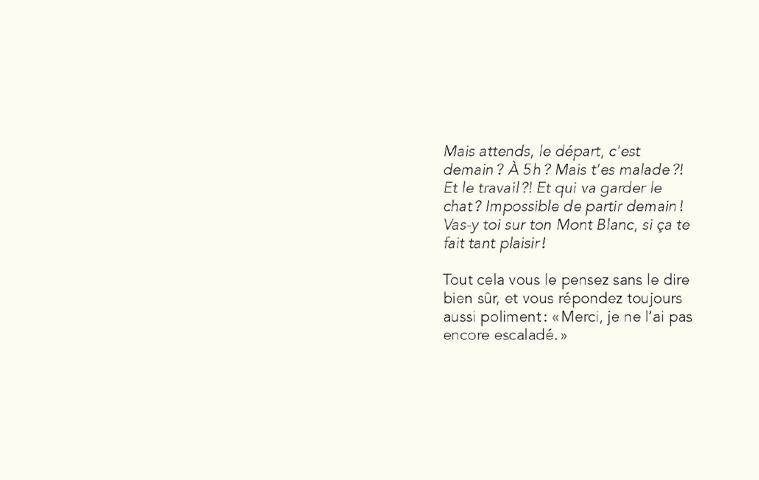
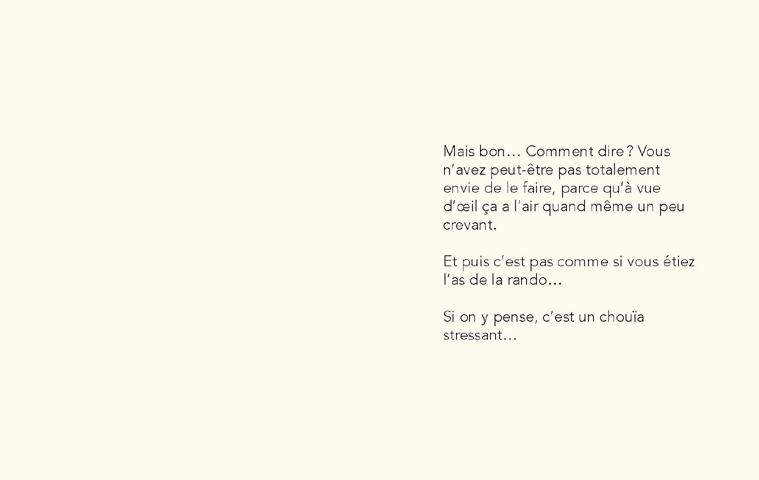

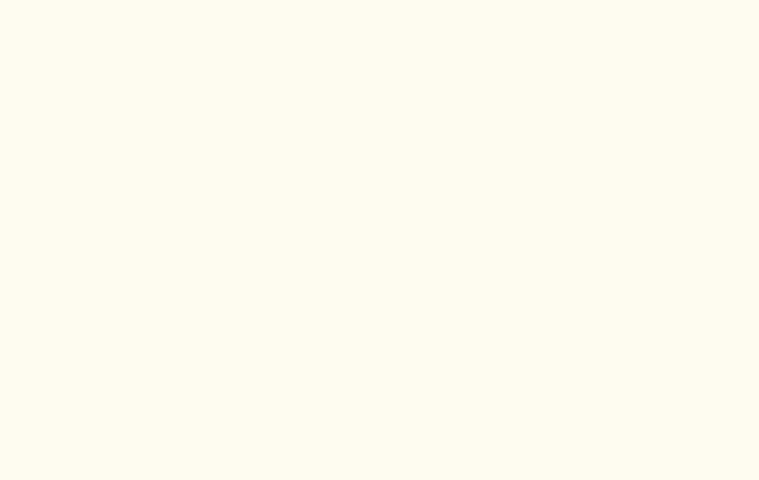
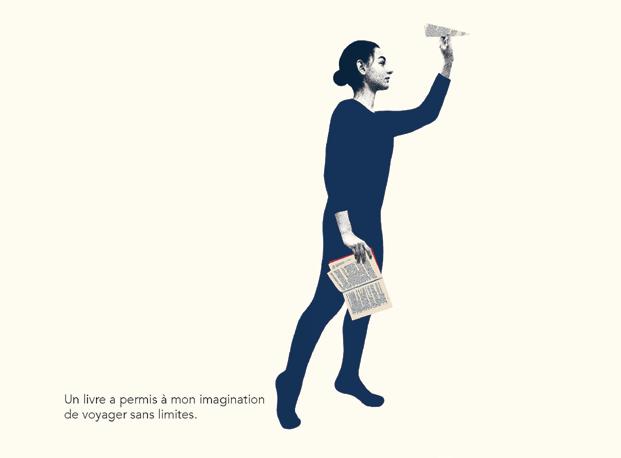

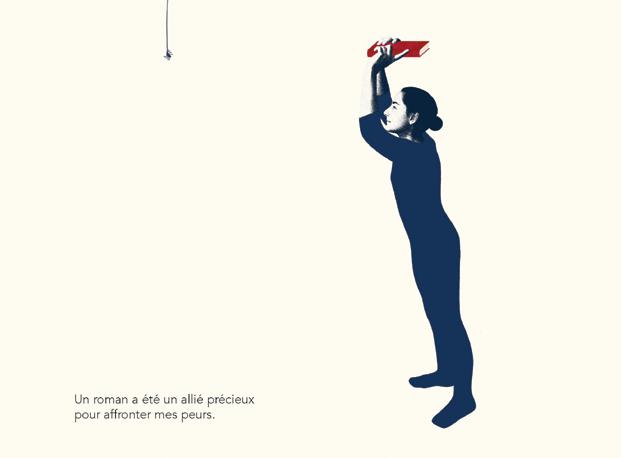
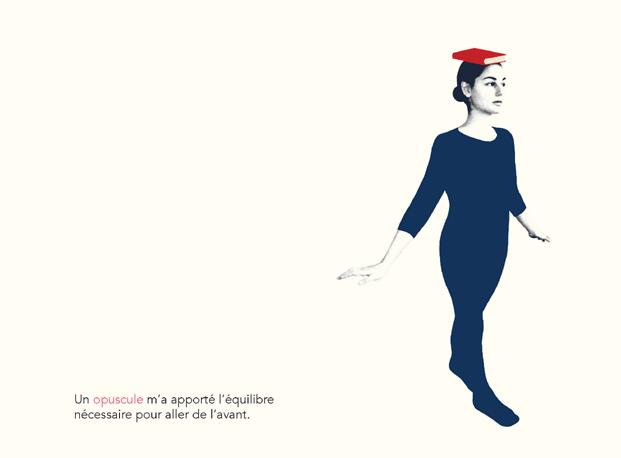
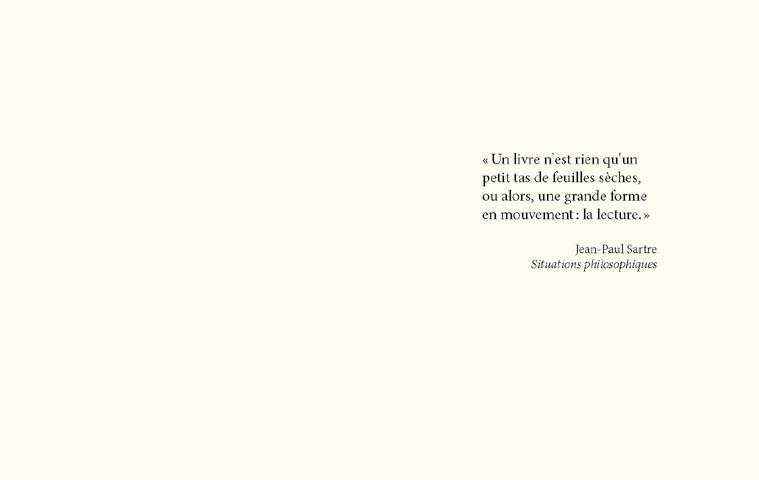
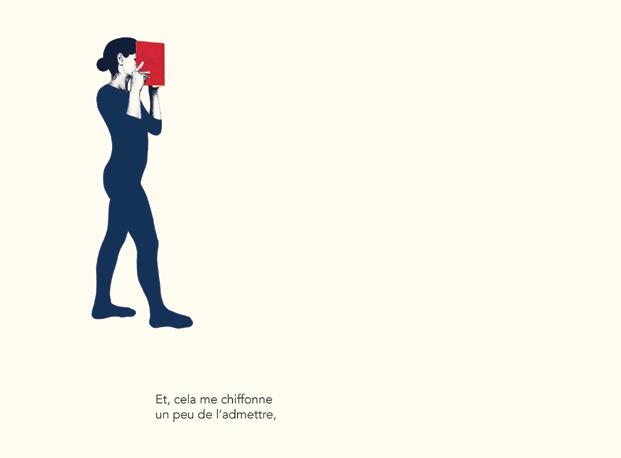
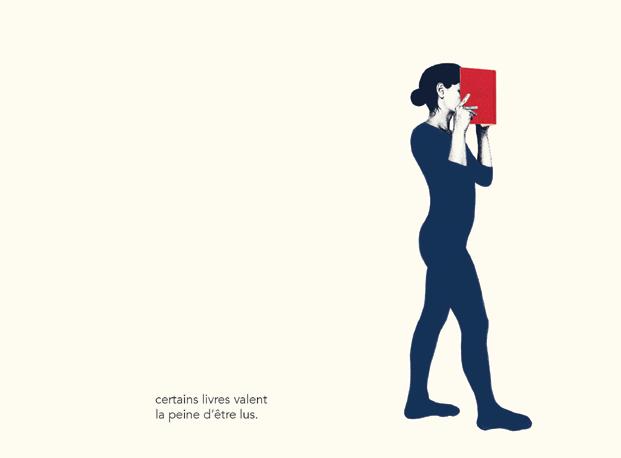



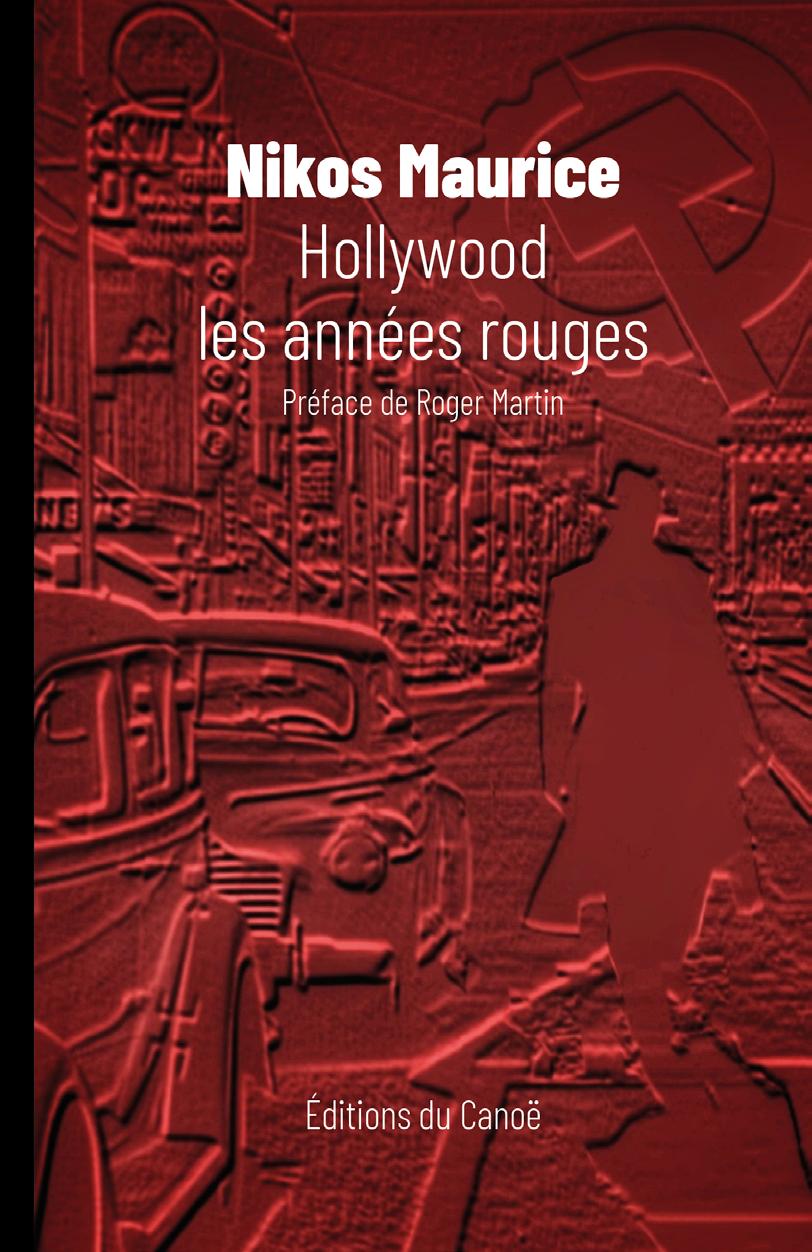
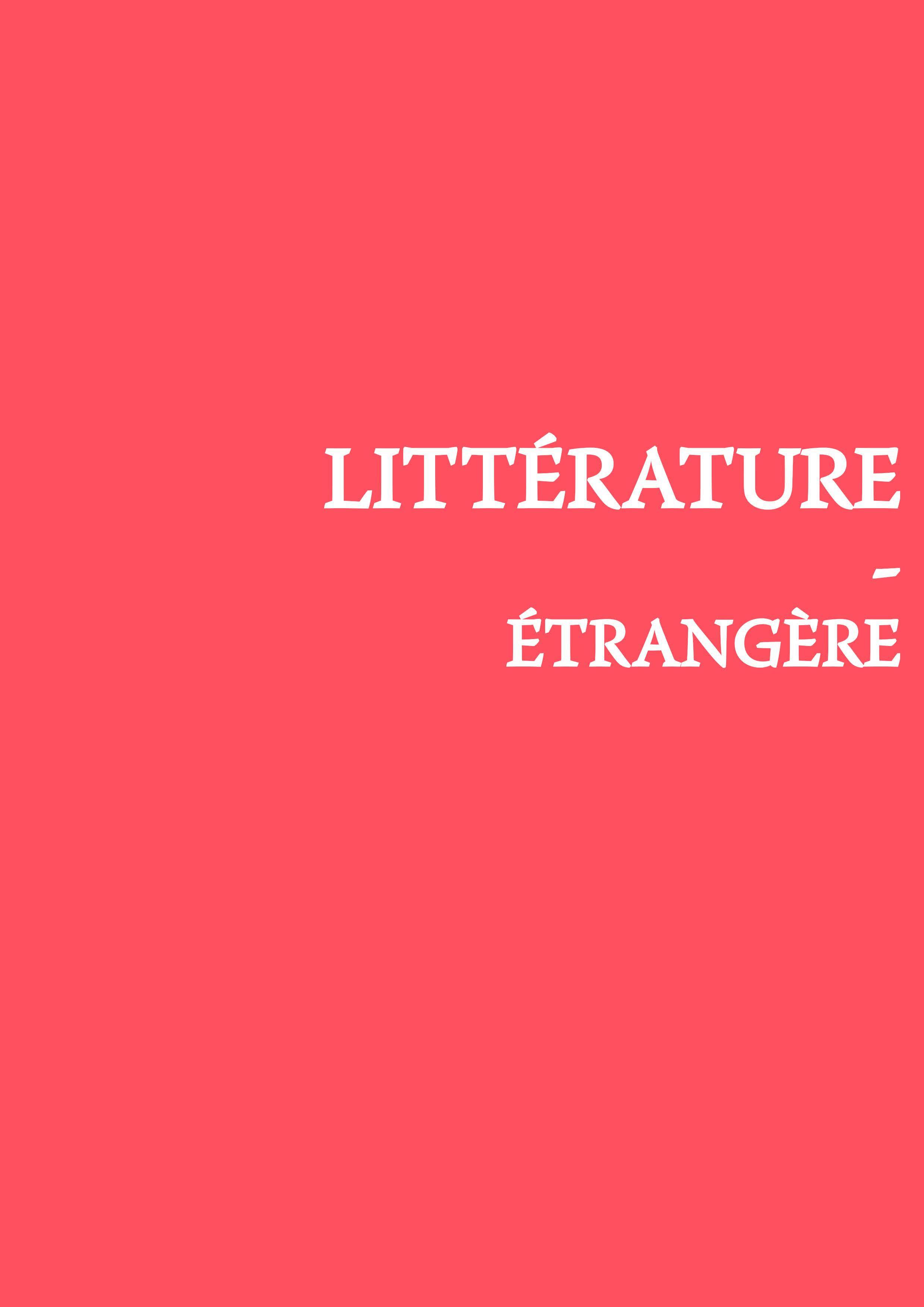

 Photo © Arch & Bruce Brown Foundation
Photo © Arch & Bruce Brown Foundation


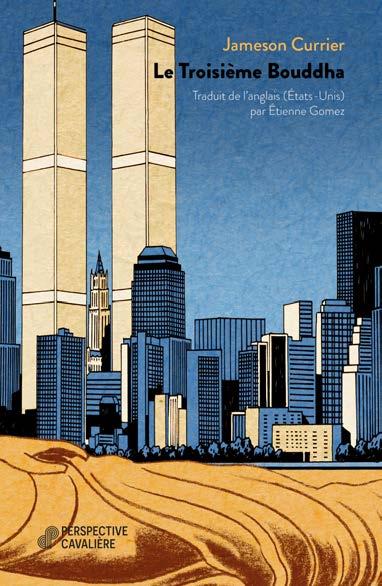

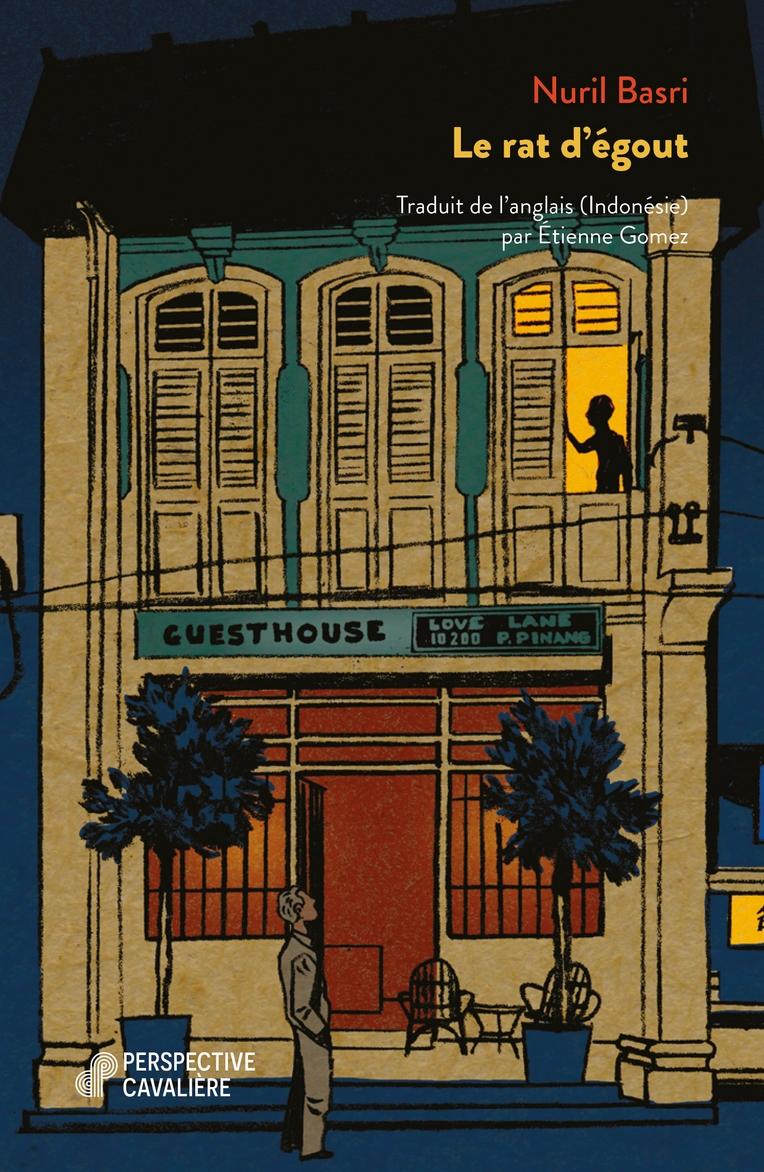
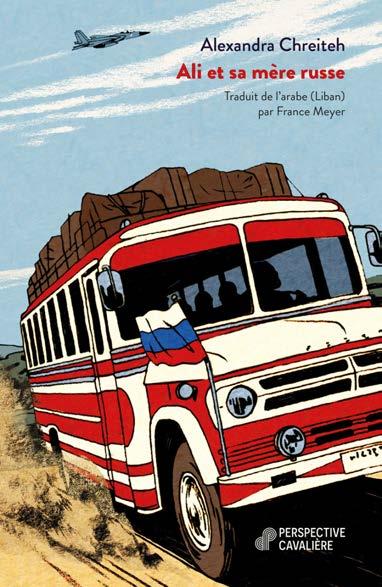
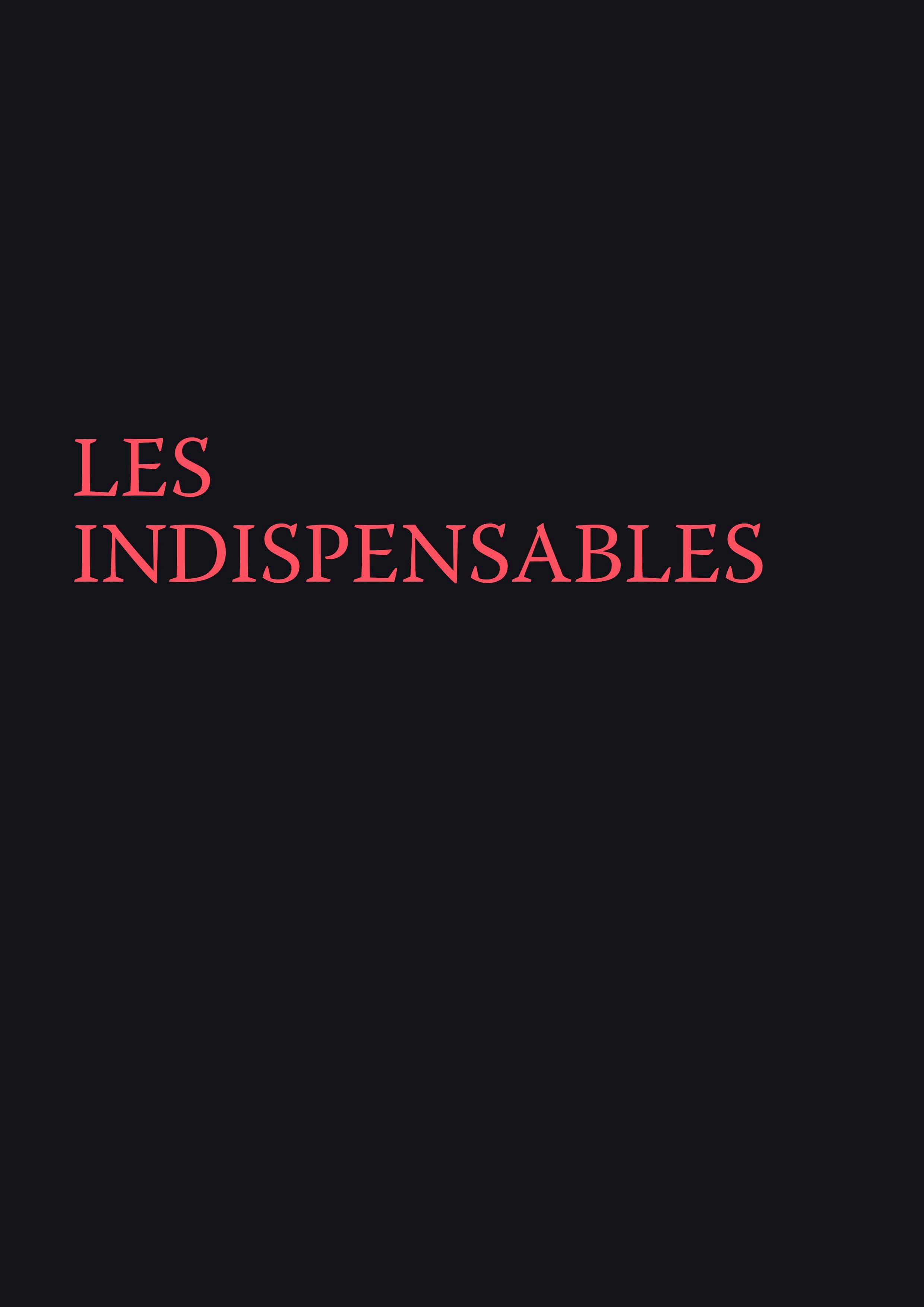
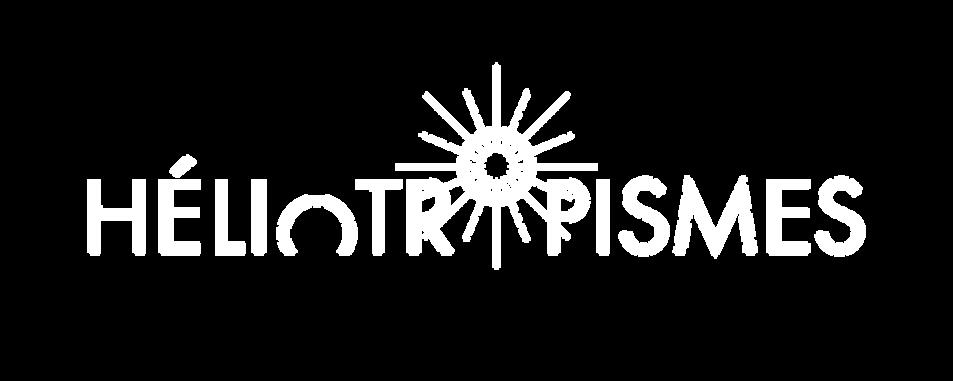
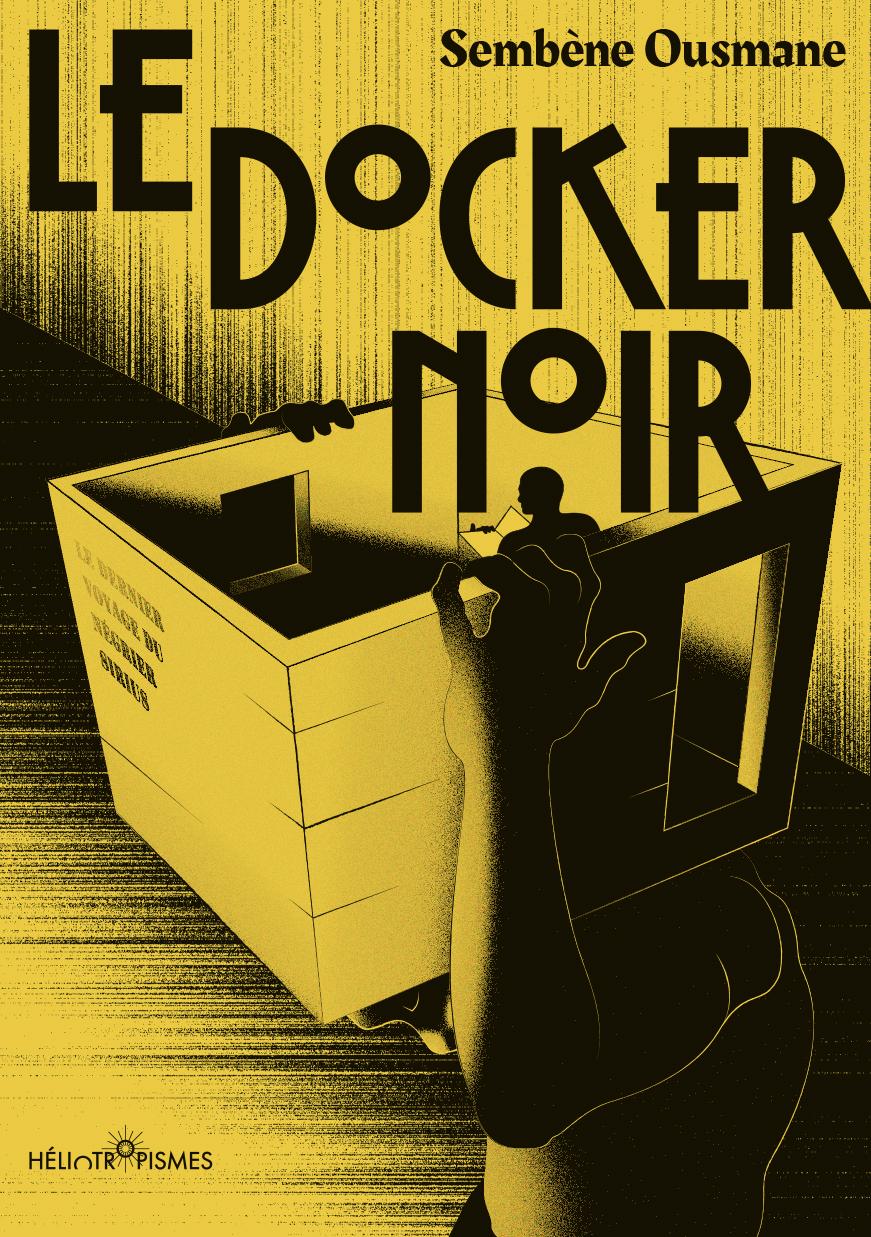

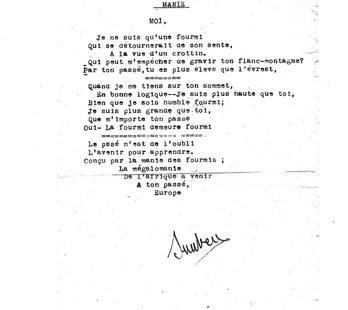


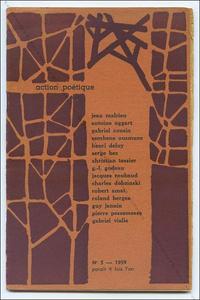
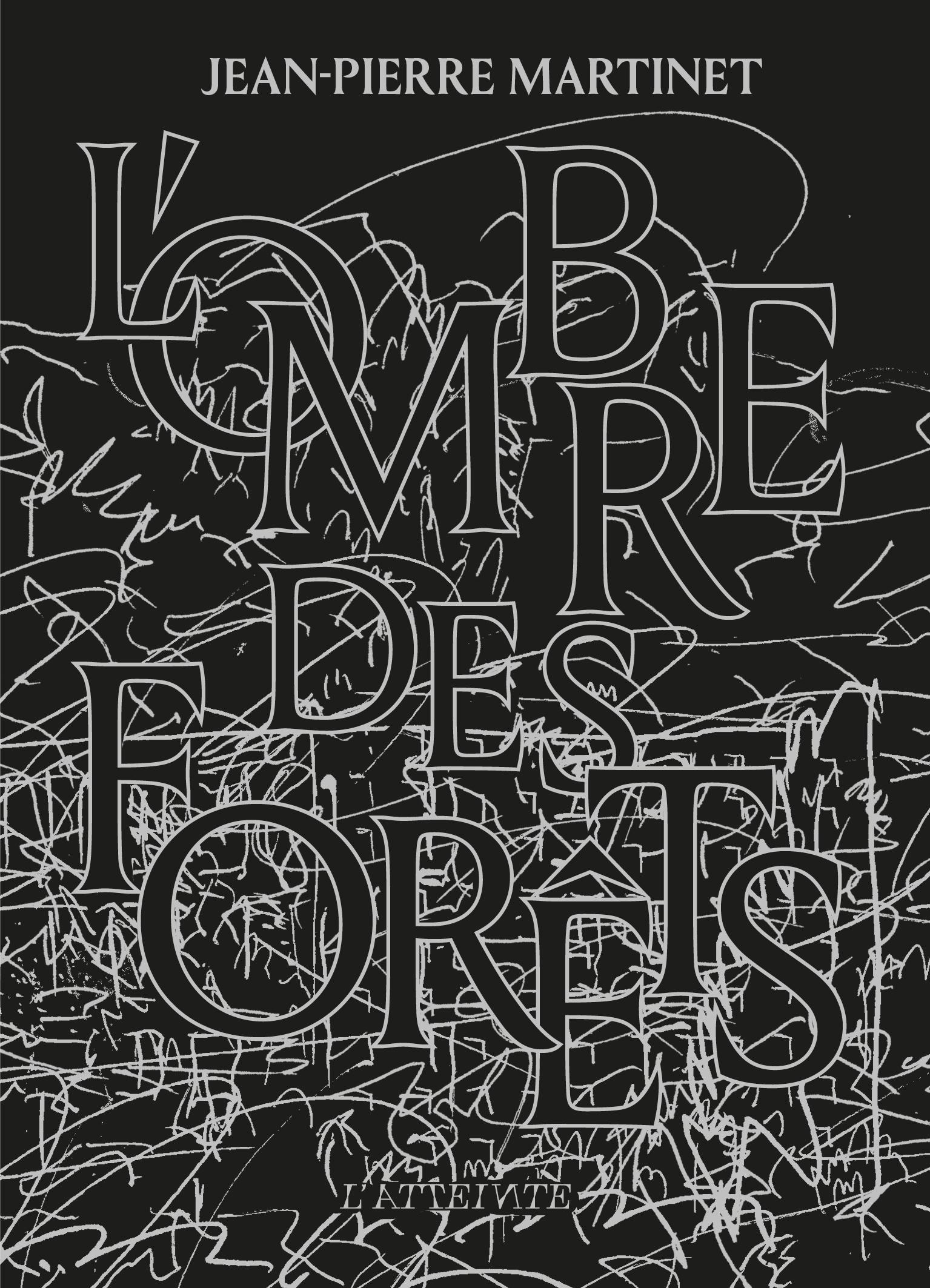 Jean-Pierre Martinet
Jean-Pierre Martinet
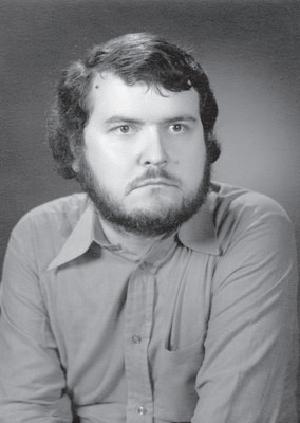
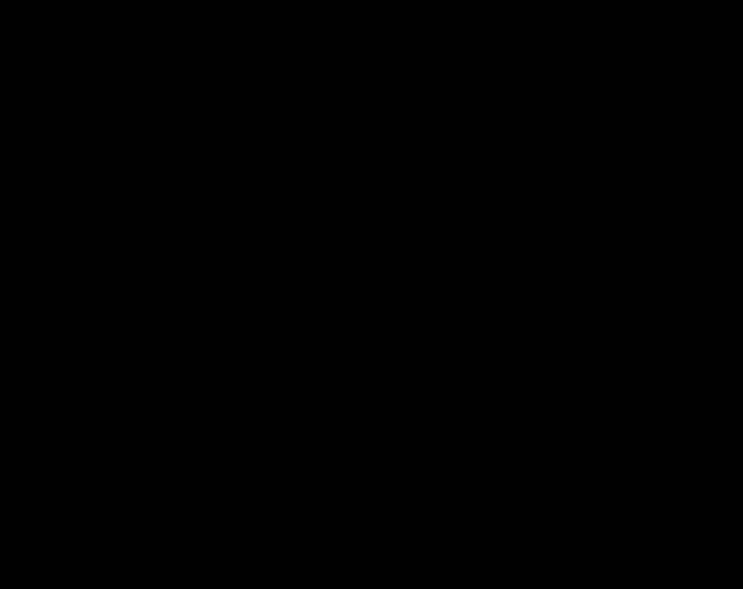
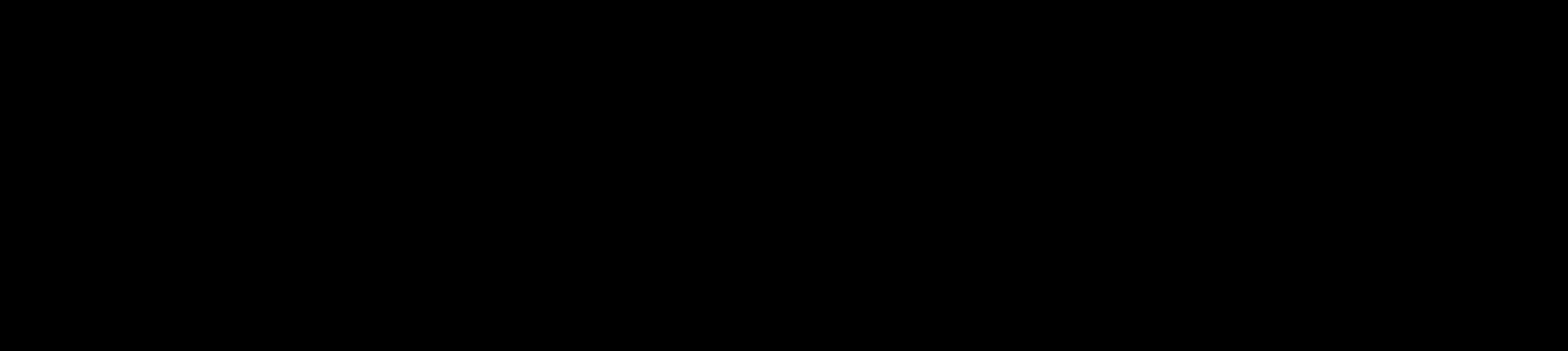
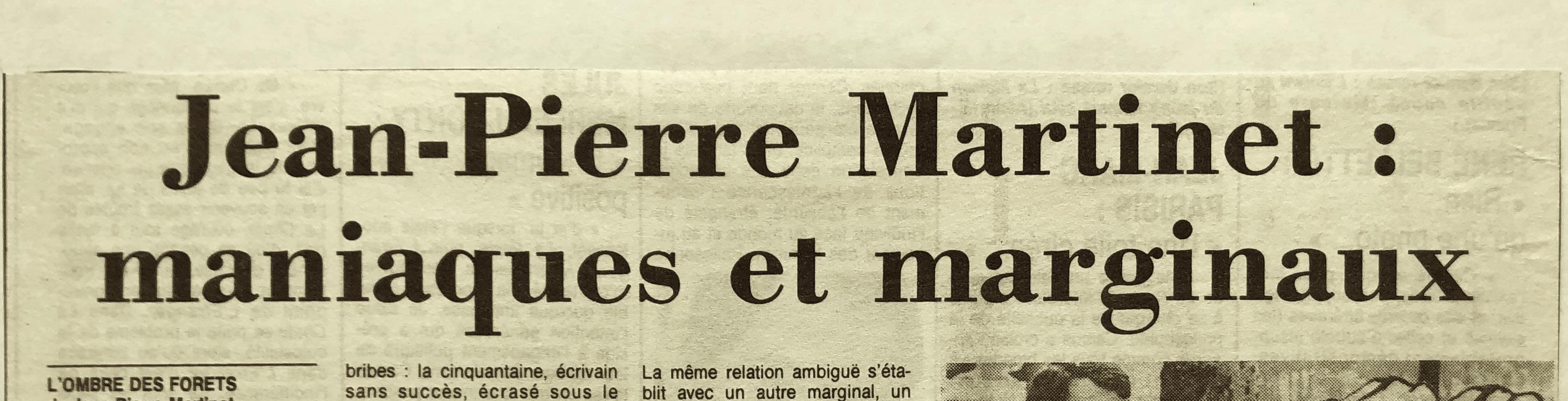
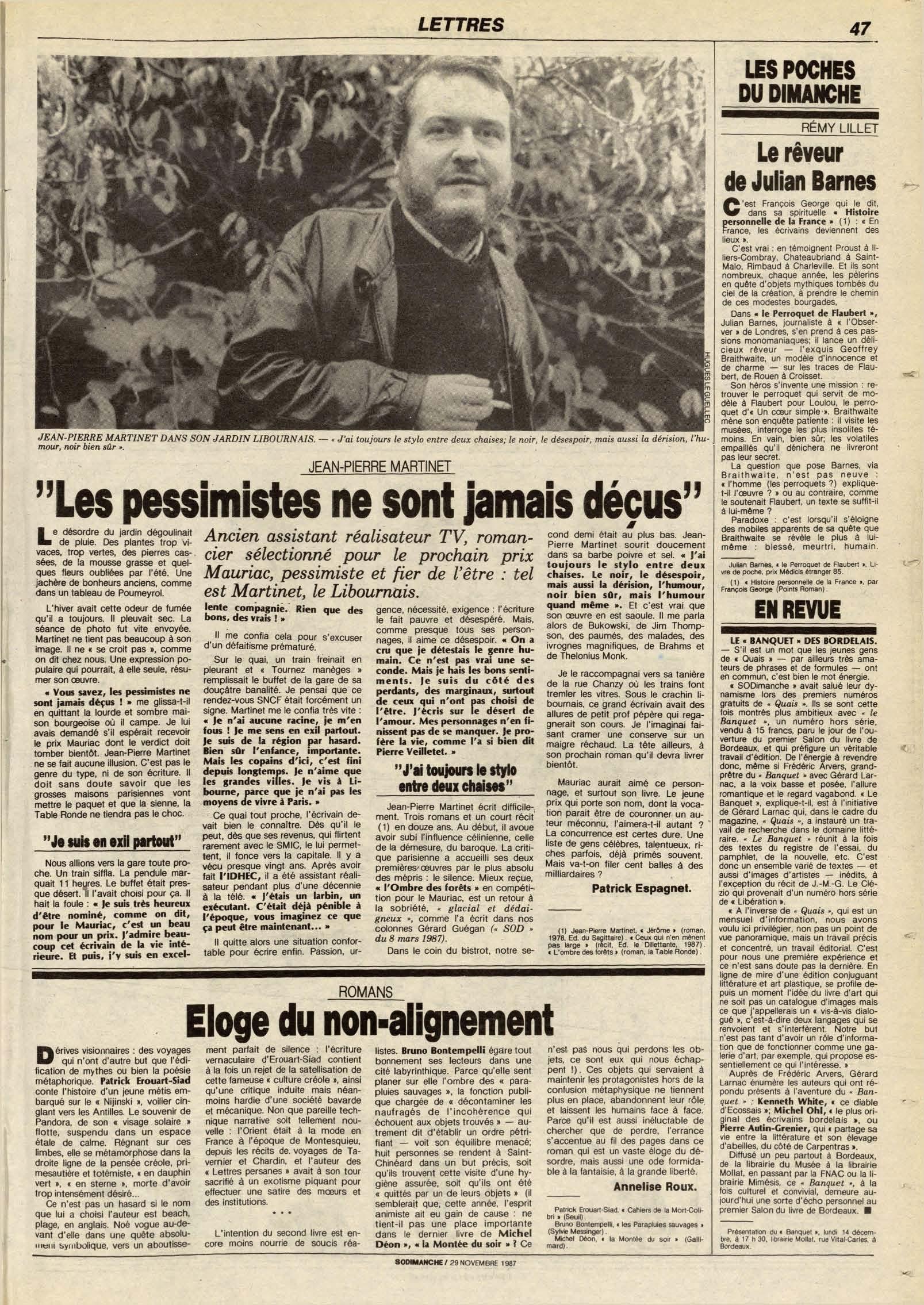
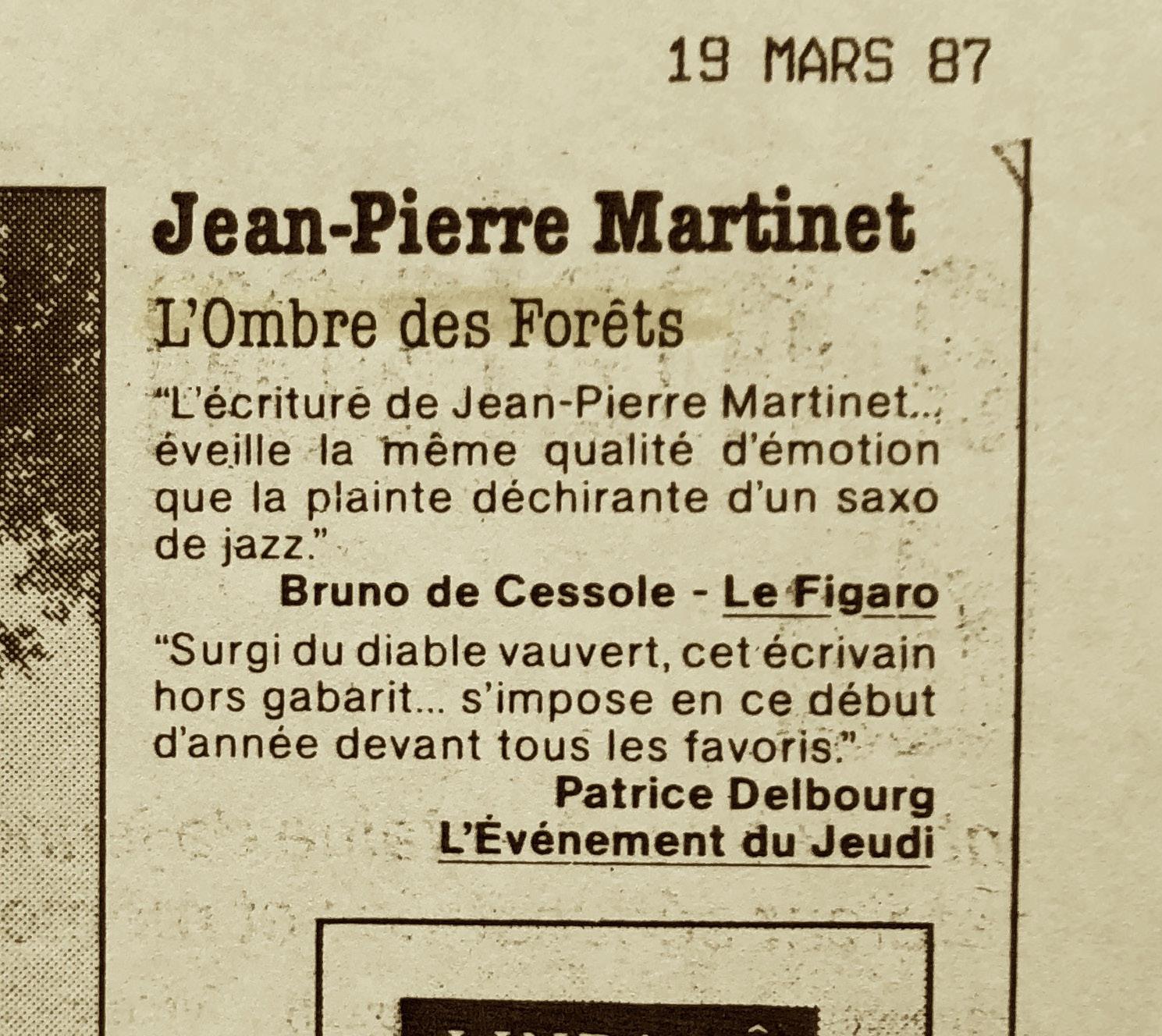
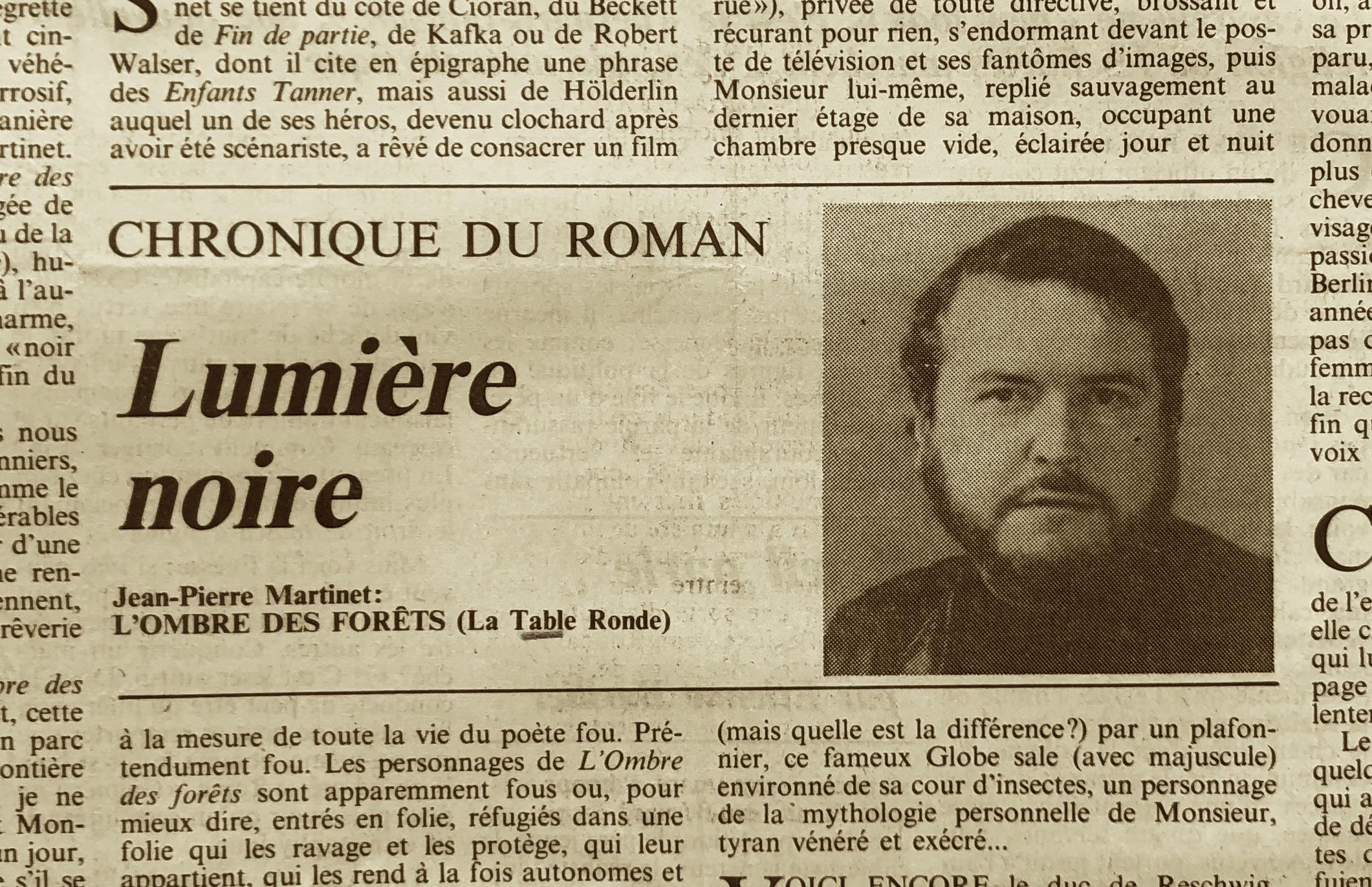
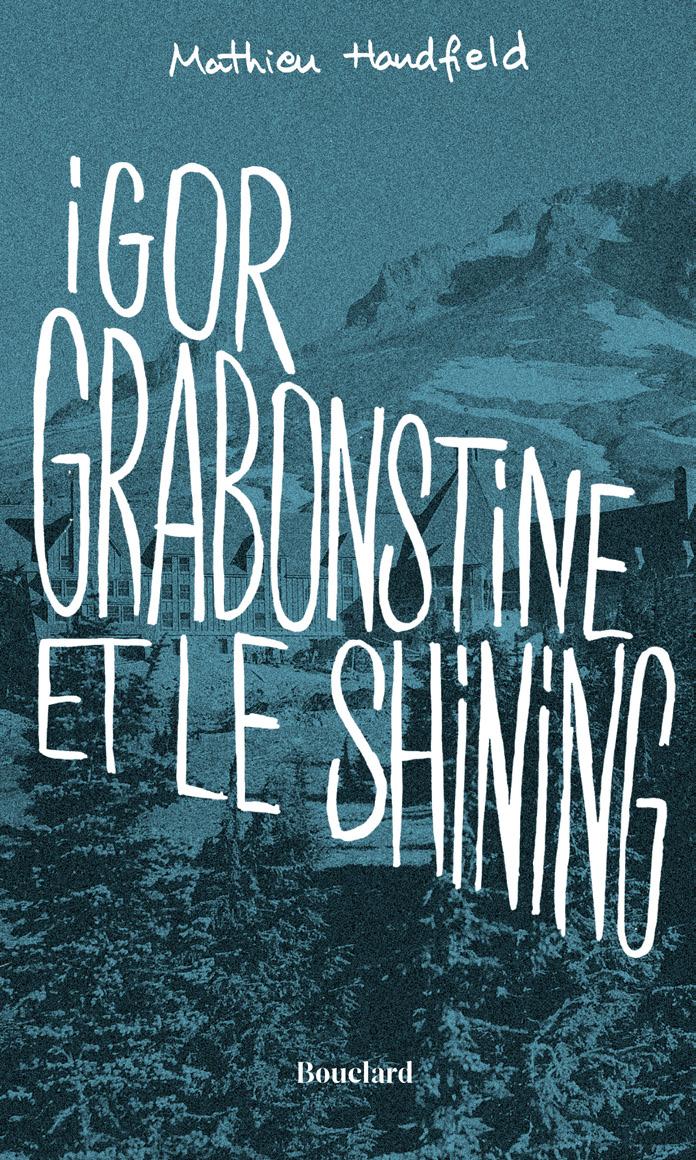











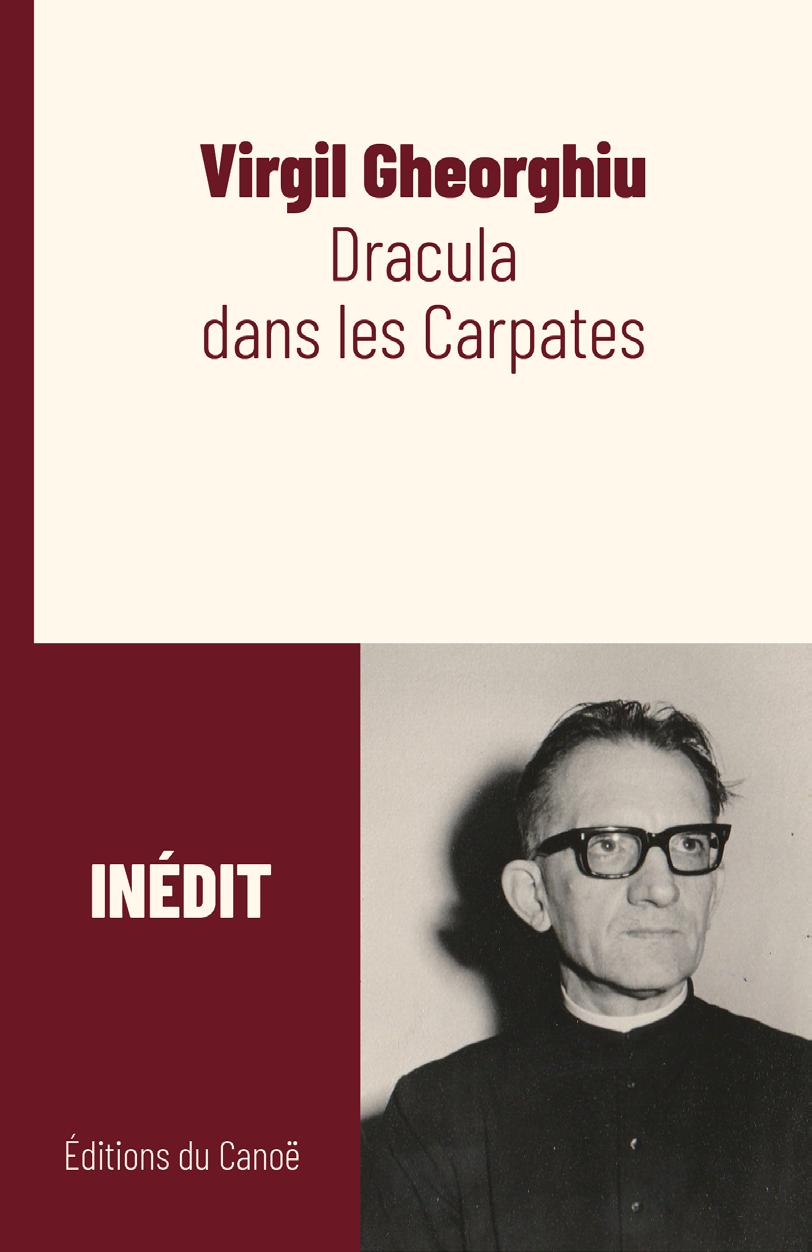
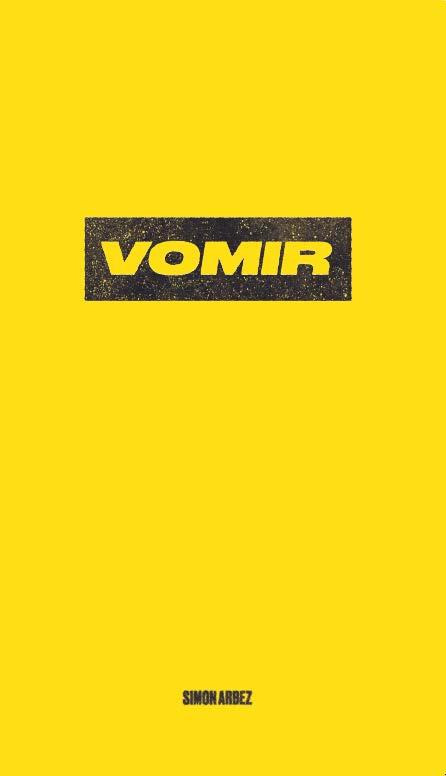
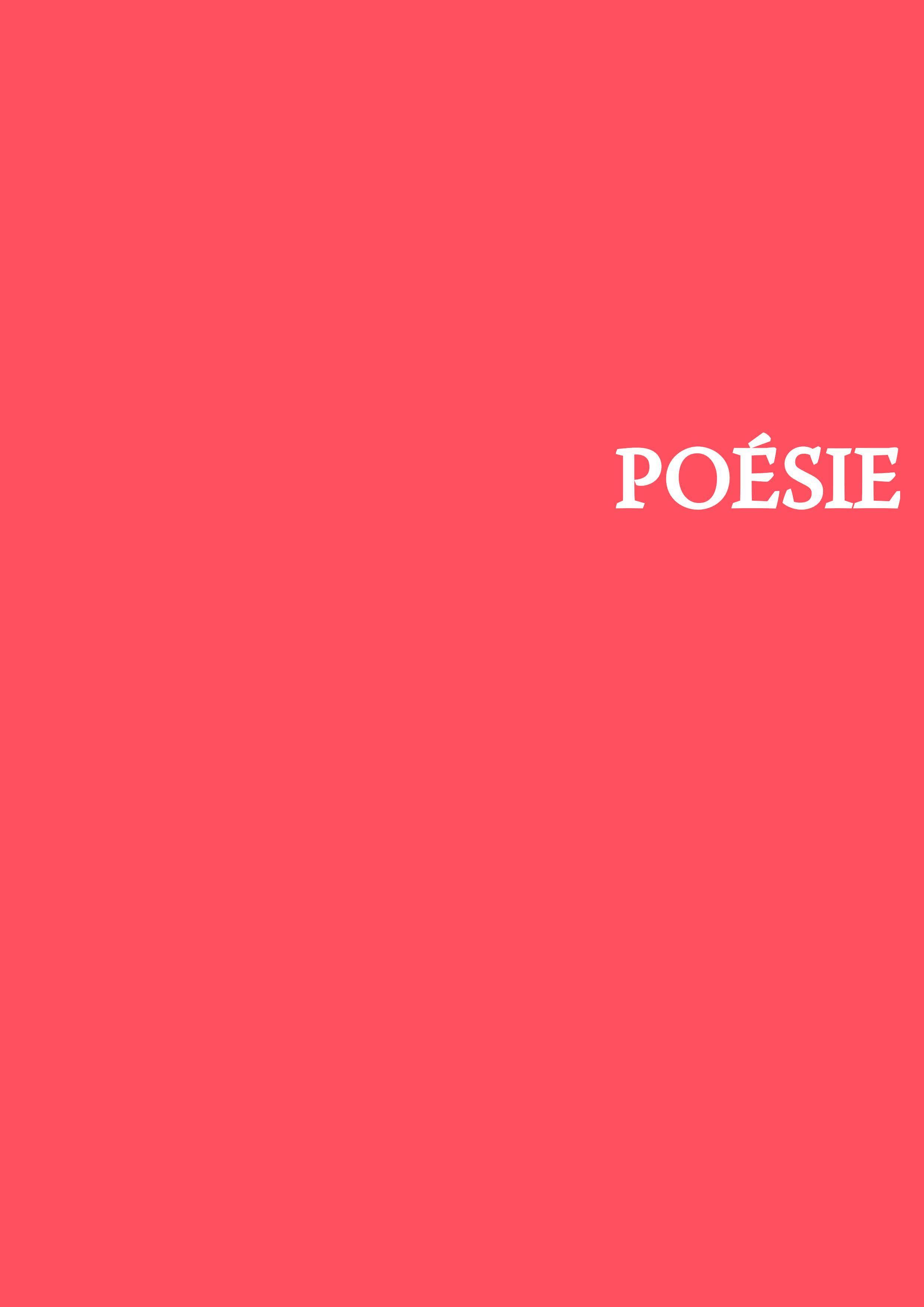
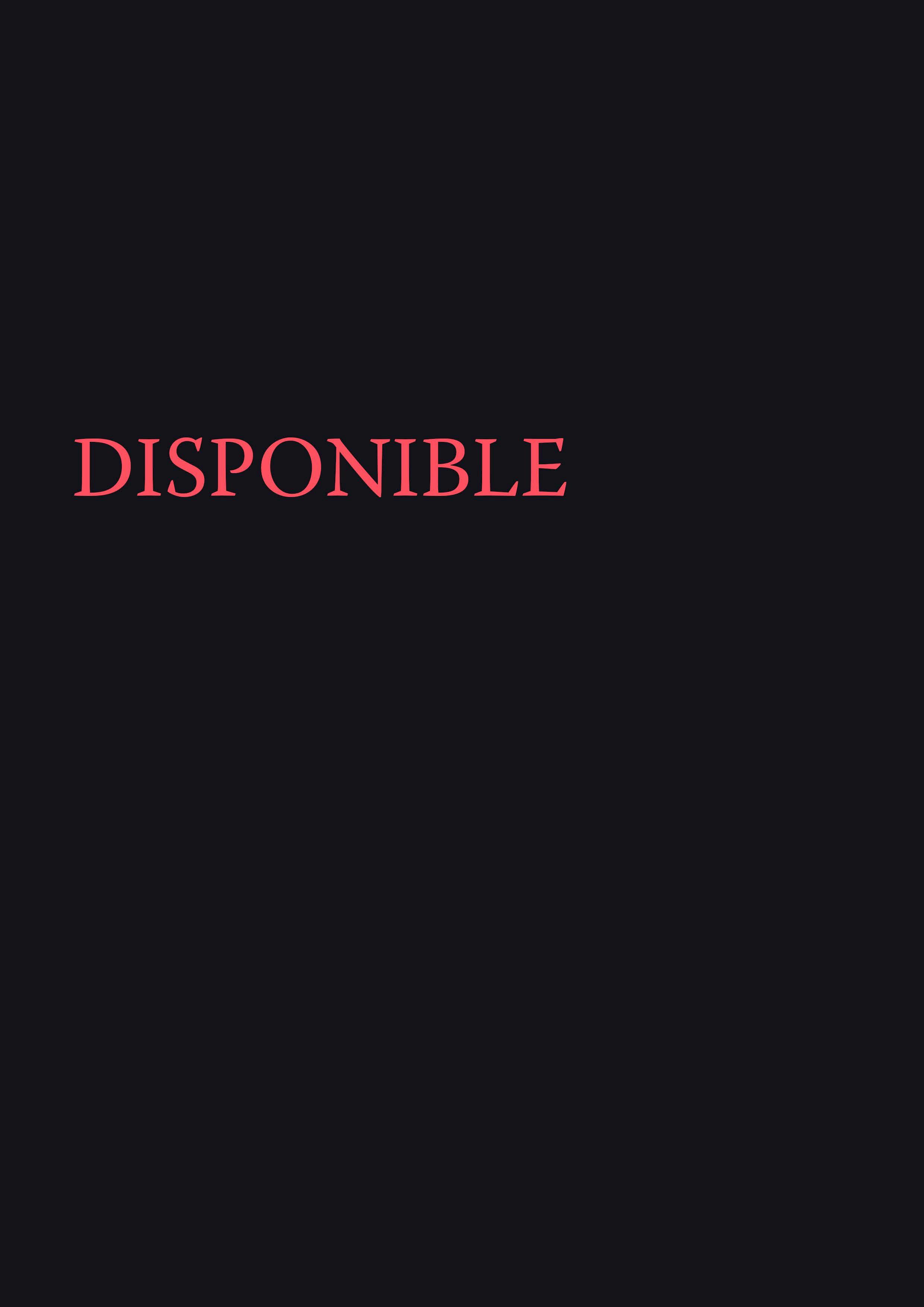
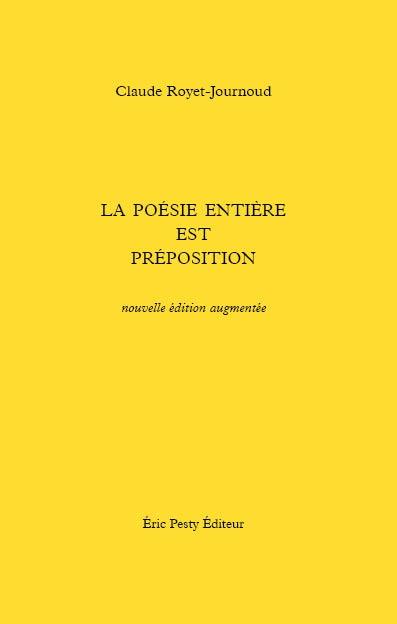
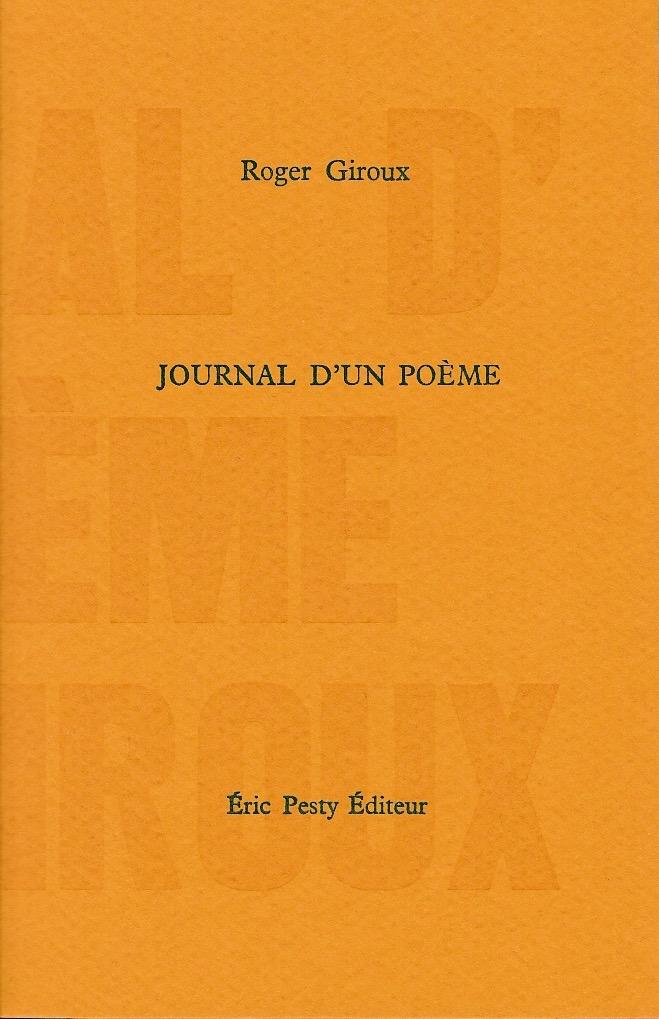
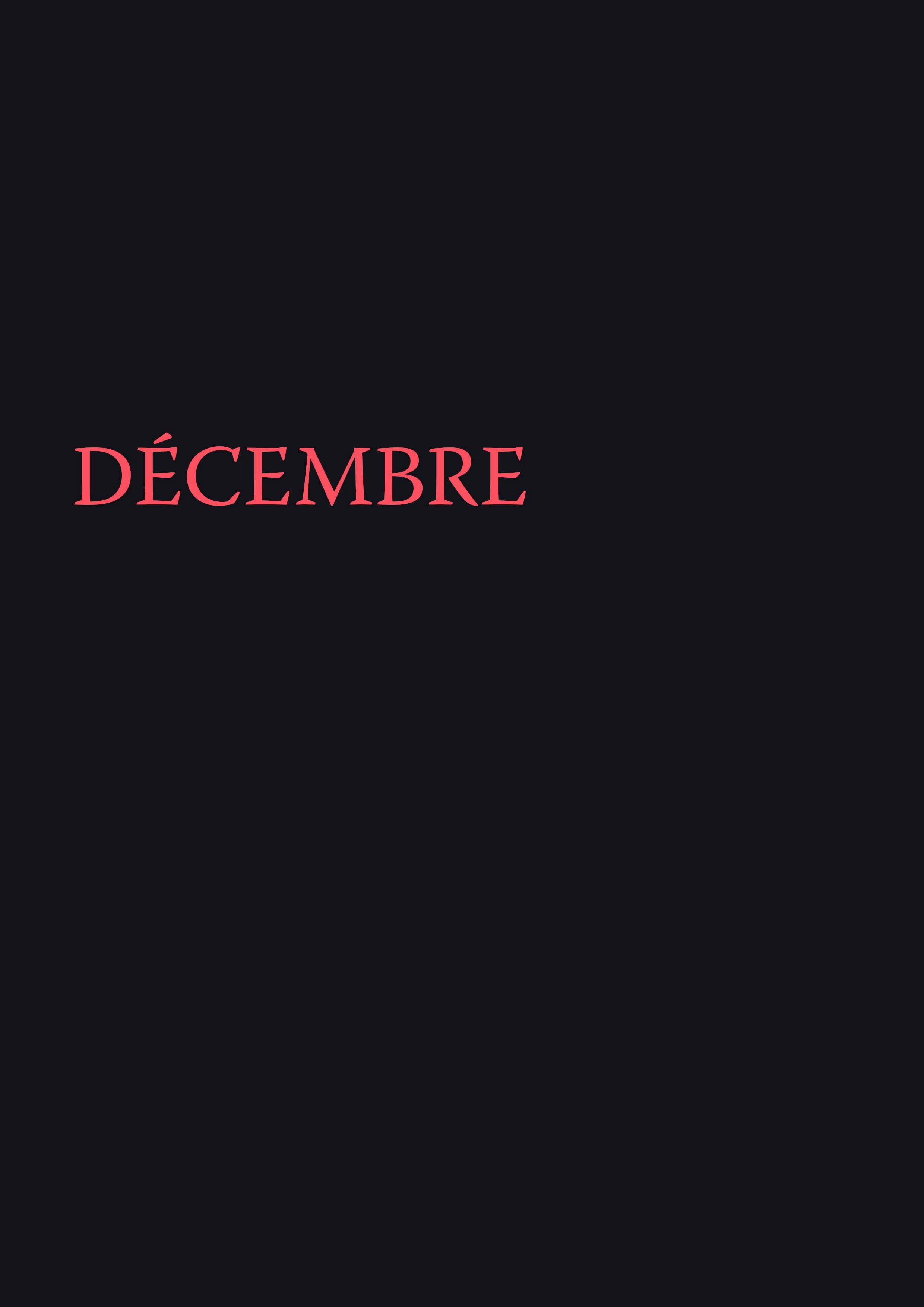
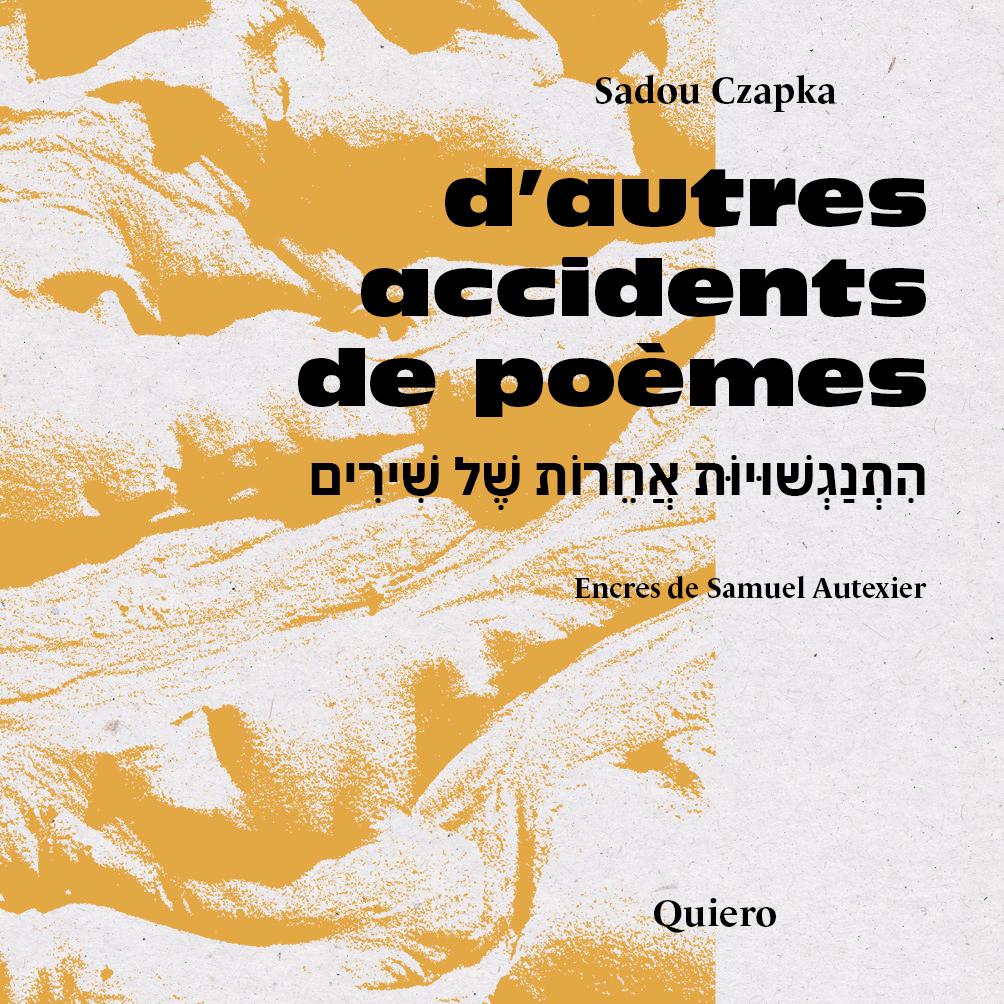

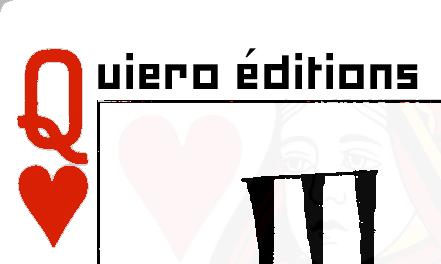

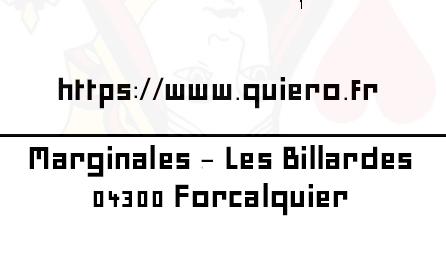




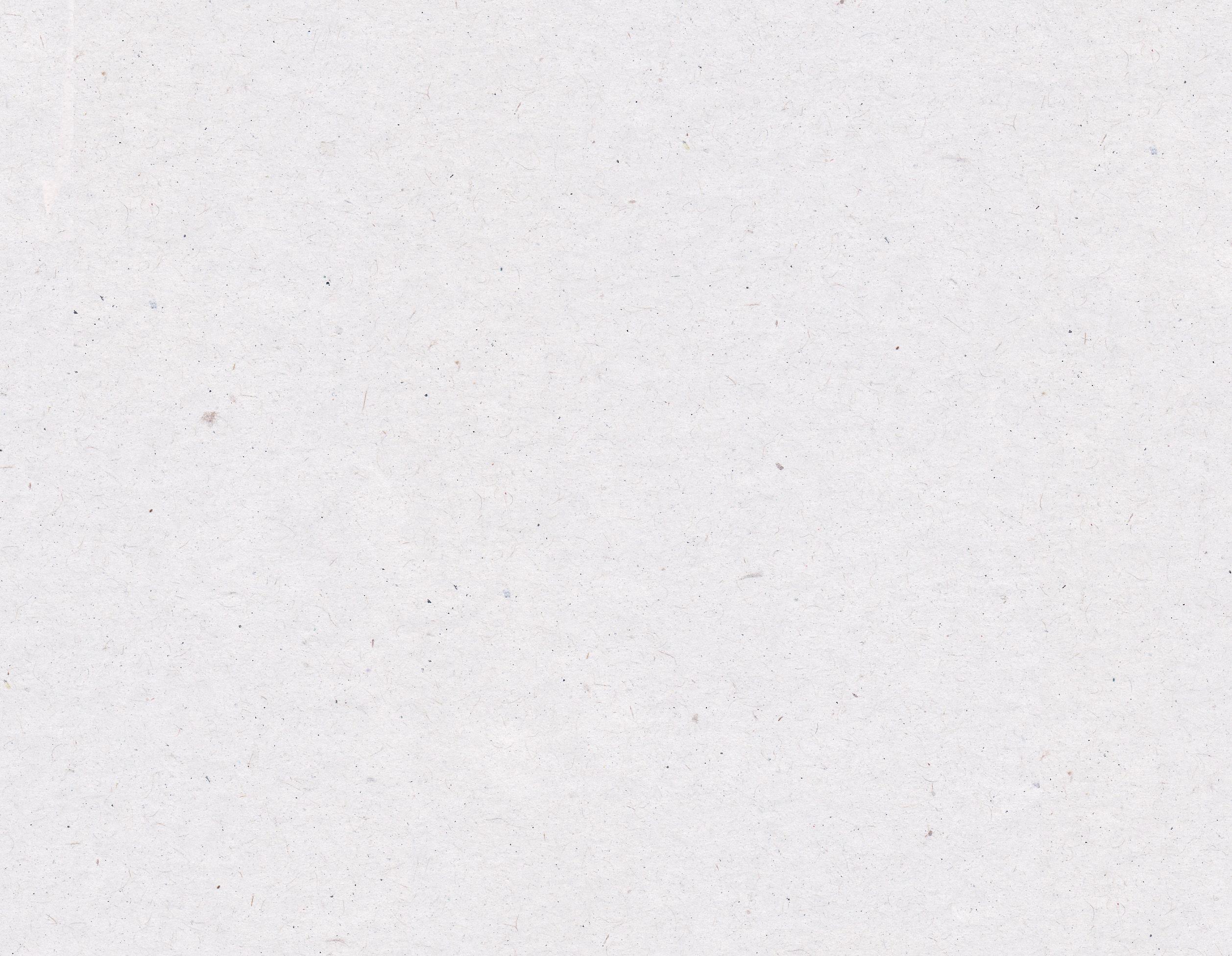
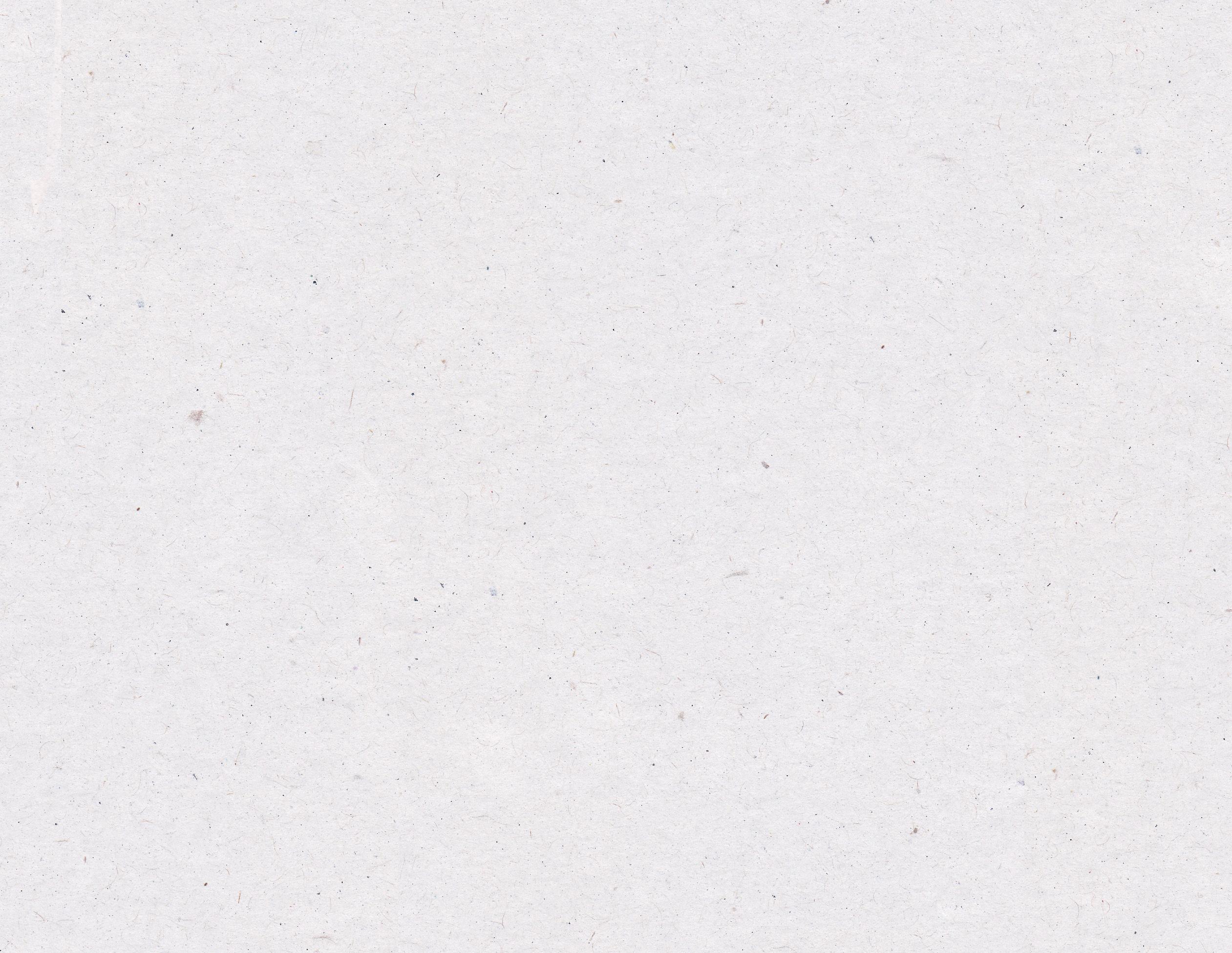

 Encre préparatoire, composition en cours d’impression dans l’atelier et portrait de Sadou Czapka par Samuel Autexier.
Encre préparatoire, composition en cours d’impression dans l’atelier et portrait de Sadou Czapka par Samuel Autexier.
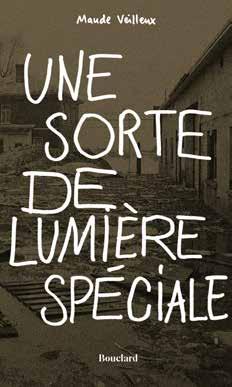



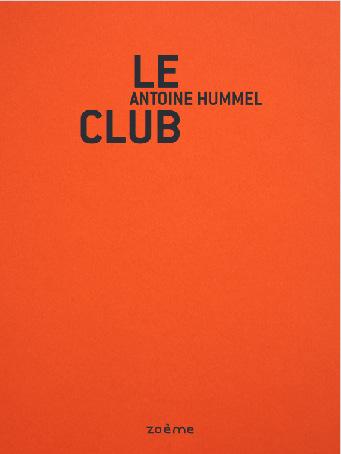

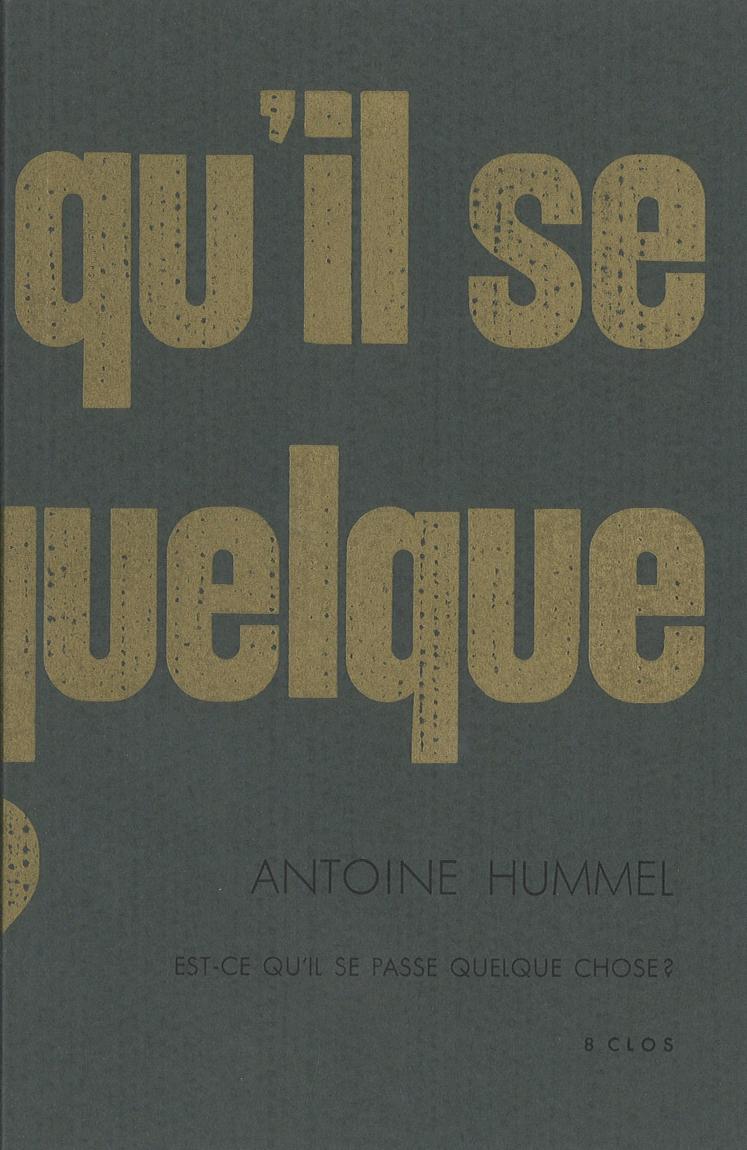


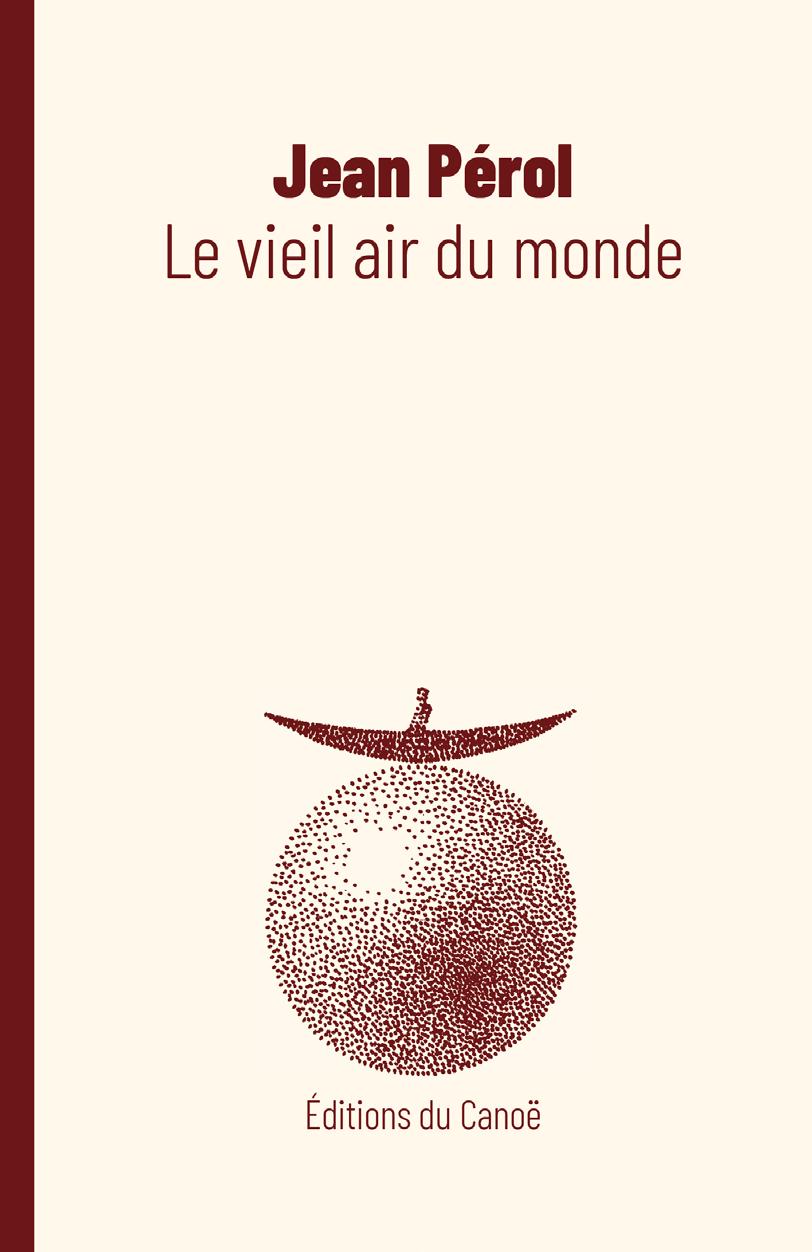
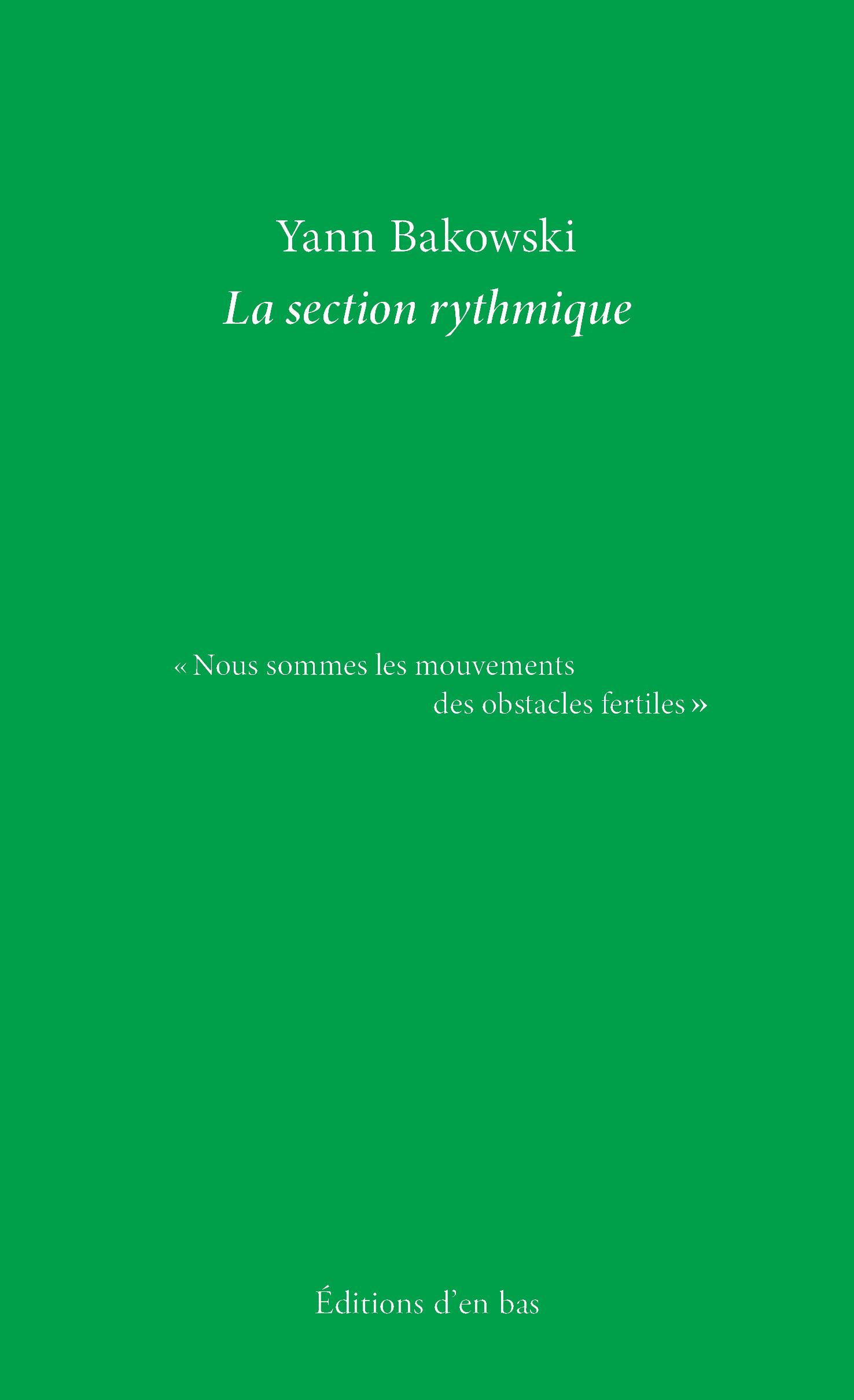




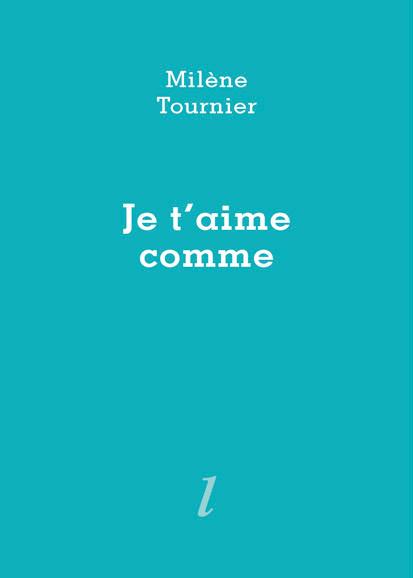

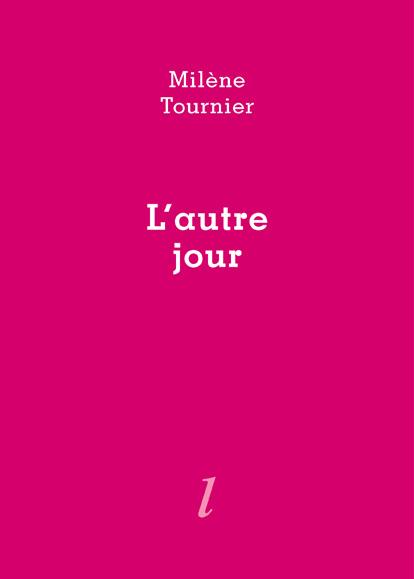



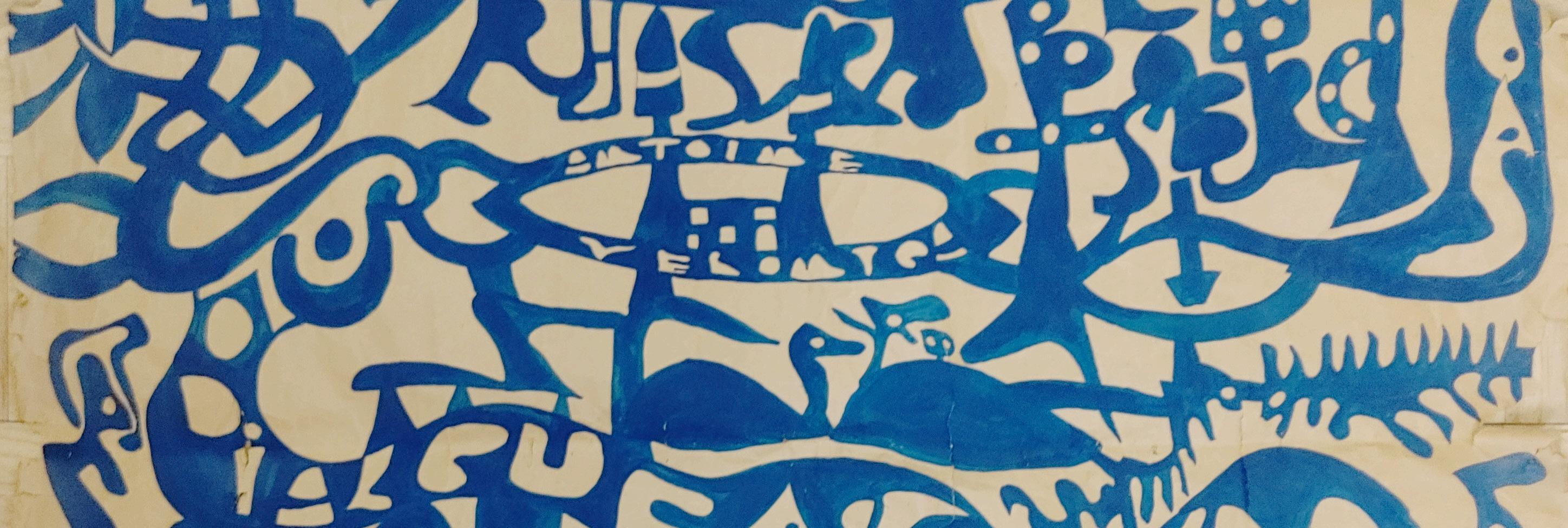
 Détail d’une encre d’Antoine Oleszkiewicz et composition en cours dans l’atelier…
Un livre de 48 pages au format 13x17 cm. Impression typographique des pages intérieures et de la couverture avec des encres de l’auteur
Détail d’une encre d’Antoine Oleszkiewicz et composition en cours dans l’atelier…
Un livre de 48 pages au format 13x17 cm. Impression typographique des pages intérieures et de la couverture avec des encres de l’auteur

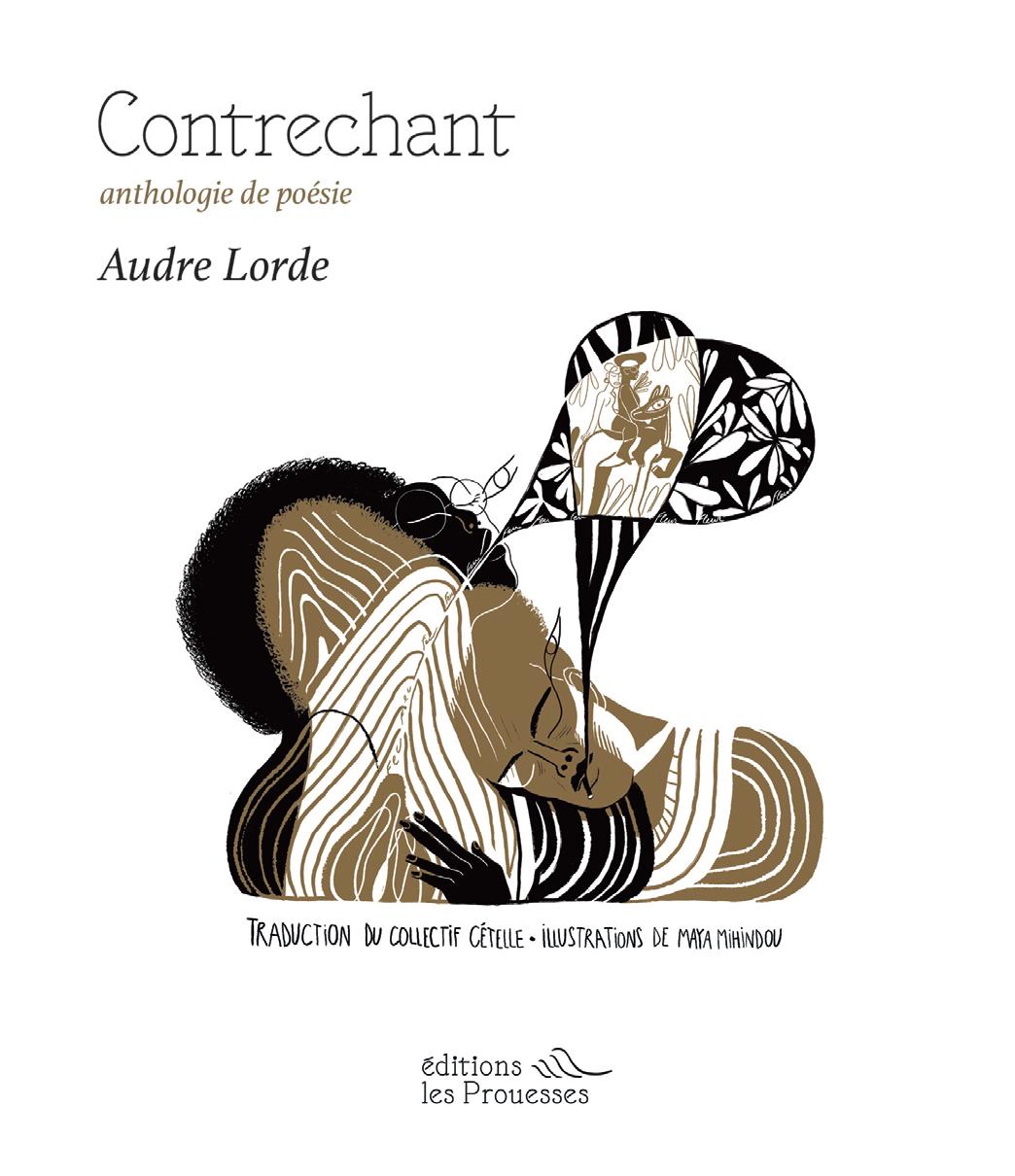


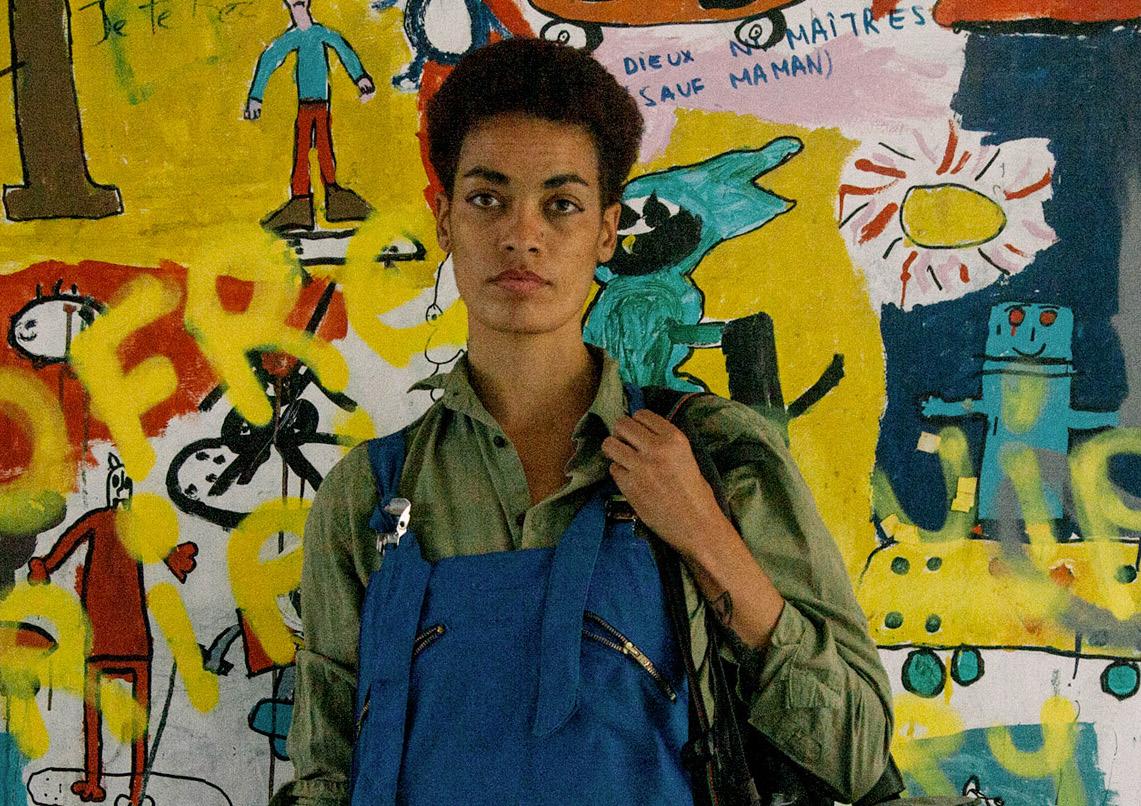



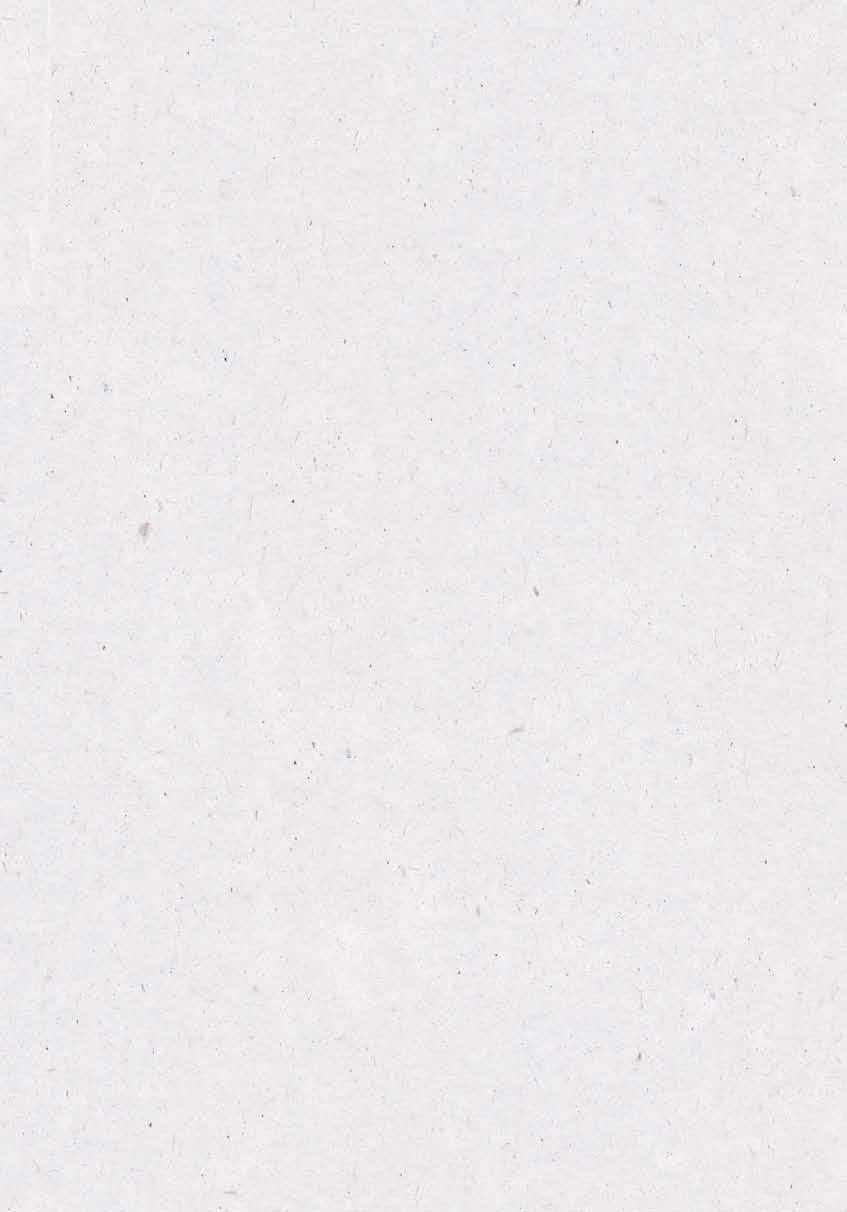
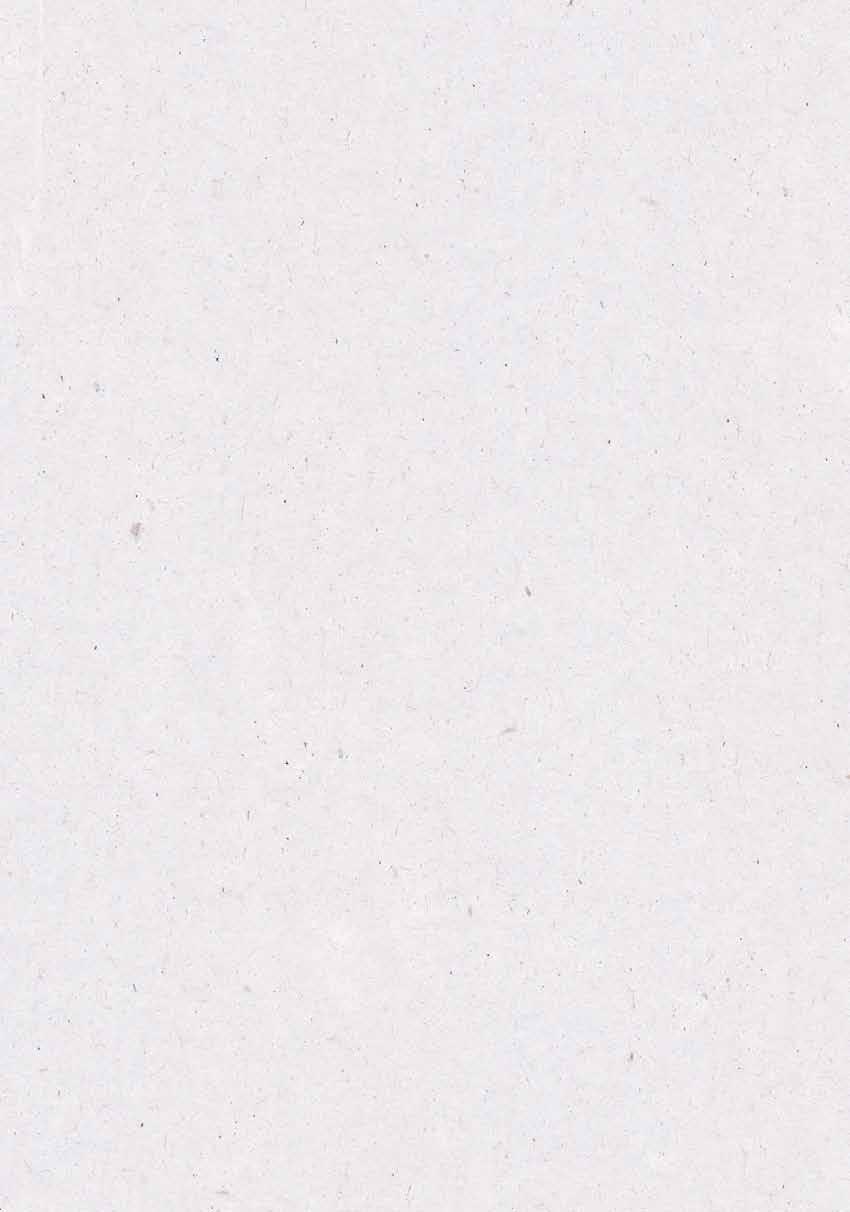
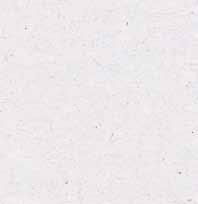

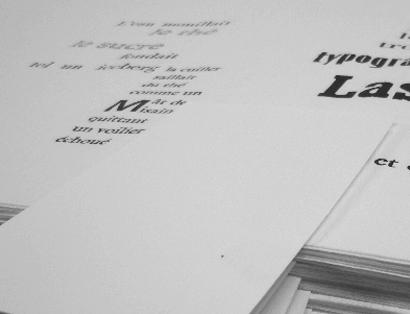
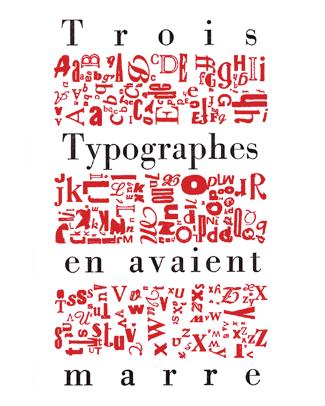

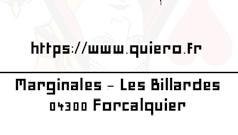




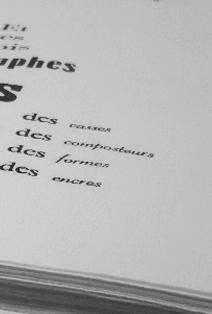
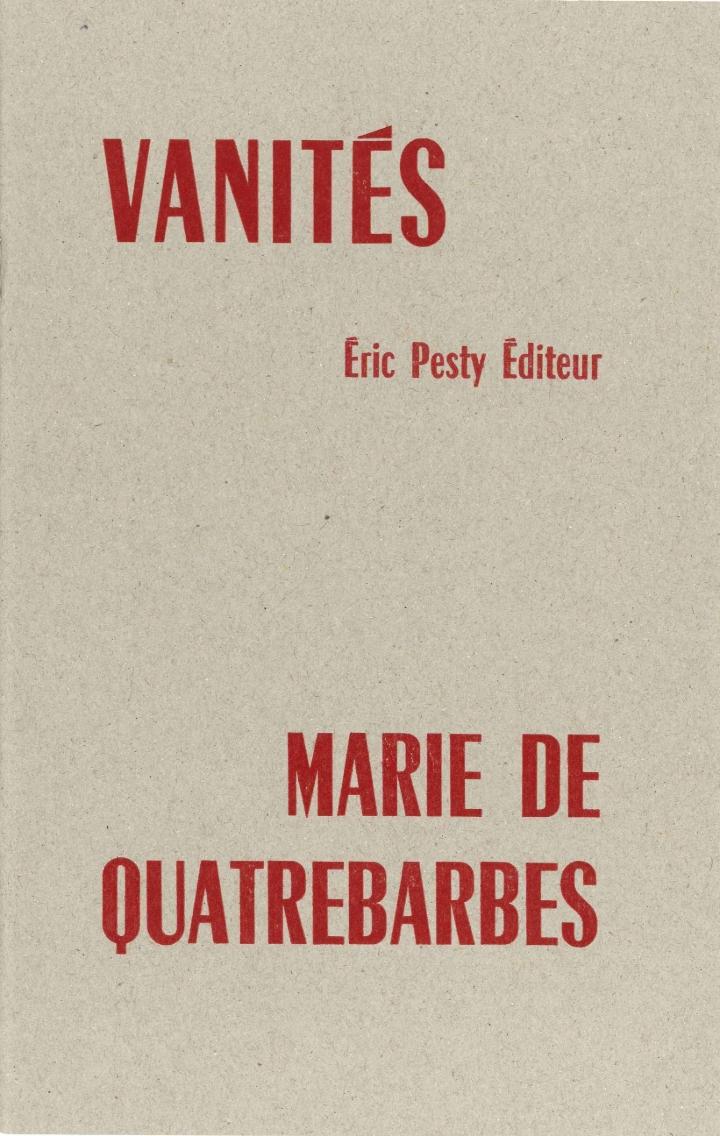
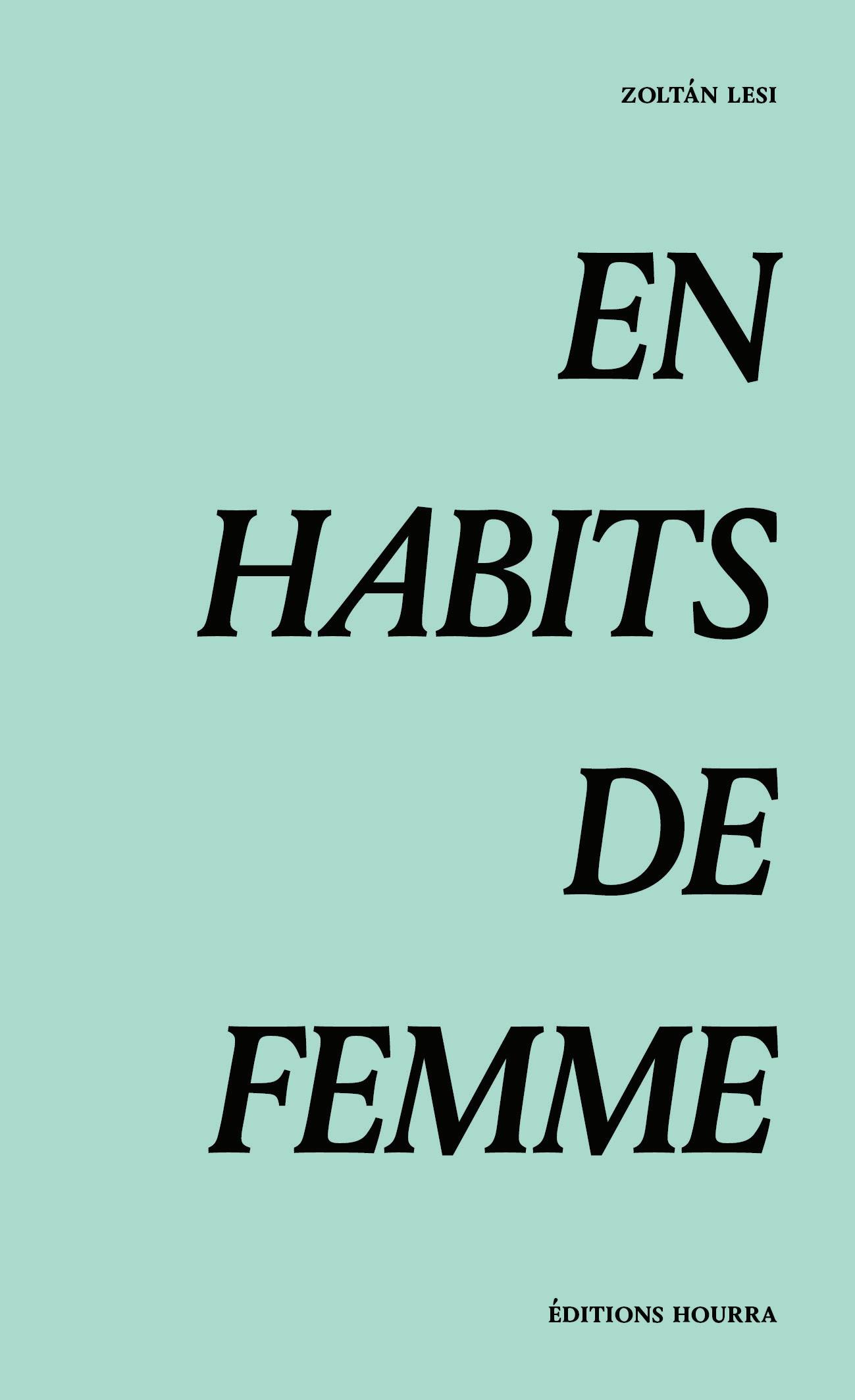
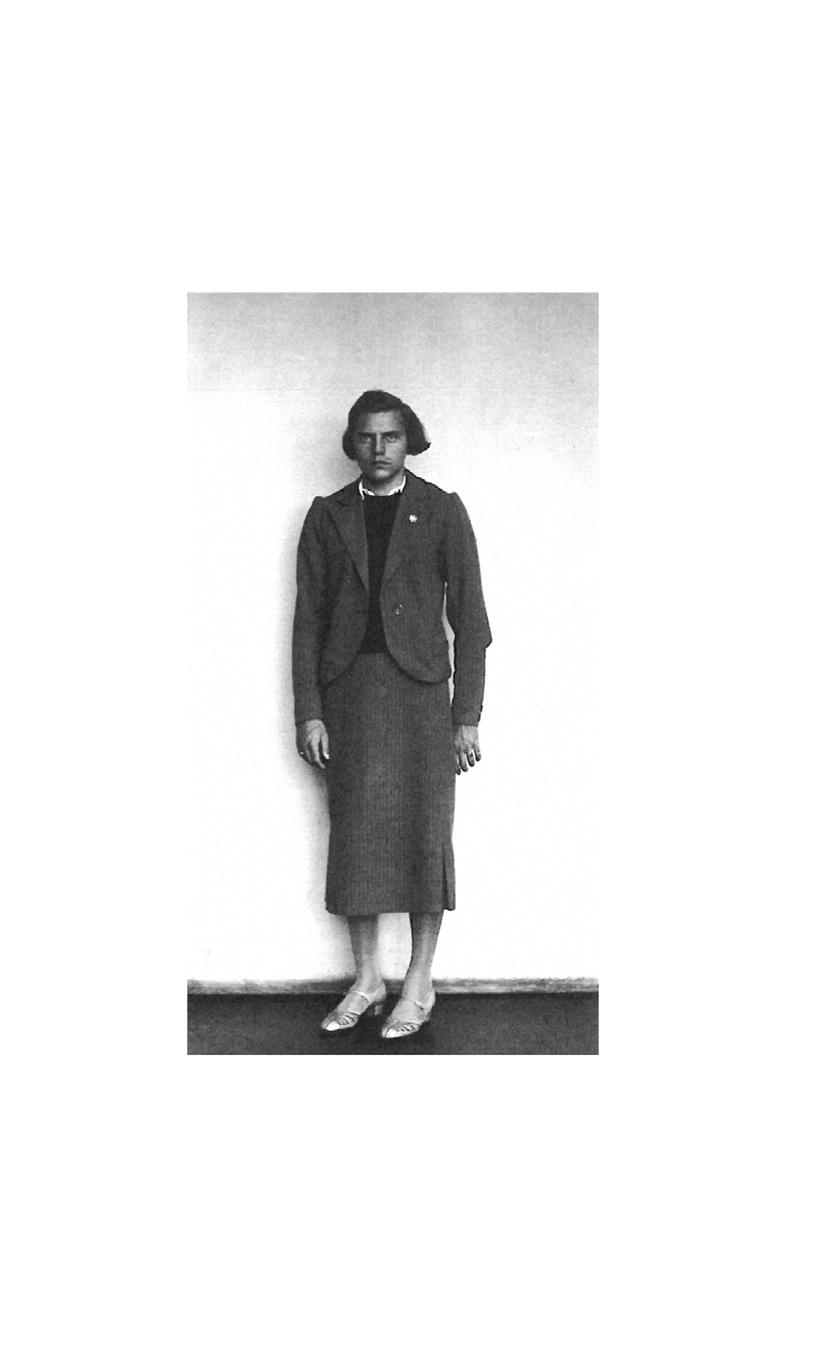
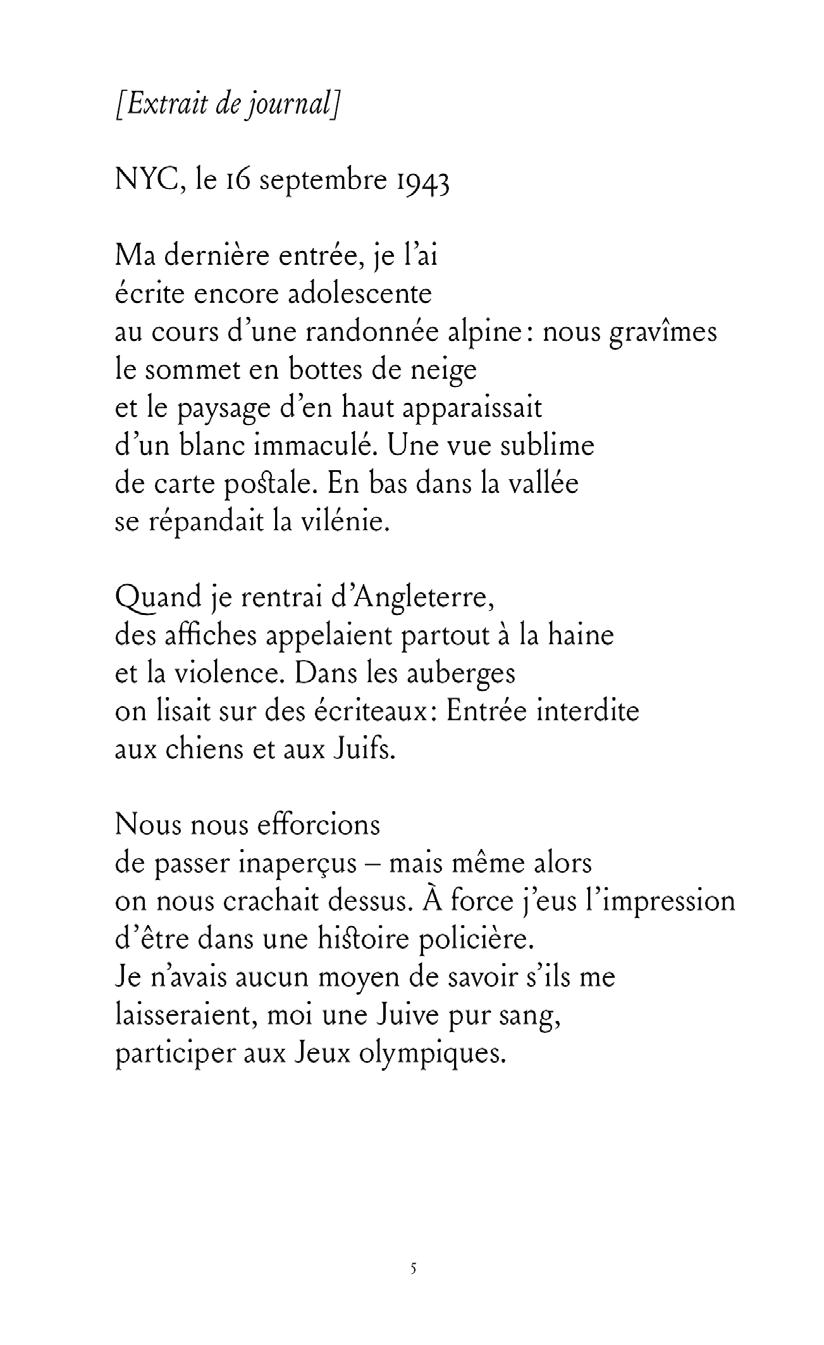
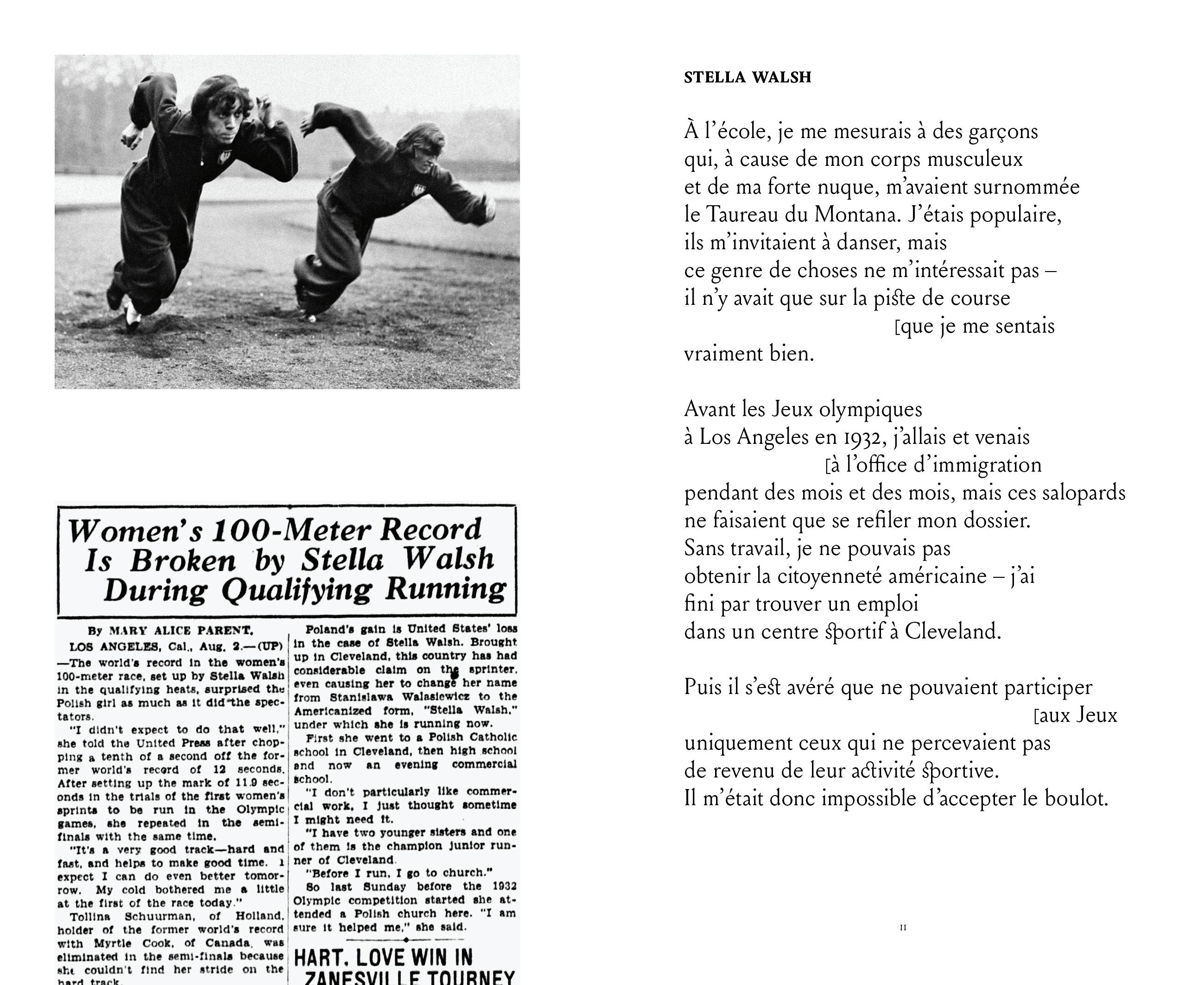


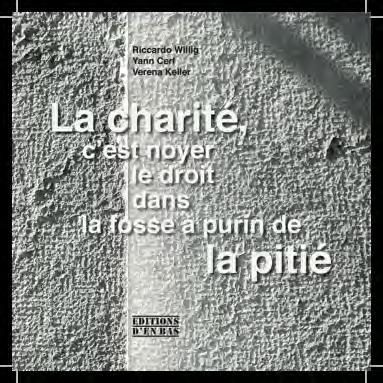


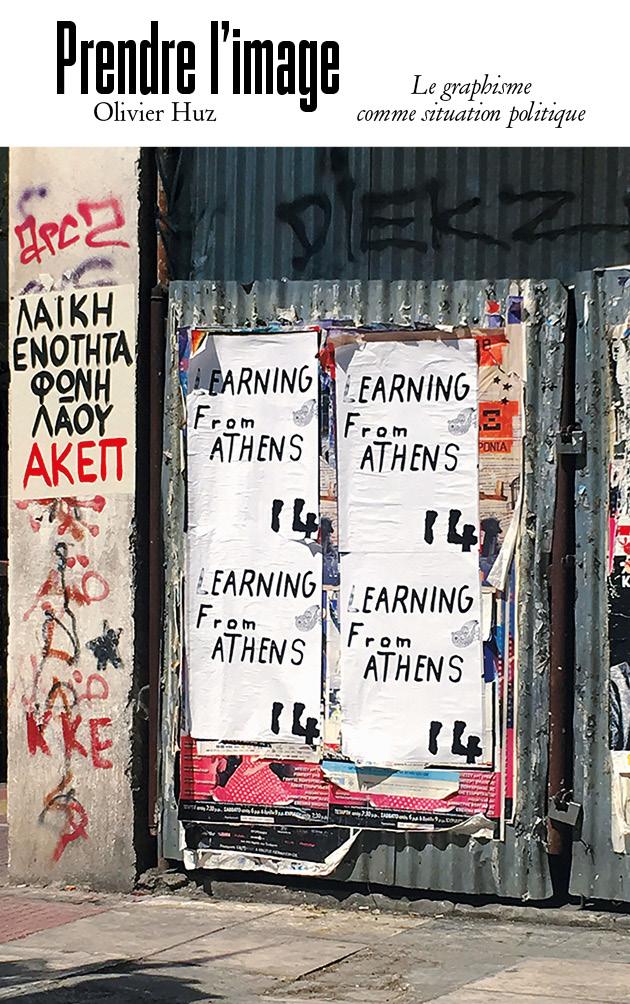 Pages suivantes : extraits [version de travail]
Pages suivantes : extraits [version de travail]