





SINGA est une organisation internationale qui contribue à créer une société plus inclusive en rassemblant locaux et nouveaux arrivants (personnes réfugiées, demandeurs d’asile…) autour de projets sociaux, professionnels et entrepreneuriaux. Elle défend l’idée d’un monde en mouvement. Du mouvement pour faire se rencontrer les idées, les opinions, les individus.

https://singafrance.com
Du mouvement dans les perceptions. Du mouvement dans les clichés, les idées préconçues.
Dans le monde, 356 millions d'enfants vivent dans la grande pauvreté, c’est-àdire avec moins de 1,70 € par jour. Prix Nobel d’économie pour ses travaux sur le terrain, Esther Duflo aborde dans une série de 10 livres autant de thèmes liés à la pauvreté pour en parler simplement avec les enfants. Tous ces livres sont illustrés par Cheyenne Olivier, édités par Seuil Jeunesse. www.seuiljeunesse.com



On ne naît pas raciste, on le devient. Cette vérité est la pierre angulaire de la fondation Lilian Thuram, ancien joueur de l’équipe de France de football, destinée à lutter contre le racisme à travers le sport et l’éducation. Le racisme est une construction intellectuelle, politique et économique : « Nous devons prendre

conscience que l’Histoire nous a conditionnés, de génération en génération, à nous voir d’abord comme des Noirs, des Blancs, des Maghrébins, des Asiatiques », affirme le joueur militant. De nombreuses ressources sont en accès libre sur le site pour accompagner les actions éducatives contre le racisme, pour l’égalité.

C’est le montant total des dons déclarés à l’impôt. La moitié des Français déclare avoir donné́ à des associations au cours de l’année 2021 (étude INJEP), principalement sous forme monétaire (3 sur 4), mais aussi, sous forme matérielle. Les donateurs sont plus souvent aisés, âgés et diplômés, mais ce sont les habitudes familiales et l’engagement bénévole qui influencent le plus fortement les comportements de don. La compassion et l’engagement personnel motivent les dons. www.injep.fr

Les Cahiers Pédagogiques paraissent huit fois par an, sur abonnement, ou à l’achat à l’exemplaire. Le numéro de septembre 2024 pose une réflexion complémentaire à ce numéro de « Questions d’Educ ».
« L’école n’est pas un sanctuaire, et le racisme, les racismes, ne l’épargnent pas. L’institution est-elle raciste ? Et dans la classe comment se manifestent les racismes ? Comment enseigner contre les racismes et l’antisémitisme, comment y former les enseignants ?
Ce dossier explore différentes manifestations du racisme à l’école, et propose des références théoriques pour contribuer à mieux lutter contre elles. » www.cahiers-pedagogiques.com/n-595-racismeset-ecole/
UNE EXPO
« CORPS À CORPS »
« Faisons corps » est l’exposition en cours du lieu culturel de la fondation Maif, ouvert gratuitement à tous et toutes. Des artistes contemporains interrogent avec leurs œuvres protéiformes le corps anatomique, les singularités et la diversité, la mise en mouvement et la force du collectif quand les corps font corps.
www.maifsocialclub.fr


Le cinéma itinérant, c’est aujourd’hui 109 exploitants passionnés (rapport d'information du Sénat, 24 mai 2023), épaulés par de nombreux bénévoles, en hexagone et outremer. Ceux-ci organisent des projections de films dans près de 2500 communes rurales, dans tous les coins du territoire national. Ils sont souvent relais des dispositifs de transmission du cinéma aux plus jeunes sur le temps scolaire, comme Ecole et Cinéma, Maternelle et Cinéma, Lycéens et Apprentis au cinéma… https://transmettrelecinema.com




Bibliographie 12 18 9 5 8 7 2 10 20 16 21 22 23 13 14 19
Actualités éducatives
É dito
Concepts et définitions
Réagir à un acte raciste, antisémiste
Le rapport inquiétant de la CNCDH
Des mesures à faire vivre
La mixité sociale comme rempart
Le concours, entre émulation et altruisme
La Shoah, plus jamais ça
Tous les cris, un SOS
L’athlétisme dans la course contre les préjugés
Alterégaux contre les « égos »
En « plongée » pour l’abolition de l’esclavage
Signaler la discrimination en ligne
Une démarche active pluridisciplinaire
L’appel à la diversité par la langue

Morgane VERVIERS
Secrétaire générale - UNSA éducation CPE
Béatrice LAURENT
Secrétaire nationale
Secteur Éducation et Culture
Professeure des écoles - Formatrice INSPÉ ont coordonné ce numéro auquel ont participé :
secteur ÉDUCATION ET CULTURE
Willie CHARBONNIER
Conseiller national, Professeur de mathématiques
Jérôme GIORDANO
Chargé de mission Enseignement supérieur
Enseignant chercheur
Jean-Jacques HENRY
Conseiller national
Professeur d'économie
Gilles LELUC
Conseiller national
Professeur de lettres modernes
Stéphanie de VANSSAY
Conseillère nationale
Professeure des écoles
Solenn TEXIER
Conseillère Nationale
Professeure d’Histoire-Géographie
Mourad OURAOU
Conseiller national
Enseignant spécialisé
Pierre-Loic AUBERT
Conseiller national
Inspecteur de l'enseignement agricole
Directeur de publication
Morgane VERVIERS Graphisme
Cécilia Bertin - ceciliabertin.com
Crédits photographique
UNSA - Unplash - Pexels - Pixabay
www.unsa-education.com

Toujours au défi de combattre les racismes et l’antisémitisme
Les sanctuaires sont rares et ne font plus remparts.
À
l’École comme partout ailleurs, les propos racistes circulent, ne restent pas au pas de la porte. Pire, le système éducatif produit lui-même du racisme, en tolérant des lieux d’éducation ségrégués, et par la fragilité de la formation transversale de ses professionnels.
Le racisme et l’antisémitisme ne sont pas voués à disparaître dans une société conflictualisée avec une extrême droite dangereusement croissante, des parcours migratoires diabolisés, des conflits mondiaux que la France ne peut ignorer. Les réseaux sociaux font caisse de résonnance, y compris passés les horaires du temps scolaire.
Dans ce contexte, les lieux d’éducation, les lieux de loisirs collectifs et associatifs, poreux aux questions de société, sont des lieux où l’éducation à l’antiracisme et l’antisémitisme se doit d’être toujours vive.
Questions d' É duc . explore cette question d’actualité autant que d’éducation, en documentant à la fois du point de vue institutionnel, légal et engagé cette lutte perpétuelle contre la haine des autres. Parce que la société inclusive que promeut l’UNSA Éducation ne peut advenir tant que perdureront les discriminations sous toutes leurs formes.
L'équipe éditoriale de "Questions d'éduc."
C’est le fait de traiter différemment, le plus souvent défavorablement, une personne ou un groupe de personnes en s’appuyant sur une ou plusieurs caractéristiques réelles ou supposées (origine, handicap, sexe, religion, orientation sexuelle, etc.) dans un domaine prévu par la loi : l’emploi, l’éducation, le logement, etc. La loi française en reconnaît plus de 25. Toute discrimination avérée peut être sanctionnée pénalement puisqu’il s’agit d’un délit.
C’est une image préconçue et simplifiée , appliquée à un groupe entier de personnes, sans tenir compte des différences individuelles.
Les stéréotypes visent souvent à justifier la conduite d’un groupe vis-à-vis d’un autre. Certains stéréotypes peuvent paraître positifs au premier abord mais sont avant tout essentialisant : tous les hommes ne sont pas fans de football par exemple.
C’est une opinion préconçue selon des critères personnels et sans fondement, qui oriente favorablement ou non, l’idée qu'on se fait d’une personne ou un groupe. Il s’agit donc d’un jugement de valeur fondé sur un stéréotype. Les préjugés sont tenaces, souvent inculqués par l’environnement social, s’en défaire demande une prise de conscience, un travail sur soi.
Ce mot caractérise l’hostilité systématique à l'égard des étrangers, c’est-à-dire d’une nationalité autre que la sienne et/ou des personnes perçues comme étrangères.
* Avec l’aide précieuse du dico en ligne Le Robert.
Ce mot devient populaire à la fin du 19 e siècle, moment de fortes poussées nationalistes, et signifie la haine des « Sémites » (Juifs et Arabes) originaires d’Orient que l’on oppose alors aux Aryens, ancêtres des Européens. Il devient très vite synonyme d’hostilité, de haine à l’encontre des juifs et seulement eux. Il a toujours cette signification.
Avant cette date, il faut plutôt parler d’antijudaïsme, populaire dans le monde chrétien qui définit une hostilité à l’encontre des pratiquants de la religion juive jugés « déicides » et auxquels on reproche de ne pas adhérer au christianisme. Aussi se diffuse l’idée que ce peuple est haïssable, ce qui a indéniablement servi de terreau à l’ antisémitisme par la suite. Il existe enfin l’ antisionisme qui, lui, qualifie une hostilité à l’encontre de l’Etat d’Israël.
Aujourd’hui c’est ce qui sert souvent de « paravent » à l’antisémitisme. On constate donc que ces trois formes d’hostilité peuvent interférer les unes envers les autres.
Cette idéologie est d’abord fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains, selon une prétendue race.
Cette vision « biologique » est populaire au 19e siècle et justifie, par exemple, la colonisation. Aujourd’hui, la notion de « civilisation » a largement remplacé celle de « races ».
Le racisme désigne donc une attitude d'hostilité systématique à l'égard d'une catégorie de personnes, déterminée selon la couleur de peau, l’origine nationale ou ethnique.
Victime (ou témoin) d’une discrimination, voici quelques démarches qu’on peut effectuer
Pour être guidé au mieux, vous pouvez vous tourner vers le Défenseur des droits dont l’une des missions est de lutter contre les discriminations et de promouvoir l’égalité, notamment lorsqu’il s’agit des services publics mais pas seulement. Toute personne qui s’estime discriminée peut le saisir mais si cette démarche vous inquiète, vous pouvez être épaulé par une association qui s’en chargera.
C’est une démarche simple, que l’on peut faire par téléphone au 3928 ou sur antidiscriminations.fr.
Les juristes du Défenseur des droits vous écoutent et vous accompagnent gratuitement.
La saisine du Défenseur des droit peut aboutir à 3 solutions :
• Une médiation : désigné par le Défenseur des droits, le médiateur entend les personnes concernées. La médiation ne peut excéder 3 mois, renouvelable une fois.
• Une transaction : le Défenseur des droits propose à l'auteur des faits une ou plusieurs sanctions (amende, indemnisation de la victime, publicité des faits). En cas d'accord, la transaction doit être validée par le procureur de la République.
• Une action en justice : si le Défenseur des droits a connaissance de faits de nature à constituer une infraction ou si l'auteur refuse la transaction, le Défenseur des droits saisit le procureur de la République.
Porter plainte, mode d’emploi
En parallèle, vous pouvez signaler ces faits à la police ou à la gendarmerie et déposer plainte contre l’auteur présumé des faits. Pour cela, il vous faudra apporter des preuves permettant d’établir l’infraction. Celles-ci peuvent être des témoignages, des écrits (SMS, courriels), des enregistrements téléphoniques.

La plainte déclenche une enquête de police. Cette enquête peut aboutir au jugement et à la condamnation de l'auteur des faits par les juridictions pénales.
Le délai pour porter plainte est de 6 ans à compter des faits.
La plainte peut être déposée auprès de n'importe quel commissariat ou brigade de gendarmerie. Vous pouvez demander l'assistance d'un avocat qui vous accompagnera dès le dépôt de plainte jusqu'à l'éventuel jugement de l'auteur de la discrimination.
Vous pouvez également vous constituer partie civile pour obtenir des dommages et intérêts. Si les faits dénoncés constituent une discrimination, l'auteur peut être jugé et condamné par le tribunal correctionnel.
Il y a des sanctions différentes s’il s’agit de personnes physiques, jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, ou morales (entreprises, associations, État, collectivités territoriales, etc.), qui encourent une amende égale à 225 000 € et des peines complémentaires comme la publication de la décision de justice dans la presse écrite*.
* Majoration si la discrimination est commise dans un lieu accueillant du public ou pour empêcher l'accès à un tel lieu : pour une personne physique, peine de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende ; personne morale amende de 375 000 €. Que
POUR APPROFONDIR POUR APPROFONDIR
Site du défenseur du droit : www.defenseurdesdroits.fr
État des lieux
Comme chaque année, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) a rendu son rapport sur la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie. Les constats sont inquiétants ; pour la première fois, on note un fléchissement de l’indice de tolérance, ce qui soulève de réelles questions sur l’évolution du vivre-ensemble et une montée forte de l’antisémitisme.
62
Tel est en 2023 l’Indice longitudinal de tolérance*, en baisse de 3 points par rapport à 2022. Évolution de la tolérance par minorités : 68 à l’égard des Juifs (-4 points) ; 57 à l’égard des Musulmans (- 2 points) Minorités jugées comme formant des groupes « à part » : Roms 63%, Musulmans 35%, Chinois 32% + 32 %
Des crimes ou délits à caractère raciste, xénophobe ou antireligieux et de 20% des signalement PHAROS **, en particulier des contenus de la plateforme X. (Données ministère de l’Intérieur)
4 fois +
D’actes antisémites dont 74 % ont eu lieu après le 7 octobre. Cela rappelle de manière brutale la persistance de l’antisémitisme dans notre pays. C’est la 1ère fois qu’il est à un tel niveau et surtout le rapport montre que les opinions antisémites ne sont plus seulement basées sur l’antisionisme mais toujours sur les vieux stéréotypes associant les Juifs au pouvoir et à l’argent.
47 %
Des personnes se présentant comme islamophobes pensent qu’ une femme est faite pour avoir des enfants et les élever...
57%
Pensent que l’homosexualité n’est pas une manière acceptable de vivre sa sexualité. Il existe ainsi une forte corrélation entre le sentiment anti-immigré et d’autres formes de haine et d’intolérance.
60 %
Des sondé.es pensent que « de nombreux immigrés viennent en France uniquement pour profiter de la protection sociale ».
43% que « l’immigration est la principale cause de l’insécurité ».
37% que les « Juifs ont un rapport particulier à l’argent ».
23% que les « enfants d’immigrés nés en France ne sont pas vraiment Français ».
24%
des personnes coupables d’infractions racistes sont poursuivies par les tribunaux, c’est très insuffisant. Un million de personnes affirment pourtant avoir été victimes chaque année d’au moins une atteinte à caractère raciste, antisémite ou xénophobes. Très peu portent plainte.
* (indice qui mesure tous les ans l’évolution des préjugés sur une échelle de 1 à 100, plus on s’approche de 100, plus la tolérance est élevée).
** PHAROS : plateforme de signalement en ligne des contenus ou des comportements illicites sur Internet analysés par des agents de police et de gendarmerie.
Plan national
Le plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine propose de mieux éduquer et mieux former sur ce sujet. Passons en revue ses principales préconisations.

Ce plan 2023-2026 est un programme gouvernemental français présenté en janvier 2023 par la première ministre. Il est élaboré par la DILCRAH (délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT) en concertation avec diverses parties prenantes, et articulé autour de cinq axes principaux :
> Mesurer la réalité du racisme, de l'antisémitisme et des discriminations
> Oser nommer la réalité de la haine
> Mieux éduquer et former
> Sanctionner les auteurs
> Accompagner les victimes
L'axe 3 se concentre sur l'éducation et la formation, en voici une synthèse des points clés :
Mesures éducatives
> Visites mémorielles obligatoires
Chaque élève bénéficiera d'au moins une visite historique ou mémorielle liée au racisme, à l'antisémitisme ou à l'antitsiganisme durant sa scolarité.
> Renforcement de l'éducation civique
Le plan prévoit un renforcement de l'enseignement moral et civique, avec un accent particulier sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme.
Formation des professionnel·les
> Formation des agents de l'État
Tous les agents de la fonction publique d'État, y compris les enseignants, recevront une formation sur ces enjeux afin d'être mieux outillés pour aborder ces sujets.
> Sensibilisation dans l'enseignement supérieur
Le plan inclut des mesures pour sensibiliser les étudiants et le
personnel de l'enseignement supérieur à ces problématiques.
Ressources pédagogiques
> Outils pour les enseignants
Le plan prévoit la mise à disposition de ressources pédagogiques pour aider les enseignants à aborder ces sujets en classe. Le Réseau
Canopé propose notamment des outils pour éduquer contre le racisme et l'antisémitisme.
Événements de sensibilisation
> Semaine d'éducation contre le racisme et l'antisémitisme
Cette semaine annuelle, qui se tient généralement en mars, offre l'opportunité aux établissements scolaires de mettre en place des actions spécifiques de sensibilisation.
L’UNSA Éducation est et restera attentive à ce que ces mesures soient concrètement mises en œuvre avec la qualité et donc les moyens nécessaires. L’éducation contre le racisme et l’antisémitisme est essentielle pour promouvoir les valeurs et principes fondamentaux de notre République, comme l’égale dignité des êtres humains, quelles que soient leurs origines ou leurs convictions.

Décryptage avec... Youssef Souidi
Youssef Souidi est docteur en économie et auteur de “Vers la sécession scolaire ? Mécaniques de la ségrégation au collège”. Il a notamment travaillé sur la cartographie sociale des collèges et les moyens d’y améliorer la mixité. Il a accepté de répondre aux questions de QDE.

Dans votre ouvrage, vous évoquez une ségrégation sociale grandissante dans le système éducatif français. Comment rendezvous compte de cette évolution ?
Youssef Souidi : En préambule, j’aimerais rappeler qu’on mesure assez mal la prévalence du racisme aujourd'hui à l'école, mais ça n'a pas toujours été le cas. Des études de la DEPP (Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance) réalisées jusqu’en 2005 posaient des questions abordant les discriminations en fonction des origines, de la race ou de la religion. La dernière étude ICCS (International Conference on Computational Science) de 2022 aborde également ces questions à travers la vie en société et la citoyenneté. Dans les deux cas, les jeunes françaises et français y apparaissent plus tolérants à la différence et rejettent davantage les discriminations que certains voisins européens.
Aujourd’hui, on peut dire que la situation a nettement évolué dans le sens d’une certaine ségrégation. Celle-ci peut se jouer à une échelle très fine et pas uniquement dans les grandes métropoles. Par exemple, à Roubaix, deux collèges sont situés à 10 minutes à pied l’un de l’autre : le premier, public, fait partie des 10% les plus défavorisés au niveau national ; le deuxième, privé sous contrat, des 5% les plus favorisés, au niveau national
également. Le niveau de ségrégation est plutôt un reflet déformant de la ségrégation résidentielle. C’est aussi vrai dans une partie des quartiers d’éducation prioritaire où les phénomènes d’évitement viennent accentuer les inégalités territoriales. Mais si la ségrégation sociale est très bien documentée, la ségrégation qu'on pourrait appeler “éthnique”, “ethno-raciale” l’est beaucoup moins. Or quand on discute avec les acteurs locaux, très souvent, cette question revient. Quand on parle de ségrégation sociale, très vite, c'est la question de la couleur de peau, de la religion qui va venir dans les discussions.
Pensez-vous qu'en améliorant la mixité dans les établissements scolaires, on pourrait aider à combattre le racisme ?
YS : Encore une fois, en France, c'est assez peu documenté. Ces questions sont assez taboues. Mais on a des études internationales, notamment en Inde ainsi qu’aux États-Unis. Elles montrent que davantage de mixité permet de réduire les préjugés et que des amitiés se créent entre personnes de différentes origines ethniques. En France, ce qu'on a observé dans les expérimentations visant à plus de mixité sociale menées dans plusieurs collèges, c’est que les élèves avaient aussi un réseau amical plus mixte socialement. En ce sens, plus de mixité permet un brassage effectif et également d'avoir une expérience concrète de l'altérité.
Concrètement comment faire pour que ce brassage social fonctionne ? Quels sont les leviers sur lesquels s’appuyer ?
YS : La question de la ségrégation résidentielle se pose rapidement. Souvent pour se dire : “c'est à l'échelle de 10 ans et, aujourd'hui, on ne peut rien
faire”. Il y a pourtant des choses à faire.
On parle souvent de l’expérimentation toulousaine, avec la fermeture d'un collège très défavorisé socialement et l’envoi de ses élèves dans plusieurs collèges plus favorisés du centreville. Le résultat est très positif, mais il a fallu un accompagnement très important de la communauté éducative pour dépasser les préjugés, les réticences et régler les problèmes de transport par exemple.
On peut également réviser la carte scolaire et les modalités d’affectation dans ce but [comme dans l’expérience parisienne] . Cela étant dit, cela a pu provoquer des phénomènes d’évitement du secteur public et des inscriptions plus nombreuses dans le privé sous contrat.
Mais même s'il y a des moyens d’agir uniquement sur le public, il me semble assez illusoire d'espérer une modification significative du niveau de ségrégation scolaire en France, sans s'attaquer à cette question du privé. Il faut leur demander plus de transparence sur la composition sociale et le niveau scolaire des candidats et des élèves retenus et ainsi objectiver leur recrutement. Ensuite, on doit envisager de moduler leur financement public en fonction du niveau de mixité sociale qu'il y a dans ces établissements. Bien sûr, il est nécessaire de tenir compte du contexte résidentiel local, même si la question est complexe. C'est un débat qu'il est difficile d'avoir en France.
Schéma de l'hétérogénéité en fonction de l'IPS comparaison public / privé sous contrat


Des études montrent que davantage de mixité permet de réduire les préjugés et que des amitiés se créent entre personnes de différentes origines ethniques
Pourtant, quand on regarde à l'international, le statut du privé français est extrêmement privilégié. En Belgique, l’enseignement privé est largement subventionné, comme en France, mais n'est pas autonome dans le recrutement des élèves. En Angleterre, le privé n’est pas subventionné et le recrutement des élèves est libre. En France, vous avez le meilleur des deux mondes. Et donc, cette question de la modulation des subventions semble extrêmement importante.
De par leur caractère dynamique et créatif, les concours scolaires sont des initiatives pédagogiques intéressantes pour sensibiliser les jeunes aux questions de discrimination et d'égalité. Ils s'inscrivent dans le cadre de l’éducation aux valeurs de la République, notamment la laïcité, l'égalité et la fraternité.
Parmi les initiatives les plus emblématiques, on trouve le concours "La Flamme de l’égalité" , créé en 2016. Il invite les élèves, du primaire au lycée, à réfléchir sur la traite humaine, l’esclavage et leurs abolitions. Ce concours vise à développer une meilleure compréhension de l'histoire et de ses répercussions contemporaines, notamment les discriminations actuelles. Les participants sont encouragés à proposer des projets créatifs sous différentes formes (exposés, vidéos, œuvres d’art, etc.), en lien avec ces thématiques historiques, et à les présenter à un jury qui récompense les meilleurs travaux lors d’une journée nationale le 10 mai.

Leconcours "Les Petits Artistes de la Mémoire" , à destination des écoles primaires, propose aux enfants de travailler sur le parcours de vie des anciens combattants de la seconde guerre mondiale, incluant des réflexions sur les discriminations raciales subies à cette époque. Bien qu'indirectement lié au racisme, ce concours permet aux jeunes élèves d'aborder la question de l’enrôlement des hommes issus des anciennes colonies françaises.
D’autres concours scolaires contre le racisme sont mis en place plus localement en partenariat avec des fondations ou associations.
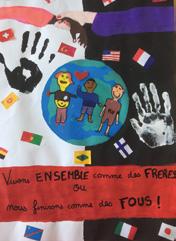
C’estle cas de la Fondation Seligmann, du nom de Françoise Seligmann, résistante puis défenseuse des droits humains décédée en 2013 qui, avec l’académie de Paris, récompense les élèves de plusieurs prix de 1.000€ dans le cadre de son concours "Vivre et agir ensemble contre le racisme".
Ainsi en 2023, les lycén.nes de Sainte-Genevièvedes-Bois ont réalisé un travail de recherche sur 36 personnalités issues de l’immigration qui ont contribué à la richesse et au rayonnement de notre pays sans avoir aucune reconnaissance publique.
Le recueil « Portraits de France » créé par les élèves leur rend hommage.
À Neuilly-sur-Marne, les élèves de CAP « réparation des carrosseries » ont réalisé une réplique de la voiture de Nelson Mandela. Ce travail a permis le lien entre savoir-faire professionnel et le travail de mémoire contre le racisme.
ÀLyon, le prix Gilbert-Dru porté principalement par la Licra et le centre historique de la résistance et de la déportation a récompensé les élèves de CM2 de l’école Mazenod pour une chorégraphie à l’occasion du dévoilement de la plaque commémorative en hommage aux enfants scolarisés dans l’école et déportés durant la seconde Guerre mondiale.
Lieu de mémoire
L’année 2025 sera marquée par la commémoration des 80 ans de l’ouverture du camp d’Auschwitz le 27 janvier 1945 par l’armée soviétique, à laquelle sera associé le Mémorial de la Shoah. Lieu de médiation essentiel pour la transmission aux futures générations, le Mémorial a ouvert en 2005.
Centre de documentation ouvert aux enseignants et chercheurs, le Mémorial qui possède un important fonds documentaire (documents, ouvrages, photographies, dessins, films…) collecte continuellement et met à disposition de tous, via un portail numérique, ses archives sur l’histoire des génocides ; celui des Juifs lors de la seconde guerre mondiale mais aussi celui des Arméniens de l’empire Ottoman entre les années 1915-1920 et celui des Tutsis au Rwanda au printemps 1994.

Lieu de rencontres, le Mémorial propose aussi des expositions dans et hors les murs, comme l’exposition « Paris 1924-2024, les jeux olympiques miroir des sociétés » qui aborde les questions de toutes les discriminations et de tous les préjugés, y compris dans le sport de compétition.
En 2023, plus de 500.000 personnes, ont participé à ses différentes activités, en France sur ses différents sites (Paris, Drancy, Chambon sur Lignon, Orléans, Pithiviers…) dont 140.000 scolaires. Les actions à destination des élèves sont portées par

un service pédagogique formé d’une dizaine de professionnel·les, mais le Mémorial s’adresse aussi directement aux enseignants.
Comme l’indique Alban Perrin, coordinateur du service formation au Mémorial, rencontré pour l’occasion : « Nous sommes conventionnés avec le MEN, les Rectorats, les INSPE et l’enseignement agricole et organisons chaque année plus de 150 actions par l’intermédiaire des plans académiques de formation. L’an passé ce sont plus de 8.000 professionnels qui ont été formés ; enseignants du premier et second degré mais aussi des professions plus variées telles que journalistes, travailleurs sociaux, élèves magistrats, policiers et gendarmes ».
Les actions de formation du Mémorial peuvent conduire aussi sur les lieux mêmes de la déportation et de l’extermination. Au total, 13 voyages d’étude au camp d’Auschwitz-Birkenau ont été organisés en 2023, à destination d’enseignants français, en plus de ceux organisés pour les scolaires (2.000 élèves) et le grand public (700 personnes).
Mémorial de la Shoah à Paris 17, rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris www.memorialdelashoah.org
Le parcours militant de… Dominique Sopo

Qui pourrait prédire la date de dissolution de SOS Racisme parce que sa raison d’être n’existerait plus ? Sûrement pas Dominique Sopo qui préside l’association depuis près de vingt ans.
Pas prêt d’arrêter son combat, dans cette vague réactionnaire qui traverse notre société. La montée de l’extrême droite autorise des mots, des ambiances, des passages à l’acte. Alors, SOS Racisme poursuit inlassablement sa mission, agit contre les haines racistes. Des actions menées par des militants qui vont qui viennent, dans une histoire transmise par les ainé.es, dont son président. Portrait.

Dominique Sopo avait huit ans quand est né SOS Racisme en 1984. Enfant à Valenciennes, né d’un père congolais et d’une mère française, il ne se souvient pas avoir subi des insultes racistes. Mais avec la montée progressive du Front National, et la popularité grandissante de Jean Marie Le Pen, les remarques racistes se propagent et son père en est victime, lui qui est devenu français par naturalisation. Ses parents s’intéressent à la vie politique, la commentent, sont électeurs de François Mitterrand. Transmission de socialisation de gauche.
Arrivé à Paris pour des études à Sciences-Po, il rencontre assez vite le syndicalisme étudiant, qui dans les années 1990 est très vivace. « A l’époque, quand on s’engageait dans un endroit, ça ouvrait plein de connexions », de l’UNEF-ID au Jeunes Socialistes, courant de la gauche socialiste, Dominique se souvient de sa première réunion politique animé par Jean-Luc Mélenchon. Puis de potes en potes, les coups de mains donnés aux organisations amies le conduisent à SOS Racisme. 2002 : coup de Trafalgar, Le Pen, père, arrive au second tour de la présidentielle face à Jacques Chirac. Un marqueur déterminant dans l’engagement de personnes de gauche. Passé le coup d’assommoir sur la tête, la réflexion pousse à l’action. « Je suis de gauche, je suis pour l’émancipation, si Jean-Marie Le Pen arrive au pouvoir, le racisme ne va faire qu’augmenter dans la société, il n’y aura plus d’émancipation possible, je dois combattre pour l’égalité. » Il prend alors la suite de Malek Boutih à la présidence de l’association, de 2003 à 2012.
Comme toute organisation qui survit dans le temps, SOS Racisme traverse des vents portants et des vents défavorables, avec de nombreuses figures de proue pour la faire exister. 15 octobre 1984, SOS Racisme est fondée. Sa création intervient un an après la « Marche pour l'égalité et contre le racisme ». Et c’est le temps des grands concerts, entrés dans la mythologie militante, pas des coups médiatiques mais des manières d’être ensemble, dans la joie, en métissage des publics. Messages artistiques et politiques, tous sont au rendez-vous, du président Mitterrand à Barbara en passant par Téléphone, Indochine ou Lavilliers. 800 000 personnes fêtent la diversité à la Concorde, puis à la Bastille, puis à Vincennes. Ça marque une génération, puis inspire les suivantes. 2024, 40 ans plus tard, elle est toujours présente dans le paysage politique. Car la lutte antiraciste est une lutte politique. Elle évolue mais demeure présente. Les jeunes racisés aujourd’hui vivants en France, sont français, leur lutte ne concerne plus le droit du sol. Ils
n’ont pas de problèmes de papiers, comme cela a existé par le passé. Alors SOS Racisme vit avec son temps, et oriente ses actions vers le testing*, les permanences juridiques, les interventions en milieu scolaire. Plus que jamais, elle poursuit son combat contre les idées d’extrême droite, dans la non-violence, mais en créant des buzz médiatiques. Comme ce fut le cas lors du meeting du candidat Zemmour à Villepinte en 2022.
SOS Racisme résiste à la crise du militantisme, phénomène répandu dans toute la société. « Nous avons une base militante composée de 18-30 ans, répartie sur tous les territoires, avec une assise nationale. C’est difficile aujourd’hui de maintenir du collectif, de la présence, de ne pas se contenter de militantisme du clic sur les réseaux sociaux. Les énergies militantes ne circulent plus, ça complique la vie des associations.» Mais la hargne raciste est virulente, il ne faut pas la mésestimer, et Dominique Sopo constate beaucoup d’irresponsabilité politique en face. Alors, il ne lâche pas son engagement, animé par le besoin de contribuer à l’émancipation des jeunesses, partageant son temps professionnel entre l’éducation par le métier de prof de SES en lycée, et la conduite d’une grande association.
Tous les cris, un seul SOS. Contre le racisme, dans un monde où le plus beau reste à faire.


Populaire depuis 1984, la petite main jaune de SOS Racisme a conquis l’espace et l’opinion publics par la mobilisation citoyenne. Depuis 40 ans, l’association promeut le « vivre ensemble » dans une tradition républicaine. L’association n’a jamais cessé d’initier des sujets de société, d’interpeller, de proposer et de manifester pour la construction d’une République métissée, tournant le dos à l’extrême droite et à la conception « communautariste » de la lutte antiraciste. Elle s’oppose à la haine raciste et xénophobe et défend l’idéal d’une société dans laquelle chacun a sa place à égale dignité, en mobilisant les énergies contre l’extrême droite, le communautarisme ou encore l’intégrisme. Ses principaux leviers d’action sont le droit, l’éducation et la culture.
*testing : ou test de discrimination, consiste à soumettre deux profils comparables pour une même demande en ne modifiant que la caractéristique (origine, handicap, âge, sexe…) susceptible d'exposer aux discriminations.

Ezzate Cursaz est conseillère technique et pédagogique au ministère des Sports depuis 23 ans. Ancienne athlète de haut niveau, elle nous livre sa vision de la lutte contre le racisme dans le sport de compétition.
> Ezzate, en tant que sportive de haut niveau d’athlétisme, as-tu été confrontée au racisme ?
E.C : Je vais peut-être surprendre mais depuis mon enfance, lorsque j’ai découvert différentes pratiques sportives dans le cadre des aménagements du temps de l’enfant à l’école primaire et sur les temps périscolaires, je ne me souviens pas avoir subi de manière directe ou indirecte des comportements racistes.
J’ai pratiqué l’athlétisme durant plusieurs années. On y trouve une reconnaissance positive des personnes issues d’origines africaines. J’ai toujours ressenti cette admiration sportive pour les athlètes issus d’Afrique ou des Caraïbes, cette reconnaissance d’être « naturellement supérieur ». On entend encore des thèses, dans lesquelles je ne me reconnais pas, défendant l’idée que ces athlètes caribéens, descendants d’esclaves, auraient des prédispositions génétiques. Par conséquent il serait normal qu’ils soient meilleurs sur le sprint par exemple. Pour moi, cela relève encore des théories de construction raciale du 19 e siècle visant à légitimer la discrimination entre les humains noirs et blancs.
Aujourd’hui, plusieurs sportifs européens du demi-fond vont s’entraîner sur les hauts
plateaux d’Afrique pour chercher à progresser. Beaucoup d’entre eux réalisent que ces nations africaines comme celle d’Éthiopie ou du Kenya sont performantes au vu des conditions géographiques, sociales et culturelles de leurs sportifs.
Comment le regard sur cette question d’une prédisposition « raciale » a évolué dans les fédérations ?
E.C : Pendant longtemps, beaucoup d’athlètes africains et caribéens gagnaient les courses et les compétitions. Ce qui confortait certains préjugés. Quand Christophe Lemaitre est devenu le premier athlète blanc à passer sous la barre des 10 secondes au 100m (9’92), des préjugés se sont effacés.
En tant qu’athlète, j’ai été plutôt préservée du racisme car la différence des origines ethniques est plutôt valorisée en fonction des disciplines. En France, nous accueillons dans nos clubs de nombreux athlètes de nationalités étrangères. Ces dernières années la fédération française d’athlétisme a dû revoir son règlement concernant l’accès de ces athlètes aux championnats de France. Aujourd’hui, tous les licenciés peuvent s’inscrire dans les compétitions, toutefois pour des raisons de sélection en équipe de France, les athlètes d’une nationalité étrangère ne sont plus autorisés à participer
au championnat de France Élite mais ils peuvent se qualifier au championnat de France Open. Lors des JOP (jeux olympiques et paralympiques) de Paris, nous avons pu voir une grande diversité de pays apparaître dans des disciplines. Les athlètes et les entraîneurs circulent de plus en plus d’un pays à un autre pour aller chercher les compétences techniques ou les infrastructures de haut niveau. Cela me conforte dans l’idée que le sport reste un peu moins exposé au racisme.
J’ai été plutôt préservée du racisme car la différence des origines ethniques est valorisée en fonction des disciplines.
Quels dispositifs ont été mis en place pour lutter contre le racisme dans le sport ?
E.C : Depuis plusieurs années, le ministère développe une politique en faveur des valeurs éducatives et citoyennes dans le sport. Il a décliné plusieurs dispositifs pour accompagner les fédérations françaises dans la lutte contre les discriminations. Un pôle ressource national « Sport éducation mixité et

citoyenneté » (SEMC) a même été créé en 2011 pour proposer des outils et accompagner l’ensemble des acteurs du sport sur ces sujets.
Un réseau de référents SEMC, des conseillers techniques et pédagogiques en services déconcentrés du ministère, a été mis en place et j’en faisais partie. Nous étions missionnés pour accompagner les clubs, les comités régionaux et les ligues de notre territoire à sensibiliser, à former les sportifs, les bénévoles, les dirigeants à la prévention des discriminations et notamment le racisme. Un bon nombre de disciplines sportives étaient engagées de manière importante, d’autres un peu moins. Malheureusement, ce pôle ressources n’existe plus. Aujourd’hui, il n’y a plus de référent dans les SDJES et DRAJES [services départementaux et délégations régionales académiques à la jeunesse, à l’engagement et aux sports]. Nous avons peu de moyens pour continuer à travailler le sujet avec nos partenaires.
Le racisme peut se manifester de différentes manières dans le milieu sportif. Des actes de violence verbale ou physique, des chants racistes dans les stades, des slogans ou des banderoles hostiles sont autant d'expressions de cette haine. Les athlètes victimes de racisme subissent souvent des humiliations publiques, ce qui peut avoir des conséquences dévastatrices sur leur moral et leur santé mentale. En outre, ce sont toutes les valeurs de citoyenneté et d’exemplarité qui sont mises à mal et qui nécessitent de faire passer un message urgent auprès des jeunes supporters. Si les pouvoirs publics de la jeunesse et de l’éducation s’emploient à lutter contre le racisme dans le sport, des organismes professionnels tels que la Fifa, l’UEFA [pour le football] ou la NBA [basket-ball] ont instauré des campagnes de sensibilisa-
tion et des politiques de tolérance zéro. Ces initiatives incluent des sanctions pour les clubs dont les supporters se livrent à des actes racistes, ainsi que des programmes éducatifs visant à promouvoir la diversité et l'inclusion.
Par ailleurs, des grands sportifs n’hésitent plus à prendre la parole et à utiliser les réseaux sociaux pour dénoncer l’inacceptable. Des mouvements tels que "Black Lives Matter" ont trouvé un écho dans le milieu sportif, incitant les athlètes à s'engager et à élever la voix contre l'injustice raciale. Une riposte est donc en train de s’organiser et de monter en puissance. Néanmoins beaucoup reste à faire pour garantir un environnement sûr et inclusif pour les athlètes et permettre que le sport soit un reflet de l'idéal d'égalité et de respect que nous aspirons à promouvoir dans notre société.
Agir par… la culture
L’association Alterégaux Isère mobilise l’action culturelle pour interpeller les jeunes et le grand public sur l’ouverture aux autres. Elle agit également auprès des personnes immigrées pour rompre l’isolement et le repli sur soi.
C’est suite à la rencontre d’acteur.rices impliqué.es localement, à Grenoble, dans la lutte contre le racisme et les discriminations, qu’est née, en 2012, AlterEgaux Isère. Cette association intervient dans les établissements scolaires, principalement dans les lycées et réalise des débats grand public dans les salles communales.
« Le travail sur la prise de la parole par les lycéens est le prétexte à l’expression argumentée, explique Michel Baffert, fondateur de l’association. Nous faisons appel à des intervenants quand il s’agit de sujets précis, comme la rhétorique de la haine, les maquisards nord-africains dans le Vercors avec le musée de la Résistance.
Un historien plus connu, Pascal Blanchard [spécialiste de l’Empire colonial français, ndlr] est également intervenu. Les élèves sont interpellés sur leurs propos, sans les juger, avec l’objectif qu’ils comprennent par eux-mêmes les préjugés, les clichés qu’ils peuvent souvent exprimer. »
L’actu prend le dessus
L’actualité s’invite aussi, assez souvent, dans les projets. Parmi les thèmes les plus fréquents figure notamment celui, tragique, des noyades de migrants qui tentent de traverser la Manche.
« La question est simple et toujours la même depuis des siècles :
Pourquoi les gens se déplacent-ils ainsi en masse ? demande Michel Baffert. J’aide alors les élèves à s’interroger sur ce qui peut motiver des gens attachés à leur pays et à leur famille à tout quitter au péril de leur vie. »
« Parvenir à faire jouer femmes et hommes dans une même pièce de théâtre est déjà un exploit en soi »
Pour être la plus concrète possible, la réflexion est toujours rapprochée d’une situation de terrain, de proximité. « Je fais le parallèle avec Grenoble et l’Isère dont la population d’origine étrangère est importante ».
Commémoration et théâtre
En outre, l’association œuvre et milite à travers de nombreuses autres manifestations. Un partenariat avec les musées de Bordeaux et Nantes la conduit
à participer chaque année, le 10 mai, à la commémoration de l’abolition de l’esclavage. Ce sont 600 personnes qui sont mobilisées.
Aux populations immigrées qui se sentent stigmatisées et ont le reflex du repli sur soi, Alterégaux Isère propose des activités de théâtre qui nécessitent de franchir d’autres obstacles culturels. « Parvenir à faire jouer femmes et hommes dans une même pièce de théâtre est déjà un exploit en soi », souligne Ali Djilali, metteur en scène pour l’association. Et pour faire face au racisme dont ils sont victimes, « nous les incitons à réfléchir sur leurs pratiques communes pour trouver les moyens de les mutualiser. Pour un européen, il n’y a pas de différence entre un guinéen, un sénégalais et un togolais ».
Ressource :
www.alteregauxisere.fr

Voyage scolaire
La ville de Nantes, un des hauts lieux de la traite atlantique, a réinvesti les quais d’où partaient les navires marchands de cette triste époque pour en faire un espace mémoriel à ciel ouvert, avec l’objectif de faire surtout « ressentir » aux élèves la réalité de l’esclavage négrier.
Inauguré à Nantes en 2012, le mémorial de l’abolition de l’esclavage est un site majeur consacré à la traite négrière. Il marque de manière solennelle et architecturale le rapport de ville à son passé de premier port négrier de France au 18e siècle et rend hommage à ceux qui ont lutté et luttent encore contre l’esclavage dans le monde. « Car il existe encore 40 millions d’êtres humains vivant dans la servitude », aime rappeler à ses élèves Raphaëlle, professeure d’histoire-géographie en collège à Nantes. Et de louer l’initiative de sa ville d’avoir réalisé ce projet urbain unique visant aussi à la méditation sur ces crimes et à appeler les générations futures à se mobiliser pour la solidarité et la fraternité.
Le monument est conçu « comme une évocation métaphorique et émotionnelle de la lutte pour l’abolition de l’esclavage » expliquent les artistes créateurs du mémorial, qui ont aménagé en une scénographie immersive sur plusieurs niveaux le quai d’où partaient les navires marchands chargés de leur inhumaine cargaison. Celui-ci est relié spatialement et symboliquement au palais de justice par la passerelle Victor Schœlcher, qui a fortement contribué à l’abolition de l’esclavage en 1848, comme pour affirmer la relation intrinsèque et fondamentale du quai au respect des droits de l’Homme.
Mise en scène émotionnelle
Le mémorial commence par un parcours commémoratif et se poursuit par un parcours méditatif constitué « de plaques de verre obliques qui plongent dans le quai et qui, à la fois, symbolisent la coupure de l’abolition, et proposent de cheminer à hauteur de fleuve, laissant imaginer ce que pouvaient ressentir les esclaves en cale », décrit Raphaëlle. Mise en scène émotionnelle donc qui vise à la rupture avec « une histoire qu’on croyait connaître », à la prise de conscience d’un contenu « souvent récité de manière automatique par les élèves ».
Et ce pan d’histoire de l’esclavage n’est pas sans surprise, bousculant bien des a priori chez les élèves. « Ils sont bien étonnés quand ils apprennent que certains noirs vendaient leurs congénères aux blancs, ça apporte de la nuance », évoque Solenn, autre

enseignante d’histoire-géographie. Mais d’évoquer sur cette thématique une masse d’informations difficile à faire passer en très peu de temps.
Aussi le mémorial nantais, par sa scénographie poignante, peut aider à mieux appréhender cette leçon du passé et en saisir toute sa gravité.

En ligne aussi, les propos et contenus (images, vidéos) racistes sont interdits par la loi et punis en fonction de leur gravité. Lorsqu'ils sont publics, les peines sont plus sévères.

Toute personne, victime ou témoin d'une publication sur internet incitant à la haine, à la violence ou à la discrimination peut faire un signalement à la police ou à la gendarmerie depuis la plateforme
PHAROS (Plateforme d'Harmonisation, d'Analyse, de Recoupement et d'Orientation des Signalements), cette plateforme est ouverte aux majeurs comme aux mineurs.
Il est déconseillé de partager le contenu, même à des fins de dénonciation, car cela contribue à sa diffusion.
Il existe d’autres solutions dont celle proposée par une association #jesuislà - Faire d’Internet un endroit meilleur qui organise des actions en ligne de lutte contre la haine et les discriminations en encourageant le civisme.
Chacun peut contribuer en fonction du temps dont il dispose via Facebook, X (ex Twitter) ou Instagram.
Concrètement la démarche est la suivante :
• des actions sont régulièrement proposées sur leurs comptes en réaction à des articles en ligne déclenchant des commentaires haineux (racistes, sexistes, homophobes…) ;
• il est proposé de répondre, de préférence directement à la publication d’origine, en apaisant le débat et en soutenant les victimes ;
• des éléments de contexte, des pistes d’argumentation et des points d’attention éventuels sont précisés dans le post qui lance l’action ;
• il suffit de suivre le lien indiqué, d’écrire un commentaire et de le terminer par #JeSuisLà ensuite il est important de liker tous les commentaires apaisants, on peut seulement liker si on n’est pas à l’aise pour commenter sur ce sujet ;
• c’est efficace, en effet quand on retourne sur le post quelques heures après le lancement de l’action, on ne voit plus les commentaires haineux mais ceux bienveillants et soutenants qui sont remontés grâce aux nombreux likes.
Une recherche* publiée en 2022 montre que le contre-discours généré par les citoyens est un moyen prometteur pour lutter contre les discours de haine et promouvoir un discours pacifique et non polarisé.
Les résultats obtenus suggèrent que le discours de haine organisé est associé à des changements dans le discours public et que le contre-discours, surtout lorsqu’il est organisé, peut aider à freiner la haine rhétorique dans le discours en ligne.
Alors pourquoi ne pas contribuer, chacun à sa mesure et en fonction de son temps disponible ?
*Garland, J., Ghazi-Zahedi, K., Young, JG. et al. Impact and dynamics of hate and counter speech online. EPJ Data Sci. 11, 3 (2022). https:// doi.org/10.1140/epjds/s13688-02100314-6

Enseignement supérieur & recherche
Le supérieur se mobilise contre le racisme à tous les niveaux ; par des référents sur les sites universitaires, des conférences et des journées de sensibilisation périodiques, des projets de recherche, la constitution d’un vivier d’experts, sans discrimination de discipline.
Les établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche, notamment les universités, ne sont pas étanches aux maux de la société et, malheureusement, racisme et antisémitisme s’y manifestent aussi ; parfois même avec une certaine violence. Les médias s’en sont fait l’écho durant ces derniers mois, en généralisant trop souvent des situations propres à quelques établissements. S’il faut condamner fermement ces faits, pour autant, ces lieux, qui sont par essence des lieux de savoirs et d’universalisme, s’organisent avec volontarisme dans la lutte contre ces discriminations.
Ainsi, depuis 2015 et le plan “Grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République”, les établissements universitaires se sont dotés d’un réseau de référent·es racisme et antisémitisme . Ceux-ci peuvent être sollicités par les étudiant·es et tous personnels auprès desquels ils relaient les différentes ressources et informations et mettent en œuvre des actions régulières contre le racisme et l’antisémitisme. Ce réseau, qui s’organise et se coordonne au niveau national, permet aussi aux différents plans nationaux de lutte (celui de 2018-20 et celui de
2023-26) de se matérialiser par des actions concrètes au niveau local. Par exemple, sur tout le territoire, les établissements d’enseignement supérieur participent activement à la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme sous différentes formes et via différentes manifestations.
Aux côtés de ces actions de formation et de sensibilisation, les équipes de recherche travaillent aussi à produire toujours plus de connaissances et de réflexions. On citera ici en exemple le réseau RRA : Réseau de recherche sur le Racisme et l'Antisémitisme qui, sous forme de structure fédérative de recherche, regroupe des unités de recherche, des universités, des associations et institutions pour favoriser la pluridisciplinarité et développer de nouveaux projets scientifiques. Ce réseau vise ainsi à fédérer des laboratoires autour de thématiques spécifiques, à répondre à des appels à projet et à mutualiser les compétences. En visant le renforcement des synergies, il
accroît la visibilité des travaux et facilite la diffusion de données scientifiques, établit des liens avec des institutions et associations citoyennes, propose une structure dynamique aux référents racisme, antisémitisme et laïcité, et constitue un vivier d’expert·es universitaires.
Ces différents exemples, il y en aurait bien d’autres, montrent que l’enseignement supérieur et la recherche prennent collectivement leurs responsabilités pour lutter contre le racisme et l’antisémitisme.

Pédagogie
La lutte contre les discriminations et le racisme a largement sa place dans les programmes de français du secondaire, souvent moins convoqués que l’histoire-géo et l’éducation morale et civique. Pourtant, les textes littéraires qui fourmillent de pépites sont un formidable levier pour sensibiliser les élèves par le prisme de la langue et l’expérience de la lecture.

Il est un fait que la réforme des programmes de collège de 2015 a facilité la chose. En organisant les séquences par des entrées humanistes (agir sur le monde, vivre en société-participer à la société, se chercher se construire...), c’est désormais à l’élève-lecteur que les manuels s’adressent plus qu’à l’élève sachant ses gammes : qu’est-ce que le roman, la poésie, le théâtre etc. Il est désormais expliqué au tableau que lire un texte qui met en situation un personnage, c’est d’abord « faire l’expérience de l’autre [le héros, le narrateur, ndlr], s’y intéresser ou s’y confronter parce que c’est quelqu’un qui nous ressemble ou qui est diffé -
rent de nous », explique Marie Musset, inspecteur d’académie IPR de lettres à Lyon.
Empathie fictionnelle
Le roman et le récit au sens large ont la vertu de « l’empathie fictionnelle » , notion qui tend à signifier que l’auteur nous invite à aller jusqu’ à « une rencontre avec ce qu’éprouve le personnage », « à ressentir ce qu’il ressent », « à nous mettre à la place d’autrui » . Une bonne manière de sensibiliser dès le plus jeune âge à la lecture, à la perspective que chaque livre est une aventure partagée où les peurs, les envies, les espoirs de l’Autre sont aussi les nôtres.
Par la fiction littéraire, « plus besoin de dénoncer, de dire l’humanisme, d’accompagner l’histoire », renchérit Marie Musset. Nous sommes plongés très directement dans l’expérience de la singularité et de l’universalité.
La littérature nous invite par d’autres chemins à cette même ouverture. Les auteur·es francophones hors de France par exemple nous montrent qu’on
Dany Laferrière, écrivain de langue française d’origine haïtienne, a été élu à l’Académie française en décembre 2013. « Comment faire l’amour à un nègre sans se fatiguer » est son premier roman.
peut parler la même langue et que celle-ci exprime pourtant une autre culture, un autre rapport aux mots et au monde, alors que la littérature étrangère traduite nous permet d’appréhender plus loin encore d’autres horizons, linguistiques, philosophiques, civilisationnels.
« Ces livres peuvent apporter des réponses aux élèves issus de la diversité »
Et là, on peut aisément évoquer la poésie, le théâtre ou des formes littéraires inconnues chez nous.
« Ces livres peuvent apporter des réponses aux élèves issus de la diversité » , conclut Marie Musset, citant nombre d’auteur·es issu·es de minorités ethniques pour qui écrire ne relève pas d’une volonté de revendiquer une identité mais bien d’une invitation à parcourir d’autres « univers » que celui des lecteurs non moins porteurs de sens et de valeurs. À nous d’apprendre à les lire et à les aimer.


Rodney Saint-Éloi
Yara El-Ghadban
Rodney Saint Eloi, né en Haïti est écrivain, tout comme Yara El-Ghadban, née en Palestine. Ils vivent dorénavant tous deux à Montréal. Ce livre engage le dialogue, fait appel aux expériences vécues par les deux écrivains. Ni manifeste, ni manuel, ni acte d’accusation : avec leurs plumes, les deux auteurs nous embarquent en réflexion contre les racismes.
« Le racisme d‘un regard est le plus perfide qui soit, il ne parle pas, il ne frappe pas, il n’émet pas d’insultes audibles, il est là, son destinataire ne saurait s’y tromper. C’est une sensation qu’aucune personne non-victime de discrimination ne peut connaître parce que ça ne fait pas partie de son expérience du monde. »

HABITANT DE NULLE PART, ORIGINAIRE DE PARTOUT
Souleymane Diamanka
La voix pleine de sourires et pleine de larmes
Sincère comme ce père noir qui repart en pleurs d'un parloir
J'ai eu la chance quelque part d'avoir été sauvé par l'art oratoire
Ce volume se compose des textes de l'album L'Hiver peul mais aussi de nombreux poèmes inédits de Souleymane Diamanka. L'auteur jongle avec les mots, les fait "métisser". Sa poésie prêche l'oralité, apparie avec finesse ses cultures peule et européenne, parce qu'il est fier d'être "habitant de nulle part et originaire de partout", dépositaire d'un chant intemporel, d'un appel à l'amour, à la tolérance et à la connaissance de l'autre.
Laura Nsafou - Barbarun Brun

« Adé est une jolie petite fille à la peau noire, aux grands yeux bruns et aux cheveux afro. Une chevelure magnifique et fournie, qui lui vaut néanmoins de nombreuses moqueries à l’école, les autres enfants lui disant notamment qu’ils ont l’impression qu’elle a « comme un million de papillons noirs sur la tête ».
Littérature jeunesse pour, avec beaucoup de tolérance, parler du harcèlement dont peuvent être victimes les enfants noirs à l’école et dans leur quotidien. Un livre, lu, discuté, commenté peut amener les enfants nonnoirs à déconstruire les préjugés qu’ils pourraient avoir, tout en leur permettant d’apprendre à s’aimer dans une société en grand manque d’inclusion.
Michel Wieviorka

On peut, ici, paraphraser Corneille et dire que la valeur d’un livre ne se compte pas à son nombre de pages. Il suffit ici au sociologue Michel Wieviorka de 146 pages, d’une écriture enlevée et d’un jeu habile de questions-réponses pour démonter les idées fausses et même parfois le complotisme qui touchent les Juifs. Cette version mise à jour décortique également l’attentat du 7 octobre et ses conséquences. Cet ouvrage permet assurément non seulement de comprendre les racines de l’antisémitisme, mais aussi d’en percevoir les contours et les évolutions, de réfléchir à son explosion en France aujourd’hui.
À présent si on vous demande, « Pourquoi les Juifs sont-ils l’objet d’une haine particulière ? », « Pourquoi Hitler détestait-il les Juifs ? » « L’antisionisme, est-ce de l’antisémitisme ? » Existe-t-il un « business de la Shoah ? », vous ne botterez plus en touche et aurez des arguments solides à avancer.
Sa forme aérée et son chapitrage permettent aisément d’y piocher des informations qu’on soit adolescent.e ou adulte. Un livre sérieux mais pas barbant, très accessible et efficace à lire dans le métro, dans son transat ou dans son bain mais à lire !
d'éduc


Questions d'éduc. :
une revue de l'UNSA Education thématique, numérique et gratuite qui aborde sous différents angles, et avec des regards complémentaires, une question d'éducation
https://www.unsa. org
Abonnez-vous !
questionsdeduc@unsa-education.org pour recevoir " Questions d'éduc. " directement dans votre boîte mail
Pour retrouver les anciens numéros c'est ici : https://urlz.fr/8SB1




