




























































































Savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va. Le 30 août 1944, L’union champenoise sortait de la clandestinité le jour de la Libération de Reims. Quatre-vingts ans plus tard, L’union s’invite chaque matin dans le quotidien de nos lecteurs. Huit décennies que nos journalistes arpentent la Marne, l’Aisne, les Ardennes, pour rendre compte le plus dèlement possible de la vie de nos territoires, de leur dynamisme, grands témoins des évolutions de notre temps, oreilles attentives de nos interlocuteurs, plumes agiles qui, sans concessions, érigent l’information comme un rempart face aux obscurantismes. Il y a nos jours et nos nuits, esclaves d’une information qui ne s’arrête jamais, témoins du meilleur comme du pire. Il y a aussi ces maillons essentiels à la vie d’un journal, des métiers de l’ombre sans qui L’union ne serait rien. Il y a les nuits blanches des rotativistes, celles des colporteurs de presse, qui vivent chaque soir une course contre la montre pour livrer à temps nos exemplaires dans votre boîte aux lettres ou chez vos marchands de journaux. Un cycle permanent qui ne s’arrête jamais, nous emmène dans le tourbillon de la vie de nos villes et de nos villages. Et qui tisse peu à peu le l de notre histoire, riche de vos histoires.






Géraldine Baehr-Pastor
Directrice générale de Rossel Est Médias






Notre histoire
Les grandes dates
La naissance d’un journal
Les enjeux pour notre entreprise 2024 : les coulisses du quotidien
L’album souvenirs
Les Unes historiques
Les coups de cœur de nos photographes
Ces reportages ont marqué leur carrière
Vous et nous
Le journal a changé leur vie
Paroles de lecteurs
Fan de la première heure
Des personnalités parlent de L’union
Savoir d’où l’on vient, c’est prendre le temps de cultiver l’héritage du passé pour maintenir l’existence du débat démocratique et prendre part à la vie de nos territoires. C’est surtout préparer l’avenir et vous donner, chaque jour, les clés de compréhension du monde qui nous entoure. Grâce à la consolidation de nos activités sur de nombreux supports – papier, sites, applications, newsletters, TV digitale –, nous rendons l’information toujours plus utile, complète et accessible à nos 350 000 lecteurs quotidiens. Plus que jamais, nous nous engageons pour un journalisme toujours plus exigeant, utile, incarné, vivant et porteur de solutions. Nous défendons un pluralisme qui porte toutes les voix, toutes les actions, tous les combats. Et ils sont nombreux. Pour le maintien du bien vivre ensemble, ici, maintenant. Pour les générations futures face à la jungle des réseaux sociaux, proies faciles de la désinformation. Pour nos modèles économiques face aux Gafa qui pillent nos contenus et font régner les algorithmes sur nos vies. Les dé s sont nombreux pour continuer à exister dans ce monde en perpétuel mouvement, alors que les intelligences arti cielles viennent à nouveau bousculer la donne. S’adapter, toujours, grandir pour faire de ces menaces de véritables opportunités, et tenir bon parce que cette aventure est formidable. Elle nous rend ers de l’héritage laissé par des compagnons qui luttèrent pour un monde libre. Aujourd’hui, nous sou ons bien plus que nos bougies, c’est un vent d’espérance pour l’avenir de la presse, qui s’annonce riche et passionnant. Vive L’union !
Savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va.
Nos dé s
Du papier au numérique
Des projets innovants
Un média engagé sur son territoire
De nouveaux leviers de croissance
Supplément gratuit au journal L’Union
Éditeur de la publication : journal L’Union
Directeur de la publication :
Géraldine Baehr-Pastor
Rédacteur en chef : Arnault Cohen
Rédaction et photos : L’union Régie publicitaire : Global Est Médias, 4-6 rue Gutenberg, 51100 Reims. CPPAP n° 0425 C 86339. Imprimé sur les presses du journal l’union, 6, rue Gutenberg, Reims. Provenance du papier : France, Suède. Merci à Hervé Chabaud, Sébastien Lacroix et Didier Louis, anciens rédacteurs en chef de L’union ainsi qu’à Gilles Grandpierre, ancien grand reporter, pour leurs précieuses contributions. Merci également au comité départemental de l’O ce National des Combattants et des Victimes de Guerre pour la labellisation de notre supplément dans le cadre du 80e anniversaire de la libération.
80ANS LIBÉRATION DE LA


1er Mai 1944
Distribution du remier numéro clandestin de L’union champenoise.
27 Septembre 1945
Le journal L’union est constitué en une Société à responsabilité limité (SARL) avec douze associés copropriétaires.
14 Mars 1965
La première femme de l’espace, la cosmonaute soviétique Valentina Terechkova, est reçue à L’union avec son mari également cosmonaute, le colonel Andrian Nikolaïev.
10 Novembre 1970
L’union publie, en pleine journée, une édition spéciale sur la mort du général de Gaulle.
4 Mai 1977
Pour le 10 000e numéro de L’union, le président de la République, Valéry Giscard d’Estaing, adresse un message au personnel du journal et à tous ses lecteurs.
















4 Avril 1943
Au café Le Petit Sapeur, les représentants de plusieurs mouvements de la Résistance prennent l’engagement de faire paraître un organe baptisé L’union.
30 Août 1944
Le journal de la Résistance L’union champenoise s’installe dans les locaux de L’Eclaireur de l’Est 87-91, place Drouet d’Erlon à Reims.
23 Novembre 1963
Après l’assassinat du président démocrate des Etats-Unis, John F. Kennedy à Dallas, le n°5903 de L’union se vend à 196 260 exemplaires, un record.
25 Mars 1967
Le chanteur Charles Aznavour s’arrête à L’union où il est reçu par Pierre Bouchez, l’un des six directeurs-gérants.
“Je suis heureux d’être reçu par le grand journal de Reims”, con e-t-il.
25 Novembre 1971
Robert Hossein donne son premier spectacle à Reims, “Crime et Châtiment”, dont il a livré la genèse à L’union.
C’est un événement national.






14 Janvier 2013
Le groupe belge Rossel rachète L’union qui est intégré dans le groupe Rossel Est Médias, avec L’Ardennais et L’Est-éclair. Une politique de modernisation et de diversi cation est engagée pour répondre aux nouvelles attentes tant sur le papier que sur les supports numériques.
26 Décembre 1999
Alors que la tempête du siècle cause des dégâts considérables, L’union regroupe ses journalistes en particulier à Reims où il y a de l’électricité pour assurer la parution des toutes les éditions du journal.
18 Juin 1987
La rotative Super Gazette, installée rue Gutenberg remplace la Wifag de la place d’Erlon pour l’impression de L’union.
15 Juillet 1985
Philippe Hersant, directeur du groupe France-Antilles, présente devant le comité d’entreprise de L’union un plan de reprise qui sera accepté par le tribunal de commerce.
Janvier 1983
Les six membres du conseil de gérance décident de transférer le pouvoir à une seule personne, Jean-Pierre Jacquet, nommé gérant unique de L’union.







Juillet 2002
Le quotidien quitte ses locaux historiques de la place Drouet-d’Erlon à Reims pour ceux de la rue de Talleyrand. En 2013, il s’installe au 14, rue Edouard-Mignot.
Mars 1992
Le groupe Hersant rachète L’Ardennais à L’Est républicain.
27 Février 1986
Coluche accorde une interview exclusive à L’union pour le lancement des Restos du cœur.
2 Novembre 1984
Le célèbre acteur américain
Peter Falk, alias Columbo, invité du Festival du Polar, s’arrête à L’union et remercie chaleureusement tout le personnel pour l’accueil qui lui a été réservé.
























Printemps 2020
L’union se met en éditions Covid-19 en raison de la pandémie qui s’installe.
27 Février 2021
Christian Lantenois, reporter photographe à L’union et L’Ardennais, est violement agressé au cour d’un reportage à Reims.
Septembre 2022
Lancement #tanews, univers éditorial dédié aux centres d’intérêts des jeunes, leurs préoccupations et envies.
5 Février 2014
Premier cahier spécial “Guerre 14-18” pour le centenaire de la Première Guerre mondiale dans L’union. Ce rendez-vous est maintenu jusqu’à n décembre 2018.
Décembre 2020
Déménagement à la Médias Factory, 6, rue Gutenberg, Reims.
3 septembre 2021
Lancement de la TV digitale sur le site de L’union.
Février 2023
Création de Terres de champagnes avec un univers sur nos sites entièrement dédié à l’actualité du champagne, à ceux qui le font et à ceux qui l’aiment.
Terres de champagnes couvre l’ensemble de l’aire d’appellation. C’est aussi une newsletter hebdomadaire.
3 zones de di usion
Aisne / Ardennes / Marne
7 éditions
Ardennes, Soissons, Laon, Epernay, Vitry-le-François, Reims, Châlons-en-Champagne lunion.fr et 1 application
236 salariés
124 journalistes 2024
64 000 exemplaires / jour


1 site internet
1 TV digitale
272 430 visiteurs uniques / jour
La création d’un journal est une aventure formidable. Quand elle survient au sortir de la Seconde Guerre mondiale, cela devient un événement historique. La naissance de L’union, le 30 août 1944, est à classer dans cette catégorie. Quatre-vingts ans plus tard, nous avons eu envie de vous raconter une histoire d’amour qui est née au même moment que notre titre.
Il est grand, blond, souriant, toujours bien droit sur sa bicyclette. Il salue les voisins mais ne s’attarde pas, entre au 21, rue de Sousse à Reims et ferme vite la porte. Depuis le mois d’avril 1944, il réside dans cette modeste maison bien cachée par une haute palissade en bois où a été discrètement installée une imprimerie clandestine. On le dit ébéniste et il donne le change. Sur son porte-bagage, il y a quelques morceaux de bois et plusieurs outils. Toujours les mêmes. À y regarder de plus près, ses mains ne sont pas celles d’un travailleur manuel. Serge Labruyère, le jeune instituteur de Venizel dans l’Aisne, a été mis à l’abri dans la Marne. Membre du réseau de la Fédération unie des jeunesses patriotiques, il a déjà participé à plusieurs opérations de récupération d’armes et est considéré en danger par ses chefs. Comme à Reims, Marcel Dalan, qui
allemande, a demandé du renfort, on lui a trouvé l’homme qu’il lui faut. Traqué la ville.
À peine arrivé, Serge Labruyère retourne à l’école. Victor lui enseigne le métier d’imprimeur et mieux vaut pour l’instituteur qu’il apprenne vite car son professeur est exigeant et lui met la pression. Il le convertit en typo-conducteur

et le charge de préparer le premier numéro du journal clandestin du Comité départemental de libération, destiné à être distribué le 1er mai. C’est au cours
proche de l’usine à gaz rémoise, qu’Henri Bertin de Ceux de la Résistance (CDLR), Raymond Guyot de la Section française de l’internationale ouvrière (SFIO) ont, au
Grande-Bretagne, les trois autres dans un camp de concentration nazi lorsqu’il s’agit de rédiger le premier numéro. Ce sont Michel Sicre, président du Comité départemental de la Libération, assisté d’Henri Kinet du Front national, du socialiste Robert Duterque, d’Edmond Forboteaux de Libé -Nord qui s’en chargent.
Avec sa collection de caractères 6 subtilisés dans une imprimerie rémoise par des ouvriers résistants, fort de plaques de linoléum en provenance directe de la Sarlino pour graver les titres, et une Minerve à pédale, une machine rudimentaire au cliquetis discret au contact de la presse avec la galée, Serge Labruyère s’applique. Inexpérimenté, il doit recommencer plusieurs fois avant d’obtenir une feuille imprimée double face, lisible et présentable qu’il tire à cinq mille exemplaires.


Retrouvez Hervé Chabaud vous raconte la grande histoire de l’union en vidéo en ashant ici
Imprimer c’est bien. Di user c’est mieux. Marcelle Tissier dit banco. Cette jeune femme arrivée de Montceau-les-Mines en Saône-et-Loire, département qu’elle a dû fuir parce qu’elle y était activement recherchée, a passé sept semaines à Dijon et s’est ennuyée. Elle est volontaire et impatiente d’être dans l’action. On lui a créé une nouvelle identité : Evelyne Martin auquel s’ajoute un nom de code, « Nadia », et un surnom a ectueux, « Zoubinette ». Pour accomplir sa tâche, elle dispose d’un vélo d’homme, transformé en bicyclette de femme par le garagiste de Port-à-Binson, de deux sacoches et d’une remorque. On lui xe un rendez-vous un soir d’avril dans un café près de l’église Saint-Thomas. On lui désigne un grand jeune homme blond qui dîne seul : « C’est ton fournisseur. » Si le jeune homme est présent les jours suivants à la même table, cela signi e que des exemplaires du journal clandestin l’attendent dans l’arrière-cuisine.
Ils ne doivent pas avoir de contacts, ce qui ne dérange pas Marcelle Tissier : « Il m’avait été tout de suite antipathique, trop beau et trop sûr de lui », con ait-elle en 1984 parlant de Serge Labruyère avec son accent incomparable de Saône-et-Loire.
Elle fait des dizaines et des dizaines de kilomètres pour distribuer le journal, met en place des « sous-dépôts », comme sous le tas de pommes de terre de l’épicier rémois Vannelet.
Pourtant, à la Libération, Zoubinette est prête à devenir Mme Serge Labruyère ! L’amour est passé par là. Ils se snobaient. Ils sont devenus inséparables. Un vrai roman. Une belle histoire.
Par Hervé Chabaud

distribué le premier
Si le jeune homme est présent les jours suivants à la même table, cela signifie que des exemplaires du journal clandestin l’attendent dans l’arrière-cuisine.

L’excellence
française
dans chaque détail !

03 26 49 04 21
Par Hervé Chabaud
La première édition de L’union, gratuite, a été publiée et distribuée le jour de la Libération de Reims, le mercredi 30 août 1944.
D’une feuille clandestine, « L’union champenoise » devient un journal ayant pignon sur rue ! Le jour de la libération de Reims, le mercredi 30 août 1944, une édition gratuite est distribuée. Elle est austère parce que sans photographie mais la « une » annonce sur toute sa largeur l’événement du jour : la libération de Reims et l’accueil chaleureux des Rémois aux troupes alliées et aux résistants qui ont concouru à ce grand moment.
Il y a aussi la volonté de s’inscrire dans la continuité de la République française incarnée par le gouvernement provisoire à la tête duquel se tient le général de Gaulle. Avec la di usion de deux messages dans la même présentation et sous le même format, celui du commissaire de la République Grégoire Guiselin, qui représente l’Etat, et celui du Comité de la Libération de la Marne qui est présidé par Michel Sicre et réunit les di érents mouvements clandestins de la Résistance qui, par leur engagement, ont contribué au grand jour vécu par les Rémois et depuis quarante-huit heures par d’autres Marnais.
Seule nuance, Guiselin conclut par « Vive le général de Gaulle, Vive la République, Vive la France », Michel Sicre par : « Vive les Alliés, Vive la France ». Désormais « L’Union champenoise » se substitue à « L’Éclaireur de l’Est », journal qui a collaboré et est interdit de parution.




















































Par Hervé Chabaud
De la Libération à juillet 2002, L’union a trôné sur la place d’Erlon, à Reims, dans un immeuble de caractère. Quatre-vingts ans plus tard, après trois déménagements, votre journal regarde vers l’avenir dans un bâtiment à l’architecture ultra-moderne, la Factory, où tous les métiers se côtoient et travaillent ensemble pour vous informer.
De la place Drouet-d’Erlon en passant par la rue de Talleyrand, la rue Gutenberg puis la rue Edouard-Mignot avant de s’installer à nouveau rue Gutenberg dans la Factory, le journal a connu plusieurs déménagements. Rien à voir entre l’immeuble de caractère d’un généreux classique occupé jusqu’à la Libération par « l’Eclaireur de l’Est » au 87-91, place Drouet-d’Erlon et l’actuel bocal futuriste aux baies vitrées alignées, si ce n’est l’expression d’une architecture évolutive où s’activent les équipes aujourd’hui.
De la Libération jusqu’à la mi-juillet 2002, « L’union », s’a che sur la place centrale de Reims qui, au l du temps, perd ses voitures au pro t d’un immense parking souterrain et d’un espace minéralisé d’où surgissent, alignés, quelques arbres pourvoyeurs de verdure et d’ombre. On se précipite alors dans la galerie d’accès du quotidien dont les vitrines sont tapissées d’images d’actualité en provenance du monde entier, comme des photos des manifestations locales dont le journal s’est fait l’écho. C’est aussi le passage obligé de toutes les personnalités qui font une visite de courtoisie au deuxième étage, au conseil de gérance, puis dans la bibliothèque. Le protocole le veut ainsi.
Lorsque le rez-de-chaussée est restructuré pour initier un accès central s’ouvrant vers les étages, l’ambiance change. Dans le même temps, l’impression en centre-ville est abandonnée au pro t d’un centre de fabrication en zone Colbert, rue Gutenberg, selon le choix du groupe France-Antilles en 1985.
Le 14 juillet 2002, une partie de la rédaction et l’ensemble des services administratifs, de la publicité et du marketing s’installent à l’angle de la rue de Talleyrand et de la rue de Vesle à deux pas du théâtre et du palais de justice. Les services techniques mais aussi les services des informations générales, des sports et de la coordination rédactionnelle prennent leurs quartiers dans un nouveau bâtiment érigé au 6, rue Gutenberg auprès de l’imprimerie. C’est une première dans la répartition éclatée des forces vives qui font chaque jour le journal.
En juin 2013, le siège du journal est transféré au 14, rue Edouard-Mignot dans un immeuble d’angle avec la rue de Courcelles, jadis siège d’une enseigne de magasins à succursales multiples. Tout y est organisé en plateau avec de vastes espaces impersonnels où les services travaillent côte à côte. L’impression demeure à Gutenberg. Néanmoins, l’idée de regrouper tous les services dans un nouveau bâtiment s’appuyant sur quelques éléments structurants du précédent et adossé à la nouvelle rotative est validé.
Début 2021, « L’union » regroupe toutes ses forces à la « Factory », nouvelle vitrine du titre. L’open space y règne en maître, chaque salarié n’a plus une place attitrée mais un casier et un caisson mobile, tandis que l’informatique s’est renforcée et les téléphones xes ont disparu. Une adaptation pour mieux répondre aux nouvelles missions dont le groupe Rossel, qui a repris « L’union » en 2012, a dé ni pour stimuler ses di érents supports d’information.










20% DE REMISE sur les poêles INÈS sur modèles en stock


En sac de 15kg 100% résineux Din plus VENTE DE PELLETS *Quantité
















Président du Groupe Rossel
Président du groupe belge Rossel, Bernard Marchant estime que L’union a bien évolué depuis son rachat en 2013. Mais qu’il doit encore s’adapter pour attirer de nouveaux lecteurs.
Par Valérie Coulet
epuis 80 ans, L’union est le premier et son département, et il doit le rester média dans sa ville
L’union fête ses 80 ans. Comment ce titre, que votre groupe belge a racheté en 2013 au groupe français Hersant, se porte-t-il ?
Un travail de fond a été mené par phases et l’entreprise a bien évolué, de façon dynamique et positive, dans un contexte social apaisé et volontariste. Aujourd’hui, le titre se trouve en bonne position pour assurer sa transformation pour le futur, dans un écosystème en changement profond. L’union est plutôt bien positionné par rapport aux autres titres, à l’extérieur et à l’intérieur du groupe. Chez nous, il est d’ailleurs considéré comme un modèle à suivre. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire.
Quels sont ses points forts et ses points faibles ?
Ses points forts sont son ancrage local et la qualité de ses contenus, ainsi que la relation de con ance avec le lectorat, qui a été recréée et qui est extrêmement importante. Dans les points forts, il y a aussi, grâce à l’environnement de travail mis en place, une bonne transversalité, ce qui est fondamental. Les équipes éditoriales, marketing, de la régie publicitaire et du back-o ce travaillent bien ensemble. Il y a une bonne dynamique. Par ailleurs, L’union fonctionne de façon autonome. Il peut réinvestir ce qu’il génère.
Il faut maintenant accélérer les e orts sur le digital. Car il est extrêmement important d’aller chercher un lectorat plus jeune et de rajeunir la relation au lecteur. On sait qu’il faut le faire grâce à des outils complémentaires et de miser sur la multidi usion : journal papier, liseuse, site…
L’union était-il très en retard au niveau digital par rapport à vos autres titres ?
Disons que les marchés ne sont pas au même niveau de maturité. Il est vrai que plus on se trouve au nord de l’Europe et plus les marchés sont numérisés. Si L’union n’était pas en avance dans ce domaine, un e ort a été fait tant au niveau éditorial qu’au niveau de la régie publicitaire. Aujourd’hui, il

y a une accélération de cette numérisation et c’est une bonne chose. Il faut rattraper le retard tout en gardant le bon équilibre.
Depuis 80 ans, L’union est le premier média dans sa ville et son département, et il doit le rester dans des plateformes multimédias. On a la chance d’avoir une radio – Champagne FM – qui est un bon vecteur de communication mais il y a un e ort à faire sur la vidéo, en trouvant le bon modèle. Les journalistes de presse ne doivent pas devenir des journalistes audiovisuels mais la vidéo doit enrichir leur capacité à raconter de belles histoires.
L’union a été le premier de vos titres à lancer, il y a trois ans, sa télé digitale. Quel bilan dressez-vous ?
On lance ce genre d’initiative pour deux raisons. La première, c’est pour enrichir notre o re au lecteur. La seconde, c’est pour transformer l’entreprise et donc amener les salariés à travailler avec ces nouveaux formats. En réalité, on teste des choses par souci de l’innovation. Car notre métier, c’est d’informer mais également d’innover.
Quelle est la recette pour qu’un titre de presse comme L’union continue de se vendre ?
Et quel modèle économique préconisez-vous pour qu’il reste rentable ?
Le monde change plus vite qu’avant et le citoyen a parfois du mal à s’y adapter. Avec le phénomène de surcommunication, les gens ont des difcultés à appréhender de façon apaisante ce qui se passe dans le monde, surtout s’ils s’informent par les réseaux sociaux. Notre travail est d’apporter des ltres grâce au prisme journalistique, en expliquant, analysant… Au fond, notre rôle est d’aider notre lectorat à ne pas subir mais à devenir acteur de l’information.
Pour mener cette mission tout en restant rentable, il faut construire un écosystème. Mais dans ce domaine, il n’y a malheureusement pas de règle. On doit tracer notre route en étant si possible aidés par les régulateurs. Car notre écosystème ne doit pas être mis à mal par des outils d’intelligence arti cielle qui pilleraient nos contenus sans que l’on soit rémunéré.
Une entreprise comme la nôtre doit être agile et performante tout en véri ant que les règles du jeu soient respectées par les di érents acteurs. Si tout se met bien en place, L’union sera encore présent pour au moins les 80 prochaines années !
Si beaucoup d’informations sont gratuites sur Internet, la grande majorité des articles digitaux sont payants.
Comment donner envie aux gens de payer ?
Autrefois, les fausses informations circulaient dans les cafés, aujourd’hui cela se passe sur les réseaux sociaux. On peut d’ailleurs parler d’une industrie de la désinformation. Si l’on veut que les gens paient pour nous lire, ce qui est indispensable, nous devons construire de bons contenus, utiles aux lecteurs. Ces derniers doivent avoir conscience de la valeur ajoutée.
Il faut d’ailleurs bien ré échir à la façon dont on vend un journal car les gens font la comparaison avec leur abonnement Net ix ou Spotify. Je répète souvent que les trois critères les plus importants pour les équipes sont la compétence, la passion et la curiosité. Et pour que les gens entrent dans le magasin, notre vitrine doit être attractive.
De nombreux journalistes et lecteurs ont peur de l’intelligence arti cielle et redoutent un nivellement par le bas. Quelle est votre position ?
Il n’y a aucune raison d’avoir peur si, plutôt que de subir l’intelligence arti cielle, on l’utilise de façon intelligente. Comme on ne doit pas créer ce que l’on craint, il faut apprendre à maîtriser et à gérer la machine. Car si on ne le fait pas, d’autres l’utiliseront mieux que nous et on risque alors de perdre la bataille. Quand on regarde en arrière, on aurait pu avoir peur d’énormément de choses. Mais l’être humain a su s’adapter. Les nouveaux dé s permettent d’avancer.












16 & 17 NOVEMBRE






Par Florentin Grandjean
Journalistes, commerciaux, graphistes, photographes, éditeurs…
Plusieurs centaines de personnes issues d’une dizaine de métiers différents travaillent chaque jour pour produire un journal et animer l’information sur nos différents supports (web, réseaux sociaux).

6h30
La Factory, le siège de L’union à Reims, s’éveille. Ce sont les journalistes du service web qui arrivent les premiers. Leur objectif : mettre en avant sur nos sites et nos réseaux sociaux l’actualité de la nuit ainsi que celle du matin, à un horaire où vous êtes très nombreux à vous connecter. Il s’agit également d’anticiper ce qui va faire l’actualité du jour qu’elle soit locale, régionale, nationale ou internationale. Il faut être à l’a ût des sujets qui marchent déjà bien, airer ceux qui vont monter en puissance dans la journée. L’idée est d’avoir sur nos sites et applications une variété de thématiques qui puissent ainsi proposer à chacun, tout au long de la journée, de piocher selon ses envies du moment : locale, sports, politique, économie, loisirs, consommations, champagne, people, Lifestyle mais aussi des jeux, quizz… L’équipe du web n’est évidemment pas seule pour proposer tout cela. Elle peut s’appuyer sur des dépêches de l’Agence France Presse mais surtout sur l’ensemble des journalistes de Rossel Est Médias soit 165 personnes entre L’union, L’Ardennais, L’Est éclair et Libération Champagne (350 000 visiteurs uniques en moyenne chaque jour sur nos sites)
9h00
Si les équipes sont déjà arrivées un peu avant, cet horaire marque le véritable lancement de la journée que ce soit au siège à Reims mais aussi dans les di érentes agences (Châlons-en-Champagne, Épernay, Vitry-le-François, Sézanne, Sainte-Ménehould, Laon, Chauny, Hirson, Soissons, Château-Thierry, Charleville-Mézières, Sedan, Fumay, Rethel et Vouziers). C’est le moment clé de la réunion des di érents services.
Web, locale, reportage, photographe, vidéo, sport… chacun se réunit avec la même priorité : déterminer quelle est l’actualité du jour, le traitement des sujets, leurs angles (la façon dont on va en parler), qui va s’en occuper, leurs déclinaisons sur le web, en vidéo et ensuite dans le journal. On anticipe aussi à ce moment-là les dossiers à venir. L’ensemble est coordonné ensuite par le rédacteur en chef du jour, tout ce qui a été décidé à cette heure pouvant être remis en question à n’importe quel moment de la journée en fonction de l’actualité.
Place ensuite aux reportages. Seuls, ou avec un photographe, les rédacteurs partent sur le terrain pour véri er une information, interviewer des personnes, suivre une conférence de presse, rendre compte de belles histoires comme des drames plus personnels. La richesse de notre métier est de pouvoir dans une même journée rencontrer des personnes très di érentes, traiter de sujets très variés avec à chaque fois le souci de mettre en avant les témoignages et ce qui préoccupe nos lecteurs au quotidien.
Le traitement de ces sujets peut se faire en direct en liaison avec le web lorsqu’il s’agit par exemple de faits divers où d’informations importantes à partager rapidement. Dans d’autres cas, les journalistes rentrent ensuite à la rédaction pour rédiger leurs articles qui sont ensuite mis en ligne puis déclinés dans le journal papier.
15h30
Les équipes dites « du soir » arrivent. Ce sont les personnes qui vont se charger de gérer la mise en page et le bouclage du journal jusque 00h30. Ce sont elles également qui prendront le relais des équipes du web à partir de 20 heures pour animer les sites et les réseaux sociaux. C’est tout une nouvelle chaîne qui se met en place pour compléter et accompagner le travail des rédacteurs qui se poursuit dans les locales ou au siège.
18h00
La réalisation des Unes. Entre les di érentes éditions de L’union et L’Ardennais, ce sont huit Unes di érentes qui sont faites chaque soir. Le choix des sujets, des titres, des photos se fait en amont avec les chefs de chaque édition puis les arbitrages sont réalisés à 18 heures par la rédaction en chef avec la personne qui monte les Unes. L’objectif est à chaque fois de mettre en avant la richesse du contenu de nos éditions avec des sujets locaux en priorité évidemment mais aussi nationaux voire internationaux quand l’actualité l’exige. Un soin particulier est mis dans la « mise en scène » de ces Unes avec un travail graphique réalisé dès que cela est possible.






C’est l’heure du bouclage et de l’envoi à l’impression de nos premières éditions. Distance du siège de Reims oblige, c’est L’Ardennais, puis L’union Ardennes qui partent en premier sur les rotatives. Suivront ensuite à partir de minuit les éditions de l’Aisne puis à partir de 0h30 celles de la Marne. Sauf actualité particulière qui nécessite un décalage de l’impression, il n’est plus possible à partir de ces horaires de changer quoi que ce soit dans le contenu du journal.
La vie continue au siège de L’union. Une fois les journaux imprimés ils sont en e et expédiés par di érents canaux. Des camions emportent ainsi les journaux chez les dépositaires de presse de chaque département qui ensuite les redispatchent vers les marchands de journaux et les porteurs (ceux qui livrent les journaux chaque matin dans les boîtes aux lettres). À Reims, les porteurs viennent directement chercher leurs journaux au siège. La gestion des abonnés postés est également assurée depuis Reims. Chaque nuit ce sont une dizaine de personnes, tous les services confondus, qui sont mobilisées pour assurer le bon fonctionnement des rotatives et de l’expédition du journal.
SCHMIDT Cormontreuil

Elle est la vedette de L’union et en impose par ses dimensions : longue de 80 mètres, elle tourne à 75 000 exemplaires par heure, 362 jours par an. Elle ? C’est la rotative GOSS Uniliner S. qui en impose dans le bâtiment de 8000 m2 spécialement construit pour l’abriter en 2008. Star du journal, sa puissance, sa beauté font à coup sûr un e et boeuf. Bichonnée, mise en route, nettoyée chaque jour par une équipe de près de 40 personnes, la rotative est le coeur qui bat au sein de l’imprimerie, une véritable ruche parfaitement rôdée qui fait naître chaque jour les 100 000 exemplaires des journaux de Rossel Est médias (L’union, L’Ardennais, L’Est éclair, Libération champagne et d’autres titres du groupe Rossel). C’est un ballet parfaitement orchestré et minuté, qui opère chaque nuit un travail minutieux et une course contre la montre 362 jours par an pour que les services des expéditions prennent le relais avant le départ des journaux pour leurs points de vente ou chez nos abonnés. Des évolutions, l’imprimerie en a connu depuis 80 ans (lire ci-dessous) pour passer de la typographie à l’o set. « Cette transition vise à moderniser nos méthodes tout en optimisant la qualité et la rapidité de nos productions », explique William Carducci, directeur adjoint du centre d’impression. « L’o set présente plusieurs avantages par rapport à la typographie traditionnelle. En premier lieu, cette méthode permet une reproduction plus précise des images et des textes, avec une qualité constante sur de grands tirages. De plus, elle o re une meilleure gestion des couleurs et une plus grande souplesse en termes de supports d’impression. Ce changement nous permettra également de réduire les coûts de production, tout en maintenant un haut niveau de qualité pour nos clients »
Les rotatives seront ouvertes au public et se visiteront le vendredi 4 octobre dans le cadre de l’opération Visite ma boîte initiée par le groupe Rossel Est Médias.
Visite sur inscription en ashant le QR Code

Que d’évolutions pour le typographe !
La rotative en chi res
E ectifs quotidiens :
7 personnes par nuit à la rotative, 3 à l’expédition, 2 à la maintenance.
Production 7 jours/7 et 362 jours par an (sauf 24 décembre, 31 décembre et 30/04 veille du 1er mai)
100 000 exemplaires en couleur par jour
50 000 exemplaires de nos hebdomadaires et journaux gratuits 11 éditions
4 500 tonnes / an de papier recyclé
1 bobine papier = 1 300 kg
11 tonnes de papier par nuit en moyenne
80 tonnes d’encres par an
290 000 plaques en alu soit 73 000 m2 par an
Entré à l’époque du plomb, et ayant arrêté à celle du numérique, Dominique Berger, en 44 ans de carrière, commencée en 1974 à l’époque du plomb, celle-ci s’est achevée en 2013 à l’ère du numérique. « Ça a commencé avec le lecteur optique, se souvient Dominique, par ailleurs correspondant de notre titre à Cormontreuil. On peut dire que ça correspond à notre scanner d’aujourd’hui, cela permettait de composer les lignes de caractères en plomb automatiquement à partir d’une feuille écrite tapée à la machine.
C’était en 1975. »
1975 est d’ailleurs une année vraiment notable, puisque c’est elle également qui a vu le début du « montage papier ». « Auparavant, le montage était très manuel, résume notre témoin : il fallait disposer les lettres en plomb que l’on sortait de petits casiers en bois, la casse, dans ce que l’on appelle un composteur, sorte de règle ajustable, aussi bien pour les titres que pour les textes. Cela demandait du temps, donc il fallait du monde. » Dominique
Berger se souvient qu’à cette époque, L’union faisait travailler en tout quelque 700 personnes !
« Auparavant, le montage était très manuel : il fallait disposer les lettres en plomb dans un composteur… »
Tout se faisait donc à la main. Puis, la mécanisation est venue en aide, sous la forme de la linotype, grande machine à l’ancienne avec engrenages, tirettes, renvois d’angle et autres courroies de transmission, et surtout munie d’un clavier, évoquant celui d’une machine à écrire, permettant de sélectionner les caractères uniquement par des actions du doigt. Dominique parle du tournant du montage papier, mais la disparition du plomb s’est faite progressivement. De même que celle des typographes euxmêmes, professionnels que l’informatique a rendus inutiles. Car leur tâche consistait à disposer les éléments sur les feuilles à imprimer : titres, textes, photos et publicités. Maintenant, c’est l’ordinateur qui fait tout ça.

Du 30 août au 30 septembre 2024

SAVEZ-VOUS QUE LA BIOÉCONOMIE EST DÉJÀ
UNE RÉALITÉ DANS VOTRE QUOTIDIEN ?


Énergie, cosmétique, emballage, pharmaceutique... : venez découvrir ces produits, fabriqués à partir de végétaux ou de matières venant des animaux.
100 événements gratuits pour tout comprendre !
d’Infos +

P ar Arn a ult C ohe n

Chaunu propose ses dessins de presse à L’union depuis une vingtaine d’années. Avec beaucoup de gourmandise, d’ailleurs, considérant que notre journal fait preuve d’une grande liberté dans le choix des dessins. Il y voit comme un héritage de Cabu, qui a fait ses premiers pas de dessinateur de presse dans L’union, chez lui, à Châlons
NNNe lui demandez pas quand il a commencé à dessiner dans L’union. Les dates, ce n’est vraiment pas son truc. N’essayez pas non plus de savoir comment il est entré dans notre journal. Il se souvient juste avoir découvert L’union dans le Quid, que seuls les plus de 50 ans peuvent connaître, quand il cherchait à tout prix des journaux où vendre ses dessins d’actualité. La gravure du
Nous sommes en 1986, Chaunu – Emmanuel de son petit prénom – a 20 ans et rêve de devenir dessinateur de presse. Il candidate dans tous les journaux de France.
S’il ne sait plus vraiment quand et comment il s’est retrouvé à dessiner pour L’union, Chaunu a parfaitement en tête son premier
commence alors. Une belle aventure.
Aujourd ’hui, Chaunu dessine pour une dizaine de journaux régionaux du pays. Depuis sa Normandie de cœur, où il réside, il caricature l’actualité avec acuité et humour, avec une productivité démentielle. Chaque soir, il envoie jusqu’à une vingtaine un large choix de dessins.
de suite senti à L’union une liberté dans le choix des dessins qu’il n’y avait pas ailleurs. J’envoie des esquisses plus ou moins percutantes et le choix dépend de l’audace du rédacteur en chef. Les autres journaux sont plus timides que vous, ils ont peur
faites des choix plus percutants, plus osés. Il y a une patte, c’est À l’écouter, cette impertinence dans les choix de dessins semble relever de la tradition, de la ligne éditoriale. Et elle aurait une Châlons. C’est peut-être ça, l’explication. À L’union, vous n’avez pas peur du dessin de presse, vous aimez le dessin de presse. Ce n’est pas toujours le cas, beaucoup de journaux s’en moquent. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi vous aviez cette
nouveau monde, celui où la jeunesse a pris le pouvoir. Cabu, c’est un homme qui respectait le lecteur, les petites gens. Cabu, c’est un trait d’une grande précision. Mitterrand, Giscard, Dorothée, le Beauf étaient dessinés avec une très grande précision. Cabu, c’est un artiste populaire de très grande valeur. Très peu de dessinateurs de presse sont entrés dans l’H istoire, malheureusement de manière tragique [dans l’attentat de Charlie Hebdo]. Avec Charb et
Fermez le ban.
ous l’aurez constaté, votre journal est bien évidemment constitué de photos et d’articles. Mais au l des pages se trouvent aussi des publicités, essentielles au modèle économique du journal.

Anne Colas est la directrice de Rossel Conseil
Médias Est : l’agence de communication et médias du Groupe Rossel La Voix basée sur La Marne, l’Aisne, les Ardennes et Aube. Sa mission est de vous accompagner dans l’élaboration de vos plans de communication.
Les marques médias du Groupe (L’Union, l’Est Eclair, Libération Champagne ou L’Ardennais) et d’éditeurs externes nous permettent de vous proposer un relais médias puissant et a nitaire pour vos campagnes notamment au local et en proximité avec votre cible.
« Notre mission, c’est d’apporter des solutions à nos clients, les orienter vers une stratégie de communication, écouter leurs besoins en leur proposant tout un éventail de produits (vidéos, contenu, encarts publicitaires…) » déclare Anne Colas.
Nos équipes vous proposent le bon mix médias pour les ampli er de la manière la plus optimale.
Forte de son expertise et de l’audience de ses supports, Rossel Conseil Médias
Est se met au service de la communication des professionnels d’activités variées (entreprises, commerces, institutions, concessions automobiles, grandes distributions, centre de formation, etc.) Nos experts vous conseillent
et vous accompagnent dans la réalisation de vos campagnes publicitaires sur-mesure, ciblées et adaptées à vos besoins, de la stratégie à la di usion de vos campagnes sur nos titres de presse quotidienne régionale et au-delà dans des environnements contextualisés.
55 collaborateurs
3 279
Clients accompagnés en 2023
29 110
Campagnes réalisées en 2023
PUBLI-REPORTAGE




Par Carole Gamelin
« «
Elle est entrée à L’union le jour de ses 20 ans. Trente-huit ans plus tard, Béatrice Lempereur, assistante de la rédaction se dévoue toujours aux lecteurs de nos journaux.
Trente-huit ans de maison ! Toute une carrière au service du journal et de ses lecteurs. Béatrice Lempereur est la dèle assistante de rédaction de L’Ardennais. Née dans l’Aisne au sein d’une famille de 6 enfants, arrivée à Charleville-Mézières à l’âge de trois mois, ayant toujours vécu dans les Ardennes, Béatrice est une ne connaisseuse du département.
Autant dire que pour la rédaction de L’Ardennais, elle est une source inépuisable d’informations. Et pourtant rien ne destinait notre collaboratrice au monde de la presse.
Tout juste diplômée d’un BTS en secrétariat de direction, Béatrice est entrée chez nous par hasard en 1986. « J’ai pris connaissance d’un poste au détour d’une conversation. Je me suis présentée à L’union pour passer des tests de sténo-dactylo. Ils m’ont rappelée le jour de mes 20 ans pour me dire que j’étais prise ».
À l’époque, L’union est installée rue de Mantoue. Quand, six ans plus tard, le journal rachète son concurrent L’Ardennais, direction le Cours Briand et « Le Château », là où étaient installées la rédaction et l’imprimerie du journal.
Accueil téléphonique, relations avec nos correspondants, nos lecteurs et nos informateurs : les missions sont variées et c’est ce qui plaît à Béatrice. « J’ai fait ma place. J’aime faciliter la vie de l’agence », résume-t-elle.
Au point de devenir un véritable pilier de l’équipe. « 38 ans, nalement c’est passé très vite ! Je ne me suis jamais ennuyée parce que dans la vie d’un journal, il y a toujours de l’imprévu et j’aime l’adrénaline », avoue celle qui confesse avoir un grand plaisir à échanger avec les journalistes.
J’ai grandi avec le journal, c’est ma deuxième famille
Des souvenirs, elle en a plein la besace ! Elle a vécu le choc des grands événements de l’histoire : « la chute du mur de Berlin, les attentats du 11 septembre, le Bataclan et bien sûr Charlie Hebdo. Je me souviens de cette photo que nous avions prise dans la rédaction avec notre a che « Je suis Charlie » et les rassemblements partout en France ». « J’ai grandi avec le journal, c’est ma deuxième famille », dit-elle. Une famille durement éprouvée par la perte ces dernières années de Valérie Léonard et David Zanga, deux journalistes de L’Ardennais. « Leur disparition m’a énormément marquée », murmure Béatrice.
Nouvelle étape dans une carrière déjà bien remplie : le déménagement des

toujours de l’imprévu








bureaux de L’Ardennais du Cours Briand vers la gare. Une nouvelle page qui l’inspire : « l’endroit est lumineux, très passant. On voit plus de monde ! », s’enthousiasme-t-elle.
Amatrice de lms avec de belles histoires « sans castagne », fan inconditionnelle de Jean-Jacques Goldman, Béa partage son temps entre L’Ardennais et sa maison de Flize. Mariée et mère de trois lles et d’un garçon, mamie-gâteau très présente pour Julia et Abel, elle aime les balades en forêt avec son chien.
À cinq ans de la retraite, notre che e de tribu sait déjà qu’elle restera dans les Ardennes. Elle compte ensuite devenir bénévole à la Croix-Rouge. Rendre service, toujours.






























TREIZIÈME EDITION



hèle Gérard a été correspondante du journal sur le secteur de Vertus, à la fin des les reportages et l’écriture l’ont remonter la pente.
«Lle plus « insolite », quand elle a donné « un cours de sténo » à Maitre Gims. Françoise Lapeyre a « beaucoup donné à L’union – le soir je carburais au Red Bull et aux rondelles de saucisson », mais ne regrette rien. « J’ai beaucoup appris et vécu tellement de choses…”
nard Legran d

es gens me demandaient de couvrir un événement. Une fois que j’avais dit oui, je ne pouvais plus revenir en arrière. Alors, je me préparais avec soin, je me
e a aidé Michèle Gérard à sortir d’un état dépressif photo des résidents de la maison de retraite, les dames se
«En 1987, Martial Gayant venait d’être Maillot jaune sur le Tour de France. Dominique Delers, journaliste à Hirson, voulait le rencontrer. Il était accompagné de Bernard Hinault. Nous les avons rencontrés ensemble et puis il m’a dit : « tu t’y connais mieux que moi, tu vas faire le papier. » C’est comme ça que j’ai commencé, d’abord pour le vélo, puis les autres sports et petit à petit pour le reste de l’actualité locale. »
Bernard Legrand s’est vite pris au jeu. « Ce qui est intéressant, c’est d’aborder tous les sujets ». Il se souvient des dimanches sportifs où il dictait son texte par téléphone à une sténo rémoise de L’union. Depuis près de 40 ans, il assure son activité avec le soutien précieux de son épouse Annick. Bernard Legrand a aussi été porteur de journaux pour L’union à Hirson. « Je me levais tous les matins à 4h30 pour mettre dans les boîtes aux lettres de 80 à 100 journaux, puis je partais travailler et le soir je faisais mon ac tivité de correspondant. Quand il neigeait, on faisait la tournée à pied avec Annick. » L’union fait la force.

l’Éducation nationale à la presse régionale, il n’y avait qu’un pas que Paul franchi allégrement en devenant correspondant pour L’union, à Laon.
aul Lefèvre a découvert notre titre en 1950… sur les genoux de son re. « Il me faisait découvrir le Tour de France avec L’union sur la table ». Il également de celui que tout le monde appelait Lulu dans le village de stribuait le journal aux habitants. « L’union était toujours à la maison. » est avec sa casquette de directeur du Centre départemental de ion pédagogique et de délégué axonais du Centre pour l’éducation et à l’information qu’il a participé à la mise en œuvre à L’union du e Jeunes reporters qui impliquait des collégiens dans la rédaction s. Ce lien étroit avec notre quotidien l’a conduit vers la correspondance nées 2000. « La presse crée du lien avec les gens. Ce qui m’a toujours ns cette activité de correspondant, c’est la diversité des interlocuteurs
Son nom restera attaché aux portraits qu’il proposait à nos lecteurs chaque , sans imaginer qu’il en écrirait pas moins de 500 !
Vous êtes passionné(e) par l’actualité locale et avez un goût prononcé pour l’écriture ?
Rejoignez notre équipe en tant que Correspondant(e) de Presse ! postuler@lunion.fr
Devenez CORRESPONDANT
Envoyer votre CV à
st-ce que vous pouvez vous asseoir à l’arrière parce que sur le siège avant je mets les journaux ? » Lorsque je rejoins Isabelle, je comprends très vite qu’être vendeur colporteur de presse (VCP), c’est être très organisé. Il est deux heures du matin lorsqu’on se rejoint sur Sedan. Le rendez-vous est donné à ce qu’on appelle « le dépôt ». Les colporteurs attendent un livreur qui débarque du siège de l’Union à Reims avec les journaux. Parfois, 5 minutes, parfois un peu plus. Car actualité oblige, et problèmes informatiques parfois, la livraison du journal peut avoir quelques minutes de retard. Une fois arrivé, tout s’enchaîne. Les colporteurs se servent dans l’arrière de la camionnette. Pour la Sedanaise, âgée de 55 ans et colporteuse depuis 9 ans, ce matin-là, il va falloir distribuer 247 éditions de l’Ardennais, une trentaine de l’Union Ardennes, di érents magazines distribués via la société Speed groupe et des quotidiens nationaux comme Le Monde, via la liale Nordispress. Des chi res qui ne lui font pas peur, puisque ça peut monter parfois « à 290 notamment les samedis », nous con e-t-elle.
Raison pour laquelle il faut être bien organisée : retirer les liens en plastique qui entourent les di érents journaux, faire des piles. et préparer le trousseau de clés qui comporte les nombreux badges et clés pour accéder aux di érents immeubles. « J’ai un peu l’impression d’être passe-partout. » Il est moins de 2h30. « La tournée, je la connais par cœur. Elle a très peu changé en neuf ans. Parfois, je teste un nouveau sens, mais sinon j’ai mes petites habitudes », explique Isabelle. Avant de partir, la VCP a tout de même véri é son carnet de route. «Le soir, on reçoit sur notre téléphone le détail de la tournée du jour, c’est globalement la même, mais il faut quand même être attentif aux déménagements, à ceux qui sont abonnés que le week-end etc ».
Première maison à distribuer. Ici, pas de di culté particulière, la boîte aux lettres est accessible. Isabelle a « juste » à plier le journal puis à le glisser. Pareil pour le voisin, également abonné. Il faut ensuite remonter dans la voiture et la déplacer de quelques

Par Margaux Plisson
mètres. En moins de dix minutes, plus de 20 journaux ont été distribués à 20 adresses di érentes.
Heureusement, ça ne circule pas beaucoup. « Toute façon, avant, j’étais convoyeuse de véhicules. J’allais parfois en Italie, en Espagne ou en Irlande. Donc, la route je connais. »
Même si, elle l’avoue, la n de l’éclairage public début 2023 n’aide pas à bien repérer les boîtes aux lettres. « Cette maison-là, par exemple, j’ai toujours cru qu’elle était rose et puis un jour, je suis repassée en plein jour et je me suis rendu compte qu’elle était orange. »
Ce genre d’anecdotes, la VCP en a plein : « Je pourrais écrire un livre ! » Entre les petites rues qu’elle a découvertes, le papy qui attend en peignoir son journal tous les matins à 7 heures, la fois où elle a appelé la police pour une voiture en feu ou encore la fois où elle a failli se faire mordre par un chien… Mais le temps le et il n’y a pas de temps à perdre. Après Sedan, direction Wadelincourt, avant un nouveau passage sur Sedan notamment à la « ZUP » où les journaux à distribuer sont nombreux : « Il y a des immeubles où je dépose 8/9 journaux », avant de terminer à Floing.
Si le trajet paraît court, environ 50 kilomètres, Isabelle met plusieurs heures à le faire. Et pour cause, la VCP s’arrête environ tous les 50/100 mètres, même si parfois il su t de bien s’y prendre pour ne pas avoir à descendre de la voiture. « C’est mon remplaçant qui m’a montré comment il fallait s’y prendre, c’est-à-dire qu’il faut bien connaître la largeur de sa voiture », ironise-t-elle.
Là où elle perd le plus de temps, c’est une petite ruelle à Floing. « Je suis obligée de couper le moteur et de marcher, j’ai compté un jour, ça fait 216 pas ! » Mais c’est aussi, au petit matin, car les voitures et les bus s’ajoutent à la circulation. Il est d’ailleurs environ 7h30 lorsqu’Isabelle termine sa tournée. Elle passe à la boulangerie chercher sa baguette quotidienne, avant d’aller se coucher à l’heure où la ville se réveille et découvre les actualités du jour.


360 vendeurscolporteurs depresselivrent chaquejour nosjournaux aux abonnés.







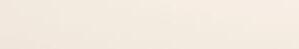





Par Aurélie Beaussart
C’est à Reims que la signature de la reddition a eu lieu dans la nuit du dimanche 6 au lundi 7 mai, pour un arrêt des combats fixé au 8 mai, à 23h01. À l’heure dite, les Allemands ont signé un nouvel acte de capitulation à Berlin. C’est cette dernière date que l’Histoire a retenue.
La une du numéro 215 de L’union est barrée par un grand titre : « L’Allemagne a capitulé ». Rapidement suivi par : « C’est à Reims que la signature de la reddition a eu lieu lundi à 2h41 ». Le tout accompagné de la photo du collège technique où fut donc signée la capitulation. 79 ans plus tard, la façade n’a guère changé. Le bâtiment est toujours un lieu d’étude. Le collège technique est devenu le lycée Roosevelt. Aujourd’hui, Olivier Lubineau, le chef de l’établissement le reconnaît volontiers : « Ça fait forcément quelque chose même si on n’en parle pas au quotidien. Les élèves de seconde, chaque année, visitent le musée de la reddition, étroitement imbriqué au lycée, a n de replonger dans l’histoire, et de bien comprendre ce qui s’est passé ici, dans ses murs. D’autant que lorsque l’on voit la salle des cartes, baptisée War Room par les Anglais et les Américains, on a l’impression que le temps s’est arrêté, que la signature s’est déroulée la veille. » Il y a 79 ans, le quartier général d’Eisenhower avait ainsi investi une partie des locaux du collège moderne technique mais les cours n’avaient pas été interrompus pour autant. Dans le hall d’entrée du lycée, on trouve la photo prise, à quelques mètres de là, dans la War Room témoignant de la signature de la reddition mais aussi, un monument aux morts dédié aux deux Guerres mondiales, et également le drapeau Rhin-Danube, que le Souvenir Français a tenu à o rir l’an dernier à l’établissement scolaire et qui jusqu’à présent était en dépôt au musée de la reddition.


Par Gérard Kancel
Le Stade de Reims remporte son premier titre de champion de France le mercredi 1er juin 1949 lors d’une rencontre initialement prévue le dimanche 29 mai.
Il y a plus de monde que d’habitude, pour un jour travaillé, sur la place d’Erlon en ce mercredi 1er juin 1949. À la sortie des bureaux et des usines, plusieurs dizaines de personnes ont convergé vers l’entrée des locaux du journal L’union.
C’est que l’heure est historique pour le Stade de Reims, club né en 1931, rouge et blanc depuis 1938. À Sète, avait débuté à 15h un match qui devait désigner le vainqueur du championnat 1948-1949 de Division 1. Disputée initialement le dimanche 29 mai, la confrontation avait été stoppée à la mi-temps par l’arbitre, le terrain des Métairies ayant été transformé en bourbier par des pluies orageuses.
La belle a aire pour les joueurs d’Henri Roessler menés 1-0 au moment de l’arrêt. Perdus comme des âmes en peine et partis pour laisser le titre à un autre faute de maîtriser leurs nerfs dans les moments décisifs. Cela avait été déjà le cas un an auparavant où Albert Batteux et ses coéquipiers s’étaient écroulés, à Saint-Etienne, alors que le championnat 1948 leur tendait les bras en cas de victoire.
Les Stadistes vont interpréter cette interruption provoquée par les vannes célestes comme un signe favorable et se refaire un moral de vainqueurs. De toute façon, ils n’ont pas le choix : Lille est repassé devant au classement et seul un succès fera d’eux des champions.
Cette fois, les Champenois ne rateront pas leur entrée en matière et mèneront à la pause sur un terrain encore boueux. Pierre Sinibaldi a ouvert le score très tôt (2e) et si son équipe n’a pu éviter la réaction des Dauphins sétois (égalisation de Koranyi à la 6e minute), elle aura trouvé les ressources nécessaires pour reprendre un but d’avance par André Petit ls juste avant la mi-temps (44e). Cet avantage, les visiteurs vont le protéger pendant une seconde période qui leur semblera avoir duré une éternité…
Le lendemain, plusieurs milliers de Rémois attendront évreusement jusqu’en milieu d’après-midi le retour du train où a pris place la délégation stadiste.
La fête va durer plusieurs jours pour les joueurs et leurs supporters. Comme au temps des sacres royaux !
Groupama s’engage à former 1 million de Français aux gestes de premiers secours.



21 juillet 1969
L’aventure Apollo 11
















































































À 3h56 du matin, les Français et le reste du monde découvrent les images en noir et blanc des premiers pas des hommes sur la Lune. Un exploit historique qui fait la Une de L’union le 21 juillet 1969.
«Le rêve de l’humanité est en n réalisé. » Dans la soirée du dimanche 20 juillet 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont les deux premiers hommes à marcher sur la Lune.
À 384 000 kilomètres de là, sur Terre, c’est l’émulation. Avec l’avènement de la télévision, de nombreux Français ont pu voir les images en direct dès 3h56 (heure française), une heure tardive qui n’a pas empêché les journaux d’en faire les gros titres dès le lendemain. Dans son édition du 21 juillet 1969, L’union propose trois pages dédiées à ce qui reste comme l’une des plus grandes prouesses de l’humanité.
Benjamin Poupard, directeur adjoint du Planétarium de Reims, revient sur cette une astronomique. « Il y a un exploit technologique et humain exceptionnel. Mais ce qui est le plus important à l’époque, c’est le symbole que représente ce voyage. Encore aujourd’hui, 55 ans après, la Lune reste le point le plus lointain qu’ont atteint les hommes. La mission avait aussi un objectif scienti que, c’est grâce aux échantillons récupérés par les astronautes qu’on a pu déterminer comment la Lune s’est créée. »
« La mention de Jules Verne dans le titre du journal est intéressante, car entre la mission Apollo 11 et le roman de ce dernier, il y a beaucoup de coïncidences. Comme la durée du voyage, 4 jours dans les deux cas, ou encore la base de lancement : dans son livre, l’écrivain français fait décoller ses voyageurs de la Floride, à quelques kilomètres de l’actuel Cap Canaveral. L’autre point à souligner est le manque de photos dans les journaux. Malgré la di usion en direct à la télé, il faudra attendre le retour des trois astronautes pour développer les pellicules prises sur la Lune, et en n avoir les photos désormais restées célèbres. »






























/Marie-Pierre Duval
6 juin 1977


















































Juin 1977, les ouvriers des VMC sont en grève depuis plusieurs jours. Après une tentative de délogement par la garde mobile, c’est un commando de la Confédération française du travail qui débarque dans la nuit du 5 au 6 juin, deux hommes ouvrent le feu, deux hommes seront blessés, le troisième, Pierre Maître, touché à la tête, mourra quelques heures après.
Six juin 1977, la nouvelle s’est répandue comme une trainée de poudre dans le milieu syndical rémois : un ouvrier des Verreries Mécaniques Champenoises (VMC) vient d’être tué lors d’un piquet de grève. « Nous étions en grève depuis plusieurs jours, se souvient Jean-Claude Boulben, secrétaire général de l’Union syndicale des retraités CGT. Nous réclamions un 13e mois pour tous, nous avions une prime annuelle, mais elle se faisait à la tête du client ! » La plupart des salariés des VMC sont alors en grève.
« Le 29 mai, la garde mobile était venue nous déloger, sans résultat », poursuit le délégué au comité d’entreprise de l’époque.
Ce soir du 5 juin, Jean-Claude Boulben est devant l’usine. « Une voiture est passée avec des gars qui ont arraché des banderoles. À ce moment, je peux vous dire que de la charbonnette a volé ! » Les charbonnettes étaient ces gourdins de bois que les ouvriers utilisaient pour allumer les fours. Quelques heures après, un nouvel équipage arrive devant l’usine, cette fois ses occupants ouvrent le feu, trois ouvriers sont touchés. Deux hommes sont blessés, Pierre Maître, touché à la tête, mourra peu après. Il avait 31 ans.
« Là, tout s’arrête, la direction veut ouvrir les négociations mais la CGT a imposé d’attendre après les obsèques. » Le 10 juin, 50 000 personnes se retrouvent au cimetière de l’Ouest, parmi elles, Henri Krasucki « mais aussi Georges Séguy, le secrétaire général de la CGT, rappelle Jean-Claude Boulben. Sans oublier des milliers de cégétistes venus de partout en France ». Une stèle, installée devant l’usine, rappelle le souvenir de Pierre Maître. Les deux auteurs des coups de feu seront condamnés aux assises à 20 ans de réclusion criminelle pour l’un et à 7 ans de prison pour l’autre.

10 mai 1981
Mitterrand président

« Pour nous, le 10 mai 81, c’était un peu la concrétisation politique de mai 68. C’était un moment historique, avec ce sentiment que les luttes avaient fini par payer ! », résume Dominique Ledemé.
Dominique Ledemé s’en souvient presque comme si c’était hier : le 10 mai 1981, il était chez lui pour assister au résultat de la présidentielle. Aujourd’hui membre de Génération.s et conseiller municipal dans l’opposition, à Reims, il avait alors 25 ans et terminait sa formation d’inspecteur du travail. Engagé à gauche, après un passage au Parti socialiste. « Le soir, j’étais avec mon épouse devant la télé », raconte-t-il. Les visages des deux candidats, Giscard et Mitterrand, apparaissent lentement à l’écran. « On ne pouvait pas savoir immédiatement qui avait gagné, car les deux avaient une calvitie », évoque-t-il, amusé.
Quelques secondes plus tard, c’est « l’explosion de joie ». Le téléphone sonne. Ce sont les copains. « On a pris une bouteille de champagne et on les a rejoints. » L’idée est lancée d’aller à Paris, « mais il pleuvait et nalement on est restés à Reims. Et on s’est couchés assez tard, vous imaginez… » Une liesse sans équivalent dans une vie « sauf peut-être lors de la victoire de la France à la Coupe du monde 98, avec cette même envie de se retrouver… »
Dominique Ledemé fêtera de nouveau l’élection de Mitterrand durant la semaine avec ses collègues en formation puis au sein d’une amicale de locataires dont il est membre, en présence du maire de Reims, le communiste Claude Lamblin (élu en 1977).
L’union du 11 mai 81, cet élu au sourire bienveillant se souvient l’avoir acheté : « Je suis pratiquement sûr de l’avoir encore. C’est le genre d’exemplaire qu’on garde, mais il faut que j’arrive à remettre la main dessus ! »
9 novembre 1989
La chute du mur de Berlin

Par Marie-Pierre Duval
En 1989, alors que la France vient de célébrer le bicentenaire de la Révolution, à l’est, un symbole de la Guerre froide s’écroule. Alors étudiant à Reims, le sénateur Antoine Lefèvre a vécu la chute du mur de Berlin avec une émotion toute particulière.
Des coups de pioche dans un mur, un violoncelliste qui joue sa partition, des petites voitures noires qui lent sur les routes, les images de la chute du mur de Berlin sont dans toutes les mémoires. Ce 9 novembre 1989, le monde assiste en direct à la n du symbole de la partition de l’Europe entre le bloc de l’Est et celui de l’Ouest, à la n de la guerre froide.
À Reims, un jeune étudiant en droit regarde cela avec une attention particulière. Le Laonnois et futur sénateur Antoine Lefèvre est franco-allemand, né à Düsseldorf. « J’ai beaucoup regardé la télévision à cette époque, les scènes de joie, ces gens qui découvraient l’ouest, Rostropovitch et son violoncelle, c’était également très émouvant de voir tous les noms de ceux qui ont péri en voulant franchir le mur. »
L’un de ses amis a fait le voyage à cette époque pour être au cœur des événements. « Il avait vécu à Berlin, il voulait voir ça, poursuit le sénateur de l’Aisne. Il faut se souvenir qu’à l’époque, cette situation semblait bloquée pour toujours même si avec Gorbatchev, on sentait que l’étau se desserrait, la chute du mur était inéluctable. » L’Est, il en avait senti le poids grâce à ses cousins de Hambourg dont une partie de la famille vivait encore de l’autre côté du rideau de fer. « Le moindre déplacement était soumis à des tas de demandes d’autorisations qui pouvaient sauter au dernier moment. En France, nous venions de célébrer le bicentenaire de la Révolution et là une porte s’ouvrait sur la liberté. »
Cette histoire de l’Allemagne, le sénateur Lefèvre a eu maintes fois l’occasion de l’évoquer avec ses propres enfants lorsqu’ils sont allés à Berlin avec l’école. « Mais comment leur expliquer ce que les Allemands ont vécu ? Cela semble maintenant si irréel qu’un pays a pu vivre ainsi coupé en deux… »
























27 décembre 1999
La tempête dévastatrice

Par Sophie Bracquemart
Une tempête d’une violence exceptionnelle s’abat sur la France du 26 au 28 décembre 1999, avec des vents mesurés à près de 200 km/h sur certains points de la côte et de 120 à 150 km/h à l’intérieur des terres.
Dans la ville préfecture de la Marne, les dégâts sont considérables. Alors premier adjoint au maire de Châlons-en-Champagne, René Doucet raconte.
« J’étais chez moi le 26 décembre. Trois arbres avaient chu dans le jardin, des tuiles s’étaient envolées de mon toit. Mon gendre et moi étions sortis dans la matinée pour parer au plus pressé. Je me souviens avoir été frappé par la violence de la tempête, sans me rendre compte des dégâts qu’elle avait occasionnés dans la ville. Ce n’est qu’en essayant de rejoindre le directeur général des services aux ateliers municipaux que je m’étais rendu compte de leur ampleur. De nombreuses voies étaient coupées à la circulation, comme l’avenue du Général-Patton que je n’avais pas pu emprunter. Les peupliers qui la bordaient avaient été sou és ! Une grande partie des quartiers de la ville étaient privés d’électricité… Heureusement, les agents municipaux étaient revenus d’eux-mêmes sur leurs congés pour nous prêter main-forte. »
Le lendemain, René Doucet et le maire, Bruno Bourg-Broc, avaient entrepris de faire le tour des sites les plus touchés. « La découverte de l’état du Petit jard nous avait frappés. Un spectacle apocalyptique s’o rait à nous, tant de grands arbres vénérables avaient été renversés ! Nous avions alors eu l’impression que nous ne parviendrions jamais à restaurer ce patrimoine. »
8 octobre 2001
Un mois dans l’œil du cyclone

Par Gilles Grandpierre
C’était le reportage d’une vie pour notre grand reporter.
En 2001, Gilles Grandpierre est allé par deux fois en Afghanistan. Près d’un quart de siècle plus tard, ses souvenirs restent plus vivants que jamais.
Qui voulait y aller ? Les candidats ne se bousculaient pas. J’avais levé la main. Le Pakistan, l’Afghanistan, vingt jours après l’e ondrement des Twin Towers, ça ne se refusait pas. Le reportage d’une vie, peut-être… Le rédacteur en chef Thierry de Cabarrus estimait les attentats du 11-Septembre su samment considérables pour justi er un reportage au long cours. Il avait raison. Une page d’histoire se tournait qui clôturait le XXe siècle. Une nouvelle guerre de « libération » se préparait, contre Al Qaïda et le fascisme taliban, cette fois. Quotidien régional ou pas, L’union devait y aller.
Deux jours après, j’étais dans l’avion d’Islamabad avec un collègue du Républicain lorrain, Francis Kochert. Pendant quinze jours, tandem inséparable. Quinze jours pour décrire les dérèglements du monde depuis cette capitale interminable rebaptisée « Journalistan ». Les angles de reportages pullulaient. Il su sait de se baisser. Je garde le souvenir de cette madrasa, cette école coranique, où des enfants pliés en deux égrenaient les sourates pendant des heures, des drapeaux américains incendiés dans les rues ou le souvenir de ce prof croisé à l’ambassade de France. Un gars de Charleville-Mézières !
Le reportage avait poussé jusqu’à Peshawar et la vertigineuse Passe de Khyber, mythique frontière pakistano-afghane en pays Pachtoune. La route de Kaboul interdite, nous avions rebroussé chemin. Fin du premier épisode. Le temps d’un aller-retour, un mois et demi plus tard, j’y étais revenu, seul cette fois. A coups de bakchichs exorbitants, j’avais atteint Djalalabad, première ville afghane sur la route de Kaboul que venaient de prendre les Américains. Tellement d’images fortes encore : paysage superbe, rouge et minéral, ville antédiluvienne traversée de pick-up surarmés, adolescents bardés de kalachnikovs, hôpital hors d’âge, frayeurs d’un tremblement de terre et, le lendemain, d’un bombardement lointain sur Tora Bora ! Au misérable Kaboul’s Hotel, les reporters s’entassaient à cinq par chambre sur des matelas jetés au sol. Le soir, nous montions sur le toit pour dicter les papiers, le téléphone satellite braqué sur le ciel. Seules les étoiles éclairaient la nuit noire.
2 juin 2002
Un incendie criminel

Un incendie a ravagé la préfecture de la Marne. Le député-maire de Châlons-en-Champagne, Bruno Bourg-Broc nous dévoile une anecdote surprenante sur cette nuit-là.
Dans la nuit du 1er au 2 juin 2002 à Châlons-en-Champagne, un homme pénètre dans le bureau du préfet de la Marne, Jean Daubigny, pour y mettre le feu. Il s’enfuit en plongeant dans le canal du Mau qui borde les jardins de la préfecture tandis que 71 sapeurs-pompiers sont dépêchés sur les lieux.
Les salons du rez-de-chaussée, les appartements du préfet, son bureau, celui de ses directeurs de cabinet… sont fortement endommagés. Ce qui n’est pas sans provoquer « d’intenses émotions » chez le député-maire de Châlons-en-Champagne, Bruno Bourg-Broc. « La préfecture, initialement l’Hôtel des Intendants de Champagne, c’était pour moi tout un symbole : celui de l’État qui était en train de brûler. »
Alors ministre de l’Intérieur, Nicolas Sarkozy était arrivé sur place dans la matinée du 2 juin. « J’étais allé l’accueillir au centre hospitalier où son hélicoptère s’était posé. Le préfet était là lui aussi, simplement vêtu d’un jean et d’un t-shirt, ses e ets personnels rendus inutilisables. Nous avions fait un état des lieux ensemble pour constater les dégâts. » Bruno Bourg-Broc dit avoir été marqué par deux choses : « Le nombre de soldats du feu mobilisés, et celui des Châlonnais s’étant rendus sur place le lendemain ». Puis il révèle une anecdote tenue secrète jusque-là. « Allant récupérer son ls à une surprise-party, l’une de mes collaboratrices était passée derrière la préfecture vers minuit. Elle avait alors vu un type sortir de l’eau, qui lui avait demandé de le conduire faubourg Saint-Antoine. Sans le savoir, elle avait véhiculé l’incendiaire qui avait pris la fuite par les jardins bordés par le canal du Mau. »
16 octobre 2003 Suicide

Poursuivi devant les assises de la Marne pour la séquestration et l’assassinat de trois jeunes gens, Pierre Chanal (56 ans) s’est suicidé avec une lame de rasoir dans la nuit du 14 au 15 octobre 2003 dans sa chambre d’hôpital.
Sa mort a mis n à son procès qui ne faisait que commencer. Et avec elle, à « l’a aire des disparus de Mourmelon ». Huit personnes avaient disparu non loin du camp militaire de Mourmelon-le-Grand entre 1980 et 1988.
« J’ai été réveillé à 3 heures du matin par un coup de téléphone, se souvient Me Gérard Chemla, qui représentait les familles des disparus de Mourmelon. C’était Monique Derrien (grand reporter à Radio France) qui m’apprenait que Pierre Chanal s’était suicidé. Étant parvenu à joindre mon associé, Vincent Durtette, nous avions convenu de nous retrouver à 7 heures du matin. Nous avions alors prévenu nos clients, tout au moins ceux que nous parvenions à contacter. Puis nous nous étions préparés à reprendre l’audience.
« C’était assez compliqué, pour tout dire. Nous avions perdu quelque chose, ce n’était pas une mort qui nous était indi érente. Les journalistes étaient en e ervescence. Nos clients, catastrophés. Nous n’arrivions pas à comprendre comment Chanal avait pu échapper à la vigilance de ses gardiens, sachant qu’il avait déjà tenté de se suicider au mois de mai. La seule personne qui n’avait pas l’air choquée, c’était sa sœur. Elle avait l’air soulagée.
« La présidente a ouvert l’audience. La cour a appris le décès de l’accusé et l’extinction de l’action publique a été constatée. L’un de mes clients s’est exclamé : « Tout ça pour ça. » Et ça s’est terminé. Il y a eu une vraie sensation de perte et cette impression qu’il avait ni par gagner. Jamais nous n’aurions de vérité judiciaire. »
9 juillet 2012 La réconciliation

Propos recueillis par Grégoire Amir-Tahmasseb
Le dimanche 8 juillet 2012, François Hollande et Angela Merkel célèbrent à Reims les 50 ans de la réconciliation franco-allemande, scellée dans la cathédrale le 8 juillet 1962 par le général de Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer. Premier adjoint à l’époque de la maire de Reims Adeline Hazan, Eric Quénard se souvient de ce jour particulier.
«Accueillir un président de la République, c’est déjà en soit particulier mais deux chefs d’État qui marchent dans les pas du général de Gaulle et du chancelier Konrad Adenauer, c’est à la fois un moment d’histoire et une organisation extrêmement complexe », témoigne Eric Quénard, premier adjoint de la maire de Reims en 2012. « Cela avait été des semaines et des semaines de travail avec l’Élysée, la préfecture, le ministère de l’Intérieur, l’ambassade d’Allemagne. »
« Ce jour-là, ce fut une communion populaire avec de nombreux Rémois qui étaient venus autour de la cathédrale et de l’hôtel de ville. Il y avait beaucoup de respect entre Angela Merkel et François Hollande. Les deux chefs d’État avaient délivré des messages très forts en direction de la jeunesse et autour de la construction européenne. Des messages qui résonnent encore aujourd’hui. »
« Tout avait été organisé pour que les moindres détails rappellent le 8 juillet 1962. Le déjeuner o ciel par exemple était réalisé par le chef Philippe Mille qui avait revisité le menu servi il y a cinquante ans. Le repas se passait dans la grande salle des fêtes de l’hôtel de ville. Cela avait été un moment mémorable et tellement apprécié par les deux chefs d’État qu’ils avaient prolongé le déjeuner qui ne devait initialement durer que trois quarts d’heure. Ils avaient pris le temps de pro ter et de partager ce moment de convivialité. J’étais assis lors de ce déjeuner à côté de l’arrière-petite- lle du général de Gaulle… Cette journée restera un moment fort de cette mandature. »
6 juillet 2015

Par Thomas Crouzet
Le 5 juillet 2015, au lendemain de l’inscription des coteaux, maisons et caves de l’appellation à l’Unesco, toute la Champagne célébrait l’événement historique à Hautvillers. Marie-Paule Cheval a fait partie de ceux qui ont communié ce jour-là, elle qui a soutenu et accompagné son mari Pierre, porteur de la candidature avec l’association Paysages de champagne, dans cette folle aventure qui a duré neuf ans.
«Au début, personne n’y croyait vraiment, con e, avec un sourire, Marie-Paule Cheval. C’est Jean-Luc Barbier, directeur du Comité Champagne, qui est venu trouver mon mari, pour lui demander s’il était partant. Même eux ne savaient pas s’ils allaient y arriver. Mais, à force de détermination et de passion, ils y sont parvenus. »
Une passion partagée par tous, ce dimanche de juillet où les verres de champagne, les drapeaux tricolores et les fanions aux couleurs de l’Unesco ont été levés haut vers le ciel.
« C’est là que j’ai pris la mesure de ce que représentait la Champagne et la erté d’être Champenois », sou e Marie-Paule Cheval.
Six mois après l’événement, Pierre Cheval, le « Monsieur Unesco » de la Champagne, décédait brutalement à son domicile. Mais personne n’a oublié le nom de ce vigneron atypique, dont les lettres s’inscrivent désormais sur un boulevard d’Aÿ-Champagne et un parc d’Hautvillers. Ni l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco, dont la Champagne célébrera l’année prochaine les dix ans à Champillon, le 4 juillet 2025.
28 janvier 2017

Par Sophie Bracquemart
Lancée le 1er août 2014 dans la continuité de l’opération Serval, l’opération Barkhane visait à maintenir la pression sur les groupes armés terroristes au Mali, accompagner les armées partenaires telles que les Forces armées maliennes et agir auprès des populations. Quatre mille militaires français avaient été déployés dans la bande sahélo-saharienne, dont 200 sapeurs du 3e régiment du génie de Charleville-Mézières. Aurélien Laudy et moi avions pu les rejoindre en janvier 2017
Parmi nos souvenirs les plus marquants, un attentat suicide perpétré contre le camp du Mécanisme opérationnel de coordination de Gao qui réunissait des groupes armés signataires des accords de paix de 2015. Revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), il avait fait plus de soixante morts et des centaines de blessés. Alors sur la plateforme opérationnelle désert de Gao, nous avions entendu l’explosion en plus de sentir le sol et les murs trembler. Puis couvert « l’événement », les combattants polycriblés opérés sur la base militaire. Tout aussi lourd, l’état de choc dans lequel se trouvaient les militaires français dont le petit véhicule protégé (PVP) avait sauté sur une mine antichar à proximité d’un puits, attaque signée d’un groupe armé terroriste dans le Nord du Mali. Il avait causé d’importantes blessures physiques à l’un des leurs que nous avions par la suite retrouvé dans les Ardennes.
Nous gardons aussi le souvenir des pénibles conditions de travail des forces françaises au Mali ainsi que celui des résultats qu’ils y avaient obtenus. À Gao, par exemple, le marché Boiteux avait retrouvé sa fonction originelle alors que les terroristes y commettaient des exécutions. Ou dans le Nord du pays, l’importance des opérations civilo-militaires dans les villages qui avaient notamment permis la remise en état de puits et l’ouverture d’écoles.
18 mars 2020
Un jour pas comme les autres

Par Véronique Chauvin
Toute sa carrière de journaliste à L’union, Véronique Chauvin l’a passée à concevoir la Une de nos éditions. Nous avons demandé à la jeune retraitée de nous dire laquelle l’avait le plus marquée. Voici sa réponse.
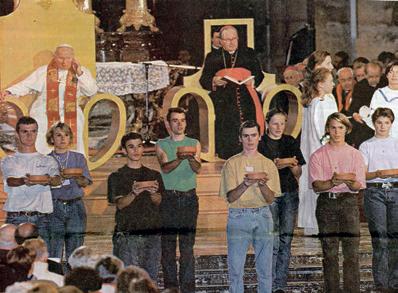
Quand Jean Paul II est entré dans la cathédrale de Reims ce 22 septembre 1996, on a ressenti une onde de chaleur qu’il dégageait, c’est irrationnel, impensable. J’ai pu prendre cette image car j’étais dans la chaire, seul photographe avec un collègue de l’AFP, j’avais une vue totale. Quand le pape a voulu quitter la cathédrale, sortant de la nef, la foule a refermé l’allée centrale. Il était prisonnier, le service d’ordre débordé. Il a mis un temps fou à sortir. En raison des mesures de sécurité, on ne pouvait pas suivre le pape. J’avais disséminé une quinzaine de photographes, dont des correspondants, reconnaissables par les services de sécurité, ils portaient des impers blancs marqués L’union.
Stéphanie Jaye t /photographe à L’union depuis 2018

Anciens comme actuels, des photographes de notre rédaction ont accepté de ne choisir qu’une image ramenée d’un reportage, et d’en rappeler le contexte.

ja , ique gend inondations dans les Ardennes. Un matin, avec Francis Dujardin, reporter, nous partons de Reims pour recueillir des témoignages. Nos bottes bateau, nous avions accosté à la fenêtre d’une maison, entrant ainsi L’habitante nous avait fait un café. Pendant que je prenais des photos, Francis posait mille et une questions à ces gens qui vivaient avec 40 ou 50 cm d’eau dans leur maison. Deux heures après, les pompiers étaient venus
Ce portrait est tiré d’un reportage réalisé avec la reporter Sophie Bracquemart sur l’inceste. Saïrati Assimakou, jeune femme de 29 ans, originaire de Mayotte, et poignant. « Un viol, c’est un crime sans cadavre. J’y pense malgré moi dès que je témoigner à visage découvert ce qui est très rare. Nous avons été plus que touchées, submergées par ses paroles, par sa sincérité, sa maturité et son combat de femmes, d’hommes, d’enfants, de toutes classes sociales.

(situé entre le tribunal et l'hôtel de police)


Bernard Sivade /photographe à L’union (1997-2021)

Pen, accompagnée de Nicolas Dupont-Aignan, vient visiter la cathédrale de Reims. Bloqués à l’intérieur car une foule hostile les attend sur le parvis, ils niront par sortir par une porte dérobée sous les huées et divers projectiles de quelques manifestants qui ont compris un peu tard le stratagème. Cette photo illustre bien le travail du reporter photographe. Une attente assez longue, très peu ou pas d’infos… Et puis une idée, un pari, une certitude et donc une sortie très rapide, quelques secondes, par le palais du Tau, leur seule échappatoire possible et moins risquée. C’est là que j’ai choisi de les attendre et je pense être le seul photographe à avoir eu cette photo.
Wafflart /photographe à L’union depuis 1994




Angel Garcia /photographe à L’Ardennais (1985-2013)

Nous sommes en 2005. Les 310 salariés de l’entreprise Thomé-Génot de Nouzonville (Ardennes), euron de l’industrie automobile, apprennent par la voix de leurs représentants syndicaux le dépôt de bilan de l’usine plus que centenaire. Regards absents, hagards, même pas en colère, comme résolus, ces ouvriers métallos, dont certains travaillent là depuis toujours, seront bientôt au chômage. La fermeture des ateliers de Nouzonville, s’ajoutant à d’autres disparitions d’entreprises métallurgiques, marque profondément la population de la Vallée de la Meuse jusqu’à Givet.
Aurélien Laudy /photographe à L’union depuis 1997




En février 2015, j’ai couvert l’opération Harpie en Guyane avec la reporter Sophie Bracquemart, suivant les militaires du 3e RG de Charleville-Mézières. Ce reportage restera gravé dans ma mémoire, non seulement pour les images capturées, mais aussi pour les épreuves surmontées. C’est un témoignage de la résilience et de la détermination nécessaires pour dévoiler les réalités cachées de la Guyane, un territoire hors norme. Travailler dans ces conditions extrêmes m’a appris l’importance de la patience, de la persévérance et de la vigilance, des qualités indispensables pour tout reporter photographe confronté à des environnements aussi hostiles et imprévisibles.






























Les marques Griffon, Gevana, Gregory Pat, Guy Debouis, Eleane, Scorzzo, MCM, Plurielles, Triumph, Sloggi, Pioneer, Dario Beltran, Hublot, chaussettes Perrin



































Par Fabrice Minuel
Cabu lui avait proposé d’assister à la conférence de rédaction de Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015. Fabrice Minuel, ancien journaliste à L’union, a décliné l’invitation, en raison d’un rendez-vous professionnel...
Durant huit ans, Cabu a publié près de 800 dessins de presse pour L’union et essentiellement pour l’agence de Châlons-en-Champagne. Le journal avait embauché comme pigiste, en juin 1953, le jeune homme de 15 ans qu’il était.
J’ai fait la connaissance de Cabu en 1996. La dernière fois que je l’ai eu au téléphone, c’était à la n du mois de décembre 2014, pendant les vacances de Noël. C’était quelques jours avant l’attentat du 7 janvier qui lui a coûté la vie.
Ce soir-là, il était pressé. Il allait au théâtre avec son épouse Véronique pour voir La Colère du Tigre, une pièce avec Michel Aumont et Claude Brasseur. Véronique me l’a ensuite con rmé : « Ce fut notre dernière pièce… »
Je l’appelais pour lui parler de mon article sur Les Pensées de Pierre Dac. L’ouvrage était illustré de ses dessins et devait paraître en mars 2015, dans sa ville natale de Châlons. Comme à chaque fois, je projetais de lui envoyer l’article.
Je ne connaissais pas les nouveaux locaux de Charlie Hebdo, rue Nicolas-Appert à Paris, un des deux journaux (avec le Canard enchaîné) pour lesquels travaillait Cabu. À plusieurs reprises, le dessinateur nous avait invités, moi et son ami l’antiquaire châlonnais Patrick Pierrejean, à assister à la conférence de rédaction. La règle du jeu est simple, à l’image d’un conseil municipal : on s’assoit, on écoute, mais on n’intervient pas.
Vous n’avez qu’à venir, à la conférence du 7 janvier�
J’ai dû décliner : ce mercredi-là, j’avais un rendez-vous professionnel incontournable, ponctué d’un déjeuner dans une brasserie châlonnaise. C’est en m’apprêtant à couper ma viande qu’un client m’a demandé des nouvelles de l’attentat qui était en train de se dérouler à Paris et dont j’ignorais encore tout. J’ai sorti mon téléphone portable de ma veste : il était saturé de messages. Le pire y était inscrit. Mon repas était terminé. Je suis sorti du restaurant les larmes aux yeux. Depuis, quand, chaque maudit 7 janvier, je vois dans les journaux ou à la télé le visage de ceux qui sont tombés sous les balles des terroristes, deux d’entre eux retiennent particulièrement mon attention en me plongeant dans de complexes ré exions. Je pense à ceux qui ont été invités à notre place à l’issue de ma défection…

Par Thomas Delobelle
Au soir de Charlie Hebdo, les gros bras de la BRI sont intervenus à Charleville-Mézières. Le photographe Aurélien Laudy et le chef d’édition Thomas Delobelle ont essayé de se fondre dans leur dispositif. Récit.
Cette matinée du 7 janvier 2015, jour du massacre chez Charlie Hebdo, toute la rédaction de L’Ardennais accuse le coup. Localement, les choses s’accélèrent quand, vers 22h30, une colonne de véhicules stationne en bas de l’avenue De-Gaulle. À l’intérieur, des hommes en noir, casqués, encagoulés, lourdement armés. Aurélien Laudy, photojournaliste, me rejoint. Quand le convoi se met en route, au culot, nous décidons de lui coller au train.
La colonne s’immobilise dans un coin discret de la zone du val de Vence. Deux hommes de la voiture qui nous précède fondent sur nous armes à la main. Pas de négociation possible : « Vous dégagez ou je vous crève les quatre pneus », nous jette à la gure « Tof », le chef, alors que des points rouges bougent sur nos poitrines...
Nous prenons des photos mais impossible de leur parler
Nous décidons donc de nous garer au milieu des autres véhicules au pied des tours de la Ronde Couture car nous avons la conviction que dès que les policiers seront à découvert, les « choufs » (ceux qui surveillent le quartier pour les dealers) feront leur job en criant.
Banco ! Peu avant minuit, des cris résonnent entre les immeubles. Nous prenons des photos mais impossible de suivre les hommes de la BRI venus interpeller un suspect.
Les premiers policiers descendent de l’immeuble calmement. Il est minuit, nos téléphones sonnent, il nous faut au plus vite regagner la rédaction du cours Briand car les rotatives ne peuvent plus attendre. Nous avons tout juste le temps de livrer quelques images et mots

Par Fabrice Curlier
À Reims, la nuit la plus longue fut celle du 7 au 8 janvier 2015, avec la traque des frères Kouachi qui avait mené au quartier Croix-Rouge. Jamais il n’y eut foule aussi importante dans la rue.
La présence d’un journaliste de TF1 devant l’hôtel de police de Reims donne l’alerte : que fait-il là, ce 7 janvier 2015 vers 18 heures, alors que toutes les forces de sécurité du pays sont à la recherche des auteurs de l’attentat de Charlie Hebdo ?
Le confrère ne veut rien dire mais on comprend qu’il attend d’intervenir en direct au 20 heures. Un policier lâche le morceau : « La BRI est à Reims pour Charlie Hebdo ». L’union publie l’information, tant pis pour TF1. Un lieu d’intervention est sou é. À l’adresse indiquée, personne ! Dans le quartier, absolument rien ! Croix-Rouge est désert. Un tuyau crevé ?
On tourne toujours, le portable sonne encore. Sur un ticket d’horodateur sont gri onnés deux noms qui vont devenir tristement célèbres : ceux de Chérif et Saïd Kouachi.
Soudain, de l’agitation est signalée à la CRS 33. La presse rapplique, qui voit une armada de Robocop ler vers Croix-Rouge. Fin de la « course-poursuite » avenue Bonaparte, à l’adresse indiquée plus tôt, sans savoir alors que l’intervention n’avait pas encore eu lieu…
Devant les télés depuis l’attentat, tout le quartier déserte d’un coup BFM-TV. C’est la foire, un cirque invraisemblable. Au bas de l’appartement de Saïd Kouachi, la foule se presse comme au spectacle pour deviner la perquisition en cours derrière les rideaux tirés. Il en sera ainsi jusqu’au bout de la nuit. Plus tard, un policier con era : « Il y a le jour le plus long, pour nous ce fut la nuit la plus longue », avec « les Kouachi toujours introuvables » et la nécessité de « gérer la menace de nouveaux attentats ».
En cette nuit de toutes les rumeurs, « on nous parlait notamment de la cathédrale de Reims comme cible potentielle »...
Par Sylvain Pohu
Avoir la chance de couvrir les Jeux olympiques de Londres en 2012 et de Rio en 2016. Des souvenirs impérissables.
Couvrir les Jeux olympiques est le Graal pour tout journaliste sportif. L’aventure devient même plus extraordinaire quand vous êtes proche d’un des athlètes en lice pour une médaille. En 2012, aux JO de Londres, j’ai suivi le parcours du Rémois Mahiedine Mekhissi-Benabbad, spécialiste du 3 000 m steeple, médaillé d’argent surprise en 2008 à Pékin, avec une double casquette : celle d’envoyé spécial de L’union et celle de partenaire d’entraînement car, à l’époque, étant moi-même athlète, je faisais partie de sa garde rapprochée. La conquête de sa deuxième médaille d’argent dans un stade en ébullition, la scène de joie avec son vainqueur, le Kenyan Ezequiel Kemboi, restée comme une image symbolique de ces Jeux...
Tous ces moments resteront gravés à vie dans ma mémoire comme celui, plus intimiste, de son entrée dans l’enceinte aux côtés de ses adversaires. J’avais repéré un endroit pour être le dernier à pouvoir l’encourager avant son entrée dans l’arène. Il m’avait laissé sans voix avec un regard qui en disait long sur sa détermination.
Quatre ans plus tard, c’est l’envol pour Rio de Janeiro au Brésil où nous suivions 17 athlètes régionaux. Là aussi, le rythme des journées était très intense. Sur la piste du mythique stade Maracana, Mahiedine Mekhissi parvenait à conquérir sa troisième médaille en autant d’olympiades. Une médaille de bronze obtenue après avoir porté réclamation contre son meilleur ennemi Kemboi. Sur le l du rasoir, comme moi pour changer mon article avec cet énième rebondissement
Spécialiste de machines à coudre pour vos loisirs créatifs

Mardi au samedi 9h à 12h et 14h à 18h30
Tous les entretiens et réparations sont effectués par nos techniciens sur place dans notre atelier.



Par Stéphane Massé et Hervé Marti
Le 16 juin 1972, deux trains roulant l’un vers l’autre se sont percutés sous le tunnel de Vierzy. L’union a souvent abordé cette catastrophe qui a fait 108 morts. Et marqué nos journalistes.
’union a interviewé divers interlocuteurs sur la catastrophe de Vierzy, survenue le 16 juin 1972. Ce soir-là, deux trains roulant en sens inverse se sont percutés dans le tunnel de ce village au Sud de Soissons. La troisième catastrophe ferroviaire la plus meurtrière de France a fait 108 morts et 111 blessés.
Pour le cinquantenaire du drame, le journaliste Hervé Marti a contacté Francis Maillard, pigiste ayant travaillé pour FR3 en 1972. Une double page était prévue. Francis Maillard gardait des images fortes dans son esprit : « J’ai vu un homme blessé qui sortait du tunnel. Il avait perdu un enfant et s’arrachait les cheveux. »
Hervé Marti rapporte que Francis Maillard et lui sont allés sur place pour le reportage : « On voulait une photo actuelle de Francis sur place. On s’est retrouvé à environ 80 mètres de l’entrée du tunnel. J’ai fait 3 ou 4 photos de Francis sur les rails lorsqu’un train est sorti du tunnel, sirène hurlante, à 80-90 km/h. J’ai attrapé Francis par le col et on s’est couché sur le ballast. Le train nous a frôlés. On a eu la peur de notre vie. Francis m’a dit : « On se tire, le chau eur va nous signaler et on va se faire arrêter par les ics. » On a quitté le site en riant de notre mésaventure et en se maudissant d’avoir été aussi dangereusement ridicules. »
Stéphane Massé a lui aussi travaillé sur le souvenir de Vierzy. Il a notamment assisté à une rencontre improbable entre Bernard Debraye, ultime rescapé sorti de l’amas de tôles, et le docteur Jean-François Devars qui lui avait sauvé la vie en lui tenant la main pendant 17 heures. Les deux hommes s’étaient retrouvés à Soissons le 16 juin 2022.
« Il y avait eu un petit moment d’hésitation entre les deux hommes qui ne s’étaient jamais revus depuis ce terrible jour, soit 50 ans, avant qu’ils ne se serrent la main », con e Stéphane Massé qui avait assisté à la scène. Il y avait une sorte de respect, de reconnaissance et d’admiration mutuelle entre les deux hommes ; le sauveteur et le sauvé. Un moment très fort.








Par Mathieu Livoreil
Le 27 février 2021, notre confrère photographe était très violemment agressé dans le cadre d’un reportage et passait quatre semaines dans le coma.
Un samedi après-midi en famille à la maison, tranquille. Jusqu’à cet appel de l’élu chargé de la sécurité à la Ville de Reims. Il vient d’apprendre qu’un photographe du journal a été pris à partie lors d’un reportage, ça a l’air sérieux, il est inquiet, me demande comment joindre le rédacteur en chef de permanence. Pour beaucoup, c’est le début d’un cauchemar qui aurait pu encore plus mal se terminer. Christian Lantenois, photographe entré à L’union en 1983, a été agressé dans le quartier Croix-Rouge, où il venait d’arriver avec une consœur pour réaliser un reportage. Il va passer quatre semaines dans le coma, entre la vie et la mort. Au journal, le choc est immense. Au-delà, l’a aire provoque un retentissement national, particulièrement à Reims, où des décennies de reportage ont fait de lui une gure familière. Les rédactions du pays dé lent entre nos murs. À l’Assemblée, les députés se lèvent pour l’applaudir, lui et ce qu’il représente. Avec d’autres, je relate ce que l’on sait des avancées de l’enquête, ce que l’on peut dire de son état de santé. Ces articles sont une épreuve. Devant le parvis de la médiathèque, se retrouver face aux traces de son agression me secoue. Quatre jours plus tard, la pluie rince Reims. En le découvrant, j’ai pensé : on ne verra plus son sang.
Comme d’autres, j’ai accumulé les reportages avec Christian au l des années. Une fois, nous avions dû battre en retraite pour ne pas être pris à partie. Sur le terrain, nous sommes identi ables, donc vulnérables, et les photographes encore plus avec leur matériel. Ce qui lui est arrivé peut sans doute arriver à chaque journaliste.
Mais c’est tombé sur lui. Lui qui pouvait déjà prétendre à la retraite, lui qui ne comptait jamais ses heures, lui qui râlait toujours si un rédacteur partait en reportage sans être accompagné d’un photographe. Christian Lantenois a survécu et c’est magni que.
Mais d’importantes séquelles physiques et neurologiques ont persisté.
Depuis quelques mois, Christian Lantenois est retraité. Il n’aura jamais pu reprendre le travail. Du 30 septembre au 3 octobre 2024, deux hommes seront jugés à huis clos par la cour d’assises des mineurs de la





• Seulement 20 €













de 26 ans
Par Hervé Chabaud
C’est une première pour le journal : la réalisation d’un hors-série. Faire la synthèse bien illustrée du voyage du pape Jean Paul II, le dimanche 22 septembre 1996, en le restituant dans son contexte historique et géopolitique dans un fascicule qui soit disponible dans tous les kiosques le mardi 24 septembre, est le dé à relever.
Finaliser les soixante-quatre pages dans les temps, assurer la livraison des maquettes et des images aux religieuses de Bar-le-Duc qui ont en charge l’impression et la livraison d’un premier tirage de 25 000 exemplaires au jour dit, exige une préparation rigoureuse en amont. J’ai en charge les textes, Bernard Reumaux, des éditions La Nuée Bleue, s’occupe de la coordination générale et de la maquette.
Nous choisissons les images les plus signi catives fournies par les reporters-photographes. Pour ne pas perdre de temps, une navette est assurée depuis Reims par un volontaire des services techniques, qui transporte jusqu’à un point relais chaque chapitre pour ne pas perdre de temps à un point de rendez-vous sur la voie romaine menant en Meuse. La messe réunissant 200 000 personnes sur la base aérienne, le passage à la basilique Saint-Remi, l’échange à la cathédrale Notre-Dame avec les dèles, l’avenir du catholicisme aux portes du troisième millénaire, tout est livré comme il se doit et, le lundi 23 septembre à 4 h 51, tout est bouclé.
Le mardi soir, le premier tirage est épuisé. Un deuxième d’un même volume est déjà en cours pour réalimenter les points de vente dès le lendemain. Il en faudra un troisième de 10 000. Un succès alors salué par notre directeur général Daniel Hutier.


















































Par Didier Louis
Didier Louis, ancien rédacteur en chef de L’union et L’Ardennais, était l’envoyé spécial du journal en Irak au début de l’année 1991. Son reportage lui a laissé des souvenirs impérissables. Il raconte.
Je me souviens du 17 janvier 1991. Du titre, sec comme un commandement, qui barre la Une de L’union : « C’est la guerre ». Le journal annonce par là même qu’il a missionné un envoyé spécial en Arabie saoudite, manifestant une ambition éditoriale singulière.
C’est d’abord la guerre de Bush. Le chef de la seule superpuissance de la planète entend étou er dans l’œuf l’invasion d’une pétromonarchie amie, le Koweït, par Saddam Hussein. Il déploie la plus grande coalition militaire depuis la Seconde Guerre mondiale. C’est une guerre à la fois lointaine, aventurière, et résonnant à nos portes. La soudaine résurgence d’une con agration des armes plonge dans l’expectative des centaines de familles attachées à notre journal. L’angoisse, la sidération s’installent parmi nos lecteurs.
La hantise de l’arme chimique�
Un millier de soldats de la région sont engagés au péril de leur vie – aviateurs de la BA 112 de Reims, BA 113 de Saint-Dizier, sapeurs du Génie de Charleville, tankistes de Mourmelon, groupement médical de Sedan, unités basées dans l’Aisne –, fournissant pas moins d’un dixième du contingent de l’opération Daguet. Ils contribueront grandement à la déroute d’un tyran présomptueux de ses forces.
Il importait que le journal témoignât et informât au plus près des troupes, de visu. En n, de visu, si l’on peut dire de la première phase de la guerre – phase aérienne – ô combien insaisissable en ce qu’elle vise à s’accaparer la maîtrise du ciel. Elle réduit les journalistes à l’interprétation de combats livrés dans un théâtre de guerre abscons, et leurs analyses à l’exégèse de la doxa militaire assénée par les communicants américains.
Je me souviens des numéros orchestrés par l’emblématique général US Schwarzkopf. Le showman maître du monde nous mitraillait de démonstrations de la suprématie des pays coalisés, nous canardait d’images provenant des caméras mises à bord des bombardiers. Une guerre du jeu vidéo avant l’heure. À Paris, la génération spontanée des experts bavards colonisait les plateaux de télévision. À Riyad, rien à voir, c’était les rites qui scandaient notre quotidien : le vacarme du pont aérien brisant l’appel à la prière lancinant du muezzin ; les confrères radio captant du son par la fenêtre de leur chambre d’hôtel pour « incarner » leurs reportages ; le barnum des directs de la télévision ; la litanie des alertes antimissiles nous enjoignant de nous réfugier nuitamment à la cave, tels des métronomes hagards, bardés de combinaisons, masques à gaz maladroitement ajustés.
Je me souviens de la hantise de l’arme chimique qui nous tenaillait avec sournoiserie, jusqu’au moment où un scud s’est écrasé près de notre hôtel dans un barouf saisissant. Un engin métallique rudimentaire de sept-huit mètres gisait là, ino ensif cigare fumant dans les décombres. Nous avons alors dé nitivement compris le leurre que représentait cette arme dite de destruction massive, version Saddam.

Une de L’union du 17 janvier 1991.
Je me souviens de l’accueil épatant, quoique minuté, réservé par nos militaires lorsque j’avais la chance, embarqué dans un pool, de recueillir leurs témoignages millimétrés dans ce désert désespérant de pâleur et de laideur. De leurs conseils précieux permettant de louvoyer entre les mines antipersonnel dont le sol était mité.
Je me souviens du amboyant, du charismatique colonel Michel Bourret, commandant des Dragons de Mourmelon, qui a joué un rôle éminent quand les chars lourds de Daguet, les AMX-30, enfoncèrent les lignes adverses, prélude de la débandade irakienne. Le 24 février 1991, au bout d’une nuit de tous les possibles qu’il avait tenu à passer sous sa tente, et tenu à la monter a n de ne pas déroger aux rites du soldat issu du rang, il avait exécuté une manœuvre décisive, exploitant l’immobilisme de l’ennemi gé dans sa doctrine soviétique. Bush triomphait. Le simulacre d’un autocrate aux pieds d’argile qui avait mysti é le nouvel ordre mondial par son orgueil, prenait n.
Je me souviens de l’entrée dans Koweït City libérée, déchiquetée, ratatinée.
Je me souviens de la guerre des mots. Du mythe de la « guerre propre », selon l’improbable terminologie. On ne saura jamais si la guerre du Golfe a fait, chez les civils irakiens, 25 000 ou 250 000 victimes…
Je me souviendrai longtemps du débarquement de nos mille militaires en rade de Toulon, dans l’indi érence de la nation. Le soleil brillait, le journal retrouvait quelques visages familiers. Mission accomplie.


Expliquer comment un pays allait à un tel point s’embraser, tient de l’irrationnel. Vingt millions de téléspectateurs en France, plus de deux milliards dans le monde, quatre-vingt mille dans l’enceinte incandescente du Stade de France ont vécu ce morceau de vie qui restera gravé dans la légende. Fabuleux, sublime, géant, ce fut le jour de gloire rêvé pour les Bleus d’Aimé Jacquet, vainqueurs de leur premier titre de champion du monde de football.
« On dira plus tard qu’on y était » me sou a en me serrant la main mon confrère Jean-Pierre, au moment où les équipes de France et du Brésil, s’avançaient dans les pas de l’arbitre marocain Saïd Belqola, en cette douce soirée estivale.
Pour en arriver là, l’équipe de France avait suscité toutes les émotions et béné cié de sérieux coups de pouce du destin : le but en or de Laurent Blanc en huitièmes de nale face au Paraguay, le tir sur la transversale de l’Italien Di Baggio en quarts, l’improbable doublé du pied gauche du droitier Lilian Thuram en demi- nales, et le malaise du Brésilien Ronaldo dans la nuit précédant la nale.
Dominer à ce point les artistes brésiliens tenait du miracle. « Et 1, et 2, et 3-0 ! » chantait un pays black, blanc, beur en liesse, débordant de bonheur. Faire chanter, danser, klaxonner les Français aussi. L’incarnation d’une France unie et ravie. Plus qu’un match, plus qu’une nale, une erté. « Zizou président ! », entonnait la foule autour de l’enceinte de Saint-Denis. Au pays des rois, le génie marseillais, portera éternellement sa couronne.
Il fallait le voir pour y croire. Vingt-six ans avant les Jeux olympiques de Paris, la France avait vibré au rythme des Bleus d’Aimé Jacquet, vainqueurs de la Coupe du monde à domicile à l’issue d’une finale endiablée. L’union y était.
Par Gérard Kancel

Fabuleux, sublime, géant, ce fut le jour de gloire






















Par Aurélie Beaussart
Le CHU de Reims a ouvert ses portes à L’union durant 3 jours, en pleine crise sanitaire de Covid-19. Une de nos photographes, en immersion, a pu vivre de l’intérieur, le quotidien d’un hôpital reconditionné pour faire face à l’un des plus grands fléaux du 21e siècle.
«C’était la n de la première vague. ça faisait un moment que la locale de Reims était en pourparlers avec le CHU pour pouvoir faire un reportage. L’idée était de pouvoir aller dans tous les services : la réanimation, la pharmacie, la blanchisserie, la restauration, le labo, l’étage Covid… voir un peu comment ça se passait », raconte la photographe Stéphanie Jayet. « J’y vais toute seule parce que, si l’hôpital nit par accepter une immersion de 3 jours, elle donne son feu vert seulement pour une seule personne. » Pas vraiment de peur ou d’inquiétude sur l’instant. « C’est la photographe qui a pris le dessus. C’était une opportunité incroyable. C’était une chance de pouvoir aller dans un hôpital pour ainsi dire transformé en champ de bataille. La seule peur que j’avais, c’était de contaminer ma famille. » Alors quand elle rentrait chez elle, le midi et le soir, durant ces trois jours d’immersion, c’était le même rituel. « Je me déshabillais intégralement dans mon entrée et j’allais directement me prendre une douche, me laver les cheveux, deux fois par jour. » Stéphanie Jayet n’avait jamais mis les pieds dans un service de réanimation. « C’était le plus spectaculaire, le plus di cile à vivre. Le personnel était débordé. C’était un truc de dingue. C’est l’un des reportages les plus marquants de toute ma carrière de photographe. » Son papa, décédé 5 ans auparavant, était médecin de campagne. « J’ai souvent pensé à lui, je me demandais ce qu’il dirait s’il voyait ce qui était en train de se passer. » En y repensant, « six mois plus tard, je n’aurais sans doute pas fait ce reportage, car lors de la deuxième vague, ma mère est morte du Covid. Je suis alors retournée au service de réa, cette fois, pour accompagner ma maman. » De cette immersion de 3 jours, un cahier spécial de 10 pages a vu le jour.














Par Sébastien Lacroix
Sébastien Lacroix, ancien rédacteur en chef de L’union-L’Ardennais, a signé environ 3 000 éditoriaux dans L’union. Dans la masse, il y en a un qu’il n’oubliera jamais. Il nous raconte pourquoi.
Le 18 novembre 2015, à l’aube, les policiers du Raid donnent l’assaut dans un appartement de Saint-Denis, espérant déloger les jihadistes Abdelhamid Abaaoud et Salah Abdeslam, coordinateurs des attentats du Bataclan et des terrasses, cinq jours auparavant. L’opération est spectaculaire. Au cours de l’assaut, un chien du raid, un berger malinois baptisé Diesel, est tué par les terroristes. Aussitôt après, une vague d’émotion a submergé les réseaux sociaux. Un compte Twitter a été créé, un hashtag #JeSuisChien a vu le jour. Il n’y en avait plus que pour Diesel. Surpris que la mort d’un chien, aussi douloureuse fut-elle pour son maître, supplante dans le cœur de millions de Français les 130 morts et près de 500 blessés des attentats, j’ai écrit un édito pour mettre en exergue le décalage entre la détermination de terroristes pour lesquels la vie humaine n’a pas grande valeur et le désarroi d’une nation face à la mort d’un chien, symptôme de notre faiblesse à leurs yeux. Que n’avais-je dit ! Dans la foulée de la publication, un torrent ininterrompu d’insultes, menaces de mort s’est déversé sur le site de L’union. Jamais un édito n’avait déchaîné un tel ot de haine. Abasourdis par une telle réaction, nous avons coupé les commentaires dans l’après-midi quand le compteur des injures a passé la barre des 850. A noter que si aujourd’hui la Russie est au cœur de nombreuses tentatives de déstabilisations numériques, il convient d’exonérer Poutine de toute volonté de manipulation à l’époque, car il avait aussitôt o ert un chiot à la police française pour remplacer Diesel. Comme quoi il peut être gentil…



























En avril 2017, L’union a fait vivre l’histoire de près à ses lecteurs. Le temps d’un mois et 100 ans après l’offensive Nivelle sur le Chemin des Dames, chacun a pu revivre ou redécouvrir la vie des Poilus.
LLLLe 16 avril. Voilà une date qui ne parle pas à grand monde. Mais sur le Chemin des Dames, elle veut dire quelque chose. C’est ce jour de allemandes. La bataille du Chemin des Dames, qui se soldera par une défaite des forces françaises.
Loin des couronnes de lauriers de Verdun, c’est peut-être ça qui a motivé la rédaction à lancer toute une série d’articles consacrés à ceux qui ont combattu et sont tombés pour la France. Chaque jour du mois d’avril 2017, 100 ans après, un sujet lié au Chemin des Dames est venu ponctuer chaque jour les pages de L’union.
Des nombre u x sujets on t é t é cou v ert s
À l’issue de ce mois si particulier (car François Hollande, à l’époque président s’est déplacé pour commémorer cette page d’histoire), un
Chacun a pu découvrir des facettes parfois méconnues du Chemin des Dames. Outre la Caverne du dragon, la question des refuges pour les soldats, les grands noms passés par le Chemin des Dames (comme Dreyfus ou l’Allemand Von Bulow), le sort de spor tifs devenus combattants, notamment ceux qui ont vu leur carrière fauchée par les balles ou les obus.
La question du deuil pour les familles a également été abordée. Entre les soldats portés disparus et ceux inhumés dans un cimetière militaire au milieu de milliers d’autres, il fallait une capacité de d’un père ou d’un neveu.
Terre de mémoire, le Chemin des Dames est aussi devenu terre de découverte, terre d’accueil pour les touristes. Le lieu regorge to ujour s d’un ta s d’his toi res qu e L’unio n vou s raconte régulièrement. C’est pour nous un joli terrain de jeux, un symbole pour tout un territoire, un encouragement à préserver la paix.









P ar M arion Dardar d
Alejandra Wolf, débarquée des États-Unis en 2017 avec sa fille, avait besoin d’un emploi pour rester en France. Grâce à L’union, qui a médiatisé sa situation, elle a décroché un CDI en quelques jours.
ACDI pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour sur le territoire
celle qui gère le centre, mais aussi les réseaux sociaux et le marketing digital, en assurant la visite.
C’est grâce à son témoignage dans L’union, en juillet 2023, que cette mère de famille originaire d’Argentine, qui a vécu 20 ans aux États-Unis, est parvenue à
parle trois langues devrait tirer un trait sur sa vie en France. Or ses recherches
Son titre de séjour ainsi obtenu n’était valable qu’un an. Alejandra a dû
copains. En tant que parent, notre travail est de construire un adulte heureux. Il y a plein de choses que j’aimais aux États-Unis, mais en tant que mère seule, plaît tellement dans la cité des sacres, Alejandra, qu’elle envisage désormais de demander la nationalité française. Elle a déjà suivi la formation civique de six

P ar Ma rio n Dardar d L’audace d’Ale x and r e réc ompensé e
En juin 2020, son audace et sa motivation, relayées par L’union, lui avaient permis de voir l’horizon s’éclaircir.
C’était au moment du Covid. Son collège était fermé. Les entreprises tournaient au ralenti. Et Alexandre errait au domicile familial de Vrigny, sans
comment Alexandre, 15 ans à l’époque, se retrouve pris en sandwich entre deux morceaux de palettes recouverts d’une pancarte en carton, de 6 h 30 à 8 heures, à l’entrée de la zone artisanale de Muizon durant trois jours pour attirer l’attention sur sa situation.
Très vite, les médias, L’union et Champagne FM en tête, repèrent le jeune
a donné sa carte… Le dossier d’Alexandre a été analysé. Vu son niveau scolaire,
année, un employeur, qui avait été touché par la pancarte, a proposé de le
Marnais de 19 ans de décrocher son CAP charpente cette année.
À la rentrée prochaine, il attaquera un BTS en enveloppe du bâtiment à Arago, grâce à l’un de ses anciens profs. Avec ce bac +2 en perspective, pour sûr, Alexandre n’aura Pourtant, il a conservé la pancarte
lui servira pour toujours. Même si, au moment de la fabriquer, ni Alexandre, ni

P ar Pac ôme B assie n
Dans le labo, il pianote sur un écran. Différentes teintes de couleurs l’entreprise Carrosseries champenoises depuis un peu plus d’un an. Et pour cause, il a été embauché par son président à la suite de la publication d’un article sur celui qui deviendra son carrossier peintre.
En mars 2023, Valentin Guy, originaire de Montmirail, dans le sud-ouest de la Marne, est devenu le meilleur peintre automobile de la région Grand Est. Il a remporté la compétition régionale WorldSkills longtemps après, j’ai eu un message de mon patron actuel qui avait vu l’article. Il voulait
Julien Palumbo, président des Carrosseries champenoises, se souvient bien du j’ai lu l’article et je l’ai contacté. Il est venu me rencontrer à Reims, il n’avait pas encore d’énergique. On sait très bien que ce sont les meilleurs qui sont sélectionnés pour faire de Valentin Guy en préparant elles aussi la compétition WorldSkills. Aujourd’hui en contrat à durée indéterminée (CDI) dans le métier qu’il rêvait d’exercer, Valentin Guy répare et peint les carrosseries qui ont été endommagées lors d’un proposé.





Chocolaterie &Salon Gourmand - Ouverts du mardi au samedi de 10h à 19h Les Chocolats de Maud - 5 rue Emile Dorigny - St Brice Courcelles www.leschocolatsdemaud.com / 06.79.49.14.82

Par Aurélie Beaussart
Pierre Pouyet, 84 ans, est abonné à L’union depuis 50 ans mais son histoire avec le journal a commencé bien avant 1974, puisqu’il avait l’habitude de feuilleter l’exemplaire de L’union de ses parents.





Sur la table du salon, des coupures de presse éparpillées permettent de retracer la vie de la famille Pouyet. « Mes parents avaient un hôtel-restaurant, ici, à Sainte-Menehould. » Il désigne du doigt un article de 1956, on y voit son père aux fourneaux. « C’est à cette époque-là que j’ai pris l’habitude de lire le journal. J'allais le chercher tous les matins, au tabac. »
En 1974, à l’âge de 33 ans, il s’abonne à L’union. Depuis, jamais, il l’assure, il ne s’est posé la question d’y mettre un terme, même s'il n’est pas toujours d’accord avec ce qu’il peut y lire.
Les coupures dé lent devant nos yeux. La photo d’un bal populaire où, en premier plan, on voit Joëlle et Pierre qui dansent. La photo de leur mariage dans la rubrique « Pour le Meilleur et pour le pire ». Des photos touchantes prises de centre aéré sur lesquelles on voit leur ls grandir peu à peu...
Pierre Pouyet est abonné 7 jours/7, « parce que l’information ne s’interrompt pas le dimanche. » Son journal, chaque jour, il prend le temps de le découvrir, et même de le savourer. D’abord avec le café, il lit « les grandes lignes, l’édito, les grands titres sur Châlons et les pages décès, avant de le passer à Madame. » Puis, il le reprend en n de matinée, pour se pencher sur les informations de second plan et à nouveau vers 16 heures. « Je le lis en intégralité. »
Pierre Pouyet apprécie aussi le coup de crayon de Chaunu, la plume de certains éditorialistes. Le journal, au l de ces cinq décennies, « a su changer avec son temps. C’est vrai qu’avant, il prenait beaucoup de place quand on le posait sur une table pour le lire. » Dans une autre pochette, il a gardé certaines Unes. L’union fait partie de sa vie et le suit en vacances. Avec L’union, Joëlle et Pierre ont gagné des places pour un spectacle sur Reims, des entrées pour une pièce de théâtre, ils ont pu assister à un match de foot. Et quand ils vont, chaque année, à la Foire de Châlons, ils s’arrêtent au stand de L’union.
S’abonner à L’union ? Rien de plus simple !
Pour connaitre toutes les o res que nous proposons, avec ou sans engagement, il su t de se rendre sur www.lunion.fr/abonnement . Nos formules numériques comprennent notamment l'accès à tous les articles sur notre site et notre application (Google Play et Apple Store), la lecture de toutes les éditions de notre journal et de nos nombreux suppléments et magazines (Diverto, Version Fémina, Guide Eco, Balades, Instant lifestyle...) en version numérique, et la possibilité de participer à tous les concours et événements "Privilèges Abonnés" .
Pour toute question ou di culté, vous pouvez également contacter notre service client au 03 66 890 404 ou par mail à abonnements@lunion.fr "












Par Frédérique Petré
Christian Simon a aujourd’hui 84 ans. Et il profite d’un repos bien mérité dans une résidence à Reims. En activité, il distribuait aux aurores le journal L’union aux abonnés du quartier Cernay – Jean-Jaurès. Il participait aussi à de nombreux salons où étaient distribués divers objets publicitaires. Ceux de L’union sont évidemment ses préférés.
Christian Simon a longtemps travaillé pour le journal L’union à Reims. « En janvier 1968, il est entré comme porteur », raconte sa lle Christelle Terre. L’homme, aujourd’hui âgé de 84 ans, distribuait le journal aux abonnés du secteur Cernay – Jean-Jaurès, de fort bonne heure. « Il était aussi vendeur itinérant et il lui arrivait de distribuer des objets publicitaires de toutes sortes ». Buvards, casquettes, stylos, calendriers, pare-soleil, cendriers, briquets, jeux de cartes, allumettes, porte-clefs… Au l des ans, Christian Simon en a conservé quelques-uns. « Il les rangeait dans une petite vitrine », se souvient Christelle.
Puis, Christian a dû déménager et poser ses a aires dans une résidence pour personnes âgées avenue Clemenceau. « Tout est maintenant dans un carton. Nous les avons ressortis pour vous », renchérit Christelle. Et ressortir tous ces objets a fait remonter quelques souvenirs. « J’ai pu apprendre qu’il distribuait à peu près 500 journaux tous les matins entre 3h et 7h à mobylette dans le quartier Jean-Jaurès. Il n’a pas d’objet préféré et se souvient juste qu’il les récupérait lors d’animations sur le Tour de France, la foire-exposition », raconte Christelle qui a promis de les conserver à son tour, « pour les montrer aux enfants, petits-enfants car L’union à Reims, c’est une institution ! ».
Christian Simon utilisait aussi l’estafette de L’union mobilisée lors d’événements particuliers (foires expo, courses cyclistes, épreuves sportives…). Une estafette aujourd’hui exposée au Musée de l’automobile à Reims. Pour mémoire, le journal L’union en t la commande en 1958. Le véhicule est équipé de 5 haut-parleurs. « Il a été revendu à un distributeur de pneus et le Musée l’a retrouvé. Il était dans un état pitoyable ! On l’a fait restaurer, dans sa livrée d’origine avec la participation du journal L’union, par la carrosserie Berganzoni », relate le président du Musée, Didier Carayon.




Quatre personnalités locales ont accépté de se prêter au jeu de la confidence pour expliquer leur lien si particulier avec notre journal.
Je pourrais dire beaucoup de choses sur L’union. Ma famille a souvent été évoquée dans ses colonnes, notamment mon père Jean quand il était maire de Reims, moi ensuite quand j’ai racheté notre maison de champagne, mes enfants Vitalie et Clovis qui ont repris les rênes et mon épouse Claire qui orchestre magni quement le festival des Flâneries musicales. Quand j’ai pris la présidence de la Mission Unesco Champagne puis celle des ateliers de vitraux Simon-Marq. Ce quotidien a toujours fait partie de notre vie. Je voudrais dire aux lecteurs combien il est précieux d’avoir un journal régional indépendant. Sans la voix des journalistes placés au plus proche du terrain, les choses ne se savent pas et quand elles ne se savent pas, personne n’est en mesure d’applaudir, de réagir, d’empêcher, de corriger ou d’améliorer. À travers tous ces articles, le journal fait qu’on se sent appartenir à ce territoire qu’il faut promouvoir. Merci aux équipes, dont la responsabilité est fondamentale, de ce lien quotidien entre nous tous et joyeux anniversaire.
Le propriétaire du champagne
Taittinger considère qu’à travers tous ces articles, « le journal fait qu’on se sent appartenir à ce territoire peuplé de personnes humbles ou aisées et souvent exceptionnelles ».
J’ai presque appris à lire avec le journal. Quand j’étais enfant, j’ai le souvenir des jeux organisés par le journal où on gagnait des lots. Aujourd’hui, je feuillette L’union tous les matins et je prends le temps de lire les éditions de la semaine le week-end. Je ne lis que le journal papier, j’aime le toucher, l’odeur. Depuis toujours, je puise une mine d’informations dans L’union. J’y trouve des idées, de l’inspiration. Je lis d’ailleurs le journal à l’ancienne, avec une paire de ciseaux, je découpe des articles. L’union m’est indispensable. Quand le facteur ou le porteur est en retard, on est emmerdé, il manque quelque chose. Quand on est militant de son territoire, comme je le suis, la lecture de L’union est fondamentale. Le journal est le miroir de notre territoire. Et puis, sur le plan professionnel, ma relation avec L’union est particulière. Le journal est né en 1944, la Foire de Châlons en 1947. Dès le départ, la Foire a grandi avec L’union qui a contribué à sa notoriété. Notre Histoire est liée, notre partenariat, fondé sur le principe du gagnant-gagnant, a pris aujourd’hui une dimension

Le président du Stade de Reims évoque ses rapports avec notre titre, petite « richesse familiale » qu’il parcourt depuis sa tendre enfance. L’actualité régionale le passionne.

Autant qu’il s’en souvienne, Jean-Pierre Caillot, 63 ans, a toujours été un lecteur assidu de L’union qui « a toujours été présent au sein de ma famille ». Entrepreneur, président depuis le 14 mai 2004 du Stade de Reims, club de football au riche passé et mondialement connu – « au moins autant que la cathédrale et le champagne », ce pur rémois parcourt L’union « tous les jours, à la maison ou en déplacement professionnel ou privé ».

Le commissaire général de la Foire de Châlons-en-Champagne a grandi et passé sa vie à lire L’union chaque matin. Il nous confie l’importance que le journal joue dans sa vie personnelle et professionnelle.

Jean-Pierre Caillot, le président de la remontée en Ligue 1 le 11 mai 2012 – après 33 ans d’attente – se considère, comme le journal de son territoire, comme « un ambassadeur de sa ville, de sa région ». «
Je découpe tous les articles traitant du Stade de Reims, et mon épouse, Catherine, en fait des livres reliés chaque saison. Ce qui permet de replonger dans l’histoire, de revivre les mini-crises et surtout les moments forts ».
Aujourd’hui, « j’aime prendre connaissance des infos avant de m’endormir, grâce à la version numérique. L’économie, la politique, le sport et les avis de décès, sont déchi rés quotidiennement. « Tourner les pages du journal papier le matin au petit-déjeuner, rien de plus appréciable ».
Ancien président du Champagne Basket
Michel Gobillot
À titre personnel, le journal est le lien indispensable et nécessaire entre notre territoire et ses habitants. Il me permet de suivre l’actualité locale mais aussi départementale et d’avoir un œil sur toute l’information économique du champagne, de l’agriculture, du commerce ou de l’industrie. En tant qu’ancien président de chambre de commerce, j’aime suivre toutes ces entreprises que j’ai connues par le passé.
Je suis attaché à lire L’union sur papier et non pas sur la nouvelle formule numérique parce que c’est une vieille habitude. Avec mon épouse, on consacre tous les jours un moment à lire dans les moindres détails tout ce qui est proposé dans le journal. Quand je suis en déplacement ou que je ne peux pas lire L’union, je rattrape mon retard. Toutes les rubriques m’intéressent, notamment le sport de l’ex Champagne-Ardenne et de la Marne et le haut niveau bien évidemment. Je suis attentif à tout ce qui se fait, de bien ou même moins bien d’ailleurs, et qui se développe sur mon territoire.
Par Carole Lardot
Il y a 80 ans, sortait le premier numéro de L’union. Votre titre de presse est devenu un média régional accessible sur tous les supports et toutes les plateformes.
Avant, c’était presque trop facile de sortir un journal 7 jours sur 7, 362 jours par an si l’on exclut les trois jours de non-parution. Facile, tout est relatif bien sûr. Fabriquer un journal de 54 pages en moyenne, c’est réinventer chaque jour un nouveau produit qui n’existe pas le matin même, qui sera disponible dans vos liseuses numériques aux alentours de minuit et dans vos boîtes aux lettres au petit matin. Nous avons l’habitude de dire qu’un journal, c’est un petit miracle quotidien, d’autant plus que L’union se décline en 7 éditions locales, car notre ADN, c’est l’information de proximité, celle que nous sommes les seuls à pouvoir vous délivrer. Mais aujourd’hui, on n’attend plus forcément la sortie du journal papier pour s’informer. Pour nous, ce qui est essentiel, c’est de vous délivrer une information de qualité en étant présent là où vous vous trouvez. Vous êtes un amoureux du papier, nous aussi. Vous préférez lire le journal en feuilletant notre liseuse numérique, nous avons optimisé la lecture en mode zen. Les plus dèles ne sortent jamais sans leur application chargée sur leur téléphone pour être alerté (ou non) en temps réel, découvrir les articles sélectionnés par la rédaction, paramétrer leurs préférences ou enregistrer un article à lire plus tard…En fonction du moment de la journée, vous nous consultez sur votre ordinateur, mais surtout sur votre smartphone comme 85 % de nos lecteurs numériques. Là encore, nous nous adaptons à vos habitudes de lecture. Plus de 220 000 personnes nous lisent chaque jour sur internet. L’information se décline aussi sous tous les formats et sur toutes les plateformes dans un souci d’accessibilité et d’inclusion. Nous avons réalisé un gros travail ces dernières années pour proposer une vaste o re vidéo que vous pouvez retrouver au cœur de nos articles, sur notre plateforme innovante de vidéos verticales véri-
ées, VVV, ou en suivant nos lives qui vous emmènent au cœur des événements. Et puis, il y a les réseaux sociaux. À chacun ses codes, ses habitudes. Nous vous apportons une information de qualité, véri ée, sourcée sur Instagram, LinkedIn, Facebook ou encore X, ex-Twitter. Vous êtes plus de 300 000 à nous suivre sur nos di érents réseaux. À l’heure des fake news et des IA génératives, disposer d’une information certi ée et véri ée est absolument primordial. Nous fêtons nos 80 ans cette année mais, sans vous, sans votre con ance et votre délité, rien ne serait possible. Alors continuons à inventer ensemble un média que nous aimons et qui nous ressemble.






être pratique, utile, leur faciliter la vie. »
Parler aux jeunes, d’accord, mais comment ? « #TaNews est un média 100 % digital et gratuit. Nous proposons beaucoup de vidéos, nous adoptons les codes des réseaux sociaux. Nous avons aujourd’hui une belle communauté Instagram de 1 255 followers. C’est un bon début. »
Dix-huit mois plus tard, #TaNews est structuré, animé par une dizaine de journalistes, dispose de son univers sur le site de L’union, a son code couleur violet, sa communauté composée de jeunes mais aussi de parents.



S’il y a une chose qui a révolutionné la presse écrite ces dernières années, c’est bien la vidéo. Aujourd’hui, les habitudes de lecture sur le web ont changé, un article écrit ne se conçoit plus sans vidéo. Voilà pourquoi L’union s’est doté d’un pôle audiovisuel, dont Aurélie Beaussart et Antonin Lhuillier sont les visages.
La consommation de vidéos sur Internet, elle-même, a évolué en trois ans. « Les besoins ont changé, explique Aurélie. Les gens regardent aujourd’hui les vidéos sur leur téléphone, donc en format vertical, et sans son dans 80 % des cas. De plus, la consommation de vidéos se fait en mode picoratif. Ils veulent donc des vidéos textées, courtes, avec des informations de qualité, vérifiées. » Antonin est tout aussi enthousiaste : « On passe tous nos journées sur le téléphone, pour lire nos mails, aller sur les réseaux sociaux, s’informer. On scrolle tout le temps.
L’idée qu’un média se mette au diapason des habitudes nouvelles est géniale. »

Afin de répondre à cette demande, L’union a ainsi lancé le 25 juin 2024, sur son site mobile, une nouvelle offre vidéo baptisée VVV, pour vidéo verticale vérifiée. Il s’agit d’un kiosque vidéo permettant aux internautes de s’informer au quotidien dans ce format. Une première dans la presse régionale française.
Ces nouveaux formats vidéo font évoluer la manière de travailler de nos journalistes. « Il nous faut synthétiser les sujets et reportages en quelques mots, sur une durée inférieure à une minute trente », explique Aurélie. « Ça nous oblige aussi à être très réactifs, ajoute Antonin. En un quart d’heure, le sujet vidéo est sur VVV. »
Du mardi au dimanche

Juillet-août : de 10h à 18h
Septembre à novembre : de 13h à 18h
Aurélie Beaussart

Alizée Szwarc Meireles porte plusieurs projets dans lesquels fusent la bonne humeur, les bons plans et l’envie de les partager à nos lecteurs et internautes.
Dans son panier de bonnes nouvelles, on trouve d’abord les Instants, quatre magazines élégants qui s’intéressent respectivement à Reims, à Troyes, aux Ardennes et au champagne. « C’est un travail sur le temps long, argumente-t-elle. On se pose, on rencontre les gens qui font la spécificité du territoire, qui ont des idées, qui font bouger les choses. Nous ne sommes pas dans l’actualité du quotidien, davantage dans la bienveillance et le positif. »
L’esprit « Instant » se décline en version digitale, dans un univers parallèle à L’union dénommé « Lifestyle ». On y trouve une montagne de bons plans et de conseils avisés. « Ici, le contexte de lecture est différent. On répond à d’autres besoins de nos lecteurs, qui recherchent des idées pour profiter de leur temps libre. Les sujets sont à la fois locaux, pour découvrir des bonnes adresses et des sources d’inspiration dans sa ville et son département, mais aussi généralistes avec des articles sur le bien-être, l’alimentation, les conseils pratiques ou encore les vacances. »
Dans le panier des bonnes nouvelles d’Alizée, il y a enfin Les Idéatrices, un mot d’origine québécoise qui désigne une personne dont le job est de chercher des idées, de trouver de nouveaux concepts. Celui d’Alizée est simple : « Mettre en lumière les initiatives des femmes du territoire. » Comment ? « En réalisant des portraits de femmes inspirantes, en créant des événements comme des tables rondes et des master classes, pour les présenter au public. »
Les projets ne manquent pas : un club des Idéatrices lancé en juin ; une série de vidéos sur des « femmes inspirantes » sera réalisée, dans lesquelles elles raconteront un succès, un échec, les leçons qu’elles en retirent. Il paraît même qu’un focus sur 50 femmes remarquables de nos territoires serait en gestation…

Par Grégoire Amir-Tahmasseb
Près de 900 élèves de l’académie de Reims ont participé l’an passé à ce concours de décryptage des fakes news.
Le projet est né après l’agression de notre journaliste photographe Christian Lantenois, dans un quartier de Reims en février 2021. En plein reportage, il avait été pris à partie par un groupe de jeune et violemment frappé à la tête avec son appareil photo. Une ré exion s’est engagée au sein de notre rédaction sur la méconnaissance du métier de journaliste et l’importance des médias dans la démocratie. Avait alors émergée l’idée de lancer un projet visant à éveiller l’esprit critique de nos jeunes, en les aidant à décrypter de fausses informations et en leur donnant les codes des réseaux sociaux pour éviter de tomber dans les pièges tendus.
Ce concours s’adresse aux collégiens et aux lycéens
Porté par notre journal, l’académie de Reims, le campus rémois de Sciences Po et Orange, ce concours, s’adresse aux collégiens et lycéens de l’académie. Encadrés par les journalistes de L’union – L’Ardennais et des élèves de Sciences Po dans le cadre de leur parcours civique, les élèves qui participent à Check ton info se mettent dans la peau de journalistes et mènent un travail d’enquête pour démêler le vrai du faux d’une information qu’il leur est donnée. Le tout restitué à travers une vidéo de deux minutes maximum.
Au printemps le grand amphithéâtre de Sciences Po Reims accueille la grande nale du concours de Check ton info. À cette occasion, les vidéos sélectionnées (dix dans la catégorie collège, dix dans la catégorie lycée) sont présentées au jury composé de professeurs, journalistes, représentants de nos partenaires ainsi que du parrain de la promotion (Maxime Valette, l’année dernière).
Les trois meilleures vidéos par catégorie reçoivent un Check d’or, d’argent et de bronze. Les lauréats collège et lycée sont ensuite les rédacteurs en chef d’un jour de L’union – L’Ardennais avant la n de l’année scolaire. Depuis son lancement en 2022, Check ton info ne cesse de prendre de l’ampleur. 865 élèves étaient ainsi inscrits à la deuxième édition l’an passé contre 500 la première, avec près de 100 capsules vidéos réalisées.




































































































































CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST - Société coopérative à capital variable - Agréée en tant qu’établissement de Crédit - Société de courtage d’as-surances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le n° ORIAS 07 022 663 – RCS Reims n° 394 157 085 – Siège social : 25 rue Libergier – 51100 REIMS. IDU ADEME : FR234269_01FBNY.
Depuis deux ans, le pôle Innovation et Développement de Rossel Est Médias conjugue qualité éditoriale et rentabilité économique, tout en renforçant ses liens avec le territoire et ses habitants. Ce travail de fond, combiné à une stratégie numérique ambitieuse, positionne le pôle comme un acteur incontournable au sein de nos titres.
Entre nous, on l’appelle le pôle «ID», un acronyme facile à retenir et révélateur de sa mission. Créé en septembre 2022, dans la foulée du travail accompli par Sébastien Lacroix, le pôle Innovation et Développement de Rossel Est Médias a pour mission de répondre aux attentes croissantes des lecteurs et des annonceurs par des initiatives éditoriales et événementielles novatrices. Ce service, désormais dirigé par Nicolas Fostier, journaliste à l’Union depuis 1996, se réinvente constamment pour renforcer l’impact du groupe sur son territoire.
Valoriser les forces vives locales
Ainsi, le pôle ID s’attache à mettre en lumière les initiatives locales en capitalisant sur le dynamisme des départements couverts par Rossel Est Médias (Marne, Ardennes, Aisne et Aube). Cette mission repose sur une collaboration étroite entre tous les services de l’entreprise : rédaction, régie publicitaire, marketing, comptabilité ... « C’est cette synergie qui garantit la cohérence et le succès de nos projets. », estime Nicolas Fostier
Les événements organisés par le pôle, tels que les divers salons (immobilier, emploi-formations, ...), les Étoiles de l’Union, les Étoiles de l’Agriculture, le Marnais de l’année, l’opération « Sauvons notre patrimoine » ... sont devenus des rendez-vous incontournables du calendrier régional. Ces événements ne se contentent pas de récompenser les acteurs économiques locaux ; ils renforcent également les liens entre les lecteurs, les annonceurs et les titres du groupe.
La rentabilité et l’exigence éditoriale
Évidemment, l’innovation doit rimer avec viabilité économique. Et c’est conscient de cette réalité que le pôle a intégré la rentabilité comme un critère central de ses initiatives. En collaboration avec la régie commerciale (RCMEst) et la direction des a aires nancières (DAF), chaque projet fait l’objet d’une analyse rigoureuse en amont. Cependant, bien que le pôle cherche à séduire les annonceurs, il n’en oublie pas
L’équipe du pôle ID en 2024
Nicolas Fostier : directeur
Régis Vaillant : directeur exécutif
Amal Hadi : responsable événementiel
Alizée Szwarc : responsable de projets magazines Instant/les Idéatrices
Fanny Diard et Léa Nicolats : Assistantes marketing
Manon Postal et Léa Laurent : chargées de communication éditoriale et développement web

Chaque année, l’union organise la soirée des Etoiles de l’Économie.
pour autant son engagement envers la qualité éditoriale. Les contenus produits, qu’il s’agisse de suppléments thématiques (emploi-formation, immobilier, santé, etc.) ou de magazines (Guide éco, Atlas éco, Balades, Un été dans l’Aube, etc.), sont élaborés avec une rigueur journalistique et en lien direct avec l’actualité. Cette exigence garantit non seulement la satisfaction des lecteurs, mais aussi l’attractivité des supports pour les annonceurs. Un cercle vertueux en somme.
Un engagement fort envers le territoire Et puis, le pôle ID ne se contente pas de valoriser les talents du territoire ; il joue également un rôle actif dans la création de marques et d’événements qui résonnent avec les aspirations des communautés locales. Des projets, voire des marques, comme « L’Instant », « Les Idéatrices », « Terres de champagnes », « Visite Ma Boîte » ou « La Grande Dégustation » témoignent de cette ambition. De même, des initiatives comme les « Face aux lecteurs », « La Classe philo » ou « Les voyages de lecteurs » renforcent le lien entre les abonnés et les titres du groupe, contribuant ainsi à un sentiment d’appartenance plus fort.
La transition numérique au cœur de la stratégie
En n, la transition numérique est bien sûr au cœur des priorités du pôle ID. Depuis deux ans, une véritable synergie entre les contenus print et web a été mise en place, assurant une di usion optimale sur les plateformes digitales et les réseaux sociaux. La marque « Instant », fer de lance de la verticale « lifestyle », en est un parfait exemple. En l’espace d’un an, elle a vu son audience passer de 148 000 à 620 000 pages vues, tandis que les communautés sur Facebook et Instagram ont connu une croissance signi cative. Le nombre d’abonnés aux newsletters départementales dépasse désormais les 10 000, ce qui con rme le succès de cette stratégie numérique.

Les plus grandes marques de véhicules de loisirs exposées sur un parc de + de 15 000 m2.










Hybride ou 100% Électrique
Disponible en 5 ou 7 places

Bientôt disponible en concession

















IIl emballe, nettoie, allume le feu ou tapisse le fond de vieux cartons. Désormais, une autre vie attend votre vieux journal : transformé en ouate de cellulose, il pourra isoler les combles de nouvelles constructions. Cette initiative insolite a vu le jour à la Voix du Nord il y a quelques mois et sera déployée pour l’ensemble des titres de Rossel Est Médias dès la rentrée. Le principe est très simple et ne demande qu’un petit e ort aux lecteurs : remettre leurs vieux journaux dans leur boîte aux lettres, y apposer un petit aimant qui signale au colporteur que les journaux peuvent être récupérés à l’occasion de sa tournée quotidienne. Une fois récupérés, les vieux journaux seront acheminés vers une usine partenaire pour être transformés. Un projet vertueux à tous points de vue, puisque les colporteurs seront rémunérés en fonction de la quantité de journaux récoltés et ramenés à l’imprimerie. De là, ils partent pour la Belgique, à Ciney, pour être transformés. « L’ouate de cellulose est un isolant biosourcé, donc durable et non toxique, explique Philippe Sun, directeur de l’usine d’Isoproc. En termes de qualité, il est très performant, été comme hiver, et en termes de durabilité, il est facile à récupérer après le chantier et à réutiliser, ce qui n’est pas le cas des autres isolants. »
L’énergie nécessaire à la fabrication de ce matériau est d’ailleurs trois fois moins importante que pour celle de la laine minérale (laine de verre, laine de roche) et vingt fois moins importante que celle du polyuréthane.
« Pour un abonné, il faut à peu près trois ans de collecte pour isoler 150 m2 de toiture, détaille Philippe Sun. Ça correspond à peu près à 1 000 journaux pour isoler une maison. » Depuis le lancement de l’opération, près de 2,5 millions de journaux ont déjà été récupérés dans le Nord et le Pas-de-Calais. Un petit geste pour les abonnés, mais de grandes conséquences positives et locales pour notre journal.


de vos journaux
de vos journaux et revalorisation
Imprimerie





VÉHICULE PRÉSENT À LA FOIRE DE CHALONS DU 30 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE





en qu atre a ffi che s
QQQuatre-vingts ans. Un bel âge. Pour marquer cette date, il fallait que l’on puisse conserver un souvenir de l’anniversaire de L’union. Ce journal collector est un premier témoignage. Aussi passionnant soit-il, ce ou posé sur une table basse. Convenons-en, ce n’est pas le plus design des objets de déco. Voilà pourquoi no us avons au ss i eu l’idée de con cevoi r de L’union.
Il se trouve que, dans la Marne, une entreprise est
géné ralement de l’ide ntité champenois e. Cet te activité est née de la passion pour le dessin de Philippe Joudart, le directeur de Cochet Concept, une agence de communication installée à Épernay, la capitale du champagne. Lorsque nous lui avons retraçant quatre époques de L’union, il a quasiment sau té de joi e, lu i qui nou rr it un e relation très particulière avec le titre. Lecteur assidu depuis sa plus tendre enfance, il a été correspondant de L’union, dans l’édition sparnacienne, entre 1984 et 1988.
Un jol i tr ai t d’unio n
Des décennies plus tard, il n’a pas repris la plume mais
Joudart.
l’Histoire du quotidien, associées à quatre lieux ou
bâtim ent hi storique de L’ unio n p la ce d ’E r lo n (1944-1964), la Foire de Châlons (1964-1984), la cathédrale de Laon (1984-2004) et le nouveau siège du journal dans les vignes (2004-2024). Un joli trait d’union entre l’histoire de L’union et celle de son territoire.
la Foire de Châlons-en-Champagne, au stand de L’union.































































































































