BYUNG-CHUL

HAN




































BYUNG-CHUL
























































































traduit de l’allemand par Olivier Mannoni
















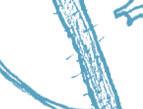
















































































Interroge les bêtes, elles t’instruiront, Les oiseaux du ciel, ils te l’apprendront ; Parle à la terre, elle t’instruira ; Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve Que la main de l’Éternel a fait toutes choses ?
Job 12, 7-91
1. Traduction de Louis Segond. (Toutes les notes sont du traducteur.)
AVANT-PROPOSJ’ai un jour éprouvé un désir profond et ardent, mieux, un besoin aigu d’être proche de la terre. J’ai donc pris la décision de jardiner quotidiennement. Pendant trois printemps, étés, automnes et hivers, c’est-à-dire trois années durant, j’ai travaillé dans le jardin que j’avais appelé Bi-Won (en coréen “Jardin secret”). Sur le panonceau en forme de cœur que mon prédécesseur avait accroché à un arceau de rosier, on lit encore “Jardin de rêve”. Je l’ai laissé en place. Après tout, mon jardin secret est lui aussi un jardin de rêve, puisque j’y rêve de la terre à venir.
Le jardinage a été pour moi une méditation silencieuse, un séjour dans le silence. Avec lui, le temps était durable et parfumé. Plus je travaillais dans mon jardin, plus j’éprouvais du respect pour la terre et sa beauté enivrante. Je suis aujourd’hui profondément persuadé que la terre est une création divine. Le jardin m’a aidé à acquérir cette conviction, mieux, cette compréhension aujourd’hui devenue une certitude et qui a pris le caractère d’une évidence. “Évidence”, à l’origine, signifie “voir”. Je l’ai vu.
Le séjour dans le jardin en fleurs m’a redonné la piété. Je crois que le jardin d’Éden a existé et existera. Je crois en
Dieu, je crois en le créateur, à ce joueur qui recommence toujours à zéro et, ce faisant, renouvelle tout. Parce qu’il est sa création, l’homme a lui aussi le devoir de participer au jeu. Le travail ou la performance détruisent le jeu. Ils constituent une action aveugle, nue, sans langage.
Certaines lignes du présent livre sont des prières, des professions de foi, mieux, des déclarations d’amour à la terre et à la nature. Il n’y a pas d’évolution biologique. Tout est dû à une révolution divine. J’en ai fait l’expérience. La biologie est en dernier ressort une théologie, une théorie de Dieu.
La terre n’est pas un être mort, inanimé, muet, mais une créature vivante et éloquente, un organisme vivant. Même la pierre vit. Cézanne, qui était possédé par la montagne Sainte-Victoire, connaissait le mystère, il savait que la roche avait une vitalité et une force particulières. Lao-tseu l’enseigne déjà :
Le monde est comme une coupe pleine de mystères. On ne peut pas le saisir. Qui veut le comprendre le perdra.
Elle est fragile, la terre, cette écorce mystérieuse. Nous nous employons aujourd’hui à l’exploiter brutalement, à lui rouler dessus et à l’user jusqu’à la corde, et nous la détruisons ainsi totalement.
La terre nous intime l’ordre de la ménager, c’est-à-dire de la traiter avec beauté. La beauté nous oblige, mieux, nous commande de la ménager. Ménager la terre est une mission que l’humanité doit remplir d’urgence, car la terre est belle, mieux, elle est magnifique.
Le ménagement appelle l’éloge. Les lignes qu’on lira ici sont des hymnes, des chants de louange à la terre. Il faudrait que cet éloge de la terre produise les sons d’un beau chant de la terre. Mais certains y liront un message de malheur, compte tenu de la puissance des catastrophes naturelles qui nous frappent aujourd’hui. Elles sont la réponse colérique de la terre à la brutalité et à la violence humaines. Nous avons perdu tout respect pour la terre. Nous ne la voyons et ne l’entendons plus.

J’ai un amour tout particulier pour Le Voyage d’hiver de Schubert. J’ai souvent chanté le lied “Rêve de printemps” :
Je rêvais de fleurs aux couleurs vives, Comme il en éclôt en mai ; Je rêvais de vertes prairies, Et du chant drôle des oiseaux.
Quand les coqs se mirent à crier, Alors mon œil s’éveilla ; Il faisait froid et sombre, Les corbeaux sur le toit craillaient.
Mais qui au verre de la fenêtre, S’occupait à peindre les feuilles ? Vous riez sans doute du rêveur Qui voyait des fleurs en hiver1 ?
Pourquoi commencer un livre sur le jardin par l’hiver et Le Voyage d’hiver ? Alors que cette saison signifie la fin absolue du temps du jardin ? Je n’ai pas l’intention de raconter ici
1. Extrait du lied “Frühlingstraum” du cycle Voyage d’hiver.
mes rêves de printemps, pas plus que de prendre la succession de Wilson Bentley, qui a photographié cinq mille flocons de neige, en me consacrant quant à moi aux fleurs de givre.
L’hiver berlinois est terrible, pis, il est destructeur. Le feu des enfers serait plus supportable que cette froideur éternelle, humide et sombre. La lumière semble tout à fait éteinte.
Ce n’est rien que l’hiver, L’hiver froid et sauvage1 !
Face au gris éternel de l’hiver berlinois s’éveille un désir métaphysique de jardin lumineux et en fleurs au cœur de l’hiver.
Le jardin idéal de Bertolt Brecht ne prévoit malheureusement rien pour les mois froids de l’hiver. Il ne fleurit que de mars à octobre :
Au bord du lac, caché entre sapin et peuplier À l’abri de murs et de buissons, un jardin, Si sagement planté de fleurs mensuelles, Qu’il fleurit de mars en octobre2 .
Je suis manifestement dépourvu de cette sagesse du jardinier, moi qui ai pris la résolution d’aménager un jardin qui fleurit en permanence, de janvier à décembre.
Je préfère la métaphysique, le désir métaphysique, à la sagesse du jardinier, à son “laisser-faire”.
1. Extrait du lied “Der stürmische Morgen” du cycle Voyage d’hiver.
2. Extrait du poème “Der Blumengarten” de Bertolt Brecht.
Un désir métaphysique analogue anime La Chambre claire de Roland Barthes. C’est un livre de deuil, un travail de deuil. Il invoque la mère défunte avec laquelle l’auteur a vécu toute sa vie. Le livre se fonde sur une photographie que Barthes serre avec ferveur, mieux, qu’il embrasse, qu’il entoure de son exaltation, mais qui n’y est pas reproduite. Elle brille par son absence. La photo montre sa mère, petite fille de cinq ans, dans le Jardin d’Hiver. Perdu au fond du Jardin d’Hiver, le visage de ma mère est flou, pâli. Dans un premier mouvement, je me suis écrié : “C’est elle ! C’est bien elle ! C’est enfin elle1 !”
Barthes distingue deux éléments dans la photographie : le studium et le punctum. Le studium porte sur les informations qu’on peut extraire de la photo. Il permet de l’étudier. Le punctum en revanche ne fournit pas d’information. Littéralement, ce mot signifie le “piqué” et remonte au mot latin pungere (“piquer”). Il poigne et atteint l’observateur.
1. Roland Barthes, La Chambre claire. Note sur la photographie, Cahiers du Cinéma-Gallimard-Seuil, Paris, 1980, p. 154-155.
Le punctum de La Chambre claire est pour moi ce jardin d’hiver où se trouve sa mère, son unique aimée – un jardin dont l’image n’est pas reproduite. Je vois à présent le jardin d’hiver en double. Lieu symbolique de la mort et de la résurrection, lieu de travail de deuil métaphysique. La Chambre claire est à mes yeux un jardin en fleurs, une lumière vive dans l’obscurité hivernale, une vie qui bat au cœur de la mort et célèbre la vie qui se réveille, au cœur de l’existence mortelle qui est aujourd’hui la nôtre. Une lumière métaphysique transforme la chambre noire en une chambre claire, en un jardin d’hiver lumineux. Roland Barthes aimait les lieder romantiques. Il prenait des cours de chant. J’aurais bien aimé l’entendre chanter. J’ai souvent le sentiment que Barthes écrit en chantant ou chante en écrivant. La Chambre claire est une sorte de cycle romantique comportant quarante et un chapitres comme autant de lieder. Dans le vingt-neuvième chapitre, il parle de la “petite fille”. La Chambre claire a pour moi la sonorité d’un Voyage d’hiver. Roland Barthes voyage en quête de sa mère, de sa bien-aimée, à travers le royaume des “Morts”. Il s’adonne à une pérégrination sans fin en quête de la vérité de sa mère.
Je ne pouvais non plus omettre de ma réflexion ceci : que j’avais découvert cette photo en remontant le Temps. Les Grecs entraient dans la Mort à reculons : ce qu’ils avaient devant eux, c’était leur passé. Ainsi ai-je remonté une vie, non la mienne, mais celle de qui j’aimais1 .
1. Ibid., p. 111.
La photographie du Jardin d’Hiver est pour lui comme la dernière musique qu’écrivit Schumann avant de sombrer, ce premier Chant de l’Aube “qui s’accorde à la fois à l’être de ma mère et au chagrin que j’ai de sa mort1”.
Les Chants de l’aube , un cycle de cinq petites pièces, forment la dernière œuvre pour piano de Schumann. Trois jours avant sa tentative de suicide, il les qualifiait de “recueil de morceaux de musique décrivant les sensations que l’on éprouve à l’approche et au lever du jour2”. Clara Schumann réagit dans un premier temps avec désarroi à cette composition : “Une fois encore, ce sont des pièces tout à fait originales, mais difficiles à appréhender, il y a là-dedans une ambiance tout à fait particulière3.”
Les Chants de l’aube sont dominés par la nostalgie de la vie qui se réveille, qui ressuscite. Ce sont des chants de deuil. On y perçoit une profonde mélancolie. Il y est question de mort et de résurrection. Les Chants espagnols de Schumann expriment déjà l’attente ardente du matin, de la vie qui se réveille :
Quand, quand naîtra le matin, Quand donc, quand donc ! Qui libérera ma vie de ces liens ?
Ses yeux, si ternes de souffrance, Ne voyaient que tourment en place de l’amour,
1. Ibid., p. 110.
2. Lettre à l’éditeur Arnold, 24 février 1854.
3. Journal de Clara Schumann, 18 octobre 1853.
Ne voyaient pas une seule joie, Ne voyaient que blessure sur blessure, Douleur sur douleur à moi infligée, Et dans la longue vie Pas une heure de joie. Si cela pourtant se produisait enfin, Que je voie enfin l’heure, Où je ne verrai jamais plus ! Quand naîtra le matin, Qui libérera ma vie de ces liens. Une aura de mystère entoure le premier Chant de l’aube. La mélancolie abyssale s’évade ensuite dans le délire. Elle est interrompue par des moments de jubilation retenue et des instants de transfiguration et de ravissement au cours desquels les premiers rayons lumineux percent timidement l’obscurité.
Ces premières heures du matin sont un temps préalable, antéposé au temps ordinaire. Le temps éphémère, le temps de la vie et de la mort, y est aboli. Ces Chants de l’aube animent, mettent mon imagination au diapason du jardin d’hiver en fleurs. Ils constituent la tonalité fondamentale du présent livre.
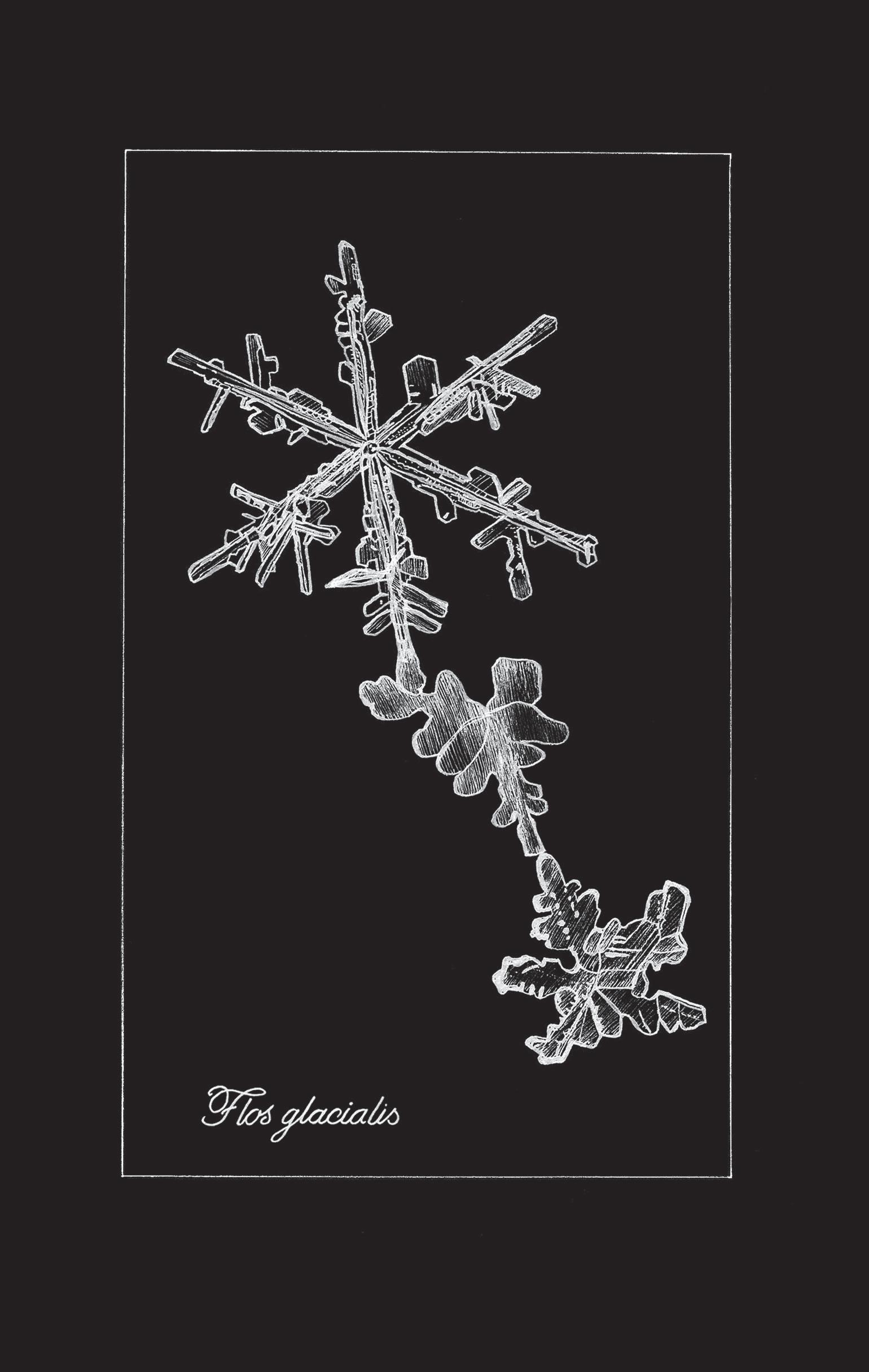
Trois années durant, Byung-Chul Han s’est consacré à son jardin, près du lac Wannsee, à Berlin. Le jardinage a été pour lui un exercice de méditation, un séjour dans le silence, dans un temps durable et parfumé. “Nous devrions réapprendre à regarder la terre, sa beauté, son étrangeté, son unicité avec étonnement. C’est au jardin que j’en fais l’expérience : la terre est magie, énigme et mystère. La traiter comme une ressource à exploiter, c’est déjà la détruire.” Avec Byung-Chul Han, la pratique du jardinage n’a rien d’un loisir, c’est une expérience profondément physique, spirituelle, esthétique. “Chaque jour que je passe dans mon jardin est une journée de bonheur. Le présent livre aurait aussi pu s’appeler Essai sur la journée réussie.”
Né en Corée du Sud en 1959, Byung-Chul Han a entamé des études de métallurgie à Séoul avant de venir étudier la philosophie, la littérature allemande et la théologie catholique en Allemagne. Docteur en philosophie, il a enseigné cette matière dans plusieurs universités, dont celle des arts de Berlin. Parmi ses ouvrages traduits en français : La Société de la fatigue (Circé, 2014) ; Dans la nuée. Réflexions sur le numérique (Actes Sud, 2015) ; Sauvons le beau. L’esthétique à l’ère numérique (Actes Sud, 2016) ; Thanatocapitalisme (PUF, 2021) ; La Fin des choses. Bouleversements du monde de la vie (Actes Sud, 2022).
ACTES SUD






www.actes-sud.fr Conception de couverture : Christel Fontes, d’après les dessins d’Isabella Gresser D É P. L É G. : JANVIER 2023 / 17 € TTC France ISBN 978-2-330-17313-5



















































