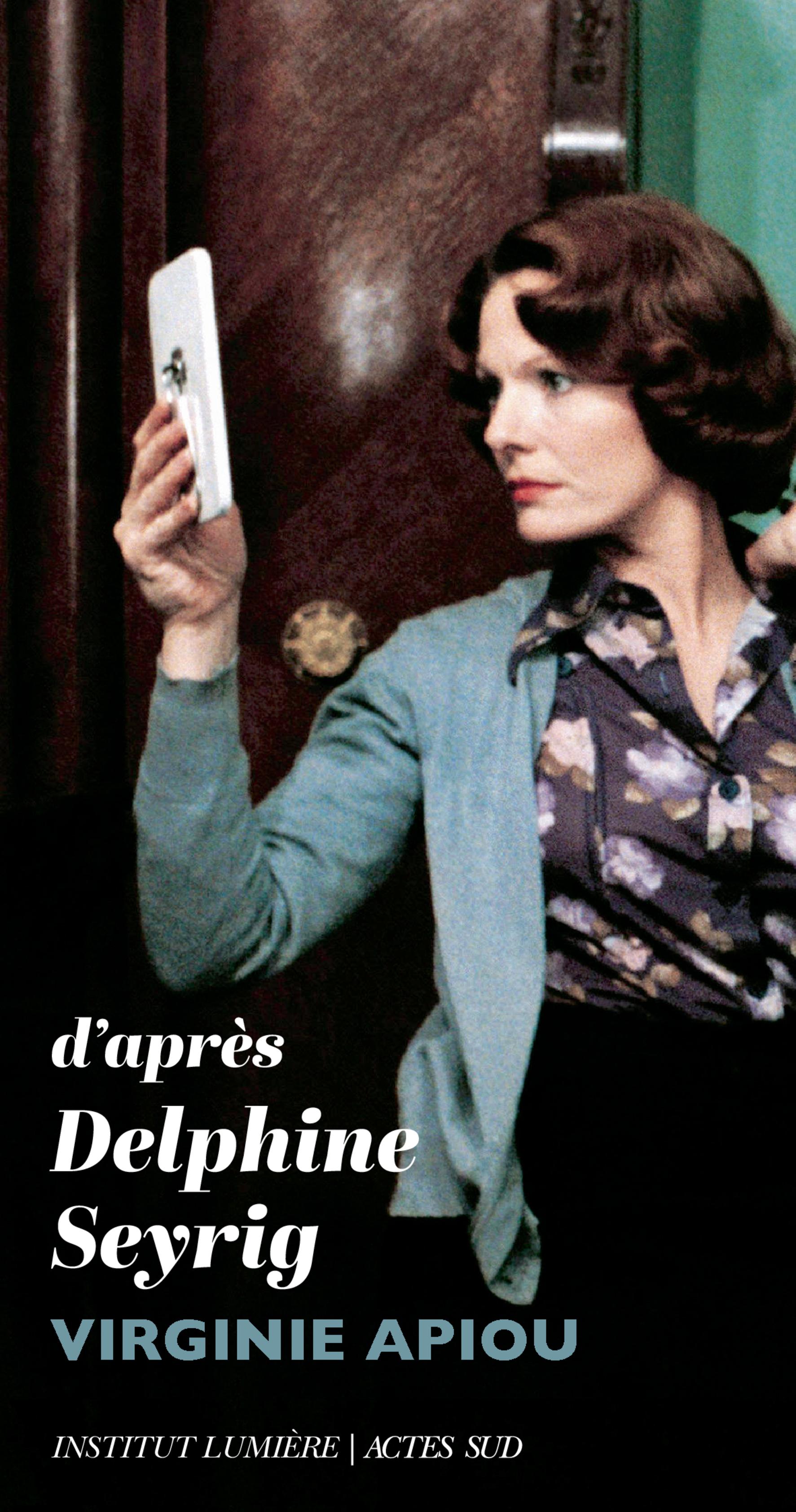
“Les choses toutes crues.”
Repérages, de Michel Soutter, Gaumont, 1977
Assise en tailleur sur une banquette large et écrue, constellée de coussins, dont un à motifs fleuris dans un style traditionnel Europe de l’Est, Delphine Seyrig peigne Olivia, une chatte angora blanche, âgée de seize ans. En 1980, la comédienne réalisatrice vit à Paris dans un appar tement très personnel. Aux murs, des œuvres pop et abstraites de son mari, le grand peintre américain Jack Youngerman, dont elle est divor‑ cée depuis longtemps. Pas de doute, Seyrig, une certaine nervosité, et un sentiment de joie vio‑ lente et politique, est prête pour son interview, prête à dire les choses toutes crues.
Concentrée et disponible à la fois, elle reçoit le magazine de télévision populaire des années 1980 : 30 millions d’amis. Avec son sourire légendaire, un t‑shirt portant l’inscription “The Old Vic”, en
hommage à la célèbre compagnie de théâtre shakespearienne, elle parle et fume.
Les cheveux roux, bouclés et flous, elle caresse Olivia, qui fut aussi sa partenaire de jeu en 1965 dans La Collection, une pièce cruelle d’ambiguïté d’Harold Pinter avec un Jean Rochefort mali‑ cieusement jaloux de la proximité de cet animal avec la comédienne. Révolution, chatte persane noire, née le 8 mai 1968, n’est pas loin. Seyrig porte sur ses deux bêtes un regard très naturel, sans obsession ni fétichisme, avec une distance très calme et réfléchie.
Accroupie dans sa cuisine, la main sous leurs gueules, la comédienne démontre de façon très docte comment leur donner un médicament afin que ces animaux à pelage long et fourni digèrent leurs poils. Les portes des placards autour forment un cocon original. On les croi rait sortis d’un cèdre du Liban, avec des formes rondes et une couleur chaude et boisée caramel clair, que Seyrig manœuvre, ouvre, ferme d’un petit coup latéral de hanche, avec une aisance légère. Elle parle très sérieusement, comme elle dirait un texte anglais distancié qui cache mille secrets tranchants de Pinter, ou un exercice de discours réel autour de la passion, imaginé pour elle par Marguerite Duras. “Petites pâtes, petits vermicelles et une espèce de poule au pot avec carottes et poireaux”, la comédienne découpe
le tout minutieusement, pour que, dit‑elle, ses “animaux restent en vie le plus longtemps pos‑ sible”, la moindre des choses selon Delphine, quand on a pris la responsabilité de vivre avec des animaux.
Tout cela se fait dans une harmonie très par‑ ticulière, ni bourgeoise ni branchée, mais le fruit de toute une histoire. Celle d’une femme à la vie personnelle qu’elle a toujours voulue secrète et dont la carrière artistique est paradoxalement totalement tournée vers l’intime. Abandonnée à la caméra de 30 millions d’amis, Delphine Sey rig ne veut pas qu’on la prenne pour une autre. Quoi de mieux qu’une émission animalière à succès pour laisser deviner qui l’on est ?
“Je ne suis pas une intellectuelle. Je n’ai pas le bachot et je lis Les Trois Mousquetaires.”
Avec l’autorisation de son père qui lui écrit
“Je parie sur toi, petit poney”, Delphine Sey‑ rig ne passe pas son bac ! À seize ans, elle vit en France depuis seulement deux ans, et se déplace en vespa dans Paris. En 1949, cette adolescente “pleine de dents rieuses” écrit un journal tra versé de très justes questions sans snobisme : “Pourquoi fait‑on des études à notre âge ?” Pour quelles raisons s’enfermer dans un cursus pas fait pour elle, alors qu’elle se définit comme un “territoire” à connaître, “une grotte” à explorer ? 9
Seyrig cherche déjà une autre image de la femme. Elle écrit avec des idées et des mots inhabituels, bien à elle. Car que peut‑on découvrir dans une grotte où tout est sombre et humide ? Quelques chauves souris, bestioles aériennes adorables qui aiment la nuit, ne vivent qu’en hauteur, jamais à ras de terre, et sont capables d’avoir mille quatre cents apparences, mille quatre cents sortes. Mul‑ tiples, les chauves‑souris sont nimbées de mys‑ tère. Un peu magiques, souvent entourées d’idées reçues, elles sont, selon les époques, d’influence solaire ou néfaste. Les chauves souris sont for cément des actrices. Delphine Seyrig, adoles cente en plein vol, pensait‑elle aux insaisissables petites chauves‑souris quand elle a écrit le mot grotte ? Probablement pas. Peut‑être a‑t‑elle plu‑ tôt vu ou entendu parler de certains grands rôles féminins qui transpercent le cinéma dont elle voit les affiches dans ce Paris d’immédiat après Seconde Guerre mondiale ? A t elle été emportée par Jennifer Jones dans le rôle de Pearl Chavez, la jeune métisse tourmentée jusqu’au toxique, rampant à mort dans la poussière du western d’amour fou Duel au soleil de King Vidor, réa‑ lisé en 1947 ? A‑t‑elle été interpellée par les cernes splendides et le sourire des commissures des lèvres vers le bas de la spectaculaire Bette Davis en 1950, dans le rôle de Margo Chan‑ ning, la comédienne flamboyante et vieillis‑ sante qui ne se démonte jamais dans All About Eve de Joseph L. Mankiewicz ? À moins que
Seyrig encore ado ne soit impressionnée par le scandale du moment autour d’Ingrid Bergman, comédienne qu’elle admire. Bergman vient de se faire proscrire d’Hollywood pour avoir choisi de vivre libre, de tout quitter, famille et métier, pour partager la vie et le travail du cinéaste ita lien Roberto Rossellini. En cette année 1950, Delphine a‑t‑elle vu Stromboli ? Comédienne débutante, a‑t‑elle été marquée par l’histoire de Karen, jeune femme retorse qui se sert de tout, y compris de l’antipathie, pour se trouver et s’im‑ poser sur l’île volcanique et rêche ?
En 1961, Delphine Seyrig répond à l’une de ses premières interviews. Attentive, filmée en noir et blanc, elle commence par craquer une allu‑ mette pour sa cigarette sans filtre. Brune, sou‑ riante, elle a un visage de femme si prononcé qu’on pourrait croire qu’un tel ovale n’a jamais été un jour celui d’une jeune fille aux joues pleines. Cadrée en gros plan, elle détaille ses rôles avec l’illumination de ceux qui ont trouvé leur façon de négocier avec le monde. Elle se souvient… 1950, elle a dix ‑ huit ans. La majorité de l’époque est à vingt et un. Elle joue au théâtre du Quartier latin, une salle minuscule, une pièce intitulée L’Amour en papier, sortie de l’es prit musical de Louis Ducreux. Ducreux est un homme léger. Parolier de la chanson sur la vie et les amours de La Ronde de l’élégant Max Ophuls, c’est aussi le compositeur et comédien que l’on
retrouvera en vieil homme injuste et poétique dans Un dimanche à la campagne de Bertrand Tavernier des décennies plus tard.
L’Amour en papier est une petite comédie loufoque. Les personnages d’un hebdomadaire illustré s’animent tout à coup, font connais sance, nouent des liens dans tous les sens. Toy Story avant l’heure ! Qualifié d’“idées charmantes et d’une alerte fantaisie” dans Paris-Presse, de “poésie légère, une drôlerie sans prétention, des fleurs artificielles si bien arrangées qu’on leur croit un parfum”, d’“art qui craque comme le papier d’un bonbon fondant” dans Le Monde, L’Amour en papier offre à une Delphine Seyrig enthousiaste et amusée pas moins de six rôles ! Sur scène, elle est tour à tour Bébé Isidore, Com‑ mère, Mme Chapeau pincé, Gaby Kini, et, ses deux préférés la Robote Betty, “amoureuse d’un coureur cycliste”, et le chat. Le chat, forcément.
Puis Delphine part. Elle découvre la pro‑ vince merveilleuse, rythmée par des tournées en Rhône‑Alpes avec le comédien‑metteur en scène Jean Dasté, charmant de rondeur pater‑ nelle, “très important pour moi”, dit‑elle.
“Il n’y a pas une culture pour les ouvriers et une pour la bourgeoisie, il n’y a qu’une culture à laquelle tout le monde devrait accéder. Il n’y a pas d’art populaire, il y a l’art tout court qui devrait exprimer l’aspiration de tout un peuple, et cela est encore plus vrai pour le théâtre, qui
rassemble tout le monde dans un même lieu, pour une même communion.” Sans doute cette profession de foi de Dasté, si essentielle, si simple et débarrassée de tout cliché ou élément de lan‑ gage, a t elle emporté Delphine. Convaincue, la jeune fille embarque et monte dans le car estampillé Comédie Jean Dasté, qui se déplace “dans des tout petits patelins”, avec des décors si malins qu’ils peuvent être installés en un rien de temps, n’importe où, notamment dans des salles de cinéma sans films. En Dasté, la minus‑ cule actrice, mini chauve souris débutante, voit le jeune homme spontané, merveilleux d’intelli gence innocente, qui joua dans L’Atalante du bla‑ gueur Jean Vigo en 1934. Une Delphine Seyrig au masculin au même âge, une même envie de suivre les choses instinctivement. Plus de quinze ans plus tard, Dasté est devenu un passionné de la décentralisation artistique, avec la comédie de Saint Étienne, une coopérative ouvrière d’inté rêt public régional.
En 1987, désormais âgé, installé dans son salon provincial, aimable, les mains grandes ouvertes, Dasté est interrogé sur ce temps de l’itinérance avec sa troupe. “C’était une époque où les comé diens d’abord étaient jeunes, ils n’avaient pas envie d’aller à Paris, et il s’est trouvé que la pauvreté nous unissait.” Sur les photos en noir et blanc légère‑ ment floues, toute la troupe charge et décharge le bus Comédie Jean Dasté ; puis tout le monde
pose à l’intérieur avec le sourire de ceux qui vivent un rêve. “Nous avons eu une cote populaire assez vite et assez grande grâce aux représentations en plein air.” Sur les places des villages, devant des gamins, pépés et mémés, gendarmes, habitants à leurs fenêtres, gens du quartier, Dasté et Seyrig jouent le grand répertoire. Bras et mains derrière le dos, bien droite, elle porte la robe xviie d’un personnage du Misanthrope de Molière. Puis la voilà devant Dasté, enrobée dans une sorte de costume bizarre, outrageusement maquillée, elle est Ariel dans La Tempête de Shakespeare, un esprit ludique et chantant qui, lorsque son maître lui demande ce qu’il réclame, répond : “Ma liberté !” Plus tard, elle est l’intenable Chéru‑ bin dans Le Mariage de Figaro de Beaumarchais, un être léger qui ne cesse de tourner autour des adultes pour obtenir ce qu’il veut. Ariel et Ché‑ rubin échappent à tout, y compris aux codes des genres. Ils ne sont ni vraiment homme, ni vraiment femme, tout à la fois masculins et/ou féminins. Ce sont des possibilités à l’infini pour une Seyrig qui expérimente la sensation qu’une actrice peut s’offrir tous les rôles, sans se préoc‑ cuper des genres. C’est le seul métier qui permet ça. En 1969, après des années d’expérience, Del phine conclura qu’“au théâtre quand on devient très vieux, on pourrait jouer des rôles indifférem‑ ment, extrapoler. À partir d’un moment ça n’a plus d’importance d’être femme ou homme”.
Retour en 1961, alors qu’elle vient d’explo‑ ser dans un film‑cathédrale : L’Année dernière à Marienbad d’Alain Resnais. Sa cigarette tou‑ jours entre les doigts, Seyrig répond aux ques‑ tions sur son métier. Elle se dit prête à repartir à tout moment en province avec la troupe ambu‑lante de Dasté. Elle pense à lui qui aime jouer et transmet sans doute encore sa passion à tous les jeunes comédiens de sa troupe.
“Quand j’étais petit j’adorais me transformer, j’aimais jouer ! Eh bien la première chose pour un comédien, c’est d’avoir du plaisir et d’avoir envie de jouer et au fond de retrouver un état d’enfance.” Del‑phine recherche aussi le plaisir de jouer. Elle garde comme Dasté quelque chose de l’enfance : une spontanéité instinctive qui lui donne le droit et la grâce de dire ce qu’elle veut de manière directe.

