PAYSANS ET CITOYENS
ENQUÊTE SUR LES NOUVEAUX LIENS À LA TERRE
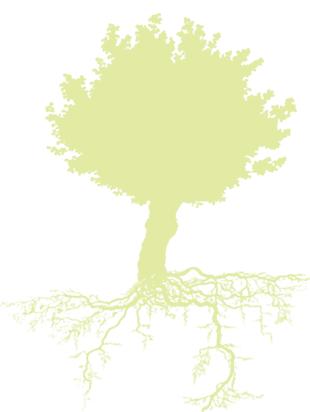


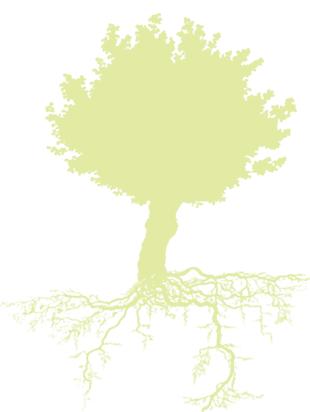

L’autrice de cet ouvrage a bénéficié d’une aide à l’écriture de la Région Nouvelle-Aquitaine.
Collection créée par Cyril Dion en 2011.
© Actes Sud, 2023
isbn 978-2-330-18083-6
www.actes-sud.fr
ENQUÊTE SUR LES NOUVEAUX LIENS À LA TERRE
DOMAINE DU POSSIBLE ACTES SUD
La Terre a perdu sa solidité et son assise, cette colline, aujourd’hui, on peut la raser à volonté, ce fleuve l’assécher, ces nuages les dissoudre. Le moment approche où l’homme n’aura plus sérieusement en face de lui que lui-même, et plus qu’un monde entièrement refait de sa main à son idée – et je doute qu’à ce moment il puisse se reposer pour jouir de son œuvre, et juger que cette œuvre était bonne.
Julien Gracq, Nœuds de vie, éditions Corti, 2021.

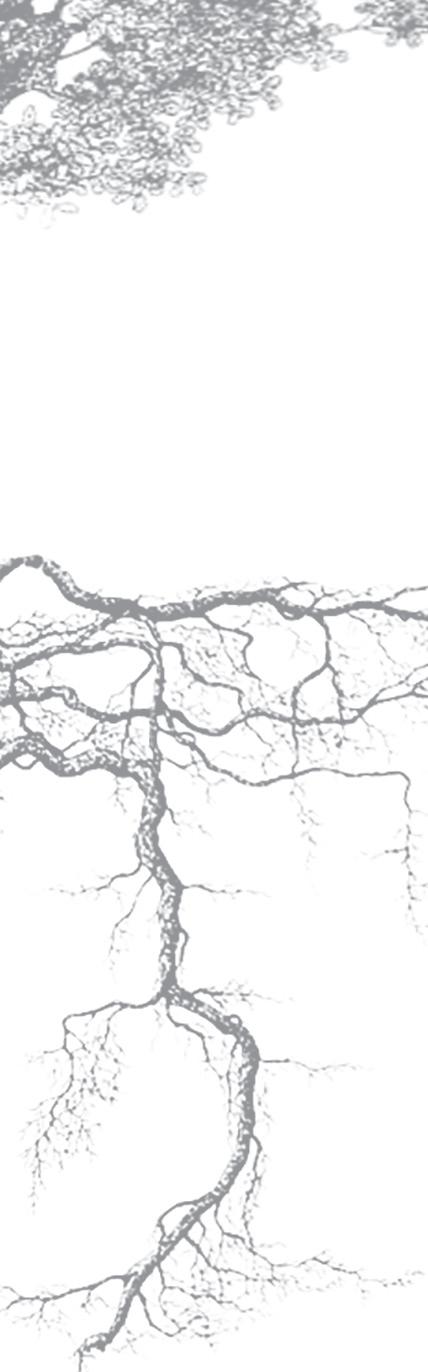


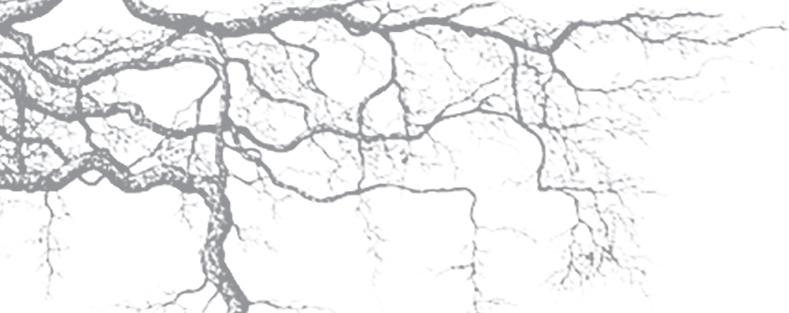



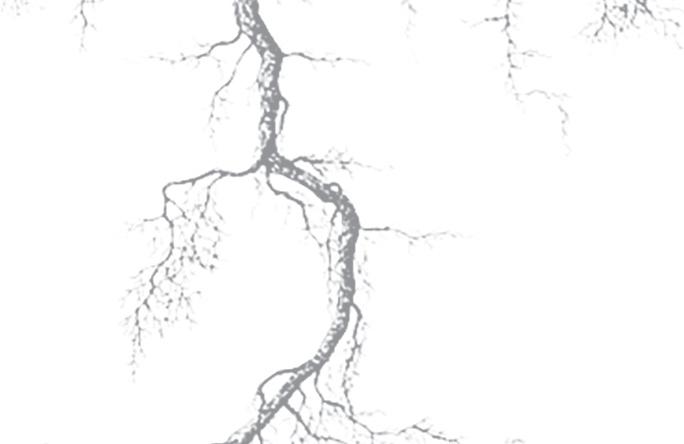

En France, une ferme sur deux est dirigée par un agriculteur de 55 ans ou plus, qui va partir à la retraite d’ici 2030. D’année en année, les chefs d’exploitation agricoles sont de moins en moins nombreux. Le renouvellement des générations est loin d’être assuré et 200 fermes disparaissent chaque semaine. Qui nous nourrira demain ? D’ici 2030, 5 millions d’hectares vont changer de main. Cela représente un cinquième de la surface agricole française. Que vont devenir ces terres ?
Le 25 janvier 2020, je me rends avec ces questions en tête à une réunion publique dans un village de Charente-Maritime. La salle des fêtes est comble : plus de 150 personnes ont répondu à l’invitation de l’association régionale Terre de Liens. Celle-ci annonce la naissance d’une nouvelle ferme. Un jeune couple s’installe sur 24 hectares pour créer une bergerie et une fromagerie en agriculture biologique. Dans cette plaine céréalière dévolue à l’export, leur projet semble insolite. Pourtant largement soutenu, il a bien failli ne jamais voir le jour I. Loin d’être un cas isolé, le parcours semé d’embûches de ces jeunes agriculteurs illustre un phénomène massif : les futurs agriculteurs n’accèdent que très difficilement à des terres. Pourtant, tant d’hectares changent de main ! Ce paradoxe constitue l’un des points de départ de ce livre. Je suis partie dans cette enquête sur la terre comme on prend la mer : avec beaucoup de questions et peu de repères. La traversée de ce continent silencieux s’est effectuée avec l’aide de navigateurs plus expérimentés : membres bénévoles et salariés du mouvement Terre de Liens, agriculteurs et autres experts. Le projet a pris forme au fil de nombreux échanges, lectures, interviews et reportages, durant deux ans.
La disparition des paysans, c’est un peu comme la disparition des abeilles : on en entend parler, mais tant que l’on continue à entendre des bourdonnements au printemps, on se dit que ce n’est pas pour
I Voir “Récit. S’installer, un parcours du combattant. La ferme de la Houlette, CharenteMaritime”, p. 60.
tout de suite. Parmi toutes les questions qui déterminent notre avenir commun, celle de la préservation et de l’accès à la terre agricole est l’une des moins visibles dans le débat public. Comment la rendre visible ? Car cette question est vitale : notre alimentation dépend des sols et du travail des agriculteurs, autant que des abeilles et de l’eau. Nous nous nourrissons des produits de la terre. Certes, des pistes de nourriture hors sol apparaissent dans nos assiettes : viande produite en laboratoire, légumes éclairés artificiellement et cultivés dans des espaces sous contrôle. Mais ces productions ne poussent pas à partir de rien : elles nécessitent elles aussi des énergies et des matières, extraites des milieux. On n’a pas trouvé mieux que de faire pousser des plantes en pleine terre avec l’énergie solaire, souligne l’agronome Marc Dufumier. Les nourritures terrestres, la saveur d’une pomme de terre du jardin, d’un fromage fermier au lait cru, d’une tomate ou d’un raisin mûris au soleil font partie des expériences qui nous relient au monde. Quant à croire que le high-tech va alimenter l’humanité… Aujourd’hui, l’agriculture paysanne nourrit toujours la majorité de la population mondiale sur un modèle de ferme familiale. Cependant, le secteur s’industrialise, et des sociétés prennent le contrôle de surfaces immenses. Est-ce le visage de l’agriculture du futur ?
La fin annoncée du pétrole, les tensions internationales ajoutent à l’instabilité du monde. À l’heure des bouleversements climatiques, écologiques et des pandémies, relocaliser les productions alimentaires pour nourrir les habitants est une nécessité. Comment assurer la sécurité alimentaire, lorsque les terres agricoles qui ont disparu sous le bitume et les lotissements sont principalement les riches terres maraîchères autour des villes ?
Il y a 50 ans, le rapport Meadows pointait les limites à la croissance. Depuis, les scientifiques alertent : notre modèle de développement est à bout de souffle. Or, notre agriculture est issue de ce modèle. Une politique agricole forte et cohérente s’est mise en place à partir de 1960, à l’échelle nationale et européenne. Elle a
bouleversé les paysages. Elle a transformé les paysans, et accéléré la diminution de la population agricole.
Le nombre de nouveaux agriculteurs qui s’installent ne cesse de diminuer depuis les années 2000 et moins de deux agriculteurs sur trois I sont aujourd’hui remplacés. Le nombre d’exploitations a été divisé par cinq en 60 ans : un peu moins de 2 millions en 1960, 390 000 en 2020 II. Les fermes ne cessent de s’agrandir, mais la surface agricole totale diminue : elle représente moins de la moitié du territoire français, 26,9 millions d’hectares en 2020. Nous avons perdu depuis 1980 l’équivalent de cinq départements, soit près de 6 millions d’hectares, principalement en raison de l’artificialisation des sols III. Ce phénomène est plus rapide que la croissance démographique. La France se situe au-dessus de la moyenne européenne d’artificialisation des sols rapportée au nombre d’habitants1.
Cette tendance n’est pas inéluctable. Les alternatives existent partout autour de nous. Aux côtés des agriculteurs, des femmes et des hommes de tous milieux ont compris que l’accès à la terre est la clé qui ouvre la porte à de nouveaux paysans, ou le verrou qui la ferme. Nous irons à la rencontre d’un archipel d’initiatives.
Ce livre est autant une enquête qu’une quête : une enquête sur l’accès à la terre et le renouvellement des générations agricoles. Et une quête des solutions qui, partout en France, permettent de produire pour aujourd’hui et pour demain l’alimentation dont nous avons besoin, en préservant des structures à taille humaine et des sols vivants. Ces exemples sont inspirants. Mais comment passer à un stade supérieur ?
La question de l’accès à la terre renvoie à une autre, plus large : celle de l’usage de la terre. Quel usage faisons-nous de la terre ?
I 13 400 installations pour 21 000 départs en 2019, 12 500 installations en 2020.
II En France métropolitaine. Agreste, recensement agricole 2020, décembre 2021.
III L’artificialisation des sols désigne tout processus impliquant une perte d’espaces naturels, agricoles ou forestiers (Enaf), conduisant à un changement d’usage et de structure des sols (affectés notamment à des fonctions urbaines ou de transport). Deux tiers des sols artificialisés sont recouverts d’une couche imperméable.
Juridiquement, la notion d’usage renvoie au droit d’usage et interroge la conception contemporaine de la propriété. La terre n’est pas un bien marchand comme un autre. C’est une ressource indispensable à toute société. Sur le chemin d’écriture de ce livre, j’ai rencontré des personnes très diverses qui la considèrent comme un bien commun. Intéressons-nous à cette conception, qui éclaire les enjeux politiques et démocratiques de nos liens à la terre. Plutôt qu’apporter des réponses, ce livre propose des éléments de réflexion et se fait l’écho de questionnements nécessaires, dans une décennie décisive.
Auparavant, un voyage dans le temps s’impose, pour poser quelques jalons et comprendre d’où nous venons, avant de regarder vers où aller, et comment.


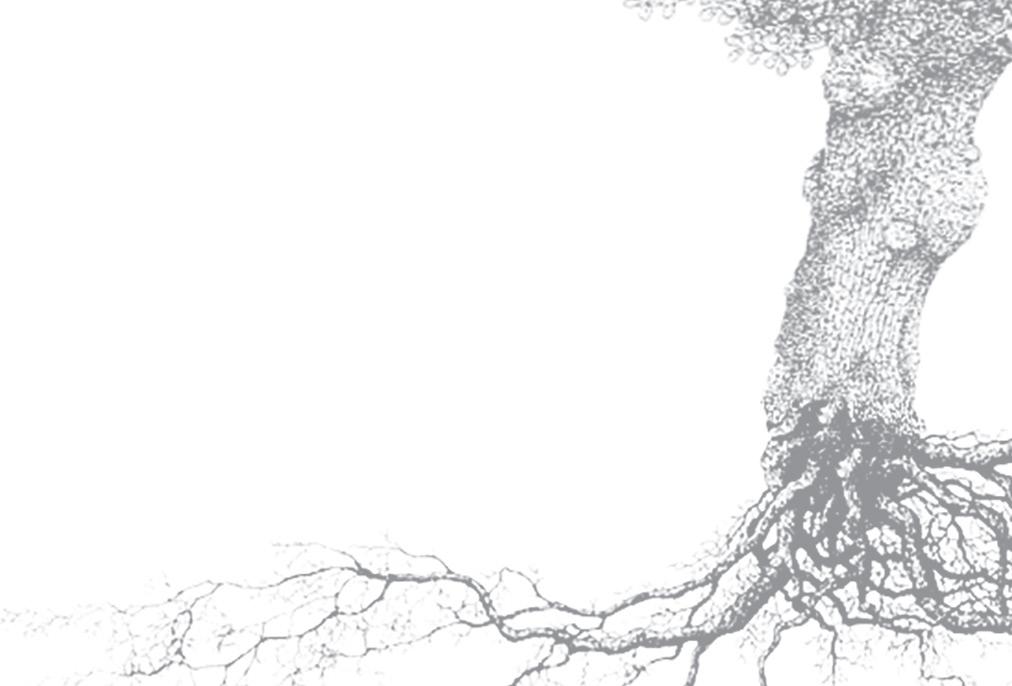
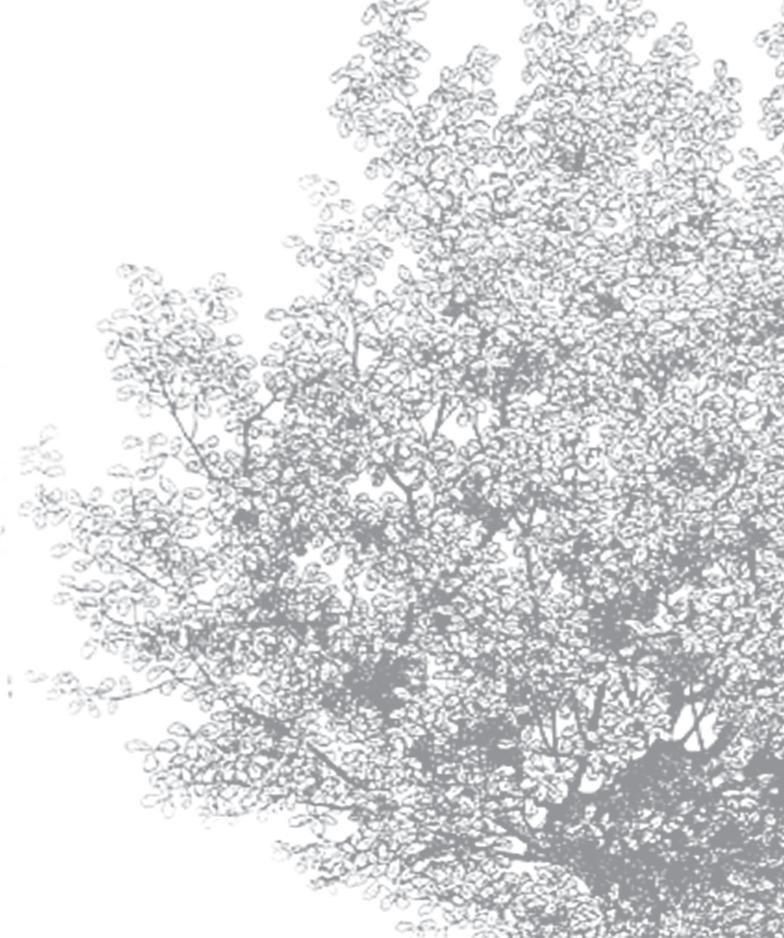















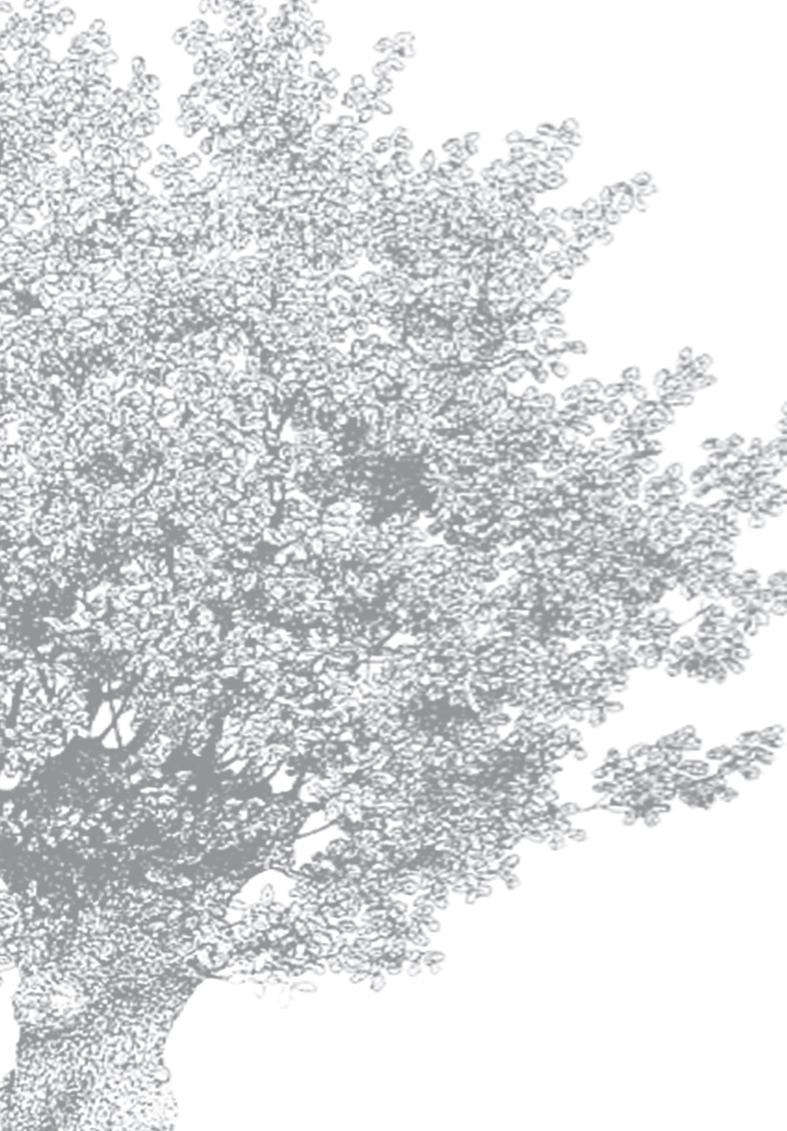



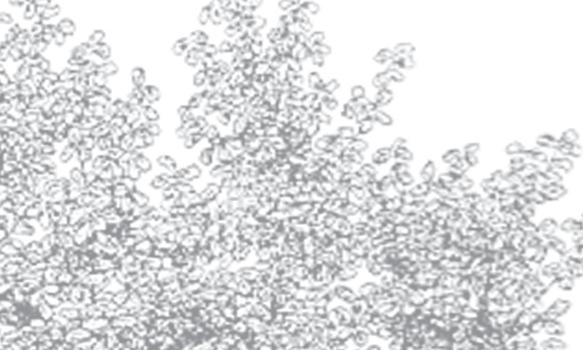


Au début du xxe siècle, l’écrivain Ernest Pérochon I, fin observateur du monde rural dont il est issu, met en lumière l’attachement à la terre chez les paysans de l’Ouest de la France, dans son roman La Parcelle 32 (1922). L’action se situe lors de la Première Guerre mondiale. Un grand-père et son petit-fils, Bernard, sortent de chez le notaire et s’en retournent à la ferme par les champs.
L’enfant montra d’un geste la plaine illuminée que les cultures différentes morcelaient à l’infini.
Toutes ces terres, au-delà des nôtres, à qui sont-elles ?
Aux voisins de Fougeray…, quelques-unes, à ceux des villages autour de Quérelles…, chacun a son petit coin. Il y a aussi des fermes qui ne sont pas à des gens du pays. (…)
Malgré le vent aigre, ils furent un moment songeurs devant cette bonne terre étendue à perte de vue sous le jeune soleil. Et puis l’enfant montra la grande parcelle qui, sur la droite, venait finir en coin au cimetière des Maquereau.
Ce champ qui nous touche et qui est de la Millancherie, à qui appartient-il ?
La Millancherie est à un monsieur de la ville ; je crois qu’il vient de mourir… Mais ce champ a été nôtre autrefois ; c’est ton grand-oncle qui l’a vendu.
Il faut le racheter.
Mon petit gars, c’est le désir de ma vie.
Le grand-père s’était approché de l’enfant et celui-ci, appuyé d’une main à son épaule, se dressait sur la pointe des pieds.
Je voudrais être riche, dit Bernard, pour racheter les champs de chez nous qui ont été vendus. Je voudrais être très riche… J’achèterais tous
I Né dans une famille de paysans petits propriétaires, dans les Deux-Sèvres, Ernest Pérochon (Courlay 1885-Niort 1942) a couru dans les champs avec les enfants des journaliers agricoles, les “cherche-pain”, avant de devenir instituteur, puis écrivain. En 1920, il obtient le prix Goncourt pour Nêne. Il est l’auteur d’une vingtaine de romans, dont Les Gardiennes (1924), adaptées au cinéma par Xavier Beauvois en 2017.
les champs que tu vois, ceux de la Millancherie, ceux de Monte-à-peine, les champs aux voisins de Fougeray, les champs à ceux de Quérelles et aussi les fermes qui sont aux messieurs… J’achèterai toutes les terres.
Son bras se tendait et se repliait en un geste d’avare, comme pour appeler à lui les parcelles innombrables et pour les grouper jalousement autour du cimetière des Mazureau.
Et le grand-père, redressé lui aussi et tremblant d’émotion, ouvrait sur la plaine des yeux avides d’amoureux.
À la fin des années 1920, au moment où Ernest Pérochon écrit ses romans sur le monde paysan, l’exploitation familiale est devenue une norme. Les prix des terres ont chuté à la fin du xixe siècle et au début du xxe, les rentiers s’en détournent et les paysans achètent. Durant la Première Guerre mondiale, 500 000 agriculteurs sont tués, autant reviennent blessés. De nombreux domaines changent de main à l’issue de la guerre. En 1929, parmi 3 650 000 chefs d’exploitation, les trois quarts sont propriétaires 1. Il subsiste toutefois d’importantes disparités d’une région à l’autre.
L’attachement paysan à posséder la terre qu’il décrit apparaît de façon similaire dans plusieurs romans du xixe siècle, de George Sand à Balzac et à Zola. Rien d’étonnant : monarchistes ou républicains, les régimes politiques qui se succèdent au xixe siècle assoient l’ordre social et le développement économique sur la propriété. Avec un corollaire : malheur à ceux qui ne possèdent rien.
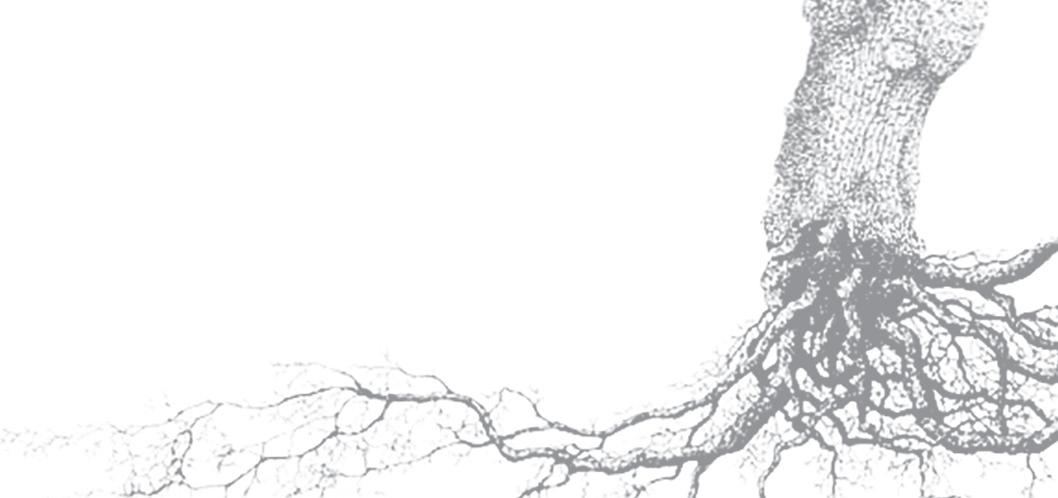
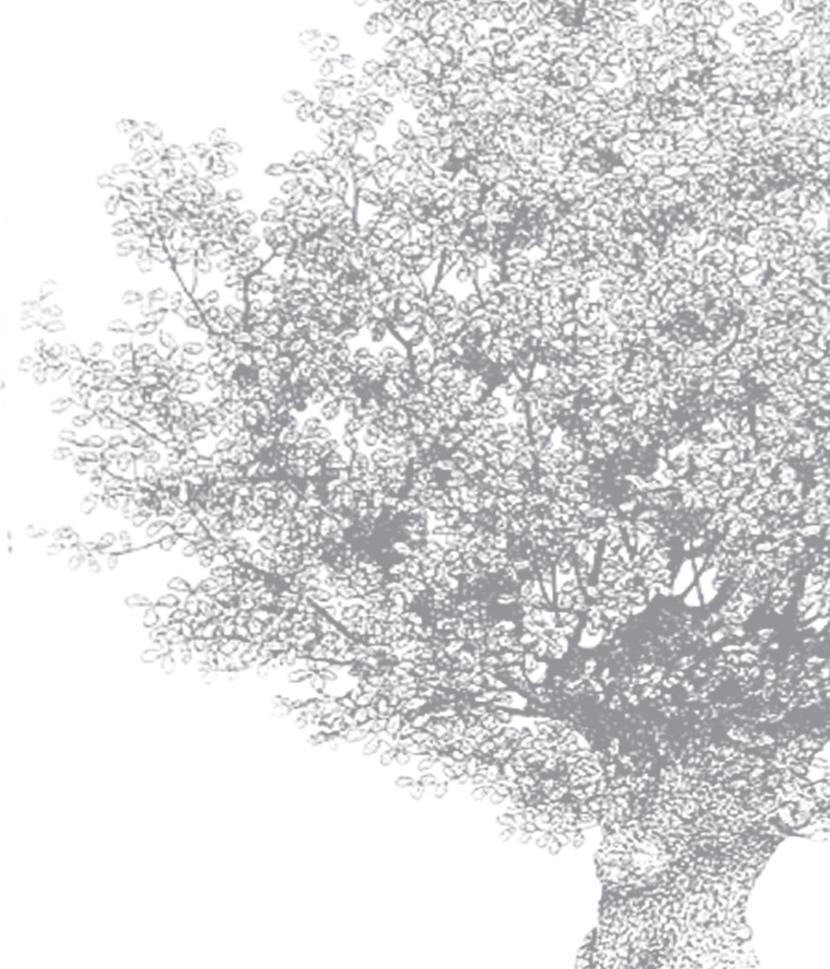


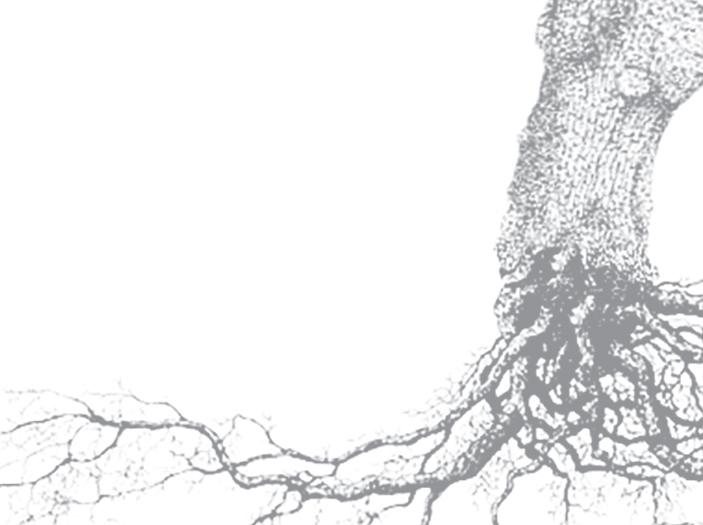
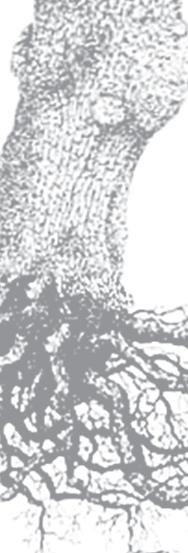







J’ai longtemps cru que le problème foncier était de nature juridique, technique, économique, et qu’une bonne dose d’ingéniosité suffirait à le résoudre. J’ai lentement découvert qu’il était le problème politique le plus significatif qui soit, parce que nos définitions et nos pratiques foncières fondent tout à la fois notre civilisation et notre système de pouvoir, façonnent nos comportements.
Remontons le temps en compagnie d’un grand connaisseur des questions agricoles et foncières : Edgard Pisani I. On doit à cet ancien ministre de l’Agriculture la loi d’orientation agricole de 1962. Cet homme politique dont l’œuvre interroge sans relâche notre façon d’habiter la terre a consacré de nombreux ouvrages aux enjeux de l’alimentation, de l’agriculture et de l’usage de la terre. Dans Utopie foncière, il analyse notre conception contemporaine de la propriété privée et la relie à un moment charnière de notre histoire : la Révolution française.
Le 26 août 1789, l’Assemblée constituante vote les quatre derniers articles de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui se clôt par l’article 17 : “La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.”
I Edgard Pisani (1918-2016) fut résistant, préfet, sénateur et ministre de l’Agriculture de 1961 à 1966 (gouvernements Debré puis Pompidou). Voir “Les lois d’orientation agricole de 1960 et 1962 pour une agriculture compétitive”, p. 30. Ministre de l’Équipement et du Logement dans le quatrième cabinet Georges Pompidou en avril 1967, il porte le projet de loi foncière qui est voté en décembre 1967 après sa démission. Cette loi dite “d’orientation foncière” a établi en France les principaux documents d’urbanisme qui ont servi à l’aménagement local : plan d’occupation des sols, schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme, etc.
Edgard Pisani, Utopie foncière, Gallimard, 1977.La Révolution française se nourrit d’une pensée libérale, née en Europe entre le xvie et le xviie siècle, dans des sociétés régies par des monarchies absolues et le pouvoir religieux. Largement diffusée par les philosophes des Lumières, cette pensée affirme des droits individuels intrinsèques ; en économie, elle prône la libéralisation des échanges marchands, ardemment souhaitée par la bourgeoisie.
La Révolution, souligne Edgard Pisani, “est le couronnement d’une longue évolution économique et sociale qui a fait de la bourgeoisie la maîtresse du monde et qui, en France, l’a placée aux portes du pouvoir. Les événements… n’ont eu d’autre objet que de lui permettre de franchir les derniers pas (…) pour détenir les moyens de consacrer par la loi la réalité de son pouvoir”. Cette révolution bourgeoise coïncide avec une révolution paysanne, provoquée par une crise économique et une disette liée à des événements climatiques. Différentes conceptions se confrontent.
Les phases de la Révolution française sont marquées par les affrontements internes au tiers état et les divergences d’intérêts entre possédants et non-possédants. Au cœur de ces débats revient sans cesse la définition du droit de propriété. C’est en effet un conflit entre deux visions économiques et politiques : l’une, libérale, prône la liberté individuelle, notamment en matière économique. L’autre est attachée aux usages collectifs et aux droits coutumiers, dans la lignée d’une organisation sociale issue du Moyen Âge. Dans la société féodale, les terres sont attribuées par le souverain pour services rendus à des vassaux. Les paysans et villageois ont des droits d’usage, qui diffèrent d’une province à une autre. Ce système ancien réglemente le commerce et taxe les produits. Dans une certaine mesure, il garantit les conditions d’existence des plus démunis. Edgard Pisani raconte : “La petite paysannerie est fondamentalement hostile à l’appropriation privative du sol, elle est fidèle à ses pratiques communautaires (…) Les paysans veulent que la propriété ne trouve son fondement que dans le travail personnel et se limite
au fruit de celui-ci, et qu’elle trouve ses disciplines dans le seul intérêt collectif1.”
Le marché foncier est inexistant dans la société féodale. À la Révolution, la conception libérale de la propriété s’imposera. Une phase décisive sera la vente des biens nationaux. Ce vaste transfert de propriété attache à la Révolution ses bénéficiaires, les paysans aisés et les bourgeois. Elle consacre aussi la terre comme bien marchand et non collectif. Lors de la loi agraire de 1791, l’Assemblée constituante accorde au propriétaire la pleine disposition de sa terre ; il l’autorise à clore et ainsi à supprimer les usages traditionnels, comme la vaine pâture I. La France s’engage dans une dynamique d’enclosures, à la suite de l’Angleterre où le mouvement a commencé dès le xvie siècle : les communs, des landes et pâtures utilisées collectivement par des communautés paysannes anglaises, sont divisés et enclos de haies pour l’élevage des ovins par les grands propriétaires.
Après la Convention montagnarde qui tente d’instaurer une économie dirigée, la Convention thermidorienne, puis le Directoire (1795-1799) adoptent une logique économique fondée sur la propriété privée et le libéralisme. La propriété est perçue comme un signe de compétence et comme garante de stabilité politique. “Contrairement à la propriété privée grecque ou romaine, qui sont pensées à partir de la communauté organique et autorisées à des fins publiques, la propriété bourgeoise de la Convention thermidorienne est exclusive, individuelle et compétitive. Elle est protégée par l’État, prétendument au profit de la communauté. La caractéristique de cette propriété privée n’est pas juste d’organiser et de séculariser un rapport de I “Anciennement, après la levée du foin ou de la récolte, les troupeaux individuels ou collectifs pouvaient parcourir toutes les parcelles sans que le propriétaire de celles-ci puisse s’y opposer ; mais chacun d’entre eux ne pouvait envoyer paître qu’un troupeau proportionnel à la superficie des terres qu’il livrait lui-même à la vaine pâture (on dit aussi vide pâture). Ce droit a subsisté jusqu’au xxe siècle dans les pays où les usages communautaires étaient restés vivaces (…) Avec l’usage des communaux et avec la glandée, la vaine pâture était pour les pauvres gens le seul moyen d’entretenir un petit troupeau.” Roger Béteille, https://www.universalis.fr/ encyclopedie/vaine-pature/
l’Homme aux choses, mais d’organiser le rapport qu’entretiennent les hommes entre eux2.”
Cette conception exclusive de la propriété va dominer jusqu’à nos jours. Toutefois, des usages et droits qui reposent sur une conception collective du foncier subsistent sous différentes formes suivant les régions, jusqu’à aujourd’hui, comme le remarque la juriste Sarah Vanuxem I. Citons à titre d’exemple les communaux du Marais poitevin ou encore la gestion collective de pâturages dans des zones de montagne, en Alsace ou dans les Pyrénées.
Au xixe siècle : une société de propriétaires
Dans le dernier quart du xixe siècle, Léon Gambetta, député de la IIIe République, voit dans l’accès à la propriété un moyen de se prémunir des débordements ouvriers comme d’un retour des monarchistes. La Révolution française a attaché à la République les bourgeois et les paysans riches en leur permettant d’accroître leurs propriétés lors de la vente des biens nationaux, rappelle-t-il dans un discours en 1874. Il est convaincu que pour faire des paysans républicains, il faut en faire des propriétaires. “Ce que nous demandons, ce qui est une loi sociale de démocratie, c’est que la propriété se divise, c’est qu’elle aille à celui qui l’exploite et qui la féconde de tous ses efforts pour lui faire produire chaque jour davantage, à son avantage personnel, mais aussi au plus grand avantage social3.”
Dans une France alors majoritairement rurale, les fermes familiales très nombreuses coexistent avec de grands domaines. Lors du recensement de 1892 4, les exploitations inférieures à dix hectares représentent les trois quarts des 5,7 millions d’exploitations, mais seulement 23 % de la surface agricole. Les moyennes exploitations (10 à 40 hectares) couvrent 20 % du nombre total et 30 % du
sol. Les exploitations supérieures à 40 hectares sont rares (4 % du nombre), mais elles couvrent près de la moitié de la surface (47 %).
Les responsables politiques de la IIIe République, partisans d’une société de propriétaires, sont en cela héritiers du Code civil de 1804, dit aussi Code Napoléon. Lequel, souligne Edgard Pisani, consacre une conception individuelle de la propriété et l’inscrit dans un corpus législatif et réglementaire durable. “Fondamentalement, l’œuvre napoléonienne poursuit et achève celle de la révolution bourgeoise : stabiliser, organiser, institutionnaliser un ordre économique et social dominé par les propriétaires, créer les normes juridiques et l’appareil d’État qui le soumettront 5.” Le Code civil accorde la primauté à la propriété sur l’usage. Les droits des citoyens sont définis relativement à leurs possessions.
Après la Première Guerre mondiale, la profession agricole s’affirme
Retour au xxe siècle. Passons rapidement sur l’entre-deux-guerres, qui voit l’émergence d’organisations professionnelles agricoles et la création des chambres d’agriculture. La profession revendique de s’organiser avec “son autonomie relative, son autorité, ses institutions et ses lois propres”. C’est une force politique et sociale qui s’affirme, en revendiquant le nom de “paysan6”. En 1929 est créé le mouvement de la Jeunesse agricole catholique (JAC) “formé initialement autour d’une mission traditionaliste de reconquête chrétienne dans les campagnes, ce mouvement adopte peu à peu une nouvelle approche de son engagement, plus progressiste et éducative, et jouera un rôle majeur dans l’évolution de l’agriculture dans les décennies qui suivront7”. Le Front populaire élu en 1936 a des projets dans le domaine agricole, notamment le statut du fermage.
Lors de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement de Vichy célèbre autant qu’il contrôle le monde paysan. Le 2 décembre 1940,
il crée une Corporation paysanne placée sous l’autorité de l’État et dissout tous les organismes agricoles existants. La Corporation paysanne disparaît avec la Libération, mais la plupart des dirigeants joueront un rôle dans le syndicalisme agricole jusqu’à la fin des années 1950.
Ouvrage réalisé par Nord Compo Achevé d’imprimer en juillet 2023 par Normandie Roto Impression s.a.s. 61250 Lonrai pour le compte des éditions Actes Sud
Le Méjan Place Nina-Berberova
13200 Arles
Dépôt légal : septembre 2023 No d’impression : (Imprimé en France)
La question du devenir des terres et des paysans est vitale, c’est pourtant l’une des moins visibles dans le débat public.
Depuis les années 2010, 200 fermes disparaissent chaque semaine en France dans l’indifférence générale. Alors que la surface agricole totale décroît, la surface moyenne par ferme n’a cessé d’augmenter. Un nouveau cycle de concentration est à l’œuvre, qui conduit inexorablement à faire grimper le prix de l’hectare, verrouillant de fait l’accès à la terre pour les jeunes.
Tandis que la moitié des agriculteurs s’apprête à prendre sa retraite d’ici 2030, que vont devenir ces terres ? Vers quelle agriculture avançons-nous ? Ce livre est une enquête autant qu’une quête : une enquête sur l’accès à la terre et le renouvellement des générations agricoles ; et une quête de nouvelles solutions qui permettent de produire localement la nourriture dont nous avons besoin.
Véronique Duval est partie à la rencontre de ceux qui font bon usage de la terre aujourd’hui : dans la Marne, sur le Larzac, au Pays basque ou au sein de l’association Terre de Liens, qui rachète des fermes pour y installer des jeunes paysans et paysannes en bio. Comment enfin peser sur l’action publique ? Comment faire de la terre un bien commun ? Telles sont les pistes qu’explore ce texte salutaire, dans une période décisive.
Véronique Duval vit en Charente-Maritime. Journaliste venue du documentaire, cofondatrice d’une jeune maison d’édition, elle a notamment publié Rencontre avec des paysans remarquables, cinq fermes biologiques et paysage aux Éditions Sud Ouest (2017).
Photographie de couverture : © Sandrine Mulas, pour Terre de Liens, 2023
DÉP. LÉG. : SEPT. 2023
23,50 € TTC France www.actes-sud.fr
ISBN : 978-2-330-18083-6
