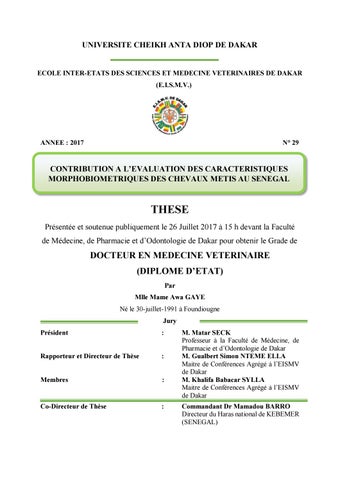UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR
ECOLE INTER-ETATS DES SCIENCES ET MEDECINE VETERINAIRES DE DAKAR (E.I.S.M.V.)
ANNEE : 2017
N° 29
CONTRIBUTION A L’EVALUATION DES CARACTERISTIQUES MORPHOBIOMETRIQUES DES CHEVAUX METIS AU SENEGAL
THESE Présentée et soutenue publiquement le 26 Juillet 2017 à 15 h devant la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie de Dakar pour obtenir le Grade de
DOCTEUR EN MEDECINE VETERINAIRE (DIPLOME D’ETAT) Par Mlle Mame Awa GAYE Né le 30-juillet-1991 à Foundiougne Jury Président
:
Rapporteur et Directeur de Thèse
:
Membres
:
Co-Directeur de Thèse
:
M. Matar SECK Professeur à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie de Dakar M. Gualbert Simon NTEME ELLA Maitre de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar M. Khalifa Babacar SYLLA Maitre de Conférences Agrégé à l’EISMV de Dakar Commandant Dr Mamadou BARRO Directeur du Haras national de KEBEMER (SENEGAL)