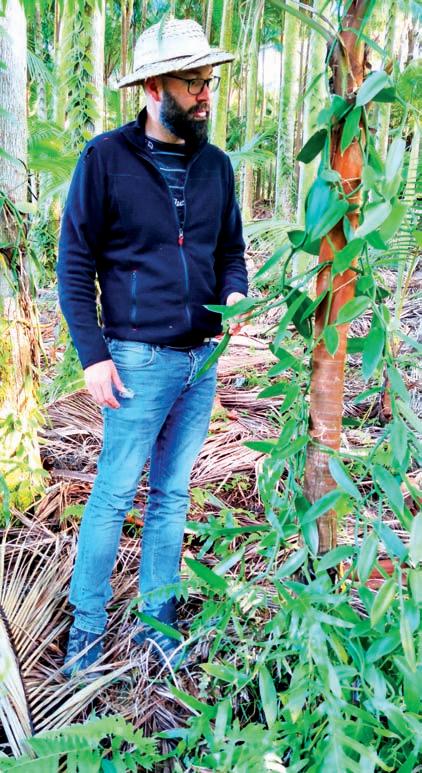3 minute read
aPrès la crise c ovid Plus d’agriculture locale dans notre assiette !
Le confinement des mois de mars à mai a confirmé la solidité du modèle agricole réunionnais, qui a pu nourrir la population sans interruption et pénurie. Sur le frais, à l’exception de quelques produits, il est aujourd’hui possible de manger entièrement local. La tendance va-t-elle durer ?
Quelques Chiffres
Advertisement
Porc : 145 producteurs
11 479 tonnes produites dans l’île (99 % du frais) volaille :
23 000 tonnes consommées en comptant le congelé.
177 producteurs
22 000 tonnes produites dans l’île
21 000 tonnes d’importation en viande congelée.
Bœuf :
Pour certains le confinement restera un mauvais souvenir. Horticulteurs, producteurs de vanille, centres équestres ont souffert de l’arrêt des activités. Pourtant, à l’échelle du monde agricole, la crise a eu des effets positifs inattendus, notamment la hausse de la consommation locale de produits frais. Pour Frédéric Vienne, président de la chambre d’agriculture (voir interview), cette hausse a été possible car l’agriculture a répondu présent.
‘‘ Durant des années, les pouvoirs publics ont investi pour nous aider à bâtir les outils de notre agriculture et durant le confinement, nous avons tous répondu présent ’’, relève Joël Sorres, agriculteur et président de la Fédération réunionnaise des coopératives agricoles, qui réunit 6 000 agriculteurs sur les 9 700 en activité dans l’île. Ce constat, il n’est pas seul à le faire, l’île de La Réunion a vu son agriculture saluée au niveau national. Elle a pu faire face à une demande importante, d’autant que la consommation de produits locaux a augmenté sur la période.
‘‘ Habituellement, la restauration collective sert près de 120 000 repas par jour, explique Pascal Quineau, éleveur et président de l’Union réunionnaise des coopératives, or la restauration collective consomme beaucoup de produits congelés, souvent importés. Là, la population a pu cuisiner et consommer davantage de frais. ’’ Certains besoins ne pourront pas être couverts par l’agriculture locale. Malgré une initiative de culture du riz pays, La Réunion est très loin de pouvoir compenser l’importation de ses 44 000 tonnes par an. Il en va de même pour les céréales et une partie de l’alimentation du bétail. L’agriculture réunionnaise est cependant en mesure aujourd’hui de couvrir entre 70 % et 80 % des besoins du territoire. Aujourd’hui, hors riz et céréales, et à condition de ne manger que du frais, il est possible de déjeuner d’une assiette produite entièrement à La Réunion.
Quatre produits viennent cependant concurrencer les cultures réunionnaises et avec des prix souvent imbattables : l’ail de Chine, l’oignon d’Inde ou de Madagascar,
328 producteurs
15 000 tonnes de viande (pour les éleveurs de la Sicarevia)
6 400 tonnes de viande fraîche importée ovins et caPrins : 93 producteurs
36 tonnes de viande ovine, 17 tonnes de viande caprine
Production maraîchère :
716 producteurs
27 400 tonnes de légumes et fruits lait : 85 éleveurs (Sicalait)
18 millions de litres les carottes de Chine et d’Australie et enfin la pomme de terre, venue de France. Du côté de la volaille, œuf et viande, les agriculteurs réunionnais peuvent batailler avec le congelé. Pour le porc, la totalité du frais est locale. Sur les fruits et légumes, à part les produits extérieurs comme le raisin et la pomme, ainsi que les produits importés ‘‘ hyperconcurrentiels ’’, la production locale est au rendez-vous. Ce développement peut-il se poursuivre ?
Les consommateurs pourront-ils privilégier le frais et continuer de cuisiner ou devrontils pour des raisons pratiques et financières revenir vers l’importation et le surgelé ?
‘‘ Nous cherchons à maintenir des prix bas pour le frais, explique Joël Sorres et sur certains produits comme la volaille, il est possible de concurrencer le congelé. Maintenant, il ne faut pas oublier les plus démunis ou les plus fragiles et chercher à proposer des prix bas’’. L’île dispose de quelques ressources pour poursuivre son développement et notamment de nombreuses terres en friche dans les Hauts. Ce sont ainsi 7 000 hectares en friche. Pour autant, il ne faut pas s’attendre à un miracle et ce, même si de jeunes agriculteurs et agricultrices peinent à trouver des terres. ‘‘ Défricher les terrains n’est pas une mince affaire, rappelle Joël Sorres. Ce sont souvent des terrains de bordure, en pente. Le seul intérêt est qu’ils peuvent être utilisés pour de l’élevage ou pour démarrer des productions en bio ’’. Il faut également ajouter le besoin d’approvisionnement en eau, ce qui signifie que ces projets ne peuvent être portés qu’avec des politiques publiques. Le choix d’avoir une assiette principalement locale peut donc se faire, à condition de le vouloir collectivement.