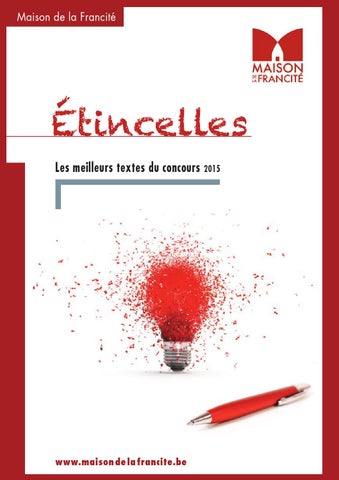Maison de la FrancitĂŠ
Étincelles Les meilleurs textes du concours 2015
www.maison de la francite.be
La Maison de la Francité remercie chaleureusement pour leur soutien :
Avec le soutien de la Commission communautaire française, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Parlement francophone bruxellois et du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Avec le soutien de la Commission communautaire française Dans la même collection :
- Variations sur trois thèmes Textes lauréats des concours d’écriture 2002, 2003 et 2004 - L’invention du siècle Les meilleurs textes du concours 2005 - Le pays de mes rêves Les meilleurs textes du concours 2006 - Mon histoire romaine Les meilleurs textes du concours 2007 - Lutin au Québec. Une aventure du “vingt-et-unième“ en Amérique du Nord Les meilleurs textes du concours 2008 - La tête dans les étoiles Les meilleurs textes du concours 2009 - Une rencontre africaine Les meilleurs textes du concours 2010 - Je t’appelle citadelle Les meilleurs textes du concours 2011 - Si j’étais magicien… Les meilleurs textes du concours 2012 - Destination ailleurs Les meilleurs textes du concours 2013 - Prisonnier Les meilleurs textes du concours 2014 Maison de la Francité 2015 4
Étincelles Les meilleurs textes du concours 2015
Préface Faire étinceller l’écriture, ce langage intime et silencieux...
Chaque année depuis 15 ans, la Maison de la Francité organise un concours de textes dans le but de motiver auprès d’un large public l'expression personnelle en langue française. En 2015, l’UNESCO, pour le thème de son « Année internationale », a choisi de célébrer la lumière et les nombreuses découvertes qui lui sont liées. S’inscrivant dans cette initiative, la Maison de la Francité a choisi le thème « étincelles » pour son concours de textes. Cette thématique est finalement fort à propos pour un concours d’écriture. L’acte d’écrire ne consiste-t-il pas à réveiller en nous les étincelles de notre imagination et de nos envies créatives ? L’acte d’écrire n’est-il pas aussi posé dans l’espoir de faire naitre des étincelles dans le regard des personnes qui nous lisent ? Des étincelles, cette année, il y en a eu de quoi allumer un formidable feu d’artifice, puisque la Maison de la Francité a reçu en tout 1.183 textes d’auteurs de tous âges : cadets, juniors et adultes. Il s’agit d’un record absolu et absolument remarquable qui témoigne bien que l’amour de l’écriture et de la langue française est bien vivant dans notre pays. L’ensemble des textes reçus représente un peu plus de 4.000 pages, que les sélectionneurs de la Maison de la Francité ont dû lire avec attention et rigueur, dans le but de présenter au jury les 45 textes les plus intéressants. Le jury quant à lui en a établi le classement : un 7
véritable défi, où se côtoient subjectivité et objectivité, où se croisent passion et raison. Dans l’édition de ce recueil, la Maison de la Francité a tenu à garder intacte la spontanéité des styles et de certaines expressions voulues par les auteurs. Nous avons cependant adapté les textes aux règles de la nouvelle orthographe. C’est ainsi que, notamment, – même si Jules Renard disait avec poésie que « l'accent circonflexe est l'hirondelle de l'écriture » –, nous avons supprimé les « chapeaux » au-dessus de certaines lettres et modifié certains autres détails encore. Nous espérons que cela ne troublera pas votre envol à la découverte des pages qui suivent. La Maison de la Francité vous souhaite une bonne lecture, en remerciant tous ceux qui ont apporté leur participation à ce concours de textes 2015 : les auteurs, les concepteurs, les organisateurs, les collaborateurs extérieurs, les sélectionneurs, les membres du jury et bien évidemment nos partenaires ainsi que la Commission communautaire française et la Fédération Wallonie-Bruxelles – leur ministère, leur parlement et leur gouvernement. Ce concours a permis de nous rassembler dans un esprit d’ouverture autour de la langue française, de sa richesse et de sa vitalité contemporaine. Initier ce partage fait partie des objectifs de la Maison de la Francité. Merci à tous de l’avoir rendu possible. Ahmed MEDHOUNE Président du Conseil d’Administration de la Maison de la Francité Donald GEORGE Directeur de la Maison de la Francité 8
Sélectionneurs - Henry LANDROIT Chroniqueur de langue, pédagogue et écrivain - Noëlle MICHEL Lectrice de la Compagnie de Lecteurs et d’Auteurs - Michaël LANGELEZ Lecteur de la Compagnie de Lecteurs et d’Auteurs - David BRANDERS Éditeur Jury Président : - Bernard TIRTIAUX Écrivain et maitre verrier Membres : - Isabelle BIELECKI Poète, romancière et dramaturge - Laurence GHIGNY Attachée culturelle à la Fédération Wallonie-Bruxelles - Claude LAJON Administrateur du Club Richelieu International Europe - Laurence ORTEGAT Auteure et présidente de la Compagnie de Lecteurs et d’Auteurs - Serge de PATOUL Député francophone bruxellois - Rita POULIN Directrice des Communications et Affaires publiques à la Délégation générale du Québec 9
Palmarès Catégorie « cadets » - 12 ans à 14 ans
- 1er prix Mlle Marie-Louve BRUYAUX (d’Enines) pour son texte Par-dessus le rebord de sa tasse de thé
- 2e prix M. Seelis VAN DER AUWERAERT (de Woluwé-Saint-Pierre) pour son texte Souvenirs
- 3e prix Mlle Alexia DEHAES (de Schaerbeek) pour son texte Élémentaire, mon cher Klimt
- 4e prix M. Sacha VELIKOVIC (de Couillet) pour son texte Le journal d'un téléphone gréviste
- 5e prix Mlle Clémentine SCHOLLAERT (de Lillois) pour son texte Votre dévouée fille - 6e prix Mlle Mélina MAGDELÉNAT (d’Ixelles) pour son texte Naissance et renaissance
11
Palmarès Catégorie « juniors » - 15 ans à 17 ans
- 1er prix Mlle Claire FRANCIS (de Wavre) pour son texte Grand frère
- 2e prix Mlle Sarah MASSAY (de Liège) pour son texte Dans une chambre
- 3e prix Mlle Gaëlle SIMON (de Vaux-sur-Sûre) pour son texte Dans la vie d'une allumette
- 4e prix ex-æquo M. Jean-François LOUVET (de Bruxelles) pour son texte Big-bang Mlle Chiara PERDICHIZZI (d’Uccle) pour son texte Le caprice des étincelles
- 5e prix Mlle Céline MATURELI (de Schaerbeek) pour son texte Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de lumière
- 6e prix M. Cyril GOSSEAU (d’Ixelles) pour son texte Décalage vers le rouge - 7e prix M. Jean SERVAIS (de Forest) pour son texte Progrès de l'aube
12
Palmarès Catégorie « adultes » - 18 ans et plus
- 1er prix Mme Françoise GUIOT (de Woluwé-Saint-Lambert) pour son texte Ma vie à pile ou face
- 2e prix Mme Anne VERHAEREN (d’Écaussines) pour son texte InstantaNés - 3e prix M. Martin COENE (d’Uccle) pour son texte Mamy
- 4e prix M. Guillaume LOHEST (de Leignon) pour son texte Le premier tweet de Prometeo - 5e prix Mlle Valentine DUHANT (de Jamioulx) pour son texte Joyeuses Pâques !
- 6e prix Mme Patricia HARDY (de Forest) pour son texte Au troisième étage
- 7e prix M. Thibaut GROUY (d’Auderghem) pour son texte Prédateur
13
- 8e prix Mme Savina LEE (d’Ixelles) pour son texte L'angle mort
- 9e prix M. Michel BARBIER (de Marcinelle) pour son texte Petit matin
- 10e prix Mme Nathalie FEREMANS (de Balatre) pour son texte L'aube revient quand même
- 11e prix au 13e prix Mme Isabelle FABLE (de Molenbeek) pour son texte Étincelle… dynamite ou dynamique M. Bruno MAREE (de Han-sur-Lesse) pour son texte Ceux qui ne font que passer M. Pierre PIROTTON (de Retinne) pour son texte Moucheur de chandelles - 14e prix ex-æquo M. Joachim SOUDAN (d’Ixelles) pour son texte Philippe et Anouk Mme Régine NAULIN (de Woluwé-Saint-Pierre) pour son texte La découverte
14
Textes des lauréats cadets
- Marie-Louve BRUYAUX Par-dessus le rebord de sa tasse de thé - Seelis VAN DER AUWERAERT Souvenirs - Alexia DEHAES Élémentaire, mon cher Klimt
17
Marie-Louve BRUYAUX Par-dessus le rebord de sa tasse de thé
Il voit le monde par-dessus le rebord d’une tasse de thé. Chaque jour, il le passe à observer le monde une tasse de thé à la main. Chaque jour la même routine. Il se lève à 7 h 02, en veillant à ce que ce soit du pied droit. Il se débarbouille avec un gant de toilette bleu ciel, il s’habille avec une chemise blanche et un pantalon rouge, il boit son bol de lait et mange sa tartine de confiture à la fraise, sort à 7h33 et emprunte la même rue menant au petit café du coin. Il s’assied à la même table que d’habitude, celle de la terrasse qui a la meilleure vue sur la rue, qu’il fasse beau, qu’il pleuve ou qu’il grêle et observe tout ce qui l’entoure. Il observe la petite fille du boulanger qui se rend en classe, il observe la mère qui se promène avec son enfant, il observe les pères qui sortent de chez eux en jurant à cause de l’heure qui avance et s’engouffrent dans leur voiture. Il observe tout ça en se délectant de tout ce qui varie de la veille. Puis le soir, il paye son thé à la menthe, en veillant à laisser un pourboire à la gentille serveuse, et rentre à 18 h 04. Une fois chez lui, il s’assied à son bureau et note tout ce qu’il vu de changé durant la journée. Il commence toujours par écrire sur une feuille lignée qui il est, pour être sûr de ne pas l’oublier : Je me nomme Philippe Clerens, Je suis écrivain et, durant ma longue carrière qui dure depuis vingt-quatre ans, je n’ai écrit que trois livres. Comme ces mots ne seront jamais connus que par moi seul, je pense pouvoir dire qu’ils ont tous les trois été de véritables chefs-d’œuvre. Ayant été chacun vendus à plus de quatre 19
millions d’exemplaires et traduits dans la quasi-totalité des langues du monde. Mon nom est connu dans le monde entier et, si ma photo n’apparaissait pas à la fin de mes livres, je crois que personne ne connaitrait mon visage n’ayant jamais désiré monter sur un plateau TV ou faire quoi que ce soit pour me montrer. Je ne vis que pour l’écriture et mon unique objectif est de n’écrire que ce qui me plait. Dans ma carrière, je n’ai réussi qu’à trois reprises à produire quelque chose qui me plaisait et venait du cœur. Mon dernier ouvrage est celui que j’ai le plus aimé. En fait, c’est le personnage qui m’a plu. L’histoire était plutôt simple mais ce qui a fait la richesse du livre, c’était son héroïne si bien décrite et si attachante qu’on ne pouvait s’empêcher de l’aimer. Elle s’appelait Anna, n’avait que huit ans et portait généralement une robe rouge à pois blancs et deux jolies nattes terminées par des nœuds écarlates. Durant toute la durée de cette aventure que fut l’écriture de son histoire, je goutai pour la première fois de ma vie à autre chose que la solitude. Je ne lâchais plus ma plume et je me mis à aimer mon héroïne comme ma propre fille. Une fois mon livre fini et édité, je me mis à dépérir. Alors que tous mes lecteurs vantaient la richesse de mon personnage et la qualité de mon style, moi, je pleurais le départ de mon personnage comme on pleure un proche décédé. À partir de ce moment, je me mis à répéter chaque jour qui passait les mêmes gestes avec la même exactitude que ceux que j’avais exécutés le jour où mon Anna était apparue pour la première fois dans mon esprit. Je me lève à la même heure et de la même manière, je me lave avec un gant de toilette de la même couleur, je m’habille avec des vêtements identiques, je mets la même quantité de lait dans mon bol et de confiture sur ma tartine, et je sors exactement à la même heure que ce jour-là. J’attends désespérément depuis quatre ans de retrouver l’étincelle, c’est ainsi que j’appelle l’inspiration qui s’empare de moi quand je décèle un 20
geste, un mot, ou un regard venant d’un inconnu et qui, comme pour ses prédécesseurs, me permettra de retrouver le bonheur en créant un futur roman. Je la guette mais je doute qu’elle revienne. Après ce travail, il allait se coucher pour sombrer dans un sommeil sans rêves. Ce matin-là ne semblait pas différer des autres jours d’été. Le soleil brillait et les enfants jouaient sur le trottoir, ne prêtant même plus attention à la célébrité assise à son habituelle table du café. Il arrivait encore que, de temps en temps, une personne de passage s’arrête pour lui demander s’il était bien Philippe Clerens, le célèbre écrivain. Que voulez-vous, on imagine toujours une personne comme lui dans une grande villa plutôt qu’attablé au petit café du coin. C’est pour cette raison qu’il ne fut pas surpris d’entendre une voix d’enfant lui demander : – Excusez-moi, vous êtes bien l’écrivain Clerens ? Il se retourna pour assouvir la curiosité de l’enfant quand il se figea net ! La petite fille qui se tenait devant lui ressemblait en tout point au personnage qu’il chérissait tant. Pas seulement au niveau de la description faite dans son roman mais également comme elle lui apparaissait dans sa tête. Elle avait de longs cheveux noirs qu’elle ramenait devant ses épaules en deux tresses, une petite robe rouge à pois blancs et de petits souliers cirés noirs. Ses yeux avaient la couleur de l’océan et pétillaient de malice et, sur son nez fin et ses pommettes, se répandaient une multitude de tâches de rousseur. Sa fine petite bouche semblait faite pour sourire et ses joues étaient légèrement rosées. Elle était menue et serrait contre 21
elle un gros livre. La pauvre enfant semblait terrorisée! L’écrivain finit par articuler : – Oui, c’est bien moi. Veux-tu que je te signe un autographe, ma petite ? – Non, répondit-elle d’une voix enfantine sortie tout droit de l’esprit de l’auteur, je voudrais autre chose. – Qu… quoi donc? – C’est assez compliqué. Puis-je m’assoir ? Il se leva et prit une chaise à la table d’à côté. Une fois installée, elle se lança : – Tout d’abord, laissez-moi me présenter. Je me nomme Anna, je devrais avoir douze ans mais j’en parais huit. En entendant ça, l’écrivain faillit s’étrangler mais la petite continua : – Il y a quatre ans, on m’a retrouvée endormie en plein milieu d’une route. Je semblais n’avoir rien subi de grave sauf qu’à mon réveil je ne me souvenais plus de rien, à part de mon prénom, Anna. Comme personne ne me connaissait et ne pouvait dire qui étaient mes parents, je fus adoptée. Après un an et demi, mon médecin déplora que je ne grandisse pas. Me croyant atteinte d’une grave maladie, mes parents me retirèrent de l’école et me firent passer toutes sortes de tests pour tenter de comprendre quelle était la cause de ma non-croissance. Ces tests ne dévoilant aucun résultat, ils décidèrent de me garder à la maison pour surveiller mon développement. Ce fut pendant cette longue période à rester cloitrée chez moi que je finis par démêler mes 22
sentiments et impressions. En effet, il me semblait que tout en moi était comme figé. J’aurais dû dépérir à rester ainsi enfermée mais non, je restais parfaitement la même. Rien chez moi n’évoluait. Et un jour, pour l’anniversaire de mes onze ans, mes parents m’offrirent un livre, votre livre, celui qui porte pour titre Anna, mon étincelle. C’était en effet le nom qu’il avait donné à son dernier roman. En l’honneur de cette inspiration qui lui avait permis d’écrire ses histoires. Il écoutait Anna sans réfléchir ou tenter de comprendre comment elle pouvait se tenir là devant lui, il se contentait de l’écouter et d’assimiler tout ce qu’elle disait. Il ne put s’empêcher de noter qu’elle s’exprimait comme une adulte malgré son air enfantin. Exactement comme l’Anna qu’il avait créée. – Je lus votre livre avec une attention toute particulière puisque l’héroïne me ressemblait en tout point. Pas seulement dans le physique et le caractère mais aussi dans l’attitude et les habitudes. Sans parler du fait que sa robe fétiche était exactement la même que celle dans laquelle j’avais été retrouvée évanouie. Plus je lisais, plus je me mis à croire que vous aviez écrit ce livre en me prenant pour modèle. Vous deviez certainement me connaitre. Cela devint une certitude quand, à la fin de l’histoire, je vis votre photo et que le premier mot qui sortit de ma bouche fut « papa ». Alors voilà, si je suis ici c’est pour vous demander si, par hasard, je ne serais pas votre fille ? Il n’en croyait pas ses oreilles, tout cela était tellement insensé mais, malgré cela, une théorie invraisemblable se mit à germer dans son esprit et, au lieu de lui répondre, il lui tendit la fameuse feuille qu’il écrivait tous les soirs. Elle la lut avec attention et le fixa le regard plein de questions. 23
Il lui demanda donc : – Est-ce que, comme mon Anna, tu as toujours sur toi ton journal dans lequel tu écris ta vie ? – Ou… oui. – Dans ce cas, cela ne te dérangerais pas de me le confier et de revenir dans deux jours ? – N… Non. Mais pourquoi ? – Tu verras, dit-il avec un sourire malicieux. Anna lui laissa donc son journal et repartit dans l’incompréhension la plus totale. L’écrivain, quant à lui, savait exactement ce qui lui restait à faire. Pour aider l’enfant, il devait d’abord savoir pourquoi elle l’avait rejoint dans la réalité. Tous les habitants du quartier furent bien surpris de ne pas le voir à sa table pendant une journée et demie et qu’il apparaisse l’après-midi suivant une liasse de papiers à la main. Ils furent encore plus surpris de voir une petite fille avec des nattes noires l’y rejoindre en courant. Elle s’assit devant lui et lui dit : – Je me souviens de tout, d’absolument tout ! Comment c’est possible ? – Il m’a suffi d’écrire en quelques pages la vie que tu as menée ces quatre dernières années, en veillant à utiliser le même style que celui que j’avais utilisé pour écrire le début de ton histoire et en pensant à rajouter que tu finissais par retrouver tes souvenirs. Mais maintenant qu’ils sont revenus, peux-tu me dire comment tu as fait pour sortir du livre ? 24
– Eh bien en fait, c’est grâce à vous. Vous m’aviez faite tellement réelle que je vivais vraiment tout ce que vous écriviez. Mais, à la fin de mon aventure, j’étais perdue et comme je ne pouvais mourir puisque vous ne m’aviez pas écrit de fin, je suis inconsciemment sortie du livre pour pouvoir continuer à évoluer. – Mais tu ne pouvais pas grandir ni te développer puisque je ne l’avais pas décrit. – Exactement, mais maintenant, s’il vous plait, remettez-vous à écrire mes histoires car, comme je suis maintenant, je ne vis plus vraiment. J’existe mais je ne vis plus. Et, à partir de ce jour, l’auteur n’eut de cesse d’écrire. Il avait compris que désormais son étincelle était et resterait toujours son Anna. Peu à peu, il reprit vie. Et chaque nuit dans ses rêves apparaissait une enfant qui, avec les années, fut de moins en moins une enfant et qui l’appelait « papa ». C’est ainsi que Philippe Clerens trouva enfin le bonheur.
25
Seelis VAN DER AUWERAERT Souvenirs
Une femme entra dans la chambre. Qui était-ce ? Je n’avais aucune idée. – Alors Marc, comment était ta journée ?, me demanda-t-elle. J’essayais de formuler une réponse, mais les mots ne me venaient pas à l’esprit. J’essayais de me rappeler ce que j’avais fait durant la journée, mais je ne me souvenais de rien. Je me contentais donc de hocher la tête. La femme me regarda d’un air triste, comme si je lui faisais de la peine. – Désolée, je n’avais pas réfléchi avant de poser la question, dit-elle. Il me faut toujours un moment pour m’habituer aux patients après les vacances. Tu m’as beaucoup manqué d’ailleurs. En entendant le mot « vacances », j’eus une espèce de déclic. Je sentais l’odeur salée de la mer, dont les vagues fluctuaient à mes pieds. Le vent tiède ébouriffait mes cheveux. Le ciel était d’un bleu foncé, sans aucun nuage. Je regardais l’horizon, là où l’eau se confondait avec le ciel. – Marc, tout va bien ? 27
J’étais de nouveau dans la chambre aux murs blancs. La femme s’était assise dans le vieux canapé rouge en face de moi. De nouveau, je n’arrivais qu’à hocher la tête. Elle me souriait, versant du thé dans une belle tasse en porcelaine. Elle y mit ensuite du sucre, remuant le tout avec une petite cuillère. Tout en me tendant la tasse, elle me dit d’un ton paisible : – Je suis allée au Japon pendant dix jours. Selon ta femme, vous y êtes allés il y a quinze ans. C’est triste que tu ne puisses plus te souvenir du voyage. Le Japon est vraiment un endroit magnifique. La culture y est complètement différente de la nôtre et le climat y est très agréable ! – Je m’en souviens, lui dis-je. Les yeux bleus de la femme s’écarquillaient – elle ne me croyait pas. – À Tokyo, il y a des buildings aussi hauts que les nuages. Les rues y sont propres, malgré une foule immense qui s’y déplace constamment. De grands écrans illuminent la ville la nuit, les couleurs changeant rapidement comme les lumières d’une discothèque. Quand il pleut, des parapluies transparents forment une grande masse au-dessus des têtes des gens. Les voitures y sont la plupart du temps petites, avec un capot très court. Aussi, la ville… la ville… Les mots m’échappaient. Ils repartaient aussi vite qu’ils m’étaient venus. Je n’arrivais plus à continuer mon histoire. Je ne me souvenais plus de la suite. – Marc ? Je regardais la femme. Je n’avais toujours aucune idée de qui elle 28
était. Elle était blonde, assez grande, avec des jambes très fines. Ses yeux d’un bleu très vif ressortaient de son visage parsemé de taches de rousseur. Ses habits avaient quelque chose de médical. Elle portait un polo assez moulant, en dessous duquel elle avait un pantalon blanc lui aussi. Une petite carte plastifiée, accrochée à son veston juste au-dessus de son sein droit, attira mon attention : « Myriam Genet - La Tour Centre pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ». Alzheimer. Ce nom me disait quelque chose. Un déclic. – M. Moens, sachez que je ne suis pas là pour vous rassurer avec du blabla inutile. Je vais donc aller droit au but, me disait le Dr Mossad. Mon cœur battait de plus en plus vite. – Vous êtes atteint de la maladie d’Alzheimer. J’avalai ma salive. Ce que je craignais le plus venait d’être confirmé. Je me tournai vers ma femme et je voyais des larmes couler sur ses joues. – Très bien, M. Mossad, dis-je en me tournant vers le docteur. Les mots sortirent de ma bouche d’un ton sec et monotone. J’essayais de cacher le fait que cette nouvelle m’effrayait, me dévastait. Bientôt je ne saurai plus ce que j’ai fait la veille. Plus tard, je ne me rappellerai plus mes années d’études, puis je n’arriverai plus à reconnaitre ma femme ni mes enfants. Finalement, parler deviendra difficile, vu que mon vocabulaire deviendra de plus en plus petit. Mon cœur battait très vite, trop vite même – je ressentais une douleur légère 29
au niveau de ma poitrine. – Tu es étrange aujourd’hui, Marc, me dit la femme en polo blanc, Myriam. Tu es sûr que tout va bien ? Un moment tu es présent, l’autre tu deviens absent. Mais tes yeux sont plus vifs lorsque tu ne m’écoutes pas. – Des souvenirs… C’est tout ce que j’avais à dire. Je me levai pour me diriger vers les toilettes. J’avais soif. J’ouvris le robinet et je vis le filet d’eau augmenter doucement en puissance. Le filet devenait un jet, puis une petite cascade. Des gouttes d’eau giclaient jusqu’à mon visage. Je réajustai la puissance en tournant le robinet, puis je formai un bol avec mes deux mains. L’eau le remplit rapidement, une partie s’écoulant entre mes doigts. Je buvais le liquide froid, bol par bol, puis je m’éclaboussais le visage d’un grand geste des mains. Je levai les yeux vers le miroir. Derrière moi, Myriam se tenait dans l’ouverture de la porte. Elle me fixait de ses yeux bleus. Elle observait intensément le reflet de mon visage. – Dis-moi Marc, ces souvenirs dont tu parles, ils sont comment ? Je me tournai lentement vers la femme, essayant de construire une phrase cohérente dans ma tête. Les mots me venaient difficilement mais, après un petit bout de temps, j’avais une phrase correcte. Je lui répondis : – Ils me viennent de temps en temps. Souvent après un mot ou un bout de texte. Ils sont clairs, mais furtifs. J’ai l’impression de disparaitre 30
dans un monde à part. Quand ils disparaissent, je ne me souviens plus de ce que j’ai vu. Je me souviens juste d’une sensation de joie immense. Myriam sourit d’un sourire magnifique. Quelqu’un frappa à la porte. Elle se tourna et commença à marcher vers l’entrée de la chambre, se déhanchant légèrement. Myriam ouvrit la porte et une autre femme entra. Celle-ci n’était pas du Centre : elle portait un long manteau beige et des chaussures à talons en cuir noir. – Ah, bonjour Myriam !, dit-elle. Les vacances se sont bien passées ? – Oui, elles étaient excellentes. Le repos m’a fait du bien !, répondit Myriam. – C’est vrai que vous le méritez vraiment ce repos. Marc va bien ? Myriam se tourna en souriant, me désigna d’un geste de la main et dit : – Comme vous pouvez voir, il est en excellente forme ! Je souriais chaleureusement à la femme, examinant son visage. Elle devait être dans sa cinquantaine et avait des yeux brun foncé en amande. Ses cheveux roux retombaient en grandes boucles sur ses épaules. Son nez, petit et fin, se trouvait à une distance parfaite de ses lèvres rouge pâle. Quand la femme me vit, un grand sourire illumina son visage et elle se précipita pour me donner un câlin. Son corps dégageait une odeur envoutante que je reconnaissais. Je me trouvais de nouveau au bord de la mer, couché sur un grand linge, sous un parasol rouge et blanc. La mer se trouvait à quelques pas de la chaise et je voyais le reflet du soleil étinceler dans les vagues. À côté de moi, ma femme lisait un magazine, couchée sur le côté. Je contemplais son corps magnifique. De mes yeux, je suivais la ligne de ses pieds, passant par ses cuisses, son derrière arrondi, puis le creux léger de sa taille, finissant par ses épaules, que recouvraient de longues 31
mèches rousses. Je m’approchai doucement d’elle, l’embrassant sur la nuque. Une odeur douce et sucrée remplit mes narines. – Isabelle. La femme rousse fit un pas soudain en arrière. Myriam était derrière elle, les yeux grands ouverts, l’air incrédule. – M… Marc ?, me dit la femme rousse d’un ton hésitant. – Isabelle ! Le nom sortit de ma bouche avec force. Isabelle rit, des larmes se formant dans ses yeux. Très vite, les gouttes devinrent trop lourdes et coulèrent le long de ses joues. Elle m’étreignit, son rire était interrompu par des sanglots irréguliers. – Marc… Ça fait si longtemps…, me dit-elle doucement. Je la serrai dans mes bras, déposant un long baiser dans le creux de son épaule. Je sentais à mon tour des larmes tièdes couler sur ma joue. J’avais reconnu ma femme.
32
Alexia DEHAES Élémentaire, mon cher Klimt…
Tant d’heures de préparation, un travail demandant une énorme dose de précision, tout ça parce qu’une idée aussi folle que complexe avait germé dans mon esprit. Je ne suis pourtant pas du genre à réaliser toutes les petites folies qui me passent par la tête mais, cette fois, c’était différent; cette idée s’était enracinée dans mon esprit jusqu’à devenir une obsession que je ne pouvais supprimer de mes pensées. Elle revenait sans cesse me hanter et la tentation de la réaliser était devenue trop forte… Le déclic s’était produit le jour où une cliente était venue dans mon atelier pour récupérer un de ses anciens tableaux que je venais de restaurer. Elle avait l’air assez contente de mon travail lorsque je lui remis son tableau, elle me remercia et me dit : – Si j’avais un talent tel que le vôtre, je ne perdrais pas mon temps au-dessus de ces vieilles œuvres. Pourquoi ne tentez-vous pas quelque chose de différent ? Il est vrai que je possédais un don en peinture que je souhaitais exploiter de manière plus prestigieuse. Tenter quelque chose de différent. Cette idée me torturait l’esprit depuis des jours, depuis cette petite étincelle et, pour une fois, j’avais fini par céder… et par me lancer dans un projet. Le but de celui-ci était 33
uniquement de transformer ma routine quotidienne en y ajoutant un grain de folie. J’étais désormais au centre de l’action, assis dans cet atelier sur une chaise en bois très inconfortable, parmi des spécialistes. Un de ces experts me jeta un coup d’œil suspicieux, pendant que les autres analysaient mon travail. Je ne cessais de me dire que, sans cette cliente, je ne serais pas assis dans cet atelier mais bien dans le mien (où les chaises étaient d’ailleurs nettement plus confortables). J’avais réalisé mon projet le plus fou, uniquement grâce à cette phrase (qui semblait d’ailleurs tout juste sortie d’une pub pour une nouvelle voiture) : « Tentez quelque chose de différent. » Une voix m’extirpa de mes pensées : – Tout à l’air en ordre monsieur, cependant nous ne comprenons toujours pas certains éléments…, me dit l’homme assis à côté de moi. Je n’écoutais plus; je paniquai tout d’un coup, quelque chose clochaitil ? Avais-je commis une erreur ? J’avais pourtant tout revu dans les moindres détails. J’étais en train de paniquer, il fallait que je me ressaisisse au plus vite sinon ils allaient percevoir mon angoisse. Je m’entendis lui répondre d’une voix mal assurée : – Ah, très bien. Euh… que souhaitez-vous savoir exactement ? – Pouvez-vous nous réexpliquer encore une fois toute l’histoire depuis le début ?
34
Tout réexpliquer ? Je me sentis un peu mieux, c’était mon moment préféré, celui que j’avais tant préparé et que je connaissais par cœur. Je ne pouvais pas leur dire la vérité bien entendu, c’était même hors de question, alors je récitai mon texte (de manière très professionnelle bien sûr). – Je travaille toujours en procédant de la même manière : je fixe un rendez-vous à mon client, je note sur une fiche les aspects à améliorer et également ses coordonnées pour pouvoir le recontacter lorsque mon travail est terminé…, commençai-je à réciter. – Poursuivez !, dit un homme à ma gauche, d’un ton impatient. – Un jour, un homme est arrivé à l’improviste dans mon atelier, me donnant un tableau qui, selon lui, avait une grande valeur au sein de sa famille et qu’il voulait que je rénove. J’ai procédé comme d’habitude, en ne notant cependant que son nom et son prénom; le reste, m’avaitil dit, ne servirait à rien. Je voulais le recontacter pour avoir plus de détails sur les éléments qu’il souhaitait que je retravaille, mais il n’était plus jamais réapparu, et j’ai découvert plus tard que le nom qu’il m’avait laissé n’était pas le sien mais celui d’un apiculteur de la région. J’avais donc un tableau dans mon atelier qui ne valait même pas la peine d’être amélioré puisque je ne savais pas à qui il appartenait. Je n’y avais plus touché depuis ce jour-là, et ce n’est qu’hier, en me penchant sur cette toile, que j’ai réalisé qu’elle possédait une grande valeur, terminai-je de manière presque théâtrale. Je finissais vraiment par y prendre gout, trop même… La femme en face de moi me lança agressivement : 35
– Vous essayez de nous faire gober qu’un homme est venu dans votre atelier de manière quasi anonyme, avant de disparaitre mystérieusement dans la nature en vous laissant avec cette œuvre d’une valeur inestimable ? Je lisais dans ses yeux une pointe d’agacement. En réalité, elle n’avait pas tort. C’était exactement ce que je voulais leur faire « gober », c’était essentiel, il le fallait, sinon tout risquait de flancher. Ils n’avaient pas l’air très convaincus, je n’avais pourtant pas si mal joué mon rôle. Le passage avec l’apiculteur avait peut-être manqué de crédibilité. – C’est presque ça, mon explication peut paraitre assez surréaliste mais c’est la vérité, sinon comment pensez-vous que cette œuvre soit tombée entre mes mains ?, continuai-je. Je devais paraitre sérieux quoi qu’il arrive, c’était essentiel. Un des hommes, probablement le patron, se leva et me dit : – Votre histoire semble en effet surréaliste mais nous sommes obligés d’y croire parce que, de toute manière, tous nos tests ont prouvé que le tableau datait de l’époque et nos spécialistes ont tout de suite reconnu le style de l’auteur; tout correspond. Je voyais bien qu’il disait cela à contrecœur mais je m’en fichais.
36
J’avais réussi à duper des spécialistes et mon projet avait fini par être une réussite, c’était tout ce qui m’importait. Un mois plus tard, je contemplais le tableau, mon tableau, qui était devenu un joyau du Louvre. Ça, c’était quelque chose de prestigieux, quelque chose de différent. Je voyais des touristes et des amateurs d’art fascinés par ma toile et j’entendais certains commentaires du style : « Klimt, c’était quand même un génie ! » S’ils savaient ! Plus je regardais mon tableau, plus je me revoyais en train de monter ma propre petite arnaque. Je me voyais quelque mois plus tôt ajouter une couche de bronxillium C43 sur une toile neuve afin de lui donner un aspect plus vieux, puis peindre dessus à la peinture à l’huile, avec la précision et le style de ce cher Klimt, pour ensuite la recouvrir à nouveau d’une fine pellicule de bronxillium. Je l’avais ensuite laissé sécher et prendre la poussière un bon mois dans ma cave (j’étais maniaque et tout devait correspondre, y compris l’odeur). Pendant ce temps, j’imaginais le scénario le plus plausible que je pourrais raconter aux experts. Chaque détail avait été crucial, je voulais que tout soit parfait. Je regardai encore une fois mon tableau, il n’était vraiment pas si mal. Mon œuvre représentait une femme pieds nus dans les bois, portant une robe dorée, ornée de quelques motifs rectangulaires et quelques cercles très colorés. Elle jouait du violon et son visage avait une expression assez figée. Bref, une œuvre 100 % Klimt. Un homme se rapprocha de mon escroquerie et la contempla un long moment. 37
Il était très grand et mince, fumait la pipe et portait une drôle de casquette à carreaux d’une autre époque. J’avais l’impression de l’avoir déjà vu quelque part… Soudain, il se retourna, nos regards se croisèrent et je sus précisément à cet instant qui il était. Il vint vers moi et dit de manière à ce que je sois le seul à l’entendre : – Vraiment pas mal du tout, ça a dû vous demander pas mal de temps et de précision, non ? C’est drôle, j’ai failli me faire avoir moi aussi. J’étais stupéfait, il méritait vraiment sa réputation. Il m’adressa un mince sourire satisfait. Dire que, d’une petite phrase insouciante, une idée complètement folle était née et qu’à partir de cela, j’avais monté une arnaque qui avait fini au Louvre, une arnaque indécelable à 100 %… enfin presque !
38
Textes des lauréats juniors
- Claire FRANCIS Grand frère - Sarah MASSAY Dans une chambre - Gaëlle SIMON Dans la vie d'une allumette
41
Claire FRANCIS Grand frère
Le front collé contre la vitre froide de la camionnette (elle est chouette, blanche avec un drôle de petit bonhomme vert dessus), j’observe la lune qui semble nous suivre. On dirait une crêpe. J’ai faim. Pourtant, quand j’imagine avaler quoi que ce soit, une envie de vomir monte dans ma gorge. J’ai l’impression qu’un tout petit animal est dans mon ventre, et qu’il a très mal, qu’il se tord dans tous les sens, comme s’il allait « rendre son âme à Dieu » (c’est papy qui dit ça... En fait c’est la même chose que « crever » mais en plus joli). Est-ce que moi aussi, je suis en train de mourir ? Je voudrais qu’on s’arrête. Je voudrais qu’on fasse demi-tour. Je voudrais qu’on rentre chez nous tous ensemble et que tout soit comme avant. Mais je dis rien. Parce que je suis le plus âgé. J’ai onze ans. C’est plus que les deux mains. Ils dorment tous. Sauf toi, papa, puisque tu conduis. Papa. Tu as changé. J’ai essayé d’en parler avec Janis, ce petit frère qui me ressemble tant, mais il ne comprenait pas ce que je voulais dire. On dirait que tu es vieux, encore plus quand tu trembles. Tu es tout 43
blanc, avec des yeux rouges, comme le sable de la plage. Je préférais le papa d’avant. Le papa fort, qui rigolait et qui disait plein de vilains mots, que j’ose même pas répéter. Je suis pas idiot. Je sais que tu es malade parce que tu n’as plus tes petits sachets bizarres, que maman appelait « ton gouffre financier », auxquels ni moi ni les autres ne pouvions toucher. Même pas pour faire une blague (enfin, on peut essayer, mais il faut courir vite alors, parce que, quand tu es fâché… tu fais un peu mal parfois). Tu me manques. Et j’ai peur. Maman dort aussi. J’imagine qu’elle se lève, qu’elle me prend doucement dans ses bras et qu’elle me chuchote, les yeux brillants, que je suis courageux, qu’elle m’aime. Alors je me blottirais contre elle, je pleurerais peut-être, je regarderais les reflets de la lune jouer comme des enfants dans ses cheveux, puis elle me dirait qu’on rentre à la maison, que c’était pour rire. Je veux pas penser à ça. Je veux pas pleurer. Pas encore. Parce que je suis fort. Je suis un grand. Un grand frère. Nous sommes arrivés dans une ville avec un nom très difficile à dire, et je n’ose pas te demander de répéter. Tu parles une drôle de langue un peu prétentieuse, avec un gros monsieur et une madame avec la peau brune comme la terre et des cheveux trop jaunes. Janis me glisse qu’on dirait des chevaux, avec leurs dents plates et dorées, ce qui me fait rire. Je crois que tu essayes de trouver un endroit pour dormir cette nuit, parce qu’Alyson a vomi dans la voiture et que ça sent vachement mauvais. C’est dur de trouver des 44
lits pour tout le monde. On est une grande famille. Six enfants. Janis, qui a un an de moins que moi, Alyson, qui a sept ans et qui reste toujours collée à Lou, qui va sur ses huit ans, puis les petits, Shaan et Tinou. Estce que tu nous vois ? Maintenant, six paires d’yeux noisette fixent le couple de poneys, tandis que Tinou, le bébé, dort contre la poitrine de maman, les poings serrés, comme pour se protéger. J’ai la plus belle des mamans. Elle a peur de rien, elle raconte plein de trucs pour les grands (un peu dégoutants parfois) et elle rigole très fort. Trop fort peut-être. Je sais qu’elle voudrait rentrer à la maison, elle aussi. Je sais qu’elle t’en veut de ne pas avoir cherché un travail, de ne pas l’avoir prévenue qu’on partait parce que tu n’avais pas payé les factures, de ne pas lui avoir demandé de l’aide. Je sais aussi qu’elle t’aime et qu’elle te suivra quoi qu’il arrive. Elle n’abandonne jamais maman. Je voudrais que tu voies tout ce que je fais pour que vous soyez fiers de moi. J’ai jamais (ou presque jamais) pleuré. J’ai jamais dit combien j’avais froid. Combien j’en avais marre. Combien j’avais mal. Et puis ce jour où on dormait dans des tentes, et qu’en pleine nuit, la mienne s’est envolée, comme un immense oiseau aux ailes déchirées : je suis resté. Serré contre Janis, tremblant ensemble sous la force de l’orage. Je me souviens de son visage où les larmes se mêlaient à l’eau glacée. Il avait froid. Il avait peur. Comme moi. On n’osait pas vous déranger, toi, maman et les autres, bien au chaud dans la camionnette. On voulait attendre le matin plutôt que de vous réveiller. Puis tu es arrivé, comme un fantôme, blanc et hurlant. Je ne 45
comprenais pas ce que tu criais, papa. J’essayais, mais il y avait trop de bruit. On ne voyait rien, sauf ton visage trop pâle qui semblait flotter dans le déluge. Quand ta main s’est refermée sur mon épaule, j’ai cru que mon bras frigorifié allait se décrocher. Tu nous as entrainés durement vers l’arrière de notre vieux tacot, nous y lançant presque. Puis ça a été le silence feutré, qui habituellement règne dans une chambre d’enfant. Jamais je n’ai aussi fort entendu le calme, même si la pluie était toujours là. Alyson et Lou étaient lovées, l’une contre l’autre, comme les salamandres du Portugal sur le sable brulant, et Shaan, le pouce en bouche, avait la tête sur le ventre de maman, qui tenait dans ses bras maigres et doux le bébé Tinou. Je les regardais, là, immobile, mes quelques vêtements gorgés d’eau tombant en loques à mes pieds. Dis papa, tu te rappelles ? Tu te rappelles de ce jour-là ? Dis-moi que tu te souviens. Je crois que je suis en train de faire une bêtise. Une grosse bêtise. J’ai peur. On n’a pas le droit d’être ici, même si tu dis que oui. Cette maison toute froide, avec le vent qui hurle comme un loup blessé en nous faisant frissonner, elle est pas à nous. Je suis terrorisé à l’idée qu’on nous surprenne ici, qu’on nous chasse en nous criant dessus, en nous beuglant des horreurs dans une langue que je comprends pas. Je veux partir ! Je veux sortir ! Je me réveille, ressort cassé qui se dresse. Mon cœur affolé cogne contre mes côtes, menaçant de les éclater. Assis, je pose une main 46
moite sur mon torse, la respiration saccadée et sifflante. Calme-toi, Adrian. Respire. Un souvenir. Un souvenir dans un cauchemar. C’est fini. Je suis en sécurité. Il fait bon ici. Dans le noir, j’entends les gémissements de Janis, les ronflements de maman (il ne faut surtout pas lui dire, hein papa ?) et de Shaan, avec les respirations de Lou, Alyson et Tinou, et toi qui bouges dans ton lit. Je me répète que tout va bien, je ne risque rien dans la yourte des amis des deux chevaux. C’est confortable, petit et plein de couleurs qui donnent envie de dormir. J’adore être ici, papa. J’avais oublié ce que ça faisait de ne pas devoir marcher pendant une heure pour avoir de l’eau. Tu te rends compte ? J’avais oublié les robinets. Et puis on a même l’électricité ici, dans cette petite cabane pleine de couvertures. On a des lampes ! J’avais envie de rire et de pleurer, tellement c’était ridicule d’être émerveillé pour quelque chose d’aussi normal. Des petites lumières qui s’allument le soir. Une yourte. La première fois que tu as prononcé ça, ça m’a fait penser à « yahourt ». Tu nous avais expliqué que des fermiers, des amis de M. et Mme Hanson (les deux chevaux), voulaient bien nous prêter cette petite habitation, au milieu des champs, reliée à une caravane, qui nous fournirait de l’eau et de l’électricité. Maman avait même souri. Elle est plus belle comme ça. Mais on a encore faim. Tu le sais. Mais tu dis que tu es malade, que tu ne peux pas aller chercher du travail. Couché dans ton lit, je ne 47
comprends pas pourquoi tu ne te lèves pas, ni pourquoi tu regardes le plafond, comme si tu réfléchissais. À quoi tu penses ? J’ai peur parfois. De toi. Maman dit que tu es comme ça à cause de la fièvre, que tu délires. Que tu es « en manque ». Tu as besoin de quoi ? Je peux tout aller chercher pour toi. Même si c’est très loin, même si c’est très dur. J’ai eu douze ans. J’ai faim. Tu es toujours malade. Je veux rentrer à la maison. Tout le monde dort. Sauf moi. Maman dit : « Qui dort dine ». Mais j’y arrive pas. Mes paupières refusent de se fermer. À côté de moi, Janis et Alyson dorment, petits êtres squelettiques. Quand je regarde leurs bras aussi fins que des allumettes, les yeux enfoncés et cernés de noir, ces côtes qui ressortent à en déchirer leur peau et ces joues creusées, je t’en veux. Je ne comprends pas. Pourquoi tu nous aides pas ? J’en ai assez de tout faire. Je veux redevenir le petit Adrian, qui ne comprenait pas. Le petit Adrian qui pouvait aller dans les bras de sa mère pour se faire consoler. Le petit Adrian qui avait le droit de dire « stop » et de pleurer. Je te jure que j’essaye de leur faire oublier, à Janis, Lou, Shaan et Alyson. Je leur montre les étoiles, en leur disant qu’elles ne sont pas les mêmes que chez nous. Je leur dis en riant que, si on était encore à la maison, on serait obligé d’aller à l’école, et qu’on ne pourrait pas se coucher aussi tard. Je leur apprends des nouveaux jeux, de nouvelles histoires… Je ne veux pas qu’ils comprennent. Je ne veux pas qu’ils 48
pleurent. Qu’ils aient conscience de là où ils sont et de ce que nous sommes devenus. Je dois les protéger, les défendre contre cette réalité qui me consume doucement. Tu as vu papa ? Je parle mieux. J’utilise des mots de grands. C’est toi qui devrais faire ça. Les aider. M’aider. Mais tu ne fais rien ! Tu restes couché ! Et tu es un menteur ! Quand tu nous as dit qu’on avait plus d’électricité parce que des autres enfants avaient saboté les fils, tu me prenais vraiment pour un débile. Avec ton regard fou et tes mains pleines de noir, j’avais compris. Qu’est-ce que tu fais ? Pourquoi ? Papa, explique-moi. Quand je te pose des questions, soit tu ne réponds pas, soit tu cries. La dernière fois tu as dit : « Je suis fatigué Adrianito ». De quoi tu es fatigué ? Tu dors tout le temps ! J’en ai marre papa. Vraiment marre. Le sommeil ne veut toujours pas de moi. J’ai beau chercher ses bras, il me repousse comme un nuage de moustiques. On entend les grosses sauterelles. Quand j’ai demandé où on était à maman, elle m’a dit : – Avant, en Espagne. Puis on a roulé jusqu’au Portugal. Ici, on est tout près de Matosinhos. C’est le nom compliqué que j’avais entendu et que je n’osais pas te demander de répéter. Donc ce sont des sauterelles portugaises. Cette conclusion me fait sourire. Il fait totalement noir dans la yourte. Du moins d’habitude. Là, il y a 49
une douce lumière qui ondule. Puis j’entends des bruits. Des pas, lourds, trainants. C’est toi. Surprise. Tu es sorti de ton lit ? Aussi tard ? Quelque chose ne va pas. Comme un message, mon cœur se met à battre plus vite et une angoisse glauque me serre le ventre. Les pas se rapprochent du centre. – Papa ? Ma voix est si faible que même moi, je l’entends à peine. Je repousse Janis, qui pousse un gémissement. Silencieux, je sors de mon lit et approche. Je ne suis qu’une ombre fondue dans l’obscurité. – Papa… ? Qu’est-ce que tu fais ? Maintenant je distingue mieux ce que tu as dans les mains. Une buche. Enflammée. Comme si c’était un nourrisson, tu la déposes avec précaution au milieu de notre abri. Épouvanté, j’aperçois, l’espace d’un instant, ton visage à demi fou, tes yeux brillants à cause de la fièvre ou des larmes. Tu ne m’entends pas. Ou plus. Tu es loin. Pourquoi ? Qu’est-ce qui se passe ? 50
La panique m’envahit, me coupant la respiration, engourdissant mes bras et mes jambes. Puis, je comprends. En un éclair, c’est une évidence. Je pensais que tu ne voyais rien. Je croyais que tu ne remarquais pas. Toute cette souffrance, ces jeux qui nous faisaient oublier notre misère, nos côtes saillantes, cette peur, cette détresse que nos cris muets tentaient de te faire comprendre. J’étais idiot. En fait tu t’en rendais compte. Et tu veux que ça s’arrête. Que tout s’arrête. Je suis désolé papa, mais tu n’as pas le droit. Je ne veux pas. Je ne me suis pas battu pour rien. J’ai été courageux. Et je ne veux pas partir. Pas comme ça. Alors que des flammes gourmandes lèchent déjà le sol, je comprends qu’il est trop tard. Trop tard pour lancer la buche dehors, pas pour nous en sortir. Je réveille Janis, qui comprend d’un regard la situation, comme s’il s’y attendait depuis longtemps. Prenant quelques affaires sur son dos, il s’élance vers la sortie. Je réveille maman, à force de cris. D’un bond, elle saisit Tinou, qu’elle garde contre elle, tout en tirant un Shaan en pleurs par la main. Je voulais voir les rayons de la lune dans ses cheveux, il y a bien longtemps. Là, ce sont des lueurs orangées qui dansent dans ses 51
yeux. Je l’ai déjà dit et je le répète car, plus à ce moment-là qu’à aucun autre, je peux affirmer : J’ai la plus magnifique des mamans. Réveillées par mes cris, Lou et Alyson sont déjà debout, perdues, décontenancées. Quand elles comprennent, elles hurlent de terreur. Des vagues de chaleur me brulent le dos, la fumée me fait tousser et me pique les yeux. Est-ce que c’est ça l’enfer ? Du chaos, de la chaleur, des frissons d’angoisse et cette impression que tout se referme ? Une sur le dos et une dans les bras, je me précipite dehors, avec cette force que je dois aux allers-retours sous un soleil de plomb, croulant sous le poids de bidons remplis d’eau. Dans la nuit noire, notre abri n’est plus qu’un immense brasier. Maman ne pleure pas, trop brisée, trop épouvantée pour y penser. Contre elle, Shaan sanglote. Elle serre Tinou, petit loir endormi, dans ses bras, comme pour s’accrocher à quelque chose. Toi, tu as réussi à te tirer de la fournaise en rampant. Je devrais te faire rouler dedans, te cracher dessus, t’insulter. Mais la seule envie qui me tenaille, c’est de me précipiter vers toi, pour t’aider à te relever. Je te cherche des milliers d’excuses. Maladie, chaleur, fièvre, tu voulais bien faire. Mais aucune ne me satisfait. Pourquoi je n’arrive pas à t’en vouloir ? Pourquoi je ne te repousse pas du pied ? Pourquoi je t’aime encore ? 52
Janis vient près de moi, m’enlaçant de ses bras décharnés. Comme s’il s’agissait d’un spectacle, nous admirons les flammes qui dansent, qui ondulent en un rythme inconnu et qui s’élèvent vers le ciel, toujours plus majestueuses, toujours plus hautes, faisant admirer leurs parures dorées et destructrices. Les étincelles, éclats dorés dans l’obscurité, s’enfuient, vives et incontrôlables, libres, vers un destin qui leur appartient. Minuscules morceaux incandescents qui signifient tellement plus que le plus grand des brasiers. C’est une de ces étincelles, j’en suis certain, que je vois dans le regard perdu de Janis. Je la vois, juste là, briller, tremblante comme un espoir imploré, un merci offert et une reconnaissance qui me perce le cœur. Puis elle s’échappe, roulant sur sa joue creuse, suivant la courbe de ses lèvres et coulant le long de son cou trop fin. Tremblant, je la cueille du bout de mon doigt, comme un trésor, pour l’effacer. Je sens la petite main de Shaan qui saisit la mienne, les cheveux de Lou qui me chatouillent le coude. Alyson vient prendre mon autre main. Puis je te regarde, droit dans tes yeux que j’ai pareils. Papa, je suis un frère. Un grand frère.
Inspiré de faits réels. 53
Sarah MASSAY Dans une chambre
C’est dans une chambre où l’air est froid comme en un cercueil de verre, où le parquet brule comme de la glace usée et dont chaque meuble est marqué par trop d’amour. Derrière les longs corridors emplis de courants d’air muets, après les escaliers escarpés, plus loin encore que le mur du silence, se trouve la chambre. Aucun son ne sort de cette pièce, mais tous la pénètrent dans un vacarme résonnant de terreur. Les pas dans le couloir annoncent la tendre punition. Là-bas, les litanies des remontrances et les fessées sont dérisoires, elles sont les préliminaires aux choses plus subtiles. Car nul n’est sanctionné en ce lieu, seul l’amour y est distribué parfois, certes, en trop grande quantité. C’est l’histoire d’un enfant, petit et charmant. Il a à peine cinq ans. C’est l’histoire d’un enfant qui attend. Recroquevillé et impatient, il se demande les larmes aux yeux quand son tant aimé parent lui reviendra. Ses larmes versées ne sont bien sûr que les fruits de sa joie amère, son sourire déborde de souvenirs, lointains et récents. Tous sont plus beaux les uns que les autres, parfois douloureux, mais ne nous faut-il pas souffrir un peu pour aimer ? Le corps du bambin est calme, son excitation est dupée avec tant de maturité que c’en devient effrayant. Et ses yeux cernés, dans lesquels se reflètent toutes ces années d’obéissance, sont la preuve irréfutable de son éducation irréprochable, de son enfance sacrifiée à l’amour. Tranquille, il se repose contre le radiateur et savoure ce moment si pur; 55
tout est silence. Seul le bruit des voitures vient briser cette paix si précieuse. Les moteurs ronronnent et râlent, mêlant leur chant aux pas des passants trop rapides, trop pressés pour s’arrêter un instant. Peutêtre auraient-ils pu entendre la respiration du petit s’ils avaient tendu l’oreille, car celle-ci est puissante, son souffle envahit la chambre et retentit dans sa poitrine. L’air est humide, la pièce froide mais, malgré cela, le chauffage est bouillant si bien qu’il lui brule le dos. Cependant, l’enfant ne peut s’arracher à cette chaleur apaisante, même ses jouets ne peuvent rivaliser avec cette douceur enivrante qui règne dans la chambre. La lune ose à peine regarder par la fenêtre, elle est consciente de l’instant précieux et de son futur – un moment furieux. Elle ne peut s’empêcher de surveiller, comme une mère veillerait son bébé endormi au fond d’un cercueil, sans trop y prêter attention, de peur d’en souffrir. Elle se contente d’assister, mécontente et indignée, même un peu jalouse, au doux courroux. C’est l’histoire d’un enfant qui attend, recroquevillé et impatient, quand un pas, lent et résonnant, glisse dans l’ombre. Quel soulagement, sa solitude trouve enfin un terme ! Tout son être se tend au bruit de la poignée qui tourne pour laisser entrer l’adoré. Hélas, le père est éreinté, son teint pâle fait ressortir ses cernes surmontés d’un regard fixe; il semble usé de sa journée. Les heures étirent son visage, pèsent sur son dos, elles furent longues et pénibles; néanmoins, le temps de la consolation est proche. Sa récompense, durement méritée, lui sera accordée sans délai, sans résistance, sans doute même à plaisir partagé… Dans le cœur de l’innocent, la joie se mêle à la peur, l’amour à la douleur. Et même si celle de son corps se régénère, la beauté de son âme ternit sous la puissance des étreintes. Elle s’érode doucement, coule dans chacune des larmes qui éclatent au contact du parquet brulant et jonchent le sol de souvenirs. 56
Le sourire du bambin ne trouve pas de réponse. C’est un visage familier et sévère que rencontrent ses yeux. Le père s’avance lentement, iI savoure la distance décroissante qui le sépare de sa progéniture. Chacun de ses pas détruit une chose innommable dans la poitrine de l’enfant, jusqu’à ce qu’une plaine déserte ait supplanté toute émotion. Ainsi qu’une fleur qui fane ou un cadavre en putréfaction, son jeune visage se décompose devant l’allure du géant en face de lui. Il patiente, immobile. Nul velours ne vient adoucir la poigne de fer qui se saisit du petit corps, le projetant tendrement sur le lit. Les couvertures, légèrement froissées, sont froides; elles semblent un linceul drapant une petite mort inhérente à cette pièce. Mais le lit, ce lit n’est pas qu’un vulgaire sommier couronné d’un matelas, il est un temple où s’exerce un culte mystique et fascinant, une dévotion à l’amour, un amour inconditionnel, incompris, irrationnel… Un vrai délit d’aimer à ce point. Et dehors, toujours, les voitures et quelques rares piétons et la lumière de la lune. La douce lumière argentée, mêlée à l’éclat orange des lampadaires, éclaire la chambre, projetant de larges ombres sur le parquet encore glacé, à chaque passage plus usé. Et les passants se font plus rares, les moteurs imperceptibles. Le monde s’anéantit tout autour. L’innocent sous les draps, paralysé par la beauté de cette scène, patiente. Allongé et anxieux, il ne rêve pas; à vrai dire, il n’y songe même pas, l’heure du coucher est encore loin. Sur ses coussins, comme un prince à qui l’on prête mille-et-une attentions, son corps est pris de tremblements; sans doute a-t-il froid. Heureusement, son père se rapproche jusqu’à atteindre le bord du matelas, il va le border, le réchauffer. Ce sont de grandes pattes qui viennent arracher ses vêtements, des mains puissantes aux caresses délicates. Dans son temple, l’enfant semble une fleur subissant le printemps prématuré d’un 57
soleil hargneux. Ses chairs comme des pétales s’ouvrent sous le baiser des rayons qui les pénètrent avec insistance. Son géniteur à ses côtés consume avec rage l’union sacrée qui relie deux êtres s’aimant envers et contre tout; il embrase chacun des pétales au corps de la fleur se tortillant sous lui. Et le bambin, toujours, patiente ; il cherche désormais le bruit réconfortant des moteurs, les pas pressés des passants et la lumière des lampadaires. Mais tous ont fui cet instant ! Le seul son parvenant à ses oreilles n’est autre que celui de sa propre voix, ses pleurs et son souffle haletant. Mais pourquoi chercher une consolation ailleurs qu’en ce lieu ? Cet endroit où tant d’émotions flambent en chœur pour former un brasier humain, mêlant plaisir et péché, douleur et passion ! Nulle flamme ne peut se mesurer à la chaleur étouffante de la chambre. Le désir y brule inlassablement et ronge l’amour comme le feu dévore l’air. Une affection à présent presque imperceptible et pourtant, dans le regard du père, quelle est cette chose étincelante et fugitive ? – Comment se nomme cette lueur fugace qui brille dans tes yeux sombres ? Peux-tu me le dire, toi qui as éteint celle qui brillait dans les pupilles de ton fils ? Quelle est cette lumière s’échappant du bucher ardent, dis-moi, toi qui as éteint celle qui aurait dû étinceler à jamais ? Te sens-tu coupable d’aimer à ce point le petit sous ton corps ? Comprends-tu pourquoi l’éclat vacillant qui l’anime est condamné à s’éteindre en tes étreintes ? Mais je vois dans tes yeux qu’un autre, il y a de cela bien longtemps, a éteint celle qui vivait en toi, et quand le souvenir te revient, quand s’éveille en ta mémoire la flamme de ton passé, j’y vois tout l’amour que tu portes à l’enfant qui est tien, à celui que tu étais. C’est l’histoire d’un enfant qui attend, jeté, vaincu, abandonné, seul, souillé, incompris… Mais aimé. Un jour, il aura un fils, et c’est dans une 58
chambre où l’air est froid comme en un cercueil de verre, où le parquet brule comme de la glace usée et dont chaque meuble est marqué par trop d’amour, que ce fils attendra, patientera et sentira à son tour s’éteindre en lui une chose que seul un brasier brulant peut ranimer.
59
Gaëlle SIMON Dans la vie d’une allumette
On ne sait jamais qui sera le prochain mais une chose est sûre : c’est que ceux tout au fond de la boite passeront en dernier. Je me dis que ceux-là n’ont pas vraiment de chance car ils vont voir leurs camarades partir un par un pour que finalement il n’en reste plus qu’un. Mais bon, c’est le destin d’une allumette, on n’y peut rien ! Moi, c’est Lumette et je suis située au centre de la boite. Je suis ami avec Al et Lulu du côté gauche et avec Minus du côté droit (surnommé ainsi de par sa petite taille inhabituelle). On pourrait croire qu’il déteste être surnommé comme cela mais non, il trouve même ce surnom assez sympathique ! Il n’est pas du genre à s’énerver et on pourrait même dire que c’est un peu le doyen de la boite. Il connait tout sur tout ! Même ce qu’il y a dans le monde extérieur ! D’ailleurs, quand on parle du monde extérieur, Lulu est la plus enthousiaste ! Elle est particulièrement passionnée par ce qui se trouve à l’extérieur. Parfois, elle raconte quelques histoires sur ce qu’il pourrait y avoir, par exemple des monstres à quatre pattes qui vivraient avec les humains ou autres. Mais nous ne saurons jamais si ce qu’elle dit est vrai car, quand nous demandons à Minus, il nous dit que nous n’avons qu’à aller voir nous-mêmes. Facile à dire, lui, il est resté une bonne semaine hors de la boite avant de revenir et a donc pu voir tout ce qu’il y avait aux alentours ! Ah ! je l’envie parfois…
61
Al par contre n’aime pas trop parler du monde extérieur. Il dit que cela n’a rien à voir avec nous et que nous devrions nous occuper de nos affaires. Pas très chaleureux comme type mais, je ne sais pas pourquoi, je lui trouve tout de même un petit côté sympa. Certains d’entre nous ont peur et se demandent jour et nuit quand viendra leur tour. Mais ceux qui font partie de cette catégorie ne sont qu’une toute petite poignée. Les autres préfèrent prendre ça du bon côté et se demandent à quoi ils vont servir. Allumer une bougie ? Un feu de bois ? Ou autre chose ? En tout cas, la plus optimiste d’entre nous, et aussi la plus rêveuse, c’est Lulu ! Elle, elle espère allumer un réacteur de fusée pour aller sur la lune ou alors allumer un nouveau Soleil ! Un peu surréaliste mais elle, ça la fait rire. Minus, lui, espère allumer un cigare. Un peu étrange comme rêve mais chacun ses gouts et ses couleurs comme on dit. Et Al… Bah, en fait, il n’a pas vraiment d’envies ni de rêves. Quant à moi, je me dis qu’allumer une bougie ne serait déjà pas mal; au moins, j’aurais apporté de la lumière aux gens. D’autres, par contre, n’ont pas de chance. Pour les plus malchanceux, ils terminent brisés en deux et, devenus inutiles, sont abandonnés à la poubelle. Ou alors, ils tombent entre deux meubles ou dans un endroit étroit et on ne les retrouve jamais… Il y aussi une autre possibilité, mais beaucoup plus rare. Il se peut, 62
parfois, que certains d’entre nous terminent dans un bricolage pour enfant, collés les uns aux autres sans que jamais leurs rêves ne se réalisent… Mais, comme je l’ai dit, c’est un cas rarissime. Pour notre part, cela ne risque pas de nous arriver. Notre petite boite se trouve dans la maison d’une vieille veuve miteuse. Et je doute qu’à son âge elle fasse encore des bricolages… Je l’ai déjà vue quelquefois, lorsqu’elle ouvre la boite pour choisir l’un d’entre nous. Et j’ai déjà pu voir aussi quelques membres de sa famille. Je sais qu’elle a deux petits-enfants, un garçon et une fille. Par contre je ne sais pas à quoi nous lui servons exactement car elle referme toujours la boite avant que je ne le sache. Lulu dit que c’est surement une vieille et cruelle sorcière qui se sert de nous pour chauffer sa marmite remplie de potions étranges ! Et que ses petits-enfants sont en réalité ses loyaux serviteurs avec lesquels elle convoite de conquérir le monde ! Elle en a de l’imagination quand même… Minus, lui, pense que nous lui servons à allumer son feu car, il faut bien l’avouer, il fait froid ici ! Et je suis sûre qu’elle a beaucoup plus froid que nous. Al, quant à lui, il n’a pas d’avis ni d’idées. En fait, il n’a jamais été très bavard… Ni imaginatif. Moi, je dis que nous le découvrirons quand notre tour sera venu. Que ce soit pour allumer une bougie ou un feu, personnellement, cette fin me convient très bien. Car j’aurai au moins apporté de la lumière et de 63
la chaleur dans la vie de cette pauvre femme. Au moins, je lui aurai donné une petite étincelle de vie. En parlant de ça, une bonne partie d’entre nous est déjà partie depuis que nous sommes ici ! Et leur départ est toujours régulier : une fois par jour quand l’horloge de l’église sonne six fois exactement. Je pense que nous sommes ici depuis… deux ou trois semaines, environ. Et à mon avis, notre tour, à moi, Al, Lulu et Minus, arrivera bientôt car nous sommes de moins en moins dans cette petite boite qui est notre maison. Mais j’espère vraiment que Minus ne finira pas à la poubelle car Al dit que, s’il est revenu dans la boite après une semaine à l’extérieur, c’est qu’il a été jugé inutile. J’espère que non car cela serait vraiment trop triste pour lui... Bref, nous verrons bien, il ne faut pas déprimer ni désespérer ! Car, en quelque sorte, nous sommes tous un peu comme une étincelle d’espoir dans la vie de tous les jours.
64
Textes des lauréats adultes
- Françoise GUIOT Ma vie à pile ou face - Anne VERHAEREN InstantaNés - Martin COENE Mamy - Guillaume LOHEST Le premier tweet de Prometeo - Valentine DUHANT Joyeuses Pâques ! - Patricia HARDY Au troisième étage - Thibaut GROUY Prédateur - Savina LEE L'angle mort - Michel BARBIER Petit matin
67
Françoise GUIOT Ma vie à pile ou face
Lila. Sacré petit bout. Il n’y a plus qu’elle qui me parle normalement. Un moulin à paroles que rien ne fait taire. Elle a toujours été comme ça. Quand ma mère vient avec elle, Lila s’affaire autour de moi sans montrer le moindre étonnement. Comme si j’étais toujours le « moi d’avant ». Comme si tous les appareillages n’existaient pas. Rien que pour ça, tout le monde devrait avoir une petite sœur de six ans. Elle entre dans la chambre. Si je suis côté face, elle grimpe sur mon lit, se couche le long de mon corps qui ne ressent plus rien et commence à pérorer. Si je suis côté pile, elle se cale en dessous du lit Stryker où je suis étendu, accroupie façon grenouille sur une feuille de nénufar et elle jacasse en continu. Puis elle sort de son mini sac rose la brosse à cheveux de sa poupée et me coiffe sans se lasser. Je l’adore. Déjà avant, mais là, sans s’en rendre compte, elle me fait le plus grand cadeau qu’on puisse me faire : poser son regard de gamine sur son grand frère et ne pas voir en moi un pantin de chiffon, ne pas voir que tout est foutu, que plus rien ne bouge. Il n’y a plus qu’elle qui soit capable de ça. Les autres ? Ah, les autres ! Je les comprends, et tout ça est de ma faute. Ils font tout pour un mieux, mais ce mieux-là est délétère. Au fil des visites, de nouveaux codes de communication se sont mis tacitement en place. Par exemple, personne n’évoque jamais l’accident. Mes potes ne parlent plus jamais de moto. On n’aborde pas non plus les lésions, les opérations prévues, tout ce que je ne pourrai pas récupérer. 69
Bien sûr, on ne parle plus de mes études. À un mois de mon diplôme… Je ne serai jamais kiné. Vous en connaissez, vous, des kinés tétraplégiques ? Mais à force d’éviter tout ce qui pourrait faire mal, on ne parle plus de rien. Parce que la maison familiale qui était parfaite jusque-là Pensez ! un bel étage à Bruxelles !… Et bien bel étage et fauteuil roulant, ça rime avec déménagement. Et le grand jardin à l’arrière, pour y accéder, il faut descendre l’escalier de la terrasse. Au fond, on peut se tourner dans toutes les directions, il n’y a vraiment pas grand-chose qu’on puisse évoquer sans que le panneau « sens interdit » ne se hisse immédiatement dans toutes les têtes. Et comme tout le monde a un mal de chien à ne pas craquer, les sujets praticables se raréfient, à part la météo et encore, elle pourrait me faire penser à « balade ». Le regard aussi. C’est impressionnant comme il disparait. Il n’y a plus que Lila, je pense, qui me regarde en face pour parler de tout et de rien et qui pouffe encore de rire parce qu’elle continue à trouver la vie amusante. Les autres, leurs yeux s’obstinent à ne plus regarder trop dans ma direction, ou frôlent juste mon visage furtivement. Ils mettent toute leur énergie à éviter de fixer mon corps inerte, mes jambes « déposées là » par les infirmiers, ou mes bras qui n’ont pas nécessairement une attitude naturelle, mais ce n’est pas moi qui arriverai à les placer autrement. Je sais que tous ces évitements, qu’il s’agisse des mots ou des regards, sont faits pour ne pas me blesser. C’est aussi pour eux tous, une façon de ne pas craquer, du moins en face de moi. Mais à force d’éviter tout, ça pue la mort, ici.
70
Alors paradoxalement, j’ai fini par aimer ça, ce système de dingue qui est indispensable pour ne pas que j’attrape des escarres. Toutes les trois heures, précises comme des coucous suisses, les filles en blanc déboulent dans ma chambre, vissent le deuxième matelas pour me coincer correctement et éviter toute torsion, et puis, à la une, à la deux, on me retourne comme une crêpe et c’est reparti pour trois heures dans l’autre sens. Pour le moment, c’est trop tôt pour déterminer si je récupèrerai quoi que ce soit ou si, toute ma vie, je jouerai le rôle de la crêpe. Trois heures les yeux au plafond, trois heures à inspecter le lino aseptisé. Ma vie à pile ou face. La première fois, face vers le bas, j’ai cru devenir fou. Le front retenu par une large bande élastique, trois heures face à mon avenir : extrêmement restreint. Maintenant c’est devenu un temps de pause. Je me dis que tout suit la même logique. Il y a cette limite de temps à ne pas dépasser pour la question d’escarres et moi je sais que c’est aussi ma limite au-delà de laquelle je n’arriverai plus à faire mon cinéma et à paraitre serein. Après, je pense que des centaines de fissures, émotionnelles cette fois, apparaitraient au grand jour, au vu de tous. Un gars, bourré d’escarres morales. Ça me donne une de ces envies de chialer comme un gosse, mais pas maintenant : j’ai la nuit pour ça. « En bas », personne ne voit l’expression de mon visage. Je peux donc laisser tomber le masque. Mon regard file dans le vide. Je sais que si les gens croisaient ce regard absent, ils seraient terrifiés. Moi aussi, je suis mort de trouille. L’envie d’en finir n’est jamais loin. Et dans ma vie, même petit, j’ai toujours eu honte quand le trouillard prenait le dessus en moi. Dans les sujets que personne n’aborde, il y a mon père. Pas une 71
visite ! Les rares fois où j’ai vaguement tenté d’en parler avec qui que ce soit, la conversation a été habilement tournée. Donc je n’essaye plus. Il doit être furieux, il a raison. Je sais bien. J’ai cassé le contrat. J’avais promis, juré, sur notre Union sacrée. Je l’ai trahi. Mais je préfèrerais mille fois qu’il vienne ici pousser une gueulante à faire trembler les murs, plutôt que cette absence-là. J’ai beau passer mon temps (et Dieu sait que j’en ai) à lui demander pardon dans ma tête. J’ai besoin de lui dire que j’ai déconné grave, que je comprends qu’il soit déçu, mais que j’ai besoin de lui autant que quand j’avais l’âge de Lila. Bon sang, je me rappelle bien. Il y a eu cet été à la plaine de vacances. Les gamins du quartier sud m’avaient pris en grippe je ne saurai jamais pourquoi. À cinq heures, quand je quittais la plaine, il fallait passer par un sentier avant d’arriver au petit bus qui me ramenait chez moi. Le seul moment où mes copains n’étaient pas avec moi puisque leurs mères les attendaient en voiture. Ces crétins du quartier sud m’attendaient et se foutaient de ma balle en haie d’honneur de chaque côté du sentier. Chaque jour la haie « d’horreur » poussait un cran plus haut dans mon imagination. Pourtant, ils ne m’ont jamais rien fait, concrètement. Mais la boule au ventre commençait de plus en plus tôt dans la journée, au point de me couper toute envie de partir le matin, puis de me tenir éveillé une partie de la nuit. J’avais peur. Et déjà à l’époque, tellement honte d’être un garçon qui a peur. Je n’en parlais donc à personne. Puis j’ai commencé à vomir le matin avant le passage du bus. J’étais pâle comme un linge et je ne tenais plus sur mes quilles. C’est mon père qui m’a fait cracher le morceau. J’ai même pleuré en lui racontant. La honte suprême en somme. La suite a signé notre lien et la naissance de l’Union sacrée. Ce n’est pas kiné qu’il aurait dû être – jusqu’il y a peu il disait « kiné de père 72
en fils », encore une phrase qu’on ne prononcera plus – c’est conteur, ou acteur. Une créativité de dingue. Il m’a monté toute une histoire à dormir debout d’où il ressortait qu’il avait eu très peur et aurait même pleuré, lui aussi, quelques jours avant moi. À l’époque, j’y ai cru. Il faut dire que, pour me faire cette terrible confession avec moult trémolos dans la voix, il avait soigné la mise en scène et m’avait emmené derrière des rangements au grenier. Il avait inventé un serment compliqué qui nous liait à jamais dans ce secret partagé. Personne au monde, hormis lui et moi, ne saurait jamais que l’un et l’autre nous avions un jour craqué. L’Union sacrée était née. Quelques jours après, un paquet est arrivé par la poste. Retour dans le coin désormais sacré du grenier. Papa m’avait fait envoyer par ses contacts intergalactiques basés au Japon, si j’en croyais les timbres, un robot détenteur de pouvoirs dépassant tout ce qui était connu jusquelà. La boite indiquait qu’il s’appelait Sparky-Robot. Il fonctionnait avec deux batteries logées dans son dos et, par un très heureux hasard, papa venait justement de trouver deux piles compatibles. Une fois lancé, Sparky-Robot marchait, tournait la tête, faisait un bruit d’enfer et, surtout, son thorax et ses yeux crachaient des étincelles dotées d’un pouvoir jamais vu : faire rétrécir la peur. Pour bien profiter de la démonstration des forces intergalactiques, il a fallu bien sûr éteindre la lampe du grenier et braver les hypothétiques araignées planquées pas loin de notre abri. Mais avec Sparky-Robot de notre côté, ce n’est pas quelques minables araignées qui allaient me filer la pétoche. Sparky a été admis dans l’Union sacrée dans un grand débordement d’étincelles et un bruit de ferraille absolument jouissif. Les batteries ont eu du mérite de tenir le coup.
73
Dans les jours qui ont suivi, mon kiné-de-père a exploité ce pauvre Sparky au-delà de toute décence. Les petits crétins du quartier sud n’avaient évidemment pas fondu au soleil. Et, malgré l’alliance intergalactique, la trouille me bloquait souvent la respiration et me filait des points de côté qui me pliaient en deux de douleur. Je me souviens de séances au grenier. Papa, Sparky et moi, tous les trois couchés sur le dos. Et papa qui laissait libre cours à son imagination pour la séance de relaxation la plus géniale qui soit. J’ai souvent repensé à ces momentslà pendant mes cours à la fac, avec une immense bouffée de tendresse. Quel talent ! C’est marrant, autant d’années après, j’entends encore sa voix qui m’expliquait tout ce qu’il fallait faire pour ne pas épuiser le « magnétocyclotron » qui alimentait nos batteries, puisque, bien sûr, nous fonctionnions nous aussi sur des piles secrètes logées quelque part dans notre thorax. Il fallait donc s’étendre sur le dos, fermer les yeux et respirer lentement mais à fond. Puis visualiser mentalement les deux batteries et sentir combien elles étaient lourdes sur le sol. Repérer toutes les zones de contact entre nos batteries et le plancher en continuant à respirer à fond et en gonflant bien le ventre. Après un moment de mise en charge intense, il fallait fermer les yeux deux fois plus fort et se concentrer au maximum jusqu’au moment où on pouvait sentir dans ses poumons la force des étincelles qui y étaient contenues. Chez les humanoïdes, elles restaient invisibles mais étaient bien là. Papa posait doucement sa main sur mon thorax et mesurait la force des étincelles. Quand j’étais rechargé au maximum, nous disions solennellement « Compagnie Sparky », puis il fallait marquer un silence et dire exactement ensemble « Sparky-pour-toujours ». Inutile de préciser qu’après une demi-heure de rechargement de 74
mon « magnéto-cyclotron », la boule au ventre avait disparu et que je respirais à pleine amplitude sans l’ombre d’un point de côté. En cas d’alerte ou d’évènement grave, le « magnéto-cyclotron » pouvait aussi être renforcé en position debout. Pas besoin de fermer les yeux. Il suffisait de respirer trois fois à fond en répétant la formule in petto. Consigne bien utile en quittant la plaine de jeu : les autres pouvaient venir ! J’ai supposé que les étincelles se voyaient quand même un peu puisqu’ils m’ont regardé différemment, puis… ne m’ont plus regardé du tout. Les premières terreurs vaincues, ce n’est pas rien, quand même. C’était central dans ma vie, cette complicité avec mon père. À longueur de temps, on commençait les mêmes phrases en même temps. J’avais choisi le même métier que lui. À chaque moment difficile, avant que je parte à mes oraux à la fac, on prononçait encore notre célèbre formule, en rigolant mais, pour nous, elle voulait tout dire. Alors bien sûr c’est vrai que j’ai tout foutu en l’air, mais je voudrais quand même qu’il vienne. Là, j’ai dormi, je pense. Je me réveille côté face. Si Lila vient aujourd’hui, je lui demanderai de m’amener mon robot pour décorer ma chambre. Les infirmières ont proposé qu’on m’apporte des objets personnels. C’est vrai qu’entre la chirurgie de transferts tendineux prévue en mai – je pourrai sans doute retrouver un petit peu de mobilité au niveau des bras – et la kiné de revalidation, je suis parti pour habiter ici plusieurs mois. Autant m’y sentir chez moi. Lila ne trouvera pas ça incongru. Elle a une capacité étonnante à me comprendre mieux que quiconque. C’est idiot comme idée de demander ce jouet à 22 ans, mais c’est la seule chose qui me soit passée par la tête. * 75
Ce soir, je n’en reviens toujours pas. Si Lila n’avait pas babillé sans réfléchir comme toujours, je ne sais pas qui m’aurait appris la débâcle. Je lui ai demandé d’apporter Sparky avant-hier. Elle est revenue hier en m’expliquant le plus naturellement du monde que le robot n’est plus dans ma chambre puisque papa l’a pris quand il est parti pour son appartement. Mais c’est quoi, ce délire d’appartement ? Ma mère était sortie boire un café, ça tombait bien. J’ai tiré les vers du nez à Lila qui répondait à tout avec toute la candeur du monde. Et là, le puzzle prenait une toute autre allure. Le crash. Mes cervicales brisées. L’entrée dans le chaos. Mon père atterré par la nouvelle et… tétanisé de culpabilité. S’il n’avait pas acheté sa moto, je ne lui aurais pas piqué les clés. Ma mère qui lui hurle dessus que oui, c’était irresponsable d’acheter cet engin surpuissant quand on a un fils qui passe sa vie sur les forums de motards. Et c’est criminel de laisser trainer les clés. En bref, c’est de sa faute. Les portes qui claquent, les silences complets à table. Et puis un jour, une valise dans le hall et mon père qui part en appartement. Je comprends mieux les silences compassés, les sujets qu’on évite. Mais il y a quelque chose qui me rend un poil d’espoir. Si mon père a pris Sparky avec lui, c’est quand même… Ça veut dire que l’Union sacrée… Ça veut quand même dire quelque chose, non ? À 19 heures, quand elle m’a fait un bisou pour partir, j’ai demandé à Lila de bien retenir une phrase et de la dire devant papa, demain, quand il ira la chercher à l’école. Elle l’a répétée deux fois, gravement. Elle disait Sporky, mais ce n’est pas grave. Elle sentait la fraise et tous mes espoirs sont partis « à Dieu vat » avec elle, en sautillant. * 76
J’étais côté pile à contempler le lino et mon avenir. La première chose qui m’a alerté c’est ce bruit de ferraille invraisemblable qui provenait du couloir. J’ai eu instantanément le front baigné de sueur. Sparky. Il n’y a que lui pour faire un bruit de casserole pareil. Puis j’ai entendu les pas. Pour être sûr de ne pas être déçu, je me suis dit très vite que non, c’était surement le grand infirmier rigolard. Ma trouille était majeure. J’ai essayé d’inspirer trois fois comme au temps où mon « magnétocyclotron » était prêt à rendre l’âme faute de carbu. Puis j’ai pris mon courage à deux mains et j’ai ouvert les yeux. Dans mon champ de vision, la vieille paire de Docksides de mon père, pas cirée – bien la preuve que c’était lui – contrastait singulièrement avec le brillant du lino. C’est dingue, mais on a dit exactement en même temps « j’te demande pardon », puis « non, c’est moi », puis on s’est mis à rire et pleurer exactement au même moment aussi. Et pendant ce temps-là, Sparky, plus bruyant que jamais, arpentait le lino en crachant tous azimuts des étincelles intergalactiques capables de réduire les terreurs gigantesques en peurs aux dimensions humaines.
77
Anne VERHAEREN InstantaNÉs
– Maëlle, on a besoin de toi à l’hôpital. Tu peux venir tout de suite ? Oui, évidemment. Je dis toujours oui… Même si je sais que les heures qui vont suivre seront pénibles. Je me lève et m’habille en vitesse. J’emporte mon matos dans un sac en bandoulière noir. Je l’ai voulu discret, ni trop visible ni trop grand, pour ne pas ajouter à l’incongruité de ma présence. Il est un peu plus de 5h00 et le jour se lève à peine lorsque je monte dans la voiture… La promesse d’une magnifique journée d’été. – Salut Ma… Je t’accompagne à la chambre 18. Le petit s’appelle Hugo. Tu verras, il est minuscule, juste un peu rouge. Les parents ne sont pas contre ta venue mais… Enfin, tu sais… Comme toujours, c’est pas évident… J’ai quand même dû insister. Je comprends mais je ne m’habitue pas. Le couloir de la maternité est tranquille. Dans quelques heures, les soins commenceront, les repas, les bains… pour certains. La porte 18 s’ouvre sur un jeune couple de parents accolés à leur bébé gisant dans le trop large couffin de l’hôpital. Leurs prunelles semblent me traverser. J’ai l’impression d’être transparente. Je précise : – Je suis la photographe. 79
La maman revient peu à peu à elle : – Je m’appelle Valérie... Voici Stéphane… et notre petit garçon. Il est né à 26 semaines. Le papa bafouille avec un pauvre sourire : – Il s’appelle Hugo. Un sanglot reste calé dans sa gorge. Il se penche vers l’enfant et prend le petit corps gourd tout en douceur… Il l’allonge sur sa paume gauche. – Il est si beau… Comme endormi. Sa main droite frôle très délicatement l’abdomen figé de l’enfant. J’ai le cœur serré. Je suis incapable d’ajouter quoi que ce soit. Je fais ce pour quoi je suis là. J’extrais mon appareil du sac et m’apprête à les photographier. Le papa opine du chef. La mère se détourne. Des larmes brillent au coin de ses yeux. Elle préfère se recoucher… J’allume le plafonnier et ferme les rideaux pour éviter le contre-jour. Le père oublie vite ma personne. Il caresse les petites joues marbrées d’Hugo, son front empourpré, parcourt les fins bras bleutés avec son index, recoiffe la chevelure fœtale rebelle. Il place le petit pouce à peine onglé près du visage triangulaire installé sur le côté. On jurerait qu’Hugo va le téter d’ici peu… Le père se laisse aller à un baiser léger comme un souffle. Celui qu’il voudrait rendre à ce corps inerte. Mon appareil accompagne la gestuelle émouvante du père. Il va s’assoir dans le fauteuil situé en face du lit, devant la fenêtre occultée. 80
Il colle le ventre bombé du bébé sur son torse pour réchauffer la chair de sa chair. Ses yeux se ferment, soulagés. Je remarque qu’Hugo et son papa se ressemblent très fort : mêmes arcades sourcilières, haut front identique, nez comique en trompette… Je choisis un angle qui mettra en valeur cette ressemblance, cette « parenté », qu’ils devront revendiquer auprès de la commune, de leur famille, de leurs amis, de leurs collègues… Ce ne sera pas facile de revenir chez soi, déshabités de l’enfant qu’ils ont appris à aimer durant de longs mois, avec pour seuls bagages, quelques clichés… Devant mon objectif troublé, le ballet se poursuit un moment qui me semble une paisible éternité. C’est doux. C’est impressionnant. C’est vivant. Je prends soudain conscience d’une absence. La mère est restée assise sur sa couche, esseulée, débraillée, en peignoir, yeux baissés, mains abandonnées, chevelure hirsute… Je zoome sur son regard inversé en train de sangloter de l’intérieur. Sans larmes cette fois. Sans voix. Elle se noie littéralement devant moi. Je l’invite à prendre Hugo dans ses bras. Elle ne réagit pas. Elle ne m’écoute pas. Elle ne m’entend pas. Elle se trouve à des lieues de là. Naufragée sur un bout de banquise qui rétrécit à vue d’œil… Je ne me résous pas à m’en aller sans avoir pu la filmer, elle, et Hugo, et Stéphane. Ensemble. Je me rends compte que je les prénomme : ils me sont désormais familiers. En arrière-plan, je perçois les gazouillis du papa. J’en pleurerais. J’en sourirais. Mon viseur se retourne instinctivement vers lui et, dans les pupilles pailletées et dilatées par le manque de sommeil, je vole le minois endormi du bel au bois mourant. Je perçois l’étincelle de vie qui fut si brièvement. Je la saisis. Flash immortalisé de ce visage en dormance qui illuminera, plus tard, quand ils seront à nouveau sereins, ces deux parents désenfantés, égarés dans cette odieuse chambre 81
d’accouchement mal insonorisée, où tout est inadapté au format des bébés nés trop tôt. Les allées et venues dans le couloir indiquent que la vie de l’unité de soin reprend. Des pleurs de nourrissons traversent la cloison et sortent peu à peu la mère de sa torpeur douloureuse. Elle revient précautionneusement à elle, à nous, à la réalité. Elle tourne la tête vers son mari et son petit. Pourtant, elle patauge encore dans le déni. Dans l’inévidence de ce qui lui arrive. Dans le froid qui la saisit. Tremblotante, elle se renfonce dans le lit. Je me demande ce que je fabrique ici… Intrigante, voyeuse, voleuse d’images, voyageuse des limbes. Je ferais mieux de retourner à mes shootings habituels : mariage bidon, communion à flonflon, récalcitrant poupon, mannequin parfait, chienchien à mémère… Le traintrain rassurant. Valérie se redresse : « Je vous remercie. On en a fini maintenant. C’est fini, je veux dire, c’est fini de toute façon ». J’hésite à m’en aller. Je voudrais tellement insister. Lui dire qu’elle risque de regretter. Lui expliquer l’importance de ces photos pour la suite. Pour se remémorer. Pour se dire que tout ça a existé, que ça fait partie de soi, de sa vie, de son passé. Je sais combien cet enfant est d’ores et déjà ombiliqué dans l’histoire de leur famille balbutiante… J’aimerais lui réciter la litanie des bébés que ma pellicule a éternisés : Sacha, Lorie, Etan, Luana, Marie, Nathan, etc. Et chaque fois la nécessité de garder une « brasille » de ces vies éphémères… Tout un album qu’on feuillète de temps à autre pour les ainés. Un montage dias qu’on commente à ceux qui naitront après, qu’on contemple au cœur d’une soirée d’été comme une brise qui rafraichit la mémoire… ou en début de journée, pour aider à avancer dans la belle lumière de l’été… ou n’importe quand, pour raviver les mouvements intenses de l’amour qui a grandi en même temps que l’enfant a poussé… Traces que rien n’efface. 82
Valérie refuse néanmoins de poser avec Hugo. C’est trop dur. C’est trop récent. Simplement trop. Mais il ne faut pas perdre de temps. L’équipe infirmière ne va pas tarder à emporter Hugo… Je range mon matériel le plus lentement possible. J’éteins la lampe principale. J’ouvre les rideaux opaques pour laisser entrer le jour. Le soleil matinal se déverse à flot dans le dos du père assis. Je me dirige vers la porte. Un dernier coup d’œil derrière moi. Et là je n’en reviens pas. L’image s’imprime sur ma rétine : une féérique aura nimbe père et fils. Elle n’échappe pas à la mère. Transfigurée, elle trouve enfin la force de se lever. Elle s’avance nu-pieds vers eux. Elle manque de chuter mais le halo fascinant lui donne le courage de les rejoindre. Elle enserre son mari et son fils de ses longs bras de mater dolorosa. L’instantané est inespéré. À mettre en boite. Vite. Valérie étire ses lèvres dans un sourire craintif. Qui n’ose pas. Qui culpabilise. Qui se dit surement : pourquoi je ris alors que je devrais encore et encore écouler les sanglots de mon corps de mère désempli… Stéphane accueille sa maladresse, sa hardiesse contenue, sa joliesse de jeune mère à peine née. Ils sont très beaux. Leurs visages se répondent silencieusement. Le lien qui les relie s’épaissit. Durcit. Assez fort pour survivre au reste. J’aime à le croire. Je le crois. Ils inscrivent à jamais leur fils dans leur histoire. Stéphane tend l’enfant aux fines paupières closes à Valérie qui l’emmaillote délicatement de ses longs doigts aux ongles coupés courts. Pour ne pas blesser. Elle avait anticipé. Elle le lui confie : les petits vêtements caramel clair, la chambre à coucher arc-en-ciel, les faire-part ennuagés et le nid d’ange en osier hérité de sa maman déjà dans les étoiles. Elle ôte sa chemise de nuit et couche Hugo contre ses seins déjà lourds qu’il lui faudra bander pour empêcher la montée de lait. Peau tout contre peau. Elle continue de murmurer à ses oreilles des petits mots dans la langue-mère. Peut-être 83
lui dit-elle au revoir, adieu, on t’aime, t’aimera toujours, tu as ta place dans notre famille, on parlera de toi, on imaginera la vie que tu aurais eue, on la vivra pour toi, on t’aime, t’aimera, on gardera ces instants-là, on ne les oubliera pas, on t’aime, t’aimera, ton bracelet de maternité, ta mèche de cheveux, l’empreinte de tes mains, de tes pieds, on t’aime, t’aimera, tu verras, ne t’en fais pas, notre Hugo, le premier de tout. Je photographie fugitivement la mère et l’enfant. Je dérobe ce moment aux heures rapides… Étincelle de vie échappée belle. Portrait pérenne du nouveau-mort-né. Sous tous les angles, toutes les sutures. Pour panser la déchirure de la séparation. Pour penser, demain, à ce qui fut si brièvement. Mais il faut savoir arrêter l’emballement de l’appareil. Ne pas s’acharner. Les laisser vivre le temps de l’adieu, hors champ. Je remballe rapidement mes affaires. Je fonds comme une photo qui coule, s’efface, se brouille. Impossible de s’habituer à ça. Heureusement, la mémoire de mon appareil conserve un peu de l’histoire instantanée d’Hugo… Je rentre chez moi pour développer les photos, retoucher les aspérités de la fin de vie. J’offrirai dès demain à Valérie et Stéphane les clichés sépia de leur enfant endormi pour toujours en cette journée d’été naissante. – Maman, tu me montres l’album de grand frère Hugo ? – Chérie, tu sais où il se trouve. Prends-le et viens t’assoir près de moi… – Voilà mamounette ! Comme j’adore cette photo où Hugo repose sur la main de papounet ! Il est tout mimi comme ça sur son ventre avec sa petite tête sur le côté. On dirait qu’il suce son pouce. Son petit derrière en l’air, c’est trop drôle ! – Oui, Marine, c’est vrai… Et comme il te ressemble, tu vois ?
84
– Mais oui, je sais… Tu dis toujours qu’on est tous les deux le portrait tout craché de papounet : le p’tit nez de la famille, les sourcils en V, le grand front ! Et il a quoi de toi, mamounette ? – J’ai choisi son prénom, ma chérie. C’est celui de mon arrière-grandpère, c’est-à-dire le grand-père de ma maman. Elle l’admirait beaucoup et il l’a élevée… Mais tu ne les as pas connus non plus. – Sur le mur derrière moi, c’est celui qui a une longue barbe grise et qui tient grand-mère des étoiles dans ses bras ? C’est celle que tu as mise à côté de la grande photo avec toi, papa et Hugo à la maternité, avec le soleil plein d’étincelles derrière vous ? – Oui, c’est bien celle-là, c’est la sixième à gauche, dans notre collection de sourires ! Marine se lève et s’écarte à pas sautillants du mur bariolé de photos familiales qu’elle connait presque par cœur. Elle sourit de toutes ses dents à cette belle après-midi estivale. Elle croque la vie pour deux, sans heurts ni fracas. Elle aime ça, l’idée d’avoir un grand frère, même s’il n’est pas là. Cet amour qu’elle ressent, qui la pousse vers l’avant, c’est le précieux cadeau d’Hugo, à elle, à ses parents… Que rappellent ces quelques instantanés devant lesquels étincèle le regard de sa maman.
85
Martin COENE Mamy
Le courrier m'était parvenu par recommandé. Une enveloppe en papier kraft. Mes coordonnées apparaissaient à l'encre noire, calligraphiées. Je l'avais posée distraitement sur le buffet en acajou et ne l'ouvris que tard dans la soirée, après m'être abruti quelque temps devant une émission de télé-réalité où des allumés de la tête se font aider 24 heures sur 24 par des spécialistes afin de rééduquer leurs délinquants de gamins. J'avais un peu pitié. Pour ces parents - de grands enfants – et, surtout, pour ces enfants – des adultes avant l'heure. Pour moi aussi, au bout du compte. J'aurais aimé qu'un spécialiste se penchât ne fût-ce qu'un jour sur nous. J'avais arraché l'enveloppe et déplié une feuille de papier épais. L'entête mentionnait une étude notariale. Le texte était bref, rédigé de cette écriture chaloupée. Suzanne Lambrecht avait formulé le vœu, dans son testament, de me léguer la photographie que je trouverais ci-joint. Ma sœur et moi revenions du parc Josaphat. Il faisait lourd. On s'était posé sur l'herbe pour regarder les tireurs à l'arc. De très hauts mâts en acier peints en vert, auxquels ils accrochaient des plumes colorées, leur servaient de cible. Ils tiraient en l'air comme des possédés depuis le pied du mât. Ma soeur et moi attendions qu'il y ait des blessés ou des morts. Mais ça n'arrivait jamais. Alors on se lassait un peu – et passions dire bonjour à l'âne. Parfois on lui faisait lécher un peu de notre glace, et parfois on lui crachait dessus. Et puis on rentrait. On achetait quelques bonbons acidulés au coca chez le primeur et retrouvions, le cœur lourd, 87
l'appartement de notre grand-mère. Sur la façade d'à côté, il y avait un hiéroglyphe. Un cerf en train de bouffer les feuilles d'un arbre. J'aimais bien, moi. J'aurais préféré que ma grand-mère habite cet immeuble-là. Je lui avais demandé pourquoi elle ne voulait pas y habiter et elle m'avait répondu en se marrant que c'était comme ça. Et puis, elle, de toute façon, les animaux qui se bâfrent sur les façades, elle en avait vraiment rien à foutre. Elle habitait l'avenue Latinis, à Schaerbeek. Un immeuble de trois étages sans cerf sur la façade et sans ascenseur. L'immeuble datait des années cinquante. Une cage d'escalier tout en pierre marbrée et angles aigus. Avec du fer forgé en guise de rampe. Au rez-de chaussée, un petit vieux. Au premier, un couple de petits vieux. Au deuxième, ma grandmère. Au dernier, Suzanne, une autre petite vieille. La seule « amie » de ma grand-mère. Tous les mardis soirs, elles mangeaient ensemble un filet américain à la brasserie de l'avenue Latinis, un peu plus loin que l'église Sainte-Suzanne – ça ne s'invente pas. Suzanne devait être une sainte pour accepter l'amitié de ma grand-mère. Ou se sentir très seule. Ou les deux. L'appartement de ma grand-mère semblait figé quelque part entre l'après-guerre et les années soixante. Des voiles jaunis par la nicotine et constamment tirés ne laissaient filtrer qu'une pâle lumière de dimanche après-midi pluvieux. Une moquette laineuse qui brulait les pieds recouvrait le sol du salon, de la salle à manger et de la chambre à coucher. Un carrelage en damier noir et beige parcourait l'unique couloir et la cuisine. Sur les carrelages des murs de la cuisine, il y avait de vieux autocollants défraichis de personnages de Disney. Ma grand-mère passait beaucoup de temps dans cette cuisine, assise à la table en 88
formica. Elle parlait toute seule. Parfois aux personnages de Disney. Elle aimait bien Daisy. Dans le salon, il y avait un téléphone en bakélite rose posé sur une table en verre. Il ne sonnait jamais et on n'avait pas le droit d'y toucher. Contre la cheminée murée, un yucca haut d'un mètre cinquante au moins retenait toute mon attention. Je pensais dur comme fer que les yuccas naissaient au Sahara. – T’es crétin ou quoi ?, me disait ma sœur. Une étagère modulable en acier et en verre fumé supportait toutes sortes de bibelots et de quarante-cinq tours. Je me souviens de Patricia Kaas et du pingouin en cristal. La table parfaitement lustrée de la salle à manger et le buffet surmonté d'une vitrine étaient sombres et encombraient toute la pièce. Le genre de mobilier sempiternel qui enlaidit inutilement les intérieurs de petits vieux. À croire qu'ils le font exprès pour déprimer leur monde. En plus, on n'a quasiment jamais bouffé sur sa table. Le poste de télévision ne diffusait que ZDF, selon ma grand-mère. Alors on matait les séries allemandes ou américaines doublées en allemand. Les sergents Jon et Ponch avaient des voix nasillardes. On se prenait quelques fois des fous rires. Ma grand-mère menaçait de couper le poste et on se taisait. On se rabattait sur les crackers au fromage et sur le jus d'orange. Ça nous filait le gout du vomi. Ma sœur a deux ans et demi de plus que moi. Elle était bouffie à cette époque. Elle l'était depuis la mort de mon père. Elle mangeait tout le temps, tout et n'importe quoi. Les garçons ne l'intéressaient pas encore à cet âge-là et elle passait le plus clair de son temps avec moi. Elle aimait bien m'insulter et me faire des clefs de bras. Quand on jouait aux Playmobils, c'était toujours elle qui prenait les cowboys. Moi, les Indiens. J'avais pas le choix. Encore moins pour les noms. Mes Indiens 89
s'appelaient tous Mentos. Ce que je préférais encore comme jeu, c'était « saucisse ». On roulait l'autre dans un tapis et puis y devait se démerder et onduler partout, comme une merde de chenille, pour pas se faire bouffer. C'était crevant. Plus tard, elle est devenue une jeune fille. Et puis une femme. Elle a rencontré Lino – je l'appelait linoléum – et s'est mariée. Elle a divorcé. S'est remariée. Plusieurs fois. Le dernier mec que je lui remets avait un tatouage de scorpion sur l'omoplate. Il avait les dents ravagées. Chaque fois que je la voyais, elle était un peu plus déglinguée de la tête. Alors, on s'est moins vus. Puis on a cessé de se voir. La dernière fois, c'est la fois où elle est passée chez moi. Sapée en training, les cheveux dégueulasses et hyper-maigre, elle n'a pas arrêté de toucher à mes affaires. Elle m'a demandé des nouvelles de notre mère. M'a demandé de la thune. Je lui ai demandé de partir. Et ne l'ai plus jamais revue. Par la suite, je me suis rendu compte qu'elle m'avait piqué des trucs. Toutes sortes d'objets sans valeur. Des DVD, un stylo Waterman qui ne marchait plus et mon vieux canif. Mes clopes, aussi. On passait les vacances d'été à la caravane. Une longue caravane verte et blanche, posée sur une parcelle rectangulaire et bordée d'ifs dans un caravaning de Noiseux. Deux marches menaient à un perron en bois pourri. Il fallait marcher sur les extrémités pour éviter de passer à travers. Franchie la porte d'entrée, à gauche, il y avait un salon. Une banquette en U avec des sièges amovibles pour y ranger des affaires. Le tissu était brun et orange, les motifs, psychédéliques. Il y avait une table basse en chêne avec du carrelage sur la surface plane. Face à la porte d'entrée, on butait contre la table à manger. Elle était fixée au sol et, quand on la rabattait, ça devenait le coin à dormir de ma grandmère. À droite, la kitchenette et, au fond, une chambre avec la douche. Ma sœur et moi dormions là.
90
La plupart des résidents du caravaning y vivaient à l'année. Il y avait beaucoup de vieux. Des parterres avec des nains de jardin, des brouettes, parfois des moulins miniatures et des géraniums. Chaque été, nous retrouvions Rachid et Vincent. Avec ma soeur, nous formions tous les quatre le « gang des BMX ». Comme dans le film dont j'avais la cassette vidéo. J'avais un BMX bleu et jaune; ma sœur, un rouge et blanc, et Vincent, il en avait un vert avec des floches sur son guidon. Rachid, lui, n’avait pas de BMX. Alors on avait customisé son vélo de ville avec du marqueur indélébile. Avec nos bécanes, on sillonnait le camping à la recherche de trucs à faire pour tuer le temps. On faisait des concours de sauts, de vitesse ou de dérapages avec nos torpédos – sauf Rachid qui n'avait qu'un frein avant et dont, dans le meilleur des cas, il ne parvenait à tirer qu'un triste couinement. Nos cascades s'accompagnaient de bruitages de pneus crissant sur le bitume ou de moteurs hyper cylindrés inspirés de L'Homme qui tombe à pic. On se faisait appeler Mike, John, Steve et Kate; et on ambitionnait tous de devenir cascadeurs. Il nous arrivait de délaisser nos vélos pour aller titiller les orvets. Il y en avait tout plein dans le tas de foin en contrebas du domaine. Parfois, M. Philippe – un vieux de la vieille du caravaning qui avait fait de la prison – nous invitait à prendre un sirop de citron et des cacahouètes dans sa caravane. On aimait bien parce que Raymond, son mainate, connaissait un paquet d'insultes. Il y avait aussi le bois de sapins dans lequel on allait placer des collets. Je ne pense pas qu'on n’ait jamais attrapé quoi que ce soit. Et puis, il y avait Rudy, le propriétaire du caravaning. Le châtelain. C'était le seul à ne pas crécher dans une bicoque en tôle. Le rez-de91
chaussée de sa maison faisait office de réception et d'épicerie. Et, comme les nouveaux venus se faisaient rares et que les résidents préféraient faire leurs courses au supermarché de Marche, il y régnait une atmosphère d'après-Tchernobyl. Pourtant, moyennant une pièce dorée de cinq francs belges, dans le bahut réfrigéré posé au centre de la pièce, on pouvait se servir de ce que le monde avait de meilleur à nous offrir. Je parle du Mister Freeze, le glaçon friandise. Une espèce de sachet de flotte congelée et conditionnée en tube par la grâce de la chimie et pour le plus grand bonheur de tous. Notre relation avec Rudy se résumait donc à cette transaction quasi quotidienne. Et, si les rayons semblaient devoir rester vides à jamais, le frigo, lui, était toujours approvisionné. Un mec futé, ce Rudy. À tous les coups, en quittant l'épicerie, on passait voir la mare. Elle regorgeait de tritons et de grenouilles. Des heures passées à mater la faune aquatique tout en mastiquant notre Mister Freeze. On était résolument sous le charme de la nature. Chacun d'entre nous s'était approprié une grenouille. La mienne s'appelait Mike. Celle de ma sœur, Kate. Il y avait encore Steve et John, mais je ne me souviens plus à qui d'entre Rachid et Vincent elles correspondaient. Elles étaient un peu nos alter ego. On leur faisait faire des courses, des sauts et tout le bordel. On leur filait des trucs à bouffer qu'on attrapait avec du papier tue-mouche. On leur avait même construit une mini cabane. Elles étaient comme des coqs en pâte. On les aimait bien, nos batraciens. Alors, quand un jour on retrouva tous ces petits corps déchiquetés et sanguinolents, gisant aux abords de la mare, quelque chose se brisa en moi. Quelqu'un avait arraché les pattes de nos copains encore vivants et avait laissé leur carcasse démembrée croupir au soleil. Quelqu'un qui nous aura servi des cuisses de grenouille au repas et nous aura forcés à les bouffer jusqu'à la dernière. Quelqu'un qui le paierait cher. En 92
attendant, on dégueulait Steve, Kate, Mike et John dans les chiottes de la caravane. Ma grand-mère carburait à la Triple Westmalle. Au lever du jour, elle décapsulait sa première bière et, à la tombée de la nuit, elle n'était plus qu'un jerrican dégoulinant d'essence. Il suffisait d'une étincelle pour la faire exploser. Ma sœur et moi l'avons senti passé et la déflagration était toujours soufflante. On se prenait des raclées pour pas grand-chose. Une porte ouverte, un courant d'air, un mot de travers. Mais, le pire, c'était la nuit. Ma grand-mère se réveillait parfois en gueulant et titubait jusqu'à la chambre. Elle hurlait qu’elle avait mal partout et voulait qu'on lui fasse du bien. Son corps était en feu. C'est le diable, disait-elle. Elle en sortait un du pieu – généralement moi – et lui ordonnait de la soulager. Elle extirpait sa chair flasque et luisante de sa robe de nuit. La scène – cette ritournelle obscène – se jouait toujours à l'identique. Elle saisissait nos mains et les menait jusqu'à ses seins lourds et moites. Nous malaxions, nous pétrissions. Encore et plus fort. Puis elle voulait qu'on lèche ses tétons. Des tétons gros comme des pis. Qu'on les suce, qu'on les mordille. Elle calait ensuite notre tête entre ses cuisses rouge et grasses et nous enfonçait le visage dans son sexe mouillé. Le rythme qu'elle intimait de ses mains – des serres – était frénétique. Intenable. Et pourtant, nous tenions. Nous emplissions d'air nos poumons lorsque nous remontions furtivement à la surface. Et replongions. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle jouisse avec hargne. Jusqu'à ce qu'elle nous inonde de son fluide ranci. Ma mère ne savait pas. Ma mère n'aurait pas pu savoir. Pas plus qu'elle n'a su comment avait fini ma grand-mère, en vérité. Ses yeux étaient autrefois pleins de vie. À présent, ils étaient éteints. Plus de flamme. Pas d'étincelle. Elle ne nous voyait plus. Elle ne voyait plus rien. 93
Sinon son chagrin. Mon père décédé. Sa longue agonie. Sa mort lente sur un lit d'hôpital. Son chemin de croix. Elle cumulait les boulots. Elle cumulait les dettes. Les frais s'amoncelaient et le temps qu'elle passait à les résorber la vidait à son tour de toute substance. Ma sœur et moi avions perdu nos deux parents. Et si nous étions liés à la mort par leur absence, nous l'étions encore plus douloureusement à notre grandmère. Mais cet été touchait à sa fin et les vacances étaient derrière nous. La promesse d'une liberté imminente. Notre mère devait passer nous prendre. Dans l'appartement de ma grand-mère, nous rongions notre frein en attendant la délivrance. X-OR le Shérif de l'Espace m'y aidait avec la plus grande peine. L'attente était pesante. Ma grand-mère cuvait sa bière dans la cuisine en radotant devant ses autocollants. Ma sœur en profitait pour fouiller les armoires du buffet en acajou. J'étais affalé dans le canapé quand elle revint avec une photographie. Elle me la tendit sans un mot. Il s'agissait d'un déjeuner en famille chez ma grandmère. La table de la salle à manger était dressée pour l'occasion. Il y avait un gâteau au centre de la table. Avec des bougies. C'était l'anniversaire de mon père. Son dernier. Il était livide. Il avait déjà perdu ses cheveux. La scène se matérialisait avec fracas dans mon esprit. Surgis d'un passé récent et pourtant déjà enfui, émotions, angoisses et ressentiments défoncèrent une porte verrouillée de ma mémoire. J'avais été aspiré par un maelstrom. L'image de mon père malade. Celle d'un homme au physique désincarné, enterré sous des couches de souvenirs sains et sûrs qui précédaient sa maladie. La seule photographie, à ce stade de sa vie, que je lui ai jamais connue et que, jusqu'alors, j'avais pu tenir entre mes mains. La contemplation virait au tourment et ce ne fut pas le tintement 94
minimaliste de la sonnette déglinguée qui m'en extirpa, mais le bruit des savates de ma grand-mère frottant mollement sur le carrelage du hall d'entrée. Je me souviens du visage creusé de ma mère. De son sourire forcé. Elle l'avait souhaité joyeux. Ma sœur et moi avons couru jusqu'à elle et nous sommes agrippés à sa jupe. Nous ne la lâcherons plus. Pour rien au monde. Pas avant d’avoir quitté l'antre de l'avenue Latinis. Ma mère avait saisi avec douceur la photographie que j'avais en main et me demanda ce que je tenais là. Mes poils s'étaient hérissés. Je l'avais oubliée. Je ne voulais pas qu'elle la voie. Je ne voulais pas briser le charme des retrouvailles. Je ne voulais pas qu'elle craque, qu'elle fonde en larmes, qu'elle se liquéfie à la vue de son mari défunt, vivant et presque mort. Mon père. Encore moins qu'elle ne s'évapore une nouvelle fois. Des appréhensions justifiées. Car elle avait filé dans la cage d'escalier et la lourde porte de l'immeuble claquait déjà. Ma sœur souleva notre seul et unique bagage et lui emboita le pas. Je m'apprêtais à faire pareil lorsque ma grand-mère me tomba dessus en m'invectivant. Elle m'arracha la photo des mains et se cala dans l'encadrement de la porte. Elle me traitait de voleur, de vaurien, de sale mioche, de petite merde lorsque cette chose brisée au fond de moi laissa s'échapper une bulle. Une bulle de rage. Une colère immense et viscérale. Ma grand-mère avait dû le comprendre. Elle se tut. Un rictus de surprise déformait son visage rougeaud. J'avais sorti mon canif de la poche de mon short. Elle recula. Je dépliai la lame sans la quitter des yeux. Elle reculait encore. J'avançais sur elle, déterminé. Elle se mit à couiner. Je voulais l'égorger comme un porc. Elle hurla à me faire péter les tympans. J'aurais voulu planter ma lame dans ce kyste bourré de haine. J'aurais voulu faire couler le pus. Percer ce corps hostile. Sentir sa chair adipeuse s'ouvrir une dernière fois. Mais ses savates glissèrent sur l'arrête de la plus haute 95
marche avant même que je ne l'effleure. Et elle fut happée par le vide à une vitesse stupéfiante. On aurait dit qu'elle avait été tirée par un élastique. Je repliai ma lame intacte et fourrai le canif dans ma poche. Je m'approchai d'elle. Elle gisait là, tête en bas, au pied de la rampe d'escalier. L'une de ses jambes était désarticulée. Sa robe était remontée et laissait apparaître une constellation de varices. Une culotte couleur chair aussi. Sa nuque ployait en angle aigu sous le poids de son corps inerte. Du sang jaillissait encore de sa gueule meurtrie. Finalement, je levai la tête et l'aperçus. Suzanne. Elle était appuyée contre la balustrade en fer forgé de son palier et me fixait de son regard plongeant, perçant. Elle ne dit rien. Je ne dis rien. Sa silhouette fantomatique persista. Un long instant. Même après qu'elle se fut éclipsée derrière la porte de son appartement. Puis j'enjambai le corps de ma grand-mère et dévalai les marches quatre à quatre. Voir mon père sur cette photographie ne me procura pas la sensation de vertige dont j'avais souvenance. Le temps et les circonstances semblaient bel et bien révolus. Je n'avais pas le souvenir non plus de nos deux visages, à l'avant-plan. Ma sœur et moi avions l'air candide et farouche de deux bêtes prises dans le faisceau lumineux des phares d'une voiture. C'était le flash. L'étincelle de colère qui jaillit en moi fut causée non pas tant par sa présence, en bout de table, que par son attitude. Elle souriait. Un sourire large et satisfait. Nous tirions tous des gueules d'enterrement et ma grand-mère se marrait. Au dos de l'image, Suzanne avait simplement écrit : « Ceci t'appartient, je crois. »
96
Guillaume LOHEST Le premier tweet de Prometeo
« Il est très regrettable que le réchauffement climatique n’entraine aucun réchauffement des peuples et des nations. » (Bernard Pivot sur Twitter, le 3 mars 2015) Il y a quelques semaines, je me trouvais en panne d’inspiration. C'était l'une des premières soirées du mois de mars. Le temps ne ressemblait à rien. La journée avait été clémente, radieuse même, mais vers les quatre heures une mauvaise neige s'était mise à tomber, de celle qui fond, elle s'était muée en crachin, puis le vent s'était levé, enfin le soleil avait réapparu, d'un coup d'un seul, éclatant, avant de se coucher et d'abandonner le pays à une nuit glaciale. Mon vieux poêle ardennais, qui tire très mal, avait fini par s’éteindre. Il était plus de vingt-deux heures, je commençais à prendre froid, et cette foutue inspiration était bien éteinte elle aussi. Je dois dire que c’est devenu une fâcheuse habitude, à tel point qu'il m'arrive de considérer ma carrière de chanteur comme un malentendu, une erreur d’appréciation de la destinée. Mon bilan, très maigre : un seul single. Son succès foudroyant m’a procuré une rente à vie, quelques coucheries au début mais, depuis six ans, rien. Single pour l’éternité. Comme si l’écriture de cette seule chanson avait consommé l'entièreté de mes ressources, épuisé l'énergie créatrice de toute une vie. En attendant, la dernière maison de disques qui croit encore en moi m’a fixé un 97
ultimatum. Il lui faut un nouveau titre avant l’été. J’ai donc consacré chaque seconde de mon temps, ces derniers mois, à traquer un début de bonne idée. Or, ce soir-là, après les giboulées, dans le froid, j’ai trouvé bien mieux. Mais en morceaux. Et bien malgré moi. Quelques jours plus tôt, j’avais pris connaissance d’une information inattendue et réjouissante : Bernard Pivot est un inconditionnel de Twitter. Je m’amuse de peu, je le reconnais mais, à chaque fois que j'y pense, cette nouvelle m’apporte un puissant et savoureux réconfort. Cela me donne l’impression que l’avenir peut être apprivoisé, même par un vieux loup ou, selon le point de vue, que le passé a encore du chien. Mon activité sur le réseau social était jusqu’alors à peu près nulle : un chanteur éteint doit pouvoir la mettre en sourdine pour passer inaperçu. Les milliers de tweets de l’ex-présentateur d’Apostrophes ont été un électrochoc. Étant moi-même ce qu’on peut trouver de plus ponctuel sur le marché de l’audiovisuel, une sorte de Sandra Kim ou de Sœur Sourire version masculine, je voue un immense respect à ceux qui ont su s’imposer sur le très, très long terme. Et Pivot, l’homme-dictée, le classique des classiques, lui, l’incarnation de la télé à l’ancienne, quand sonne l’heure de twitter, il n’y va pas par quatre chemins : il tweete. Histoire de montrer qu’il n’a pas dit son dernier mot. Alors, me suis-je dit, moi non plus. Et, d’un coup d’un seul, j’ai plongé dans la twittosphère. Mais ce n’était pas pour m’exprimer, non, c’était un terrain de chasse, c’était là que je comptais débusquer mon idée fulgurante, la révélation de mon prochain disque, ou single, restons lucide. Je me suis mis à suivre toute une série de personnalités, d’actualités folles et d’improbables sujets : #vieéternelle, #Brassens, #jesuischarlie, #histoiresérotiques, #pivot, #single, #stromae, 98
#papefrançois, #francophonie, #chiensdecirque, #quadrilinguisme. Entre autres. Ce soir-là, j’ai tenté #suicide. Et la lumière fut. C’était une femme. Le premier tweet que j’ai lu d’elle avait été rédigé trois minutes plus tôt. Six mots, trente-huit caractères. Un sens absurde, mais ce visage, ces yeux ! EstelleB – 3 mn [#suicide ce soir pour motif géologique] La minuscule photographie présentait des traits jeunes, un regard étincelant, presque aguicheur. Le second tweet est venu presque aussitôt. EstelleB – À l’instant [Ouvert le gaz, j’attends, j’ai pris ma décision, quelqu’un me suit en France, en Suisse ou en Belgique ?] Oui, ai-je pensé, en Belgique oui. Mais était-elle sérieuse ? Cela me paraissait invraisemblable. J’aurais dû tweeter avec le hashtag #suicide pour me manifester, mais je ne voulais pas être démasqué, mon pseudo était mon nom de scène. J’ai donc patienté, attendu moi aussi, mais dans l’indécision par contre, et dans l’indécence du follower qui ne se dévoile pas. Y avait-il vraiment, quelque part dans le monde francophone, une jeune femme en train de se suicider en direct sur Twitter avec pour seul public un chanteur raté trop lâche pour l’en dissuader : moi ? EstelleB – À l’instant [Combien de tweets encore avant l’explosion ?]
99
Je ne parvenais pas à penser à autre chose qu’à la chanson que j’allais écrire sur cette femme, c’était certain à présent. Mais il allait me falloir davantage de tweets. Si elle devait craquer une allumette, j’espérais avec cynisme que ce serait le plus tard possible. J’avais besoin de creuser un peu le personnage, son histoire, ses raisons de vouloir en finir. Une question juridique m’a alors traversé l’esprit : pouvait-on considérer mon attitude comme de la non-assistance à personne en danger ? Non, c’était ridicule. Quoique. Et Bernard Pivot, qu’aurait-il fait dans ma situation ? Je me suis surpris à imaginer que je pouvais l’alerter. Il suffisait de lui envoyer un tweet après tout, il était certainement en alerte, là, dans le coin, à quelques hashtags de distance... * Je me suis éclipsé un instant. Il me fallait un verre de rouge. Le foyer de mon poêle n’était plus qu’un lointain souvenir, la température de l’air dans la pièce n’en gardait aucune trace. Mes doigts étaient glacés. À mon retour devant l’écran quinze pouces, j’ai découvert deux nouveaux tweets. EstelleB – 2 mn [On est foutus, condamnés par l'anthropocène, on croyait que l'Homme avait le contrôle en tout mais Gaïa revient sur le devant de la scène.] EstelleB – 1 mn [Les #Lumières, c'était notre dernier atout.] À ce stade, il faut m’imaginer troublé. Celle que j’avais prise pour une adolescente un peu allumée venait de se montrer d’un coup d’un seul, mystique et intello, historienne, poète. Et elle avait balancé ce mot barbare – anthropocène – , qui ne cadrait pas bien avec un suicide au 100
gaz, surtout sur le Web. J’ai donc temporisé et réfléchi. Une petite recherche s’imposait. #Anthropocene, sur Twitter, ne m’a pas beaucoup aidé : l’accent avait sauté, je me retrouvais avec le terme en anglais et les commentaires décousus de toute une série de Bernard Pivot anglo-saxons. Je me suis donc rabattu sur wikipédia. Je résume. Anthropocène : terme utilisé par certains chercheurs pour indiquer que nous serions entrés dans une nouvelle ère géologique depuis l’avènement de l’âge industriel. Une ère dans laquelle l’influence humaine est si importante, sur le climat, sur la biodiversité, sur les grands cycles chimiques, que nous serions devenus, nous, les hommes, la première force géologique sur terre. Bon. Entre les lignes, ça disait surtout ceci : on a tout bousillé, toutes les courbes partent en exponentielle, on ne sait pas ce qui nous attend. Tout va péter, quoi. Entretemps, Estelle avait tweeté. Elle était pile dans le sujet. EstelleB – 7 mn [Ressources épuisées. Envolées. C'est le cas de le dire on a tout jeté dans l'atmosphère.] EstelleB – 3 mn [Alors je tweete en attendant le grand fracas. Je tire encore un peu grâce à ma gazinière.] Pour ma chanson, cela commençait à devenir un rien compliqué; néanmoins, j’y croyais encore. J’avais trouvé le titre, ça s’appellerait « E-suicide Estelle », et ce serait en fa mineur, parce que cette tonalité m’avait réussi pour mon unique single. Pour le reste, il allait s’agir de la jouer finement parce que je n’avais aucune idée de la suite. Tout dépendait des tweets. S’il y en avait d’autres. Ce qu'ils me diraient d'elle. 101
Michel Butor a affirmé au sujet de Twitter : « Cent-quarante caractères, c’est une contrainte prosodique acceptable. » Je suis d’accord mais, sur le moment, ça ne m’aidait pas dans ma propre prosodie. Il était près de minuit, je désespérais pour ma chanson. Histoire de passer le temps et de me donner du courage, je suis allé consulter les derniers Pivot. Bernard Pivot – 3 h [Peut-être existe-t-il des couples aux sentiments tièdes, presque froids, qui espèrent dans le réchauffement de la planète ?] J’en avais connu de meilleurs. Et je ne parvenais pas à abandonner mon projet de chanson sur EstelleB. J’étais à ce moment convaincu que son histoire de gaz n’était qu’une mise en scène destinée à créer le buzz, mais je suis resté de trop longues minutes sans nouvelle d’elle. Vingtsix très exactement, au bout desquelles je me suis résolu à intervenir. Mon pseudo de chanteur me retenait toutefois. J’ai d’abord pensé contourner l’obstacle en me créant un nouveau compte d’utilisateur, mais je n’avais plus le temps. J’ai donc entrepris de rédiger un message limité à cent-quarante caractères. En réalité, c’était mon premier tweet. Depuis mon inscription, je n’avais fait que suivre. Contrainte prosodique acceptable ? Contrainte tout court. J’ai écrit une bonne dizaine de tweets différents, effacés sans les envoyer. Puis il a bien fallu lâcher prise, d’un coup d’un seul, avec ce nom ridicule. Prometeo officiel – À l’instant [@EstelleB : S’il vous plait, faites un signe. Pourquoi #anthropocène vous angoisse-t-il tant ? J’ai besoin de vous pour ma prochaine chanson…] Je l’avais fait. Mais à peine avais-je cliqué sur « envoyer » que je me 102
suis enfui dans ma cuisine pour ouvrir une nouvelle bouteille de rouge. Ma paranoïa avait repris le dessus. Si la presse people tombait sur mon tweet, j’imaginais déjà les titres : « Le chanteur Prometeo cherche désespérément un second souffle sur Twitter » ou, pire : « La loose de Prometeo jusqu’au bout du web. » La curiosité a mis quelques minutes à revenir le disputer à la honte. Je suis retourné devant l’écran. Rien d’Estelle. Par contre, le hashtag #anthropocène s’était enflammé. La jeune femme avait reçu, depuis mon tweet, des dizaines de réponses. Quelques messages m’étaient adressés, la plupart au sujet de mon identité. Est-ce que j’étais bien le chanteur Prometeo ? Malheureusement, oui. Une heure plus tard, je m’étais lassé de cette avalanche de tweets désordonnés. Certains débattaient de l’anthropocène et du réchauffement climatique (il s’agissait d’évaluer de combien de degrés la terre se réchaufferait), d’autres construisaient des scénarios sur la mort ou sur le bluff d’EstelleB. Poursuivre mon rôle dans ces discussions aurait été indécent et pathétique. J’avais ouvert les vannes d’un flot incontrôlable, j’avais allumé la mèche, donné le signal officiel que tous les voyeurs pouvaient se dévoiler. Toute nouvelle prosodie de ma part aurait aggravé mon cas. J’ai accordé ma guitare folk et joué en fa mineur, cherchant, à défaut de paroles, une bonne mélodie. Pour combler l’absence de texte, je chantonnais anthropocène, anthropocène, ou Estelle, Estelle, dans l’espoir de faire surgir quelque chose de fort. Musicalement parlant, bien sûr. Mais les harmonies esquissées demeuraient bien ternes, trop tièdes, ça ne décollait pas. Je suis allé me coucher à trois heures, vaseux, avec le sentiment de m’être enfoncé encore un peu davantage dans mon statut d’ancienne star éteinte. Prometeo, un vrai trou noir : ça aussi c’était un bon titre. 103
* Le lendemain matin, à onze heures, avec treize degrés dans la pièce de vie, je me suis résolu à relancer le poêle. Comme d’habitude, j’étais aux prises avec des buches humides, achetées trop tard dans la saison et trop bon marché, à un type qui coupe son bois en extra après ses journées de travail. Pour son plaisir soi-disant; le mien était de craquer les allumettes les unes après les autres en attendant que ça prenne. Quand, enfin réchauffé, j’ai déverrouillé l’ordinateur laissé en veille, j’ai compris que ma nuit n’avait pas été vaine. Un tweet m’avait été adressé, à 3h45, par un certain Alexandre. Alexandre12 – 8 h [@prometeoofficiel : Votre chanson est peut-être déjà écrite malgré vous. Relisez les tweets d’EstelleB : si je compte bien, ce sont des vers.] Piqué de curiosité, je me suis mis à collecter avec excitation les messages écrits la veille par Estelle, jouant du copier-coller pour les mettre bout à bout. Précisément, ça copiait mais ça ne collait pas bien, certaines phrases me semblaient trop longues; d’autres, beaucoup trop courtes. À moins de les découper ? Il allait falloir que j’y revienne. Mais plus tard, car une autre surprise m’attendait. Je n’avais pas remarqué, depuis que Bernard Pivot m’avait amené à le fréquenter assidument, que Twitter permettait de recevoir aussi des messages privés. Or j’en avais deux. Le premier, daté, me souhaitait la bienvenue sur le réseau social. Le second était d’Estelle, il avait été envoyé à minuit et demie. Il disait : « Ne vous inquiétez pas Prometeo, je ne suis pas morte. C'est incroyable que ce soit vous, justement vous, qui ayez réagi… De quelle chanson parlez-vous ? Nous devrions nous 104
rencontrer. Je vous parlerai de l’anthropocène. De cette grande accélération qui me paralyse au point de m'empêcher de vivre. Avezvous déjà mis des tweets en musique ? » Elle terminait en me laissant un numéro de portable. J’ai longuement regardé le visage de la photo, cherchant sur ses joues, autour des lèvres, dans son regard, le scintillement d'une angoisse. Aujourd’hui, enfin, tout est prêt, paroles et musique. En fa dièse mineur. J'ai chargé le vieux poêle de mes buches les plus sèches car, tout à l'heure, Estelle frappera à la porte. Je lui préparerai un thé. Parleronsnous d’anthropocène ou de musique, de ses tweets ou du mien ? Tout bien réfléchi, je suis incapable de dire si elle a bluffé au sujet du gaz et du suicide. Je ne compte pas le lui demander car, au fond, cela ne change rien à notre chanson. Qu'en pensera-t-elle ? Suis-je parvenu à prendre la mesure de l'anthropocène ? Ajouter ce dièse à la tonalité, c'était une idée ridicule au départ. Je voulais dissimuler un clin d’œil, un petit caprice de forme. Mais autant l'avouer après tout : dès l'instant où je me suis contraint à composer en fa# mineur, d'un coup d'un seul quelque chose s'est délié, les notes et les mots ont trouvé leur place. C'est peut-être un signe.
N.B. Les tweets de Bernard Pivot sont authentiques, ainsi que la citation attribuée à Michel Butor. 105
Valentine DUHANT Joyeuses Pâques !
– À vos marques, prêts… Partez ! Au signal du DRH, les employés, armés d’un panier frappé du logo de l’entreprise, s’élancent dans le couloir. Bousculade effrénée d’employés, intérimaires, stagiaires, contractuels, chercheurs, chefs de service, experts financiers et responsables du marketing, mélange de statuts qui se tendent dans un même élan vers un objectif commun : ramasser le plus d’œufs possible et, surtout, trouver le mystérieux œuf d’or. Éparpillés à travers l’étage, les travailleurs courent, ouvrent des portes, ferment des tiroirs, fouillent des cartons, soulèvent des couvercles, amassant au passage une myriade de douceurs sucrées. Tous retombent en enfance, cet âge d’or où les trésors étaient cachés dans le jardin, le parc ou le salon, déposés par des cloches aux carillons de fée qui annonçaient bombance. Bondissant joyeusement d’un coin à l’autre dans un vacarme de claquement de portes et d’éclats de rire, chacun savoure à l’avance les délices pascals qu’il partagera en famille. Et hop, un œuf dans le casier ! Et hop, un autre sur la fontaine à eau ! Les collègues guillerets remplissent leur panier avec un enthousiasme fébrile, échangeant au passage des clins d’œil complices de mauvais garnements. Quelle bonne idée que ce team building récréatif gommant tout 107
statut et toute hiérarchie ! Une parenthèse bienvenue dans le traintrain des réunions, analyses et autres feedbacks. Plus de rapports, plus de pouvoir, juste de la légèreté, un plan gagnant-gagnant orienté plaisir. CDD temps-plein, salaire attractif, pas d’expérience exigée. Compétences demandées : agilité, endurance et dérision. Une fois les œufs les plus faciles à trouver bien au chaud dans les paniers, le rythme ralentit peu à peu. Le poids de la récolte se fait sentir, on commence à s’essouffler, à souffler, à s’arrêter. Seuls les plus endurants sautillent toujours d’une pièce à l’autre, multipliant leur butin avec gourmandise. Toujours pas d’œuf d’or en vue mais, au moins, du bon temps praliné en perspective. – J’ai trouvé un œuf d’argent ! Le cri victorieux résonne dans tout l’étage et arrête net la course des chercheurs d’or modernes. Rayonnant, le regard pétillant de fierté, un stagiaire tient entre les mains un œuf énorme d’une brillance métallique, Graal du pauvre mais Graal tout de même. Tremblant d’excitation, il glisse son ongle dans une fente minuscule et en ouvre l’extrémité. Sous le regard envieux de ses collègues haletants, il y plonge la main et en ressort un carton d’un geste ample et théâtral. Il s’éclaircit la gorge pour en lire le contenu, fait durer le suspense quelques instants et claironne d’une voix tonnante : – Cinq jours de congés payés supplémentaires ! Stupeur ! Des avantages salariaux !? Eux qui s’attendaient à gagner leur poids en chocolat ou un lapin géant ! Voilà qui change la donne. Quel autre lapin sortira donc du chapeau d’or ? 108
La tension monte d’un cran, l’air se fait plus dense et se charge d’une ardeur électrique. L’œuf étincelant a mis le feu aux poudres, le feu d’artifice promet d’être éblouissant. Les chercheurs de trésor enjoués se muent en une cohorte de soldats de plomb. La cadence s’accélère, les fronts se plissent, les mollets geignent. À chacun sa stratégie, à chacun son plan d’attaque. Les pièces éloignées ? Non, les plus proches ! Les planches hautes ? Non, les plus basses. Les bureaux, check ! La remise, check ! Les toilettes ? Vite ! Non, moi d’abord ! On se pousse, on se tire, on se dépasse, on se marche sur les pieds. L’œuf d’or ira au plus efficace, au plus rapide, au plus réactif, au plus proactif ! À chacun sa chance, mais que le meilleur gagne. Soudain, le DRH s’exclame : – Plus que quinze minutes ! Les participants déjà à bout de souffle se jaugent, une lueur de défi dans le regard, consommés d’une ardente volonté de gagner. Les complets-vestons, chemises amidonnées et tailleurs pantalons s’agitent de plus belle, gesticulant et grimaçant sous l’effort. Quelle drôle d’idée que cette compétition incongrue, attisant les inimitiés et encourageant les coups bas ! Rapports de pouvoir, course insensée au résultat insignifiant, contrat à dureté minée. Nerfs fragiles s’abstenir. À court d’idées de cachettes potentielles, certains changent de stratégie et misent sur leurs concurrents, les suivant à la trace ou leur barrant le passage pour les freiner dans leur lancée. Qui du patient, du futé ou du rapide trouvera le lot tant convoité ? Plus de pitié, plus de gaieté, c’est dépasse ou trépasse.
109
Suant et transpirant dans les bureaux surchauffés de chaleur humaine, les cravates sont dénouées d’un coup sec et les vestes jetées à la hâte. Brulant d’une fièvre insensée, la horde désordonnée puise dans ses réserves pour tenir le rythme. On se retient par la manche, on se fait des crochepieds, on se double et on s’écarte d’un geste brusque. Mais où est donc ce satané œuf d’or ? Le petit bois a pris, les petits soldats bouillent, le brasier s’étend à une vitesse fulgurante, gerbe brulante et crépitante de pression sans soupape, étincelle partie de rien qui grandit, grandit et… – OUIIIIIIIIIII ! Le sifflet du DRH explose dans le couloir, rebondit sur les murs des bureaux et perce les tympans. Coupés dans leur élan, tous cherchent le vainqueur des yeux, haletants et hébétés, le regard assombri de dépit. C’est Camille, la directrice du marketing, tailleur froissé et sourire carnassier, qui serre l’œuf dans ses bras tel un être fragile à protéger de cette masse barbare, doudou de l’enfance ou contrat juteux. Avec une lenteur calculée, elle plonge une main au vernis écaillé dans le coffre au trésor. Elle prend une grande inspiration avant de déclamer, star du jour : – Prime de six mois de salaire ! Un silence pesant de dépit suit son annonce triomphale, les perdants reprenant leur souffle tout en tenant mollement leur panier à moitié vidé dans l’échauffourée. Les claquements secs des pas du DRH résonnent dans le couloir lorsqu’il s’avance vers Camille pour lui serrer la main.
110
– Félicitations ! Fais bon usage de ce petit cadeau de Pâques ! Tout sourire et dynamisme de convenance, il se tourne ensuite vers les autres : – J’espère que vous avez pris du bon temps et que avez pu recharger vos batteries pour affronter de nouveaux défis ! À présent, rassemblons notre butin et faisons un peu de rangement avant de nous remettre au travail. Chacun cligne des yeux comme s’il s’éveillait d’un mauvais rêve et regarde autour de lui d’un air hagard, découvrant l’étendue du chaos : chaises renversées, œufs éparpillés, sol jonché de documents, câbles emmêlés, habits froissés, cheveux défaits, chemises collantes de sueur. Une tornade noire semble avoir traversé les bureaux, parenthèse de folie dure et électrisante. Peu à peu, les intérimaires, stagiaires, contractuels, chercheurs, chefs de service, experts financiers et responsables du marketing récupèrent le contenu de leur panier et réparent les dégâts. Chacun évite le regard des autres et tente de reprendre contenance malgré ses membres raides et son esprit embrumé. Une fois tout remis en ordre, tous reprennent leur place et se remettent au travail sans être vraiment certains de ce qui vient de se passer. Tandis qu’ils peinent à se reconcentrer sur leurs tâches respectives, le DRH retourne à son bureau d’un pas nonchalant, un sourire mielleux de pub pour dentifrice toujours plaqué sur le visage. En chemin, il prend soin de s’arrêter régulièrement pour passer la tête dans chaque pièce et lancer à la cantonade : – Joyeuses Pâques à tous et toutes !
111
Patricia HARDY Au troisième étage
Le ciel crache des trombes d’eau et la petite qui veut aller au parc ! Je lui dis que ce n’est pas possible; nous allons rentrer à l’appartement et, pour la consoler d’un chagrin qu’elle n’a pas encore montré, je pousse la porte d’un magasin de jouets. Quelle chance qu’il soit sur notre chemin celui-là. Oui, nous avons de la chance; elle, d’avoir une super grand-mère et moi, d’être du bon côté du trottoir. Il est là, il ne travaille pas, il est sans emploi et il aime aller chercher la petite depuis son entrée en maternelle. Est-ce qu’il vient avec nous ? Je ne me souviens pas. Sans doute, car une sale drache d’octobre tombe avec fracas. S’il avait fait soleil, c’est sûr qu’il ne serait pas venu avec nous. Je ne sais plus, mais ce n’est pas son genre de me suivre. D’habitude, c’est moi qui le suis. Par exemple, le weekend, je ne demande plus où nous allons, moi j’ai toujours eu trop d’ambition et de rêves. Quand nous nous sommes rencontrés, j’avais envie de promenades à la campagne et à la mer et puis, j’ai appris à me contenter. Il a deux ou trois adresses de prédilection à dix-quinze minutes à pied de l’appartement. Avec le temps, ça nous a fait des repères, une routine. C’est du solide nous deux. Il doit être passé 16h et la petite ne sourit plus, elle a compris que nous n’irions pas au parc. Je pourrais lui acheter un jouet qu’elle aimera plus tard mais, ici et maintenant, elle n’en a rien à cirer. Elle tient à son 113
parc, celui de ses souvenirs, d’avant son déménagement, mais bon, une autre fois ma chérie, nous aurons d’autres occasions, je te le promets. Nous traversons et marchons de plus en plus vite, malgré les bonnes raisons de nous mettre au sec. Elle est en pétard, exceptionnellement elle pleure. Assise dans la poussette qu’il conduit dans la rue qui descend vers le square, elle tend ses jambes furieusement, elle veut s’arrêter et faire marche arrière. Je me tais. Elle ne changera pas d’avis et nous non plus; c’est pour son bien et, de toute façon, si je l’écoutais, son père dirait que sa mère est vraiment folle. Nous sommes arrivés, elle se lève et il faut la prendre par la main pour qu’elle ne reparte pas aussitôt dans la direction opposée. Qui ouvre la porte ? Je ne sais plus. La voiture est repliée, c’est lui qui la tient en tout cas; et elle, elle commence à crier, toute à la sauvagerie de son âge, ce qui résonne curieusement dans ce hall d’entrée fréquenté généralement par des octogénaires très civilisés. Moi, au fond, je suis silencieusement d’accord avec elle. Le parc, c’est important; ce sont ses racines, c’est là où elle a connu ses premiers plaisirs – se balancer, glisser sur le toboggan, faire des pâtés, la connaissance d’autres enfants. Je n’ai jamais remis les pieds là où j’ai vécu mes premières années. Le Congo, c’est loin. Soixante ans et plus de 6.000 kilomètres. Depuis que je suis en Belgique, mon cœur de petite fille blanche, fille de l’adjudant-chef, l’homme au ceinturon flambant, mon cœur est encore en larmes, alors, ma chérie, même si ton parc est à deux pas, je sais que le tien est en train de se noyer.
114
J’appelle le vieil ascenseur et nous entrons trempés; lui, le premier avec le buggy, puis elle, qui se réfugie dans le coin adverse, puis moi qui leur fais face tout en évitant le regard du miroir. D’habitude, elle aime appuyer sur le bouton du 7e étage mais, là, elle l’ignore et quand nous commençons à monter, qu’elle a en quelque sorte perdu tout espoir, qu’elle se sent seule, incomprise, peut-être abandonnée, trahie, impuissante certainement, humiliée même, elle rue dans les brancards, comme on dit. Elle agite les jambes devant elle, et ses petits pieds cognent la paroi en bois, l’ascenseur gémit, l’habitacle tremble. Elle a quatre ans et je ne la juge pas; ce n’est pas grave, c’est une petite fille, ma petite-fille, je l’aime, même quand elle fait la tête. Nous allons arriver et nous allons jouer, oublier, passer à autre chose, ce n’est pas grave. Au 3e étage, il la claque. Je ne l’ai pas vu venir. Sa main de boucher au chômage est partie tout à coup, faisant un grand bruit brutal et sec sur le dessus de sa tête d’enfant. Il ne l’a pas frappée sur la joue mais sur le sommet de la tête. S’il l’avait frappée sur la joue, sa joue aurait encore été rouge dans une demi-heure et, dans une demi-heure, son papa vient la chercher. Il l’a claquée sur le dessus de la tête pour que mon fils ne voie rien. Elle n’a pas l’air plus étonnée que ça ou le cache bien. Elle continue de grogner sans baisser le son ni les yeux rougis et embués de grosses larmes. C’est une brave, c’est une guerrière, je suis fière d’elle. Je ne dis rien. Je sais qu’il ne faut rien dire, qu’un seul mot pourrait avoir des conséquences terribles. Que je pourrais faire pire que mieux, 115
provoquer, envenimer, regretter. Je ne suis pas lâche, il y a longtemps que j’ai appris à me taire. Il n’a pas un regard pour moi. Cette fois je ne suis pas sa proie. Du coin de l’œil, je le vois la fixer avec sa rage d’homme petit et faible. Ses traits sont devenus incroyablement durs; son profil s’est aiguisé, il pourrait trancher comme une lame de stylet; ses yeux brillent d’un éclat qu’ils n’ont que dans la violence. Il ne prononce pas un mot, il est sûr de son bon droit, je le sais. Elle n’avait qu’à la fermer; après tout, elle lui a donné un coup de pied, elle lui doit le respect, elle va apprendre ce que c’est que la vie, ce que c’est d’être une femme. Je suis sonnée. Cette fois, je regarde le miroir; sans lunettes, je me devine transparente et l’œil éteint. Il l’a frappée. Je me le répète : il l’a frappée. Dans cet ascenseur qui n’en finit pas de monter, je l’entends elle et le vois lui, tel qu’il sait être, médiocre, calculateur et cruel. Je me demande si je ne dois pas en avoir pitié. Il est blême. Il l’a frappée. L’information met du temps à m’arriver vraiment. Il-alevé-la-main-sur-elle. Et ça lui a visiblement plu. Peut-être même qu’il jouit sous mes yeux de l’avoir tapée ? J’hésite, est-ce qu’il l’a battue ? Il a calculé son geste pour ne pas qu’il y ait de trace. Je suis sans voix et étrangement calme. Je me parle parce que je sais que ça ne sert à rien de lui parler. Il a toujours raison et il ne s’excusera jamais. Je ne fais rien à part me faire face et je me dis que je dois ab-so-lument revenir à moi. Je me rappelle. Reviens. Celle que tu étais, celle que tu étais avant, 116
celle que tu étais avant lui doit revenir. Je-dois-revenir. Pour la petite. Au moins pour la petite. La petite a besoin de toi. Au 7e, j’ouvre la porte de l’appartement et nous nous asseyons tout de suite toutes les deux, par terre, dans le couloir. Je la prends dans mes bras, je nous console avec de pauvres mots qui rassurent : « Papa va venir ma chérie ». Je nous berce avec toute la tendresse qui me reste tandis qu’il nous toise, lèvres pincées et jointures serrées devant la cuisine. Elle se relève et je la suis dans le salon. Nous ouvrons le jeu, des cartes de l’alphabet en relief, elle les touche et je les lui nomme en attendant son papa. Quand elle partira avec lui à 17 h 30, nous aurons découvert les lettres de A à J comme son prénom. Gentiment, elle nous dira au revoir, comme si de rien n’était, comme si rien de spécial ne s’était passé dans cet ascenseur. C’est la dernière fois qu’elle l’a vu. Nous ne nous sommes pas parlé lui et moi ce soir-là. Le lendemain, j’ai marché dans Bruxelles, et je me répétais : il l’a claquée. Je n’ai pas tout de suite pensé qu’il a toujours été violent. Il m’a fallu quelques jours encore pour réaliser que j’avais vécu dix années dans la peur. Alors j’ai profité d’une de ses absences pour faire venir un serrurier et mettre ses affaires hors de chez moi. Et je me suis dit que, sans la petite, il y serait encore chez moi, et qu’à coup sûr, elle et moi, dans ce vaste univers, nous nous étions retrouvées, infiniment et mystérieusement proches l’une de l’autre. Et aussi qu’un enfant, c’est beaucoup plus grand qu’on ne croit. 117
Thibaut GROUY Prédateur
Le sol tremblait de manière presque imperceptible. Peu sont capables de détecter des vibrations aussi subtiles. Elles produisent un son inaudible pour la plupart, mais pas pour le prédateur embusqué, les sens aux aguets, les muscles tendus, les nerfs à fleur de peau. Il scrutait au loin, dans l’attente d’un mouvement qui confirme ce qu’il avait anticipé : l’arrivée du troupeau. Il n’avait pas chassé depuis plusieurs jours et la soif de sang inextinguible avait repris le dessus. Il ne pouvait réprimer un tel besoin. C’était écrit dans ses gènes; il était né pour tuer. Il aperçut enfin les premiers membres du troupeau dans la lumière crépusculaire. Leurs ombres s’allongeaient derrière eux, leurs regards vagabondaient distraitement. Ils avançaient d’un pas preste, pressés les uns contre les autres. Ils formaient ainsi une masse compacte de bétail abruti. Leur marche hâtée soulevait un léger nuage de sable. Déjà la moitié de cet imposant cortège était entrée dans le champ de vision du prédateur. Celui-ci connaissait exactement ses habitudes. Il savait par où il passerait et à quel moment. Il n’y avait pas plus prévisible que ce genre de proies. Cependant, il n’était pas suffisamment expérimenté pour oser s’attaquer à des animaux plus méfiants. Le soleil avait presque disparu du ciel, laissant les ténèbres recouvrir peu à peu l’environnement. Il n’était plus possible de distinguer les couleurs; le décor était devenu un nuancier de gris. Entre chien et loup, dit-on. Et cela arrangeait bien notre représentant du sommet de la 119
pyramide alimentaire. Se faire passer pour une simple bête domestiquée lui garantissait un avantage tactique. Dans l’obscurité naissante, il pouvait aisément se glisser parmi eux sans éveiller le moindre soupçon. Mais il préféra se déplacer jusqu’à une cavité plus sombre encore, guettant avec avidité son passage. Son assaut serait fulgurant. Il ne fallait pas créer un mouvement de panique… Dans un premier temps. Cela pourrait le mettre lui-même en danger. Chacun de ses gestes devrait être précis et efficace comme les engrenages d’une horloge. Un faux mouvement, une hésitation et tout basculerait en une microseconde. Au mieux, il pourrait prendre la fuite et commencer à traquer un nouveau troupeau dans un autre endroit (ce n’était pas les opportunités qui manquaient). Au pire… Il balaya ces pensées parasites de son esprit. Il était bien trop pragmatique pour se laisser envahir par les incertitudes de l’avenir. Alors que la distance qui le séparait de sa cible diminuait, il se concentra à nouveau sur l’instant présent. L’adrénaline s’était frayé un chemin dans ses veines. Elle s’était infiltrée dans chaque parcelle de muscle et stimulait son système nerveux au maximum. Le cerveau en alerte, il pouvait même entendre les battements de son propre cœur en fond. Il savourait la chaleur de son être. Pas une douce flamme mais un furieux incendie, prêt à dévorer toutes les chairs à sa portée. Dans le noir scintillaient deux petites escarbilles rougeoyantes, témoins du brasier qui l’habitait. Le maitriser relevait de l’exploit. Il ne parviendrait pas à réprimer une telle violence bien longtemps. Heureusement, le troupeau s’était rapproché à une vitesse folle. Dans l’ignorance, il poursuivait sa course effrénée, le cerveau programmé à respecter un itinéraire fixe. Les silhouettes élancées dansaient dans les dernières lueurs du jour. Le bruit de leurs foulées rapides envahissait l’atmosphère. La tension atteignait son paroxysme. Le monstre à l’affut étudiait chacune des proies potentielles 120
à la recherche d’un signe… Une femelle ralentit la cadence et se détacha de la masse. Le prédateur la repéra instantanément. Lorsqu’elle s’isola nettement du groupe, il focalisa toute son attention sur elle. Cette innocente créature représentait la délivrance, la purge de ses pulsions assassines. Il n’y aurait aucune autre occasion; ce serait elle et nulle autre. À peine l’avaitil découverte que déjà elle l’obnubilait. Sa fourrure soignée aux reflets dorés, ses courbes délicates et sensuelles, sa posture altière… tout en elle provoquait la fascination et l’appétence. Instinctivement, il retroussa la lèvre supérieure. Sa trajectoire indécise la précipitait dans le piège. Lui se rapprochait à pas feutrés tandis que les bribes d’une conversation au téléphone lui parvenaient : – J’ai été retenue plus… Clôturer leur dossier… Sa voix était ferme, sans compromis. Elle dégageait une certaine assurance, un fort tempérament qui devait lui être utile dans sa profession. Six mètres. – Ne t’é-ner-ve PAS, articula-t-elle dans son portable, insistant bien sur la négation. Elle n’avait pas haussé le ton mais son expression était sans équivoque. Accaparée par la discussion, elle n’avait pas remarqué que le couloir était désormais désert (ou presque). Le reste du troupeau 121
s’était rué dans les profondeurs de la station de métro. Quatre mètres. Il respirait son parfum. Puissant. Enivrant. Le désir le consumait de l’intérieur, balayant toute trace d’humanité sur son passage. Ne restait plus que le carnassier, si proche de sa convoitée. Si affamé. Deux mètres… L’attaque fut foudroyante. Un éclair. Le prédateur fondit sur elle, enfonçant impitoyablement ses griffes dans le ventre de la jeune femme. Elle sentit la lame d’acier s’enfoncer en elle de dix centimètres et poussa un cri, rapidement étouffé par une pression sur sa gorge. Il l’attirait dans l’obscurité au moment de lui asséner un deuxième coup de couteau. Celui-ci perfora son poumon gauche. Le troisième coup fut fatal; le métal froid glissa le long de son estomac pour aller sectionner l’aorte. Surprise par un tel déferlement, elle était restée amorphe, les muscles pétrifiés. Elle, qui était d’habitude si fière, presque arrogante, était réduite à l’état de pantin entre les griffes de cette bête. Lorsqu’elle émergea de sa brève léthargie, il était trop tard. D’une main, elle tenta vainement de dégager sa trachée. L’agresseur la plaqua au sol. À mesure que le sang s’écoulait de ses blessures, elle perdait toute son énergie vitale. Elle avait toujours été une battante, c’était dans sa nature. Se retrouver dans une telle situation de faiblesse la laissait démunie. En dernière option, elle tenta d’appeler à l’aide mais tout ce qui sortit de sa bouche, c’était un souffle mourant. Elle prit alors pleinement conscience de ce qui lui arrivait. La peur l’enserra. Une peur primaire, archaïque. Elle était la mouche prise dans la toile. L’antilope saisie par le fauve. La brebis dans la gueule du loup. Elle sentait venir la fin, et 122
l’instinct de survie n’y changerait rien. Elle croisa le regard de son assaillant et y vit toute la cruauté que pouvait recéler l’âme humaine. Deux grandes pupilles la fixaient intensément. Deux fenêtres vers un abysse qui voulait l’aspirer. Pas de souvenir précis défilant devant ses yeux. Juste des images floues, hétéroclites. Une succession de flashs incohérents, comme si toute son existence n’avait aucun sens. Elle perdait pied avec la réalité. Le prédateur était quasiment allongé sur sa victime. Le sang maculait sa chemise. Il entendait vaguement le GSM déverser des phrases dérisoires du genre « …Tu m’écoutes au moins… ». D’un geste brusque, il le poussa plus loin. Il ne voulait surtout pas être dérangé pendant l’instant crucial. La fournaise, qui le dévorait depuis le début, se calmait lentement. Désormais impassible, il sondait le visage d’en face qui, lui, affichait un air affolé. Elle comprenait l’inéluctable. Ses globes oculaires roulaient dans leurs orbites à la recherche d’une échappatoire. La pauvre bête sans défense s’accrochait encore à la vie dans un réflexe primitif. Il sentit les muscles de sa proie s’alanguir, sa respiration devenir lourde. Il capta alors son regard et y vit toute la faiblesse que pouvait recéler l’âme humaine. Deux petites pupilles fébriles l’observaient craintivement. Deux petites prunelles au fond desquelles luisait une flammèche moribonde. Elle perdait pied avec la réalité. L’espace entre les deux êtres n’était pas plus épais qu’un linceul. Ils étaient tous deux figés dans une sorte de communion macabre. Le monde autour d’eux s’était évaporé. Elle basculait; lui s’accrochait à ce moment infime et infini. Ce moment où l’ultime étincelle de vie s’évanouit, avalée par le vide. Un vide vertigineux et redoutable. Le néant, l’absence de tout. 123
Encore en extase, le prédateur se releva. Lorsqu’il perçut le grondement annonçant l’arrivée imminente d’un nouveau troupeau en sens inverse, il prit la fuite laissant derrière lui un cadavre exsangue. Dehors, une fine couche de sable générée par des travaux se dispersait, emportée par le vent d’ouest. Les centaines d’empreintes fraichement tracées s’estompaient progressivement. L’éclairage public jetait sur la rue une lumière austère tandis que les derniers rayons du soleil frappaient le haut des gratte-ciels. Dans l’air humide et malsain de ce mois d’automne résonnèrent les premiers cris d’effroi provenant des entrailles de la ville. L’attaque avait été foudroyante. Un éclair.
124
Savina LEE L’angle mort
On avait décidé de bouger. Le début de soirée chez Auré c’était sympa, il y avait de l’ambiance. Trente-deux piges. On avait commandé plein de tapas, on avait bien bu. On avait envie d’aller dans un bar, danser sur les tables. Je croyais que j’allais passer une belle nuit. Et je suis là. Est-ce que je suis en train de mourir ? C’est trop con. Quand j’arrive à penser, je pense à ça, que c’est trop con. Parfois je pars, mais il y a un gars qui me parle tout le temps, ou bien c’est un autre, je sais pas… Combien ils sont, plusieurs, mais j’en sais rien… Il y a beaucoup de bruit, ça pue, ça fait plusieurs fois que je me vomis dessus, je suis épuisée, j’ai mal partout, c’est trop con. Où sont Auré, Charlotte et Céline ? On était quatre dans la voiture. Je me concentre sur les sons pour entendre leurs voix, mais j’arrive pas à rester attentive; d’ailleurs, il y a un bourdonnement de dingue qui couvre tout. Il y a du vent, des cliquetis, des voix en français, en néerlandais, des walkies talkies qui grésillent sans cesse, avec des bips bips… Et ce gars qui me parle, mais je comprends rien à ce qu’il dit, il me lâche pas… Ou bien c’est un autre… Je crois que je lui demande où sont mes potes et je crois qu’il 125
n’entend pas parce qu’il met juste ses deux mains sur ma figure. Mais ça m’a tellement fatiguée de poser une question que je m’endors comme ça, avec la sensation de ses mains chaudes autour de mes yeux. Je suppose que je ne dors plus mais je ne sens plus mon corps, je SUIS le bourdonnement. Un bourdonnement qui entend s’il ferme les paupières, qui voit s’il arrête d’écouter. Une seule perception à la fois. En plus, j’ai Alzeihmer, impossible de savoir à quoi ressemble ce gars : dès que j’ai les yeux fermés, je ne parviens pas me à figurer ses traits et, quand je les ouvre, je ne sais jamais si c’est le même qui est là, penché sur moi. Parce qu’ils sont plusieurs, ça j’ai bien compris. Parfois je me dis qu’ils sont bien gentils de supporter l’odeur, le bruit, mon immense fatigue… Est-ce que je meurs maintenant ? C’est trop con, la prochaine fois, on devrait danser chez Auré, en sautant dans les fauteuils, comme des enfants… Mais il n’y aura plus jamais de prochaine fois, cocotte… Parfois ça me réveille parce qu’ils me mettent un truc sur le visage et puis je me rendors. Je finis par n’être ni bien ni mal, je pense que plus rien n’existe, le monde était une vaste blague à laquelle on a tous cru, une sorte de poisson d’avril géant aux infos pour toute la planète et depuis des générations… Les tables de multiplication, les noms latins, les multinationales, Mère Teresa ou Lady Gaga, tout ça n’a jamais vraiment existé, hein, c’est ça ? On nous fait croire vraiment n’importe quoi ! Mais quand on meurt, on se rend bien compte qu’il n’y a rien qu’une fatigue énorme, un bourdonnement hypnotisant, des tubes digestifs qui se remplissent et se vident… Voilà on n’était que ça, de gentils tubes digestifs à l’assaut d’un monde imaginaire, des tubes digestifs bien obéissants qui comptent, étudient, bossent, font la fête 126
et fondent de merveilleuses familles de tubes digestifs… Et puis là, ils sont deux, c’est sûr. Il y en a un qui a son visage près du mien et l’autre, je le vois derrière, il fait des travaux de chantiers, il a une scie qui fait des étincelles. Et le pire c’est qu’on dirait qu’ils s’encouragent l’un l’autre ou qu’ils jouent à touché-coulé, ils semblent se donner des indications, ça a l’air passionnant leur truc. En tout cas moi, ça me réveille complètement parce que ces étincelles-là, c’est beau, c’est inattendu, et je me concentre dessus. Elles décollent, fusent, s’éteignent et recommencent… Je peux faire un vœu ? Au début, je voulais leur dire qu’ils pouvaient arrêter leur jeu, que tout ça n’était qu’une blague de toute façon mais là j’ai envie qu’ils continuent, j’aime bien. Je crois que je suis mieux parce que quand le gars m’a dit avec une étrange douceur dans la voix : « Tu es très courageuse et il va falloir l’être encore… », non seulement j’ai compris mais j’ai eu le réflexe de me dire qu’avec les mecs c’est toujours comme ça : leurs compliments, en fait ce sont des menaces. Deux ans et sept mois qu’on s’est rencontrés. Enfin que moi je l’ai rencontrée. Parce qu’elle me dit que ce soir-là, c’est comme si elle ne m’avait pas vu, pas enregistré… Moi je me souviens de tout, et surtout d’elle, de son visage tranquille, de son regard perdu : elle s’abandonnait, elle n’y croyait plus et surtout elle ne comprenait rien à ce qui arrivait. Elle partait rejoindre ses trois « meilleures collègues » décédées sur le coup. Nous, dès qu’on a vu qu’il y en avait une qui respirait encore, qui n’était touchée ni à la tête ni aux autres endroits vitaux, on a développé 127
le max de moyens. C’était ça notre nuit, sortir cette fille de là, une course contre l’amertume et les minutes. On voulait pas qu’elle parte et en plus moi je l’ai tout de suite trouvée belle… Elle était coincée dans la carcasse de la voiture, perdait du sang, beaucoup trop de sang, par l’artère fémorale, son cœur s’épuisait, ses poumons fatiguaient, bref ses paramètres étaient mauvais et on n’arrivait pas à atteindre l’hémorragie. Et puis je suis passé tous les jours aux soins intensifs. Avec des fleurs parfois ! Elle n’était pas vraiment enthousiaste, pas vraiment contraire non plus… Elle ne disait pas grand-chose et je comprenais bien ça… Quelque chose au fond de moi me demandait de m’obstiner. Elle m’appelait « Mister Brightside »… Alors voilà moi, suivant mon horaire, je me trouvais toujours une « pause Pauline », et je montais au cinquième chambre B523. Elle est sortie de là et je l’ai suivie. Elle a fait sa kiné, on allait boire des cafés, elle a fini par me demander des détails sur cette nuit-là, à quoi ça ressemblait, ce qu’elle disait, si elle m’avait vomi dessus. Elle a commencé à rire de mes vannes de con, elle s’est remise à bien marcher, à vouloir aimer. Elle m’a dit : – D’accord. Je pense qu’à toi je peux faire confiance. Et j’ai senti que ça venait de loin. Aujourd’hui, Pauline, on est de nouveau à deux dans cet hôpital sauf que là on est au dixième et que moi qui ai l’habitude d’agir selon des procédures, gestes calculés, paroles soupesées, moi qui ai toujours 128
quelque chose à faire dans chaque situation d’intervention, que ce soit un clochard bourré qui a glissé sur le trottoir, une demoiselle qui a oublié de petit-déjeuner, ou un chauffeur de poids lourd qui a omis de mettre son clignotant, là je suis comme un touriste, complètement Lost in translation. Je caresse tes cheveux, je retiens ta cuisse pleine de cicatrices, ok, parce que l’infirmière dit que c’est bien pour toi. Tu sais Pauline, malheureusement, j’ai déjà vu un enfant mourir, j’ai déjà vu une mère tenir son enfant mort, j’ai dû observer des vieux agoniser dans d’affreux gargouillis, des visages crispés, entendre des cris qui t’arrachent l’âme, des gens qui ont mal, des gens qui ont la trouille, des gens qui ont tellement peur que ce soit foutu, mais je suis toujours resté calme, confiant. Parce que c’est ce qu’il faut, parce que c’est la seule chose que je peux apporter. C’est pas une histoire d’adrénaline, je crois que c’est une question de racines, un truc au fond de moi qui me permet de rester droit, un truc difficile à expliquer aux gens, mais là, Pauline, tu vois, je tremble, je vais chialer, je vais chialer… Je sais que personne ne va mourir mais je ne nous ai jamais senti aussi fragiles, je n’avais jamais perçu les choses sous cet angle-là, c’est comme une partie du fonctionnement de l’univers qui m’était resté invisible jusque là et pourtant j’avais les yeux bien ouverts, crois-moi ! Pauline, tu me regardes avec fierté, c’est plein d’étincelles dans ta tête je te connais, et je m’accroche à ça quand le docteur nous dit : – Voilà la tête est presque dégagée. Madame, encore une poussée et bébé est là !
129
Michel BARBIER Petit matin
Le village allait bientôt s’éveiller… La nuit s’était passée sans bruit, hormis les miaulements des chats. Si le ciel restait bien noir au-dessus des toits, on avait déjà entendu quelques chants d’oiseau isolés. De l’autre côté de la voie de chemin de fer, le coq de la ferme se taisait encore. Plus loin, entre les nuages, on apercevait une poignée d’étoiles, comme des étincelles, qui scintillaient, l’une après l’autre. Debout dans la cuisine, en salopette bleue, le garagiste vidait sa tasse de café. Il avait l’air mal réveillé. D’ordinaire, il ne se mettait pas au boulot avant les huit heures, huit heures et demie. Mais le client avait dit : au lever du jour. Et le travail n’était pas fini… Il descendit l’escalier de fer, brancha le poste à souder, s’enfonça la tête dans le casque et baissa la visière de protection. L’appareil crépita sèchement, comme des feuilles mortes sous les pas d’un coureur, tout en soulevant des éclaboussures d’étincelles. L’épicière, en peignoir, versa du lait dans un poêlon. Puis, elle s’aperçut qu’elle n’avait plus de chocolat. Mais elle n’avait qu’à passer la porte du magasin pour en trouver… Elle tourna le bouton du réchaud en approchant l’allume-gaz du bec. Elle dut appuyer plusieurs fois pour obtenir la petite étincelle qui fit jaillir les flammes. Quand le lait se mit à frémir, elle y plongea une barre de chocolat noir. À seize ans, on n’aime pas se lever tôt. Pourtant, depuis qu’elle aimait 131
Nicolas, Louise était toujours debout la première. Elle s’éternisait devant le miroir de la salle de bain, pillait la trousse de maquillage de sa mère et changeait trois fois de tenue… Son cœur battait déjà un peu plus fort quand elle s’engagea sur le trottoir, son cartable au dos. Une étincelle de clarté matinale venait d’effleurer le clocher de l’église. Derrière sa fenêtre, au-dessus de l’enseigne du garage, le vieux, immobile dans son fauteuil, regardait le monde apparaitre : la rue, le passage à niveau, le quai de la gare, les voies, la cour de la ferme… Depuis qu’il voyait passer Louise, fraiche et jolie comme toutes les amoureuses, une lueur fugitive brillait au fond de ses prunelles éteintes, chaque matin. Louise tourna dans la ruelle en pavés, puis se mit à courir jusqu’à la chapelle. À l’intérieur, c’était sombre et humide. La flammèche rougeoyait dans la lampe à huile, entre la dizaine de chaises et l’autel, éclairant à peine le grand Christ en croix et la statue de la Vierge… Une ombre passa derrière un vitrail et Nicolas entra. À chaque fois qu’ils étaient serrés l’un contre l’autre, langue contre langue, une étincelle fulgurante éclatait qui leur perçait les reins. Cela finirait par un incendie, un jour ou l’autre… Ils ne se disaient rien… Ils parleraient plus tard, tout leur saoul, dans le train. Nicolas sortit son paquet de cigarettes et le Zippo que Louise lui avait offert. Elle sourit en suivant chacun de ses gestes : l’index qui soulève le couvercle du briquet, avec un petit déclic, le pouce qui fait tourner la roulette jusqu’à la soudaine étincelle qui enflamme la mèche… Ils fumèrent, les yeux dans les yeux, savourant ce premier plaisir défendu qui en prédisait d’autres. Elle toussa un peu et prit une décision : quand 132
elle attendra leur premier enfant, elle arrêtera, évidemment… Si quelqu’un dormait encore dans la rue, le fracas du volet du garage venait de l’éveiller à coup sûr. Le client attendait déjà sur le trottoir, tiré à quatre épingles, comme tous les représentants de commerce… Il avait dormi dans la chambre d’hôte, au-dessus de l’épicerie, et le garagiste l’envia pour ça. Le moteur de la voiture ne démarra pas du premier coup et le client s’énerva. Le garagiste dit que ce n’était pas grave : un problème d’allumage, l’étincelle qui ne se produit pas. Il faudrait remplacer les bougies, mais le client n’avait pas le temps, il avait déjà du retard. Il dit qu’il s’arrêterait au retour. Le moteur finit par vibrer sous le capot, juste au moment où un premier rayon de soleil fusait de derrière la colline… Le garagiste s’avança un peu pour jeter un coup d’œil vers le magasin, mais la belle épicière ne semblait pas pressée d’ouvrir. Louise et Nicolas se tenaient par la taille, sur le quai, au bord des voies. Ils attendaient l’express pour l’Italie qui passait quelques minutes avant leur omnibus. Bientôt, il allait déferler devant eux à toute vitesse, pareil au flot tumultueux d’un torrent souterrain, quand il débouche du flanc de la montagne… À la belle saison, le soleil matinal éclairait par l’arrière les compartiments dont les stores n’étaient pas baissés, et c’était comme l’obturateur d’un projecteur de cinéma qui en mettait plein les yeux… Un jour, Louise et Nicolas monteraient dans ce train pour aller à Venise. La voiture s’apprêtait à franchir le passage à niveau quand la sonnerie se déclencha et que les feux rouges se mirent à clignoter. Le représentant hésita, ralentit, puis se dit qu’il était déjà très en retard, 133
qu’il avait le temps de passer… Il enfonça l’accélérateur, la voiture bondit, mais le moteur cala, au milieu des voies. En un instant, tout se figea, comme si quelqu’un avait appuyé sur « pause » : Louise et Nicolas enlacés sur le quai, le fermier devant la porte de l’étable, l’épicière occupée à lever son volet, le garagiste qui sortait pour la saluer. On entendait que la sonnerie menaçante et le démarreur, sans relâche et sans succès. La maudite étincelle ne venait pas. Il aurait dû faire remplacer les bougies… Il n’envisageait même pas de quitter la voiture. Il insistait encore, et encore… Alors le bruit du rapide surgit, lointain, et très vite de plus en plus proche, de plus en plus fort. Le train apparut, tout au bout des voies, dans un reste de brume matinale. Aussitôt, il freina. Du métal des roues, crissant sur celui des rails, jaillissaient des gerbes d’étincelles colorées… Le représentant s’arcbouta sur le volant, donna un coup de clé rageur et la voiture démarra, enfin. Le souffle du train effleura son pare-choc arrière. Pendant de longues minutes, assis sur son capot, devant la ferme, il respira l’air à grandes gorgées, malgré les effluves du tas de fumier au sommet duquel le coq s’était décidé à chanter. Le fermier le regardait en hochant la tête… Louise et Nicolas allaient monter dans l’omnibus. Elle tremblait encore un peu et il lui caressait les cheveux… L’épicière, toute pâle, posa la main sur son décolleté en poussant un soupir de soulagement et adressa un sourire au garagiste qui en fut heureux pour la journée. La sonnerie du passage à niveau s’arrêta. Le coq se tut. Le clocher de l’église tinta sept fois… Le vieux, au-dessus du garage, décolla son 134
visage de la vitre et retomba dans son fauteuil. Il avait pris l’habitude, depuis longtemps, de penser à la mort, chaque jour, pour ne pas être surpris le moment venu. Il s’en approchait doucement dans sa tête, pas trop près, pour ne pas la provoquer, comme s’il voulait l’apprivoiser. Il la connaissait mieux que quiconque dans le village. Et mieux que quiconque il avait vu, juste au-dessus du passage à niveau, les rayons du soleil levant étinceler sur la lame de la grande faux.
135
Table des matières
Préface
7
Sélectionneurs / Jury
9
Palmarès
11
Textes des lauréats cadets
17
Marie-Louve BRUYAUX - Par-dessus le rebord de sa tasse de thé
19
Alexia DEHAES - Élémentaire, mon cher Klimt
33
Seelis VAN DER AUWERAERT - Souvenirs
Textes des lauréats juniors
27
41
Claire FRANCIS - Grand frère
43
Gaëlle SIMON - Dans la vie d'une allumette
61
Sarah MASSAY - Dans une chambre
55
Textes des lauréats adultes
67
Françoise GUIOT - Ma vie à pile ou face
69
Martin COENE - Mamy
87
Anne VERHAEREN - InstantaNés
79
Guillaume LOHEST - Le premier tweet de Prometeo
97
Valentine DUHANT - Joyeuses Pâques !
107
Thibaut GROUY - Prédateur
119
Michel BARBIER - Petit matin
131
Patricia HARDY - Au troisième étage
113
Savina LEE - L'angle mort
125
137
Nous remercions aussi :
- Kalame, réseau des animateurs d'ateliers d'écriture, - la Compagnie de Lecteurs et d'Auteurs (CLéA), - le Centre de l'Audiovisuel à Bruxelles, - le Centre du Film sur l'Art, - le café-théâtre B'lzou, - le Centre belge de la bande dessinée, - les éditions Le Lombard,
Etincelles - Recueil des meilleurs textes 2015 Dépôt légal : D/2015/3233/2 Coordination du projet : Anne Vandendorpe en collaboration avec Virginie D’Hooge Relectures et corrections : Lydia Zaïd et Judith Lachterman Encodage de la base de données : Vicky Gillissen Graphisme : Olivier David Sans oublier les interventions de Rachid El Khabbabi, André Mortier et Kamélya El M’Rabet
Illustrations : Fotolia © Zorro + katrin_timoff
- les éditions Racine.
La Maison de la Francité bénéficie du soutien de la Commission communautaire française.
La promotion du français au cœur de Bruxelles Créée en 1976 d’après le mot cher à Léopold Sédar Senghor, la Maison de la Francité est une ASBL qui assure la promotion de la langue française et de la francophonie internationale, dans un esprit d'ouverture et de modernité. Cette action s'exerce prioritairement dans les régions bruxelloise et wallonne. Loin de se limiter aux spécialistes, elle vise à sensibiliser le public le plus large. À travers de nombreux services et activités destinés à un public varié, francophone ou non, elle contribue à faciliter l'apprentissage et la maitrise du français oral et écrit, tout comme à stimuler l'expression en français. Par son concours de textes, c'est à la liberté de création et à l'imagination qu'elle souhaite encourager jeunes et adultes à partir de l'âge de 12 ans.
18 rue Joseph II - 1000 Bruxelles 02 219 49 33 mdlf@maisondelafrancite.be www.maisondela francite.be