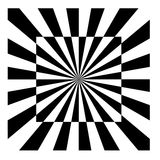9 minute read
Apprendre|Des centres culturels bientôt cinquantenaires
Au début des années 70, des initiatives lancées par divers passionnés émergent un peu partout en Wallonie. En près de 50 ans, l’action culturelle s’est progressivement professionnalisée, mais le lien avec les habitants reste un enjeu majeur.
Texte : Caroline Dunski - Photos : H. Rase et A. Zaldua
Advertisement
En Brabant wallon comme ailleurs, les premiers centres culturels sont souvent construits autour d’initiatives menées par des artistes désireux d’amener des disciplines artistiques au cœur des villages. Mais ce n’est pas le seul ressort d’une telle émergence. Des matières comme l’aménagement du territoire mobilisent aussi les habitants et les associations, comme c’est le cas à Braine-l’Alleud où le Foyer culturel est créé en 1972, de la rencontre volontaire d’une trentaine d’associations culturelles et des pouvoirs publics. Tout au long des années 70, des associations locales comme les maisons de jeunes
Un foyer culturel sans salle, c’était un peu un OVNI. Notre action était très axée sur l’animation festive et les relations avec les habitants. Il fallait travailler autrement. On était très connectés à la vie associative et citoyenne.
Luc Schoukens, directeur retraité du Centre de loisirs et d’information
et des organismes d’éducation permanente vont fédérer les forces vives, qui s’institutionnaliseront progressivement sous la forme de centres culturels, en s’appuyant sur l’Arrêté royal du 5 août 1970 qui fixe les conditions de reconnaissance des maisons de la culture et des foyers culturels.
D’Est… En 1965, avec quelques amis, le céramiste Max van der Linden organise un premier concert dans l’église Saint-Martin de Tourinnes-la-Grosse. Il regrette alors l’absence des villageois et se demande comment les intéresser. Sur le site internet de l’association qui porte son nom, le céramiste raconte qu'il se met alors à courir après tous les Saint-Martin du Brabant wallon, « et les voilà cavalant vers Tourinnes au départ des vingt-cinq paroisses placées sous son patronage ». Cette première exposition consacrée à Saint-Martin connait un énorme succès et suscite l’ouverture de lieux voisins de l’église – granges, greniers et autres salons privés – à de nombreux plasticiens. Les Fêtes de la Saint-Martin constituent probablement le plus ancien et le plus célèbre parcours d’artistes de Wallonie.
En 1971, Max van der Linden obtient une subvention pour former le Foyer culturel de la Vallée de la Nethen, tout premier foyer culturel en milieu rural, dont il devient animateur-directeur. En 1975, sous l’impulsion de Feuillen Simon, un spectacle réunissant fanfare, chorale et habitants de Tourinnes retrace la vie de Saint-Martin. Le succès est tel que chaque année en novembre un nouveau spectacle est monté dans l’église.
… en Ouest Dans les années 70, trente-trois villages brabançons (c’était avant la fusion des communes !) accueillent le chapiteau du Sang Neuf, compagnie théâtrale de Lucien Froidebise. Avec Opération étoile filante, les joyeux saltimbanques proposent des animations qui créent du lien entre les habitants de villages voisins. Francis Houtteman, animateur du Sang Neuf, se sent tellement bien à Ittre qu’il choisit d’y rester et propose, en 1973, de créer un foyer culturel, qui permettrait d'obtenir des subventions de la commune et du Ministère de la Culture française (ancêtre de la Fédération
Wallonie-Bruxelles), comme le prévoit le « Plan quinquennal de politique culturelle », publié au début de l’année 1968 sous la direction de Pierre Wigny, alors Ministre de la Culture française. Francis Houtteman sera le premier animateur-directeur du Centre de loisirs et d’information (CLI) qui préfigure la fusion administrative de trois villages, Ittre, Haut-Ittre et Virginal, au sein d’une même commune. L’AG du CLI est réunie en septembre 1974 et ses statuts sont publiés au Moniteur en janvier 1975. « Un foyer culturel sans salle, c’était un peu un OVNI, se souvient Luc Schoukens, directeur désormais retraité du CLI qu’il a rejoint en 1983. Notre action était très axée sur l’animation festive et les relations avec les habitants. Il fallait travailler autrement. On était très connectés à la vie associative et citoyenne. » À Tubize, c’est aussi du théâtre qui suscite l’émergence d’un foyer culturel. Entre 1974 et 1978, la Cie du Téléphone, groupe de théâtre-action, présente deux spectacles engagés un peu partout en Belgique. Dans la foulée de leur présentation à Tubize, entre 1978 et 1982, un lieu d’animation s’ouvre au 133 de la rue de Mons. « Le téléphone » devient le siège de plusieurs associations et l'on y organise débats, concerts, cinéma, théâtre, ateliers, expositions... Une convention est signée avec le Ministère de la Culture pour développer le projet, qui tisse de nombreuses relations avec les
interview
foyers culturels d’Ittre et de Rebecq (1971), mais il faudra attendre 1982 et le changement de majorité communale pour que les nouveaux dirigeants décident de créer un foyer culturel et d’engager un animateur-directeur : Bruno Soudan est chargé de poser les bases de la nouvelle institution et d’organiser la coordination des associations grâce aux premières activités. En 2019, il devient « le premier retraité de l’asbl ».

PLAY, une exposition légère et mobile de PULSART.
« L’ère du réseau s’est généralisée » Olivier Van Hee, inspecteur Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Les contextes dans lesquels sont nés les différents centres culturels ont-ils un impact sur leur action et leurs publics ? Non, plus maintenant. Les modèles de gestion ont changé et les contextes aussi. Surtout en Brabant wallon, avec les mutations de population. Les centres culturels ont rebondi sur des enjeux d’aujourd’hui. C’est aussi ce que voulait induire le Décret de 2013.
Comment ont évolué les synergies avec les autres opérateurs socioculturels ? Les synergies ont toujours existé, avec des hauts et des bas parfois, mais sans qu’il
n’y ait jamais de rupture structurelle. En réalité, comme les autres opérateurs, les centres culturels sont souvent des petites structures, travailler seul est donc quasi mission impossible. L’ouverture à des partenaires est aujourd’hui admise comme une évidence. C’est une vraie progression de ces 10 dernières années où, de façon générale dans toute la société, l’ère du réseau s’est généralisée. Le décret 2013 a d’ailleurs reconnu cette dimension avec les dispositifs de coopération.
Quel est l’enjeu de l’analyse partagée du territoire imposée par ce décret ? La Fédération Wallonie-Bruxelles a fait le
constat qu’une série de centres culturels se sont spécialisés en fonction des passions de l’un ou l’autre animateur. Au début, tout le monde s’en est réjoui, parce que cela montrait une professionnalisation. Puis il a été demandé aux centres culturels de retourner vers les populations de leur territoire pour prendre connaissance de leurs attentes et de vérifier à quoi pourrait leur servir un centre culturel. Aucune méthodologie n’était imposée et la plupart des centres culturels ont réalisé leur analyse en faisant appel à la créativité. Ils ont eu le sentiment de retourner à leur premier métier et de redevenir animateurs. Propos recueillis par C. Du.
Les droits culturels L’Arrêté royal du 5 août 1970 affirme la volonté d’une gestion associative. Dans les années 80, le secteur négocie le virage de l’aide à la création et à la diffusion artistiques. « Aujourd’hui, plus de la moitié de la diffusion des arts de la scène passe par les centres culturels, souligne Olivier Van Hee, ancien directeur du Centre culturel du Brabant wallon devenu inspecteur Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ceux-ci n’ont toutefois pas perdu en route la part de contact avec le tissu associatif, contrairement à la Flandre et la France, où la culture est essentiellement devenue un produit de consommation. » En 1992, le premier décret des centres culturels va stabiliser le secteur en instaurant le contratprogramme, plan pluriannuel de financement, et en clarifiant le rôle des pouvoirs locaux. L’enjeu du Décret de 2013, qui réaffirme la question des droits culturels déjà présente dès les années 70, et donne mission aux centres culturels de porter la capacité de débat et de réflexion de la population, est d’ouvrir le secteur à de nouveaux publics. « Il importe que les centres culturels ne développent un certain entre-soi, en s’adressant toujours aux mêmes publics avec les mêmes partenaires, souligne Olivier Van Hee. L’enjeu, dans un contexte de pauvreté grandissante, est de ne pas décrocher d’une partie de la population. » Si la population du Brabant wallon, « poumon démographique de la Wallonie » 1 , reste globalement préservée par ce phénomène de paupérisation et affiche le taux d’instruction le plus élevé, il n’empêche que le soutien des initiatives locales qui favorisent la convivialité, le lien social et le sentiment d’appartenance demeure nécessaire. « L’enjeu de demain, note Olivier Van Hee, sera de convaincre les communes qui ont des moyens que d’autres n’ont pas, de les investir dans la culture. Parfois, au niveau local en Brabant wallon, on manque de réflexion sur l’enjeu qu’elle représente. L’offre structurée par des opérateurs pourrait être mieux soutenue. »
1. Thierry Eggerickx, démographe, indiquait lors de la rencontre-débat Brabant wallon, au-delà des clichés : mythes, réalités et défis culturels, organisée le 12 décembre 2019 au CCBW, que la « jeune province » assure la moitié de la croissance démographique de la Wallonie.
Pour bien comprendre La ligne éditoriale de la rubrique « Cultures d'un territoire » s’oriente vers le traitement de sujets de fond chers au Centre culturel du Brabant wallon. Pour trouver les multiples activités proposées par les opérateurs culturels de la province, rendez-vous sur l’agenda culturel en ligne du Brabant wallon : www.culturebw.be.
DES DYNAMIQUES SUPRA-COMMUNALES Le territoire du Brabant wallon est largement animé par des dynamiques supra-communales, sur une base territoriale ou thématique. À l’Ouest, on l’a lu, les centres culturels ont très tôt développé des synergies. Celles-ci se sont renforcées quand, avec les mouvements d’édu cation permanente, ils ont pris part au « Volet citoyenneté de la Reconversion de l’Ouest du Brabant wallon », soutenu dès 1998 grâce à une aide spécifique du Ministère de la Communauté française. À l’Est, le GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne, créé en 2002, a pour mission de gérer une dynamique de développement rural initiée par le programme européen Leader+. Sur le plan thématique, citons PULSART, plateforme de sensibilisation à l’art contem porain, ou le Réseau brabançon pour le droit au logement (RBDL), créé par la Coordination Éducation permanente, pour traiter de questions telles que le logement public ou l’habitat léger.
Chacune de ces différentes plateformes mobilisant des partenaires nombreux et divers a vu ses projets s’adapter aux enjeux identifiés par l’analyse partagée du territoire. Les partenaires « culture » du GAL ont, par exemple, décidé de cesser les spectacles d’été, organisés dès 2005, en faveur de « Scène de villages ». « La dynamique du territoire est autre avec cette opération culturelle itinérante et plus intimiste, et surtout gratuite ! », lit-on dans le Dossier de demande de reconduction de reconnaissance 2021-2025, du Centre culturel de Jodoigne et Orp-Jauche.
De son côté, PULSART souhaite favoriser le développement du sentiment d’appartenance, la conservation d’une mixité sociale et répondre à la question de la mobilité en organisant des expositions légères et mobiles qui peuvent facilement s’adapter à des lieux exigus et rencontrer des publics dits « éloignés de la culture » (même si cette dernière notion, elle-même, suscite des débats…).
À l’échelle de la Province, la plateforme Hélix, créée en 2013 dans la foulée des Assises du développement culturel territorial du Brabant wallon, rassemble plusieurs secteurs culturels autour d’une charte de coopération désirée et durable, inter et intrasectorielle, « afin de contribuer à l'exercice du droit à la culture des populations, dans une perspective d’égalité et d'émancipation » (art. 2 du décret de 2013).