Biotopes d’importance nationale
Vue d’ensemble des cinq inventaires de biotopes : hauts-marais, bas-marais, zones alluviales, sites de reproduction de batraciens ainsi que prairies et pâturages secs


Vue d’ensemble des cinq inventaires de biotopes : hauts-marais, bas-marais, zones alluviales, sites de reproduction de batraciens ainsi que prairies et pâturages secs

Vue d’ensemble des cinq inventaires de biotopes : hauts-marais, bas-marais, zones alluviales, sites de reproduction de batraciens ainsi que prairies et pâturages secs
Publié par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) Berne, 2024
Éditeur
Office fédéral de l’environnement (OFEV)
L’OFEV est un office du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).
Auteurs
Gaby Volkart, Christian Hedinger, Leslie Bonnard, Lea Bauer, Regina Jöhl, Martin Urech (Info Habitat GmbH), Ursina Tobler (service conseil IBN, info fauna – karch)
Groupe d’accompagnement
Philippe Grosvernier, Monika Martin, Célien Montavon, Michael Ryf (Info Habitat Gmbh), Ariel Bergamini (WSL), Stephan Lussi, Peter Staubli, Nathalie Widmer (OFEV)
Conception et accompagnement à l’OFEV
Béatrice Werffeli
Soutien rédactionnel
Gregor Klaus
Traduction Service linguistique de l’OFEV
Conception graphique
Cindy Aebischer (OFEV)
Mise en page
Funke Lettershop AG
Photo de couverture
Vallon de l’Allondon, Jan Ryser/OFEV
Téléchargement au format PDF www.bafu.admin.ch/uz-2404-f
Il n’est pas possible de commander une version imprimée.
Cette publication est également disponible en allemand. La langue originale est l’allemand.
© OFEV 2024
National biotope inventories exist for five habitats: Raised bogs and transitional moors; fenland; alluvial zones; amphibian breeding areas; dry meadows and pastures. They play a central role in the conservation and promotion of biodiversity in Switzerland. This publication brings together current knowledge (as at 2023) on biotope inventories (habitat ecology, species diversity, area, distribution, status, endangerment, development, enforcement, conservation, restoration).
Cinq types de milieux naturels sont couverts par les inventaires de biotopes d’importance nationale : les hauts-marais et les marais de transition, les bas-marais, les zones alluviales, les sites de reproduction de batraciens ainsi que les prairies et pâturages secs. Ils revêtent une importance centrale pour le maintien et le développement de la biodiversité en Suisse. La présente publication réunit les connaissances actuelles (état 2023) sur les inventaires de biotopes (écologie du milieu naturel, diversité des espèces, surface, répartition, état, menace, évolution, exécution, gestion, assainissements).
Für fünf Lebensräume sind nationale Biotopinventare in Kraft: Hoch- und Übergangsmoore, Flachmoore, Auengebiete, Amphibienlaichgebiete sowie Trockenwiesen und -weiden. Sie spielen eine zentrale Rolle bei der Erhaltung und Förderung der Biodiversität in der Schweiz Die vorliegende Publikation vereint das aktuelle Wissen (Stand 2023) zu den Biotopinventaren (Ökologie des Lebensraums, Artenvielfalt, Fläche, Verteilung, Zustand, Gefährdung, Entwicklung, Vollzug, Pflege, Sanierungen).
In Svizzera esistono cinque inventari dei biotopi: Torbiere alte, Paludi, Zone golenali, Siti di riproduzione di anfibi, Prati e pascoli secchi. Tali biotopi sono fondamentali ai fini del mantenimento e della promozione della biodiversità in Svizzera. La presente pubblicazione riunisce le conoscenze attuali (stato: 2023) in materia di inventari dei biotopi (ecologia dello spazio vitale, diversità delle specie, superficie, distribuzione, stato, livello di minaccia, sviluppo, esecuzione, cura, risanamenti).
Keywords: Biotope inventories, habitats, biodiversity, enforcement, enhancement and conservation, protected areas
Mots-clés : inventaires de biotopes, milieux naturels, biodiversité, exécution, valorisation et entretien, zones protégées
Stichwörter: Biotopinventare, Lebensräume, Biodiversität, Vollzug, Aufwertung und Pflege, Schutzgebiete
Parole chiave: inventari dei biotopi, spazi vitali, biodiversità, esecuzione, valorizzazione e cura, zone protette
Où trouve-t-on encore aujourd’hui de grandes prairies fleuries et colorées abritant des orchidées et des gentianes ? Où peut-on encore entendre par une chaude soirée de mai le chant du crapaud accoucheur, rappelant le son d’une clochette ? Où les écoliers peuvent-ils découvrir le rossolis à feuilles rondes, une des plantes carnivores de notre pays, familière des hauts-marais ? Où existe-t-il encore des tronçons attrayants de rivières coulant librement, pourvus de zones alluviales et d’îlots de gravier ? La réponse à ces questions est toujours la même : sur les surfaces qui ont été délimitées à titre de biotopes d’importance nationale. Ces hauts lieux de la nature en Suisse réunissent les aires les mieux préservées de cinq milieux naturels caractéristiques de la Suisse, autrefois largement répandus et répartis dans toutes les régions et à toutes les altitudes.
Entre 1991 et 2010, sur la base de l’art. 18 a de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, la Confédération a mis en vigueur cinq inventaires de biotopes et les ordonnances correspondantes : hauts-marais et marais de transition, bas-marais, zones alluviales, sites de reproduction de batraciens ainsi que prairies et pâturages secs.
Les 7092 objets répertoriés dans les inventaires sont protégés et jouent un rôle crucial pour la préservation de la biodiversité en Suisse. Un tiers des sites abritant des espèces menacées qui ont été signalés se trouvent dans les biotopes d’importance nationale, qui ne représentent que 2,27 % du territoire national.
Les biotopes d’importance nationale sont non seulement des refuges d’une valeur inestimable pour la biodiversité, mais aussi des lieux à partir desquels des milieux naturels nouvellement crées ou valorisés sur le plan écologique peuvent être recolonisés. En outre, ils améliorent de manière décisive la qualité du paysage et fournissent de nombreux services pour le bien-être de notre pays : les prairies sèches fleuries aux couleurs vives et les étangs remplis de têtards font la joie des personnes en quête de détente, les marais intacts stockent le carbone et les zones alluviales protègent contre les crues.
Malgré les mesures de protection et de conservation, la qualité écologique se dégrade néanmoins en de nombreux endroits, comme le montre le Suivi des effets de la protection des biotopes en Suisse (ci-après WBS). Mais il y a toutefois aussi de bonnes nouvelles : avec le soutien de la Confédération, les cantons ont investi ces dernières années beaucoup d’argent, de temps et de passion dans la protection et l’assainissement des biotopes d’importance nationale. Les actions de débroussaillage des prairies et pâturages secs, la création de plans d’eau de reproduction pour les amphibiens et le comblement de fossés de drainage dans les marais sont quelques-unes des mesures prises, et les données du WBS montrent qu’elles produisent bien l’effet escompté.
Les investissements nécessaires pour accroître la qualité des biotopes contribuent de manière importante au maintien de la diversité paysagère et écologique en Suisse. En outre, ils ont de nombreux effets positifs pour l’économie et la société.
Katrin Schneeberger, directrice
Office fédéral de l’environnement (OFEV)
La Suisse héberge une grande variété de milieux naturels et donc de paysages sur une faible superficie. Cinq types de biotopes y sont particulièrement caractéristiques :
Hauts-marais
Milieux humides originels, habitats de sphaignes et d’espèces animales, végétales et fongiques rares et hautement spécialisées
Bas-marais
Roselières lacustres, marais à grandes laîches richement structurés et marais à petites laîches aux fleurs colorées
Zones alluviales
Espaces bordant les cours d’eau et les lacs et marqués par un régime hydrique dynamique (y c. plaines alluviales alpines et marges proglaciaires)
Sites de reproduction de batraciens
Plans d’eau de reproduction et alentours, habitats centraux des grenouilles, des crapauds et des tritons
Prairies et pâturages secs
Milieux naturels d’herbages riches en espèces aux faciès diversifiés et colorés sur des sols non fertilisés
La Suisse a inscrit les surfaces les plus remarquables et les plus menacées de ces types de biotopes dans cinq inventaires fédéraux afin de les protéger. Il s’agit des plus précieux vestiges de ces milieux naturels autrefois fort répandus. Que ce soit par leur lien avec les eaux, leur pauvreté en nutriments, leur dynamique naturelle et surtout la présence d’espèces rares et menacées, ces milieux à part se démarquent dans le paysage façonné au cours des siècles par l’être humain.
Avec leurs biocénoses particulières, les milieux naturels des inventaires fédéraux contribuent de façon déterminante à la qualité paysagère : les magnifiques paysages propices aux loisirs de proximité et au tourisme comprennent presque toujours des biotopes d’importance nationale. Les objets inventoriés revêtent aussi une importance croissante comme lieux de repli pour un grand nombre d’animaux, de plantes et de champignons devenus rares.
L’histoire des inventaires fédéraux des biotopes d’importance nationale est relativement récente. Depuis l’acceptation de l’initiative populaire « Pour la protection des marais – Initiative de Rothenthurm » en 1987 (fig. 1), les hauts-marais et les bas-marais sont protégés par la Constitution (fig. 2). En parallèle, le nouvel art. 18 a de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) jetait les bases des inventaires fédéraux de biotopes. Il permet au Conseil fédéral de désigner des biotopes d’importance nationale et de préciser les buts visés par la protection. Depuis, une nouvelle approche de la protection de la nature et du paysage s’est établie.
Chaque inventaire fédéral dispose de sa propre ordonnance, composée du texte (notamment avec les buts de protection, les mesures et les aspects administratifs) et de l’annexe 1 (la liste des objets). Pour certains biotopes, l’ordonnance comprend encore d’autres annexes, par exemple pour les objets dont l’examen n’est pas terminé ou pour les objets itinérants dans le cas des sites de reproduction de batraciens. Les fiches signalétiques des objets contiennent le périmètre et les informations spécifiques aux biotopes.
Les cinq milieux naturels particulièrement précieux et caractéristiques de la Suisse
Les marais recouverts de brume, les zones alluviales et les deltas sauvages, les étangs pleins de poésie et les prairies fleuries d’où monte le chant du grillon confèrent au paysage sa diversité et son ambiance particulière.
1
Haut-marais
Glaubenberg (OW)
Photo : Philippe Grosvernier/LIN’eco

2
Bas-marais avec des linaigrettes Schüpfheim (LU)

3
Zones alluviales du Rhin à Rhäzüns Canton des Grisons
Photo : Andreas Gerth/OFEV



Les cinq inventaires de biotopes englobent environ la moitié des milieux naturels menacés de Suisse. Pour que la biodiversité puisse être garantie à long terme, il est donc très important de prendre aussi des mesures pour d’autres types de milieux naturels.
Établissement et révision des inventaires
Les surfaces qui entraient en ligne de compte pour les inventaires fédéraux de biotopes ont été choisies au terme d’une procédure scientifique complexe et à la faveur d’une
Site de reproduction de batraciens Canton de Vaud
Prairie sèche avec œillets des Chartreux Canton de Zurich
étroite collaboration entre la Confédération et les services cantonaux. L’identification des biotopes potentiellement d’importance nationale s’est fondée dans un premier temps sur la connaissance du contexte local ainsi que sur des photographies aériennes, des inventaires cantonaux et/ou sur d’autres données. Sur cette base, de nombreux spécialistes ont relevé sur place, en suivant un protocole précis, la végétation et les espèces présentes, l’utilisation du sol et, lorsque c’était opportun, la dynamique naturelle ainsi que les atteintes existantes. Après avoir été évalués à l’aide de critères appliqués à l’ensemble de la Suisse, les objets les plus précieux sur le plan qualitatif ont été proposés pour l’inventaire fédéral. Le Conseil
Fig. 1 : Dépliant d’information et carte postale de l’initiative de Rothenthurm
L’acceptation de l’initiative par le peuple le 6 décembre 1987 a inauguré une nouvelle ère pour la protection des biotopes.


Illustrations : à gauche : Hug, Fritz/ Sozarch_F_Pe-0410 ; à droite : inconnu/Sozarch_F_Ka-0001-650
fédéral a ensuite désigné les objets d’importance nationale.
Les objets de niveau qualitatif moindre ont été proposés aux cantons pour leurs inventaires cantonaux.
Les inventaires de biotopes ont été établis au cours des 30 dernières années. Les hauts-marais ont été les premiers biotopes à faire l’objet d’un inventaire en 1991, suivis des zones alluviales en 1992, des bas-marais en 1994, des sites de reproduction de batraciens (IBN) en 2001 et des prairies et pâturages secs (PPS) en 2010.
La Confédération est tenue de réexaminer ses inventaires et de les mettre à jour régulièrement (art. 16, al. 2, de l’ordonnance sur la protection de la nature et du paysage
Base de données pour l’évaluation de la qualité
Les 2,27 % du territoire national qui sont désignés comme biotopes d’importance nationale sont bien documentés. Les données et les documents disponibles se trouvent sur la page web de l’OFEV « Biotopes d’importance nationale »1.
1 www.bafu.admin.ch > Thème Biodiversité > Informations pour spécialistes > Favoriser et mettre en réseau les milieux naturels de grande valeur écologique > Biotopes d’importance nationale
[OPN]) (fig. 3). Chaque révision comprend un examen technique suivi d’une consultation interne à l’administration et d’une consultation publique, après quoi le Conseil fédéral met en vigueur les nouveaux objets ou les objets révisés.
Inventaire fédéral des sites marécageux
L’inventaire fédéral des sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale n’est pas traité dans la présente publication. Comptant 89 objets (87 499 ha), il recense les paysages caractérisés par la présence de marais, raison pour laquelle une part notable des objets des inventaires fédéraux des hauts-marais et des bas-marais d’importance nationale (respectivement 44 et 33 %) se trouvent dans des sites marécageux, mais aussi 8 % des zones alluviales, 6 % des sites de reproduction de batraciens et 2 % des prairies et pâturages secs. Au total, 27 % de la surface des sites marécageux est constituée de biotopes d’importance nationale. Les surfaces restantes sont composées d’autres éléments naturels et culturels (p. ex. prés de fauche, ruisseaux, haies, forêts et bâtiments).
Fig. 2 : Bases légales pour les inventaires de biotopes d’importance nationale
Constitution
Art. 78 Protection des marais
Hauts-marais
Ordonnance sur les hauts-marais RS 451.32
Bas-marais
Ordonnance sur les bas-marais RS 451.33
Aide à l’exécution Aide à l’exécution
Protection de la nature et du paysage
Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
Art. 18 a Biotopes d’importance nationale
Zones alluviales
Ordonnance sur les zones alluviales RS 451.31
Aide à l’exécution
Sites de reproduction de batraciens
Ordonnance sur les batraciens RS 451.34
Prairies et pâturages secs
Ordonnance sur les prairies sèches RS 451.37
Aide à l’exécution Aide à l’exécution
Fig. 3 : Évolution de la surface par inventaire de biotopes
Les inventaires de biotopes ont été adaptés lors de révisions (art. 16, al. 2, OPN), ce qui explique les sauts dans le graphique. Il a ainsi été possible de corriger les périmètres erronés et de compléter les inventaires avec des biotopes d’importance nationale qui n’avaient pas été pris en considération lors de l’établissement de l’inventaire initial.
Hauts-marais
Bas-marais
Zones alluviales IBN PPS
Base de données : données sur les biotopes OFEV 2023 1990
2.1 Faits et chiffres
Les cinq inventaires fédéraux de biotopes de la Suisse englobent au total 93 608 ha (2,27 % du territoire national ; état des données sur les biotopes OFEV 2023), ce qui correspond à moins d’un tiers de la surface d’habitat et d’infrastructure de la Suisse1
Les parts des zones alluviales, des bas-marais, des prairies et pâturages secs et des sites de reproduction de batraciens sont à peu près similaires (fig. 4). Les hauts-marais recouvrent nettement moins de surface, car ils ne se forment que dans des conditions stationnelles très particulières et ont été détruits en maints endroits.
Contrairement à la surface, le nombre d’objets par inventaire varie fortement : l’inventaire des prairies et pâturages secs comprend près de 4000 objets, alors que celui des zones alluviales n’en contient que 326 (fig. 5)
1 Surface d’habitat et d’infrastructure = 7,9 % de la surface de la Suisse selon OFS 2023 ; elle se compose de l’espace industriel et commercial, de l’espace bâti, des surfaces de transport, des surfaces d’habitat spéciales ainsi que des espaces de détente et des espaces verts.
Fig. 5 : Nombre d’objets par inventaire de biotopes
Total 7092 objets
Base de données : données sur les biotopes OFEV 2023
Fig. 4 : Nombre d’objets et surface des inventaires fédéraux de biotopes ainsi que part de surface des différents biotopes rapportée à la surface totale des biotopes (diagramme en camenbert)
d’objets
Hauts-marais
Bas-marais
Zones alluviales IBN
Base de données : données sur les biotopes OFEV 2023. Sites de reproduction des batraciens : secteurs A et B des objets fixes (annexe 1 de l’ordonnance sur les batraciens [OBat]) et objets itinérants (annexe 2 OBat, avec un rayon de 52,3 m). Hauts-marais sans zone de contact. Surfaces avec chevauchements dans le tableau (les surfaces situées dans deux inventaires en même temps sont indiquées deux fois), part de surface dans le diagramme en camenbert sans chevauchement.
Fig. 6 : Situation géographique des biotopes d’importance nationale
Les objets sont représentés par des points (sauf les zones alluviales). Ces points ne sont pas à l’échelle, c’est-à-dire que les surfaces des objets qui sont visibles sur la carte sont plus grandes qu’en réalité.
Hauts-marais
Bas-marais
Zones alluviales
IBN
PPS

Base de données : données sur les biotopes OFEV 2023
Situation des biotopes
La répartition géographique des objets des cinq inventaires de biotopes diffère considérablement (fig. 6). La densité élevée de biotopes dans les Alpes septentrionales orientales est due avant tout aux bas-marais, qui y profitent des conditions géologiques sur du flysch et des précipitations abondantes sur le versant nord des Alpes. Les zones alluviales se concentrent sur le Plateau (zones alluviales de basse altitude) et dans les Alpes (marges proglaciaires et plaines alluviales alpines). Les sites de reproduction de batraciens se trouvent sur le Plateau, car peu d’espèces d’amphibiens vivent en altitude. Les prairies et pâturages secs les plus nombreux et les plus grands se situent dans les régions d’estivage des Alpes et de l’arc jurassien.
Le versant nord des Alpes est la région biogéographique qui affiche la plus grande part de surface de biotopes rapportée à sa superficie, suivie du Plateau et des Alpes centrales orientales (fig. 7). Le versant sud des Alpes présente la plus faible densité de biotopes, car la déprise des prairies et des pâturages secs et la progression de la forêt qui en découle y sont déjà importantes. En outre, les versants très escarpés et les régions de plaine fortement exploitées laissent peu de place pour de grands biotopes.
2 %

Surface des biotopes d’importance nationale
98 %
Reste du territoire suisse
Fig. 7 : Part de surface des inventaires de biotopes pour chaque région biogéographique et type de biotope
Exemple de lecture : dans la région biogéographique du Jura, 1,97 % de la superficie a la qualité d’un biotope d’importance nationale.
Hautsmarais
Bas-marais
Zones alluviales IBN
Base de données : données sur les biotopes OFEV 2023 ; régions biogéographiques d’après OFEV 2022
Fig. 8 : Part de surface des inventaires de biotopes pour chaque étage altitudinal et type de biotope Base
Bas-marais
Zones
Les hauts-marais sont principalement situés aux étages montagnard (mont.) et subalpin. Sur le Plateau, les marais et les prairies et pâturages secs ont largement disparu, car presque toutes les stations potentielles y sont bâties ou soumises à une exploitation intensive. Plus de 60 % des prairies et pâturages secs se trouvent dans la zone subalpine.
Répartition des biotopes par canton
Du fait de leur grande superficie, les cantons de Berne, des Grisons, de Vaud et du Valais hébergent ensemble environ la moitié de la surface totale des biotopes (52 557 ha ; fig. 9). Certains cantons plus petits présentent cependant des parts de surface de biotopes nettement plus élevées (fig. 10). Le canton de Genève vient en tête, avec environ 9 % du territoire cantonal situés dans des inventaires fédéraux (surtout des sites de reproduction de batraciens avec de vastes habitats terrestres, appelés secteurs B), suivi d’Obwald (5 %) et de Schwytz (env. 4 %), tous deux caractérisés par leurs vastes surfaces de marais.
Répartition par étage altitudinal
La part de surface par étage altitudinal varie fortement selon l’inventaire (fig. 8). Les sites de reproduction de batraciens et les zones alluviales de cours d’eau dominent à l’étage collinéen (coll.), les prairies sèches, les plaines alluviales alpines et les marges proglaciaires aux étages subalpin et alpin.
Taille et connectivité des objets
La superficie des objets inscrits dans les inventaires et la distance qui les sépare jouent un rôle central pour la fonctionnalité biologique des biotopes en tant qu’habitat pour la flore et la faune. La plupart des objets couvrent
Fig. 9 : Surface des biotopes d’importance nationale par canton et inventaire de biotopes
Hauts-marais Bas-marais
alluviales
Fig. 10 : Part de surface des inventaires de biotopes pour chaque canton
100 % = territoire cantonal
Base de données : données sur les biotopes OFEV 2023
seulement de très petites surfaces – en règle générale moins de 5 ha, sauf dans le cas des zones alluviales, où 57 % des objets sont supérieurs à 30 ha (fig. 11)
Les courtes distances entre les biotopes peuvent en partie compenser leur petite taille, puisque les espèces présentes
Fig. 11 : Part des objets de biotopes pour chaque classe de grandeur
peuvent alors se connecter et former ce que l’on appelle des métapopulations. Alors que les prairies et pâturages secs sont espacés de 500 à 1500 m en moyenne selon la région, les marais sont plus éloignés, 700 à 3000 m séparant un objet du suivant. Les sites de reproduction de batraciens sont encore plus distants les uns des autres ;
Exemple de lecture : 57 % de toutes les zones alluviales d’importance nationale dépassent les 30 ha.
Hauts-marais
Bas-marais
Zones alluviales
IBN
PPS
Distance moyenne entre objets d’un même type de biotope selon les régions biogéographiques
Jura
Plateau
Versant nord des Alpes
Versant sud des Alpes
Alpes centrales occidentales
Alpes centrales orientales
Moyenne sur l'ensemble de la Suisse
Base de données : données sur les biotopes OFEV 2023
pour les zones alluviales, les distances peuvent même aller de 2500 à 8500 m (fig. 12)
Biotopes sur les surfaces exploitées par l’agriculture
Plus de la moitié (62 %) des biotopes d’importance nationale sont situés en zone agricole (fig. 13). Une part importante de leur surface se trouve dans la région d’estivage, où l’intensité générale de l’exploitation est jusqu’à présent plus faible que sur la surface agricole utile proprement dite, ce qui a un effet positif sur la présence de biotopes dignes de protection. C’est pourquoi les prairies et pâturages secs et les bas-marais sont encore aujourd’hui des éléments paysagers typiques des alpages extensifs.
La proportion élevée de zones alluviales dans la région d’estivage s’explique par le fait que tous les objets constitués par des marges glaciaires s’y trouvent. La situation s’inverse dans le cas des sites de reproduction de batraciens, qui sont situés avant tout dans les zones de la surface agricole utile à basse altitude, où se trouvent aussi les aires de distribution principales de la plupart des espèces d’amphibiens menacées.
Biotopes et forêts
Près de la moitié de la surface des sites de reproduction de batraciens, des zones alluviales et des hauts-marais est boisée (forêts et forêts buissonnantes selon l’Office fédéral de topographie [swisstopo], fig. 14). Comme beaucoup d’espèces d’amphibiens hibernent en forêt, ce milieu est aussi intégré dans le périmètre de protection. Les zones alluviales comprennent, outre des surfaces de graviers, des surfaces rudérales et des eaux, une part importante de forêts alluviales. Les hauts-marais ne se composent pas seulement de zones ouvertes constamment saturées d’eau, mais aussi de forêts marécageuses environnantes. Les pâturages boisés des prairies et pâturages secs dans le Jura sont des paysages particulièrement diversifiés et riches en espèces.
Dans les autres types de biotopes, des boisements trop importants sont en revanche moins souhaitables. Dans les bas-marais ainsi que les prairies et pâturages secs, la présence de buissons et d’arbres est en règle générale le signe d’un déficit d’exécution. Dans les hauts-marais, une part trop importante de ligneux indique que les conditions hydrologiques ne sont pas optimales, puisque des peuplements denses de buissons et d’arbres ne peuvent normalement pas se former dans les hauts-marais gorgés d’eau.
Fig. 13 : Surface des inventaires de biotopes selon l’utilisation du sol
Les sites de reproduction de batraciens (IBN), les hauts-marais et les zones alluviales comprennent de nombreux secteurs – avant tout des étendues d’eau et des forêts – qui ne sont pas exploités par l’agriculture. Les bas-marais et les prairies et pâturages secs (PPS) comprennent aussi des surfaces de ligneux, des surfaces rudérales non utilisées ainsi que des pelouses alpines et des affleurements rocheux. La surface agricole utile comprend les champs et les herbages en dessous de la limite d’estivage. Cette surface n’inclut pas la forêt, les eaux, la région d’estivage et quelques autres milieux (p. ex. affleurements rocheux, parcs, espace urbain).
Hors agriculture
Région d ’estivage
Surface en hectares
Surface agricole utile
Hauts-marais
Bas-marais
Zones alluviales IBN
Base de données : données sur les biotopes OFEV 2023, recoupées avec des données sur la surface agricole utile OFAG 2019
Fig. 14 : Part de forêts (y c. forêts buissonnantes) pour chaque inventaire de biotopes (surface)
Remarque : la part de forêts de l’ensemble des zones alluviales est de 29 %, mais les zones alluviales situées à basse altitude (sans les plaines alluviales alpines et les marges proglaciaires) ont une part de forêts de 52 %.
Pas de forêts
Forêts
Part en %
Hauts-marais
Bas-marais
Zones alluviales IBN
Base de données : données sur les biotopes OFEV 2023 ; données vectorielles swisstopo 2021 (forêts et forêts buissonnantes)
Biotopes dans les agglomérations
Environ 15 % de tous les biotopes nationaux sont partiellement situés dans des agglomérations (Hunziker 2020).
Toutefois, seuls 4,7 % des objets et 2,7 % des surfaces des inventaires se trouvent dans des villes-centres (la commune-centre d’une agglomération selon OFS 2014).
Les sites de reproduction de batraciens représentent les biotopes les plus fréquents dans des villes (9,4 % des objets de l’inventaire, 8,1 % de la surface).
Les surfaces d’inventaire sont relativement importantes dans les villes-satellites (les centres secondaires, selon OFS 2014, caractérisés par un flux de pendulaires vers les villes plus grandes, par exemple Le Locle), où elles représentent 5,5 % de la superficie communale. Les villes plus grandes (les centres principaux) ont seulement 3 % de surface de biotopes nationaux.
Les biotopes d’importance nationale représentent les aires centrales d’un réseau de milieux naturels et d’aires de mise en réseau écologiquement précieux répartis sur l’ensemble du territoire. Ce réseau est tout aussi nécessaire à la prospérité du pays que les « infrastructures techniques » (p. ex. les routes, les voies ferrées, les lignes électriques et les conduites d’eau).
Une biodiversité prospère est indispensable au bienêtre et à la sécurité économique à long terme des êtres humains. Les biotopes d’importance nationale, milieux naturels intacts de haute qualité écologique, fournissent de nombreux services écosystémiques précieux dont quelques exemples (voir aussi IPBES 2018) sont exposés ci-après.
Tourisme, détente : les zones alluviales diversifiées, les marais sauvages et les prairies sèches richement fleuries offrent des instants privilégiés aux personnes en quête de détente (fig. 15).
Protection contre les dangers naturels : les zones alluviales et les marais ralentissent l’écoulement des eaux et protègent ainsi contre les crues.
Stockage du carbone : la matière organique des marais séquestre du carbone, qui est libéré lors de leur destruction.
Sécurité : abritant de nombreuses espèces rares, les biotopes sont des réservoirs de plantes et d’animaux qui pourront servir à l’avenir pour des usages médicinaux ou des innovations techniques.

Les biotopes d’importance nationale abritent une très grande variété d’espèces : au total, plus de 17 000 espèces y ont été recensées (évaluation sur la base des données d’InfoSpecies, le Centre suisse d’information sur les espèces, état 2023). Parmi elles figurent des espèces spécialisées de groupes fort différents – du loriot d’Europe (Oriolus oriolus) à la discrète parnassie des marais (Parnassia palustris) en passant par le sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) et la cigalette fredonnante (Cicadetta cantilatrix). Chaque objet possède sa propre palette d’espèces selon la station et le type de milieu naturel.
Alors qu’ils ne couvrent que 2,27 % du territoire suisse, les biotopes nationaux hébergent 84 % de toutes les espèces prioritaires au niveau national (tab. 1). Ces chiffres montrent combien ces biotopes sont importants pour les espèces spécialisées tributaires de ces milieux devenus rares. En effet, ces biotopes représentent des refuges à partir desquels elles peuvent recoloniser des milieux naturels revitalisés, nouvellement créés ou abandonnés.
Tab. 1 : Nombre d’espèces prioritaires au niveau national (EPN ; OFEV 2023) attestées dans les biotopes d’importance nationale Flore, faune et cryptogames (= mousses, lichens et champignons). Évaluation basée sur les données d’InfoSpecies, état 2023. La priorité nationale se fonde sur les indications relatives au statut de menace et sur la responsabilité que porte la Suisse s’agissant de la conservation de l’espèce considérée.
Depuis 2011, les changements survenus dans les biotopes d’importance nationale sont recensés dans le cadre du Suivi des effets de la protection des biotopes en Suisse (ci-après WBS) (Bergamini et al. 2019). Ce suivi a été lancé par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et développé à l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) en étroite collaboration avec l’OFEV. Le but principal est de contrôler si les biotopes évoluent conformément aux objectifs de protection et si leur surface et leur qualité se maintiennent.
Lors des relevés sur le terrain, un échantillonnage représentatif sur le plan géographique et écologique permet de collecter des données détaillées sur la végétation (dans les marais, les zones alluviales et les prairies et pâturages secs) et sur la présence de grenouilles, de crapauds et de tritons (dans les sites de reproduction de batraciens). Un sixième des objets d’importance nationale est représenté dans l’échantillonnage. Chaque cycle de relevé dure six ans. Lors de l’analyse des vues aériennes, les modifications de tous les objets d’importance nationale sont consignées.
Les résultats montrent dans l’ensemble que la qualité écologique des biotopes nationaux tend à se dégrader :
• Ces 20 dernières années, les hauts-marais se sont enrichis en nutriments et se sont asséchés.
• Les bas-marais se sont également asséchés. La couverture boisée a progressé et la part des espèces typiques des marais a diminué.
• Une augmentation des ligneux a aussi été constatée dans les prairies et les pâturages secs, notamment sur le versant sud des Alpes. Selon la région, les milieux naturels sont devenus plus riches en nutriments, en particulier en altitude.
• Dans les sites de reproduction de batraciens, les objets ont en moyenne perdu au moins une espèce de batracien. Les populations de sonneurs à ventre jaune, de crapauds calamites et de crapauds accoucheurs, des espèces en danger, sont en nette régression.
• En ce qui concerne les zones alluviales, il n’est pas encore possible d’identifier des tendances avec certitude pour des raisons méthodologiques.
Si les évolutions négatives prédominent, des changements positifs sont toutefois observés au niveau régional :
• La couverture boisée diminue dans les hauts-marais du Plateau.
• La part des espèces figurant sur liste rouge est restée constante dans les hauts-marais et les bas-marais.
• Le recul de certaines espèces d’amphibiens a ralenti ou s’est même arrêté durant ces quinze dernières années.
Les principales perturbations qui affectent actuellement les biotopes présentées ci-après (mesures prises et gestion, voir point 2.5).
Taille et isolement : beaucoup d’objets sont très petits et isolés. L’appauvrissement génétique et les fluctuations de population menacent les populations qui y vivent. Ces objets ne peuvent plus remplir leur fonction de centre de dispersion pour les espèces caractéristiques.
Cette situation est particulièrement visible dans les sites de reproduction de batraciens (fig. 16). Alors que la qualité du milieu naturel est jugée bonne dans près de la moitié des objets, une espèce par objet en moyenne a disparu sur une période d’environ 20 ans. La plupart des pertes ont eu lieu avant 2005 ; depuis, la situation s’est stabilisée pour un grand nombre d’espèces, sauf pour le crapaud accoucheur et le crapaud calamite, qui continuent à décliner. Ce déclin est probablement dû à la perte de la structure de métapopulation (Smith et Green 2005). Chaque souspopulation d’une métapopulation dépend des échanges
Fig. 16 : Objet de site de reproduction de batraciens Bildweiher Un bon exemple des nombreux objets qui forment des îlots verts précieux mais isolés dans les zones urbanisées et industrielles.

avec les sous-populations voisines (Hanski 1994). La plupart des sous-populations sont trop petites pour survivre à long terme sans un tel réseau. Si celui-ci se réduit par suite de la perte de milieux naturels, cette structure se brise, ce qui peut expliquer pourquoi des espèces disparaissent de certains objets alors que ceux-ci semblent constituer des habitats de bonne qualité.
Manque d’eau : les marais et les sites de reproduction de batraciens souffrent particulièrement du manque d’eau –que ce soit en raison de drainages, de prélèvements d’eau ou de l’absence de précipitations. Les espèces caractéristiques des marais ne peuvent survivre que si elles disposent de suffisamment d’eau, ce qui ne se vérifie que pour une petite partie des marais selon les résultats du WBS. Le manque d’eau a aussi des conséquences sur les zones alluviales, parce qu’elles ne sont plus épisodiquement inondées, parce que le niveau des eaux souterraines a trop baissé ou parce que, lorsque les glaciers auront disparu, elles ne seront plus alimentées en eau de fonte.
Apports de nutriments et produits phytosanitaires : le niveau de nutriments augmente dans de nombreux biotopes, ce qui a pour effet que les espèces caractéristiques diminuent au profit d’espèces plus répandues (Charmillot et al. 2021 ; Strebel et
Bühler 2015). L’enrichissement graduel en nutriments (eutrophisation) est la conséquence des apports d’azote atmosphériques provenant de l’agriculture, des transports et des ménages. Même des marais éloignés et intacts de l’espace alpin sont touchés. Les apports trop élevés de nutriments peuvent aussi provenir d’une pâture trop intensive ou d’une irrigation à l’intérieur ou autour du biotope. En outre, l’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces voisines menace la biodiversité des milieux proches de l’état naturel.
Disparition des structures de milieux naturels : la volonté de rationalisation de l’exploitation fait que l’on tend davantage à supprimer des structures de milieux naturels comme les arbres isolés, les haies et les tas de pierres plutôt qu’à en créer de nouvelles (Guntern et al. 2020). Ce phénomène est également en augmentation dans les régions de montagne. Les murs de pierres ne sont souvent plus entretenus et disparaissent ainsi d’eux-mêmes avec le temps.
Disparition des plans d’eau temporaires : les structures de milieux naturels ne sont pas les seules à disparaître des paysages communs bien ordonnés ; les mares deviennent elles aussi toujours plus rares. Il manque particulièrement souvent des plans d’eau temporaires nécessaires pour la
Fig. 17 : Variations du niveau de l’eau et diversité des espèces
Plus un plan d’eau calme contient de l’eau longtemps, plus le risque de prédation est élevé. Dans l’étang de gauche, la diversité des espèces d’amphibiens est pour cette raison peu élevée. Les espèces moins compétitives ou celles dont les larves n’ont pas développé de comportement d’évitement des prédateurs au cours de l’évolution peuvent se reproduire avec plus de succès dans les étangs qui s’assèchent annuellement (à droite).
Prédateurs






Larves d’amphibiens
Prédation
Graphique :





















Risque d’assèchement
reproduction des espèces qui pondent tardivement et qui sont aujourd’hui les plus menacées (Schmidt et al. 2023).
Si le plan d’eau ne s’assèche pas en automne, il est boudé au printemps ou recèle des larves de libellules voraces de l’année précédente. S’il se remplit trop tôt au printemps, il abrite déjà des larves de grande taille très compétitives ou des tritons, qui sont autant de prédateurs pour les têtards (fig. 17). Avec la sécheresse estivale accentuée par les changements climatiques, il a souvent des difficultés à afficher naturellement des variations de niveau adéquates.
Les étangs artificiels vidangeables permettent de gérer le niveau d’eau de manière ciblée pour favoriser les amphibiens tributaires des plans d’eau temporaires, donc précisément les espèces qui ont le plus disparu des objets de l’inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens (Bergamini et al. 2019a).
Espèces exotiques envahissantes : les espèces exotiques envahissantes se dispersent dans tous les biotopes, mais surtout dans les zones alluviales. En font notamment partie la renouée du Japon (Reynoutria japonica), la vergerette annuelle (Erigeron annuus), le buddléia de David (Buddleja davidii) ou les espèces exotiques de cotonéasters.
Embroussaillement et enfrichement des terrains agricoles : beaucoup de bas-marais et de prairies et pâturages secs restent menacés par l’abandon de l’exploitation ou par la sous-exploitation (fig. 18). Le WBS a montré que la couverture boisée a augmenté de plus de 5 % dans 10 % de tous les objets de l’inventaire fédéral des prairies et pâturages secs au cours des 10 dernières années et dans environ 4 % des bas-marais au cours des 25 dernières années. La technicisation croissante de l’agriculture devrait permettre de trouver de nouvelles solutions pour maintenir ouvertes, moyennant une charge de travail limitée, les surfaces éloignées et difficiles à exploiter.
Le but principal visé par les cinq ordonnances de protection des biotopes est la « conservation intacte », en matière de surface et de qualité. Les aides à l’exécution informent

les acteurs à l’échelon cantonal sur la mise en œuvre appropriée.
Mise en œuvre par les cantons
Les ordonnances fédérales de protection des biotopes chargent les cantons de mettre en œuvre les objets d’importance nationale. La « mise en œuvre » désigne la concrétisation de la législation fédérale au moyen d’instruments juridiques ou relevant de l’aménagement du territoire généralement contraignants. Les cantons prennent les mesures juridiquement contraignantes nécessaires pour garantir à long terme la préservation intacte de l’objet. Pour ce faire, ils peuvent utiliser leurs propres instruments, dès lors qu’ils sont appropriés pour atteindre l’objectif visé.
La mise en œuvre comprend quatre éléments :
1. une protection contraignante pour les propriétaires fonciers, avec délimitation à l’échelle des parcelles (secteur A pour les objets de l’inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens) ;
2. la garantie de mise en œuvre de mesures de gestion et d’entretien adaptées ;
3. la délimitation de zones-tampon suffisantes du point de vue écologique ;
4. l’assainissement des objets détériorés.
Protection contraignante pour les propriétaires fonciers
Les instruments suivants permettent de mettre en place une protection contraignante pour le propriétaire de la parcelle : le plan directeur cantonal et une protection sur le plan






cantonal sous la forme d’ordonnance, de décret ou d’arrêté du Conseil d’État ou une zone de protection juridiquement contraignante dans le cadre d’un plan d’affectation (fig. 19).
Garantie des mesures de gestion et d’entretien
La plupart du temps, l’entretien des bas-marais et des prairies et pâturages secs est réglé par des contrats d’exploitation, conformément à la LPN. Il s’agit de conventions conclues entre les responsables d’exploitation et le canton. Elles complètent les objectifs de protection, les conditions d’exploitation et les contributions versées en vertu de l’ordonnance sur les paiements directs (OPD).
Les décisions de mise sous protection sont accompagnées d’un plan de gestion qui décrit les mesures d’entretien et de régénération. En forêt, l’entretien des biotopes peut être réglé au moyen d’une réserve forestière spéciale.
Zones-tampon suffisantes du point de vue écologique
Une zone-tampon suffisante du point de vue écologique englobe les fonctions suivantes :
• Zone-tampon trophique : elle protège les biotopes contre les nutriments apportés par les eaux, en particulier les engrais. Dans cette zone, il faut prévoir une exploitation extensive (fig. 20).


• Zone-tampon hydrique : les marais, mais aussi d’autres biotopes humides comme les zones alluviales ou les sites de reproduction de batraciens, ont besoin d’un approvisionnement en eau naturel. Si celui-ci est perturbé, les biotopes s’assèchent. La zone-tampon hydrique garantit l’approvisionnement en eau ; dans cette zone, les interventions dans le régime hydrique sont à éviter. Zone-tampon biologique : des mesures appropriées doivent protéger la faune et la flore du biotope contre les dérangements (p. ex. bruit, lumière, animaux domestiques). En outre, les espèces animales et végétales spécifiques aux biotopes doivent pouvoir accéder aux habitats voisins dont elles ont besoin pour leur développement (p. ex. arbres, lisière, plans d’eau).
• Zone-tampon morphodynamique : elle ne concerne que les zones alluviales. Il s’agit d’une surface attenante à la zone alluviale où sont tolérés les événements tels que l’érosion des berges, les inondations, les glissements de terrain et l’alluvionnement.
La délimitation des zones-tampon trophiques est aujourd’hui la plus avancée : une zone-tampon trophique est délimitée ou n’est pas nécessaire pour 66 % des objets (28 % des objets ont une zone-tampon trophique suffisante du point de vue écologique, 38 % n’en ont pas besoin [OFEV 2022]).





Haut-marais de Rotmoos (FR). Zone de protection A : haut-marais ; zone de protection B : forêt ; zone de protection C : zone-tampon. Le plan de protection prescrit pour la zone B une « exploitation sylvicole s’orientant vers l’état naturel » et interdit notamment « l’introduction d’espèces d’arbres et d’arbustes non indigènes et étrangères à la station ». Pour la zone C, le plan prescrit une exploitation agricole extensive, à régler par contrat, en même temps que les éventuels dédommagements pour perte de revenu, avec les exploitants. La zone A comprend les surfaces de

Zones de protection
A Haut-marais
B Forêt
C Zones-tampon
Assainissement des biotopes détériorés
Beaucoup de marais ne sont plus dans un état leur permettant de remplir de manière suffisante leur fonction écologique. Selon les cantons, seulement 40 % des objets ne nécessitent pas d’assainissement (OFEV 2022). L’état des objets restants est soit inconnu soit de moyenne ou mauvaise qualité. Ce constat correspond aux résultats actuels du WBS, selon lesquels près de la moitié des objets doivent être examinés, voire ont probablement besoin d’être assainis. Les hauts-marais sont les objets qui présentent le besoin d’assainissement le plus élevé.
Les travaux d’assainissement des biotopes ont nettement gagné en importance au cours des dernières années (fig. 21). Il existe plusieurs guides et listes de contrôle pour aider les acteurs concernés. Le WBS a montré que, sur le Plateau, l’assainissement des biotopes a en partie permis d’inverser la tendance. C’est ainsi que la couverture boisée des hautsmarais du Plateau a diminué grâce aux assainissements et à un entretien efficace (Bergamini et al. 2019). La présence d’espèces figurant sur liste rouge dans les hauts-marais et les bas-marais n’a pas baissé, et le recul de certaines espèces communes d’amphibiens a ralenti ou s’est même localement arrêté durant ces quinze dernières années. Ces avancées ont été possibles grâce aux mesures conjointes de la Confédération, des cantons et d’autres acteurs.
État de la mise en œuvre
La Confédération détermine régulièrement l’état d’avancement de la mise en œuvre au moyen d’un questionnaire portant sur tous les inventaires de biotopes. Cette enquête a été réalisée pour la quatrième fois en 2021 (OFEV 2022).
La mise en œuvre n’est achevée que pour un quart environ des objets (protection contraignante pour le propriétaire foncier, entretien réglé par un contrat, zones-tampon délimitées, qualité maintenue). Dans le cas des sites de reproduction de batraciens, cette proportion est de 44 %, et elle est de 11 % pour l’inventaire fédéral des prairies et pâturages secs (l’inventaire fédéral le plus récent). L’état d’avancement des quatre éléments constitutifs de la mise en œuvre varie aussi entre les inventaires et à l’intérieur de ceux-ci (fig. 22). Afin d’éviter des pertes de qualité et, par conséquent, des mesures d’assainissement supplémentaires dans les biotopes, il est nécessaire d’agir dès à présent. Aussi les mesures de
Fig. 20 : Zone-tampon trophique autour du haut-marais de La Mosse d’en Bas à La Verrerie (FR)
Une zone de 10 à 30 m autour du biotope n’est pas fertilisée. Les produits phytosanitaires n’y sont pas non plus utilisés.

protection et d’entretien des biotopes d’importance nationale doivent-elles être renforcées de toute urgence.
Il n’en demeure pas moins qu’entre 2018 (dernière enquête) et 2021, la protection, l’entretien et la qualité des objets se sont légèrement améliorés. Le renforcement des moyens ordinaires par des mesures d’urgence prises dès 2017 produit ses premiers effets. Ce sont autant de pas faits dans la bonne direction, mais ils sont (encore) modestes et trop lents. La protection et le maintien de la qualité écologique des biotopes d’importance nationale ne seront couronnés de succès que si les cantons prennent leur responsabilité et mettent à disposition les ressources
Assainissement dans les marais de Guin (FR)

Fig. 22 : État de la mise en œuvre des inventaires fédéraux de biotopes
Pourcentage d’objets avec une protection contraignante pour les propriétaires fonciers, un entretien réglementé, des zones-tampon délimitées et une bonne qualité. Zones-tampon : les indications ne sont pas uniformes ; en règle générale, il s’agit des zones-tampon trophiques. Entre parenthèses : nombre d’objets par inventaire. Seuls les objets dont l’ensemble de la surface est concerné sont indiqués.
Protection
Entretien
Zones-tampon
Qualité
Total des objets par inventaire
Part des objets en %
Source : enquête auprès des cantons 2021, OFEV 2022
humaines correspondantes. La mise en œuvre intégrale et rapide du mandat légal existant de longue date suppose en effet aussi la volonté d’accorder une grande importance à la protection, à l’entretien et à l’assainissement des objets.
Aides financières de la Confédération
Comme beaucoup de biotopes dignes de protection résultent d’une exploitation de longue date, ils doivent être gérés et entretenus régulièrement. Près de la moitié des biotopes ont en outre besoin de mesures d’assainissement (enquête auprès des cantons sur l’état de la mise en œuvre, OFEV 2022). Les mesures d’entretien et de valorisation sont financées au moyen des conventions-programmes dans le cadre de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). Les prestations et les aides financières sont décrites dans le Manuel sur les conventions-programmes dans le domaine de l’environnement (OFEV 2023, mis à jour tous les quatre ans). Les cantons organisent la protection, la gestion et les assainissements.
Les coûts annuels récurrents pour une protection et un entretien des biotopes d’importance nationale conformes aux exigences légales se montent à plus de 100 millions de francs (Martin et al. 2017). Dans l’état actuel des connaissances, les coûts d’assainissement sont estimés à environ 1,6 milliard de francs. Les plus importants sont à mettre au compte de la restauration du régime hydrique des hauts-marais et des bas-marais dégradés et ainsi que de la revitalisation des zones alluviales.
L’argent investi en faveur de la biodiversité ne préserve pas seulement les richesses naturelles, il accroît aussi la création de valeur de l’économie locale, augmente l’attractivité des zones concernées et peut contribuer à freiner l’exode rural (OFEV 2019b). Les moyens fédéraux destinés à la protection de la nature bénéficient en premier lieu à l’agriculture et au secteur du bâtiment. Les principales régions concernées sont les régions périphériques, dans lesquelles sont mises en œuvre la plupart des mesures en faveur de la biodiversité.
De nombreux acteurs
En plus de la Confédération et des cantons, ce sont surtout les communes, les ONG, l’agriculture et la sylviculture ainsi que les propriétaires fonciers privés qui participent au maintien des biotopes et de leurs qualités. Seule la collaboration étroite des politiques sectorielles de la Suisse permettra la préservation à long terme des biotopes d’importance nationale.
Sylviculture et protection des biotopes : un travail en partenariat
Lorsque les biotopes nationaux sont situés dans l’aire forestière ou concernés par l’exploitation sylvicole, les autorités forestières cantonales et les services de protection de la nature élaborent conjointement les mesures de protection. Une réserve forestière assortie d’un plan de mesures sylvicoles représente un bon instrument pour tirer parti des synergies : les objectifs de protection du biotope sont intégrés aux objectifs de la réserve forestière ou les objectifs de la réserve forestière (p. ex. la promotion de certaines associations forestières rares) sont intégrés dans les objectifs de protection du biotope.
Une exception : les objets de l’inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens Font exception les objets itinérants de l’inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens. Il s’agit d’objets situés dans des sites d’extraction de matériaux en activité qui ne sont pas définis comme un périmètre à protéger, mais désignent des zones ponctuelles à proximité desquelles les conditions nécessaires à la réalisation des objectifs de protection doivent être créées ou maintenues. Il importe d’abord ici de garantir des mesures favorables aux amphibiens sous forme de conventions contraignantes ou de conditions définies par le canton et les exploitants de gravières.
Une particularité : les sites prioritaires de prairies et pâturages secs
Dans les sites prioritaires de prairies et pâturages secs (ordonnance sur les prairies sèches, art. 5), une importance majeure est accordée à la conservation, à la valorisation et à la mise en réseau des objets de l’inventaire. La protection et la conservation y sont planifiées de façon ciblée sur une plus grande surface, de façon à augmenter la valeur des objets. Les sites prioritaires complètent ainsi la protection des objets. Leurs buts et les mesures à prendre sont formulés dans un concept global. Les sites prioritaires constituent par définition un habitat de grande valeur écologique pour la faune et la flore typiques des prairies et pâturages secs. Ils comprennent un objet ou plusieurs objets proches les uns des autres et jouxtant des habitats et éléments structurels naturels ou semi-naturels.

3.1 Caractéristiques
Le sol constamment gorgé d’eau des hauts-marais est pauvre en oxygène et ne contient pour cette raison presque pas de bactéries, de vers de terre et d’autres organismes. Les restes de végétaux ne se décomposent donc que partiellement et s’accumulent sous forme de tourbe. Croissant très lentement (env. 1 mm par an), la tourbe a besoin de millénaires pour former plusieurs mètres d’épaisseur.
Comme la couche supérieure de ce milieu naturel s’élève progressivement au-dessus du niveau des eaux souterraines, les hauts-marais sont entièrement tributaires des précipitations. Telles de gigantesques éponges dans le paysage, ils absorbent et retiennent l’eau des précipitations grâce aux sphaignes, une mousse qui domine la végétation pauvre, jouit d’une capacité de rétention hydrique exceptionnelle et acidifie son milieu.
Les hauts-marais sont extrêmement pauvres en éléments nutritifs, puisque ceux qui sont contenus dans la tourbe ne sont pas disponibles pour les plantes. L’unique source de nutriments provient donc des précipitations atmosphériques.
Répartition des hauts-marais d’importance nationale
Les marais stockent d’importantes quantités de carbone organique. Ils ont donc une incidence sur le climat. Lorsqu’ils s’assèchent, ils deviennent par contre des sources de CO2 : les émissions de gaz à effet de serre provenant des marais asséchés et exploités à des fins agricoles représentent 5 % des émissions globales de gaz à effet serre d’origine anthropique et il convient donc d’y porter une grande attention (Joosten 2015).
Les marais de transition sont des stades de transition entre hauts-marais et bas-marais. La végétation des hauts-marais, les sols agricoles adjacents souvent riches en tourbe ainsi que les bas-marais qui les jouxtent généralement forment ce que l’on appelle un complexe marécageux, dans lequel toutes les parties sont hydrologiquement reliées. Toutes les mesures prises à proximité immédiate des hauts-marais ont donc des effets sur l’ensemble du complexe marécageux.

Base de données : données sur les biotopes OFEV 2023
Les deux plus grands complexes de hauts-marais qui existent encore en Suisse sont ceux des Ponts-de-Martel (NE) et de Rothenthurm (SZ, ZG). Ils ont cependant aussi été en grande partie asséchés et sont partiellement exploités de façon extensive par l’agriculture et la sylviculture.
Végétation de buttes (Oxycocco-Sphagnetea)
Les sphaignes forment des monticules arrondis appelés buttes. Ces buttes forment avec les gouilles des complexes de buttes et de gouilles typiques des hauts-marais, très rares en Suisse. Outre les sphaignes, des plantes typiques des hauts-marais y poussent, comme l’andromède à feuilles de romarin (Andromeda polifolia), la canneberge (Vaccinium oxycoccos), le rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia) et la linaigrette engainante (Eriophorum vaginatum)
Photo : Butte (monticule de tourbe) avec des espèces spécialisées © Philippe Grosvernier/LIN’eco
Végétation de gouilles (Rhynchosporion albae)
Les gouilles forment le pendant des buttes dans le complexe de buttes et de gouilles (voir ci-dessus). Elles sont presque toujours remplies d’eau et hébergent un petit nombre d’espèces spécialisées comme la laîche des bourbiers (Carex limosa) et la scheuchzérie des marais (Scheuchzeria palustris), mais aussi le rossolis à longues feuilles (Drosera anglica) et la mousse Scorpidium scorpioides
Photo : Rossolis à longues feuilles (Drosera anglica) © Ariel Bergamini/WSL
Pinède de tourbière (Pino mugo-Sphagnetum)
La végétation caractéristique de ces surfaces de hauts-marais est composée de sphaignes, de pins de montagne et d’arbrisseaux. Près du centre du marais, le peuplement de pins de montagne s’éclaircit et les arbres sont toujours plus petits. Cette unité de végétation de haut-marais est relativement fréquente en Suisse.
Photo : Salwidili (LU)
© Regina Jöhl/oekoskop






Végétation de combe d’écoulement, marais de transition (Caricion lasiocarpae)
Cette végétation pousse dans les petites combes d’origine naturelle dans lesquelles le trop-plein d’eau du haut-marais s’écoule. Les espèces végétales typiques sont la laîche à utricules contractés en bec (Carex rostrata), le trèfle d’eau (Menyanthes trifoliata) et le comaret des marais (Potentilla palustris)
Photo : Comaret des marais (Potentilla palustris)
© Ariel Bergamini/WSL
Boulaie et pessière de tourbière (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Bazzanio-Piceetum)
Les bouleaux et les épicéas qui croissent dans les hauts-marais pénètrent en général moins au centre que les pins de montagne. Les sphaignes dominantes et les arbrisseaux sont aussi typiques de cette unité de végétation. Celle-ci pousse fréquemment sur les surfaces asséchées.
Photo : Müschenegg (FR)
© Philippe Grosvernier/LIN’eco
Végétation mixte de tourbière
Cette unité de végétation est prédominante dans les hauts-marais secondaires. Elle est composée de mosaïques d’unités de végétation décrites ci-dessus, qui ne peuvent être cartographiées individuellement en raison de leur petite taille. On y trouve souvent un mélange de végétation de haut-marais et de végétation étrangère aux tourbières avec beaucoup de trichophore gazonnant (Trichophorum cespitosum)
Photo : Sörenberg (LU)
© Philippe Grosvernier/LIN’eco
Importance nationale
Les hauts-marais de Suisse sont les premiers biotopes inventoriés, entre 1978 et 1982. Un haut-marais était inscrit dans l’inventaire lorsqu’il remplissait les critères suivants (Grünig et al. 1986) :
• recouvrement par les sphaignes (toutes les espèces du genre Sphagnum) supérieur à 5 % ; présence d’au moins 1 des 4 plantes vasculaires caractéristiques des hauts-marais (Andromeda polifolia, Drosera rotundifolia, Eriophorum vaginatum, Vaccinium oxycoccos) ou 3 des 17 espèces végétales vivant dans les hauts-marais (Betula nana, Calluna vulgaris, Carex limosa, Carex paupercula, Carex pauciflora, Drosera anglica, Drosera intermedia, Empetrum nigrum, Lycopodiella inundata, Melampyrum pratense, Pinus mugo, Rhynchospora alba, Scheuchzeria palustris, Trichophorum cespitosum, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis-idaea) ;
• surface avec végétation marécageuse dominante (> 50 % d’espèces caractéristiques des marais) d’un seul tenant d’au moins 625 m2
On distingue deux types de hauts-marais. Les hautsmarais qui n’ont pas été exploités ou sont presque intacts sont considérés comme primaires. Les hauts-marais qui subissent l’influence de l’être humain ou qui sont partiellement exploités sont considérés comme secondaires. Dans l’inventaire, les hauts-marais uniquement soumis au piétinement sont en général catégorisés comme primaires alors que ceux qui sont asséchés artificiellement ou fertilisés sont classés comme secondaires.
En plus du haut-marais proprement dit, l’inventaire comprend également une « zone de contact ». Cette zone comprend les surfaces limitrophes du haut-marais directement reliées avec lui sur le plan hydrologique et destinées à le protéger
des influences étrangères (la zone de contact englobe avant tout des bas-marais et des sols tourbeux dégradés, exploités par l’agriculture ou recouverts de forêt).
Après l’acceptation de l’initiative de Rothenthurm en 1987, le Conseil fédéral a proposé d’inscrire les objets de cet inventaire dans l’ordonnance sur les hauts-marais, ce qui fut réalisé avec la décision du 21 janvier 1991.
Les hauts-marais suisses ne sont souvent plus que des vestiges de tourbières qui ont été exploitées, au moins partiellement, dans le passé puis abandonnées à elles-mêmes. La végétation de ces sites détériorés comprend en partie des espèces typiques des hauts-marais, mais il est par endroits difficile de la catégoriser. L’importance de ces stations pour la protection des espèces ne doit cependant pas être sous-estimée.
L’inventaire des hauts-marais de Suisse distingue six unités de végétation caractérisées par des associations végétales typiques. Ces types d’associations végétales sont bien visibles dans les hauts-marais primaires très peu influencés par l’être humain.
Exploitation
Les hauts-marais sont des milieux naturels pauvres en nutriments et sensibles au piétinement ; ils ne devraient donc pas être exploités. À la différence des bas-marais, il faut si possible y renoncer à la pâture, car les sphaignes ne supportent pas le piétinement ni le tassement et beaucoup d’espèces caractéristiques des hauts-marais réagissent de manière extrêmement sensible aux apports de nutriments.
Lorsque les hauts-marais sont trop secs, ils s’embroussaillent, raison pour laquelle certains objets sont régulièrement débroussaillés et parfois fauchés (avant tout les marais de transition).
Tab. 2 : Nombre d’objets et surface dans l’inventaire fédéral des hauts-marais
Base de données : données sur les biotopes OFEV 2023
L’inventaire fédéral des hauts-marais et des marais de transition d’importance nationale compte 551 objets (tab. 2). Il est, en superficie, de loin le plus petit des cinq inventaires fédéraux de biotopes : les hauts-marais et les marais de transition ne couvrent plus que 1567 ha. Les hauts-marais encore existants se trouvent surtout sur le versant nord des Alpes (carte p. 27 ) ; il existe cependant par exemple aussi de très beaux hauts-marais en Haute-Engadine. Dans le Jura et sur le Plateau, régions autrefois riches en marais, beaucoup de hauts-marais ont été détruits, mais il y reste encore des vestiges précieux.
Seul un petit nombre de plantes, d’animaux et de champignons hautement spécialisés sont adaptés au milieu acide et pauvre en nutriments des hauts-marais (fig. 23). Le rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia), par exemple, trouve un apport en nutriments en retenant et digérant de petits insectes grâce aux poils glanduleux et collants de ses feuilles.
Comme ce milieu naturel est devenu très rare, de nombreuses espèces des hauts-marais sont menacées. Les plantes des hauts-marais les plus connues et les plus importantes pour la production de la tourbe sont les sphaignes (Sphagnum spp.). En Suisse, 33 espèces de sphaignes sont connues, dont beaucoup sont tributaires des
Espèces caractéristiques des hauts-marais


tourbières (Küchler et al. 2018). Selon le WBS, les sphaignes ne couvrent aujourd’hui en moyenne plus que 43 % des hauts-marais. Dans un haut-marais en bonne santé, le recouvrement devrait normalement être supérieur à 80 %.
Les hauts-marais hébergent aussi des espèces animales spécialisées. La chenille du solitaire (Colias palaeno) se nourrit par exemple uniquement des feuilles de l’airelle des marais (Vaccinium uliginosum), qui croît presque exclusivement dans les hauts-marais. Le papillon adulte, par contre, a besoin de fleurs riches en nectar dans les environs pour se nourrir, telles que les composées ou les caprifoliacées (notamment scabieuses, knauties). Comme cette mosaïque de milieux se raréfie, ce papillon diurne est aujourd’hui menacé dans certaines régions.
Parmi les espèces prioritaires au niveau national et relativement fréquentes dans les hauts-marais, on peut citer la leucorrhine douteuse (Leucorrhinia dubia), l’aeschne azurée (Aeshna caerulea), le nacré de la canneberge (Boloria aquilionaris), la cordulie arctique (Somatochlora arctica) ou la sphaigne brune (Sphagnum fuscum)
Bois souterrain
Au XVIIe siècle, la Suisse connut une pénurie de bois de feu. Les coupes de bois destinées à la production énergétique et le pâturage libre pluriséculaire avaient fortement dégradé


la forêt. Celle-ci n’arrivait donc plus à couvrir les besoins en matières premières et en énergie d’une population en rapide augmentation et d’une industrie en pleine expansion. C’est alors que l’on s’intéressa pour la première fois aux gisements de tourbe, et spécialement à ceux des hauts-marais, en tant que ressource d’énergie. Ainsi, en 1712, le médecin de la ville de Zurich Johann Jakob Scheuchzer, après une description des imposants gisements de tourbe de la région administrative de Rüti dans l’Oberland zurichois, conseillait-il d’exploiter ce « bois souterrain » comme cela se pratiquait depuis longtemps déjà en Hollande et au nord de l’Allemagne.
De nombreuses tourbières furent ainsi exploitées jusqu’à anéantissement. L’extraction s’intensifia en particulier dans les périodes difficiles, la dernière fois lors de la Seconde Guerre mondiale, durant laquelle on brûla 2,5 millions de tonnes de tourbe (OFEFP 2002). Si l’on considère pour les sites suisses une épaisseur moyenne de la tourbe de 2 m, cela correspond à une surface de 1000 ha, soit environ les deux tiers de l’étendue actuelle des hauts-marais d’importance nationale.
Presque tous les hauts-marais du Jura et du Plateau ont connu à un moment donné une exploitation de la tourbe (fig. 24). Une grande partie des objets d’importance nationale actuels en portent les traces et ne sont souvent plus que les modestes vestiges de hauts-marais jadis très vastes. La
plaine jurassienne à l’est de la Brévine (NE), par exemple, était à l’origine un haut-marais d’un seul tenant. Il n’en reste aujourd’hui que quatre petits fragments qui, dans l’inventaire des hauts-marais, constituent le Marais de la Châtagne (NE).
Fossés et systèmes de drainage À la suite de l’acceptation par le peuple et les cantons de l’initiative de Rothenturm en 1987, les hauts-marais, en tant que relicte de la végétation d’origine, ne peuvent plus être exploités pour leur tourbe. Dans presque tous les marais subsistent cependant des fossés et des systèmes de drainage aménagés durant les siècles passés, qui ont encore une influence négative sur les conditions de vie dans les hauts-marais.
L’assèchement porte atteinte directement, mais aussi indirectement, à la végétation. Des conditions plus sèches ont pour effet de minéraliser la couche supérieure de la tourbe, ce qui libère des nutriments et entraîne une auto-fertilisation des marais. Cette fertilisation favorise l’établissement et la croissance de buissons et d’arbres, dont la présence peut augmenter l’évaporation, ce qui entraîne une baisse du niveau d’eau et accroît encore l’assèchement.
Environ 70 % des hauts-marais encore existants en Suisse sont fortement influencés par l’être humain, raison pour laquelle des mesures de régénération étendues sont souvent nécessaires pour préserver le milieu naturel.
Fig. 24 : Exploitation semi-industrielle de la tourbe dans la première moitié du XXe siècle
Exploitation et séchage de la tourbe aux Ponts-de-Martel (NE) et à La Chaux, Tramelan (BE)


Toujours plus secs et plus riches en nutriments
Alors que les biotopes marécageux font l’objet d’une protection presque totale en vertu de la Constitution, les hauts-marais s’assèchent toujours plus – l’eau, vitale pour ces milieux, se raréfie. La couverture boisée a progressé, ce qui résulte aussi du manque d’eau. Entre 1985 et 2015, l’embroussaillement des hauts-marais a augmenté chaque année de 0,2 à 0,5 %, avant tout dans le Jura et les Alpes centrales (Bergamini et al. 2019a).
Les hauts-marais tendent aussi à devenir plus riches en nutriments en raison des apports d’azote par l’air.
Même si l’évolution négative de l’état des marais est manifeste, on constate aussi des changements positifs. Ainsi, dans les hauts-marais du Plateau, la couverture boisée a diminué grâce aux nombreuses mesures de régénération et actions de débroussaillage.
Le rôle joué par les hauts-marais dans le régime hydrique du paysage est souvent sous-estimé. Dans les régions où les précipitations sont importantes, ils atténuent l’écoulement des pluies intenses après des périodes de sécheresse et servent donc à prévenir des inondations. La capacité de rétention des bas-marais est un peu moindre. En outre, en cas de pluies persistantes, les hauts-marais purifient l’eau qui les traverse et stockent des quantités importantes de carbone organique. Ils ont donc une incidence sur le climat.
Lorsque les hauts-marais s’assèchent, la tourbe se décompose et ils émettent du CO2 au lieu de fixer ce gaz à effet de serre (Joosten 2015). Il est donc prioritaire de rétablir la fonction turfigène des hauts-marais. Pour qu’ils puissent de nouveau servir de puits de carbone, il faut relever les niveaux d’eau et les stabiliser. À cet effet, les systèmes de drainage doivent être désactivés par la construction de barrages et le comblement des fossés, de sorte à amener le niveau d’eau le plus près possible de la surface.
Au cours des deux dernières décennies, ces mesures ont permis de ralentir, mais non de stopper la destruction progressive des marais en Suisse. Les premiers succès obtenus par des projets de régénération montrent combien il est important, pour les marais, de rétablir les conditions hydrologiques (p. 34 ; Küchler et al. 2018).
Exemples d’assainissements réussis de hauts-marais
Arbres abattus et palplanches contre l’écoulement de l’eau
Lors de la régénération d’une tourbière secondaire à Mauntschas Tridas (St. Moritz, GR), les arbres renversés ou abattus entre 2017 et 2019 ont été placés dans des gouilles. En effet, la tourbe s’était érodée ou avait été décomposée par des utilisations antérieures (piste de ski de fond). Depuis, les mousses et autres plantes colonisent peu à peu les troncs. Avec le temps, une couverture fermée de mousse et de végétation se formera à nouveau.


A l’extrémité inférieure de la zone marécageuse, l’eau a été retenue à l’aide de palplanches afin que l’eau du marais ne puisse plus s’écouler librement de la zone.






































Le haut-marais de la Gruère, au sud-est de Saignelégier (JU), est l’une des plus grandes tourbières d’un seul tenant de Suisse. Il fait actuellement l’objet d’un vaste projet de revitalisation destiné à supprimer les fossés de drainage du XVIIe siècle et à rétablir l’hydrologie de la zone. La première étape a eu lieu en 2018. Selon les caractéristiques du terrain, des barrages ont été construits et les fossés ont été comblés avec de la tourbe du site. La forêt a pu être repoussée. Grâce à ces mesures, les sphaignes ont pu recoloniser de nombreux endroits du site, lui redonnant sa vitalité et sa capacité à fixer le carbone.


















Image, swisstopo, NPOC, swisstopo





est un portail d'accès aux informations géolocalisées, données et services qui sont mis à disposition par l'administration fédérale Malgré la grande attention quʼelles portent à la justesse des informations diffusées sur ce site, les autorités fédérales ne peuvent endosser aucune fiabilité et à lʼintégralité de ces informations. Droits d'auteur: autorités de la Confédération suisse. http://www.disclaimer.admin.ch/informations_juridiques.html

4.1 Caractéristiques
Les bas-marais se forment lors de l’atterrissement des lacs, du défrichement de forêts humides ou simplement aux endroits où de l’eau stagne en permanence à la surface du sol. Les bas-marais sont traditionnellement utilisés comme pâturages ou prairies à litière. Contrairement aux hauts-marais, une exploitation extensive des bas-marais, telle que la fauche ou la pâture, est généralement requise pour empêcher le reboisement.
Les bas-marais sont alimentés par les eaux de surface, les eaux du sol et les précipitations. Les eaux de pente, les eaux souterraines et les inondations temporaires amènent des nutriments dans le système, raison pour laquelle la végétation y est plus productive et plus diversifiée que dans les hauts-marais. Les bas-marais sont toutefois beaucoup plus pauvres en nutriments que les terres assolées et herbagères exploitées intensivement et servent ainsi d’habitat à de nombreuses espèces animales et végétales spécialisées.
La capacité de rétention d’eau des bas-marais est un peu moindre que celle des hauts-marais. Cependant, comme
Répartition des bas-marais d’importance nationale
les bas-marais bénéficient d’une superficie totale en Suisse beaucoup plus grande que celle des hauts-marais, leur capacité de rétention revêt également une grande importance.
Importance nationale
Les bas-marais de Suisse ont été cartographiés entre 1986 et 1989 à une échelle de 1 : 25 000 selon des critères uniformes encore valables aujourd’hui. Les conditions d’admission minimales sont les suivantes :
• présence d’au moins dix espèces des bas-marais sur 20 m2 ou recouvrement des espèces des bas-marais supérieur à celui des autres espèces ;
• un objet doit contenir au moins un objet partiel de 1 ha (au moins 0,5 ha au-dessus de la limite de la forêt), les autres objets partiels doivent avoir une superficie d’au moins 0,25 ha.
Chaque surface marécageuse d’un seul tenant est considérée comme un objet partiel. Les objets partiels distants de moins de 100 m l’un de l’autre sont regroupés en un objet.

Les bas-marais présentent des aspects très variés. Des unités de bas-marais très différentes peuvent se former suivant le degré d’humidité, les propriétés du sol, la topographie, la géologie et le type d’exploitation. Ces unités se caractérisent par des associations végétales typiques du milieu.
Roselière (Phragmition)
Les roselières sont une composante principale des zones d’atterrissement des eaux. Les peuplements denses de roseaux laissent passer peu de lumière et forment une épaisse litière, ce qui explique que très peu d’espèces spécialisées s’y développent. Les roselières constituent un habitat important pour de nombreux oiseaux et insectes.
Photo : Sugiez (FR)
© Monika Martin/oekoskop

Marais à grandes laîches (Magnocaricion)
Les marais à grandes laîches sont une autre unité de végétation caractéristique des zones d’atterrissement des lacs et des étangs. Comme leur nom l’indique, ils sont dominés par de grandes laîches en touradons et sont aussi relativement pauvres en espèces.
Photo : Morat (FR)
© Monika Martin/oekoskop

Marais alcalins ou acides à petites laîches
Les marais à petites laîches des Alpes et des Préalpes (marais alcalins à petites laîches – Caricion davallianae ; marais acides à petites laîches – Caricion nigrae) abritent souvent la linaigrette, visible de loin. Riches en fleurs, les marais alcalins offrent un habitat particulièrement favorable aux insectes.
Photo : Bellegarde (FR)
© Gaby Volkart/atena



Prairie à molinie (Molinion) avec mégaphorbiaie marécageuse (Filipendulion) en bordure
Les prairies à molinie sont des prairies humides riches en nutriments qui requièrent une exploitation régulière. Le foin était traditionnellement utilisé comme litière pour le bétail. Les fossés humides ou les bordures plus riches en nutriments abritent des mégaphorbiaies à reine des prés (Filipendula ulmaria)
Photo : Gros Mont (FR)
© Gaby Volkart/atena
Prairie humide à populage (Calthion)
Dans les stations encore plus riches en nutriments, on trouve des prairies humides appelées prairies à populage. Cellesci abritent souvent des trolles d’Europe (Trollius europaeus, comme sur l’image ci-contre) et de nombreuses orchidées. Les prairies humides doivent être régulièrement pâturées ou fauchées.
Photo : Entlebuch (LU)
© Monika Martin/oekoskop
Beaucoup de bas-marais d’importance nationale sont pâturés de manière très extensive (Val de Charmey, FR)

Pour chaque objet partiel, les experts estiment le recouvrement des différentes unités de végétation. Les surfaces non marécageuses situées à l’intérieur du bas-marais et supérieures à 0,25 ha sont exclues de l’objet. Les surfaces non marécageuses plus petites situées à l’intérieur du biotope n’en sont en revanche pas exclues.
Les bas-marais cartographiés sont soumis à un processus d’évaluation qui repose sur la taille de la surface et les unités de végétation présentes. Les objets qui atteignent un certain nombre de points au terme de cette évaluation sont déclarés d’importance nationale et inscrits dans l’ordonnance sur les bas-marais.
Bon nombre de bas-marais se sont formés à la suite de l’utilisation du sol comme prairie à litière ou pâturage. Ils doivent être régulièrement exploités pour éviter que de nombreuses surfaces ne s’embroussaillent et ne se reboisent. Aujourd’hui, l’entretien d’environ 85 % des bas-marais est réglé au moyen de conventions ou d’autres instruments (OFEV 2022). Outre l’assèchement, l’intensification et l’abandon de l’exploitation sont les principales menaces qui pèsent sur ces milieux naturels.
Les bas-marais à petites laîches doivent être fauchés tard (d’ordinaire seulement après le 1er septembre), de façon à laisser aux espèces les plus tardives le temps de se ressemer. Ce milieu naturel ne doit en aucun cas être fertilisé. En effet, toute fertilisation provoque une réduction souvent radicale de la diversité des espèces.
Les bas-marais pâturés extensivement et non fertilisés se distinguent par leur grande richesse en espèces (fig. 25). Une pâture trop longue avec des animaux trop nombreux et trop lourds entraîne cependant un recul des espèces (dégâts dus à l’apport de nutriments et au piétinement). Selon l’art. 29 OPD, les surfaces abritant des types de végétation sensibles au piétinement doivent être exclues de la pâture (clôture). Contrairement à l’exploitation comme prairie à litière, la pâture extensive favorise la diversité en structures du milieu, ce qui est favorable aux insectes et aux araignées.
Tab. 3 : Nombre d’objets et surface dans l’inventaire fédéral des bas-marais
Associations végétales caractéristiques (chiffres arrondis sur la base des données cartographiques de l’OFEV)
Groupement végétal
(Phragmition)
à grandes laîches (Magnocaricion)
Marais alcalin à petites laîches (Caricion davallianae)
Marais acide à petites laîches (Caricion nigrae)
Prairie à molinie (Molinion)
Prairie humide à populage (Calthion) et mégaphorbiaie marécageuse (Filipendulion)
Base de données : données sur les biotopes OFEV 2023
4.2 L’inventaire des bas-marais en chiffres
L’inventaire fédéral des bas-marais comprend 1335 objets, qui recouvrent une surface totale de 22 501 ha (20 fois plus que les hauts-marais). Le tableau 3 montre les parts de surface des différents types de milieux.
La plupart des bas-marais se trouvent sur le versant nord des Alpes. Le Plateau en compte peu ; il convient de noter à cet égard que la densité de bas-marais est plus élevée sur le Plateau oriental que sur le Plateau occidental. Le Valais, le Tessin et le canton du Jura en abritent très peu (carte p. 37).
Alors que les hauts-marais abritent un petit nombre d’espèces et d’associations végétales le plus souvent rares, les bas-marais hébergent une faune et une flore plus diversifiées. Les prairies à litière régulièrement fauchées (tous les un à trois ans) comptent même parmi les biotopes les plus riches en espèces d’Europe centrale.
Plusieurs espèces de libellules auxquelles les petits plans d’eau servent de sites de reproduction ont leur aire de distribution principale dans les bas-marais. Les azurés des marais (Phengaris spp.), des papillons diurnes, sont d’autres insectes caractéristiques des bas-marais. Leurs chenilles se nourrissent de plantes des marais (p. ex. Sanguisorba officinalis) et dépendent de certaines fourmis présentes
des bas-marais


seulement dans ce milieu pour leur développement. C’est pourquoi on les appelle également « azurés myrmécophiles ». Les trois espèces d’azurés des marais (azuré des mouillères, azuré des paluds et azuré de la sanguisorbe) sont aujourd’hui rares et très menacées (statut liste rouge : EN).
Les bas-marais abritent de nombreuses espèces prioritaires au niveau national. Le criquet ensanglanté (Stethophyma grossum), l’iris de Sibérie (Iris sibirica) et la gentiane des marais (Gentiana pneumonanthe) y sont fréquents. D’autres espèces prioritaires au niveau national ne s’y rencontrent plus que rarement, par exemple le vanneau huppé (Vanellus vanellus) et les azurés des marais susmentionnés.
Correction des eaux et améliorations foncières Durant le haut Moyen Âge, les bas-marais recouvraient environ 6 % de l’actuel territoire national (250 000 ha). La prairie à litière connut son apogée économique et socioculturel dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Lorsque, avec les premiers chemins de fer, des céréales moins chères arrivèrent d’Europe de l’Est et d’outre-mer, bien des paysans suisses se virent contraints de remplacer la culture céréalière, devenue non rentable, par l’élevage. Évidemment, la paille nécessaire à la litière d’étable devint denrée rare. La molinie s’avéra un bon substitut, à tel point qu’il devint profitable de transformer les prairies fourragères en prairies humides en les irriguant.


Par ailleurs, les grandes améliorations foncières du XIXe siècle, avec l’endiguement et la rectification des cours d’eau ainsi que le drainage des plaines et leur transformation en terrains cultivables, provoquèrent la disparition de nombreux vastes bas-marais naturels du Plateau. À titre d’exemple, on peut citer la première correction des eaux du Jura entre 1869 et 1888, qui amena l’assèchement de quelques 400 km2 du Grand Marais, cette vaste plaine marécageuse entre les lacs de Bienne, Neuchâtel et Morat. Aujourd’hui, le Grand Marais est l’une des principales régions maraîchères de Suisse et n’abrite plus que quelques bas-marais sur les rives des lacs.
Au XXe siècle, la plupart des prairies à litière furent sacrifiées à l’intensification de l’exploitation agricole. Aujourd’hui, il n’y a plus de besoin en litière de bas-marais. Dans pratiquement tous les bas-marais restants subsistent des fossés et des systèmes de drainage aménagés durant les décennies ou les siècles passés, qui ont encore une influence négative sur les conditions de vie dans les marais.
Évolution de la qualité
À l’instar des hauts-marais, les bas-marais deviennent toujours plus secs (Bergamini et al. 2019 et 2022). La couverture boisée progresse (fig. 27) et la part des espèces marécageuses caractéristiques régresse, en particulier dans les bas-marais alcalins et les roselières. Cette évolution a été confirmée par des relevés effectués entre 1995/1997 et 2005/2006 dans les cariçaies neutro-basophiles situées à différentes altitudes : en dix ans, les plantes vasculaires
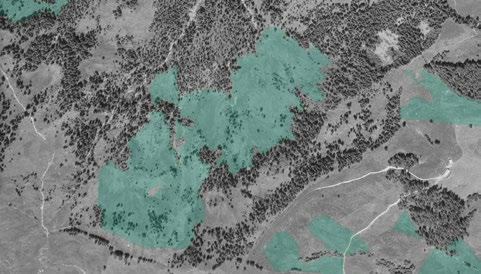
spécialisées ont diminué de 9,4 % et les mousses spécialisées même de 14,9 % (Bergamini et al. 2008).
La dégradation de la qualité des marais a aussi été mise en évidence lors du dernier « Suivi de la protection des marais » effectué entre 1997 et 2006 (Klaus 2007) : à cette époque déjà, un quart des marais s’étaient sensiblement asséchés, dans un quart d’entre eux l’approvisionnement en nutriments avait fortement augmenté, dans près d’un tiers les plantes ligneuses croissaient en plus grand nombre et le caractère marécageux avait sensiblement diminué dans 15 % de tous les marais. La surface des marais s’était certes peu réduite au cours de la période d’observation, mais celle des bas-marais non turfigènes (en particulier les prairies humides à populage) s’était étendue au détriment des bas-marais turfigènes (p. ex. les marais à petites laîches), ce qui équivaut à une nette perte de qualité.
Les différentes mesures prises au cours des deux dernières décennies ont permis de freiner la disparition de la flore et de la faune caractéristiques des bas-marais de Suisse, mais elles n’ont pas pu l’arrêter. En maints endroits, des contrats d’exploitation ont permis de convenir d’une exploitation adaptée au site. Ces mesures, conjuguées à l’assainissement des conditions hydrologiques, ont permis d’améliorer les chances de survie de la flore et de la faune caractéristiques des bas-marais.

Des zones-tampon indispensables
Comme pour d’autres biotopes, les marais doivent être protégés contre les possibles influences néfastes de leur environnement. Pour cette raison, les deux ordonnances sur les hauts-marais et les bas-marais exigent la délimitation de zones-tampon suffisantes du point de vue écologique autour des biotopes marécageux. Cette zone-tampon est constituée d’une zone-tampon trophique, d’une zonetampon hydrique et d’une zone-tampon biologique (voir aussi point 5.1). À l’heure actuelle, il reste à délimiter des zones-tampon trophiques pour environ 22 % des basmarais et 16 % des hauts-marais (OFEV 2022).
Les marais sont tributaires d’un excédent d’eau provenant de leur environnement. Dans presque tous les marais de Suisse, cet apport d’eau ou le régime des eaux (voir chap. 3 Hauts-marais et marais de transition) est plus ou moins fortement perturbé (drainages, captages de sources ou d’eaux souterraines, routes, remblais ferroviaires et autres constructions). Il est donc nécessaire de prendre des mesures qui protègent les ressources en eau des marais. Ces mesures doivent être appliquées dans le bassin versant du marais.
Dans le cadre du projet « Espace Marais », des bases méthodologiques ont été élaborées pour définir les bassins versants pour un objet donné. Ces zones-tampon sont déterminées à l’aide de calculs et de modélisations SIG et sur la base d’une évaluation d’experts. En plus du complexe de biotopes marécageux central, qui forme un ensemble hydrologique, on distingue différents types de bassins versants (fig. 28) :
• bassin versant alimentant le complexe marécageux par ruissellement ;
• bassin versant d’un ruisseau alimentant le complexe marécageux ;
• bassin versant d’un ruisseau présentant un risque d’érosion pour les surfaces marécageuses ;
• ourlet sensible.
Dans ces zones, toute modification du régime hydrique est susceptible de compromettre l’approvisionnement en eau nécessaire à la préservation du marais. Pour cette raison, les projets dans les bassins versants d’un biotope marécageux doivent faire l’objet d’un examen approfondi avant de pouvoir être autorisés. Cette approche permet un renversement du fardeau de la preuve : il appartient à
l’auteur d’un projet (construction de route, drainage, etc.) de démontrer que ce projet n’aura pas d’impact sur le régime hydrique des marais. Les cantons, qui sont responsables de la protection des marais, ont désormais à disposition un instrument qui leur permet de veiller au respect des ordonnances sur les hauts-marais et les bas-marais, aux termes desquelles les cantons veillent en particulier à ce que « le régime local des eaux soit maintenu et, si cela favorise la régénération du marais, amélioré » (respectivement art. 5, al. 1, let. e, et art. 5, al. 2, let. g).
Certains cantons appliquent déjà cette nouvelle méthode. Le canton de Berne, par exemple, a fait délimiter les périmètres de prévention pour les zones-tampon hydriques et les a inscrits en 2019 dans le plan sectoriel Biodiversité, qui est contraignant pour les autorités.
Fig. 28 : Structure des zones-tampon hydriques à Rotmoos (BE)
Les bassins versants des ruisseaux (violet et vert foncé), du complexe de biotopes marécageux (vert moyen) et de l’ourlet sensible (beige) sont délimités.
Complexe de biotopes marécageux
Zones-tampon hydriques
Types de surfaces
Bassin versant du complexe de biotopes marécageux
Ourlet sensible
Bassin versant ruisseau avec alimentation du complexe marécageux
Bassin versant ruisseau avec risque d’érosion du complexe marécageux

Carte : geo7
Exemples d’assainissements réussis de bas-marais
Le bas-marais du Grossried (Luzein, GR) avec son réseau de fossés et de drainages avant et après la renaturation en 2018
Le bas-marais est situé dans une région d’estivage à 1725 m d’altitude. Dans les années 1940, dans le cadre du plan Wahlen, un vaste réseau de drainage souterrain et de fossés a été mis en place dans le but de drainer, retourner et ensemencer le bas-marais. Le réseau de drainage nécessite depuis d’importants assainissements. Par temps de pluie, des inondations s’y produisent. Plutôt que d’assainir les conduites de drainage, des mesures ont été prises pour retenir l’eau qui s’écoule du marais ainsi que désactiver les conduites de drainage et les fossés. L’élévation du niveau de l’eau a permis le développement d’une végétation marécageuse étendue et la formation de plusieurs petits plans d’eau propices à l’aeschne azurée (Aeshna carulea), présente dans la région. Pour compenser la perte de surface dévolue à la pâture, des éclaircissements ont été réalisés à différents endroits dans des pâturages boisés existants.




5.1 Caractéristiques
Les zones alluviales naturelles sont des biotopes dynamiques. Façonnées par l’eau, elles se forment le long des lacs et des cours d’eau, dont le niveau est soumis à de fortes fluctuations saisonnières et annuelles. Elles sont donc périodiquement ou épisodiquement inondées. L’eau transporte des alluvions, du bois mort et des éléments fertilisants et donne naissance à une grande diversité de structures.
Deux catégories différentes de zones alluviales sont inscrites dans l’inventaire national des zones alluviales : les zones alluviales situées à basse altitude, jusqu’à 1800 m (zones alluviales de cours d’eau, deltas et zones alluviales de rives lacustres) et les zones alluviales alpines situées à plus de 1800 m (plaines alluviales alpines et marges proglaciaires) (fig. 29).
La dynamique des eaux induit dans un espace restreint une mosaïque de milieux naturels très différents comme des bancs de gravier ou de sable, des mégaphorbiaies et des forêts alluviales (voir Types de milieux – zones alluviales, p. 48). Les zones alluviales forment ainsi des paysages attrayants et sont très appréciées par la population comme lieu de détente.
Répartition des zones alluviales d’importance nationale
Base de données : données sur les biotopes
Les zones alluviales fournissent de nombreux services écosystémiques. Elles protègent notamment contre les crues en absorbant et retenant l’eau lors d’inondations, ce qui abaisse le niveau de crue et réduit les dégâts dans les secteurs proches des cours d’eau. En outre, les zones alluviales diversifiées sont souvent des lieux de détente et agissent comme des filtres naturels en retenant les polluants des eaux de surface.
Importance nationale
Une surface alluviale se caractérise avant tout par son potentiel à être inondée. Au moment de l’établissement de l’inventaire, il se peut cependant que certaines zones partielles soient complètement à sec. Pour cette raison, les secteurs du territoire situés dans la zone d’influence d’eaux de surface qui remplissaient les conditions minimales suivantes ont été admis :
• zones alluviales de basse altitude (en dessous de 1800 m) : au minimum 2 ha de végétation alluviale en bordure de lacs et cours d’eau naturels ou proches de l’état naturel ou 5 ha en bordure d’eaux corrigées ;
• zones alluviales alpines (au-dessus de 1800 m) : au minimum 0,25 ha caractérisé par un paysage alluvial fluvial ou fluvioglaciaire et répondant à des critères géomorphologiques et biologiques.

Les milieux alluviaux typiques sont spécialisés dans l’interaction continue, périodique ou épisodique avec les eaux. Les sites de reproduction de batraciens et la végétation des bas-marais peuvent aussi en faire partie. Beaucoup de sites de reproduction de batraciens et de bas-marais d’importance nationale se situent dans des zones alluviales (ils
Bancs de sédiments
Alluvions nues ou faiblement colonisées (gravier, cailloux, galets, sable, limon ou argile) exondées durant les basses eaux. Lorsqu’elles se prolongent, les formations alluviales herbacées s’installent progressivement ; elles peuvent toutefois être détruites lors de la crue suivante. Il s’agit d’un habitat important pour les oiseaux qui nichent sur les bancs de gravier (chevalier guignette, petit gravelot).
Photo : Zone alluviale de Tschingel (BE)
© Jan Ryser/OFEV
Formation herbacée du domaine alluvial
Les bancs de sédiments et les terrasses rajeunis de manière régulière par les crues sont colonisés par des espèces pionnières herbacées, les gazons des lieux piétinés et inondés, des mégaphorbiaies et une végétation annuelle. La diversité des espèces y est élevée. L’air et l’eau véhiculent de nombreuses graines et une faible concurrence règne entre les espèces. Des germinations et des plantules de saules, d’aulnes et de peupliers accompagnent fréquemment les espèces herbacées pionnières.
Photo : Allondon près de Dardagny (GE)
© Jan Ryser/OFEV
Bas-marais de basse et haute altitude
Des bas-marais se forment dans les dépressions constamment humides et les bras secondaires en voie d’atterrissement, qui sont le plus souvent protégés des effets directs de la dynamique des eaux. De nombreuses espèces des bas-marais spécialisées peuvent être présentes dans un espace restreint, par exemple dans les rares groupements pionniers des bords de torrents alpins (Caricion bicolori)
Photo : Kleinhöchstettenau, Rubigen (BE)
© Markus Bolliger/OFEV



représentent respectivement 17 % et 5 % des surfaces de zones alluviales). La présence d’un petit nombre de prairies et pâturages secs d’importance nationale dans ce milieu (tout juste 1 % des surfaces de zones alluviales) illustre le large éventail des conditions environnementales qui peuvent exister dans un espace restreint. En plus des eaux proprement dites, les zones alluviales hébergent les types de milieux présentés ci-après.



Forêt alluviale à bois tendre
Ces forêts sont les premières formations de bosquets qui colonisent les bords du cours d’eau ou les îlots de gravier. Elles sont composées d’essences à bois relativement léger telles que saules, aulnes ou peupliers (p. ex. saulaies blanches, aulnaies noires ou alluviales). Des espèces spéciales comme l’argousier (Hippophaë rhamnoides) ou le tamarin des Alpes (Myricaria germanica) appartiennent à ce milieu.
Photo : Zone alluviale de la Singine près de Sodbach (BE)
© Stephan Lussi/OFEV
Forêt alluviale à bois dur
Ces formations se trouvent dans les zones les plus éloignées de la rivière ainsi que sur les terrasses supérieures. Elles sont sous l’influence des eaux souterraines et des inondations lors de crues exceptionnelles. L’influence de l’eau freine le développement en forêt normale (forêt climacique). Ces formations sont caractérisées par le frêne, l’orme de montagne et l’érable plane. On y trouve aussi des pins et des chênes.
Photo : Giriz, Koblenz (AG)
© Jan Ryser/OFEV
Surfaces glaciaires
Les rochers et éboulis morainiques sont colonisés par des espèces pionnières spécialisées adaptées aux conditions difficiles. La couverture végétale augmente en même temps que se forme le sol. Des peuplements de saules ou d’aulnes verts peuvent marquer localement la zone. Ils constituent une base alimentaire pour les gallinacés et permettent aux cerfs et aux chamois de se camoufler.
Photo : Marge du glacier de Gelten (BE)
© Stephan Lussi/OFEV
Comme les limites des zones alluviales sont fréquemment mouvantes et parfois indistinctes, le périmètre a été délimité sur la base de points de repère visibles (p. ex. arête de versant, chemin, route). Il est donc fréquent qu’une zone alluviale inclut aussi de la végétation atypique pour ce biotope. Dans les gorges ou les ravins, les forêts de pente, en général proches de l’état naturel, sont souvent intégrées dans les objets jusqu’à une hauteur assez élevée au-dessus des eaux à titre d’élément du complexe alluvial.
Une mosaïque de milieux
Le niveau des lacs et des cours d’eau est soumis à des fluctuations journalières, hebdomadaires et annuelles. Il dépend naturellement des précipitations ou de la fonte des neiges. En raison de ce régime d’écoulement saisonnier, les différentes parties d’une zone alluviale peuvent être plus ou moins imprégnées d’eau, voire submergées durant des heures ou des semaines. Les crues plus importantes qui ne se produisent que quelques fois par an – ou plus rarement dans le cas des événements extrêmes – peuvent par contre remanier le milieu. Le cours d’eau modifie son tracé et la végétation existante est entièrement détruite dans certaines parties du site. Des plantes pionnières germent sur les nouveaux bancs de graviers nés de la crue (fig. 30). Cette interaction entre le développement naturel de la végétation et sa brusque interruption est indispensable pour qu’une faune et une flore riches en espèces et en partie hautement spécialisées puissent exister.
Tab. 4 : Durée de développement et de maintien des formations alluviales les plus fréquentes
Formation
Durée de développement (en années)
Durée de maintien (en années)
Bancs de gravier – < 1
Végétation pionnière herbacée 1 1-3
Fourrés et manteaux de saules 3-5 5-10
Forêt alluviale à bois tendre ≥ 10 30-50
Forêt alluviale à bois dur > 30 50-100
Source : Roulier et al. 2007
Fig. 29 : Types de zones alluviales d’importance nationale
Zones alluviales de cours d’eau
Ces zones sont le type le plus fréquent et le plus dynamique des altitudes inférieures. La végétation se compose d’une mosaïque d’associations pionnières, de fourrés et de forêts alluviales. Les systèmes entièrement naturels sont aujourd’hui très rares. En maints endroits, des aménagements restreignent la dynamique. Dans ce cas, il manque une régénération régulière derrière la digue de protection contre les crues. La végétation ne peut se maintenir que lorsque le niveau des eaux souterraines est suffisamment élevé. Photo : Gastereholz (BE).

© Jan Ryser/OFEV
Deltas
Les deltas se situent aux embouchures de cours d’eau dans des lacs. L’écoulement des eaux et le charriage des alluvions sont ici ralentis. Le matériau se dépose et forme des bancs qui avancent lentement dans le lac. Seuls quelques deltas de petits cours d’eau sont encore intacts.
La végétation marque une transition entre un écoulement dynamique et un état stagnant. Les forêts alluviales se mélangent avec la végétation pionnière et les marais. Photo : Bolle di Magadino (TI).

Zones alluviales de rives lacustres
Les zones alluviales de rives lacustres sont déterminées par les crues régulières et les variations du niveau des eaux souterraines. La dynamique mécanique se borne ici et là au ressac. Dans les zones alluviales des lacs, la végétation des zones alluviales et celle des marais sont étroitement imbriquées. En Suisse, les plus grandes zones alluviales de rives lacustres se trouvent dans la région des Trois-Lacs. Photo : Le Chablais (FR).

Marges proglaciaires
Les marges proglaciaires comprennent deux domaines différents : elles sont formées soit par la glace (domaine glaciaire) soit par le torrent glaciaire (domaine fluvial). Les fluctuations journalières de débit durant l’été, le trouble caractéristique de l’eau (coloration blanchâtre dite « lait glaciaire ») et les fluctuations des matériaux charriés sont influencés par le glacier. En général, seules des plantes pionnières poussent dans ce milieu. Photo : Kanderfirn (BE).

Plaines alluviales alpines
Les plaines alluviales alpines comprennent les régions plates au-dessus de 1800 m, marquées par les inondations et les déplacements et dépôts de sédiments. Les plaines alluviales alpines sont très dynamiques. Les inondations, la sédimentation, le déblai et le déplacement du chenal d’écoulement peuvent modifier radicalement, en très peu de temps, les conditions à proximité du lit. Les zones plus stables sont souvent utilisées aussi comme pâturage d’estivage. Photo : Plaun la Greina (GR).

La vitesse de cette évolution dépend des facteurs du site (tab. 4). À basse altitude, des niveaux des eaux souterraines élevés peuvent fortement la ralentir. En altitude ou sur des sites présentant des conditions topographiques particulières, il peut arriver que certaines formations de la zonation de végétation manquent naturellement (fig. 32).
Exploitation et revitalisation
Les zones alluviales naturelles ne dépendent pas d’une exploitation par l’être humain. La dynamique naturelle de l’eau et des matériaux charriés conserve et façonne les milieux alluviaux.
Aujourd’hui, cette dynamique naturelle est entravée ou a disparu en maints endroits du fait de l’endiguement des rivières, de l’exploitation de l’eau ou du prélèvement d’alluvions et de bois mort. Là où il est possible de le faire, les tronçons aménagés devraient être renaturalisés et les interventions, abandonnées ou atténuées au profit des zones alluviales. Dans de nombreux cas, des compromis
Fig. 30 : Effet des crues sur le fonctionnement des zones alluviales
peuvent être trouvés, qui permettent la plus grande dynamique possible dans un cadre contrôlé.
De nombreuses zones alluviales comprennent de vastes surfaces de forêt, pour la protection et l’entretien desquelles des instruments de la gestion forestière peuvent être utilisés. Lorsque la dynamique des eaux est suffisante, des réserves forestières naturelles et spéciales peuvent être délimitées. L’entretien forestier est surtout nécessaire là où la dynamique naturelle ne peut pas être rétablie à moyen ou long terme et où la végétation doit être ramenée aux premiers stades de succession par des interventions artificielles. En 2021, 11 % des zones alluviales étaient principalement entretenues à l’aide d’instruments forestiers (OFEV 2022).
5.2 L’inventaire des zones alluviales en chiffres
L’inventaire fédéral des zones alluviales d’importance nationale comprend 326 objets pour une surface totale
Horizon colmaté : couche imperméable formée par le dépôt de matériaux fins sur le lit du cours d’eau aux périodes de faible débit. Lors d’une crue, cette couche est décolmatée, ce qui rétablit une perméabilité.

Érosion de la rive (maintien de la surface ouverte sans ligneux)
Déplacement latéral du chenal d’écoulement
Décolmatage de la couche supérieure (perméabilité)
de 27 844 ha (carte p. 47, tab. 5). Les objets recouvrent environ 0,67 % du territoire national. Les Alpes centrales occidentales possèdent la plus forte densité d’objets, tandis que le Jura présente la plus faible (fig. 31). Du fait de la grande taille des marges proglaciaires, la moitié de la surface des zones alluviales est constituée de zones alluviales alpines.
Les zones alluviales sont naturellement peu nombreuses dans le Jura en raison de sa géologie calcaire. Sur le Plateau, les zones alluviales se sont plutôt raréfiées par suite de l’utilisation du sol ; il subsiste cependant encore de vastes surfaces alluviales résiduelles le long des grands cours d’eau du Plateau.
Fig. 31 : Part des zones alluviales dans les régions biogéographiques
Tab. 5 : Nombre d’objets et surface dans l’inventaire fédéral des zones alluviales
Objets nationaux par type de zone alluviale
Part en %
277 ha
VersantsuddesAlpesAlpescentralesorientalesAlpescentralesoccidentalesVersantnorddesAlpes
Source : données sur les biotopes OFEV 2023
Fig. 32 : Zonation de la végétation dans une zone alluviale de cours d’eau
Base de données : données sur les biotopes OFEV 2023
Pointe de crue
Crue moyenne
Niveau moyen des eaux Niveau
Vég. pionnière annuelle
Source : Funke Lettershop AG d’après spektrum.de
de gravier avec pin sylvestre Frênaie à orme alluviale
Végétation zonale F. all. à bois tendre
Forêt alluviale à bois dur
Forêt marécageuse (sur sol tourbeux)
Dépression humide (marginale)
En raison de la dynamique naturelle, les zones alluviales abritent des espèces végétales et animales hautement spécialisées. La grande variété des types de milieux qu’elles abritent favorise la présence simultanée de plusieurs espèces présentant des exigences très différentes. Le petit gravelot (Charadrius dubius) niche sur les bancs de sable et de gravier ; un peu plus loin, le sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) coasse dans une petite flaque. Avec beaucoup de chance, on pourra observer un grand sylvain (Limenitis populi), un papillon diurne qui quitte rarement les forêts alluviales.
Les zones alluviales abritent hébergent de nombreuses espèces prioritaires au niveau national comme le martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis), le criquet des iscles (Chorthippus pullus), la leucorrhine à large queue (Leucorrhinia caudalis) et le tamarin des Alpes (Myricaria germanica).
Les zones alluviales bordaient autrefois presque toutes les eaux du Plateau et de larges vallées des Alpes et du Jura, où elles formaient de vastes complexes de milieux naturels dans les plaines et les fonds plats des vallées.
Soucieux de se protéger contre les crues et désirant gagner de nouvelles terres cultivables pour nourrir une population croissante, les êtres humains s’efforcent depuis des siècles de limiter les processus dynamiques à l’origine de la formation des zones alluviales. La modification du paysage aquatique a atteint son point culminant au XIXe siècle. Müller-Wenk et al. (2004) estiment que, en 1900, la surface des zones alluviales situées en dessous de 1800 m d’altitude avait diminué de 55 %. Depuis, leur surface a encore baissé de 36 % (Lachat et al. 2010). Le recul le plus important entre 1900 et 2010 concerne l’espace alpin, où la correction des eaux a commencé relativement tard (tab. 6)
Les zones alluviales les plus précieuses qui subsistent à basse altitude sont sous protection fédérale depuis 1992. Cette première série d’objets inscrits dans l’inventaire a été entretemps complétée en plusieurs étapes, d’abord en 2001 avec les zones alluviales alpines (au-dessus de 1800 m, plaines alluviales alpines et marges proglaciaires) puis en 2003 et 2017 avec des compléments systématiques.
Près d’un quart de la superficie de l’inventaire fédéral est situé le long d’eaux corrigées, ce qui menace la qualité des surfaces alluviales, puisque la modification du régime d’écoulement due à l’exploitation hydroélectrique, de même que l’aménagement et les corrections des eaux, perturbent ou empêchent la régénération naturelle des milieux alluviaux (fig. 34)
Espèces caractéristiques des zones alluviales




Tab. 6 : Recul des zones alluviales en dessous de 1800 m d’altitude entre 1900 et 2010 par région biogéographique
biogéographique
Source : Lachat et al. 2010
Fig. 34 : Zone alluviale recolonisée par la forêt Neirivue (FR) 1930, 1974 et 2020. Lorsque la dynamique des eaux est insuffisante, les zones alluviales perdent leurs bancs de gravier et leur végétation pionnière herbacée. La Sarine a été canalisée au milieu du XXe siècle. En outre, la construction d’un barrage en amont à Lessoc (1969-1973) a tellement réduit la dynamique de l’eau que les bancs de gravier ont été recolonisés par la forêt.



Exploiter les synergies
De nombreuses eaux ne sont plus dans leur état naturel et ne peuvent plus fournir de services écosystémiques ou alors seulement de façon limitée. Depuis 2011, la politique suisse en matière de protection des eaux vise donc à revaloriser les cours d’eau et les rives lacustres par la délimitation d’un espace réservé aux eaux, la mise en œuvre de mesures de revitalisation et la diminution des atteintes écologiques induites par l’utilisation de la force hydraulique (migration des poissons, effet d’éclusée, charriage). Cette tâche, qui s’effectuera sur plusieurs générations, permettra de revitaliser aussi les zones alluviales. Le but est de restaurer les processus naturels ou du moins de s’en rapprocher le plus possible en mettant en place assez d’espace pour la dynamique, un régime de charriage adéquat et un débit suffisant. Lors du renouvellement des concessions hydroélectriques, les besoins spécifiques des zones alluviales doivent être analysés et pris en compte de manière optimale, notamment au moment de déterminer les débits résiduels adéquats.
Les assainissements dans les zones alluviales ont certes un prix, mais ils représentent un investissement rentable, car les mesures de valorisation y ont généralement un effet écologique rapide (OFEV 2020). En outre, celles-ci génèrent un gain direct d’attractivité pour les loisirs de proximité et le tourisme. Dans la région densément bâtie du Plateau, les zones alluviales sont des espaces de détente et d’habitat très précieux ; à cet égard, il est primordial de mettre en place une bonne gestion des visiteurs (p. 57). En ce qui concerne la protection naturelle contre les crues, toutes les synergies devraient être bien coordonnées et exploitées de manière optimale.
Intégrer les bassins versants
Une gestion intégrale des eaux suppose que les zones alluviales soient prises en compte dans le contexte de l’ensemble du bassin versant. La connexion des zones alluviales entre elles et avec leur environnement est indispensable au maintien des espèces typiques de ces milieux.
Pour mener à bien ces tâches, une attention particulière doit être accordée à la bonne collaboration entre les différents intervenants. Diverses mesures d’assainissement nécessitent des processus participatifs et dépendent d’un bon travail de relations publiques.
Exemples d’assainissements réussis et de créations de zones alluviales
Un espace façonné par la nature
La zone alluviale au bord de la Bünz s’est formée d’elle-même, quasiment du jour au lendemain, en raison d’une crue en mai 1999. La rivière a débordé et a façonné son lit en un paysage alluvial à forte dynamique morphologique. Le canton, les communes riveraines et les propriétaires fonciers ont convenu de conserver cette zone alluviale par un remaniement parcellaire et des mesures destinées à extensifier l’exploitation. Depuis, la zone alluviale a pu évoluer librement et s’est modifiée à plusieurs reprises par suite de crues. Avec sa mosaïque de petits milieux, la zone alluviale de la Bünz offre des conditions idéales pour les carabidés et les orthoptères. Un relevé réalisé en 2009/2010 a permis de trouver 81 espèces de carabes, dont l’omophron bordé (Omophron limbatum), dont la présence en Argovie avait été attestée pour la dernière fois en 1950. En outre, quatorze espèces d’orthoptères ont été recensées, dont le rare oedipode aigue-marine (Sphingonotus caerulans).

Dans la zone alluviale d’Eggrank-Thurspitz, les derniers 5 km de la Thur ont été revitalisés jusqu’à son embouchure dans le Rhin entre 2008 et 2017. En aval de l’Eggrank, un lieu où la rivière dessine un coude marqué, les ouvrages de stabilisation des berges ont été démantelés et des anciens bras morts, réactivés. Tandis que la zone alluviale a été revalorisée pour la nature, la protection des surfaces agricoles des environs a été améliorée et diverses offres pour les loisirs de proximité ont été mises en place. Au cours des prochaines années, la Thur pourra évoluer grâce à sa dynamique propre et poursuivre sa revitalisation.
Thurspitz (ZH), en 2002 et 2016


Thur (ZH) revitalisée, aujourd’hui

La zone alluviale de Rietheim est située le long du Koblenzer Laufen, un tronçon assez long où le Rhin coule librement. Grâce à l’achat de terrains, la zone du « Chly Rhy » a pu être largement remaniée (curage d’un bras latéral, suppression de plantations de peupliers, rétablissement d’îlots dans la zone de l’embouchure et aménagement d’étangs alimentés par les eaux souterraines). En outre, l’exploitation des surfaces agricoles attenantes a été extensifiée. L’eau peut ainsi à nouveau s’écouler à travers la zone et la façonner. La surface sert à nouveau d’habitat et d’élément de connexion pour diverses espèces alluviales. Des chemins et des postes d’observation ont été aménagés pour les personnes en quête de détente.
La revitalisation du site de Rietheim inclut la mise en place d’un espace de détente et d’un système de gestion des visiteurs, Zurzach (AG)



Fossés de tourbage inondés à Spitzmäder (SG)
6.1 Caractéristiques
Les amphibiens comptent parmi les groupes d’espèces les plus menacés. La plupart des espèces dépendent de plans d’eau calmes pour leur reproduction. Or ces habitats sont sans doute ceux qui ont le plus souffert de la transformation du paysage au cours des 150 dernières années. L’inventaire des sites de reproduction de batraciens d’importance nationale doit protéger durablement un réseau comprenant les meilleurs sites de reproduction, milieux essentiels pour la survie à long terme de ces animaux.
Les exigences posées aux milieux aquatiques de reproduction varient cependant énormément. Ainsi, certaines espèces utilisent de préférence les mares qui s’assèchent en été, alors que d’autres privilégient les rives de grands lacs et d’autres encore déposent leurs larves dans des ruisseaux. Les sites de reproduction de batraciens inscrits dans l’inventaire reflètent cette diversité (fig. 35)
Importance nationale
Un objet est jugé d’importance nationale lorsqu’il atteint une valeur seuil déterminée pour la région biogéographique. Une importance particulière est accordée à la présence
d’espèces très menacées, mais ce critère ne suffit pas pour une inscription dans l’inventaire. Le nombre d’espèces et la taille de la population des espèces menacées sont aussi déterminants pour le calcul de la valeur seuil (Pellet et al. 2012). Dans les Alpes, les objets pauvres en espèces qui jouent un rôle important dans le réseau ont aussi été inscrits dans l’inventaire.
Comme pour les autres inventaires fédéraux, les objets de l’inventaire sont désignés par des coordonnées géographiques avec, le plus souvent, un périmètre de protection déterminé. Dans ces objets fixes, la position du plan d’eau de reproduction reste inchangée pendant des décennies. Le périmètre de protection est souvent divisé en deux secteurs :
• le secteur A englobe les plans d’eau de reproduction et les habitats terrestres attenants ;
le secteur B protège des zones situées à l’écart du plan d’eau de reproduction qui sont importantes pour les amphibiens (p. ex. des habitats terrestres plus éloignés comme des forêts ou des corridors de migration). En outre, le secteur B sert aussi de zone-tampon et protège les milieux de reproduction contre des influences indésirables (OBat, Ryser 2002).
Répartition des objets de l’inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens

Les espèces d’amphibiens pionnières comme le crapaud calamite ou le sonneur à ventre jaune sont dépendantes de milieux naturels présentant une forte dynamique temporelle et spatiale. Aujourd’hui, ce type de milieu naturel ne se rencontre presque plus que dans les sites d’extraction comme les gravières. Pour cette raison, environ 10 % des objets de l’inventaire sont ce que l’on appelle des objets itinérants : dans ce cas, c’est le site d’extraction qui est considéré comme milieu naturel digne de protection. Comme l’emplacement des plans d’eau de reproduction se modifie au fil de l’exploitation et que l’excavation elle-même peut « se déplacer » au cours du temps, le site est désigné seulement par ses coordonnées centrales sans périmètre de protection fixe (OBat, Ryser 2002).
Types de plans d’eau de reproduction
Les amphibiens ont colonisé de nombreux milieux naturels qui sont liés aux activités humaines et qui constituent aujourd’hui de précieux habitats de substitution (fig. 36) À l’origine, les vastes milieux occupés par les amphibiens se trouvaient dans la zone d’inondation des lacs et des grands cours d’eau du Plateau. La régulation des niveaux de l’eau a entraîné la perte de ces habitats temporairement inondés. En outre, de vastes zones humides ont disparu par suite de l’intensification de l’utilisation du sol (Lachat et al. 2010). Leurs habitats originels n’existant plus, de nombreuses espèces ont dû se rabattre sur des habitats secondaires créés par l’être humain.
Beaucoup d’espèces pionnières ont trouvé, dans les sites d’extraction telles que les gravières, les glaisières et les carrières, exactement les conditions qu’elles ne trouvent plus dans les cours d’eau régulés, à savoir un déplacement fréquent et important de matériaux, qui empêche durablement que la végétation se développe sur le sol nu, et des mares temporaires peu profondes qui se reforment sans cesse et sont par conséquent exemptes de prédateurs pour les têtards. En Suisse, 41 % des présences connues de crapauds calamites et un tiers de celles de sonneurs à ventre jaune se trouvent dans des sites d’extraction. Presque un cinquième des objets de l’inventaire sont des sites d’extraction de matériaux.
Les places d’armes de l’armée comptent aussi parmi les objets de l’inventaire les plus riches en espèces. Il s’agit en effet de vastes espaces naturels utilisés de façon peu intensive, dans lesquels la circulation de véhicules lourds –comparable à des « événements extrêmes » relativement rares – tasse le sol et crée des plans d’eau de reproduction temporaires. Tandis que les pistes de tanks offrent aux espèces pionnières comme le crapaud calamite ou le sonneur à ventre jaune les milieux dont elles ont besoin, les prairies et les pâturages, souvent exploités extensivement, constituent, avec leurs haies et leurs zones boisées, des milieux plus matures idéaux pour le triton crêté, la rainette verte, le crapaud commun et la grenouille rousse.
Les amphibiens utilisent des types de plans d’eau très différents
Plan d’eau pionnier temporaire à Stetten (SH)

Beratungsstelle
Plan d’eau temporaire avec végétation avancée à Möhlin (AG)

Plan d’eau de reproduction permanent à Gunzgen et Boningen (SO)

Beaucoup d’exploitants de gravières et de responsables de places d’armes s’efforcent activement de maintenir et de développer les milieux naturels des amphibiens. À cet égard, l’évolution des exigences en matière d’exploitation et de remise en culture constitue un défi complexe à relever (voir point 6.4).
Les bassins d’incendie, autrefois très fréquents (fig. 37), sont utilisés comme plans d’eau de reproduction par plusieurs espèces comme le triton alpestre, la salamandre tachetée, la grenouille rousse et le crapaud commun. Ces bassins doivent régulièrement être pompés et curés. Effectué à intervalles de quelques années, cet entretien convient surtout au crapaud accoucheur, puisque tous les prédateurs des têtards sont éliminés, ce qui offre à l’espèce des conditions parfaites pour sa reproduction. Aujourd’hui, de nombreux bassins d’incendie sont devenus superflus et sont soit supprimés soit laissés à l’abandon, perdant ainsi leur valeur pour le crapaud accoucheur.
L’inventaire comprend aussi d’anciennes installations de pisciculture (fig. 37). Dans certains cas rares, une végétation riveraine bien développée permet la coexistence de poissons et de larves d’amphibiens. Les étangs destinés à l’élevage de carpes, dont l’eau est vidée au moment de la pêche et qui restent secs jusqu’à l’apport d’une nouvelle population d’alevins, offrent aussi par période des conditions attrayantes pour la reproduction des amphibiens.
Le secteur B des objets peut comporter des pâturages ou des terres arables exploitées intensivement. Ces milieux, qui semblent a priori peu dignes de protection, sont en général inclus dans l’objet lorsqu’ils constituent des corridors de migration qui doivent être protégés contre la construction ou la fragmentation. Ils peuvent aussi être inscrits à titre d’éléments d’une zone-tampon trophique en périphérie ou à titre d’habitat terrestre pour des espèces comme le crapaud calamite dans les terres assolées (fig. 37 ; Schweizer 2014) ou comme le crapaud accoucheur dans les pâturages riches en cachettes telles que des trous de souris.
Quelque 14 000 plans d’eau de reproduction d’amphibiens sont connus en Suisse. L’inventaire des sites de reproduction de batraciens d’importance nationale protège les sites les plus précieux dans toutes les régions de Suisse à titre d’aires de distribution principales et de centres de dispersion des amphibiens. Il comprend 929 objets pour une superficie totale de 21 671 ha (tab. 7). Les objets de l’inventaire couvrent environ 0,52 % du territoire national.
Le nombre d’espèces d’amphibiens varie selon les différentes régions géographiques de la Suisse. Dans les Alpes, les étangs sont moins nombreux que sur le Plateau en raison de la topographie ; de plus, la saison de reproduction en montagne
Fig. 36 : Les amphibiens pionniers ont besoin d’une dynamique sous la forme d’« événements extrêmes » récurrents
Autrefois, les crues modifiaient les zones alluviales des cours d’eau et créaient des plans d’eau de reproduction dynamiques.
Aujourd’hui, ce sont les excavatrices dans les gravières… … ou les tanks sur les places d’armes qui créent ce type de dynamique.



Tab. 7 : Nombre d’objets et surface dans l’inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens État de la révision de janvier 2021. La surface des objets itinérants est extrapolée (rayon de 53 m).
Type
Objets fixes (secteurs A)
Objets fixes (secteurs B)
Objets itinérants
Base de données : données sur les biotopes OFEV 2023
est trop courte pour beaucoup d’espèces, ce qui fait que leur diversité diminue avec l’altitude. C’est sur le Plateau, où vivent la plupart des espèces, que la densité des objets est la plus élevée (carte p. 61). Le Tessin possède un nombre d’objets supérieur à la moyenne, car beaucoup d’espèces qui y vivent sont très menacées. Près d’un tiers des surfaces recouvrent celles d’autres inventaires de biotopes d’importance nationale, principalement des bas-marais et des zones alluviales.
L’inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens est le seul inventaire national qui a pour but de protéger un groupe d’espèces et non un milieu naturel donné (p. 66, fig. 39).
Toutes les espèces d’amphibiens appartiennent aux espèces prioritaires au niveau national à l’exception de la grenouille rousse, du triton alpestre et du complexe des grenouilles vertes.
La part de la population d’espèces données vivant dans des objets de l’inventaire fédéral illustre l’importance que ces objets revêtent pour la protection des espèces. Par exemple, la rainette italienne, une espèce très menacée, est présente presque exclusivement dans des surfaces de l’inventaire (80 % des occurrences). Dans le cas de la grenouille rousse, largement répandue, la probabilité d’en rencontrer est la même à l’intérieur qu’à l’extérieur des objets de l’inventaire, mais les populations de très grande taille sont deux fois plus fréquentes dans les objets d’importance nationale. Les très grandes populations de tritons crêtés italiens se trouvent même seulement dans les objets de l’inventaire. Ceux-ci sont donc des centres importants de dispersion des espèces.
Les milieux naturels de vaste étendue jouent à cet égard un rôle central. Alors que la superficie médiane des objets d’importance nationale (secteurs A et B) est d’environ 12 ha, une population de crapauds calamites a besoin par exemple de 10 à 16 ha de surface rudérale et d’étangs pionniers pour survivre à long terme (Schmidt 2006). Une population de crapauds communs vivant dans une zone alluviale de cours d’eau a besoin, quant à elle, d’un habitat terrestre d’environ 60 ha avec beaucoup de bois mort pour se maintenir à long terme (Indermaur et Schmidt 2011).
Milieux à amphibiens étroitement liés à l’être humain et à la production d’aliments
Bassin d’incendie dans l’Emmental abritant des crapauds accoucheurs

Étang à carpes exploité de façon proche de l’état naturel sur le Plateau

Crapaud calamite dans un champ

Évolution de la diversité des espèces
Beaucoup d’espèces cibles des sites de reproduction de batraciens ont disparu (fig. 38). En moyenne, chaque objet a vu disparaître une espèce d’amphibien en dix ans (Bergamini et al. 2019). Les pertes concernent en particulier les espèces tributaires de plans d’eau temporaires (p. ex. le sonneur à ventre jaune, le crapaud calamite), mais aussi le triton crêté ou le triton lobé. Ce recul est dû au manque de plans d’eau présentant un niveau d’eau adéquat au moment approprié (hydropériode) : soit le plan d’eau est en eau de manière permanente et il n’est donc pas approprié pour ces espèces, soit il s’assèche trop tôt en raison des conditions météorologiques de plus en plus sèches au printemps et en été.
Évolution de la qualité des milieux
Les espèces d’amphibiens pionnières (sonneur à ventre jaune, crapaud calamite, crapaud accoucheur) ont besoin, en plus de plans d’eau à des stades de succession précoces, de vastes surfaces de sol nu. Des lieux de refuge pour
les périodes sèches comme des tas de branches ou de pierres et des haies sont aussi indispensables. Les tritons, la rainette verte et la grenouille agile se reproduisent dans des plans d’eau un peu plus matures. Ces espèces ont aussi besoin d’un bon ensoleillement et de plans d’eau temporaires ainsi que d’habitats terrestres bien structurés.
L’analyse des vues aériennes du WBS montre que les surfaces boisées et les surfaces de sol nu ont en moyenne diminué dans les objets au cours des 20 dernières années, alors que les surfaces d’eau ont augmenté. Si l’augmentation des plans d’eau est à coup sûr une évolution positive, le recul des sols nus pénalise les espèces pionnières.
Les amphibiens généralistes (crapaud commun, grenouille rousse, triton alpestre) sont moins exigeants en matière de plans d’eau, pour autant que ceux-ci n’abritent pas de poissons. Ils ont aussi besoin d’habitats terrestres bien structurés et de forêts riches en bois mort couché. Ces espèces parcourent souvent de longues distances entre les habitats terrestres et les plans d’eau de reproduction, raison pour laquelle les corridors de migration doivent être pris en considération dans le périmètre de protection.
Fig. 38 : Évolution de la diversité des espèces dans les sites de reproduction de batraciens d’importance nationale entre l’inscription dans l’inventaire (avant 2001) et la première phase du WBS (2011 à 2017)
La barre « OBat » montre la diversité moyenne des espèces avant l’inscription d’un objet dans l’inventaire (depuis les années 1980 jusqu’à 2001).
La barre « WBS » montre la diversité moyenne des espèces pendant la première phase du WBS, entre 2011 et 2017.
Nouvelles découvertes Espèces connues Nombre d’espèces par objet ± 1SE
Source : WBS, Bergamini et al. 2019a 0 3 2 1 4 5 6 7
Toutes les espèces Espèces très menacées Espèces tributaires de plans d’eau temporaires
Fig. 39 : Espèces d’amphibiens de Suisse avec leur statut selon la liste rouge correspondante
Salamandre noire
Salamandra atra Non menacée (LC)

Triton crêté
Triturus cristatus En danger (EN)

Crapaud commun Bufo bufo Non menacée (LC)

Rainette italienne Hyla intermedia En danger (EN)

Grenouille de Lataste Rana latastei Vulnérable (VU)

Salamandre tachetée
Salamandra salamandra Vulnérable (VU)

Triton lobé ou ponctué Lissotriton vulgaris En danger (EN)

Crapaud accoucheur Alytes obstetricans Vulnérable (VU)

Complexe Grenouilles vertes Pelophylax spp. Vulnérable (VU)

Grenouille agile Rana dalmatina En danger (EN)

Triton alpestre Ichthyosaura alpestris Non menacée (LC)

Triton crêté italien Triturus carnifex En danger (EN)

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata Vulnérable (VU)

Rainette verte Hyla arborea Vulnérable (VU)

Triton palmé Lissotriton helveticus Vulnérable (VU)

Crapaud calamite Epidalea calamita En danger (EN)

Grenouille rousse Rana temporaria Non menacée (LC)

La présence de poissons dans un plan d’eau de reproduction entraîne un recul des populations d’amphibiens (Schmidt 2007). À l’état naturel, la plupart des milieux aquatiques utilisés par les amphibiens ne comportent pas de poissons. L’apport artificiel de poissons, qu’il s’agisse de poissons rouges provenant d’un aquarium ou de truites dans un lac de montagne, porte donc fortement atteinte aux plans d’eau à amphibiens.
Sur les sites d’extraction de matériaux, le rythme toujours plus élevé d’extraction et de remblayage menace les habitats des amphibiens. Au cours des 20 dernières années, la surface nue inutilisée à l’intérieur des périmètres d’extraction a diminué d’environ un tiers en moyenne. Les bassins de décantation disparaîtront bientôt presque entièrement des sites, car ils peuvent aujourd’hui être remplacés par des cycles de traitement de l’eau qui exigent moins d’espace et ne constituent donc plus que des « volumes vides » indésirables. La remise en culture des zones ouvertes a lieu désormais un ou deux ans plus tôt qu’au début de ce siècle.
Les amphibiens allochtones représentent aussi un problème. L’introduction sur le versant nord des Alpes du triton crêté italien, qui ne vivait à l’origine que sur le versant sud des Alpes, ou la dispersion de grenouilles rieuses provenant d’Europe de l’Est constituent une menace pour les espèces indigènes, que ce soit sous forme de concurrence, de prédation ou de réservoir de maladies. Là où elle est encore possible, la lutte contre ces espèces est très coûteuse et demande énormément de temps.
Les perturbations et les atteintes susmentionnées ne diminueront pas au cours des prochaines années. Dans le cadre de la protection des amphibiens, on essaie de faire face à ces tendances négatives en appliquant de nombreuses mesures et, dans certains cas, de nouveaux instruments. Un monitoring à long terme a montré que la création massive de nouveaux milieux naturels connectés permet d’augmenter des populations qui étaient en déclin. Dans le canton d’Argovie, la création de centaines d’étangs et de mares entre 1991 et 2019 a permis d’augmenter 63 % des 43 métapopulations étudiées et d’en stabiliser 14 % (Moor et al. 2022).
Se fondant sur la présence des espèces, info fauna – karch et l’équipe du service conseil IBN ont déterminé des zones de conservation prioritaires pour les amphibiens de façon à pouvoir mieux conserver les grandes métapopulations (Pellet et al. 2020, fig. 40). Cette base indique où il est possible d’atteindre, pour la conservation des amphibiens, le meilleur rapport coût-utilité.
Agir ensemble
En ce qui concerne la gestion des milieux naturels dans les sites d’extraction, les groupes d’accompagnement composés des exploitants, de représentants du canton et d’ONG ont donné de bons résultats. Des réunions régulières permettent de définir les mesures de promotion des espèces au cours de l’extraction de façon à ce qu’il y ait constamment assez d’habitats pour les amphibiens sur le site. Comme des machines lourdes sont déjà sur place, les mesures sont facilement réalisables et peu onéreuses.
Pâturer pour éviter l’embroussaillement
Du fait de l’augmentation des apports azotés atmosphériques, la gestion des biotopes rudéraux devient plus complexe et plus coûteuse. Entretenir ce type d’objet pour les garder dans un état idéal pour les amphibiens
Fig. 40 : Zones de conservation prioritaires pour les amphibiens
Les points utilisés pour indiquer les sites ne sont pas à l’échelle. La priorisation se base sur le nombre d’espèces très menacées par km2 et le nombre de très grandes populations d’espèces très menacées.
Nombre d’espèces menacées par km2 1 2 3 4 5 6 7

pionniers constitue une tâche onéreuse. Pour cette raison, plusieurs cantons mènent des essais de pâture avec des races d’animaux de rente peu exigeantes en vue de garder les surfaces ouvertes (fig. 41)
Améliorer la mise en réseau
Le recul continuel de la plupart des espèces d’amphibiens dans presque toutes les régions de Suisse montre que la mise en réseau de leurs habitats ne suffit actuellement pas pour leur préservation (Schmidt et al. 2023). La mise en place d’un réseau de surfaces de haute qualité écologique représente donc une très bonne occasion pour soutenir les populations d’amphibiens.
Plus une surface de qualité écologique élevée est grande, plus les populations sont importantes. Partant de ce constat, le service conseil IBN a cartographié les milieux naturels présents dans les objets de l’inventaire et les a mis en relation avec les données sur la présence d’amphibiens (Siffert et al. 2022). Cette étude fournit des indications précises sur les surfaces et les milieux spécifiques dont une espèce donnée a besoin pour atteindre une certaine taille de population. Ces indications permettront à l’avenir de définir des surfaces minimales et des états optimaux pour les milieux des espèces concernées.
Fig. 41 : Pâture de sites de reproduction de batraciens
Il est important de créer de nouveaux sites de reproduction à proximité des populations connues. Dans l’idéal, un nouveau site de reproduction comprend plusieurs plans d’eau avec différentes hydropériodes et des habitats terrestres diversifiés. D’ordinaire, les espèces courantes comme le triton alpestre, la grenouille rousse et éventuellement le crapaud commun occupent rapidement le nouveau site. Si le site abrite suffisamment de plans d’eau temporaires et d’habitats pionniers, on peut aussi espérer que des espèces très menacées comme le sonneur à ventre jaune, le triton crêté ou la rainette verte le colonisent.
Il est ensuite nécessaire de mettre en place un entretien ciblé et à long terme du nouveau site (p. 69). Les milieux pionniers doivent régulièrement être ramenés au stade initial de la succession – mécaniquement ou par la pâture – et les plans d’eau temporaires doivent être vidangés chaque année et débarrassés de leur végétation. Dans le meilleur des cas, un nombre suffisant d’espèces d’amphibiens viendront ainsi coloniser le nouveau site au fil des ans et développer de grandes populations de façon à ce que celui-ci acquiert une importance nationale.
Les surfaces peuvent être gardées ouvertes en y faisant pâturer des animaux de rente ; dans ce cas, il faut tenir compte non seulement des besoins des amphibiens mais aussi de ceux du bétail.


Exemples d’assainissement et de création réussis de sites de reproduction de batraciens
Des étangs pouvant être vidangés
Les surfaces rudérales et les mares temporaires de l’ancienne gravière de Mettlen (BE) sont aujourd’hui un paradis pour le crapaud calamite et le sonneur à ventre jaune. La gravière désaffectée a été inscrite dans l’inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens après la remise en culture en raison de la présence de très nombreux crapauds calamites. Les étangs étanchéifiés avec de la glaise et du béton sont régulièrement vidangés et réaménagés mécaniquement. Des vaches Galloway et Highland paissent sur le site pour le garder ouvert et contenir la végétation.

L’objet de Spitzmäder, situé dans la partie saint-galloise de la vallée du Rhin, est un ancien site d’extraction de la tourbe qui n’est plus utilisé et qui est géré depuis les années 1990 par l’association Pro Riet à titre d’espace naturel protégé. La gestion, respectueuse de la nature, qui inclut l’inondation de surfaces à litière pendant le semestre d’été et l’entretien des anciennes surfaces d’exploitation de la tourbe, est intervenue trop tardivement pour la rainette verte, qui a disparu de la vallée du Rhin. En revanche, le triton crêté, le triton lobé, les espèces d’amphibiens courantes ainsi que de nombreux insectes, plantes, oiseaux et mammifères profitent des zones de marais.


7.1 Caractéristiques
Les herbages riches en espèces sur stations maigres (pauvres en nutriments) et sèches ou à sécheresse variable sont le plus souvent le résultat de l’exploitation agricole traditionnelle et constituent un bien culturel majeur de la Suisse. Choisi pour représenter de façon concise toute la variété des différents types de végétation, le nom donné à l’inventaire fédéral – « Prairies et pâturages secs » –réunit sous une même dénomination les associations herbagères sèches et maigres les plus précieuses sur le plan écologique.
La présence et l’expression des prairies et pâturages secs sont directement influencées par les facteurs stationnels naturels, principalement par le sous-sol géologique, les propriétés pédologiques, le relief et le climat. Les prairies et pâturages secs se caractérisent par leur sécheresse intermittente et surtout par leur pauvreté en nutriments. Les conditions suivantes favorisent leur présence : un sous-sol perméable, une exposition au sud, peu de précipitations et une faible humidité de l’air (p. ex. exposition au foehn, climat continental).
Répartition des prairies et pâturages secs d’importance nationale
Importance nationale
Les objets de l’inventaire fédéral des prairies et pâturages secs ont été relevés à l’aide d’une clé de cartographie spécifiquement élaborée à cet effet dans les années 1990 (Eggenberg et al. 2001). La taille minimale des surfaces a été adaptée selon la région : sur le Plateau, la superficie minimale est aujourd’hui de 30 ares ; en région d’estivage, elle est de 200 ares.
Pour savoir si une surface peut potentiellement être un objet de l’inventaire, les experts examinent si elle satisfait aux critères de ce que l’on appelle une « clé des seuils ». Un critère central est la présence d’espèces indicatrices floristiques :
• au minimum six espèces indicatrices des pelouses sèches, des prairies mésophiles, des nardaies, des pelouses à seslérie, des pelouses à carex ferrugineux ou des pelouses à fétuque paniculée sont présentes par surface de 25 m2, ou
• les espèces indicatrices représentent au moins 50 % de la couverture végétale de la surface. Les prairies humides et les prairies grasses riches en espèces (notamment les prairies à fromental) sont aussi prises en considération dans l’inventaire à condition de présenter suffisamment d’indicateurs de sécheresse.

Dans l’inventaire, 19 groupements végétaux combinant au total plus de 350 types de végétation différents ont été distingués.
Prairie mésophile (Mesobromion)
Les prairies mésophiles sont les surfaces de l’inventaire les plus représentées à l’échelle suisse, avec des espèces caractéristiques telles que la sauge des prés (Salvia pratensis), le brome dressé (Bromus erectus), le thym serpolet (Thymus serpyllum aggr.) ou l’hélianthème nummulaire (Helianthemum nummularium)
Photo : Puidoux (VD)
© Gaby Volkart/atena

Pelouse sèche (Xerobromion)
Les pelouses sèches caractéristiques abritent un nombre particulièrement élevé d’espèces dignes de protection. Devenues rares, elles ne se rencontrent aujourd’hui que sur les sols peu profonds. Les espèces caractéristiques sont notamment la vipérine commune (Echium vulgare), l’aspérule des collines (Asperula cynanchica) et la globulaire allongée (Globularia bisnagarica, comme sur l’image ci-contre).
Photo : Près de Genève
© Gaby Volkart/atena

Association d’ourlets séchards (Origanetalia)
Les prairies et pâturages secs fauchés moins souvent ou tardivement abritent des plantes des ourlets comme le trèfle pourpre (Trifolium rubens), visible sur l’image, ou le laser à larges feuilles (Laserpitium latifolium) et le laser siler (L. siler) et souvent aussi l’origan (Origanum vulgare), qui donne son nom au groupement.
Photo : Urnerboden (UR)
© Monika Martin/oekoskop




Pelouse à carex ferrugineux (Caricion ferruginae)
Les pelouses escarpées à carex ferrugineux situées en altitude fournissaient du foin à l’agriculture de montagne. Aujourd’hui, ces surfaces sont encore fauchées surtout en Suisse centrale et dans le canton de Berne. En Suisse romande, elles sont le plus souvent pâturées. L’image montre une prairie avec de nombreuses campanules en thyrse (Campanula thyrsoides)
Photo : Urserental (UR)
© Guido Masé/oekoskop
Pelouse à seslérie (Seslerion)
Les pelouses à seslérie croissent sur les sols peu profonds et sont souvent riches en fleurs. On peut voir sur l’image la grande gentiane calcicole (Gentiana clusii), la globulaire à feuilles en cœur (Globularia cordifolia) et la seslérie bleuâtre (Sesleria caerulea), qui donne son nom au groupement.
Au-dessus de Bex (VD)
© Monika Martin/oekoskop
Nardaie riche en espèces (Nardion)
L’inventaire fédéral des prairies et pâturages secs ne comprend que les nardaies qui présentent une diversité d’espèces particulièrement élevée. La photo montre un objet avec de nombreux arnicas (Arnica montana) et orchis moucherons (Gymnadenia conopsea)
Photo : Rauft Gurtnellen (UR)
© Monika Martin/oekoskop
Fig. 42 : Part de surface des groupements végétaux dans l’inventaire fédéral des prairies et pâturages secs
Pelouse à seslérie du Sud des Alpes (0,1%)
Pelouse sèche subcontinentale (0,3%)
Pelouse à fétuque paniculée (0,5%)
Végétation sèche des ourlets (0,9%)
Pelouse sèche subatlantique (1,1%)
Pelouse sèche de basse altitude pauvre en espèces (1,2%)
végétal
Groupement
Prairie mésophile steppique (1,8%)
Végétation indéterminée (2,1%)
Pelouse sèche semi-rudérale (2,7%)
Pelouse sèche d’altitude pauvre en espèces (2,9%)
Prairie mésophile avec indicateurs de sécheresse (3,8%) Nardaie (3,2%)
Pelouse sèche de type steppique (6%)
Prairie grasse sèche riche en espèces (6,5%)
Pelouse à carex ferrugineux (7,7%)
Pelouse à fétuque bigarrée (10,2%)
Prairie mésophile caractéristique (12%)
Pelouse à seslérie (18,1%)
Prairie mésophile avec indicateurs d’eutrophisation (18,9%)
Base de données : données sur les biotopes OFEV 2023
Comme l’inventaire se concentre sur les prairies et pâturages secs particulièrement menacés et régulièrement exploités, les milieux rocheux (avec moins de 25 % de végétation), les peuplements forestiers presque fermés (degré de recouvrement de la strate arbustive excédant 50 %) et les gazons alpins n’ont pas été relevés. Les surfaces peuvent inclure au maximum 75 % de surface qui ne sont pas des prairies ou pâturages secs (forêt, buissons, zones humides, rochers).
Sur la base de la cartographie, l’importance nationale d’un objet a ensuite été déterminée à l’aide d’une méthode d’évaluation détaillée (Eggenberg et al. 2001). Seuls les prairies et pâturages secs les plus précieux ont été inscrits dans l’inventaire. Il s’agit par exemple d’objets de très grande taille ou recouverts d’une végétation d’une valeur particulière et dotés d’éléments structurels. Ainsi, en plus des objets d’importance nationale, il existe d’autres prairies maigres fleuries de grande valeur qui sont connues et protégées à l’échelon cantonal ou communal.
Certaines stations sèches qui présentent une particularité unique ont également été identifiées. Ces cas spéciaux sont appelés des « singularités ». Ils se distinguent par la
Part (%) de la surface totale dans l’inventaire PPS
présence d’espèces menacées particulièrement nombreuses ou très spécifiques ou par un mode d’exploitation spécial ou représentent un élément paysager caractéristique. Les surfaces de ce type peuvent être inscrites dans l’inventaire à titre de singularité même si elles ne remplissent pas tous les critères de la méthode de cartographie.
Certains groupements végétaux sont rares (pelouse sèche subatlantique) ou présents seulement régionalement (pelouse sèche subcontinentale, pelouse à fétuque paniculée, pelouse à seslérie du sud des Alpes) (fig. 42) Les prairies et pâturages secs peuvent se présenter aussi sous une autre forme qu’une prairie ou un pâturage ouvert, par exemple sous forme de forêt clairsemée, de pâturage boisé ou de mosaïque d’habitats associée à des marais.
Aux étages collinéen (jusqu’à env. 600 m) et montagnard (600 à 1200 m), les gradients de nutriments et d’humidité jouent un rôle déterminant dans la différenciation de la végétation : les pelouses steppiques et les pelouses extrêmement sèches se situent à une extrémité de l’échelle, tandis que les prairies grasses riches en espèces se situent à l’autre extrémité. Aux étages subalpin et alpin, la végétation dépend en outre fortement du taux d’acidité
du sol : la nardaie et la pelouse à fétuque paniculée sur roches siliceuses acides représentent l’un des deux pôles, l’autre étant formé par les pelouses à seslérie sur roches calcaires (Eggenberg et al. 2001).
Exploitation
Les 28 281 ha de prairies et pâturages secs d’importance nationale sont exploités par plus de 15 000 exploitations agricoles. La majeure partie est pâturée (64 %) et seulement 24 % environ sont encore fauchés ; 12 % des surfaces sont recensées comme friche (surfaces non utilisées) (fig. 43). Au cours des dernières décennies, le travail d’entretien, considérable, a amené beaucoup d’agriculteurs à faire pâturer des bovins et des moutons dans leurs prairies sèches. Dans de nombreuses régions, la conservation des prairies de fauche restantes avec leur composition d’espèces très spécifique est devenue par conséquent une priorité.
Les exigences en matière d’exploitation des prairies et pâturages secs sont réglées dans l’aide à l’exécution et dans
Fig. 43 : Répartition des surfaces de prairies et pâturages secs selon l’exploitation
Total 28 281 ha
Pâturage chevalin (1,8 %)
Pâturage caprin (0,2 %)
Pâturage ovin (9,2 %)
Autre pâturage permanent (4,4 %)
Autre exploitation (0,2 %)
plusieurs fiches techniques (Dipner, Volkart et al. 2010). Les principes les plus importants à cet égard sont les suivants : pas de fumure (un affourragement complémentaire est donc également exclu), pas d’irrigation et pas d’épandage de produits phytosanitaires.
Prairies sèches
Les prairies sèches sont fauchées une ou deux fois par an selon la station et parfois pâturées par des bovins en automne (cf. Dipner, Volkart et al. 2010 ainsi que Jöhl et Dipner 2019).
Les plantes de relativement grande taille qui supportent bien la fauche ont les meilleures chances de survie, ce qui explique pourquoi les espèces-clés, comme la sauge des prés (Salvia pratensis), l’avoine pubescente (Helictotrichon pubescens), l’esparcette commune (Onobrychis viciifolia) ou la campanule agglomérée (Campanula glomerata), se rencontrent nettement plus fréquemment dans les prairies que dans les pâturages.
Une forme particulière d’exploitation des prairies est la pâture précoce avant la fauche, dans laquelle la prairie sèche est utilisée pour un court pacage de printemps avant la montée à l’alpage. Ces surfaces sont ensuite fauchées à la fin de l’été, en règle générale plus tard que la fauche normale.
de
Pâturage bovin (47,5 %)
Prairie de fauche ou pâturage fauché (20,7 %)
Friche, pas d’exploitation (12,5 %)
Fanages d’altitude (4,1 %)
La forme la plus spectaculaire d’exploitation des prairies est sans doute celle de la récolte de foin des rochers (fig. 44). Appelées fanages d’altitude, les prairies de fauche en région d’estivage sont souvent très escarpées et situées à une hauteur vertigineuse. L’inventaire recense environ 1000 ha de surfaces de fanages d’altitude ; la plupart se trouvent en Suisse centrale et dans le canton de Berne. Ces surfaces sont particulièrement menacées par l’abandon de l’exploitation, car la fauche y est risquée et complexe et demande un travail considérable. En règle générale, lorsque les fanages d’altitude ne sont plus exploités, la diversité des espèces diminue.
Pâturages secs
Environ deux tiers des surfaces de prairies et pâturages secs sont utilisés comme pâturages. Le pacage avec des bovins est le plus fréquent (fig. 45). Ce type de bétail convient particulièrement bien, car il s’alimente de manière moins sélective que les moutons et les chèvres et broute de manière plus régulière.
L’abroutissement et le piétinement du bétail créent des trouées et des niches dont sont tributaires une flore et


une faune spécialisées : les pâturages n’ont ainsi rien à envier aux prairies s’agissant du nombre d’espèces. Les plantes typiques des pâturages secs sont épineuses, ont des feuilles en rosette ou produisent des stolons pour se protéger contre l’abroutissement.
Beaucoup de pâturages secs possèdent une variété de structures remarquable, en particulier les pâturages boisés ou les selves de châtaigniers au Tessin. La conservation à long terme de cette diversité – également précieuse sur le plan paysager – exige un investissement important de la part des agriculteurs : sans entretien régulier, la plupart des pâturages extensifs sont envahis par les mauvaises herbes et s’embroussaillent relativement vite (Volkart et al. 2008).
Près de 10 % des surfaces de prairies et pâturages secs sont pâturées par des moutons. Pour qu’elle réponde aux attentes, cette forme d’exploitation est fastidieuse, car les moutons broutent de façon ciblée certaines plantes. Les graminées peuvent ainsi rapidement prédominer sur les pâturages à ovins (Schiess-Bühler et Martin 2008). Les moutons permettent cependant de garder des surfaces de prairies et pâturages secs ouvertes sur les sols peu profonds en forte pente, là où les bovins seraient trop lourds. Les chèvres, elles, apprécient les arbres et les buissons et sont donc utilisées pour le pacage des surfaces embroussaillées.
Quelle que soit le type de bétail, la pâture doit être très extensive. Si un trop grand nombre d’animaux paissent trop longtemps sur la surface, ils détruisent la végétation
caractéristique des pâturages secs en quelques années (Perrenoud et Godat 2006, Schiess-Bühler et Martin 2008, Martin et al. 2007, 2008 et 2018a/b).
7.2 L’inventaire en chiffres
L’inventaire fédéral des prairies et pâturages secs compte 3951 objets pour une surface totale de 28 281 ha (tab. 8) : 44 % d’entre eux sont situés sur la surface agricole utile et 46 % en région d’estivage ; environ 10 % des objets sont des surfaces non exploitées par l’agriculture. Les objets de l’inventaire couvrent 0,68 % du territoire national.
Un peu moins de deux tiers (60 %) des surfaces de prairies et pâturages secs sont situées à l’étage subalpin, à partir d’environ
Tab. 8 : Inventaire fédéral des prairies et pâturages secs d’importance nationale
Nombre d’objets et surface au-dessus et en dessous de la limite d’estivage
et pâturages secs en dehors de la région d’estivage
Prairies et pâturages secs dans la région d’estivage
Base de données : données sur les biotopes OFEV 2023
1500 m d’altitude jusqu’à la limite de la forêt. La plupart des objets se trouvent dans le Jura et les Alpes (carte p. 73). Ils sont inégalement répartis entre les cantons. Les cantons des Grisons, de Vaud, du Valais et de Berne en comptent le plus, ce qui tient notamment à leur taille et à leurs conditions écologiques et topographiques bénéfiques. Les conditions climatiques qui règnent en Valais (climat continental avec peu de précipitations et faible couverture nuageuse, rayonnement solaire intensif et fortes variations de température) sont particulièrement favorables à la formation de précieux prairies et pâturages secs, raison pour laquelle le nombre des surfaces inscrites dans l’inventaire a été limité aux meilleurs complexes.
Les prairies et pâturages secs comptent parmi les milieux naturels les plus riches en espèces de Suisse. Une surface de seulement 1 are peut compter jusqu’à 100 espèces végétales. Une majorité des papillons, des orthoptères, des abeilles sauvages et des escargots indigènes vivent aussi dans les prairies et pâturages secs et en sont en partie fortement tributaires. Des reptiles, des oiseaux et des mammifères profitent également de ces surfaces aux conditions climatiques favorables, riches en structures et exploitées de façon extensive.
Beaucoup d’espèces prioritaires au niveau national vivent dans les prairies et pâturages secs. L’appolon
Fig. 47 : Prairies et pâturages secs d’importance nationale riches en structures et particulièrement précieux sur le plan écologique
En haut : mosaïque d’habitats dans le Chestenweide sur le Rigi (LU)
En bas : précieux buissons épineux dans le Blauenweide (BL)


(Parnassius apollo), l’ascalaphe soufré (Libelloides coccajus), le lézard des souches (Lacerta agilis) et l’orchis bouffon (Orchis morio) y sont des hôtes fréquents (fig. 46)
Fig. 46 : Espèces caractéristiques des prairies et pâturages secs d’importance nationale
Lézard des souches (Lacerta agilis)

Œdipode rouge (Oedipoda germanica)

Orchis bouffon (Orchis morio)

Ascalaphe soufré (Libelloides coccajus)

Fig. 48 : Espèces des prairies et pâturages riches en structures
L’abeille maçonne à poils roux (Megachile parietina) est devenue extrêmement rare dans le nord de la Suisse et est souvent tributaire des prairies et pâturages secs. Elle construit ses nids sur les pierres et les rochers.

La pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) utilise les massifs épineux pour nicher, comme perchoir de chasse et pour stocker ses proies qu’elle empale ou coince sur les épines. Elle trouve ses proies (surtout des gros insectes comme le grillon champêtre) aux endroits sans végétation.

Les structures contribuent de façon déterminante à la valeur écologique d’un objet de l’inventaire (voir encadré). Lors de la cartographie et de l’évaluation, elles sont donc intégrées à titre d’« éléments structurels » lorsqu’elles sont incluses dans l’objet et d’« éléments limitrophes » lorsqu’elles sont situées en limite de ce dernier. Selon la région, les haies, les buissons, les lisières, les murs de pierres sèches, les arbres isolés, les rochers, les zones de source, les dolines notamment peuvent être des éléments caractéristiques du paysage (p. 79, fig. 47). Combinés à la végétation sèche, ces éléments offrent à la faune la mosaïque d’habitats dont elle a besoin (fig. 48)
Les défrichements, surtout ceux réalisés durant le haut Moyen Âge, ont ouvert la couverture forestière de la Suisse et créé un paysage rural varié. Pendant longtemps, les herbages ont été utilisés seulement pour la pâture. L’introduction de la stabulation il y a environ 200 ans a entraîné une augmentation de la fauche pour obtenir le foin nécessaire. Le fumier était principalement épandu sur
Éléments structurels et limitrophes par catégorie
• Structures ligneuses : arbres isolés, buissons, haies, lisières
• Structures minérales : tas d’épierrage, murs de pierres, blocs de rocher, sol nu, ruine, étable
• Structures humides : zones de sources, ruisseaux, zones humides
• Structures végétales : mégaphorbiaies, végétation rudérale, pelouses non utilisées
les terres assolées et les prairies sont restées des milieux maigres (pauvres en nutriments).
Selon les estimations, les sites maigres couvraient vers 1900 une surface de 760 000 ha (Lachat et al. 2010). Au XXe siècle, un recul marqué s’est amorcé, surtout après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Depuis 1900, 95 % des surfaces maigres ont disparu (Lachat et al. 2010). Alors qu’ils étaient autrefois la règle dans le paysage rural, les prairies et pâturages secs riches en espèces sont devenus aujourd’hui l’exception. Sur le Plateau et le versant sud des Alpes, leur recul est même estimé à 99 %.
Quelles sont les principales raisons de cette très forte diminution ? L’utilisation d’engrais chimiques, de lisier et d’aliments pour animaux du commerce ainsi que la mécanisation de l’agriculture (meilleure accessibilité, suppression des structures) ont transformé de nombreuses stations sèches en herbages certes plus productifs mais aussi plus pauvres en espèces. En outre, l’exploitation de sites difficilement accessibles et escarpés a été abandonnée, permettant à la forêt d’occuper les herbages secs riches en espèces. À ces pertes se sont ajoutées celles dues aux infrastructures et aux constructions sur les sites bien ensoleillés à proximité des zones habitées (fig. 49).
La comparaison des inventaires cantonaux des prairies maigres réalisés dans les années 1980 et de l’inventaire fédéral de 2010 montre que de nombreuses surfaces ont encore été bâties à la fin du XXe siècle ou ont fait l’objet d’une exploitation plus intensive. Selon la région, la diminution des stations maigres correspond à une part de 17
à 43 % des surfaces inventoriées par les cantons dans les années 1980 (Eggenberg et al. 2008, Pro Seco 2007).
En outre, les données du WBS montrent que la qualité écologique des prairies et pâturages secs s’est dégradée depuis 1995. Le milieu naturel s’est enrichi en nutriments et est devenu plus dense et plus ombragé. L’apport d’azote par l’air et un embroussaillement accru en maints endroits dû au manque d’entretien des pâturages modifient la composition de la couverture végétale (Bergamini et al. 2020).
Alors que de nombreux projets œuvrent actuellement pour stopper cette tendance négative, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour parvenir à l’inverser et préserver la qualité écologique des prairies et pâturages secs (pp. 82-83).
Préserver les prairies et pâturages secs non exploités
Les friches qui abritent des espèces rares n’ont pas toujours besoin d’une exploitation régulière. À haute altitude, certaines friches se maintiennent parfaitement sans intervention humaine ; en dessous de la limite de la forêt, une exploitation extensive est par contre indispensable pour éviter le reboisement. Le changement structurel dans l’agriculture fait que bon nombre de surfaces de prairies et pâturages secs ne sont plus exploitées de façon
traditionnelle par les agriculteurs. L’engagement d’entreprises paysagistes et les travaux d’entretien effectués par des chasseurs, des entreprises forestières ou des groupes d’écoliers, de civilistes ou de bénévoles sont autant de solutions de remplacement pour maintenir l’exploitation.
Sur les stations sèches qui s’embroussaillent, les chèvres, qui mangent volontiers les ligneux et empêchent leur propagation, peuvent se révéler très efficaces. D’autres animaux plus exotiques comme le zébu nain, la vache Highland ou le yack sont aussi utilisés dans certains cas pour la pâture.
Créer de nouvelles prairies sèches et de nouveaux pâturages secs
La première chose à faire est de protéger les prairies et pâturages secs existants qui ne le sont pas encore : les gazons alpins riches en espèces, les prairies et pâturages secs situés à haute altitude ou les surfaces résiduelles sur le Plateau. La création de prairies et pâturages secs représente aussi une mesure importante pour compléter le réseau des milieux secs. Les sols bruts (p. ex. sur des talus ferroviaires et routiers), les sols peu profonds très caillouteux et les forêts clairsemées xérothermophiles abritant déjà une végétation sèche conviennent bien pour la création de prairies et pâturages secs. L’apport de foin et de semences provenant de telles surfaces proches permet d’introduire des espèces typiques. Les prairies fleuries colorées et la riche faune qu’elles abritent font le bonheur des personnes en quête de détente et des touristes.
Fig. 49 : Pertes de prairies et pâturages secs dues aux constructions Versant sud au-dessus de Tamins (GR) en 1956 et en 2019. Les conditions du site permettent de supposer que, dans les années 1950, la végétation typique des prairies et pâturages secs était prédominante. La surface en rouge indique le contour actuel de l’objet. Une grande partie de la végétation caractéristique a disparu en raison des constructions.


Exemples d’assainissement et de création réussis de prairies et pâturages secs
Travail communautaire et entreprises d’entretien du paysage
L’entretien de nombreux pâturages est organisé de façon communautaire. Sur le Blauenweide (BL), 40 bénévoles apportent leur aide un jour par an.

Le groupe « Pro Biotope » de Pro Natura est composé de forestiers, d’agriculteurs et de paysagistes. Depuis 2017, il débroussaille de nombreux prairies et pâturages secs. Cette prairie sèche à Schiers (GR) est aujourd’hui entretenue par la société de chasse.

Les exploitations spécialisées dans la gestion de milieux naturels extensifs entretiennent souvent des surfaces qui demandent beaucoup de travail comme ici à Douanne (BE).

Débroussaillage et nouvelles surfaces : pâturages caprins, forêts claires et talus non humifiés



Des forêts clairsemées sont aménagées depuis le milieu des années 1990 dans la Thurauenwald près de Flaach (ZH). Du foin récolté dans des objets voisins est amené dans les nouvelles forêts claires.
Dans les cantons des Grisons et d’Uri, un troupeau de chèvres itinérantes pâture depuis 2018 sur diverses surfaces de prairies et pâturages secs embroussaillées (sur mandat de Pro Natura). Les chèvres ont donné de bons résultats, car elles sont friandes de buissons.
À Glattfelden (ZH), de nouvelles prairies sèches ont été aménagées à grande échelle. La photo montre un talus sans apport de terre végétale le long d’une route de contournement, qui a été végétalisé avec le produit de la fauche de prairies et pâturages secs voisins.
Abegg J., Bonnard L. 2021 : Ökologisch erforderliche Abflüsse in Auengebieten, Expertenbericht im Auftrag des BAFU, interne Version 2021, Zürich und Bern.
Bergamini A., Ginzler C., Schmidt B. R., Bedolla A., Boch S., Ecker K., Graf U., Küchler H., Küchler M., Dosch O., Holderegger R. 2019a : Zustand und Entwicklung der Biotope von nationaler Bedeutung : Resultate 2011-2017 der Wirkungskontrolle Biotopschutz Schweiz. WSL Ber. 85. 104 p.
Bergamini A. et al. 2022 : Suivi des effets de la protection des biotopes en Suisse (WBS) : Évaluation des indicateurs annuels.
Bergamini A., Ginzler C., Schmidt B. R., Bedolla A., Boch S., Ecker K., Graf U., Küchler H., Küchler M., Dosch O., Holderegger R. 2019b : Résultats du suivi des effets de la protection des biotopes – Résumé. Édit. : Office fédéral de l’environnement (OFEV), Berne, 20 p.
Bergamini A., Ginzler C., Schmidt B. R., Bedolla A., Boch S., Ecker K., Graf U., Küchler H., Küchler M., Dosch O., Holderegger R. 2020 : Quelles évolutions connaissent les biotopes d’importance nationale ? Résultats de la première phase du suivi des effets de la protection des biotopes en Suisse. Nature & Paysage : Inside (CDPNP) 20(1) : 12-16.
Bergamini A., Peintinger M., Fakheran S., Moradi H., Schmid B., Joshi J. 2008 : Loss of habitat specialists despite conservation management in fen remnants 19952006, ScienceDirect, Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 11 (2009) 65-79.
Boch S., Ginzler C., Holderegger R., Schmidt B. R., Bergamini A. (2022) : Aires centrales, piliers de l’infrastructure écologique : situation et évolution. Hotspot 45, 8-9.
Charmillot K., Hedinger C., Babbi M., Widmer S., Dengler J. 2021 : Vegetationsveränderungen in Kalkhalbtrockerasen des Schweizer Juras ü ber 40 Jahre. Tuexenia 41 : 441-457. Göttingen 2021.
Dipner M., Volkart G. et al. 2010 : Prairies et pâturages secs d’importance nationale. Aide à l’exécution de l’ordonnance sur les prairies sèches. Office fédéral de l’environnement, Berne. L’environnement pratique n° 1017, 83 p.
Eggenberg S., Dalang T., Dipner M., Mayer C. 2001 : Cartographie et évaluation des prairies et pâturages secs d’importance nationale. Rapport technique. Cahier de l’environnement n° 325. Édit. : Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), Berne. 252 p.
Eggenberg S., Volkart G., Hedinger C., Hofmann R. 2008 : Referenzobjekte für die Dokumentation von Entwicklungstrends in TWW. Fallstudie zu ausgewählten TWW-Objekten (Referenzobjekten) mit drei zeitlichen Beobachtungsfenstern bzw. zwei Entwicklungstrends. Biotopinventarprogramm BAFU.
Gimmi U., Lachat T., Bürgi M. 2011 : Reconstructing the collapse of wetland networks in the Swiss lowlands 18502000. Landscape Ecology 26 : 1071-1083.
Grünig A. (ed.) 1994 : Mires and Man. Mire Conservation in a Densely Populated Country – the Swiss Experience. 415 p.
Grünig A., Vetterli L., Wildi O. 1986 : Die Hoch- und Übergangsmoore der Schweiz / Les hauts-marais et marais de transition de Suisse. Birmensdorf, Eidg. Forschungsanstalt WSL / Birmensdorf, Inst. fédéral de recherches WSL. Bericht 281/Rapport 281, 62 p. / 58 p.
Guntern J., Pauli D., Klaus G. 2020 : Biodiversitätsfördernde Strukturen im Landwirtschaftsgebiet. Bedeutung, Entwicklung und Stossrichtungen für die Förderung. Hrsg. : Forum Biodiversität Schweiz (SCNAT), Bern. 90 p.
Hanski I., Chris D., Thomas C. D. 1994 : Metapopulation dynamics and conservation : A spatially explicit model applied to butterflies, Biological Conservation, Volume 68, Issue 2, 1994, Pages 167-180, ISSN 0006-3207, DOI : 10.1016/0006-3207(94)90348-4. (www. sciencedirect. com/science/article/pii/0006320794903484)
Hunziker Ch. 2020 : Biotopobjekte in Agglomerationen. Bericht Info Habitat im Auftrag des BAFU. 47 p.
IPBES 2018 : Résumé à l’intention des décideurs de l’évaluation régionale de la biodiversité et des services écosystémiques pour l’Europe et l’Asie centrale de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. M. Fischer et al. (éd.).
Indermaur L., Schmidt B. R. 2011 : Quantitative recommendations for amphibian terrestrial habitat conservation derived from habitat selection behavior. Ecological Applications 21 : 2548-2554.
Jöhl R., Dipner M. 2019 : Nutzungsempfehlungen für Tww-Brachen. Bericht im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt BAFU.
Joosten H. et al. 2015 : MoorFutures. Integration of additional ecosystem services (including biodiversity) into carbon credits – standard, methodology and transferability to other regions, BfN-Skripten 407. Bundesamt für Naturschutz.
Klaus G. (Red.) 2007 : État et évolution des marais en Suisse. Résultats du suivi de la protection des marais. Office fédéral de l’environnement, Berne. État de l’environnement n° 0730. 97 p.
Küchler M., Küchler H., Bergamini A., Bedolla A., Ecker K., Feldmeyer-Christe E., Graf U., Holderegger R. 2018 : Moore der Schweiz : Zustand, Entwicklung, Regeneration. Bern, Haupt : 258 p.
Lachat T., Blaser F., Bösch R., Bonnard L., Gimmi U., Grünig A., Roulier C., Sirena G., Stöcklin J., Volkart G. 2010 : Verlust wertvoller Lebensräume. Pages 22-63. In T. Lachat, D. Pauli, Y. Gonseth, G. Klaus, C. Scheidegger, P. Vittoz, and T. Walter, editors. In : Wandel der Biodiversität in der Schweiz seit 1900. Ist die Talsohle erreicht ? Zürich, Bristol-Stiftung, Bern, Stuttgart, Wien.
Lüscher B., Zumbach S. 2003 : Geburtshelferkröten im Oberaargau. Naturhistorisches Museum, Bern.
Martin M., Jöhl R. et al. 2017, actualisation 2021 : Biotopes d’importance nationale – Coûts des inventaires de biotopes. Rapport d’experts à l’intention de la Confédération, établi sur mandat de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). 2e édition, 2017.
Martin M., Volkart G., Jöhl R., Hunziker Ch. 2007 : Schafe auf Trockenweiden. Fallstudie im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt BAFU.
Martin M., Volkart G., Jöhl R. 2008 : Bewirtschaftung von artenreichen Rinderweiden. Analyse der artenreichsten TWW-Rinderweiden : 9 Fallbeispiele. Fallstudie im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt BAFU.
Martin M., Volkart G., Jöhl R. 2018a : Recommandations pour les contrats pâturages LPN. Rapport sur mandat de l’Office fédéral de l’environnement OFEV.
Martin M., Jöhl R., Volkart G. 2018b : Bewirtschaftung von artenreichen Ziegenweiden. Fallstudie im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt BAFU.
Moor H., Bergamini A., Vorburger C., Holderegger R., Bühler C., Egger S., Schmidt B. 2022 : Bending the curve : Simple but massive conservation action leads to landscape-scale recovery of amphibians. PNAS, Vol. 119, N° 42, 8 p.
Müller-Wenk R., Huber F., Kuhn N., Peter A. 2004 : Landnutzung in potenziellen Fliessgewässer-Auen – Artengefährdung und Ökobilanzen. Schriftenreihe Umwelt Nr. 361. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Bern.
OFEFP (éd.) 2001 : Zones alluviales et zones-tampon. Dossier Zones alluviales : fiche no 4, 12 p.
OFEFP (éd.) 2002 : Les marais et leur protection en Suisse. Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, Berne. 66 p.
OFEV (éd.) 2019a : Liste des espèces et des milieux prioritaires au niveau national. Espèces et milieux prioritaires pour la conservation en Suisse. Office fédéral de l’environnement, Berne. L’environnement pratique n° 1709, 98 p.
OFEV (éd.) 2019b : Flux de financement, bénéficiaires et effets des investissements dans la protection de la nature et la biodiversité en forêt. Enquête auprès des cantons. Rapport final. Office fédéral de l’environnement, Berne.
OFEV (éd.) 2020 : Inventaire fédéral des zones alluviales d’importance nationale – État et besoin d’action. Office fédéral de l’environnement, Berne.
OFEV (éd.) 2022 : État de la mise en œuvre des inventaires de biotopes d’importance nationale. Enquête auprès des cantons. Office fédéral de l’environnement, Berne.
OFEV (éd.) 2022 : Les régions biogéographiques de la Suisse. 1re édition actualisée 2022. 1re parution 2001. Office fédéral de l’environnement, Berne. Connaissance de l’environnement n° 2214, 28 p.
OFEV (éd.) 2023 : Biodiversité en Suisse. État et évolution. Office fédéral de l’environnement, Berne. État de l’environnement n° 2306, Biodiversité, 98 p.
OFEV (éd.) 2023 : Manuel sur les conventions-programmes 2025-2028 dans le domaine de l’environnement. Communication de l’OFEV en tant qu’autorité d’exécution. Office fédéral de l’environnement, Berne. L’environnement pratique n° 2315 : 304 p.
OFEV et InfoSpecies (éd.) Projet : Liste des espèces prioritaires au niveau national. Espèces prioritaires pour la conservation en Suisse. Office fédéral de l’environnement, Berne. L’environnement pratique.
OFS 2014 : L’espace à caractère urbain 2012. Rapport explicatif, 40 p.
OFS 2023 : Statistique suisse de la superficie, surfaces d’habitat et d’infrastructure relevées de 1985 à 2018.
Pellet J. 2015 : Analyse de l’évolution des communautés de batraciens dans les sites de reproduction d’importance nationale entre l’OBat (2001-2007) et le programme de suivi des effets de la protection des biotopes en Suisse WBS (2011-2014).
Pellet J., Ramseier P., Tobler U., Zumbach S. 2020 : Un dernier rempart pour les batraciens menacés de Suisse : les zones de conservation prioritaires. Nature & Paysage : Inside (CDPNP) 1 : 37-40.
Pellet J., Borgula A., Ryser J., Zumbach S. 2012 : Évaluation des sites de reproduction de batraciens et définition des seuils nationaux. Office fédéral de l’environnement (OFEV), Berne.
Perrenoud A., Godat S. 2006 : Prairies et pâturages secs. Entretien avec des chèvres. Fiche d’information. OFEV & AGRIDEA (éd.), Berne et Lindau. 4 p.
ProSeco 2007 : Inventarvergleiche. Bericht im Auftrag des BAFU. 63 p.
Roulier C., Rast S. et Hausammann A. (2007) : Plan d’aménagement du Rhône PA-R3 – Outil prédictif du développement des milieux riverains. Service conseil Zones alluviales, Yverdon-les-Bains.
Ryser J., Borgula A., Fallot P., Kohli E., Zumbach S. 2002 : Inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d’importance nationale – Guide d’application. L’environnement pratique. Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, Berne.
Schiess-Bühler C., Martin M. 2008 : Prairies et pâturages secs. Moutons et pâturages secs. Fiche d’information. OFEV & AGRIDEA (éd.), Berne et Lindau. 8 p.
Schmidt B. R. 2006 : Beurteilung der Machbarkeit und Anforderungen an eine Umsiedlung der Amphibien der Zurlindengrube ins Gebiet « Lachmatt » (Muttenz). Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz (karch), Bern.
Schmidt B. R. 2007 : Fische und Amphibien oder Fische vs. Amphibien ? Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz (karch), Bern.
Schmidt, B. R., Mermod, M., Zumbach, S. 2023 : Liste rouge des amphibiens – Espèces menacées en Suisse. L’environnement pratique. Office fédéral de l’environnement OFEV, Berne et info fauna, Neuchâtel.
Schweizer E. 2014 : Das Ackerbaugebiet – ein Lebensraum für die Kreuzkröte. Milan 3 : 4-5.
Siffert O., Pellet J., Ramseier P., Tobler U., Zumbach S. 2022 : Caractéristiques d’habitat et taille des populations de batraciens dans les sites d’importance nationale –Rapport final. Service conseil IBN.
Smith M. A. and Green D. M. 2005. Dispersal and the metapopulation paradigm in amphibian ecology and conservation : are all amphibian populations metapopulations ? / Ecography 28 : 110/128.
Strebel N., Bühler C. 2015 : Recent shifts in plant species suggest opposing land-use changes in alpine pastures. Alpine Botany 125 (1) : 1-9.
Volkart G., Godat S. 2008 : Mit Nutzungsvielfalt zur Artenvielfalt ; nicht zu intensiv aber auch nicht zu extensiv. ; Hotspot zu Trockenwiesen und -weiden vom 18.9.2008 : 8-9.
Vue d’ensemble des inventaires (Données d’inventaire OFEV 2023). Un tableau plus complet des données d’inventaire peut être consulté sur la page internet des publications de l’OFEV www.bafu.admin.ch/uz-2404-f