






Tournée vers l’avenir
Avant d’avoir atteint l’âge adulte et d’avoir complété un baccalauréat en comptabilité à l’Université du Québec à Trois-Rivières, Carianne Lemire n’avait jamais considéré l’agriculture comme un possible métier. Mais lorsque sa passion pour la chose agricole émerge finalement vers l’âge de 19 ans, elle en devient une fière représentante, et ce, au point d’être aujourd’hui impliquée dans deux entreprises familiales. Un portrait s’impose.


« C’est le contact avec le marché du travail plus urbain qui a suscité en moi une profonde réflexion, confie Mme Lemire. Voulais-je vraiment travailler pour d’autres personnes? N’étais-je pas plus heureuse lorsque je travaillais au sein de la ferme maraîchère familiale? Les réponses m’ont clairement montré le chemin du retour. »
La ferme familiale d’un peu plus de 100 hectares, Les Maraîchers L&L, située à Saint-Michel dans la MRC des Jardinsde-Napierville, lui ouvre les bras. Elle reçoit 20 % des parts de l’entreprise en 2020 et, dès 2021, décide de lancer en partenariat avec sa mère une seconde compagnie, Les Transplants CL, qui se spécialise dans la culture et la vente de transplants dans ses 16 serres de 4500 pi carrés. « Nos cultures en serre sont le chou, l’oignon, la laitue, le piment et la tomate, toutes vendues à des producteurs de la région », explique la jeune entrepreneure, qui occupe également le poste d’administratrice sur le conseil d’administration de l’Association de la relève agricole de la Montérégie-Ouest (ARAMO).
Sous peu, son frère devrait également rejoindre l’actionnariat des Maraîchers L&L à hauteur de 20 %. À terme, le plan prévoit que lors de la retraite des parents, les deux enfants devraient se partager l’entreprise en parts égales. « Mes parents étant encore très jeunes, cela ne se concrétisera pas avant 2040 », lance avec humour Mme Lemire.
ÉDITEUR : Benoit Chartier

RÉDACTEUR EN CHEF : Martin Bourassa
ADJOINTE À LA RÉDACTION : Annie Blanchette
TEXTES ET COORDINATION : Yves Rivard
CONTRÔLEUR : Monique Laliberté
DIRECTEUR DU TIRAGE : Pierre Charbonneau
Si la ferme familiale cultive depuis longtemps le chou, la betterave et la courge principalement pour le marché de l’exportation vers les États-Unis, la jeune entrepreneure se verrait bien devenir une référence dans la culture de la courge. « J’aimerais bien développer davantage le créneau de la courge. Il y a tellement de variétés. Actuellement, nous en semons cinq, mais même si nous passions à 15 variétés, elles trouveraient preneur auprès de notre clientèle », confirme Carianne Lemire.
Consciente de la rareté de la maind’œuvre, elle se dit ouverte et prête à une plus grande automatisation des procédés agricoles. « Mon frère a suivi une formation en mécanique agricole, il sera certainement à même de faire les meilleurs choix à cet égard », souligne Mme Lemire.
Contrairement à la tendance observable au sein des jeunes entrepreneurs de sa génération, Carianne Lemire assure ne pas vouloir intégrer les amis au capital humain de l’entreprise. « Même en situation de pénurie, il faut établir des balises, créer des zones réservées entre employés et amis, et ce, afin d’éviter des situations de friction au travail qui pourraient avoir des répercussions sur les amitiés, et vice-versa. »
PUBLIÉ PAR:
DIRECTEUR DE LA PUBLICITÉ : Guillaume Bédard
DIRECTEUR DE LA PRODUCTION :
Alex Carrière
PUBLICITAIRES :
Louise Beauregard
Manon Brasseur
Luc Desrosiers
Miriam Houle
Isabelle St-Sauveur
TÉL. : 450 773-6028
TÉLÉCOPIEUR : 450 773-3115
WEB : www.dbc.ca
SITE
COURRIEL : admin@dbc.ca
Publié 12 fois par année par DBC Communications inc.
655, avenue Sainte-Anne, Saint-Hyacinthe, Québec J2S 5G4
Imprimé par Imprimerie
Transcontinental SENC division Transmag, 10807, rue Mirabeau, Ville d’Anjou Québec H1J 1T7.
Dépôt légal Bibliothèque nationale du Canada
Copyright® Tous droits réservés sur les textes et les photos.

Les articles sont la responsabilité exclusive des auteurs.
Prix d’abonnement : 1 an (taxes incluses)...............35 00$
Poste publication - convention : PP40051633
26 500 exemplaires
distribués dans Le Courrier de Saint-Hyacinthe et par la poste aux producteurs agricoles dans les régions suivantes :
Montérégie-Est
Montérégie-Ouest
Centre-du-Québec
Prochaine édition 4 mai 2023
Cahier spécial

Dans un contexte de profond changement démographique et sociétal, la relève agricole québécoise non apparentée gagne en popularité. Selon les derniers chiffres du MAPAQ, près de 15 % des transferts du milieu agricole s’effectueraient hors du cadre familial, même élargi. Julien Lamarre, 30 ans, fait partie de ces jeunes entrepreneurs qui ne demandent qu’à vivre leur rêve : celui de cultiver une terre.
M. Lamarre est un jeune producteur qui se spécialise dans le secteur des grandes cultures de grains bio, dans la région de Saint-Sébastien et de SaintBlaise-sur-Richelieu. « Afin de pouvoir gagner ma vie, je travaille présentement sur deux sites : la ferme familiale de 80 hectares, la Ferme Lamarre, et la Ferme L&S Poussard de 260 hectares, propriété de Sylvain Poussard. »
Salaire et grand air
Le principe de relève à l’œuvre ici est simple. « Chaque année, Sylvain me transfère 10 % de ses terres en location. J’en suis à ma seconde saison avec lui. Je cultive donc 20 % de sa superficie. Il effectue les travaux à forfait pour l’instant, mais dans un avenir rapproché, je commencerai le rachat progressif de sa machinerie agricole. À partir de ce moment, j’effectuerai les travaux à forfait sur les hectares qui ne
me sont pas encore loués. Bien sûr, je n’aurai pas d’actifs si je n’achète pas les terres, mais le mode locatif me permet de me dégager un salaire. » Et de faire ce qu’il aime vraiment, convient-il de souligner.
Selon M. Lamarre, ce partenariat gagnant-gagnant repose avant tout sur une excellente relation humaine, condition cruciale dans un cas de relève non apparentée. « J’ai connu Sylvain alors que j’étais représentant de machinerie agricole pour Agritex, il y a plusieurs années. Notre relation a toujours été excellente. Lorsqu’il m’a proposé ce partenariat, je savais que ce serait une belle et bonne aventure. »

Un bail notarié et deux saisons plus tard, Julien Lamarre se dit enchanté de cette dynamique qui voit M. Poussard se retirer progressivement pour lui laisser la place. « Il ne s’agit pas d’un événement soudain, comme lors d’un rachat, où tu te retrouves seul à tout gérer, mais bien d’un lent processus de transfert de connaissances et de responsabilités qui confère une expérience sûre et ancrée dans la réalité quotidienne et saisonnière. »
Réussir en dehors du système Interrogé à savoir si le processus de transfert avait nécessité des aides ou des accompagnements professionnels extérieurs, Julien Lamarre se félicite de ne pas avoir eu jusqu’ici recours au système bancaire. « Bien sûr, un notaire est intervenu dans l’officialisation de notre accord, mais
sinon, je n’ai pas eu besoin de me soumettre aux différentes étapes du système habituel. Je n’ai donc pas de prêt à assumer, pas de stress et de soucis liés aux impératifs mensuels et autres. Avec la hausse actuelle des taux d’intérêt, j’imagine que plusieurs jeunes entrepreneurs agricoles en processus de relève doivent dormir moins bien », confie-t-il.
Le mot de la fin concernant ce partenariat? « Sachant que Sylvain désire léguer la propriété à ses enfants, il n’y a pas de mauvaise surprise possible. Au contraire, je suis au courant de tout et libre de continuer ou d’arrêter un jour. Mais, je suis certainement heureux de constituer un locataire à long terme et de vivre cette vie », conclut M. Lamarre.
directrice territoriale. En Montérégie, une personne est ainsi disponible dans chacun de nos trois points de service. »
En vertu de son volet Tout pour la relève agricole, la Financière agricole du Québec (FADQ) accompagne et soutient le développement de nouveaux projets et de projets de reprise entrepreneuriale dans toutes les régions de notre belle province. Au terme de trois années de pandémie et de changements, il devenait impératif de dresser l’état des lieux avec Sonia Simard, directrice territoriale.

« Le Plan stratégique de la Financière agricole est en constante évolution, et le volet ciblant la relève ne fait pas exception. L’objectif est et demeure de maintenir le taux d’adhésion des jeunes entrepreneurs agricoles à environ 85 % », explique Mme Simard.

Pour ce faire, la FADQ a créé une section dédiée à la relève sur son site Internet, où il est possible de tout savoir sur les méthodes, pratiques et programmes offerts.
« Une équipe de professionnels dédiée à l’accompagnement des jeunes entrepreneurs, au démarrage et aux productions émergentes a aussi été mise sur pied il y a environ deux ans, souligne la
Changer pour mieux aider
Toujours dans le but de prouver sa pertinence, la FADQ a aussi procédé l’été dernier à une bonification des formations liées à l’obtention de subventions à la relève. « Qu’il soit question de temps partiel ou de temps plein, ces formations permettent souvent de hausser les sommes auxquelles les jeunes entrepreneurs ont droit », rappelle Mme Simard.
Autre changement d’importance : l’arrivée en juin 2022 du programme Investissement Croissance durable mis en place pour les entrepreneurs agricoles qui ont des projets d’investissement, peu importe leur secteur de production et l’étape de vie de leur entreprise. Il permet de soutenir des investissements productifs et à caractère durable. L’aide financière accordée est conditionnelle à l’octroi d’une garantie de prêt de La Financière agricole. Le montant maximal du financement admissible par entreprise, pour le volet 4 ciblant la relève, s’élève à 45 000 $. L’aide est versée sur une période de trois ans.
question d’obtenir des informations et des commentaires de première ligne », mentionne Mme Simard, qui ajoute du même souffle que l’objectif est de toujours garder un contact direct avec la relève afin d’offrir des services et des programmes qui répondent directement à leurs besoins.
rait actuellement sur une nouvelle itération de sa Stratégie visant la relève. « Dans le but d’arrimer nos interventions avec les nouvelles réalités auxquelles les jeunes entrepreneurs sont confrontés, notamment celle de la hausse des taux d’intérêt, nos équipes travaillent de concert avec plusieurs représentants de la relève afin d’explorer les différentes possibilités d’aide et d’accompagnement. »


prise familiale ou l’achat d’une entreprise non apparentée.
Le saviez-vous ?
Pas moins de 86% des jeunes de la relève possèdent un diplôme d’études postsecondaire (y compris le diplôme d’études professionnelles) et 66% d’entre eux sont spécialisés en agriculture.
planificateur financier sont utilisés fréquemment par 75 % des jeunes.
Pour l’ensemble de la relève, l’outil de financement le plus utilisé au moment de l’établissement demeure l’emprunt auprès d’un établissement financier, suivi de l’aide gouvernementale.
Vous vous distinguez par votre engagement clair dans la communauté, par vos compétences distinctes ou par l’innovation? Ce concours est pour vous, vous courez la chance de recevoir une bourse de 7500$.
Au Québec, environ 5793 entrepreneurs agricoles de moins de 40 ans font partie de la relève, ce qui représente 16% des entreprises agricoles de la province.
Depuis une quinzaine d’années, plus du tiers des jeunes de la relève se sont établis en démarrant une entreprise. Les autres ont fait l’acquisition d’une entre-
La relève féminine représente à elle seule au moins 29 % des établissements en agriculture depuis 2021.
Une statistique intéressante : la majorité des jeunes femmes agricultrices sont âgées de 25 et 33 ans alors que les jeunes hommes ont moins de 25 ans.
En Montérégie, les services-conseils d’un comptable, d’un fiscaliste ou d’un
La production laitière est l’activité principale pour un jeune de la relève sur trois, les grandes cultures arrivent au deuxième rang, suivi par l’acériculture ainsi que les légumes frais et de transformation.
Le prix de la relève agricole fait honneur à un ou des jeunes entrepreneurs, quelle que soit la spécialité de production.
Vous êtes propriétaire majoritaire de votre entreprise et faites partie de la relève agricole?
Inscrivez-vous d’ici le 9 juin 2023 : https://www.mapaq.gouv.qc.ca/ fr/Les-Grands-Evenements/prixreleve agricole/Pages/Prixreleveagricole.aspx

Karina Salazar
Agente en formation agricole, Collectif en formation agricole de la Montérégie 450 454 5115, poste 6288 ksalazar@upa.qc.ca

Comme les conclusions de son récent Congrès annuel l’ont confirmé, la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) est de tous les combats menant à l’amélioration des conditions favorisant la relève agricole et à sa pérennité. Dans un contexte de hausse fulgurante des valeurs des terres agricoles, de pénurie de main-d’œuvre, de spéculation foncière et d’absence d’incitatif fiscal à la vente d’une terre agricole à une relève, la FRAQ multiplie les interventions et demande à être réellement entendue par les instances gouvernementales. Mireille Beaudoin, coordonnatrice à la recherche et aux politiques agricoles, répond à nos questions.

GTA : En quelques phrases, comment résumer le contexte global de la relève agricole?
Mireille Beaudoin : Depuis la pandémie, il y a un engouement sociétal pour les notions d’autonomie alimentaire, de production locale et d’achat local. Afin de pouvoir cuisiner et manger local, il faut des producteurs locaux. Malheureusement, plusieurs dossiers permettant de soutenir les initiatives visant à favoriser l’accès aux terres et à assurer la relève d’entreprises agricoles existantes traînent ou sont carrément dans l’impasse. Pour concrétiser la vision politique et économique du gouvernement, on se retrouve devant des obstacles dressés par ce même gouvernement... Difficile d’avancer.

GTA : Les années de pandémie ontelles eu pour effet de ralentir la création de nouvelles entreprises agricoles, de retarder certaines transactions de relève?
M.B. : On recense une hausse de 2,3 %, selon le Recensement de l’agriculture 2021 de Statistique Canada. Cependant, ces données ne deviennent réellement significatives qu’au terme de deux recensements, car seulement la moitié de ces nouvelles entreprises parviennent à survivre à cette période. Le vrai enjeu de la relève au Canada n’est pas les barrières à l’entrée en agriculture, mais le maintien en activité des nouvelles fermes.
GTA : Quels sont les enjeux précis que la FRAQ tente de faire valoir auprès du gouvernement?
M.B. : Il y en a plusieurs, je citerai ceux-ci, tirés de L’Enquête canadienne sur la situation des entreprises (1er trimestre 2023) de Statistique Canada et spécifiques à l’agriculture : explosion du coût des intrants de 69 %, flambée de l’inflation de 64 %, bond des taux d’intérêt et des coûts liés à la dette de 58,5 %, hausse des coûts liés au transport de 49,9 % et montée des coûts d’assurance de 31,7 %. En réponse à ces nombreuses difficultés, 4,9 % des répondants envisageraient de vendre leur entreprise.
GTA : Ce contexte haussier est-il en voie de revenir à la normale au terme de trois années de surchauffe?
M.B. : Non. Les coûts de production continuent d’être très élevés. Les coûts des intrants et la perte de revenus continuent de faire souffrir les entreprises de la relève, et on n’a pas encore vu toutes les répercussions. Il y a même un désen-
gouement pour l’achat d’aliments locaux et biologiques auprès des consommateurs qui voient le prix de leur panier d’épicerie augmenter et un essoufflement des fermiers locaux.
GTA : Quelles sont les solutions?
M.B. : Parmi les plus importantes, on note la mise en place d’une loi anti-spéculation sur les terres agricoles, la création de programmes d’aide d’urgence afin d’injecter des liquidités dans les entreprises agricoles, l’optimisation du soutien aux entreprises dans cette période de crise, une meilleure promotion des programmes et des services disponibles, puis une hausse significative du budget du MAPAQ. Ces demandes s’ajoutent à celles déjà défendues, soit la mise en place d’un incitatif fiscal à la vente d’une terre agricole à une relève et la mise en place d’une obligation à cultiver les terres en friche par les propriétaires.
GTA : C’est bien connu : plusieurs personnes désirant démarrer leur entreprise doivent travailler ailleurs pour vivre et amasser les sommes nécessaires. Quel est le constat?
M.B. : La proportion de jeunes de la relève qui travaillent à l’extérieur de l’entreprise agricole tend à augmenter. En 2021, 44 % des jeunes agricultrices et agriculteurs occupaient un emploi en dehors de l’entreprise, comparativement à 38 % en 2006. En 2021, les jeunes agriculteurs déclaraient que cet emploi extérieur représentait, en moyenne, 60 % de leur temps de travail et 72 % de leur revenu annuel. Ces proportions sont nettement supérieures à celles des années précédentes et montrent qu’il est de plus en plus difficile de joindre les deux bouts lorsqu’on se lance en agriculture.
GTA : Que sait-on de ces emplois extérieurs les plus fréquents?
M.B. : C’est bien défini : un travail extérieur est plus fréquent pour les jeunes de la relève établis par démarrage d’une entreprise (63 %), comparativement à ceux et celles établis par transfert non apparenté (50 %) ou par transfert familial (30 %). Au cours des 12 mois ayant précédé le recensement réalisé en 2021, 63 % des jeunes agricultrices et agriculteurs établis par démarrage occupaient un emploi à l’extérieur de l’entreprise. Les proportions étaient de 50 % pour la relève en situation de transfert non apparenté et de 30 % pour la relève établie par transfert familial. Ces résultats sont similaires à ceux de 2016.
Les jeunes de la relève en situation de démarrage ou de transfert non apparenté occupant un travail à l’extérieur de l’entreprise y consacraient, en moyenne, un peu plus de temps (62 %) que ceux et celles de la relève en situation de transfert familial (56 %). Peu importe le mode d’établissement, pour environ le tiers des jeunes qui occupaient un emploi à l’extérieur de l’entreprise, celui-ci était lié à l’agriculture. Toujours selon le recensement de 2021, les jeunes de la relève établie depuis moins de 5 ans occupaient un emploi à l’extérieur de l’entreprise dans près de la moitié des cas (44 %). La proportion était de 20 % pour la relève établie depuis 10 ans ou plus.
Le rôle du cheval en agriculture a certainement beaucoup changé au cours des 50 dernières années. Autrefois utilisé comme bête de travail sur la ferme au vu de ses grandes capacités physiques, le noble animal est aujourd’hui surtout élevé pour le loisir et la compétition sportive. À preuve : la grande majorité des chevaux détenus par les exploitations agricoles se révèlent être des chevaux de selle pour l’équitation et la randonnée.

Comme beaucoup de rapports et de statistiques, ceux concernant la présence et l’utilisation du cheval au sein
date à laquelle la pandémie et les confinements ont eu raison des activités trimestrielles de collecte d’informations.
Cela dit, les plus récentes, publiées sur le site du ministère de l’Agriculture, de l’environnement et des ressources naturelles du Québec, indiquent que quelque 2959 entreprises agricoles hébergeaient des chevaux, et que près de 60 % d’entre elles en possédaient trois ou moins.
Des données à relativiser
Selon les données de 2021, le Québec recensait 418 éleveurs pour un nombre de poulains produits de 1692. Les
ventes totales annuelles à la ferme se chiffraient alors à 9 M$. Des données probablement similaires aujourd’hui révèlent que les éleveurs équins se trouvent principalement en Montérégie (23 %), en Chaudière-Appalaches (13 %), en Estrie (10 %), dans Lanaudière (10 %) et dans les Laurentides (9 %). Ceux-ci produisent des poulains qui assurent le renouvellement du cheptel québécois. Contrairement à d’autres secteurs agricoles, la production n’est pas régulière d’une année à l’autre, ce qui s’explique, entre autres, par la fluctuation de la demande et par les 345 jours que dure la gestation des juments. Les chevaux sont principalement exportés vers les États-Unis pour une utilisation dans les disciplines sportives.

Il existe de nombreuses associations d’éleveurs et de propriétaires de chevaux de race pure au Québec. Ces éleveurs se regroupent selon leur race préférée : arabe, appaloosa , belge, canadien, clydesdale , percheron, quarter-horse et standardbred , pour ne nommer que celles-là.
Il existe une race patrimoniale au Québec : le cheval canadien. Officiellement reconnue et classée en 1999, elle est la seule race équine développée au Québec et au Canada. Le cheval canadien est apprécié pour sa polyvalence, son endurance et sa docilité. Il sert aussi bien de cheval de selle que de cheval d’attelage.
L’organisme Cheval Québec est responsable du programme Équi-Qualité, reconnu par le gouvernement du Québec. Cette certification identifie, entre autres, les écuries et les fermes d’élevage qui respectent le code d’éthique de l’organisme. De plus, les éleveurs et les propriétaires de chevaux doivent se conformer aux exigences du Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage (CNSAE), peu importe leur secteur d’activité.


vaux », note M. Litjens, également viceprésident de la Société des Éleveurs de Chevaux Canadiens (SECC).

c’est pourquoi la ferme compte autant de reproducteurs. Sinon, on pourrait perdre d’autres lignées, ce qui serait terrible. »
Depuis 1975, la Ferme Litjens, sise à Saint-Armand, se targue de promouvoir la lignée du Cheval canadien. Fidèles à la tradition amorcée par ses parents, John et Colette, Normand Litjens et sa conjointe, Linda Flamez, tiennent les rênes de cette entreprise, la plus importante au Canada pour cette lignée et donc la plus précieuse en matière de sauvegarde génétique.

« La passion du Cheval canadien, le dévouement pour la race et le désir d’offrir des chevaux de qualité gardent la passion vivante, déclare d’entrée de jeu M. Litjens. Mais l’élevage équin est toujours sujet aux cycles économiques. L’équitation, soit-elle sportive ou pour des fins récréatives, est considérée comme une activité de luxe. Et quand le contexte économique change drastiquement, comme c’est le cas depuis trois ans et, plus spécifiquement, depuis les derniers mois, les éleveurs espèrent toujours que la demande restera forte. »

Ce qui est toujours le cas chez Ferme Litjens. « Actuellement, notre troupeau est constitué de 90 chevaux, dont 12 adultes reproducteurs éprouvés. Annuellement, on recense environ 25 naissances. Le marché actuel est très fort, on manque souvent de jeunes sujets. Il semblerait que les années de pandémie ont donné plus de temps libre aux amateurs de che-
Peu de gens le savent, mais la race du Cheval canadien ne compte que huit lignées, dont une virtuellement disparue.
« L’avenir est dans la diversité génétique,
Conformation, tempérament et génétique sont la priorité du programme d’élevage en vigueur à la Ferme Litjens. Mais d’autres principes régissent les activités de l’entreprise, notamment le concept de vie en liberté. « Le cheval doit faire sa vie
de cheval, explique M. Litjens. Le troupeau de juments vit à l’extérieur toute l’année, se promenant sur 60 hectares de pâturage et boisé. Nous surveillons de près les poulinages, mais tentons d’intervenir le moins possible. Nous laissons à la jument et au petit le temps de s’imprégner. Avec toutes les naissances prévues, nous avons investi dans un système de caméras de surveillance des boxes de poulinage. Après quelques jours, la jument et son petit retournent au parc avec deux ou trois autres juments et leurs petits. Ils sont élevés en groupe et évoluent dans de grands parcs avec forêt, ruisseaux et pâturages. »
La clientèle féminine change la donne
L’industrie du dressage aurait complètement changé de visage au cours des 50 dernières années, selon M. Litjens. « Du temps de mon père, les propriétaires de troupeau étaient à 90 % des hommes. Aujourd’hui, 70 % des acheteurs sont des femmes », constate-t-il.
La vente de sujets s’effectue une fois le sevrage terminé, soit quatre à six mois suivant la naissance. « Les poulains sont réservés à l’avance et garantis génétiquement », explique-t-il en prenant soin de préciser que chaque cheval vendu directement par un éleveur bénéficie à la sauvegarde de la race. « Une réalité bien différente des achats lors d’encans, par exemple », conclut Normand Litjens.

La ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada, Marie-Claude Bibeau, et le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, André Lamontagne, annoncent la signature d’une entente bilatérale dans le cadre du nouveau Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable). Cette entente est assortie d’un investissement conjoint des gouvernements du Canada et du Québec estimé à 955 M$ dans le secteur agroalimentaire québécois au cours des cinq prochaines années.

Il s’agit d’un financement supplémentaire de 97 M$ par rapport au cadre stratégique précédent, soit une augmentation de 25 % de l’enveloppe pour les initiatives stratégiques à frais partagés.
L’entente souligne également le leadership du Québec en matière d’amélioration des pratiques agroenvironnementales; en effet, l’Initiative ministérielle de rétribution des pratiques agroenvironnementales est reconnue et bénéficiera d’un financement spécifique. Le Québec se dote ainsi d’outils supplémentaires dans la poursuite de ses objectifs d’agriculture durable et continue d’agir afin de développer un secteur bioalimentaire prospère et résilient.

Ce partenariat contribuera à l’atteinte des cibles, objectifs et indicateurs établis par le Québec dans le cadre de ses plans et stratégies pour le secteur bioalimentaire. Il établit également les paramètres des programmes pancanadiens de ges-
tion des risques de l’entreprise (GRE) que sont Agri-investissement, Agri-stabilité, Agri-protection et Agri-relance, de façon qu’ils soient plus opportuns, plus équitables et plus simples. Cela se traduit notamment par une augmentation du taux d’indemnisation dans le programme Agristabilité, le faisant passer de 70 % à 80 %.
Faits saillants
• Le PCA durable signifie, pour le Québec, un montant global estimé à 955 M$ : • une enveloppe budgétaire de 367 M$ pour les initiatives stratégiques à frais partagés du Québec, dont 220 M$ provenant du gouvernement fédéral et 147 M$ du gouvernement du Québec;
• un montant estimé à 588 M$, dont 353 M$ provenant du gouvernement fédéral et 235 M$ du gouvernement du Québec, sur la base des conditions économiques et climatiques observées au cours des dernières années dans les programmes de gestion des risques de l’entreprise, soit : Agri-stabilité, Agri-investissement, Agri-protection et Agri-relance. Mentionnons que de façon complémentaire à ces programmes pancanadiens s’ajoutent les programmes exclusivement québécois : Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles, Agri-Québec et Agri-Québec Plus.
• Les programmes de GRE continueront d’aider les producteurs à gérer les risques majeurs qui menacent la viabilité des fermes et qui sont au-delà de leurs capacités.

• L’ancien cadre stratégique, le Partenariat canadien pour l’agriculture : accordcadre fédéral-provincial-territorial sur
une politique agricole, agroalimentaire et des produits agroindustriels, est entré en vigueur le 1er avril 2018 et prendra fin le 31 mars 2023. Une nouvelle mouture de l’accord-cadre multilatéral pour le PCA durable entrera en vigueur le 1er avril 2023 et aura cours jusqu’au 31 mars 2028.
André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, et son homologue fédérale, Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada, ont signé une nouvelle entente couvrant les cinq prochaines années.
Pour la première fois en vingt ans, le Japon rouvre ses portes au bœuf transformé canadien. Cette réalisation marque le début d’une nouvelle ère pour le Canada et son deuxième plus grand marché de bœuf et
de produits du bœuf. Elle élargit l’accès au marché pour les exportateurs canadiens, tout en profitant aux consommateurs japonais qui auront un meilleur accès aux produits de bœuf de qualité du Canada.

Cette mesure supprime aussi les dernières restrictions sur le bœuf canadien que le Japon avait imposées en 2003, après la découverte d’un cas d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) en Alberta.

Dans le cadre de la nouvelle Stratégie pour l’Indo-Pacifique, le gouvernement du Canada s’est engagé à saisir les possibilités économiques pour le Canada en renforçant ses partenariats régionaux, dont le Japon. L’Agence canadienne d’inspection des aliments, avec le soutien d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, a travaillé sans relâche au cours des dernières années pour faire valoir les normes élevées de production et d’assurance de la qualité du bœuf canadien pour rétablir l’accès complet aux marchés clés, tels que le Japon.
Un marché important
Le Japon est un marché important pour le Canada et le reste du monde. En 2022, le marché japonais du bœuf et des produits du bœuf canadiens était évalué à 518 M$, en grande partie grâce à l’accès préférentiel du Canada dans le cadre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste.
Cet accès élargi au marché fait suite à un autre assouplissement des restrictions en 2019, lorsque le Japon a approuvé les importations de bœuf canadien provenant de bovins âgés de plus de 30 mois.
« Le Conseil des viandes du Canada est très content de voir élargir l’accès de
notre bœuf aux marchés japonais. Pour nos membres, ce marché est critique pour leurs produits, surtout les produits de bœufs transformés et les galettes de bœuf. Cette entente s’ajoute aux succès récents de notre industrie au Japon depuis la signature du PTPGP. Nous tenons à remercier les ministres Bibeau et Ng, ainsi que l’ACIA de leur travail acharné pour ouvrir ces débouchés », a déclaré Christopher White, pdg de Conseil des viandes du Canada.
Les faits en bref
• Le Japon est le troisième plus grand marché agricole et agroalimentaire du Canada.
• Dans le cadre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, les droits de douane de 38,5 % imposés par le Japon sur les importations de bœuf (dont les galettes de bœuf haché) passeront à 23,35 % d’ici le 1 er avril 2023 et à 9 % d’ici 2033. Les droits de douane sur d’autres produits de bœuf transformés seront réduits encore davantage et, dans certains cas, complètement éliminés. Ce changement donne aux exportateurs canadiens un avantage marqué sur le plan des droits de douane par rapport à leurs principaux concurrents.
• Selon Statistique Canada, la valeur totale des exportations de bœuf canadien vers tous les pays en 2022 s’élevait à plus de 4,6 G$.

que le formateur le 12 avril. La formation se termine le 20 avril.
Examen réussi dans le passé
Les personnes qui ont réussi un examen sur l’utilisation des pesticides dans le passé n’ont peut-être pas à suivre la formation à nouveau. Elles doivent consulter
la liste des formatons reconnues par le ministère de l’Environnement. Pour pouvoir faire des épandages à forfait, elles doivent passer à nouveau un examen.

Sous supervision
La personne qui détient le certificat peut superviser l’opération d’épandage. Une
formation sur l’utilisation des pesticides sous supervision existe. Elle permet à l’opérateur de faire cette tâche dans les règles de l’art mais ne mène pas à l’obtention du certificat.
Pour plus d’information sur les formations, consultez le catalogue des formations sur uplus.upa.qc.ca.

Le printemps arrive et certaines personnes réalisent qu’au moins une personne de l’entreprise agricole doit avoir réussi un examen sur l’utilisation des pesticides pour pouvoir en acheter et en utiliser. Débute alors une course à la formation afin de réussir la course au certificat du ministère de l’Environnement. Bonne nouvelle, des formations en ligne existent.

La formation « Pesticides en milieu agricole » peut être suivie en tout temps. Elle vise à préparer les participants à réussir l’examen menant à l’obtention du certificat de catégorie E. Ce certificat est suffisant pour utiliser des pesticides sur sa propre exploitation. Les participants qui souhaitent réaliser des applications à forfait doivent obtenir le certificat de classe CD8. Ils doivent réussir un deuxième examen.
En formule hybride
Le Collectif en formation agricole Saguenay-Lac-St-Jean propose en formule hybride la formation Pesticide à forfait, qui porte sur l’utilisation des pesticides (E.1 et CD8) en formule hybride. Les participants pourront se brancher en même temps




On apprenait tout récemment que les érables ne servent pas uniquement à se sucrer le bec. Leurs feuilles pourraient également aider à lutter contre les maladies bactériennes chez les végétaux comme la laitue, la tomate et la fraise. Le stagiaire postdoctoral à la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval, Maxime DelisleHoude, étudie le potentiel antibactérien de ces feuillages depuis quelques années.
Un antibactérien moins toxique
Peu de produits offerts sur le marché ciblent les bactéries néfastes pour les plants, et la plupart d’entre eux contiennent du cuivre. « Ce métal est un élément quand même toxique pour le sol et pour l’humain. Ça cause souvent de la phytotoxicité, c’està-dire des petites nécroses sur les feuilles, quand ce n’est pas appliqué dans les bonnes conditions ou aux doses optimales », rapporte Maxime Delisle-Houde, également membre du Centre de recherche et d’innovation sur les végétaux.
Il a donc cherché de nouveaux outils pour lutter contre les maladies bactériennes avec des produits généralement reconnus sans risque pour l’humain. Les extraits de feuilles d’érable s’étaient largement démarqués pour inhiber la croissance des bactéries. « Le composé empêche leur multiplication. À des doses plus élevées, il peut même tuer les bactéries en s’attaquant à leur structure, pouvant entraîner une rupture de la paroi bactérienne », précise le stagiaire postdoctoral.
L’accumulation de feuilles au sol peut entraîner un problème d’acidification de la terre et causer le déclin de plusieurs arbres. « Dans le futur, on pourrait s’imaginer collecter une partie de ces feuilles au sol chez les acéricultrices et acériculteurs pour produire notre extrait en plus grande quantité », suggère Maxime Delisle-Houde.
Outre la valorisation dans les érablières, le chercheur pense aussi aux feuilles mortes récoltées par les municipalités qui pourraient être transformées en extrait. Même si elles ne proviennent pas que des érables, d’autres types de feuilles contiennent des composés similaires, comme celle du chêne.
Pour extraire l’agent antibactérien des feuilles, elles sont broyées dans un malaxeur, puis mélangées avec de l’éthanol pour en extraire le composé actif et pour tuer les microbes présents dans le mélange. Une fois le solvant évaporé, seule une fine poudre reste. Facile à utiliser et à conserver, Maxime Delisle-Houde y voit une occasion de commercialisation pour la pulvérisation directement sur les plants.

Dans la présente étude, Maxime Delisle-Houde a testé les extraits d’érable argenté sur trois bactéries importantes pour les agriculteurs et agricultrices: celles responsables du chancre bactérien (Clavibacter michiganensis) et de la moucheture bactérienne (Pseudomonas syringae) chez la tomate, et la bactérie qui
cause la tache angulaire chez la fraise (Xanthomonas fragariae ). Les extraits d’érables pourraient toutefois protéger contre d’autres bactéries, comme celles qui s’attaquent à la laitue.
En plus de l’effet antibactérien, certaines études rapportent que les extraits de feuilles d’érable peuvent stimuler les mécanismes de défense des plantes.
Maxime Delisle-Houde et ses collègues souhaitent valider cette hypothèse prochainement. Avec d’autres collaboratrices et collaborateurs de l’Université Laval, ils s’attarderont aux stress abiotiques comme le manque d’eau et les changements de températures.
Cette étude a été publiée dans la revue scientifique HortScience


Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) ont réagi au dévoilement du budget 2023-2024 du gouvernement du Québec au cours duquel le ministre des Finances, Éric Girard, a notamment annoncé une bonification de 23,2 M$ sur deux ans de la mesure de rétribution des pratiques environnementales en agriculture. Cette annonce correspond à près de la moitié de l’engagement électoral du parti qui forme aujourd’hui le gouvernement, qui s’élevait à 50 M$.
« Le soutien de l’État est capital pour permettre aux producteurs de poursuivre la modernisation de leurs pratiques tout en restant compétitifs. Ainsi, nous reconnaissons l’effort du ministre Girard, qui a confirmé ce que nous espérons être une première - et non une dernière - annonce afin de concrétiser l’engagement électoral de 50 M$ de son parti pour soutenir le virage agroenvironnemental qui est en cours au Québec. La mesure de rétribution des pratiques environnementales en agriculture fait partie d’une approche visionnaire de notre secteur, qui contribue à consolider la confiance des producteurs et à soutenir leur engagement », affirme le président des PGQ, Christian Overbeek.
Les PGQ tiennent aussi à souligner le financement additionnel de programmes favorisant l’autonomie alimentaire du Québec. Une partie des sommes annoncées à cet effet - qui s’élèvent à 35 M$ annuellement, durant cinq ans - permettra, dans une certaine mesure, la bonification du
financement de l’Initiative ministérielle Productivité végétale. Il s’agit de la concrétisation d’un engagement que les PGQ estiment juste de le souligner.
Les besoins régionaux ignorés
Par ailleurs, malgré des crédits supplémentaires de 32 M$ accordés au MAPAQ pour appuyer le développement en région, les besoins distincts des régions éloignées des grands centres urbains auraient été ignorés. « Nous réitérons la nécessité que les besoins particuliers
des régions périphériques soient pris en compte, et ce, de manière plus spécifique », soutient M. Overbeek.
En outre, le gouvernement a prévu, à partir de l’année prochaine, des sommes notables pour le financement de la politique bioalimentaire, dont en recherche scientifique, et pour la constitution de réserves de propane.
« Les producteurs de grains sont un acteur fort de l’activité économique sur tout le territoire du Québec. Ils sont mobilisés en faveur d’une meilleure réponse
aux attentes sociétales en matière environnementale. Nous continuons donc notre travail, en partenariat avec les autorités, afin de maximiser notre contribution », conclut M. Overbeek.
Pour rappel, Les Producteurs de grains du Québec représentent quelque 9500 productrices et producteurs dans toutes les régions du Québec. Ils génèrent un chiffre d’affaires annuel de 2 G$. La production et la transformation de grains représentent ensemble près de 20 000 emplois au Québec.




et dérange beaucoup les stades plus matures de ses proies en les empêchant de se reproduire trop rapidement. L’organisme avait déjà été considéré pour la lutte biologique dans les vergers canadiens, mais son élevage a été jugé trop difficile.
Il est de plus en plus difficile de mettre en marché de nouveaux agents de lutte biologique. Il ne faudrait pas répéter l’erreur de l’introduction de la coccinelle asiatique aux États-Unis en 1988.
Un acarien indigène, de la famille des Anystidées, a été remarqué dans la nature par Taro Saito à St-Catharines, en Ontario. M. Saito, technicien au Centre de recherche et d’innovation de Vineland, Ontario, a réussi son élevage et l’a étudié durant plus de 10 ans. Cet acarien possède toutes les qualités recherchées pour son introduction au Canada et il pourrait complémenter les stratégies de lutte intégrée actuelles en serre. Il est maintenant disponible sur le marché canadien tandis qu’aux États-Unis on ne le reconnaît pas comme organisme indigène et il est interdit de commercialisation.

Anystis baccarum est son nom, mais il est mis en marché sous le nom de Crazee Mite ou l’acarien fou à cause de son comportement erratique, en zigzags, lorsqu’il est à la recherche d’une proie. C’est un prédateur généraliste, agressif qui parcourt de grandes distances pour se nourrir. De plus, il tue plus que ce qu’il mange
Tous ces acariens sont des femelles qui n’ont pas besoin de mâles pour se reproduire (parthénogenèse). De couleur rouge carmin, il est gros et facile à voir à l’œil nu. Tandis que les œufs sont pondus dans le substrat et difficiles à voir. Il y a 4 stades incluant un stade chrysalide ou pupe. Le cycle œufs/adulte est d’une durée de 3 à 5 semaines selon la température. La femelle peut pondre de 45 à 150 œufs et vivra environ 3 semaines. Au premier stade mobile il est facile à identifier, car il a seulement 6 pattes. Tous les stades mobiles sont prédateurs, mais l’adulte est le plus gros (1,5 à 2 mm), soit environ 2 fois la grosseur d’un Phytoseiulus persimilis adulte pour ceux qui s’y connaissent. Et il est plus vorace. Les stades immobiles ou cocons seront difficiles à localiser, car ils sont bien cachés entre les nervures et les replis des feuilles.
Cet acarien ne diapause pas en jours courts (hiver). Il demeure actif de 15 °C, même à 5 °C, mais les conditions qui lui sont favorables sont de 24 °C avec 6070 % d’humidité relative. Le prédateur se déplace rapidement pour rejoindre ses proies. Il peut parfois injecter une toxine lors de l’attaque pour immobiliser ses victimes.

Anystis prédate tous les stades des ennemis des cultures, mais préfère les
jeunes. Son attitude agressive dérange beaucoup, car il harcèle directement les organismes nuisibles même s’il ne les tue pas directement. L’acarien peut aussi survivre sur du pollen, des œufs d’Ephestia (œufs de papillons) ou des cystes (œufs) d’Artemia ou de crevettes.
Les ravageurs affectés en serre sont : les thrips des petits fruits, Echinothrips, thrips de l’oignon, Thrips parvispinus, les
pucerons (vert du pêcher, de la digitale et de la pomme de terre), les tétranyques (les toiles ne l’arrêtent pas), aleurodes, cochenilles et kermès à carapace tendre et les sciarides. Des recherches supplémentaires seront nécessaires pour son introduction dans culture de la tomate, car les trichomes (genre de poils) semblent déranger ses déplacements, mais il est efficace dans le cannabis.

Anystis est compatible avec la plupart des autres auxiliaires, mais il s’attaquera aux Neoseiulus cucumeris et Amblyseius swirskii. Il est donc possible d’utiliser les N. cucumeris en sachets, peu coûteux, comme support à leur croissance. Le fait de les nourrir sera aussi utile pour les garder dans la culture. Des recherches dévoilent un meilleur contrôle sur les thrips si Anystis est introduit avec des Neoseiulus cucumeris. Contre le puceron de la digitale, le contrôle sera bonifié s’il est complété avec l’introduction d’ Aphidius ervi (guêpe parasitoïde). Anystis ne s’attaque pas aux momies des pucerons. Dans le cas des tétranyques, il serait préférable d’introduire les agents de lutte biologique Neoseiulus fallacis ou P. persimilis précédemment. Anystis terminera le travail. Ce nouvel acarien prédateur est compatible avec le biopesticide BotaniGard et autres Beauveria (champignons entomopathogènes). Ce nouvel acarien prédateur (Anystis baccarum) aurait des lacunes :
• N’aime pas marcher sur le terreau, sauf pour pondre. Il préfère se déplacer sur le feuillage et les structures
• Incompatible avec les tables inondantes sauf si les feuilles se touchent
• Incompatible avec la propagation sous brouillard, semis ou boutures
• Anystis se déplace beaucoup et s’éloignera de la culture s’il ne trouve pas de nourriture
• Incompatible avec les huiles et les savons insecticides

Taux d’introduction suggéré : Dose générale en prévention : 0,25 acarien/ pied²
Dose en curatif : 2,0 acariens/ pied²
L’acarien est vendu en 3 formats avec des formes mobiles : 50 (flacon de 40 g) 250 (petit contenant) et 1000 dans un sac avec des copeaux de bois. Un taux de mortalité de 10 % est acceptable, car il peut y avoir du cannibalisme. Le contenu doit être acclimaté aux conditions de serre avant d’être distribué sur les plantes, mais l’acarien se déplace bien lui-même si les feuilles se touchent. Souhaitons qu’avec l’arrivée de ce nouvel allié, les producteurs de fleurs et de légumes puissent optimiser leur stratégie de lutte biologique en serre.
Références bibliographiques
- Aphid predator (Trombidiformes : Anystidae), Anystis baccarum, Whirligig mite, sur le site de InfluentialPoints.com https://influentialpoints.com/ biocontrol/Anystis_baccarum_whirligig_mite.htm

- Crazee Mite (Anystis baccarum) Predatory (Whirligig) Mite, Technical Manual, Applied Bio-Nomics Ltd., 2 pages https://www.appliedbionomics.com/wp-content/uploads/Anystis-baccarumTechnocal-Manual.pdf
- Buitenhuis, R. & T. Saito, 2022. Anystis: Building a New Predatory Mite from Potential to Product, Greenhouse Grower 18 janvier. https://www.greenhousegrower.com/production/anystis-building-anew-predatory-mite-from-potential-to-product/
- Gupta, S. K. & P. S. Kumar, 2018. The underestimated worth of predatory and parasitic mites in India: does it really have to import exotic species for biological control? CAB Reviews 13 (031): 17 pages doi: 10.1079/PAVSNNR201813031

Les entrepreneurs consacrent plusieurs années à bâtir une entreprise performante et prospère dont ils tirent une grande fierté, et ce, peu importe leur champ de pratique. C’est donc sans surprise qu’une forte proportion d’entre eux souhaitent un jour transférer leur entreprise pour assurer sa pérennité. Le Portrait du repreneuriat de PME au Québec en 2017, établi par le Centre de transfert d’entreprise du Québec en collaboration avec l’Université du Québec à TroisRivières 1, illustre très bien cette réalité, surtout dans notre province, et particulièrement en zone dite rurale.
Les producteurs agricoles ne font pas exception à la règle, bien au contraire. Selon le Recensement de l’agriculture de 20212, 20 % des entreprises agricoles ont une relève. Par ailleurs, il existe un attachement unique et fort à l’idée de transmettre une ferme familiale de génération en génération. Vous prévoyez cette aventure bientôt? Voici quelques points à considérer avant de débuter.
Avant toute chose, la taille ainsi que la valeur de l’entreprise obligent une réflexion approfondie et une bonne préparation de part et d’autre. Cette étape ne doit pas être prise à la légère. Il faut prendre le temps de bien faire les choses au lieu de précipiter le processus et d’escamoter ou de bâcler des étapes. Il est sain de se questionner sur la vision, les objectifs et les besoins mutuels des cédants et de la relève. En comparant les réponses de chaque partie, des écarts déterminants pour la suite des choses peuvent apparaître et deviendront des points de discussion. Se faire accompagner par un professionnel en transfert et en relation humaine facilitera la communication, déterminera les phases du transfert et soutiendra les parties pour le volet de la délégation de tâches et de pouvoir ainsi que pour la gestion du changement.
non au cédant, vous devez posséder une multitude de compétences en vue d’assurer une bonne et saine gestion de l’entreprise agricole. La formation et l’expérience deviennent ainsi des incontournables. Une offre variée de formation initiale, professionnelle, technique ou universitaire est à votre portée. La liste complète se trouve sur le site Carrières –bioalimentaire à l’adresse suivante : www.mapaq.gouv.qc.ca/carrieresbioalim. L’offre diversifiée de cours de formation continue est aussi très intéressante pour compléter l’acquisition ponctuelle de connaissances complémentaires. Les Collectifs régionaux en formation agricole3 recensent l’offre et la diffusent sur leur site.
L’expérience pratique constitue aussi un atout important. Il est primordial que vous travailliez au sein de votre entreprise, mais si la situation le permet, allez prendre de l’expérience à l’extérieur de la ferme familiale pour vous initier à d’autres façons de faire et confronter vos idées. N’hésitez pas à effectuer un stage d’études hors de votre région ou de votre production.
Restez informé des nouveautés en transfert d’entreprise (sur les plans humain, fiscal, juridique, etc.) en participant à des événements organisés autour du sujet, en faisant des lectures ou en discutant avec des producteurs ayant vécu le processus. Malgré l’unicité des situations, vos collègues du milieu agricole pourront
des entreprises nécessitent un transfert qui se planifie et s’échelonne généralement sur plusieurs années. Il est facile de perdre de vue l’objectif final au milieu des tâches courantes. Plusieurs ressources se spécialisent dans ce domaine. En voici quelques-unes.
Il n’y a qu’à penser aux conseillers en relève agricole du MAPAQ, présents dans toutes les régions. Ils disposent de plusieurs outils, comme la formation Coexploitation cédants-relève 4 , pour vous faire vivre un transfert harmonieux. D’une durée de six jours, elle traite des aspects humains, juridiques, fiscaux, économiques ainsi que de la préparation à la retraite. Un beau survol de tous les enjeux possibles avec des professionnels qualifiés.
Le Programme services-conseils, de son côté, propose un volet consacré au transfert de ferme, qui inclut des rencontres individuelles et multidisciplinaires avec des spécialistes. L’équipe du Réseau Agriconseils Montérégie se fera un plaisir de vous renseigner sur ce programme avantageux.
Si vous cherchez un site d’exploitation tion de votre entreprise, ainsi qu’un accompagnement personnalisé, les vaillent activement pour vous. La majorité des MRC de la Montérégie adhèrent à ce service. Une visite sur le site Web de L’ARTERRE vous convaincra de contacter ses agents : www.arterre.ca.
Le Centre de transfert d’entreprise du Québec5 accompagne les entrepreneurs dans ce type de démarche. Une multitude d’outils, de formations et d’événements sont accessibles sur son site Internet.

Des ressources et des outils variés et adaptés à toutes les situations sont offerts. Vous hésitez ou vous ne savez pas par où commencer? Les conseillers en relève du MAPAQ en Montérégie demeurent disponibles pour vous renseigner et vous accompagner. N’hésitez pas à les contacter.
MRC de Vaudreuil-Soulanges, de Beauharnois-Salaberry, du HautSaint-Laurent, de Roussillon, du HautRichelieu et des Jardins-de-Napierville
Hugues Désilets
450 427-2000, poste 5111 hugues.desilets@mapaq.gouv.qc.ca
MRC de Pierre-De Saurel et de La Vallée-du-Richelieu
Sandra Dagenais
450 778 -6530, poste 6122 sandra.dagenais@mapaq.gouv.qc.ca
MRC d’Acton, de Brome-Missisquoi, de La Haute-Yamaska, des Maskoutains, de Marguerite-D’Youville, de Rouville et agglomération de Longueuil
Yves Simard
450 778-6530, poste 6157 yves.simard@mapaq.gouv.qc.ca
1. www.ctequebec.com/ etude-quantitative-repreneuriat-quebec/
2. https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/ adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/ agriculture/devenir-agriculteur/ED_ portrait_releve_agricole_MAPAQ.pdf

3. www.upa.qc.ca/producteur/formations
4. www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/centreduquebec/ INPACQInfolettre/releve/Pages/Formation coexploitationpasseportharmonieux.aspx
5. www.ctequebec.com
ABDENOUR BOUKHALFA, agronome, conseiller en agroenvironnement, Direction régionale de la Montérégie, ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)

Au cours des 16 dernières années, plus de 500 essais au champ ont été menés sur 21 cultures végétales dans le but d’établir des valeurs scientifiques de référence en fertilisation dans des conditions propres au Québec. Ces valeurs ont été compilées dans des grilles, qui permettent de déterminer les besoins en éléments fertilisants des cultures et de planifier les applications d’engrais.
Le Guide de référence en fertilisation publié par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (www.craaq.qc.ca/Publications-duCRAAQ/guide-de-reference-enfertilisation-2e-edition/p/PSOL0101) est un document essentiel pour les agronomes, les producteurs agricoles et les professionnels en ce qui concerne la gestion des matières fertilisantes. Ce guide regroupe plusieurs grilles de fertilisation. Il sert de référence pour l’établissement des plans de fertilisation selon les cultures, et il rassemble des informations pertinentes et exhaustives sur les plans technique, scientifique et opérationnel.
Le MAPAQ a entrepris des travaux de mise à jour de plusieurs grilles de fertilisation au chapitre 12 de ce guide. L’objectif est d’assurer l’utilisation des quantités d’engrais appropriées selon les besoins et ainsi d’obtenir le meilleur rendement commercialisable pour chaque culture.
Au cours des 20 dernières années, le MAPAQ a mis en place plusieurs programmes d’aide financière afin d’actualiser les valeurs de référence des grilles de fertilisation pour les cultures de plein
champ. Grâce aux essais menés chez des producteurs agricoles dans l’ensemble des régions du Québec, des ajustements aux valeurs actuelles des grilles ont pu être apportés, permettant ainsi d’améliorer les pratiques de fertilisation des cultures.



Depuis 2020, de nouvelles références en fertilisation ont été définies pour 11 cultures. Une trentaine de grilles de fertilisation ont également été mises à jour, éditées et publiées à l’intention des agronomes, des producteurs agricoles et des professionnels du secteur.
Jusqu’à présent, les superficies des cultures concernées par de nouvelles valeurs de référence en fertilisation sont estimées à plus de 220 000 hectares pour les céréales et à plus de 13 000 hectares pour les cultures maraîchères. Pour consulter les grilles, visitez le site Internet du MAPAQ (www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/ Agroenvironnement/fertilisants/Pages/ grilles-reference.aspx).
Une grille de référence est un document présentant des doses d’application d’éléments nutritifs en kilogramme par hectare pour les trois éléments majeurs, soit l’azote (N), le phosphore (P2O5) et le potassium (K2O), en fonction de plusieurs paramètres (culturaux, pédoclimatiques, etc.).
Des données actualisées
La comparaison entre les anciennes et les nouvelles grilles montre que dans une large majorité des cas, les ajustements d’éléments fertilisants ont été revus à la baisse. Les diminutions observées peuvent être qualifiées de moyennes à faibles selon les cultures. Alors que 20 % des nouvelles grilles proposent des doses semblables aux anciennes, seulement 15 % des nouvelles grilles recommandent une augmentation de la quantité. Ces dernières fournissent également des informations plus complètes sur les doses à appliquer selon la fertilité des sols, les calibres visés, les périodes d’application, le mode et le fractionnement suggérés ainsi que le type de fertilisant à utiliser. Les informations supplémentaires fournies par la nouvelle mouture des grilles permettent ainsi aux utilisateurs d’améliorer leurs pratiques de fertilisation.
Les ajustements apportés aux quantités recommandées de fertilisants reposent sur des données obtenues à partir d’essais réalisés exclusivement au Québec, afin que soient prises en compte les conditions particulières liées au climat nordique.
Tous les essais sont conduits selon des protocoles validés par des professionnels et des experts reconnus dans le domaine de la fertilisation.
Bien que les grilles constituent un excellent outil de référence, l’agronome demeure responsable de recommander la quantité de fertilisants à utiliser en fonction des conditions spécifiques de sa pratique et de la situation des champs (précédent cultural, structure et texture du sol, pluviométrie, cultivars, santé des sols, etc.).
D’autres mises à jour à venir
Les travaux de mise à jour des grilles de fertilisation se poursuivent, notamment pour les cultures de prairies de graminées et de légumineuses en établissement, ainsi que pour les oignons verts, les oignons secs et les radis produits dans des sols organiques (terre noire).
La prochaine publication portera sur les ajustements des grilles pour les prairies graminées et légumineuses. Elle est attendue à l’été 2023 et sera suivie des grilles consacrées à trois cultures en terre noire : radis, oignon sec et oignon vert.
Nos remerciements vont à l’équipe de recherche de l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement, aux nombreux collaborateurs des clubs-conseils en agroenvironnement responsables des sites d’essais, aux membres du comité scientifique, aux collaborateurs et au personnel de soutien du MAPAQ qui, tous ensemble, permettent l’actualisation de ces grilles de fertilisation au bénéfice de milieu agricole québécois.
Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) ont récemment publié leur Guide des pratiques de gestion bénéfiques pour atténuer les émissions dans les fermes laitières, qui vise à aider les producteurs laitiers canadiens à contribuer à l’atteinte de la carboneutralité d’ici 2050, un objectif ambitieux fixé par les PLC l’année dernière.


La réalisation de cet objectif confirme que le secteur laitier représente un acteur incontournable dans la mise en œuvre des solutions permettant de lutter contre les changements climatiques et atteste auprès des consommateurs qu’ils pourront continuer à apprécier les produits laitiers fabriqués à partir de lait 100 % canadien au cours des années à venir.
L e Guide des pratiques de gestion bénéfiques des PLC a été élaboré en consultation avec des experts afin d’aider les producteurs à identifier et à mettre en œuvre les pratiques de gestion bénéfiques (PGB) dans leur ferme : il comprend entre autres un aperçu d’une trentaine de suggestions de PGB permettant de réduire les émissions,
d’augmenter la séquestration du carbone et d’améliorer la durabilité environnementale globale.
Les PLC travaillent avec des spécialistes en réduction des GES, les gouvernements fédéral et provinciaux, les acteurs du secteur laitier et, surtout, les producteurs, sur des stratégies pouvant être appliquées à l’échelle de la ferme afin de réduire et de séquestrer les émissions dans un souci d’amélioration continue.
Pour en savoir plus sur les mesures prises par les producteurs laitiers canadiens en vue de parvenir à la carboneutralité de la production laitière à la ferme d’ici à 2050, veuillez consulter le site : producteurslaitiersducanada.ca/fr/ developpement-durable.
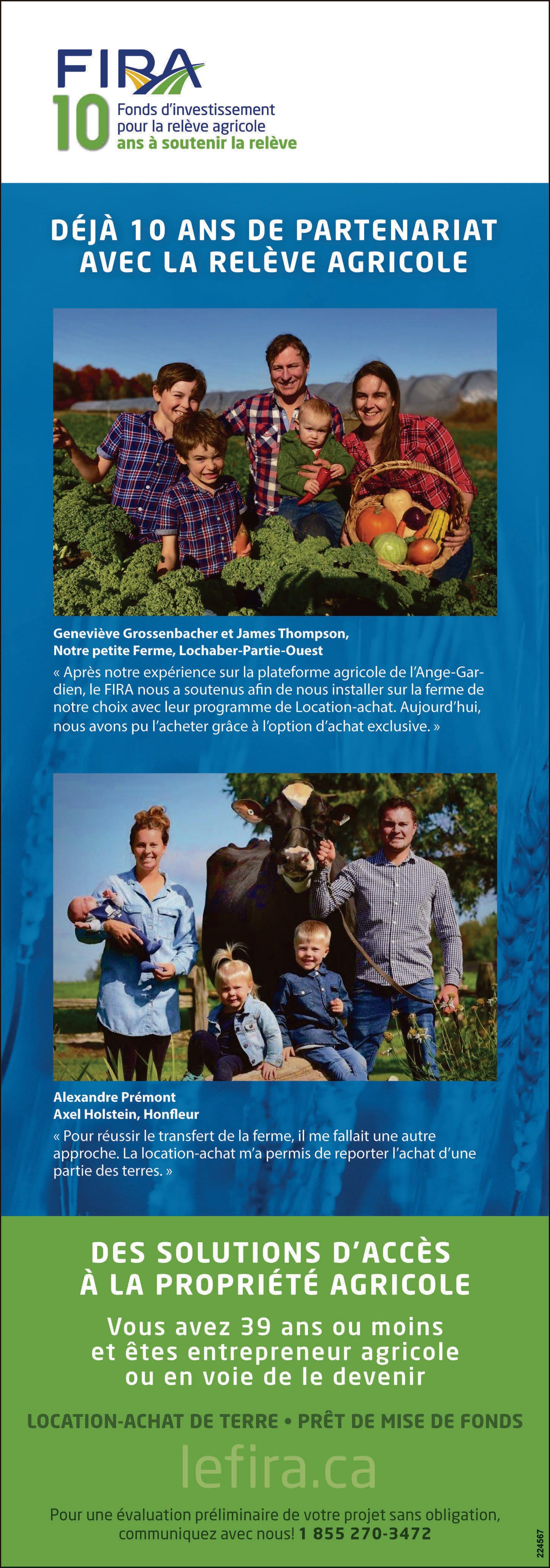

Aux premières loges des changements climatiques, les productrices et producteurs agricoles prennent action pour améliorer leur résilience et productivité tout en réduisant leur empreinte carbone. Alors que le gouvernement du Canada a fixé une cible de réduction des émissions de GES liées à l’application des engrais, il a mené des consultations auprès de l’industrie pour recueillir des commentaires sur les approches volontaires qui sont le plus à même de soutenir le secteur dans ses démarches.
Plus de 2000 réponses ont été reçues dans le cadre de la consultation en ligne, des ateliers techniques et des assemblées générales, tenues de mars à octobre 2022. Les agriculteurs, les producteurs, les associations de l’industrie, les provinces et les territoires, les scientifiques et les organisations environnementales ont fait part de leurs commentaires. AAC a analysé cette précieuse rétroaction et a publié aujourd’hui le rapport intitulé « Ce que nous avons entendu : consultation sur la réduction des émissions attribuables aux engrais ». Le contenu du rapport orientera les efforts déployés par AAC, en collaboration avec le secteur, pour atteindre la cible nationale de réduction des émissions attribuables aux engrais de 30 % par rapport aux niveaux de 2020 d’ici 2030, rendant la production alimentaire de plus en plus

durable et ouvrant de nouveaux débouchés économiques.
Les consultations ont mis en lumière un désir d’améliorer la communication et d’accroître l’engagement entre le gouvernement et le secteur agricole. À cette fin, en partenariat avec le secteur, un nouveau groupe de travail sur les engrais sera établi sous l’égide du Comité consultatif sur la Stratégie pour une agriculture durable. En tant que coprésident du Comité, AAC collaborera avec le nouveau groupe de travail pour atteindre les objectifs suivants :
• renforcer le dialogue entre l’industrie et le gouvernement afin d’échanger des renseignements et des pratiques exemplaires et de trouver des ressources pour réduire les émissions attribuables aux engrais;
• examiner les mécanismes qui nécessitent un soutien supplémentaire, tels que le financement de programmes et l’adoption de pratiques de gestion bénéfiques (PGB);

• améliorer la mesure et le suivi des réductions des émissions attribuables aux engrais dans le secteur. Les consultations permettront aussi au gouvernement du Canada de s’assurer que ses programmes appuyant l’adoption des pratiques de gestion bénéfiques, l’acquisition de technologies propres et la recherche et l’innovation soient adaptés à la réalité du terrain.
Les faits en bref
• Les engrais sont un intrant essentiel pour les cultures agricoles du Canada. Cependant, l’application d’engrais synthétiques crée un puissant gaz à effet de serre qui est environ 300 fois plus puissant que le dioxyde de carbone. Les émissions liées à l’utilisation d’engrais sont la seule catégorie d’émissions agricoles du Canada qui devrait augmenter de manière signifi-
cative jusqu’en 2030 si le statu quo est maintenu. Il est nécessaire de relever ce défi pour que le secteur agricole puisse continuer de croître tout en contribuant à l’atteinte des objectifs du Canada en matière de changements climatiques.
• La consultation publique est en cours et les Canadiennes et Canadiens sont invités à faire part de leurs idées en ligne jusqu’au 31 mars.

C’est du 11 au 13 avril que se tiendra la 7e édition de l’Expo-printemps du Québec à Victoriaville. Rassemblant les jugements des races de vaches laitières Ayrshire, Holstein et Jersey, cet événement accueillera plus de 250 sujets provenant du Québec et d’autres provinces canadiennes. En plus des jugements, une vente d’animaux de race Ayrshire Élite proposera une sélection de plus de 25 lots de grande qualité pour quiconque désire améliorer son troupeau.

Plus de 2000 visiteurs du Québec, du Canada et de l’international sont attendus sur le site de l’Exposition de Victoriaville. Ceux ne pouvant se déplacer pourront heureusement suivre l’action via la webdiffusion des différents jugements.
Du nouveau
Nouveauté cette année : l’Expo-printemps aura la chance d’être l’hôte de la convention nationale Holstein Canada, ce qui augmentera le volume d’exposants et de visiteurs et fera du jugement Holstein un jugement reconnu nationalement.
Les éleveurs auront également la chance de découvrir plusieurs compagnies de machineries agricoles à travers les kiosques commerciaux qui seront présents dans le pavillon Agri-Sport.
L’accent sur la relève
Des ateliers de formation portant sur différents sujets, dont la génétique, la vente et les techniques de jugement, seront offerts gratuitement aux écoles d’agriculture. Les jeunes seront également mis en évidence le mercredi 12 avril lorsqu’ils prendront part au concours de présenta-

tion offert gratuitement aux 25 ans et moins. Ce concours de présentation vise à apprendre aux jeunes à montrer leur animal sous son meilleur jour, et ce, avec une aisance naturelle.
En plus d’être une occasion de promouvoir l’élevage laitier, le rassemblement de toutes les races laitières permettra un rayonnement encore plus grand dans l’industrie, puisque les meilleurs sujets y seront présentés.
Programmation
Mardi 11 avril
18 h : Vente Élite Ayrshire; Mercredi 12 avril
8 h : Jugement Ayrshire et Jersey (Juge Ayrshire : Kurt Wolf, juge Jersey : Richard Landry);
15 h : Jugement des génisses Holstein et Holstein Rouge et Blanc en alternance (Juge Holstein : Mike Duckett);
20 h : Concours de présentation pour les jeunes âgés de 25 ans et moins, présenté par Holdstar génétique (Juge Holstein : Frédéric Dubois);
Jeudi 13 avril
8 h : Jugement des vaches Holstein et Holstein Rouge et Blanc en alternance
13 h : Tailgate du Championnat Suprême, présenté par Blondin Sires.
www.expoprintempsduquebec.com
Québec Vert accueille favorablement l’annonce des deux paliers de gouvernement d’investir davantage dans l’agriculture durable et l’adoption de bonnes pratiques environnementales dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable.

Les entreprises du secteur de l’horticulture ornementale, environnementale et nourricière que représente Québec Vert travaillent depuis plusieurs années à réduire leur empreinte environnementale par l’adoption et l’amélioration de pratiques respectueuses de l’environnement.
Par conséquent, la Fédération accueille favorablement tout programme ou investissement gouvernemental qui vise à favoriser l’adoption de pratiques durables. Québec Vert espère par ailleurs que les programmes développés dans le cadre du Partenariat canadien pour une agriculture durable seront adaptés aux besoins du secteur et à ses particularités, notamment en ce qui a trait à la durée des cycles de production des végétaux qui peuvent s’étaler sur plusieurs années.
Québec Vert souhaite également rappeler que le secteur de l’horticulture ornementale, nourricière et environnementale, composante à part entière de
l’agriculture, est un partenaire de choix dans la mise en place de pratiques agroenvironnementales. En effet, une utilisation et des aménagements judicieux de végétaux produits au Québec contribuent de différentes façons à améliorer la santé et la conservation des sols, à diminuer les coûts énergétiques et à lutter contre les changements climatiques.
Québec Vert est une fédération composée de 12 associations d’entreprises et de professionnels œuvrant en horticulture ornementale, nourricière et environnementale. Porte-parole de la communauté du végétal et du paysage, sa mission est de représenter et de promouvoir le secteur de l’horticulture ornementale, nourricière et environnementale et en favoriser la croissance dans une perspective de développement durable.
Le Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable) entrera en vigueur le 1er avril 2023. Ce nouvel accord quinquennal conclu entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux permet de renouveler l’appui au secteur agricole canadien afin qu’il demeure un chef de file mondial de l’agriculture durable sur les plans environnemental, économique et social.
Par le PCA durable, les programmes de gestion des risques de l’entreprise dont le financement est partagé entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sont reconduits.
Agri-stabilité
Le programme Agri-stabilité est pour sa part bonifié à compter de 2023 afin de protéger les producteurs contre les baisses importantes de revenu agricole attribuables aux pertes de production, à la hausse des coûts et aux conditions du marché. Ainsi, en participant à Agri-stabilité, l’entreprise dont la marge de l’année diminue de plus de 30 % par rapport à sa marge de référence pourrait bénéficier d’un paiement représentant dorénavant 80 % de la baisse de marge au lieu de 70 %



De plus, les producteurs du Québec qui participent à Agri-stabilité ont accès à un programme complémentaire, Agri-Québec Plus, qui intervient dans les secteurs non couverts ou associés au Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA) et à la gestion de l’offre. Le paiement du programme Agri-Québec Plus correspond à l’écart entre le montant du paiement d’Agri-stabilité et le montant d’un paiement calculé selon des paramètres similaires et couvrant 85 % de la marge de référence. La complémentarité des deux programmes générera aussi une augmentation du taux de paiement à AgriQuébec Plus qui passera de 70 % à 80 %.
Date limite
Pour participer à Agri-stabilité, les entreprises ont jusqu’au 30 avril pour payer leur contribution auprès de la Financière agricole du Québec afin de protéger leur marge.
Avec plus de 6000 bêtes, les propriétaires de chevaux de la Mauricie doivent produire ou acheter l’équivalent de plus de 1 216 667 petites balles carrées de foin ou 21 900 tonnes. Cela fait beaucoup de foin à produire et à acheter pour les propriétaires de chevaux! Mais comment reconnaître du bon foin à chevaux?



Besoin
Avant même de défaire une balle de foin, la première étape consiste à établir le niveau de qualité du fourrage dont les chevaux ont besoin selon leur travail, leur stade physiologique, leur race, etc. Par exemple, un poulain en croissance n’aura pas les mêmes besoins en protéines qu’un cheval âgé qui vit au pâturage. De même, les besoins énergétiques d’un cheval de course diffèrent de ceux d’une jument en gestation. Il faut toujours garder en tête que le cheval est d’abord un herbivore et que les concentrés viennent seulement balancer les éléments manquants dans les fourrages. Il est donc plus avantageux d’offrir un foin d’excellente qualité, fauché jeune, et de réduire les concentrés que de donner aux chevaux un foin mature avec beaucoup de concentrés.
Sa composition et son apparence
La seconde étape pour évaluer le foin consiste à l’inspecter à l’œil et au toucher en déballant quelques balles. Les feuilles étant plus nutritives et plus digestibles que les tiges, le foin doit être agréable au toucher parce qu’il contient une bonne quantité de feuilles souples plutôt que raide à cause d’une abondance de tiges. Les chevaux sont capables de trier le foin avec leur fine bouche et ils préféreront un foin avec un ratio feuilles/tiges élevé.

Aussi, apprenez à reconnaître les graminées et les légumineuses les plus courantes telles que la fléole des prés
légumineuses contiennent plus de protéines que les graminées. Un foin à teneur élevée en légumineuses est préférable pour des animaux en croissance ou en lactation tandis qu’un foin à dominance de graminées convient plutôt aux chevaux à l’entretien ou en entraînement. Il est aussi très important de distinguer les mauvaises herbes des plantes désirables. Un peu de jeune chiendent n’est pas trop problématique, alors que la présence de prêle des champs, de moutarde, de trèfle alsike et de fougères est nocive pour les chevaux.
Également, il faut noter le stade de maturité auquel les plantes ont été fauchées. Plus le foin est mature, plus il est fibreux et plus il contient des épis de tiges et de fleurs. Il sera alors moins nutritif. La teneur en énergie diminue drastiquement dans les graminées après l’épiaison.
La couleur idéale d’une balle de foin tire sur le vert ou le vert pâle. Il arrive parfois que certaines balles soient décolorées en partie et que leur teinte s’approche du jaune pâle, à cause du soleil. Cela affecte
seulement leur contenu en vitamine A et elles peuvent malgré tout être de bonne qualité. Cependant, assurez-vous que l’intérieur de la balle n’est pas décoloré, car cela peut être un signe que le foin a été trop longtemps au champ avant qu’il ne soit pressé ou mis en balle. S’il est resté à la pluie ou s’il a été insuffisamment séché ou mal entreposé, le foin aura une apparence brunâtre et il risque de contenir des moisissures et de la poussière.
Son odeur
Un bon foin sera agréable à sentir tandis qu’un foin ayant chauffé aura une odeur forte, piquante, de moisi et peu agréable. Les nez fins peuvent sentir les moisissures avant même d’en voir les traces.
Les chevaux sont très sensibles à la poussière, et les moisissures sont toxiques pour eux. Il est donc recommandé d’ouvrir plusieurs balles qui sont susceptibles d’être de moins bonne qualité afin de vérifier la présence de moisissures et de poussière : balles brunâtres, celles qui
ont une drôle d’odeur ou qui sont plus pesantes que les autres. Comme la météo au Québec ne rime pas toujours avec foin sec, il est tolérable d’avoir un faible pourcentage de balles poussiéreuses dans un lot, surtout lors de la première coupe. Il existe différentes solutions pour alimenter les animaux selon la dégradation du foin : faire tremper le foin dans l’eau, utiliser un purificateur de foin ou « hay steamer », secouer le foin et le défaire en brins à l’extérieur ou le jeter.
Une analyse essentielle
Trop souvent la grande oubliée, une analyse en bonne et due forme de la composition chimique est essentielle pour établir avec justesse la qualité d’un foin. À moins de 35 dollars l’analyse, vous pourrez déterminer précisément la valeur nutritive de votre foin et dans quelle mesure elle répond aux besoins de vos chevaux. N’hésitez pas à consulter votre spécialiste en nutrition animale afin de bien échantillonner vos balles pour l’analyse et de balancer la ration finale pour votre cheval selon les nutriments que votre fourrage contient réellement.

