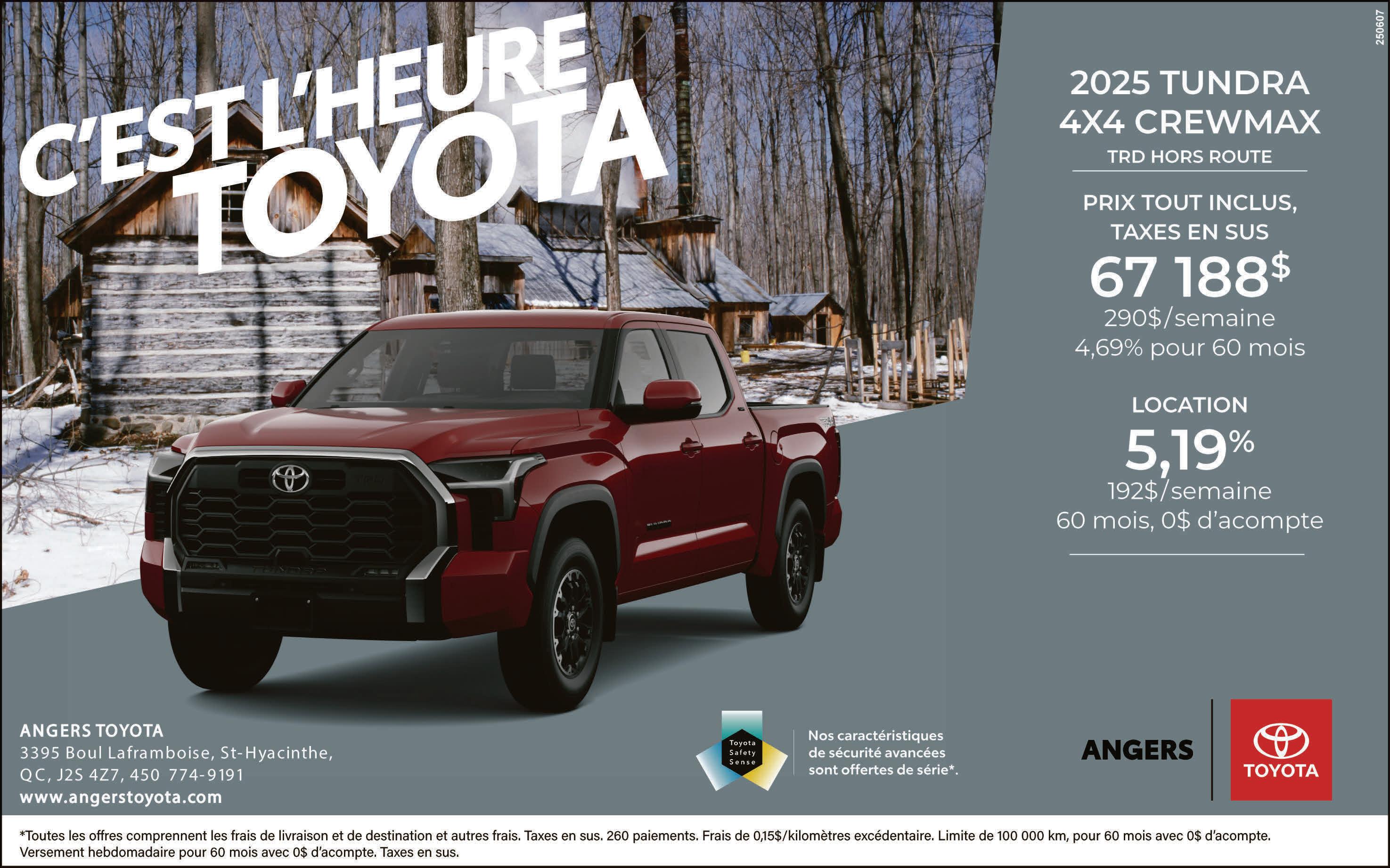Aussi dans cette
• Services Acéricoles Trudeau dévoile des nouveautés p. 3
• Les PPAQ font le point sur la saison 2025 p. 4 et 5
• L’IQDHO parle de fertigation p. 14






Aussi dans cette
• Services Acéricoles Trudeau dévoile des nouveautés p. 3
• Les PPAQ font le point sur la saison 2025 p. 4 et 5
• L’IQDHO parle de fertigation p. 14



Dans l’objectif de toujours mieux outiller les producteurs acéricoles dans leurs activités, leur situation, leur recherche de l’excellence et leur efficience, les équipementiers développent de nouveaux systèmes susceptibles de faire la différence. Pour la saison 2025, deux types d’équipement méritent d’être détaillés. Lisez ce qui suit.
Première nouveauté : l’adaptateur de marque DSD pour les chalumeaux 1/4. « L’adaptateur pour les chalumeaux 5/16 est un produit populaire depuis plusieurs années, mais l’adaptateur pour chalumeau 1/4 est nouveau et offre plusieurs avantages. Le trou d’entaillage étant de .225, cela réduit l’importance de
la blessure faite à l’arbre et limite les fuites », explique Martin Trudeau, de Services acéricoles Martin Trudeau, fondée il y a trois ans afin de pallier le manque de service d’installation observé dans la grande région de Sainte-Christine. « J’ai débuté en distribuant la marque MemProtec, puis j’ai ajouté la gamme de produits de DSD International et d’autres produits d’Industries Brassard et Plastech Chalumo », précise-t-il.
Optimum osmose
Seconde nouveauté, tout aussi importante : le MemPro 3000 HD à 12 000 HDSS, le concentrateur le plus compact sur le marché (49-1/2 po x 90 po). « On parle d’une nouvelle configuration d’osmose avec caissons simples. En option, deux caissons doubles supplémentaires sont disponibles pour une possibilité totale de 12 membranes. Cet appareil permet d’optimiser la performance de l’osmose pour les acériculteurs œuvrant dans un

L’adaptateur de marque DSD pour les chalumeaux 1/4. Photo : gracieuseté.
ÉDITEUR :
Benoit Chartier
RÉDACTEUR EN CHEF : Martin Bourassa
ADJOINTE À LA RÉDACTION : Annie Blanchette
TEXTES ET COORDINATION : Yves Rivard
CONTRÔLEUR :
Monique Laliberté
DIRECTEUR DU TIRAGE : Pierre Charbonneau
DIRECTEUR DE LA PUBLICITÉ :
Guillaume Bédard
ADJOINT AU DIRECTEUR
DE LA PUBLICITÉ : Simon Cusson
DIRECTEUR DE LA PRODUCTION : Alex Carrière
PUBLICITAIRES : Louise Beauregard
Manon Brasseur
Luc Desrosiers
Linda Douville
Miriam Houle
Michel Marot
Isabelle St-Sauveur
PUBLIÉ PAR:
TÉL. : 450 773-6028
TÉLÉCOPIEUR : 450 773-3115
SITE WEB : www.dbc.ca COURRIEL : admin@dbc.ca
créneau de 5000 à 20 000 entailles et qui souhaitent obtenir une haute concentration », note M. Trudeau. À noter : de conception unimodulaire facilitant l’installation, le MemPro permet une recirculation positive sur les membranes et peut être entièrement automatisé.
Des produits et des services pour l’industrie
Comme le fait valoir Martin Trudeau, il n’est pas rare de voir de nouvelles entre-
prises acéricoles nécessiter des servicesconseils en matière d’acquisition d’équipements et de services d’installation. « Notre entreprise est en mesure de s’acquitter de la planification, de l’installation de tubulures, d’intégration d’équipement dans divers types de locaux. Parfois, une entreprise qui décide de changer d’équipement a besoin de spécialistes pour calibrer le tout et s’assurer de la meilleure utilisation possible. Nous sommes là pour ça », conclut Martin Trudeau.

Le MemPro 3000 HD à 12 000 HD-SS, le concentrateur le plus compact sur le marché. Photo : gracieuseté.
Publié 12 fois par année par DBC Communications inc. 655, avenue Sainte-Anne, Saint-Hyacinthe, Québec J2S 5G4 Imprimé par Imprimerie Transcontinental SENC division Transmag, 10807, rue Mirabeau, Ville d’Anjou Québec H1J 1T7. Dépôt légal Bibliothèque nationale du Canada Copyright® Tous droits réservés sur les textes et les photos. Les articles sont la responsabilité exclusive des auteurs. Prix d’abonnement : 1 an (taxes incluses)...............40 00$ Poste publication - convention : PP40051633
27 000 exemplaires distribués dans Le Courrier de Saint-Hyacinthe et par Postes Canada aux producteurs agricoles dans les régions suivantes :
Montérégie-Est Montérégie-Ouest Centre-du-Québec
Prochaine édition 10 avril 2025 Spécial relève et famille agricole

Yves Rivard GTA
La saison acéricole 2025 ayant été officiellement lancée le 20 février, il nous est apparu pertinent de mettre quelques dossiers à jour, question d’anticiper ce à quoi la production de produits de l’érable risque de ressembler. Alors qu’au moment d’écrire ces lignes, dame Nature semble offrir de bonnes conditions, Joël Vaudeville, directeur des communications pour les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ), répond à nos questions.
GTA : Débutons par l’entente de principe pour la Convention de mise en marché 2025 et 2026. Quels éléments convient-il de souligner?
Joël Vaudeville : Les PPAQ sont tout d’abord très heureux d’avoir une entente négociée avec le Conseil de l’industrie de l’érable (CIE). Cette entente est de deux ans en ce qui concerne le prix du sirop d’érable, et de trois ans pour le normatif, ce qui constitue une première, le normatif étant habituellement arrimé à la période de fixation du prix. On parle ainsi d’une
hausse de prix de l’ordre de 2,6 % pour le sirop régulier en 2025, une hausse ramenée sur la production 2024 qui touche toutes les catégories de sirop. Pour 2026, la hausse se chiffre à 1,5 %. On parle donc d’une hausse de 4,1 % sur deux ans pour le sirop régulier. Cela dit, face au déséquilibre recensé pour le sirop biologique, l’offre pour ce produit étant supérieure à la demande depuis quelques années, on note une baisse de la prime bio, celle-ci passant de 0,22 $/livre à 0,18 $/livre. En 2022, on parlait d’un paiement de prime bio
avoisinant les 83 %, alors qu’en 2024, il est question de projections se situant sous la barre des 70 %. À l’heure actuelle, la réserve stratégique contient environ 80 % de sirop bio. Il se vend donc moins bien que le sirop régulier.
GTA : Comment expliquer cette baisse?
J.V. : À une tendance de marché liée à l’inflation observée dans le secteur de l’alimentation. Les consommateurs se sont probablement tournés vers le sirop régulier pour cause de coût inférieur. Cela dit, les données indiquent que pour

2024, l’offre se positionne à 161 % pour le sirop bio, donc 61 % en excédent. Pour revenir à la première question, il importe de préciser que le CIE augmentera son prélevé pour financer le fonds de classement, déficitaire depuis quelques années. Le prélevé de 0,0075 $/livre pour le classement est augmenté à 0,0125 $/livre pour les membres du CIE afin d’être à parité avec celui des PPAQ. À noter : la période de classement sera prolongée du 30 octobre au 30 novembre, selon certaines conditions.
GTA : En novembre 2024, les PPAQ ont rejeté la proposition préliminaire de cibles de superficies acéricoles annoncée par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF). Où en est-on quatre mois plus tard?
J.V. : Vous avez sûrement vu notre canne de sirop spéciale envoyée à la CAQ pour dénoncer la situation? Depuis, les négociations ont repris. Les changements survenus aux postes de sous-ministre et du conseiller politique au dossier ont été vus comme une volonté d’ouverture. Nous sommes toutefois loin de la coupe aux lèvres, et la lenteur des discussions inquiète nos membres. Nos représenta-


tions auprès du public se poursuivront, car il s’agit d’un choix collectif : coupe-ton les forêts du Québec pour faire des pâtes et papiers ou les préserve-t-on pour enrichir notre patrimoine et donner lieu à une activité économique telle que l’acériculture, qui permet l’équité des usages? La balle est du côté gouvernemental. On parle toujours de la mise en production acéricole à court, moyen et long termes de 200 000 hectares de forêt publique, dont 25 000 hectares
pour les dix prochaines années et 35 000 hectares pour les dix années suivantes. Sans nouvelle entente, on est toujours au même point : les industriels du bois continuent à couper les plus beaux érables, et c’est l’incertitude pour notre filière. Mais, notre patience a des limites. Le public doit être informé de ce qui se passe. Un érable prend de 50 à 60 ans avant d’être mature. Les décisions qui ne se prennent pas aujourd’hui auront des impacts dans le futur.
GTA : Pour 2024, l’industrie a enregistré une récolte record de 239 millions de livres de sirop d’érable. Une belle surprise après des années plus difficiles. J.V. : Après des années en dents de scie, oui. En 2022, 211 millions de livres, en 2023, 124 millions : des résultats qui avaient affecté la réserve stratégique. Sans vouloir me livrer à des prédictions ou pronostics, au moment de cette entrevue, les grands froids ont certainement bien préparé le terrain en influant favorablement sur le taux de brix de l’eau d’érable, et le bon couvert de neige observé permet une bonne irrigation des sols. L’an dernier, tout avait débuté tôt, au début de février, et s’était terminé tard, soit en avril. Il y a eu deux saisons en une, ce qui ne devrait pas se dérouler cette année. En 2024, on recensait 52 millions d’entailles en production, une capacité de production qui devrait être un peu plus importante cette année en raison des nouvelles émissions d’entailles.
GTA : Il y a plusieurs semaines, le premier ministre du Québec, François Legault, a menacé l’administration Trump d’appliquer un tarif supplémentaire de 25 % sur le sirop d’érable. Avez-vous été consulté avant que cette possibilité soit évoquée?
J.V. : Absolument pas. Nous sommes présentement en pourparlers avec le MAPAQ pour préparer un plan advenant l’application de tels tarifs à l’exportation. Les PPAQ ont informé le ministre que

l’effet de doubles tarifs serait catastrophique sur la filière acéricole. Les pronostics parlent d’une baisse de marché de 25 % pour une hausse de tarif de 25 %. Nous comprenons ce que M. Legault a tenté de faire, mais en aucun cas, nous ne souhaitons voir le sirop d’érable québécois faire les frais d’une guerre commerciale entre les deux pays.
«L’offre pour ce produit [sirop bio] étant supérieure à la demande depuis quelques années, on note une baisse de la prime bio, celle-ci passant de 0,22 $/livre à 0,18 $/livre.
GTA : Advenant l’instauration de tarifs douaniers en hausse à l’exportation vers les États-Unis, la diversification de vos marchés, notamment vers les pays qui en sont friands au point de le vendre à 100 $ le gallon en boutique, ne rendraitelle pas votre production plus rentable?
J.V. : Nous travaillons sur la diversification des marchés depuis un certain temps. Nous sommes présents dans les grands marchés tels que le Japon, l’Australie, la Grande-Bretagne et l’Allemagne. Nous étudions plusieurs autres marchés, en collaboration avec Québec, notamment pour les stocks invendus à destination des ÉtatsUnis. On ne parle pas de petites quantités, mais bien de 100 millions de livres en 2024 pour une valeur de plus de 400 M$.




Pendant ce temps, pour le producteur, l’ensemble des coûts a doublé. »
Il y a cinq ans, Philippe Ouellette et Nathalie Vachon, copropriétaires d’une ferme de 90 hectares sise à SaintJoachim-de-Shefford, se sont lancés dans l’aventure de la production acéricole traditionnelle. Si, pour l’heure, l’entreprise se limite à une production de particulier, elle produit de 120 à 150 gallons annuellement. De quoi satisfaire sa clientèle. Mais la donne pourrait changer alors qu’une expansion est présentement à l’étude.
« Nous opérons toujours à la chaudière, lance M. Ouellette. La tradition, c’est bien, sauf quand il est question de prix. Nous en sommes présentement à revoir nos prix, car celui en vigueur un peu partout ne semble pas avoir bougé depuis 1963, soit 50 $ le gallon à la ferme. Mais, à l’épicerie, on parle presque de 10 $ la canne, ce qui revient à 80 $ le gallon.
Cela dit, le couple ne s’est pas lancé à l’aveuglette dans la production. « Plus jeune, j’ai travaillé pour la ferme Arès, à Fulford, là où j’ai appris toutes les techniques de préparation, d’entaillage, de collecte et de mise en conserve, explique M. Ouellette. Lorsque nous avons acheté la ferme, on y trouvait un équipement désuet, que j’ai remplacé, question d’être prêt si l’on obtient un quota. »
La vraie saveur du terroir
Outre son savoureux sirop clair de début de saison et l’ambré qui suit, la microentreprise offre également du beurre d’érable et du sucre granulé. La clientèle se rend à la ferme pour y faire ses achats ou passer ses commandes, une occasion de garder le contact et de miser sur le bouche à bouche pour hausser les ventes. Si tout va pour le mieux dans le plus sucré des mondes, Philippe Ouellette étudie présentement différentes possibilités d’expansion et de collecte, notam-

À La Cabane à Phil, toutes les opérations sont menées de manière traditionnelle, de l’entaillage à la mise en vente en passant par la collecte. Photo : gracieuseté.
ment la migration vers un système à tubulure pour la saison 2026. « Si ce projet se réalise, nous débuterons probablement par un lot de 1000 entailles à tubulures et poursuivrons le reste à la chaudière, confie-t-il. L’ingénieur qui est venu évaluer les possibilités de production a chiffré à 8000 le nombre d’entailles possibles sur une quinzaine d’hectares. Donc, annuellement, on pourrait ajouter des tubulures, car la collecte demande beaucoup de temps et de mains. Ce nouveau système me permettrait peut-être d’œuvrer seul ou presque. C’est à considérer. » Pour information : 450 776-4336.

Les consommateurs apprécient grandement le sirop clair de cette entreprise sise à Saint-Joachim-deShefford. Photo : gracieuseté.


Quand : les mardis 11 et 25 mars à 9 h 30
Au programme
11 mars | Aménagements favorisant la biodiversité et entretien des haies brise-vent
• Comment diversifier sa ferme pour une lutte intégrée optimale contre les insectes ravageurs
Geneviève Labrie, biologisteentomologiste, Ph. D.
• Tout savoir sur l’entretien des haies brise-vent
Benoît Poiraudeau, technicien agricole, MAPAQ
25 mars | Changements climatiques et résilience des sols
• Bilan des profils de sol de la saison 2024
Marie-Eve Bernard, agronome, conseillère en agroenvironnement et en santé des sols, MAPAQ
• Première étude québécoise sur la santé des sols en grandes cultures biologiques : résultats et perspectives
Stéphanie Lavergne, agronome, professeure en grandes cultures biologi-

ques, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
• Visez l’agriculture durable (santé
des sols) et la rentabilité à la ferme
Renaud Péloquin, producteur de grandes cultures et de veau de grain
Ces webinaires sont une initiative de la Direction régionale de la Montérégie du MAPAQ, en collaboration avec Expansion PME.
Consultez le calendrier des événements bioalimentaires du MAPAQ pour plus de détails et pour vous inscrire : quebec.ca/calendrierbioalimentaire.
Quand : les vendredis 21 mars et 4 avril à 9 h
Au programme
21 mars | Productivité des plantes fourragères : un enjeu au cœur de la rentabilité de votre entreprise!
• Du semis à la gestion des coupes : comment optimiser les rendements?
Julie Lajeunesse, agr., M. Sc., biologiste en gestion des plantes fourragères et petits fruits, Agriculture et Agroalimentaire Canada
• Est-ce que trop d’ensilage de maïs peut nuire à la rentabilité de nos fermes laitières?
Jean-Philippe Laroche, agr., M. Sc., expert en production laitière – nutrition et fourrages, Lactanet
• La qualité d’abord, sans compromettre le rendement!
Benoît Hivon, producteur laitier et copropriétaire, Ferme des Chenaux
4 avril | Le potentiel des technologies de pulvérisation intelligentes et des

pulvérisation intelligente : état des lieux et perspectives en grades cultures
• Produire sous couvert permanent Jean-Luc Laplante, producteur, Ferme Madrice
Ces webinaires sont une initiative des directions régionales de la Montérégie, de la Mauricie, du Centre-du-Québec et de Montréal-Laval-Lanaudière du MAPAQ, en collaboration avec Expansion PME.

COLLECTIF EN FORMATION AGRICOLE

Guylaine Martin agr. Répondante en formation agricole
Il est maintenant possible d’obtenir une Attestation d’Études Collégiales (AEC) en Entrepreneuriat et gestion d’entreprise agricole grâce à son expérience dans ce domaine. Une démarche de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) conduit à l’obtention de ce diplôme.
La RAC permet à celles ayant appris ailleurs qu’en milieu scolaire (ou qui ont été formés à l’étranger) de passer directement à l’étape de l’évaluation de leurs compétences, ce qui leur évite d’avoir à suivre des cours dans lesquels elles réapprendraient ce qu’elles savent déjà. La démarche se fait entièrement à distance en tenant compte des besoins de la participante et de ses multiples obligations.

• Attestation d’études collégiale (AEC) en production maraichère biologique
• Diplôme d’études collégiales en gestion et Technologies de l’entreprise agricole (GTEA)
Valérie Plante Agente en formation agricole
En Montérégie, on dénombre 888 entreprises acéricoles, soit 643 en Montérégie-Est et 245 en MontérégieOuest. Elles représentent un total de 4 millions d’entailles sur les 53,92 millions distribuées partout au Québec. Afin de permettre aux acériculteurs et acéricultrices de se perfectionner, le Collectif en formation agricole de la Montérégie leur offre des formations pour les maintenir à jour dans les pratiques acéricoles, et ce, année après année.
térégie les outils nécessaires à la transformation de leurs produits. Pour le moment, seulement le cours de transformation de base a eu lieu à deux reprises, mais des cours plus avancés seront disponibles à la fin mai et au début juin.
La RAC est également disponible pour les diplômes suivants :
Pour plus d’information, communiquez avec Thierry de Rouville, conseiller pédagogique au Cégep de Victoriaville : DeRouville.Thierry@cegepvicto.ca ou 819 758-6401 poste 2750.
À l’automne dernier et au début de l’hiver, Parcours Formation a dispensé plusieurs formations, dont « Utilisation du GPS en érablière », « Aménagement acérico-forestier » et « Planification d’une installation de tubulures ».
Cette année, nous avons collaboré avec Doris Dallaire qui vient de la région de Chaudière-Appalaches afin de fournir aux producteurs de la Mon-
Le centre ACER, en collaboration avec AGRIcarrières, a développé la formation en ligne de trois heures « Tout savoir sur la filtration du sirop d’érable ». La dernière séance a eu lieu le 25 février, mais d’autres groupes seront disponibles dans les prochains mois. Par ailleurs, en Montérégie, nous avons collaboré avec le Centre ACER et les PPAQ pour perfectionner les acériculteurs et acéricultrices sur les sujets tels que la salubrité et l’assainissement pour améliorer le rendement et la qualité du sirop d’érable.
Pour savoir sur ce qui se passe, les PPAQ, en collaboration avec divers partenaires, animent le balado «La Station acéricole » depuis un peu plus d’un an. Il est disponible sur toutes les plateformes qui en offrent.
produits dans le cadre d’un projet de recherche est donc accessible sur la plateforme web www.irda.qc.ca.
À l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA), les équipes de recherche se consacrent à l’innovation et à l’amélioration des pratiques agricoles au Québec. La recherche couvre divers domaines, allant de la phytoprotection aux pratiques d’élevage, en passant par la santé des sols et la qualité de l’eau et de l’air. Les chercheurs collaborent, entre autres, avec des producteurs agricoles pour développer des technologies et des méthodes adaptées aux enjeux climatiques et environnementaux.
Au cours des dernières semaines, l’IRDA a mis en ligne son nouveau site web. Grâce à ce dernier, il est plus facile que jamais d’identifier les expertises et les résultats de recherche dont le milieu agricole a besoin. En plus de faire de la recherche et du développement, l’IRDA a aussi pour mandat de transmettre ses connaissances acquises afin qu’elles soient appliquées à la ferme. Ainsi, la majorité des documents
Des données sur les sols agricoles du Québec
Lors de sa fondation, le MAPAQ a confié à l’IRDA le soin de conserver l’information recueillie au fil des ans sur les sols agricoles québécois et de la rendre disponible. Vous trouverez donc à même le site l’information suivante :
• 37 fiches des séries de sols du Québec ;
• 17 cartes pédologiques du Québec incluant 837 feuillets cartographiques ;
• Cartes du potentiel agricole des sols du Québec, incluant 949 feuillets ;
• Résultats de vastes études sur l’état de santé des sols agricoles du Québec, dont la plus récente de 2023 ;
• La série de vidéos éducatives
« L’appel de la pelle ».
Quatre outils d’aide à la décision complémentaires pour la gestion de l’eau à la ferme et la conservation des sols agricoles
Face aux défis liés à la gestion de l’eau et des sols, l’IRDA met à la disposition du
secteur agricole quatre outils pour améliorer les pratiques à la ferme.
EstimEau
Permet d’estimer les besoins en eau de la ferme et la disponibilité de la ressource selon sa localisation.
Terranimo
Permet de comprendre, évaluer et diminuer l’impact du passage de la machinerie agricole sur les sols.
ProfilSol
Permet de qualifier la structure de sols pour obtenir des résultats élaborés quant à la structure du sol et de localiser les problèmes.
Horus
Permet l’accès aux données agronomiques et de propriétés de sol pour mesurer l’impact des pratiques agricoles d’une ferme.
Un balado sur la gestion de l’eau à la ferme – (Eau)trement dit (Eau)trement dit est un balado abordant différents sujets ayant trait à la gestion de l’eau dans le secteur agricole du Québec. Chaque épisode dure en moyenne

30 minutes et se retrouve sur le site web de l’IRDA, Apple Podcasts, YouTube, Spotify et Google Podcasts. Que vous soyez en voiture, au champ ou à la ferme, le balado est gratuit et facilement accessible sur votre téléphone. Bonne écoute !
Au cours des prochains mois, l’IRDA continuera à enrichir le contenu disponible dans son site web.
Communiquez avec nous à communications@irda.qc.ca pour toute question !



Le Programme des travailleurs étrangers temporaires a connu une hausse des demandes en raison de l’économie de l’après-pandémie, des faibles taux de chômage et du taux record de postes vacants en 2022. Pour remédier à ces pénuries, le Programme a adopté une série de changements de politiques ayant mené à la situation difficile vécue par de nombreux producteurs agricoles en 2024 à la suite du réajustement opéré. Fernando Borja, directeur général de la Fondation des entreprises en recrutement de main-d’œuvre agricole étrangère (FERME), y va de ses pronostics concernant la saison 2025.
Pour rappel, en date du 1er mai 2024, les évaluations de l’impact sur le marché du travail sont valides pour six mois (comparativement à 12 mois) pour assurer la représentation exacte des mesures du marché du travail; le pourcentage de la main-d’œuvre pouvant
provenir du Programme, volet des bas salaires, est passé de 30 % à 20 % pour tous les employeurs ciblés par le Plan d’action 2022; et les employeurs doivent étudier toutes les options avant de faire une demande d’évaluation de l’impact sur le marché du travail, y compris le recrutement auprès des demandeurs d’asile ayant un permis de travail valide au Canada. De plus, depuis le 1er janvier 2024, les employeurs ont l’obligation de réviser annuellement le salaire des travailleurs étrangers temporaires pour s’assurer qu’il reflète les hausses du taux salarial applicable à leurs poste et région de travail.
Délais et retards
Depuis 1989, FERME est le plus important partenaire en matière d’embauche à l’étranger pour la filière agroalimentaire. Son avis sur la situation est basé sur les interactions directes entre la main-d’œuvre et les employeurs. « Le gouvernement resserre de plus en plus les règles et a décrété plusieurs interdictions, ce qui rend difficile pour les entreprises de compter sur la main-d’œuvre
étrangère. Cette année, la situation risque fort d’être la même qu’en 2024, avec des délais et des retards qui affecteront la production, ce qui nous inquiète beaucoup », confie M. Borja.
Ce dernier révèle qu’une demande de révision des délais impartis a été acheminée au gouvernement. « Déposer une demande six mois seulement avant le début du travail en agriculture, c’est trop court. Les candidats sélectionnés doivent prendre des arrangements, ils ont des familles. Nous comprenons les défis auxquels fait face le gouvernement en matière de construction de logements et tout, mais dans le secteur agricole, c’est bien souvent l’employeur qui héberge les travailleurs étrangers. La situation est différente. Une souplesse à cet égard devrait être accordée. »
Cela dit, selon M. Borja, pour l’heure, la perspective d’imposition de tarifs par les États-Unis n’aurait pas eu d’impact sur la demande. « Bien sûr, certains producteurs sont inquiets. Devrai-je produire moins? Serai-je en mesure d’exporter? Beaucoup de questions, pas de réponses pour l’instant », note M. Borja.

Toutes catégories confondues, FERME a accueilli 21 612 travailleurs en 2024, dont 1374 pour le secteur agricole. « Nous nous attendons à une légère baisse pour 2025, en raison des réajustements de politiques gouvernementales », souligne-t-il.
Estimant recevoir une bonne écoute de la part du gouvernement, il n’entrevoit pas la possibilité de moyens de pression. « Pas pour nous, pas pour le moment. Nous travaillons en collaboration avec plusieurs intervenants, dont l’UPA. Notre message passe auprès du gouvernement : les travailleurs étrangers temporaires ne sont pas un fardeau, mais bien une ressource importante », conclut M. Borja.




Katie Blondeau agr., conseillère en serriculture, IQDHO, Projet de recherche dirigé par : Réza Némati, Ph. D., Chercheur en pratiques culturales, IQDHO
Il est maintenant évident que les changements climatiques ont un impact majeur sur l’agriculture et le secteur de l’horticulture ornementale en plein champ n’y échappe pas. Concrètement, les changements climatiques représentent des défis majeurs pour les producteurs qui devront s’adapter rapidement et modifier leurs pratiques actuelles.
La gestion de l’azote dans le sol en est un exemple, notamment par l’intensification des événements climatiques extrêmes, tels que les sécheresses prolongées et les pluies torrentielles. Ces phénomènes affectent la disponibilité en eau et l’efficacité des engrais conven-
tionnels, rendant nécessaire l’adoption de stratégies de gestion plus précises.
En horticulture ornementale, la production de thuyas est appréciée notamment pour leur esthétique et leur rusticité, toutefois, elle nécessite des quantités élevées d’engrais azoté (environ 150 kg d’azote par hectare). Afin d’assurer une croissance optimale en production, il est d’autant plus important d’améliorer la fertilisation tout en minimisant les pertes de nutriments dans l’environnement.
L’équipe de recherche de l’IQDHO s’est intéressée davantage à cet enjeu avec son projet de « Évaluation de la fertigation dans la culture de thuyas en champ – IA221719 ». Cette étude récente, réalisée sur deux ans, a démontré que l’efficacité de la fertilisation, qu’elle soit granulaire, par fertigation ou hybride, dépend fortement des conditions de pluviométrie. En période de sécheresse et de faible humidité, la fertigation offre un avantage, car elle favorise la percolation de nitrate jusqu’à la rhizosphère des thuyas. En revanche, dans des conditions de sol humide, la fertilisation gra-
nulaire se révèle plus performante, grâce à une diffusion progressive et une solubilisation plus lente.

L’étude menée par l’IQDHO a également analysé l’effet des doses et des méthodes d’application de l’azote sur la croissance des thuyas. Les résultats indiquent que la hauteur des thuyas n’est pas significativement influencée par la dose d’azote (0 vs 150 kg N/ha) ni par la méthode d’application (granulaire, fertigation ou hybride). En revanche, une dose de 150 kg d’azote par hectare a un impact positif sur le diamètre du tronc et la qualité générale des thuyas. Bien que la fertigation ait permis une amélioration de l’assimilation de l’azote, selon les analyses foliaires, cet avantage n’a pas encore conduit à des gains de croissance mesurables à court terme. À plus long terme, l’optimisation des pratiques de fertigation pourrait néanmoins entraîner des améliorations notables en termes de croissance et de qualité des thuyas.
À noter qu’il a aussi été observé que les thuyas âgés de trois ans (environ 3 pieds de hauteur) concentrent leur activité racinaire dans les 30 premiers centi-
mètres du sol. Cette information est essentielle pour maximiser l’efficacité des apports nutritionnels, favoriser une gestion durable des fertilisants et limiter les pertes par lessivage.



Kim Després Conseillère en relève et démarrage, Direction régionale de la Mauricie, ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)
Aussi emballant soit-il, le démarrage d’une entreprise agricole comporte plusieurs éléments à considérer : hausse des coûts d’exploitation, différentes réglementations, concurrence accrue et nécessité d’adopter des pratiques durables. Quand une entreprise en est à ses balbutiements, il peut sembler prématuré de parler de planification stratégique. Or, c’est à ce moment que celle-ci prend toute son importance.
La planification stratégique permet tout d’abord de clarifier les objectifs à long terme de l’entreprise et de définir sa vision. Elle offre une direction et un cadre de travail qui guideront l’entreprise tout au long de son existence. Elle évite de se perdre dans les détails du quotidien ou de s’éparpiller en poursuivant des occasions d’affaires qui ne sont pas alignées sur ses objectifs. Les risques auxquels sont exposées les entreprises agricoles sont nombreux.
Une planification stratégique permet d’identifier ces menaces et de développer des stratégies pour les atténuer. Elle propose aussi des mécanismes d’adaptation, comme la diversification des activités, l’adhésion à des assurances agricoles ou encore l’adoption de pratiques culturales plus résilientes.
Comme les ressources sont souvent limitées en phase de démarrage, une bonne planification stratégique permet de les maximiser. On peut optimiser les processus de production, identifier les sources de financement appropriées et la gestion des coûts pour améliorer la rentabilité.
Une telle planification permet aussi de s’ajuster aux tendances du marché et d’aligner ses objectifs en ce sens. On peut penser à l’accroissement de la demande pour les produits biologiques, aux changements dans les habitudes alimentaires des consommateurs ou aux exigences accrues en matière de pratiques durables. Cela contribue à maintenir une compétitivité à long terme, en ajustant la production, les canaux de distribution et la proposition de valeur.
Les étapes clés d’une planification stratégique
La première étape est de définir la vision et la mission. La vision est l’objectif à atteindre à long terme, tan-
dis que la mission explique le rôle à jouer pour y parvenir. Ces éléments doivent être clairs, concis et motivants.
Exemple : pour une entreprise qui se spécialise dans la culture de légumes biologiques, sa vision pourrait être de « devenir le principal fournisseur de légumes biologiques dans la région » et sa mission, de « produire des légumes frais, de haute qualité, respectueux de l’environnement, tout en soutenant l’agriculture durable ».
Par la suite, il y a lieu de faire une analyse FFPM (forces, faiblesses, possibilités, menaces) pour mieux comprendre la situation interne et externe de l’entreprise et identifier :
• Les forces (ex. : expertise technique, terres agricoles de qualité, accès à des subventions ou à du financement);
• Les faiblesses (ex. : manque de notoriété sur le marché, ressources financières limitées);
• Les possibilités (ex. : croissance de la demande pour des produits biologiques, accès à de nouveaux marchés);
• Les menaces (ex. : augmentation du nombre d’événements climatiques extrêmes, réglementations actuelles et à venir).
Cette analyse permet d’élaborer des stratégies qui misent sur les forces, tout en minimisant les faiblesses. Une fois cette étape terminée, il est temps de défi-

nir des objectifs clairs et mesurables. Ceux-ci doivent être alignés sur la mission et la vision et peuvent cibler divers domaines : la production, la rentabilité, les parts de marché, l’innovation, la durabilité, etc.
Exemples d’objectifs :
• Augmenter la production de 10 % d’ici 5 ans;
• Réduire les coûts de production de 5 % en adoptant des technologies plus efficaces;
• Élargir la part de marché en nouant des partenariats avec des distributeurs locaux;
• Obtenir la certification biologique d’ici 3 ans.
Une fois les objectifs définis vient le moment de mettre au point des stratégies pour les atteindre. Elles peuvent inclure la mise en place de nouvelles pratiques agricoles, l’acquisition d’équipements, le lancement de campagnes de marketing, ou encore l’exploration de différents canaux de distribution. Une approche intégrée qui combine à la fois des solutions à court terme et des perspectives à long terme est essentielle pour garantir la croissance de l’entreprise.
Quand les objectifs et les actions sont définis, la rédaction du plan d’action peut commencer. Ce document décrit en détail les actions à entreprendre pour mettre en œuvre les stratégies choisies. Il inclut des informations sur les ressources nécessaires (financement, personnel, équipements), le calendrier d’exécution et les responsables de chaque tâche. Il permet de s’assurer que chacune des étapes du processus stratégique sera exécutée efficacement et dans les délais impartis.
Les suivis et l’évaluation sont cruciaux pour que l’entreprise reste sur la bonne voie et adapte sa stratégie si nécessaire. Cela implique de définir des indicateurs clés de performance comme la rentabilité, la croissance des ventes, la réduction des coûts, etc. Des réunions régulières peuvent permettre de détecter des écarts et de prendre des mesures correctives en temps utile.
Enfin, il faut garder en tête que la stratégie doit être flexible et évoluer en fonction des résultats obtenus et des nouvelles informations. Si certaines actions ne mènent pas aux résultats attendus, ou si l’environnement du marché change, il faut ajuster ses objectifs et ses actions.
En résumé, la planification stratégique est un incontournable pour toute entreprise agricole en démarrage. Elle lui permettra de naviguer efficacement dans un secteur dynamique, en constante évolution, et contribuera à sa réussite à long terme.





Par ailleurs, les pratiques actuelles d’apport massif d’engrais azotés en trois fractions (50 kg de N/ha/an), souvent réparties entre mai, juin et juillet, ne garantissent pas une disponibilité suffisante en azote durant toute la saison de croissance, qui s’étend de mai à octobre au Québec. Les suivis des concentrations en nitrates dans le sol ont révélé des déficits critiques en azote à certaines périodes de la saison de croissance des thuyas, en fonction des précipitations.
Pour répondre à ces défis, cette étude recommande l’adoption d’une fertilisation dynamique. Cette méthode repose sur des apports fréquents et progressifs, ajustés en fonction des concentrations en nitrates dans le sol, du rythme de croissance des thuyas et des conditions climatiques, notamment les précipitations. Cepndant, des recherches complémentaires seront nécessaires pour perfectionner cette stratégie et maximiser ses bénéfices pour les producteurs.
Ce projet est financé par l’entremise du Programme Innov’Action agroalimentaire en vertu du Partenariat canadien pour l’agriculture, entente conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec.
Pour des informations supplémentaires sur le projet : IQDHO. Rapport final du projet IA221719, Évaluation de la fertigation dans la culture de thuyas en champ, Réza Némati et coll., 2025, 60 p.
L’IQDHO, l’Institut québécois du développement de l’horticulture ornementale, est un centre d’expertise unique au Québec. Pour plus de détails sur l’institut voici nos coordonnées :
3230 rue Sicotte, Bureau E-307 Saint-Hyacinthe, QC J2S 2M2 info@iqdho.com