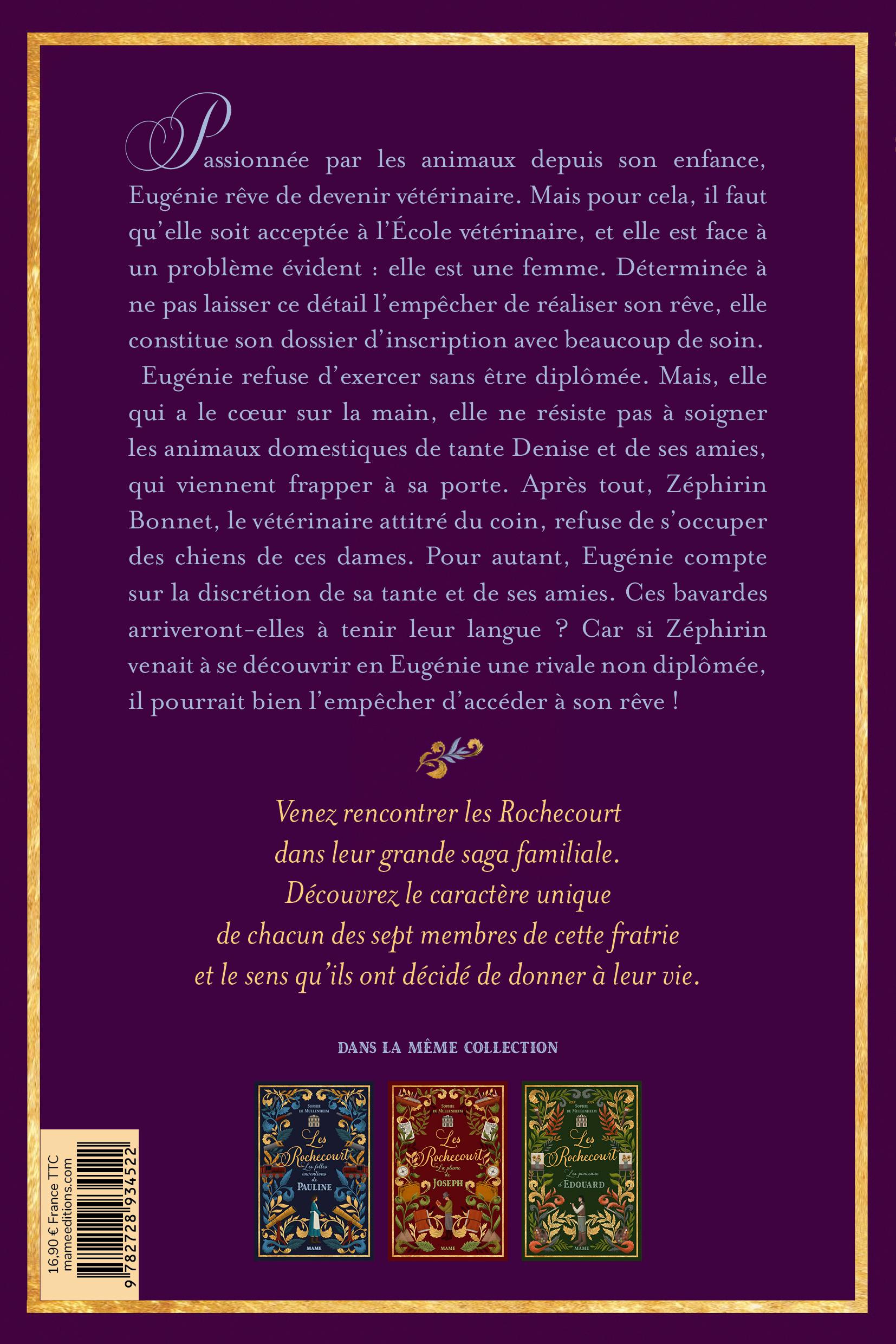Sophie de Mullenheim L’ambition
'
Eugenied’ d’
À Mathilde, suivras-tu les traces d’Eugénie ?
Normandie, avril 1897.
Madeleine ouvre la porte de l’arrière-cuisine en chantonnant, un panier de linge propre et humide sous le bras.
Le soleil est de retour, elle va pouvoir étendre la lessive à l’arrière de la maison pour que tout soit sec ce soir.
— Ah ! hurle-t-elle en découvrant la masse informe qui entrave le passage.
Madeleine pose précipitamment son chargement à ses pieds et dégringole les quelques marches.
— Mademoiselle Eugénie ! Mademoiselle Eugénie ! appellet-elle, affolée.
La jeune fille gît, inerte, en travers de l’escalier qui descend au jardin. Elle est d’une pâleur effrayante, les yeux fermés et cernés de noir, la bouche légèrement ouverte. Ses mains, son visage et le tablier qui protège sa robe sont maculés de sang.
— Seigneur Dieu ! bredouille Madeleine en se signant plusieurs fois. Mademoiselle Eugénie !
Elle se penche, hésite, n’ose pas toucher la jeune fille. Et si elle ne respirait plus ?
Madeleine regarde autour d’elle, paniquée. Elle cherche quelqu’un. N’y a-t-il donc personne par ici qui pourrait venir l’aider ?
— Mademoiselle Eugénie, répète-t-elle, la voix éraillée par l’angoisse.
Madeleine s’accroupit, tend la main, puis la retire vivement. Elle ne peut pas. C’est au-dessus de ses forces. Elle n’est pas préparée au pire. La domestique est entrée au service de la famille Rochecourt il y a presque vingt-cinq ans. Elle était alors une toute jeune fille, plus jeune qu’Eugénie aujourd’hui.
Elle a vu naître, grandir, s’épanouir et s’affirmer chacun des enfants de la maison. Elle a été engagée pour les choyer et les élever. Pas pour les voir mourir.
— Mademoiselle Eugénie, gémit-elle, éplorée.
Soudain, un très léger bruit lui parvient. Madeleine fronce les sourcils et tend l’oreille en retenant sa respiration. Le bruit se répète. Comme un souffle. Un ronflement discret. La domestique écarquille les yeux, perplexe, et fixe le visage d’Eugénie. Sa mine est affreuse, en effet, mais ses traits sont détendus. Plus bas, son tablier est maculé de sang, mais il se soulève tout doucement au niveau de la poitrine. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Eugénie respire…
et Madeleine aussi, pour le coup. La jeune fille vit ! Elle n’a rien ! Elle dort ! Elle ronfle même, très discrètement.
L’angoisse de Madeleine reflue tout à coup. Elle redevient lucide et se souvient de l’excitation d’Eugénie, il y a deux jours. Elle ricane de se trouver si stupide et d’avoir pu imaginer le pire.
Madeleine se penche enfin sur le corps d’Eugénie et la secoue par l’épaule.
— Mademoiselle Eugénie, gronde-t-elle sans grande conviction. Réveillez-vous, voyons.
Eugénie grogne, grimace et cligne des yeux. Quand elle les ouvre enfin et découvre Madeleine à quelques centimètres de son visage, elle esquisse une petite moue désolée.
— Ah, Madeleine… Tu es là ?
— Moi, oui, parce que c’est ma place, rouspète la domestique. Vous, en revanche, vous n’avez rien à faire ici !
— Je ne voulais réveiller personne, Madeleine. Et ne rien salir non plus, répond Eugénie, la voix encore pâteuse. Mais comme j’étais épuisée… j’ai dû m’endormir.
Madeleine lève les yeux au ciel.
— Ce n’est pas une façon de se tenir pour une jeune fille de votre âge, la gourmande-t-elle.
— Allons, Madeleine, je vais bientôt avoir 20 ans ! grommelle Eugénie.
— Justement. Il est grand temps que vous cessiez vos enfantillages.
Eugénie sourit franchement puis se redresse en grimaçant. Dormir sur la pierre d’un escalier n’a rien de très confortable.
— Ce ne sont pas des enfantillages, Madeleine, répliquet-elle. J’ai bien fait d’y aller, tu sais : Caprice a eu son petit.
— Peu importe. Vous ne me ferez pas croire qu’il est raisonnable de rester un jour et demi sans dormir, pour rester au chevet d’une jument !
Mais Eugénie n’écoute pas.
— Tu aurais vu ça, Madeleine. C’était magnifique !
— Et sûrement dégoûtant surtout, grogne la bonne en regardant le sang.
— Pierre et moi avons baptisé le poulain Brioche, annonce Eugénie, radieuse, car il a la couleur de tes délicieuses brioches. Tu l’aimeras tout de suite.
Mais Madeleine ne se laisse pas amadouer. Elle évalue déjà le temps qu’il lui faudra frotter pour rattraper les taches du tablier et celles de la robe également.
— Il est si beau ! Et il s’est mis debout presque tout de suite ! s’enthousiasme Eugénie.
La jeune fille poursuit son récit, le regard vague, indifférente aux bougonneries de la domestique. Elle revit chaque instant de la mise bas de la jument de Jean et Marie, les fermiers de la Petite Minote. Madeleine, elle, râle dans sa barbe et tente de lui retirer son tablier souillé.
Puis, quand elles ont terminé toutes les deux, Eugénie se tourne vers Madeleine et lui sourit.
— Pardon, Madeleine, s’excuse-t-elle. Je ne voulais pas t’ennuyer ni te tracasser.
Madeleine hausse les épaules.
— Allez, ce n’est rien, souffle-t-elle.
Et comme elle relève la tête pour sourire à son tour à Eugénie, son expression se fige. Elle ouvre la bouche, tend la main vers le visage de la jeune fille et pâlit.
— Mademoiselle…, bredouille-t-elle en portant la main à l’oreille d’Eugénie.
Lorsqu’elle la retire, elle a de petites croûtes de sang séché sur le bout des doigts.
— Votre oreille, s’alarme-t-elle. Elle a saigné.
— Oh, ça, ce n’est rien ! s’empresse de dire Eugénie, rassurante. Le sabot de Caprice m’a heurté pendant la mise bas. C’est ma faute. Je ne me tenais pas au bon endroit.
— Mais…
Eugénie porte la main à sa tempe et secoue la tête.
— Ce n’est rien. Je n’ai pas mal, je t’assure. J’ai été surprise, c’est tout.
Madeleine soupire profondément. Un jour, tout cela se terminera mal.
Tante Denise entre dans la salle à manger, précédée par Pauline, allée l’accueillir à son arrivée, et s’assoit lourdement sur l’une des chaises autour de la table. Jules Rochecourt, qui a posé son journal précipitamment, se lève pour embrasser sa tante.
— Tante Denise ! Que nous vaut l’honneur de votre visite ? demande-t-il, aimable.
La vieille dame soupire bruyamment et simule une fatigue intense.
— Ah, mes enfants ! Quelle journée !
Jules Rochecourt lève un œil amusé vers sa fille Pauline qui lui sourit, complice. Aujourd’hui, leur vieille tante est arrivée si tôt que la journée a à peine eu le temps de commencer. Eux-mêmes, pourtant matinaux, n’ont pas encore terminé leur petit déjeuner.
— Voulez-vous que je demande à Madeleine de vous préparer quelque chose pour vous remonter le moral ? propose alors la jeune fille d’une voix polie.
Tante Denise se retourne vivement vers sa petite-nièce, les yeux brillants de gourmandise.
— Oh ! quelle bonne idée, s’exclame-t-elle. Je pense que cela pourrait me faire du bien, en effet. Si je ne mange pas très vite quelque chose, je risque de tourner de l’œil.
Pauline se retient de pouffer et baisse simplement la tête pour acquiescer. Tante Denise est certainement la plus gourmande et la plus charmante pique-assiette qu’elle connaisse.
— Et demande à Madeleine de me mettre un peu de sa délicieuse confiture de prune avec la brioche, s’il te plaît, lance tante Denise au moment où sa nièce s’apprête à quitter la pièce.
La vieille dame se tourne alors vers son neveu dans un froufroutement de dentelles noires.
— Ta fille est adorable, mon cher Jules, le félicite-t-elle. Toujours prévenante et attentionnée.
Jules s’amuse du sans-gêne de sa tante, mais il ne peut qu’être d’accord avec elle à propos de Pauline. À bientôt 21 ans, sa fille est un trésor pour lui qui se sent vieillir. Elle a pris la décision de rester à la Minotière pour s’occuper de lui tandis que ses frères et sœurs prennent un à un leur envol. Quand elle n’est pas dans son atelier à fabriquer quelque étrange machine pour aider l’un ou l’autre, Pauline lui masse les épaules et le
dos souvent ankylosés par ses années de labeur à la minoterie1. Elle prend le temps de lire les journaux avec lui et de s’intéresser à l’actualité. Elle l’accompagne là où il a besoin d’aller : sur la plage pour se dérouiller les jambes, chez son vieil ami l’abbé Morand ou, dernièrement, en ville pour voir le brigadier Flairon et lui demander des nouvelles du cambriolage dont il a été victime et durant lequel les mémoires de sa défunte femme ont disparu.
— Vous êtes bien matinale aujourd’hui, ma tante, s’enquiert-il après un moment.
— C’est parce que j’ai promis à mon amie, Joséphine Caron, de venir vous voir.
Jules Rochecourt relève un sourcil étonné.
— Madame Caron ? répète-t-il.
Tante Denise hausse les épaules.
— La pauvre femme, la plaint-elle. Dieu me préserve de vieillir comme elle.
Jules Rochecourt se garde bien de sourire. À plus de 80 ans, tante Denise est plus âgée que son amie, mais elle affiche une santé rayonnante. Après des années de privations sous l’emprise du tyrannique et détestable oncle Léopold, il semble que la vieille dame devenue veuve ait entamé une deuxième jeunesse qui lui donne des ailes et un appétit vorace. À côté d’elle, la plupart des femmes de son âge paraissent de fragiles petites choses.
1. Une minoterie est une usine dans laquelle on transforme le blé en farine.
— Mais c'est pire encore pour son chien, déplore tante Denise.
— Son chien ?
— Il devient si vieux qu’il souffre d’arthrose.
— Ah…
Jules Rochecourt se demande si la sœur de sa mère ne lui fait pas une blague. Est-elle vraiment venue chez eux, presque aux aurores, pour parler du chien de sa vieille amie Joséphine Caron ?
— Eugénie est-elle là ? demande alors tante Denise.
Un chien. Eugénie… Bien sûr ! Jules Rochecourt aurait dû s’en douter.
— Elle dort, répond-il. Elle a assisté à un poulinage et elle a besoin de récupérer.
Tante Denise plisse le nez, déçue.
— J’avais promis à Joséphine qu’Eugénie viendrait voir son chien.
Jules Rochecourt secoue la tête.
— Tante Denise ! s’exclame-t-il. Eugénie vous a déjà répété maintes et maintes fois qu’elle ne soigne pas les animaux de compagnie.
— Ttt, ttt, fadaises ! répond la vieille dame. D’ailleurs, elle n’a jamais refusé un coup de main à aucune de mes amies.
— Sans doute parce qu’elle est trop bien élevée pour oser le faire, suggère Jules Rochecourt. 16
— Ta fille est très bien élevée, en effet, concède tante Denise, bonne joueuse.
La vieille dame aime énormément Jules et ses enfants qui se montrent tous très prévenants à son égard. Ils sont sa seule famille puisqu’elle n’a jamais eu d’enfants. Et à la mort d’Henriette, la femme de Jules, il y a déjà cinq ans, tante Denise a été très présente pour eux tous.
— Il n’empêche que ta fille aime ça, ajoute-t-elle. Et puis, à quoi sert un vétérinaire sinon à soigner les animaux ?
— Eugénie n’est pas encore vétérinaire, note son père.
— Et alors ? Il serait temps qu’elle se lance. Et, en plus, le vétérinaire du coin… ce Zéphirin Bonnet… il ne m’inspire pas confiance. Il ne s’y connaît qu’en vaches et en moutons. Pas en chiens.
— Eugénie non plus.
— Voyons, Jules, tu sais que ce n’est pas vrai. Ta fille a toujours été attirée par les animaux. Tous les animaux. Et en particulier les chiens. En plus, elle a déjà donné des conseils à Joséphine. Ce n’est l’affaire que de quelques minutes.
Jules Rochecourt lève les yeux au ciel. Il sait que sa tante ne lâchera pas l’affaire.
— Eh bien, ses conseils ne semblent pas avoir été très bons si votre amie doit de nouveau voir quelqu’un pour son chien, constate-t-il.
— Au contraire. Nestor a beaucoup apprécié.
— Nestor ?
— Le chien de Joséphine ! répond tante Denise. Si seulement tout le monde était aussi efficace que ta fille, même les hommes s’en sentiraient mieux. Et Hector souffrirait moins.
Jules Rochecourt fronce les sourcils. Il ne comprend plus rien.
— Hector ? interroge-t-il.
— Le mari de Joséphine ! précise tante Denise, agacée que son neveu ne suive pas. Lui aussi est perclus d’arthrose. Mais son médecin ne sait pas y faire.
Cette fois-ci, Jules Rochecourt se retient de rire franchement. Il glousse dans sa barbe grise et attrape son journal pour se donner de la contenance.
— Si les conseils d’Eugénie pour Nestor sont bons, Joséphine devrait peut-être les appliquer à Hector aussi, réfléchit soudain tout haut tante Denise.
— Tante Denise ! s’indigne Jules Rochecourt, atterré. Si vous continuez, je vais interdire définitivement à Eugénie d’aider vos amies avec leurs animaux. Vos idées saugrenues risqueraient de lui attirer des ennuis !
Le jeune homme vérifie l’adresse sur la petite annonce, puis lève les yeux sur la façade de la maison cossue bordée par une allée menant à une cour à l’arrière, où se trouvent les écuries. Deux colonnes d’inspiration antique encadrent la porte d’entrée surmontée par un fronton triangulaire qui rappelle les temples grecs. Le style est ostentatoire, un peu ridicule au milieu de l’alignement de maisons typiquement normandes qui bordent la rue. Sur la porte, une large plaque en cuivre confirme toute l’importance que le propriétaire des lieux accorde à sa personne.
Monsieur Zéphirin BONNET Docteur vétérinaire
Diplômé avec les honneurs de l’École nationale vétérinaire d’Alfort
L’étude rapide des lieux suffit à confirmer au candidat ce qu’il avait perçu en lisant l’annonce aux tournures ampoulées et prétentieuses. Il sait déjà à quel genre de personnage il va avoir affaire, et quelle attitude il va devoir adopter afin de mettre toutes les chances de son côté.
« Un jeu d’enfant », pense-t-il, satisfait.
Alors, sans hésiter, il lève la main, attrape le heurtoir en cuivre et frappe trois coups vifs. Presque aussitôt, un domestique en grande tenue ouvre la porte avec un air digne.
— Monsieur ?
— Je viens pour l’annonce, dit le jeune homme en montrant le journal qu’il tient à la main.
— L’annonce stipule que le docteur Bonnet ne recevra les candidats qu’à partir de dix heures et demie.
Le jeune homme sourit, l’air tout à fait aimable.
— Eh bien, disons que je suis un peu en avance.
— C’est que…, hésite le domestique.
Il dévisage le jeune homme avec une certaine défiance. Lorsque son maître a publié l’annonce pour un poste de secrétaire, il imaginait que les candidats seraient plus âgés et plus simples dans leur mise. Au lieu de cela, le jeune homme qui se tient devant lui doit avoir moins de la trentaine et il a des airs de fils de bonne famille. Bien habillé, les cheveux blonds légèrement longs et bouclés coiffés en arrière, la moustache parfaitement taillée, le visage un peu carré, les lèvres fines, il a le port droit et sûr de lui.
— Ne vous inquiétez pas, je peux attendre, le rassure alors le jeune homme d’une voix charmeuse. Cela ne me dérange pas du tout, ajoute-t-il en faisant un pas en avant.
Il émane de lui une sorte d’autorité naturelle qui oblige le domestique à reculer malgré lui. Après une courte hésitation et un regard dans la rue, il ouvre finalement la porte et fait pénétrer le candidat dans la maison.
Une fois à l’intérieur, le jeune homme observe tout autour de lui et fait mine d’attendre quelque chose. Le domestique se trouble. Il ne sait que faire.
— Félix Duvivier, se présente alors le jeune homme avec assurance. Vous pouvez m’annoncer au docteur Bonnet et lui donner mes références, ajoute-t-il en tendant au domestique une épaisse lettre manuscrite.
Le domestique déglutit. Ce n’est pas ainsi que les choses sont censées se dérouler, pourtant, il acquiesce d’un mouvement de la tête confus et disparaît rapidement derrière une porte donnant sur le vestibule.
Félix Duvivier ne peut s’empêcher de sourire. Il aime prendre l’ascendant sur les gens. C’est plus fort que lui. Pourtant, quand la porte par laquelle le domestique a disparu se rouvre, il se compose un air soumis. Il ne doit pas perdre de vue l’objectif qu’il s’est fixé : décrocher ce poste de secrétaire pour commencer une nouvelle vie, rangée et tout ce qu’il y a de plus respectable2.
2. Pour découvrir les précédents « exploits » de Félix Duvivier, lisez les aventures de Pauline, Joseph et Édouard.
— Monsieur Duvivier, l’appelle le domestique. Le docteur Bonnet vous attend, veuillez me suivre.
Le jeune homme se félicite intérieurement. Tout se passe exactement comme il l’espérait. En arrivant en avance, il ne laissera pas le temps aux autres candidats de rencontrer le vétérinaire. Le poste est pour lui, même si Zéphirin Bonnet ne le sait pas encore.
Le vétérinaire relève les yeux du courrier quand son domestique, Ferdinand, ouvre la porte sur le candidat. Il est très surpris de le découvrir si jeune, car la lettre qu’il a sous les yeux vante une expérience rare en matière de secrétariat vétérinaire. Mais, après tout, pourquoi pas ? Il n’y a pas que lui qui puisse être brillant en ce bas monde.
Zéphirin Bonnet est de ces personnes qui se croient supérieures aux autres par le seul fait de leurs études. En effet, depuis qu’il a décroché il y a quelques années, le précieux diplôme de l’École vétérinaire de Maisons-Alfort, Bonnet a le sentiment tout à fait délicieux d’être devenu quelqu’un. Il a maintenant une belle maison, une des toutes premières voitures avec un moteur de la région, des domestiques, un chien pure race, une table toujours bien garnie, une cave avec les meilleurs vins et du cholestérol plein les veines. Avec le temps, son ego a enflé proportionnellement à son ventre qu’il a désormais énorme. Il a le cheveu rare, mais le portefeuille plein ; les dents gâtées, mais un porte-plume en ivoire ; le nez épaté et veiné de rouge, mais des amis à la mairie, à la région
et quelques-uns même à Paris. En quelques mots, Zéphirin Bonnet est fier de sa position qu’il estime privilégiée et méritée.
— Monsieur Duvivier, votre expérience m’impressionne, dit-il d’emblée.
— Elle n’est rien à côté de la vôtre, docteur Bonnet, susurre le jeune homme habilement.
— Vous semblez déjà connaître beaucoup de choses.
— Ce n’est rien à côté de ce que vous pourrez m’apprendre.
Zéphirin Bonnet sourit de contentement. La flatterie est la meilleure des stratégies pour lui plaire. Félix Duvivier l’a tout de suite compris, et il en use et abuse sans modération. Ainsi, en quelques minutes à peine, le vétérinaire est séduit, au point d’en oublier de tester les connaissances de son interlocuteur, de passer outre son regard métallique qui le met mal à l’aise et de lui signer immédiatement une lettre d’engagement sans même prendre le temps de vérifier les références du garçon.
Lorsque Félix Duvivier quitte la maison près d’une heure plus tard, les candidats sont nombreux à attendre devant la porte.
— Messieurs, les salue le jeune homme, les yeux brillants de satisfaction. Je crains que vous ne deviez faire demi-tour.
Le poste est pourvu.
Il passe entre les postulants agglutinés à la porte et s’éloigne sans prêter attention aux murmures de mécontentement qui montent dans son dos. Félix Duvivier affiche un sourire satisfait. Sa nouvelle vie commence maintenant !
Pauline passe la tête par la porte des écuries. Elle aperçoit Alphonse et Pierre debout devant la dernière stalle, un peu à l’écart des autres, et juste à côté de celle où est entreposé tout le matériel pour harnacher les chevaux. Elle leur sourit et les rejoint.
— Alors, où est cette merveille ? leur lance-t-elle en guise de salut.
Les deux frères de la Petite Minote s’écartent légèrement pour la laisser passer.
— Po, je te présente Brioche, dit alors Alphonse d’une voix joyeuse.
Le poulain à la robe cuivrée et aux yeux bordés de cils immenses est collé au flanc de sa mère et les regarde avec curiosité.
— Comme il est beau ! s’exclame Pauline.
Pierre hoche la tête.
— Père et moi pensions qu’il n’arriverait jamais et nous commencions même à nous inquiéter, avoue-t-il de sa voix profonde et grave. Mais Eugénie disait qu’il prenait son temps pour se faire beau. Elle avait raison.
Pauline étudie le petit animal avec émerveillement.
— Comme la nature est bien faite, souffle-t-elle. Regardez-moi ça ! Tout est à sa place, en ordre de marche.
— Un peu comme tes machines, la taquine Alphonse.
Pauline relève la tête et fusille son meilleur ami du regard.
— Tu ne crois pas si bien dire, Al, se vexe-t-elle. La nouvelle lessiveuse que j’ai imaginée pour Madeleine fonctionne parfaite…
Alphonse la coupe par un éclat de rire.
— Je sais, Po ! Je sais. Je te rappelle que c’est avec moi que tu l’as essayée la première fois.
Pauline hausse les épaules et sourit. Alphonse et elle passent énormément de temps ensemble dès que le jeune homme ne travaille pas à la ferme de ses parents. Il est son assistant en toute occasion, son meilleur ami et confident. Ils se connaissent depuis qu’ils sont tout petits.
— Comment va Eugénie ? demande Pierre, de l’inquiétude dans la voix.
— Elle dort… Et Madeleine râle. Je te conseille d’ailleurs de ne pas te présenter avant plusieurs jours à la maison, Pierre, plaisante Pauline. Madeleine est furieuse contre toi. Elle prétend que c’est à cause de toi qu’Eugénie est rentrée couverte
de sang, épuisée et avec une mine affreuse. Tu la connais. Elle bougonne en répétant que ce n’est pas une façon de faire pour une fille Rochecourt et que tu es un irresponsable.
Pierre esquisse un sourire. Il imagine tout à fait la scène. Il n’empêche qu’il n’est pas serein.
— Et son oreille ? demande-t-il avec sérieux.
Pauline le regarde sans comprendre.
— Eugénie s’est pris un coup violent dans l’oreille, explique le jeune homme. Elle se tenait derrière Caprice qui a rué.
Pauline grimace. Elle l’ignorait.
— Je ne sais pas, avoue-t-elle. En tout cas, cela ne l’empêche pas de ronfler comme un sonneur !
— On parle de moi ? s’exclame une voix faussement courroucée dans leur dos.
Pauline se retourne tout en faisant un clin d’œil à Pierre.
— Au moins, elle n’est pas devenue sourde ! lui murmure-t-elle.
Eugénie est debout sur le seuil des écuries, fraîchement réveillée et toute pomponnée. Il est difficile d’imaginer que cette jeune fille à la robe parfaitement repassée et au chignon brun sagement tiré en arrière est la même que celle que Madeleine a trouvée affalée au pied de l’escalier de l’office un peu plus tôt dans la matinée. Elle a le teint frais en dehors d’une marque légèrement bleutée sur le côté droit du visage, au niveau de l’oreille.
— Tu es déjà réveillée ? s’étonne Pauline en souriant à sa sœur.
Eugénie plisse la bouche, les yeux rieurs.
— C’est préférable si je ne veux pas que tu racontes toutes sortes d’horreurs à mon sujet durant mon absence, répond-elle, mordante. Comment va-t-il ? demande-t-elle sans perdre davantage de temps.
Pauline sourit en la regardant s’avancer vers la stalle où se tiennent la jument et son petit. Elle connaît trop sa sœur pour savoir qu’elle ne pouvait rester sans nouvelles de son nouveau petit protégé pendant longtemps.
— Il est en pleine forme, répond aussitôt Pierre dont le regard noisette s’est illuminé à l’arrivée de la jeune fille. C’est un vrai glouton.
Comme pour donner raison au jeune homme, le poulain tend la bouche vers le flanc de sa mère pour téter.
— Les premières tétées sont les plus importantes, note Eugénie, satisfaite. Le premier lait, le colostrum, est très riche en anticorps de la mère. Cela lui sera très utile pour se défendre contre les maladies plus tard.
Pauline lance un regard amusé aux deux garçons.
— Si Madame le docteur le dit…, taquine-t-elle.
Eugénie ne relève pas l’allusion. Elle penche la tête sur le côté et étudie le petit avec un regard de connaisseuse. À côté d’elle, Pauline adopte inconsciemment le même mouvement. Alphonse ne peut s’empêcher de s’amuser intérieurement de cette similitude. Elles sont pourtant assez différentes physiquement. Eugénie est plus grande et plus charpentée que sa
sœur. Toutes les deux sont brunes, mais Pauline est aussi frisée et décoiffée qu’un mouton, tandis qu’Eugénie discipline ses longues boucles dans un chignon agrémenté d’une petite frange afin d’éviter que des cheveux ne lui tombent dans les yeux. Pauline a le nez petit et rond, les yeux noisette, Eugénie a le même profil grec que son père et les yeux marron.
— Il est magnifique, souffle Eugénie non sans émotion. La nature fait vraiment bien les choses.
— C’est exactement ce que vient de dire Po, constate Alphonse.
Mais Eugénie est déjà ailleurs.
— Pierre, tu as pensé à désinfecter le cordon ombilical avec des compresses de thym ? demande-t-elle en penchant la tête vers le ventre du poulain.
Pierre sourit. Il y a pensé, bien sûr. Eugénie le lui a répété dix fois avant de consentir à retourner chez elle.
— J’ai lu quelque part qu’il fallait…
— Eugénie, Eugénie, la coupe Pierre avec toujours la même voix douce et grave. Il va bien. Très bien. Ce n’est pas le premier poulain de la Petite Minote, tu sais.
Eugénie regarde son ami et acquiesce d’un mouvement de la tête. Elle a toujours admiré le calme de Pierre. Malgré son physique épais, ses mains énormes et ses larges épaules, elle n’a jamais vu quelqu’un d’aussi délicat, gentil et timide à la fois.
D’ailleurs, les animaux ne s’y trompent pas : ils font une immense confiance à ce grand garçon de ferme.
— Tu as raison, Pierre, souffle-t-elle. C’est juste que j’ai lu quelque part…
— Les livres ne savent pas tout, note son ami. Fais confiance à ton instinct.
Eugénie baisse la tête. Elle sait que Pierre a raison. Elle doit d’abord sentir les bêtes. Si elle veut devenir vétérinaire, les livres n’y suffiront pas.
— Comment va ton oreille ? demande alors le garçon pour changer de sujet.
— Comment ?
— Ton oreille, comment va-t-elle ?
— Tu dis ? Je n’entends pas bien, répond Eugénie en parlant fort.
Pierre pâlit aussitôt, inquiet. Mais Eugénie éclate de rire.
— Très bien ! Mon oreille va très bien, idiot. Ce n’est absolument rien.
Pierre plisse le nez tandis que Pauline regarde sa sœur, suspicieuse. Elle ignore tout de la violence du coup qu’Eugénie a reçu, mais elle la soupçonne de ne pas dire tout à fait la vérité.
Eugénie a toujours été résistante au mal.
Hier matin, la maison a été secouée par un hurlement en provenance de la chambre des filles. Tout le monde s’est précipité, redoutant un drame. Madeleine était debout devant le lit d’Eugénie, blanche comme un linge.
— Retirez-moi ça d’ici ! bredouillait-elle en montrant le matelas.
Le spectacle n’avait rien de très appétissant en effet : sur les draps, des tronçons de vers de terre continuaient de se tortiller péniblement ; une sauterelle aux pattes brisées cherchait à sauter hors du lit, en vain, et un scarabée à moitié écrasé n’avait plus la force d’avancer.
— Qu’est-ce que c’est que ces horreurs ? marmonnait la pauvre bonne.
Quand Eugénie est entrée à son tour, elle a pâli, elle aussi, et s’est mise à chercher partout.
— Où est-il ? Où est-il ?
Et elle soulevait le drap frénétiquement à la recherche d’on ne sait quoi.
Ce n’est qu’après un moment qu’elle a soupiré de soulagement et dégagé de sous un amoncellement de vêtements une petite boule de piquants, fort mignonne, il faut l’avouer.
— Mon hérisson, a murmuré Eugénie pour ne pas effrayer davantage l’animal qui s’est roulé en boule à cause des cris de Madeleine, certainement. Je lui ai apporté des insectes pour qu’il mange.
Madeleine détournait les yeux, dégoûtée.
— Quelle horreur !
Lorsqu’elle est entrée au service de la famille il y a quelques années, c’était pour s’occuper d’enfants. Pas d’animaux en tout genre. Ni pour nettoyer les garde-mangers de hérissons apprivoisés !
Malheureusement pour Madeleine, tout le monde fut sous le charme du petit animal. Et elle a eu beau nous dire qu’il était certainement couvert de parasites, personne ne l’a écoutée.
Ce n’est que le soir venu, lorsqu’Eugénie s’est couchée avec son hérisson et que nous avons découvert sa peau piquetée de petits trous dus aux piquants de son petit protégé, qu’il a été décidé qu’elle devait le relâcher.
Quel déchirement ! Eugénie était en larmes. Elle jurait qu’il ne lui faisait pas mal ! Mais comme rien n’y faisait, elle a tenu à installer son hérisson dans un nid douillet au pied de l’escalier extérieur de la maison.
Ce matin, au réveil, Eugénie s’est précipitée pour récupérer subrepticement son compagnon. Hélas, le hérisson était sans doute moins affecté qu’elle par la séparation. Il n’est plus à l’endroit où elle l’a si confortablement installé. Et Eugénie a beau chercher, elle ne le retrouve nulle part.
Assis sur le pas de la porte, Graindorge attend sa maîtresse, la tête tournée en direction de la Petite Minote. Madeleine, les bras chargés, veut sortir de la cuisine et grogne en le découvrant sur son passage.
— Graindorge, râle-t-elle, bouge de là ! Tu m’empêches de travailler.
Comme le chien ne cille pas, elle tente de le pousser doucement du bout du pied. Mais il ne réagit toujours pas et se plante même un peu plus fermement sur son arrière-train, bien décidé à montrer qu’il n’est pas question qu’il quitte son poste de guet.
Madeleine lève les yeux au ciel et soupire.
— Ce chien va me rendre folle, marmonne-t-elle en l’enjambant acrobatiquement.
Ce disant, elle ne peut s’empêcher de sourire. Quoi qu’elle en dise, de tous les animaux rapportés à la maison par Eugénie,
Graindorge est de loin son préféré. Parfois même, elle lui donne discrètement quelques restes des repas. La gouvernante ne l’avouera jamais, mais elle est même contente qu’il soit là. Un chien de garde à la maison, elle trouve que c’est une très bonne chose. Depuis que le bureau de Jules Rochecourt a été cambriolé, Madeleine s’inquiète que les voleurs reviennent. Au moins, avec Graindorge, elle se sent un peu plus rassurée. Même s’il ne quitte pas sa jeune maîtresse d’une semelle et dort dans sa chambre.
Soudain, Graindorge se redresse sur ses pattes, tend la tête et aboie joyeusement. En un clin d’œil, il dévale les quelques marches de la cuisine, manquant de renverser Madeleine qui revient, et se précipite vers Eugénie, de retour de la Petite Minote.
Lorsqu’il arrive aux pieds de la jeune fille, il se précipite dans ses jupons en agitant la queue et en se frottant à elle.
Eugénie rit, s’accroupit et gratte longuement la tête du chien qui se laisse faire avec un plaisir certain.
— Tu vois, dit-elle, amusée, je ne suis pas partie longtemps !
Graindorge pose sa tête sur les jupes de la jeune fille et reste ainsi, immobile. Sa truffe humide frémit, ses oreilles sont secouées de minuscules tremblements. Il est bien et s’il pouvait il ne bougerait plus de là.
Eugénie, rêveuse, continue de le gratouiller en pensant avec un pincement au cœur qu’il lui faudra se séparer de son chien
le jour où elle décidera de partir faire ses études. Comment y parviendra-t-elle alors qu’elle n’a même pas réussi à laisser
Graindorge à sa sœur Camille, qui vit pourtant à quelques centaines de mètres de là seulement ? Elle pensait lui offrir le chiot à la robe beige doré en guise de cadeau de mariage, mais elle n’avait finalement cessé de trouver mille excuses pour ne pas le faire.
« Dès qu’il est propre, je te le laisse », avait-elle dit.
« Je n’ose pas te le confier tout de suite, car il n’obéit pas bien, avait-elle argumenté ensuite. Ce ne serait pas un cadeau pour vous de l’avoir, pour le moment. »
« Maintenant que l’hiver est terminé, il perd ses poils. C’est infernal ! s’était-elle lamentée. Ce n’est vraiment pas le meilleur moment de l’accueillir chez vous. »
« Graindorge a un mauvais rhume. Je le soigne et je te l’amène. »
À chaque nouvelle excuse, Camille et son mari Charles avaient acquiescé, amusés. Un jour, ils avaient eux-mêmes trouvé un prétexte pour ne pas prendre le chien chez eux. L’air désespéré d’Eugénie à l’idée de la séparation leur avait fendu le cœur.
Depuis lors, Graindorge demeure auprès d’Eugénie même si, officiellement, il est le chien de Camille et Charles.
Soudain, Eugénie se redresse et défroisse sa longue jupe avec le plat de la main.
— Allons, il faut que j’y aille, lance-t-elle gaiement.
Graindorge redresse la tête, la regarde de ses yeux humides et agite la queue.
— Inutile de me faire les yeux doux, Graindorge, rigole Eugénie. Tu ne peux pas venir avec moi cette fois-ci.
Le chien n’écoute pas et tandis qu’elle veut avancer, il se colle à ses jambes avec insistance. Eugénie rit.
— Graindorge ! Tu vas me faire tomber !
Madeleine sort la tête de la porte de la cuisine.
— Ce chien est une vraie tête de mule, lui lance Eugénie en plaisantant. Il ne veut pas me lâcher d’une semelle.
Madeleine sourit.
— Je crois qu’il est jaloux ! dit-elle.
— Jaloux ?
— De tous les animaux de la ferme et de tout ce qui vous tient éloignée de lui.
Eugénie déglutit et regarde son chien avec tendresse.
— Tu es jaloux, toi ? murmure-t-elle.
Le chien agite la queue en guise de réponse. Alors Eugénie abdique.
— D’accord, dit-elle. Tu as encore gagné. Allons nous promener un peu tous les deux. Et ensuite, tu me laisseras y aller. D’accord ?
Graindorge jappe. Il a compris.
Eugénie est penchée sur le vieux chien de Joséphine Caron. Elle a finalement cédé à la demande pressante de tante Denise et l’a rejointe en fin de journée chez son amie pour examiner son chien. Eugénie a très peu de volonté quand un animal a besoin d’aide. Elle ne sait pas non plus résister longtemps à sa tante quand cette dernière a une idée derrière la tête.
La jeune fille masse doucement les pattes du caniche qui semble se détendre sous l’effet de ses soins. Elle regarde en souriant à demi la tête que l’animal laisse aller doucement sur le côté. Il a les yeux fermés et les babines légèrement relevées qui donnent l’impression qu’il sourit, lui aussi.
— Tu apprécies ça, Nestor, on dirait, s’amuse Eugénie.
En guise de réponse, le chien émet un petit grognement de gorge.
— Le faites-vous marcher un peu tous les jours comme je vous l’avais recommandé, madame Caron ? demande-t-elle.
La vieille dame rougit légèrement sous la couche de poudre blanche dont elle s’est enduit le visage. Il faut avouer que l’exercice n’est pas son fort et qu’elle préfère rester chez elle pour recevoir quelques amies et se tenir informée des derniers potins. Alors, forcément, le chien ne sort pas beaucoup. Et, avec l’âge, il prend du poids, s’empâte et se raidit.
Eugénie fronce les sourcils.
— Voyons, madame Caron ! la gronde-t-elle gentiment. Comment voulez-vous que Nestor aille mieux s’il ne bouge pas ? Un chien, même vieux, a besoin de se dépenser pour rester en forme. Si vous ne vouliez pas faire d’exercice, il fallait vous acheter un chien en porcelaine que vous auriez posé sur votre cheminée.
Joséphine Caron secoue la tête, choquée.
— Tout de même, ce n’est pas la même chose !
Eugénie sourit.
— Je disais cela pour vous faire réagir, Madame. Néanmoins, vous devez suivre mes conseils, sans cela Nestor souffrira de plus en plus de son arthrose.
La vieille dame lance un regard attendri à son chien et acquiesce d’un hochement de tête. Elle se promet de faire un effort.
— C’est comme ton mari ! lance alors tante Denise, goguenarde. S’il reste assis toute la journée, il ne pourra bientôt plus bouger.
— Nestor est plus facile à convaincre qu’Hector, grommelle Joséphine Caron.
— Ce qu’il faudrait à ton mari, c’est un bon médecin, fait remarquer tante Denise. Au moins, pour Nestor, tu as trouvé le meilleur vétérinaire du coin.
Eugénie relève un sourcil suspicieux et voit sa tante qui la regarde avec intensité. Alors la jeune fille secoue énergiquement la tête.
— Non, non et non, s’exclame-t-elle. Je vous l’ai déjà dit cent fois, tante Denise. Je ne suis pas vétérinaire. Du moins pas encore. Les études sont longues, je vous le rappelle, et je n’ai toujours pas intégré l’école.
— Allons, Eugénie. Tu joues sur les mots.
— Non, vraiment. Je ne le suis pas.
— Et qu’es-tu en train de faire, alors ? demande tante Denise, finaude.
Eugénie plisse le nez, lâche la patte du caniche comme si elle lui brûlait les mains et soupire.
— Je vous aide ! grogne-t-elle, vexée de s’être fait avoir une fois de plus. Et je n’aurais pas dû.
— Qui te le reprochera ? l’amadoue tante Denise. Joséphine ? ajoute-t-elle en se tournant spontanément vers son amie.
La vieille dame lève les mains en l’air.
— Surtout pas moi, répond-elle.
Tante Denise émet un petit rire satisfait.
— Tu vois ! assene-t-elle.
— Et que faites-vous du vétérinaire local ? demande Eugénie, piquée au vif.
— Zéphirin Bonnet ? interroge tante Denise.
— Lui-même. Je doute qu’il apprécie que je lui vole sa place alors même que je n’ai aucun diplôme.
Tante Denise hausse les épaules, moqueuse.
— Personne n’avait jamais eu de diplôme ici avant lui et les animaux ne s’en portaient pas plus mal. C’est au bon sens paysan et humain que nous avons fait confiance jusqu’à maintenant. Il n’y a pas de raison que les choses soient autrement.
— Justement, les temps changent, tante Denise, fait remarquer Eugénie. La science fait de jour en jour des progrès qui pourront profiter aux animaux.
— Mais ce Zéphirin Bonnet est un incapable, les coupe Joséphine Caron.
— Qu’en savez-vous ? demande la jeune fille. A-t-il seulement vu Nestor ?
La vieille dame secoue la tête.
— Il n’a jamais voulu me recevoir. Il prétend qu’il a d’autres choses plus importantes à faire que de s’occuper des chiens de ces dames.
— Quel mépris ! s’offusque tante Denise en surjouant l’indignation.
Eugénie se retient de sourire. Sa tante a toujours eu un sens du théâtre inné. Il n’empêche qu’elle n’a pas tout à fait tort.
— Il ne pourra pas t’accuser de lui voler une clientèle dont il ne veut pas, ajoute tante Denise pour enfoncer le clou.
En montant ton affaire, tu rendrais de fiers services à la communauté.
— Mais qui parle de clientèle ? s’énerve Eugénie pour de bon. Qui veut monter une affaire ? Je vous ai dit que je n’étais pas vétérinaire ! J’ai besoin d’étudier pour cela. Et je dois d’abord passer un concours.
Tante Denise soupire.
— Il ne faut jamais dire : « Fontaine, je ne boirai pas de ton eau », murmure-t-elle.
Cette fois-ci, les choses vont trop loin. Eugénie tapote gentiment le flanc de Nestor et se redresse, les yeux brillants de colère.
— C’est terminé, madame Caron. Je crois qu’il est temps pour moi de partir.
Joséphine Caron, qui perçoit la tension dans la voix de la jeune fille, n’insiste pas.
— Combien je te dois ? demande-t-elle simplement.
Eugénie claque la langue.
— Rien. Je suis venue vous aider. C’est tout.
— Mais sans toi, Nestor irait moins bien.
Eugénie grimace.
— Eh bien, considérez que j’ai fait cela uniquement pour Nestor et que, par conséquent, comme il ne peut pas me payer, il ne me doit rien.
— Tout travail mérite salaire, intervient tante Denise.
— Pas cette fois-ci, lâche Eugénie. Au revoir, Mesdames.
Elle tourne les talons et s’apprête à partir, mais s’arrête et se retourne.
— Ah, juste une chose !
Les deux vieilles dames la regardent, indécises.
— Considérez que c’est la dernière fois que je fais ce genre de chose. Je ne vous aiderai plus avant d’avoir décroché mon diplôme.
Une moue dépitée se lit sur les visages des deux amies. Eugénie fait un petit mouvement de la tête agacé, se détourne pour repartir et s’arrête une nouvelle fois.
— Et une deuxième chose ! ajoute-t-elle avec autorité. Ne vous avisez pas de raconter à vos amies que je suis venue.
Elle tourne les talons et quitte la maison. Dans son dos, les deux vieilles dames grimacent, gênées. Pour ce qui est de tenir leur langue, c’est déjà trop tard. En début d’après-midi, tante Denise, sûre d’elle, a raconté à toutes ses amies que sa nièce allait s’occuper de Nestor et qu’elle était disponible pour soigner leurs animaux de compagnie.