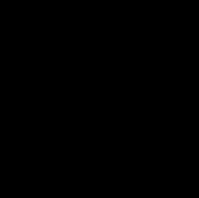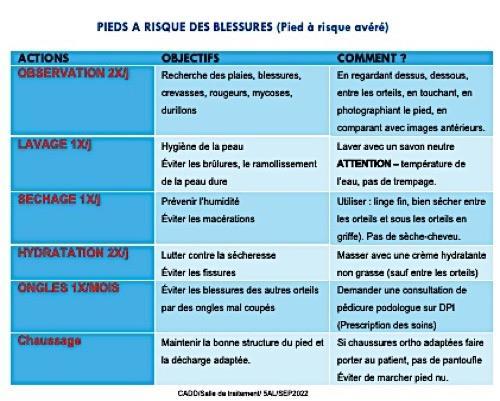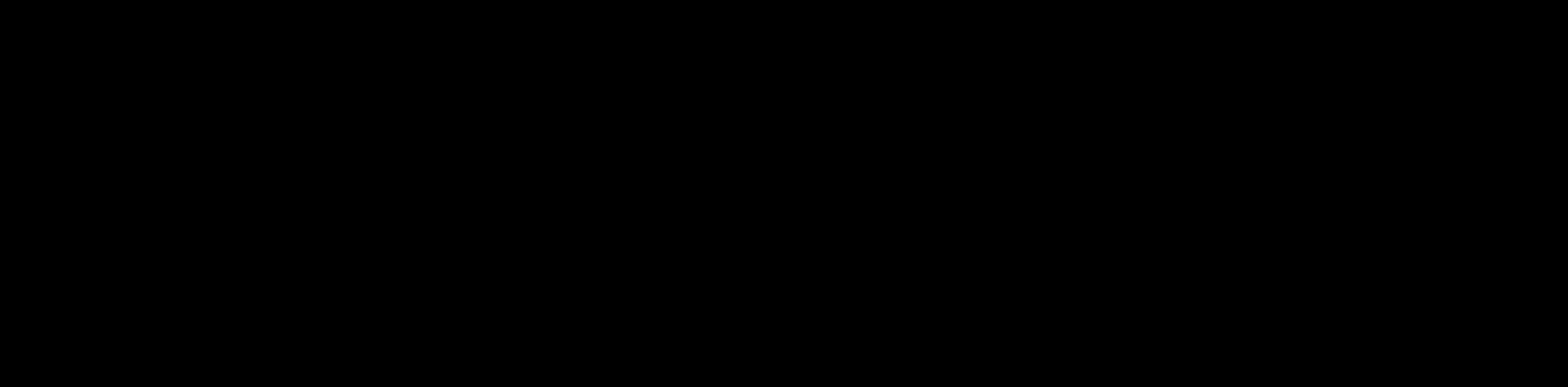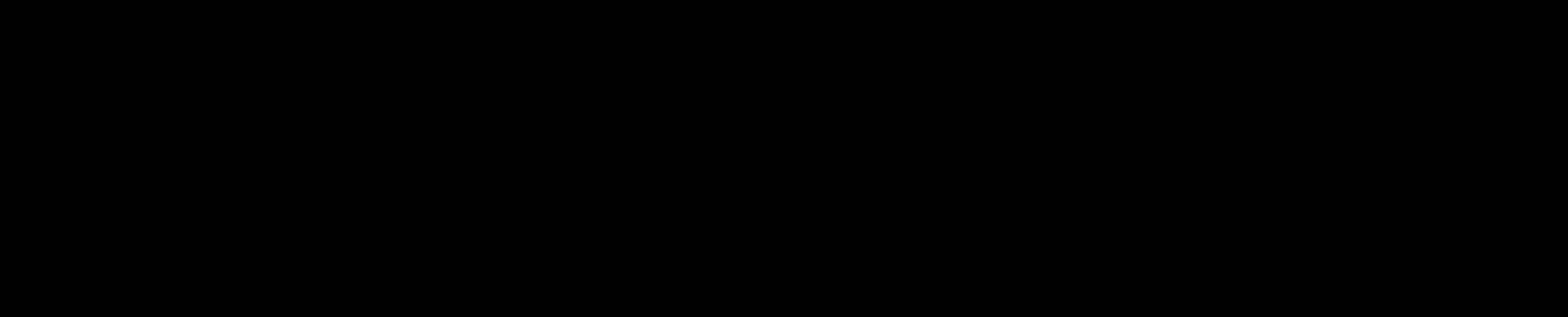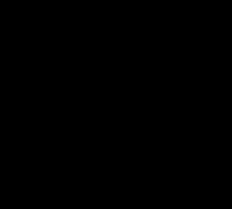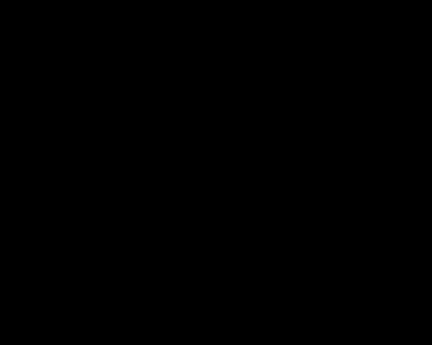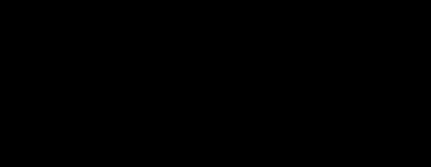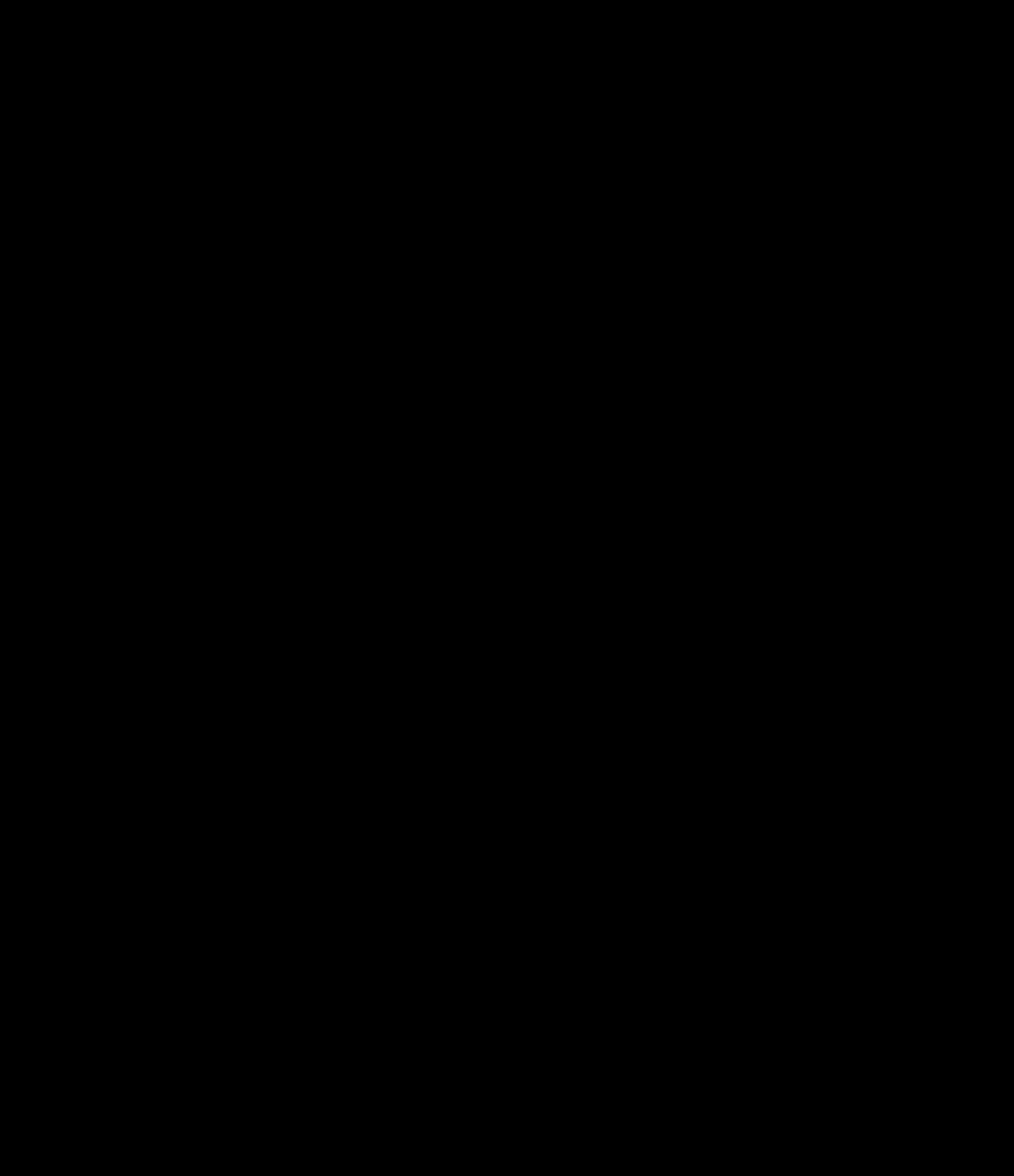La




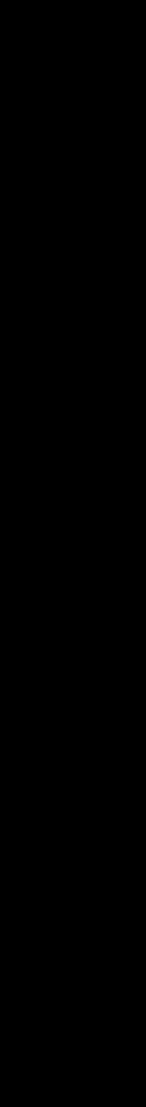


classe inversée et le temps de formation en présentiel pour le personnel soignant
Céline Josserand IS en soins de plaies, Vesselina Avramova IS en soins de plaies, Marie-José Roulin Adjointe à la direction des soins Direction des soins, programme plaies et cicatrisation
Début Fin..... Formation obligatoire

E-learning de 30min Atelier pratique de 45 min sur le terrain


N= 27 personnes ont répondu aux questionnaires transmis avant et après l'atelier

Implémentation de la thérapie à pression négative


Création d'une affiche
Création d'unTuto <2min
A8
Journée Qualité 2022
Projet de soins anticipés avec l’aide d’un jeu des valeurs
Expérience en soins aigus oncologiques, DONCO, unité 7BL

CONTEXTE
Etablir un projet de soins anticipés (ProSA) permet de connaitre, de respecter les valeurs et préférences des patients pour les soins et traitements à venir. Il est toutefois difficile de parler des démarches pour la fin de vie, tant pour les patients que pour les professionnels de santé.
OBJECTIFS
Intégrer l’avis (la vie) du patient et ses priorités en encourageant la parole .
Favoriser des décisions partagées, en préservant l’autonomie des personnes.
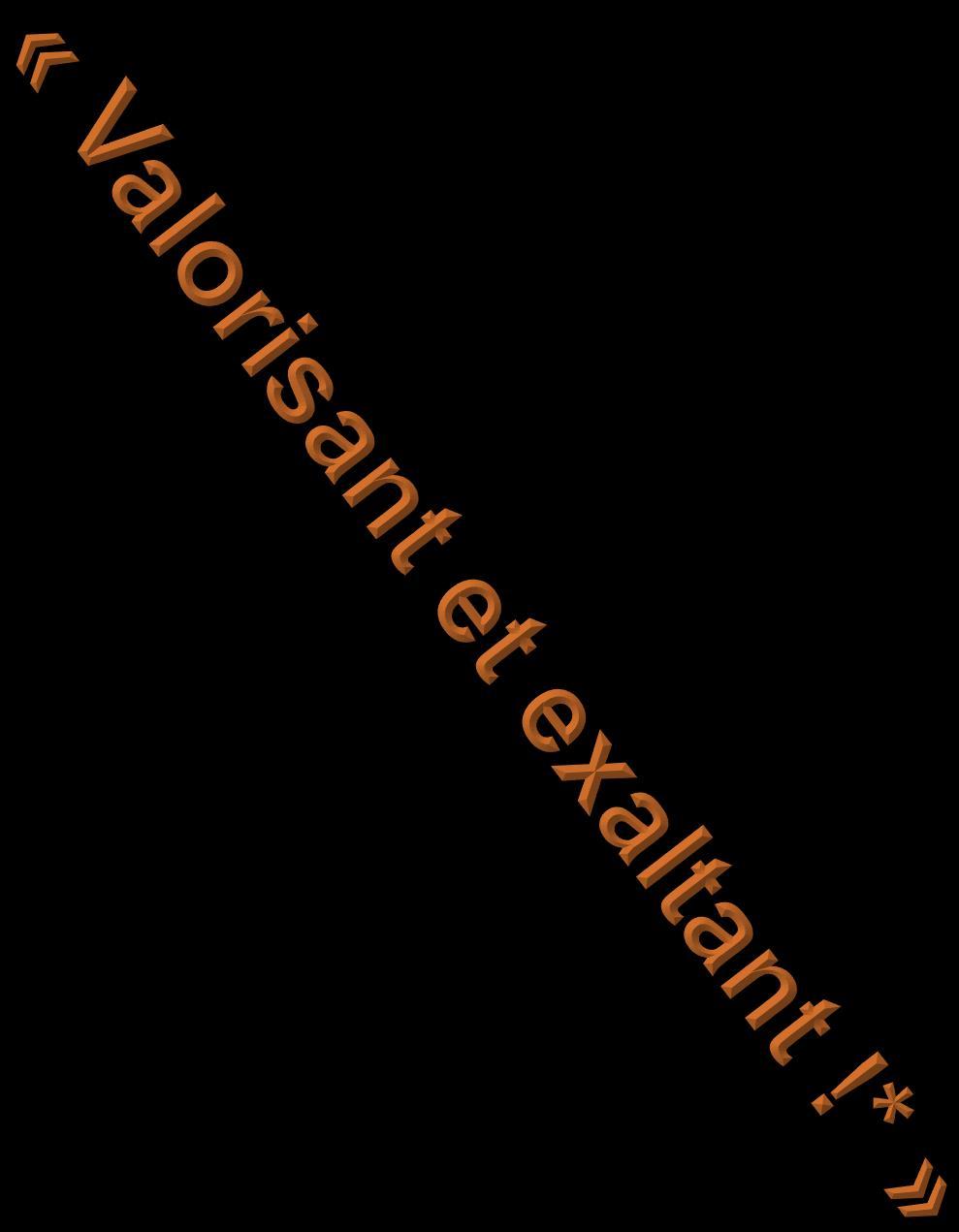


Renforcer les compétences relationnelles des soignants.

METHODE








Formation, complétée par un encadrement clinique et des séances d’intervision, pour 11 infirmier-ères et 1 médecin adjoint.
Utilisation du jeu de cartes «Anticip’action» (développé en collaboration avec UNIGE, et le soutien de la fondation privée HUG).

Réalisation de 1 à 3 entretiens par patient.
CONCLUSION
RESULTATS
Après 12 mois : 27 patients au total. 1 entretien pour 12 patients. 2 entretiens pour 9 patients. 3 entretiens pour 6 patients.
11 patientsont élaboré des directives anticipées.
Lieux des entretiens : 63% en chambre. 24% en bureau. 13% en loggia.
Participation du proche : 6 patients.
Durée moyenne par entretien: 55 minutes.
*Commentaires des infirmier.ères
Cette intervention innovante dans un service stationnaire en oncologie est prometteuse. Elle a permis de mettre en place des plans de soins personnalisés, avec une visée centrée sur la qualité de vie exprimée par la personne. Les souhaits orientent également les soins quotidiens.
PERSPECTIVES
Cette démarche enrichit l’offre d’anticipation des soins aux patients. Ces résultats complèteront ceux d’autres études menées en milieu ambulatoire afin d’affiner l’intervention de soins et d’émettre des recommandations pour la pratique. Des réflexions pour la proposer à d’autres secteurs du service d’oncologie sont en cours.
A13
Journée Qualité 2022
BRUYERE David¹; BERRET Pierre-André¹; MARCIONETTI-RUSCONI Sylvie¹; PAUTEX Sophie² ; FERNANDEZ Eugenio¹; BOLLONDI PAULY Catherine² - ¹DONCO, ²Centre de Soins Palliatifs et Soins de Support
La sémantique au service de la réutilisation des données cliniques
Des données massives, une réutilisation limitée
Les données générées dans l’hôpital sont de plus en plus nombreuses, mais leur réutilisation à d’autres fins que l’activité clinique reste limitée et coûteuse.

L’hôpital a de plus en plus besoin de pouvoir réutiliser efficacement ces données, pour remplir des registres, pour la recherche, pour l’amélioration de la qualité, etc.
Data




Combien d’enfants souffrent ils d’une fracture mal guérie?
Une solution
Constituer la liste de toutes les variables cliniques structurées produites dans les HUG.

Choisir des standards reconnus qui permettent de représenter le plus fidèlement ces variables.
Encoder ces variables en les liant à des codes issus de ces standards.
Vaste Compositionnel
Des barrières
Digitalisation Encodage
R40.2 Coma

T57.0 Effets toxiques de l’Arsenic et de ses composés



E34.3 Insuffisance staturale, non classée ailleurs Z63 Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale
La digitalisation et l’encodage des données ne suffisent pas pour gérer la complexité du monde réel. Il est nécessaire d’adopter une stratégie qui permette de représenter, stocker et réutiliser les informations cliniques, en s’affranchissant des limitations techniques.
Cette stratégie doit remettre la sémantique au centre de la problématique des données.
International
Des résultats
Combien d’enfants souffrent ils d’une fracture mal guérie?
Sémantique
Réponse
L’encodage des données structurées dans le langage SNOMED CT permet:


• Une sémantique indépendante de la technique.
• Moins de perte d’information liée à l’encodage.
• Un langage unifié pour représenter l’information.
• La réduction du nombre de variables différentes.
Données structurées
Journée Qualité 2022 B01
Christophe Gaudet Blavignac, Julien Ehrsam, Cyrille Duret, Nikola Bjelogrlic, Christian Lovis
formelle Données
90%
65’000
24’500
variables HUG
concepts SNOMED CT
Accompagnement des apprentis :












Journée
B06
Qualité 2022
transition
le monde professionnel
Une
vers
à travers la démarche éthique
CONSTAT Nécessité de compétences éthiques La réalité du monde soignant Difficultés d’adaptation OBJECTIFS Favoriser la réflexion éthique Susciter le plaisir du métier * La qualité des soins comme une réelle compétence
Former les référents aux outils d’apprentissage Identifier le niveau de l’étudiant Apporter des outils d’accompagnement Etablir une relation de confiance
Evaluation des résultats du projet dans 2 ans Déployer le projet sur l’ensemble des HUG
Charline COUDERC (RS) Coralie PEILLEX (ARS) Claire THABUIS (RES) Maria MOSTAJO (ASSC/FPP) Audrey TOXÉ (Adjointe RRH) D-RG – Hôpital de Loëx
MÉTHODE
PERSPECTIVES
PROJET PILOTE INTERPROFESSIONNEL EN CHIRURGIE VISCERALE
Chirurgie ; 2 : COSPA ; 3 : CSPSS

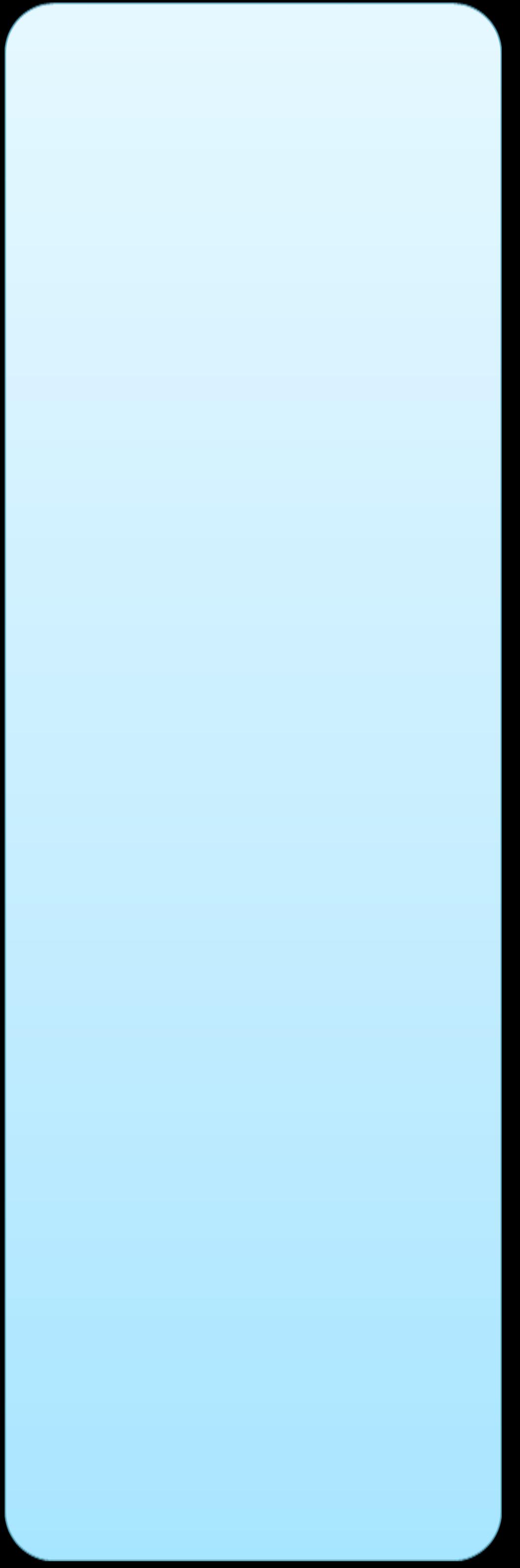



Suivi des indicateurs et réajustement
Soutien des proches
Discussion interprofessionnelle facilitée
Interventions groupées soins palliatifs généraux

Offrir des soins palliatifs précoces et suivre les recommandations de prises en charge
Soulager les symptômes, soutenir les proches, adapter les trajectoires de soins aux besoins et anticiper la prise en charge des
Soutenir le développement des compétences de l’équipe interprofessionnelle à dispenser des soins palliatifs généraux.


Améliorer la collaboration avec le réseau de soins palliatifs spécialisés.


« OFFRIR PRÉCOCEMENT DES SOINS PALLIATIFS ET DE SUPPORT EN CHIRURGIE VISCÉRALE »
Séance d’information à l’équipe médico soignante


















2 infirmières en CAS soins palliatifs en cours
Concept de soins palliatifs précoces et recommandation de prises en charge
Screening des patients et présentation au colloque
E-learning : « PROSA » et « soins palliatifs pour tous »

CONCLUSION :
Un soutien clinique par une infirmière spécialisée du CSPSS et une infirmière spécialisée en soins palliatifs
La dynamique est lancée ! Les soins palliatifs s’intègrent petit à petit dans la culture du service facilitant les discussions interprofessionnelles.

Les consultations de soins palliatifs spécialisés sont initiées.
PERSPECTIVES :
L’implémentation de ces pratiques innovantes répondant précocement aux besoins des patients pourra être déployée sur l’ensemble des unités de chirurgie viscérale.
Journée
B11
Qualité 2022
Consultation COSPA
ALAMERCERY France1, BOLLONDI PAULY Catherine2, BUCHS Sonia1, BUCHS Nicolas, COCAULT DUVERGER Cécile1, ESCHER Monica2, HENTSCH Lisa2, LIOT Emilie1, PAUTEX Sophie2, RIS Frédéric1, ROCH BARRENA Florence1 , SZARZYNSKI BLOCQUET Alexandra3, TOSO Christian1 1 : Département de
Prévenir ou Accepter le risque de chute?
DEGREMONT Christine IRES, HOXHA Mirjeta QO /Département des Neurosciences Cliniques /Service de Neurochirurgie
METHODE :
CONTEXTE:
Unité spécialisée avec accueil de patients avec troubles cognitifs et atteintes dorsolombaires Impact potentiellement mortel de la chute chez les patients de neurochirurgie ( EIG)
Taux de chute de 8,9 ‰ pour l’unité VS pour le département 6,2‰ ( année 2021/2022)
OBJECTIFS :
Comprendre le contexte des chutes, les facteurs contributifs (patient/unité/infrastructure) associés aux chutes

Agir sur ces facteurs pour mieux prévenir-limiter les chutes et leurs conséquences
RESULTATS
80% des patients sont des patients uni chuteurs 74% des chutes ont lieu en chambre; 36% des chutes ont lieu lors du transfert ; 26% debout et 18% du lit 40% des patients chutent entre J0 et J1 de l’admission 69% en 2021 de taux de détection du risque de chute , 76% en 2022 65% des patients chuteurs sont des opérés du rachis; 35% sont des opérés du crâne 65% ont des troubles de cognition ou de perception 80% ont des troubles de la mobilité (transfert et mobilité) 55% ont une altération de la fonction d’élimination
PLAN
D’ACTION
Analyse des données TBO Analyse approfondie des chutes sur l’année 2021&2022 par une collaboratrice Analyse en équipe interdisciplinaire Revue des contres mesures mise en place à disposition Benchmarking Eléments de l’EIG
Identifier lors du HUDDLE en interdisciplinaire
• les facteurs aggravants • l'équilibre, la capacité de transfert, la mobilité Déterminer lors du HUDDLE l'acceptation ou non du risque de chute selon l’algorithme pour déterminer les contre-mesures Réaliser les 1ers levers des spondylodèses par les physio à J1 et J2 Evaluer le risque de chute dès l’admission et réévaluation de la contre-mesure du choix quotidien Anticiper les besoins d’élimination Réaliser des ateliers positionnement–transferts pour les soignants Sensibiliser les nouveaux collaborateurs Améliorer les moyens de contre-mesures Suivi mensuel là travers dynamo et au quotidien sur le HUDDLE
PERSPECTIVES :
Diminution du taux de chute Discussion avec le groupe chute
Journée Qualité
B16
2022
Tapis sonnette
Matelas alarme Tapis de sol
Gouvernance registres cliniques aux HUG
LUBBEKE Anne*, BRIOT Pascal**, OURAHMOUNE Aimad Eddine**, VON PINOCI Marina**
*Département de chirurgie **Service Qualité des soins
Situation de départ
En 2019 et 2020 deux enquêtes ont été menées :
o Rapport sur le clinical data management : organisation hétérogène en termes de % de temps dédié aux registres, de profil professionnel des data managers et de compétences
o Rapport sur l’état des lieux des registres cliniques (recensement) : les registres sont en croissance et leur répartition varie entre les différents départements
Résultats et livrables
En mai 2022 le Comité registres a été créé. Pourquoi ?
o Pour améliorerl’efficacité et l’efficiencedes registres cliniques nouveaux et existants
o Pour améliorer l'intégration des registres HUG dans le système d'information clinique des HUG et dans les registres multicentriques
Qu’est-ce que le comité fait?
o Aide à la création et gestion des registres o Priorise le développement des registres o Élabore un workflowpour la demande de création/participation à un registre clinique o Valide et met à jour les outils et les documents de la gouvernance

o Crée et maintient un programme de formation spécifique pour les cqDM des registres cliniques (hors recherche)
o Crée et soutient le collège des clinical quality data managers (CODM)
Recommandation d’amélioration
En octobre 2020 des recommandations pour améliorer la gouvernance des registres cliniques ont été acceptées par la Commission Qualité des Soins :
o Créer le rôle de “clinical quality data manager” et leur cahier des charges (niveaux junior et senior) et fonction SEF

o Développer une formation interne spécifique
o Former un collège des data managers
o Créer une "charte d’utilisation des registres" définissant rôle et responsabilités du responsable de registre et des HUG
o Élaborer un workflow pour la demande de création/participation à un registre incluant une échelle de priorisation
o Gérer les registres via la plateforme institutionnelle des registres cliniques


o Intégrer les clinical quality data managers (cqDM) dans les équipes cliniques (CDI)







o Communique à la Commission qualité sécurité (CQS) les problématiques de gestion identifiées des registres cliniques o Fourni un rapport annuel à la CQS sur les registres cliniques o Communique les mises à jour et changements
Qu’est-ce qui a été produit jusqu’à présent ?
o Définition HUG des registres clinique o Profil des cqDM approuvé par les RH o Demande de participation et critères de pertinence o Plan de création /Plan de participation des registres cliniques o Page intranet
o Échelle de priorisation (en phase de validation) o Programme de formation pour les cqDM (disponible dans Espace carrière HUG) o Collège des cqDM o Liste des registres dans DPI register

Journée Qualité 2022 B18
Visitez notre page intranet http://www.intrahug.ch/groupes/registres-cliniques
Un patient traverse deux structures de soins sans travers !
1Département de Chirurgie, 2Service d’Anesthésiologie





CONTEXTE
Suite à l’analyse des déclarations d’incidents lors des transferts de patient.es entre le département de chirurgie et les SINPI (département de médecine aiguë), une réflexion a été menée conjointement en vue d’améliorer la communication interprofessionnelle au travers des transmissions

OBJECTIFS
Améliorer la communication entre professionnel.les de deux entités différentes
Transmettre les informations pertinentes et structurées
Assurer la sécurité du patient lors de la transition délicate dans la continuité de sa prise en charge
METHODE
Implication d’une infirmière de chaque spécialité pour comprendre les réalités et priorités de chaque service Construction d’un outil de transmissions orales sur la base des réflexions communes selon SBAR2
Mise en productivité de l’outil et évaluation par le questionnaire de satisfaction

INDICATEURS DE SUIVI
Titre
Noms des auteurs et département/service
Sous-titre si vous le souhaitez
Besoins
Sécurité des soins
Équipements Cockpit DPI
Responsabilité professionnelle Communication Information patient complète
Partage d’expériences
Outil de transmissions structurées
Surveillance et soins spécifiques
Reformulation

















Ensemble pour notre patient
Satisfaction des patient.es, des équipes, déclarations d’incidents, documentation DPI, amélioration de la collaboration interprofessionnelle entre les équipes du D Chir et SINPI
CONCLUSION
Cet outil de transmissions orales garantit la continuité des soins dans une approche cohérente, une vision et une démarche transversale sécuritaire en respectant la spécificité de chaque structure
PERSPECTIVES
L’outil de transmissions sera adapté afin d’être proposé dans d’autres structures de soins
Journée
B22
Qualité 2022
Roch Barrena Florence1 , Roset Nathalie1 , Trbic Bozana2, Ferrari Sandra2 , Barrionuevo Vial Karen1, Fernandes Jesus1, Fontaine Iampieri Carole2, Vermeulen François1 ,Walder Bernard2 , Triponez Frédéric1 , Alamercery France1
SBAR2
Intégration des soins palliatifs en cardiologie auprès des patients insuffisants cardiaques
Aurélie Schneider Paccot1, Céline Artigue1, Armelle Delort1, Catherine Bollondi Pauly2, Dre Lisa Hentsch3 et Dr Philippe Meyer1
1Service de cardiologie, Département de médecine, 2 Direction des soins, 3 Service de médecine palliative, Département de réadaptation et gériatrie.
Contexte
Pour améliorer la qualité de vie et la qualité des soins, l’équipe d’insuffisance cardiaque collabore avec l’équipe de médecine palliative. Le but est d’introduire précocement les soins palliatifs dans la prise en charge des patients insuffisants cardiaques sévères selon les recommandations nationales et internationales.
Méthode
• Lors des consultations d’insuffisance cardiaque:
• Utilisation de la question surprise « Vous ne seriez pas surpris si le patient décédait dans les 12 mois à venir » pour introduire une approche palliative
• Evaluation initiale des symptômes au moyen de l’échelle ESAS
• Dépistage des patients pouvant bénéficier d’une prise en charge palliative spécialisée par le P-Cares
Objectifs
• Permettre au patient d’exprimer ses valeurs et ses préférences dans une démarche d’anticipation des soins
§ Amener le patient à amorcer une réflexion sur le plan de soin anticipé et les directives anticipées
§ Offrir un soutien global adapté aux familles
§ Favoriser la continuité des soins de façon pluridisciplinaire tout au long du parcours de soin du patient
§ Développer et renforcer nos compétences professionnelles en soins palliatifs généraux
Conclusion
• Consultation conjointe entre le médecin cardiologue et le médecin palliativiste pour les patients identifiés

• Planification de consultation de soins palliatifs pour les patients en bilan prétransplantation et pré-implantation d’une assistance ventriculaire gauche
• Séances de coaching et de formation continue par l’équipe pluri-professionnelle des soins palliatifs
Résultats
Nombre de patients insuffisants cardiaques ayant bénéficiés d’une consultation de soins palliatifs
Ambulatoire Pré-transplantation / Pré LVAD
Nous travaillons à implémenter une culture centrée sur les priorités du patient tout au long de sa maladie.
Les patients sont satisfaits d’être précocement impliqués dans leur prise en charge palliative et l’équipe soignante apprécie de pouvoir échanger sur des cas difficiles et prendre les décisions en interdisciplinarité afin de maintenir le suivi jusqu’à la fin de vie.
La suite de notre intervention consistera à évaluer la satisfaction du patient et de ses proches avec leur prise en charge, l’impact sur la trajectoire de soin, le nombre d’hospitalisations et le rapport coût-bénéfice.
Journée Qualité 2022 B 42
0 5 12 3 6 8 0 10 20 2020 2021
2022 (en cours)
La gestion du risque infectieux par les Indicateurs au bloc opératoire
CONTEXTE
L’infection du site opératoire représente entre 20 et 33% des infections associées aux soins
Les soins prodigués sont de nature plurimodale et interprofessionnelle C’est pourquoi, la prévention des infections est une démarche collective nécessitant une culture commune du risque infectieux et une maîtrise des recommandations.
OBJECTIF
Mesurer de façon continue et dynamique certains indicateurs significatifs reflétant la qualité de la prise en charge du risque infectieux au bloc opératoire afin de rendre leur amélioration pérenne et visible.
METHODE



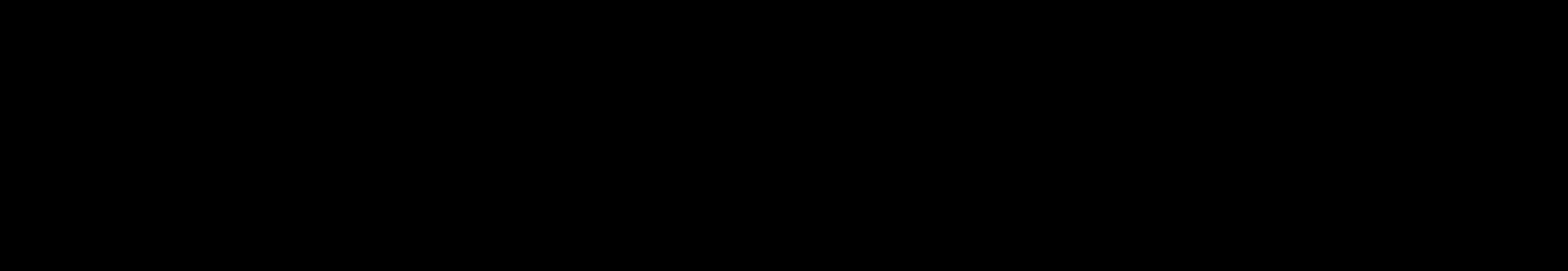





Rédaction du référentiel «zone patient» (ZP) adapté au contexte des soins en salle d’opération selon l’OMS
Sessions d’observance de l’HDM (Hygiène Des Mains, méthode OMS) avec feedback mensuel aux équipes
Contrôle de la qualité du bio nettoyage par ATPmétrie (6 écouvillonnages par bloc et par mois) enrichi de prélèvements microbiologiques sur gélose à visée pédagogique avec feedback mensuel aux équipes
Ex d’Indicateur «HDM» selon les 5 indications Taux d’observance 2022 (N=355 50% IC95 [ 44.9% 55.3%]

Ex d’indicateur «Maîtrise de l’environnement» (N= 192) Norme EN 17141
CONCLUSION et PERSPECTIVES

L’implémentation d’indicateurs en prévention des infections aux blocs opératoires permet de comprendre la Zone patient et d’impliquer les personnels et l’encadrement dans l’amélioration de leur pratique collective Ces indicateurs, démontrent une tendance à l’amélioration et ont vocation à évoluer vers des indicateurs et des analyses plus académiques Tout en ouvrant la porte au management par la qualité, leurs restitutions devront s’accompagner de projets d’amélioration et font partie intégrante de la culture de la sécurité du bloc opératoire de demain.




Journée
B32
Qualité 2022
BOUGHANMI, N., JESUS SILVA ,T., CALLONI, A., VECCHIA, E., DANIEL, E., PERNIN, E., BARBAU THORENS, E., SOLDEVILLA, J., PERREARD, M., JOUBERT, D. / DS Bloc pôle pratiques professionnelles
victimesd’arrêtscardio-respiratoires(ACR)extrahospitaliers

CONTEXTEETPROBLEME
1.~450ACR/animpliquantunappelau144,dont~250qui sontréanimés/an
2.Moyensderéponsemisenœuvreconsidérables: Ambulances,SMUR,hélicoptère,cardiologieinterventionnelle ±ECMO,soinsintensifs,réhabilitation…




3.Unesurvieàlasortiedel’hôpitalquiestbasse:moins de10%en2010avecunétatneurologiqueparfoismauvais TempsentrelecollapsusetledébutduMCEtroplong, qualitéduMCEinsuffisante
METHODE
Améliorerletauxde reconnaissancedesACRà réanimerounondurant l’appeld’urgencel’appel
Régulateurs
Améliorerdélaid’initiationduMCEettaux d’assistancetéléphoniqueauMCE
Initieretaméliorerl’engagement despremiersrépondants
OBJECTIFS
Améliorerletauxdesurvie
Reconnaitreplusde90%desACRàréanimeràl’appel
InitierMCEdansles120secondes
AssistertouslesACRàréanimer
Engagerles«first»pourtouslesACRàréanimer

RESULTATSintermédiaires
1.TauxdedétectiondesACR:2016:44.6%-2022:60.0%
ApplicationMomentum(mobilisation premiersrépondants)

ApplicationUrgentime(vidéo)& SARA(vidéosdedémonstration)
R.LARRIBAU/F.GUICHE/D.BOUSSARD
Témoinet Patient
4.Retouràlacirculationspontanée:2016:42.9%-2022:55.1%
2.Tauxd’engagementdespremiersrépondants:2020:40.7%-2021:41.2%5.Tauxdesurvie:2010:6.9%-2016:13.6%(police)-2018:17%(réanimationguidéetel)
3.Tauxdeguidagedesmanœuvresréanimation:encours
CONCLUSION
AugmentationdutauxdereconnaissancedesACRàl’appel–dutauxderetouràlacirculationspontanée–dutaux desurvie
Orientationprogressivedepuisdenombreusesannéesversunerégulationhauteperformanceavecungainde tempsaubénéficedupatientetdoncd’uneaméliorationdesasurviesansséquelleneurologique

PERSPECTIVES
Atteindre80%detauxdereconnaissancedesACRàréanimeràl’appel
Atteindreunesurvieenbonétatneurologiqueenpermanence~30%
Atteindreundélaide8minutesentreledécrochédel’appeletl’arrivée d’unprofessionnelsurplace
JournéeQualité2022 B36 Développementd’unprocessusqualitéenrégulationpouraméliorerlasurviedespatients
Télécommunication
Processus Informatique-
Arrivée de bébé
Pose du harnais de Pavlik
Le numérique au service de la maladie luxante de la hanche en pédiatrie

Bit Sandrine , Chappey Christelle, Gagnot Stéphanie, Vergnon Marilyn , Viloux Aurélie
DFEA / Salle de plâtre pédiatrique orthopédie
Pose du diagnostic médical et enseignement infirmier structuré pour l’habillement , le change, l’allaitement, le portage …





Parents submergés par les émotions qui recevront beaucoup d’informations pour n’en retenir qu’une partie











Questionnement qui augmente à la maison, malgré une brochure mise à disposition.
«Comment je l’allaite ?»
«On ne pourra plus lui donner son bain?»
«Comment je l’habille?»
Création d’un QR code sur la brochure qui dirige les parents vers nos vidéos. «Merci pour vos vidéos , on ne se sent plus tout seul»


Comment aider ces parents face à cette détresse ?






Nous filmons les procédures avec les bons gestes à acquérir
DFEA Département de la femme de l’enfant et de l’adolescent

Journée Qualité 2022 B02
23ème
INTERVENTION
L’entretien infirmier en réhabilitation cardiaque : un test encourageant
Maryne Boënnec, infirmière; Enora Livron, infirmière; Nelida Rayneau, Responsable d’équipe de soins;

Céline Ventose, adjointe de la responsable des soins; Dre ElenaTessitore, médecin adjointe cardiologie; Dre Eliana Hanna Deschamps, médecin adjointe réadaptation et médecine interne SERVICE DE MÉDECINE INTERNE ET DE RÉADAPTATION BEAU SÉJOUR 3DK
Face à une augmentation des personnes ayant subi un événement cardiovasculaire et afin de répondre aux besoins de la population genevoise, un programme de réadaptation cardiaque stationnaire a vu le jour à l’hôpital de Beau Séjour.
Ce programme interdisciplinaire sur trois semaines a été développé en collaboration entre les services de cardiologie, de chirurgie cardio-vasculaire et de médecine interne et de réadaptation
Dans ce cadre, l’équipe infirmière propose, aux patient es et à leurs proches aidants, des entretiens hebdomadaires.
OBJECTIFS
Diminution des risques de récidive Prise en soins individualisée des facteurs de risque cardiovasculaires

Patient acteur de sa prise en soins
1er entretien
• Obtenir le consentement du patient
• Faire un point de situation sur la compréhension de la maladie cardiaque, des facteurs de risque cardiovasculaires
• Partager le vécu de la situation avec le patient.
• Evaluer ses besoins

• Fixer un objectif personnalisé en lien avec le facteur de risque déterminé
Respect
confiance Esprit d’équipe Reconnaissance
RESULTATS
2ème entretien
• Faire un point de situation sur la réalisation de l’objectif fixé
• Réajuster en fonction des besoins du patient

• Si l’objectif atteint : en fixer un nouveau
• Laisser un temps de parole libre, expression sur le vécu de l’hospitalisation
3ème entretien
• Faire un bilan sur l’atteinte des objectifs avec un feedback des 3 semaines
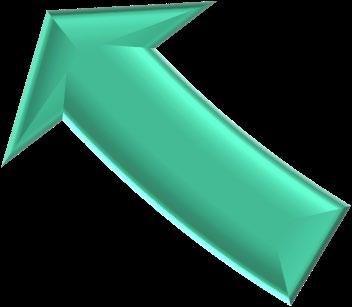

• Préparer la sortie : Expliquer les traitements au patient, l’orienter ainsi que les proches aidants vers les associations, les spécialistes, les groupes de maintenance d’activités physiques partenaires
• Evaluer de manière pertinente les interventions via 2 questionnaires.

Phase de test auprès de 10 patients :
• Meilleure adhésion thérapeutique et prise de conscience de la maladie et ses facteurs de risque cardiovasculaire

• Partenariat de soin avec les infirmières formées en éducation thérapeutique et l’équipe interdisciplinaire
• Interventions préventives et éducatives (des contacts pour des différentes associations partenaires après l'hospitalisation)
• Intégration des proches aidants permettant aux patients la poursuite de leurs objectifs après le retour à domicile
• Reconnaissance du leadership et du rôle spécifique de l’infirmière en réadaptation cardiaque
Egalité et inclusion B03
Journée Qualité 2022
Gestion du stress: un atelier d’apprentissage à la safe place
Cadre favorisant la transmission des outils d’autohypnose
Espace de ressourcement dans un programme de perte de poids •
consultations individuelles en hypnose • constitution de groupe de 5 patients • 5 foisx1h30/semaine
Outil concret, utilisable facilement et adapté à chacun






Partage entre pairs
Entrainement guidé
Tâche à domicile
Acquisition des compétences améliorant l’autonomie et la confiance en soi
«Je suis en chemin petit à petit de faire appel, facilement à mes ressources internes dans les moments difficiles et avoir conscience de mon état d’être de mieux en mieux». Michèle, 42 ans

«Le conflit dans mon corps et mon esprit se réduit dans le temps, parce que j’ai développé un regard différent, celui d’acceptation, me réapproprie moi-même dans le sens positif». Sophie, 35 ans
Première session réalisée en 2022
• Ouverture possible sur tout public en situation de stress

Journée Qualité
B07
2022
Anna Toumanova, Valérie Blyweert, Catherine Haenni, Nathalie Fraile, Unité d’Education Thérapeutique du Patient, Département de médecine
2
•
•
•
Induction
Transe: Safe place
Retour
∙
∙
∙
DES PAYS À FAIBLE ET MOYEN REVENU ET/OU VIVANT DES CRISES HUMANITAIRES
CONTEXTE
537 millions de personnes vivent avec le diabète dans le monde
Dans les centres de réhabilitation physique du Comité International de la Croix Rouge (CICR), 20 40% des amputations sont le fait des complications du diabète
3/4 dans des pays à faible et moyen revenu (PFMR)
CONSTAT :
50 70% des amputations non traumatiques sont causées par le diabète
La majorité des amputations sont évitables par une détection et une prise en charge précoces
Les systèmes de santé et le personnel de santé doivent renforcer la prise en charge interprofessionnelle des personnes atteintes par le diabète et garantir la continuité des soins
OBJECTIFS
• Renforcer et améliorer la prise en charge interprofessionnelle des personnes vivant avec le diabète et atteintes de complications au niveau des pieds
• Promouvoir une approche biopsychosociale, centrée sur les compétences cliniques et de réhabilitation
• Former les professionnel le s de santé des PFMR où les HUG, le CICR et des organisations humanitaires sont déjà impliqués dans des projets concernant la prise en charge des personnes souffrant de maladies non transmissibles
METHODE
• Analyse des besoins de formation des professionnel le s de la santé
• Analyse des expériences passées, besoins et projets pilotes
• Constitution d’un groupe d'expert e s des HUG et du CICR avec des partenaires externes: D Foot International, Université Numérique Francophone Mondiale (UNFM), Médecins Sans Frontières (MSF)
• Création d’une formation en ligne par le groupe d’experts
• Contenu basé sur les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les preuves scientifiques et les directives pour la gestion des personnes vivant avec un pied diabétique dans les PFMR et les crises humanitaires


RESULTATS
• Elaboration d’une formation en ligne d’autoapprentissage testée et validée par les expert e s et des utilisateur trice s du terrain.

• Parcours d'apprentissage composé de 18 modules, avec comme objectifs de
• mettre en œuvre une approche holistique et interprofessionnelle pour répondre aux besoins sociaux, psychologiques, cliniques et de réadaptation des personnes vivant avec le diabète et de prévenir toute complication

• renforcer les connaissances, les compétences techniques et les attitudes pour soigner et soutenir les personnes vivant avec le diabète et souffrant de plaie(s) au pied
PUBLIC CIBLE:
Personnel infirmier, médical, de réhabilitation physique, professionnel le s de la santé mentale et autres personnes impliquées dans la prise en charge des personnes vivant avec un diabète
CONCLUSION ET PERSPECTIVES
• Création d’un partenariat interinstitutionnel, interprofessionnel, académique et international





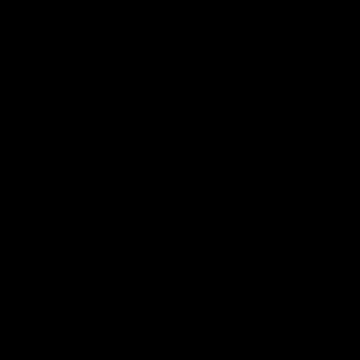

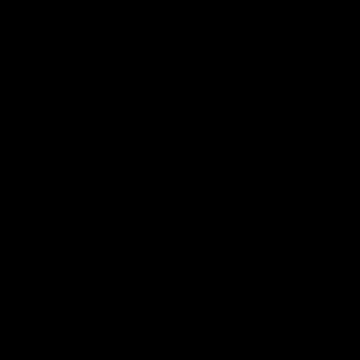






• Elaboration d’une formation interprofessionnelle en ligne à l’attention de multiples professionnels de la santé pouvant être utilisée tant dans les contextes de l’humanitaire, dans les PFMR qu’aux HUG.
• Participation au renforcement des compétences et l’amélioration globale de la prise en charge des personnes vivant avec le diabète dans les PFMR et dans des contextes humanitaires
• Traduction en français et ukrainien dès que possible
• Utilisation du matériel de la formation aux HUG et dans différents projets internationaux des HUG
• Formation présentielle des équipes du CICR travaillant au Liban, en Syrie et en Iran (mars 2023)

• Evaluation de l’enseignement par les apprenant e s
• Soumission pour l’accréditation du cours par l’Université de Genève

1 Service de Médecine Tropicale et Humanitaire, DMPR, HUG ; 2 Unité santé, CICR ; 3 Programme de Réhabilitation Physique, CICR ; 4 Learning and Development, CICR ; 5 Programme des Soins de
Primaires, CICR ; 6 Programme Santé Mentale et Soutien Psychosocial, CICR ; 7 Programme des Hôpitaux, CICR ; 8 Service d’Endocrinologie Diabète, Nutrition et Education thérapeutique du Patient, HUG ; 9 Programme Plaies et Cicatrisation, HUG

Journée
2022 B12 GESTION DES PERSONNES AVEC UN PIED DIABÉTIQUE : FORMATION INTERPROFESSIONNELLE ET INTERINSTITUTIONNELLE À DESTINATION
Qualité
Aebischer Perone S1,2, Castellsague Perolini M1, Benyaich A3, Carvalho J4, Monroy A5, Miller S6 , Giebsen Y7 , Jornayvaz F8 , Vuagnat H9, Dromer C2, Chappuis F1
Santé
Présence gériatrique au Heart Team
: une avancée !
¹Centre de médecine de l’âge avancé, ²Service de gériatrie, 3Service chirurgie cardio vasculaire, 4Service de cardiologie
Résultats
CONTEXTE
Les valvulopathies cardiaques sont plus fréquentes à un âge avancé. Le pronostic est défavorable avec un taux de mortalité atteignant 50% à deux ans chez les patients âgés de plus de 75 ans souffrant d’une sténose aortique sévère symptomatique non traitée
OBJECTIFS
La collaboration entre cardiologues, chirurgiens cardio vasculaires et gériatres joue un rôle important pour déterminer quels patients sont les plus susceptibles de bénéficier d’une prise en charge percutanée, chirurgicales, ou pour qui un traitement conservateur est l’option la plus raisonnable
METHODE






L’unité de gériatrie de liaison (UGL) participe au colloque multidisciplinaire Heart team (HT) des HUG depuis le mois de janvier 2022. Le but de cette étude est de décrire la population évaluée par l’UGL au HT et d’évaluer l’apport de sa participation
CONCLUSION
Décisions
UGL favorables pour une PEC percutanée ou chirurgicale : 37/44 (84.1%)
Percutanée 21 (47.7%%) Chirurgie 5 (11.4%) Traitement conservateur 11 (25%)
Décisions
UGL non favorables pour une PEC percutanée ou chirurgicale : 7/44 (15.9%) 4/7 (57.1%) : avis partagés par le HT 1/7 (14.3%) : TAVI, non effectué (patient parti contre avis médical) 2/7(28.6%) Chirurgie, 1 bonne évolution, 1 défavorable
Concernant les patients ayant bénéficié d’une PEC percutanée (MitraClip et TAVI, n=21 patients):
Concernant les patients ayant bénéficié d’un TAVI (n=17 patients):
sexe âge MMS BPCO (H+F) Score STS (H+F) Euroscore II (H+F) n=10 H (47.6%) n=11 F (52.4%) 83.1 ±4.7 84.9 ±6.5 27.0 ±1.4 25.5 ±2.4 Non 14 Oui 7 4.5 ±3.2 8.0 ±14.0 Succès à 30j Décès AVC Autres complications vasculaires 14/17 (82.4%) 0/17 2/17 (11.8%) 2/17 (11.8%)
L’implication récente de l’UGL a permis de mettre en évidence et de prendre en charge les principaux syndromes gériatriques présents chez une majorité des patients. Elle a aussi permis de contribuer à l’organisation du suivi post-intervention, non seulement sur le plan médical (suivi cognitif, nutritionnel, mobilité ), mais également sur l’organisation de la sortie en investiguant les personnes ressources pour le patient et en décidant de l’orientation (réadaptation ou domicile avec aide)
PERSPECTIVES
Il est important de poursuivre cette évaluation gériatrique afin de permettre une PEC pluridisciplinaire du patient âgé souffrant de valvulopathie cardiaque.
Journée
B17
Qualité 2022
Sara Yunus Ligozat¹, Thierry Chevalley², Christoph Huber3, Mustafa Cikirikcioglu3, Georgios Giannakopoulos4, Marco Roffi4, Christophe Graf1, 2, Stéphane Noble4 ,
Moi et mes médicaments
Un outil pour faciliter la communication soignant/patient autour du traitement

CONSTATS
• 50% des patients, toutes maladies confondues, ne prennent pas leurs médicaments tels que prescrits (OMS)

• Pour communiquer avec les patients autour des médicaments, les soignants ne posent souvent qu’une seule question : «Vous prenez bien vos médicaments ?» Réponse … oui !
MÉTHODE : enquête qualitative
18 soignants
6 patients



• Difficultés d’identifier les patients ne prenant pas leur traitement
• Vécu de frustration, de déception, sentiment d’inutilité, d’échec
• Difficultés à comprendre les patients et à communiquer avec eux
• Crainte que les soignants réagissent négativement s’ils disent qu’ils ne prennent pas leurs médicaments ou que cela ait un impact sur leurs relations
• Sentiment d’être freinés à partager leurs difficultés d’adhésion avec leurs soignants
OBJECTIFS
Faciliter la communication autour des médicaments !


• Donner confiance aux soignants pour aborder le délicat sujet de la prise des médicaments
• Aider les soignants à approfondir leurs entretiens autour des médicaments et à créer les conditions pour que les patients se sentent libres et en confiance pour s’exprimer
• Aider les soignants à mieux comprendre les patients pour affiner la justesse de leur accompagnement
Pour explorer le vécu et les priorités des patients …
12 thèmes d’exploration 50 questions ouvertes
Un médicament, c’est quoi pour vous ?
Dans quelle mesure est ce important pour vous de prendre des médicaments ?
Quels autres traitements, ne figurant pas sur votre ordonnance, prenez vous ?
Dans quelle mesure vos médicaments influencent ils vos projets de vie ?
A qui parlez vous de vos médicaments ?
Qu’est ce qui vous aide / vous freine pour prendre vos médicaments ?
RESULTATS
Côté patients
« J’ai posé des questions que je n’aurais pas osé poser spontanément. J’ai maintenant une vision plus large du patient »
« Ça m’a hallucinée ce qu’elle m’a dit. Je la connais depuis plusieurs années et je ne m’occupais que de son asthme, pas de ce qui lui pose problème »
« Je n’ai pas parlé pour faire plaisir aux soignants mais pour dire ce qui est important pour moi »
RESULTATS
Côté soignants
« Je n’aurais pas parlé de mes traitements parallèles sans les cartes »
« J’ai plus parlé, d’habitude c’est plus l’infirmière qui parle ! »
« Il faudrait donner cet outil aux médecins, s’ils me comprenaient mieux ça m’éviterait de prendre des antidépresseurs »
CONCLUSION
PERSPECTIVES
Les thèmes et les questions ouvertes sont très aidantes pour les soignants
de cet outil libère la parole des patients
permet ensuite aux soignants d’ajuster l’accompagnement de leurs patients
Diffusion au plus grand nombre : présentations, capsules vidéo
Le fil rouge des 3 jours de formation ETP aux HUG ?
Insertion dans la journée « Dispensation des médicaments » ?
Visibilité dans « Pulsations » et rédaction d’un article dans la revue ETP/TPE ?
Journée Qualité 2022 B23
Journée qualité 2022 B23 ✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
L’utilisation
Il
SALIEZ PIERRET Géraldine, BRAILLARD Olivia, LAZZARO Daniela, SCHNEIDER Marie-Paule, Service de Médecine de 1er recours (SMPR/DMPR)
Importance
du rôle


infirmier dans le suivi des patients au centre SLA
Marjorie/Service de Neurologie/Département Neucli
• Améliorer la qualité de la prise en charge et l’accueil
• Coordonner les différentes consultations et faire le lien entre les consultants
Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA)
OBJECTIFS
• Faciliter la communication entre le patient et les différents intervenants
• Soutenir et accompagner le patient et les proches
• Améliorer la qualité de vie et l’espérance de vie du patient
Centre SLA:
Neurologue pneumologue nutritionniste diététicien phoniatre logopédiste soins palliatifs généticien gastro entérologue psychiatre infirmières de liaison assistante sociale physiothérapeute ergothérapeute équipe VNI
Patient & proche aidant
Infirmière référente
CONCLUSION
≈70 consultations/année 40 patients suivis au CESLA
Le patient établit une relation de confiance avec l’infirmière référente qui est identifiée comme personne ressource dans la prise en charge
PERSPECTIVES
Développer/renforcer le rôle infirmier de coordination avec le réseau externe
Créer une brochure d’information pour le patient
Participer aux consultations de neurologie lors de l’annonce du diagnostic avec le proche aidant

Créer un binôme infirmier
Réseau externe : Médecins traitant soins à domicile physiothérapeute ergothérapeute soins palliatifs
«Vous pouvez agir sur la planification des rendez vous selon ma fatigue» de Mme. K.
«Vous êtes une personne à qui je peux me référer pour mes différentes demandes» de Mr.N. «C'est très rassurant de vous voir à chaque passage» de Mme. M.
«Je peux compter sur vous» de Mme. C.
Journée Qualité 2022
B27
BEL
Maladie dégénérative Perte progressive des fonctions motrices Incurable Besoin d’une prise en charge multidisciplinaire 500 à 600 patients en Suisse
Améliorer la prévention et le traitement pour la prise en charge des patients à risque d’escarres au sein de la DIVISION PRIVE
Auteur: V. AVRAMOVA (IS plaies Projet de rotation PLAIES&CICATRISATION 2022) Co Auteurs S. DI TOMMASO, C. GIANADDA, M J. ROULIN, B. LE MENE, A. SCHNELL
Direction des soins, programme plaies&cicatrisation Département des services communs, Division Privé Journée Qualité 2022 HUG projet de type B
Problématique
L’escarre est une lésion ischémique localisée au niveau de la peau et/ou des tissus sous jacents, située en général sur une saillie osseuse. Elle est le résultat d’un phénomène de pression, ou de pression associée à un cisaillement.

But
Ce projet, ayant débuté en janvier 2022, a pour but d’améliorer la prévention et le traitement de la prise en charge des patients à risque d’escarres au sein de la DIVISION PRIVE.
Méthodologie

Une mini enquête qualitative, à travers un focus group a pris forme au sein de l’équipe soignante du 9EL.

Les résultats de cette mini enquête a permis de cibler le sujet à traiter, puis par la suite d’identifier les difficultés rencontrées par les soignants, de les corriger et de mettre en place prochainement des outils d’amélioration au sein du département et des besoins/attentes des unités

Résultats Objectifs
Interprofessionnalité
Coordination -Continuité des soins Personne de référence au sein de la Division Privé Transmission des connaissances
Perspectives d’amélioration
Soins Evaluation clinique -Mise en place de mesures spécifiques - Améliorer la prévention - Matériel: recensement des besoins spécifiques au département











Enseignement


Formation -Mise à jour des connaissances E learning -Ateliers pratiques Accompagner dans la bonne pratique Renforcer l’application des recommandations de bonnes pratique



Expertise
Application des recommandations de bonne pratique Utiliser les outils institutionnels S’appuyer sur la littérature Améliorer la rigueur pour les évaluations de positionnement et de sensibilité
Le projet sera appliqué au sein du département et des équipes soignantes de la Division Privé dès le 1er janvier 2023.

Références
Augmenter la sécurité
Diminuer les coûts
Augmenter la qualité
Outils
Diagramme d’Ishikawa
Focus Group
B37
Enquêtes de satisfaction des patients aux HUG :
Déclaration d'un incident par un patient
Direction médicale Service qualité des soins D.S.Ferreira C. Courvoisier D. Haller G. Roch F.
CONTEXTE
L’enquête de satisfaction des patients permet de recueillir le vécu des patients de leur expérience de soins.
Les HUG utilisent depuis plusieurs années un Questionnaire de satisfaction validé par l’institut Picker. Sa version courte contient 23 questions fermées + 1 question permettant de laisser un commentaire libre. Environ 5000 de ces commentaires libres sont générés chaque année Si certains sont des commentaires simples du vécu hospitalier, d’autres revêtent un caractère plus critique et s’apparentent à des incidents, voir des Evénements Indésirables Graves (EIG). Ils sont actuellement transférés par courriel aux responsables de services et pour certains, aux Quality Officer.
Piste d’amélioration
Une réponse n’est pas toujours donnée directement au patient.
- L’investigation du problème ne se déroule pas dans un cadre formalisé tel qu’un groupe incident Aussi le suivi des actions correctives est difficile à réaliser
OBJECTIF
Evaluer la pertinence et la faisabilité d’une analyse systématique des commentaires libres et la charge (volume ) pour les groupes incidents si ceux ci leurs sont transférés..
METHODE












Analyse qualitative des commentaires libres générés en 2021 par 2 responsables de l’enquête satisfaction. Classement des commentaires selon une matrice validée et intégrant la définition institutionnelle des incidents
CONCLUSION
RESULTATS
En 2021, l’enquête de satisfaction a généré 4579 commentaires (Figure 1):

- La répartition est quasi égale entre les commentaires positifs et négatifs Les commentaires négatifs sont pour la plupart bénins
- 215 commentaires nécessitent un traitement plus poussé et 43 de ces commentaires pourraient mener à une déclaration d’incidents à traiter par un groupe incident selon la définition institutionnelle.
Cette enquête montre la possibilité de valoriser le potentiel des commentaires des patients. Un certain nombre d’entre eux correspond à des incidents qui auraient pu être déclarés et traités par un groupe incident L’enquête réalisée montre également que leur analyse par un groupe incident est faisable en terme de volume Ce projet pourrait conduire au transfert de certains commentaires libres de l’enquête de satisfaction sur la nouvelle plateforme de gestion des incidents et chaque département pourrait ainsi le traiter via son groupe incident, Ce travail contribuerait à améliorer la culture sécurité dans l’institution
Journée Qualité 2022 B41
Protocole d’hémorragie massive (HM) aux soins intensifs adultes
CONTEXTE
En 2019, le protocole institutionnel de prise en charge de l’hémorragie massive (HM) a été déployé.
L’HM est une hémorragie active incontrôlable ou dans un contexte à risque, avec au moins un état de choc, une coagulopathie sévère ou un besoin transfusionnel de plus de 4 concentrées érythrocytaires (CE) en moins de 1 heure

OBJECTIFS
Les objectifs du protocole d’HM sont d’améliorer le pronostic des patients et de diminuer la consommation de produits sanguins.

Le but de notre travail était de vérifier si la nouvelle pratique a été réellement implémentée et si des adaptations locales étaient nécessaires.
METHODOLOGIE
Depuis mars 2022, en utilisant le modèle d’amélioration de la qualité des soins Plan Do Study Act proposé par l’Institute for Heathcare Improvement, le service de soins intensifs adultes (SIA) a développé une stratégie qui permet le suivi rapproché des épisodes d’hémorragie massive (study) et l’implémentation d’adaptations spécifiques (act).
L’HM n’est pas documentée dans DPI ni dans Clinisoft (logiciel des SIA) par une donnée structurée. Pour cette raison nous avons créé une alerte informatique automatique 24/7 déclenchée par la documentation de 4 CE ou plus administrés en moins de 1 heure Chaque fois que cette condition est présente, une alerte est envoyée par email Une analyse rétrospective dans les 72h confirme ou pas l’évènement et identifie les participants médico soignants à la prise en charge du patient
Un questionnaire électronique (Forms®) et anonyme leur est ensuite envoyé afin de recueillir un feedback Les points explorés sont : connaissance préalable du protocole d’HM, reconnaissance de l’HM, activation du protocole, utilisation du système de réchauffement des perfusions (Fluido®), satisfaction du délai de livraison des produits sanguins, désactivation du protocole et satisfaction de la prise en charge du patient Le lien avec le Groupe Incident du service est aussi maintenu afin de détecter d’autres problématiques En fonction des difficultés relevées et de la pertinence des propositions d’amélioration, des interventions sont ensuite proposées
RESULTATS
Entre mars et fin octobre 2022, 11 cas d’hémorragie massive ont eu lieu dans le service des SIA L’alerte informatique a permis de détecter 10 cas sur 11 Le protocole de TM a été activé 8 fois sur 11 Septante neuf collaborateurs ont participé à un épisode d’HM; parmi eux, 13 à plus d’un.
Le taux de réponse au questionnaire a été de 72%. Nonante-six pour cent des répondants connaissait le protocole d’HM mais la majorité n’avait jamais participé ni à la prise en charge en réel (54%) ni en simulation (70%). Cinq pour cent a rapporté des difficultés à reconnaitre l’HM (saignement sous les draps, désaccord dans l’équipe). Vingt quatre pour cent a rencontré des difficultés à activer le protocole (requête pour le mauvais patient, chemin informatique inconnu). Le Fluido® n’a pas été utilisé dans 3 situations d‘HM mais dans 50% des cas où il a été utilisé, des difficultés techniques (debullage, personnel non dédié) ont été signalées
Cent pour cent du personnel impliqué était satisfait du délai de livraison des produits sanguins.
Exposition à l'HM
Pas exposé 1 fois 2 fois 3 fois
Depuis septembre des formations sur l’utilisation du Fluido® et des nouvelles simulations ont été organisées et des modifications de la requête informatique sont en cours de réalisation

CONCLUSION
Le modèle d’amélioration de la qualité des soins nous a permis de constater que le protocole d’HM fait désormais partie des pratiques médico-soignantes aux SIA malgré la basse exposition du personnel
Grâce à l’analyse et au feedback de l’équipe, les points critiques du processus (demande informatique, utilisation Fluido®, répartition des rôles) ont été identifiés et traités Ces améliorations seront évaluées lors des prochains épisodes d’HM
PERSPECTIVES
Ce travail se base sur un monitoring des pratiques cliniques multimodale (données consolidées, facteurs organisationnels et humains) qui permet de suivre l’implémentation presque en direct de nouvelles procédures. Nous pensons qu’il soit particulièrement adapté pour les situations peu fréquentes mais avec un impact critique sur le pronostic du patient
Journée Qualité 2022 B33
Dr Filippo Boroli, Dr Nils Siegenthaler, Mounia Hannachi, Yosr Karker, Joëlle Magnard et Zilfi Koyluk Tomsuk Service des soins intensifs adultes Département de médecine aiguë
Développement du plan de continuité dans le service de soins intensifs adultes : les soins priorisés
CONTEXTE
En cas d'événement majeur ou de catastrophe, le service des soins intensifs adultes (SIA) doit pouvoir offrir une réponse adaptée et proportionnelle, dans un délai limité, à l'afflux de patients pouvant bénéficier du plateau technique des HUG.
Pendant la 1ère vague COVID, les activités non urgentes des HUG se sont mises à l’arrêt pour libérer des ressources au bénéfice des services de médecine aigue. Cette approche pragmatique a permis de soigner des milliers de patients atteints du COVID au prix des autres malades générant un haut niveau de frustration parmi le personnel.
En prévision d’un nouvel évènement majeur de longue durée une nouvelle organisation de travail aux SIA permettant de soigner au mieux le plus grand nombre de patients tout en épargnant du personnel était nécessaire.
Nous avons donc développé une approche innovante de prise en charge, visant à garantir la continuité de l’activité en préservant le personnel d'une fatigue excessive : les soins priorisés.

METHODOLOGIE
Depuis fin février 2020, plusieurs focus groupes ont été menés avec le personnel médico soignant afin d’obtenir leur retour d’expérience de la première vague pandémique ; le service a fait aussi appel à des spécialistes en médecine humanitaire et des catastrophes, en sécurité industrielle et en éthique pour leur expérience dans les évènements majeurs La méthode d'investigation organisationnelle et systémique (MINOS) a été utilisée pour élaborer le modèle de sécurité du service des soins intensifs ; les menaces d'arrêt d'activité ont été identifiées et leur prévention, récupération et atténuation ont été planifiées. Ces actions ont été mises à jour en fonction de l'évolution de la crise Des séances de Crew Resource management (CRM) et des simulations au chevet des patients ont été utilisées dans la phase de mise en œuvre

RESULTATS
Entre mars 2020 et février 2021, en raison de deux vagues épidémiques, 350 patients positifs au test Sars Cov 2 ont été admis aux SIA.
Les piliers du modèle de sécurité de SIA étaient la protection du personnel et la prise en charge des patients (A) ; les menaces identifiées pour la continuité des activités étaient le manque de ressources humaines, la surcharge d'activité individuelle, les erreurs médicales, les escarres et les infections nosocomiales ; elles ont été évaluées à un risque intermédiaire ou élevé pour la sécurité des patients.
Le plan des soins priorisés a été élaboré pour contrôler, récupérer et atténuer ces menaces.
Il se composait des éléments suivants : niveaux adaptables de soins (B), organisation modulaire par cellule, huddles, matrice de priorisation des activités (C) et méthode de délégation contrôlée.
A B
Avant la mise en œuvre, 55 infirmières et 46 médecins ont été formés par des cours de CRM et des simulations tabletop.
La phase pilote a été déployée dans une cellule, de décembre 2021 à janvier 2022 Soixante-sept patients ont été admis au cours de cette période ; treize adaptations du plan initial ont été introduites Aucun

CONCLUSION
Une différente organisation de travail en cas d’événement majeure de long durée est nécessaire et possible.

Les soins priorisés pourraient être la réponse adaptée et proportionnelle des SIA à ce type de crises permettant la continuité de l'activité tout en protégeant le personnel de la surcharge d’activité. Des tests supplémentaires sont nécessaires.
aussi pour les crises de surcharge de courte
Journée Qualité 2022
B47
Dr Filippo Boroli1,3, Dr Didier Tassaux1, Annie Claude Paubel1, Helene Lenoir1, Pr Jérôme Pugin1 et Dr Olivier Hagon2,3 1Service des soins intensifs adultes Département de médecine aiguë; 2Service de médecine tropicale et humanitaire Département de médecine de premier recours 3WHO Collaborating Centre for Humanitarian Medicine and Disaster Management
« Idéaxion en avant les projets

G Choupay1, D Bandon2, M Ranieri3, R Zucchegna4
1Service qualité des soins, 2Direction projets et processus, 3 Service biomédical et équipement, 4 Direction ressources humaines
CONTEXTE
Les HUG, comme toute grande institution, possèdent leur lot de projets qui s’enlisent sans atteindre les objectifs escomptés. Fort de ce constat, l’approche Idéaxion a été développée pour résoudre des défis dans un temps limité, de manière agile et participative, et ainsi accélérer les projets ou initiatives.
Fruit d’une réflexion conjointe entre le Centre de l’Innovation, la Direction des projets et processus et le Service qualité des soins, Idéaxion est né en 2019. La Direction des ressources humaines a rejoint l’équipe en 2020.

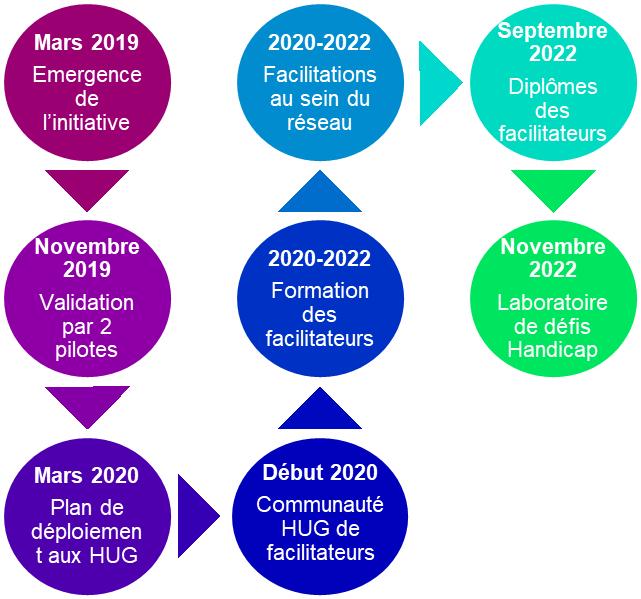
OBJECTIFS
Adopter une nouvelle approche accélérée de recherche et de mise en œuvre de solutions, basée sur des démarches participatives, créatives et agiles.
Deux offres de service
• Mode flash : 1 à 3 ateliers participatifs pour poser un diagnostic, rechercher des solutions, prototyper
• Mode approfondi : dérouler un cycle complet de design thinking

RÉSULTATS
MÉTHODE RÉUSSITES
COMMUNAUTÉ DE FACILITATION

P Albrecht (DEX), S Baldelli (DirCom), C Cuvilliez (DPP), M Despond (DMQ), M Kindstrand (DF), L Loureiro (DPP), T Palese (DRH), L Paulus (RSE), S Rocha (DO), E Sarrey (DS), M Syll (DPP)
PERSPECTIVES
Développer
Journée
Qualité 2022
A12
»
!
Accord de partenariat pour une activité en jobslash Compétences de la communauté de facilitatrices et de facilitateurs Solutions prototypées et testées dans des défis de différentes natures Satisfaction des porteurs et porteuses de défi Visibilité dans le réseau des communautés d’intelligence collective des entreprises genevoises et commission fédérale qualité Laboratoire de défis sur le thème « Comment améliorer l’accueil et l'expériencedelapersonne en situation de handicap aux HUG ? » Pérenniser l'offre de service et l'organisation en support
Organiser un Laboratoire annuel de défis . Handicap pour 2022 >> Quel thème en 2023 ? Evaluer les deux premières années, avant renouvellement de l’accord de partenariat Renforcer la communauté de facilitation et ancrer un réseau d’ambassadeurs et d'ambassadrices
des interactions avec le réseau genevois de facilitation
CQS
CONTEXTE
Commission Qualité-Sécurité
Emergence d’une instance de gouvernance de niveau 2 dédiée à la qualité et à la sécurité des soins aux HUG
G Choupay1 , P Chopard1 , AC Raë2 , E Sarrey2 , M Ferreira2 1Service qualité des soins, 2Direction des soins
OBJECTIFS
MÉTHODE
RÉSULTATS
Les organisations de santé doivent assurer des soins sûrs, fiables et efficaces aux patients La littérature montre l’importance de disposer d’un comité traitant de qualité sécurité des prestations dans les organisations de soins. Cette structure de gouvernance doit être une des sources d’influence pour la qualité sécurité des soins fournis.
Aux HUG, en 2011 a été crée un groupe appelé «délégation du CD à la coordination de la qualité et à la gestion des risques». Ce groupe est devenu la CQS en 2016, co présidée par le Directeur médical et la Directrice des soins.
Faire de la CQS une instance de gouvernance de niveau 2, sous délégation directe du comité de direction, garante d’une stratégie qualité-sécurité alignée avec la stratégie institutionnelle des HUG et qui décline les projets placés sous sa responsabilité dont elle a la supervision et la charge.
Depuis 2020, a été mise en place une structuration par portefeuille de projets transversaux et de responsabilités, en organisant une délégation de la CQS à des comités spécialisés opérationnels dans lesquels les parties prenantes expertes du sujet aux HUG sont impliquées (SQS, Départements, Directions métier ). Parallèlement, la CQS a redéfini ses missions, et activités, sa composition, son fonctionnement.
Elle s’est notamment dotée de PMO pour la coordination de ses projets et activités.
La CQS a permis de
• renforcer la gestion des risques (8 risques cliniques identifiés dans la cartographie des HUG),
• ainsi que le management par la qualité (développement d’indicateurs et programme DynamO),
• développer plusieurs axes de la culture qualité (Formations qualité/sécurité des soins, formations Just-Culture, enquête culture sécurité, etc.).
Depuis mai 2022, la CQS compte un patient partenaire parmi ses membres. Cette contribution active a été mise en place avec la collaboration du programme PP+3P des HUG.
MISSIONS
• Promouvoir l’amélioration continue de la qualité au sein des HUG
• Garantir la mise en œuvre de la politique qualité institutionnelle validée par le CD
• Définir la stratégie qualité sécurité dans l’alignement du plan stratégique de l’institution et superviser sa mise en œuvre
• Veiller à la cohérence des actions départementales en lien avec la stratégie qualité qualité sécurité institutionnelle
Membres fixes Responsable du pôle pilotage médico économique Mme Vindret Catherine Représentant de la DSI M. Meyer Rodolphe Pharmacien chef M. Bonnabry Pascal Médecin chef du SQS Pr Haller Guy Expert qualité M. Ferreira Miguel Médecin chef SPCI Pr Harbarth Stephan
Membres renouvelables Représentant collège des QO Mme Bernhard Valérie Représentant collège des QO M. Meier Gaëtan Représentant collège des chefs de département Pre Rubbia Brandt Laura Représentant conseil des responsables des soins Mme Macrez Ovan Isabelle Un patient partenaire M. Rae Stefaan
Invités permanents PMO SQS Mme Choupay Gaëlle
PMO DS Mme Evelyne Sarrey
NIVEAU STRATEGIQUE
• Orientations stratégiques et politique qualité des HUG
• Pilotage des programmes et attribution des ressources
• Reporting
NIVEAU TACTIQUE OPERATIONNEL
• Maitrise des risques (risques cliniques, vigilances, EIG…)
• Culture qualité sécurité (enquêtes, Teamstepps, DynamO…)
• Satisfaction patient (gestion des plaintes, des commentaires)
• Indicateurs (développement, TBO, suivis…)
• Registres et Data management (développement des registres)
• Certification et accréditation (obligatoires et propres aux HUG)
• Formation (formation continue, et postgrade…)
PERSPECTIVES
Dans les systèmes segmentés et décentralisés, l’importance du développement d’une compréhension commune et d’une coordination stratégique accordée à la qualité et à la sécurité est essentielle pour améliorer la prise en soins des patientes et des patients et réduire les préjudices subis. [A. Auraaen, K. Saar et N. Klazinga (2020)]
La commission qualité sécurité des HUG doit poursuivre sa transformation notamment en développant le réseau opérationnel qui lui permettra de décliner les recommandations qu’elle émet et d’appliquer ses décisions.
La prochaine étape clé est l’élaboration de la stratégie qualité des HUG qui sera déclinée dans la politique qualité.
Journée Qualité 2022 B48
–
2011 Délégation du CD à la coordination de la qualité et à la gestion des risques 2016 Commission Qualité Sécurité Sous délégation du CD 19 membres 2022 • Commission
Sécurité
RÔLES & RESPONSABILITÉS
Qualité
2
13
dont
Présidence Directeur médical Pr Perrier Arnaud
• Instance de niveau
•
membres
1 patient partenaire Co
Directrice des soins Mme Merkli Sandra
Création d’une consultation spécialisée pour les patients COVID positifs admis en unités non COVID
RESULTATS

Vague Omicron en 2022
Débordement des unités COVID avec des patients pauci symptomatiques
Affectation des patients COVID aux unités non COVID à l’admission unités hybrides
Identifier les patients avec une péjoration de l'état clinique
Conduite de la consultation
1. Identification des patients à risque Etude de dossier Test COVID, âge, statut vaccinal, signes symptômes, besoins en 02, laboratoire, traitements, antécédents





2. Evaluation clinique selon profil du patient
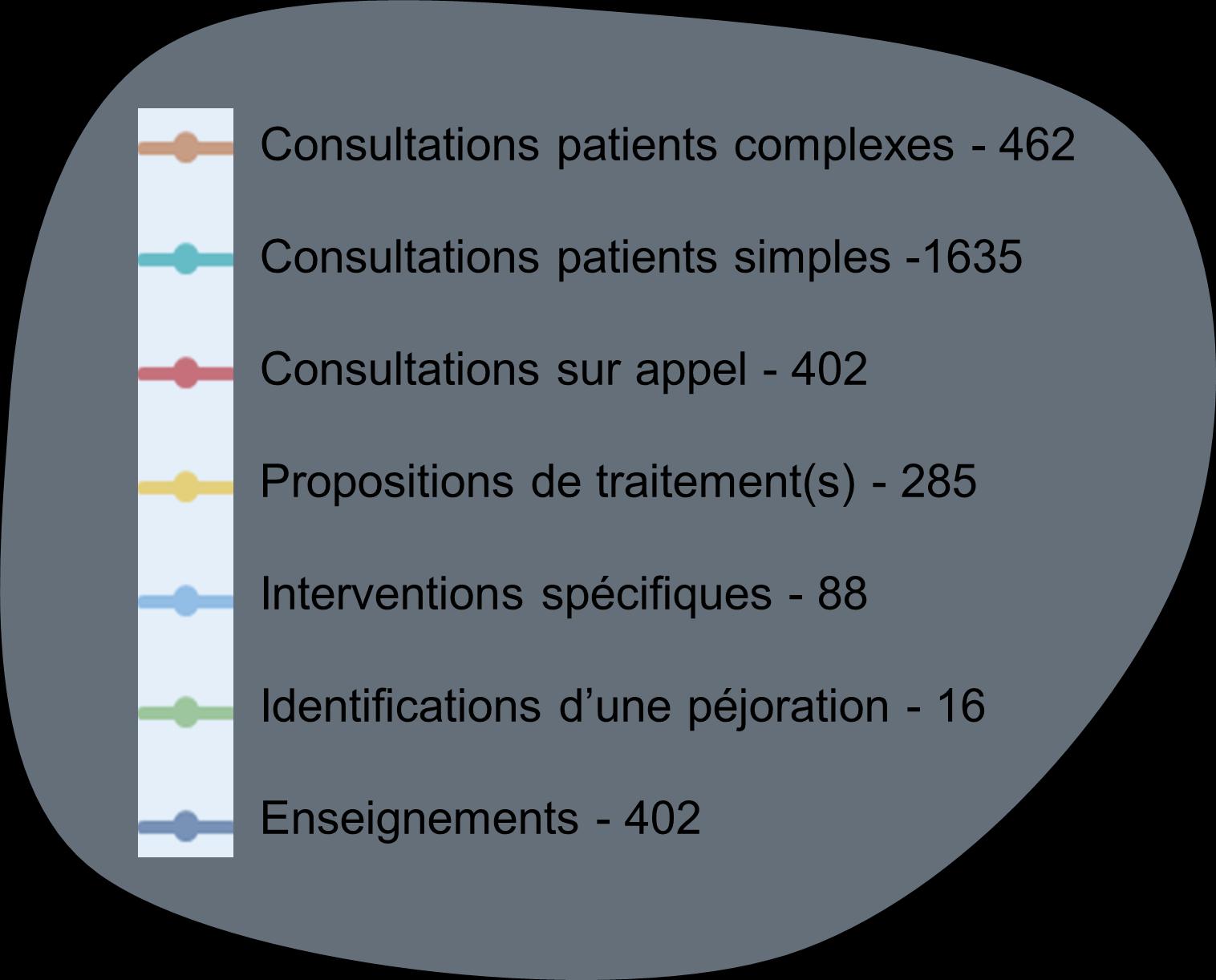
Cas «simple»
Cas «complexe» ou à risque
OBJECTIFS
Créer une consultation spécialisée pour optimiser la prise en soins des patients positif au SARS CoV 2 des unités hybrides

METHODE
• État des lieux et littérature scientifique
Déterminer les patients plus vulnérables Propositions thérapeutiques
Informations et enseignements aux patients et aux collaborateurs
• Groupe projet: 4 infirmières, 2 infectiologues, 2 ISC, 1 adjointe de direction des soins, 1 responsable d’équipe des ISC, 1 adjoint du responsable des soins, 1 responsable des soins



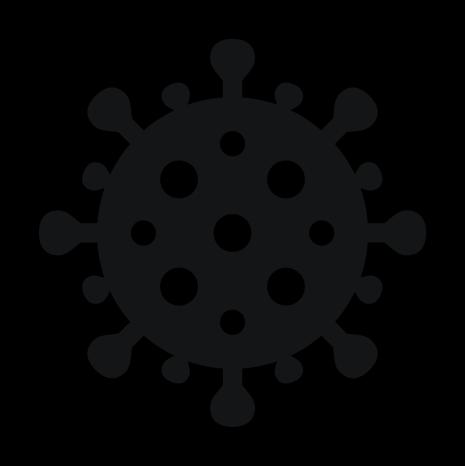
• Constitution de l’équipe de la consultation: 4 infirmières ers et 2 infectiologues
• Acquisition des ressources
• Standardisation de la consultation et définition des indicateurs
• Coaching de l’équipe infirmière par ISC
CONCLUSION et PERSPECTIVES
La consultation maintient ses activités du lundi au vendredi de 8h à 17h aux Hôpitaux Universitaires de Genève.
Ce dispositif pourrait servir d’exemple précurseur pour des consultations dans diverses spécialités
3. Identification des besoins et interventions si besoin
4. Consilium avec un.e infectiologue Présentation des cas complexes et décision des stratégies thérapeutiques ou des recommandations à proposer aux équipes
Indicateurs




Journée Qualité
B26
2022
Auteurs: Patrick Teixeira Machado, Vanessa Salle, Nachid Mounir, Sandra Djila, Manon Valette, Sonja , Adolfo Villar, Pauline Vetter, Alexandra
CHAMBRES MÈRE-ENFANT:
quand 2 spécialités ne font qu’une H. AIT EL HADJ, M.GARCIA, B.PIERRET, S.BOCHERENS, S.CARRON, C.VASSANT, R.PFISTER, M.EPINEY
DFEA UNITE POST PARTUM UNITE NEONATOLOGIE
CONTEXTE:
A la naissance, certains enfants nécessitent une hospitalisation de courte durée dans le service de néonatologie par exemple, pour un risque infectieux ou des hypoglycémies et sont séparés de leurs mamans
OBJECTIFS:
- Soins spécifiques pour la dyade
- Favoriser le lien mère/enfant
Soutenir l’allaitement




Renforcement du rôle parental Travail interprofessionnel
METHODE:
- groupe de travail interprofessionnel défini
- Identification des axes prioritaires
- Définir le champs d’action de chaque professionnel Vis ma vie
Rédaction d’une charte de fonctionnement
CONCLUSION:
Ouverture de 4 chambres: sur une année, 150 dyades mère-enfant on été hospitalisées pour un total de 578 jours d’hospitalisation Partage de compétences Satisfaction des patients Enrichissement personnel et professionnel des soignants Communication interservices

PERSPECTIVES
:
Une évaluation structurée de la satisfaction des parents doit être menée.
Projet de réduire le stress de départ en permettant aux parents d’enfants prématurés hospitalisés durant un long séjour de passer les dernières 48h ensemble avant leur retour à domicile
Journée
B28
Qualité 2022
Enquête satisfaction «information à la sortie» : focus dans une unité de chirurgie viscérale
CONTEXTE :

Analyse en séance pluridisciplinaire (Dynamo) des résultats du questionnaire satisfaction des patient.es 45% d’insatisfaction de la dimension «information à la sortie» 33% d’insatisfaction de la dimension «information à la sortie» sur les HUG en 2022
OBJECTIFS :
Identifier les informations manquantes à la sortie Améliorer et faciliter les conditions de retour à domicile
Inclure le patient.e comme partenaire de l’équipe de soins
METHODE : Élaboration d’un questionnaire destiné au patient.e Entretien téléphonique des patient.es volontaires entre J3 et J5 de leur sortie sur 1 mois Analyse des réponses du questionnaire Axes d’amélioration discutés en équipe














DONNÉES
Sur 24 patient.es interrogé.es : 50% ont été informé.es de leur sortie le jour même 25% ont été informé.es la veille 100% n’ont pas reçu la brochure institutionnelle «Guide du patient» 90% ont été rassuré.es avant leur sortie à la fois par l’équipe médicale et soignante 80% ont reçu des informations concernant le suivi post-opératoire 100% n’ont pas reçu de numéro de contact en cas d’urgence 72% ont relevé le manque d’informations suite à leur retour à domicile
Les bulles d’amélioration

CONCLUSION
Identification des thématiques manquantes Clarification des informations dans une démarche collective (équipe interprofessionnelle– patient.es partenaires) Reconnaissance des patient.es participants
Création d’un groupe de travail pluridisciplinaire
Réalisation d’une brochure connectée
Analyse des résultats 6 mois après l’introduction
B46
Journée Qualité 2022
DUCASSE Céline1, MEGEVAND Fabiana1, TOSO Christian1, ALAMERCERY France1, ROCH BARRENA Florence1, NOVO Carlos2 1: Département de Chirurgie / 2: Service qualité
ALIMENTATION SOINS
GUÉRISON SUIVI
TRAITEMENT
PERSPECTIVES
Programme thérapeutique conçu avec les patients:
Processus de mise en œuvre du partenariat avec des patients dans l’unité d’Education Thérapeutique du Patient (UETP)
a





a Unité d’Education Thérapeutique du patient, Centre collaborateur OMS, Service d’Endocrinologie, Diabétologie, Nutrition et ETP, département de Médecine, Hôpitaux Universitaires de Genève et Université de Genève, Suisse b Patiente partenaire
POURQUOI?
CONTEXTE :
• Un axe du plan stratégique institutionnel
• Une demande des patients
+ une opportunité d’amélioration d’un programme d’enseignement collectif préparant à la chirurgie bariatrique
PROBLEME: ambivalence des professionnels de santé
OBJECTIFS:
Adapter le programme thérapeutique au plus près des besoins des patients
Expérimenter avec l’équipe de l’UETP un dispositif d’accompagnement au partenariat
Evaluer les changements des représentations du partenariat en santé.
RECRUTEMENT des PP PREPARATION des partenaires
1.
EXPLORATION des besoins
• Etude qualitative/ analyse par double lecture (6 PP déjà actifs, 6PS de l’UETP)
• Représentations différentes des modèles de partenariat
• Enjeux de place et de pouvoirs: statut des savoirs et respect de l’identité professionnelle
2.
RENCONTRE des partenaires
• Présentation: faire connaissance
• Mise au travail des compétences respectives communes et complémentaires
• Elaboration d’une charte commune de collaboration
COMMENT?
Un dispositif d’accompagnement au partenariat des acteurs sur mesure, cocréé et co-mis en œuvre par une équipe-projet partenaire (PP+PS)
4.
3.
TRAVAIL COLLABORATIF
•Observation du programme éducatif de préparation à la chirurgie bariatrique (3 jours) par la PP
•Analyse commune pour l’identification de la problématique
•Construction collective d’hypothèses de solution et amélioration du programme existant
EVALUATION-EVOLUTION
•QUALITE: Allocation d’un budget pérenne pour l’intervention de PP dans l’unité
Changement de positionnement des PS quant au partenariat en santé
•EFFICACITE (transformation du programme en cours): PP comme nouvel acteur co animateur des ateliers
APPRENTISSAGES et PERSPECTIVES?
Le partenariat en santé ne se décrète pas: il se construit avec les acteurs de santé en réponse à leurs besoins.
Son expérimentation devient situation d’apprentissage pour faire évoluer les partenaires dans leur collaboration et rendre visible, au sein de l’institution, les éléments favorables et les obstacles à sa mise en œuvre.
Le projet promeut une culture du partenariat à plus large spectre et à plus haut niveau de collaboration dans le service.
Journée Qualité 2022
B08
Florence Somers a, Anna Toumanovaa, Lydia Lanza a, Judith Bassb, Zoltan Pataky
PP: Patient partenaire PS: Professionnel de Santé
staying Alive en CHIR - BLS staying Alive en CHIR - BLS
Contexte Objectifs
• Cours de rappel formation Basic Life Support tous les deux ans


• 17% des collaborateurs à jour en chirurgie fin 2021
• Référentiel commun devait être remis à jour
Methode






• 11 nouveaux référents BLS formés soit 15 au total
• Demi-journées de formation spécifiques pour l’ensemble des référents
• Sessions de deux heures : Partie théorique Démonstration temps réel par les référents Reconstitution algorithme par les participants Entrainement sur mannequin Questionnaire en ligne en fin de session


Testez vous

• Former 50% des collaborateurs fin 2022 en chirurgie et 80% fin 2023.
• Améliorer le contenu de la formation, le partage d'expérience et favoriser l’expertise des référents.
• Créer un support formatif adapté et ludique.
Resultats et perspectives
• Formation ouverte à d'autres fillières que soignantes et à d'autres départements.
• 58% des collaborateurs formés fin décembre 2022, 13 sessions en 2022 et 20 sessions en 2023.
• 96% des collaborateurs trouvent le contenu de la formation pertinent et facile à comprendre.

• Réactualiser le E-Learning institutionnel. Proposer des débriefings après chaque réanimation réalisée.

 J. AOustin - H. Meriah - H. Christain - J. De Chassey- F. Vermeulen - F. Alamercery
J. AOustin - H. Meriah - H. Christain - J. De Chassey- F. Vermeulen - F. Alamercery
«Pied à Risque Avéré»
Démarche éducative auprès du patient ayant un diabète
Auteurs: Carla Drumond Campos, Équipe de soins 5ABCL, Dagmar Dimeglio Département de Chirurgie, Unité d’orthopédie septique
Contexte: Le diabète, une pandémie silencieuse, qui atteint 9,3% de la population mondiale avec un décès toutes les 8 secondes. L’antécédent d’ulcère plantaire, chez un patient avec un diabète, augmente de 30% le risque de développer une nouvelle ulcération dans la même année et à 2% le risque d’une amputation. Au 5AL, en dépit, d’un suivi en salle de traitement et en consultation de l’appareillage, trop souvent, les patients reviennent pour les récidives des plaies.

OBJECTIFS:
• Intégrer, dans une unité de soins aigus, des soins d’autogestion de la maladie et de promotion de la santé.
• Former les soignants à l’observation, au soin et au partage des connaissances autour du «Pied à Risque Avéré».
• Formaliser les occasions éducatives.
Quoi?
Soins
- Surveillances
Autogestion de la maladie
Partage
Pour qui? Équipe médico soignante
Quand? Occasions éducatives
Amélioration des Soins


Innovation
Comment?
Check list « Pied à Risque Avéré »
- Prescription des soins Transmissions ciblées
CONCLUSION :
Où?
5AL Unité des soins aigus
PERSPECTIVES:
Ce projet s’inscrit dans la vision 20+5 avec l’amélioration continue, la qualité des soins et le partenariat. Il amène une plus value dans l’optimisation des compétences des soignants, l’autonomie du patient dans sa maladie et la réduction des complications. La visibilité et la transversalité de la transmission ciblée «Prise en charge du Pied à Risque Avéré», au sein de tous les départements aux HUG, est un atout majeur pour garantir la continuité de la prise en soins.
Suivre les indicateurs tels que le processus (utilisation de la prescription de soins et transmission ciblée), l’intégration (qualité et pertinence de la documentation), les bénéficiaires (questionnaires sur l’acquisition des compétences durant le séjour hospitalier) et les résultats (nombre de réhospitalisations) avec des critères à définir.


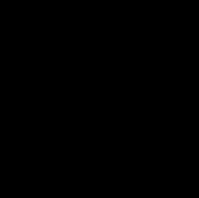



Promouvoir une prise en soins standardisée sur le «Pied à Risque Avéré» au sein des HUG. Développer le travail en réseaux avec les équipes en aval et les médecins traitants.
Références::
1.. JornayazF.,R., et al. Le diabète: une pandémie oublié? Rev méd. Suisse. 2021, n° 741,1059 1060
2. Malacarne. S., et al. Prévention des complications du pied diabétique. Rev méd. Suisse.Vol 2, n° 521, 2016.pp1092 1096

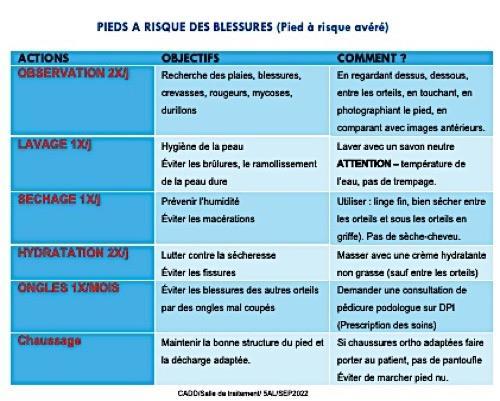
B31













JournéeQualité2022 TransportdesDMx,DispositifsMédicauxpré-désinfectés: SécuritéetTraçabilitérenforcées STDMetSTERunispouraméliorerlaQualité AuDEX,Départementd’Exploitation,lesServicesTransportDistributionetMagasinetStérilisationCentraleunispour: Réduirelesrisques(AES…)pournoscollaborateursetlepersonneldesUnitésdeSoinslorsdelamanipulationsdessacs AméliorerlatraçabilitédesDispositifsMédicauxpré-désinfectésentransit Garantirdesconditionsoptimalesdetransport EquipeProjet:Alexandra(AABR)_Sandrine(SATH)_Alexandre(ABAD)_Carlos(JCRM)_Alejandro(AGTO)_Stéphane(SNDB)_Emmanuelle(EFUE)etlessponsors:Thierry(TERN)etFabienne(FMOA) MerciégalementàlaCAIB,aupersonneldesUnitésdeSoins,àlaDirectiondesSoinsetàPlexusSantépourleurcontributiondirecteauprojet B38
Parcours de formation pour le personnel soignant
Auteures: Magalhaes Rachel, Bilhete Irina, Portier Jane, Welker Sylvie. Département de médecine de premier recours - Clinique de Crans Montana
Les changements induits par la crise de la COVID 19 ont contribués au besoin de mettre en valeur les formations d’une part internes à la clinique ainsi qu'au catalogue des HUG toujours en lien avec les objectifs prioritaires de notre mission de soin en réadaptation.
OBJECTIFS
Meilleure visibilité des formations pour les soignants
Soutenir et encourager la participation aux formations

Susciter l'intérêt et l'adhésion
Développement des compétences
Attractivité de la clinique
Améliorer la qualité et la sécurité des soins
MÉTHODES















Groupe de travail
Evaluation des besoins
Recensement des formations disponibles

Création d'un planning

OUTILS

Espace pour la transmission des savoirs
Création d'une matrice des compétences (skillmix, grademix)
Ce projet en cours d’élaboration a pour objectif de mettre en valeur les compétences des soignants ainsi que leur amélioration. Il permettra également de proposer des formations pour développer des nouvelles compétences et expertises dans le domaine de la réadaptation. Tout cela permettra de rendre visible la mission et l'offre en soin dispensées à la clinique de Crans-Montana.
Journée d'accueil HUG
Journée d'accueil CCM Intégration nouveau collaborateur Huddleet tableau d'unité Entretien motivationnel Préparation RAD Instruction feu BLS APP Atelier violence DPI Supervisions CIR MIF
Journée Qualité 2022 B43

















Journée Qualité 2022 A10 PURE (Premature Uninfected a Real Example) Flavia Rosa-Mangeret1, Gaud Catho2, Valérie Sauvan2, Olivier Baud1, Sébastien Fau1, Francisca Barcos-Munoz1, Marlene Abreu1, Laetitia Ocampo1,Karine Olearan1, Yann-Levy Jamet1, Nathalie Bochaton3, Delphine David1, Aline Gaudin1, Catherine Vassant-Allemoz1, Nicolo Buetti2, Riccardo E. Pfister1 (1) Service de Néonatologie et Soins intensifs pédiatriques, Hôpitaux Universitaires de Genève; (2) Service de prévention et contrôle de l’infection, Hôpitaux Universitaires de Genève, (3) Direction des Soins Un projet «Bottom- up» pour réduire l’infection nosocomiale
Réduire l’incidence des CLABSI de 50% de décembre 2020 a décembre 2022 (de 16 a 8 infections/1000 jours cathéter) Groupe Feedback et Promotion des pratiques • HDM • Formation et promotion • Posters Groupe Cathéter Evaluation et changements des pratiques autour du cathéter (questionnaire, vidéos, protocoles) Groupe Environnement Redéfinitions zones, restructuration Protocole désinfection couveuses Surveillance épidémiologique avec SPCI Communication équipe 2020: 25% des prématurés ont une CLABSI Projet continue dans un cycle de qualité. Objectif actuel: 50 % de réduction de l'incidence CLABSI d’ici décembre 2024! Engagement de l'équipe! Approche «Bottom-up» a efficacement réduit le CLABSI. Réduction de 70% de l’incidence des CLABSI (4,6 infections/1000 jours cathéter) 2019 2022 2020
OBJECTIF
Une lutte quotidienne contre les infections liées aux cathéters en néonatologie
CONTEXTE
• Entre 2019 et 2020, 98 % des infections associées aux cathéters
• Pose de cathéter complexe et immaturité du système immunitaire
• Manipulation des cathéters hautement à risque
Projet multidisciplinaire
OBJECTIFS du « groupe cathéter »
1. Stopper les infections liées au cathéter
2. Revoir et Renforcer les bonnes pratiques médicaux soignantes autour des cathéters en néonatologie

METHODE








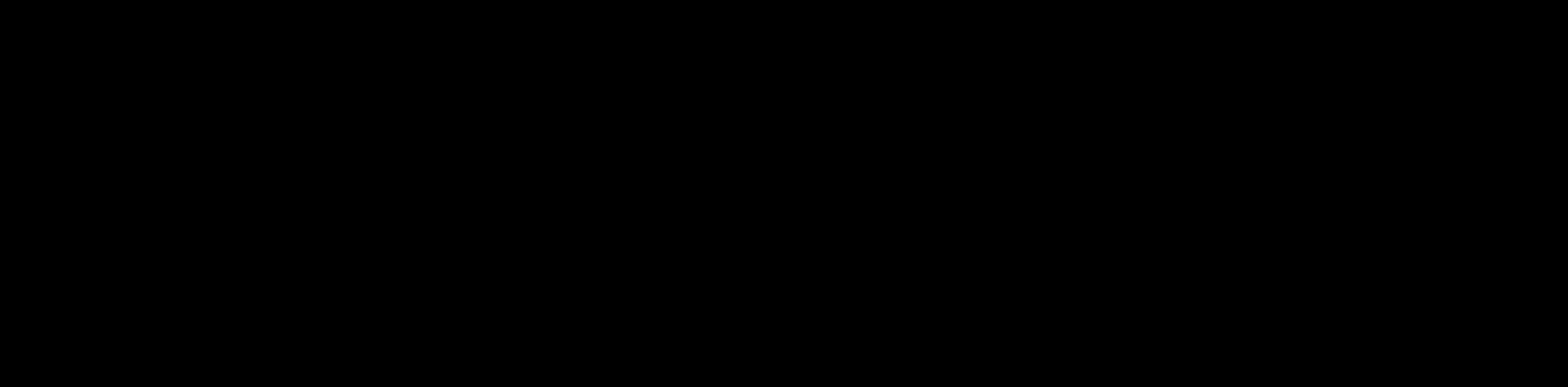
















• Revue libre de littérature
• Inventaire des bonnes pratiques et recommandations HUG et hôpitaux Suisse, Français et Belge
• Questionnaire d’auto détermination de la pratique des infirmières
CONCLUSION
Culture médico soignante et mobilisation de tous pour combattre les infections liées aux cathéters grâce à une collaboration multidisciplinaire
RESULTATS suite
RESULTATS
Alignement des standards de pratique sur recommandations internationales
Le questionnaire d’auto détermination des infirmières confirme:

• Le besoin de resensibiliser les équipes infirmières aux bonnes pratiques
• Le manque de clarté de certaines procédures liées à la spécificité des cathéters en néonatologie
• Restitution des résultats aux équipes soignantes
• Réajustement des circuits de perfusions (cf. exemple 1)

• Réalisation de capsules vidéos: bonnes pratiques de la préparation à l’injection des médicaments IV en néonatologie (cf exemple 2)


Associées aux mesures des autres groupes de travail, ces premières interventions ont permis de réduire de 70 % les infections liées aux cathéters
PERSPECTIVES
J’utilise des compresses imprégnées de chlorhexidine à 2% pour connecter et déconnecter les tubulures….
Révision du guideline pour la pose des PICC en Neonatologie Evaluation de la durée de vie des cathéters Evaluation des pratiques par un nouveau questionnaire
Journée
B25
Qualité 2022
!!
N.Bochaton, P. Bellue, S. Fau, A. Carlhan-Lederman, C. Mardegan, V. Sauvan, V. Depret-Turconi, C. Vassant- Allemoz, R.Pfister, F. Rosa-Mangeret PURE (Premature Uninfected a Real Example)
Exemple
1 Exemple 2
L’AS DES CŒURS ou la préparation et l’accueil de l’enfant opéré cardiaque aux USIPED par l’aide-soignant.e
L.Penfornus, W.Arhab, C.Biyiha, M.Duverney, M.Hasanagic, K.Salihu, N.Bochaton, DFEA






Pour faire face à la forte activité des soins intensifs de pédiatrie, sous délégation infirmière, certaines tâches sont réalisées par les aides soignant es pour permettre une meilleur répartition de la charge de travail et de libérer du temps aux infirmier.es.
L’infirmier e délègue à l’aide soignant e la préparation du matériel et de la chambre qui va accueillir l’enfant opéré cardiaque du jour.
Place standard : Place pour la réception d’un enfant post chirurgie cardiaque:


Avec les compétences que l’aide soignant.e a développées aux USIPED, celui le ci va structurer et organiser la préparation du matériel et de la chambre pour accueillir l’enfant
Tour de transport avec O2 et air
Scope et câbles
Respirateur calibré et fonctionnel x2
Lit adapté
Table de nuit et matériel d’aspiration
Matériel pour les drains Pace maker
Pour l’enfant : Pour l’aide soignante :
* Qualité et sécurité des soins augmentés
* Double contrôle du matériel
* Efficience dans la prise en charge
* Participation active à la prise en charge de l’enfant
* Satisfaction et fierté
* Reconnaissance
* Collaboration et partage de responsabilité avec l’infirmier.e apprécié
* Meilleure connaissance de l’enfant
Pour l’infirmier.e : Pour Le médecin :
* Un gain de temps
* L’aide soignant.e connait
* Temps dégagé pour autre activité l’enfant à l’avance en cas de
* Diminution du stress complication et gagnera en
* Diminution charge de travail efficacité et réactivité
Les plus values sont multiples : meilleur efficacité, prise en charge simplifiée car chacun à un rôle défini, sécurité accrue pour l’enfant, satisfaction de l’équipe et répercussion sur la dynamique d’équipe par l’implication, valorisation
Standardiser sur la base d’une procédure cette préparation en créant un outil récapitulatif, type arbre décisionnel pour faciliter son utilisation et la formation du personnel Continuer de développer la collaboration aide soignante infirmiere sur d’autres situations de soins complexes et étendre ce type de collaboration à tous les enfants en post opératoire
Journée
B 34
Qualité 2022
24 février 2022
La Russie attaque l’Ukraine.
Contexte
Task Force Ukraine, créée par les HUG, pour anticiper l’accueil des nombreux réfugiés générée par cette guerre
Le programme santé migrants (PSM, SMPR), consultation de référence pour les réfugiés, réalise qu’il ne pourra pas absorber ce flux supplémentaire
: Une 1ère consultation indispensable pour orienter le suivi médical des réfugiés d'Ukraine



Création d’un structure parallèle : le PSM bis.

Nécessité de former le personnel infirmier recruté pour évaluer l’état de santé des Ukrainiens adultes primo arrivants

L'évaluation de santé initiale (ESI)
Résultats : formulaire ESI (évaluation de santé initiale) semi standardisé Entretien en 5 étapes
1. Présentation du PSM, du système de santé GE et du parcours de soin
2. Bilan social
3. Anamnèse somatique
4. Santé mentale




Objectifs
Former le personnel, standardiser et homogénéiser les procédures Identifier les patients nécessitant des soins, les orienter dans le système Dépister rapidement les problèmes de santé mentale Recourir à des pratiques culturellement acceptables pour les patients

Méthode
Groupe de travail médico infirmier Mise à jour, adaptation et standardisation d’un questionnaire infirmier préexistant Développement d’un algorithme décisionnel pour la prise en charge du patient Focus sur la santé mentale car population spécifique, exposée à la guerre

5. Laboratoire prescrit par l’infirmière, avant 1er rdv médical


Conclusion
Environ 2000 patients vus en 8 mois ESI = entretien semi standardisée, acceptable culturellement, permettant de:
Évaluer rapidement l’état de santé des réfugiés à l’arrivée
Les orienter efficacement dans le système de soins Dépister précocement leurs problèmes de santé mentale




En situation de crise migratoire importante, une approche collaborative et interprofessionnelle favorise la dynamique d'équipe et facilite l'identification rapide des besoins des réfugiés

Perspectives
Journée
B44
Qualité 2022
Pierre-David KAMOUN, Pawan PRASAD, Sophie DURIEUX-PAILLARD, Serge GAY, Fanny BENARD Programme Santé Migrants, Service de Médecine de Premier Recours
5
Lesson learned : WE CAN DO IT !
Renforcement de l’autonomie d’évaluation des soignants du PSM, yc avec les autres réfugiés Développement dans d’autres unités du DMPR/ HUG ?
Consultation pour refugiés d'Ukraine par mois et par département (source : Dashboard Ukraine HUG 02 12 2022)
Application LILI – traçabilité de la prestation lit réalisée par le SPH







Déclencheur technologie utilisée pour le monitoring de la prestation lit devenue obsolète
Opportunité ajouter des alertes, améliorer la traçabilité et la localisation

Résultats
HUG
Résultats SPH
• sécurité patient grâce à un meilleur système d’alerte des maintenances
• maîtrise du processus, nous connaissons aujourd’hui mieux les lieux et les fréquences de nettoyage

• qualité de la prestation via le suivi des nettoyages à fond va permettre d’augmenter cette activité
Qualité 2022
• lien avec la GMAO
• alerte des transporteurs patients
• sécurité patient grâce à un meilleur système d’alerte des maintenances











Journée
B04
Malek Ben (DEX), Ludovic Bouet (DSI), Osvaldo Pinto De Oliveira (DSI), Aymeric Fauvin (DO), Hugo Freitas Martinho (SPH), Maurice Gremion (SBE), Salète Marques (SBE), Gaëtan Meier (SPH), Nathalie Oger (DSI)
Restriction de l’accès aux applications pour les patients incarcérés
Facteurs de risques
Problème : diffusion d’informations sur les patients incarcérés via GRECO, Concerto, etc… utiles à la prise en charge mais risque pour la sécurité dans le contexte pénitentiaire




Facteurs de risques : tentative d’évasion, remise d’objet ou de substance, intimidation, etc…


Restriction aux applications : Reprise de l’identification des patients incarcérés via la notion «Discrétion totale» + blocage des éléments critiques au plus haut niveau du système d’information HUG









Même prise en charge + Même qualité des soins + Même accès aux examens et spécialités + Même sécurité

Journée Qualité 2022 B29
Madalena Almeida (SMP), Nicolas Cassoni (DSI), Alexandre Garrido (DPSS), Gaëtam Meier (D MPR) Florian Müller (DSI), Nicolas Peigné (SMP), Hans Wolff (SMP)
CONTEXTE
Massage du dos avec une synergie d’huiles essentielles pour améliorer la prise en charge de la douleur et soutenir les femmes pendant la période de pré-travail et le début de travail d’accouchement qui peuvent être douloureux et anxiogènes.
OBJECTIFS
Evaluer si l’application de l’aromathérapie lors du massage a un impact sur l’anxiété et la douleur des parturientes.si l’ application de INDICATEURS





Douleur, anxiété, satisfaction
CRITÈRES D’INCLUSION
Les femmes primipares et multipares en bonne santé avec une grossesse harmonieuse.
METHODE
Questionnaire évaluant l’anxiété : STAI

Evaluation de la douleur : EVA Questionnaire de satisfaction pour les sages- femmes et les patientes.
CONCLUSION
Le massage proposé a montré des effets positifs sur la douleurs, l’anxiété ainsi que la satisfaction de nos patientes.
PERSPECTIVES
Cette offre sera dorénavant proposée en salle d’accouchement.
AROMA-NAISSANCE
Offrir à nos patientes un soin complémentaire en salle d’accouchement
C Y Montandon L Van Baalen, G Giauque, Pre.,B Martinez de Tejada , Dr. C Daelemans Dr. C De Labrusse, Dr. HE Thorn Cole,
RÉSULTATS
En moyenne l’anxiété a diminué de 8.6 points.Ce résultat est compatible avec une réduction réelle entre 5 et 12 points.
La douleur a également diminué après le massage entre 2 et 16 points.
Synergie d’huiles essentielles
Calmante
Géranium
Sédative
FLYER D’INFORMATION / RECRUTEMENT
Information de l’étude Oralement aux consultations, aux urgences au prénatal et à leu arrivée
En salle d’accouchement à l’aide de la brochure
Vérification des critères d’éligibilités Lavande fine
Rassurante
Benjoin
Apaisante
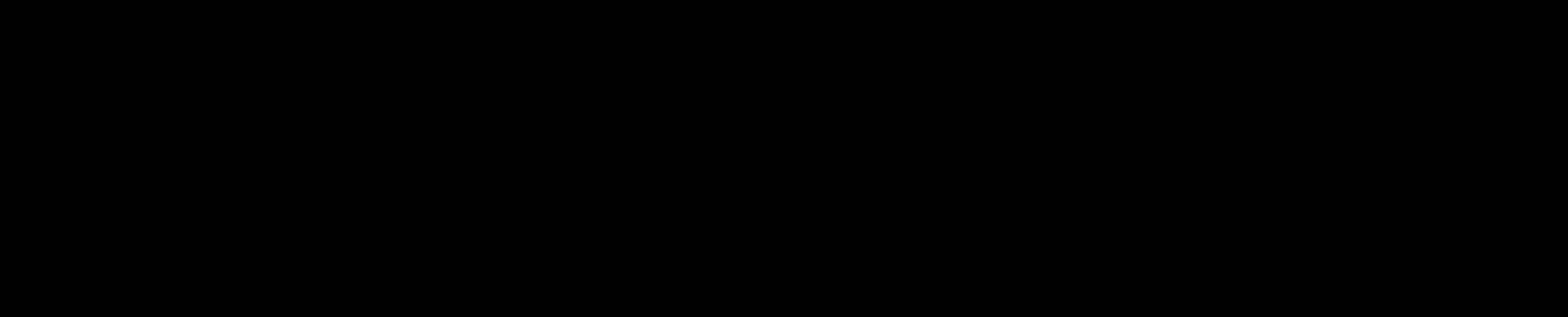





Petit grain bigarade
SATISFACTION
Le massage a été très apprécié par les patientes avec un taux de satisfaction à 78%.

Les soignants ont également appréciés le soins en soulignant qu’il demandait plus de temps que des soins usuellement proposée, surtout en raison des questionnaires.
Journée Qualité 2022
B09
Infirmières Spécialistes Cliniques… penser sa pratique autrement
« Penser sa pratique et pratiquer sa pensée » N. Bochaton MScSI, A. Groz MScSI, V.Gogniat MSc, Direction des soins, Pôle
Cadre APP
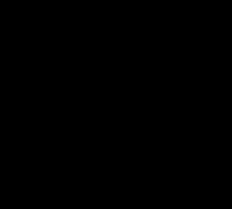

















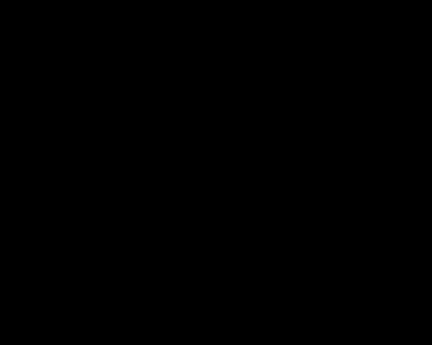














CONTEXTEte et problématique
46 ISC
Domaine d’expertises et liens de pratiques pluriels Situations professionnelles complexes: Accompagnement des équipes, patients, familles. Sentiment de solitude
OBJECTIFS
Répondre au besoin d’échange formel autour des pratiques ISC par la création d’un espace de pensée groupal de travail.
Etapes GEASE
METHODE
Espace réflexif entre pairs sous forme d’analyse de la pratique professionnelle (APP) 10 séances chaque année (5 à 10 participants) et engagement sur l’année Méthode GEASE (Groupe d’Entrainement à l’Analyse de Situations Educatives)

CONCLUSION
Pratiques Professionnelles
• Engagement
• Confidentialité
• Bienveillance
• Non jugement
NARRATION d’une situation professionnelle vécue
FORMULATION d’une question par le narrateur
QUESTIONNEMENT du groupe envers le narrateur PROPOSITIONS du groupe:
• Compréhension
«Elargir son réseau»
«Respect des étapes qui nous permet d’avoir une meilleure réflexion»
«Aller au fond de ce qu'on pense sereinement»
« Penser sa pratique et pratiquer sa pensée» selon une modalité structurée un atout pour l’assise et le rayonnement professionnels des ISC
REFERENCES
• Dederding B, Gogniat V, Hochuli I. Dispositif de formation à l’analyse de la pratique professionnelle. Soins cadres. 2017;(103) : 53 56.
«Avoir une autre vision avec le regard des autres» «Avoir une vision panoramique de la situation»
• Résonnance Solutions CONCLUSION par le narrateur
«Je viens avec des questions … j’ai des réponses»
«Permet de passer du ressenti au raisonnement»
RÉSULTATS
☼ Maturité professionnelle
☼ Mobilisation et développement: ☼ des savoirs expérientiels ☼ des principes éthiques ☼ de la créativité
☼ Sentiment d’appartenance
☼ Cohésion du groupe
PERSPECTIVES
Formation à l’APP pour les ISC en uniformité avec la formation de Master ès Sciences en Sciences Infirmières MSc. SI
Supervision Groupale
• Lagadec AM. L'analyse des pratiques professionnelles comme moyen de développement des compétences: ancrage théorique, processus à l'œuvre et limites de ces dispositifs. Rech Soins Infirm. 2009;(97):4 22.
• Verdon M, Bochaton N, Roulin MJ, Groz A. (2021). Analyse de la pratique professionnelle dans la pratique des infirmières cliniciennes spécialisées d’un hôpital universitaire Suisse: une analyse de contenu. Revue francophone internationale de recherche infirmière. 2021; 7(3): 1 8. doi: https://doi.org/10.1016/j.refiri.2021.10024
Journée
B14
Qualité 2022
Lutter contre le Délirium aux Soins Intensifs de Pédiatrie : une Nouvelle Philosophie
CHEVALIER Audrey (1), TOURNAIRE Céline (1), RUDOLF VON ROHR Thomas (2), FONZO-CHRISTE Caroline (2), BORDESSOULE Alice (1). (1)Service de néonatologie et des soins intensifs de pédiatrie, (2) Unité de pharmacie clinique spécialisée, HUG
CONTEXTE :
Le délirium se caractérise par la survenue brutale d’une perturbation de la conscience et une altération du fonctionnement cognitif.
Le diagnostic du délirium est complexe. Près d’un patient sur trois présente un délirium dans une unité de soins intensifs de pédiatrie.

Le délirium augmente la durée de séjour, les accidents iatrogènes, la durée de ventilation mécanique, la mortalité.
OBJECTIFS :
o Agir sur l’environnement tout en assurant une sécurité optimale du patient
o Protéger le patient des nuisances auditives et lumineuses
o Acquérir une prévention systématique
o Encourager la réflexion des collaborateurs

RESULTATS :
1. Implémentation d’un protocole pour faciliter le dépistage : échelles d’évaluation SOS-PD et RASS
2. Ajout des mesures environnementales pour la prévention et la prise en charge du délirium
3. Clarification des mesures pharmacologiques en fonction de la situation
CONCLUSION :
Politique d’unité d’amélioration des conditions de vie de l’enfant hospitalisé aux soins intensifs de pédiatrie :
o Favoriser la présence des parents o Stimuler la connaissance de l’équipe soignante
o Prévenir le délirium par les mesures environnementales
o Evaluer
o Travailler en inter disciplinarité
PERSPECTIVES :
E learning : apport théorique + vidéo immersive reproduisant le vécu de l’enfant
Journée Qualité 2022
B19
Contexte
• Aux HUG, en 2021, 145 situations de deuil périnatal (mort in utero, interruption médicale de grossesse, fausse couche tardive, décès néonatal).

• Tabou sociétal, deuil dit « invisible »
• Isolement et solitude dans le post partum
• Demande des couples suivis sur le long terme de rencontrer des pairs, partager avec eux pour se sentir mieux compris
Objectifs
• Partage sur le vécu du deuil périnatal entre pairs
• Réduire la symptomatologie d’un deuil pathologique
• Prévenir les complications psychologiques/psychiatriques, améliorer la qualité de vie des parents endeuillés
• Permettre l’élaboration de récits traumatiques et verbaliser
• Favoriser les échanges
1. Les étapes du deuil
Comprendre le processus du deuil, identifier les étapes traversées et mettre des mots sur la réalité
Résultats
2. Le vécu à l’intérieur du couple
Échanger et consentir aux différences de rythme et besoins propres à chacun-e.
3. Vécu dans la société et l’entourage
Parler du sentiment d’incompréhension ressenti à l’extérieur, briser le tabou et le silence autour du deuil périnatal, rompre le sentiment de solitude.
Méthode
• Groupe de 8-10 personnes (en couple ou seul.e)

• 4 séances de 1 heure
• Accompagnement par un-e psychiatre, accompagné-e d’un-e sage femme ou d’un-e aumônier-e en alternance
5. Témoignage







«Grâce à ce groupe de paroles, nous avons pu découvrir de nouvelles ressources auprès des autres couples présents. Cela nous a aussi permis de pouvoir mettre des mots sur ce que nous vivions, tout en étant réellement compris par les autres participants. Tout cela a été extrêmement précieux pour nous dans notre processus de deuil »
Conclusion
• Création de liens forts entre les parents
• Émergence de ressources
• Richesse de l’aspect pluridisciplinaire de l’accompagnement
• En complément ou non de suivis en couple psychothérapeutiques ou en individuel deuil périnatal
Perspectives
• Pérenniser ces séances de thérapies de groupe
• 3 fois par an ou davantage selon la demande
4. Les ressources Mesurer le chemin parcouru, les ressources intérieures et extérieures
Journée Qualité 2022 B39
1 2 3 4 5
Intégrationet@Intégration

Unprocessusdʼaccueiletdʼintégrationpertinent, maitriséetévolutifestprimordial pourfidéliser unnouveaupersonnel.
LaDirectiondessoinsproposedepuisde nombreusesannéesunprogrammedʼintégration.

En2022,ceprogrammeestrévisédanssaformeet sonfond.

Ajusterleprogrammeauxtransformationsdes environnementshumainsetprofessionnels. Former100%desnouveauxcollaborateursen renforçantlʼaspectinterprofessionnel.





Valoriserlesformationsréaliséesdèsl'arrivée. Favoriserlacommunicationentreles formateurs.
Faireévoluerledispositif.

JournéeQualité2022 B49
Journéesd'intégrationdesnouveauxpersonnelssoignants
Maitrisedu fluxparticipants Contenus actualisés Parcoursdigital apprécié Gestiond'équipe modernisée Résultats Contexte Objectifs Auteures:M.Seignobos,C.Kervella,I.Ovan-Directiondessoins-CentredeFormationetCompétences Intégration réussie PPS AS-ASA SF ASSC Infirmiers 8 6 4 2 0 Contributàdévelopperun sentiment d'appartenanceauxHUG Intranet actualisé +90 FORMATEURS IMPLIQUÉS 14 SEMAINESDEFORMATION PARANNÉE 189 SOIGNANTS INTÉGRÉS DEJANVÀSEPT2022 DESNOUVEAUXCOLLABORATEURS SOIGNANTSFORMÉS DEPUISJANV22 5 RENCONTRESDEL'ÉQUIPE PROJETEN2021 98% Timeline
SÉCURISATION ET SIMPLIFICATION DU PROCESSUS D’IDENTIFICATION
DES TRAITEMENTS INTRAVEINEUX
Chefs de projet : A. Berent & S. Sommer Service d’Hématologie / Département d’Oncologie



Contexte : Le processus d’identification des traitements intraveineux est basé sur la retranscription manuscrite des informations figurant dans le DPI sur des étiquettes blanches ou partiellement pré remplies.



Problématique : Risque d’erreur lié à la retranscription et mauvaise lisibilité. Activité très chronophage.

Objectifs : Sécuriser et simplifier le processus d’identification des traitements intraveineux en supprimant la rédaction manuscrites au sein des unités d’oncohématologie. Diminuer de 50% le temps dédié à la réalisation des étiquettes.
Identification
Traitement
Planification
7 cm 6.4 cm 5 cm 4.4 cm
Comment ça marche : La création d’une interface informatique permet de générer automatiquement les étiquettes des traitements intraveineux de chaque patient. Les étiquettes sont imprimées sur les planches « Diogène » Le matériel utilisé est déjà disponible dans l’institution ce qui n’entraine qu’un coût restreint
Résultats : Dans les unités d’onco-hématologie adulte 95% des étiquettes sont désormais informatisées. Le temps dédié aux étiquettes a diminué de 59% La satisfaction des infirmières par rapport à l’étiquetage est en très net amélioration

Temps de réalisation d'une étiquette manuscrite
Temps de vérification d'une étiquette informatisée

50
Temps [sec] Rédacteur n°
40
30
20
60 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Temps médian de 36 sec.
Temps [sec] Médianne
Temps de réalisation d’une étiquette 10
20
10
Temps [sec] Rédacteur n°
30 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0

Temps médian de 13 sec.
Conclusion : La production automatique des étiquettes augmente la sécurité et redistribue du temps patient. Son déploiement dans les unités de soins serait une plus value pour les patients et les équipes soignantes des HUG.

Mandante : S. Decosterd / Equipe projet : Dr Guignard B., Portela J., Staub J-C., Ducloux P., Dr Beauverd Y., Tarpin-Lyonnet M., Despond M., Girard C., Percebois V.

A04
Journée Qualité 2022
Qualité 2022
Journée
CONTEXTE
Création d’une équipe pluridisciplinaire pour la prise en soin et l’accompagnement des enfants en situation de handicap intervenant dans toutes les unités du DFEA

OBJECTIFS
Assurer une référence, un suivi et un lien continu Optimiser l’anticipation d’une hospitalisation, le retour à domicile et la mise à jour des données partagées.
Améliorer la qualité des soins et la communication entre les différents intervenants Offrir des consultations ambulatoires pluridisciplinaires
METHODE



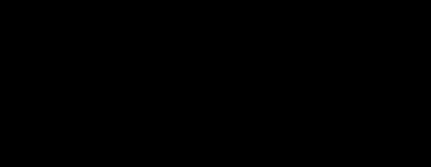

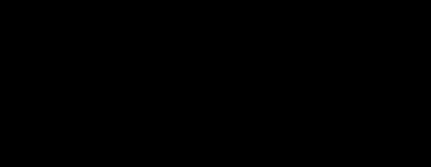







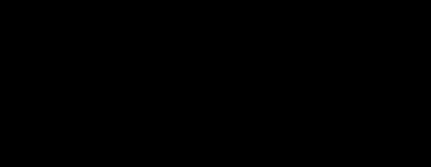










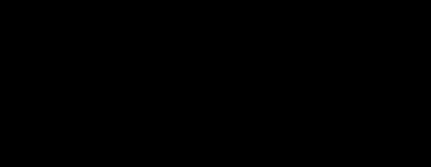

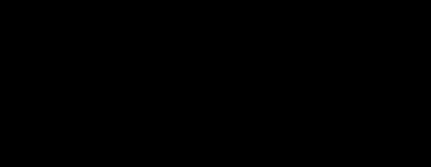

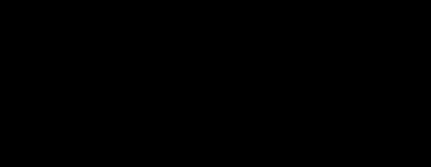



L’EMHP est contactée par les proches aidants et/ou les institutions et/ou les divers services du DFEA. Une consultation est organisée afin de définir les besoins qui seront transmis au service qui va accueillir l’enfant, ainsi que les divers intervenants.
CONCLUSION
Les enfants en situation de handicap nécessitent une prise en soin complexe et pluridisciplinaire et en partenariat avec les proches aidants. L’EMHP répond à ce besoin en offrant une prestation individualisée avec un suivi pré hospitalier, hospitalier jusqu’au retour à domicile.
PROMOTION
QUALITE DE SOINS
Journée Qualité 2022
B05
Laurent Jardinier (Infirmier DFEA), Sarah Eigenheer Meroni (Physiothérapeute DFEA), Florence Klimczak (Ergothérapeute NEUCLI DFEA)
TRAVAIL ADMINISTRATIF TRAVAIL
PATIENTS
AVEC
Problématiques
IDENTITE SOUTIEN AUX
EMHP Collaboration Inf / Physio / Ergo
UNITES
079 55 38 3 38
equipemobilehandicap@hcuge.ch
ANTICIPATION PRE HOSP SUIVI HOSPITALIER PREPA RETOUR A DOMICILE
CONTEXTE
Ø Fins de vie et retraits ou limitations thérapeutiques fréquents aux Urgences
Ø Absence de guideline propre au service pour l’évaluation des symptômes et pour l’instauration d’une sédation palliative

Ø Recours pas toujours aisé aux spécialistes en soins palliatifs en raison de l’urgence des situations rencontrées dans le service
Ø Envie d’autonomisation des médecins et soignants du service
Ø Travail de fin de diplôme FSU sur la thématique du retrait / limitation thérapeutique au SU
OBJECTIFS et METHODE
1. Promouvoir l’interdisciplinarité dans une démarche participative : Constitution sur la base du volontariat d’un groupe interdisciplinaires (médecins, RES, infirmier e s, ASSC, aides soignant e s) de référents de soins palliatifs au SU, formation par les spécialistes du service de médecine palliative [SMP] puis expansion de la formation aux équipes médico soignantes du SU assurée par les membres du groupe
2. Améliorer la qualité des soins :
Ø Élaborer un protocole médico soignant et un algorithme de prise de décision lors d’un retrait ou limitation thérapeutique dont les principaux objectifs sont :
• Savoir évaluer les symptômes et les définir comme réfractaires pour débuter une sédation palliative
• Savoir effectuer le retrait thérapeutique d’un patient sous assistance respiratoire
• Savoir interroger sa pratique et proposer des axes d’amélioration par le biais d’une check list
• Répondre à une logique institutionnelle et départementale pour la prise en charge des soins palliatifs hors service de médecine palliative [SMP]
Ø Élaborer un outil informatique (ordre à boutons) pour la prescription des échelles d’évaluation des symptômes, la titration de morphine et de midazolam, et l’instauration de sédation palliative si besoin
3 . Gagner en transversalité : travail collaboratif entre les soins intensifs, les urgences et le service de médecine palliative
CONCLUSION
Projet qui continue à prendre forme et fait écho au niveau du service et du DMA
ACTIONS
A VENIR
1. Valida(on du protocole médico soignant (en cours)
2. Forma(on des CDC

RESULTATS
Référents SP formés:
4 infirmières
1 CDC
1 Médecin Adjoint 1 RES 1 ASA 1 ASSC







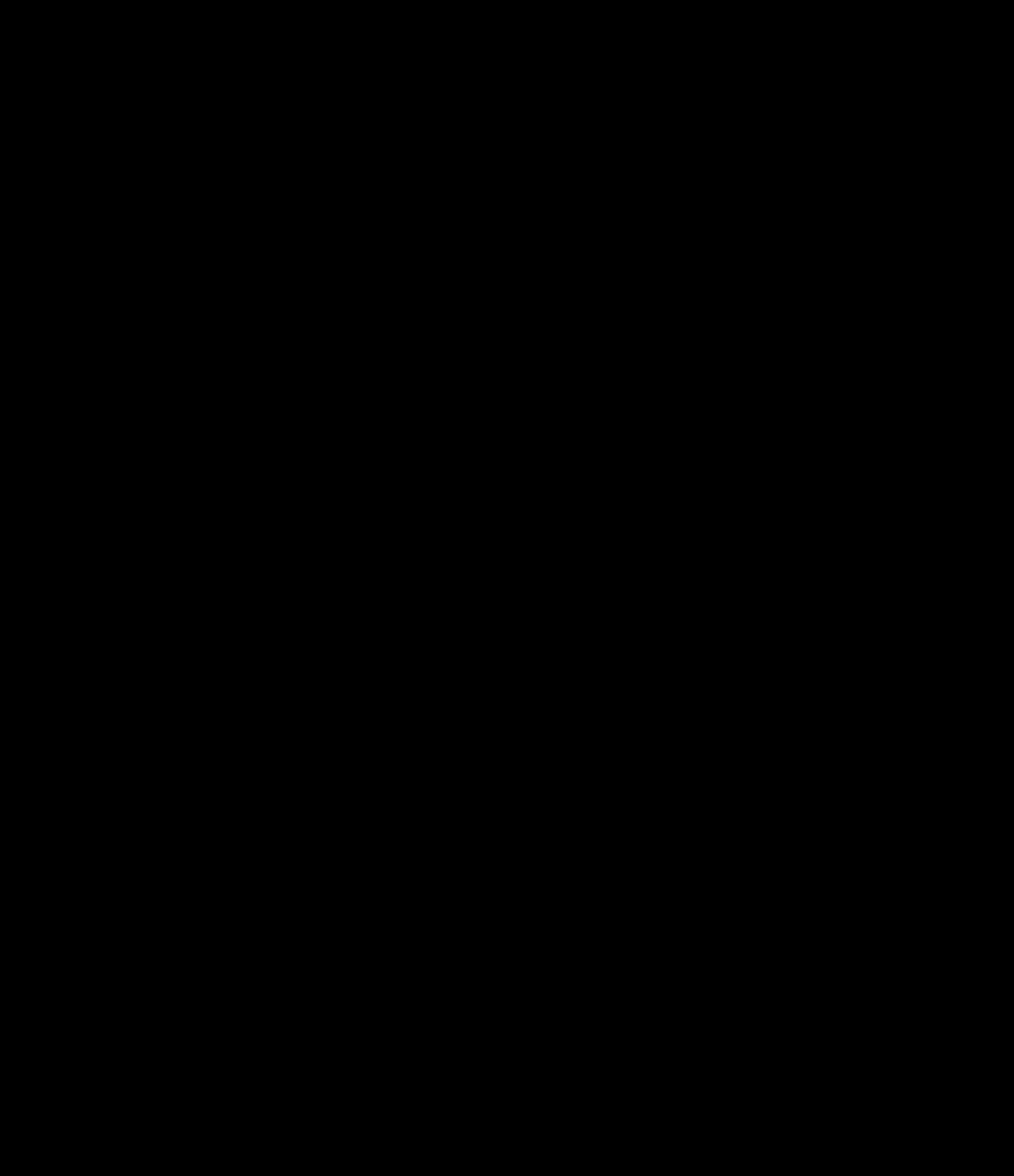


Formation FSU:
Promotion 34 en mars 2022 et promotion 35 en Janvier 2023
Formation Soignants SU:
Infirmiers: 30 ASSC : 8
APPRENTIS ASSC : 2 ASA :6 Total: 6 ateliers 46 soignants
Formation post-graduée des médecins internes:
Novembre 2021 et et octobre 2022
Logistique spécifique
Unité d’observation du SU : Check list, pochette «pense bête» pour les soignants : livret sédation, décès, deuil, aumônerie etc Aménagement d’une armoire spécifique pour les soins de confort dans la chambre dédiée aux fins de vie
Simulation
Introduction de scénarios de simulation autour des retraits/ limitations thérapeutiques pour les séances interprofessionnelles du SU au CIS
3. Elabora(on de l’ou(l informa(que (sur DPI) pour la surveillances des symptômes et leur traçabilité lors des retraits ou limita(ons thérapeu(ques afin de faciliter le travail des équipes et analyser des données
4. Analyse des check lists remplies sur 1 an pour con(nuer d’améliorer notre pra(que
5. Pérenniser les forma(ons, le main(en de compétences et la sensibilisa(on :
• Organiser des forma(ons auprès des soignants et pour les médecins une fois/an
• Assurer l’intérêt d’autres personnes pour les inclure en tant que référents et assurer leur forma(on par les spécialistes de soins pallia(fs
• Suivre l’acquisi(on des compétences par le biais d’accompagnements cliniques et ateliers de simula(on
• Retour sur l’implémenta(on après 6 mois de mise en place du protocole puis 1 an et bilan des ac(ons pour proposer une remédia(on et une améliora(on.

Journée
B30
Qualité 2022
Soins palliatifs au sein du service des Urgences : Pour une fin de vie sans souffrance Mme Anouar DEBBAGH ZRIOUIL DEMORGE, Dre Sophie GARCIN
PLANNING Définition Etat des lieux et état futur Plan d’actions Control Janvier2021 Mars2021 Juin2023 Décembre2022
La gestion de la violence du patient envers un collaborateur dans le département des Neurosciences Cliniques
Anne-Laure Blanchard Courtois- ARS; Mirjeta Hoxha Shaqiri-QO
CONTEXTE :
Les collaborateurs sont exposés à des situations de violence physique ou verbale par les patients, souvent en lien avec leur état clinique du patient. En 2021, la violence est identifiée
comme la causse la plus importante des incidents. 30% des déclarations portent sur la violence Elle peut induire des conséquences sur la santé des collaborateurs
OBJECTIFS
Développer une méthode de gestion de la violence post événement systématique et similaire pour tous les cadres soignants
Renforcer le soutien aux collaborateurs et aux cadres soignants par la hiérarchie pour ce type d’événement.
METHODE
Création d’un algorithme par et pour les cadres soignant et PPS avec l’implication des RH
Collaboration avec le Centre Interprofessionnel de Simulation (CIS) pour développer un programme de prévention et renforcement des compétences face aux situations de violence sous forme d’atelier de simulation


Animation d’un journal club par un ISC sur la thématique violence

Sensibilisation des nouveaux collaborateurs à la violence
PERSPECTIVES




Développer d’un indicateur qualité
Réaliser un questionnaire de satisfaction du collaborateur avant formation et post formation au CIS
Renforcer les compétences d’évaluation du risque et réponse apportée
Identifier et prévenir le risque en équipe
Processus de sensibilisation des collaborateurs

Identifier les signaux et comportement
Ajuster les comportements pour protéger les patients et soignants
Anticiper en inter professionnalité
Journée Qualité 2022 B10
Transplantation hépatique : utilisation d’un outil pour favoriser l’adhérence
Sabine Leray Sofia Bosch Collette
CONTEXTE : Le parcours menant à la transplantation est parsemé de difficultés. La non-adhérence du patient ralentit son accessibilité voir l’exclut du projet de greffe. L’utilisation d’une échelle comme outil prédictif nous permettrait de dessiner un profil de non adhérence et ainsi d’être en capacité de mettre en place des mesures d’accompagnement.
OBJECTIFS : -mesurer les ressources du patient
- Identifier les freins et leviers à l’adhésion Mettre en place des mesures personnalisées d’accompagnement
Aide décisionnelle à la description en liste d’attente
La méthode utilisée est qualitative et s’appuie sur les 5 dimensions de la non adhérence de l’organisation mondiale de la santé. La mesure de l’adhérence est faite au décours d’un entretien avec la coordinatrice de transplantation au moment du bilan pré greffe.





CONCLUSION : Inclure ces 5 dimensions de la non adhérence permet aux patients de s’approprier de manière consciente la prise en charge et favorise son suivi. L’outil lui permet de devenir autonome et de savoir où et comment demander de l’aide. Les 1ers retours mettent en avant un renforcement dans le la relation soignant/ soigné et un sentiment de confiance thérapeutique augmenté.

Journée Qualité 2022 B15
Acceptatibilité de la télémédecine par les patients et les






médecins à Genève
CONTEXTE
La télémédecine (TLM) a connu un essor durant la pandémie bouleversant les fondements même de notre pratique médicale traditionnelle et notre relation avec nos patients, conduisant à de nouvelles réflexions.
OBJECTIFS
• Evaluer l'acceptabilité des patients et des médecins concernant différents moyens de TLM dans différentes situations médicales
• Evaluer les avantages et les inconvénients perçus
METHODE





• Enquête transversale en 2021
• Patients en salle d’attentes urgences ambulatoires HUG, Onex et La Tour et centres médicaux
• Médecins des HUG et médecins en cabinet membres de l'AMGe
• Questionnaire en ligne 27 items via Qualtrics
RESULTATS 567 patients (55 % de femmes, 67 55% à l’hôpital) et 448 médecins ont participé (51 % de femmes, 50 % de médecins travaillant aux HUG)


Les patients et les médecins étaient plus enclin à accepter la vidéo pour la plupart des problèmes de santé principalement s’ils utilisaient en privée la vidéo pour leurs appels et/ou s’ils avaient déjà une consultation par vidéo
CONCLUSION
Malgré l'utilisation accrue de la télémédecine (par viso) depuis la pandémie, le téléphone reste plus acceptable que la vidéo dans la plupart des situations médicales sauf en cas de consultation nécessitant un soutien psychologique. Les aspects de sécurité et de confidentialité restent les principales inquiétudes des patients. La limitation de l’examen physique et le manque d’évaluation clinique constituent les principaux freins à l’adoption de la TLM par les médecins.
PERSPECTIVES
Pour que la télémédecine soit efficace, nous devons veiller à ce qu’elle soit intégrée de manière appropriée dans nos services de santé et qu’elle devienne une pratique de routine pour les soignants et les patients. Il faut également intégrer l’enseignement de cette nouvelle pratique dans la formation des médecins et des soignants plus largement.
B20
Journée Qualité 2022
S. Mazouri, R. Luechinger, O. Braillard, M. Dominicé Dao. S. Achab, P. Hudelson, N. Bajwa, O. Braillard, N. Junod Perron Service de cybersanté et télémédecine, Départements de médecine de premier recours, de psychiatrie, de la femme de l’enfant et l’adolescent, Direction médicale
Quels comportements de communication les patients préfèrent-ils en visio-consultation?
S. Mazouri, R. Luechinger, M. Dominicé Dao. S. Achab, P. Hudelson, N. Bajwa, O. Braillard, N. Junod Perron
Service de cybersanté et télémédecine, Départements de médecine de premier recours, de psychiatrie, de la femme de l’enfant et l’adolescent, Direction médicale









CONTEXTE
Elle a cependant connu un essor nouveau durant la pandémie liée au Coronavirus SARS 2
OBJECTIFS
Analyser les préférences des patient-es par rapport à six différents comportements de communication du médecin en téléconsultation par visio

METHODE
Enquête transversale
Patients en salle d’attentes urgences ambulatoires HUG, Onex et La Tour Visionnement de capsules vidéos sur tablette (2 séquences par comportement)

1. Cadrage visage/buste ou visage
2. Orientation du regard
3. Phase sociale
4. Confidentialité
5. Pauses
6. Empathie

CONCLUSION
RESULTATS 417 patient-es ont visionné chacun-e 3 comportements (2 séquences)

Profil des patients: femmes 54%; 71%; < 25 ans: 23 5%; 25 44 ans 42 2%; 45 64%: 29 3 et > 65 ans 5%)
Avis pas expert
Avis expert Pas de préférence
Comportement Commentaires totaux Raisons concordantes
Cadrage 113 26 (23)
Orientation regard 82 4 (5)
Confidentialité 156 87 (56)
Environnement 113 38 (34) Pauses 138 70 (51) Empathie 122 98 (80)
Le fait d’être non européen était associé à une attention moindre à la qualité de la connexion (OR 0.23 IC 0.06-0.79, p =0.02) et une préférence pour des pauses plus longues (OR 3.1 IC 1.14-8.40, p=0.03).
Les patients préfèrent les comportements de communication recommandés par les experts concernant le cadrage, le fait d’aborder la confidentialité, la mise à l’aise du patient en demandant la connexion (son et image) et l’expression non verbale accentuée. En revanche, l’orientation du regard vers le patient plutôt que vers l’écran et des pauses plus longues entre les phrases n’ont pas été privilégiées.
PERSPECTIVES
Bien que nos observations doivent être répétées dans différents contextes de soins et dans des interactions impliquant d’autres professionnels de la santé, nos résultats indiquent que les patients sont attentifs aux comportements de communication spécifiques à la visio conférence. Ces comportements de communication devraient être enseignés de manière plus régulière en formation pré et post graduée ainsi qu’en formation continue, compte tenu de l’importance grandissante de l’utilisation de la visio consultation dans nos contextes de travail.
Journée
B21
Qualité 2022
Projet interprofessionnel au CAAP ARVE amélioration de la
prise
en charge des situations d'urgence
DELIEUTRAZ Tatiana, DOMENJOZ Iris, FAVROD-COUNE Thierry, GARTNER Birgit, KERHARO Armel, LAGARDE Gregor . Service de médecine de premier recours
CONTEXTE
CAAP Arve: Suivit des dépendance aux opiacés Suivit par des psychiatres, et infirmiers Consultation Interniste (3 demi journée par semaine)
OBJECTIFS
Créer des Guidelines adaptées aux besoins spécifiques du lieu et des patients du CAAP Arve Infirmiers parfois sans médecins Patients difficiles à piquer Peu d’expérience dans les situations d’urgences
METHODE




M Kerharo, et M Lagarde infirmiers au CAAP Arve. Identification du besoin de guideline dans 3 situations: 1) Surdosage en opiacés 2) Crise convulsive 3) Réaction anaphylactique

Dr Domenjoz, Cheffe de clinique SMPR, interniste au CAAP Arve. Rédaction des guidelines en fonction des besoins spécifique du CAAP.
Mme Tatiana Delieutraz, Infirmière spécialiste clinique. Dr Thierry Favrod Coune, Médecin adjoint responsable A.I. de l’Unité des dépendances, SMPR. Dr Birgit Gartner, Médecin adjoint, Service des urgences. Relecture des guideline et expertise dans le domaine de la médecine d’urgence.
PERSPECTIVES
Formation de l’équipe infirmière du CAAP Arve par Mme Delieutraz, en collaboration avec M. Kerharo et M. Lagarde
Journée Qualité 2022 B24
Programme de séda,on procédurale adapté aux enfants a6eints de troubles du spectre au,s,que et de retard neurodéveloppemental :
Efficacité et sécurité d’une première analyse d'une série de cas consécu,fs.
CONTEXTE
Enfants confrontés à des défis uniques
RESULTATS
Environnement
OBJECTIFS
Mesurer de cas de sédation procédurale d'enfants ponction veineuse, une vaccination ou d’autres procédures


Enfant et Proches
METHODE
Revue de dossier dans le cadre d’amélioration de la qualité. Appel téléphonique le soir de la sédation et 24 heures après la sédation pour effets indésirables à domicile Taux de réussite, effets adverses, satisfaction analysés

CONCLUSION
Diagramme : Pilliers principaux du programme de sédation procédurale de l’enfant atteint de TSA
Mesure Nombre






Nombre de sédation
Nombre de patients
Age moyen (écart interquartile) 7.7 (4.3 10.2) Garçons 21 (70%) Diagnostic primaire Trouble du spectre autistique 23 (77%) Retard neurodéveloppemental 7 (23%) Procédure (% du nombre de sédations) Ponction veineuse 36 (95%) Électrocardiogramme 16 (42%) Vaccination ou injection de médicaments intramusculaires 9 (24%) Évaluation dentaire 4 (11%) Ponction lombaire 2 (5%) Changement de bouton de gastrostomie 2 (5%) Ablation de fils de suture 2 (5%) Nasofibroscopie 2 (5%)
Charactéristiques des procédures et effets adverses Procédures réussies sans contention 37 (97%)


Effets adverses
Agitation au réveil 1 (2.5%) Vomissement 1 (2.5%) Réveil prolongé 1 (2.5%) Satisfaction Satisfaction parentale de 5/5 37 (97%)
Tableau : Résultats principaux de la première analyse
L'expérience décrite dans cette série de cas ajoute des preuves à la faisabilité de l'approche intégrative centrée sur l’enfant, dans la SP des enfants atteints de TSA et de retards de développement. Avec une approche prudente adaptée aux habitudes de l’enfant et guidée par ses proches, en utilisant une combinaison de dexmédétomidine et de protoxyde d'azote, nous démontrons que des soins efficaces, sans douleur, avec un minimum d’anxiété et sans événements indésirables majeurs est possible.

PERSPECTIVES FUTURES

Pour mener à bien et pérenniser un tel programme, il sera important de dédier des ressources humaines et immobilières à la sédation procédurale des enfants susmentionnés mais aussi des enfants trop apeurés malgré une approche psychologique (distraction, hypnose) ou des enfants nécessitants une procédure douloureuse sans nécessairement besoin de mobiliser le bloc opératoire. L’objectif a atteindre est de faire de la contention physique, lors des soins, une histoire du passé, pour tous les enfants à l’hôpital.

Qualité 2022

B35
Journée
Dr SAHYOUN Cyril, JARDINIER Laurent, Dr ANTONSEN Ar;om, TOUVRON Christelle, Cellule Confort Pédiatrique, Programme Handicap, DFEA
(%)
38
30
Thérapie d’exposistion standardisée à domicile Pharmacologie Anésthésie locale Dexmédétomidine intranasale MEOPA Efficacité & Confiance
Siencieux, lumières tamisées adaptation à l’enfant
2.
EVALUATION DE LA SATISFACTION DES
CONTEXTE
1.
OBJECTIFS
INTERNES
AU
SMIR-BS
: Enquête bisannuelle, suivi sur 5 ans M. Kossovsky, E. Hanna Deschamps, U. Ahrendts, M. De Martin, C. Luthy
Département de Réadaptation et Gériatrie, Service de médecine interne et de réadaptation de Beau-Séjour
RESULTATS
En 2017, le Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) a introduit la notion de bien être dans les programmes communs de formation des médecins internes aux Etats Unis (1, 2). Des domaines comme le mentorat, le sentiment d’être impliqué dans le fonctionnement du service ainsi que la forte implication des cadres médicaux dans les interventions dédiées sont associés au succès de ces programmes (3)
14:505






Dans le but de déterminer les aspects pouvant être améliorés dans la rotation proposée aux médecins internes en formation dans le service, nous menons une enquête bisannuelle depuis 2018.
En sus de la satisfaction globale, nous cherchons à déterminer comment des aspects tels que la connaissance de ce qui est professionnellement attendu, la qualité de l‘encadrement, la prise en charge multidisciplinaire ainsi que la recommandation de la rotation auprès des collègues est jugée.
METHODE
Le questionnaire est adressé par email, anonymement complété en ligne et renvoyé via le logiciel Form Office au secrétariat du service. Un seul rappel est envoyé.
La réponse à chaque question est évaluée par une échelle de Likert à 3 ou 4 niveaux. Les questions concernant ce qui est attendu du travail est évaluée par une réponse binaire Oui/Non. La moyenne de chaque réponse est calculée pour chaque période de 6 mois, puis progressivement ajoutée aux valeurs précédentes. Les résultats sont régulièrement présentés et discutés en présence des cadres médico soignants. Des séances de retour aux médecins internes sont également organisées.
Entre 2018 et 2022, 65 questionnaires ont été analysés. Les internes avaient en moyenne 31 ans, étaient en moyenne dans leur 5èm e année de formation, la proportion de femmes était de 51 %
Quelle est votre évaluation globale de votre passage au SMIR BS ☐ insuffisante 1 ☐ moyenne2 ☐ satisfaisante 3 ☐ très satisfaisante 4 2.5
La question «Avez vous eu des échanges sur ce qu’on attendait de vous ?» a évolué de 15 à 90% de réponses positives selon la période (données non présentées).
La question «Avez vous eu des échanges sur vos objectifs à atteindre ?» est restée aux alentours de 50% de réponses positives selon la période (ci dessous).
.5
Avez vous eu des échanges sur vos objectifs à atteindre ? 0
3.5 5 A quel point recommandez
1 1 2 3 4 5 6 7 8
La rotation au SMIR BS auprès des collègue reste recommandée lors des dernières périodes de collecte de données
3 4 5 6 7 8
Les réponses aux questions concernant la satisfaction de la collaboration avec les différents professionnels (infirmiers, ergothérapeutes, physiothérapeutes, secrétariat) sont restées, au cours des périodes, avec des niveaux entre satisfaisant et très satisfaisant (données non présentées).
Cette surveillance répétée de la satisfaction des internes du SMIR BS a permis de modifier notre programme de formation et d’encadrement, d’une manière positive puisque le niveau de satisfaction globale s’est amélioré durant la période observée. Des progrès restent cependant possibles notamment dans les domaines d’échange avec les internes sur les objectifs à atteindre, et dans le type de prestations que l’on attend d’eux.
CONCLUSION PERSPECTIVES
Après bientôt trois ans de pandémie COVID 19 notamment, les hôpitaux vivent une situation de stress et la satisfaction des jeunes médecins est un enjeu qui comporte de nombreux aspects (e.g. risque de burn out, qualité & sécurité des soins). Par ailleurs, la qualité de l’encadrement des médecins en formation constitue une préoccupation pour des cadres responsables qui sont souvent confrontés à des défis complexes d’organisation. Nous projetons de poursuivre cette surveillance afin d’améliorer la communication managériale (le ton des discussions, le comportement en matière d’information, la qualité des informations, ainsi que la nature et l’étendue des feedbacks) dans un esprit de transparence, d’utilité et de proactivité à l’encontre de nos équipes.
Journée Qualité 2022
B40
Accreditation Council for Graduate Medical Education. Common Program Requirements (Residency), 2020. Available: https://www.acgme.org/Portals/PFAssets/ProgramRequirements/CPRResidency2020.pdf
Sharp M , Burkart KM Trainee wellness: why it matters, and how to promote it. Ann Am Thorac Soc 2017;
12 3. Mari S Meyen R Kim B Resident led organizational initiatives to reduce burnout and improve wellness. BMC Med Educ 2019;19:1 10
vous cette rotation ☐ pas recommandée ☐ modérément recommandée ☐ fortement recommandée 2 2.5 3 1 2
Tableau de bord des consultations (TBC)
CONTEXTE
Une proportion importante des consultations ambulatoires réalisées aux HUG n’est pas suivie par une saisie de prestations. Pour rattraper la facturation, une analyse à postériori est effectuée et des fichiers sont envoyés aux médecins. Mais une correction rétroactive est complexe et fastidieuse.
Ni le DPI ni OPALE ne permettent au médecin prestataire de s’assurer facilement que les consultations réalisées durant sa journée ont été bien saisies.
Une application était dès lors nécessaire pour permettre au médecin d’avoir une vision ergonomique et claire des consultations de la journée dont celles non facturées

METHODE



















Un groupe de travail interprofessionnel du Département de Médecine de Premier Recours, de la Direction des Finances et de la Direction des Systèmes d’Information, ont identifié les besoins des prestataires et les solutions informatiques pour y répondre
Le TBC est un module de DPI qui rapproche les consultations enregistrées dans DPA et les prestations saisies dans OPALE Une attention particulière a été faite sur l’ergonomie afin que l’outil soit facilement pris en main, sans formation préalable.
CONCLUSION
Idéalement le TBC devrait être utilisé quotidiennement (1). L’ergonomie permet à l’utilisateur d’identifier immédiatement les prestations manquantes (3) et de les corriger via un lien Opale (6).
Le prestataire peut aussi visualiser le détail des prestations TARMED saisies (5) ainsi que le nombre d’heures valorisées (7) en consultation.
PERSPECTIVES
Le succès du projet dépend principalement de l’adoption de l’outil par les médecins
La plus-value immédiate est le gain de temps pour le médecin ainsi que pour les intervenants administratifs chargés des corrections Le résultat escompté est forte diminution des visites sans prestation et donc une augmentation des recettes
Prochainement l’outil sera mis à disposition des autres prestataires de soins.

Journée Qualité 2022 B45
Pierre-Yves Bertrand – Chargé de Projet, Nicolas Perone – Médecin Associé, Baptiste Munier - Analyste en informatique, Fabien Julliard Analyste en informatique, Diogo Teixeira - Administrateur adjoint - (D-MPR, DSI, DF)
3. les montants facturés et les manquants Ouverture du tableau en un clic, avec: 1. la date du jour 2. les consultations agendées apparaissant par ordre chronologique Deuxième clic: 4. vue hebdomadaire 5. détail des codes Tarmed pour un patient 6. ouverture de la facture d’un patient, pour modification 7. nombre d’heures équivalentes




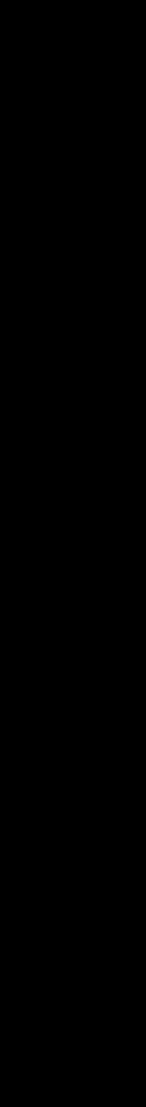










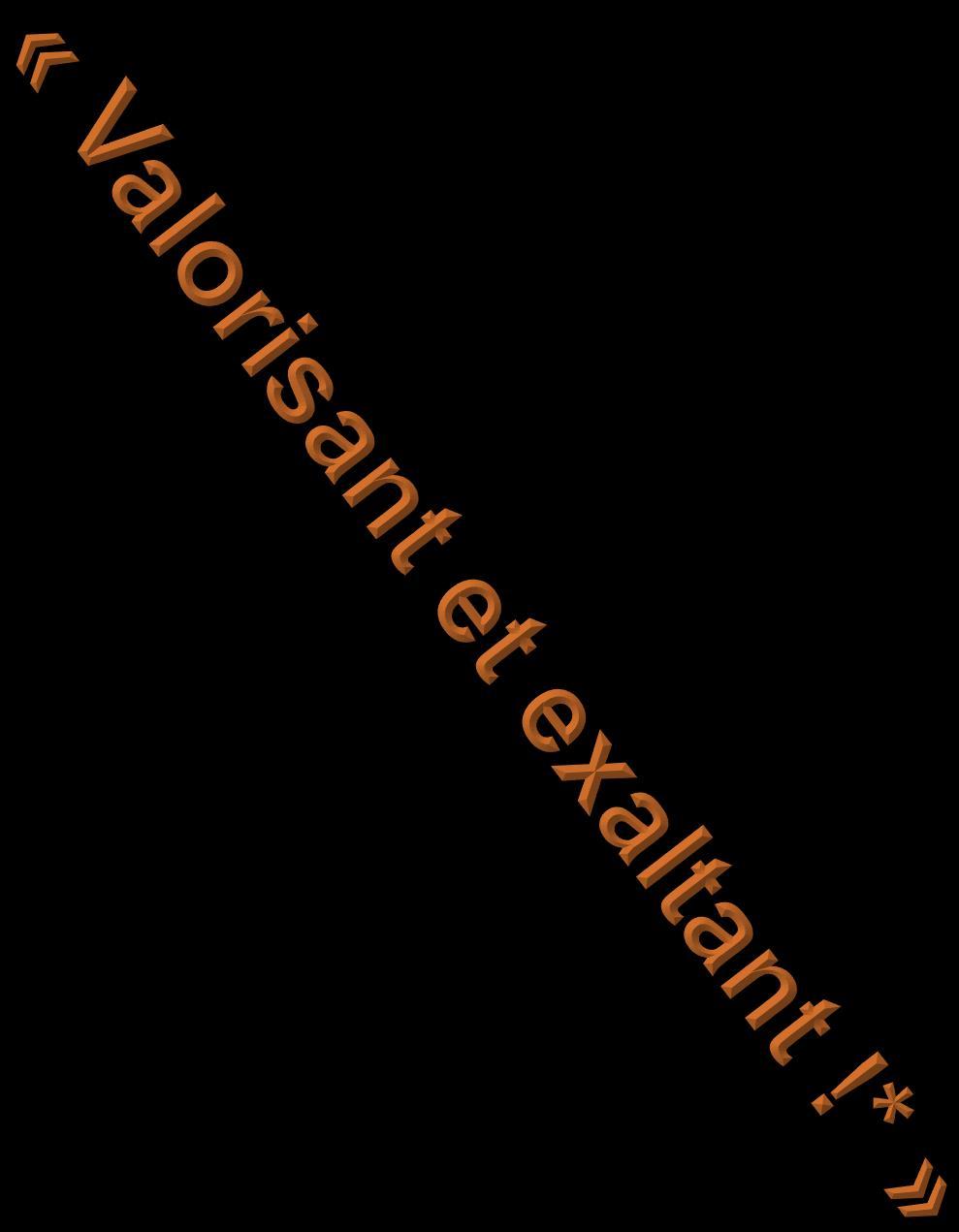


































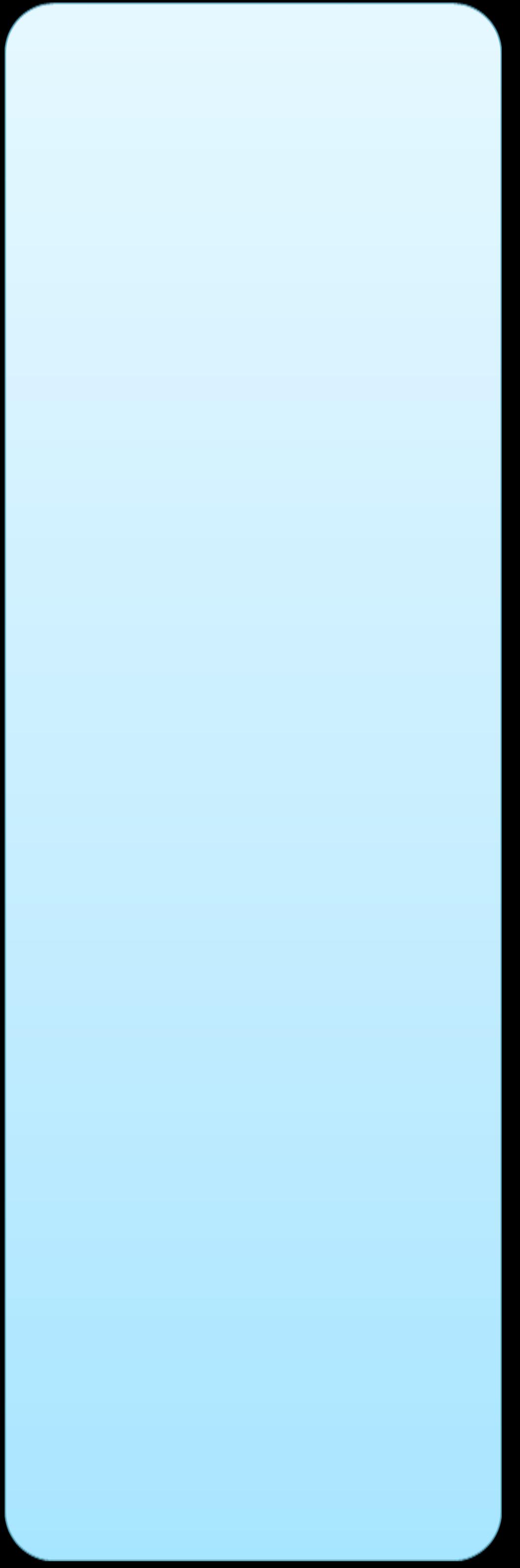





































































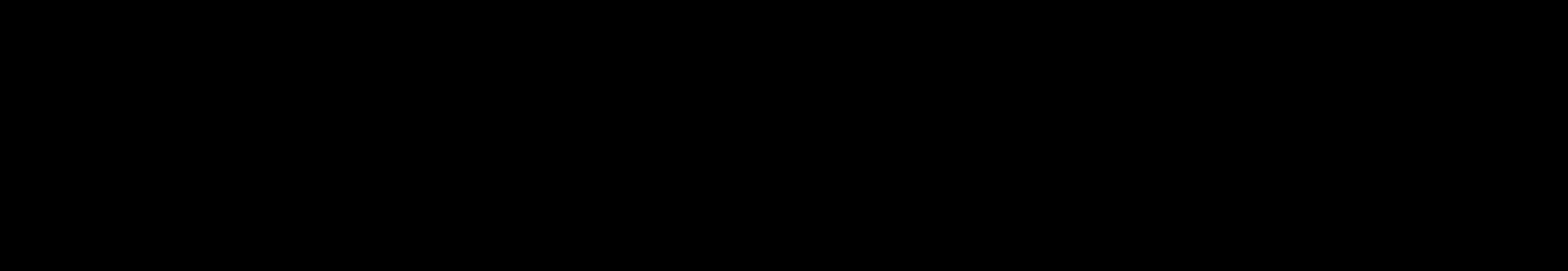




































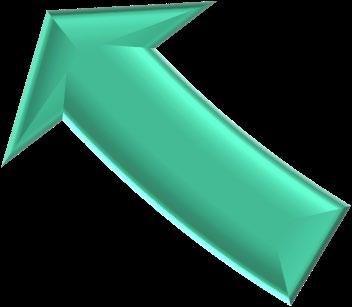




















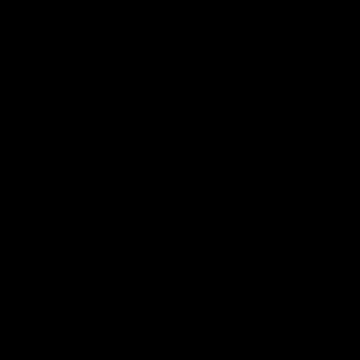



































































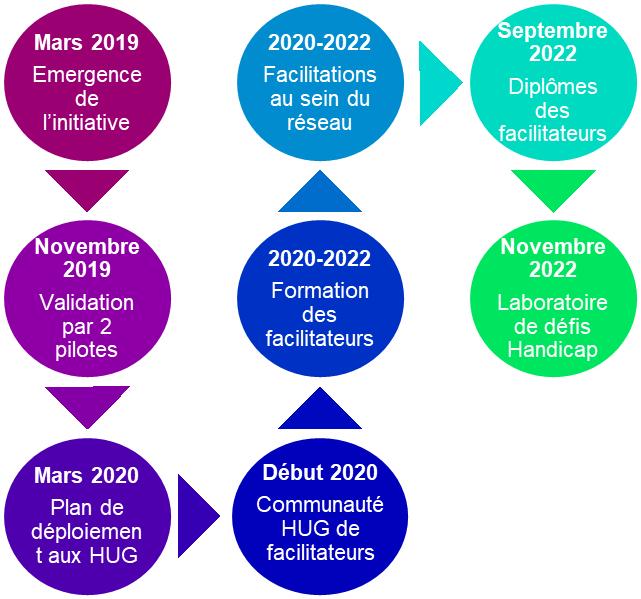







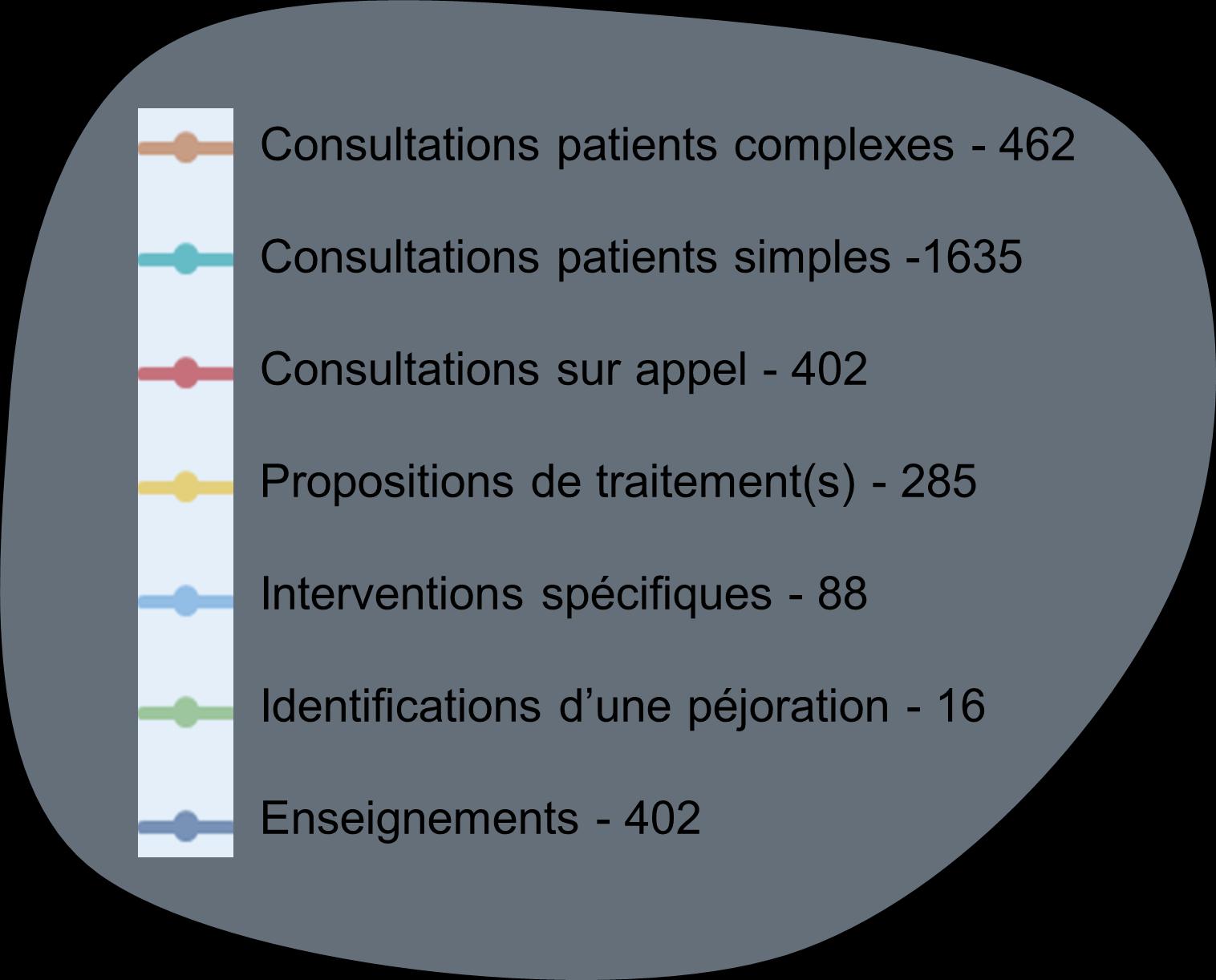




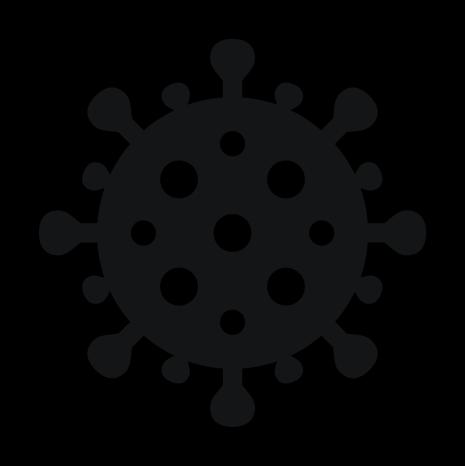











































 J. AOustin - H. Meriah - H. Christain - J. De Chassey- F. Vermeulen - F. Alamercery
J. AOustin - H. Meriah - H. Christain - J. De Chassey- F. Vermeulen - F. Alamercery