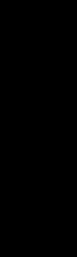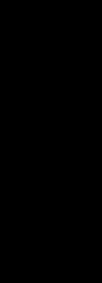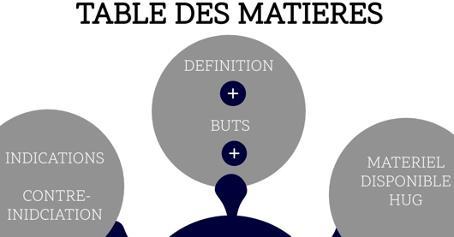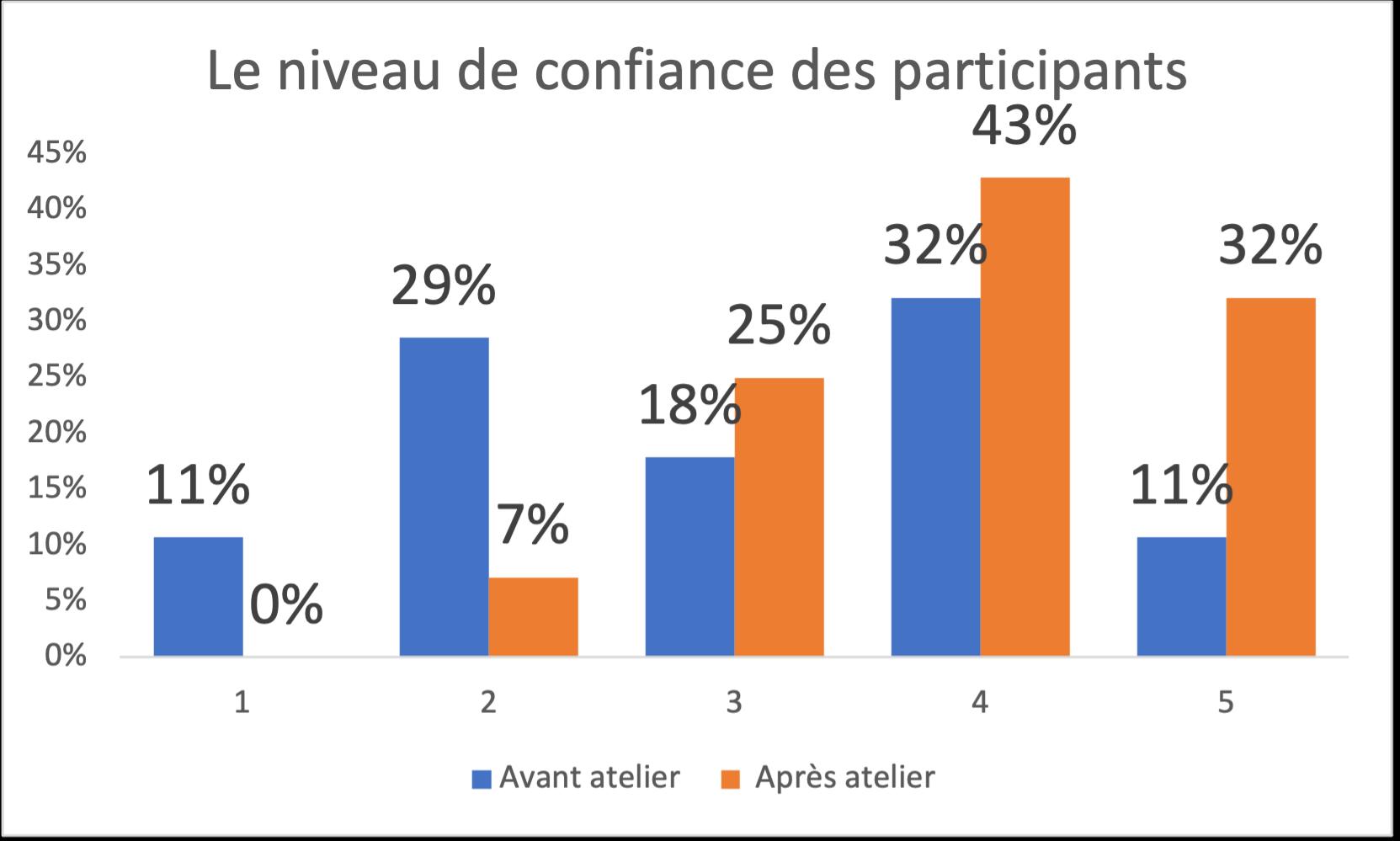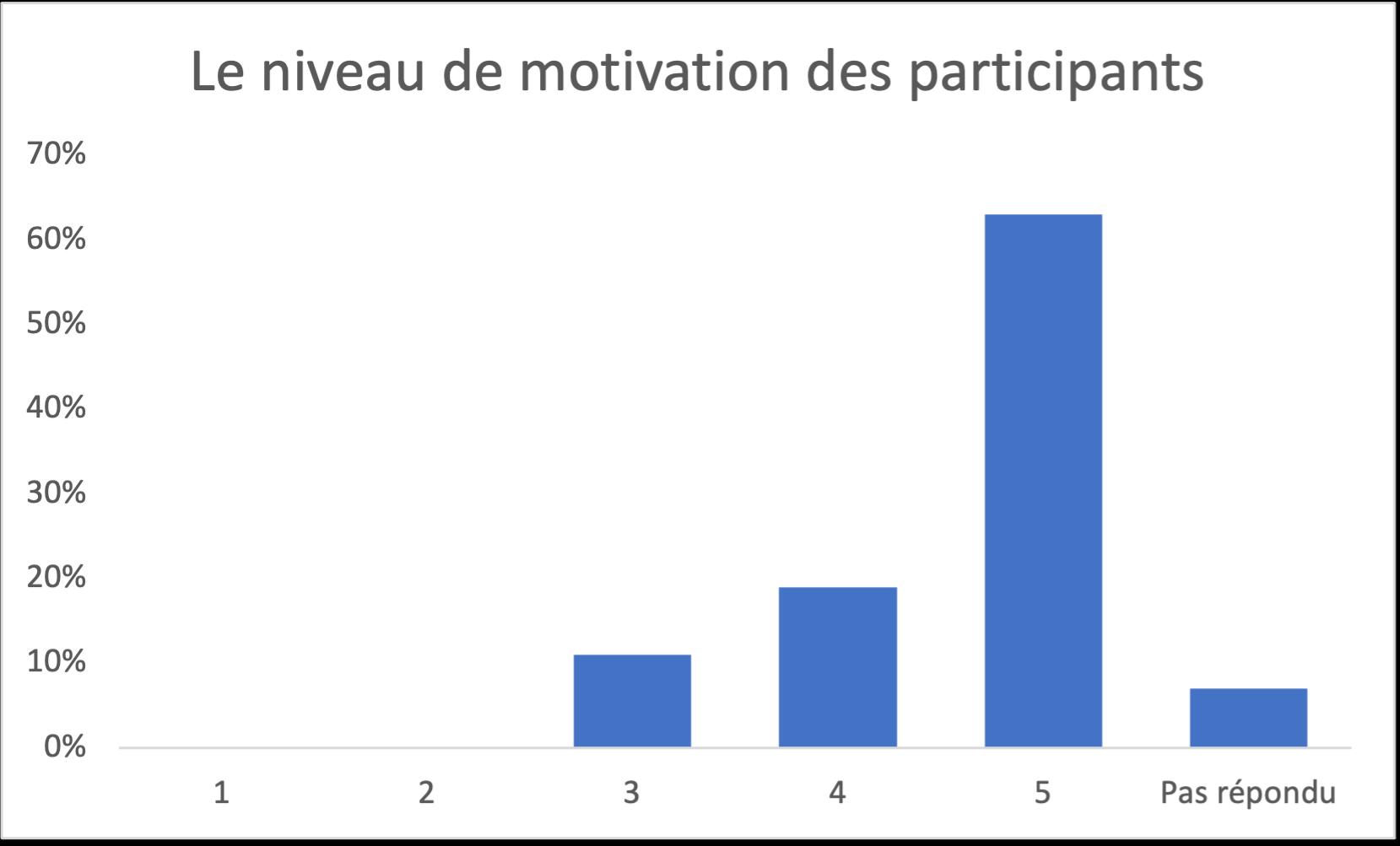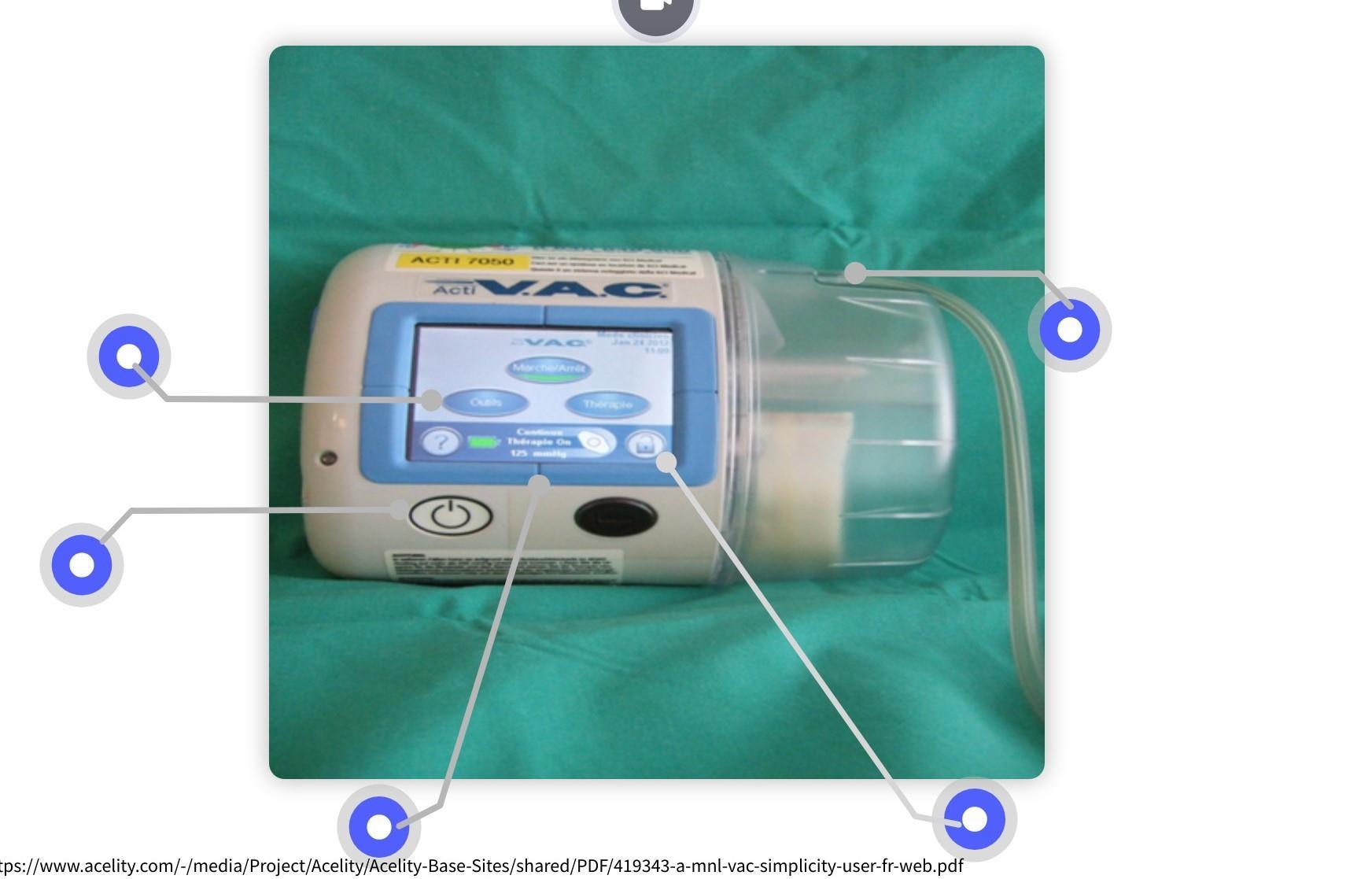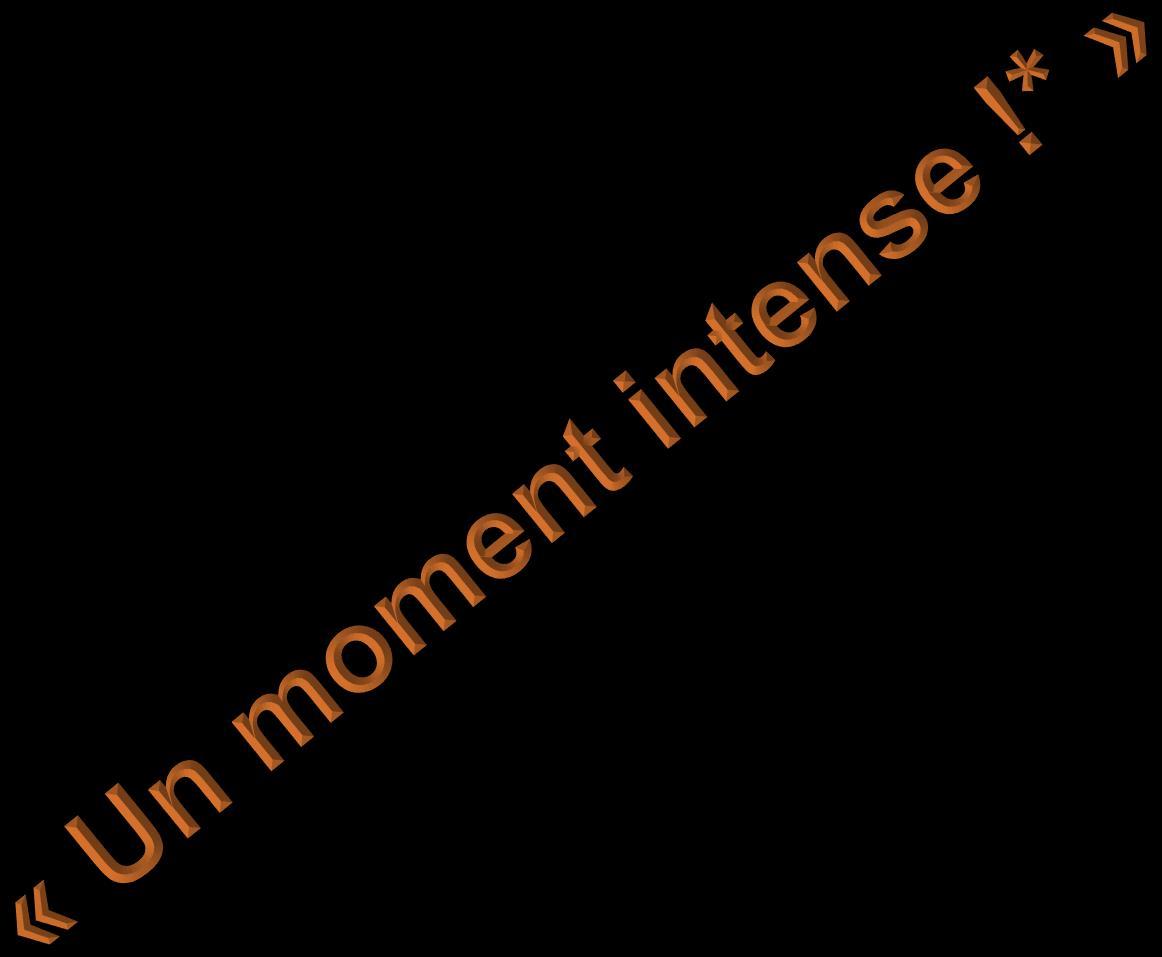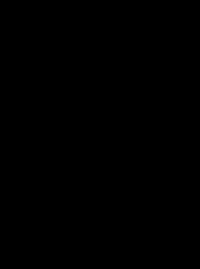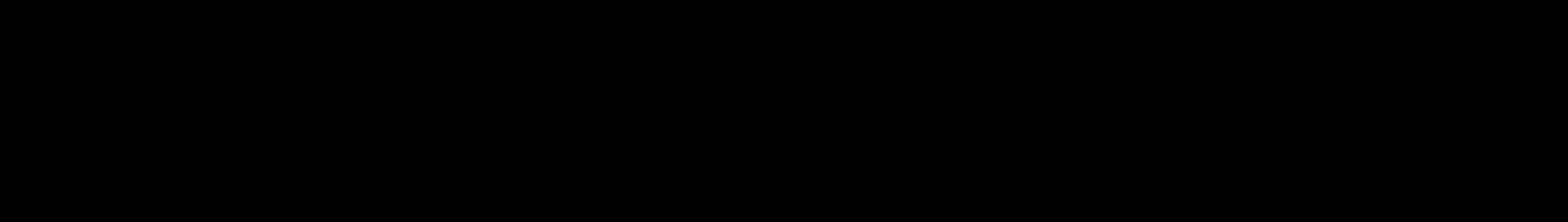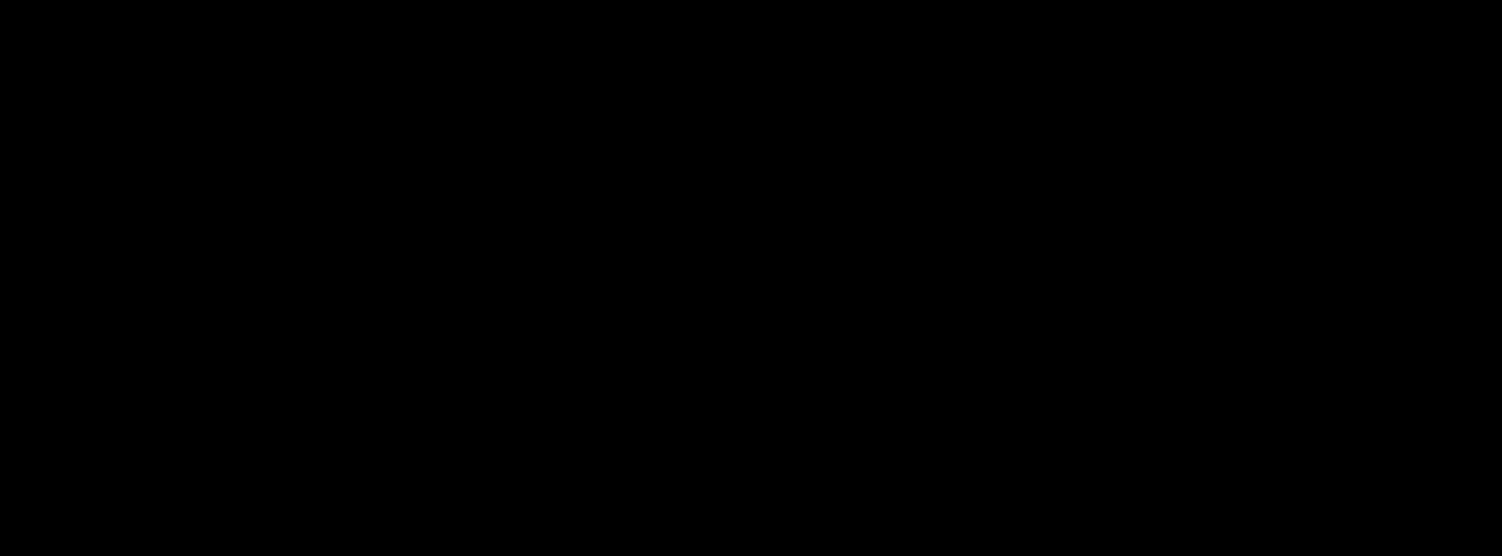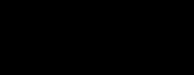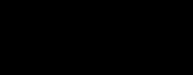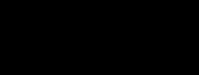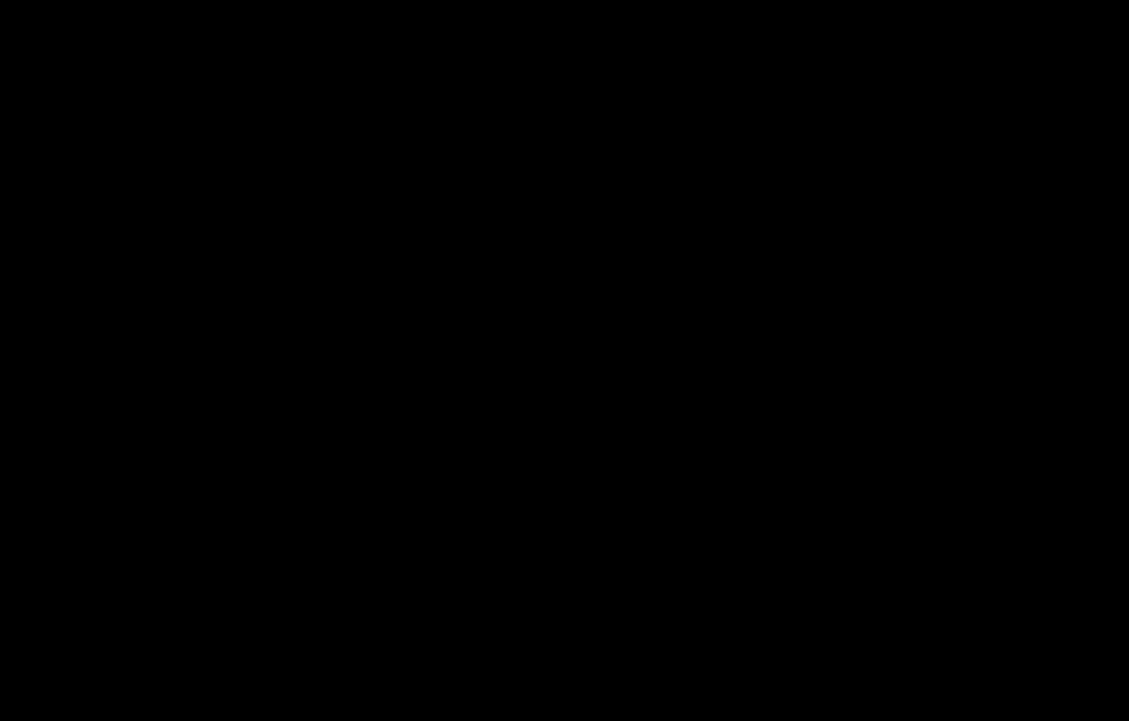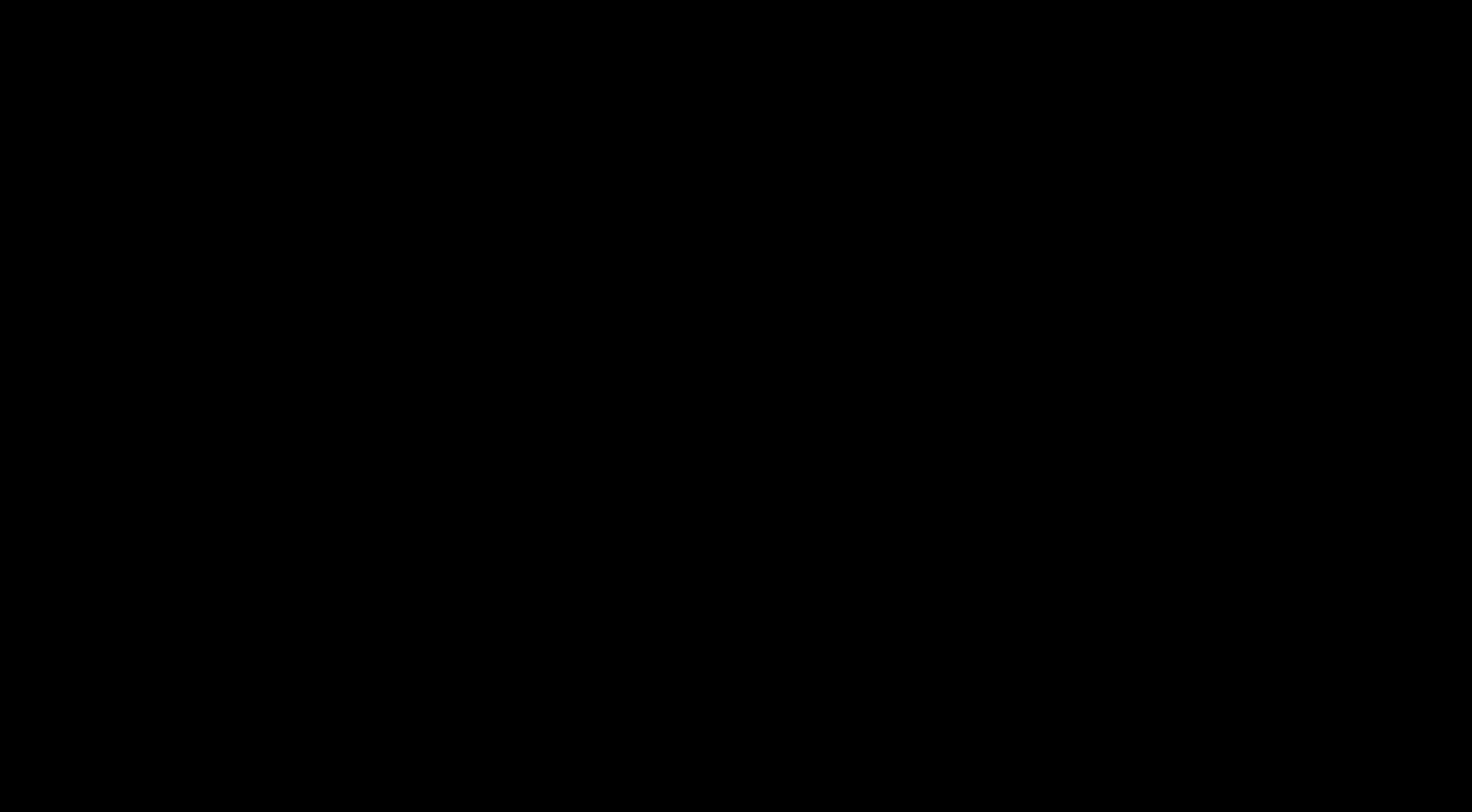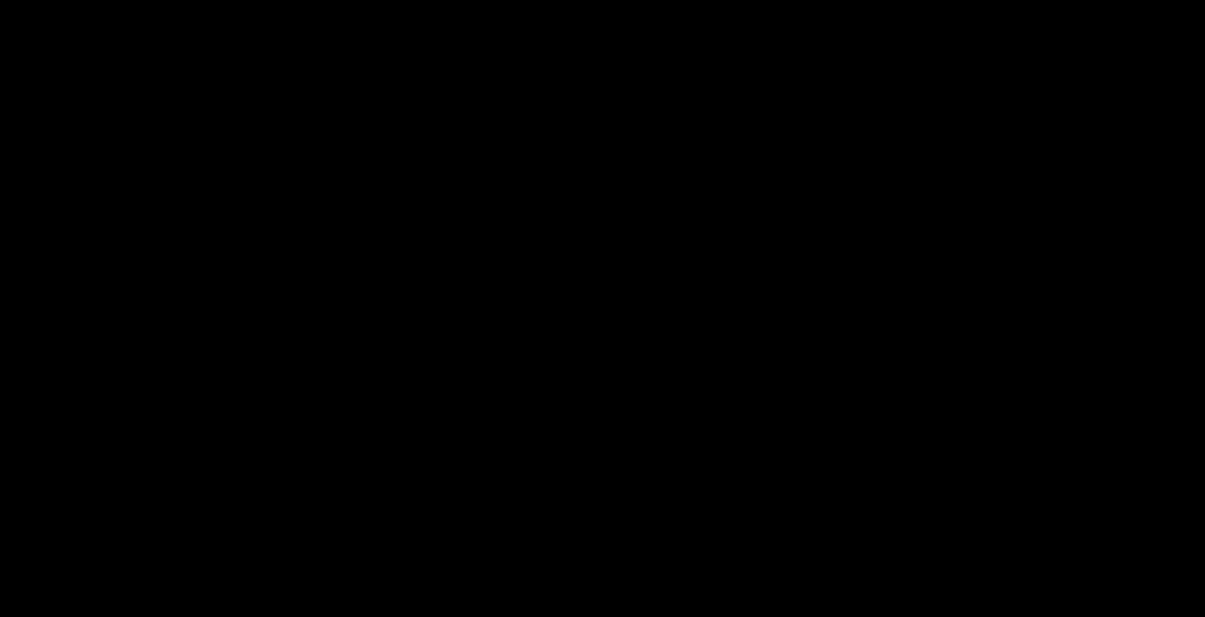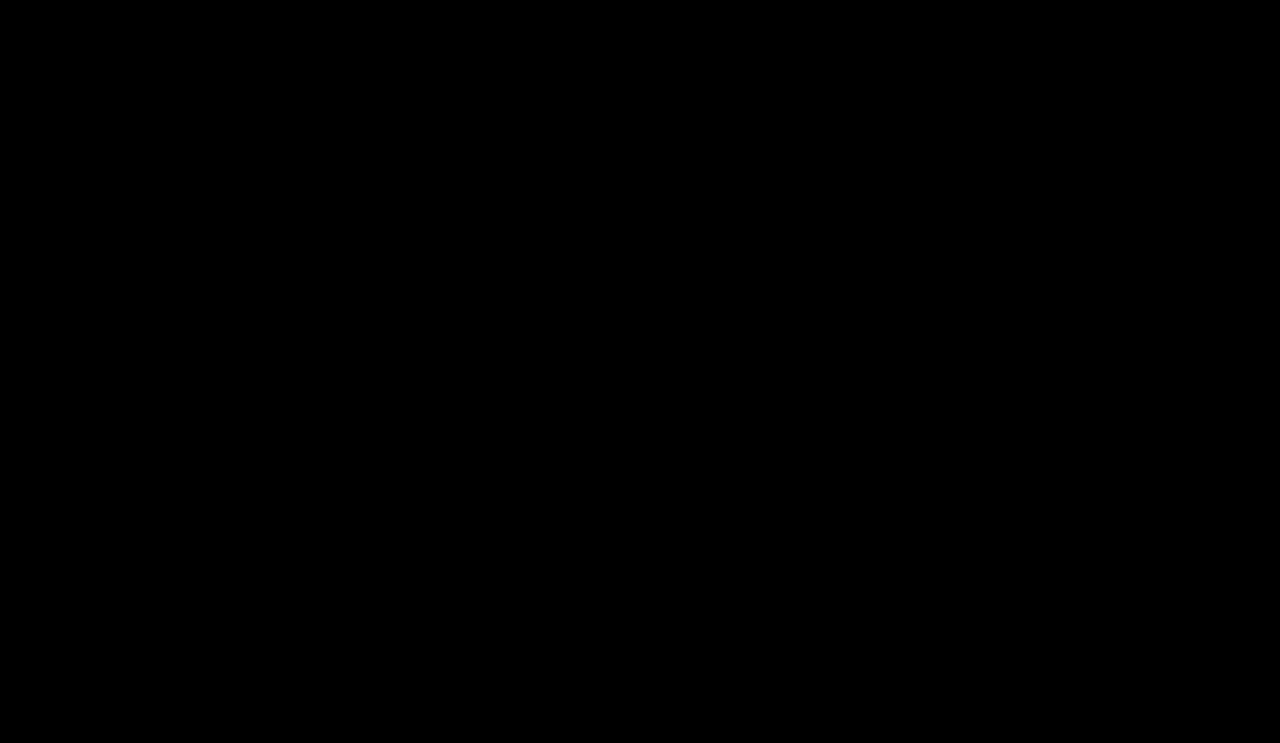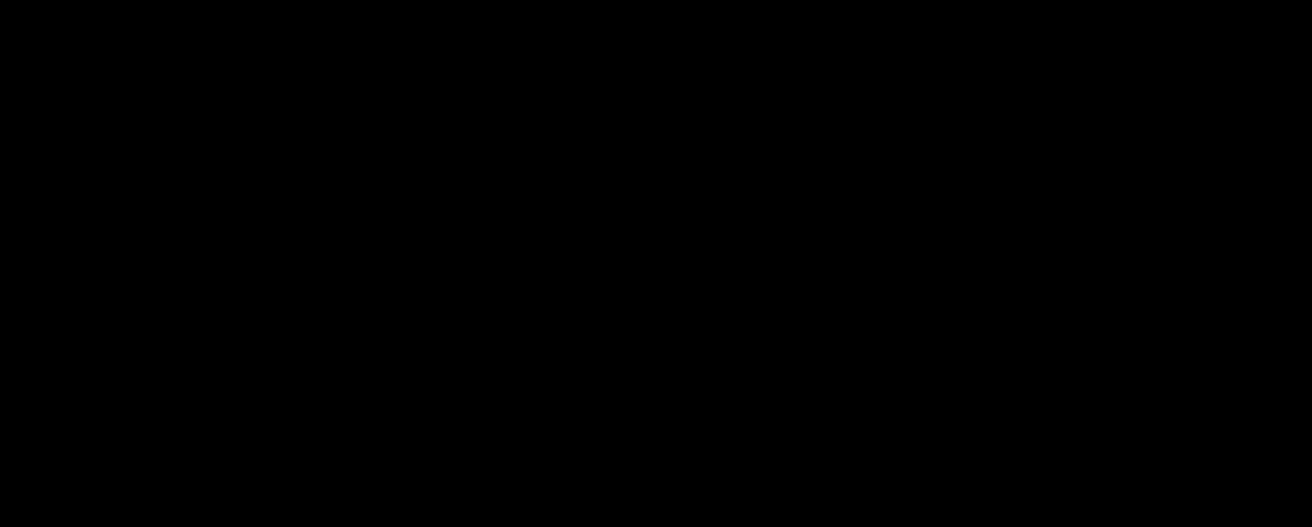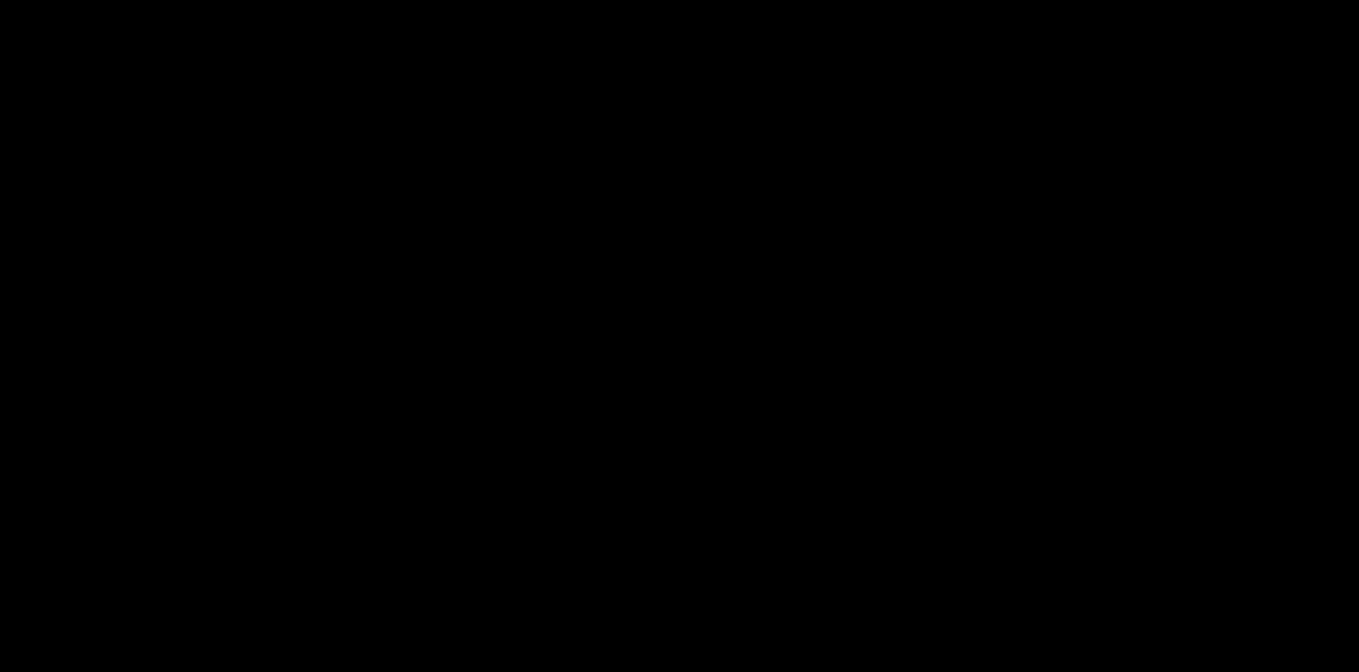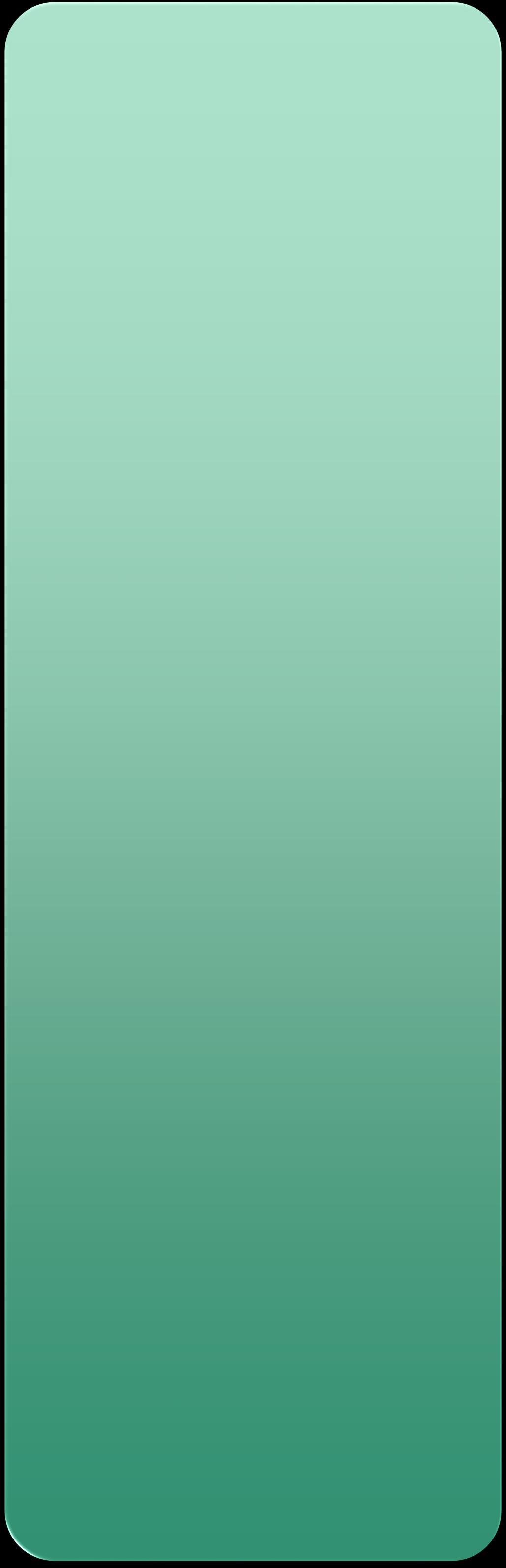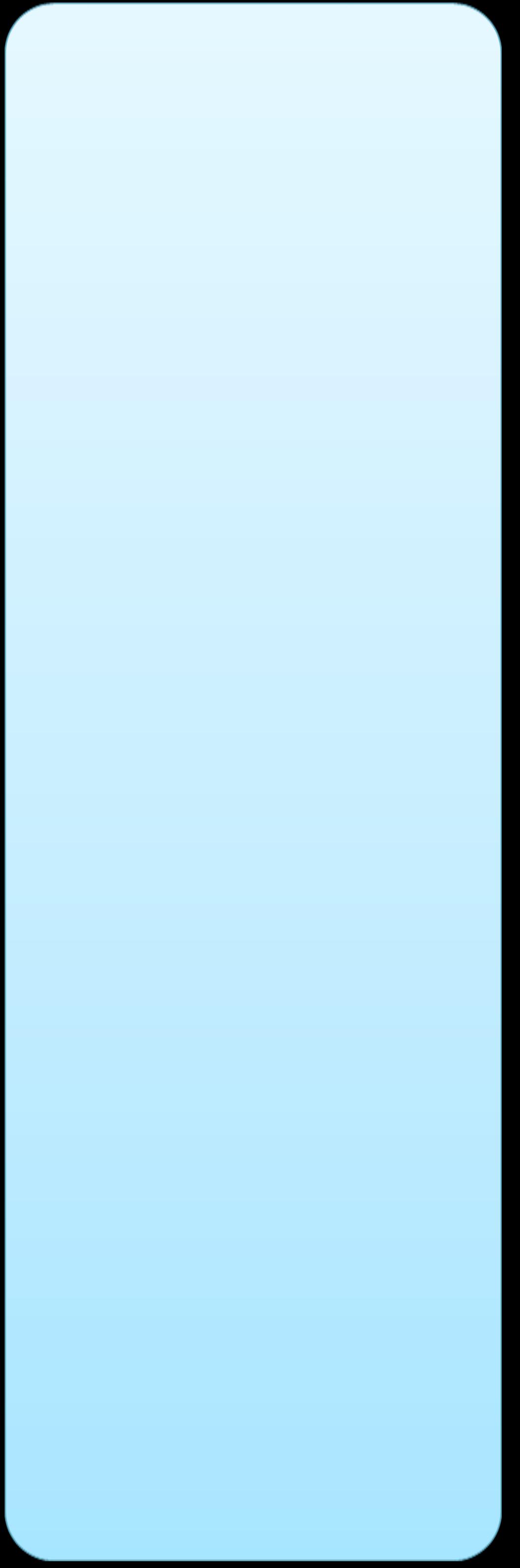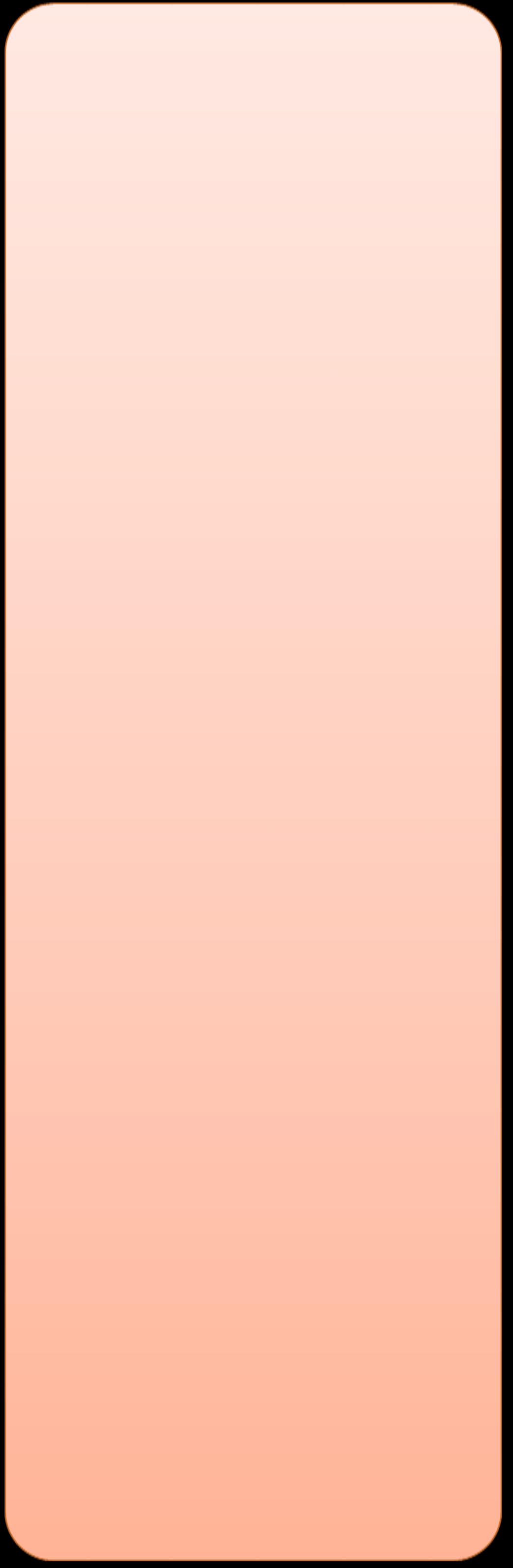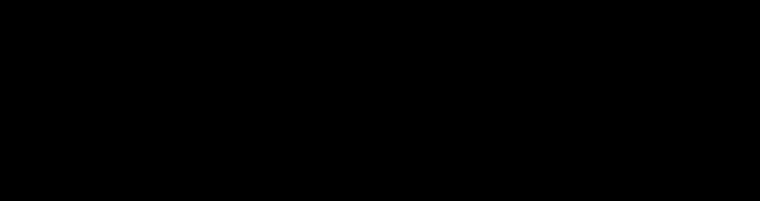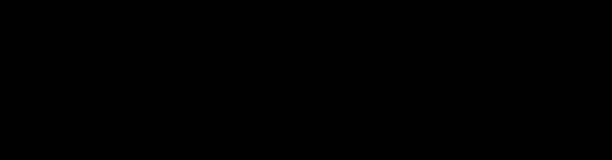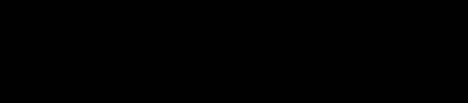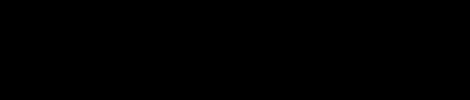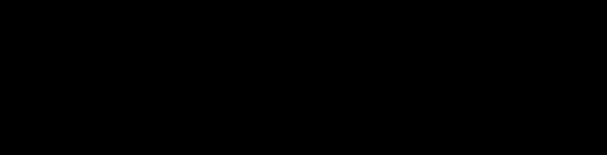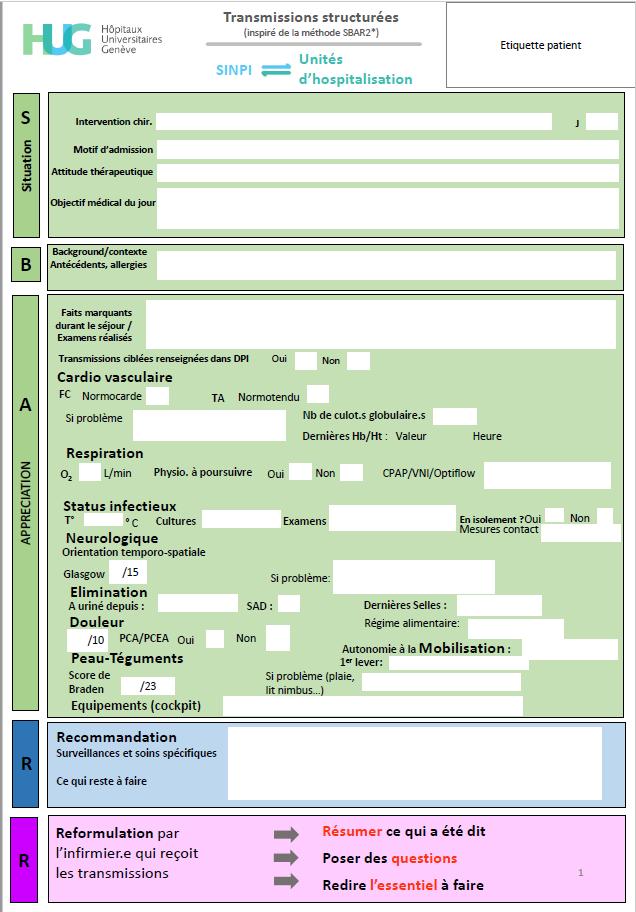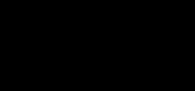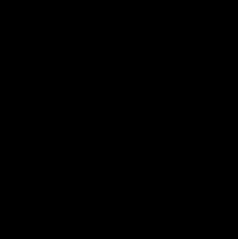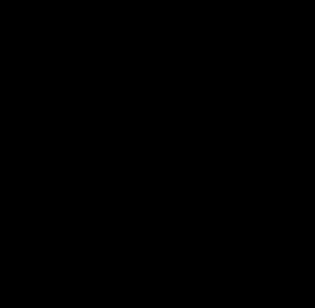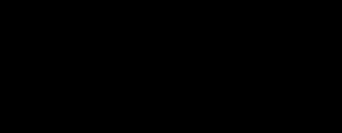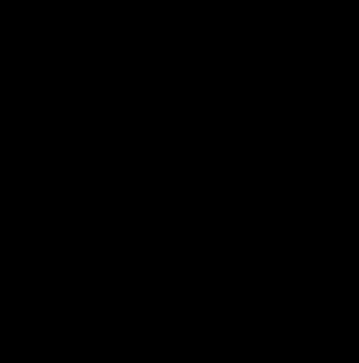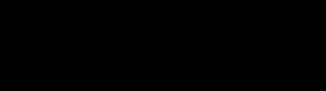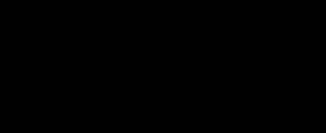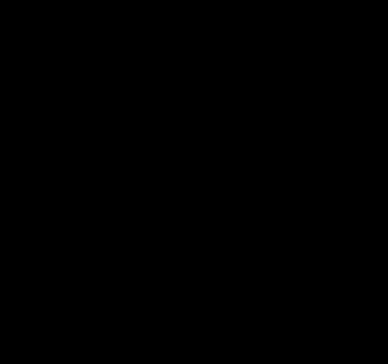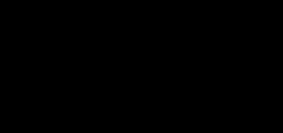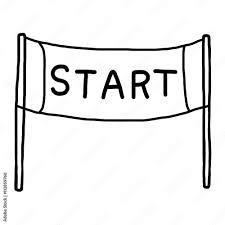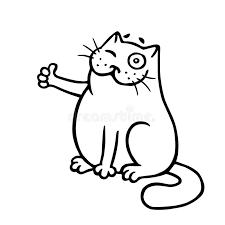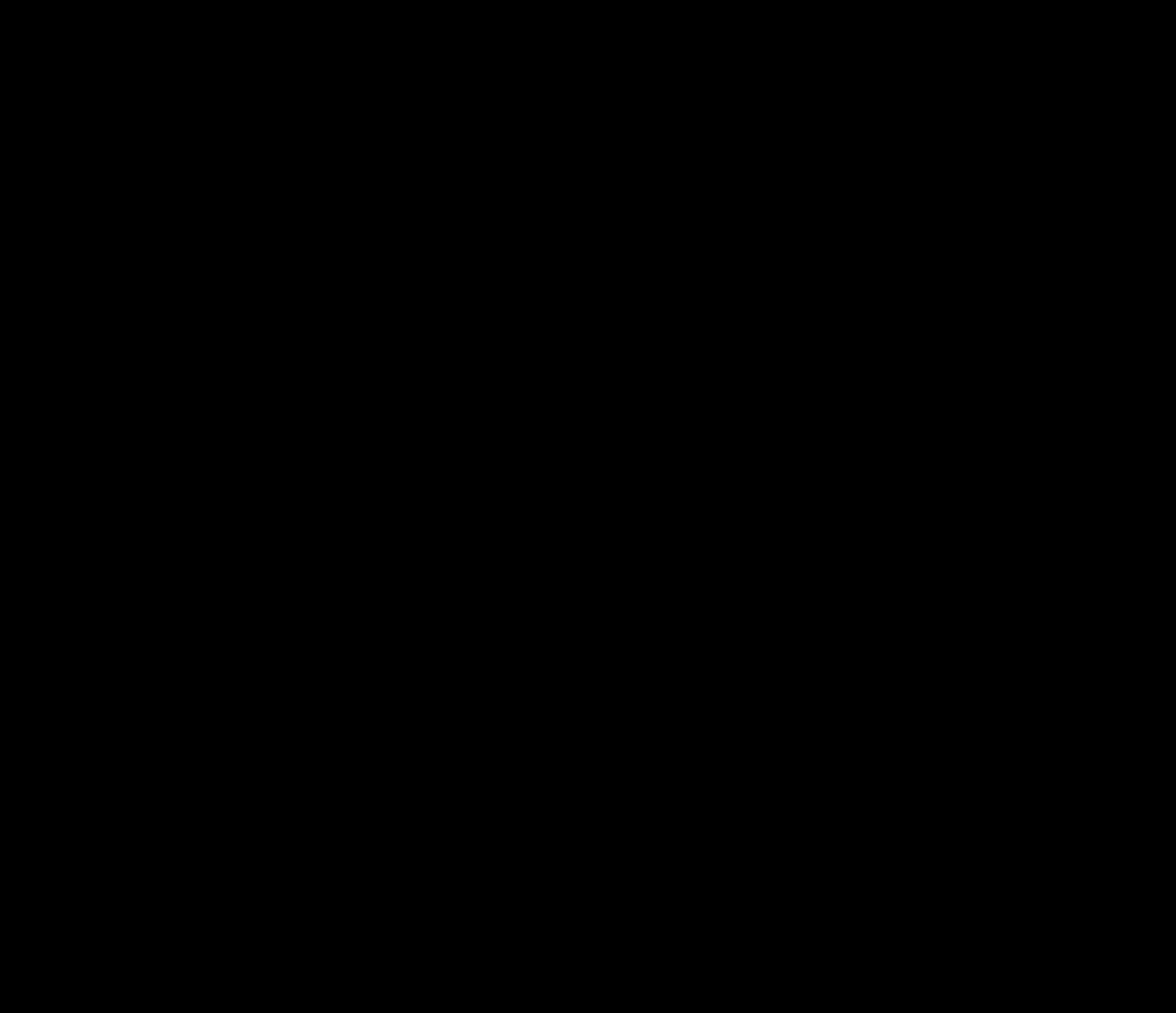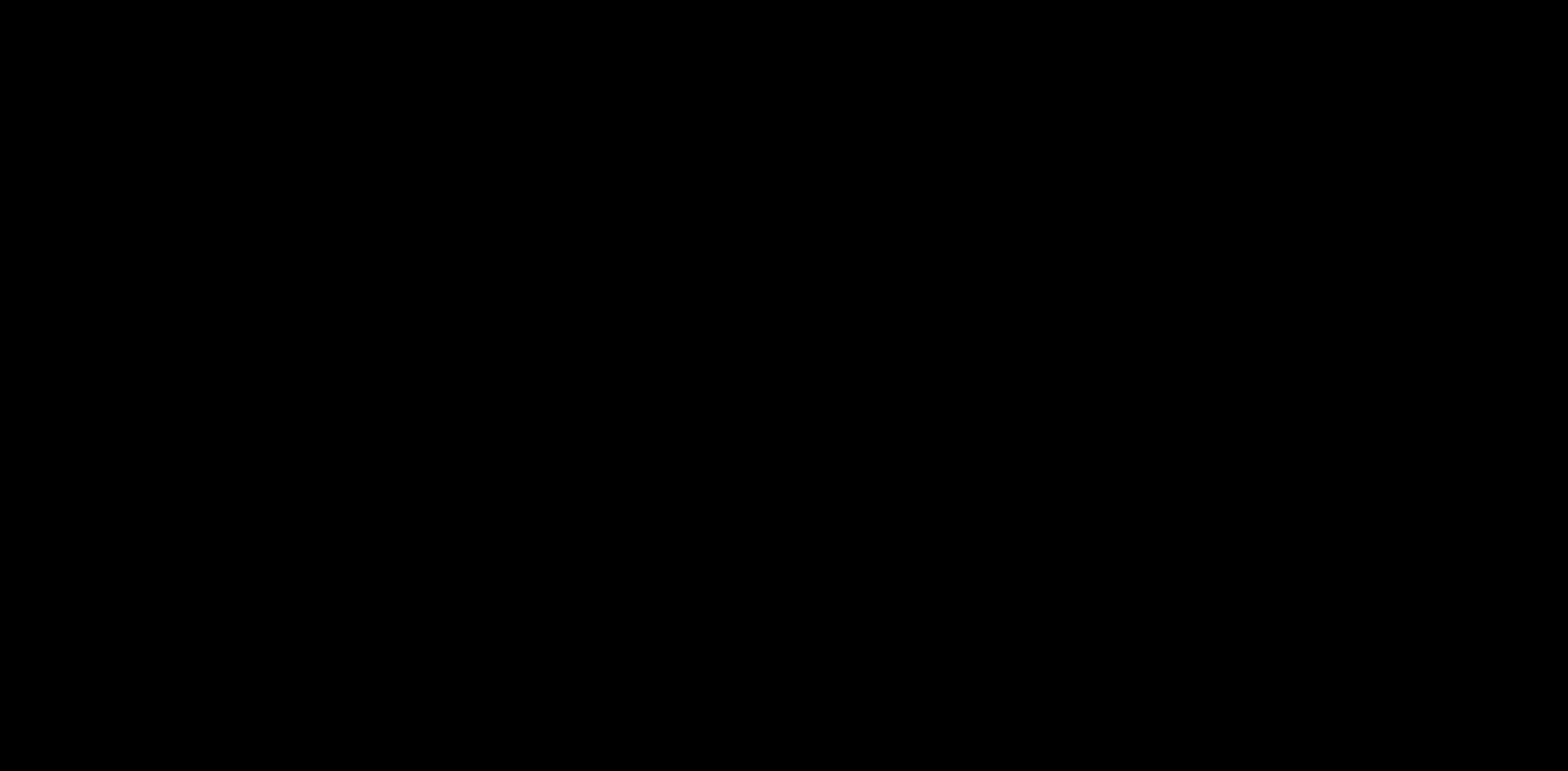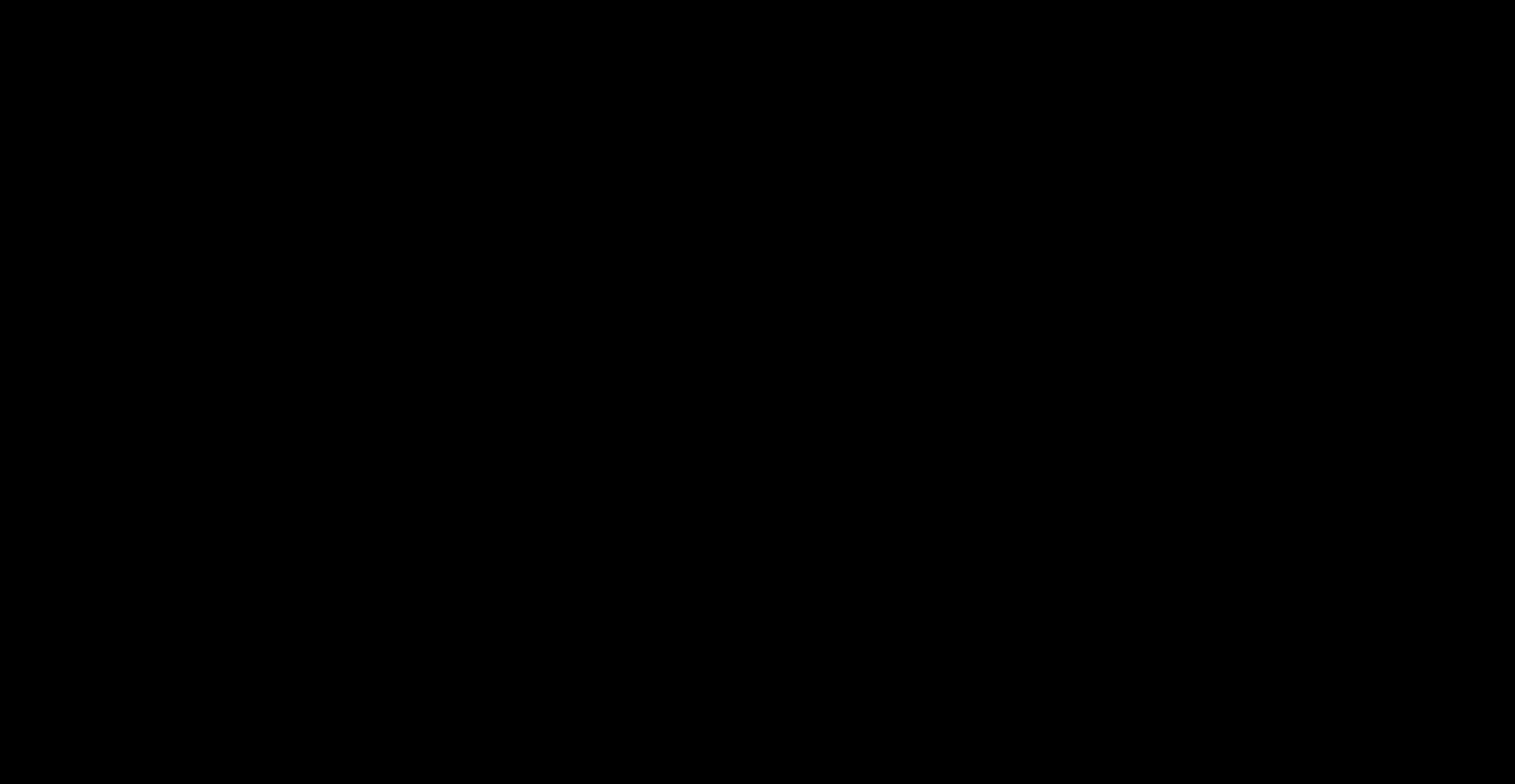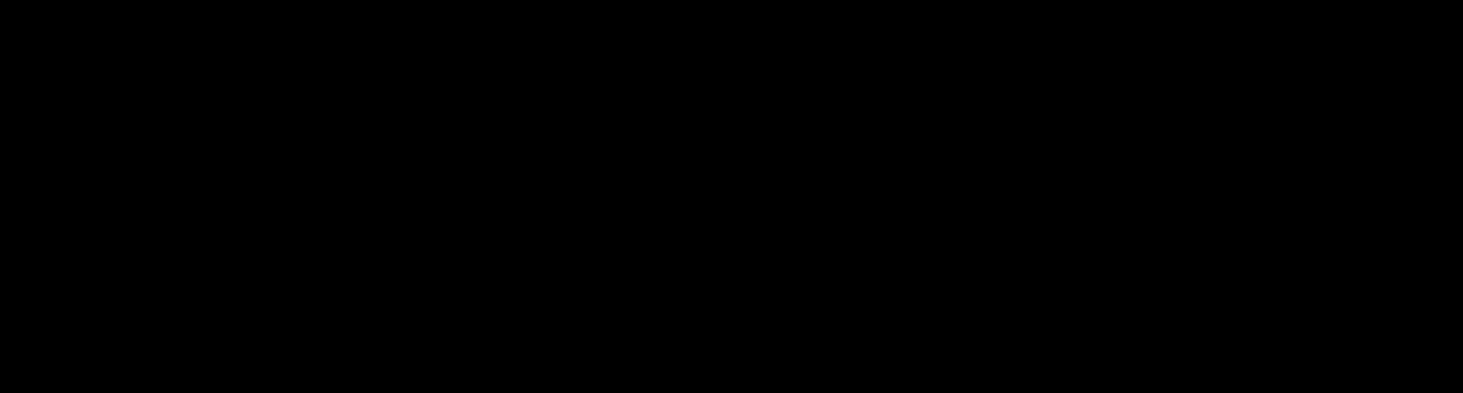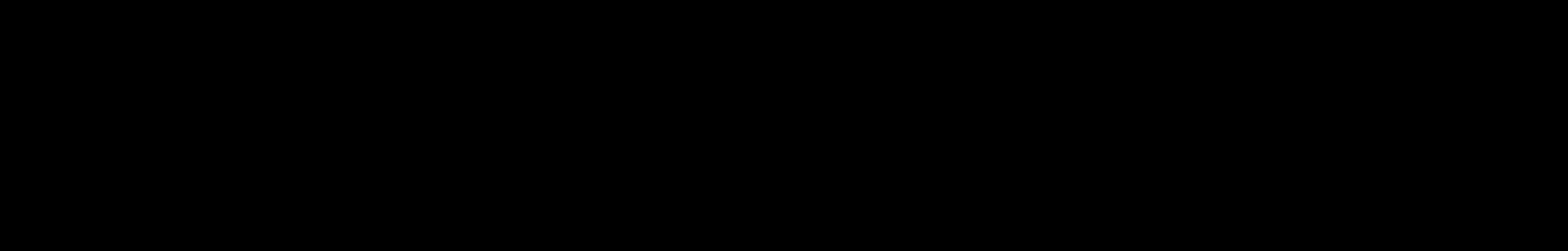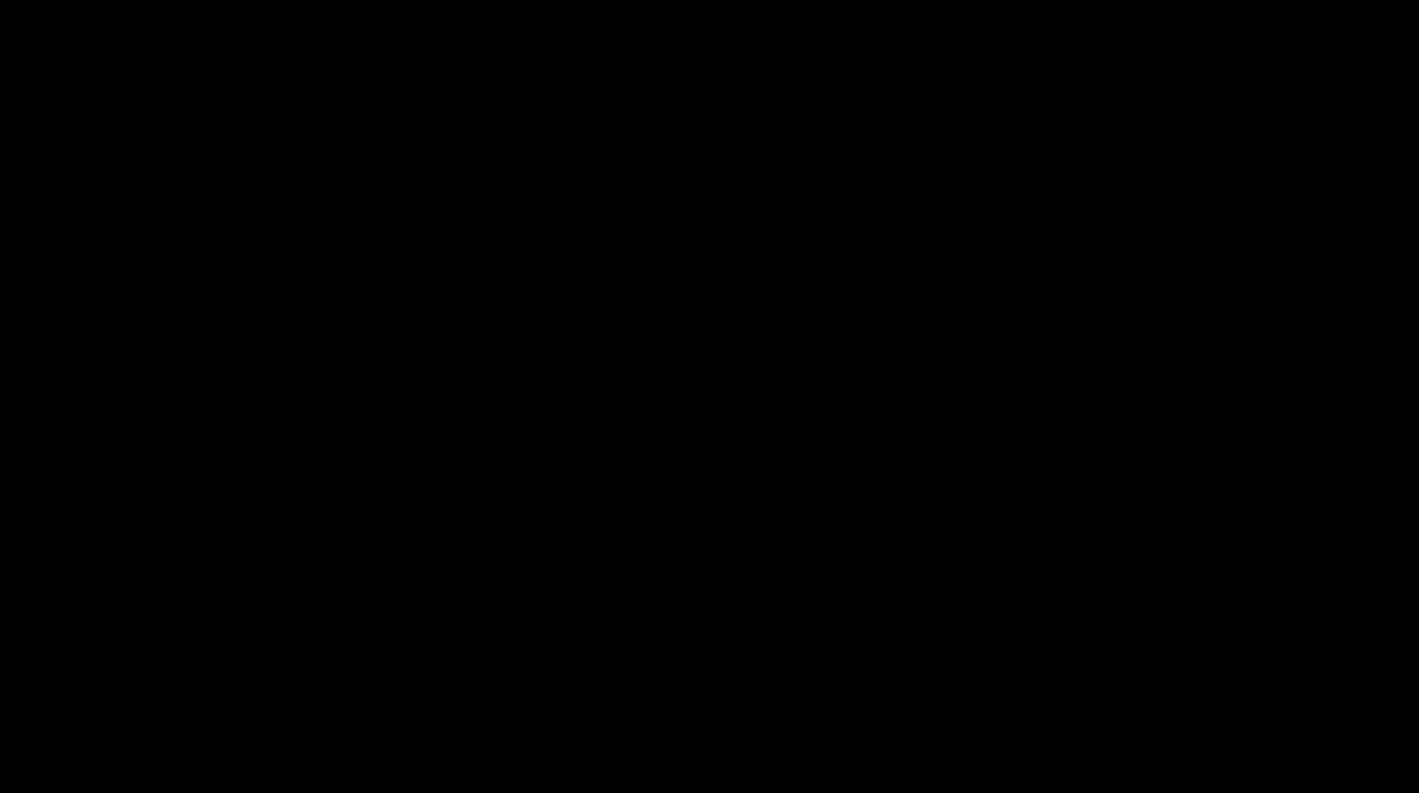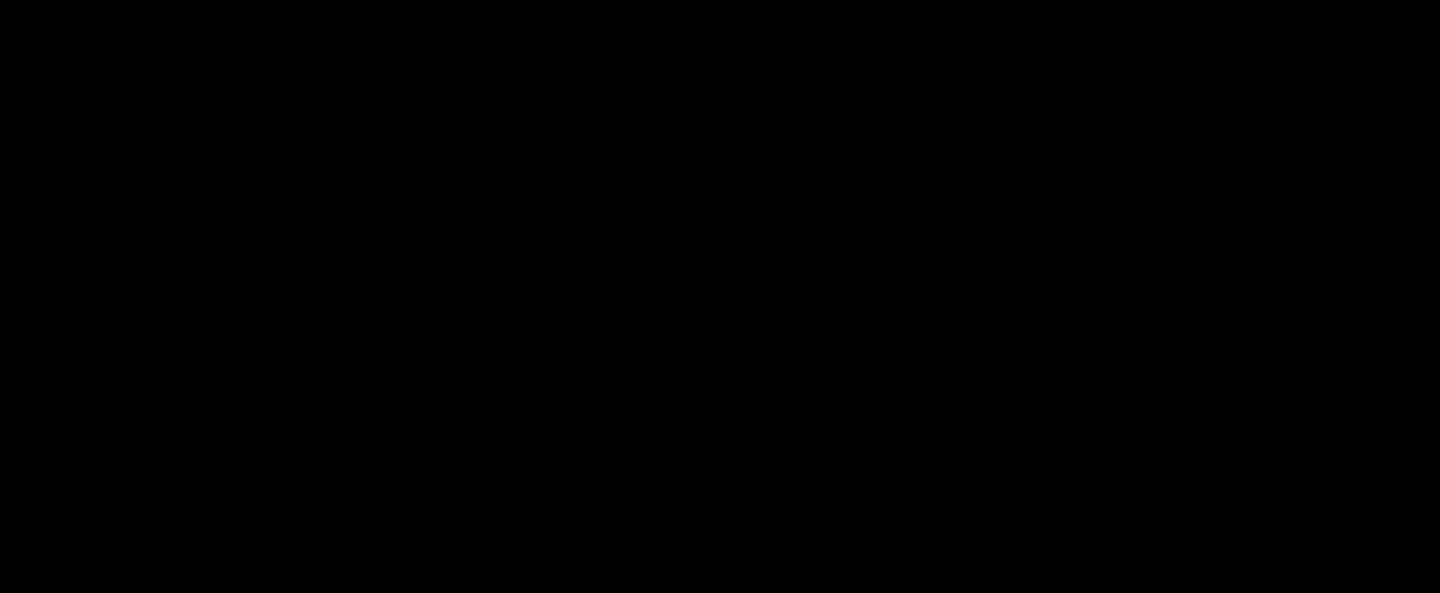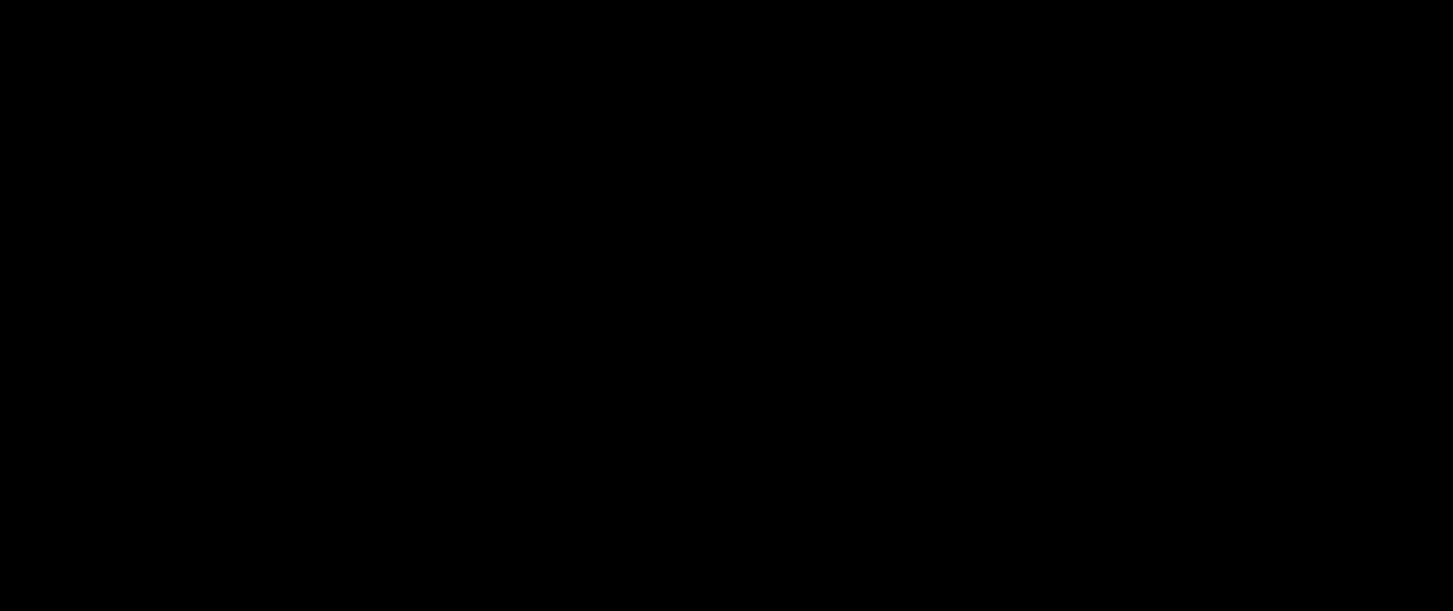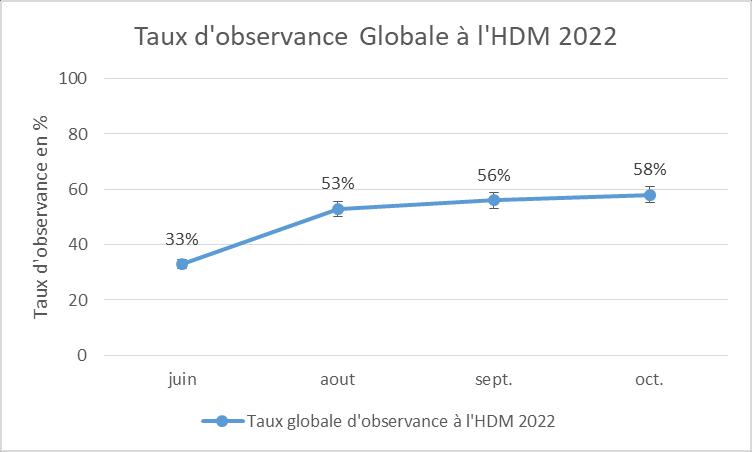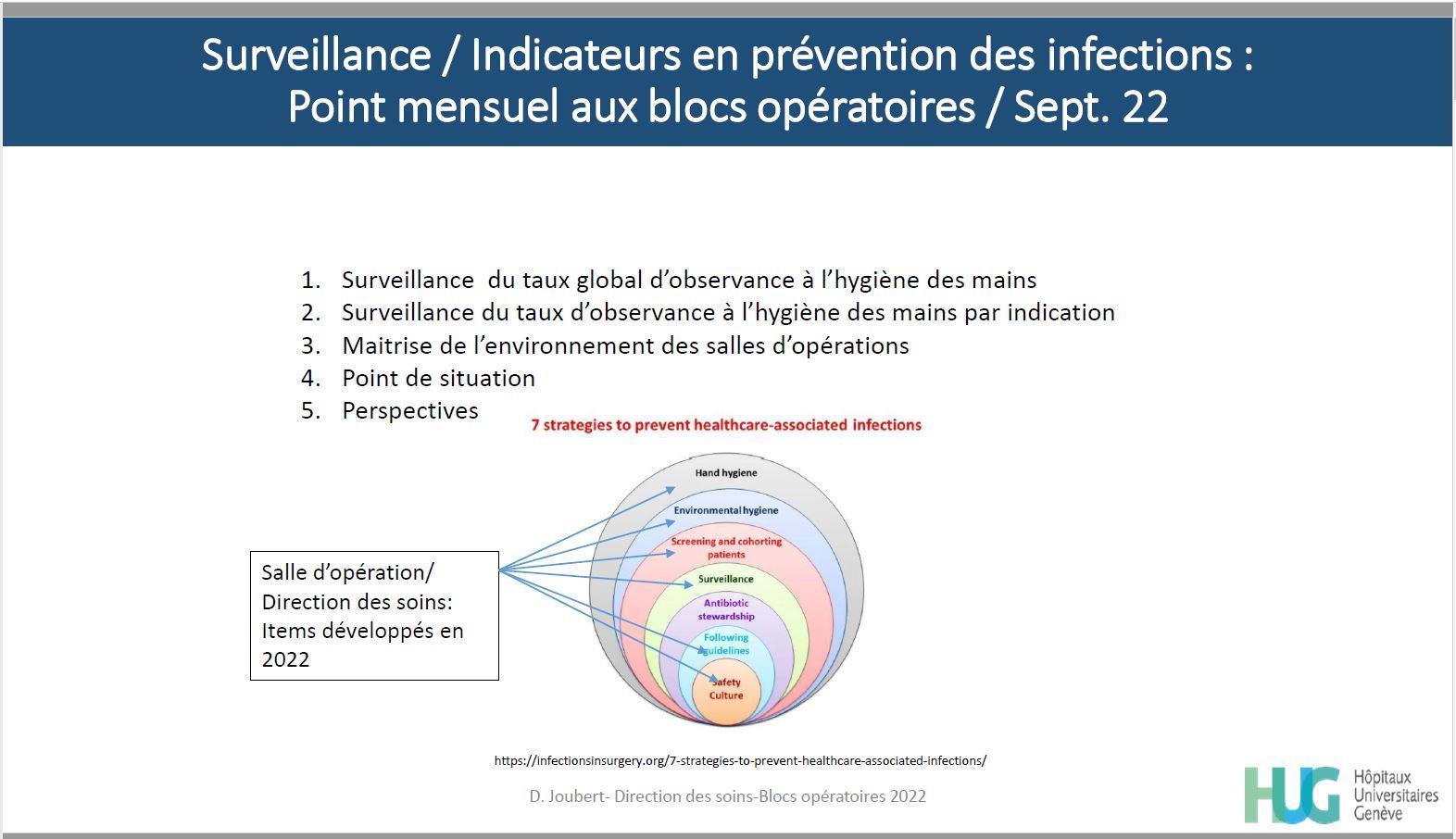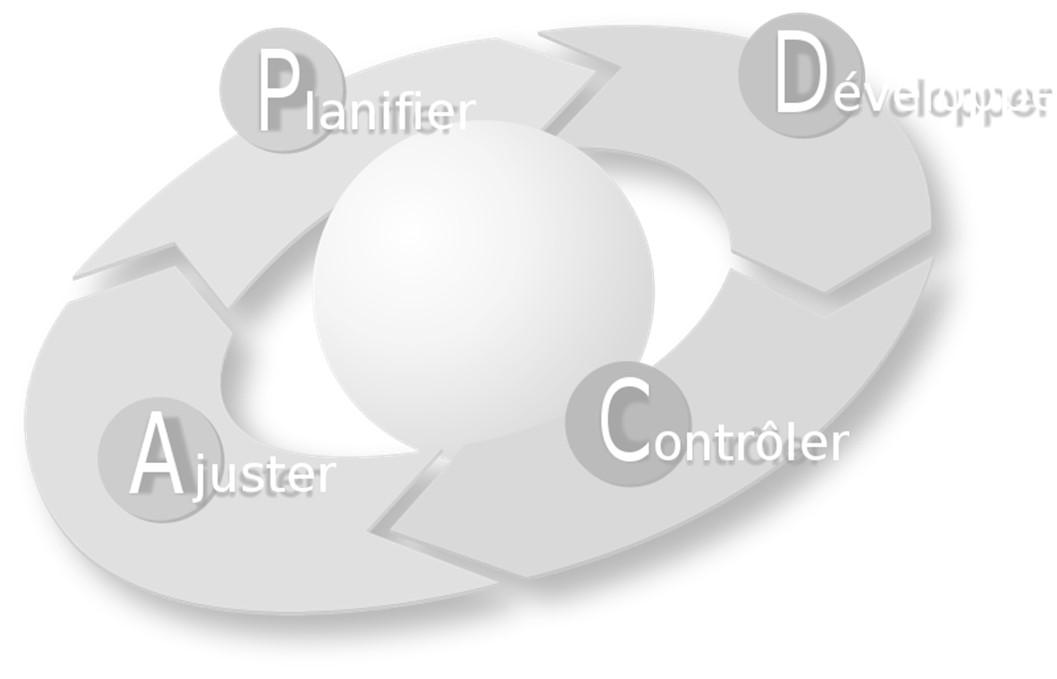La

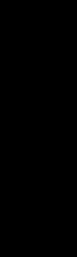
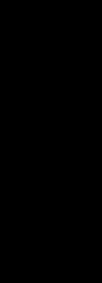




classe inversée et le temps de formation en présentiel pour le personnel soignant
Céline Josserand IS en soins de plaies, Vesselina Avramova IS en soins de plaies, Marie-José Roulin Adjointe à la direction des soins Direction des soins, programme plaies et cicatrisation
Début Fin..... Formation obligatoire

E-learning de 30min Atelier pratique de 45 min sur le terrain
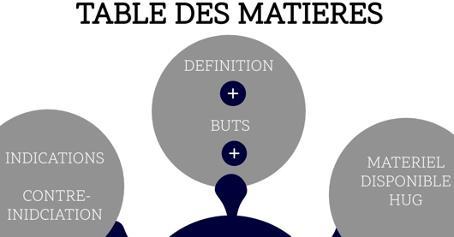

N= 27 personnes ont répondu aux questionnaires transmis avant et après l'atelier
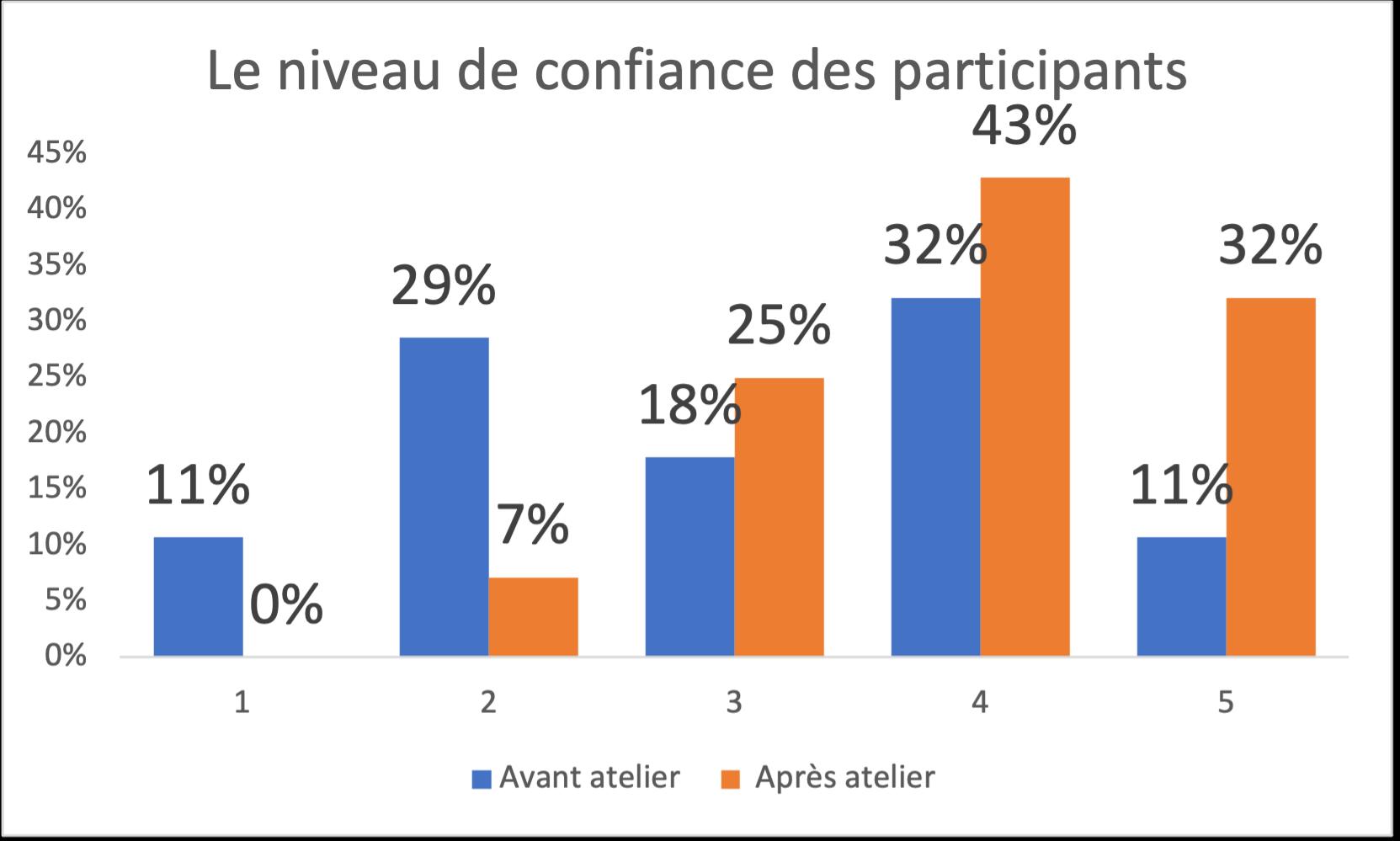
Implémentation de la thérapie à pression négative
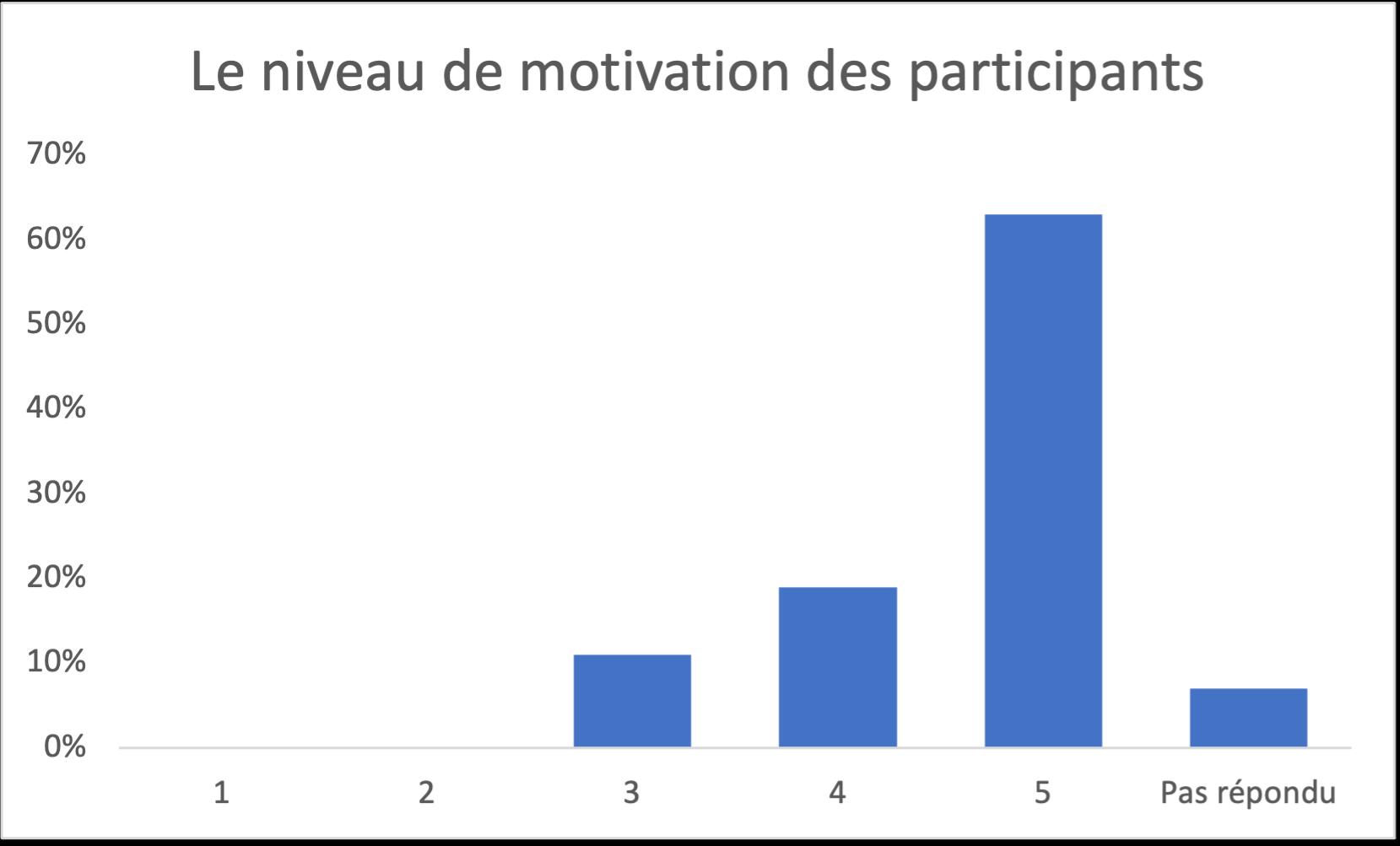
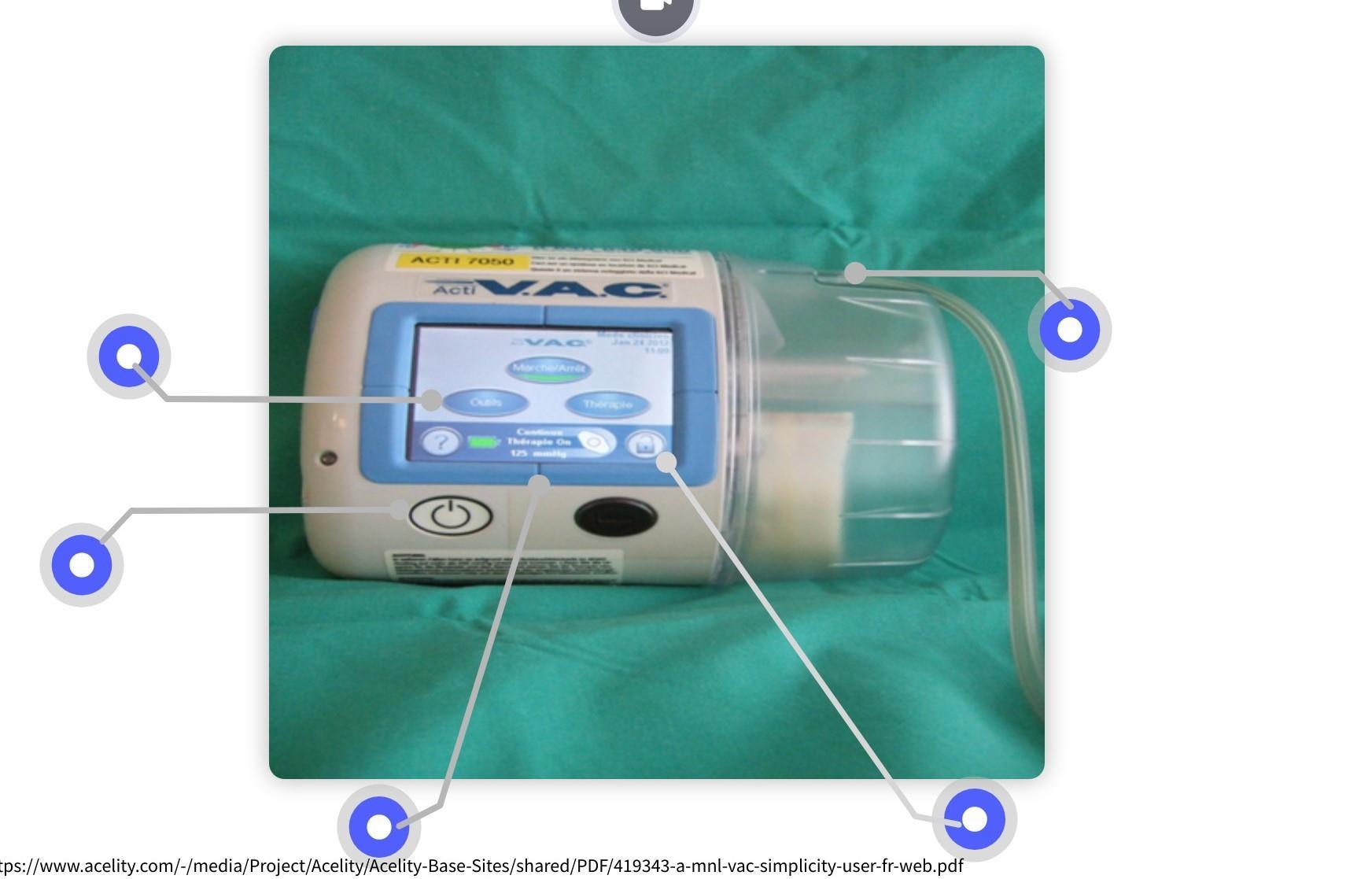
Création d'une affiche
Création d'unTuto <2min
A8
Journée Qualité 2022
Projet de soins anticipés avec l’aide d’un jeu des valeurs
Expérience en soins aigus oncologiques, DONCO, unité 7BL

CONTEXTE
Etablir un projet de soins anticipés (ProSA) permet de connaitre, de respecter les valeurs et préférences des patients pour les soins et traitements à venir. Il est toutefois difficile de parler des démarches pour la fin de vie, tant pour les patients que pour les professionnels de santé.
OBJECTIFS
Intégrer l’avis (la vie) du patient et ses priorités en encourageant la parole .
Favoriser des décisions partagées, en préservant l’autonomie des personnes.

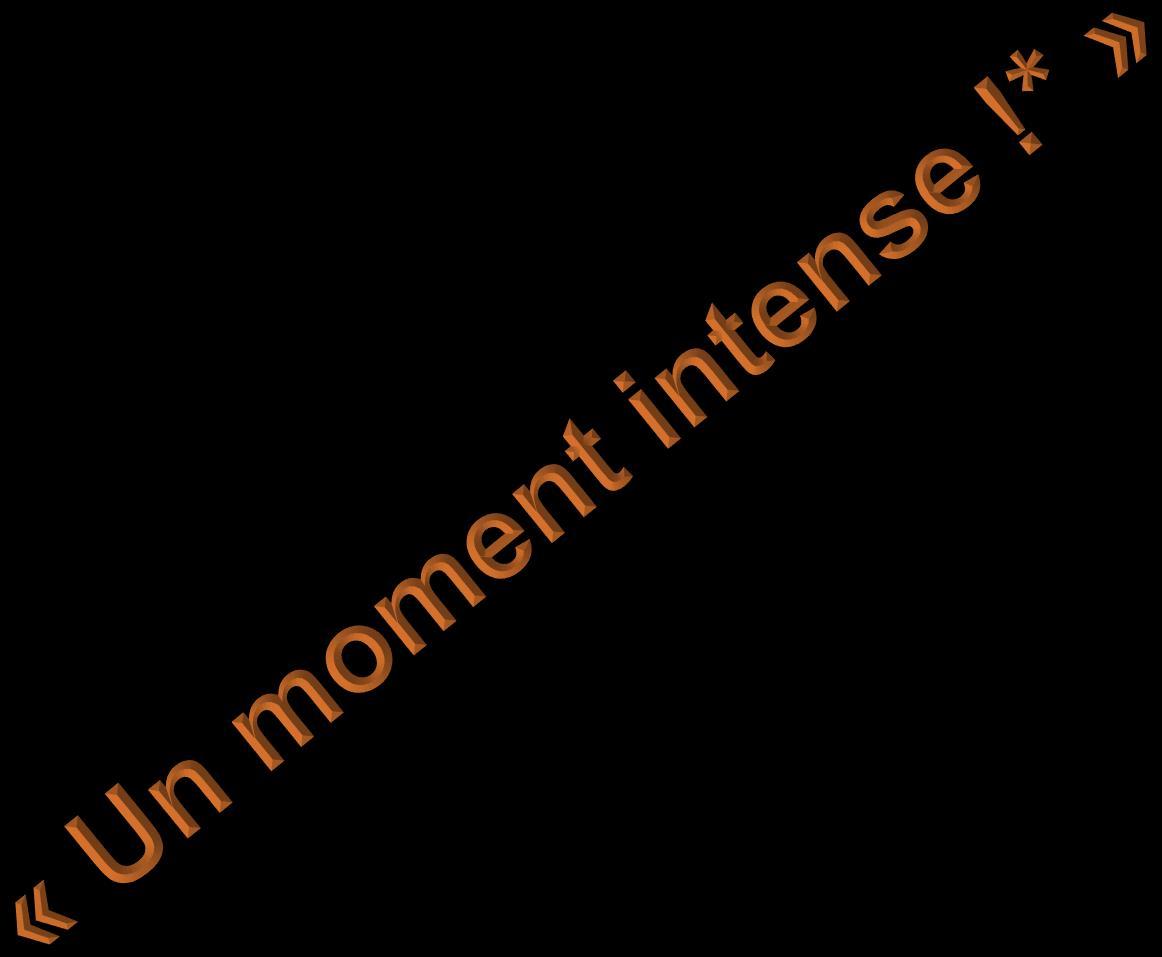

Renforcer les compétences relationnelles des soignants.

METHODE
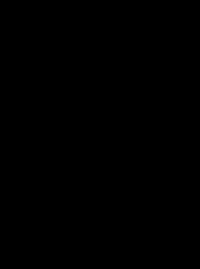
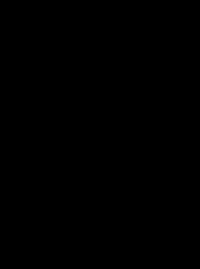


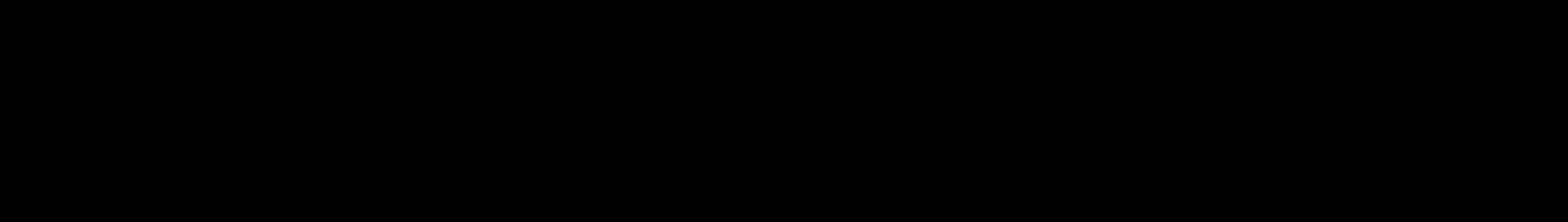

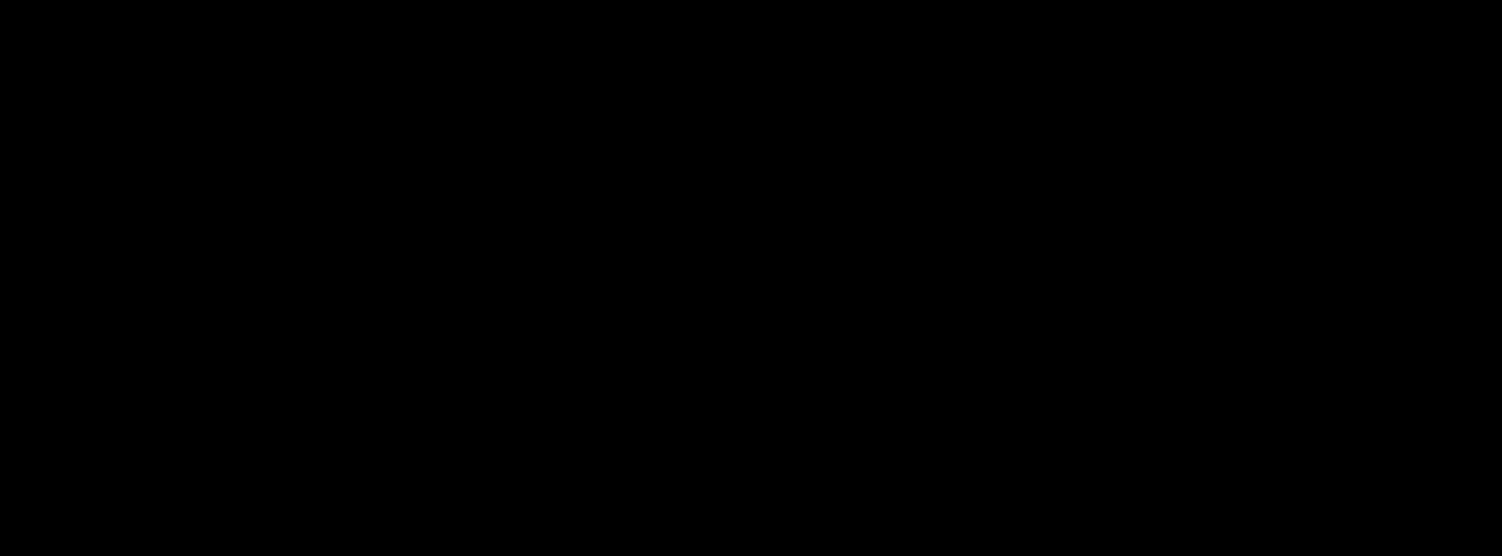

Formation, complétée par un encadrement clinique et des séances d’intervision, pour 11 infirmier-ères et 1 médecin adjoint.
Utilisation du jeu de cartes «Anticip’action» (développé en collaboration avec UNIGE, et le soutien de la fondation privée HUG).

Réalisation de 1 à 3 entretiens par patient.
CONCLUSION
RESULTATS
Après 12 mois : 27 patients au total. 1 entretien pour 12 patients. 2 entretiens pour 9 patients. 3 entretiens pour 6 patients.
11 patientsont élaboré des directives anticipées.
Lieux des entretiens : 63% en chambre. 24% en bureau. 13% en loggia.
Participation du proche : 6 patients.
Durée moyenne par entretien: 55 minutes.
*Commentaires des infirmier.ères
Cette intervention innovante dans un service stationnaire en oncologie est prometteuse. Elle a permis de mettre en place des plans de soins personnalisés, avec une visée centrée sur la qualité de vie exprimée par la personne. Les souhaits orientent également les soins quotidiens.
PERSPECTIVES
Cette démarche enrichit l’offre d’anticipation des soins aux patients. Ces résultats complèteront ceux d’autres études menées en milieu ambulatoire afin d’affiner l’intervention de soins et d’émettre des recommandations pour la pratique. Des réflexions pour la proposer à d’autres secteurs du service d’oncologie sont en cours.
A13
Journée Qualité 2022
BRUYERE David¹; BERRET Pierre-André¹; MARCIONETTI-RUSCONI Sylvie¹; PAUTEX Sophie² ; FERNANDEZ Eugenio¹; BOLLONDI PAULY Catherine² - ¹DONCO, ²Centre de Soins Palliatifs et Soins de Support
La sémantique au service de la réutilisation des données cliniques
Des données massives, une réutilisation limitée
Les données générées dans l’hôpital sont de plus en plus nombreuses, mais leur réutilisation à d’autres fins que l’activité clinique reste limitée et coûteuse.

L’hôpital a de plus en plus besoin de pouvoir réutiliser efficacement ces données, pour remplir des registres, pour la recherche, pour l’amélioration de la qualité, etc.
Data
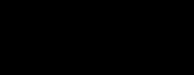
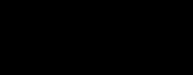
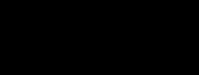

Combien d’enfants souffrent ils d’une fracture mal guérie?
Une solution
Constituer la liste de toutes les variables cliniques structurées produites dans les HUG.

Choisir des standards reconnus qui permettent de représenter le plus fidèlement ces variables.
Encoder ces variables en les liant à des codes issus de ces standards.
Vaste Compositionnel
Des barrières
Digitalisation Encodage
R40.2 Coma

T57.0 Effets toxiques de l’Arsenic et de ses composés



E34.3 Insuffisance staturale, non classée ailleurs Z63 Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale
La digitalisation et l’encodage des données ne suffisent pas pour gérer la complexité du monde réel. Il est nécessaire d’adopter une stratégie qui permette de représenter, stocker et réutiliser les informations cliniques, en s’affranchissant des limitations techniques.
Cette stratégie doit remettre la sémantique au centre de la problématique des données.
International
Des résultats
Combien d’enfants souffrent ils d’une fracture mal guérie?
Sémantique
Réponse
L’encodage des données structurées dans le langage SNOMED CT permet:


• Une sémantique indépendante de la technique.
• Moins de perte d’information liée à l’encodage.
• Un langage unifié pour représenter l’information.
• La réduction du nombre de variables différentes.
Données structurées
Journée Qualité 2022 B01
Christophe Gaudet Blavignac, Julien Ehrsam, Cyrille Duret, Nikola Bjelogrlic, Christian Lovis
formelle Données
90%
65’000
24’500
variables HUG
concepts SNOMED CT
Accompagnement des apprentis :


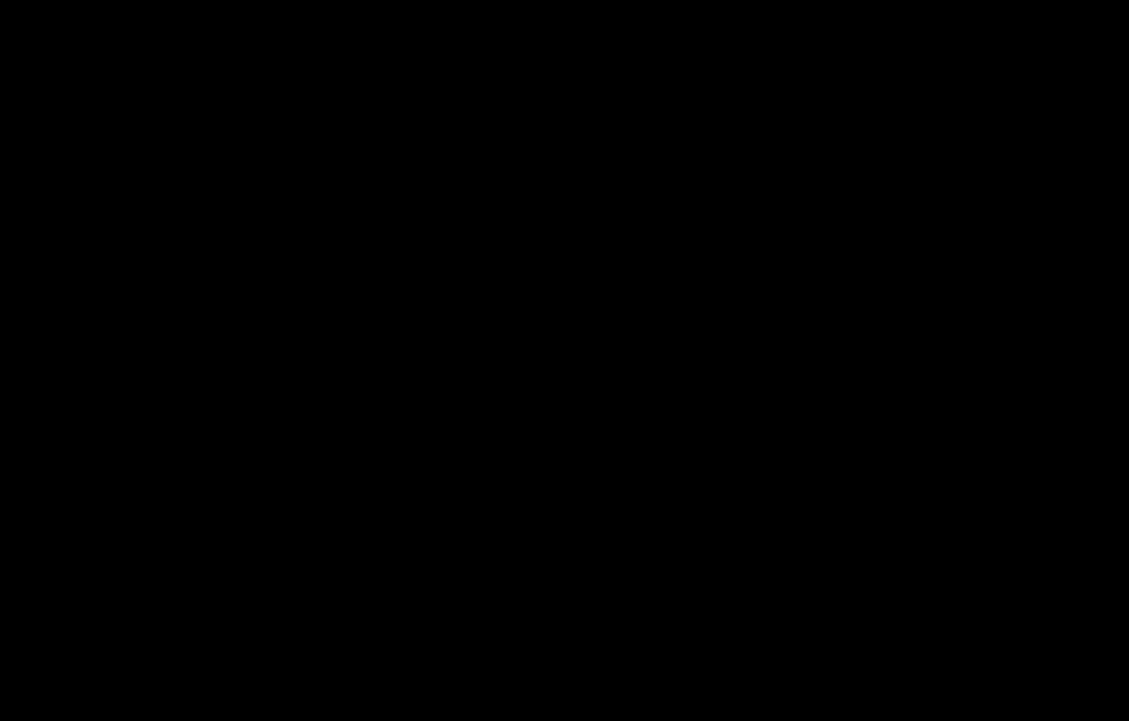

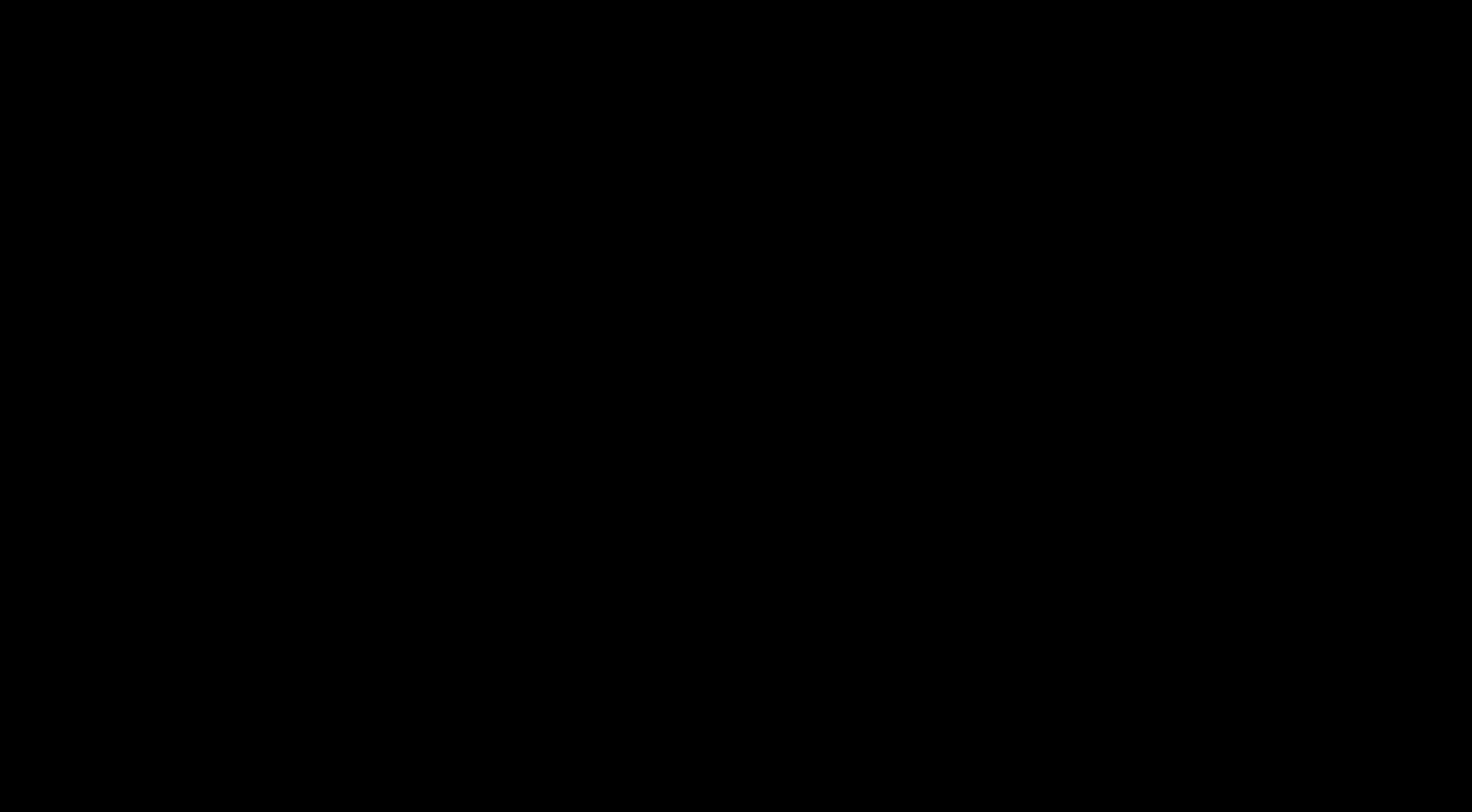
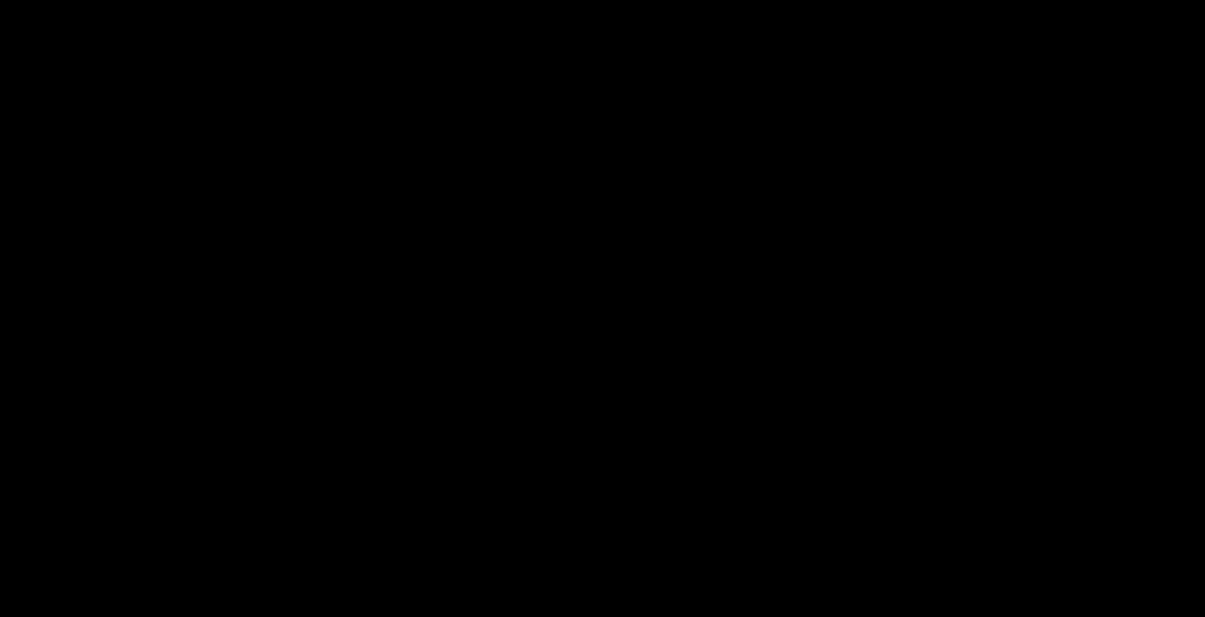
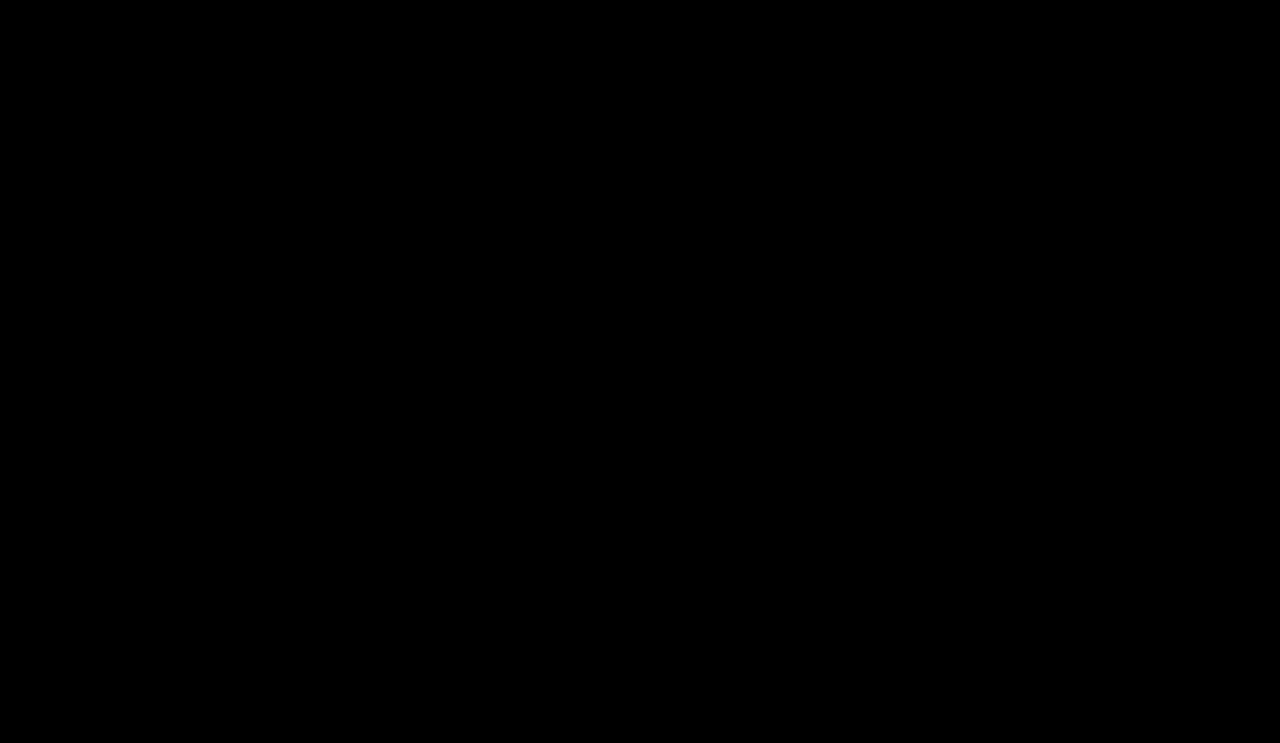


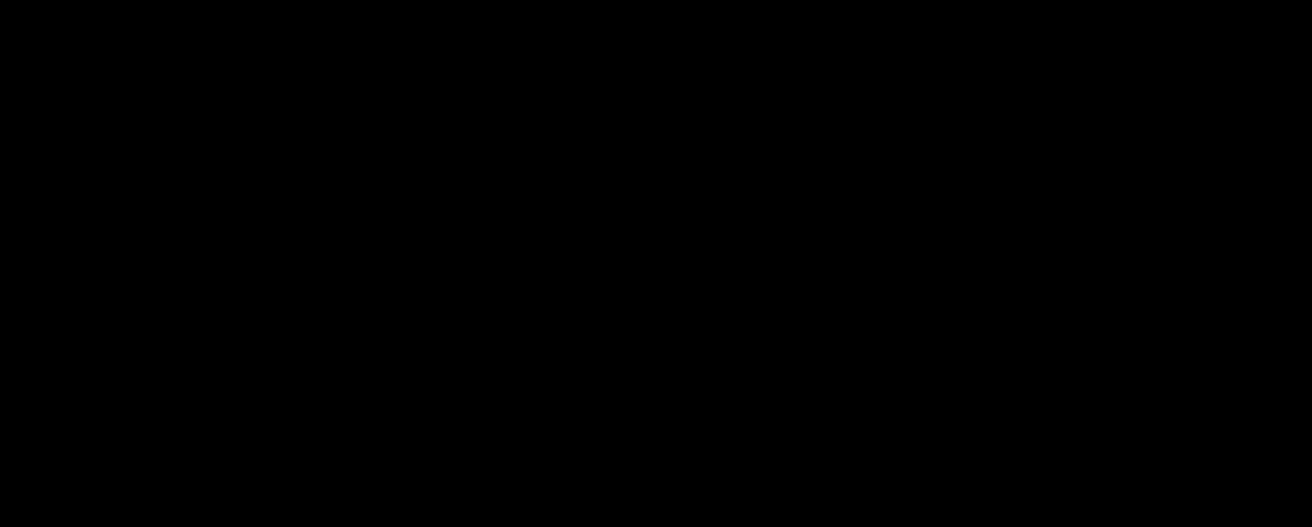
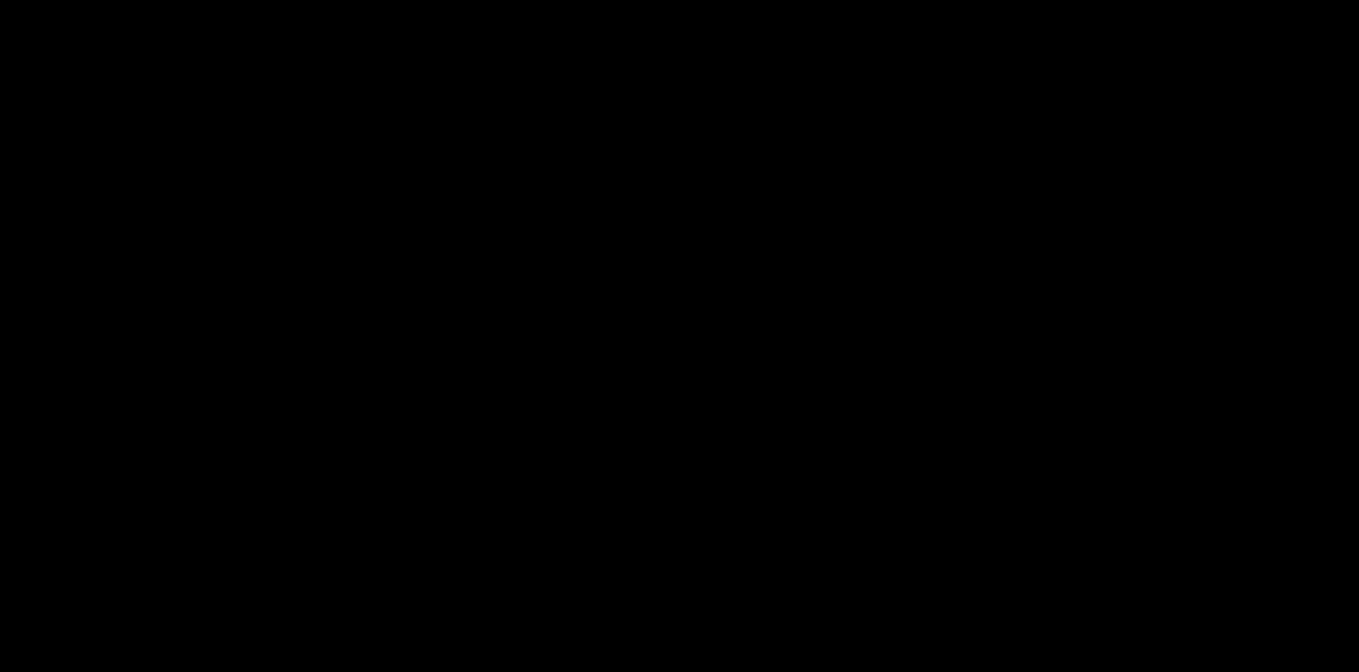

Journée
B06
Qualité 2022
transition
le monde professionnel
Une
vers
à travers la démarche éthique
CONSTAT Nécessité de compétences éthiques La réalité du monde soignant Difficultés d’adaptation OBJECTIFS Favoriser la réflexion éthique Susciter le plaisir du métier * La qualité des soins comme une réelle compétence
Former les référents aux outils d’apprentissage Identifier le niveau de l’étudiant Apporter des outils d’accompagnement Etablir une relation de confiance
Evaluation des résultats du projet dans 2 ans Déployer le projet sur l’ensemble des HUG
Charline COUDERC (RS) Coralie PEILLEX (ARS) Claire THABUIS (RES) Maria MOSTAJO (ASSC/FPP) Audrey TOXÉ (Adjointe RRH) D-RG – Hôpital de Loëx
MÉTHODE
PERSPECTIVES
PROJET PILOTE INTERPROFESSIONNEL EN CHIRURGIE VISCERALE
Chirurgie ; 2 : COSPA ; 3 : CSPSS
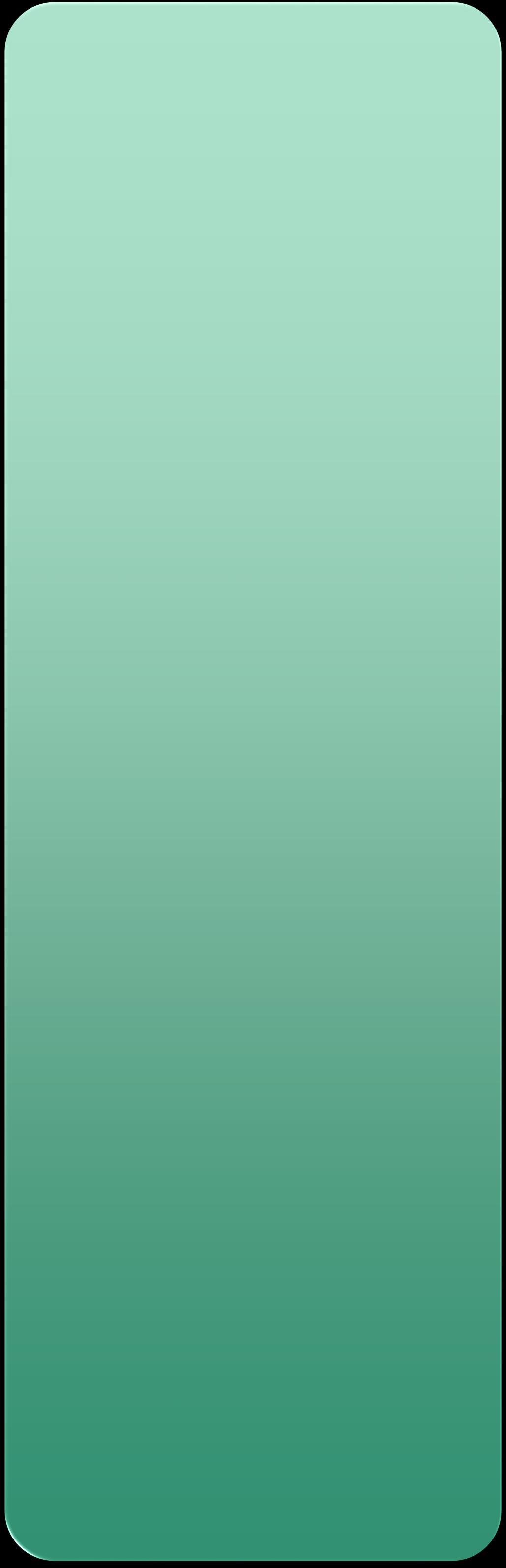
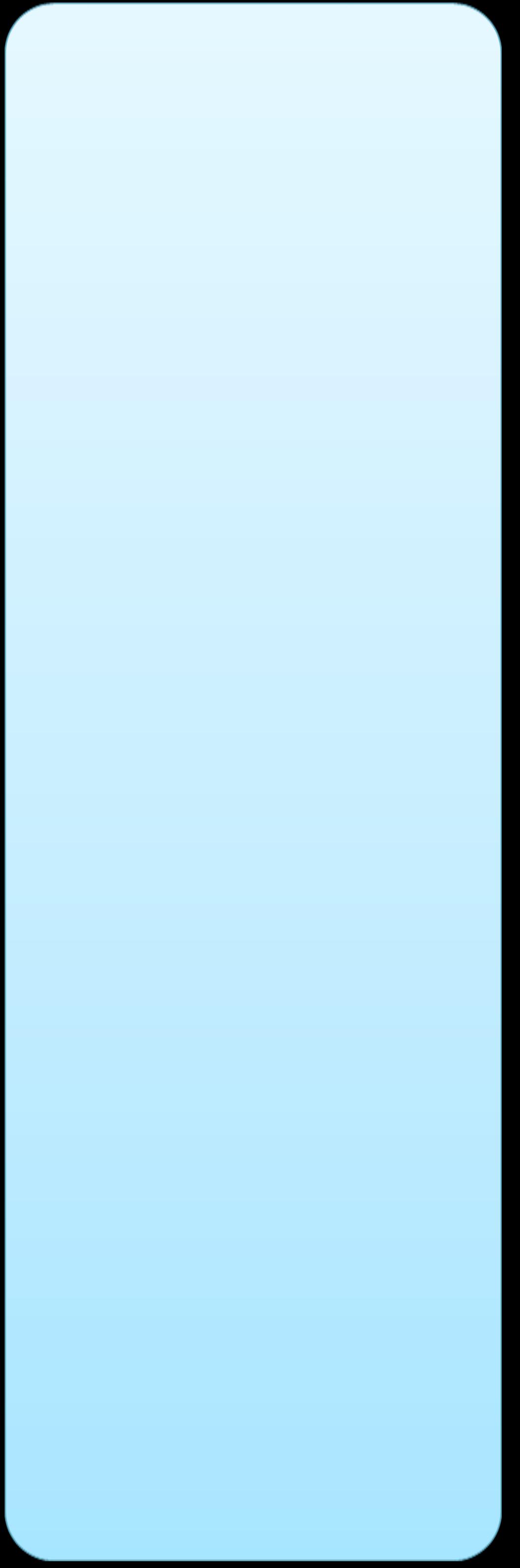
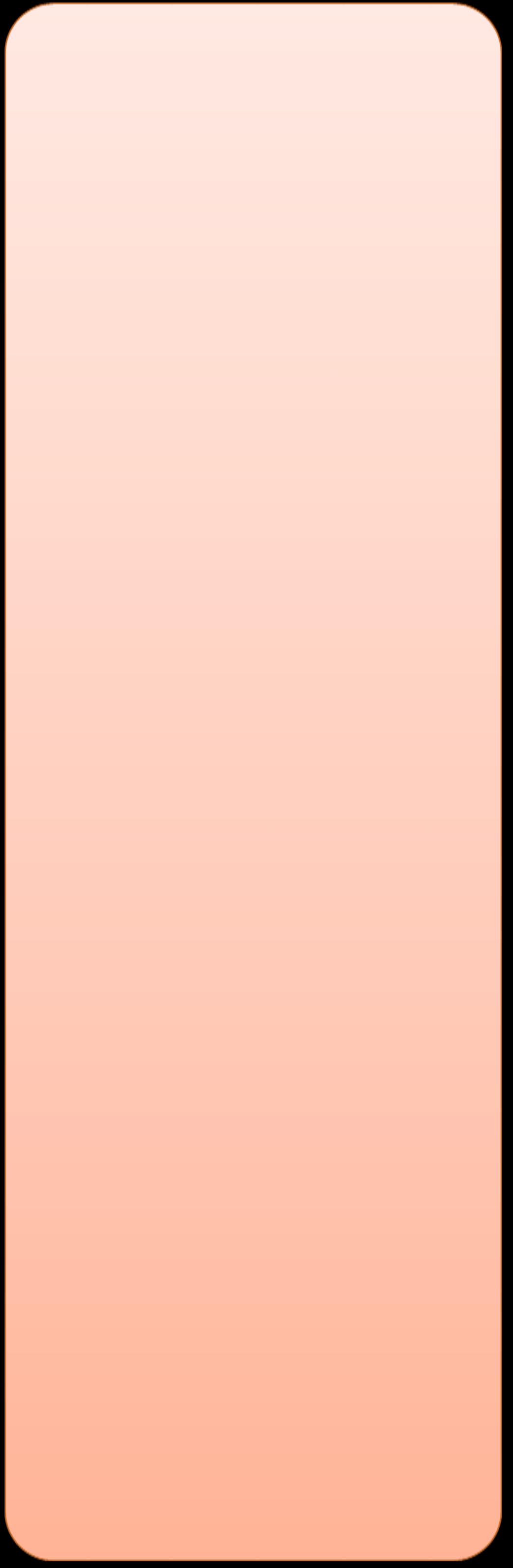


Suivi des indicateurs et réajustement
Soutien des proches
Discussion interprofessionnelle facilitée
Interventions groupées soins palliatifs généraux

Offrir des soins palliatifs précoces et suivre les recommandations de prises en charge
Soulager les symptômes, soutenir les proches, adapter les trajectoires de soins aux besoins et anticiper la prise en charge des
Soutenir le développement des compétences de l’équipe interprofessionnelle à dispenser des soins palliatifs généraux.


Améliorer la collaboration avec le réseau de soins palliatifs spécialisés.


« OFFRIR PRÉCOCEMENT DES SOINS PALLIATIFS ET DE SUPPORT EN CHIRURGIE VISCÉRALE »
Séance d’information à l’équipe médico soignante


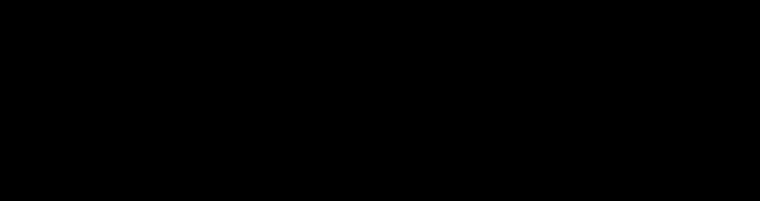


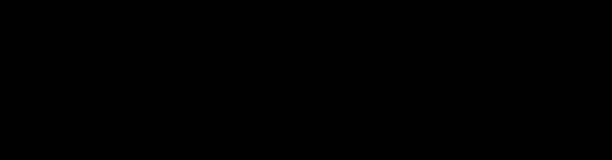




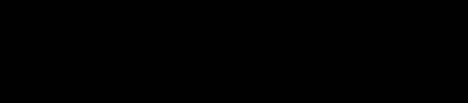


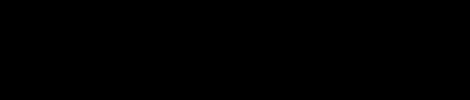

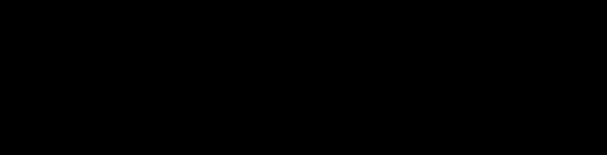


2 infirmières en CAS soins palliatifs en cours
Concept de soins palliatifs précoces et recommandation de prises en charge
Screening des patients et présentation au colloque
E-learning : « PROSA » et « soins palliatifs pour tous »

CONCLUSION :
Un soutien clinique par une infirmière spécialisée du CSPSS et une infirmière spécialisée en soins palliatifs
La dynamique est lancée ! Les soins palliatifs s’intègrent petit à petit dans la culture du service facilitant les discussions interprofessionnelles.

Les consultations de soins palliatifs spécialisés sont initiées.
PERSPECTIVES :
L’implémentation de ces pratiques innovantes répondant précocement aux besoins des patients pourra être déployée sur l’ensemble des unités de chirurgie viscérale.
Journée
B11
Qualité 2022
Consultation COSPA
ALAMERCERY France1, BOLLONDI PAULY Catherine2, BUCHS Sonia1, BUCHS Nicolas, COCAULT DUVERGER Cécile1, ESCHER Monica2, HENTSCH Lisa2, LIOT Emilie1, PAUTEX Sophie2, RIS Frédéric1, ROCH BARRENA Florence1 , SZARZYNSKI BLOCQUET Alexandra3, TOSO Christian1 1 : Département de
Prévenir ou Accepter le risque de chute?
DEGREMONT Christine IRES, HOXHA Mirjeta QO /Département des Neurosciences Cliniques /Service de Neurochirurgie
METHODE :
CONTEXTE:
Unité spécialisée avec accueil de patients avec troubles cognitifs et atteintes dorsolombaires Impact potentiellement mortel de la chute chez les patients de neurochirurgie ( EIG)
Taux de chute de 8,9 ‰ pour l’unité VS pour le département 6,2‰ ( année 2021/2022)
OBJECTIFS :
Comprendre le contexte des chutes, les facteurs contributifs (patient/unité/infrastructure) associés aux chutes

Agir sur ces facteurs pour mieux prévenir-limiter les chutes et leurs conséquences
RESULTATS
80% des patients sont des patients uni chuteurs 74% des chutes ont lieu en chambre; 36% des chutes ont lieu lors du transfert ; 26% debout et 18% du lit 40% des patients chutent entre J0 et J1 de l’admission 69% en 2021 de taux de détection du risque de chute , 76% en 2022 65% des patients chuteurs sont des opérés du rachis; 35% sont des opérés du crâne 65% ont des troubles de cognition ou de perception 80% ont des troubles de la mobilité (transfert et mobilité) 55% ont une altération de la fonction d’élimination
PLAN
D’ACTION
Analyse des données TBO Analyse approfondie des chutes sur l’année 2021&2022 par une collaboratrice Analyse en équipe interdisciplinaire Revue des contres mesures mise en place à disposition Benchmarking Eléments de l’EIG
Identifier lors du HUDDLE en interdisciplinaire
• les facteurs aggravants • l'équilibre, la capacité de transfert, la mobilité Déterminer lors du HUDDLE l'acceptation ou non du risque de chute selon l’algorithme pour déterminer les contre-mesures Réaliser les 1ers levers des spondylodèses par les physio à J1 et J2 Evaluer le risque de chute dès l’admission et réévaluation de la contre-mesure du choix quotidien Anticiper les besoins d’élimination Réaliser des ateliers positionnement–transferts pour les soignants Sensibiliser les nouveaux collaborateurs Améliorer les moyens de contre-mesures Suivi mensuel là travers dynamo et au quotidien sur le HUDDLE
PERSPECTIVES :
Diminution du taux de chute Discussion avec le groupe chute
Journée Qualité
B16
2022
Tapis sonnette
Matelas alarme Tapis de sol
Un patient traverse deux structures de soins sans travers !
1Département de Chirurgie, 2Service d’Anesthésiologie





CONTEXTE
Suite à l’analyse des déclarations d’incidents lors des transferts de patient.es entre le département de chirurgie et les SINPI (département de médecine aiguë), une réflexion a été menée conjointement en vue d’améliorer la communication interprofessionnelle au travers des transmissions
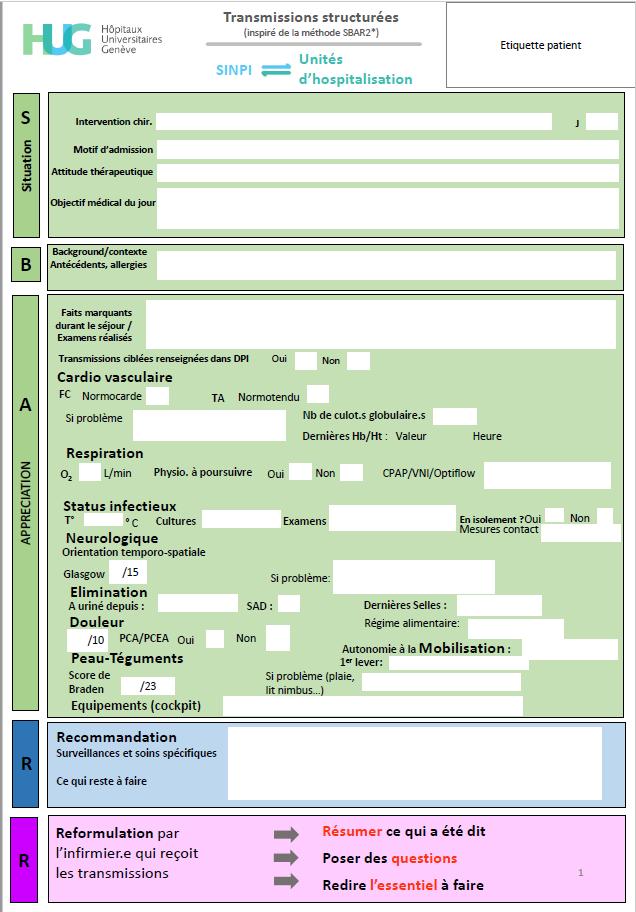
OBJECTIFS
Améliorer la communication entre professionnel.les de deux entités différentes
Transmettre les informations pertinentes et structurées
Assurer la sécurité du patient lors de la transition délicate dans la continuité de sa prise en charge
METHODE
Implication d’une infirmière de chaque spécialité pour comprendre les réalités et priorités de chaque service Construction d’un outil de transmissions orales sur la base des réflexions communes selon SBAR2
Mise en productivité de l’outil et évaluation par le questionnaire de satisfaction

INDICATEURS DE SUIVI
Titre
Noms des auteurs et département/service
Sous-titre si vous le souhaitez
Besoins
Sécurité des soins
Équipements Cockpit DPI
Responsabilité professionnelle Communication Information patient complète
Partage d’expériences
Outil de transmissions structurées
Surveillance et soins spécifiques
Reformulation


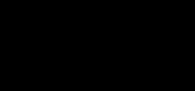
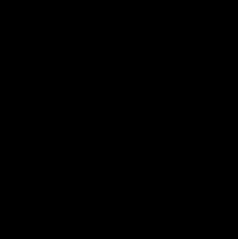

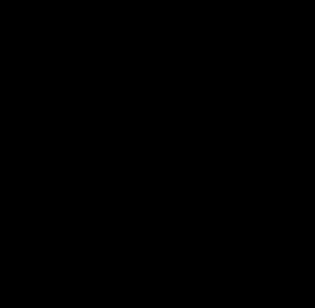
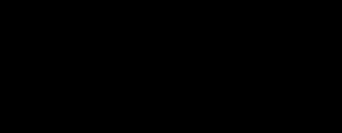
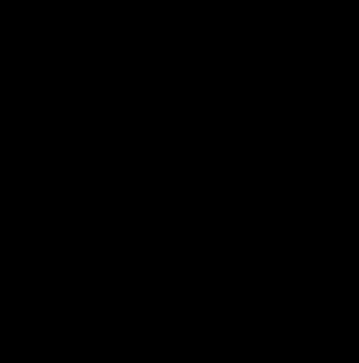
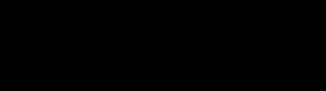

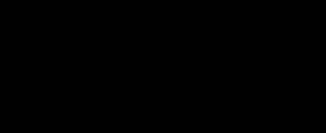
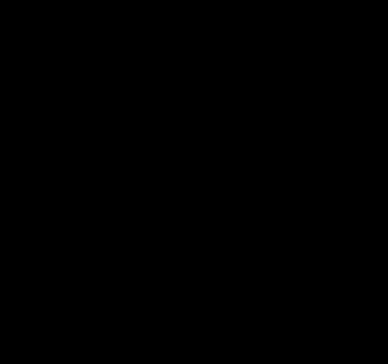
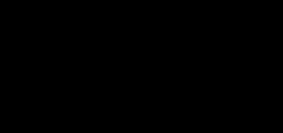




Ensemble pour notre patient
Satisfaction des patient.es, des équipes, déclarations d’incidents, documentation DPI, amélioration de la collaboration interprofessionnelle entre les équipes du D Chir et SINPI
CONCLUSION
Cet outil de transmissions orales garantit la continuité des soins dans une approche cohérente, une vision et une démarche transversale sécuritaire en respectant la spécificité de chaque structure
PERSPECTIVES
L’outil de transmissions sera adapté afin d’être proposé dans d’autres structures de soins
Journée
B22
Qualité 2022
Roch Barrena Florence1 , Roset Nathalie1 , Trbic Bozana2, Ferrari Sandra2 , Barrionuevo Vial Karen1, Fernandes Jesus1, Fontaine Iampieri Carole2, Vermeulen François1 ,Walder Bernard2 , Triponez Frédéric1 , Alamercery France1
SBAR2
Intégration des soins palliatifs en cardiologie auprès des patients insuffisants cardiaques
Aurélie Schneider Paccot1, Céline Artigue1, Armelle Delort1, Catherine Bollondi Pauly2, Dre Lisa Hentsch3 et Dr Philippe Meyer1
1Service de cardiologie, Département de médecine, 2 Direction des soins, 3 Service de médecine palliative, Département de réadaptation et gériatrie.
Contexte
Pour améliorer la qualité de vie et la qualité des soins, l’équipe d’insuffisance cardiaque collabore avec l’équipe de médecine palliative. Le but est d’introduire précocement les soins palliatifs dans la prise en charge des patients insuffisants cardiaques sévères selon les recommandations nationales et internationales.
Méthode
• Lors des consultations d’insuffisance cardiaque:
• Utilisation de la question surprise « Vous ne seriez pas surpris si le patient décédait dans les 12 mois à venir » pour introduire une approche palliative
• Evaluation initiale des symptômes au moyen de l’échelle ESAS
• Dépistage des patients pouvant bénéficier d’une prise en charge palliative spécialisée par le P-Cares
Objectifs
• Permettre au patient d’exprimer ses valeurs et ses préférences dans une démarche d’anticipation des soins
§ Amener le patient à amorcer une réflexion sur le plan de soin anticipé et les directives anticipées
§ Offrir un soutien global adapté aux familles
§ Favoriser la continuité des soins de façon pluridisciplinaire tout au long du parcours de soin du patient
§ Développer et renforcer nos compétences professionnelles en soins palliatifs généraux
Conclusion
• Consultation conjointe entre le médecin cardiologue et le médecin palliativiste pour les patients identifiés

• Planification de consultation de soins palliatifs pour les patients en bilan prétransplantation et pré-implantation d’une assistance ventriculaire gauche
• Séances de coaching et de formation continue par l’équipe pluri-professionnelle des soins palliatifs
Résultats
Nombre de patients insuffisants cardiaques ayant bénéficiés d’une consultation de soins palliatifs
Ambulatoire Pré-transplantation / Pré LVAD
Nous travaillons à implémenter une culture centrée sur les priorités du patient tout au long de sa maladie.
Les patients sont satisfaits d’être précocement impliqués dans leur prise en charge palliative et l’équipe soignante apprécie de pouvoir échanger sur des cas difficiles et prendre les décisions en interdisciplinarité afin de maintenir le suivi jusqu’à la fin de vie.
La suite de notre intervention consistera à évaluer la satisfaction du patient et de ses proches avec leur prise en charge, l’impact sur la trajectoire de soin, le nombre d’hospitalisations et le rapport coût-bénéfice.
Journée Qualité 2022 B 42
0 5 12 3 6 8 0 10 20 2020 2021
2022 (en cours)
Gouvernance registres cliniques aux HUG
LUBBEKE Anne*, BRIOT Pascal**, OURAHMOUNE Aimad Eddine**, VON PINOCI Marina**
*Département de chirurgie **Service Qualité des soins
Situation de départ
En 2019 et 2020 deux enquêtes ont été menées :
o Rapport sur le clinical data management : organisation hétérogène en termes de % de temps dédié aux registres, de profil professionnel des data managers et de compétences
o Rapport sur l’état des lieux des registres cliniques (recensement) : les registres sont en croissance et leur répartition varie entre les différents départements
Résultats et livrables
En mai 2022 le Comité registres a été créé. Pourquoi ?
o Pour améliorerl’efficacité et l’efficiencedes registres cliniques nouveaux et existants
o Pour améliorer l'intégration des registres HUG dans le système d'information clinique des HUG et dans les registres multicentriques
Qu’est-ce que le comité fait?
o Aide à la création et gestion des registres o Priorise le développement des registres o Élabore un workflowpour la demande de création/participation à un registre clinique o Valide et met à jour les outils et les documents de la gouvernance
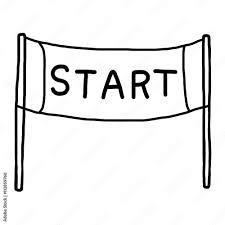
o Crée et maintient un programme de formation spécifique pour les cqDM des registres cliniques (hors recherche)
o Crée et soutient le collège des clinical quality data managers (CODM)
Recommandation d’amélioration
En octobre 2020 des recommandations pour améliorer la gouvernance des registres cliniques ont été acceptées par la Commission Qualité des Soins :
o Créer le rôle de “clinical quality data manager” et leur cahier des charges (niveaux junior et senior) et fonction SEF
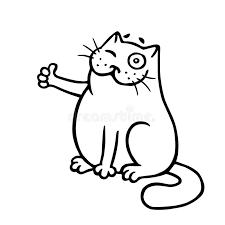
o Développer une formation interne spécifique
o Former un collège des data managers
o Créer une "charte d’utilisation des registres" définissant rôle et responsabilités du responsable de registre et des HUG
o Élaborer un workflow pour la demande de création/participation à un registre incluant une échelle de priorisation
o Gérer les registres via la plateforme institutionnelle des registres cliniques


o Intégrer les clinical quality data managers (cqDM) dans les équipes cliniques (CDI)


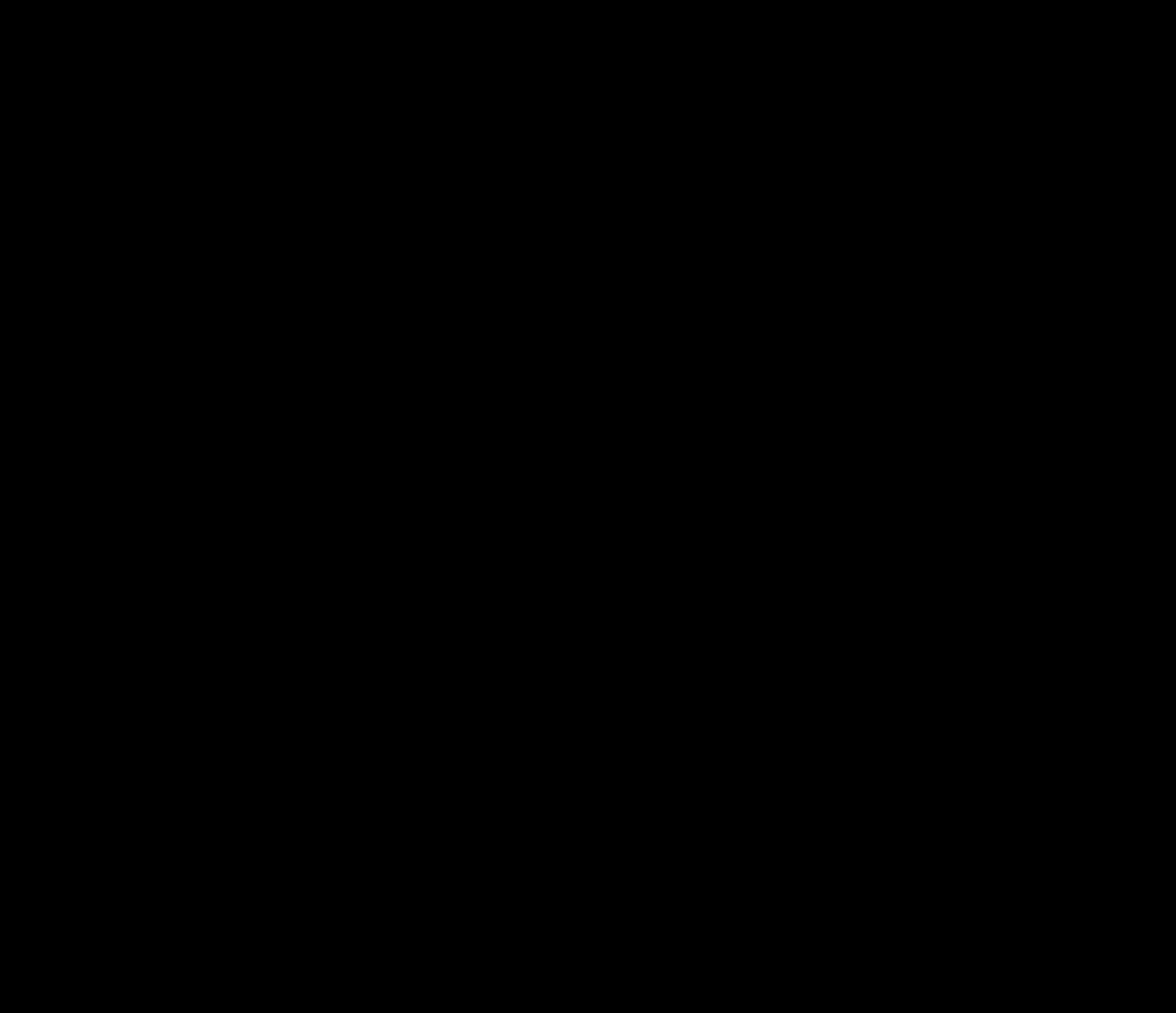

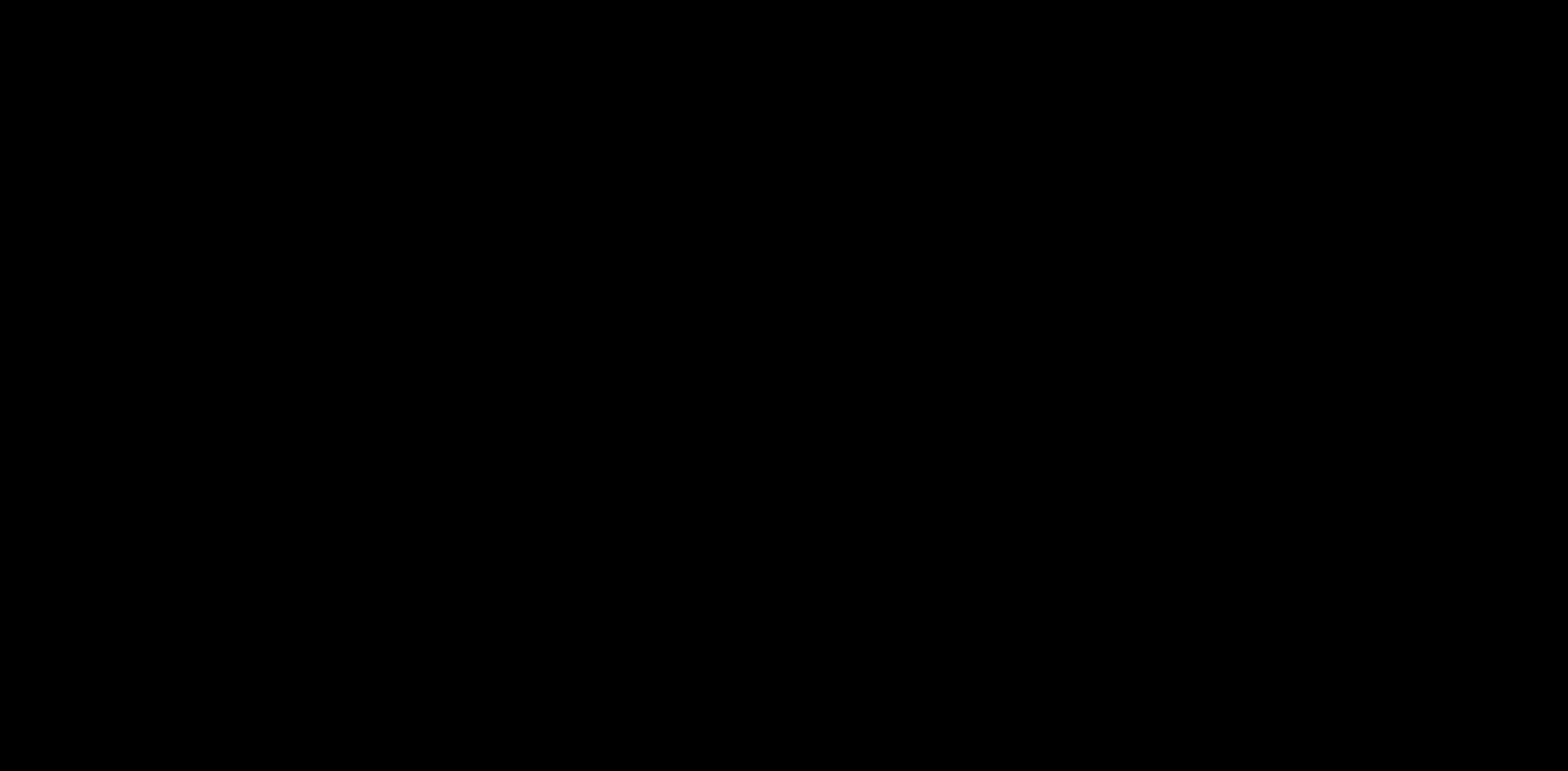

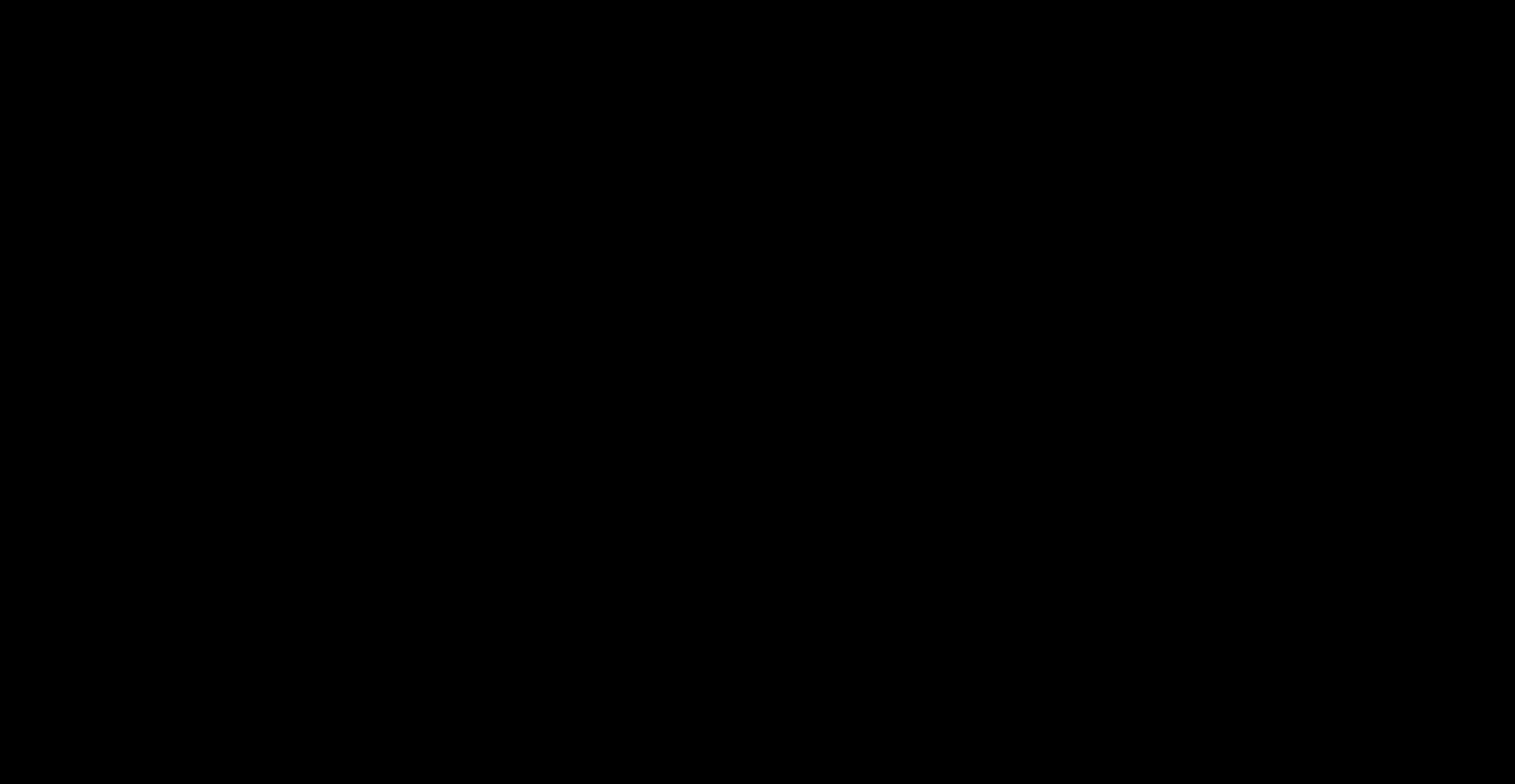
o Communique à la Commission qualité sécurité (CQS) les problématiques de gestion identifiées des registres cliniques o Fourni un rapport annuel à la CQS sur les registres cliniques o Communique les mises à jour et changements
Qu’est-ce qui a été produit jusqu’à présent ?
o Définition HUG des registres clinique o Profil des cqDM approuvé par les RH o Demande de participation et critères de pertinence o Plan de création /Plan de participation des registres cliniques o Page intranet
o Échelle de priorisation (en phase de validation) o Programme de formation pour les cqDM (disponible dans Espace carrière HUG) o Collège des cqDM o Liste des registres dans DPI register

Journée Qualité 2022 B18
Visitez notre page intranet http://www.intrahug.ch/groupes/registres-cliniques
La gestion du risque infectieux par les Indicateurs au bloc opératoire
CONTEXTE
L’infection du site opératoire représente entre 20 et 33% des infections associées aux soins
Les soins prodigués sont de nature plurimodale et interprofessionnelle C’est pourquoi, la prévention des infections est une démarche collective nécessitant une culture commune du risque infectieux et une maîtrise des recommandations.
OBJECTIF
Mesurer de façon continue et dynamique certains indicateurs significatifs reflétant la qualité de la prise en charge du risque infectieux au bloc opératoire afin de rendre leur amélioration pérenne et visible.
METHODE
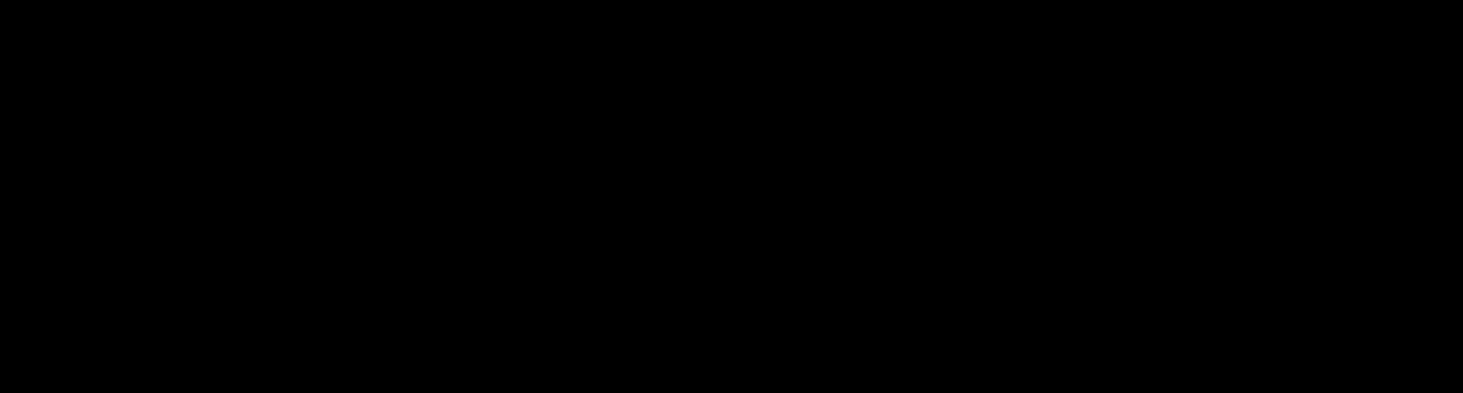

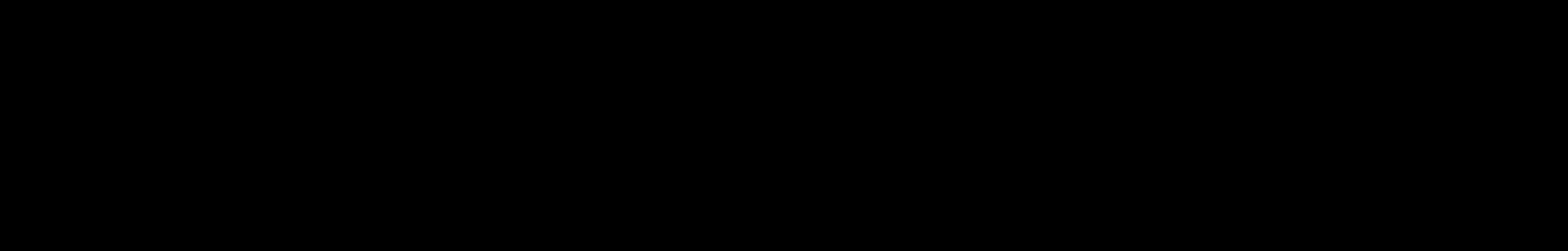

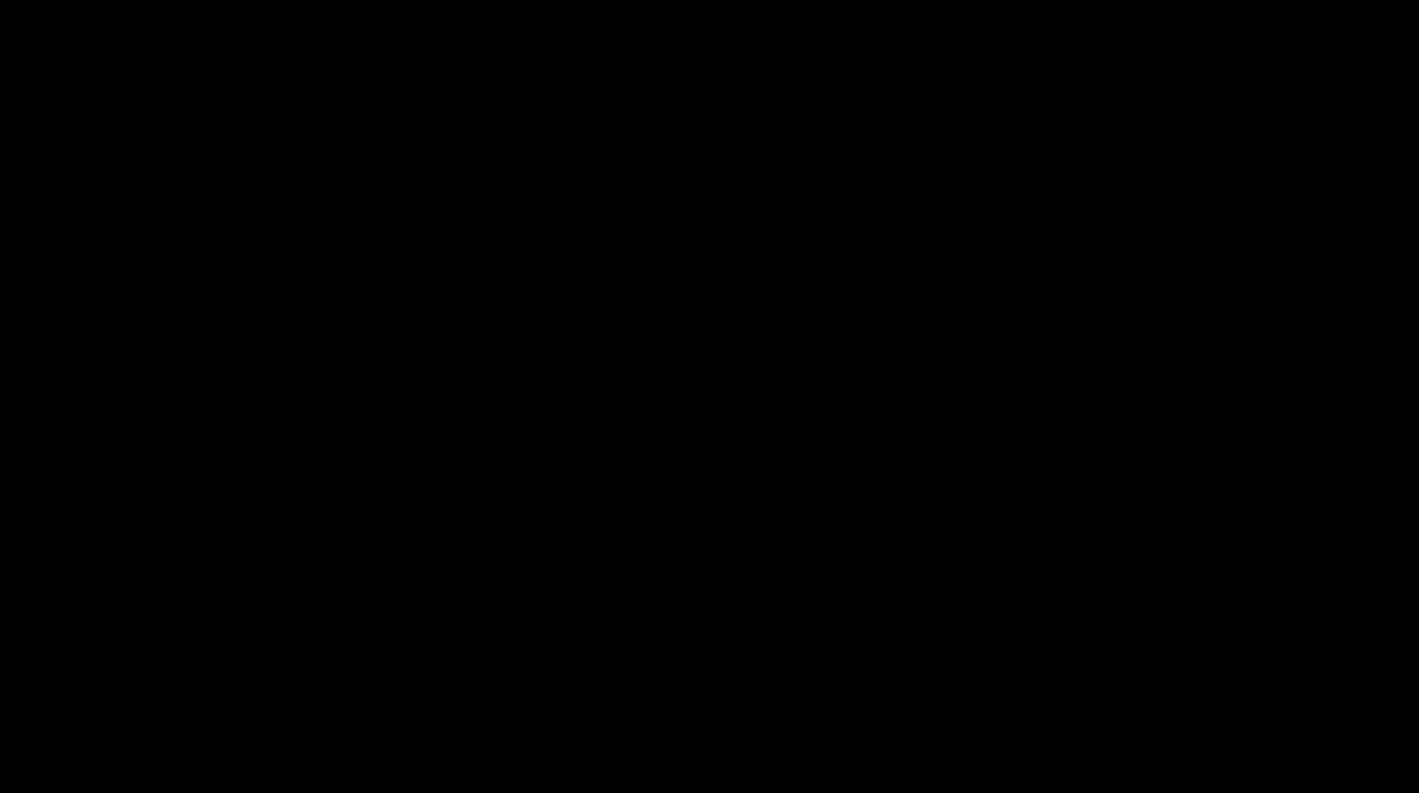


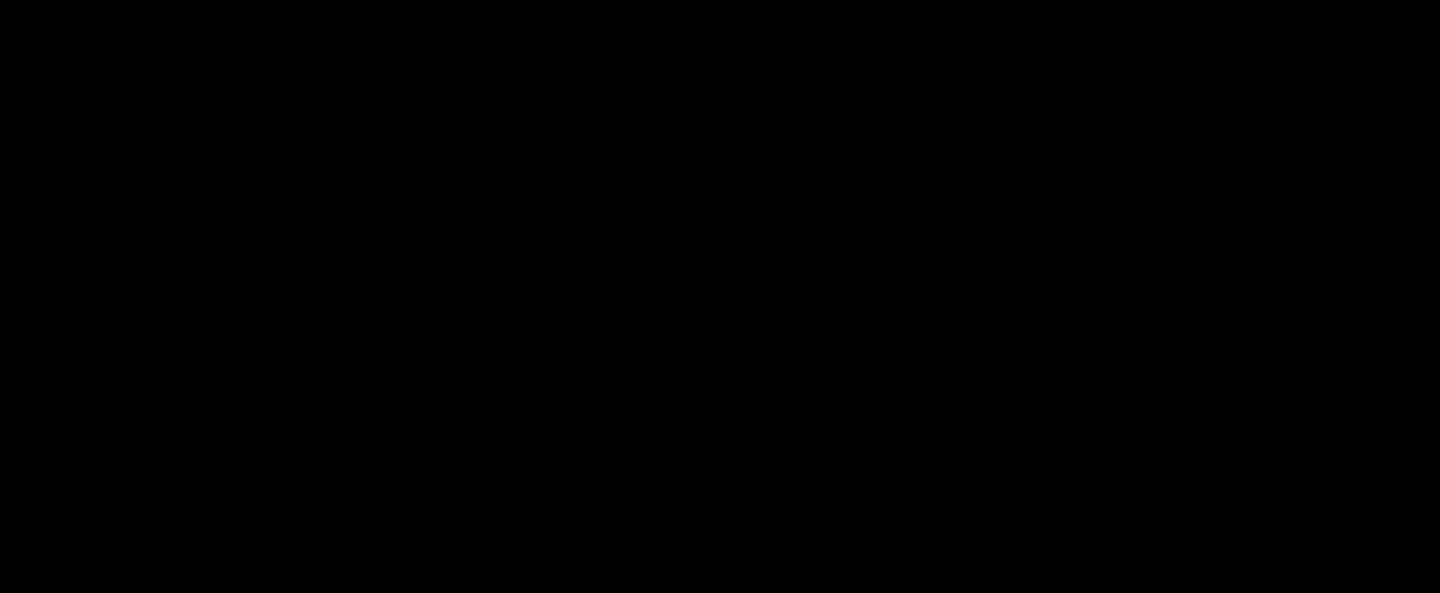
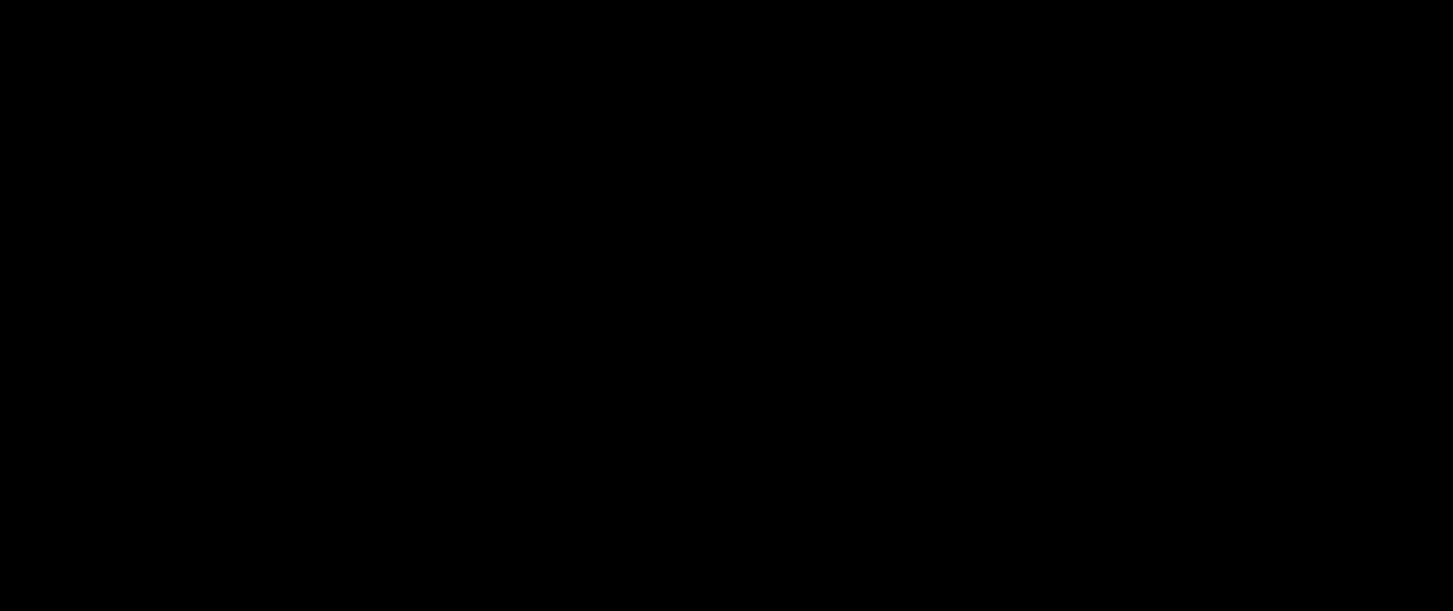
Rédaction du référentiel «zone patient» (ZP) adapté au contexte des soins en salle d’opération selon l’OMS
Sessions d’observance de l’HDM (Hygiène Des Mains, méthode OMS) avec feedback mensuel aux équipes
Contrôle de la qualité du bio nettoyage par ATPmétrie (6 écouvillonnages par bloc et par mois) enrichi de prélèvements microbiologiques sur gélose à visée pédagogique avec feedback mensuel aux équipes
Ex d’Indicateur «HDM» selon les 5 indications Taux d’observance 2022 (N=355 50% IC95 [ 44.9% 55.3%]
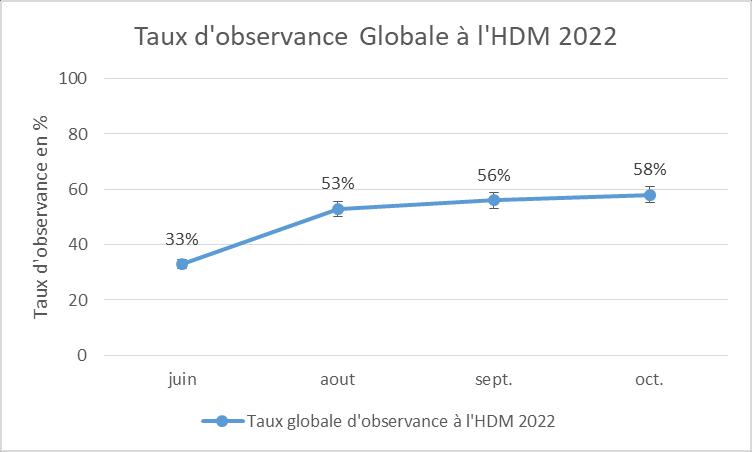
Ex d’indicateur «Maîtrise de l’environnement» (N= 192) Norme EN 17141
CONCLUSION et PERSPECTIVES

L’implémentation d’indicateurs en prévention des infections aux blocs opératoires permet de comprendre la Zone patient et d’impliquer les personnels et l’encadrement dans l’amélioration de leur pratique collective Ces indicateurs, démontrent une tendance à l’amélioration et ont vocation à évoluer vers des indicateurs et des analyses plus académiques Tout en ouvrant la porte au management par la qualité, leurs restitutions devront s’accompagner de projets d’amélioration et font partie intégrante de la culture de la sécurité du bloc opératoire de demain.

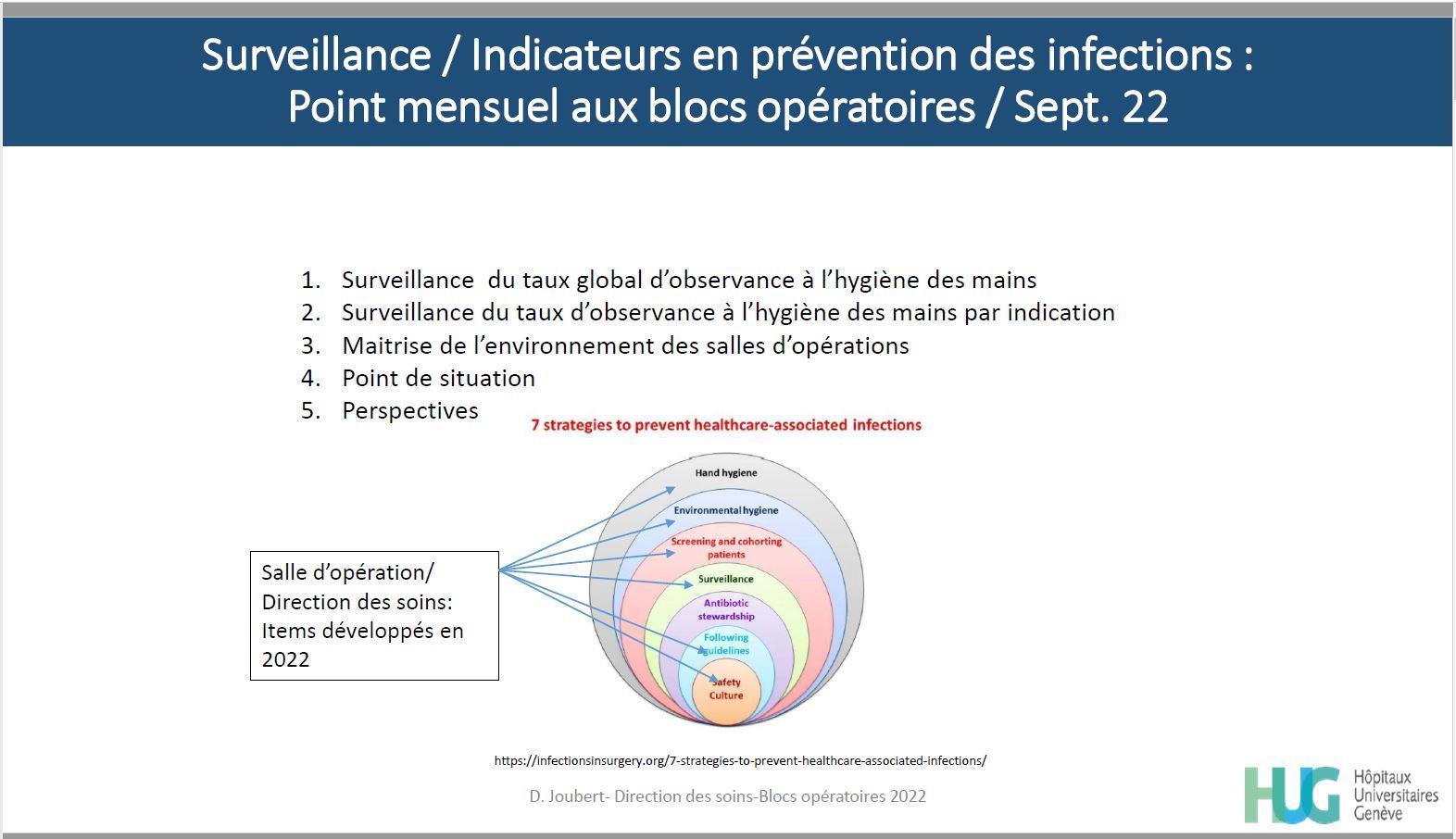


Journée
B32
Qualité 2022
BOUGHANMI, N., JESUS SILVA ,T., CALLONI, A., VECCHIA, E., DANIEL, E., PERNIN, E., BARBAU THORENS, E., SOLDEVILLA, J., PERREARD, M., JOUBERT, D. / DS Bloc pôle pratiques professionnelles
victimesd’arrêtscardio-respiratoires(ACR)extrahospitaliers

CONTEXTEETPROBLEME
1.~450ACR/animpliquantunappelau144,dont~250qui sontréanimés/an
2.Moyensderéponsemisenœuvreconsidérables: Ambulances,SMUR,hélicoptère,cardiologieinterventionnelle ±ECMO,soinsintensifs,réhabilitation…




3.Unesurvieàlasortiedel’hôpitalquiestbasse:moins de10%en2010avecunétatneurologiqueparfoismauvais TempsentrelecollapsusetledébutduMCEtroplong, qualitéduMCEinsuffisante
METHODE
Améliorerletauxde reconnaissancedesACRà réanimerounondurant l’appeld’urgencel’appel
Régulateurs
Améliorerdélaid’initiationduMCEettaux d’assistancetéléphoniqueauMCE
Initieretaméliorerl’engagement despremiersrépondants
OBJECTIFS
Améliorerletauxdesurvie
Reconnaitreplusde90%desACRàréanimeràl’appel
InitierMCEdansles120secondes
AssistertouslesACRàréanimer
Engagerles«first»pourtouslesACRàréanimer

RESULTATSintermédiaires
1.TauxdedétectiondesACR:2016:44.6%-2022:60.0%
ApplicationMomentum(mobilisation premiersrépondants)
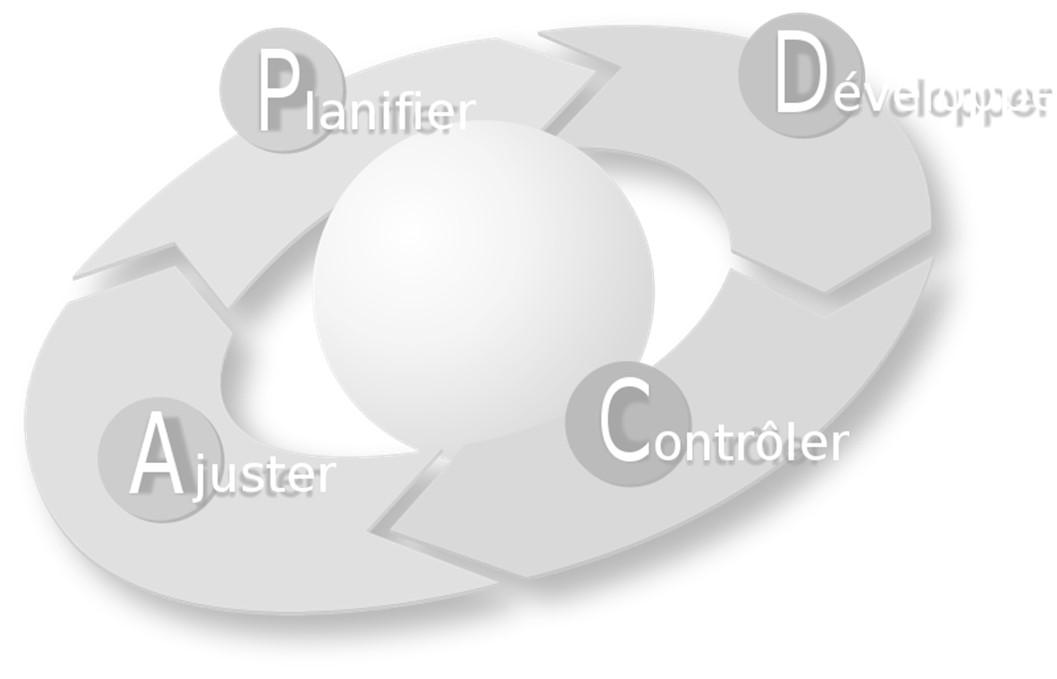
ApplicationUrgentime(vidéo)& SARA(vidéosdedémonstration)
R.LARRIBAU/F.GUICHE/D.BOUSSARD
Témoinet Patient
4.Retouràlacirculationspontanée:2016:42.9%-2022:55.1%
2.Tauxd’engagementdespremiersrépondants:2020:40.7%-2021:41.2%5.Tauxdesurvie:2010:6.9%-2016:13.6%(police)-2018:17%(réanimationguidéetel)
3.Tauxdeguidagedesmanœuvresréanimation:encours
CONCLUSION
AugmentationdutauxdereconnaissancedesACRàl’appel–dutauxderetouràlacirculationspontanée–dutaux desurvie
Orientationprogressivedepuisdenombreusesannéesversunerégulationhauteperformanceavecungainde tempsaubénéficedupatientetdoncd’uneaméliorationdesasurviesansséquelleneurologique

PERSPECTIVES
Atteindre80%detauxdereconnaissancedesACRàréanimeràl’appel
Atteindreunesurvieenbonétatneurologiqueenpermanence~30%
Atteindreundélaide8minutesentreledécrochédel’appeletl’arrivée d’unprofessionnelsurplace
JournéeQualité2022 B36 Développementd’unprocessusqualitéenrégulationpouraméliorerlasurviedespatients
Télécommunication
Processus Informatique-