Penser la santé N° 27 – JUILLET 2023
ENFANTS VICTIMES D’AGRESSIONS SEXUELLES
COMMENT SORTIR DU SILENCE ?
Près d’un enfant sur cinq est victime d’abus sexuels, selon le Conseil de l’Europe.
INNOVATION De la paralysie à la marche grâce à la pensée PANDÉMIES Les prévenir en surveillant les eaux usées TOC Une pathologie taboue et sous-estimée
Édité par le CHUV www.invivomagazine.com






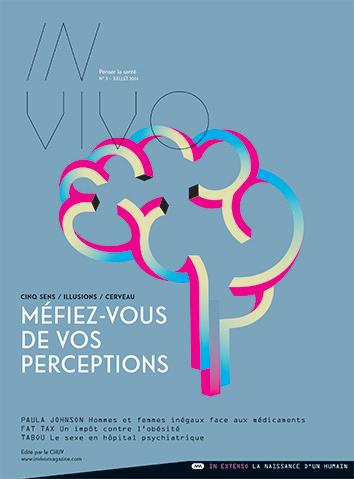



« Un magazine fantastique, dont les posters habillent toujours nos murs. »
Swissnex, Brésil










ABONNEZ-VOUS À IN VIVO


















« Vos infographies sont géniales, faciles à comprendre et adaptées au public auquel j’enseigne. »
Isabelle G., Lausanne








Recevez les 6 prochains numéros à votre domicile en vous inscrivant sur www.invivomagazine.com
















SOMMAIRE
IN SITU
7 / HEALTH VALLEY
Jeux vidéo et sclérose en plaques
11 / SUR LA ROUTE
Un vaccin contre le cancer
FOCUS
17 / DOSSIER
Enfants victimes d’agressions sexuelles
PAR ÉMILIE MATHYS
MENS SANA
30 / INTERVIEW
Dina Bader
« La question de la mutilation génitale féminine est extrêmement taboue »
PAR CAROLE EXTERMANN
34 / DÉCRYPTAGE
L’obsession de manger sainement
PAR CAROLE BERSET IN VIVO / N° 27 / JUILLET 2023

Dans le film « Festen » (1998), le cinéaste danois Thomas Vinterberg raconte l’explosion d’un secret de famille lié à l’inceste. Christian, l’un des personnages principaux de l’histoire, révèle la véritable cause du décès de sa sœur jumelle : elle s’est suicidée, car elle a été victime, comme lui, des abus sexuels de leur père tout au long de leur enfance. La construction du film balance entre l’identification au personnage de Christian et au père, parasitant la capacité de comprendre où se situe la vérité et qui croire. Finalement, le père reconnaît les faits.
Le magazine In Vivo édité par le CHUV est vendu au prix de CHF 5.- en librairie et distribué gratuitement sur les différents sites du CHUV.


MENS SANA
37 / PROSPECTION
Retrouver la marche
PAR STÉPHANIE DE ROGUIN
40 / TENDANCE
Le syndrome du cœur brisé
PAR YANN BERNARDINELLI
43 / COULISSES
Les méthodes sophistiquées de l’antidopage
PAR ANDRÉE-MARIE DUSSAULT
CORPORE SANO
48 / INNOVATION
Les eaux usées comme système d’alerte
PAR ERIK FREUDENREICH
52 / TENDANCE
Aux limites de la vie, les soins palliatifs
PAR AUDREY MAGAT
56 / TABOU
Le TOC ou la maladie du doute
PAR CAROLE EXTERMANN
58 / DÉCRYPTAGE
Les surprenants effets secondaires des médicaments
PAR STÉPHANIE DE ROGUIN
62 / EN IMAGES
En simulation d’urgence
PAR AUDREY MAGAT
CURSUS
71 / ÉCLAIRAGE
Augmentation des violences envers le personnel du CHUV
PAR SIMON FARAUD
SUIVEZ-NOUS SUR : TWITTER : INVIVO_CHUV FACEBOOK : CHUVLAUSANNE


ARNAUD DEMAISON
Responsable éditorial
CHATGPT N’A PAS ÉCRIT CE MESSAGE
L’intelligence artificielle (IA) s’immisce toujours plus dans des activités considérées jusqu’à présent comme exclusivement humaines. En début d’année, ChatGPT faisait la une des médias, à la fois loué et craint pour ses prouesses rédactionnelles. Le générateur d’images artificielles DeepFaceLab défraye régulièrement la chronique pour ses montages photographiques hyperréalistes, les « deep fake ». Le mois dernier, Google présentait Med-PaLM 2, un outil d’IA médicale de conseils et d’informations pour les patient·e·s, capable d’interpréter et de répondre à des questions médicales complexes. Plus la liste s’allonge, plus l’humain se demande quelle plus-value il peut encore apporter au milieu de ce foisonnement technologique.
En médecine, l’IA est déjà partie prenante de la recherche et contribue à réaliser des exploits, comme celui de remettre sur pieds des paraplégiques (p. 37) ou de freiner la progression d’une sclérose en plaques (p. 7). En intervenant dorénavant au niveau du diagnostic, la machine fait même un pas supplémentaire sur le terrain du·de la spécialiste. Peut-être est-elle déjà capable de différencier l’infarctus du myocarde du syndrome du cœur brisé (p. 40) ? Mais face à un enfant qui montre des signes anormaux d’hyperactivité, de stress ou d’anxiété, saurait-elle se substituer aux yeux et aux oreilles de l’expert·e ?
Un logiciel ne peut fonctionner qu’avec les informations qu’on lui donne. Les médecins, pour leur part, travaillent aussi avec toute la complexité, les non-dits et l’imprévisibilité des interactions humaines. Les agressions sexuelles sur mineur·e·s (p. 17) sont particulièrement difficiles à détecter à cause de l’omerta qui les entoure, alors qu’elles entraînent des conséquences à long terme potentiellement mortelles. Un silence des proches et des victimes elles-mêmes, soucieuses de préserver le lien – familial, par exemple, en cas d’inceste – au détriment de leur santé. Aussi puissante soit la nouvelle intelligence artificielle de Google, elle ne peut répondre qu’aux questions qu’on lui pose. Pour le reste, il y a votre médecin. /
Grâce à ses hôpitaux universitaires, ses centres de recherche et ses nombreuses start-up qui se spécialisent dans le domaine de la santé, la Suisse romande excelle en matière d’innovation médicale. Ce savoir-faire unique lui vaut aujourd’hui le surnom de « Health Valley ».
Grâce à ses hôpitaux universitaires, ses centres de recherche et ses nombreuses start-up qui se spécialisent dans le domaine de la santé, la Suisse romande excelle en matière d’innovation médicale. Ce savoir-faire unique lui vaut aujourd’hui le surnom de « Health Valley ».
IN SITU
HEALTH VALLEY
GENÈVE P. 11
Actualité de l’innovation médicale en Suisse romande.
Actualité de l’innovation médicale en Suisse romande.
L’histoire du vaccin contre le cancer développé par l’entreprise Amal Therapeutics.
LAUSANNE P. 7
De nouvelles pistes sont explorées au CHUV pour lutter contre les symptômes liés à la sclérose en plaques.
NEUCHÂTEL P. 10
Loïc Posta gagne un prix à Taïwan pour son innovation en géothermie.
FRIBOURG P. 6
La start-up Neuria utilise les jeux vidéo pour entraîner les capacités cognitives.
START-UP
UNE MOLÉCULE
EN OR
La start-up genevoise Stalicla, spécialisée dans la médecine de précision pour soigner les troubles du développement neurologique et des troubles neuropsychiatriques, a racheté à Novartis la molécule Mavoglurant pour 270 millions de francs.
Le contrat conclu avec le géant bâlois devrait permettre à la start-up genevoise de développer de nouvelles thérapies contre les troubles neurodéveloppementaux.
CHIRURGIE VIRTUELLE
Développer des simulateurs encore plus précis pour la formation des jeunes chirurgien·ne·s, c’est l’objectif de Proficiency : un consortium réunissant des partenaires comme l’Hôpital cantonal de Saint-Gall, le CHUV et la biotech genevoise ORamaVR Le projet a bénéficié d’une enveloppe de 12 millions de francs de la part d’Innosuisse et développe notamment des solutions basées sur la réalité augmentée.
ENTRAÎNEMENT COGNITIF
Neuria, une start-up active dans le domaine des neurosciences, de la psychologie et l’informatique a remporté le prix de l’innovation 2022/23 pour les start-up du canton de Fribourg. L’entreprise propose des systèmes d’entraînements cognitifs sous forme de jeux sur smartphone.

« La santé mentale est trop importante pour qu’on y pense avec une calculette. »
STEPHAN WENGER
COPRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES PSYCHOLOGUES, À PROPOS DU REFUS DE SANTÉSUISSE DE REMBOURSER LES THÉRAPIES PRODIGUÉES PAR DES PSYCHOLOGUES EN FORMATION, DANS « CQFD » DE LA RTS DU 14 MARS 2023.
C’est le nombre de personnes en attente d’une transplantation d’organe à l’échelle nationale au 31 décembre 2022. La même année, seules 570 transplantations avaient eu lieu et 83 personnes sur liste d’attente sont décédées. La situation a été qualifiée de « critique » par Franz Immer, le directeur de Swisstransplant, alors que la nouvelle loi sur le consentement présumé n’entre en vigueur qu’en 2025.
Un pacemaker pour lutter contre les troubles érectiles
DISPOSITIF Un pacemaker dans le basventre, c’est l’invention de la start-up lausannoise Comphya. Le dispositif permet d’activer le nerf responsable de l’érection, ce qui pourrait contribuer à améliorer la santé sexuelle de près de 66 millions d’hommes rien qu’aux États-Unis et en Europe. Le spin-off de l’EPFL a réussi à lever 5,1 millions de francs dans le cadre de ce projet et prévoit d’obtenir la validation pour le marché américain d’ici deux ans. Les autorités sanitaires australiennes ont d’ores et déjà donné leur aval aux essais cliniques.
UNE
PUCE
CONTRE LES MALADIES
NEUROLOGIQUES
Développé par deux chercheur·euse·s de l’EPFL, la neuro-puce NeuralTree analyse les ondes neuronales pour détecter les signes avant-coureurs d’un symptôme lié à des troubles neurologiques, tels que les crises d’épilepsie ou de Parkinson, et peut envoyer une impulsion électrique pour les bloquer. Entraîné sur des données émanant de personnes souffrant de Parkinson ou d’épilepsie et disposant d’une meilleure résolution que les modèles de puce neuronale existants, NeuralTree permet des analyses plus précises et la détection d’un plus grand nombre de troubles et de symptômes tout en consommant moins d’énergie.
Le jeu vidéo contre la sclérose en plaques
Des chercheurs du CHUV se penchent sur le potentiel du jeu vidéo pour lutter contre les troubles cognitifs liés à la sclérose en plaques. Les spécialistes développent un nouvel outil thérapeutique.
INNOVATION Lors de la première phase de développement de la sclérose en plaques –appelée « phase inflammatoire » – certain·e·s patient·e·s sont parfaitement à même de marcher et de se tenir debout mais peuvent ressentir une fatigue récurrente ou des troubles de la concentration. Pour lutter contre ces déficiences cognitives, le professeur Arseny Sokolov, du Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation au CHUV, mise sur une technologie de jeu vidéo, d’abord développée par une équipe académique californienne, dans l’optique d’atténuer la perte de capacités cognitives liée au vieillissement du cerveau.
La méthode combine exercices cognitifs et physiques. La personne fait face à un écran géant sur lequel figurent des cibles à atteindre, parfois au prix d’un effort physique. Le jeu se déroule sur plusieurs niveaux dans un univers inspiré du monde maya riche et réaliste. Le dispositif est équipé d’une caméra qui suit les mouvements de la personne pour déterminer si elle atteint la cible. « Nous cherchons à comprendre dans quelle mesure la stimulation de l’activité cérébrale par le jeu vidéo permet d’atténuer les troubles cognitifs chez les personnes souffrant de sclérose en plaques », résume Arseny Sokolov. Le jeu vidéo permet aussi d’entretenir la motivation en s’adaptant en temps réel aux performances de la personne qui l’utilise.
Maladie auto-immune, la sclérose en plaques se produit lorsque les cellules de défense immunitaire s’attaquent aux neurones. Les premiers symptômes, qui peuvent aller jusqu’à des troubles de la marche, apparaissent dans la plupart des cas chez des individus entre 20 et 40 ans.
Les progrès de la médecine permettent aujourd’hui de déceler la sclérose en plaques à un stade plus précoce qu’auparavant.
TEXTE : JULIEN CREVOISIER


« Grâce à l’IRM, on peut établir un diagnostic dès la première apparition des symptômes », explique Renaud Du Pasquier, chef du Service de neurologie du CHUV. « Poser le diagnostic le plus tôt possible est un facteur décisif. » La sclérose en plaques recèle malheureusement encore bien des mystères : ses causes n’ont toujours pas été clairement élucidées et aucun traitement ne permet d’en guérir. Le seul moyen pour améliorer la qualité de vie des patient·e·s reste donc la lutte contre les symptômes.
Ce traitement comprend le plus souvent des médicaments qui permettent de retarder la progression de la maladie et des symptômes les plus handicapants. Pour les patient·e·s qui disposent encore des capacités physiques nécessaires, le recours au jeu vidéo constituerait donc un outil thérapeutique supplémentaire. Il permettrait notamment la réhabilitation de fonctions cognitives essentielles au quotidien.
« La neuroréhabilitation des patients atteints de troubles cognitifs liés à la sclérose en plaques est un domaine de recherche clinique et scientifique relativement peu développé », constate Arseny Sokolov. « Son potentiel est pourtant bien réel : renforcement de la concentration, augmentation de la vitesse de traitement de l’information, amélioration de la mémoire immédiate et baisse de la fatigue. »
EN HAUT : ARSENY SOKOLOV, RESPONSABLE DE L’UNITÉ DE NEUROPSYCHOLOGIE AU CHUV
EN BAS : REPRÉSENTATION EN 3D DE CELLULES NERVEUSES.
Après une première phase conduite sur 12 patient·e·s au CHUV et des résultats encourageants, la deuxième phase du projet pilote a été lancée en février 2023 en collaboration avec l’Hôpital de l’Île à Berne, la clinique de réhabilitation de Valens (SG) et l’Université de Gênes, en Italie. À terme, l’étude portera sur 192 patients. Le projet a reçu une enveloppe de 2 millions de francs du Fonds national suisse (FNS). /

3 QUESTIONS À

ROMAIN BARBEN ET EDONA BUGACKI
LE DUO SE MOBILISE AVEC L’ANTENNE LAUSANNOISE DE L’ASSOCIATION MARROW POUR SENSIBILISER LE PUBLIC AU DON DE CELLULES SOUCHES.
1 EN SUISSE, SEULE UNE PERSONNE SUR QUATRE PARVIENT À TROUVER
UN·E DONNEUR·EUSE DE CELLULES SOUCHES SANGUINES COMPATIBLES. LE PUBLIC MANQUE-T-IL D’INFORMATIONS À CE SUJET ?
Les donneurs sont rares car les probabilités de compatibilité sont très faibles. Même au sein du cercle familial, seuls 25% des demandeurs parviennent à trouver un donneur compatible. On se trouve donc dans une situation où l’écrasante majorité des gens qui souhaitent faire un don et qui sont enregistrées ne seront probablement jamais appelées, alors que d’autres potentiellement compatibles ne figurent pas dans le registre. Par ailleurs, certaines personnes peuvent s’avérer réticentes face à la perspective d’une intervention assez lourde. Beaucoup ignorent en effet que 80% des dons s’effectuent aujourd’hui par prélèvement sanguin, et plus par ablation de moelle osseuse.
2
POURQUOI LES PROFILS LES PLUS RECHERCHÉS POUR LE DON SONT-ILS
LES HOMMES JEUNES ?
Il y a deux raisons principales à cela : d’abord, les gens de moins de 40 ans sont davantage recherchés
pour les dons de cellules souches sanguines parce qu’ils sont globalement en meilleure santé. Ensuite, les hommes sont plus recherchés que les femmes car, lors de l’accouchement, ces dernières développent souvent des anticorps qui réduisent considérablement la compatibilité de leur sang avec celui des demandeurs potentiels.
3
Une
étude tente d’évaluer l’incidence de la pollution aux dioxines
POPULATION Après la découverte en 2021 de la présence de dioxines dans les sols lausannois, le conseiller d’État vaudois Vassilis Venizelos, chargé de l’environnement, s’était voulu rassurant : les concentrations de dioxines sont trop faibles pour représenter un quelconque risque pour la population. Toutefois, le Canton recommande, entre autres, de prévenir l’ingestion de terre
QUELS SONT LES ÉVÉNEMENTS PHARES DE L’ASSOCIATION MARROW CETTE ANNÉE ?
Nous avons organisé une course contre la leucémie au stade Pierre de Coubertin, en avril dernier, notamment sponsorisée par les Services industriels de Lausanne et le canton de Vaud, ainsi qu’un concert de bienfaisance au casino de Montbenon qui nous ont permis de récolter des fonds pour CRS Transfusion. Cet été, nous tiendrons un stand au Paléo Festival qui nous permettra de promouvoir le don de cellules souches. Il est capital d’informer le public, car, en cas de maladie sanguine grave, comme la leucémie, le don de cellules souches du sang peut s’avérer vital. /
notamment pour les enfants et de bien laver les légumes cultivés sur place. La consommation d’œufs et de poulets élevés à même les sols contaminés est également à proscrire. Dans la foulée, l’O∞ce du médecin cantonal a commandé une étude pour déterminer le taux de dioxines dans le sang de la population lausannoise comparé au reste du canton. Les résultats sont attendus mi-2024. Les dioxines sont des substances toxiques qui, à hautes doses, peuvent entre autres provoquer des cancers, des problèmes de reproduction et des défaillances du système immunitaire.
TRANSPLANTATION CARDIAQUE
La première
greffe
du cœur au CHUV a été
effectuée en 1987. Aujourd’hui, on fête sa 400e transplantation, soit une opération consistant à remplacer un cœur malade par un cœur sain, prélevé sur une personne en mort cérébrale.
AVANT
Avant de procéder à une transplantation cardiaque, plusieurs options thérapeutiques, s’offrent aux patient·e·s : d’abord, le suivi médicamenteux et dans un second temps, la pose d’un dispositif d’assistance ventriculaire qui permet de conserver l’aptitude du cœur à pomper. Lorsque celui-ci n’est plus capable d’effectuer correctement le travail de pompe malgré les solutions temporaires de préservation de l’organe, la transplantation cardiaque est indiquée. Actuellement, au CHUV, 18 personnes figurent sur la liste d’attente. Pour qu’un cœur soit compatible entre donneur et receveur, il est indispensable de respecter la compatibilité des groupes sanguins et de vérifier l’absence d’anticorps chez le receveur qui pourraient interagir avec le cœur du donneur. Une compatibilité en termes de sexe et de corpulence est également souhaitable.
PENDANT
Lorsqu’une personne est déclarée en état de mort cérébrale, son cœur est arrêté, prélevé et placé dans la glace pour être transporté et transplanté. La greffe est coordonnée entre le centre hospitalier qui gère le don et le centre qui le reçoit. L’organisation Swisstransplant organise ce déplacement. Pendant une telle intervention, chaque seconde compte. La durée de conservation du cœur à greffer est d’environ quatre heures hors du corps.
APRÈS
Lorsqu’il n’y a pas de complications, la durée de l’hospitalisation est d’environ trois semaines. Un suivi pluridisciplinaire est alors mis en place pour la revalidation des patient·e·s et pour prévenir les risques de rejet. La durée de vie d’un cœur greffé est de douze à quatorze ans. Dans certains cas rares, des personnes subiront plusieurs transplantations au cours de leur vie. La famille de la personne qui a donné son organe a le droit, en tout temps, de demander des nouvelles.

La banque des excréments
MICROBIOTE Collecter des selles venues des quatre coins du monde pour les stocker en Suisse, c’est le projet de Microbiota Vault, auquel participe notamment l’Université de Lausanne. L’objectif est de conserver des échantillons du microbiote, cette flore intestinale composée de milliers de milliards de micro-organismes. Le microbiote est en phase d’appauvrissement depuis quelques années dans les pays industrialisés. Les spécialistes estiment que cette perte de microbiodiversité pourrait avoir un lien avec la montée en flèche de certaines maladies, comme l’asthme ou le diabète, dans nos sociétés. Ce projet de conservation promet donc de constituer une aide précieuse pour la recherche ces prochaines années.

3 QUESTIONS À
CHANTAL CAVIN
L’ANCIENNE PARANAGEUSE BERNOISE, MÉDAILLE D’OR EN 2006, A TESTÉ LE BONNET DE BAIN EYECAP IMAGINÉ PAR QUATRE ÉTUDIANTS DE LA HEG GENÈVE.
1 COMMENT PRÉVIENT-ON LES RISQUES DE COLLISION LORS DE LA NATATION EN BASSIN ?
En paranatation, les nageurs malvoyants ou non voyants sont guidés par la présence d’un « tapper », sorte de ballon suspendu au-dessus de l’eau à chaque extrémité du bassin. Lorsque l’athlète parvient à la fin du bassin, sa tête ou son épaule viendra toucher le « tapper », lui signalant qu’il faut faire demi-tour ou s’arrêter.
2 COMMENT FONCTIONNE LE BONNET DE BAIN CONNECTÉ EYECAP ?
Dès que l’on s’approche trop du bord de la piscine, le bonnet Eyecap émet une vibration. Ce système peut être utilisé de manière autonome par chaque nageur et remplace le « tapper » à l’entraînement. Lors des compétitions, le « tapper » est cependant toujours obligatoire et ne peut pas encore être remplacé par les bonnets Eyecap.
3 VOUS SENTEZ-VOUS PLUS À L’AISE AVEC CETTE TECHNOLOGIE ?
Eyecap permet aux personnes atteintes de handicap visuel de s’entraîner de manière autonome et sécurisée. C’est un grand pas en avant vers l’autonomisation des athlètes actifs dans la paranatation, mais aussi pour les personnes malvoyantes ou non voyantes qui pratiquent la natation dans le cadre de leurs loisirs. /
Un jeune Neuchâtelois
remporte un prix scientifique à Taïwan
CONCOURS À 18 ans, Loïc Posta a représenté la Suisse à la Foire scientifique internationale de Taïwan (TISF) qui s’est tenue du 5 au 10 février dernier et qui cherche à promouvoir les inventions des moins de 20 ans. Loïc Posta a présenté son système de mesures de la température par fibre optique qui est utilisé dans le cadre de forages géothermiques. Le dispositif a notamment déjà été mis à l’épreuve lors d’une évaluation géologique d’un projet de forage aquifère à Concise (VD). À Taïwan, son invention lui a valu le premier prix dans la catégorie « sciences de la terre et de l’environnement ».
Recherche biomédicale, la relève
SOLUTION La fondation lausannoise Leenaards a décerné son prix pour la recherche biomédicale translationnelle 2023 à trois projets menés par des équipes lémaniques : le premier entend découvrir comment traiter les infections bactériennes réfractaires aux antibiotiques grâce à du sucre, le deuxième ambitionne de lutter contre les symptômes de la schizophrénie en stimulant le cervelet, et le troisième se penche sur les causes des maladies cardiovasculaires chez les personnes qui ne sont pas considérées comme étant à risque. Le prix Leenaards s’élève à 1,5 million de francs répartis entre les trois lauréats.
Forte consommation d’e-cigarettes chez les jeunes
FUMÉE Selon une étude de Promotion santé Valais et Unisanté menée auprès de quelque 1400 jeunes de 14 à 25 ans en août 2022, 12% consomment des e-cigarettes jetables (ou « puffs ») de façon fréquente, c’est-à-dire au moins une fois durant plus de 10 jours au cours du dernier mois. Par ailleurs, 59% des personnes interrogées en auraient consommé au moins une fois. Unisanté et Promotion santé Valais estiment que l’accès à ces produits, généralement consommés dans un cadre festif ou à domicile, devrait être davantage contrôlé. Le risque de dépendance est en effet élevé, d’autant qu’un jeune sur cinq indique avoir consommé des « puffs » dont la teneur en nicotine dépassait la norme légale (20 mg/ml).
AMAL THERAPEUTICS
GENÈVE SUR LA ROUTE À la rencontre des acteurs et actrices de la Health Valley. Nouvelle étape : Genève.
Un vaccin contre le cancer
La biotech Amal Therapeutics développe un vaccin thérapeutique qui agit sur les cellules tumorales.
TEXTE : SAMUEL GOLLY
Les vaccins sont bien connus comme moyen de prévention, mais ils peuvent aussi être utilisés pour la guérison. L’objectif de ces vaccins thérapeutiques, proches de l’immunothérapie, est de stimuler le système immunitaire pour lui apprendre à reconnaître et à éliminer les cellules responsables de la maladie, ici, les cellules tumorales.
L’innovation de la start-up genevoise Amal Therapeutics : une plateforme vaccinale brevetée qui a permis à la fondatrice Madiha Derouazi et à l’immunologue Élodie Belnoue de recevoir le Prix de l’inventeur européen en 2022. Par « plateforme vaccinale », on désigne une stratégie vaccinale adaptable à plusieurs maladies, en l’occurrence différents types de cancer. Baptisée Kisima, cette plateforme se présente comme une protéine composée de trois éléments : un peptide permettant au vaccin de pénétrer les cellules responsables du déclenchement des réponses immunitaires, un autre qui joue le rôle
d’adjuvant, et enfin un module portant plusieurs antigènes similaires à ceux des cellules tumorales à cibler.
La plateforme permet donc de développer des vaccins thérapeutiques puissants et polyvalents contre le cancer, une nouveauté. Kisima se distingue des générations précédentes par la stimulation de deux types de lymphocytes, actifs dans les réactions immunitaires. « Les lymphocytes dits ‹ aidants › soutiennent les lymphocytes ‹ tueurs › dans la reconnaissance et l’élimination des cellules tumorales, explique l’immunologue Élodie Belnoue. Les lymphocytes ‹ aidants › jouent aussi un rôle important pour la mémoire immunitaire. » Spin-off de l’Université de Genève et des HUG, Amal Therapeutics, fondée en 2012, a été rachetée en 2019 par le groupe allemand Boehringer Ingelheim. La start-up conduit actuellement des essais cliniques auprès de personnes atteintes de cancers colorectaux. /
« DOLLY » OU LE RAPPEL AU MONDE SCIENTIFIQUE DE SES RESPONSABILITÉS
TEXTE :
BENO Î T DUBUIS
Février 1997, il y a un peu plus de vingt-cinq ans, une équipe scientifique dirigée par le professeur Ian Wilmut du Roslin Institute présentait au monde Dolly, la brebis clonée. Un exploit que de nombreux scientifiques croyaient impossible et qui agita le monde entier.
Pourtant, Dolly n’était pas la première. En réalité, les premiers clonages réussis, de grenouilles et de poissons, ont été réalisés dans les années 1950 et 1960. Et Dolly n’était même pas le premier mammifère cloné. Alors pourquoi la naissance de Dolly a-t-elle suscité un tel engouement ?
Comme nous le rappelle le site de l’institut Roslin, elle fut le premier mammifère cloné à partir d’une cellule adulte. Le processus, appelé transfert nucléaire de cellules somatiques, consiste à retirer le matériel génétique d’un ovule, puis à le remplacer par le matériel génétique d’un autre animal.
Dolly a été clonée en utilisant le matériel génétique d’une cellule de la glande mammaire d’une brebis de la race Finn Dorset âgée de 6 ans, implanté dans un ovule d’une brebis Scottish Blackface.
Lorsqu’elle est née le 5 juillet 1996, Dolly avait le visage blanc d’une brebis Finn Dorset, et non le visage noir de sa mère porteuse, ce qui prouve qu’elle était bien un clone. Comme l’ADN de Dolly provenait d’une cellule de la glande mammaire, l’équipe de recherche lui a donné le nom de Dolly Parton.
Parmi les implications largement débattues, figuraient d’abord le fait qu’il serait possible de prendre une culture cellulaire, par exemple d’une vache, d’un poulet ou d’un mouton, et de produire des dizaines, des centaines, des milliers, voire des millions de copies précises, mais aussi, surtout, la perspective effrayante qu’on pourrait utiliser des cellules humaines pour créer une armée de clones.

inartis.ch republic-of-innovation.ch healthvalley.ch
Les débats pour et contre le clonage se poursuivent aujourd’hui encore, même si le type de clonage utilisé pour créer Dolly a pratiquement disparu. Il s’est avéré que le transfert nucléaire de cellules somatiques avait un faible taux de réussite. Dolly est le seul animal né de 277 embryons clonés, et des années de recherche n’ont pas permis d’améliorer le pourcentage de clones viables. Entre-temps, une meilleure méthode a été mise au point : les cellules souches pluripotentes induites, ou iPSC.
Dolly allait mourir six ans plus tard. C’est environ la moitié de la durée de vie habituelle d’un mouton. Lorsque Dolly a eu 1 an, l’équipe de l’Institut a analysé son ADN et découvert que ses télomères, les « capuchons » situés à l’extrémité des chromosomes, étaient plus courts qu’ils n’auraient dû l’être pour un mouton de cet âge. Lorsque Dolly est morte, il a été largement admis que ses télomères courts étaient le résultat du clonage et au moins partiellement responsables de sa mort précoce.
Cependant, un rapport du Roslin Institute semble indiquer que « les examens de santé approfondis auxquels Dolly a été soumise à l’époque n’ont révélé aucune affection pouvant être directement liée à un vieillissement prématuré ou accéléré ». Et les études futures sur les animaux clonés ont révélé des télomères plus courts, plus longs et normaux. Il est donc di∞cile de prouver que la mort précoce de Dolly était directement liée au clonage.
Nul doute que Dolly a marqué les esprits. Elle restera le témoignage d’une science qui progresse, mais également le rappel au monde scientifique de ses responsabilités. /
POST-SCRIPTUM
LA SUITE DES ARTICLES D’ IN VIVO
IN VITRO
Infertilité, quand la science crée la vie
Dans le monde, une personne sur six est touchée par l’infertilité, a annoncé l’OMS en avril dernier. L’organisation y voit un problème de santé majeur puisque l’incapacité à procréer engendre des problèmes d’anxiété, de la dépression et augmente le risque de violences conjugales. En Suisse, ce phénomène se lit aussi par l’augmentation du recours à la fécondation in vitro. En 2021, 6900 personnes ont utilisé à cette méthode pour concevoir un enfant, ce qui représente 11% de plus que l’année précédente, d’après l’O∞ce fédéral de la statistique. /
VIH
Prévenir le sida comme on le traite
Pour les femmes atteintes du sida, le risque de transmettre la maladie en allaitant son enfant est extrêmement faible, confirme une étude menée dans les hôpitaux suisses. Si la mère est suivie et traitée, elle peut donc allaiter sans exposer son bébé à la maladie. Un changement de pratique, puisque, jusqu’à présent, bien que le risque de contamination du virus durant la grossesse était écarté, l’allaitement était déconseillé. /

CERVEAU
les défis du quatrième âge Écouter de la musique ou en pratiquer freine le déclin du cerveau. C’est la conclusion d’une étude menée auprès de 132 seniors, entre 62 et 78 ans, par l’Unige, la Haute école spécialisée de Suisse occidentale et l’EPFL. Les personnes participantes ont, pour une partie d’entre elles, suivi des cours de piano de façon hebdomadaire, tandis qu’une autre partie a reçu des cours portés sur la reconnaissance des instruments de musique et l’analyse de la structure d’œuvres. Grâce à la neuro-imagerie, les spécialistes ont pu observer une augmentation de la matière grise dans quatre régions du cerveau liées à la cognition. / IV n° 17 p. 19
Hyperlongévité :
SUPERBACTÉRIES
Les bactéries, nos meilleures ennemies Un microscope optique et une caméra de téléphone portable, c’est tout ce que nécessite la nouvelle méthode d’antibiogramme développée par des scientifiques de l’EPFL et de la Vrije Universiteit de Bruxelles. Le dispositif permet de mesurer la résistance bactérienne pour pouvoir administrer un antibiotique adapté. Un enjeu capital puisque la résistance aux antibiotiques est une cause de décès majeure. En 2019, on comptait par exemple 1,27 million de décès dans le monde pour cette raison. /

DES
MICROPLASTIQUES JUSQUE
DANS LE CORPS HUMAIN
À Paris, des négociations internationales se sont tenues en mai dernier dans le but d’établir un traité contre la pollution plastique au niveau mondial. En augmentation constante, la production de plastique a doublé ces vingt dernières années. Et en Suisse, ce sont plus de 14’000 tonnes de plastique qui sont rejetées dans les sols chaque année.
Particulièrement préoccupants, les microplastiques (paillettes d’une taille inférieure à 5 mm provenant de la fragmentation d’emballages ou d’objets en plastique) se retrouvent partout, y compris dans le corps humain. Chaque individu en absorbe environ 5 grammes par semaine, soit l’équivalent d’une carte de crédit, selon une étude australienne de 2019. Une absorption dont les conséquences sont encore peu explorées. Cependant, les scientifiques redoutent les potentiels effets inflammatoires de ces microplastiques qui se retrouvent dans les tissus pulmonaires, les bronches ou même le sang.
Ci-contre, des militant·e·s écologistes prélèvent des échantillons d’eau dans la région d’Aceh, en Indonésie, où de nombreuses rivières ont été contaminées par des microplastiques qui se détachent des vêtements pendant la lessive.
PHOTO : HOTLI SIMANJUNTAK/EPA/KEYSTONE


ENFANTS VICTIMES D’AGRE SSIONS SEXUELLES
COMMENT SORTIR DU SILENCE ?
ÉMILIE MATHYS
JEANNE MARTEL
Aucune classe sociale, aucun milieu n’est épargné. Les violences sexuelles qui frappent les personnes mineures sont omniprésentes. On estime qu’un enfant sur cinq subit une agression de ce type. L’inceste, quant à lui, concernerait un enfant sur dix. Des chiffres effrayants et pourtant sous-estimés, selon les spécialistes. Présentation d'un enjeu de santé publique de grande ampleur.
Cousine, petite-fille, meilleur ami, voisine, collègue… Nous côtoyons, pour la plupart d’entre nous à notre insu, une personne qui a été abusée sexuellement dans son enfance. Nous avons aussi entendu les histoires d’un père qui se rend trop souvent dans la chambre à coucher de sa fille lorsque le reste de la famille dort ou d’un adolescent qui harcèle sa cousine sous couvert de « jeux d’enfants ». Nous connaissons ces personnes, parfois, sans avoir conscience de leur vécu, ou en l’occultant : il est souvent plus facile de détourner le regard que de se confronter à la réalité de ces agressions. Si la parole se libère autour des violences sexuelles depuis le mouvement #MeToo, le tabou qui pèse sur les abus sexuels – en particulier les actes incestueux – dont sont victimes les enfants est puissant, paralysant.
Près d’un enfant sur cinq est victime de violences sexuelles, selon le Conseil de l’Europe, la principale organisation de défense des droits humains en Europe. Attouchements, exhibitionnisme, viol, harcèlement et agressions ou encore exploitation sous forme de prostitution, le spectre est large et recouvre toutes les strates de la société. En Europe et en Amérique du Nord, l’inceste, soit des relations sexuelles entre personnes partageant un lien de sang, concernerait un enfant sur dix. Pour la Suisse, une étude de 2019 de la RTS faisait état d’environ 350 enfants victimes d’inceste par année. Une tendance stable, mais « des chiffres qui ne révèlent toutefois que la pointe de l’iceberg », précise l’article. En effet, il n’existe actuellement en Suisse aucune enquête institutionnelle sur l’inceste. La proportion de mères abusives serait également sous-évaluée, même si, comme pour les autres types de violences sexuelles, 94% des agresseur·e·s sont des hommes, dont environ un quart de mineur·e·s au moment des faits.
« Les abus sexuels sur les mineur·e·s sont une problématique fréquente et sont vraisemblablement sous-estimés », confirme Francesca Hoegger, pédiatre et cheffe de clinique au CAN Team, une unité du CHUV qui offre un soutien aux professionnel·le·s dans la détection et l’évaluation des situations de maltraitance chez les mineur·e·s. Vulnérables et influençables, les enfants sont des cibles faciles. « La notion de sexualité chez les plus jeunes n’a pas la même signification que pour un adulte. Et un abus sexuel peut être fait sans violence.
CHIFFRES
Entre
70% et 85%
des enfants connaissent leur agresseur·e /
Environ un tiers
des enfants victimes d’abus n’en parlent à personne
UN ENFANT SUR CINQ VICTIME
D’ABUS SEXUELS
Cette estimation formulée par le Conseil de l’Europe est issue de la combinaison de plusieurs études et des statistiques publiées par l’Unicef, l’Organisation internationale du travail ou encore l’Organisation mondiale de la santé. Ce chiffre tient également compte du sous-signalement dont les abus sexuels font souvent l’objet.
Source : Libération, « D’où vient l’estimation selon laquelle un enfant sur cinq a été victime de violences sexuelles ? », 09.11.2021
Nombre de personnes ne se souviennent pas de ce qui leur est arrivé ou le conscientisent tardivement comme tel », poursuit Francesca Hoegger. A fortiori, lorsque des enfants en situation de handicap sont concerné·e·s : une population à risque élevé d’abus, et qui peut éprouver des difficultés d’expression et de la compréhension de tel ou tel geste, donné dans le cadre des soins, par exemple. La parole est d’autant plus précieuse qu’un examen clinique de la sphère génitale n’apportera pas toujours de preuves, souligne la pédiatre du CHUV. « Nous trouvons des lésions dans 30% seulement des cas d’abus avec contact physique. C’est la raison pour laquelle les propos spontanés d’un enfant sont souvent les plus pertinents. »
Le phénomène de « dissociation », également lié à d’autres types de traumas, est l’une des clés pour comprendre l’« amnésie traumatique » dont sont frappées beaucoup de ces victimes d’abus sexuels privées de parole. Cette réaction physiologique de
survie se produit lorsque la violence est insupportable (pouvant mener jusqu’à une « mort de stress »), paralysant les fonctions mentales supérieures et rendant complètement inaccessible la réponse émotionnelle. La personne a l’impression d’être « à côté » ou « au-dessus de son corps ». Son pendant, appelé mémoire traumatique, peut quant à lui faire ressurgir à tout moment des souvenirs enfouis dans le subconscient. Les agressions reviennent fréquemment sous forme de flash-back, à l’âge adulte, déclenchés par une odeur, un lieu, une couleur, et réactivant les traumas passés. En plus de ces réactions physiologiques, il faut également prendre en compte le contexte hiérarchique et relationnel dans lequel s’inscrivent ces abus et qui complique d’autant la libération de la parole : entre 70% et 85% des enfants connaissent leur agresseur·e.
INCESTE, SILENCE ET DÉNI
« La famille représente la principale sphère où s’exercent les abus sexuels et les violences. L’inceste s’inscrit souvent dans une relation privilégiée entre un adulte abuseur et un enfant », rappelle Alessandra Duc Marwood, psychiatre et médecin adjointe du Centre les Boréales, une structure créée en 2010 et dédiée aux violences intrafamiliales. « Les enfants sont victimes de violences par les figures qui représentent la protection et la sécurité, entraînant une confusion par rapport à la personne censée protéger et prodiguer de l’amour, mais qui, dans le même temps, devient celle qui fait du mal. On apprend les règles relationnelles au sein de sa famille, comment savoir ce qui est normal ou non ? » détaille la psychiatre. Un point également souligné par la journaliste française Charlotte Pudlowski dans son enquête minutieuse se basant sur un vécu familial, « Ou peut-être une nuit –Inceste : la guerre du silence1 ». « On ne se révolte pas contre ceux que l’on aime. C’est ce qui fait de l’inceste une arme de domination si puissante. »
Le silence qui pèse sur de jeunes victimes pétries de honte et de culpabilité est d’autant plus lourd que révéler au grand jour des abus commis par un·e proche équivaut à menacer la tranquillité du « cocon » familial. « Dans les familles où il y a des actes incestueux, la parole est plus punissable que les actes », assure Alessandra Duc Marwood. Toujours dans son essai, Charlotte Pudlowski note : « Plus l’amour est présent, le respect, le sentiment d’être redevable et dépendant, plus le risque est grand
Abus sexuel
Interaction de nature sexuelle inappropriée à l’âge et au niveau du développement psycho-sexuel de l’enfant ainsi qu’à son statut dans la société.
Agressions sexuelles
Renvoient à une attaque – soudaine et brutale – portant une atteinte physique et/ou psychique à quelqu’un.
Violences sexuelles
Elles s’inscrivent dans le cadre de la maltraitance infantile. Elles incluent les contacts physiques directs et les actes, qui se déroulent à travers une interaction visuelle, verbale ou psychologique.
Dissociation
Phénomène de déconnexion involontaire des émotions afin de se détacher de la souffrance. Impression d’absence de soi au moment des violences.
ESPT
État de stress post-traumatique.
Réaction psychologique résultant d’une situation durant laquelle l’intégrité physique et/ou psychologique de la personne a été menacée et/ou atteinte. Peut s’exprimer par exemple sous la forme d’hypervigilance et de flash-back.
Mémoire traumatique
Conséquence psychotraumatique des violences. Se traduit par des flash-back, des illusions sensorielles, des cauchemars qui font revivre le traumatisme, avec la même détresse, les mêmes réactions physiologiques, somatiques et psychologiques que celles vécues lors des violences.
Résilience
La capacité à réussir à vivre et à se développer positivement, de manière socialement acceptable, en dépit du stress ou d’une épreuve négative.
de faire exploser son socle, ses proches, sa famille et plus la révolte semble impossible, la dénonciation ingérable, ou pas tout de suite, ou tard, ou au prix de l’exclusion du foyer ». Ce mur, Marjorie, 34 ans, abusée par son cousin de ses 4 à 10 ans, y a fait face : « Il me faisait taire en me répétant que c’était sale et que si je racontais ce secret, tout le monde penserait que j’étais sale, moi aussi. J’ai, une fois, essayé d’en parler à ma grand-mère, mais celle-ci n’a pas réagi. » Le déni des conjoint·e·s et des proches est monnaie courante dans les affaires d’inceste. Ils ou elles en viennent même souvent jusqu’à prendre le parti de l’auteur·e, observe la psychiatre. Un désaveu qu’a vécu Heidi avec sa mère, lorsque celle-ci a appris que son mari avait abusé de sa fille pendant des années. « Elle s’est d’abord montrée désolée, puis m’en a voulu, m’accusant d’avoir sciemment séduit mon beau-père », raconte l’étudiante de 22 ans qui a depuis coupé les liens.
Ce déni, on le retrouve aussi fréquemment du côté des agresseur·e·s, observe Alessandra Duc Marwood. « Beaucoup d’auteur·e·s de violences avouent les faits mais rejettent toute responsabilité. Nous devons leur rappeler qu’un·e enfant n’est jamais consentant ou demandeur de faveurs sexuelles. » Tout un travail est alors effectué avec la personne auteure de violences autour de la reconnaissance des faits, d’un rappel de la loi et, surtout, d’une prise de conscience de l’impact d’un inceste.
UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE
Si le nombre de violences sexuelles sur personnes mineures reste sousévalué, leurs répercussions sur l’état de santé de la population sont, elles, bien tangibles. Une étude étasunienne1 datant de 2018 estime l’impact économique annuel des abus sexuels sur les enfants à plus de 9 milliards de dollars pour le pays. Un montant qui comprend les coûts des soins de santé, de la protection de l’enfance, de l’éducation spécialisée, de la violence et de la criminalité, du suicide et de la perte de productivité des personnes abusées. « Nous ne sommes pas égaux face aux risques ou à la résilience. Mais on sait qu’avoir vécu des violences ou des abus prétérite l’avenir », relève Alessandra Duc Marwood. D’autant plus si les facteurs de risques se cumulent (isolement social, maladie, précarité, etc.).
1 « One Year’s Losses for Child Sexual Abuse in U.S. Top $9 Billion, New Study Suggests » | Johns Hopkins | Bloomberg School of Public Health (jhu.edu)

« JE
NE VOULAIS PAS

dissociation1, mais, avec les années, le poids de ce qui m’était arrivé pesait de plus en plus lourd. Puis la crise du Covid-19 a éclaté et moi avec. C’était trop, j’avais une boule de haine en moi, j’en voulais à tout le monde. Mon copain de l’époque – la première personne qui a su m’écouter – m’a alors poussée à en parler à mon frère, dont j’étais très proche. Il m’a crue, ça a été un énorme soulagement.
ÊTRE CELLE QUI DÉTRUIT
LA FAMILLE »
Mais il pouvait aussi se montrer très manipulateur, pleurait, menaçait de se suicider si je le dénonçais. Je ressentais beaucoup de pression. Surtout, parce que je ne voulais pas être celle qui détruit la famille.
La première fois que j’ai mentionné avoir été victime d’inceste, c’était le ans, à deux amies. Elles étaient choquées et n’ont pas su quoi répondre. Je ne leur en veux pas, mais je me suis sentie bête et honteuse. Je me suis alors à nouveau tue. J’ai longtemps été en
Avec son aide, j’ai alerté une partie de ma famille. Tout le monde était sous le choc. Je me suis sentie soulagée, mais en même temps très seule : beaucoup d’adultes s’en doutaient mais n’ont rien fait. Aujourd’hui, tout le monde s’en veut. J’ai porté plainte trois jours après ces révélations, en mai 2020, sur conseil de mon père. Ma mère, qui en tant qu’ancienne conjointe était suspecte, a appris par la police que mon beau-père avait abusé de moi. Je suis toujours dans l’attente du procès qui ne cesse d’être repoussé² et, pendant ce temps, même s’il n’a plus le droit de voir mon demi-frère, mon agresseur est en liberté. La justice n’en fait pas assez pour les victimes, on devrait être soutenues davantage.
Si j’ai accepté de témoigner, c’est pour montrer que les victimes n’ont pas de visage particulier. Personne n’est à l’abri, on connaît toutes et tous quelqu’un dans son entourage qui a subi des abus. Et c’est important de sentir qu’on n’est pas seul·e. J’ai fondé l’année dernière l’association Amor Fati, qui propose notamment un groupe de parole à Fribourg pour les victimes d’abus sexuels. Je suis également étudiante en psychologie. J’espère ainsi pouvoir aider d’autres personnes dans le futur. »
1 Épisodes au cours desquels, à la suite d’un trauma, la personne perd le contact avec un ou plusieurs aspects de la réalité : son corps, ses pensées, son environnement, et/ou ses actions lui deviennent étrangers.
² Entre-temps, la première partie du procès a eu lieu, la procureure a requis 12 ans ferme contre le prévenu qui a fait recours.
Les séquelles chez l’enfant sont multiples et diffèrent selon l’individu et son genre. Elles peuvent prendre la forme d’un état de choc, d’anxiété, d’agressivité, de retards développementaux ou de manifestations neurobiologiques. Les conséquences, d’autant plus si les abus se répètent dans le temps, perdurent souvent à l’âge adulte et à travers les générations. Problèmes d’attachement, TOC, agressivité, addictions, comportements sexuels à risque, maladies chroniques, isolement : la liste est longue. Pour Marjorie, les abus perpétrés par son cousin se sont traduits par des problèmes d’anorexie et de boulimie, de consommation problématique d’alcool et de difficultés dans son intimité. « J’emploie aujourd’hui encore des expressions un peu enfantines pour parler de sexe, ou j’essaie simplement d’éviter d’en parler. J’ai toujours l’impression que je fais quelque chose de mal ou de sale », raconte la jeune femme, dont les blocages ont notamment prétérité nombre de ses histoires sentimentales. De son côté, Heidi se souvient avoir eu ses règles très tôt, à l’âge de 9 ans. « Enfant, je m’habillais déjà comme une grande, je portais du rouge à lèvres. Mon beau-père m’achetait des habits d’adulte. » Elle aussi vit des blocages au niveau de sa sexualité, sous forme de flash-back.
Moins connus, les problèmes cardiovasculaires à l’âge adulte peuvent également être une résultante de traumas, dont les abus sexuels. « Quel que soit le type de maltraitance, une victime d’abus a plus de probabilités d’être en hyper-vigilance constante en raison d’un syndrome de stress post-traumatique et, ainsi, d’être constamment sous adrénaline et cortisol », souligne Marco Tuberoso, psychologue à l’association Espas, qui s’engage auprès des enfants et des adultes concerné·e·s par les abus sexuels. L’essai Ou peut-être une nuit dépeint le cas de Lydia, 48 ans, qui, à la suite de chocs psychologiques liés à des abus sexuels par son père, a développé une maladie neurovégétative dégénérative. Elle est désormais en chaise roulante.
« Avoir subi des violences sexuelles ne signifie pas toujours un mauvais pronostic pour le futur développement de l’enfant, précise la Dre Francesca Hoegger. Mais trouver le soutien nécessaire aide à aller bien. Plus l’enfant est pris en charge tôt, plus les chances sont grandes que les conséquences sur sa santé soient moindres. » Plus nuancée, Alessandra Duc Marwood reconnaît que « beaucoup d’anciennes victimes construisent leur vie et font des choses merveilleuses. Mais au prix d’une souffrance intérieure énorme. »
AIDER LES ADULTES PRÉOCCUPÉ E S PAR LEURS FANTASMES
Il est parfois plus confortable pour une société de panser des blessures que de les prévenir. De prendre en charge les victimes plutôt que de se demander qui sont les agresseur·euse·s, pourquoi ils ou elles agissent et comment de telles violences, décennie après décennie, gangrènent nos sociétés en toute impunité. D’éviter de regarder en face des visages connus et qui, pourtant, ont commis l’indicible. Certaines structures ont, toutefois, le courage de prendre le problème à la racine : c’est le cas de l’association Dis No, installée discrètement au premier étage d’un immeuble résidentiel du centre de Lausanne.
La mission de cette organisation unique en Suisse romande : apporter son aide à des adolescent·e·s ou des adultes préoccupé·e·s par des fantasmes sexuels envers des enfants (communément appelés « pédophilie ») et à risque de passage à l’acte. Une problématique qui concernerait environ 1% de la population masculine (soit environ 66’000 personnes en Suisse) et sur laquelle pèse « un stigmate et un tabou considérables », selon Hakim Gonthier, le directeur de l’association. « Nous travaillons avec des personnes en grande souffrance qui ne savent pas vers qui se tourner. Comment en parler à ses proches ? Nous sommes souvent les seules personnes à être au courant de ce qui se passe dans leur tête. »
TYPES DE VIOLENCES SEXUELLES
SANS CONTACT CORPOREL
• Exhibitionnisme
• Voyeurisme
• Confrontation à du matériel pornographique
• Agressions verbales
AVEC CONTACT CORPOREL
• Sans pénétration : attouchements, masturbation de l’auteur·e sur la victime ou de la victime sur l’auteur·e.
• Avec pénétration : pénétration orale, vaginale, anale de l’auteur·e sur la victime ou de la victime sur l’auteur·e qui le demande.
Sources : LAVI CentreLAVI-Abus-sur-mineurs-pdf, memoiretraumatique.org
REPÉRER LES SIGNAUX D’ALERTE
Les signes qui peuvent alerter chez les enfants et les adolescent·e·s varient en fonction de l’âge et du genre. Il existe différents types de manifestations de violences sur un individu.
Physiques
• Problèmes somatiques (ex. : énurésie, eczéma…)
• Fatigue chronique
• Infections urinaires ou vaginales à répétition, constipation
• Maux de tête
• Maux de ventre
• Douleur et/ou difficulté à marcher ou à s’asseoir
L’association leur offre ainsi une écoute attentive, ainsi qu’à leurs proches, et les accompagne dans une démarche de changement qui peut parfois prendre du temps : « Nous observons fréquemment une minimisation des faits, des mécanismes de déni ou de distorsions cognitives, soit l’interprétation des gestes d’enfants comme une invitation. Nous les aidons à conscientiser ces fantasmes, à les recadrer et nous leur rappelons la loi », relate Hakim Gonthier. Le directeur se montre toutefois rassurant : « Faire le pas de nous contacter est un facteur protecteur de passage à l’acte. »
L’association n’offre pas de soutien thérapeutique mais réoriente les personnes vers des spécialistes, lorsqu’ils ou elles acceptent. Elle rencontre en effet des difficultés à trouver des thérapeutes, souvent peu formé·e·s ou enclin·e·s à travailler avec ce type de patient·e.
Psychiques
• Retards développementaux
• Symptômes de stress post-traumatique
• Symptômes dépressifs
• Symptômes de dissociation
• État de choc
Comportementaux
• Changements de comportements soudains et inexpliqués
• Colère, agressivité
• Comportements sexuels problématiques
• Anxiété, peur, méfiance
• Problèmes scolaires
• Scarification
• Troubles alimentaires, du sommeil
• Problèmes d’hygiène
À l’instar des auteur·trice·s d’abus sexuels, les personnes faisant appel à l’association sont en majorité des hommes. Les femmes qui recherchent de l’aide à Dis No souffrent plus généralement de TOC pédophilique, soit « la peur d’être pédophile », qui diffère de l’attirance pour les enfants. L’association a à cœur sa lutte contre les mythes entourant ce trouble et précise que pédophilie n’équivaut pas à agression sexuelle. « On estime que seules 30 à 40% des personnes ayant commis une agression sexuelle sur les enfants présentent une attirance sexuelle primaire ou exclusive pour les enfants, ce qui les classerait dans la catégorie des pédophiles, précise Hakim Gonthier. Les 60% restants sont le fait de personnes qui ne répondent pas à un diagnostic de pédophilie mais sont des agresseurs dits opportunistes avec un profil

« ON PEUT TRANSFORMER
SON TRAUMA EN QUELQUE
CHOSE DE POSITIF »
« Oui, l’inceste concerne aussi les hommes. Et en parler ne rend pas moins ‹ viril ›. C’est important qu’on nous entende sur ce sujet.
J’ai été abusé par deux personnes différentes, ce qui signifie aussi deux expériences distinctes. J’étais très jeune la première fois, autour de 3 ans. On avait l’habitude de jouer à papamaman avec mes ami·e·s. Une fille plus âgée, la cousine de ma cousine,
insistait toujours pour que je fasse le papa et elle la maman. Elle m’a une fois emmené dans un bâtiment isolé, c’est là qu’elle en a profité pour m’attoucher. Ça s’est répété plusieurs fois. Je sentais que c’était inhabituel, bizarre, mais je n’ai pas le souvenir de quelque chose de violent.
Contrairement à la deuxième personne qui m’a agressé. Je vivais à l’époque chez ma tante, dans un
Prosper Gabriel 24 ans
environnement très violent, très stressant. Ma cousine, alors âgée de 16 ans, en a profité. Étant donné que je ne faisais pas directement partie de la famille, elle savait qu’on ne prendrait jamais mon parti. Avec elle, il y a tout eu, des attouchements à la pénétration. Des menaces et du chantage. J’avais tellement peur de me faire bannir de chez ma tante que j’en étais au point où c’était à moi de tout faire pour qu’on ne nous attrape pas. Cette situation a duré un an, puis j’ai déménagé et, en 2014, j’ai rejoint mon oncle en Suisse.
Par instinct de survie, je n’ai jamais rien dit. J’ai mis cette affaire dans une boîte, je me suis en quelque sorte coupé de mes émotions. Mais peutêtre se sont-elles exprimées autrement. J’ai, par exemple, pu ressentir du dégoût pour les femmes, je ne croyais pas en l’amour. À l’inverse, je recherchais constamment leur attention. J’ai toujours été sensible aux violences, notamment aux violences sexuelles envers les femmes. Lorsqu’elles se confiaient à moi, j’avais envie de leur dire ‹ je sais ce que vous vivez ›. Je me suis longtemps senti impuissant. J’avais cette envie de montrer que j’étais le plus fort, le plus massif, en étant à fond dans le sport. J’avais la sensation d’être le petit Prosper qui doit se taire et que ma cousine avait toujours une emprise sur moi. Je suis parvenu à transformer ce désir de ‹ masculinité › en quelque chose de positif. J’ai même été champion suisse de boxe amateur. Si je devais aujourd’hui croiser cette femme, je voudrais lui montrer que, malgré ce qu’elle m’a fait subir, je vais bien. Je suis une personne à part entière. »
psychopathique ou antisocial. » Le spécialiste recommande de ne pas stigmatiser cette attirance, tant que cette dernière, encadrée par des limites claires et des stratégies de non-passage à l’acte, reste circonscrite à des pensées. « Prenez contact avant que la situation ne devienne hors de contrôle. L’onde de choc est telle pour la victime, comme pour la personne et ses proches, qu’une fois la limite franchie, il est impossible de revenir en arrière », insiste-t-il.
Marco Tuberoso d’Espas travaille avec des auteur·e·s d’agressions sexuelles de moins de 18 ans envoyé·e·s par le Tribunal des mineurs. Ce sont majoritairement des garçons qui ont, pour la plupart, également subi des maltraitances, et pour un tiers d’entre eux·elles des violences sexuelles. « Attention : cela ne signifie pas que toutes les personnes abusées deviennent des abuseurs, insiste Marco Tuberoso. Pour les adolescents auteurs, la sexualité est souvent un moyen d’entrer dans une forme de délinquance, de montrer à quel point ils vont mal. » Dans une société genrée où l’expression des émotions reste exclue de la construction de la masculinité (les filles, elles, auront davantage des tendances autodestructrices), le psychologue s’attache à faire parler ces jeunes garçons de leur souffrance, tout en leur rappelant que le fait d’avoir été victime d’abus ne leur donne pas le droit d’agresser un tiers à leur tour.
RÉÉDUQUER LA SOCIÉTÉ
Enracinées dans toutes les strates d’une société patriarcale, n’épargnant personne, que l’on soit victime ou proche, et rejaillissant sur les générations d’après, les violences sexuelles représentent un enjeu de santé publique, dont chacun et chacune doit se saisir. Détourner le regard ou se murer dans le silence pour préserver des semblants de liens familiaux et sociaux peut être condamnable par la justice. Il en va de même pour les professionnel·le·s de la santé qui, de l’avis des personnes interrogées, sont encore trop peu formé·e·s à ces problématiques, au contact malgré eux de situations tragiques. « Nous devons oser poser la question, ouvrir la porte et leur laisser la place », insiste Francesca Hoegger. Et Alessandra Duc Marwood de conclure : « Il faut une rééducation de la société. Nous avons un devoir d’entendre et de protéger les plus vulnérables. » /
CENTRES LAVI
- aide et conseils pour les victimes de violences physiques, sexuelles ou psychiques
- soutien psychologique et juridique
- conseil pour les aides financières profa.ch/lavi
ASSOCIATION ESPAS
- suivis thérapeutiques pour les victimes de violences sexuelles
- prise en charge pour adolescent·e·s qui ont commis des violences sexuelles
- cours de sensibilisation pour les professionnel·le·s espas.info
BRIGADE DES MŒURS
- s’occupe de ce qui concerne l’intégrité corporelle
- reçoit les plaintes pour maltraitance physique ou sexuelle
- reçoit les personnes 24h/24 vd.ch
ASSOCIATION DIS NO
- active dans la prévention de la maltraitance et des abus sexuels
- accueille les adultes ou adolescent·e·s qui ressentent une attirance envers les enfants
- uniquement destiné aux personnes qui n’ont pas commis d’actes d’ordre sexuel
disno.ch
CAN TEAM
- forme les professionnel·le·s à la détection de la maltraitance et à l’orientation vers des mesures de protection de l’enfant et l’adolescent·e
- rattaché au Service de pédiatrie du CHUV
chuv.ch
CONSULTATION LES BORÉALES
- destinée aux familles et couples concernés par des situations de violences ou d’abus sexuels
- propose des thérapies individuelles de couple ou de famille
- organise des visites à domicile et des groupes de parole chuv.ch
RECUEILLIS
« LA PAROLE SE LIBÈRE, MAIS LA JUSTICE AVANCE LENTEMENT »
La reconnaissance par la justice est, pour beaucoup de victimes d’abus sexuels, une étape indispensable vers la reconstruction de soi. L’avocate lausannoise Coralie Devaud déplore une législation suisse archaïque en matière de viol et d’inceste. PROPOS
in vivo Que se passe-t-il au niveau juridique lorsqu’un abus sexuel est commis sur un·e mineur·e ?
coralie devaud Les abus sexuels commis sur des enfants sont des infractions qui se poursuivent d’office. Cela signifie qu’une plainte n’est pas nécessaire pour l’ouverture de la procédure pénale. Il est toutefois conseillé de déposer plainte en vue de faire valoir ses droits. La majorité des signalements de mise en danger d’un mineur émanent du milieu médical, scolaire ou familial. Toutefois, si l’enfant est capable de discernement, autour de l’âge de 15 ans, il peut aussi lui-même déposer plainte. La machine judiciaire se met en marche et une procédure est rapidement lancée. Selon l’âge de l’auteur la procédure s’engage soit devant le Tribunal des mineurs, soit devant le Ministère public si la personne est majeure.
Biographie
Née à Lausanne et après avoir obtenu une licence en droit, Me Coralie Devaud poursuit son parcours académique en rédigeant une thèse de doctorat sur le consentement éclairé du·de la patient·e. Depuis plus de dix ans, elle pratique en qualité d’avocate pénaliste et défend notamment les intérêts des enfants ayant subi des violences physiques, psychiques ou sexuelles. Me Coralie Devaud conseille et assiste également les professionnel·le·s de la santé lors de procédures pénales et disciplinaires.
iv Les enfants sont des êtres vulnérables, qui n’ont pas forcément accès à la parole. Des précautions sont-elles prises au moment de l’audition ?
cd Le processus d’audition des enfants, des plus jeunes particulièrement, est très précis. L’enfant, en fonction de ses facultés, soit à partir de 5 ou 6 ans, est entendu et filmé dans un local adapté, en présence d’un psychologue LAVI, et selon un protocole qui a notamment pour but d’éviter toute influence ou contamination des déclarations de la victime. Des inspecteurs – disposant d’une formation spécifique en la matière – suivent l’audition, retransmise sur un écran, dans une autre pièce. Nous sommes très attentifs aux dires spontanés de l’enfant. Tout est fait pour ne pas polluer son discours et éviter un risque de victimisation secondaire1
iv Dans le cas où l’accusé·e présumé·e est l’un des parents, que se passe-t-il ?
cd Le procureur interpelle la Justice de paix –l’autorité de protection de l’enfant – pour qu’un curateur de représentation soit attribué à l’enfant en vue de défendre ses intérêts dans la procédure. En d’autres termes, cela signifie qu’on ôte aux parents le pouvoir légal de représenter leur enfant à ce titre. La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) peut également intervenir pour le volet civil. Elle peut, par exemple, demander un placement de l’enfant si l’on estime que ce dernier n’est pas en sécurité avec ses parents ou ses représentants devant la loi.
1 La victimisation secondaire est le mécanisme qui fait souffrir une seconde fois la victime de violence ou d’agression quand on ne la croit pas, qu’on minimise les faits ou encore qu’on la considère comme coupable de ce qui lui arrive.
iv L’inceste représente l’ultime tabou social. Pourtant, dans la loi suisse, il n’est pas considéré comme un crime.
cd En effet, l’inceste est, selon le Code pénal, un délit qui relève du droit de la famille. Cette disposition avait pour but, à l’origine, d’éviter la consanguinité et de préserver le lien familial. L’inceste doit être accompagné de contrainte ou de violence pour être considéré comme un crime. À l’image de la définition du viol en Suisse, la disposition qui concerne l’inceste est archaïque : pour qu’il y ait inceste, il doit y avoir un acte sexuel entre ascendants et descendants ou entre frère et sœur. L’auteur d’inceste peut uniquement être de sexe masculin et la victime de sexe féminin. Les liens incestueux d’une mère avec son fils ou d’un père avec son fils n’entrent pas dans la définition de l’inceste, tout comme les abus qui seraient commis par un frère adoptif ou un beau-père, puisque le Code pénal ne reconnaît que les liens du sang.

iv Vous citiez une loi suisse désuète en matière de viol. Qu’en est-il exactement ?
cd À l’heure actuelle, la définition du viol est très restrictive : elle se fonde sur la notion de contrainte physique ou psychologique. Un « non » exprimé oralement en l’absence d’un moyen de contrainte n’entre pas dans ce cadre, aux yeux de la loi. L’infériorité cognitive ainsi que la dépendance émotionnelle et sociale peuvent, particulièrement chez les enfants et les adolescent·e·s, induire une énorme pression qui les rend incapables de s’opposer à des abus sexuels. Il est souvent nécessaire de rappeler qu’un enfant n’est jamais consentant, et qu’une agression sexuelle peut être faite sans contrainte. En outre, un viol, à l’instar de l’inceste, est seulement reconnu dans le cadre de la pénétration d’un pénis dans un vagin, excluant la fellation et la sodomie et, de facto, les agressions sexuelles entre personnes de même sexe.
iv Les affaires d’abus sexuels, d’autant plus quand elles concernent des enfants, ont ceci de complexe qu’elles manquent souvent de preuves.
cd Oui, c’est toute la difficulté de ce genre de procédure : les victimes ont le sentiment de devoir démontrer qu’elles disent la vérité. Il est rare qu’un auteur reconnaisse les faits, sauf s’il existe des preuves évidentes, comme, des traces scientifiques
ou un grand-père qui aurait fait des photographies des parties intimes de sa petite-fille. Et même dans ce cas, il arrive que des agresseurs, ainsi que leurs conjointes, se murent dans le déni. Les instances juridiques collaborent étroitement avec le corps médical qui pourra, par exemple, attester d’un état post-traumatique. Un élément supplémentaire pour le tribunal, sachant que le doute joue toujours en faveur de l’accusé. Le dossier d’une victime d’abus sexuels est un véritable château de cartes et parvenir jusqu’au tribunal est un parcours du combattant.
iv Du point de vue des victimes, que peut leur apporter la justice suisse ?
cd On entend fréquemment que les victimes se sentent abandonnées, que tout le processus judiciaire tourne autour du prévenu. Mais tous les survivants ne font pas appel à la justice dans le même but : certains ont besoin d’obtenir une reconnaissance des faits pour se reconstruire, d’autres une condamnation. D’autres encore entament un processus judiciaire pour éviter que l’histoire ne se répète. /
Dans chaque numéro d’In Vivo, le Focus se clôt sur une sélection d’ouvrages en « libres échos ». Ces suggestions de lectures sont préparées en collaboration avec Payot Libraire et sont signées Joëlle Brack, libraire et responsable éditoriale de www.payot.ch.
EMBRASSE-MOI

Embrasse-moi
LIDIA MATHEZ
LA JOIE DE LIRE, 2023
CHF 24.90

Lidia Mathez, jeune diplômée de l’École supérieure de bande dessinée et d’illustration de Genève, frappe par la maîtrise d’« Embrassemoi », son premier roman graphique –et autobiographique.
Fragile et déprimée, la jeune Lidia du livre vit mal son entrée dans sa vie de femme. Peu à peu, les souvenirs occultés d’abus subis dans l’enfance prennent forme. Mais savoir donne-t-il le moyen de gérer la vérité ? Pour s’en sortir, l’héroïne devra faire preuve de courage et de lucidité, tout comme son alter ego l’illustratrice.
IN VIVO Comment cet album est-il né ?
lidia mathez À la fin de l’année 2020, notre professeur nous a orientés vers les sujets pour l’examen final. C’était sur le thème de l’anxiété, j’ai dû faire un travail sur moi-même, et à travers ce processus, les souvenirs ont commencé à remonter. J’en ai parlé à mes parents, j’ai pu comprendre ce qui m’était arrivé, et j’ai décidé d’en faire mon portfolio d’examen. Mon but était de briser un tabou d’une manière plus accessible que dans les livres.
IV Vos enseignant·e·s l’ont accepté ?
lm Leurs réticences visaient moins le sujet que mon style, proche du manga, et la technique digitale que j’avais choisi d’utiliser pour ce projet. Mais c’est d’abord à moi que ça devait plaire, puisque c’est moi qui devais aller mieux. Ça a cependant été très di∞cile, les images et les souvenirs revenaient et, parfois, je me suis écroulée. Heureusement, ma classe et mes professeurs m’ont soutenue. Et puis c’était pour mon diplôme, je ne pouvais plus m’arrêter. Dans ce roman graphique, le noir est omniprésent : après le trauma, ce bain de liquide noir, opaque, dont surgissent des mains et des yeux, habitait mes rêves. Par contre, je ne voulais rien d’agressif dans le dessin, pas même pour l’abuseur. C’est une chose sur laquelle je voulais mettre le doigt : les méchants ne sont pas typés, n’importe qui peut être un abuseur. Ce style appartient d’ailleurs uniquement à cet album.
IV Comment s’est déroulée la publication de l’album ?
lm Cette offre m’a troublée, car si j’étais bien sûr heureuse de cette occasion, rare pour les jeunes artistes, c’était mon histoire qui allait être publiée. Fallait-il changer les noms, modifier certaines choses ? Finalement, j’ai uniquement a∞né quelques détails, et je me suis dit qu’on verrait bien. Dès la parution, j’ai reçu de nombreux messages sur Instagram, de victimes qui n’osaient pas parler. Cela arrive à beaucoup de gens, malheureusement leur silence protège les abus. Au début, je répondais, mais j’ai dû simplifier pour ne pas être submergée, ça a été un grand défi.
IV Quel est votre conseil pour les personnes victimes ? lm Je recommande de parler aux parents, aux amis, aux spécialistes, pour prendre du recul, même si c’est di∞cile, car la surprise puis la gêne paralysent d’abord les réactions. On n’a jamais de « chance » en cas d’abus, mais, pour ma part, j’apprécie d’avoir un entourage sain qui, passé le choc, m’a soutenue et encouragée. Si on est seul (ou qu’il est la source de l’abus), il faut vraiment s’adresser à quelqu’un d’autre. J’ai aussi eu des retours sur l’album de la part de médecins, qui l’utilisent pour l’accompagnement des personnes victimes d’abus : c’est chouette qu’il puisse aider. /
CHRONIQUE

La petite menteuse
PASCALE ROBERT-DIARD
L’ICONOCLASTE, 2022
220 PAGES
CHF 31.10
Lisa a eu « de la chance dans son malheur » : ses enseignant·e·s ont compris que l’adolescente allait mal, elle a été entendue et a pu dénoncer son violeur, qui a été jugé et sévèrement condamné. Lorsqu’elle débarque dans le bureau de Me Alice Keridreux, l’affaire semble donc close. Mais elle s’ouvre, au contraire, et révèle ses chaussetrapes. Bretonne amateure de bains de mer glacés, Alice va devoir plonger au cœur d’un dossier troublant. Pascale Robert-Diard, chroniqueuse judiciaire au Monde, romance à peine un cas réel récemment médiatisé. Et il fallait sa solide connaissance des procédures pour actionner les ressorts du doute et du réexamen sans nuire au besoin croissant de confiance dans la parole des victimes. Dosant parfaitement le suspense de l’instruction et la tension des esprits, elle offre un regard différent, lucide mais empathique, sur une affaire sans doute unique en son genre. Ou peut-être pas ?
EN BREF

Ils ne savaient pas
BRUNO CLAVIER
PAYOT, 2022
192 PAGES, CHF 28.50
Pourquoi les psys, spécialistes du décryptage de révélations occultées, sont-ils ·elles si aveugles et sourd·e·s aux signaux des victimes d’abus sexuels ? Psychanalyste et psychologue clinicien (et ancienne victime d’abus), Bruno Clavier remonte aux sources d’un déni – théorisé par Freud et Lacan – qui rend le·la psy incapable d’accepter les indices pourtant clairs de violences sexuelles. À la fois réquisitoire et plaidoyer, cet essai nourri d’expériences préfère à la critique dure des récits de réussites thérapeutiques permises par le discernement du·de la praticien·ne.

Ou peut-être une nuit
CHARLOTTE PUDLOWSKI
LIVRE DE POCHE, 2023
256 PAGES, CHF 14.20
Tiré d’un podcast retentissant, Ou peut-être une nuit décortique l’accumulation de silences qui bâillonne les victimes d’inceste. Témoignages à l’appui (dont celui de sa mère), la journaliste débusque les complicités du crime. En cause : le modèle de domination patriarcal, qui dresse femmes et enfants à y souscrire. Parler fait courir le risque de n’être pas cru·e, brise la cellule familiale, dévoile les mensonges et l’hypocrisie sociale, le silence arrange donc tout le monde. Et en convainc les victimes, les poussant avec perversité à être leur meilleur bourreau.

Te laisse pas faire
JOCELYNE ROBERT
ÉDITIONS DE L’HOMME, 2019
128 PAGES, CHF 20.60
Un format généreux, un style BD, un ton vif, des encarts colorés : cet ouvrage de la sexologue québécoise est destiné aux enfants. Cet excellent matériau semble cependant plus pertinent dans les mains des adultes, qui trouvent là un canal à la fois attrayant et complet pour aborder avec les 5 – 12 ans le sujet des abus sexuels, sans simplifier ni dramatiser. Les histoires dessinées et les jeux de réflexion, à développer en fonction de l’âge et de l’intérêt, sont calibrés pour cerner le problème, favoriser le dialogue, et rassurer par des explications constructives.

« Le but de mon travail n’est pas de remettre en question la condamnation de l’excision. »
Dina Bader
DINA BADER Juridiquement, rien ne permet de distinguer les pratiques d’excision et les opérations génitales comme la nymphoplastie. La chercheuse montre comment l’éthnocentrisme biaise la perception de ces pratiques.
INTERVIEW : CAROLE EXTERMANN
PHOTO : JEANNE MARTEL
« Il y a dix ans, personne ne serait
venu m’interviewer à ce sujet »
Dina Bader a travaillé sur la différence entre l’excision et les opérations des parties génitales féminines à visée esthétique (nymphoplasties). In Vivo lui consacre une grande interview. L’occasion de mieux comprendre comment la réglementation des pratiques d’excision et des chirurgies esthétiques génitales se mêle à des enjeux politiques, mais aussi comment le questionnement autour de leur comparaison est nécessaire pour ne pas entraver le travail de prévention contre les pratiques d’excision sur le terrain.
in vivo Votre recherche s’est concentrée sur le concept de mutilation génitale féminine en confrontant les chirurgies esthétiques génitales et les pratiques d’excisions. Comment ce projet s’est-il construit ?
DinA BADER Je m’intéressais à l’excision sur le plan sociologique et en lien avec des questions liées à la migration et au genre. Cependant, au cours de mon travail, il n’était pas rare que mes recherches en ligne sur les interventions de modification génitale mènent à des informations concernant la chirurgie esthétique. Je me suis alors rendu compte
d’un paradoxe frappant. Alors que depuis trente ans, l’excision est fermement condamnée en Suisse, le recours à la chirurgie esthétique génitale est au contraire en pleine effervescence. Explorer ces deux pistes en parallèle me permettait ainsi de tenter de mieux cerner le concept de mutilation génitale féminine. Et ce qui différencie les pratiques d’excisions et les chirurgies esthétiques génitales comme la nymphoplastie.
iv Était-il facile d’obtenir des informations à ce sujet ?
DB La question de la comparaison entre les pratiques d’excisions et les chirurgies esthétiques génitales est extrêmement taboue. Il y a dix ans, personne ne serait venu m’interviewer à ce sujet. La complexité du sujet est aussi liée aux stéréotypes qui sont associés à ces pratiques. Dans les discours publics, les excisions sont volontiers représentées comme des gestes barbares commis au rasoir rouillé sur un sol poussiéreux. Et les nymphoplasties, des opérations maîtrisées réalisées dans un milieu médical. Ces interventions sont aussi
communément distinguées par la catégorie de personnes qu’elles concernent : ce sont des femmes adultes qui auraient recours à la nymphoplastie, tandis que l’excision toucherait uniquement des mineures. Or, de plus en plus d’adolescentes et préadolescentes ont recours à la nymphoplastie, alors que l’excision est aussi interdite aux femmes adultes et consentantes. Puis, contrairement aux idées reçues, de nombreuses excisions sont pratiquées dans un cadre médical. C’est le cas en Égypte, par exemple, où 84% de ces interventions sont réalisées à l’hôpital.
«
LA LÉGALITÉ DES OPÉRATIONS GÉNITALES ESTHÉTIQUES EST SURTOUT LIÉE À DES ARGUMENTS ÉCONOMIQUES. »
iv Pourquoi la chirurgie esthétique doit-elle englober la réflexion sur les mutilations génitales ?
DB Depuis 2012, une loi punissant la mutilation des organes génitaux féminins est entrée en vigueur. Mais juridiquement, rien ne permet de distinguer les deux pratiques. La loi ne fait nulle mention du consentement ou de l’âge, ou même des conditions dans lesquelles elles seraient effectuées. Elle condamne toute atteinte faite aux organes génitaux féminins et en cela, les chirurgies esthétiques sont concernées. Dans les forums de discussions en ligne, des femmes qui ont eu recours à des opérations génitales parlent d’un sentiment de mutilation quand l’opération s’est mal déroulée ou que le résultat n’est pas celui imaginé. D’ailleurs,
certaines vont consulter des médecins spécialisés dans la reconstruction vulvaire, alors que ce service était pensé à l’origine pour les femmes touchées par l’excision. La frontière entre excisions et chirurgies esthétiques génitales est poreuse, et la distinction repose sur une interprétation et traduit une forme d’ethnocentrisme. Certains chirurgiens craignent de pratiquer une nymphoplastie sur une jeune fille noire de peur d’être poursuivis pour excision. Par ailleurs, la consommation de pornographie occidentale induit un regain d’intérêt, auprès des hommes d’origine africaine, pour l’excision. Pour le législateur suisse, le type d’excision qui consiste en l’ablation des petites lèvres est interdit, mais la nymphoplastie qui réduit partiellement ou complètement les petites lèvres est autorisée. La légalité d’une pratique ne devrait pas reposer sur le seul critère du nom qu’on lui donne.
iv Comment ces stéréotypes liés à l’excision sont-ils forgés, d’après vous ?
BIOGRAPHIE
En tant que sociologue, Dina Bader s’est spécialisée dans les questions liées à la migration et au genre. Sa thèse de doctorat sur la problématique des mutilations génitales et des opérations esthétiques génitales a obtenu le prix
DB Pour nourrir mes recherches, j’ai analysé les discours médiatiques et les débats parlementaires et j’ai constaté que le renforcement de ces stéréotypes et la catégorisation de la pratique de l’excision perçue comme un geste barbare servent à la stigmatisation des personnes migrantes, majoritairement noires et issues de l’asile. Cette thématique devient alors l’opportunité pour les partis politiques conservateurs d’alimenter un argumentaire contre l’immigration, sans pour autant assumer un discours directement xénophobe. Les stéréotypes sont également amplifiés par les représentations sociales qui imaginent une moralité sociale et une éthique médicale moins développées dans les pays non occidentaux.
iv Faudrait-il alors assouplir la loi en termes de mutilation génitale ?
« Genre – Égalité femme-homme » en 2019 de l’Université de Lausanne. Elle est actuellement cheffe de projet et chargée d’enseignement à l’Université de Neuchâtel.
DB Non. Le but de mon travail n’est absolument pas de remettre en question la condamnation de l’excision, mais de questionner les différences de postures. Est-il possible de soutenir l’intervention chirurgicale sur le sexe des femmes, parfois très jeunes tout en condamnant les pratiques d’excision ? En
Suisse, l’excision est d’ailleurs punissable même lorsqu’elle est réalisée à l’étranger alors que la famille vivait encore dans son pays d’origine. Par contre, les opérations génitales ne bénéficient d’aucune réglementation explicite. Il semble ainsi important de se questionner sur la cohérence de ce double standard et des messages contradictoires que cela peut induire.
iv En 2022, la Société suisse de chirurgie plastique, reconstructive et esthétique estime l’augmentation du recours à ce type d’opérations à 50% au cours des cinq dernières années. Comment expliquer cette effervescence ?
sujet, particulièrement lorsque l’opération est un échec. Cela se mesure notamment en s’intéressant au décalage entre les témoignages d’opérations ratées sur les forums en ligne ou lors de consultations et le nombre de plaintes déposées. Un expert que j’ai interrogé m’expliquait ainsi que les médecins qui réalisent des nymphoplasties prennent peu de risques. Car porter plainte pour une opération vulvaire ratée comporte encore une dimension gênante qui dissuade sans doute les personnes concernées.
iv Le consentement pourrait-il être un critère distinctif entre la nymphoplastie et l’excision ?
DB C’est un argument qui est souvent utilisé. Se faire opérer pour des raisons esthétiques serait un choix, tandis que les femmes subiraient, contre leur gré, les pratiques d’excision. Malheureusement, il semble di∞cile d’accepter la nymphoplastie comme un choix pris en dehors d’un contexte socioculturel précis. Les normes de beauté, particulièrement dans ce domaine, exercent en effet une forte pression sur les femmes dont l’acceptation sociale dépend de standards précis. Le consentement est donc, dans ce cadre-là, particulièrement biaisé. De plus, les pratiques d’excision demandées par des femmes adultes ne sont pas jugées acceptables. Ce qui montre bien que le consentement ne définit pas ce qui constitue une mutilation génitale féminine.
DB La volonté de vouloir corriger son sexe repose en grande partie sur de la méconnaissance. Une part importante des femmes ne savent pas à quoi ressemble véritablement l’état naturel de la vulve et ses diversités d’apparence. Beaucoup sont ainsi orientées par des images issues de la pornographie qui présentent des organes lisses, opérés ou retouchés, mais qui ne correspondent pas à la réalité. Il y a ensuite, parallèlement, une forme de capitalisation qui s’opère à partir de ce potentiel complexe. On constate ainsi l’émergence de produits cosmétiques destinés à soigner et embellir le sexe féminin qui contribuent à entretenir l’idée qu’il y a un standard de beauté précis auquel il faut correspondre. Parfois, des bénéfices sur la qualité de la vie sexuelle de la patiente sont aussi évoqués. Les études scientifiques qui prouvent cette amélioration comportent souvent des biais importants et l’amélioration constatée n’est souvent due qu’au fait de s’être débarrassée d’un complexe. Toutefois, en ayant recours à la nymphoplastie, la patiente s’expose aussi à des douleurs potentielles, des complications lors de l’accouchement ou encore à une perte de la sensibilité. Mon analyse des débats parlementaires montre que le législateur suisse voulait exempter les chirurgies esthétiques génitales car elles représentent justement un marché très lucratif ; leur tolérance est donc surtout liée à des arguments économiques.
iv La raison de cette augmentation est parfois aussi rattachée à une libération de la parole autour de ce sujet, qu’en pensez-vous ?
iv Quelles solutions peuvent être mises en place pour sensibiliser la population à ces questions ?
DB Il est important de reconsidérer la façon dont les enfants sont socialisés et comment les normes liées au genre leur sont transmises. Dans le cadre de l’éducation sexuelle, plus précisément, il est capital d’exposer la diversité et la fonction des organes génitaux féminins. Il faut aussi donner aux plus jeunes les outils pour comprendre les enjeux liés à l’apparence des sexes. Il me paraît également central de leur transmettre des clés pour développer un regard critique vis-à-vis des standards de beauté souvent arbitraires et évolutifs selon les époques et les cultures. /
DB Durant les entretiens menés dans le cadre de mon projet, j’ai au contraire pu constater le tabou qui peut s’établir autour de ce
L’obsession de manger sainement
Une attention excessive portée à la qualité de l’alimentation peut avoir des conséquences néfastes sur la santé. Ce comportement, l’orthorexie, touche notamment les jeunes. Un phénomène accentué par les réseaux sociaux.
«Ma valeur était exclusivement définie par ce que je mangeais. »
Mathilde Blancal, auteure du livre
Confidences d’une ex-accro des régimes1, revient avec humour sur son long combat contre les troubles du comportement alimentaire (TCA), et les comportements orthorexiques. « Faire attention à la qualité de sa nourriture est extrêmement valorisé dans nos sociétés occidentales. Sans le savoir, certaines personnes en me complimentant encourageaient mon comportement. Il y a aussi une certaine fierté à réussir à se plier à un tel régime alimentaire. J’avais l’impression d’être dans le juste et parfois même, un peu au-dessus des autres. »
* Éd. Jouvence, 2022
HISTOIRE
L’orthorexie a été décrite pour la première fois en 1997 par le médecin américain Steve Bratman. Loin de vouloir en faire une pathologie, le but consistait à ouvrir le débat sur une tendance qu’il avait de plus en plus observée chez ses patient·e·s.
Du grec « orthos » (correct) et « orexie » (appétit), l’orthorexie renvoie à une volonté excessive d’ingérer exclusivement des aliments considérés comme sains. Une personne orthorexique aura tendance à porter une attention démesurée à la qualité de sa nourriture, qu’elle classera de façon binaire : bonne ou mauvaise. « Je passais des heures au supermarché à choisir mes aliments et cuisinais également tout moi-même afin de ne rien ingérer de mauvais pour mon corps », résume Mathilde Blancal. Cette division peut amener la personne orthorexique à établir des règles strictes concernant son alimentation. « Cette catégorisation se base toutefois
sur une pensée dichotomique subjective, qui ne correspond pas à la réalité, aucun aliment n’étant intrinsèquement sain ou malsain », explique Maaike Kruseman, diététicienne en cabinet privé et chargée de cours à l’Université de Lausanne.
La limite à partir de laquelle une personne bascule d’une simple envie de privilégier une nourriture saine vers une préoccupation excessive reste di∞cile à déterminer.
ORIGINE
Les normes sociales telles que l’autodiscipline ou la valorisation d’une alimentation saine semblent jouer un rôle dans le développement d’une orthorexie. Celle-ci restant encore peu explorée, seules de futures recherches permettront de confirmer ces liens.
L’orthorexie n’est en effet pas encore reconnue comme un trouble mental et ne figure pas dans les classifications o∞cielles.
« C’est un phénomène nouveau, pour lequel il n’existe pas encore de définition o∞cielle, ni de critères standardisés pour son diagnostic. Ce qui rend la recherche des causes di∞cile.
L’orthorexie peut servir, entre autres, à exercer un contrôle sur l’anxiété ou à augmenter l’estime de soi. Les spécialistes supposent aussi qu’il existe des liens entre l’orthorexie, le perfectionnisme, la rigidité et la compulsion », détaille Carolin Janetschek, cheffe de clinique au sein de l’unité spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire du CHUV.
LES ADOS ET LES RÉSEAUX SOCIAUX
En Suisse, près de trois quarts des filles âgées de 16 à 20 ans souhaitent maigrir, selon le Swiss multicenter adolescent survey on health (Smash). Alors que l’anorexie mentale survient en général au début et à la fin de l’adolescence, la boulimie se déclare souvent plus tard, entre 18 et 21 ans, selon l’O∞ce fédéral de la statistique (OFS). Les réseaux sociaux
sont par ailleurs omniprésents dans leur vie : 98% des jeunes Suisse·esse·s disposent d’un profil sur au moins un réseau social, et plus de la moitié d’entre euxs·elles utilisent Instagram plusieurs fois par jour, selon l’étude suisse James 2022. « Durant l’adolescence, les jeunes s’orientent naturellement vers des modèles extérieurs à la famille. Aujourd’hui, Internet joue un rôle de plus en plus important à cet égard. Ainsi, les conseils nutritionnels non fondés scientifiquement peuvent représenter un danger pour les jeunes », souligne Christin Hornung, pédopsychiatre au CHUV.
Sous couvert de dénominations promouvant un mode de vie healthy, certains comptes véhiculent des injonctions délétères si elles sont consultées de façon excessive et sans recul. « Les contenus avec le hashtag ‹ What I eat in a day ›, où des filles incroyablement belles ingèrent 1000 calories par jour en buvant des smoothies et en mangeant des épinards, peuvent paraître très séduisants. Je me souviens m’être abonnée et désabonnée régulièrement de comptes qui m’intéressaient mais me faisaient paradoxalement énormément de mal », raconte Mathilde Blancal. Pour la diététicienne Maaike Kruseman, il s’agit d’un vrai problème de santé publique. « Le manque de chiffres et de données ne nous permet néanmoins pas encore d’évaluer le phénomène. »
CHIFFRES
En Suisse, 3,5% de la population souffre d’un TCA au cours de sa vie, selon l’Office fédéral de la statistique. Les femmes sont quatre fois plus touchées que les hommes (5,3% contre 1,5% de la population).
inégalité
Aggravés par la pandémie, les TCA restent plus difficiles à diagnostiquer chez les hommes que chez les femmes. Une récente étude britannique a toutefois révélé une augmentation de 128% des cas entre 2016 et 2021.
PRISE EN CHARGE DÉLICATE
L’absence de critères scientifiques permettant d’identifier une orthorexie empêche la pose d’un diagnostic à proprement parler. Des questionnaires, disponibles en ligne, sont parfois utilisés comme outils de dépistage de l’orthorexie. Leur pertinence reste cependant vivement critiquée. « La prévalence varie d’un pays à l’autre, d’une population à l’autre, ainsi qu’en fonction de l’outil utilisé pour l’évaluation. Les résultats peuvent aller de 6,9% à 75,5% », rapporte Christin Hornung. La question de la nécessité d’un traitement peut se poser dans certains cas. « Si le comportement
alimentaire entrave le développement physique et mental normal d’un adolescent – que cela se manifeste par des carences ou un retrait social – ou si l’adolescent et ses proches sont en souffrance, il peut valoir la peine de consulter », explique Carolin Janetschek. Certaines catégories de la population comme les sportif·ve·s sont par ailleurs plus à risque de développer un tel trouble (voir aussi encadré).
L’enjeu réside enfin dans la prise en charge des patient·e·s par une équipe professionnelle. « Il existe une appropriation de la thématique nutritionnelle alimentaire par des personnes qui ne sont pas formées dans le domaine, explique Maaike Kruseman. Les conseils souvent trop réducteurs de certain·e·s nutritionnistes – dont le titre n’est pas protégé en Suisse – peuvent parfois faire de nombreux dégâts. Mieux vaut donc s’adresser à un diététicien diplômé, par exemple, qui établira un suivi et un rééquilibrage alimentaire sur mesure. » /
CARENCES
L’orthorexie peut entraîner des symptômes somatiques tels qu’un manque de certaines substances dans le sang, de vitamines, de fer ou de calcium, un déficit de croissance, voire une aménorrhée – une absence de règles.
Déficit énergétique relatif dans le sport
Le contrôle de l’alimentation peut améliorer les performances sportives et éviter les blessures. Mais, les apports caloriques doivent aussi permettre de couvrir les dépenses d’énergie et de bien récupérer. « Dans des sports esthétiques ou gravitationnels, la minceur peut parfois améliorer les performances. Or, elle peut aussi menacer le bon fonctionnement de l’organisme si l’athlète est en déficit énergétique », précise Nathalie Wenger, médecin du sport, cheffe de clinique au sein du Centre SportAdo du CHUV.
Anciennement appelé « Triade de l’athlète féminine », le syndrome du RED-S (Relative Energy Deficiency in Sports) touche de nombreuses personnes. Le sujet reste toutefois méconnu en Suisse, à la fois
par les médecins du sport, les coachs sportifs et les athlètes, et certains symptômes comme une absence de menstruations demeurent tabous. « La prévention est essentielle en raison des conséquences potentiellement irréversibles sur les corps, les os ou le psychisme. Nous recommandons un bilan médicosportif annuel pour les jeunes effectuant plus de trois entraînements sportifs par semaine. »
L’association faîtière du sport suisse (Swiss Olympic) souhaite répondre à cet enjeu avec le lancement fin 2019 du projet « Femme et sport d’élite », qui vise notamment à démystifier certains sujets « tabous » comme le RED-S.
JE PENSE DONC JE MARCHE
Appliquée à la santé, l’intelligence artificielle permet des avancées fascinantes. Grâce à cette technologie, un patient paraplégique a retrouvé le contrôle de ses jambes par la pensée.
Ce n’est ni la première ni la dernière fois
qu’Elon Musk fait parler de lui. En décembre dernier, l’entrepreneur sudafricain annonçait que sa start-up Neuralink saurait implanter son premier appareil connecté dans le cerveau d’un être humain dans les six mois à venir. L’objectif ?
Booster le cerveau d’un individu en parfaite santé, pour le rendre encore plus efficient. Le milliardaire avait annoncé en juillet 2019 que Neuralink réaliserait ses premiers essais sur des humains l’année d’après. Il aura finalement fallu attendre
mai 2023 pour que les autorités sanitaires américaines autorisent des tests d’implants sur des humains par Neuralink.
UNE INNOVATION SPECTACULAIRE
AU CHUV-EPFL
Plus près de chez nous, la recherche autour de l’intelligence artificielle appliquée à des fins thérapeutiques avance également. Une équipe du centre NeuroRestore, à Lausanne, vient de développer un implant cérébral permettant de faire remarcher une personne paralysée grâce à la pensée, c’est-à-dire en lui faisant imaginer et visualiser les mouvements souhaités. Une nouvelle étape spectaculaire menée par la neurochirurgienne
Jocelyne Bloch, au CHUV, et le neuroscientifique Grégoire Courtine de l’EPFL, un duo bien connu dans le milieu.
En 2018, l’équipe pluridisciplinaire parvenait déjà à redonner la possibilité de marcher à des personnes paraplégiques grâce à des électrostimulations diffusées sous la lésion de la moelle épinière. Ce projet, c’était Stimo (cf. dossier dans IV n° 24). Depuis, un palier supplémentaire a été franchi, en impliquant cette fois le cerveau. Avec ce nouveau système, la personne est toujours équipée d’un implant au niveau de la moelle épinière au-dessus de la blessure, mais aussi d’un deuxième implant inséré dans le cortex cérébral.
« Cet implant permet de décoder l’intention motrice du patient au niveau cérébral, explique Henri Lorach, chef du projet. L’intention détectée est convertie en impulsions électriques sur la moelle épinière qui va engendrer le mouvement voulu. Il s’agit donc de restaurer la connexion entre le cerveau et la moelle épinière, par un pont digital. » (Voir encadré).
À ce jour, le nouveau dispositif –BSI, pour Brain-Spine-Interface –, développé en collaboration avec l’équipe de recherche Clinatec du CEA de Grenoble, a fait l’objet d’un seul essai clinique sur un patient qui avait déjà participé à l’étude Stimo. « Cette étude pilote devrait se faire sur deux patients, mais pour l’instant nous n’en n’avons inclus qu’un seul »,
précise Jocelyne Bloch. D’autres essais sont prévus pour la réactivation des membres supérieurs. L’équipe vient en effet d’obtenir les autorisations de SwissMedic et de SwissEthics qui valident l’essai pour les bras.
DES RÉSULTATS SATISFAISANTS
APRÈS UNE SEMAINE
Dans le futur, l’intégration des deux implants pourrait se faire en une seule intervention chirurgicale. Avec le patient concerné, qui portait déjà le capteur au niveau de la moelle épinière, l’équipe a pu décoder les signaux de la marche très rapidement, puis l’entraîner à ressentir et à imaginer ses mouvements. Après une semaine environ, et en moins de dix séances, il a pu faire ses premiers pas.
COMMENT ÇA FONCTIONNE
L’implant cérébral testé par le centre NeuroRestore s’insère à la surface du cerveau au niveau de l’os du crâne. Doté de 64 électrodes, il fait 5 centimètres de diamètre. Son rôle est de recueillir des signaux électriques provenant du cortex moteur, permettant ainsi à un programme informatique de détecter les signaux en lien avec la marche, de décoder les mouvements des différentes articulations d’un membre.
Un petit ordinateur est placé sur le dos du·de la patient·e. L’intention de ce·tte dernier·ère, par exemple lever le pied gauche pour faire un pas, est transmise à l’ordinateur par un programme spécifique, puis au stimulateur situé sur l’endroit lésé de la moelle épinière, qui diffuse une électrostimulation et génère l’action en question.
La grande avancée par rapport à Stimo, c’est que l’implant cérébral permet une marche plus fluide, même si elle reste plus lente que celle d’un individu valide et qu’elle nécessite une aide telle que des béquilles ou un déambulateur. « C’est le cerveau du patient qui déclenche le mouvement, et non un programme externe, expose Jocelyne Bloch. Il s’agit donc exactement du même mécanisme que celui présent chez une personne valide, même si pour cette dernière, le mouvement se fait automatiquement. »
UNE COMPÉTITION
QUI N’EN EST PAS UNE
Quant à la course aux implants cérébraux, la neurochirurgienne Jocelyne Bloch ne se formalise
Visualiser clairement les actions à effectuer demande un entraînement, qui se fait d’abord devant un écran, par le contrôle d’un avatar virtuel. On procède ainsi pour une articulation après l’autre. Une séance permet déjà de déceler les signaux identifiables pour quatre articulations, le genou gauche, le genou droit, la hanche gauche et la hanche droite, par exemple.
Après une année d’utilisation régulière du Brain-SpineInterface (BSI), le patient ayant participé à l’essai clinique marche aujourd’hui en s’aidant d’un déambulateur : « Je peux lancer le mouvement avec mon cerveau, je peux même parler en effectuant le mouvement. Si je le veux, je peux maintenir un pied en l’air avant de le reposer. Je peux décider de l’endroit où je m’arrête, faire un pas plus grand que l’autre, et je peux continuer ainsi tant que je veux. »

« Je peux lancer le mouvement avec mon cerveau », explique le patient qui a retrouvé la marche grâce à un implant cérébral.
pas. « Cette compétition déclarée est plus un amusement qu’autre chose. C’est positif que plusieurs personnes travaillent dans le domaine, cela fait avancer les choses. » D’autres institutions dans le monde participent à ce type de recherches. Le centre Clinatec, à Grenoble, a développé et utilise le même dispositif cortical que l’équipe du CHUVEPFL, « à la différence près que les intentions du patient
contrôlent un exosquelette qui assiste les mouvements, alors que notre projet vise à ce que le patient retrouve le contrôle de ses propres muscles », explique Henri Lorach.
Pour l’instant, la technologie développée est surtout prévue pour réparer les lésions de la moelle épinière. « Dans l’absolu, il serait possible de rétablir le circuit dans d’autres types de pathologies,
par exemple dans le cas d’un AVC, si le cortex est toujours enregistrable », avance Jocelyne Bloch. Potentiellement, le système pourrait aussi s’appliquer à des individus atteints de la maladie de Parkinson, pour rectifier des troubles de la marche. /
QUAND LES ÉMOTIONS DÉTRAQUENT LE CŒUR
Les émotions intenses peuvent provoquer une pathologie cardiaque grave qui touche principalement les femmes et imite l’infarctus : le syndrome du cœur brisé.
Le culte dominical ne s’est pas déroulé comme prévu pour Simone Vaucher, une enseignante vaudoise retraitée de 78 ans. À côté d’elle sur le banc, une femme vacille à plusieurs reprises puis s’effondre. Choquée, l’ex-enseignante la croit morte. Finalement, la personne semble se remettre de son malaise, mais Simone Vaucher, pour sa part, demeure angoissée. « Une fois chez moi, j’ai mis trois heures à me reprendre. Mon cœur tapait et ma respiration brûlait, je ne savais pas si c’étaient les
poumons ou le cœur », décrit-elle. Incapable de s’en remettre, elle consulte son généraliste qui l’envoie aux urgences du CHUV suspectant un infarctus du myocarde. Mais les investigations mènent à une autre piste : elle a été victime du syndrome de takotsubo, ou syndrome du cœur brisé.
UN CŒUR EN FORME D’AMPHORE
Le syndrome de takotsubo est une atteinte cardiaque qui survient souvent à la suite d’une situation de stress intense. Les cardiologues ne savent pas comment le
COMME UNE AMPHORE DANS LE CŒUR
À la suite d’une situation de stress, il arrive que le muscle cardiaque ne se contracte pas suffisamment. Une forme d’amphore apparaît. C’est le syndrome de takotsubo.
Ventricule gauche sain
CŒUR « NORMAL »
prévenir, car il n’est pas encore entièrement compris. Cependant, il a été démontré que les niveaux de catécholamines, les hormones du stress, sont en augmentation massive lors de l’apparition de ce syndrome. En conséquence, le muscle cardiaque ne se contracte pas suffisamment au niveau de la pointe du cœur, ce qui l’empêche de fonctionner correctement. Une partie du cœur prend alors une forme caractéristique d’amphore.
« L’élément déclencheur peut être un stress émotionnel ou physique », précise
Sarah Hugelshofer, cardiologue au Service de cardiologie du CHUV. La majorité des cas émotionnels surviennent lors d’un choc, par exemple à l’annonce d’un décès, même s’ils peuvent également survenir lors de situations heureuses comme l’annonce d’un gain à la loterie. Les stress physiques concernent la moitié des cas et sont déclenchés par une activité physique intense pour laquelle les personnes ne sont pas préparées, une douleur sévère ou des affections neurologiques comme les AVC ou les crises d’épilepsie. Des antécédents psychiatriques tels que l’angoisse et la dépression augmentent la prédisposition au syndrome. De plus,
une composante héréditaire existe probablement, car on trouve des familles présentant plusieurs cas.
Le syndrome touche neuf femmes pour un homme. Les femmes sont principalement concernées dès l’approche de la ménopause, ce qui suggère un lien avec la baisse d’œstrogènes. « Ces hormones sont connues pour leur effet protecteur contre les maladies cardiovasculaires, mais leur association au syndrome du cœur brisé n’est pas clairement comprise, tout comme les facteurs qui déterminent l’évolution de la maladie », reconnaît la cardiologue.
ÉCARTER L’INFARCTUS
LES FEMMES, OUBLIÉES DE LA CARDIOLOGIE
Le syndrome de takotsubo, parce qu’il touche principalement les femmes, est encore peu compris, dans une médecine des hommes faite pour les hommes. Aujourd’hui encore, les femmes meurent deux fois plus que les hommes des suites d’une maladie cardiovasculaire, takotsubo compris, notamment parce que les femmes sont sousreprésentées dans les études cliniques sur lesquelles sont définis les protocoles de prise en charge ou les tests de traitements. Il s’ensuit une cardiologie genrée, dans laquelle les femmes sont encore trop souvent moins bien traitées que les hommes.
Les symptômes, quant à eux, sont mieux connus. Ils sont similaires à ceux de l’infarctus du myocarde : douleur thoracique, essoufflement et perte de connaissance. Malheureusement, ils ne peuvent être immédiatement différenciés, car « les électrocardiogrammes initiaux
Le ventricule hypertrophié pompe le sang moins efficacement
Il prend la forme d’une amphore, un piège à pieuvre japonais nommé « takotsubo »
sont les mêmes, tout comme les marqueurs sanguins », indique Sarah Hugelshofer. Cependant, une coronarographie – une technique d’imagerie invasive basée sur les rayons X utilisée pour visualiser les artères menant au cœur – peut précisément aider à diagnostiquer l’infarctus du myocarde, car il est causé par une artère partiellement ou entièrement bouchée visible avec cette méthode. « S’il n’y a pas d’occlusion visible, on cherche autre chose comme une inflammation du myocarde ou un takotsubo. Une échographie et souvent une IRM du cœur sont alors réalisées pour établir le diagnostic final. »
Comme l’occlusion artérielle responsable de l’infarctus entraîne la mort des cellules cardiaques et mène au décès dans les cas graves, il est important d’intervenir rapidement pour rétablir le flux sanguin. Alors que pour le syndrome du cœur
DEUX JOURS CRITIQUES
Le syndrome de takotsubo touchait une personne sur 36’000 en 2018, selon le European Heart Journal, et représentait 1 à 3% des patient·e·s avec une suspicion d’infarctus du myocarde. Les statistiques grimpent à 6% pour les patientes et seraient sous-estimées. Le risque d’arrêt cardiaque ou d’arythmie pouvant entraîner la mort est similaire pendant les premières quarantehuit heures pour le syndrome de takotsubo et pour l’infarctus du myocarde. Passé ce délai, le pronostic à long terme est excellent pour le syndrome de takotsubo. Le cœur se rétablit complètement dans les deux mois suivant le diagnostic. Le taux de récidive est de 1 à 5% au cours des cinq années suivant l’attaque.
brisé, une hospitalisation avec surveillance cardiaque et un traitement médicamenteux sont nécessaires. « Il est donc crucial de différencier les deux pathologies par une imagerie des coronaires », détaille la cardiologue.
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EN SOUTIEN Récemment, une équipe de recherche de l’EPFZ et de l’Université de Zurich a conçu un outil basé sur l’intelligence artificielle pour tenter de faciliter la différenciation du takotsubo avec l’infarctus. « Habituellement, elle se fait par coronarographie, mais nous voulions tester le potentiel de l’échographie pour le diagnostic. Nous avons d’abord entraîné notre intelligence artificielle à partir de données d’échocardiographie d’individus dont le diagnostic était connu afin qu’elle apprenne automatiquement à identifier et extraire des informations pertinentes pour le diagnostic. Nous l’avons ensuite testée sur d’autres données et comparée à l’humain », indique Fabian Laumer doctorant au Department of Computer Science de l’EPFZ et premier auteur de cette étude. Comparé aux cardiologues, l’outil s’est avéré légèrement plus efficace et plus rapide. « Mais il est encore loin d’atteindre la précision obtenue avec la coronarographie », précise le chercheur.
L’intelligence artificielle est déjà utilisée en cardiologie pour mesurer la fonction cardiaque en complément des analyses manuelles, notamment pour les images d’IRM. « Bien qu’elle ne puisse pas remplacer les personnes, dans certains cas elle peut être plus fiable, car un ordinateur applique une analyse qui est parfaitement reproductible contrairement aux différents opérateurs humains », ajoute Sarah Hugelshofer. /
DES MÉTHODES TOUJOURS PLUS SOPHISTIQUÉES CONTRE LE DOPAGE
ANDRÉE-MARIE DUSSAULT
À partir de l’urine et du sang des athlètes, différentes techniques sont utilisées pour identifier la potentielle présence de produits dopants. Sans cesse plus sensibles, celles-ci rendent la tricherie plus difficile. Trajectoire d’un échantillon au sein du Laboratoire suisse d’analyse du dopage.
Bienvenue au Laboratoire suisse d’analyse du dopage du Centre universitaire romand de médecine légale. Ici travaillent des expert·e·s en chimie, biologie, pharmacie et sciences forensiques, comme Nicolas Jan. Dans le monde, une trentaine de laboratoires de ce type sont accrédités par l’Agence mondiale antidopage pour faire un travail bien particulier. « Sur les 11 infractions établies par cette structure, nous nous concentrons principalement sur la première : détecter les substances interdites destinées à augmenter les capacités physiques ou mentales d’un athlète dans un échantillon de sang ou d’urine fourni par un sportif », explique le chercheur.
Les échantillons analysés sont fournis par une fédération sportive internationale ou nationale, ou
une agence antidopage et sont anonymes, relève-t-il. À partir du moment où il reçoit un kit d’urine ou de sang, le laboratoire a vingt jours pour rendre les résultats au partenaire. Les kits reçus sont composés de deux conteneurs. Le premier échantillon est utilisé pour l’analyse, le second est conservé intact, en cas de contestation par l’athlète.
500 substances interdites dans 100 microlitres
Dans un premier temps, l’intégrité de l’échantillon est contrôlée, pour s’assurer qu’il n’a pas été manipulé. Ensuite, l’échantillon est séparé en sous-échantillons, afin de subir plusieurs types d’analyses chimiques ou biologiques. Pour ce faire, les échantillons doivent d’abord passer par une phase de purification, où ils sont débarrassés de tout ce qui pourrait interférer dans le processus d’analyse. « Lors de cette étape, on part d’un volume relativement grand, pouvant aller jusqu’à 15 ml, pour se retrouver finalement avec moins de 100 microlitres », détaille Nicolas Jan. Ces opérations peuvent prendre jusqu’à une semaine. Une série de tests standards de dépistage est appliquée à tous les échantillons. Ce contrôle permet de détecter quelque 500 substances interdites.
« Selon le sport et les demandes de nos clients,
ou s’il y a des suspicions envers un athlète, nous pouvons réaliser des tests supplémentaires. »
Comme le nombre de substances qui doivent être recherchées est substantiel, une première phase d’analyses dites « rapides » permet d’exclure tous les échantillons négatifs, c’est-à-dire ceux qui ne contiennent aucune trace de substance prohibée. « Tandis que pour ceux qui présentent une suspicion, on repart de l’échantillon initial et on fait une analyse de confirmation en utilisant une méthode analytique dédiée spécifiquement à la substance que nous suspectons. » Si tout va bien, ce dépistage prend environ une semaine. Les instruments d’analyse fonctionnent 24 heures sur 24, avec une cinquantaine d’échantillons testés à la fois.
Ensuite, les résultats sont lus et interprétés par deux personnes indépendantes. Puis le résultat final est validé par la direction du laboratoire avant d’être rendu au·à la client·e qui en notifiera l’athlète. « Si le résultat est positif, soit celui-ci l’acceptera et sera sanctionné : quatre ans de suspension pour une première infraction ou exclusion à vie pour une seconde, soit il contestera et pourra demander l’analyse du deuxième échantillon », signale-t-il, spécifiant que dans le monde, entre 1 et 2% des échantillons testés contiennent des substances interdites.
En plus des analyses chimiques, le Laboratoire suisse d’analyse du dopage effectue des recherches afin de suivre certaines variables biologiques chez les athlètes. « Ces suivis permettent de mettre en évidence d’éventuelles variations, notamment au niveau sanguin au cours du temps. » Ces valeurs sont inscrites dans le passeport biologique de l’athlète.
Ce système, développé au Laboratoire suisse dans les années 2000 et introduit par l’Agence mondiale antidopage en 2009, permet de révéler indirectement des pratiques de dopage. « Certaines substances ou méthodes de dopage ne peuvent pas être détectées directement ; par exemple la transfusion sanguine autologue (un athlète qui se réinjecte son propre sang), mais des marqueurs indirects peuvent le mettre en évidence. »
Au niveau mondial, les sports les plus touchés par le dopage sont le culturisme (22% des infractions en 2019), l’athlétisme (18%) et le cyclisme (14%).
Dopage ou contamination ?
La complexité du contrôle du dopage repose principalement sur les « micro-dosages », di∞cilement détectables ou des substances qui ne circulent pas encore sur le marché et pour lesquelles aucune méthode n’est encore implémentée dans les laboratoires. Nicolas Jan rappelle le scandale qui a secoué l’entreprise Balco, au début des années 2000, aux ÉtatsUnis, qui produisait une substance dopante indétectable aux contrôles, consommée par des athlètes de très haut niveau.
À l’inverse, la sophistication des méthodes de détection complique le processus. « Les techniques pour repérer les substances interdites sont devenues si sensibles qu’il devient parfois di∞cile de distinguer s’il s’agit de produits dopants ou d’une contamination, explique Patrik Noack, médecinchef de Swiss Cycling et de Swiss Athletics et Health Performance O∞cer de l’équipe olympique suisse. Si l’athlète consomme de la viande d’animaux d’élevage ou des produits végétaux traités avec des médicaments ou des produits chimiques, ces substances peuvent apparaître lors des tests. » Le spécialiste évoque aussi les contraintes liées à cette pratique. « Les athlètes du pool de contrôle international doivent se rendre disponibles pour un test une heure par jour, souvent très tôt le matin. Ceci peut être contraignant quand on est en phase d’entraînement intensif. »
En 2021, quelque 2200 tests ont été commandités par la Swiss Sport Integrity, le centre de compétences suisse de lutte contre le dopage, indique son directeur, Ernst König. Il précise qu’un contrôle coûte en moyenne 1000 francs. Le nombre de tests dans chaque sport est fixé selon une analyse des risques. « Puis une équipe de scientifiques sportifs détermine quels athlètes tester à l’aide de différents critères comme les performances, les résultats ou les analyses précédentes. » Les stratégies scientifiques antidopages
ont beaucoup évolué, confirme-t-il. « Le clivage entre les méthodes pour tricher et celles pour détecter les substances interdites a diminué de façon notoire. » Il relève par ailleurs que même s’il y a toujours de nouvelles substances sur le marché, celles utilisées il y a vingt ans – notamment les stéroïdes – le sont encore aujourd’hui.
Contrairement aux pays voisins comme la France, l’Allemagne ou l’Italie, l’autodopage n’est pas punissable en Suisse, note-t-il. Un postulat parlementaire a mandaté le Conseil fédéral pour qu’il se penche sur la question. « Le statut de Swiss Olympic concernant le dopage, fondé sur le Code mondial antidopage de l’AMA, relève du droit privé ; il faudrait évaluer, entre autres choses, s’il serait juste que l’athlète soit puni deux fois. » /
Les substances dopantes les plus fréquemment dépistées dans le monde sont les stéroïdes anabolisants, stimulants, diurétiques et agents masquants.
RECHERCHE
Dans ce « Labo des humanités », In Vivo vous fait découvrir un projet de recherche de l’Institut des humanités en médecine (IHM) du CHUV et de la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL.
Les traumatismes familiaux silencieux de la migration
SALVATORE BEVILACQUA & ELENA MARTINEZ / IHM

Selon Toni Ricciardi (2022), la Suisse aurait abrité entre 1949 et 1975 près de 50’000 « enfants du placard », pour ne parler que des Italiens. Ce chiffre est décuplé si on considère les autres formes de séparation induites par l’impossibilité du regroupement familial. Voir : bit.ly/43q59WQ
« J’ai été déracinée sans avoir la possibilité de m’enraciner à nouveau. Je me suis retrouvée du jour au lendemain avec mes parents, ces inconnus… qui le sont toujours un peu aujourd’hui. » Ces propos sont ceux de Mme E.B., dont les premières années ont été marquées par un long séjour de huit ans au Portugal, pays d’origine de ses parents qui travaillaient à Luins (VD) en tant que saisonnier·ère·s. À l’instar de nombre d’enfants d’immigré·e·s portugais·es, italien·ne·s, espagnol·e·s et ex-yougoslaves arrivés en Suisse entre 1950 et 1980, E.B. a été élevée au Portugal par ses grandsparents, puis par une tante, avant d’être rapatriée en Suisse en 1985 par ses parents et « régularisée », c’est-à-dire autorisée à les rejoindre dans le cadre d’un regroupement familial finalement admis sur le plan légal par l’obtention d’un permis de séjour annuel.
« Une personne ne naît pas irrégulière ou clandestine, une personne naît en tant que personne », rappelle Toni Ricciardi, historien de l’émigration à l’Université de Genève, dans le film documentaire Non far rumore (« Ne fais pas de bruit ! ») réalisé par RAI 3 en 2019.
« Régularisée » ? Derrière son apparente innocuité, le terme abrite en réalité une redoutable violence institutionnelle, dont les effets se font sentir aujourd’hui encore chez Mme E.B. et beaucoup d’autres
enfants clandestins, dont lesdits « enfants du placard », que certains parents, ne pouvant se résoudre à une séparation, prirent le risque de garder, la peur au ventre, auprès d’eux·elles en Suisse. Ces dernier·ère·s ne se doutaient pas qu’une telle décision « par défaut », permettant de contourner une loi particulièrement dure, pouvait grever, longtemps après, l’estime de soi ou la santé de leurs enfants, au même titre que ces autres « solutions » consistant à les confier à de la famille restée dans le pays d’origine, ou à les placer dans des institutions d’accueil.
Salvatore Bevilacqua, anthropologue de la santé, interdit de séjour jusqu’à l’âge de 4 ans bien que né en Suisse, étudie la question des séquelles des séparations affectives familiales – mais aussi, comme dans le cas de Mme E.B., de retrouvailles traumatisantes – sur la construction identitaire de ces enfants « fantômes » et de leurs parents. Réalisée dans le cadre de l’Institut des humanités en médecine, avec le soutien de la Fondation Leenaards, sa recherche recueille les témoignages de personnes directement concernées et analyse les interactions entre ces épisodes marquants de leur vie, leurs trajectoires de santé et les liens familiaux intergénérationnels. Le projet propose ainsi une compréhension originale de cette thématique, en développant une perspective de santé publique, croisant histoire de la migration en Suisse et anthropologie de la santé. /
CAROLE CLAIR
CORESPONSABLE DE L’UNITÉ SANTÉ ET GENRE UNISANTÉ, FACULTÉ DE BIOLOGIE ET MÉDECINE, LAUSANNE
« Et si le patient était une patiente »
La sensibilisation à la question de l’influence du genre en médecine est abordée, avec les étudiant·e·s, par la reprise de situations concrètes. On se demande alors ce qui aurait été différent si le patient avait été une patiente ou inversement. Aujourd’hui encore, on observe effectivement la puissance de l’ancrage des stéréotypes et leur impact sur les choix de prise en charge. Situation classique : lorsqu’une personne se présente aux urgences avec une dégradation de sa santé mentale, l’investigation sera davantage orientée vers la sphère professionnelle pour les hommes, tandis que pour les femmes le personnel médical aura tendance à davantage se concentrer sur la sphère familiale. Ces disparités ont pourtant un enjeu vital, le fait que le diagnostic de dépression est plus di∞cile à poser chez les hommes se reflète ensuite dans un taux de suicide quatre fois plus élevé que chez les femmes.
Ces biais se dessinent déjà au niveau de la construction du savoir. La recherche autour des maladies cardiovasculaires s’est particulièrement concentrée sur un profil type d’homme blanc
PROFIL
Carole Clair est coresponsable de l’Unité santé et genre à Unisanté, à Lausanne, avec la sociologue Joëlle Schwarz depuis 2019. Elle mène actuellement plusieurs projets de recherche sur le sujet du genre et de son influence en santé et collabore avec les autres universités suisses pour l’amélioration de l’enseignement du genre en médecine.

pour ensuite extrapoler les connaissances aux autres groupes. Une méthode remise en question face à la surmortalité des femmes victimes d’infarctus, par exemple. Ce constat a généré une inversion de la tendance et les études en cardiologie sont les premières à avoir intégré davantage de femmes.
Pour tenter de cerner les différences entre les genres, il faut observer les variations biologiques telles que la répartition des graisses ou encore les hormones, mais il est aussi nécessaire de tenir compte du contexte social. Il est par exemple démontré que les femmes présentent plus de sensibilité à la douleur. Lors des expériences menées pour étudier ce phénomène, des hommes et des femmes ont été exposés à des stimuli douloureux. Effectivement, il est particulièrement complexe de savoir si l’écart repose sur un aspect biologique ou social et si les femmes ressentent effectivement plus fort la douleur ou s’autorisent plus facilement à dire « j’ai mal ».
Heureusement, des changements s’opèrent. Au niveau européen, par exemple, il est exigé pour toute recherche de travailler avec un échantillon mixte intégrant des femmes, des hommes et des personnes non blanches, lorsque cela est pertinent. On observe aussi que l’augmentation de femmes médecins permet de s’intéresser à des maladies jusqu’alors négligées.
SURVEILLER LES EAUX USÉES POUR PRÉVENIR LES PANDÉMIES
L’analyse d’échantillons provenant de stations d’épuration devient toujours plus précise. Plusieurs initiatives ont été lancées en Suisse pour mettre en place un système d’alerte en cas de pandémie basé sur cette approche.
TEXTE : ERIK FREUDENREICH
Traquer le Covid-19 en étudiant les eaux usées des toilettes des avions. C’est l’une des mesures recommandées par l’Union européenne en début d’année, à la suite de la flambée de cas enregistrés en Chine. Les autorités de plusieurs pays, dont la Belgique et le Canada, ont décidé d’implémenter cette méthode d’analyse. Concrètement, les eaux usées sont extraites dès l’atterrissage de l’appareil et transmises à un laboratoire. Celui-ci procède alors à un séquençage qui permet d’identifier les variants présents et d’évaluer le degré de circulation du virus.
Les aéroports de Genève et de Zurich n’ont pas adopté cette mesure pour l’instant. Mais elle fait l’objet d’un projet de recherche amorcé au moment de la crise sanitaire
par des équipes de recherche suisses, en collaboration avec l’Eawag, l’Institut fédéral pour l’aménagement, l’épuration et la protection des eaux (voir encadré). Les scientifiques ont notamment réussi à détecter la présence du Covid-19 dans les eaux usées à travers des échantillons prélevés lors de la première phase de la pandémie. À terme, l’objectif vise à constituer un système d’alerte précoce. Plusieurs initiatives sont d’ailleurs en cours au niveau suisse pour instaurer un tel dispositif de manière pérenne.
COMPRENDRE L’IMPACT
« L’analyse des eaux usées est une approche intéressante, qui peut donner beaucoup de renseignements sur l’activité humaine et l’impact sur l’environnement, y compris l’apparition de pathologies », explique Marc Augsburger, responsable
de l’Unité de toxicologie et de chimie forensiques (UTCF), qui fait partie du Centre universitaire romand de médecine légale. C’est un sujet qui suscite un fort intérêt auprès des scientifiques depuis une vingtaine d’années, et ce, pour plusieurs raisons. « La première, c’est que les eaux usées sont le reflet d’une activité humaine d’un bassin de population donné et que leur analyse permet d’éviter de faire des prélèvements biologiques sur un nombre important de personnes. »
Elle permet aussi de mieux comprendre et de prévenir l’impact de certaines industries ou infrastructures. « Un hôpital, par exemple, délivre beaucoup de médicaments, dont certains présentent une certaine toxicité pour l’environnement ou les humains. Comme ces molécules ne peuvent souvent pas être filtrées par les stations d’épuration,

Dans le laboratoire de Dübendorf, en Suisse, une collaboratrice place des échantillons d’eaux usées dans un congélateur, à -60 degrés. Le département de microbiologie environnementale de l’Institut fédéral des sciences et technologies aquatiques s’intéresse à la surveillance des coronavirus dans les eaux usées.
UN PROJET DE RECHERCHE DU FONDS NATIONAL SUISSE
Quels sont les moteurs de propagation des virus ? À quelle vitesse peut-on identifier les variants responsables d’une vague ? Comment un virus pandémique devient-il endémique ? Voici quelques-unes des questions soulevées par le projet « WISE » (Wastewater-based Infectious Disease Surveillance) du Fonds national suisse. Celui-ci réunit des chercheur·euse·s de l’Institut fédéral pour l’aménagement, l’épuration et la protection des eaux et des écoles polytechniques fédérales de Zurich et de Lausanne.
L’étude a commencé au mois de novembre 2022 et vise à développer les méthodes et les analyses de la surveillance des maladies infectieuses basée sur les eaux usées établies au moment de la pandémie de Covid-19. Des échantillons sont analysés chaque semaine à partir de six stations d’épuration réparties en Suisse.
disposer d’informations provenant des eaux usées permet de procéder à une meilleure analyse de risques et d’implémenter des mesures plus en amont. »
L’expert souligne cependant les défis techniques qui restent à relever en la matière. « Cela demeure une méthode d’analyse qui est davantage qualitative
que quantitative. Ainsi, les concentrations mesurées ne seront pas les mêmes à la suite d’un orage ou pendant une période de sécheresse. »
Aussi, les molécules rejetées dans l’urine ont été transformées par le corps, ce qui là encore complique le calcul des concentrations. D’autant plus qu’il faut avoir auparavant identifié les marqueurs pertinents des substances recherchées. « Un tel monitoring se montre particulièrement intéressant s’il est effectué dans le temps. Par exemple, on peut observer une augmentation de la présence de substances illicites dans un endroit donné au moment de l’organisation d’un événement de grande ampleur comme un festival de musique. »
ACCÉLÉRER LA PRISE DE DÉCISION
Le think tank suisse Pour Demain vient de publier une étude sur les avantages d’un système d’alerte précoce institutionnalisé basé sur l’analyse continue des eaux usées. Réalisé en collaboration avec le cabinet de conseil Eraneos et le bureau d’études Infras, le rapport souligne qu’un tel dispositif permettrait d’économiser jusqu’à 30 milliards de francs en cas de pandémie en Suisse.
L’étude suggère d’instaurer une surveillance permanente de cinq agents pathogènes présentant le plus grand potentiel pandémique dans 50 à 100 stations d’épuration
en Suisse, soit le Covid-19, les autres coronavirus, les virus de la grippe, la variole et la rougeole. Une mesure complétée par le séquençage génomique de ces agents pathogènes à partir d’échantillons provenant des hôpitaux, des cabinets médicaux et des eaux usées, ainsi qu’une meilleure gestion des données récoltées pour permettre une prise de décision plus rapide en cas de crise sanitaire.
« Un système d’alerte précoce agit comme un détecteur à incendie ou un bulletin d’avalanches », illustre Laurent Bächler, chargé de programme biosécurité du think tank Pour Demain. « La surveillance des agents pathogènes peut éviter des coûts humains et économiques importants, non seulement en période de pandémie, mais aussi en temps normal, par exemple grâce à une meilleure connaissance des bactéries résistantes aux antibiotiques. »
UN
FORT RETOUR
SUR INVESTISSEMENT
L’étude a pris en compte trois scénarios : une pandémie similaire au Covid-19, une pandémie forte et une situation pandémique extrême. Elle estime les pertes humaines et économiques évitées lors de la première apparition d’un agent pathogène dangereux, grâce à l’avance gagnée par le système d’alerte, permettant par exemple de décréter un confinement cinq ou dix jours plus tôt.
FONCTIONNEMENT D,UN SYSTÈME
D,ALERTE PRÉCOCE EN CAS DE PANDÉMIE
1 2
Récolte d’échantillons d’eaux usées auprès de stations d’épuration, d’hôpitaux et de cabinets médicaux.
3
Recherche d’agents pathogènes dans les échantillons par séquençage génomique.
4
Analyse et interprétation des données au sein d’une plateforme centralisée.
« La prochaine pandémie n’est qu’une question de temps et la probabilité qu’elle soit plus grave que le Covid-19 est élevée, soulignent les auteurs de l’étude. Avec des dépenses annuelles d’environ 5 millions de francs en cas de situation normale, non pandémique, les coûts d’investissement sont faibles par rapport aux avantages positifs étendus – plus d’un milliard de francs dans un cas de pandémie similaire à celle
Prise de décision accélérée pour les autorités concernant les mesures à mettre en place pour réduire la propagation des agents pathogènes détectés.
du Covid-19, et jusqu’à 15 à 30 milliards dans les scénarios forts et extrêmes. Des études de l’Imperial College London et de McKinsey montrent que les investissements dans la préparation et la lutte contre les pandémies sont rentables. »
Des débats sur l’adoption d’un tel système sont également en cours au niveau politique. Ainsi, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique
du Conseil national a déposé en fin d’année dernière un postulat pour que le Conseil fédéral étudie l’extension du monitoring des eaux usées du Covid-19 à d’autres pathogènes. Le gouvernement s’est montré favorable à ce postulat, qui devrait être traité par le Parlement ces prochains mois. /
AUX LIMITES DE LA VIE
Les soins palliatifs prennent en charge les patient·e·s dans la dernière phase de leur vie. Entre directives anticipées, changement de l’objectif thérapeutique et soulagement des souffrances, cette spécialité évolue avec la société vieillissante.
«La mort nous attend tous. Nous avons tendance à l’occulter dans nos sociétés mais la reconnaître permet aussi de l’appréhender avec plus de sérénité. » Gian Domenico Borasio, chef de service aux soins palliatifs du CHUV, en appelle à une meilleure sensibilisation quant aux questions de fin de vie. Ces situations sont multiples, souvent liées à l’âge et aux maladies comme la démence, mais aussi aux maladies chroniques et aux cancers. « Ces patients touchent aux limites de la médecine, explique le professeur. Les organes sont trop fatigués, la maladie profondément installée. Les soins palliatifs ne visent pas forcément à allonger la vie mais surtout à en améliorer la qualité. »
Appelée « changement d’orientation thérapeutique », cette décision signifie que les traitements ne vont désormais
COMPASSION
Philip Larkin, professeur et directeur des soins palliatifs infirmiers au CHUV, s’intéresse au concept de compassion en soins palliatifs. « Les soins de fin de vie requièrent l’empathie du soignant. La compassion représente la concrétisation par l’action de ce sentiment. » Selon lui, cette capacité se concrétise par l’aptitude à soutenir les décisions des patient·e·s tout en respectant son autonomie. « Cette bienveillance ne peut opérer que si le personnel soignant et les institutions appliquent aussi une forme d’autocompassion. »
plus viser la guérison ou le rallongement de la vie – sans pour autant opter pour un arrêt total des soins. « Ce n’est pas un échec de la médecine si un patient meurt, c’est la manière qui est essentielle », précise Gian Domenico Borasio, auteur du livre de sensibilisation Mourir et directeur de la première chaire de médecine palliative de Suisse créée en 2006 à l’Université de Lausanne. « Il faut absolument éviter de persévérer dans l’administration de traitements, parfois invasifs, à un patient qui n’en veut pas, ou pour qui ils n’ont plus de sens.
L’objectif est de soulager les souffrances physiques, psychosociales et existentielles du patient, en l’accompagnant correctement pour lui permettre d’exprimer tout son potentiel humain dans la dernière phase de sa vie. »
ÉLARGIR LA PRISE EN CHARGE
Près de 70% de la population suisse manifeste le souhait de mourir à domicile mais dans les faits, moins de 20%

y parviennent : 40% décèdent à l’hôpital et 40% en EMS, selon un rapport fédéral. Pour Ralf Jox, responsable de l’unité d’éthique clinique et cotitulaire de la chaire des soins palliatifs gériatriques du CHUV, les soins palliatifs sont aujourd’hui confrontés à deux problématiques : « Ils sont encore trop limités aux patients atteints de cancer en phase terminale, alors qu’ils devraient être envisagés pour de nombreuses autres pathologies et, surtout, bien plus tôt. » En effet, au CHUV, en moyenne 75% des patient·e·s en soins palliatifs sont atteint·e·s d’un cancer, 25% d’une autre pathologie.
« Les soins devraient en outre commencer sur les derniers mois, voire années de la vie, et pas seulement les derniers jours, pour davantage de confort. C’est une idée préconçue d’imaginer le palliatif comme la médecine des derniers instants seulement. »
La gestion des douleurs est en effet primordiale : quelle que soit sa pathologie de base, une personne en soins palliatifs souffre en moyenne de plus de dix symptômes physiques et psychologiques simultanément, selon un article du Swiss Medical Forum.
En Suisse, 62% des décès concernent des personnes âgées de plus de 80 ans. Le vieillissement de la population en appelle ainsi à une considération plus précoce des soins palliatifs pour les malades. Une stratégie également intéressante sur le plan financier : 25 à 30% des coûts de la santé sont liés aux soins effectués dans les dernières années de l’existence, surtout en raison des hospitalisations.
Les soins palliatifs visent ainsi à être davantage menés au domicile des personnes ou en EMS. Une bonne idée, selon le professeur Borasio, à condition de ne pas reporter la charge sur les proches aidant·e·s. « Les familles ne peuvent pas
« À VOS SOUHAITS »
Comment aborder le sujet des volontés de fin de vie avec ses proches ? Les 44 cartes du jeu À vos souhaits –traduit de la version originale américaine Go Wish – permettent de s’interroger sur ces grandes questions. L’outil, qui se commande sur Internet, invite à l’échange et permet au·à la joueur·euse de s’exprimer sur ses valeurs, ses doutes et ses volontés.
« Ce jeu apporte une approche ludique qui peut encourager et faciliter la réflexion autour des valeurs et des préférences de fin de vie, commente Ralf Jox, responsable de l’unité d’éthique clinique et cotitulaire de la chaire des soins palliatifs gériatriques du CHUV. Mais ce n’est pas su∞sant pour rédiger des directives anticipées de manière claire et applicable. Le projet de soins anticipés (advance care planning) est un modèle beaucoup plus complet qui consiste à accompagner la personne tout au long du processus, de la réflexion à la signature des documents de prévoyance. »
prodiguer les soins seules. Les fins de vie peuvent être compliquées et exigeantes. Reporter ces soins à la maison sans un soutien étatique et financier suffisant déplace la responsabilité sur les proches, qui se retrouvent souvent surchargés. » Les personnels d’EMS sont souvent insuffisamment formés aux soins palliatifs. Dans le canton de Vaud, quatre équipes mobiles de soins palliatifs existent pour aider les patient·e·s et leurs familles dans leur lieu de vie, que ce soit à la maison ou à l’EMS.
L’IMPORTANCE DES DIRECTIVES ANTICIPÉES
« Ce n’est pas possible de penser constamment à la mort mais ce n’est pas sain de totalement l’occulter non plus, souligne l’éthicien Ralf Jox. Penser à sa finitude aide à réaliser l’importance de vivre sa vie pleinement. Anticiper ses décisions permet aussi de soulager les proches. Les moments de maladie ou de deuil dans l’entourage sont propices à aborder ces sujets malheureusement encore trop tabous. »
Selon l’Office fédéral de la statistique (OFS), 70% des personnes âgées (de plus de 65 ans) pour qui des décisions importantes doivent être prises n’ont pas leur pleine capacité de discernement. Le « projet de soins anticipés » (advance care planning) vise à pallier les limites actuelles des directives anticipées. Objectif : inciter les individus à réfléchir en amont à leurs valeurs ainsi qu’au niveau de soins qu’ils souhaitent ou non et à mettre leurs volontés par écrit, de manière claire et sans contradictions. « Les directives anticipées aident grandement les familles à décider de l’ampleur des soins à entreprendre, explique Ralf Jox. Dans ces situations, les décisions doivent se baser sur la volonté présumée du patient et non pas sur ses propres valeurs. Ces choix peuvent être difficiles sans guide. »
Il n’existe aujourd’hui pas un seul formulaire étatique, mais une diversité de documents. Le plus utilisé est celui de la Fédération des médecins suisses (FMH) mais ses terminologies complexes le rendent difficile à appréhender. « Ces directives doivent être remplies avec l’aide du médecin traitant, par exemple. Malheureusement, ces démarches ne sont pas spécifiquement remboursées par l’assurance maladie. »
Selon les sondages, près de 30% des Suisse·sse·s ont rempli des directives anticipées, moitié moins en Suisse romande. Or à l’hôpital, seulement 5% des patient·e·s présentent leurs directives.
« Il n’existe pas de registre national et de nombreuses personnes n’ont pas informé leurs proches du lieu où elles ont rangé leurs directives anticipées. Ces informations restent donc introuvables. C’est dommage, il faudrait les intégrer au dossier électronique du patient. »
LE RÔLE PRÉPONDÉRANT DES PROCHES
« La famille, les amis, l’entourage sont déterminants dans l’accompagnement d’une personne en soins palliatifs, précise Mathieu Bernard, directeur de la chaire de psychologie palliative du CHUV (créée en 2021, c’est la première en Suisse). Ce sont ces personnes qui améliorent la qualité de vie et participent à donner un sens à l’existence vécue. Mais elles peuvent aussi représenter une source de stress pour le patient, qui s’inquiète de leur devenir, voire même culpabilise d’être un fardeau, d’imposer ces situations difficiles. » Souvent démuni·e·s, les proches ont également besoin de soutien. « Ils peuvent s’épuiser émotionnellement et physiquement, ce qui peut être dangereux », avertit Mathieu Bernard.
Les patient·e·s en soins palliatifs bénéficient d’un accompagnement social, psychologique
EN QUÊTE DE SPIRITUALITÉ
Face à la mort, la spiritualité peut devenir une ressource importante.
« Dans les soins palliatifs, la spiritualité englobe la question du sens de la vie et/ ou un sentiment de transcendance, de connexion avec quelque chose qui dépasse sa propre condition d’être humain, explique Mathieu Bernard, directeur de la chaire de psychologie palliative du CHUV. Elle ne se réduit donc pas à la religion uniquement. L’objectif est d’accompagner chaque patient dans sa propre croyance. » Les accompagnant·e·s spirituel·le·s –anciennement appelé·e·s aumôniers – sont présent·e·s dans l’hôpital à cette fin. Les réflexions sur le sens de sa propre existence ou de sa maladie peuvent aussi être encadrées par les psychologues.
« Mais si la spiritualité peut représenter une aide en fin de vie, pour d’autres, l’émergence de la maladie peut être vécue comme un abandon ou une trahison. Dans tous les cas, la spiritualité doit être évaluée et au besoin intégrée dans la prise en charge. »
et spirituel. L’acceptation de la mort est différente en fonction de la vitesse de progression de la maladie et de l’âge des patient·e·s. « Les personnes âgées peuvent accepter plus facilement la fin de leur vie, alors que c’est beaucoup plus difficile chez les plus jeunes, pour qui cette réalité n’est pas compatible avec les enjeux qui devraient être les leurs. Indépendamment de l’âge, pour certains patients, la fin de vie n’est pas concevable, ils peuvent alors manifester du déni face à la réalité. C’est un mécanisme de défense qui permet de refréner les angoisses de mort. Il faut alors les accompagner en partant de leur réalité subjective, ce qui nécessite de s’adapter avec délicatesse à leur situation. Vouloir les confronter coûte que coûte à la réalité médicale objective peut être très dommageable pour les patients », soulignent les deux spécialistes. Des recherches ont également montré que la notion d’altruisme pouvait gagner en importance dans cette phase de vie : « Les patients cherchent alors à donner, à transmettre quelque chose pour la postérité. » /

Mathieu Bernard Directeur de la chaire de psychologie palliative du CHUV, le spécialiste détaille l’importance de l’entourage dans l’accompagnement d’une personne en soins palliatifs.
LE TOC OU LA MALADIE DU DOUTE
TEXTE: CAROLE EXTERMANN
Pathologie trop souvent sous-estimée, le trouble obsessionnel compulsif concerne pourtant de nombreuses personnes qui ne peuvent pas bénéficier d’une prise en charge adaptée.
On ne s’imagine pas que, pour certaines personnes, il est impossible de quitter un appartement sans prendre une photo des lampes éteintes. Et d’y retourner malgré tout pour vérifier que rien n’est resté allumé. En partir, puis y retourner, encore une fois, parfois pendant des heures. On ne s’imagine pas que certaines personnes peuvent passer sept heures par jour sous la douche, huit heures à nettoyer un logement, jusqu’à en dévisser les plinthes, craignant qu’il reste de la poussière dessous. Alors qu’il touche 2 à 3% de la population, le trouble obsessionnel compulsif (TOC) reste une affection peu connue. « La population concernée est pourtant considérable, dit Julien Elowe, médecin-chef au Service de psychiatrie du CHUV. En comparaison, le nombre de personnes atteintes de schizophrénie représente 1 à 2% de la population. Pourtant, on en parle davantage. » Le TOC se divise en deux parties. Il y a l’obsession, une
pensée souvent intrusive et persistante, et la compulsion, un comportement mis en place par la personne pour désamorcer l’anxiété liée à la pensée obsédante. « Je dis souvent à mes patients : ce que vous vivez, tout le monde le vit, mais chez vous, c’est devenu incontrôlable. »
DE LA ROUTINE À LA MALADIE
Mais comment savoir quand un rituel, une habitude ou une routine devient un TOC ? Pour Margaux*, 40 ans, il a fallu beaucoup de temps pour comprendre ce dont elle souffrait. « Déjà enfant, je réalisais des petits rituels, notamment en lien avec la superstition et les pensées magiques. Je faisais fréquemment le signe de croix pour qu’il n’arrive pas de malheur. » L’excès d’anxiété dont elle souffre amène la famille à consulter un pédopsychiatre qui ne relèvera rien de particulier. Plus tard, à l’âge de 19 ans, elle fait face à une augmentation importante de son TOC en lien avec le stress des examens de maturité. « Je passais plusieurs heures par jour à faire le ménage. J’ai alors consulté un autre psychiatre qui a posé un diagnostic, mais comme il n’était pas spécialisé dans le traitement des TOC, il m’a juste prescrit une forte dose d’antidépresseurs. Je n’avais plus de TOC, mais je souffrais terriblement des effets secondaires des médicaments. »
Malgré son trouble, la jeune femme parvient à suivre des études et à se former en tant qu’enseignante. L’arrivée du Covid-19, et les contraintes liées à la limitation de la propagation du virus, marquera un tournant. « Le fait d’être confinée à la maison, où mon TOC se manifeste le plus, a été particulièrement complexe. Et je n’avais plus accès aux thérapies que je suivais. »
PRISE EN CHARGE LACUNAIRE
Pathologie des jeunes – puisque l’âge médian des personnes concernées est de 19 ans et que, dans 25% des cas, les TOC commencent avant l’âge de 10 ans –, ce trouble est pourtant souvent repéré trop tard. Une situation vécue par Agathe Gumy, fondatrice de l’association Tocs passerelles, dont la fille a souffert de TOC. « Au moment où le trouble a été identifié, je ne connaissais absolument pas cette maladie. Et à l’époque, on ne trouvait sur internet aucune information liée aux TOC en Suisse. Aujourd’hui encore, il n’existe en Suisse romande aucun centre ou service hospitalier spécialisé. »
Souvent, les personnes concernées ne savent donc pas vers qui se tourner et éprouvent de la honte à en parler. C’est également le cas de Margaux*, qui passe aujourd’hui encore entre huit et dix heures par jour à faire le ménage et divers rituels. « Ma plus grande phobie était d’être internée, qu’on me considère comme folle. En plus de consacrer énormément de temps au nettoyage, je passe quotidiennement deux à trois heures à faire des listes mentales, et si je suis interrompue, je dois tout recommencer à plusieurs reprises pour vérifier que tout est en ordre dans ma vie. »
Le caractère chronophage du TOC génère une souffrance énorme et peut rendre la vie sociale et professionnelle impossible. « Au travail, je n’en ai jamais parlé. J’ai dû réduire mon taux d’emploi à 60%, et j’avais constamment honte d’avoir l’air aussi épuisée alors que j’enseignais seulement à temps partiel. Puis ma fatigue a pris une telle ampleur que je n’avais pas d’autre solution que de me mettre en arrêt. »
Pour Julien Elowe aussi, les structures spécialisées manquent. « La prise en charge ambulatoire est largement insuffisante. L’idéal serait de pouvoir proposer des traitements intensifs. » Une solution pour laquelle avait opté Agathe Gumy au moment où le mal-être de sa fille l’avait poussée à la tentative de suicide. « Nous nous
sommes rendues en France à la Clinique Lyon Lumière, équipée d’un service spécialisé dans le traitement du TOC. Mais à ce moment-là, nous ne savions pas qu’il était recommandé de continuer la thérapie par un suivi psychothérapeutique. »
Actuellement, ce qui fonctionne le mieux pour accompagner les personnes souffrant d’un TOC est d’appliquer la technique d’exposition avec prévention de réponse. Une méthode psychothérapeutique comportementale qui consiste à confronter les patient·e·s à la situation qui génère le TOC, en les encourageant à limiter le rituel généralement réalisé. Dans le cadre de son travail pour l’association Tocs Passerelles, Agathe Gumy reçoit une à quatre demandes par jour. La structure propose des pistes pour mieux comprendre la maladie et orienter les personnes concernées vers les thérapeutes spécialisé·e·s.
Des tables rondes sont également mises en place. « Quand j’ai entendu un autre participant raconter son expérience, je n’ai pas pu retenir mes larmes, raconte Margaux. Pour la première fois, j’ai pris conscience que le TOC est une maladie. » Pour Agathe Gumy, il est urgent d’informer et de former les professionnel·le·s de la santé au sujet de cette pathologie et notamment les pédiatres. « Le diagnostic du TOC n’est pas difficile à poser et il est capital de prendre en charge le trouble avant qu’il prenne trop d’ampleur. » Pour élargir les possibilités thérapeutiques, Margaux souhaite suivre une psychothérapie assistée par psychédéliques. « J’ai eu mon premier rendez-vous aux HUG en octobre dernier, mais mon dossier est toujours en attente. » Une latence difficile face à l’urgence de pouvoir retrouver des conditions de vie supportables, et reprendre le travail. /
* prénom d’emprunt
En Suisse, près de 10% des hospitalisations sont liées à la prise d’un médicament et à ses éventuels effets indésirables. Beaucoup de ces situations pourraient être évitées, grâce à des gestes simples.
TEXTE : STÉPHANIE DE ROGUIN
Parcours d’une nouvelle substance jusqu’à sa mise sur le marché :
ui ne s’est jamais retrouvé, à la suite de la prise d’un médicament, dans un état plus désagréable encore que le mal initial ? Cette situation est loin d’être rare. Elle représente même près de 10% des cas d’hospitalisation en Suisse, selon la Fondation Sécurité des patients. Quelles explications se cachent derrière ce chiffre ? Comment éviter ces effets indésirables et comment rattraper la situation une fois qu’ils se manifestent ?
Lorsqu’un malaise ou une éruption cutanée inattendue surviennent après la prise d’un médicament, il serait plus juste de parler « d’événement indésirable », souligne Thierry Buclin, médecin-chef au Service
de pharmacologie clinique du CHUV.
« L’événement, c’est quelque chose que l’on observe. Une fois le problème détecté, nous menons une investigation pour comprendre s’il est lié ou non à la prise du médicament. Si le problème concerne uniquement un individu, nous appliquons une démarche diagnostique clinique en procédant par élimination. En cas de problème plus largement répandu, une série d’études sera faite pour déterminer s’il y a causalité ou non. On parle alors d’effet indésirable quand on conclut qu’il existe véritablement un lien de cause à effet. »
1 – ÉTUDE PRÉ-CLINIQUE
Les principes actifs candidats sont soumis à des simulations en laboratoire et à des essais sur des animaux.
DIFFÉRENTS TYPES D’EFFETS
INDÉSIRABLES
Le personnel médical peut anticiper l’apparition de ces effets indésirables selon le type auquel ils appartiennent : on parle d’effets indésirables de type A pour des effets essentiellement pharmacologiques. Les effets secondaires directement liés à un traitement donné en font partie, à l’image d’un anticoagulant administré à un·e patient·e pour le·la soulager d’une thrombose, par exemple, et qui va parfois provoquer des hématomes.
2 – ESSAIS
la première fois. Dans ce cas, l’organisme déclenche une réaction inflammatoire pour se défendre. Cette réaction peut provoquer une série d’événements indésirables tels que des hépatites, des attaques artérielles ou cérébrales.
DES ÉVÉNEMENTS RARES À CONSIDÉRER AVEC SÉRIEUX
CLINIQUES
PHASE I
La préparation est d’abord testée sur un petit nombre de volontaires en bonne santé afin d’étudier les réactions de l’organisme, celles sur le métabolisme et la tolérance à la substance.
Il existe aussi des effets pharmacologiques que l’on appelle off-target, de type B, comme ceux déclenchés par certains antibiotiques contenant des molécules prévues pour attaquer des bactéries, mais qui peuvent aussi se fixer sur d’autres structures de l’organisme, par exemple les neurorécepteurs. Le journal Le Temps avait rapporté au printemps 2022 l’histoire d’un patient, qui, traité par antibiotiques pour une pneumonie, a connu un épisode maniaque avec un délire mystique. C’est très probablement ce qui s’est passé dans ce cas-là.
Les événements indésirables de type B sont moins fréquents et donc plus difficiles à prévoir. En effet, les allergies ou les intolérances à une substance se révèlent imprévisibles si le ou la patient·e rencontre la molécule en question pour
Il peut paraître étonnant que des événements indésirables se manifestent fréquemment, alors que la procédure d’essai et de validation de toute nouvelle substance jusqu’à sa mise sur le marché est si lourde. « Certains effets indésirables rares ou très rares, des interactions avec d’autres médicaments ou d’autres risques liés à l’emploi d’un médicament ne sont observés qu’après l’autorisation, une fois que le produit est largement utilisé », rapporte Lukas Jaggi, porte-parole chez Swissmedic. Des risques qu’il ne faut en aucun cas négliger, puisqu’ils peuvent avoir des conséquences mortelles. « Cette marge d’erreur s’explique en partie parce que les candidats qui participent aux essais cliniques sont généralement plus jeunes et en meilleure santé que les malades qui vont effectivement prendre le médicament une fois celui-ci commercialisé », ajoute le spécialiste du CHUV Thierry Buclin. En outre, les malades reçoivent plusieurs médicaments, ce qui favorise les interactions médicamenteuses.
3 – ESSAIS CLINIQUES
PHASE II
Elle concerne quelques dizaines à quelques centaines de patient·e·s et fournit de plus amples informations sur la sécurité, l’efficacité et le dosage optimal du futur médicament.
L’IMPORTANCE DE LA PHARMACOVIGILANCE
Pour améliorer l’information aux patient·e·s, notamment dans les notices qui accompagnent tout médicament, il est primordial de relayer les événements indésirables rencontrés. Tout·e médecin ou pharmacien·ne qui en est informé·e a l’obligation, depuis 2003, de transmettre l’événement au réseau suisse de pharmacovigilance. Au CHUV par exemple, l’un des relais de ce réseau est le Service de pharmacologie clinique qui répond aux demandes des médecins. Le dossier de la personne est alors rigoureusement analysé pour pouvoir fournir des recommandations individualisées, par exemple une éviction définitive du médicament. Ensuite, ces spécialistes décrivent le cas sous forme
anonyme dans une base de données de pharmacovigilance coordonnée par Swissmedic. Ces données rejoignent celles de très nombreux pays de l’OMS, dont le centre de pharmacovigilance situé à Uppsala, en Suède. En Suisse, on dénombre environ 3000 signalements par an.
« Les spécialistes parviennent ainsi à identifier des signaux d’effets indésirables. Ces derniers pourront justifier soit de nouvelles études, soit des ajouts sur les notices de médicaments, voire des contre-indications à certains profils de patients », explique Thierry Buclin. L’issue de dernier recours consiste à retirer le médicament du marché, ce qui arrive plusieurs fois par an, étant donné que plusieurs dizaines de nouvelles substances entrent sur le marché chaque année.
CONSEILS EN MATIÈRE DE MÉDICAMENTS
4 – ESSAIS CLINIQUES
PHASE III
Quelques centaines à quelques milliers de personnes y participent. Cette étape vise à déterminer le profil d’effets secondaires du produit ainsi que les groupes de personnes et de patient·e·s chez lesquels le bénéfice attendu dépasse les risques potentiels.
Des gestes simples peuvent cependant contribuer à éviter une partie des événements indésirables, précise Sébastien Marti, propriétaire et directeur de trois pharmacies dans le canton de Neuchâtel et vice-président de PharmaSuisse. « Cela peut sembler évident, mais le fait de bien lire la notice d’un médicament et de respecter les consignes qui sont données, par exemple de prendre une capsule pendant ou avant le repas, est
primordial et souvent négligé. » Des médicaments courants contenant de l’ibuprofen, comme l’Algifor, ont pour effet de créer de l’acidité gastrique. Le fait de les prendre pendant le repas diminue cette tendance. Certains traitements voient aussi leur effet perturbé lorsqu’ils sont pris avec de l’alcool ou avec du tabac. La notice signale ce type d’incompatibilités.
Pour sa part, Thierry Buclin recommande le principe d’une sobriété médicamenteuse. Le spécialiste évoque également le cas de la prise régulière d’anti-inflammatoires, qui ont souvent pour effet d’augmenter la tension artérielle, débouchant sur la prescription d’anti-hypertenseurs. « Il faut éviter au maximum ces cascades médicamenteuses. Il est parfois plus bénéfique d’enlever un médicament que d’en ajouter un », insiste le médecin-chef au Service de pharmacologie clinique du CHUV.
5 – SURVEILLANCE
Après l’autorisation de mise sur le marché, le profil de sécurité d’un médicament est surveillé en continu pour minimiser les risques potentiels pour les patient·e·s.
Dans la même veine, respecter la posologie est tout aussi important. « Si le patient éprouve le besoin de modifier la quantité prescrite, parce que l’effet est trop ou pas assez fort, il doit en parler à son médecin traitant ou pharmacien. » De manière générale, être transparent avec les professionnel·le·s de la santé et leur donner un maximum d’informations empêchent bien des problèmes. Enfin, l’utilisation d’un pilulier ou d’un semainier peut s’avérer utile pour s’assurer d’avoir bien pris son ou ses médicaments.
Le développement du dossier électronique du patient (DEP) se profile également comme une solution prometteuse pour améliorer l’information aux différent·e·s professionnel·le·s de la santé qui auront désormais à disposition l’historique et une vision globale de la situation de chacun·e de leurs patient·e·s. Dans les établissements où un tel système existe déjà à l’interne, le dispositif informatisé signale automatiquement lorsqu’une incompatibilité médicamenteuse apparaît. /
* noms d’emprunt

« Il faut éviter au maximum les cascades médicamenteuses. Il est parfois plus bénéfique d’enlever un médicament que d’en ajouter un », explique Thierry Buclin, médecin-chef de la Division de pharmacologie clinique du CHUV.

EN SIMULATION D’URGENCE
LE SERVICE DES URGENCES ORGANISE DEPUIS 2012 DES FORMATIONS SUR MANNEQUIN DURANT LESQUELLES LES ÉQUIPES REPRODUISENT DES SITUATIONS RÉELLES. OBJECTIF : RENFORCER LA
COHÉSION
DANS UN CONTEXTE OÙ CHAQUE MINUTE COMPTE.
TEXTE : AUDREY MAGAT
PHOTOS : GILLES WEBER
Un homme de 65 ans arrive aux urgences. Il a perdu connaissance dans son appartement, et se plaint de douleurs thoraciques. À son arrivée aux urgences, son rythme cardiaque s’est déjà emballé, sa tension chute, puis son cœur s’arrête. Un massage cardiaque est entamé, l’adrénaline injectée, les voies aériennes sécurisées. Il va survivre. Ce patient est en réalité un mannequinsimulateur ultra-sophistiqué. Depuis 2012, le Service des urgences propose des journées de formation au déchoquage, c’est-à-dire des situations nécessitant une prise en charge immédiate, comme dans le cas d’un arrêt cardiaque, de traumatismes graves ou encore de détresse respiratoire sévère.
Appelées formation « advanced life support » (ALS), ces simulations – issues à l’origine du monde de l’aviation – confrontent des médecins et des infirmier·ère·s à des scénarios d’urgence vitale. « En prenant le temps d’analyser leur comportement dans des situations critiques, les équipes s’améliorent sur le plan médical et infirmier mais entraînent aussi des aspects essentiels, comme la communication, le leadership et la gestion d’équipe », explique Nicolas Beysard, médecin associé aux urgences du CHUV et formateur. Au total, près de 1000 personnes ont participé à une simulation depuis la création de cette formation.

1/
SE RAPPROCHER DE LA RÉALITÉ
Les formateurs et formatrices préparent différents scénarios d’urgence. Les mannequins sont habillés, coiffés, maquillés de sang ou de vomi selon la situation. « Le problème est que nous ne disposons dans notre service que de mannequins d’hommes caucasiens d’âge moyen, nous devons donc nous organiser pour les adapter », précise Nicolas Beysard. Ultratechnologique, le mannequin a un pouls qui évolue et peut exprimer des sons, à l’aide d’un micro contrôlé par le·la technicien·ne.

2/ MISE EN SITUATION
Quatre scénarios de vingt minutes, suivis chacun d’un débriefing de quarante-cinq minutes sont répartis sur la journée. Ces formations ont lieu deux fois par mois sur dix mois. Dans la salle, les masques à oxygène côtoient les diverses sondes, le défibrillateur et de réelles armoires à pharmacie. La prise en charge ne doit pas excéder trente minutes.

3/ SUIVRE LE RYTHME
L’équipe, de sept personnes au minimum, se compose de médecins des urgences et des soins intensifs, d’infirmiers et d’infirmières. D’autres spécialistes, par exemple venus de l’orthopédie ou de l’anesthésie, peuvent se rajouter au besoin. Chaque situation est menée sous la direction d’un « leader », généralement le ou la médecin. Véritable chef·fe d’orchestre, son rôle est d’indiquer quels gestes appliquer, ou quels médicaments donner.



4/ TRAVAIL D’ÉQUIPE
Chaque membre de l’équipe doit coller une étiquette indiquant son prénom et sa fonction.
« Nous sommes trop nombreux pour tous nous connaître, explique Yves Lemaire, infirmier
5/ COMPLICATIONS EN DIRECT
Depuis la salle de pilotage, l’équipe qui s’occupe de l’évaluation observe la prise en charge. Ils peuvent modifier les paramètres vitaux du mannequin, en provoquant par exemple un arrêt cardiaque ou un retour à un rythme stable, selon les décisions prises par l’équipe soignante.
responsable des simulations médicales. S’adresser à quelqu’un par son prénom crée une proximité favorable à la cohésion d’équipe. »



6/ CONCENTRATION PALPABLE
La tension et la concentration sont à leur comble. Hormis les sons des machines, les équipes travaillent dans le calme. Leurs gestes sont précis. Elles sont rapidement immergées dans la simulation. Oubliant le mannequin, l’équipe identifie les organes vitaux menacés, entame un massage cardiaque. L’enjeu de survie, même simulé, est omniprésent.

7/ MAINTENIR LES ÉCHANGES
La communication est essentielle dans les situations d’urgence. Il faut donc s’assurer d’être entendu·e, « de fermer les boucles », précise le médecin cadre. « Autrement dit, de répéter
8/ RETOUR D’EXPÉRIENCE
Au débriefing, toutes les personnes livrent leurs impressions. L’équipe de formation les aiguille afin qu’elles posent un regard critique sur leur propre expérience.
« C’est plus instructif de constater soi-même ses faiblesses », précise la formatrice Marie Guinat, cheffe de clinique aux soins intensifs.
Les journées de simulation ne sont pas des évaluations.
« Les participant·e·s doivent agir comme à leur habitude pour repérer les mauvais réflexes, les soucis de communication. »
L’interdisciplinarité de cette simulation permet aussi de poser un autre regard sur les métiers et responsabilités de chacun·e.
l’ordre donné afin de confirmer qu’il a été compris. » Durant l’intervention, le leader résume ainsi plusieurs fois la situation et fait le point sur les données vitales.

On marche dessus tous les jours, mais pas question de les ramasser. Présents partout, les champignons mycorhiziens sont un cas d’école de symbiose. « Grâce aux filaments qui se fixent au niveau des racines, ils fournissent des éléments nutritifs aux plantes, comme des minéraux ou du phosphate. En échange, ils reçoivent notamment du sucre », résume Ian Sanders, généticien au Département d’écologie et d’évolution de l’UNIL.
Une autre espèce pourrait tirer parti de ce bénéfice mutuel : l’être humain, confronté à des crises alimentaires que les effets du réchauffement climatique viennent encore renforcer. « On sait depuis les années 1970 que les réseaux mycorhiziens permettent d’augmenter les rendements de cultures comme le riz, le maïs, les pommes de terre ou le manioc », explique le chercheur. En laboratoire, ses travaux ont permis de multiplier la croissance du riz par cinq en 2010. Sur le terrain, des expériences à grande échelle d’une variété particulière, le Rhizophagus irregularis, ont été menées avec succès sur le manioc en Colombie,
NOM
CHAMPIGNONS MYCORHIZIENS
TAILLE (TÊTE + CORPS)
30 À 500 MICROMÈTRES
CARACTÉRISTIQUE
LEURS RÉSEAUX ALIMENTENT LE MONDE VÉGÉTAL EN EAU ET EN NUTRIMENTS.
Des champignons qui font rêver
En favorisant la croissance des plantes, les champignons mycorhiziens permettent d’améliorer les rendements agricoles.
La fin de la faim ?
TEXTE : JEAN-CHRISTOPHE PIOT

en Tanzanie et au Kenya. À la clé, de meilleurs rendements et une réduction de l’usage des intrants agricoles, phosphates en tête.
Reste à mieux comprendre un phénomène que la diversité des champignons et des sols rend complexe, chaque parcelle exigeant des apports différents qui ne donneront pas les mêmes résultats quelques kilomètres plus loin. « Des champignons identiques produisent des descendants génétiquement variables, avec des effets différents sur les plantes. Ils modifient également le microbiome (soit l’ensemble des micro-organismes et leurs gènes vivant dans un environnement particulier) et la structure de chaque sol », explique Ian Sanders.
Aujourd’hui, Ian Sanders concentre son travail sur le manioc, plante tropicale cultivée dans les zones les plus arides de la planète, là où le risque de malnutrition voire de famine est le plus élevé. D’ici deux ou trois ans, le programme déployé avec des exploitant·e·s colombien·ne·s devrait permettre de faire avancer une recherche appliquée novatrice, utile et respectueuse des écosystèmes. /
ANJA PATTSCHULL
Infirmière clinicienne spécialisée, Service de gériatrie et réadaptation gériatrique, CHUV
« Cela en vaut-il encore la peine ? »
Infirmière en gériatrie, j’ai dû entendre cette question plusieurs centaines de fois. Et la prononcer aussi. Elle survient lorsqu’il n’est plus certain que les traitements administrés à l’hôpital apportent davantage au·à la patient·e qu’ils ne lui occasionnent de souffrance ou d’inconfort. Obligatoirement, quelqu’un la posera en premier. Peut-être un peu maladroitement, peut-être pas au bon moment.

n’est pas prête à envisager la fin de soins à but curatif. De ces différents points de vue découleront des discussions éthiques, puis des décisions qui témoigneront de la capacité de l’ensemble des acteur·trice·s à adopter ou non une attitude cohérente et concertée.
Souvent, ce sera le début d’une longue série de discussions au sein de l’équipe interprofessionnelle. Une infirmière préconise de dispenser uniquement des soins de confort. Selon elle, le cap de l’acharnement thérapeutique est déjà franchi. Un autre soignant questionne la pertinence de prendre les paramètres vitaux, de mettre de l’oxygène. Ne devrait-on pas simplement accompagner et soulager les symptômes ? Un soignant n’a pas voulu réveiller le ou la patient·e car il pense qu’il est préférable de privilégier son repos à la prise du repas. Mais d’autres membres de l’équipe estiment qu’interrompre certains traitements serait trop brutal, que des investigations supplémentaires pourraient profiter au patient, ou que sa famille
C’est tout sauf simple. D’abord, parce qu’il n’existe pas d’instant « T » où l’on conclurait que les traitements et les soins dispensés pour maintenir ou améliorer la santé de la personne n’ont pas les effets escomptés. C’est un processus progressif, une situation changeante, avec des signes contradictoires. Ensuite, parce que chaque professionnel·le a comme grille de lecture les savoirs spécifiques de sa discipline et les compétences en lien avec son expérience. Par définition, chacun·e aura donc une vision différente. Et s’il est pertinent de renoncer à une visée curative ou aux traitements invasifs lorsque l’espoir d’une guérison s’éloigne, le bon moment n’est pas le même pour tout le monde. Enfin, c’est à la lumière des besoins et souhaits de la patiente ou du patient lui-même que les décisions doivent être prises, avec elle, lui ou les membres de sa famille selon les circonstances.
Il n’y a pas de règle universelle permettant de dire ce qui est juste ou faux. Soigner est un art, qui se pratique en équipe. Et la meilleure des équipes est celle qui cultive le doute, qui accueille les points de vue dissonants, qui reconnaît le caractère unique de chaque situation et se montre capable de cheminer. Dans ce contexte, « cela en vaut-il encore la peine ? » est une saine question. /
C
H
17
21
NO

COCAÏNE
C 17h 21NO 4
4 UNE MOLÉCULE, UNE HISTOIRE
TEXTE : JEAN-CHRISTOPHE
PIOT
Connue des peuples des Andes depuis des siècles, la molécule de la cocaïne a d’abord été utilisée comme médicament en Europe avant de devenir un problème de santé publique majeur.
En Amérique du Sud, d’où elle est originaire, la feuille de coca est appréciée pour son effet stimulant : mâchée ou préparée en infusion, elle aide à lutter contre la fatigue ou les effets de l’altitude. Au milieu du XIXe siècle, différents chimistes allemands et autrichiens parviennent à extraire et à concentrer la molécule, un alcaloïde comme la morphine, la caféine ou la nicotine. « Ce n’est pourtant pas pour ses propriétés excitantes que l’ester méthylique de la benzoylecgonine –le nom scientifique de la cocaïne – intègre la pharmacopée occidentale », explique Thierry Buclin,
La cocaïne, du médicament à la drogue
chef de la Division de pharmacologie clinique du CHUV. « La cocaïne a été le premier anesthésique local. Appliquée sur une muqueuse, elle permet alors d’endormir la surface concernée, ce qui facilite le travail des chirurgiens tout en réduisant la souffrance des patients. » Petit à petit, la cocaïne se banalise au point qu’on la retrouve souvent dans les armoires à pharmacie des particuliers qui l’utilisent notamment comme analgésique, anxiolytique et antidépresseur.
Au tournant du XXe siècle, les médecins et les pharmacien·ne·s sonnent l’alarme. Encore présente
dans le paquetage des soldats de la Grande Guerre avec des produits comme le vin Mariani, une boisson tonique réalisée à partir de feuilles de coca macérées dans du vin, la cocaïne fait les frais des premières législations antistupéfiants qui se mettent en place au lendemain du conflit. « Son interdiction progressive, comme celle des opiacés, avait pour but d’éviter une épidémie de dépendance qui touchait d’ailleurs d’abord les soignants. »
En cause, les propriétés particulières de la molécule. « La cocaïne mime les effets de la dopamine, un neurotransmetteur sécrété
par l’organisme quand nous sommes excités par une bonne nouvelle, un repas agréable, une séance de sport… C’est la molécule de la récompense. » Tout le problème de la célèbre poudre blanche tient au fait qu’une fois son effet passé, la descente pousse les individus à vouloir retrouver cette sensation d’euphorie. Ce phénomène engendre un effet de craving et de dépendance aux effets souvent catastrophiques pour les cocaïnomanes : problèmes financiers, désocialisation et isolement. « C’est la drogue de l’addiction par excellence, explique Thierry Buclin. Comme le manque se traduit par un état dépressif et des idées noires, reprendre une dose est particulièrement tentant. Sur le plan physique, en revanche, il n’y a pas de danger majeur d’overdose avec la cocaïne en dehors du risque d’accidents cardiaques. » /
CURSUS ÉCLAIRAGE
Texte :
Simon Faraud
Quand les mots et les coups pleuvent
Le nombre d’incidents liés à des situations de conflit ou de violence envers le personnel du CHUV a connu une nette augmentation en 2021. Si la charge émotionnelle est généralement exacerbée dans le contexte hospitalier, la nervosité semble amplifiée par la pandémie de Covid-19. Que ce soit pour prévenir ou pour guérir, des solutions existent.
On ressent au CHUV les mêmes tensions que dans la société. »
Cela fait plus de quinze ans que Fabrice Dupuis est agent de sécurité au CHUV. Depuis le retour au libre accès de l’hôpital après la pandémie de Covid-19, lui et ses collègues constatent une augmentation des conflits et de la violence dans l’institution.
Au bénéfice d’une formation spécifique au secteur hospitalier, les agent·e·s s’attachent avant tout à apaiser les tensions, comme l’indique celui qui est aussi chef du Secteur opérations pour Securitas : « Nous cherchons toujours à apporter la réponse appropriée à chaque situation. Souvent, la présence
d’un·e agent·e de sécurité su∞t à calmer les esprits. La désescalade verbale est l’outil que nous utilisons en priorité. Dans la plupart des cas, cela su∞t à ramener le calme. »
UNE OFFRE DE FORMATION ADAPTÉE
Les collaboratrices et les collaborateurs sont en première ligne et ont un rôle important à jouer dans la prévention de la violence hospitalière. Pour leur donner les clés, le Centre des formations a mis sur pied le cours « Prévention et gestion des conflits et de la violence » en 2015. Depuis, 43 sessions ont été organisées et plus de 500 professionnel·le·s formé·e·s. Quelque 94% d’entre elles et d’entre eux la recommandent, preuve que l’enseignement a atteint sa cible.

Muriel Gasser, responsable du domaine Relation patients & proches au Centre des formations, explique que « le but est que les professionnels aient les bons outils pour anticiper, car il y a sans doute des situations dans lesquelles il est possible d’éviter l’escalade. »
Dès cet automne, une offre révisée permettra de mieux répondre aux besoins des collaborateur·trice·s tout en optimisant la durée de formation. Par ailleurs, un e-learning réalisé par les HUG est à disposition de tout le personnel sur eformation.chuv.ch.
GÉRER L’APRÈS
Dans le cas où des violences surviendraient malgré tout, l’institution soutient et appuie les collaborateur·trice·s en suivant une procédure établie qui peut, selon la gravité du cas, faire intervenir la Sécurité, la Médecine du personnel, l’Unité de médecine des violences, la Psychiatrie de liaison, voire l’Unité des affaires juridiques.
L’Espace de médiation entre patient·e·s, proches et professionnel·le·s (EMP) est également à disposition de toute personne souffrant d’un rapport problématique avec un·e patient·e ou son entourage.
Ouvert il y a dix ans pour offrir un espace d’écoute aux soigné·e·s, l’EMP est de plus en plus sollicité par les professionnel·le·s, qui représentent aujourd’hui 14% des cas, contre 3% en 2012.
MIEUX VAUT PRÉVENIR
QUE GUÉRIR
Pour Pierre Merminod, adjoint du chef de la Sécurité du CHUV, il est important d’anticiper les tensions et, au moindre doute, de ne pas hésiter à recourir à un point de vue externe : « L’empathie fait partie des métiers de l’hôpital. Mais, du fait de notre expérience, nous pouvons apporter un autre regard et alerter les collaborateurs lorsqu’une situation n’est pas normale. Quand vous pensez que vous devriez faire appel à la sécurité, la réponse n’est jamais ‹ non ›. On nous appelle rarement assez tôt. »

Pour plus d’informations sur ce sujet, voir aussi l’article « Augmentation de la violence envers le personnel soignant » paru dans le n° 25 d’In Vivo.
ÉVOLUTION DES VIOLENCES AU CHUV
ENTRE 2020 ET 2021 dans les autres sites du CHUV
Dossiers d’annonces du personnel pour agression ces plaintes sont gérées par la Sécurité et l’Unité des affaires juridiques
16% Sollicitations de la police par l’hôpital
dans la Cité hospitalière
Texte :
Simon Faraud
Hervé Henry, chef du Secteur jardins et voirie
« Je n’ai plus enfilé la salopette depuis 2015 ! » Entré au CHUV comme jardinier en 2001, Hervé Henry est aujourd’hui chef du Secteur jardins et voirie. S’il endosse désormais un rôle organisationnel, l’horticulteur de formation ne s’est jamais éloigné de sa première passion, la nature.
Lors d’une visite de la ville de Brisbane, en Australie, Hervé Henry tombe en admiration devant un arbre dont la base est entièrement recouverte de fleurs. Une anecdote qui en dit long sur notre collègue : « J’adore découvrir la manière dont les autres entretiennent leurs espaces extérieurs. Même quand je suis en vacances, je ne peux pas m’empêcher de glaner des idées ! » Des inspirations qui, sous son impulsion, se muent en de nombreux projets tels que les ruches sur le bâtiment de liaison, les zones de pique-nique et, bientôt, des hôtels à insectes.
UNE QUÊTE D’ÉQUILIBRE
« Mon but est de trouver un juste équilibre entre la beauté du site et le maintien de zones de nature qui favorisent la biodiversité, et ce, tout en assurant la sécurité des passants », précise le Vaudois d’origine. Ainsi, les jardinier·ère·s n’utilisent plus de produits phytosanitaires depuis une dizaine d’années et adaptent l’entretien aux besoins de chaque surface. « Certaines zones sont tondues régulièrement et agrémentées de fleurs tandis
que sur d’autres, nous favorisons la prairie. Nous laissons également des zones refuges non fauchées durant une année afin de permettre à la petite faune de se protéger en hiver. »
Dans la fonction qu’il occupe depuis 2015, les nouvelles technologies jouent un rôle clé.

Grâce à ces dernières, Hervé Henry a créé un plan de gestion des arbres, qui sont désormais répertoriés sur des cartes interactives et disposent d’un équivalent du « dossier patient » dans des bases de données. Une digitalisation qui se nourrit de sa fine connaissance du terrain : « Je connais chacun des 2000 arbres qui se trouvent sur nos surfaces ! » /

→ Champ d’action
Organiser les activités (entretien des espaces verts, balayage, vidange des poubelles, déneigement, etc.) des 11 collaborateurs·trices du Secteur jardins et voirie dans la Cité hospitalière, Cery, Prangins, le CLE et Sylvana.
→ Signes distinctifs
En dehors du CHUV, Hervé Henry aime passer du temps avec son épouse et ses deux filles. Et s’il ne jardine plus à l’hôpital, il se rattrape à la maison : « Mon métier reste jardinier, c’est ma passion. »
BACKSTAGE

AFFICHAGE
Une étape importante de la conception d’In Vivo consiste à afficher toutes les pages du numéro au mur. L’équipe de Large Network est ici accompagnée d’Émilie Mathys, journaliste au sein du Service de communication et

ILLUSTRATION

de création audiovisuelle du CHUV, qui s’est occupée pour cette édition de la rédaction du dossier sur les abus sexuels envers les enfants.


Pour accompagner l’article sur la prise en charge des patient·e·s dans leur dernière phase de vie (p. 52), l’illustratrice Ana Yael a exploré plusieurs pistes.

JEANNE MARTEL
Photographe au Service de communication et de création audiovisuelle du CHUV, elle collabore régulièrement avec Large Network pour In Vivo. Pour ce numéro, elle s’est rendue à Fribourg et Neuchâtel afin d’y réaliser trois portraits.

JEAN-CHRISTOPHE PIOT

CAROLE BERSET
En parallèle de ses études de philosophie, Carole Berset a été responsable de tous les contenus publiés sur le site francophone de l’association Philosophie.ch. Elle a rejoint l’équipe de Large Network en août 2022 en tant que journaliste et coordinatrice du portail PME du SECO. Pour In Vivo elle s’est intéressée au phénomène de l’orthorexie.
Diplômé en sciences politiques, Jean-Christophe Piot travaille comme journaliste pour plusieurs médias en France et Suisse. Il aborde pour des sujets qui touchent souvent à la médecine, à l’économie et à l’environnement. Pour ce numéro, il s’est intéressé à la molécule de la cocaïne et aux champignons mycorhiziens.
IN VIVO
Une publication éditée par le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et l’agence de presse Large Network
www.invivomagazine.com
ÉDITION
CHUV, rue du Bugnon 46 1011 Lausanne, Suisse
T. + 41 21 314 11 11, www.chuv.ch redaction@invivomagazine.com
ÉDITEURS RESPONSABLES
Béatrice Schaad et Nicolas Demartines
DIRECTION DE PROJET ET ÉDITION ONLINE
Arnaud Demaison
REMERCIEMENTS
Service de communication et création audiovisuelle du CHUV
PARTENAIRE DE DISTRIBUTION
BioAlps
RÉALISATION ÉDITORIALE ET GRAPHIQUE
Large Network, www.largenetwork.com
T. + 41 22 919 19 19
RESPONSABLES DE LA PUBLICATION
Gabriel Sigrist et Pierre Grosjean
DIRECTION DE PROJET
Carole Extermann
DESIGN
Large Network (Aurélien Barrelet, Sabrine Elias, Lena Erard)
RÉDACTION
Large Network (Yann Bernardinelli, Carole Berset, Julien Crevoisier, Andrée-Marie Dussault, Carole Extermann, Erik Freudenreich, Samuel Golly, Audrey Magat, Jean-Christophe Piot, Stéphanie de Roguin), Arnaud Demaison, Émilie Mathys
RECHERCHE ICONOGRAPHIQUE
Sabrine Elias
COUVERTURE
Large Network, Aurélien Barrelet
IMAGES
CHUV (Heïdi Diaz, Apichat Ganguillet, Jeanne Martel, Gilles Weber), Ana Yael
IMPRESSION
PCL Presses Centrales SA
TIRAGE
15’000 exemplaires en français
Les propos tenus par les intervenant·e·s dans In Vivo et In Extenso n’engagent que les intéressé·e·s et en aucune manière l’éditeur.
SUIVEZ-NOUS SUR : TWITTER : INVIVO_CHUV FACEBOOK : CHUVLAUSANNE

Donnez de l’élan à votre hôpital
en soutenant des projets de recherche, de soins et de formation.
Faites un don avec TWINT !
Scannez le code QR avec l’app TWINT. Confirmez le montant et le don.

Coordonnées bancaires
Banque cantonale vaudoise

