Numéro Minuscule 87








C’était il y a une grosse dizaine d’années. Au détour d’un stand établi dans l’un des mille recoins du vénérable festival d’Angoulême, nous découvrions Vignette. Cet objet de grande taille présentait images et bandes dessinées de qualité, se plaçant sans rougir dans la descendance des revues estampillées Haute École des arts du Rhin de type Belles Illustrations et Nyctalope. À sa tête et dans ses pages, aux côtés de ses acolytes Eugène Riousse et Baptiste Filippi, Alice Saey appuyait déjà sur les nœuds synaptiques qui conditionnent l’amour et l’idolâtrie. Ce choc soudain trouva dans les années qui suivirent de quoi se rassurer sur son épaisseur. Ses motifs hypnotiques et ses couleurs luminescentes se sont déclinés depuis lors dans des vidéos musicales, dans des courts d’animation, sur des affiches, sur des murs et dans des illustrations pour la presse. Avec, à chaque fois, cette volonté de faire danser les natures mortes, de transformer le réalisme en abstraction et de dompter l’imprévisible. Cet entre-deux place les regardeuses et regardeurs dans une situation étonnante : en même temps que la répétition des formes semble rationaliser les thèmes de ses dessins, la plasticité du trait et la palette puissante semblent nous avertir que l’impossible est à venir. À la fois apaisé·es par le rythme continu imprimé par le dessin, ébahi·es par son usage du grandiose et aux aguets du moindre bouleversement, les spectateur·rices se sont, sans y prendre garde, fait submerger.
À la une de ce numéro « minuscule », il nous fallait cette force captivante du travail d’Alice Saey. Pour nous plonger dans l’infime, pour nous montrer que cette invisibilité n’est pas synonyme d’immobilisme, que derrière l’inanimé peut se révéler le vibrant, il nous fallait une artiste capable de prouver qu’après le calme vient la tempête. Un souffle qui décoiffe de plus belle quand l'animation vient s'en mêler et dont l'ingérence se déclenche grâce au QR code ci-joint. Merci Alice d'avoir donné à cette couverture un peu de ta magie.






@skimadrawing

Entre Skima et Pierre Noire de Conté à Paris, c’est une véritable histoire d’amour qui dure depuis des années.
Grâce à ses talents d’illustrateur hyperréaliste, il explore à l’infini la puissance du noir avec les Crayons et Carrés iconiques Conté à Paris. Permettant aussi bien les aplats poudrés mats que les détails intenses minutieux, la texture velours et la pigmentation de Pierre Noire permettent de travailler toutes les nuances de noir, de jouer avec la lumière et les contrastes pour donner à ses créations une profondeur unique, jusqu’à semer le doute entre photographie et illustration.
Vous trouvez cette oreille immense ?
Elle en réalité MINUSCULE : scannez le QR code pour découvrir l’illustration en entier !


Vous avez envie de découvrir la musique classique ?
D’écouter un grand orchestre symphonique dans une très belle salle ?
D’être guidé·e dans votre choix ?
La Philharmonie a sélectionné pour vous des concerts réunissant des œuvres connues, grandioses, émouvantes, mémorables, des classiques du répertoire joués par les meilleurs musiciens, qui sont autant d’excellentes entrées en la matière.
Laissez-vous emporter par la magie de la musique !



Pour la 8e collaboration de son Lyf Lab, Lyf a confié à la talentueuse illustratrice lyonnaise Orane Sigal le soin de mettre en couleur la table d’un restaurant. On y déguste des plats savoureux, on y sirote des cocktails qui pétillent, on y commande et on y paye avec un simple QR Code...
Résultat : une création acidulée, qui réchauffe les soirées d’hiver et dans laquelle on a envie de plonger la tête la première : « Du soleil sur la table, s’il vous plaît ! »
« On est bien peu de chose », murmurait face à l’univers l’homme le plus intelligent du monde. Et il n’avait pas tort : il faut bien admettre que nous sommes minuscules. Par rapport à Uranus par exemple. Ou à une météorite. Et même si on prend un éléphant, un gros, on est vachement plus petit. Pour autant, doit-on être vexé de cet état de fait ? Ne devrait-on pas se réjouir d’être si humble, rikiki, rabougri quand cela nous a permis de prendre pendant des siècles notre planète pour un espace infini ? Nous avons fait dans le système solaire ce que nos Polly Pocket font dans nos chambres : de toutes petites villes avec de toutes petites maisons remplies de tout petits meubles. Et puis voilà, on se balade au milieu de tout ça en se faisant des mini-coiffures, en mettant des mini-vêtements pour aller dans des mini-restaurants manger des mini-aliments dans des mini-assiettes. On ne le dit pas assez, mais à l’échelle du cosmos, nous sommes vachement mignons.
Comme tout est relatif, il y a aussi des choses qui nous paraissent, à nous, parfaitement ridicules. Pourtant, nous savons leur importance dans la possibilité ou non de survivre : les virus, microbes, bactéries et molécules qui décident, alors même qu’ils nous sont invisibles, de la justesse de notre présence au monde. Au milieu de tout ça, il y a le dessin, qui prend prétexte de représenter le minuscule pour inventer de nouveaux mondes et leur offrir une beauté insoupçonnable. Car le tout petit, peu importe l’échelle, c’est avant tout ça : ce qu’on ne voit pas. À nous, alors, de l’imaginer.
Directeur de la publication : Jérémie Martinez
Direction Kiblind : Jérémie Martinez - Jean Tourette - Gabriel Viry
Comité de rédaction : Agathe Bruguière
Maxime Gueugneau - Elora Quittet - Jérémie Martinez
Jean Tourette - Gabriel Viry
Coordination éditoriale : Elora Quittet
Team Kiblind : Blanche Blouin - Guillaume Bonneau
Romane Chevallier- Magda Chmielowska - Nell Coissard
Edmée Garcia-Mariller - Chloé Girot - Léa Guiraud
Mélodie Labbé - Rachel Lafitte - Laëtitia Lafort
Marie Lascaux - Romane Lechleiter - Anne-Capucine
Lequenne - Céline Montangerand - Lara Mottin - Zoé Paille
Guillaume Petit - Morgane Philippe - Charlotte Roux
Déborah Schmitt - Éva Spalinger - Paloma Stéfani
Sara Thion - Olivier Trias
Avec l'aide de Noémie Arensma et Maxime Lechleiter
Réviseur : Raphaël Lagier
Traducteur·rices : Anita Conrade - Mark McGovern
Direction artistique : Kiblind Agence
Imprimeur : Musumeci S.p.A. / musumecispa.it
Papier : Le magazine Kiblind est imprimé sur papier Fedrigoni / Symbol Freelife E/E49 Country 250g Arena natural Bulk 90g
Typographies : Kiblind Magazine (Benoît Bodhuin) et Freight Text (Joshua Darden)
Édité par Kiblind Édition & Klar Communication. SARL au capital de 15 000 euros - 507 472 249 RCS Lyon - FRANCE 27 rue Bouteille - 69001 Lyon / 69 rue Armand Carrel75019 Paris - 04 78 27 69 82 / KIBLIND c/o Spaces - 5455 av. de Gaspé - H2T 3B3 Montréal QC
Le magazine est publié en version française et anglaise. kiblind.com / kiblind-atelier.com / kiblind-agence.com / illustration-festival.com
ISSN : 1628-4146
Les textes ainsi que l’ensemble des publications n’engagent que la responsabilité de leurs auteur·rices. Tous droits strictement réservés. Merci à Matthieu Sandjivy. THX CBS.
Contact : magazine@kiblind.com




SAEY 1 — 4
GIULIANO BUTTAFUOCO 22 — 23 EMILIE RAOUL 38 — 39





Animatrice et néanmoins illustratrice, Alice Saey a opté pour l'hypnose des regardeur·euses à base de motifs hallucinogènes et de couleurs en percussion. C'était le bon choix.
Minuscule X alicesaey.com
Le dessinateur italien Giuliano Buttafuoco joue de son trait noir et de ses dégradés pour mieux projeter notre relation au monde dans le surnaturel.
Son mini-mini : « Quand l’homme se rend compte que la Terre est petite. »
Tiny X giulianobuttafuocoillustrator.com
Il est des gens qui savent tout faire et Émilie Raoul est de ceux-là, aussi à l’aise dans le contemplatif que dans le cartoonesque.
Son mini-mini : « Quand la fille du dentiste regarde trop la télé, son père lui récure les mini-toons. »
Minuscule X @raoul.emilie
Chou Chia Yu use des angles cassants pour mieux s’enfoncer dans la rétine et proposer un dessin à la beauté pure et immédiate.
Son mini-mini : « minuscule » m’a directement fait penser à des choses petites et mignonnes. »
Cute things X @chou_ooxx
Le Marseillais et membre du collectif Random Kingdom ne cherche qu’une chose : vous perdre dans la forêt enchantée de ses créations.
Son mini-mini : « Un·e petit·e gobelin·e fan de jardinage, mais qui n’a pas la main verte. »
Gardening gobelin X @cruel.n.tender
Richard Short empile les personnages comme le pâtissier décore sa pièce montée : avec le goût du sucre et l’envie de plaire.
Son mini-mini : « Une ruche d'abeilles à la suite d'une attaque de guêpes, inspirée de l'art du 14e siècle. »
Tiny X @r_t_short
Les dessins coulants de Jamiyla Lowe chevauchent en couleur le flasque de la vie.
Son mini-mini : « Parfois, on a l’impression que quelque chose cloche, alors que c'est dans notre tête (ou dans notre cou). »
Tiny X jamiylalowe.com
Dérangeant, puissant et estomaquant, le travail de Lulu Lin aka Dig a Hole frappe fort autant par sa maîtrise que par l’effet immédiat qu’il provoque.
Son mini-mini : « Ce qui peut paraître insignifiant pour certain·es peut revêtir une signification énorme pour d'autres »
Tiny X @da_ _h_
À la fois confortable et percutant, le travail de Philip Lindeman nous propose des repères psychédéliques pour mieux les brouiller ensuite.
Son mini-mini : « Tenter de capturer ce sentiment de petitesse qu’on peut avoir dans notre relation à l’univers »
Tiny X @philip_lindeman












homesicksuni.bandcamp.com slackarama.bandcamp.com








On minimise tout.
On rapetisse, on rétrécit, on raccourcit, on diminue, on compresse, on miniaturise, on amoindrit... au risque de perdre au passage ce qui donne toute dimension. En résumé – et à trop résumer – n’en arrivons-nous pas parfois à perdre, par économie, la signification et le sens des choses ?
C’est tentant, presque naturel, de penser qu’il y a toujours du mieux dans les comparatifs de supériorité – comme le scande la devise olympique – et ce jusqu’au superlatif absolu, en devenant la plus grande ou le plus grand : GOAT.
Pourtant, « le mieux est le mortel ennemi du bien », prévient Montesquieu. Alors la taille compte-t-elle vraiment, et l’importance doit-elle se mesurer au format plutôt qu’à l’aune de l’utilité, de la beauté ou de la rareté ?
On a créé certaines petites choses pour leur usage pratique et transportable, comme les boîtes d’allumettes ou les briquets, par exemple ; d’autres parce que leur fonction imposait un format réduit, comme les timbres. Et pour les habiller, on les a illustrés.
Par l’illustration, de petites choses qui n’avaient en elles-mêmes aucune valeur sont devenues des objets de collection. Et ce uniquement parce que l’art a fait son œuvre, en aidant bien volontiers cette humaine caractéristique à vouloir posséder, surtout si c’est rare.
Le marketing l’a bien compris. Et saisissant habilement le phénomène de la collection, on a inventé des objets miniatures parfaitement inutiles cette fois, dont l’unique fonction est de magnifier une marque et de rester bien en tête, au même endroit, sur un meuble quelconque avec d’autres goodies, comme des boules à neige.
Moralité : grande ou petite, les choses n’ont d’importance que celle qu’on leur accorde.
1er bâton – 8h12 : terrasse de café, hiver 2025
Le peu d’âmes ici consiste en un groupe de nigaud·es impénitent·es qui dégage, à chaque ouverture de bouche, une fumée malodorante mêlée d’une condensation chaud-froid.
Le garçon de café, cinq minutes devant lui, se joint à ces gens. La pause est brève et se doit donc d’être efficace. Il attrape sur le comptoir une boîte d’allumettes dont il sort une tige, gratte le bouton, et « crac »… Avec ce geste anodin, presque trivial, la lumière et la chaleur générées par ce mouvement le ramènent quelques siècles en arrière.
Avant l’avènement de l’allumette moderne, faire du feu nécessitait des compétences techniques ou des outils légèrement poussés. Tout change au début du XIXe siècle : en 1827, grâce au concours d’un Suédois, d’un Anglais et d’un Français,
la première allumette à friction naît. Une petite tige avec une tête chimique, associée à un grattoir d’une autre composante. En un frottement surgit une flamme. Jusqu’alors dangereuse, cette nouvelle « Allumette de sécurité » ou « Allumette suédoise » se répand : les utilisateur·ices sont de plus en plus nombreux·ses. Il y a un marché du bâtonnet !
Forte d’un succès mondial, l’allumette est fabriquée partout ! Plusieurs centaines d’entreprises saisissent l’opportunité. Elles seront bientôt 700 rien qu’en France. Il s’agit alors de se démarquer. Et comme souvent, c’est par le beau que les sociétés comme Caussemille ou Roche & Cie vont séduire les usager·es.
2e bâton – En expulsant une première bouffée, il regarde dans sa main la petite boîte cartonnée au design fatigué par le temps
Paysages, figures historiques, publicités
ou propagandes : chaque boîte devient une miniature illustrée qui peut faire toute la différence au milieu des centaines d’autres références.
Pendant la Révolution russe, la boîte d’allumettes était un support de propagande de plus, exaltant les travailleurs, arborant des marteaux et des faucilles flamboyants ou portant des slogans révolutionnaires.
Au Japon, les boîtes des années 1920 à 1950 rivalisaient d’élégance. Inspirées par les estampes traditionnelles, elles représentaient des geishas, des paysages montagneux ou des scènes de thé.
Les Suédois, pionniers des allumettes de sûreté, avaient quant à eux une passion particulière pour les animaux.
De leur côté, les Anglais ont une tradition de boîtes d’allumettes humoristiques. Les illustrations jouaient sur des jeux de mots, comme un « allumoir pour hommes enflammés » (sous-entendu pour les gros dragueurs). Une série célèbre représentait d’ailleurs un bonhomme en costume tirant sur une corde, accompagné du texte : « Keep calm, strike matches. »
Chaque culture, chaque pays s’est emparé de ce tout petit espace d’expression à des fins communicationnelles ou artistiques. Les allumettes ne sont pas que des outils. Elles incarnent des époques, des cultures et des courants artistiques.
3e bâton – On distingue vaguement « Manufacture de l’État », « allumettes chimiques » et un portrait au profil juvénile.
En France, sous le second Empire, les caricatures de Napoléon et autres personnages politiques sont imprimées en lithographie sur de grandes planches. On en fait des médias politiques.





























1 - Boîtes d’allumettes, Roche & Cie, Collection de Noël.
2 - Boîtes "portefeuille", Prado 123, entre 1870 et 1872.
3 - Étiquette, Roche & Cie, 1848.
4 - Boîtes "portefeuille", Causemille, entre 1858 et 1872.
5 – Étiquettes allumettes, Alfred Choubrac, Source : BnF Gallica, Petite histoire des alumettes, Marie Boissière, 2018.
6 - Étiquette allumettes "Red Tiger," Malayan Matches Ltd of Selangor in the Federated Malay States, 1922.
7 – Étiquette allumettes Casque d’Or, S.E.I.T.A., 1940 / Vannes, Collection du Musée de Bretagne.
8 – Strip « Le cochon délivré ou l’allumette utilisée », Benjamin Rabier, 1901.
9 - Affiche « Feu...à volonté », Allumettes "Casque d'Or", Robert FALCUCCI, 1930.

Les fabricants exploitent en interne des packagings picturaux, parfois avec une telle minutie que certains contenants deviennent de véritables œuvres, exposées lors des expositions universelles.
Les grands affichistes se prêtent aussi au jeu, appelés ponctuellement par des hôtels ou des restaurants de luxe. Ces derniers offrent à leur clientèle fortunée des souvenirs élégants, qui sont aussi des objets publicitaires circulant entre les mains et vantant leurs établissements. L’allumette devient un goodie d’art.
De 1840 à 1880, c’est l’âge d’or de l’illustration sur boîte d’allumettes.
La créativité poussée à son paroxysme par le capitalisme. Une histoire qui n’a rien de singulier mais a néanmoins le mérite d’avoir mis en circulation des objets d’art qui fascinent aujourd’hui quelque 2 000 philuménistes.
4e bâton – Un passant s’arrête : « T’as du feu ? » Et lui rend l’objet : « Original les allumettes, c’est old school j’aime bien ! »
On ne leur a rien demandé, mais les services de l’État ont instauré une taxe sur les allumettes, pour redresser les comptes. L’objet marchait si bien sur le plan commercial que l’État a fini par imposer un monopole national. Les allumettes entrent dans la SEIT (Société d’exploitation industrielle du tabac) : c’est ainsi que naît la SEITA, placée sous régie publique.
Le monopole éteint la concurrence et dans le même temps la créativité exprimée jusqu’alors. Étant seul acteur du marché, la SEITA n’a pas besoin de se démarquer. Pour autant, elle poursuit le travail pictural en imaginant quelques séries régionales et folkloriques, son emblématique gamme « Casque d’or » et ses bâtons bleus, suscitant ainsi l’effet collection chez les usager·es.
En parallèle, le briquet jetable fait son entrée : bon marché, pratique, solide, il concourt lui aussi à reléguer l’allumette au second plan.
5e bâton – « Mais qui utilise encore des allumettes aujourd’hui ? » Il range la petite boîte dans la poche de son pantalon. Les deux finiront ensemble dans le lave-linge…
Le contraste entre l’utilité triviale de ce tout petit objet et la largeur de l’espace d’expression qu’il a offert est étonnant. Aujourd’hui, on regarde bien souvent l’allumette comme une relique. Et à juste titre.
En témoignent les collections particulières et muséales de ces cartons qui ont été les témoins d’histoires, de courants politiques et artistiques. Plus récemment, le monopole est mis à mal par des entreprises de personnalisation de boîtes mais aussi par de plus petits studios qui revisitent l’iconographie de l’allumette pour en faire de beaux objets ou pour continuer de surfer sur sa capacité marketing.
Toujours est-il que ces objets, aussi ordinaires soient-ils, racontent une histoire plus grande qu’eux. Une célébration du banal. Et peut-être qu’Andersen avait tout compris : il suffit d’une flamme pour raviver une histoire oubliée, enfouie.
SOURCES :
→ Fonds iconographique de la SEITA, France Archives, Portail national des archives (francearchives.gouv)
→ Collections du musée de Bretagne, Portail documentaire du musée de Bretagne et de l’écomusée de la Bintinais (collections.musee-bretagne.fr)
→ British Matchbox Label & Bookmatch Society (phillumeny. com)
→ Marie Boissière, Petite Histoire des allumettes, 2018, BnF (gallica.bnf.fr)
→ Tom Tit, La Science amusante – Le problème des trois allumettes, 1921, Larousse (gallica.bnf.fr)
→ Remy Devèze, Philuménie, La passion des boîtes d’allumettes (youtube.com)
Lorsque nous pensons « minuscule » et « illustration », difficile de ne pas avoir à l’esprit ce petit rectangle de papier de 20 × 26 mm qui est peut-être l’un des supports les plus démocratiques et universels de l’illustration contemporaine. Il voyage, s’offre, s’échange, se garde précieusement : le timbre bien sûr !
Mais avant qu’ils ne prennent place sur nos cartes postales de vacances ou dans nos tiroirs, les timbres avaient bien sûr une fonction utilitaire. Pour la petite histoire, ils ont fait leur apparition au XIXe siècle, en Angleterre. Loin d’être une explosion de créativité, le « Penny Black » figurait uniquement un portrait de la reine Victoria. En France, ils apparaissent le 1er janvier 1849 et sont à l’image de Cérès, déesse de l’agriculture, de la fécondité et des moissons. Bien qu’un peu plus inventifs que ceux des Anglais, pas de grande folie en termes d’illustration.
Mais très vite, les timbres ont commencé à raconter des histoires, à célébrer des figures, des événements et parmi eux, l’épopée de la conquête spatiale russe !
En effet, les années 1950-1960 sont le théâtre de nombreuses avancées dans le domaine spatial. Le 4 octobre 1957, l’URSS lance le premier satellite artificiel Spoutnik. Puis le 3 novembre 1957, Spoutnik 2 sera envoyé avec, à son bord, le premier être vivant, la chienne Laïka. S’ensuivront de nombreuses années de compétition entre l’URSS et les États-Unis qui s’achèveront en 1969 par le premier pas de l’homme sur la Lune.
Nombre d’objets retraçant ces épisodes de conquête spatiale verront ensuite le jour. Et c’est notamment grâce aux timbres que le grand public découvre les derniers exploits spatiaux. Quelques semaines seulement après le lancement de Spoutnik, des centaines de timbres commémoratifs sont déjà disponibles,









affichant fièrement le satellite en orbite autour de la Terre. Ils sont souvent accompagnés de slogans exaltant la puissance et l’ingéniosité soviétiques. Le style futuriste, souvent associé aux idéaux socialistes, les couleurs vives, les compositions dynamiques et les représentations symboliques comme la faucille et le marteau associés aux étoiles et planètes soulignent le rôle fondamental de cet outil. Les timbres deviennent ainsi une preuve tangible des prouesses russes et permettent de célébrer les grandes étapes de l’exploration en voyageant, au gré des courriers, dans le monde entier.
Et puis, il y a cette ironie douce-amère : ces petits carrés de papier, si fragiles, qui deviennent le support pour célébrer des colosses de titane et d’acier. Mais n’est-ce pas là tout le charme des timbres ? Cette capacité à capturer l’immense dans l’infime, à faire tenir des galaxies sur quelques millimètres carrés ?

Encore aujourd’hui, les timbres sont des témoins silencieux de nos époques. Ils nous rappellent que même les plus petites choses peuvent raconter les plus grandes histoires. Alors quelle histoire avez-vous envie de collectionner ?
SOURCES :
Maison russe des sciences et de la culture à Paris
→ crsc.fr/une-exposition-de-timbres-rares-sur-l-histoire-del-exploration-spatiale-est-presentee-par-la-maison-russe-aparis-a-l-occasion-du-60-e-anniversaire-du-premier-vol-spatial-habite/
« Histoire postale de la France et de ses colonies, 1939-1981 » → histoire-et-philatelie.fr
« La petite histoire du timbre-poste » → lapostegroupe.com/fr/actualite/ la-petite-histoire-du-timbre-poste
« Entrée en vigueur du timbre-poste » → francearchives.gouv.fr/pages_histoire/39976
« Histoire du timbre Marianne, de 1849 à aujourd’hui » → laposte.fr/envoyer/histoire-timbre-marianne
1. Timbre Journées des cosmonautes ©Maison russe des sciences et de la culture à Paris, 1972
2. Timbre Exploration de l’espace.Lancement des satellites artificiels « Mars4 », « Mars-5 », « Mars-6 » et « Mars-7 » ©Maison russe des sciences et de la culture à Paris, 1974
3. Timbre Conquête spatiale, ©Maison russe des sciences et de la culture à Paris, 1983
4. Timbre L’Homme des pays soviétiques dans l’espace ©Maison russe des sciences et de la culture à Paris, 1961
5. Timbre Lancement du premier satellite artificiel soviétique de la Terre, ©Maison russe des sciences et de la culture à Paris, 1957
6. Idem
7. Timbre Sonde spatiale programme «Venera », ©Maison russe des sciences et de la culture à Paris, 1961
8. Idem
9. Timbre Valentine Terechkova, première femme cosmonaute, ©Maison russe des sciences et de la culture à Paris, 1963
10. Timbre Youri Gagarine, ©Maison russe des sciences et de la culture à Paris, 1964
Dans notre monde contemporain où les objets du quotidien sont le plus souvent définis par leur utilité pratique, certains irréductibles échappent à cette logique pour raconter des histoires ou incarner des récits générationnels et culturels. Nous avons décidé de nous intéresser à ces petits objets illustrés qu’on adore collectionner et garder précieusement, comme si leur présence seule pouvait conjurer le mauvais sort ou booster nos journées. Plus que de simples bibelots décoratifs ou des gadgets sans âme, ils portent en eux un langage visuel riche, oscillant entre le fictif et le symbolique, et nous rappellent que, parfois, un objet peut être bien plus qu’un objet.








Les figurines par exemple, issues de la pop culture, sont bien plus que de simples jouets. Quand elles sont collectionnées, elles racontent une autre histoire, celle de la personne qui les possède. Chaque figurine est le reflet d’un souvenir d’enfance, d’un moment marquant ou d’une passion profonde pour un univers fictif. La collection devient une sorte de journal intime visuel où chaque pièce représente une émotion ou une période de vie.
rine. Cette idée simple mais efficace a posé les bases d’un nouveau marketing centré sur l’affect et l’engagement.




Cette présence de l’objet dans nos intérieurs n’est pas anodine : elle traduit un besoin d’attachement à des récits qui nous construisent. Le phénomène du « collectionnisme » trouve son origine dans la nostalgie et le désir de revivre certaines expériences. En ce sens, il y a un côté presque fétichiste dans la façon dont nous prêtons aux objets des émotions et des souvenirs. Les collections de figurines peuvent également s’analyser comme des marqueurs d’appartenance à une communauté culturelle. Participer à des conventions, échanger des pièces rares ou décorer son espace avec des éléments de la pop culture est une manière de revendiquer une identité.








14 15
Dans cette dynamique, les marques ont rapidement saisi l’opportunité de transformer ces petits objets en outils marketing puissants. La création de goodies, ces objets promotionnels souvent perçus comme anodins, se pare d’une charge symbolique bien plus forte qu’il n’y paraît. Au début du XXe siècle, avec le développement des techniques d’impression et de fabrication en série, les marques commencent à distribuer des objets personnalisés. Porte-clés, figurines ou petites boîtes en fer décorées (souvent associées à des produits alimentaires) deviennent des supports publicitaires prisés. Ces objets miniatures combinent utilité et esthétique, mais surtout, ils permettent de prolonger la visibilité de la marque dans le quotidien des utilisateurs.
La marque américaine de snacks Cracker Jack, popularisée dans les années 1910, en est un bon exemple : chaque boîte contenait une petite surprise, souvent une mini-figu-
À partir des années 1950, les goodies marketing connaissent une véritable explosion, portée par deux grandes évolutions : la culture de masse et l’avènement de la télévision. La pop culture devient une source d’inspiration pour la création d’objets marketing et les marques s’inspirent des codes du « collectionnisme » en jouant sur l’exclusivité, la rareté ou la customisation. L’idée principale : transformer un simple objet en un bien désirable. Avec le succès des franchises cinématographiques, des bandes dessinées et des dessins animés, les figurines, pins, porte-clés et autres petits objets dérivés deviennent des symboles culturels. Des exemples emblématiques, tels que les figurines Star Wars (apparues dans les années 1980), les porte-clés représentant le célèbre Bibendum de Michelin (dans les années 1950) ou encore les miniatures de bouteilles Coca-Cola, témoignent de la manière dont un simple produit dérivé peut devenir un objet de collection mondialement prisé.
Alors on peut se demander pourquoi l’attractivité de ces petits objets inutiles perdure à travers les siècles ; peut-être justement parce qu’ils sont inutiles ? Et dans un monde où l’on valorise avant tout l’efficacité, ces objets nous rappellent une chose essentielle : parfois, ce qu’on garde le plus précieusement, ce n’est pas ce dont on a besoin, mais ce qui nous procure du plaisir.
1 à 3. Affiche promotionnelles Cracker Jack ©Cracker Jack
4 .Figurine de collection Ôtori-sama, Le voyage de Chihiro de Miyazaki ©Maison Ghibli / 2025
5. Figurine de collection Boh Mouse, Le voyage de Chihiro de Miyazaki ©Maison Ghibli / 2025
6.Figurine de collection Kaonashide, Le voyage de Chihiro de Miyazaki ©Maison Ghibli / 2025
7. Figurine de collection Asterix, Pile d'albums 2nde édition, Asterix et Obélix ©Collectoys / 2025
8. Figurine de collection Bibendum Michelin ©Michelin
9 à 14. Figurine de collection Star Wars ©L.F.L HONG
15. Figurines de collection Sailor Boy ©Craker Jack / 2000
On lui met la tête à l’envers, une fois, deux fois, et quand on la retourne la neige tombe délicatement sur le monde qui l’entoure. C’est la vie et le principe de la boule à neige.










Parmi ces petits objets illustrés d’apparence inutile mais bien utiles à notre psyché, la boule à neige tient une place à part.
Les boules à neige ont cela de beau qu’elles abritent dans leur globe des paysages ou des personnages dont l’image nous parle. Elles transportent en miniature des éléments de notre imaginaire ou de nos souvenirs et elles nous permettent, si on les regarde bien, de plonger dans un univers au-delà de leurs frontières de verre.
Et en plus il neige. Si on les secoue correctement, les boules à neige ajoutent aux scènes une dose de féerie et, étrangement, avec ces flocons animés d’un lent mouvement, l’impression d’un temps suspendu.
Collectionnées, chéries, parfois oubliées puis retrouvées avec délice, conservées sur une étagère, au fond d’un tiroir ou sur un bureau comme presse-papier, les boules à neige sont des objets qui deviennent sacrés. Elles transportent avec elles la nostalgie d’une période, d’un moment, d’une enfance, nous offrent à chaque pirouette un temps d’émerveillement et la possibilité de plonger nous aussi dans ce monde silencieux et magique.
Bien qu’elles nous semblent avoir traversé le temps, les boules à neige ne sont pas si ancestrales et certainement pas démodées.
Il semblerait qu’elles soient nées en Autriche, puis apparues pour la première fois à Paris lors de l’Exposition universelle de 1878 sur les stands des maîtres verriers français. La première boule à neige en série a été produite pour l’inauguration de la Tour Eiffel en 1889 et a rencontré, sans surprise, un franc succès.
Au cours du XXe siècle, les marques s’en sont emparées, avec plus ou moins de retenue et de talent, pour le plus grand plaisir des collectionneuses et collectionneurs et des enfants de tous âges.
Aujourd’hui, si la boule à neige figure dans la liste des objets dérivés kitsch et des souvenirs douteux, et si on a toutes et tous une boule à neige qui nous a marqué·es et qu’on n’ose pas assumer, elle fait son retour avec de nouvelles images et de nouvelles palettes de couleurs, paillettes, flocons, pour nous plonger dans des mondes magiques qui nous ressemblent.










1 - « Téléférique de Brest », Géronimo Lagadec, France
- « Bibendum Michelin » ©Michelin
7 - « Rue de Paris, temps de pluie », Gustave Caillebotte, 1877
8 - « Partie de bateau », Gustave Caillebotte, vers 1877-1878 © GrandPalaisRmn, Musée d'Orsay/ F. Raux
9 - Le Bon Marché Rive Gauche x Le Parisianer - Illustration : Caroline Peron
10 - Le Bon Marché Rive Gauche x Le Parisianer - Illustration : Maguelone du Fou
11- « Hello Kitty », Silver Buffalo, NY ©Sanrio CO., LTD, 2024
12 - « Dauphin
13 - « The Beatles, Abbey Road » ©The Beatles Merchandise from Half Moon Bay
14 - « Le Roi Lion, Le cercle de la vie », Walt Disney Showcase Collection ©Disney - Designer : Jim Shore
15 - « Nekozuna Snow Dome », jouet gashapon japonais, Kitan Club
16 - « Wednesday », Silver Buffalo, NY ©Netflix
17 - « Nevermore Academy », Wednesday, Mad Monkey ©Netflix
18 - « Harry Potter et le Prince de sang-mêlé » ©Wizarding World Harry Potter
19 - « Dobby », Harry Potter ©Harry Potter merchandise by Half Moon Bay
20 - « Hogwarts », Harry Potter ©Harry Potter merchandise by Half Moon Bay


Ce festival indépendant de musiques actuelles rassemble plus de 40 artistes, 4 scènes, un bar et une restauration en circuits courts, des animations et un camping gratuit. Parmi les artistes de la 19e édition, vous retrouverez : Dub Inc, Tiakola, Mc Solaar, Sofiane Pamart, Ultra Vomit, Kompromat et bien d'autres. La programmation complète est à retrouver sur foreztival.com
Pour la troisième année consécutive, l'équipe a choisi de collaborer avec Corentin de Studio Rafale. Un amoureux de musique et de sport, qui parle de ses passions avec passion. Il transmet son enthousiasme à travers des illustrations et des animations empreintes de vie et de mouvement. Son univers, où le végétal occupe une place centrale, trouve un écho parfait dans les racines ancrées dans la nature du Foreztival.


Il est devant nous, large, haut et long. Le mur de données nous bloque la vue, nous aveugle à grands coups d’informations et de chiffres imbriqués les uns dans les autres, construisant un baragouinage dont le sens nous échappe.
Bienheureusement, des outils de traduction existent : les data designs. Grâce à eux, les oiseaux chantent, le soleil brille et nous comprenons ce que le monde a à nous dire. Voici donc six data designs sur la thématique de notre numéro : minuscule.

Dans la vie, Il y a les grandes questions existentielles, et puis il y a les autres. Les petites colles dont les réponses ne vous rendent pas plus intelligent·e mais qui auront le mérite de déjouer le silence gênant d’un premier date raté ou d’un covoiturage Blablacar.
Histoire de vous équiper en sujets de discussion hasardeux, c’est à cette deuxième catégorie de questions qu’il va falloir répondre, afin de tester vos connaissances sur l’univers des petites choses. À vos loupes, zoomez.
Question N°01
À cause d’un léger détail, un Australien peu attentif s’est vu condamné à une amende de 60 000 dollars. À votre avis :
A b Il a mangé un gâteau sur lequel il était écrit « Ne pas manger »
B b Il a toqué sur une porte où était inscrit « Ne pas toquer »
C b Il a parlé dans une bibliothèque où il était inscrit « Silence »




Chaque espèce a ses particularités : elle se déplace ou non, pique ou non, est mortelle ou pas.
Les moustiques sont présents sur Terre depuis plus longtemps que l’Homme : depuis l’ère Jurassique, il y a 170 millions d’années.
Le moustique est un des animaux les plus mortels pour l’homme.
Leur taille est comprise entre 0,5 et 1,5cm.
Les moustiques possèdent une espérance de vie de 15 à 40 jours.
Dans l'ensemble, les moustiques sont responsables de plus de 700 000 morts chaque année.
Les moustiques qui aiment les lieux habités par l’Homme sont appelés des anthropophiles.
Les 350 rectangles correspondent au nombre total d’espèces de moustiques dans le monde (échelle 1/10)
Nombre d’espèces non anthropophile (échelle 1/10)
Nombre d’espèces dangereuses pour l’homme
Nombre d’espèces présente en France
Non, le cousin n’appartient pas à la famille des moustiques !
45% du territoire français est colonisé par les moustiques tigres.
Contrairement aux idées reçus, les moustiques se développent proches de point d’eau tiède et stagnante, et pas seulement dans les lieux humides.
Les moustiques ne piquent pas seulement les humains, ils se nourrissent également du sang de grenouilles et d'autres amphibiens.
PAR LÉA GUIRAUD & ANNE-CAPUCINE LEQUENNE

Volcan actif Taal
311m d'altitude Philippines
Aéroport
Juancho E.Yrausquin 400m Saba, Antilles
Forêt nationale d'Adak
12 x 25,2m Île d'Adak, Alaska
Salle de sport Singapore Microgyms 18m2, Singapour
À Tiny Town, pas besoin de s’éreinter marches ou de dépenser vos pécules de jumelles. Profitez du charme d’une humaine (littéralement) rassemblant petits lieux existants du monde. Bonne
Île Just Room Enough Archipel310m2desMille-Îles, dans l'État de New York

Île Bishop rock 50m Royaume-Uni
s’éreinter en montant des pécules dans une paire d’une ville à taille rassemblant tous les plus Bonne visite !
Hôtel Eh'häusl 2,5m de large Amberg, Allemagne
Café -bar Verdens Mindste 10m2, Tullinsgaden, Copenhague
Rond-point
1m, Haute-Garonne,Labarthe-sur-Lèze France
Mairie de Saint-Germain-de-Pasquier 8m2 Saint-Germain-de-Pasquier, Normandie
Chapelle Cross Island 30m2
Oneida, New-York
LamaisondeBayeux 16m2 sur2étages Bayeux,Calvados,France

Little House 29m2 Toronto, Canada
Musée The Maypol Inn 2,45m x 95cm Warley, West Yorkshire, Angleterre
Théatre Kremlhof Scène de 1,3m Villach, Autriche
Cinéma Dei Piccoli 63 places Rome, Italie
Manneken-Pis 58cm de haut Bruxelles, Belgique
Discothèque Teledisko 2,40m x 80cm Berlin, Allemagne
Fleuve La Veules 1,15km
Veules-les-Roses Seine-Maritime, France

Le pollen a beau être une minuscule particule, il fait pas mal de victimes... Chaque année, 20 % de la population subit des symptômes très glamours du tant redouté « rhume des foins » : yeux qui piquent et qui rougeoient, flots de morve, raclements de gorge incessants et toux à gogo...










Noyau de la cellule végétative































Noyau de la cellule germinative
































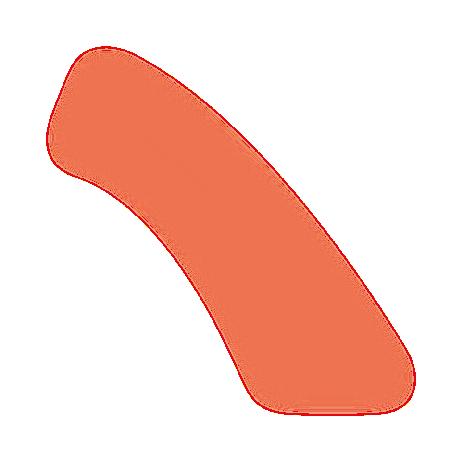

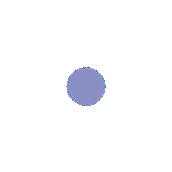


































Évolution de la concentration de pollen dans l’air. connus quiconstituentlamatiè ils font partiedespluspetitsobje qui sontdesparticulesélémentair écrans...)estcomposéedephotons



























Spin=1
Charge électrique = 0






Lapalynologie(l’étud mat nsdepollenpré svêteme victime escènedec lalocaliser me ladaterletemps . ère. jetsphy s iques ires: s


uaemu rayonsdusoleilàsonzénithparexemple. Il s'agirait enfaitd'unpetitcourt-circuitentredeux nerfs t r è s p r hco se pourdécrirelephénomènequi consiste à éternuerlorsqueleregardpassed 'uncouloir so m b r e xua Outburst)cheznosamis britanniques il toucheprèsd'unquartdelapop u lation. U n sorg mon ÉgalementnomméACHOO (AutosomaldominantComp e lling He lioOp h t h laim c


quidéclenchealorsunéternuementpresquedigne de ceux de nosdaron·nes. anatomiquement:aucontactd'uneforte luminosité, lesimpulsionsdunerfoptiquestimulent«p arerreur » le





bule r ge• 7mµ8



Parti c u el



















L A CUILLÈREDE POLLEN A V ALÉEPAR TA TATABIO AUP’TITD É J O TO-STERNUTA T
























Autre d’eau deprotéines( ac i des aminés) de su














Petits mais puissants, minuscules mais mythiques : voici une sélection de personnages de fiction qui prouvent que la grandeur n’est qu’une question de perspective.
















Dans un monde polarisé par les extrêmes, on s’est posé une question existentielle : combien de tiny houses pourraient tenir dans la résidence principale de Bernard Arnault, l’homme le plus riche de France ?
Alors, pour répondre à la question : une tiny house ça mesure en moyenne 20 m², donc on vous laisse faire le calcul…
Depuis 2005, le milliardaire habite un hôtel particulier du XIXe siècle près des Invalides à Paris, acquis pour la modique somme de 25 millions d’euros, avec 2 000 m², quatre étages, un jardin et une piscine en sous-sol.
gros comme une
100 tiny houses et oui, on est d’accord, ça fait beaucoup.
Spoiler alert : ça fait








PROPOS RECUEILLIS PAR MAXIME GUEUGNEAU & ELORA QUITTET



L’être humain adulte a les mains pleines de doigts gros, gras et malhabiles. Certains héros tentent de défier la biologie disgracieuse de notre espèce en la forçant à se faire précise et patiente. Ces dessinateurs et dessinatrices ont en effet choisi le petit format comme un des lieux de prédilection de leur art. Ainsi en est-il de MC Squirrel qui pinceaute sur de rikiki céramiques, de la nail artiste
Marième Niang (Clap Clap Nails Club) qui n’officie que sur de vrais ongles et de Jul Quanouai qui, dans un souci d’équilibre cosmique, contrebalance ses grands dessins en noir et blanc par de minuscules formats ultracolorés. C’était impossible, alors ils l’ont fait. Mais pourquoi donc ?
KIBLIND Pouvez-vous vous présenter et nous parler de vos pratiques du dessin miniature ?
MC SQUIRREL Moi, je suis illustratrice et aussi céramiste, mais là, on va surtout parler des mes toutes petites céramiques, de mes petits totems que je fais souvent avec des animaux et des chiens en particulier.
MARIÈME NANG Moi, je fais du nail art et ma spécialité, c’est que je ne travaille quasiment que sur des ongles naturels.
JUL QUANOUAI La pratique de la miniature pour moi, elle est définie par des règles qui sont pour le moment presque immuables, c’est-à-dire que je dessine en 4 × 4 cm ou 4 × 5 cm ou 5 × 5 cm avec un bord blanc tout le temps et avec le même type de feutres qui sont beaucoup trop gros à la base pour dessiner sur ce genre de format.
En fait, tous mes boulots je les oriente comme des axes de recherche. Je fais comme si j’étais en laboratoire. Je me donne des contraintes qui me plaisent et ensuite, je les fais courir sur un certain nombre d’années jusqu’à en avoir fait le tour.
KIBLIND Quel a été l’élément déclencheur qui vous a amené·es vers le dessin miniature ?
MCS J’ai fait de la céramique et en fin de cours, il me restait un peu de terre et j’avais pas envie de la gâcher. Souvent, il restait 1520 minutes, alors je faisais des petits trucs rapides et mignons. J’ai commencé à faire des petits chiens et ça a évolué, je leur ai ajouté des petits trucs sur la tête. Je trouvais ça très mignon donc quand je suis retournée en cours, je prenais des heures à ne faire que des tout petits trucs.
JQ Les miniatures sont venues à moi en deux temps. Le premier temps, c’est avec les enfants dont je m’occupais en centre de loisir. On avait ces feutres et je me suis rendu compte que c’était des outils que j’aimais bien. Le deuxième temps, c’est grâce à ma compagne, la dessinatrice et peintre
Junie Briffaz. Elle faisait beaucoup de miniatures, et de la voir faire, ça m’a ramené à cette piste que j’avais déjà commencé à explorer avec les petits. Ça m’a donné envie de me mettre à faire ces choses très colorées et très petites. Ça vient de son boulot à elle et j’en ai fait une piste de mon côté.
KIBLIND Marième, qu’est-ce qui t’a poussée à dessiner sur des surfaces aussi particulières que des ongles ?
MN J’ai une passion pour les mini-objets. Dans ma pratique, à la fac, je faisais beaucoup de grands formats et je me suis rendu compte que c’étaient pas les choses que je préférais. Quand j’ai décidé de faire les ongles, au contraire ça ne m’a pas posé de problème de faire du nail art sur de tout petits ongles. Commercialement parlant, je me disais aussi que c’était quelque chose de « niche ». Et plus c’était petit, plus c’était challengeant pour moi. Je me suis dit qu’il fallait réussir à se différencier dans les ongles car le nail art est souvent associé à de très grands ongles. Comme j’ai l’esprit de contradiction, plus c’est petit et plus je me fais le défi d’y arriver.
KIBLIND Qu’est-ce que le petit format vous permet que le grand n’offre pas ?
MN Je trouve que c’est marrant de faire des formats mignons pour dissimuler des trucs pas mignons dedans. J’aime tout ce qui est petit en fait, et pourtant, je suis très grande. J’ai tout un tas de mini-trucs chez moi et j’aime les mini-trucs.
MCS Je partage un peu la même idée. Pour moi, les choses petites sont très mignonnes et j’aime bien collectionner de toutes petites choses, des petites fèves, des petits objets. Ça me fait penser à quand on était petit·es avec nos Playmobils et qu’on se créait des histoires avec plein de petites choses. C’est assez réconfortant, il y a aussi un côté gri-gri qu’on peut collectionner et je trouve ça assez satisfaisant.







KIBLIND MC Squirrel, il t’arrive aussi de dessiner sur de plus grands formats. Donc, à l’inverse de la question précédente, qu’est-ce que le petit empêche et que tu viens retrouver sur des grands formats ?
MCS Le plus grand, ça permet de construire une histoire plus globale, d’aller dans plusieurs sens, mais c’est aussi plus impressionnant, ça fait plus peur que les petites choses. Ça me rassure de faire des petites choses.
KIBLIND Est-ce que dessiner petit a développé chez vous certaines qualités que vous n’aviez pas forcément avec les grands formats ?
MN Moi, je fais déjà très attention aux détails, donc ça renforce cet aspect-là. Et puis ça m’aide à me concentrer car j’ai tendance à aller un peu à droite à gauche. Quand je fais du nail art, je dois être très très concentrée car il faut faire attention à tout réduire. Toutes les échelles sont beaucoup plus petites.
MCS Moi, ça m’a vraiment aidée à développer ma patience car il y a beaucoup de loupés et c’est pas toujours très satisfaisant. Ça me force à me concentrer aussi. C’est le cas par exemple quand je dois faire des tout petits yeux sur de tout petits visages. Je trouve ça très apaisant en fait. Ça va bien avec la technique de la céramique. De devoir me concentrer sur de toutes petites choses, ça me lisse un peu le cerveau, c’est très agréable.
KIBLIND Est-ce que vous avez l’impression que les contraintes induites par le petit format vous aident à pousser votre créativité ?
JQ Oui, moi ça me permet de produire beaucoup et donc de moins penser au dessin que je suis en train de faire. Ça me libère de ce que je fais à côté, c’est-à-dire les dessins en noir et blanc et les peintures qui me prennent énormément de temps et qui sont très prévus à l’avance.
MN Pour moi, la contrainte, c’est que les ongles des gens sont très différents, donc il y a certains projets qui ne sont pas réalisables parfois. Ma contrainte, elle est là mais je ne me mets pas de limites. Pour moi, d’ailleurs, c’est pas contraignant, c’est juste que comme c’est un truc esthétique, il faut vérifier que ça va pas être foiré et je peux pas vraiment le savoir à l’avance.
MCS Ça me force à être minutieuse car les détails sont tout petits. Et puis il y a aussi des contraintes qui ne viennent pas de toi. Par exemple, la façon dont ça sèche, etc. Plus c’est petit, plus c’est fragile, et pour que le résultat soit cool il ne faut pas que ça casse. Sinon, il y a les contraintes que moi je me mets, c’est-à-dire de travailler sur des formats de plus en plus petits et voir où je peux aller dans le détail.
KIBLIND MC Squirrel, les outils que tu utilises sont-ils différents selon la taille de la céramique que tu produis ?
MCS C’est pas mal les mêmes. J’utilise mes mains et toujours les mêmes outils, car j’aime bien utiliser des pinceaux assez fins même quand je travaille sur des céramiques plus grandes. Je trouve ça cool de garder les mêmes justement car ça me permet de faire des petites choses et de passer à des grandes quand je veux, sans avoir à penser à mon matériel.
KIBLIND Et toi, Marième ?
MN J’utilise principalement des tout petits pinceaux hyper-fins qui sont faits pour faire du nail art. Des fois, j’utilise aussi des crayons de couleur et des Posca, mais j’utilise principalement des pinceaux très très fins. Parfois, je vais détourner des produits de maquillage ou des petites gommettes pas forcément faites pour les ongles.
KIBLIND Puisqu’on est sur les ongles, sur le support, est-ce que tu dessines à côté sur feuille et quelle différence est-ce que tu constates ?
MN Avec les feuilles, j’ai du mal. J’ai tendance à prendre des feuilles A4 et à les recouper à l’infini pour avoir des petits formats car je me sens pas à l’aise sur du grand. Sur les ongles, il y a un côté où ça glisse. Le papier, je peux effacer avec une gomme mais finalement, sur les ongles aussi, je peux mettre un coup de coton et recommencer. Je me sens beaucoup plus libre que sur des feuilles, c’est pour ça que je préfère peindre plutôt que de vraiment dessiner. Le dessin feuille-papier me détend un peu moins, me fout un peu plus la pression que les ongles. Même si parfois je ne sais pas trop ce que je suis en train de faire, ça m’inquiète beaucoup moins.
KIBLIND Et le fait que ce soit les mains de quelqu’un d’autre, ça ne te met pas plus de responsabilité ?
MN C’est pas très engageant en fait. À côté, je fais aussi du tatouage et c’est pas la même pression. Les ongles, au pire on ne met pas la main devant la lampe et ça ne catalyse pas. Tout est toujours effaçable avant cette étape-là. Donc en fait, il n’y a pas trop de pression.
J’aime bien expérimenter et parfois, c’est juste ça que j’aime bien. Même si le résultat n’est pas à la hauteur de ce que j’avais espéré, les gens n’ont pas forcément de références. J’ai l’avantage de faire beaucoup de premières fois, ce qui fait que si je ne réalise pas exactement ce qui était prévu, les gens ne voient pas la différence. Et puis si vraiment je le sens pas, il y a toujours un plan B, toujours une alternative. Au pire, on bascule sur quelque chose dont je suis sûre.
KIBLIND La main n’est pas un support fixe, ça doit pas être évident...
MN C’est surtout le format le problème. Les gens arrivent avec des images venues d’internet et je suis obligée de préciser que leurs mains ne sont pas du tout les mêmes, que les ongles ne sont pas du tout les mêmes, que moi je n’opère pas sur de
faux ongles donc ils sont beaucoup plus imparfaits et beaucoup plus irréguliers. Il ne faut pas qu’ils s’attendent à avoir la même chose que sur la photo. Et les gens, en fait, une fois que je leur ai dit ça, ils ne s’attendent à rien du tout. C’est pour ça qu’il m’arrive de refuser des projets. Typiquement les dégradés, on ne peut pas les faire sur de tout petits ongles, ça va être ultra-moche parce qu’il n’y a pas de place pour dégrader quoi que ce soit. Une fois que les gens sont prévenus, il n’y a pas de souci. C’est si on les prend par surprise du genre « bon bah, j’ai pas réussi, désolée », que ça peut être compliqué.
KIBLIND Est-ce que dessiner petit, vous donne une plus grande marge d’erreur comme on voit moins ?
MCS J’ai beaucoup moins le droit à l’erreur sur les céramiques que sur le dessin en illustration. En illustration, je travaille sur l’iPad et je peux effacer et recommencer comme je veux. En céramique, on a moins ça. On peut effacer avec une petite éponge et de l’eau mais ta terre blanche devient un peu grise et c’est pas très beau. C’est le côté que j’aime bien justement : si je me trompe, c’est pas grave, il y aura un œil chelou ou ce sera un fruit avec de la couleur qui dépasse. J’aime bien ce genre d’erreur.
KIBLIND Jul, tes dessins sont extrêmement différents quand tu dessines en grand et quand tu fais tes miniatures. Pourquoi changer à ce point d’outil et de style ? Est-ce que ce changement t’offre plus le droit à l’erreur ? Tu nous parlais par exemple de tes trop gros feutres par rapport au support...
JQ Moi quand je dessine en petit, c’est l’erreur que je recherche, justement. Il y a deux familles de dessins quand je dessine en tout petit. Il y a ceux qui sont vraiment bien tombés, et il y a quelque chose qui me plaît là-dedans, mais il y a aussi ceux qui sont à côté et il y a aussi quelque chose qui me plaît en eux.
« C’est vraiment le côté challenge qui me plaît. De me dire que c’est possible quand la plupart des gens vont dire que c’est impossible. Mon esprit de contradiction est servi : je me dois de le faire même si c’est censé ne pas être possible. »
Marième Nang
→




En général, ceux que je jette, ce sont tous ceux qui sont entre les deux, ceux qui sont « à peu près » réussis. Dans le dernier livre que j’ai fait avec Colorama [maison de microédition allemande, ndlr], j’ai mis en regard des dessins que je trouve réussis et d’autres que je trouve ratés. Et c’est quand je les trouve très réussis ou très ratés que ça m’intéresse de les mettre les uns à côté des autres.
En gros, j’ai trois pistes de travail : le dessin en noir et blanc au Rotring, la peinture à l’acrylique et à l’aérographe, et ces dessins-là. Moi ce qui m’intéresse, c’est le dessin et la recherche en dessin. Ça peut être autant pour une expo dans un centre d’art contemporain que pour un t-shirt. Tout ce qui m’intéresse là-dedans, c’est le dessin. Le fait de changer de style, c’est juste des axes de travail qui viennent à moi.
KIBLIND Est-ce que le principe de synthèse que nécessitent forcément ces petites tailles est une piste de réflexion qui vous a intéressé·es ?
MCS Oui, tu vas direct à l’essentiel et à ce qui te plaît le plus dans la forme que tu fais. En tout cas en céramique, tu vas pas mettre plein de détails. J’essaie d’imaginer l’âme du petit animal que je viens de faire et j’essaie d’aller droit au but.
MN Moi, ça me donne juste un cadre en fait. C’est cool parce que j’ai tendance à faire ce que je veux tout le temps. Là, le fait d’avoir un cadre imposé et d’avoir des mains que je ne connais pas me pousse à essayer de faire parfaitement ce qu’on m’a demandé dans un cadre qui n’a pas été choisi par moi. C’est vraiment le côté challenge qui me plaît. De me dire que c’est possible quand la plupart des gens vont dire que c’est impossible. Mon esprit de contradiction est servi : je me dois de le faire même si c’est censé ne pas être possible.
JQ Je me retrouve bien dans ce que dit Marième. Moi le synthétique je le bosse plutôt en grand parce que j’aime bien qu’il y ait
beaucoup de blanc. Alors que là, c’est plus le truc de : les feutres sont trop gros, le format est trop petit, le sujet est trop vaste, ça n’a aucun sens et donc j’y vais. Je pars du principe que je vais dessiner n’importe comment et que c’est impossible. Je me sens plus créatif quand je me dis que c’est foutu d’avance. Des fois ça rate complètement, mais c’est pas grave. Ça m’oblige à revenir dans un truc d’instinct et pas de réflexion.
KIBLIND Pour revenir à ce qui vous a décidé·es à dessiner petit : vous parliez toutes les deux de collections de petits objets, est-ce que vous pouvez développer un peu ce sujet-là ?
MN Moi je ne me l’explique pas trop. J’aime les objets en général et je me suis rendu compte que plus ils étaient petits, plus je trouvais ça mignon. J’ai le sentiment de ne pas être trop collection à la base. Mais malgré moi, je possède quelques collections car les gens s’engouffrent dans ce truc et m’achètent des choses. J’aime trop les mini-meubles, et ça j’en ai pas mal chez moi. Chaque pièce a son lot de mini-objets dédiés. Dans la cuisine, j’ai des mini-condiments, des mini-accessoires comme un mini-caddie, un mini-panier. Dans mon salon, j’ai plein de petits jouets qui vont aller des mini-artoys au mini-jouet du McDo.
C’est comme ce que disait Aurore, MC Squirrel il y a quelque chose de très sécurisant dans les mini-objets. À la fois, on peut se dire qu’on peut les emmener tout le temps avec soi et à la fois, moi j’ai pas envie qu’ils sortent de ma maison. Chez moi, y a absolument rien qui a de la valeur pécuniaire mais il y a ces petits objets. Je me dis que si quelqu’un débarque ici et veut cambrioler, il va être très déçu parce qu’il n’y a rien. Il y a que des jouets comme ça.
J’aime trop ces mini-objets aussi parce que c’est pas censé être des choses d’adulte. Alors que pour moi, c’est ce qui a le plus de valeur dans ma maison. Pour moi, premier degré, c’est très sérieux mes mini-objets.
C’est encore une histoire de contre-pied : adulte, on n’est pas censé avoir ça et pourtant j’ai décidé que c’était ma passion. Peut-être que j’aime ça aussi parce que ça fait plein de petites couleurs, je sais pas.
MCS Je te retrouve un peu là-dessus, sur le fait que ce sont des choses que nous ne sommes pas censées garder en tant qu’adulte. Quand je vois des gens qui ont des intérieurs très minimalistes, je me dis que chez moi ça doit paraître très enfantin. Il y a plein de toutes petites choses mais c’est pas pour autant qu’à mes yeux ce sont des objets pour enfant.
Les collections, ça a dû commencer quand j’étais petite avec les jouets Kinder, j’en avais plein. J’en ai encore beaucoup d’ailleurs. Pareil pour les fèves, j’adorais ça. Encore aujourd’hui, quand je vais en brocante, j’adore chercher les petites fèves, trouver les plus chou. C’est rassurant parce que ça me rappelle un peu l’enfance. Et je trouve ça cool de pouvoir en créer, de faire ma propre collection de petites choses.
KIBLIND Et toi, Jul, tu as aussi cette fascination pour les petites choses ?
JQ Alors, pour les objets et la collection, c’est pas du tout mon cas. Après, j’ai la chance de vivre dans un univers où il y a plein de petits trucs parce que je suis papa depuis pas longtemps, et nous passons notre temps à acheter de la dînette et des trucs comme ça. J’aime beaucoup mais ce
n’est pas quelque chose que je ferais pour moi. Mais c’est des objets avec lesquels je vis, et j’aime vivre avec ces petits fac-similés de la vie d’adulte.
Dans le dessin, c’est vraiment plus une fascination. J’aime les images qui servent à quelque chose et qui sont sorties de leur contexte. Quand j’étais petit, j’étais vraiment obsédé par les quatrièmes de couverture de bande dessinée. La fin des Picsou par exemple où tu avais toutes les petites couvertures des numéros précédents. Et esthétiquement, je trouvais ça vraiment cool. Limite ça m’intéressait plus que l’image en elle-même. J’adorais cet amas d’images. D’ailleurs – ça m’est revenu pendant qu’on parlait –, enfant, je fabriquais des livres pour les Barbie de mes sœurs. Je découpais toutes les mini-couvertures et je les recollais sur les faux petits livres que je fabriquais et ça faisait une petite bibliothèque de Picsou Magazine mais en miniature.
Aujourd’hui, j’aime bien quand je fais des séries de petits dessins, je les étale tous sur une table. Ça m’a réconcilié avec les questions du mignon et du jeu. Ce sont des choses, d’une manière tout à fait genrée et immature, qui n’arrivaient pas à me toucher étant plus jeune. Mais je commence à me rendre compte que ça a toujours été là dans ma vie et que j’avais besoin que ça revienne dans mon boulot, ce côté mignon, coloré, simple et petit.

« Moi quand je dessine en petit, c’est l’erreur que je recherche, justement. Il y a deux familles de dessins quand je dessine en tout petit. Il y a ceux qui sont vraiment bien tombés, et il y a quelque chose qui me plaît là-dedans, mais il y a aussi ceux qui sont à côté et il y a aussi quelque chose qui me plaît en eux. »
Jul Quanouai


KIBLIND Pour conclure, si vous aviez le pouvoir de miniaturiser quelque chose, qu’est-ce que ce serait ?
MN Mon appartement. Comme ça, je l’emmène partout avec moi. En revanche, il faudrait que j’aie le droit de le remettre en grand. Et comme ça, quand je me balade, je peux le redéployer et je suis partout chez moi. Et pareil avec les gens. Si on a envie d’emmener des gens, hop, dans ma poche en tout petit, comme les Minipouss.
MCS Je suis assez d’accord. Mon appartement en miniature ce serait pas mal. Ou alors, peut-être mes vêtements. Les voir en tout petit, ça me plairait bien.
MN Ah oui, les petites chaussures...
JQ Moi, j’allais dire qu’il n’y avait aucun objet qui m’intéresse en petit. La première idée qui m’est venue, c’est d’avoir la possibilité de me réduire moi, ma copine et mon fils, comme ça, on pourrait se faire des petits recoins dans l’appartement avec des cabanes en carton et recréer des petits univers. Comme dans le film Le Petit Monde des Borrowers que j’avais vu quand j’étais petit. Ils se font une table basse avec un bouton, ce genre de chose. C’est le rêve, ça décuple les moyens à l’infini.



Bruno Benne
Rocío Molina
Les Douze Travelos d’Hercule


Compagnie MPTA –Mathurin Bolze
Galactik Ensemble
Collectif Petit Travers & Quatuor Debussy
Nicolas Barry / Marie Gourdain
Abou Lagraa & Ballet de l’Opéra de Tunis
François Chaignaud & Aymeric Hainaux
Ballet de l’Opéra de Lyon
Merce Cunningham +Christos Papadopoulos
Ramon Lima
Marlène Saldana & Jonathan Drillet
Joana Schweizer
Crystal Pite & Jonathon Young
La Bouche Cabaret
Anne Martin
Ballet national de Marseille – (LA)HORDE
Tiago Guedes
NDT 2 | Marcos Morau + Botis Seva
Ayelen Parolin
Aïcha M’Barek & Hafiz Dhaou
Hoghe + Schulte & Emmanuel Eggermont
Tom Grand Mourcel & Vera Gorbatcheva
Jeune Ballet du CNSMD de Lyon + House On Fire
Premières parties
Cabaret
Histoire(s) de la danse
Cosmologies
Festival Écrans Mixtes
Festival utoPistes
Camping CN D














Ci-avant, une collection de collections. Les compositions qui s’enchaînent dans les pages précédentes sont celles de Manon Bucciarelli, réalisées pour son livre Ceci n’est pas une chaussure édité en novembre 2024 par Gallimard Jeunesse.
Elles ont toutes pour point commun d’inventorier de petits machins et des mini-choses qui ravissent notre goût pathologique pour l’accumulation. Autre point commun : elles sont sacrément jolies.




Star des blockbusters reléguée au rang d’outsider avec l’arrivée des images de synthèse dans les années 2000, la miniature de cinéma a connu un retour aussi surprenant que jouissif ces dernières années. C’est en particulier au réalisateur Wes Anderson qu’on le doit, mais aussi à un magicien plus discret, répondant au nom de Simon Weisse.
Avec sa fille Lucy Weisse et son équipe, le chef miniaturiste a construit les miniatures les plus emblématiques des films du réalisateur américain. Rencontre avec la famille de grands artistes qui se cache derrière ces œuvres miniatures.
Lui, c’est Simon Weisse, chef miniaturiste et prop maker* pour le cinéma depuis 35 ans. Le Franco-Allemand est aujourd’hui surtout connu pour être le miniaturiste attitré de Wes Anderson, pour qui il a réalisé les maquettes des films The Grand Budapest Hotel, Asteroid City, Isle of Dogs et The French Dispatch, entre autres merveilles cinématographiques.
* Fabricant d’accessoires.
C’EST QUOI UN·E MINIATURISTE ?
Un·e miniaturiste – également appelé·e maquettiste – conçoit et fabrique des modèles tridimensionnels réduits représentant des ensembles architecturaux et des éléments de décors pour des films de cinéma ou des pubs.
MINIATURE D’ART
MINIATURE POUR LE CINÉMA
Précise, soignée et méticuleuse, la miniature d’art est construite de manière à être adaptée à l’œil humain et à durer dans le temps. Lorsqu’elle est utilisée pour le cinéma, la miniature est cette fois pensée pour la caméra. Elle est donc travaillée de façon que la partie visible à la caméra seulement soit détaillée, et est temporaire.
Réplique
miniature du train EMD F7 des années 50 utilisée dans le film Asteroid City de Wes Anderson, tourné à Chinchon en Espagne.
PATIENCE
« Il faut beaucoup de patience et de l’imagination. Il faut aussi savoir détourner des choses de leur usage. Par exemple, savoir reconnaître des formes dans un objet qu’on pourrait réutiliser ou transformer un objet en un autre. C’est superimportant d’ouvrir ses horizons. » SIMON
Il n’y a pas de formation à proprement parler pour devenir miniaturiste. La seule école est celle du « learning by doing » dont Simon Weisse et sa fille Lucy sont des adeptes.
CHEF·FE DÉCORATEUR·RICE
Responsable de la création d’un décor de film et de toutes les étapes que cela implique, du dessin des plans à la supervision de la fabrication des éléments de décor.
Responsable de la construction des maquettes de A à Z. Celles-ci sont construites de façon artisanale grâce à une équipe aux savoir-faire variés (ébénisterie, peinture, sculpture…)
C’EST DANS L’ATELIER BERLINOIS
DE SIMON ET LUCY WEISSE QUE LES MAQUETTES
DES FILMS DE WES ANDERSON PRENNENT VIE
GÉNÉRALEMENT DE 10 À 15 ARTISAN·ES.
« On travaille à l’ancienne avec des marteaux et des clous » SIMON
« On travaille avec menuisiers, des architectes, des peintres, des gens qui travaillent le plâtre… C’est ça qui apporte le détail, qui rend tout beau, car ce sont des gens qui viennent de partout et qui ont donc des idées différentes aussi. Et puis, on peut toujours apprendre des choses d’autres gens, donc c’est très pratique. » LUCY POUR LE MUSÉE DU CINÉMA ET DES MINIATURES DE LYON
TheFrenchDispatch
Une fois les storyboards de Wes Anderson reçus, Simon Weisse et son équipe échangent avec le chef décorateur et le chef opérateur du film et se mettent à l’ouvrage.
« On parle toujours de maquette, donc les gens pensent qu’on est dans notre cave à la maison et qu’on joue au petit train, mais nous, on construit ces miniatures et ensuite, il y a un travail de peinture et de patine dessus qui est pour moi aussi important que le travail de construction. » SIMON
« C’est très important d’être perfectionniste. D’aller jusqu’au bout, de presque même faire l’arrière de la maquette. De mettre de minuscules rideaux derrière les fenêtres même si elles sont très loin. C’est ça qui donne la vie à ces miniatures. » LUCY
TheFrenchDispatch
Isle of Dogs
« On construit nos maquettes le plus grand possible. Dans les années 1950-60, quand on filmait un avion, même s’il était petit, ça passait avec l’œil du public. Maintenant, l’œil du public a changé. Un avion va désormais faire 1 mètre et plus 30 cm parce que les caméras sont devenues meilleures et l’image est devenue plus nette. »
SIMON
« Quand il y a d’autres éléments qui entrent en jeu avec les maquettes comme la pluie, la fumée, le feu, plus c’est petit, moins ça marche. » LUCY
« Il y a des échelles qui reviennent souvent, par exemple à cause des tailles de wagons et de locomotives. Il y a des gens qui construisent des trains et des paysages chez eux, donc là, on peut tout acheter, les personnages, les chaises, la machine à laver etc... » LUCY
TheWonderfulStory ofHenrySugar
Lorsqu'elles sont construites, les miniatures sont souvent filmées en post-production, à un endroit différent de celui du tournage du film de Wes Anderson.
« Il est rare qu’on aille sur le tournage. Une fois, on a construit quelque chose qui nécessitait qu’on soit là avec les acteur·rices, etc., mais sinon, on construit à Berlin et on envoie à Londres pour Wes. » SIMON
« Wes ne vient jamais sur les tournages. Il est venu une fois sur le Grand Budapest Hotel. Ce qui l’intéresse, ce n’est pas la maquette en ellemême, c’est le rendu à l’image. Nous, on essaie de composer ça comme il le souhaite. On lui envoie une image prise à l’appareil numérique pour qu’il découvre ça sur son écran. » SIMON
Alors que les décorateur·rices et scénographes doivent définir les couleurs et la patine d’un élément de décor en se projetant sur un plateau de cinéma où la lumière peut jaillir de partout, le miniaturistes ont l’avantage de pouvoir décider eux-mêmes de la lumière.
« Wes veut toujours tourner en lumière naturelle, il n’aime pas le studio. Nous, il faut dire qu’on a certaines maquettes qui sont immenses. La maquette d’un chemin dans La Merveilleuse Histoire de Henry Sugar faisait 50 mètres de long, et louer un studio qui fait 50 mètres de long avec tout l’éclairage, ça aurait coûté un prix horrible. » SIMON
« Il voulait tourner ça en extérieur, sauf que c’est compliqué à Berlin au mois de novembre. On avait trouvé une serre vide qui faisait pile la bonne taille donc on l’a transformée en studio de cinéma pour tournage de miniatures. » SIMON
« Même si l’image pour laquelle on a travaillé pendant des mois ne dure qu’une seconde à l'écran, il suffit que 100 000 personnes aillent au cinéma et ça fait 100 000 secondes » SIMON
LE GRAND BUDAPEST HOTEL, LA MINIATURE LA PLUS MARQUANTE POUR
Le Grand Budapest Hotel est inspiré du Grand Hotel
Pupp à Karlovy Vary en République tchèque.
TEMPS DE RÉALISATION
Deux mois à 6 ou 7 personnes
TAILLE
3 × 4 m
« Ça a été un point de départ pour le travail qu’on fait aujourd’hui, c’est notre référence principale. Tout le monde nous connaît, même celles et ceux qui n’ont pas vu le film, c’est assez curieux. On en vend partout, sur des tasses, dans des calendriers de l’Avent. L’autre jour, j’ai même vu un essuie-pieds avec l’hôtel dessus. » SIMON
« Pour cet hôtel, on a choisi l’échelle 1/18 pour une raison toute bête : au départ, il devait y avoir plein de voitures garées devant. Et à cette échelle, on trouve toutes les bagnoles qu’on veut. » SIMON
Si l’utilisation de la miniature au cinéma reste une pratique bien plus marginale qu’au temps des Jurassic Park, Titanic et E.T., elle re-gagne en popularité grâce à des réalisateur·rices modernes désireux·ses d’apporter une dose d’authenticité à leurs films et de créer des esthétiques où l’imparfait devient charmant. Mais aussi et surtout grâce à celles et ceux, qui comme Simon et Lucy Weisse, construisent depuis leur atelier des mondes qui resteront à tout jamais dans les mémoires de millions de personnes.
« Comme maintenant, on a cette possibilité de rattraper des choses en post-production en numérique, les images de synthèse peuvent être complémentaires. Je connais des collègues et des réalisateur·rices qui ne veulent que du numérique ou que de la maquette. Moi, je leur dis “prenez un peu de tout, mais prenez le meilleur de tout, mélangez ces techniques et vous allez arriver à un résultat superbe”. » SIMON
Ce reportage sur les miniatures au cinéma vous a ouvert l’appétit ? Courez donc au musée du cinéma et des miniatures à Lyon, où vous pourrez voir de vos propres yeux plusieurs miniatures utilisées dans les films de Wes Anderson dans un espace qui lui est entièrement dédié.

Au-delà des imaginaires et des terreurs nocturnes, comme la simple idée d’un scarabée géant au fond de son duvet, les insectes sont nos amis pour la vie, la vraie.
C’est ce que cherche à montrer l’équipe de l’insectarium de Montréal avec un musée exemplaire et une plaque tournante de l’entomologie internationale qui, derrière les sujets minuscules, voit toujours les choses en plus grand.



Anopheles punctipennis. . Carabus granulatus. Arthropodes… Il y a des jours, comme ceux-là, où la vie se joue sur Wikipédia et le soleil se couche, avec une tempête de neige, sur le sen- timent de se sentir moins bébête que la veille. Comme ses autres camarades du dictionnaire, la macrophotographie fait aussi partie des nou- velles découvertes qui rendent aussi puissant sur le plan du vocabulaire que véritablement minuscule sur tous les autres, face à plus d’un million d’espèces d’insectes recensés actuel- lement sur la planète. Étudiant originaire de Montpellier, Raphaël Grellety pratique la tech- nique qu’il nous explique dans un café branché de Montréal. « La macro consiste à photogra- phier des sujets de petite taille au plus près et sans zoom ». Elle est très utilisée dans l’univers des insectes, une véritable passion qu’il exerce aujourd’hui entre la photographie ama- teur et un double cursus universitaire d’entomologie entre le sud de la France et le début du grand Nord. En Abitibi-Témiscamingue, où la forêt boréale commence à s’étendre à perte de vue, il étudie, pendant deux ans, l’impact de l’évolution des écosystèmes forestiers sur la vie des insectes, en comparant trois secteurs où la patte de l’homme s’est plus ou moins avancée. « Pour schématiser, l’été, on recueille les sujets (jusqu’à 12 000 insectes grâce à des pièges éparpillés dans la forêt) et l’hiver, on les invento- rie et on les analyse, dans les labos de recherche. Le but, c’est de comprendre l’impact des coupes d’arbres sur la vie des araignées et, plus généra- lement, sur l’évolution de la biodiversité fores- tière. » De passage à Montréal pour quelques semaines, Raphaël Grellety trace sa route, encore à peine enneigée, comme une version pour adultes d’un « Défis nature » qui ne servi- rait plus seulement à jouer. Passionné, depuis tout petit, par la nature et par les animaux, il est de la team brame du cerf, tentes d’affût dans les Cévennes ou stage d’éco-volontariat à Madagascar, à la recherche d’une espèce de punaise bien particulière et jamais encore
photographiée. « L’hiver, en France, je n’ai pas de problème à trouver quelques sujets, un peu lé- thargiques, à prendre en photo. Mais ici, je suis contraint de faire une pause et de chercher, avec un téléobjectif, des oiseaux ou des mammifères. »
La forêt et les arthropodes, dissimulés sous le manteau, s’éloignent ainsi, comme dans le rétroviseur d’un pick-up, mais Montréal, tout au long de l’année, ne cesse de s’intéresser aux bibites, l’autre petit nom des insectes dans le jargon québécois. L’entomologie, la branche de la zoologie qui leur est consacrée, est en- seignée dans toutes les grandes universités de la ville et, côté anglophone, McGill dispose d’un musée scientifique, Lyman, fondé dès 1914 et doté d’une collection de 2,8 millions de spécimens. Surtout, depuis 35 ans, l’insec- tarium municipal s’est érigé en figure de proue de la recherche et d’un vaste projet scientifi- co-culturel visant à changer l’image des petites bêtes auprès du grand public.
« Mais qui sommes-nous sur cette planète pour décider qu’un insecte ne mérite pas de vivre parce qu’il est petit ? » Ancien notaire, Georges Bros- sard a fait partie de ceux qui portent la banane à sa position d’origine et parcourent le monde à la découverte des insectes. Un vrai person- nage, voyageur vertébré autant qu’invétéré, qui a traversé plus de 100 pays et amassé plus de 250 000 spécimens, soit la plus grande col- lection privée au monde, stockée dans le sous- sol de sa maison. L’idée de l’insectarium voit le jour dans cette même pièce, en 1985, lorsque le maire de Montréal et le directeur du jardin botanique découvrent son trésor souterrain. Après cinq ans de préfiguration, incluant la visite de deux établissements japonais de ré- férence, une campagne de crowdfunding avant l’heure et le legs de sa collection à la ville, le premier insectarium est inauguré en 1990
au cœur du parc Maisonneuve. Bon nombre de passionné·es, professionnel·les ou simples citoyen·nes, ont participé à la démarche, comme le frère Firmin Laliberté qui a co-fondé l’Association des entomologistes amateurs du Québec dans les années soixante-dix. Il a constitué une collection de plus de 100 000 insectes et fédéré une communauté internationale de paroissien·nes sensibles aux bibites.
Immédiatement, le nouvel insectarium de Montréal séduit le public à travers sa collection permanente, constituée d’espèces vivantes ou naturalisées, et ses événements. Lancé dès 1993, par exemple, « Croque-Insectes » propose une initiation à l’entomophagie à base de petites recettes qui font plaisir, année après année, comme la bruschetta à la chenille de bambou ou le roulé de tortillas aux fourmis Atta. Différents programmes de recherche et de sauvegarde sont également lancés, notamment en faveur des papillons migrateurs Monarque, connus pour leurs belles ailes orangées et leurs allers-retours de 7 000 km entre le nord et le sud de l’Amérique. Georges Brossard a ainsi réalisé son projet et devient un ambassadeur médiatique de l’entomologie, enchaînant les séries documentaires, comme Mémoires d’insectes ou Insectia. En 2004, il inspire le film Le Papillon bleu qui raconte son voyage au Costa Rica, dix-sept ans plus tôt, accompagnant un jeune garçon atteint d’un cancer en phase terminale et guéri, miraculeusement, après avoir réalisé son rêve ultime : découvrir un morpho bleu. Deuxième grand collectionneur-donateur du musée, Firmin Laliberté a également laissé une trace importante dans le petit monde fabuleux des amateurs et amatrices d’insectes au Québec. Plus de quinze ans après sa disparition, son association est encore très vivace, entre sorties d’identification, soirées entomologiques et conférences sur l’élevage de cloportes. La page Facebook ressemble à un préquel des réseaux sociaux avant X, sur lequel on
s’échange poliment des conseils, des bons plans pour le Salon de la Nature et des macrophotos de Phidippus purpuratus ou de Tricholochmaea cavicollis…
En 2012, en prévision du 375e anniversaire de la ville (2017), l’insectarium lance une démarche de refonte complète de son projet ethnogra phique. Elle aboutira, dix ans et une pandémie plus tard, à l’inauguration d’un musée vivant, entièrement remodelé, basé sur l’expérience et l’immersion au contact des insectes.
Ancien responsable de la recherche et des col lections, promu directeur de l’établissement en 2019, Maxim Larrivée n’est pas du genre minuscule, à croire que l’allure sympathique et la taille du bonhomme aident à voir les choses en grand et en mieux. Ce passionné précoce de papillons, qui se souvient de sa première collection de 32 espèces, dès l’âge de trois ans, a impulsé et accompagné la « Métamorphose » de l’insectarium pour lui donner un écrin d’exception, assez unique en son genre, fréquenté par plus de 250 000 personnes chaque année. « Dès 2012, on a entrepris une démarche de concertation inspirée par la théorie de la biophilie. On est parti du constat que les insectes génèrent des émotions, du dégoût à l’émerveillement, et qu’il fallait travailler sur ce registre pour changer leur image et apprendre au public à coexister avec eux. »
Un concours international d’architecture est lancé, en 2014, pour répondre à ce nouveau projet culturel et à un cahier des charges qui tient sur une colonne vertébrale : « Le design du nouveau musée devait contribuer à l’expérience biophilique des visiteurs·euses, c’est-à-dire favoriser l’immersion et l’interaction avec les insectes à tous les niveaux : sensoriel, émotif, esthétique… »
C’est un consortium montréalais-berlinois qui est retenu pour construire le nouvel édifice, en lieu et place du premier, avec un ensemble




de cases fondamentales à cocher, sur le plan de l’architecture, du paysage, de l’expérience visiteur, de l’éco-conception et de la façon de faire coexister du public, des chercheur·euses et des milliers d’insectes vivants dans un même bâtiment.

Plus de deux ans et demi après sa réouverture, Maxim Larrivée ne se lasse pas du résultat et on le comprend, surtout quand on a la chance de faire la visite dans son sillon. Alors que l’édifice se découvre, de l’extérieur, par sa vaste serre translucide en dents de scie, elle commence par l’exploration souterraine d’une série d’espaces reproduisant les grandes caractéristiques de perception des insectes : vision, hautes fréquences, ultra-violets sur les plantes, évolution dans l’espace avec une caméra qui nous filme à l’envers pour se voir avancer sans considération de gravité… « C’est un bon exemple du design au service de l’expérience : tout l’espace est conçu avec du béton projeté, qui évoque la sensation de la terre, en rappelant les irrégularités des territoires, les trous, les cavités et tous les petits endroits que les insectes utilisent pour survivre. » Le directeur nous laisse ensuite profiter des « tête-à-tête » proposés avec des insectes vivants, comme une expérience de dating avec six espèces exceptionnelles (sauterelle à capuchon géante, mante orchidée, etc.) censée virer au coup de foudre. Ici comme ailleurs, les explications sont seulement proposées sur l’application d’accompagnement à la visite, afin de se consacrer uniquement à la sensation du vivant et de matérialiser le concept de « cognition incarnée », cher à notre guide : « On a tout fait, en quelque sorte, pour ne pas rester un musée scientifique classique, où l’on apprend, mais d’abord un lieu où l’on ressent. » C’est une transition parfaite avant de découvrir le « Dôme », l’une des pièces maîtresses de l’établissement, où plus de 2 500 insectes naturalisés sont ordonnés, dans un décor et un silence de
cathédrale, à travers deux rangées de 36 cadres lumineux, classés par couleurs et par caractéristiques physiques, comme les grandes langues ou les « pattes impressionnantes ».
« Les architectes ont réussi à nous convaincre, notamment sur l’organisation par couleur, qui est un peu une hérésie pour des scientifiques comme nous. C’est un parti pris esthétique qui fait aussi partie de l’ambition globale, à savoir offrir un sentiment de beauté, voire un moment de méditation, aux visiteur·euses… » Partie intégrante du consortium, le cabinet d’architectes allemand Kuehn Malvezzi est justement renommé pour ses lieux de culte, à l’image de la future House of One, un lieu de prière œcuménique au cœur de Berlin, rassemblant une église, une mosquée et une synagogue dans un même édifice…
« Il fait trop chaud pour vous, Madame ? »
Maxim Larrivée a le petit mot facile et la photo instantanée lorsqu’il tombe sur un papillon, dans le grand vivarium, dont il partage une information auprès de ses équipes de recherche. C’est vrai que l’ambiance est volontairement tropicale dans ce grand espace en pente douce, entièrement revêtu de verre et d’un grand filet permettant de faire cohabiter plus de 120 espèces vivantes, dont de nombreux papillons en semi-liberté. « L’espace a été très complexe à concevoir, avec beaucoup de contraintes techniques, un milieu naturel à reproduire et 60 % d’humidité pour favoriser l’activité des insectes, ce qui permet au public de partager un vrai moment avec eux. » Les papillons volent, peuvent se poser sur quelqu’un, d’autres espèces s’affairent, sous des yeux ébahis, comme l’impressionnante colonie de fourmis coupeuses de feuilles qui cultivent, de façon militaire, l’énorme champignon dont elles s’alimentent en retour.


Au-delà de l’expérience pour le public, le vi- varium sert également d’observatoire pour les cinq chercheurs et chercheuses, à temps plein, de l’établissement ; ils réalisent sur place des études comportementales, de conser- vation et d’adaptation, notamment pour les espèces menacées, toujours avec l’objectif d’acquérir du savoir sur la biodiversité et les conséquences du réchauffement climatique.
« Le champ de découvertes reste très vaste, car on estime connaître seulement 10 % à 20 % des espèces d’insectes sur la planète, dont une grande partie vivent dans des régions tropicales qui n’ont pas forcément les mêmes priorités… » Nous rencon- trons Julia et Michel, à la sortie du laboratoire, juste derrière le champignon des fourmis, qui participent notamment au programme « Mis- sion monarque » visant à protéger les habitats de reproduction de cette espèce en déclin. Comme d’autres dispositifs initiés par l’insec- tarium (e-butterfly, Sentinelles du Nunavik, etc.), il s’appuie également sur une démarche de science participative, permettant à cha- cun·e de contribuer à la collecte de données, avec l’aide des outils numériques et de l’intel- ligence artificielle. À côté des chercheur·euses, l’établissement regroupe également une équipe horticole à temps plein, qui intervient à l’intérieur et à l’extérieur du musée, ainsi qu’un petit groupe de médiateur·rices chargé des nombreuses activités et animations proposées en continu. C’est Lucile avec ses cheveux cou leur jungle qui s’occupera par exemple de nous déposer une sauterelle géante sur la main, le temps d’une petite session d’autonettoyage qui prend tout son temps…
La visite s’achève, à la sortie du vivarium, sur l’espace dédié aux ateliers face au jardin des pollinisateurs qui témoigne, malgré la neige, de l’ouverture du musée vers l’extérieur. On saisit ainsi l’ambition définitive du directeur qui œuvre toujours à ouvrir le monde des in sectes sur d’autres univers, comme la cuisine,
le design ou le spectacle vivant. À côté du restaurant saisonnier Croques-Insectes, par exemple, l’insectarium a sollicité un chef pour concocter une box gastronomique, « Entomo- Miam », qui contient notamment de la tape- nade de tomates aux ténébrions ou des petits sablés aux grillons. De la même manière, dans le cadre de ses résidences artistiques, l’insecta- rium a accueilli en 2024 la création chorégra- phique d’une artiste québécoise, Claudia Chan Tak, qui s’inspire des papillons malgaches dans le cadre d’un spectacle autour de ses origines. « Vous avez compris, conclut Maxim : nous souhaitons contribuer, à notre échelle, à développer une société entomophile, car elle a tout simplement besoin des insectes pour vivre ! Au même titre que le design de notre musée a pu être qualifié d’anti-architecture, au sens où elle s’efface au service des sujets, notre mission fonda- mentale serait de faire en sorte que notre propre musée devienne même inutile… »
En attendant, sur un autre plan de la ville, Raphaël Grellety veut continuer à se rendre utile avec les araignées. « C’est un type d’insectes, moins étudié que d’autres, qui est un maillon es- sentiel de la chaîne alimentaire car elles sont à la fois des prédatrices et des proies. Elles s’adaptent à tous les environnements, jusqu’à 6 000 mètres d’altitude, et même aux perturbations, car ce sont souvent les premiers insectes que l’on retrouve






©Mahdi Aridj



La bande dessinée est née libre et partout, elle est dans les fers. Contrainte dans son format et dans son esthétique, elle erre le regard vide, de case en case, de gros nez en gros nez. Pourtant, il existe des cas où elle se fait toute petite et parvient à se faufiler vers la lumière. C’est le cas de la première histoire des Schtroumpfs de Peyo, qui s’était insérée en format minus dans Le Journal de Spirou. C’est le cas, aussi, de La Couleur des choses de Martin Panchaud qui fait de son minimalisme une grande œuvre.




















Il était écrit qu’ils devaient naître ainsi. Après leur apparition dans La Flûte à six schtroumpfs (ou... à six trous, son titre original), seizième histoire de la série Johan et Pirlouit du même Peyo, c’est dans un mini-récit au mini-format inséré dans le n° 1107 du Journal de Spirou en 1959 que les Schtroumpfs prennent leur indépendance avec leur première aventure : Les Schtroumpfs noirs. La version que nous connaissons toustes est celle publiée en 1963 et redessinée pour s’adapter à la taille album. Mais avant le prestige de la brochure et la gloire des librairies, les gars bleus les plus célèbres de la partie sont devenus très grands en se faisant tout petits.
L’histoire des Schtroumpfs combine à peu près tout ce qu’on adore : une idée sympa, un bon retour public, une initiative éditoriale et la complicité de plusieurs artistes. Évidemment, rien n’était prévu. En 1958, Peyo aka


Pierre Culliford est un des auteurs bien installés du Journal de Spirou, sorte de hall of fame de la bande dessinée franco-belge d’après-guerre où on croise Franquin, Morris, Jijé, Tillieux et Roba. Un truc qu’on appellera l’École de Marcinelle. Il commencera à prendre un bon statut au sein du journal grâce au succès de Johan et Pirlouit, qui raconte les aventures de deux potes au Moyen Âge. Les Schtroumpfs y font leur première apparition en 1958, parce qu’il fallait à Peyo des êtres magiques pour être les fabricants magiques de la flûte magique au cœur de son histoire. Un langage (inventé avec Franquin), une couleur (choisie par la coloriste Nine, sa femme) et des dégaines de lutins (piochées dans ses souvenirs d’animateur à la C.B.A.) plus tard, les Schtroumpfs existent. Et, alors même qu’ils n’apparaissent que dans dix pages, ces énergumènes font un immense tabac chez les lecteur·rices de Spirou.
C’est alors qu’intervient Yvan Delporte, petit rigolo porté à la tête du Journal justement parce qu’il l’était. Yvan Delporte voit dans Les Schtroumpfs matière à se faire un peu mousser. Reprenant un système de pliage expérimenté dans le numéro 1000 de Spirou, il se dit que ce serait drôlement malin – et ça l’est, effectivement – d’encarter dans sa publication un mini-récit inédit de 48 mini-pages de 10 × 7 cm. Et qui de mieux que les Schtroumpfs pour lancer cette idée de génie, eux qui, n’étant pas bien grands, n’auront aucun mal à entrer dans ce mini-format. Peyo dit « bingo », Yvan Delporte dit « je t’aide pour le scénario parce que je suis rigolo » et Les Schtroumpfs noirs, première histoire des Schtroumpfs, paraît donc dans ce format impossible. Ainsi, les enfants lecteur·rices ont pu allégrement se planter quelques agrafes – non fournies par le magazine – dans la main afin de fabriquer en DIY cette BD devenue collector.
La société ayant bien changé et le soin des mains étant devenu primordial, Frédéric Niffle puis Dupuis ont eu la bonne idée de rééditer ces proto-Schtroumpfs en peu plus grand que le format initial, mais déjà reliés (et cartonnés, et avec un dos carré). Ainsi, la version ici présentée est celle de cette nouvelle édition de 2018. Mais l’intérêt que nous y apportons reste le même car la présente publication reproduit les dessins et le découpage originaux. Comme le dit lui-même le dossier consacré à ces mini-récits dans Le Journal de Spirou n° 1672, « le format d’impression conditionne le dessin ». Et nous sommes forcés de le constater, alors même que nous tenons devant nos yeux des pages bien différentes de celles que nous avons lues durant notre jeunesse. En dehors du style rondelet qui s’est affirmé entre 1959 et 1963, on remarque que la version mini (et peut-être la rapidité d’exécution due à la périodicité du magazine) force Peyo à faire plus simple. Ainsi le trait est-il plus épais, les lignes moins nombreuses et l’efficacité poussée à son maximum. Les détails ne comptent guère quand la case fait moins d’un centimètre et les décors sont réduits au strict minimum. Tout est là pour le récit pur, la dynamique, la conduite de la narration. Au contraire, quand l’histoire paraît en album, Peyo et son assistant Francis Bertrand se laissent aller à la construction d’une atmosphère, d’un paysage. Les Schtroumpfs noirs y trouvent des ornements. On y perd sans doute en art de la synthèse mais on y gagne en univers, en caractérisation des personnages. Chacun jugera. On notera aussi que le gaufrier se transforme : là où il y avait quatre bandes de cases par page, il y en a cinq dans le grand format qui ne compte plus que vingt pages. Il se passe beaucoup de choses en peu de pages et l’action y est décrite plus patiemment. Mais le petit format a fait son travail sur le dessin de Peyo et ni les lecteur·rices d’hier, ni celles et ceux d’aujourd’hui ne s’en plaindront.


Il est d’ailleurs intéressant de noter que ce mini-récit n’est pas resté lettre morte. Ni dans Le Journal de Spirou, qui continuera de nombreuses années à en encarter dans ses pages (dont cinq autres Schtroumpfs) jusqu’au XXIe siècle avec notamment du Lewis Trondheim. Mais on retrouve encore aujourd’hui ce même système de bande dessinée à faire soi-même, incluse dans les pages de votre journal préféré. Biscoto magazine, par exemple, propose chaque mois un livrikiki à confectionner soi-même. Et il aura eu la bonté de ne pas attendre cinquante ans avant de les publier en relié et cartonné via ses recueils Minimaxilivrikiki. L’éditeur L’Articho n’a même pas besoin d’avoir un périodique pour sortir sa collection minuscule « Coco Comics ». Au-delà du format, on trouve un clin d’œil appuyé à notre histoire dans le très méta Opération Cracoucass, où nous pouvons fabriquer là aussi notre propre mini-BD, encore plus mini que mini. Il s’agit, nous l’avouons, du point de départ de ce texte. La petitesse a donc ses vertus, que ce soit en termes de sous, de dessin et d’aspect ludique pour les lectrices et lecteurs.
POUR LIRE +
→ Les Schtroumpfs noirs de Peyo, Dupuis, collection
« Les mini-récits Schtroumpfs », 2018
→ Minimaxilivrikiki n° 1, collectif, Biscoto, 2024
→ Opération Cracoucass de Tofépi, L’Articho, 2024
POUR EN SAVOIR +
→ Topo sur les mini-récits : bdcouvertes.be/bdcouvertes/ MiniRecits/minircit.htm
→ Peyo l’enchanteur de Hugues Dayez, Niffle, Dupuis, 2018
Je lui ai pris tout ce qu’il avait, mais c’est pas grand-chose…
Pas de chance.
Taisez-vous !
Voilà Simon !
Hé, mais… Ah ! Tu as encore un gâteau pour nous ?
Je dois vraiment y aller ! Ne le prenez pas, cette fois… C’est pour l’anniversaire de Rupert.
On a une idée pour se faire du fric honnêtement ! Mais on a besoin de toi.











!




Il a encore grossi





On ne veut pas de ton gâteau. Viens t’asseoir










! Je ne ferai plus de trucs dégoûtants… La dernière fois, j’ai dû aller chez le médecin et ma mère ne sait toujours pas la vérité.
On ne te fera rien, cette fois. Nous sommes amis maintenant…
Tu connais Winney McMurphy ?
La voyante ? Oui. Elle commande parfois des gâteaux ésotériques à ma maman.
Hé, m’dame ! Voulez un coup de main ?

Urf



Foutez-moi le camp, bande de voyous.
On l’a vue l’autre jour faire ses courses au Sainsbury’s.
C’était horrible ! Elle transpirait et poussait des petits gémissements à chaque pas.





Un taxi ! Ça doit lui coûter une fortune.
Alors, on s’est dit qu’on pouvait lui livrer ses courses !







Mais voilà. Le problème, c’est que dans le quartier, on s’est déjà fait une mauvaise réputation. Alors elle n’a pas trop confiance.






Mais toi, c’est différent. Vu que tu es gros… Comme elle.





Je suis sûr qu’elle est prête à bien payer. C’est du gagnant-gagnant… et honnête !




Elle prend un taxi pour faire ses courses ?!







Salut ! Toujours à glander ?

Je ne sais pas trop. La dernière fois, vous…
C’est du passé, tout ça !
Alors, tu acceptes ou pas ?!




Salut, Lorna !
On ne glande pas, on travaille !

Simon, je te présente ma sœur Lorna.
On discute affaires, là.
Hé, faites tourner le gâteau !
Mmmm…! Mais il est excellent, ce gâteau !
Alors, tu acceptes ou pas ?
En plus, la licorne… C’est mon animal porte-bonheur !
Les clopes.
Tu vois, ici, on sait tous fumer et…
Oh ! Le joli gâteau ! Je peux en avoir ?
Je ne t’ai jamais vu dans le quartier… Tu t’appelles comment ?
Ben… Simon.
C’est… C’est ma maman qui l’a fait ! Elle fait des gâteaux de toutes les couleurs !
C’est vrai qu’ils sont bons, les gâteaux de ta mère.




Bah oui, en fait…

Mais pourquoi vous avez toujours besoin d’argent
Ça ne te regarde pas !

… ça coûte une fortune de fumer.

CABINET DE VOYANCE ET MAISON DE WINNEY MCMURPHY
Bon ! Alors ! Tu dis quoi ?
Si ça marche, on va se faire un paquet de fric ! Et toi, tu feras quoi ?
C’est quand même un peu minable. Tout ça pour des cigarettes…
Moi ? Haha ! J’épouserai un riche !
Ah ! Tu finiras avec un vieux !
Toi, tu la fermes ! Tu ne parles pas comme ça à ma sœur ! Et toi, Simon, t’en dis quoi, alors ?
Elle m’a donné la liste de courses. Elle est d’accord pour 10 £ !
OK, on y va.
10 £, c’est pas beaucoup.
Je suis sûr qu’elle l’a fait exprès ! Mpff ! 12 litres de lait et 15 litres de Coca ! Eh ben !
Et pourquoi il ne porte rien, lui ? C’est lourd, merde !
La ferme !
Allez ! Plus vite, je lui ai dit qu’on serait de retour dans une heure !
Hmm… J’ai bien réfléchi… Et je suis d’accord pour vous aider ! Mais je ne pourrai rien porter, j’ai des problèmes de dos. C’est lié à mon poids, d’après le médecin.
Mpff.
Posez les sacs là.
On t’attend un peu plus loin.
Dépêche-toi !
Ça suffit pour un paquet de clopes !
Le monde de la bande dessinée s’est paré de points d’interrogation et de bouches bées lorsque son plus illustre et international festival consacra La Couleur des choses de Martin Panchaud avec son Fauve d’or 2023. L’objet avait en effet de quoi surprendre : sous couvert de polar bon teint, le Suisse défrichait une piste graphique détonnante à base de cercles colorés, de plans d’architecte et de mise en page type schéma d’ingénierie spatiale. Le livre faisait ici le pari de lecteur·ices investi·es, prêt·es à déchiffrer ce code nouveau pour plonger dans un récit trépidant. La Couleur des choses ou quand le minimalisme prend de l’épaisseur.
En 2016, Internet fut créé afin d’accueillir Swanh.net, la première œuvre qui présenta au monde le travail de Martin Panchaud. Une bande dessinée de 123 m de long, déroulable à la souris, et qui nous refait le match aller entre Dark Vador et l’alliance rebelle, celui de l’épisode IV. Cette bande dessinée numérique possède une particularité légèrement plus originale qu’un fanatisme random pour Star Wars : ses personnages sont des points et tout est observé depuis le dessus. À première vue, on pense être de retour en classe de techno, à se fader le circuit électronique d’une alarme de cartable. Mais si l’on prend le temps de se pencher plus avant sur la chose, en se forçant même un peu, l’histoire se déploie et nous emporte dans cette aventure pourtant vue et revue lors de longs week-ends de la Pentecôte. Plus qu’une facétie de petit malin, le langage mis en place par Martin Panchaud vient questionner les limites de la bande dessinée, trouble notre rapport à l’image qui en est le cœur et relance cette vieille machine que l’on croyait avoir perdue à l’adolescence : l’imagination. Ce que le monde ne savait pas, en revanche, c’est qu’il s’agissait d’un simple tour de chauffe avant le décollage de la fusée Martin Panchaud. Celui-ci aura lieu quatre ans plus tard avec la publication de Die Farbe der Dinge chez la très vénérable maison suisse-allemande Edition Moderne. Mais comme le Festival d’Angoulême n’a pas fait allemand LV1, il ne lui attribuera son Fauve d’or qu’avec la traduction française parue aux éditions Çà et Là : La Couleur des choses.

Swanh ne s’est pas posé sur la planète terre en venant d’ailleurs et, non, Martin Panchaud n’a pas subi d’abduction. Ce projet est le fruit d’une démarche engagée par l’auteur et quelques-un·es de ses ami·es au sortir de ses études. L’École professionnelle des arts contemporains de Saxon, première école à enseigner la bande dessinée en Suisse, lui a ouvert les yeux. En peaufinant sa maîtrise de la PAO et en lui faisant dans le même temps découvrir le monde merveilleux du 9e art, ses études ont fait de l’aspirant auteur un mutant. Après son diplôme, il fonde avec des gens venus de tous les bords des arts visuels l’association Octopode qui aura pour but de faire dialoguer la bande dessinée avec d’autres disciplines pour créer de nouveaux chemins. Le sien fera confronter sa pratique du graphisme et la narration séquentielle. Je suis suisse, pourrait-il résumer, tant la culture helvétique du minimalisme et de l’épure guide ses recherches. C’est dans ce cadre qu’il forme ses premiers ronds et schémas à la base de son langage dessiné. Si le projet Octopode n’aura pas tant de suite en librairie, il ouvre néanmoins pour Martin Panchaud le champ des possibles. Et Swanh naît de cette ambition. La Couleur des choses, qu’il travaille de longues années durant, est l’application personnelle de cette syntaxe inventée à un récit hard-boiled à la sauce anglaise diablement séduisant.
La légende veut que ce soit lors d’un séjour linguistique en Angleterre que naît l’histoire de Simon, jeune adolescent au foyer dysfonctionnel qui n’a pas l’âge pour jouer aux courses mais qui y joue quand même. Et gagne. Il s’agira alors pour lui de tout faire pour récupérer son magot, ce qui inclut pas mal d’embrouilles au passage, avec des potes, son père, des flics, et où vient même se nicher un flingue. La perfide Albion pose un décor parfait pour ce roman graphique noir où l’on entend presque l’accent cockney chanter depuis les petites boules colorées qui nous servent de personnages. Ce genre de récit prend l’exact contre-pied du style graphique froid utilisé par Martin Panchaud. La violence, l’action permanente et les sentiments exacerbés que possède cette littérature de genre ne devraient pas s’accommoder des compositions schématiques et de l’inexpressivité des acteur·rices principaux·les. Pourtant, La Couleur des choses marche et embarque les lecteur·rices aussi bien, voire mieux qu’une BD au dessin virtuose.
C’est que le Suisse maîtrise son sujet et son style qu’il a travaillé des années durant. Il use de l’espace de la page comme d’un plan dans lequel l’œil doit cheminer. Sa science graphique guide notre regard et l’amène du point A au point B, exactement comme il l’avait prévu. Mais surtout l’auteur n’est pas seul dans sa galère. La silencieuse esthétique du livre agit paradoxalement comme un aimant sur la personne qui le tient entre ses mains. Qui ouvre l’album doit faire un pas de plus qu’à l’accoutumée pour pouvoir en décrypter le code. Ce faisant, on s’engage corps (les yeux sont doublement attentifs) et âme (les rebondissements le touchent alors deux fois plus) dans le récit qui se déroule sous son nez. À cette immersion mentale vient s’ajouter aussi une sorte de fierté d’avoir décodé cette langue mystérieuse qu’on pourrait croire sortie du plus obscur dictionnaire d’informatique. Le piège s’est refermé sur nous. L’aspect ludique n’est pas à négliger non plus pour ce qui se présente avec un point de vue top-down, cousinade assumée avec les jeux vidéo qui nous firent vibrer jadis, tels les premiers GTA voire le jeu de foot Kick off pour les plus ancien·nes d’entre nous..

Mais il est un autre aspect de la bande dessinée que Martin Panchaud manie ici avec brio : le texte. Non seulement il ressort de ses vieux dossiers l’art subtil de la typographie pour créer ici un décor visuel et développer là l’expressivité de ses personnages, mais l’usage littéraire qui en est fait agit comme l’huile dans ce rouage ascétique de formes et de traits géométriques. Car l’auteur ne pouvait pas ici faire fausse route. Le genre abordé nécessitait d’une part qu’on sente la gouaille et la roublardise de personnages aux prises avec le bitume de la vie. D’autre part, puisque son dessin efface les visages et les gestes de ses héros, Martin Panchaud se devait de tout faire passer par le texte pur. Un challenge relevé haut la main puisque les lecteur·rices développent une empathie insoupçonnée avec les personnages.
La Couleur des choses est une expérience graphique et littéraire comme seule la bande dessinée est capable d’en donner. En poussant les murs, Martin Panchaud change l’architecture classique de la planche et lui ajoute des ornements aussi incongrus qu’admirables. Il n’est pas seul dans son combat pour changer la déco et ouvrir de nouvelles pièces. Au-dessus de lui, nous pouvons voir Chris Ware et Yūichi Yokoyama lui sourire chaleureusement, et à ses côtés, il pourra compter sur le travail du Polonais et architecte Łukasz Wojciechowski , du Français Nicolas Nadé et encore de la Coréenne Saehan Parc. Y avait pas un gars qui disait « Less is more » à un moment ?
POUR LIRE +
→ La Couleur des choses de Martin Panchaud, Çà et Là, 2022
→ Soleil Mécanique de Lukasz Wojciechowski, Çà et Là, 2021
→ Building Stories, de Chris Ware, Delcourt, 2014
POUR EN SAVOIR +
→ Interview de Martin Panchaud : lefigaro.fr/bd/martinpanchaud-la-couleur-des-choses-est-une-revanche-sur-madyslexie-20221217
→ Épisode 37 de « 9e art le podcast » de la Cité de la bande dessinée : citebd.org/neuvieme-art/ep37-martin-panchaud
→ Chapitre « Géométrie » de Marguerite Demoëte dans Bande dessinée 1964-2024, Éditions du Centre Pompidou, 2024


Ce qui est bien, c’est que le minuscule, puisqu’il est relatif, se retrouve partout.
Ainsi sommes-nous allé·es le dénicher dans les arts voisins et le secouer pour voir ce qui en tombe. Nous avons donc demandé à Radio Minus de nous parler des enfants chanteur·euses et du marketing auquel on les a soumis·es, à la chercheuse en info com Laurence Leveneur-Martel de nous faire l’histoire des petits formats à la télévision, et au journaliste Pierre Maugein de tester pour nous les changements d’échelle dans les jeux vidéo.
En bon explorateur, Pierre Maugein se perd dans un nombre infini de mondes virtuels dès qu’il empoigne sa manette. Mais ne croyez pas qu’il s’y balade seulement pour le loisir. Journaliste pour JVMagazine , Pierre Maugein observe, ressent, analyse et raconte. Pour ce numéro « Minuscule », ce sont donc les effets des changements d’échelle dans les jeux vidéo qui ont capté toute son attention.


« Regardez ce point. C’est ici. C’est notre foyer. C’est nous. Dessus se trouvent tous·tes celles et ceux que vous aimez, tou·tes celles et ceux que vous connaissez, tous·tes celles et ceux dont vous ayez jamais entendu parler, tous les êtres humains qui aient jamais vécu. » C’est par cette phrase que le célèbre astronome américain et vulgarisateur Carl Sagan ouvre son livre – Pale Blue Dot – en hommage à une seule image. Une seule certes, mais à la puissance évocatrice de dizaines de milliers. Pris par la sonde Voyager 1 lors de son odyssée d’étude des planètes du système solaire externe (à partir de Jupiter), à plus de 6 milliards de kilomètres de la Terre, cet instantané montre notre planète comme un petit point bleu pâle. ↓

Rien de plus qu’« une scène minuscule dans l’immense arène cosmique ». À cette échelle, la concentration devient extrême. Comme des atomes serrés qui densifient de la matière, cette concentration apparaît comme un résumé lointain de toute notre humanité. À la fois diamant rare, mais aussi preuve flagrante d’une insignifiance totale dans l’immensité de l’univers. Une histoire de regard, de point de vue qui questionne la place, l’importance, le legs, les possibilités ou l’inquiétude. L’overview effect – ou effet de surplomb –décrit par les astronautes lorsqu’elles et ils observent notre planète depuis l’espace, vrai choc cognitif, ouvre une nouvelle perception de l’environnement. Une émotion ressentie, de manière moins viscérale, par tous·tes celles et ceux qui ont pu voir cette représentation de la Terre via diverses photos, des documentaires, etc. Notre imaginaire n’a pas a priori les clés de compréhension de ce changement brutal de place dans notre univers proche, quotidien. Toutes les certitudes deviennent alors apprentissages une fois la transition d’échelle opérée. Un stratagème utilisé dans bien des contes et des histoires, afin de créer un malaise, une distance, un regard neuf. Si Alice au Pays des merveilles se sert de l’image du miroir, le rapetissement y est lui aussi central, étape par laquelle Alice doit passer pour entrer de plain-pied dans la fantaisie. C’est un élément central de The Legend of Zelda : The Minish Cap où Link doit venir en aide au peuple miniature des Minish, population secrète ayant aidé le royaume à plusieurs reprises. Comme dans une sorte de porte de sortie au sein d’une série qui avait déjà fait visiter le monde d’Hyrule de fond en comble aux joueurs, le jeu déplace Link dans un monde à la fois présent sous ses yeux et inconnu. Dans une redécouverte de son quotidien et de menaces insoupçonnées depuis les hauteurs où il évoluait, il prend conscience d’une autre strate de son univers, et d’une nouvelle place dans son environnement. Par la miniaturisation, The Minish Cap remet son héros à la place des petit·es, de celles et ceux vivant dans l’ombre, afin de rendre son ascension plus mémorable, en tant que porteur d’une vérité inédite. Ou du moins colporteur des oublié·es. Bien sûr, l’idée principale est ludique : changer de dimension pour jouer avec des obstacles détournés (un gravier devenant montagne) et y retrouver le plaisir enfantin d’observer cette nature minuscule et d’essayer de comprendre ses secrets.

C’est là tout le principe de la série Pikmin, où le capitaine Olimar s’écrase sur une certaine « Planète lointaine ». Dans cet endroit à l’atmosphère toxique pour son organisme, ce tout petit astronaute doit retrouver les pièces de son vaisseau sous 30 jours, faute de quoi il trouvera la mort. Il peut tout de même compter sur les valeureux Pikmin pour lui donner un coup de pédoncule, petits êtres mi-animaux, mi-plantes. Dans le rôle d’un entomologiste, les joueur·euses dirigent alors cette troupe improbable, à la découverte d’une faune extraterrestre minuscule – en accord avec la forme la plus probable de la vie sur une exoplanète. Le dépaysement vient donc autant de l’aspect extra-système solaire que de l’échelle, le micro étant par-









fois encore plus déstabilisant que le macro. Concept qu’a embrassé le jeu de survie Grounded, où – à l’image du film Chérie, j’ai rétréci les gosses de Joe Johnston – des jeunes gens se trouvent réduits par une expérience scientifique, bien obligés de faire face aux terreurs des jardins. Changer de vision ici, c’est réenchanter l’habituel, faire d’un carré de pelouse un no man’s land étouffant. Il y a du fantastique dans le minuscule, taille où n’importe quel insecte devient le monstre le plus terrifiant de l’histoire des contes et légendes. Il suffit de voir la tête d’une fourmi au microscope, en particulier celle capturée par le photographe animalier Eugenijus Kavaliauskas, pour y déceler tous les codes de l’horreur réunis entre deux antennes. L’altérité peut naître de ce que l’on imagine maîtriser le mieux, il suffit d’un prisme pour lui donner un éclat différent.
Ce genre de basculement remet aussi la nature, trop souvent perçue comme inféodée aux désirs de l’humanité, dans son rôle de force implacable. De notre côté du monde, rares sont les animaux à représenter encore un danger. Une peur, tout au plus, avec la survivance de la mauvaise image du loup. Mais même si peu d’entre nous sont serein·es dans l’obscurité d’une forêt, plane tout de même un sentiment d’impunité. Redevenir petit·es, c’est retrouver le respect des êtres vivants qui nous entourent, et par homonymie découvrir à nouveau un émerveillement enfantin. À la fois se sentir dépassé·e et y dénicher un souffle renouvelé. C’est aussi cet aspect de décalage, grisant, que recherchent – malgré eux – les personnages principaux de It Takes Two, couple en perdition. Outre une miniaturisation qui rend chaque personnage plus mignon alors qu’ils rivalisent de choix parentaux et personnels parfois désastreux, le duo va revivre une partie des étapes de sa vie commune d’un point de vue altéré, également embrigadé dans des péripéties folles que seule leur petite taille leur permet d’expérimenter. Il s’agit ici d’un déplacement des problématiques vers un univers tout à la fois inconnu et gorgé de souvenirs (niveau dans une boule à neige rapportée de vacances ensemble, chambre de leur fille, serre abandonnée par manque de temps, etc.). La prise de distance physique et la réappropriation de son intimité via un autre angle sont des méthodes ouvrant à la reprise de la discussion dans ce couple, chemin vers une possible entente. Le rapport à l’enfant, au jouet également, reste important. Comme si être celui de leur fille, sous la forme de petites poupées, les plaçait dans la main et l’esprit de cette dernière. Ils doivent réinvestir son cœur et son âme pour trouver une voie saine, quitte à ce que ce soit elle qui donne l’impulsion.
Se muer en un être minuscule peut donc s’éloigner de la punition de gameplay que l’on trouve dans bien des RPG (jeux de rôle) où des sorts diminuent la taille du groupe de héros et d’héroïnes afin de les rendre moins offensifs·ves. On peut même y trouver une certaine tentation de voyeurisme. L’expression « vouloir être une petite souris » – afin de pouvoir observer en secret une personne ↓


– s’incarne parfaitement dans un jeu comme Mr. Mosquito, où le but est de piquer les divers membres d’une famille sans finir sa courte vie de moustique écrasé contre un mur ou sur une cuisse. Et si la piqûre reste la finalité, il est nécessaire d’observer le comportement de sa proie, en virevoltant autour. C’est depuis la cachette que représente le fait d’être minuscule que les joueuses et joueurs vont alors se transformer en témoins de la vie quotidienne d’autres personnes : à la fois gêné·es par cette intrusion et intrigué·es par ces scènes bien connues de tous les jours auxquelles ils et elles prennent part différemment. Et même si le jeu pousse le potard de la curiosité un peu trop loin avec une séquence de bain tirant sur le fantasme déplacé, il se construit davantage sur l’absurdité du moment, voire la projection amusante dans les yeux de toutes ces bestioles qui passent leur temps à croiser de grandes formes naviguant dans leur quotidien à elles. Et quand elles grimpent sur nous, sont-elles conscientes que nous ne sommes pas uniquement des montagnes ? Wanda, lui, ne le sait que trop bien. Le personnage principal de Shadow of the Colossus n’est pas minuscule à notre échelle. Il l’est par rapport à des colosses qu’il escalade, formes de vie gigantesques dont la mort doit lui conférer le pouvoir de ramener sa bien-aimée à la vie. Si insignifiant qu’il peine même à attirer l’attention de ces créatures, il doit les attaquer, titiller leur colère pour entrer dans leur monde. Un univers lent, minéral, millénaire, paisible. C’est parce qu’on ne les comprend pas, parce que leur gigantisme effraie – ainsi que le risque de leur immense force, même involontaire – qu’il paraît dans un premier temps presque « normal » d’effectuer cette quête macabre. Puis le monstre change de camp, et devient le colosse d’un autre.
Le jeu vidéo a ce pouvoir de changer notre rapport au monde par la multiplicité des rôles et des formes qu’il fait endosser et prendre aux joueurs et joueuses. Comme Voyager 1, il s’est lui aussi aventuré loin dans l’infini (ici de la création) pour nous regarder et questionner notre place dans un monde inventif et mouvant.







Laurence Leveneur-Martel ne fait pas que regarder passivement les émissions de divertissement à la télévision comme nous autres, pauvres mortels. Non, la maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’Université Toulouse Capitole les analyse. La preuve en mots avec un article sur les formats télévisuels courts, leur fonction et leur évolution.
« Court », « mini », « bref », l’adjonction de ces adjectifs à des programmes audiovisuels laisse perplexe tant les formats et les genres qu’ils désignent sont divers. D’ailleurs, si tous renvoient à l’idée d’une durée de diffusion plus réduite qu’à l’accoutumée, comme les courts-métrages d’une dizaine de minutes en moyenne au regard des longs d’une heure trente, il reste que les productions auxquelles ils font référence présentent des longueurs variables, des web-séries d’épisodes d’une minute trente aux téléfilms de deux à trois fois 90 minutes, en passant par la mini-série constituée d’épisodes allant d’une vingtaine à une cinquantaine de minutes, autant dire que la brièveté du format est ici toute relative…

Peut-être le phénomène commence-t-il sur ce qui est désormais, compte tenu des usages autour des écrans de nos smartphones, le mal nommé « petit » écran de télévision. Dans les années 1960, les premier·es téléspectateur·rices découvrent un format dit « interlude », qui permet de remplir des grilles de programmes ↓
naissantes de façon ludique, et donne aux speakerines le temps de reprendre leur souffle entre deux programmes de télévision. C’est le rôle du « rébus express » ou « petit train de la gaîté », également appelé « petit train rébus » et remplacé ensuite par le « petit train de la mémoire ». Cet intermède sans gain invite les téléspectateur·rices de l’époque à jouer à des devinettes visuelles, sous une forme originale. Un train miniature, entièrement conçu des mains du sculpteur et réalisateur Maurice Brunot, et sur lequel s’affichent les éléments d’un rébus, semble ainsi parcourir à la façon d’un vrai train, grâce à un raccord de perspective, un décor naturel d’une région française1. L’interlude en question est donc en soi une véritable innovation télévisuelle pour l’époque, comme bon nombre de ces formes brèves parfois tombées dans l’oubli.
D’autres formats courts permettent ainsi au service de la recherche de l’ORTF, quelques années plus tard, de tenter des expérimentations télévisuelles, comme les Shadoks de Jacques Rouxel, qui défraient la chronique en proposant, entre 1968 et 1974, un dessin animé narré par Claude Piéplu, aux antipodes des classiques Disney. L’humour absurde qui s’y déploie autour de personnages « bêtes et méchants » déconcerte le public. Mais la reconnaissance ultérieure d’une série devenue culte facilite le développement de nombreux produits dérivés, tant l’univers développé par ses auteurs est riche. Une exposition hommage y est même consacrée en 2016 au Musée des arts modestes de Sète.
Plus récemment, la bien nommée série Bref, créée par Kyan Khojandi et Bruno Muschio et diffusée au sein du Grand Journal de Canal+ de 2011 à 2012, a marqué toute une génération par son montage ultra-rapide d’épisodes de moins de deux minutes. Cette short-com raconte les déboires d’un trentenaire parisien, sur un ton proche de formats web qui se développent alors2, comme 60 secondes, web-série quotidienne développée par Arte et diffusée à l’été 2011 sur Facebook3, qui se fonde elle aussi sur les témoignages intimes de sa protagoniste principale, mais avec un montage plus classique en plan fixe.
Le web présente certes aujourd’hui de nombreux formats audiovisuels courts, qu’il s’agisse de web-séries ou de reels diffusés sur les réseaux sociaux, dont plusieurs s’inspirent de formats narratifs préexistants4, et certains sont parfois récupérés par les chaînes de télévision pour une diffusion sur leurs antennes ou







en replay, dans l’objectif de capter un public jeune, mais il faut rappeler que la genèse de ces formes brèves est déjà en germe dans la télévision elle-même depuis plusieurs années.
Les premiers formats courts à la télévision, outre les formes innovantes évoquées plus haut, sont d’abord le fait de l’introduction de la publicité, qui succéda aux émissions dites « compensées ». Ces dernières permettaient, avant et après les actualités télévisées, de faire de la propagande d’intérêt général. L’adjectif « compensé » venait du fait que la télévision recevait une rémunération dite compensatrice pour la diffusion de ces messages, parfois désignés comme des spots, des flashs, des communiqués. L’introduction de la publicité de marque à la télévision en 1968 va définitivement planter les graines d’un remodelage des productions télévisuelles. Le découpage et la scénarisation même de certaines séries répond désormais aux contraintes des coupures publicitaires à l’antenne. L’organisation des émissions de flux, leur séquençage facilitent l’introduction de la publicité aux moments les plus forts. Mais surtout, la concurrence accentue la multiplication d’espaces « interstitiels » dans les grilles de programmes : programmes courts (Scènes de ménage, C Canteloup, D’Art d’art, etc.), programmes parrainés (La Minute bricolage, Astuce de chef, etc.), diffusés avant ou après les journaux télévisés, et remplissant une fonction majeure puisqu’ils facilitent la transition entre des émissions aux tonalités diverses, et le passage d’un réel souvent traumatique énoncé par les unes au monde publicitaire fait de joie et de bonheur diffusé par les autres5.
En somme, les formes courtes à la télévision ou ailleurs, c’est un peu comme ces cafés serrés : intenses, rapides, et terriblement efficaces. Elles captent notre attention en quelques secondes, nous font rire, réfléchir, et parfois même rêver…

NOTES :
1 - « Maurice Brunot à propos du petit train express », Au-delà de l’écran, diffusé le 13 mars 1966. INA : www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/i04240419/maurice-brunot-a-propos-du-petit-train-de-la-memoire.
2 - Voir Rio, Florence. « Du programme court télévisuel à la mini-série web : l’essor d’un dispositif novateur ? ». Les formes brèves audiovisuelles, édité par Sylvie Perineau, CNRS Éditions, 2013 www.doi.org/10.4000/books. editionscnrs.17936.
3 - Ibid.
4 - Jost, F. (2014). « Webséries, séries TV : allers-retours. Des narrations en transit », Télévision, n° 5(1), 13-25. www.doi-org.gorgone.univ-toulouse.fr/10.3917/telev.005.0013.
5 - Voir Spies, V. (2004). La télévision dans le miroir:Théorie, histoire et analyse des émissions réflexives, Harmattan, p. 149-174.
Visuels dans l'ordre d'apparition : RÉBUS EXPRESS (2), LES SHADOKS (2), BREF (2), 60 SECONDES (2), SCÈNES DE MÉNAGE (1) & ASTUCE DE CHEF (1).
Du disque d’or étranger à la K7 du bled voisin, bien peu de productions musicales impliquant des enfants sont passées à travers les mailles du filet de Radio Minus. Fondé en 2013, ce collectif de diggers invétérés exhume et documente des décennies de disques enregistrés pour, mais aussi par des enfants, et en tire volontiers quelques conclusions.






Petites vedettes, talents précoces, voix d’exception ou enfants des studios… Très tôt dans leur histoire, les maisons de disques recrutent et prennent en main la carrière de très jeunes interprètes. Que ce soit en groupe ou en solo, à l’adresse des adultes attendris ou pour d’autres enfants, les disques interprétés par les plus jeunes chanteuses et chanteurs représentent une part importante de la production discographique mondiale : chansons de Noël ou de fête des Mères, rondes et comptines, reprises juvéniles ou décalques des tubes du moment… Mais aussi, parfois, pures créations originales, insolites et inattendues. Dans le secteur de la « variété junior », le gag sympathique flirte avec le calcul des producteurs flairant le bon coup, le criard ou le nunuche contrastent avec l’émotion sincère des jeunes interprètes, et le statut de ces « mini-stars » reste ambivalent. Quelle place l’industrie du disque leur accorde-t-elle réellement ? Et quels sont donc les enjeux spécifiques liés à ce type de vedettariat ?
Débarquant dans le monde du cinéma au détour des années 1930, Shirley Temple est la première enfant star à connaître un succès international. Plutôt que de compter sur ses performances vocales, les producteurs misent sur son image de petite fille mignonne, maligne et dynamique, arrivant à point nommé comme antidote à la Grande Dépression des années 1930 aux États-Unis. Qu’elle fasse des claquettes ou entonne un petit air dédié aux « Crackers en forme d’animaux » , son apparente insouciance fait mouche auprès d’une population confrontée à des réalités autrement plus lourdes de conséquences. Si superficielle soit-elle, une telle exploitation de la figure de l’enfant chanteur augure de la manière dont l’industrie musicale et celle du cinéma s’entendront dorénavant autour d’un intérêt commun. Conjointement, ils pourront mieux façonner, entre réalité et fiction, la légende de ces jeunes et malléables petites vedettes.
Sorti en salles en 1957, L’Enfant à la voix d’or témoigne de la pérennité de la recette : mettant en scène quelques éléments biographiques mâtinés de pure fiction, ce film dépeint le petit Joselito sous les traits d’un garnement turbulent mais au cœur pur, qui tout en jouant du lance-pierres utilise ses talents pour venir en aide à la jeune aveugle du village. Son image devient indissociable de ce personnage dont on ne sait plus guère ce qu’il a de réel ou de fictif. Dans l’Espagne franquiste et catholique d’après-guerre, confrontée à de grandes difficultés économiques et sociales, une telle incarnation de l’enfant sensible et dévoué devient iconique.
« Dans ma maison de disques, RCA, j’étais l’un des meilleurs vendeurs, avec Elvis Presley. J’ai été un des deux seuls au monde à être invité à trois reprises dans l’émission Ed Sullivan Show, la plus regardée aux États-Unis. (…) Le pape Jean XXIII m’a invité au Vatican. Fidel Castro a fait spécialement fabriquer une collection de cigares bagués à mon effigie ! (…) Ma voix m’a aussi permis de faire du cinéma. De 1956 à 1968, j’ai été la vedette de quatorze films ! » 1
Né dans un petit village d’Andalousie, Joselito n’a pas encore quinze ans lorsqu’il rencontre ce succès international dépassant toutes les espérances. Dans son sillage, c’est une véritable avalanche de voix lyriques et juvéniles qui s’abat sur l’Europe, où l’angélisme de la jeune Marisol, de l’Italien Robertino, du Marseillais Ramuncho et du Néerlandais Heintje suscite un engouement phénoménal. ↓
Rappelons que les concours de talents – qui ont depuis fait leur grand retour en prime time à la télévision – jouaient déjà un rôle important au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Tremplins et radio-crochets locaux ou nationaux ont alors les faveurs du public. Leur principe est élémentaire : on y juge les capacités vocales des candidat·es à l’aune des critères du moment, le plébiscite de l’assistance pouvant également servir de baromètre aux dénicheur·euses de talents précoces, toujours à l’affût de potentiel·les successeur·es d’un Tino Rossi, d'une Édith Piaf ou d’un Luis Mariano.
De ces tremplins s’échappe une volée de rossignolets soudain tirés de l’anonymat et propulsés sur le devant de la scène grâce à leurs voix d’exception. La déferlante de 45 tours qui immortalise leurs exploits – des millions d’exemplaires vendus – ne cible pourtant guère leurs congénères du même âge : s’adressant aux adultes avec un mélange de sentimentalité, de dévotion, de bucolisme et de piété filiale, leurs chansons nous renseignent généralement bien plus sur les attentes de la société des adultes que sur la personnalité réelle de ces enfants. Leur statut est d’abord celui d’un·e interprète, certes virtuose, mais au service d’un répertoire sur lequel ces enfants ont peu de prise. Écrites et composées par des équipes de professionnel·les qui les associent rarement au processus, leurs chansons restent l’affaire de grandes personnes communiquant entre elles à travers la figure de l’enfant pour des raisons qui leur appartiennent.
À l’instar des jeunes Stevie Wonder ou de Sammy Davis Jr, de Brenda Lee ou de Petula Clark, de la célébrissime Hibari Misora ou de la chanteuse Björk, nombreuses seront les petites vedettes à poursuivre de grandes carrières au point de faire oublier leurs débuts en culottes courtes.
En 1970, l’Europe affronte l’ouragan Poppys. S’inspirant du succès rencontré outre-Atlantique par des groupes comme les Jackson Five ou les Osmonds, mais surtout par la chorale afro-protestataire des Voices of East Harlem, le producteur Eddy Barclay souhaite lancer sa propre formation. Son associé Jean-Jacques Thébault s’adresse à la chorale des Petits Chanteurs d’Asnières, tandis qu’un ancien des Petits Chanteurs à la croix de bois, le musicien François Bernheim, prend en charge la direction artistique du projet et la création d’un répertoire original avec la bénédiction de la productrice Jacqueline Herrenschmidt. Le lancement de cette chorale pop, jeune et pacifiste s’opère par le biais d’un format sécurisant : l’incontournable « disque de Noël ».
En plus d’occuper la scène en jouant l’effet de groupe, la dimension chorale des Poppys présente un avantage de taille : incarnant « la voix d’une génération », le groupe offre aux médias l’image d’une jeunesse à la fois positive, dynamique et acceptable, dont le message pacifiste reste suffisamment apolitique pour ne pas s’attirer les foudres du public le plus réfractaire aux cheveux longs. Fustigeant la guerre et la violence en pleine période de conflit armé au Vietnam, le « Noël 70 » des Poppys rapporte à la maison de disques, ainsi qu’à ses jeunes interprètes, un succès dépassant toutes les espérances. Avec plus de 1,5 million de 45 tours vendus l’année suivante, le groupe devient incontournable dans le paysage audiovisuel français. Son succès s’étend à d’autres pays d’Europe, notamment les Pays-Bas, où ses apparitions provoquent de véritables émeutes. L’histoire des Poppys s’écrira au fil des ans, de disques d’or en tournées monstres, des scènes européennes aux rivages du lointain Japon, mais aussi de bénéfices records en procès douloureux.










Finger 5, Essonnes Five, Parchis, Las Colombianitas, Groupies, ou Bisous Pop... Que ce soit en groupe ou en solo, les années 1970 puis 1980 sont le théâtre d’une impressionnante déferlante pop où les projets de ce type se multiplient dans tous les pays industrialisés. Format commode et peu onéreux, le 45 tours offre à des producteur·rices et à des directeur·rices artistiques l’occasion d’enregistrer leurs propres enfants, nièces ou neveux le temps d’un morceau. Depuis les années 1960, le disque n’est plus l’apanage des seules voix d’exception, et l’on s’autorise à confier quelques morceaux à des interprètes d’un autre genre, enfants évoluant dans l’entourage des studios, au naturel rafraîchissant. Que ce soit le temps d’un bide éphémère ou d’un succès international, le son des enfants chanteurs s’adapte au goût du jour et en suivant les modes : pop, rock, glam, cumbia, disco, funk, punk, new-wave ou hip-hop.
La question des abus qui sous-tendent l’exploitation des enfants dans l’industrie du spectacle a de tout temps fait l’objet d’un intérêt très particulier des médias et de la société civile. Conditions de travail, mauvais traitements, gestion financière douteuse ou suites de carrière cataclysmiques continuent d’alimenter régulièrement les pages des revues à scandale au gré de révélations parfois nécessaires, souvent voyeuristes. On y mesure l’ampleur du gouffre qui sépare, dans bien des cas, l’ambiance dans la salle et celle des coulisses.
Aujourd’hui encore, les médias grand public se font régulièrement l’écho de ces interrogations sur les conséquences psychologiques de la starification précoce des enfants. Par répercussions, leur intérêt nous révèle à quel point la figure médiatique de la vedette adulte reste, elle aussi, prisonnière de pulsions infantiles : entre besoin d’être en permanence au centre de l’attention, valorisation de l’hubris, difficile gestion de la frustration et de la définition des limites pour qui se retrouve en position de pouvoir, sur le plan financier comme sur le plan symbolique. Le traitement médiatique des faits divers impliquant des enfants vedettes s’apparente dans bien des cas à un troublant voyeurisme qui semble se délecter du spectacle de l’innocence pervertie par les tentations du diable : drogue ou sexe sur fond de dépression nerveuse, décadence des idoles passant subitement « des sommets aux bas-fonds »… Exacerbé par la candeur initiale des jeunes protagonistes, l’archétype de l’« ange déchu » fonctionne alors pleinement. Aucune figure ne peut rivaliser avec celle de l’enfant dans cette mise en scène moderne du mythe de l’ascension et de la chute : récit d’initiation mâtiné de pacte faustien où son innocence idéalisée rend plus cuisant encore le contraste entre l’angélisme de l’image publique et les failles qui émaillent la vie privée. Dans un ouvrage entièrement consacré au sujet, la chercheuse Jane O’Connor relève à cet égard, en paraphrasant Carl Gustav Jung, comment « les mythes impliquant l’archétype de “l’enfant” sont particulièrement puissants, parce qu’ils nous renvoient à ce que nous avons tous en commun : la lutte dans l’épreuve, pour grandir et atteindre le succès » 2
L’enfant vedette en perdition serait l’exception qui doit confirmer la règle et renforcer les valeurs méritoires irriguant l’inconscient de nos sociétés traditionnelles. Sacrifié, il devient la victime expiatoire des péchés associés à un succès trop rapide, à une réussite excessive et à une usurpation de la célébrité, puisque celle-ci ne saurait résulter, dans son cas précis, d’années de labeur acharné. Montrant le mauvais exemple à ne pas suivre, la tentation à laquelle ne pas succomber, sa figure renforce également l’ordre social fondé ↓
sur la séparation de l’enfance et de l’âge adulte dans des sociétés modernes qui ont exclu l’enfant de la sphère productive et économique, préservant celui-ci du travail aux champs, à la mine ou à l’atelier comme de toute forme d’exploitation mercantile… Et qui accordent, néanmoins, d’étranges dérogations à cette règle aux seuls et uniques tenants de l’industrie culturelle.
Autrefois interprètes au service d’une machine médiatico-culturelle omnipotente, les enfants ont aussi conquis, lentement mais sûrement, le droit d’être parfois reconnus comme les auteur·rices et acteur·rices de leurs propres créations. En 1956, la poétesse Minou Drouet, âgée de neuf ans, adhère sur concours à la Sacem. Contestant de fait la place et le rôle auxquels l’époque et les grandes personnes entendaient l’assigner, cette adhésion marque une étape importante dans la reconnaissance officielle, en France, du statut des créations enfantines. En l’espace de quelques décennies, ce statut continuera d’évoluer fortement, y compris au sein de l’industrie disque, sous l’influence croisée des mouvements punk et DIY, de l’évolution des conceptions pédagogiques et de l’accessibilité toujours plus grande aux moyens techniques de production et de diffusion.
D’un côté, on assistera donc à l’éclosion progressive d’une flopée de disques issus de projets pédagogiques, d’enregistrements scolaires ou domestiques qui présentent un répertoire original écrit, composé ou improvisé par des enfants, indépendamment des pratiques et du filtre de l’industrie musicale.
De l’autre, les éternelles recettes de la kidsploitation continueront d’exercer leur influence, bien au-delà de la seule industrie musicale, comme on peut l’observer aujourd’hui dans les phénomènes liés aux réseaux sociaux, à la mise en scène des enfants et à leur statut de nouveaux influenceurs.
Surannées, alléchantes, improbables ou drolatiques, les pochettes de ces disques et les chansons qui s’y rapportent nous renvoient à une époque où s’inventèrent un panel d’usages, de pratiques et de représentations de l’enfance sur lesquelles il convient plus que jamais de s’interroger.



Sous une forme remaniée, cet article reprend des passages et constitue un avant-goût du livre Miniatures, trésors cachés du disque pour enfants, à paraître en 2025 aux éditions L’Articho.






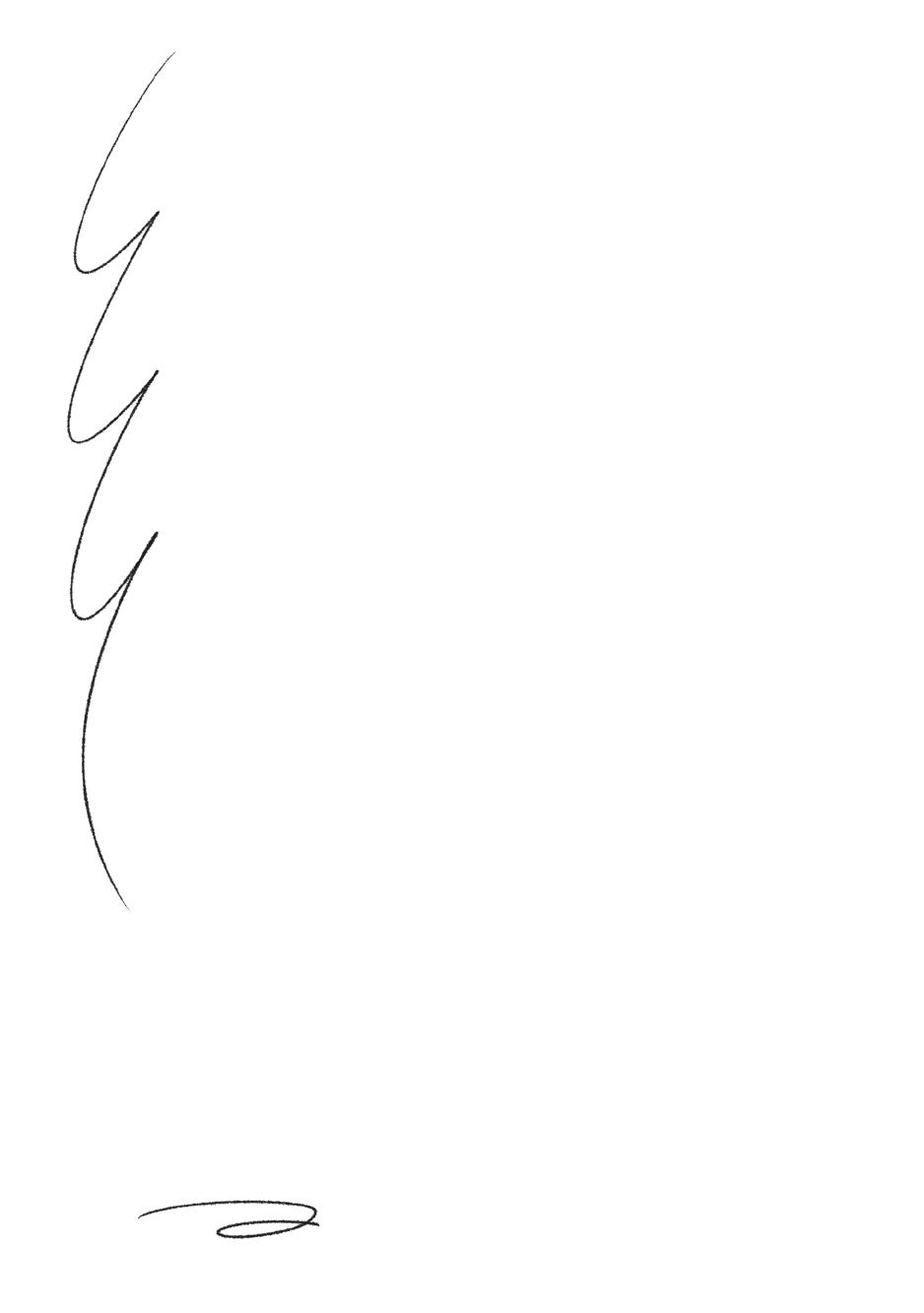



KILMOTOR HELGEREUMANN





Le livre dont a paru en 1982 en Grande-Bretagne. se souvenir que les années 80 par un joyeux réchauffement froide, replongeant le terreur qu’il apprécie ggs n’étant pas tellement rebelote, il fit, en réponse, . Les Bloggs, retraité·es, quotidien bouleversé d’un bombardement sé·es mais confiant·es les Bloggs suivront jusqu’à recommandations officielles, viront évidemment de Damoclès tombera. sublime graphiquement En alternant de petites au dessin friandise avec dessins en double page réalisme funeste, il nos illusions et celle héros, symétrise ce nous fait croire avec est. Et de la farce annon cée, nous tombons dans
Quandsouffle


dont nous allons parler Grande-Bretagne. Il faut années 80 débutèrent réchauffement de la Guerre le monde dans cette apprécie tant. Raymond Bri tellement friand de cette réponse, retraité·es, y voient leur bouleversé par l’imminence bombardement atomique. Angois confiant·es en leurs décideurs, jusqu’à l’absurde les officielles, qui ne ser à rien quand l’épée tombera. Raymond Briggs graphiquement ce trompe-l’œil. petites cases avec des page au il brise de ses qu’on ce qui annon dans la soufflele Briggs, Tanibis, 48









Un serpent, un renard, un lapin, sanglier, une bique. Nous nous demandait, que ça Pourtant, petit à petit à l’ombre d’un rocher se serrant les coudes et rant tout court, à se protéger terrible qui les entoure. volontairement nu et toire ascétique, Adrien à redonner de l’espoir entre l’homme et la nature si évidente, à vue de nez. habitude, il use de sa pour en dire beaucoup minimum. Ainsi l’ombre avance, les couleurs qui corps vivants qui agissent beau des puzzles discourent ment que mille mots. veille à mettre à son compte.





@adrienparlange
serpent, une petite fille, un hérisson, un Nous dirions, si on ça sent la castagne. ils se rassemblent et parviennent, en et même en se ser protéger de la chaleur entoure. Dans un décor autour d’une his Adrien Parlange parvient l’espoir dans une alliance nature qui n’est pas nez. Et comme à son maîtrise graphique beaucoup en montrant le l’ombre du rocher qui qui évoluent et ces agissent comme le plus discourent aussi claire mots. Encore une mer compte.
d’Adrien Parlange, éditions
Partie, 40














32E RENCONTRES DE LA BANDE DESSINÉE & DE L’ILLUSTRATION


















































est
À travers un ensemble exceptionnel de près de 300 œuvres, L’art est dans la rue interroge l’essor spectaculaire de l’affiche illustrée à Paris, dans la seconde moitié du xixe siècle.
Co-organisée en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, l’exposition est une plongée saisissante dans l’univers visuel de la ville du xixe siècle à travers les œuvres d’artistes connus et méconnus comme Toulouse-Lautrec, Mucha, Grasset, Steinlen…
Parce que l’illustration a toute sa place au musée, le musée d’Orsay et KIBLIND proposent un écho contemporain à L’art est dans la rue à travers une collection d’affiches exclusives imprimées par KIBLIND Atelier.
Rendez-vous le 18 mars 2025 pour le lancement de la collection. Affiches disponibles à la boutique du Musée d’Orsay, les boutiques KIBLIND et sur KIBLIND-atelier.com
→ 13e Biennale Internationale Design Saint-Étienne
Saint-Étienne (FR)
22 mai → 06 juillet 2025
→ citedudesign.com
→ Biennale internationale de design graphique
Chaumont (FR)
23 mai → 19 octobre 2025
→ centrenationaldugraphisme.fr/la-biennale
→ Festival international du court-métrage - Clermont-Ferrand
Clermont-Ferrand (FR)
31 janvier → 08 février 2025
→ clermont-filmfest.org
→ Nuits Sonores
Lyon (FR)
28 mai → 01 juin 2025
→ nuits-sonores.com
Qui dit nouvelle année dit nouvelle mascotte. Faites donc connaissance avec Sticki, le guide qui saura vous recommander l’événement qui colle à vos envies. Après tout, qui de mieux qu’un personnage constamment en train de regarder par la fenêtre pour vous aiguiller sur le monde ?
Découvrez 13 super événements à venir représentés sous forme de stickers. Car une illustration vaut mieux que mille mots, non ?

partage son amour pour l’illustration et la création éditoriale depuis Lyon, Paris et Montreal. KIBLIND est un magazine, une agence créative, un atelier d’édition et un festival international d’illustration, IF.














APPEL À CANDIDATURES
DU 15 OCTOBRE AU 31 JANVIER























































Adé · Barbara Pravi · Clara Luciani · Dalí
Emma Peters · Fatboy Slim · Gwendoline
Jean-Louis Aubert · Jeanne Cherhal
Jok’Air · Kompromat · Last Train
Lucky Love · Mandragora · Miki
MC Solaar · Michel Polnareff
Oboy · Perceval · Sophye Soliveau
Terrenoire · The Avener · THÉA
The Limiñanas · Tiakola
Théodora · Vald · Yael Naim
Yoa · Yodelice ... + les créations du printemps
La voix des femmes : hommage à Oum Kalthoum
Toute première fois : 40 ans des iNOUïS Köln Variations par Edouard Ferlet













