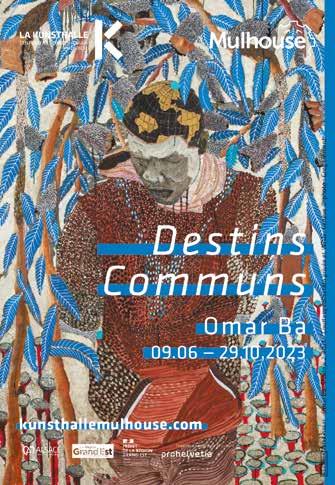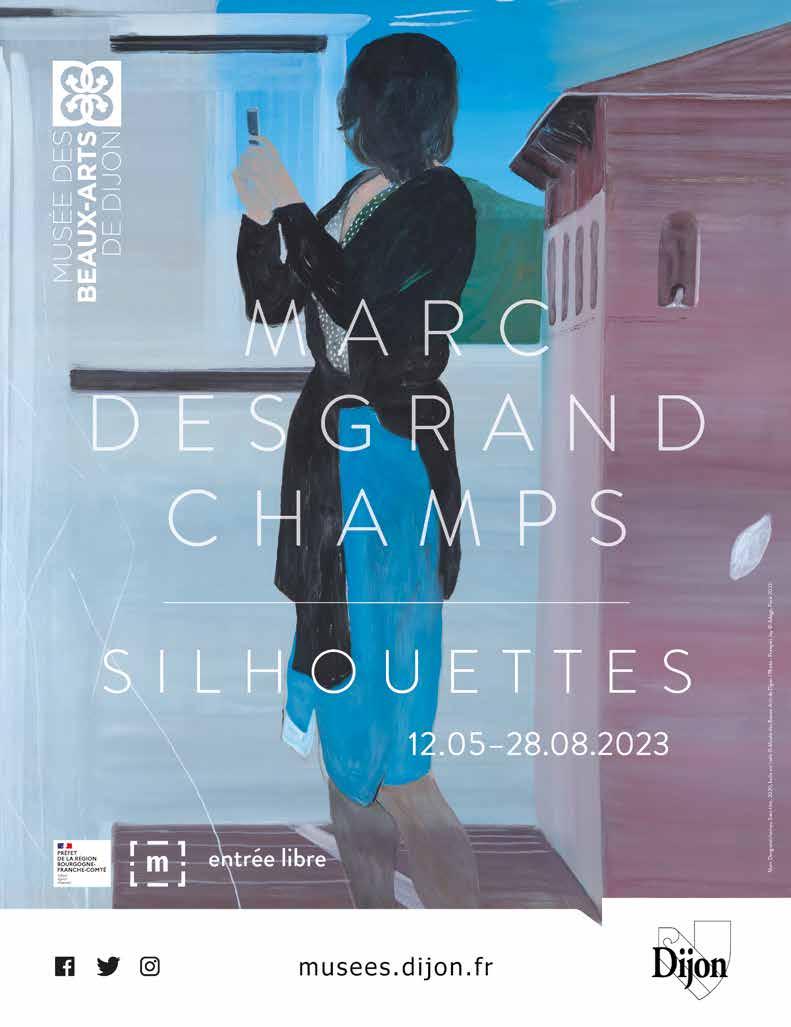Directeurs de la publication et de la rédaction : Bruno Chibane & Philippe Schweyer
Rédacteur en chef : Philippe Schweyer ps@mediapop.fr
06 22 44 68 67
Secrétaire de rédaction : Aude Ziegelmeyer
Relecture : Manon Landreau
Direction artistique : Starlight
Ont participé à ce numéro :
RÉDACTEURS
Nathalie Bach, Cécile Becker, Nicolas Bézard, Valérie Bisson, Benjamin Bottemer, Alma Decaix-Massiani, Emmanuel Dosda, Sylvia Dubost, Caroline Châtelet, Lucie Chevron, Nicolas Comment, Coralie Donas, Christophe Fourvel, Clo Jack, Antoine Jarry, Bruno Lagabbe, Pierre Lemarchand, Lucas Le Texier, Guillaume Malvoisin, Stéphanie-Lucie Mathern, Luc Maechel, Myriam Mechita, Martial Ratel, Mylène Mistre-Schaal, JC Polien, Nicolas Querci, Aurélie Vautrin, Nathanaelle Viaux, Fabrice Voné, Clément Willer, Gilles Weinzaepflen, Aude Ziegelmeyer.
PHOTOGRAPHES ET ILLUSTRATEURS
Vincent Arbelet, Pascal Bastien, Bearboz, Nicolas Bézard, Sébastien Bozon, Mar Castañedo, Tanguy Clory, Nicolas Comment, Caroline Cutaia, Richard Dumas, Romain Gamba, Alicia Gardès, Delphine Ghosarossian, Teona Goreci, Anne Immelé, Nicolas Leblanc, Benoît Linder, Anne Marzeliere, Renaud Monfourny, Zélie Noreda, Arno Paul, Bernard Plossu, JC Polien, Olivier Roller, Dorian Rollin, Christophe Urbain, Nicolas Waltefaugle.
COUVERTURE
Areski photographié par Delphine Ghosarossian pour Novo www.dghosarossian.com
IMPRIMEUR
Estimprim – PubliVal Conseils
Dépôt légal : juin 2023
ISSN : 1969-9514 – © Novo 2023
Le contenu des articles n’engage que leurs auteurs. Les manuscrits et documents publiés ne sont pas renvoyés.
CE MAGAZINE EST ÉDITÉ PAR CHICMEDIAS & MÉDIAPOP
CHICMEDIAS
37 rue du Fossé des Treize / 67000 Strasbourg
Sarl au capital de 47 057 € – Siret 509 169 280 00047
Direction : Bruno Chibane bruno.chibane@chicmedias.com — 06 08 07 99 45
Responsable administratif : Gwenaëlle Lecointe administration@chicmedias.com — 03 67 08 20 87
MÉDIAPOP
12 quai d’Isly / 68100 Mulhouse
Sarl au capital de 1000 € – Siret 507 961 001 00017
Direction : Philippe Schweyer ps@mediapop.fr – 06 22 44 68 67 www.mediapop.fr
ABONNEMENT
Novo est gratuit, mais vous pouvez vous abonner pour le recevoir où vous voulez.
ABONNEMENT France : 4 numéros — 30 €
Hors France : 4 numéros — 50 €
DIFFUSION
Contactez-nous pour diffuser Novo auprès de votre public.
WWW.NOVOMAG.FR
PROLOGUE 7
PHILIPPE DJIAN
FOCUS 17-39
8-15
La sélection de la rédaction
SONS 41-61
Areski 42-46, Mona Soyoc 47-49, Musica 50-51, Unblock Project 52-53 , La Féline 54-56, Coco Machine 57-59, Récréation 60, Sinaïve 61
ARTS 63-88
Bernard Plossu 64-67, Marc Desgrandchamps 68-69 , Elmgreen & Dragset 70-71, Pippa Garner 72-73 , Benjamin Foudral 74-75, Christina Kubisch 76-77 , Biennale internationale de design graphique 78-79 , Abdelkader Benchamma 80-81 ,
Radical + Lore Bert 82-83, Julien Ceccaldi 84-85 , Alice Motard et Marie-Pierre Bonniol 86-87, Omar Ba 88
IN SITU 89-101
Les expositions de l’été
CHRONIQUES 102-106
Nicolas Comment 102-109 , Stéphanie-Lucie Mathern et Benoit Linder 110-111 , Myriam Mechita 112-113, Nathalie Bach 114, Emmanuel Abela 116 , Bruno Lagabbe 118, JC Polien 120, Emmanuel Abela 122
SELECTA
Livres 124
Disques 126
ÉPILOGUE 128
SOMMAIRE OURS
5
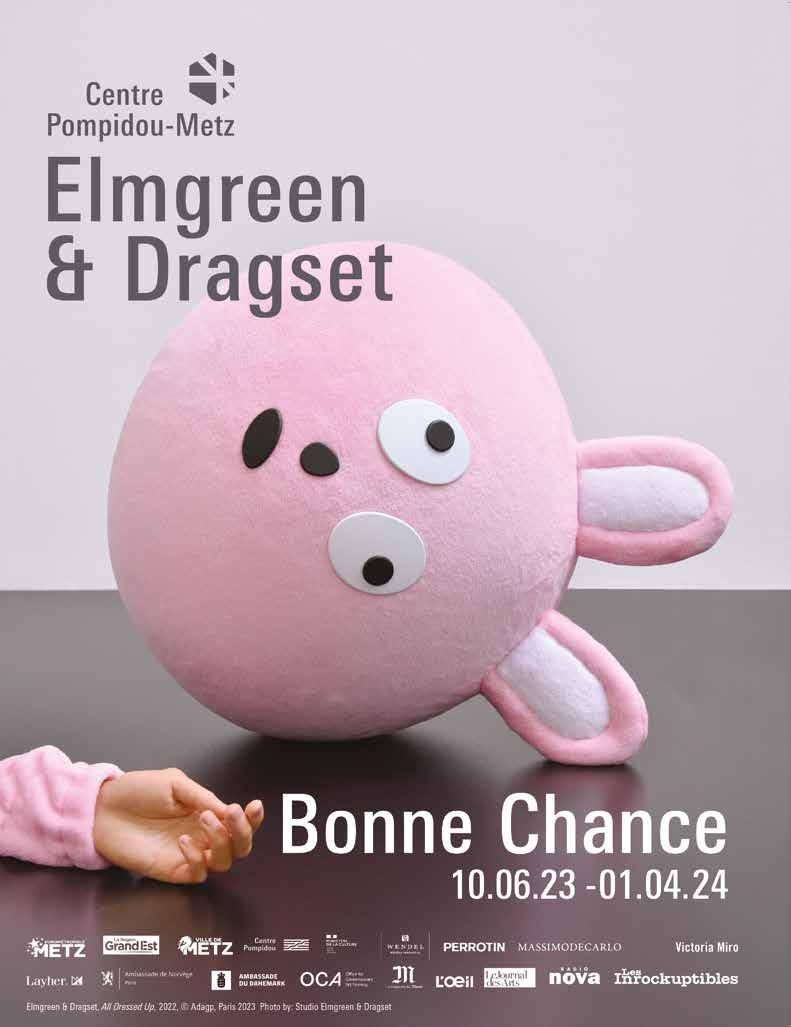
DOLORÈS
J’avançais perché sur mon vélo, slalomant cheveux au vent entre les terrasses bondées. La bière coulait à flots. Les rires fusaient. Le pays se relaxait. Une voiture m’a doublé sans crier gare. Une Mini ou un modèle dans le genre. S’échappait par ses fenêtres grandes ouvertes, un chant mystérieux qui m’attirait irrésistiblement. L’été était là. Je me suis mis en danseuse et j’ai appuyé sur les pédales pour me rapprocher, mais la femme au volant de la Mini a accéléré doucement comme pour me narguer. L’air était saturé de pollen. J’ai cru un bref instant que c’était Leonard Cohen qui chantait, mais en redonnant un grand coup de pédale, j’ai réussi à me glisser dans le sillage de la Mini, le temps d’identifier la voix de Jean-Louis Murat. Avant d’avoir pu reconnaître la chanson, la voiture a accéléré de plus belle. Je n’étais pas du genre à renoncer. J’ai poussé sur mes pédales pour la rejoindre au feu rouge. Le feu est passé au vert. J’ai à peine pu distinguer quelques bribes de chant noyées dans le brouhaha ambiant. C’était bien Jean-Louis Murat au milieu des klaxons et des bruits de moteur. Maintenant qu’il était mort, il passait à nouveau à la radio. J’étais de retour dans le sillage de la Mini quand elle a pilé brutalement. La conductrice a ouvert sa portière pour me bloquer le passage :
Qu’est-ce que vous avez à vous coller à moi ?
— C’est à cause de votre musique.
— Je vous prenais pour un dingue.
— Je voulais juste écouter la chanson.
— C’est pas une raison pour me faire peur.
— C’est quelle radio ?
— J’écoute ce que je veux.
— Avec les fenêtres grandes ouvertes ?
— Ma clim est en panne.
— Quand j’aime une chanson, je préfère m’isoler pour l’écouter.
Elle s’est approchée pour me dévisager :
— Mince, je ne t’avais pas reconnu. Son visage me disait vaguement quelque chose.
J’ai fait semblant de la reconnaître.
— Je ne voulais pas te faire peur.
— Je t’ai pris pour un psychopathe.
— C’est la première fois que je fais ça.
— Au collège, tu faisais déjà du vélo.
Cette fois, j’ai su que c’était elle. Dolorès. Elle ne ressemblait plus beaucoup à la fille trop belle pour moi qui avait fait souffrir la moitié du bahut, mais c’était elle.
— Le vélo, c’est bon pour la santé.
— En ville, c’est du suicide.
— J’adore respirer les gaz d’échappement.
Elle n’a pas relevé. Elle s’est contentée de me fixer du regard comme perdue dans ses pensées. J’avais envie de lui demander ce qu’elle était devenue après toutes ces années, mais c’est elle qui a relancé la conversation.
— Si je me souviens bien, tu rêvais de devenir écrivain ?
Je me suis demandé comment elle pouvait se souvenir de ça. Ses dents étaient mal alignées. Sa peau était abîmée par les UV. Elle ne ressemblait plus que vaguement à la Dolorès que j’avais connue, mais elle avait toujours le chic pour remuer le couteau dans la plaie.
— J’écris des histoires pour un magazine.
— C’est ce que tu voulais ?
— J’aurais préféré écrire le plus grand roman de tous les temps. Et toi, qu’est-ce que tu fais dans la vie ?
— Rien de spécial.
Elle a dit ça d’un ton résigné.
— Tu ne fais rien ?
— J’attends la retraite.
— C’est triste.
— Je suis usée.
— Tu as des enfants ?
— Et un ex-mari. Vraiment rien de spécial. La chanson de Murat s’était arrêtée sans que je m’en aperçoive. Trouant le ronronnement des moteurs, les mots « missile », « drone », « destruction », « offensive », « contre-offensive », « massacre » s’échappaient des haut-parleurs de la Mini comme des balles tirées dans le vide par un sniper invisible.
Par Philippe Schweyer
7
DJIAN, L’INCENDIAIRE
Qui en France sait mieux parler de littérature que Philippe Djian ? Pas grand monde, comme il le prouve encore lorsque nous le rencontrons à Biarritz, où il vit et travaille. Conversation avec un orfèvre de la langue, un passeur attentif, un écrivain libre et terriblement attachant.
 Texte et photo par Nicolas Bézard
Texte et photo par Nicolas Bézard
8
Philippe Djian a changé ma vie. C’était en 2002. J’avais 20 ans. Nous étions en été. Le soleil tapait fort. Je me réfugiais dans une librairie en quête d’un peu d’ombre et de fraîcheur. Pour tuer le temps, j’ouvrais un livre et en lisais machinalement la première phrase : « On lui avait cassé les dents. » Tel un mantra, je me la répétais plusieurs fois dans la tête, en déroulais encore et encore la succession des syllabes, attiré par leur vibration étrange. « On lui avait cassé les dents. » Peut-être même à un moment ai-je dû, entre les rayons musique et littérature américaine, la prononcer à voix haute – c’était un temps où, en franchissant la porte d’un libraire, vous ne risquiez pas de trébucher sur un guide de développement personnel. Mais l’époque n’était pas non plus à l’apaisement. Il y avait ces tours qui s’étaient effondrées un an plus tôt, ces bombes qui explosaient aux quatre coins de la planète, ces fous furieux qui mitraillaient des innocents dans des mairies. « On lui avait cassé les dents. » La phrase disait cette fièvre qui s’était emparée du monde. Elle était signée Philippe Djian. Le roman s’intitulait Ça, c’est un baiser. Mais qui était-il au juste, ce type capable de vous rouler une pelle sur la couverture de son bouquin pour ensuite vous mettre un uppercut dès la première ligne lue ?
La même année, j’apprenais un peu mieux à le connaître grâce à un texte que je sors encore très souvent de ma bibliothèque : Ardoise. Sans pédanterie aucune, mais avec une passion et un enthousiasme débordants, Philippe Djian y développait sa vision de la littérature, sa conception du style, et s’acquittait d’une dette envers les écrivains qui lui avaient non seulement appris à écrire, mais aussi et surtout à vivre. Ainsi, Djian me présentait à ses amis Salinger, Kerouac et Faulkner. Il m’expliquait pourquoi l’écrivain Céline mérite, contrairement à l’homme, qu’on s’y attarde. Pourquoi Hemingway est un maître, même si « en avoir ou pas » importe peu. Comment Brautigan s’est débrouillé pour faire décoller des planeurs et comment Carver a été touché par la grâce. Fort de ces rencontres décisives, je pouvais désormais envisager l’avenir avec confiance. Je comprenais ce qu’était un écrivain. Je comprenais que pour tous ces gens qui allaient m’accompagner pour le restant de mon existence, l’écriture demeurait inséparable de la vie. Philippe Djian venait d’allumer en moi des incendies qui depuis ne se sont jamais plus éteints.
Vingt ans ont passé. Je suis attablé en terrasse du Royalty à Biarritz et c’est de nouveau l’été. Philippe Djian vient de prendre place en face de moi. Il n’a pas encore beaucoup parlé mais, étrangement, sa voix est aussi familière à mon oreille que celle d’un proche. Son visage dégage une expression sereine. Il vient, me dit-il, de terminer un roman, celui qui succédera à Sans compter , publié à la fin de l’hiver dernier chez Flammarion. Dans mon for intérieur, je suis tiraillé entre l’envie de lui dire à quel point je lui suis redevable, et la volonté de faire mon travail d’interviewer de la façon la plus neutre possible. En attendant, Djian lance un regard vers le ciel et constate que le ciel est bleu, « mais il va y avoir de l’orage ce soir », s’avance-t-il.
« Ils avaient annoncé des orages pour la fin de journée » [c’est la première phrase de 37°2 le matin, ndlr], je connais un auteur un peu confidentiel qui a écrit ça il y a longtemps.
Ça me rappelle vaguement quelque chose. Vous savez qu’on me dit toujours d’arrêter avec la météo ? Sans compter commence aussi par ça. Si on en parle, n’hésitez pas à me reprendre sur le prénom du personnage. Je pourrais me tromper, car je viens de finir le prochain livre et j’ai d’autres noms en tête.
Nathan, il s’appelle Nathan, comme dans Ça, c’est un baiser.
J’ai un mal fou avec les prénoms, qui sont tout sauf anodins. Aucune de mes héroïnes ne s’appelle Mauricette par exemple. Il faut les choisir intelligemment, parce qu’au début je ne sais pas dans quelle direction mes personnages vont aller, d’où ils viennent, ce qu’ils font précisément dans la vie. Si d’un seul coup je me bloque avec un prénom qui enferme le personnage dans une catégorie sociale ou une époque, ça ne va pas aller.
C’est déjà une affaire de style, le choix du prénom ?
Oui, car si vous prenez un prénom qui se termine par un son qui ne s’accordera pas avec ce qui suit dans votre phrase, un imparfait du subjonctif par exemple, votre oreille ne va pas apprécier.
Vos prénoms ne sont jamais à la mode mais ils ne sont pas désuets non plus. On pourrait indifféremment les entendre en France, aux États-Unis, en Allemagne, etc.
Je ne veux pas qu’ils m’embarquent vers des endroits où je n’ai pas envie d’aller. Au début, je trouvais des prénoms qui me donnaient de l’espace. « Henri », par exemple, que l’on peut prononcer différemment selon qu’on soit en France ou dans un autre pays, et qui convient autant à un brave type qu’à un parfait salaud.
Dans votre premier livre publié, le recueil de nouvelles 50 contre 1 , vos personnages s’appelaient souvent Philippe. Un prénom que vous n’avez plus utilisé par la suite.
C’était une autre époque. J’écrivais sur ce que je vivais. Les petits boulots. Mes rapports amicaux, mes relations sentimentales. J’avais 30 ans. Aujourd’hui, j’en ai deux fois et demie plus, et je ne m’intéresse plus aux mêmes choses. Prenez le dernier Bret Easton Ellis [Les éclats, ndlr], j’ai été agréablement surpris d’y retrouver un univers qui était celui de Moins que zéro, mais 40 ans plus tard, sous un éclairage différent.
Ça vous a déjà traversé l’esprit de faire comme cet auteur et de revisiter un de vos anciens textes ?
J’y ai souvent pensé. Poursuivre une histoire en explorant d’autres voies, surtout que dans la vie, les histoires ne se terminent jamais. Et puis les histoires ne m’appartiennent pas. Certains écrivains vous disent que leur histoire, ils l’avaient dans la tête depuis des années. Moi, je n’ai rien en tête excepté une première phrase, qui va m’amener tout doucement à la deuxième, et ainsi de suite. D’où l’idée que ce n’est jamais fini, qu’une histoire n’a ni début, ni milieu, ni fin.
9
C’est le genre de choses que vous abordez lors de vos ateliers d’écriture ?
Oui, mais c’est un débat permanent. Par exemple, il y a une participante que j’ai suivie pendant trois ateliers et qui, entre la fin du deuxième et le début du troisième, s’est inscrite aux ateliers de Gallimard, dirigés par Jean-Marie Laclavetine. Elle me montre son manuscrit et c’est une catastrophe. Le type a tout démoli en lui disant qu’il fallait remettre l’intrigue au premier plan, et donner un maximum d’indications au lecteur. Je lui ai expliqué par A+B pourquoi il ne fallait pas faire ça. Je n’ai rien contre Laclavetine, mais quand j’ouvre ses bouquins, je constate qu’il n’y a pas de travail sur la langue. Il y a peut-être de vagues idées, mais les gens sont en droit d’attendre autre chose de la littérature. Sinon, autant les diriger vers un bouquin qui parle de sciences humaines ou de politique. Le roman est dans une situation un peu précaire. Il y a la concurrence des séries, de la télévision, des réseaux sociaux. La littérature doit conserver ce qui fait sa force pour maintenir sa place au milieu de tout ça. Si ce que vous allez ressentir en ouvrant un roman ne vous grandit pas un peu, alors autant faire autre chose.
Le cœur de la littérature que vous défendez depuis toujours, c’est la langue.
Oui, car sinon la littérature ne sert plus à rien. Mais il faut aussi penser qu’elle tient une place dans la société, au même titre que toute autre activité. Pour qu’une société fonctionne, il faut des écrivains, des philosophes comme il faut des maçons, des jardiniers… Le problème est de savoir si les gens vont continuer de lire des livres. On nous dit que 70 % des lecteurs sont aujourd’hui des lectrices. Je dis merci aux femmes, mais je m’inquiète aussi de la place accordée aujourd’hui à la littérature par notre société.
On se rencontre à Biarritz, une ville qui tourne le dos au vieux continent et regarde vers l’océan. Est-ce pour ressentir cette possibilité d’un ailleurs que vous vivez ici ?
C’est surtout pour l’éloignement d’avec Paris. Bien sûr, il y a la proximité de l’Espagne. En quelques minutes vous êtes dans un autre monde où les gens sont encore dehors à une heure du matin, avec les enfants qui jouent dans la rue. L’arrièrepays est somptueux. Il y a la présence de l’océan et du surf, qui est un mode de vie à part. Mais l’intention première, c’était de rester à distance de ce microcosme parisien qui ne m’intéresse pas.
On ne m’y parle pas comme j’aimerais qu’on me parle. Les voix un peu particulières, celles qui me touchent, je les entends ailleurs.
C’est vrai que vous avez toujours évité les capitales. Vous avez vécu à Bordeaux et Biarritz plutôt qu’à Paris, à Lausanne plutôt qu’à Genève, à Florence plutôt qu’à Rome, à Boston plutôt qu’à New York. On voit et on entend mieux lorsqu’on adopte une position décentrée ?
Je pense que j’ai ressenti ça bien avant de le comprendre. Dans son récent papier pour Le Monde, Fabrice Gabriel écrit que je suis un outsider. J’aime bien ce mot. J’habite loin de Paris, je fais mon boulot, je n’emmerde personne et personne ne vient m’emmerder. Il faut comprendre que je suis né et que j’ai grandi dans l’appartement parisien où ma mère elle-même avait vu le jour. Nous y habitions avec mon grand-père. À un moment donné, j’ai dit stop, terminé, je ne vois plus d’intérêt à rester là. Je ressens une pesanteur à Paris. Une agressivité, que je retrouve dans le milieu littéraire parisien. Même s’il y en a des bien pires que celui-là, c’est un monde que je trouve dur. Il y a peu d’enthousiasme, peu d’ouverture vers l’autre. Quand j’ai publié Ardoise, Bernard Pivot, qui ne se lève pas la nuit pour lire mes romans, s’étonnait de voir un écrivain dire du bien d’autres écrivains. Mais l’émotion que me procurent les autres, c’est tout ce que j’ai à transmettre. Il arrive un moment où lorsque vous êtes un artiste, vous devez renvoyer la balle. Si vous ne prenez pas ce rôle de passeur, alors vous resterez tout seul sur votre branche morte jusqu’à ce qu’elle tombe. Je préfère être dans la vie, parler aux gens, échanger avec eux, plutôt que de faire partie d’un milieu qui se fossilise. Mon fils vient de m’offrir un livre de Dickens, ce qui a priori n’est pas ma tasse de thé, et pourtant j’ai pris un plaisir fou à le lire. Mais je serais passé à côté si personne ne m’y avait amené. Donc c’est l’idée que l’écrivain a un rôle à tenir. Il peut aider les gens à garder les yeux ouverts, ce qui va être de plus en plus compliqué avec l’intelligence artificielle et toute cette technologie qui est en train d’arriver. Si on ne donne pas aux gens quelques outils pour appréhender tout ça, on est mal barré.
Vous pensez qu’à terme les livres seront écrits par des algorithmes ?
C’est déjà une réalité. J’ai visité il y a quelques années une exposition consacrée à ces nouvelles technologies. Elle se terminait par la présentation d’une intelligence artificielle. On lui demandait d’écrire un scénario et le résultat était plutôt bon, bien meilleur qu’un tas de bouquins qu’on peut trouver dans le commerce. En ce moment, on voit circuler ces photos générées par une IA de Macron qui se fait poursuivre par des types déchaînés dans une manifestation, et vous avez des personnes qui vous expliquent que ces images sont vraies. D’où
10
l’importance encore accrue des écrivains et du rapport à la langue, pour pouvoir démêler le vrai du faux, pour savoir quels mots on choisit pour exprimer ce que nous vivons actuellement.
Vous êtes un écrivain de l’ultra contemporain, voire de la légère anticipation comme dans 2030 . Le passé ne semble pas vous intéresser, et pourtant vous avez plus d’une trentaine de romans à votre actif. Vous concevez que ça commence à s’appeler une œuvre ?
Je ne pense jamais à ça. Et si je commençais à me pencher sur la question, ça sentirait le sapin. Je suis loin de faire l’unanimité. Il y a plein de gens qui n’aiment pas mon travail.
Et beaucoup qui l’aiment.
Je n’en sais rien. Je l’espère. Vous avez remarqué que mes livres n’accaparent pas les sélections des prix littéraires.
Mais ça vous ferait plaisir de recevoir un prix tel que le Goncourt qui dans son jury compte ÉricEmmanuel Schmitt ?
Comment des types comme ça peuvent-ils siéger au Goncourt ? On nage en plein délire. Sauf qu’ils ont mis en place un système qui assure leur survie au sein d’un milieu littéraire parisien basé sur le copinage, le renvoi d’ascenseur et la cooptation. Je n’ai pas spécialement envie d’être adoubé par ÉricEmmanuel Schmitt. On parle quand même d’un mec qui dialogue avec Dieu, qui se barre avec son pognon en Belgique et qui par-dessus le marché écrit des livres épouvantables. J’ai vu qu’il se vantait d’inventer des mots. Mais la littérature, ce n’est pas inventer des mots, c’est trouver un rythme, une sonorité qui englobera toutes les émotions que vous ressentez. Je pense à Richard Brautigan, un écrivain capable de faire tenir une tragédie grecque dans un dé à coudre. Quand on s’appelle Éric-Emmanuel Schmitt, on ne fait rien tenir dans un dé à coudre.
Vous fait-elle peur, cette époque qui brûle ce qu’elle a autrefois encensé, et où sévit de nouveau une police de la pensée ?
Elle me fait peur pour mes enfants et mes petitsenfants, mais pas pour moi. Quand certains ont dit à la sortie de Oh… que j’y faisais une apologie du viol, j’ai été surpris. J’apprenais soudain que je vivais dans un monde où personne ne violait personne. Il faut arrêter avec cette hypocrisie. Ce n’est pas faire l’apologie d’un crime que d’en parler. Et c’est une tromperie de faire croire que ça n’existe pas.
Ce retour en force du puritanisme se traduit en littérature par une forme d’hygiénisme. Les
romans feel-good , mises en fiction d’une idéologie marchande et conservatrice, déferlent dans les librairies. Ça ne vous met pas en colère de voir que ces produits calibrés pour brosser le lecteur dans le sens du poil, et d’où la littérature semble absente, sont aujourd’hui les livres qui se vendent le plus ?
Ce n’est pas mon problème mais celui des éditeurs. N’importe qui a le droit d’écrire des romans, même si c’est mauvais. C’est à l’éditeur ensuite de faire son choix. Un jour, j’ai déjeuné avec le représentant d’une maison d’édition. Il m’explique qu’il a lu un manuscrit incroyable, une merveille absolue. Je lui demande quand sera publié le livre et il me répond qu’il ne sera pas édité par eux, au prétexte qu’il ne se vendra pas.
Vous dites souvent qu’un écrivain n’a pas le droit de perdre un lecteur. Non, car ça voudrait dire qu’il a mal fait son boulot. Évidemment, il a le droit de rater des choses. Il peut m’arriver de déconner complètement. Nelly Kaprièlian des Inrocks me dit toujours que je ne sais pas comment terminer mes romans, et qu’on y parle trop du temps qu’il fait. Que je ne sache pas finir, ça, c’est possible, mais concernant la météo, je me vois mal parler d’un personnage si je ne sais pas s’il fait jour ou s’il fait nuit, s’il fait chaud ou froid. Je suis très sensible à la luminosité d’une journée, donc j’imagine qu’il en est de même pour mes personnages.
C’est vrai qu’on ne donnerait pas cher d’un livre qui ne nous ferait ni chaud ni froid. La météo, parlons-en. Votre écriture est climatique. Plutôt que de nous décrire avec précision des lieux ou des personnages, vous instaurez des climats. Et il fait souvent trop chaud ou trop froid dans vos histoires. Les personnages doivent faire face à des canicules, des inondations…
Si demain je vous écris un joli truc sur la poésie de l’eau qui coule dans un ruisseau alors que la planète est en train de brûler et qu’il y a des millions de gens qui suffoquent, vous allez vous demander ce que je fabrique.
Vous aimez confronter vos personnages à des situations extrêmes.
C’est la situation qui m’intéresse. Et pas forcément le fait qu’elle soit extrême. Dans Sans compter, il s’agit simplement d’un type qui rentre chez lui et se retrouve au milieu d’une dispute entre sa femme et sa belle-mère. On est loin de la fin du monde. Mais c’est à moi de trouver le moyen de rendre cette situation intéressante. Alors je réfléchis au motif de l’engueulade, à la configuration du lieu. Il se trouve que la belle-mère est poète et qu’elle travaille dans un cabanon à proximité de la maison. Ça me permet d’inventer une géographie, un climat, une tension, et c’est suffisant pour continuer.
Cette situation, elle vous donne la possibilité d’atteindre plus vite la vérité des personnages ?
Oui, mais cette vérité est partielle, donc fausse. Par exemple, il y a ce confit assez violent entre la mère et sa fille au début de Sans compter, mais on comprend plus tard que leur relation est beaucoup plus tendre qu’il n’y parait. Un écrivain propose un univers, un espace particulier, et il doit être le maître de cet espace. Il ne doit pas se retrouver coincé. Pourquoi je n’écris jamais sur Paris, alors que c’est la ville que je connais le mieux ? Parce que si d’un seul coup j’ai envie qu’un séisme secoue mon histoire, j’aurais du mal à faire croire que la terre tremble à Châtelet. Donc je m’arrange pour qu’on ne sache pas précisément où ça se passe. On ne sait pas si on est en France, dans un pays nordique ou anglo-saxon, et je sais que certains lecteurs sont gênés par cette absence volontaire de précision.
11
Vous avez fait une exception avec Impardonnables, dont l’intrigue se déroule au Pays basque.
Et une autre avec Lent Dehors, dans lequel le personnage se réfugie à Martha’s Vineyard, une petite île du Massachusetts où nous avons vécu. Mais pour en revenir à cette question de la précision, au xixe siècle, des auteurs comme Stevenson ou Conrad étaient complètement à l’opposé de ce qui se passait en France, avec le roman réaliste à la Balzac. Stevenson parlait de suspense, de point de vue, alors que les écrivains français étaient obsédés par le réalisme. Mais on ne peut pas être plus réaliste que la réalité, et ça, Stevenson l’avait compris. Il savait que la littérature devait prendre un autre chemin. Une chose m’a frappé dans Lord Jim, de Joseph Conrad. À un moment, le héros pose le pied sur un débarcadère, et soudain il y a un rayon de soleil qui vient faire scintiller son bouton de manchette. En une seule phrase, une seule image, je comprends tout de ce personnage, son allure, sa condition sociale. Ce n’est pas la peine de m’en dire plus.
Parmi tous vos textes, il y en a-t-il un auquel vous tenez plus qu’un autre ?
J’aime bien Ardoise, parce que c’est l’idée de dire que sans certains écrivains, je ne serais pas devenu ce que je suis. Il y a des gens qui me disent qu’ils ont découvert Richard Brautigan grâce à ce livre.
Je fais partie de ces gens. Vous avez mis des livres dans mes mains. Dans ce cas, c’est que j’ai fait mon job. Les plus grandes émotions de ma vie, je les ai eues à travers la lecture, alors il me parait normal de les transmettre. Si une poignée de mes lecteurs se mettent à lire Brautigan et que ça leur ouvre une porte vers d’autres écrivains, alors j’ai rempli ma part du contrat. Les auteurs dont je parle dans Ardoise ont changé ma vision du monde. C’est la question du pas de côté qui vous permet de regarder des choses que tout le monde voit, mais sous un angle différent. Depuis Shakespeare, toutes les histoires ont été plus ou moins racontées. Mais se dire qu’en bougeant légèrement l’axe de la caméra, en faisant un petit pas de côté, les éléments de cette histoire vont vous apparaître sous un jour nouveau, ça ne me semble pas inintéressant. Et je n’ai pas trouvé mieux que la langue pour l’exprimer. Un jour, j’attendais quelqu’un sur la place Saint-Sulpice. Il y avait un sans-abri qui dormait sur un banc, dans son sac de couchage, et pas très loin de lui, des jeunes gars habillés à la mode et qui jouaient au foot devant une petite assemblée. Un autre dans le même genre les a rejoints, et quand il est passé devant le SDF, il s’est penché vers lui et il a commencé à lui caresser la tête, puis à sortir un bout de chiffon de son duvet pour lui nettoyer le visage. Une scène biblique. Je me suis dit : qui regarde ça ? Personne. Les gens autour étaient focalisés sur le match de foot alors que c’est ce geste-là qu’il fallait voir, et rien d’autre. Mais pour avoir cette profondeur de champ, il faut savoir prendre du recul. C’est pour cette raison que j’ai quitté Paris à l’âge de 25 ans, et qu’avec ma femme et mes enfants, nous avons longtemps habité à l’étranger.
Lorsqu’on écrit et que l’on habite dans un pays dont on ne maîtrise pas la langue, j’ai l’impression qu’on apprend à réentendre sa propre langue, que l’on fait la paix avec celle-ci, en quelque sorte.
C’est drôle ce que vous me dites parce que j’ai ressenti exactement la même chose quand je suis arrivé aux États-Unis. D’un seul coup mon univers sonore avait changé, avec la radio, les conversations des gens que je ne faisais pas spécialement l’effort de comprendre, et alors j’ai senti naître comme une espèce de relation amicale avec ma langue. Le
simple fait d’écrire en français me faisait retourner vers quelque chose qui me touchait, me parlait profondément.
Dans le livre de conversation avec Jean-Louis Ezine, Entre nous soit dit , vous écrivez : « C hez moi, l’écrivain et l’individu ne sont pas les meilleurs amis du monde, je pense même qu’ils ne s’apprécient guère », est-ce qu’après 40 ans de vie commune, l’écrivain et l’individu se sont réconciliés ?
Elle est vicieuse votre question. Je dirais non, car l’écrivain peut tout réinventer. Il part de rien et il a la possibilité de créer un monde, des personnages, des rapports entre ces personnages. L’individu, lui, doit faire avec ce qui existe déjà, et dont il n’a, la plupart du temps, pas la maîtrise.
À quand Ardoise 2 ? Qui sont, aujourd’hui, les écrivains qui vous aident à traverser la rue ?
Bret Easton Ellis, Jonathan Franzen ou Philip Roth, dont je viens de relire les premiers livres. Ces auteurs me procurent de l’émotion. Ardoise ressort en septembre en édition de poche chez J’ai lu, et j’ai pensé à leur proposer une suite, car il y a encore beaucoup d’auteurs dont j’aurais envie de parler. Dans Ardoise, je ne parle pas de Philip Roth ou de Richard Ford, alors que ce sont des écrivains magnifiques. Je ne parle pas non plus de Stevenson, ou de Gabriel Tallent, dont j’ai adoré My Absolute Darling. Bien sûr, après avoir passé ma vie à lire, je n’ai plus la même capacité à m’enflammer pour un bouquin. Mon enthousiasme est plus intérieur, plus mental. Je comprends la beauté de ce que je lis, de ce que ça provoque chez moi, alors qu’avant, ça me tombait violemment dessus, et je ne savais plus où j’étais.
Ardoise , c’est ce texte assez unique, ni essai, ni roman, une sorte d’adresse directe au lecteur, de la part d’un ami qui lui voudrait du bien. Vous lui parlez de cette chose infiniment complexe qu’est le style en littérature, mais avec une voix qui reste à tout moment compréhensible.
Mon fils, qui écoute beaucoup de musique, essaie tout doucement de m’attirer vers des propositions très expérimentales. Il a compris qu’il me fallait un cheminement, que je n’allais pas me mettre d’un seul coup à écouter du free jazz et à tout comprendre de cette musique, sans être passé d’abord par d’autres choses plus accessibles. C’est la même chose pour l’écriture. Vous pouvez partir tout de suite dans quelque chose d’imbitable, mais est-ce compatible avec l’envie de parler au plus grand nombre ? Je préfère m’adresser à un large lectorat, en essayant de l’entraîner petit à petit vers des formes plus exigeantes.
12
Votre fils est de bon conseil, car dans Sans compter, Nathan écoute Nils Frahm.
Sauf que c’est moi qui lui ai fait écouter Nils Frahm. J’adore Nils Frahm. J’aime ses obsessions, son travail sur la répétition. Sa musicalité m’inspire.
C’est un des rares artistes que je peux écouter en écrivant.
Moi aussi, j’écoute souvent du Nils Frahm en écrivant. Sa musique ne prend pas le dessus sur la langue que vous êtes en train de travailler. Au contraire, elle vous aide. Elle vous apporte d’autres perspectives. J’aime toujours discuter avec des musiciens et des cinéastes de la façon dont ils travaillent. Ils rencontrent souvent les mêmes problèmes que moi avec l’écriture. Et leur manière de les résoudre m’intéresse.
Le mot « grâce » revient souvent dans Sans compter. Vous y croyez vraiment, à cette histoire de grâce ? Vous l’avez déjà sentie vous tomber dessus pendant que vous écriviez ?
Je ne suis pas assez bon pour ça. Mais oui, je pense qu’il y a des écrivains qui sont touchés par la grâce. Quand Brautigan a l’idée d’écrire une nouvelle parce qu’il est devant son lavabo et qu’il tombe sur un cheveu qui appartenait à la fille qui vient de le plaquer, je ne sais pas comment appeler ça autrement que de la grâce.
Votre style a beaucoup évolué depuis 50 contre 1, passant d’une langue brutale, exubérante, à une écriture à l’os, fluide, beaucoup moins métaphorique.
En effet, c’est cet aspect liquide de la langue, cette fluidité que j’essaie de préserver en écrivant, qui m’intéresse aujourd’hui. Je suis dans un travail de soustraction. J’élimine les aspérités, les obstacles qui pourraient empêcher l’écriture de s’écouler naturellement. Vous parlez d’écriture à l’os. J’aime bien cette idée de retirer tout ce qui en trop, le gras et la chair, pour toucher à l’essentiel, comme Stevenson qui n’a besoin que d’un rayon de soleil et d’un bouton de manchette pour mettre en place un univers. Céline disait de ses contemporains qu’ils étaient lourds. Il a raison. Il ne faut pas être lourd.
Si le registre de votre langue est courant, vous aimez parfois utiliser des mots ou des expressions rares. « Nathan, c’est moi, c’est ma faute, se morigène-t-elle », lit-on dans Sans compter.
C’est pour m’amuser, et aussi parce que j’aime l’effet que ce mot produit dans la phrase. Même chose avec les adverbes. S’ils sonnent bien à mon oreille, je ne m’en prive pas. Mon style a longtemps été critiqué. Au début, mes livres plaisaient à des
jeunes mais se faisaient démolir par l’intelligentsia. Ça ne m’empêchait pas de dormir, mais d’un autre côté, j’étais embêté vis-à-vis du message que je voulais faire passer, à savoir qu’il existe d’autres manières de raconter des histoires. J’étais un peu las d’être l’outsider. Cette absence de reconnaissance du cœur de mon travail, qui est la langue, me gênait.
Ce dernier roman est une déclaration d’amour à la poésie. On y découvre Gaby, une poète émérite, qui avec ses lectures publiques fait salle comble. C’est de la science-fiction, ce que vous nous racontez là.
Oui et non. J’ai assisté à des lectures à la Maison de la Poésie qui rencontraient un certain succès, mais je me doute bien que ce n’est pas toujours le cas. La poésie, pour moi, c’est l’absence totale de contrainte. Ceux qui en écrivent savent qu’ils ne vont pas en vivre, donc ils ne font que ce qu’ils ont envie de faire. J’écris de la poésie, mais juste pour moi. Je ne la publie pas.
Pourquoi ?
Parce que je sais qu’elle n’est compréhensible que par moi, et qu’elle ne touchera personne d’autre.
Comment pouvez-vous en être sûr ? Carver aussi écrivait de la poésie, et non seulement elle nous touche encore aujourd’hui, mais elle est magnifique.
Il fait ce qu’il veut. Bukowski aussi a publié ses poèmes.
Êtes-vous comme ce personnage de Nathan, prêt à vous pâmer devant un poète ?
Oui, parce qu’un poète n’a besoin que d’une page pour faire passer une émotion que je vais mettre 50 feuillets à transmettre.
Pourtant il me semble qu’il y a une forme de poésie très contemporaine dans vos romans. Dans le dernier, on peut lire : « Il n’est pas très tard, le soleil s’est à peine couché, les gens sont sortis des bureaux et déambulent sur les trottoirs, devant les vitrines, en pleine conversation avec leur téléphone. On ne sait pas où ils sont exactement, dans quelle ville, dans quel pays, sur quel continent, on ne sait pas s’ils vont s’arrêter pour manger une gaufre ou baver devant une paire de sneakers ou entrer dans un magasin et acheter ce qu’il faut pour fabriquer une bombe. » Qu’est-ce que ce passage sinon la captation poétique du monde tel qu’il se présente à nous aujourd’hui ?
À la fin du prochain livre, mon personnage s’assoit sur un banc et il dit : « Mon Dieu, changez-
13
moi en statue ». Je ne sais pas si cette situation est poétique, mais son mystère vibre en moi, il m’ouvre un champ des possibles.
Cela me fait penser au titre de votre roman Ça, c’est un baiser , si énigmatique et beau.
Mon frère est mort d’un cancer du poumon. À la fin de sa vie, nous étions tous autour de lui pour l’accompagner. Alors qu’il rendait son dernier soupir, sa femme s’est penchée sur lui pour l’embrasser et il a eu ces seuls mots : « Ça, c’est un baiser. »
La poésie que vous défendez ne se trouve pas dans les nuages, dans les nimbes, mais à hauteur d’être humain.
En tout cas, c’est ainsi que je la ressens, même si parfois j’ai envie d’écrire des choses stupides comme « le ciel est bleu ». Mais si la phrase qui précède a été suffisamment bien travaillée, et que la suivante l’est tout autant, ce « ciel est bleu » peut avoir autant d’éclat et de beauté qu’un diamant serti dans un bijou.
Pour rester dans ce registre poétique, les femmes dans vos romans se mordent souvent les lèvres. C’est avec ce genre de petites observations que l’on donne de la chair à un personnage ?
Oui, car ce sont des choses que tout le monde ne remarque pas forcément, à l’image du bouton de manchette.
Dans Sans compter, votre narrateur se lave très souvent les mains. Un geste qui fait sens avec la pandémie que nous venons de vivre, et en même temps, on se rend compte petit à petit que ce personnage n’est pas tout propre.
À vous de comprendre ce que vous voulez.
Une chose est certaine, c’est que l’on rit beaucoup en vous lisant. L’humour est présent dans ce roman comme dans les autres.
Vous avez remarqué à quel point le rire est assez mal vu dans le milieu trop sérieux des lettres françaises ? Pourtant, j’ai la conviction qu’un écrivain doit être capable de faire rire ses lecteurs. C’est si agréable de rire en lisant un livre. Ou en l’écrivant. Je ne devrais pas le dire, mais parfois quand je travaille sur un roman, je me fais rire tout seul.
L’eau et le feu se mêlent souvent dans vos intrigues. Dans Sans compter, il est encore question d’une maison qui a brûlé et d’une salle de bain qui fuit. Écrire, est-ce allumer des feux pour les éteindre ensuite ? Un écrivain est-il un pompier pyromane ? Je n’ai pas la prétention de déclencher des incendies.
Pourtant, ça brûle souvent dans vos livres. Ou ça se noie. Mais c’est depuis toujours le lot de l’humanité, non ? Et si vous rajoutez à ces risques climatiques ce que nous avons évoqué à propos de l’IA, je pense qu’on n’a encore rien vu. Je lis de plus en plus de romans agités par cette question de la fin du monde. Le dernier espace pour se protéger de tout ça, c’est peut-être encore la poésie, car les puissants qui tirent les ficelles n’en lisent pas, donc ils n’iront jamais vous chercher sur ce terrain-là.
Vos intrigues sont de plus en plus tirées par les cheveux. On y croise d’étranges créatures surnaturelles, vous multipliez les rebondissements improbables, le trait est volontairement grossi, et pourtant les relations
entre les gens sont très finement observées, et nous ramènent à ce que nous pouvons vivre au quotidien. C’est en convoquant les puissances du faux que l’on atteint le vrai ?
Certainement. Mais je ne sais pas si cette quête du vrai par le faux est consciente. Je cherche peutêtre tout simplement à donner un parfum un peu particulier à mon histoire. Et puis il y a la question du plaisir, qui est essentielle lorsqu’elle s’attache à la lecture ou à l’écriture. Et le plaisir chez moi se traduit souvent par des bizarreries, comme cette créature dont vous parlez, ou bien par des choses ambivalentes, comme ce Nathan qui d’un côté apparaît comme un type avec qui vous auriez plaisir à boire un verre, et de l’autre comme quelqu’un de très inquiétant.
Nathan est impuissant, et pour la première fois dans un roman vous n’êtes plus dans un rapport frontal avec le sexe. D’ailleurs, fait quasi unique dans toute votre œuvre, Sans compter ne compte aucune scène de sexe.
C’est juste que je ne trouve plus le même intérêt à écrire des scènes de sexe qu’à une certaine époque. J’ai déjà beaucoup travaillé ce matériau, notamment dans Vers chez les blancs , alors qu’est-ce que je pourrais inventer de plus ? Pour autant, le sexe n’est pas absent de mon livre. Il est là, mais sous une autre forme. Et la voie est libre pour d’autres types de rapports humains.
James Salter affirmait que le sexe était l’axe majeur de la vie. Vous êtes d’accord avec cette idée ?
On en revient toujours à ça, oui. Nathan le constate en tant que journaliste et observateur du monde : le sexe y tient toujours la place centrale et c’est lui qui mène la danse. Il est à l’origine de nos rapports humains. Même lorsqu’un politique s’adresse à son électorat, il s’agit avant tout de séduction.
Vous interrogez aussi la masculinité à travers vos romans, où les hommes sont bien souvent des êtres faibles et facultatifs, tandis que les femmes sont puissantes et essentielles.
Ce n’est que justice, car les hommes occupent majoritairement la première place dans les romans. Si j’accorde cette importance aux femmes dans ce que j’écris, ce n’est pas pour être féministe – même si les Inrocks avaient titré « Djian, féministe » il y a quelques années –, mais simplement parce qu’elles m’intéressent plus que les hommes. J’ai encore du mal à savoir comment une femme va réagir, alors que les hommes me paraissent beaucoup plus prévisibles.
14
Dans Lent Dehors, vous écriviez : « Ne t’occupe pas de ce qu’on écrit sur toi, que ce soit bon ou mauvais. Évite les endroits où l’on parle des livres. N’écoute personne. Si quelqu’un se penche sur ton épaule, bondis et frappe-le au visage. Ne tiens pas de discours sur ton travail, il n’y a rien à en dire. Ne te demande pas pourquoi tu écris mais pense que chacune de tes phrases pourrait être la dernière. » Et pourtant, vous dirigez des ateliers d’écriture. N’est-ce pas paradoxal ?
Non, parce que j’ai écrit ça il y a longtemps. Je ne suis plus le même aujourd’hui. Lorsque j’avais des ateliers d’écriture chez Gallimard, j’étais le seul écrivain à ne donner aucune indication sur le contenu de mes séances. Je ne proposais qu’un simple intitulé : « marcher sur la queue du tigre ». Mais si vous le faites sans précaution, lui aussi sera susceptible de bondir et de vous frapper au visage.
Quel genre de professeur est Philippe Djian ?
Quelqu’un qui écoute, car je sais qu’écrire un mauvais livre est aussi difficile que d’en écrire un bon. Donc j’ai du respect pour la personne qui s’y met. Comment expliquer à quelqu’un que ce qu’il a produit n’est pas bon ? A contrario, comment expliquer qu’une répétition n’est pas forcément une erreur, et même qu’elle peut donner du relief à votre phrase ? Je tâche de ne jamais perdre de vue que c’est un travail de longue haleine que j’ai sous les yeux. Je dois être capable de dire franchement les choses, et en retour d’écouter ce qu’on a à me dire. D’ailleurs, les participants n’hésitent jamais à me reprendre quand c’est moi qui déconne. Et ça m’arrive de déconner, je n’ai pas la science infuse. Mais j’essaie de leur faire éviter les erreurs que j’ai faites et qui m’ont fait perdre du temps. Quand je dirige un atelier, je n’essaie pas de dire aux gens comment il faut écrire, mais comment il ne faut pas écrire. Par exemple : la concordance des temps. Si vous la suivez à la lettre, vous allez finir par écrire « que je travaillasse », ce qui ne passe pas à l’oreille. En ce moment, je lis le manuscrit d’un jeune qui parle de la guerre de 14. Il s’y prend bien, sauf que pour coller à l’époque, il multiplie les imparfaits du subjonctif et à un moment, il me perd. Son « travaillasse », il peut me le faire une fois, pas deux.
Contrairement à d’autres écrivains, vous ne multipliez pas les versions et révisions de vos textes. Vous ne travaillez pas non plus avec des relecteurs. C’est possible d’être à la fois son unique lecteur et le plus intransigeant ? Absolument. Quand j’ai commencé, je travaillais encore sur une machine à écrire. Il fallait mettre un carbone et comme je ne savais pas taper, chaque page me prenait un temps fou. Et lorsque
je m’apercevais d’une erreur, il fallait que je retape tout depuis le début. Un jour, j’en ai eu assez et j’ai décidé de me passer de marge et d’interligne, afin de ne plus avoir la possibilité d’appliquer des corrections sur ma feuille. J’étais contraint de bien réfléchir à ce que j’allais écrire, de peser chaque mot. Aujourd’hui, je n’écris rien, pas une phrase, que je ne puisse assumer et défendre devant tout le monde, car cette phrase n’est en rien un premier jet ou un brouillon, mais la production définitive, longuement mûrie dans mon esprit. Si elle existe, c’est qu’elle a trouvé sa place dans le texte, et qu’elle me permet d’en écrire une autre après.
Cette méthode requiert une grande capacité de concentration.
Mais c’est de la concentration à l’état pur, l’écriture. Stephen King disait que si vous étiez incapable de fermer les portes autour de vous avant de vous mettre à écrire, alors il valait mieux ne jamais commencer. Personne ne doit pouvoir entrer dans votre cerveau lorsque vous écrivez.
Vous avez des rituels pour vous mettre dans cet état de concentration ?
J’ouvre le capot de mon ordinateur [ rires]. J’ai souvent vu des gens travailler de leurs mains, et j’ai appris à ne pas m’en aller tant que le travail n’avait pas été fait comme il devait l’être. Leonard Cohen a passé un mois à chercher une rime à « orange », et il a fini par la trouver. Il n’y a jamais rien de bâclé dans ce que je fais, même si j’entends dire parfois que mon écriture est relâchée.
Je dirais plutôt qu’elle est souple. Je préfère.
Quand savez-vous qu’un roman est terminé ?
Lorsque je sens que je vais lui nuire si je continue. Quand j’ai trouvé cette phrase : « Mon Dieu, changez-moi en statue », qui est la dernière du prochain livre, sur le moment, je ne comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire. Est-ce que le type se pétrifie ? Est-ce qu’il est heureux ? Est-ce qu’il a peur de ce qui va suivre ? Je ne suis pas plus avancé maintenant, mais ce que je sens, c’est que si je poursuis le texte, je risque de l’abîmer. Alors je n’y touche plus. Je m’arrête là.
— SANS COMPTER, Philippe
Djian, Éditions Flammarion
15

f oc - u s
Duras sans filtre
En 1982, Yann Andréa a trente ans, Marguerite Duras presque quarante de plus. Leur relation est intense, puissante – profondément toxique. Avec lucidité, le futur écrivain se confiera quelques années plus tard à la journaliste Michèle Manceaux… Aujourd’hui, les comédiens Katell Daunis et Julien Derivaz adaptent avec beaucoup de pudeur ce texte éponyme publié en 2016. Un monologue taillé sur mesure avec une précision d’orfèvre, à découvrir dans l’écrin si particulier du Théâtre du Peuple de Bussang. (A.V.)
JE VOUDRAIS PARLER DE DURAS, théâtre du 11 août au 2 septembre au Théâtre du Peuple Maurice-Pottecher, à Bussang www.theatredupeuple.com

Cité métamorphosée
Le festival d’art numérique Constellations s’apprête à investir Metz tout l’été. De jour comme de nuit, 26 lieux de la ville seront augmentés par la présence d’œuvres pour la plupart totalement inédites. Deux parcours s’offrent à vous : « Pierres numériques » à la tombée du jour (avec mapping vidéo, installations audiovisuelles immersives, installations numériques et interactives…) et « Art & Jardin » pendant la journée, une promenade au fil de l’eau et du patrimoine paysager messin. (B.B.)

CONSTELLATIONS, festival du 22 juin au 2 septembre à Metz www.constellations-metz.fr
Mythosphérique
La dernière épopée héroïque du Cercle est… circulaire. C’est démontré, schéma à l’appui, page 245 de la revue annuelle éditée par le collectif alsacien éponyme. Mythologia, telle est la thématique de la onzième édition qui zoome sur Saturne et ses anneaux en compagnie de l’astrobiologiste Nathalie Chabrol, questionne la cité-jardin idéale – ronde – selon l’urbaniste Ebenezer Howard, interroge l’Anneau des Nibelungen, ou analyse avec l’anthropologue David Le Breton la figure de Narcisse à l’ère du nombrilisme triomphateur. (E.D.)
www.cerclemagazine.com

focus
Evanescent © Jesse Lindemann
18
Julien Derivaz © Xavier Deranlot
Regards d’exil
Calais recto verso, L’Impasse, Regards d’exil… La migration et ses dérives sont au cœur des séries photographiques shootées par Luc Georges. Si les voies de l’exil sont souvent associées au mouvement de vies ballotées, la « jungle » de Calais nous rappelle que migrer, c’est aussi l’attente. L’attente d’un ailleurs et l’espoir d’un avenir meilleur. Le photographe mulhousien pose un regard plein d’empathie sur les acteurs de ce drame humain et saisit leur quotidien, entre abris de fortune, chemins boueux, conditions de vie tristement déplorables et entraide. (M.M.)

exposition jusqu’au 26 août à la Bibliothèque municipale Grand’Rue, à Mulhouse bibliotheques.mulhouse.fr
Saint-Tropez, sous la pluie
Cet été, pas de twist à Saint-Tropez : beaucoup trop vulgaire pour les lecteurs de Novo. Et comme ce n’est pas notre genre non plus de jouer à la pétanque en plein cagnard, on restera au frais pour feuilleter le « carnet de pluie » que les éditions De l’air, des livres ont eu la bonne idée de confier à Nicolas Comment. En contemplant ses images gorgées de poésie dans lesquelles apparaissent sa muse Milo et les fantômes d’amis réels ou imaginaires (Christophe, Colette, Lou Reed, Paul Valery, Baudelaire, Roger Vadim, Romy Schneider…), on rallie Bernard Plossu pour qui « le mauvais temps dans le Midi est le plus photogénique ». (P.S.)
SAINT-TROPEZ, SOUS LA PLUIE

Nicolas Comment, De l’air, des livres delair.fr
Toile croate
À une encablure du changement de dizaine, le Festival International du film de Nancy 29e du nom va inclure un focus sur le cinéma croate, en parallèle de son habituelle compétition de courts et longs métrages internationaux. Au programme, de multiples projections de films, des rencontres avec les équipes, des tables rondes, des ateliers et même des apéros concerts, le tout dans une ambiance à la cool et parfaitement conviviale. Jivyéli ! (A.V.)
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE NANCY, festival du 25 août au 3 septembre au site de la Manufacture, cinéma Caméo, Goethe Institut, CCAM, à Nancy et Vandœuvre-lès-Nancy www.fifnl.com

focus
Malla Hukkanen dans Les feuilles mortes de Aki Kaurimsaki © Sputnik
19
© Luc Georges
Échappées
On adore se perdre dans les multiples détails d’Ariane Pinel, décidément à la tête du peloton : les planches de la dessinatrice strasbourgeoise, telles les toiles de Pieter Brueghel, recèlent de luxuriantes surprises visuelles. L’illustratrice, avec ses pages saturées de minihéros, animaux et bicyclettes, invite le lecteur à observer le monde, avec Sasha et les vélos (texte de Joël Henry) qui pédale à la découverte des sommets montagneux ou des bords de mer avec son lot de « kékés musclés qui font du ski nautique ». Ce livre vient d’être traduit en coréen et chinois alors qu’Ariane sort L’île aux vélos où les autos sont proscrites. Ouvrages cyclophiles édités par Cambourakis. (E.D.)

www.cambourakis.com
Quelle virilité !
Yannick & Brandon ont vraiment la Langue Pendue – nom du label de Renaud Sachet qui édite une cassette huit titres du duo, La Kour. Depuis la Réunion, la daronne et la patronne du dancehall LGBTQIA+ décollent en créole. Yannick Péria (artiste peintre militant·e queer) et Brandon Gercara (récemment exposé·e à La Filature pour Vagamondes), champagne à la main et robes de soirée sur le dos, font bouger les corps des cocos et des pinecos. « Laisse les PD tranquille » et fous le bordel sur la piste ! (E.D.)

instagram.com/renaudsachetlanguependue
Né sens
Livre/accordéon, objet d’art pour adultes esthètes ou ouvrage très petite jeunesse, abstraction ou figuration ? Tu vois le jour ! (Hélium), de Laurent Moreau, diplômé de la HEAR, s’adresse au nouveau-né. Le chat noir lui « souhaite la bienvenue », l’oiseau « pépie » au-dessus de lui, le papillon « virevolte » pour rendre hommage au bébé. Le lecteur, de 0 à 100 ans, s’enveloppe dans la douce couverture évoquée par quelques traits et se laisse bercer par les vagues d’une berceuse ondulante. (E.D.)

helium-editions.fr
Le Paradis blanc
Sous la baguette experte de la compositrice multi-casquettes (toujours jaunes) Eve Risser, Red Desert Orchestra, fait s’accorder musique contemporaine et africaine et dialoguer artistes européens, burkinabés et maliens. Ici, les nuits sont si longues qu’on en oublie le temps… Portée par une parfaite Eurythmia, derrière son piano, Eve fait rimer saxo et Bamako, laissant tromboner le sable fin et laiteux, entrer dans la transe les djembés, percuter les balafons en une hypnose collective sans passeport. (E.D.)
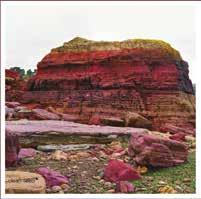
cleanfeed-records.com
Concerts à venir : www.everisser.com/concerts
focus
20

Et moi, et moi, émois
Comme tout le monde, j’ai d’abord aimé, décrypté, analysé, déchiffré les couv’ de mes disques favoris avant de les placer délicatement sous le diamant de la Technics parentale. Écoutons nos pochettes (anthologie Densité), concept et ouvrage initiés par Gilles de Kerdrel, propose une exploration de 33 pochettes racontées par JD Beauvallet (Unkown Pleasures de Joy Division), Dominique A (l’album éponyme de Molly Drake) ou notre consœur (Novo, Section 26) Valérie Bisson. Elle s’arrête sur le sentiment confus produit par la découverte de Seventeen Seconds de The Cure (1980) : « Je ne l’ai pas encore apprivoisé, mis aucun mot sur lui, il n’est qu’émois, troubles et impressions. » (E.D.)

www.ecoutonsnospochettes.com
Rencontre/lecture/écoute de pochettes le 30 juin chez Madame Café, à Schiltigheim
www.facebook.com/madamecafe.schilick
Monstres & Cie
Dragons terrifiants, serpents sifflant, fantômes errants, vampires assoiffés de sang, sorciers complotant… Les deux violonistes Dandarvaanchig Enkhjargal et Dimitar Gougov et le percussionniste Fabien Guyot, trio alsacien composant Violons Barbares, mêlent sonorités bulgares, mongoles et jazz freaks sur Monsters and Fantastic Creatures. On flippe, alors on se love vite dans la si douce « Danse à Hélène ». Ouf… (E.D.)

violonsbarbares.com
Concerts le 21 juillet à La Broque (Festival Jazz’n Bruche), le 22 septembre à Soultz (Pole 360), le 7 octobre à Ettlingen, à proximité de Karlsruhe (Stadthalle), Live Drawing Show avec Clotilde Perrin
De l’hear !
Il y a beaucoup de très bonnes raisons pour se rendre, comme chaque année, au Week-end des Diplômes de la Haute école des arts du Rhin (du 30 juin au 2 juillet) à la HEAR, 1 rue de l’Académie à Strasbourg. Traverser le jardin de l’école, puis aller de salle en salle, à la découverte des projets des options Art, Design textile, Didactique visuelle, Communication graphique… Durant, ces quelques jours : présentation des diplômes de Scéno (en trois lieux du secteur), concerts des doctorants en Création et interprétation musicales à La Pokop ou projections au Cosmos… (E.D.)
www.hear.fr

focus
Anna Trouillot, diplôme
2022 © Emmanuel Dosda
22

Never Stop Making Sense
Stop ou encore, demandait Evelyne Pagès aux auditeurs de RTL en 1983. Stop ou encore, c’est aussi ce que bruit la rumeur aux dernières éditions du Tribu Festival. Encore, ce sera la réponse de l’équipe de Zutique Productions. Encore et toujours, complétons ici. As usual, le festival 23 danse sur l’équilibre juste entre les groupes établis, et reconnus des réseaux et des circuits mondiaux, et les artistes émergents. As usual, no border, no label. Ghana/Toulouse, Strasbourg/Argentine. Musiques improvisées, cirque, afrogroove, activistes syncopés. Esthétiques enveloppées dans une pagaille hautement cohérente, racines musicales puisant à toutes les sources du monde, consciences éveillées au fil des sept jours de programmation. Ecce homo. Des humains, on en trouve à la base et dans les entournures. As usual, once again. Les humains joueront fin septembre dans le creuset dijonnais qu’est ce festival. En vrac et tout à fait subjective, une sélecta : Nicolas Lafourest et ses inspis faulkneriennes, la langue rugueuse de Sam Karpienia, les équilibres d’Antoine Viard en compagnie de Camille Nebbia puis Lise Pauton, et Chouk Bwa & The Ångstromers, combo belgohaïtien qui enflammait durablement une session KEXP, il y a 3 ans. Citons encore, la création du rappeur Napoleon Maddox, L’Ouverture de Toussaint, fédératrice et vivifiante face aux envies de cancel culture de quelques idiots beaux parleurs. Tribu ne panse pas les plaies, ce festival les pense et les laisse ouvertes à la danse des cervelles. Encore et encore, chantait un natif d’Agen.
 Par Guillaume Malvoisin
Par Guillaume Malvoisin
— TRIBU FESTIVAL, festival du 22 septembre au 1er octobre à Dijon tribufestival.com
focus 24
Chouk Bwa & The Ångstromers

Guinguette d’automne
A la mi-septembre, le CDN Besançon FrancheComté organise une guinguette de rentrée : cinq jours de retrouvailles autour du théâtre, de la lecture, du cinéma et de la musique, histoire de lancer sa nouvelle saison sous les cotillons – et le signe d’un engagement politique et féministe toujours plus affirmé. Une autre bonne nouvelle : tous les spectacles seront gratuits sur réservation ! Voilà finalement une bonne raison d’attendre la fin de l’été…
 Par Aurélie Vautrin
Par Aurélie Vautrin
GUINGUETTE D’OUVERTURE festival, 12-16 septembre 2023, au CDN Besançon Franche-Comté, à Besançon www.cdn-besancon.fr
New York – Paris – Buenos Aires et retours
Résumer la carrière et les contours de la musique de Richard Galliano serait aussi imbécile qu’inutile. L’homme est insaisissable, mais surtout encore vivant. Loin d’être ce monument marmoréen et immobile. Vivant, donc en développement, comme dirait Sir Buddha sous son manguier. Pas forcément des plus emblématiques, ses saillies accordéonnées en 1993 sur la « Vie Violence » de Nougaro n’en sont pas moins un bel aperçu de l’urgence à écouter un tel musicien. Violent, précis, frappant aux tripes comme Piazzolla savait taper, lui aussi. Astor, justement, maître à penser de Michel Portal ou de Galliano, avec qui il enregistra à la même période « Ballet Tango ». Pour ce concert de début de saison à l’Opéra de Dijon, on trace des diagonales, c’est le New York Tango Trio. Hommage à Astor le Fort, donc diagonales aux teintes de jazz, de tango et du new musette, inventé par Galliano sur les scènes hexagonales. Le trio en jeu, c’est celui du disque sorti en 2022, le disque où Adrien Moignard tient la guitare et Diego Imbert la contrebasse. Morceaux de Piazzolla et compositions persos. De quoi jouer à son tour les exégètes, les curseurs d’influences et de prendre plaisir aux frontières qui se brouillent entre les deux grands musiciens. Piazzolla a toujours eu un peu de jazz dans le sang, pour preuve son disque gravé en compagnie d’un Gerry Mulligan solide et revenu inopinément des seringues. Galliano, lui, s’est piqué souvent, mais du bonheur de joindre l’Argentine au pavé franchouille. Ici, avec un trio dont la science du dialogue évoque le meilleur des petites prières prises en secret aux dimanches matin, ce bonheur danse sur l’harmonie, sur les accords renversés comme les tables peuvent l’être en fin de banquet. Avec l’ivresse de la joie.

Par Guillaume Malvoisin
— RICHARD GALLIANO, concert le 30 septembre à l’Opéra de Dijon, à Dijon www.opera-dijon.fr
focus
Richard Galliano © Vincent Catala
—
26
De l’une à l’hôte @ M. Cavalca

Miraculeuse Ladybug
La coccinelle est toujours sur la jaquette – mais dans une version plus chromée, plus brillante, et plus assumée aussi : vingt ans après, Émilie Simon nous offre une édition rework de son tout premier album éponyme – un disque qui lui avait permis à l’époque de décrocher sa première Victoire de la musique, et l’avait révélée au grand public par la même occasion. Un par un, la chanteuse-auteure-compositrice-arrangeuseproductrice-couteau-suisse a retravaillé tous ses titres, sans nostalgie aucune – juste poussée par l’envie de découvrir à quoi ressembleraient ces morceaux s’ils avaient été composés aujourd’hui. Garder leurs essences, mais les accorder à sa sensibilité actuelle… Regarder le passé avec bienveillance pour inventer son avenir. Un jeu de miroirs où tout a changé en restant semblable, les tonalités, les harmonies, les mélodies – le nouvel album d’Émilie Simon, c’est donc un peu son premier aussi, un cadeau pour elle et pour son public, un coup de baguette magique comme elle en distille depuis vingt ans, petites bulles de douceur ouatées résolument modernes qui résonnent encore longtemps après l’écoute. Et cet ES, Émilie Simon le célèbre également sur scène, avec un spectacle qu’elle promet « unique et accompagné de surprises ». Pas mal, le concert de rentrée du Moloco, non ?
 Par Aurélie Vautrin
Par Aurélie Vautrin
— ÉMILIE SIMON, concert le 29 septembre au Moloco, à Audincourt

www.lemoloco.com
Dix ans de Détonation
Parce qu’un changement de dizaine, ça se fête avec panache, le festival Détonation s’offre un lifting quasi complet : nouveau visage, nouvelles scènes – et de nouvelles bases résolument tournées vers l’avenir en termes d’engagement écologique et sociétal. Deux jours de programmation audacieuse, avec les nouvelles figures de la scène française et européenne – Zaho de Sagazan, Warhaus, Silly Boy Blue, Bagarre, Lucie Antunes (…), mais également toute une série de coups de cœur à découvrir, des concerts sauvages et pas mal de surprises – notamment Unblock Project, la création du chorégraphe bisontin Étienne Rochefort et du génial Mondkopf. Soit trente artistes electro-rap-rock à découvrir sur trois scènes dans un festival à taille humaine, résolument festif et plus que jamais attaché à ses valeurs. On notera également une autre nouveauté : La Chaufferie, un chapiteau avec une scène centrale qui accueillera en continu une programmation electro et rap pendant les deux jours du festival. Et d’étonnantes expériences sensorielles à tester, comme le prêt de gilets vibrants. Voilà qui promet deux jours d’intensité maximale à tous les points de vue !
Par Aurélie Vautrin
— DÉTONATION, festival les 22 et 23 septembre à La Chaufferie et autres sites, à Besançon www.detonation-festival.com
focus
Zaho de Sagazan @ Zoé Cavaro
28
Émilie Simon © Nicolas Despis

Milestones et petits nuages

40 ans. À l’âge où un parrain du cyclisme comme Valverde traînait à finir, enfin, sa carrière, d’autres revivifient leurs principes actifs. Sans stéroïdes, sans adjuvants, sans gains marginaux. Bruts. Énergie brute. Intelligence brute. Plaisir brut. 40 ans que le festival Météo s’ingénie à faire rimer insolence et expérimentations. Ce qui n’est pas une sinécure. Pas une sinécure non plus, de rassembler l’énergie d’un festival quadra en quatre petites journées. Allumant une ville et, entre autres, une friche imparable. Marchant à la marge et dans les pas de ses prédécesseurs, Mathieu Schoenahl, l’actuel directeur ajoute sa patte. Celle qui le rapprocherait d’un Alan Lomax allant récup’ du son sur le terrain des Indiens d’Amérique, des Scottishs ou des tarentelles sardes. La patte d’un chercheur et d’un témoin documentaire du son brut de son temps. L’an passé, on écrivait, un peu idiot amusé, à propos du troisième jour de cérémonie :
« Commentaires sonores, drones qui contrepointent comme un téton dans le froid matinal, sagacité des grands espaces dont les paysages bégayent. Voilà pour l’ambiance où tout ce qui est joué s’emboîte et s’imbrique à merveille. Rien ne semble être épargné par le mouvement commun, là où les musiciens avaient déjà niché leur savoir, leur faconde et leurs idées. » Parions que ces lignes soient toujours d’actu avec la présence sous les pierres de Motoco de jeunes pousses, Tatiana Paris, Sofia Jernberg ou le trio [Na], et de vieilles branches, Joke Lanz, Mike Reed ou Mats Gustafsson. Tous, électrique, éclectiques et forcenés dans le plaisir de la découverte advenue pour tous. Sans égal. Bienvenue pour chacun. Sans contrainte.
Par Guillaume Malvoisin
— MÉTÉO, MULHOUSE MUSIC FESTIVAL, festival du 23 au 26 août à Mulhouse www.festival-meteo.fr
L’envers du chef-d’œuvre
Parmi la profusion d’albums de bande dessinée sortant chaque semaine en librairie, peu de publications font figure d’événement. Ce fut le cas, systématiquement, pour celles de l’américain Chris Ware. Depuis les histoires courtes publiées au début des années 1990 dans RAW puis avec son Acme Novelty Library, il bâtit une œuvrepuzzle, à l’image de son travail graphique. Proche de l’artisanat, celui-ci s’inspire volontiers de l’âge d’or des comics et de la publicité. Ses albums Jimmy Corrigan et Rusty Brown, récompensés d’innombrables fois, mettent en évidence son sens génial de la mise en page et sa ligne claire élégante, capables de nous faire voyager dans les souvenirs, les émotions, les espoirs de ses héros. Lorsqu’il s’agit d’inventer de nouvelles façons de raconter des histoires, Chris Ware se fait virtuose : pour preuve son monumental Building Stories, coffret comprenant 14 formats illustrés, dévoilant un récit que l’on peut suivre sans ordre préétabli. Avec « Chris Ware. Paper Life », le Cartoonmuseum de Bâle consacre une rétrospective réalisée en collaboration avec l’auteur, dévoilant planches originales, croquis, films d’animation ou encore des objets et personnages en trois dimensions réalisés par l’artiste. En mettant en lumière ses différentes étapes de travail, l’exposition invite à disséquer ce qui est probablement la dernière véritable révolution dans le monde du neuvième art.
Par Benjamin Bottemer
— CHRIS WARE, PAPER LIFE, exposition du 1er juillet au 29 octobre au Cartoonmuseum, à Bâle www.cartoonmuseum.ch

focus
The Hatch © Juliane Schütz
30
Jimmy Corrigan, 2003

Un syndicaliste à la mairie
Il y a bien des façons de devenir maire de Mulhouse… La riche exposition que le Musée historique consacre à Auguste Wicky permet de découvrir le parcours d’une figure syndicale et politique de l’entre-deux-guerres. Rien ne destinait Auguste Wicky, né en 1873 à Bourbach-le-Bas, au pied des Vosges, à devenir celui que les Mulhousiens de tous bords s’accordent à considérer comme un grand maire (de gauche). Orphelin très jeune, il quitte son village à 17 ans pour rejoindre Belfort où il apprend le français et découvre la dure réalité du monde industriel. Lorsqu’il arrive à Mulhouse en 1898, le syndicalisme est en plein essor. Emprisonné en 1915 en raison de ses penchants pour la France, il en profite pour rédiger ses souvenirs de jeunesse (L’Orphelin). Lorsque l’Alsace redevient française en 1918, Wicky reprend ses activités syndicales. Tête de liste SFIO aux municipales de 1925, il devient le premier maire socialiste de la ville et va pouvoir mettre en œuvre son programme : construction de logements populaires (cités Brustlein, Wolf, Haut-Poirier et Drouot), d’écoles, des bains municipaux, lutte contre le chômage… En 1935, la maison du peuple inaugurée en 1934 accueille le 32e congrès national du parti socialiste SFIO. C’est une consécration pour Wicky, reconnu nationalement pour ses engagements et ses réalisations. Confrontée à la crise des années 1930 et à un grand manque de logements, Mulhouse est alors un laboratoire d’expérimentations innovantes à l’échelle municipale pour la gauche qui arrivera au pouvoir en 1936. Expulsé par les Allemands en 1940, Wicky passe la guerre dans le Lot-et-Garonne. Les photos de lui en berger, déclinées en peintures, serviront sa communication après-guerre. À la libération, il redevient maire. La ville ayant été bombardée à plusieurs reprises, la tâche qui l’attend est immense. Usé par le travail et la maladie, Wicky démissionne en décembre 1946. Il décède peu après, le 12 janvier 1947.
 Par Philippe Schweyer
Par Philippe Schweyer
— AUGUSTE WICKY, exposition jusqu’au 17 septembre au Musée Historique de Mulhouse, à Mulhouse historique.musees-mulhouse.fr
La rue est à eux
Cette année, le festival Scènes de rue se décline en version kids avec PopUp !, comprenez par là une édition spéciale jeune public avec une vingtaine de spectacles et ateliers programmés. Cirque, théâtre, danse, balades et cache-cache interactifs, manèges rétro, puzzle 3D géant, cascades, concerts, voltiges… Les propositions sont ultra variées et résolument inclusives, avec toujours en filigrane l’envie d’affiner avec douceur l’esprit critique de nos chères petites têtes multicolores. On retient notamment la présence du blÖffique théâtre avec La ville du chat obstiné, un spectacle interdit aux adultes qui fait découvrir la ville à hauteur de matou, ou encore celle de la Compagnie Toi d’abord, avec La peur au ventre, l’histoire d’un cascadeur raté, d’une mini-moto et d’un cercle de feu. À leurs côtés, d’autres habitués de la rue, comme Jeanne Simone, le Cirque Rouages, Adieu Panurge ou encore Titanos, ce qui promet un tsunami d’émotions façon grand huit – sans oublier Dalila Boitaud Mazaudier de la compagnie UZ et Coutumes avec son spectacle autour du génocide rwandais, Tout dépend du nombre de vaches. Et puis, bien sûr, un chouette temps de bamboche avec le grand bal de Toto & les Sauvages, concert-spectacle en mode fiesta-roue libre auquel chacun pourra prendre part à sa façon. Voilà qui devrait ravir les petits et grands enfants pour le premier weekend des grandes vacances.
Par Aurélie Vautrin
— POPUP ! SCÈNES DE RUE
JEUNE PUBLIC,
festival du 7 au 9 juillet

dans divers lieux à Mulhouse
www.scenesderue.fr
focus
La peur au ventre, Cie Toi d’abord © José Rivelon
32
« Le baiser de l’Hôtel de Ville » version mulhousienne. Auguste Wicky embrasse une Alsacienne le 10 février 1945 alors que la ville, libérée le 28 novembre 1944, accueille les généraux De Gaulle, De Lattre… (Musée historique de Mulhouse)

Douceur radicale

Dans Radikale Zärtlichkeit, la théoricienne allemande Seyda Kurt cherchait récemment à élaborer la notion de douceur radicale, pour déconstruire une certaine violence qui imprègne les structures dominantes et viriles de l’amitié et de l’amour. C’est dans le prolongement de telles questions, vitales aujourd’hui du point de vue politique comme du point de vue écologique, que s’inscrit la pièce en ouverture de la nouvelle saison du Théâtre nationale de Strasbourg. La Tendresse, création de Julie Berès qui s’est associée aux plumes de Lisa Guez, Kevin Keiss et Alice Zeniter, sera donnée du 4 au 14 octobre, comme un vent caressant qui emporterait nos vieilles habitudes, pour nous laisser en imaginer d’autres, pleines de promesses. Notons qu’avant cela, les journées d’ouverture de la saison auront lieu du 15 au 17 septembre, avec concerts et quelques mots de Caroline Guiela Nguyen, nouvelle directrice du TNS. Née d’une patiente enquête, La Tendresse explore les processus de construction et de reproduction de la masculinité dominante. Les questions posées sont courageuses : « Qu’ont hérité les jeunes hommes des modes de pensée et d’éducation de leurs pères ? Quels rapports ont-ils avec les femmes, notamment après le mouvement #MeToo ? Quelles injonctions contradictoires pèsent sur eux ? » Ces questions sont essentielles, pour voir en face les formes de violence sociale les plus voilées, et pour imaginer de nouvelles relations entre nous, qui tisseraient un autre rapport à soi, aux autres, au monde, sous le signe de la tendresse, d’une douceur radicale…
Par Clément Willer
— LA TENDRESSE, théâtre du 4 au 14 octobre au Théâtre National de Strasbourg, salle Koltès, à Strasbourg www.tns.fr

La Comédie se podcaste
Durant la saison 21-22, l’équipe de la Comédie de Colmar a proposé une série de podcasts faisant écho à la programmation du CDN. Le champ d’investigation est ouvert et la vision est transversale, dépassant le strict cadre de l’art théâtral : cinéma, musique, arts visuels, poésie, bande dessinée… Une approche pop, teintée d’humour, n’empêche pas le sérieux de l’aventure radiophonique. Y ont notamment participé : la chanteuse Françoiz Breut, le musicien Cascadeur, Carla Pallone de Mansfield.TYA, la conservatrice du musée Unterlinden Pantxika De Paepe, Philippe Cohen Solal de Gotan Project et Outsider, la metteuse en scène Nathalie Béasse, la musicienne contemporaine Eve Risser, l’illustrateur Vanoli ou l’autrice d’Ultramarins Mariette Navarro. En 22-23, la Comédie a poursuivi cette création en ligne nommée « Com’ à la radio », permettant d’offrir une lecture enrichie, un regard augmenté sur sa saison, portant sur des thèmes qui se dégagent des spectacles programmés : Les femmes s’en mêlent (la place des femmes dans le 7e art est notamment questionnée dans la création Des Femmes qui nagent d’Émilie Capliez), Les fourberies de J.B. (pour l’année Molière), Bêtes de scène (les animaux au plateau), Place aux jeunes ! (la Comédie est très sensible à l’émergence), Les histoires d’amour finissent mal, en général (ce qui n’est pas faux, dans la vie et sur les plateaux…). Les participants ? La metteuse en scène Jeanne Candel, le groupe Fergessen pour des créations musicales originales, l’immense Pierre Maillet pour une chronique ciné, Anne-Lise Heimburger et ses cartes blanches, mais aussi Gaspard Raymond et la jeune troupe, Léopoldine HH, Penda Diouf, Sophie Suma, Paul Schirck, Marion Bouquet, Juliette Steiner & Ludmila Gander, ainsi que l’Opéra Studio ! Chaque épisode est illustré par Lili Terrana. Réglez votre poste, fermez les yeux et tendez vos antennes. Vous êtes sur la bonne fréquence ? C’est Com’ à la radio !
Par Emmanuel Dosda
— COM’ À LA RADIO, Série d’émissions de la Comédie de Colmar à podcaster comedie-colmar.com, podcloud.fr/podcast/cc-com-a-la-radio
Et à écouter sur Spotify (Comédie de Colmar dans la rubrique Podcast et émissions), sur Apple podcast, Google podcast… Ainsi que sur la borne d’écoute située dans le hall du théâtre
focus
© Lili Terrana
34
© Axelle de Russé

L’amour sans objet
Jean-Sébastien Bach a quelque chose de classique et de convenu, en apparence. Mais aussi, sous les apparences, d’illimité, de vertigineux. Pour Marguerite Duras, il était l’incarnation de « l’amour sans objet », sans but, qu’elle plaçait au-dessus de tout. Elle voulait écrire des livres illisibles et messianiques comme sa musique. Des livres « aussi loin de toute parole que l’inconnu d’un amour sans objet. Comme celui du Christ ou de Bach – tous les deux d’une vertigineuse équivalence. » Pour sa rentrée, l’Orchestre philharmonique de Strasbourg nous emportera dans ce flux d’amour cosmique en rendant hommage au compositeur baroque de Leipzig. Une « journée pas comme les autres » lui sera consacrée le 21 septembre à une heure étrangement inhabituelle, 8 h 15, pour un lever en douceur et en musique, avec thé, café, viennoiseries. Ce sera la première de ces journées visant à casser les codes associés à la musique classique en proposant des horaires décalés, en permettant de boire ou de manger pendant les concerts, à l’occasion de petitsdéjeuners ou d’afterworks, pour faire de l’Orchestre « un lieu de possibles ». On s’imagine bercé par Anne-Sophie Pascal à l’alto, Pierro Poro au violoncelle et Thomas Kaufman à la contrebasse, interprétant les fascinantes Variations Goldberg, alors qu’on est encore perdu dans ses pensées rêveuses du matin et dans les vapeurs de café…
Par Clément Willer
— UNE JOURNÉE PAS COMME LES AUTRES,
concert le 21 septembre au Palais de la Musique et des Congrès, à Strasbourg philharmonique.strasbourg.eu
Sur le rivage
Après les méandres de l’esthétique et de l’histoire, le nouveau volet de Spectres d’Europe s’intéresse aux figures éthérées et abstraites qui peuplent notre inconscient. Le Ballet de l’Opéra national du Rhin fait ainsi dialoguer trois pièces de son répertoire, chorégraphiées par des figures majeures de la danse contemporaine bercées par la culture européenne.
Songs From Before de Lucinda Childs, créée en 2009 par le Ballet de l’OnR, On the Nature of Daylight de David Dawson, créée en 2007 par le Semperoper Ballett et Enemy in the Figure de William Forsythe, créée en 1989 par le Ballet de Francfort, sont au programme de la soirée. C’est peut-être la prose poétique de Haruki Murakami, servant de prétexte à la pièce de Lucinda Childs sur la musique de Max Richter, qui englobe au mieux la portée singulière de ce programme moins évident, mais tout aussi puissant que les précédents. En interrogeant les écrans de nos projections et de nos représentations, Spectres d’Europe réaffirme son puissant message de nécessaires introspections individuelles et collectives, propices à la traversée des miroirs, temporels, historiques ou psychiques.


Insignifiances apparentes, mystères ordinaires, jeux de lumière, la solitude humaine fait face au monde entier et redit la quête, parfois hallucinée, de sens, d’attachement, de partage. La création – danse, musique, corps – redit ce dont l’homme est capable dans son immense claustration, une beauté possible, le meilleur face au pire.
Par Valérie Bisson
— SPECTRES D’EUROPE, danse du 25 au 30 juin à l’Opéra national du Rhin, à Strasbourg www.operanationaldurhin.eu
focus
On the Nature of Daylight (D. Dawson) – BonR © Agathe Poupeney
36

Vapeurs estivales
Les Rotondes de Luxembourg sacrifient une nouvelle fois leurs vacances au profit des nôtres avec la quinzième édition du festival Congés Annulés. Pour accompagner les longs apéros sur le parvis de cet ancien site ferroviaire aux portes de Luxembourg, c’est un mois de concerts et DJsets rock, electro, pop et indie qui nous attend. Le festival débute avec une Opening Night où se produiront les locaux de Francis of Delirium, qui redessine le rock indé des années 1990, le groupe Fat Dog avec son mélange de jazz, de punk et de blues ou encore la songwriter et poète japonaise Haru Nemuri. Plus d’une quinzaine de concerts et d’événements se tiendront aux Rotondes pour faire encore monter la chaleur de l’été. Citons la venue de A Place to Bury Strangers, The Murder Capital, Les Savy Fav, Ditz, Hanakiv, une soirée dédiée au label electro-pop Beast Records ou encore la release party des Luxembourgeois de ENGLBRT. Congés Annulés proposera également une projection du documentaire Anonymous Club consacré à l’artiste pop-garage australienne Courtney Barnett. La période de la fin juillet à la fin août sera aussi le moment de la troisième phase du projet Voie 15 : reconstitution d’une tranche de quai grandeur nature réalisée dans le cadre du European Design Festival Luxembourg, sa blancheur immaculée invite graffeurs et illustrateurs à venir exprimer leur créativité. Quant aux amateurs de galettes, ils pourront venir chiner à l’occasion du Vide-Disques Merch-o-Rama.
 Par Benjamin Bottemer
Par Benjamin Bottemer
— CONGÉS ANNULÉS, festival du 28 juillet au 23 août aux Rotondes de Luxembourg, à Luxembourg www.rotondes.lu
L’un dans l’autre
En ouverture de sa saison 2023-2024, le Théâtre de la Manufacture nous met face à notre propre humanité et à ses paradoxes à travers deux seul-en-scène. Dans Il n’y a pas de Ajar, l’autrice et rabbine Delphine Horvilleur invente un fils imaginaire à Émile Ajar, l’alter ego de Romain Gary qui signe La Vie devant soi, le second prix Goncourt du romancier en 1975. Incarné par Johanna Nizard, Abraham Ajar clame que nous ne sommes jamais « que ce que nous pensons être ». Face à l’appartenance, aux discriminations et à la revendication identitaire toujours plus forte, il nous invite à faire ce pas de géant vers l’étranger qui sommeille en nous. En entrechoquant la Bible et les mots de son père Gary/Ajar, Abraham crée un écho puissant au monde d’aujourd’hui.
Quant à la metteuse en scène Juliette Navis, elle livre avec Céline le second volet d’une trilogie. Après J.C., autour d’une figure dérivée d’un célèbre acteur belge de films d’action, c’est une célébrité inspirée par la plus célèbre des chanteuses québécoises que campe la comédienne Laure Mathis. Avant le retour ultime à la terre, l’idole d’antan se métamorphose, se livrant à l’introspection avant de se tourner vers des questionnements sociaux et environnementaux. Réflexion clownesque autour de la vieillesse, de la mort et de la transformation, Céline évoque une société dont les nombreuses fictions ont détourné notre regard de toute notion de finitude.
Par Benjamin Bottemer
— IL N’Y A PAS DE AJAR, théâtre les 8 et 9 septembre au Théâtre de la Manufacture, à Nancy www.theatre-manufacture.fr
— CÉLINE, théâtre du 3 au 6 octobre au Théâtre de la Manufacture

focus
© Pooneh Ghana
38
© Pauline Legoff
Un autre monde
Un peu partout, à Strasbourg et ailleurs, on peut voir ces derniers temps les intrigantes affiches annonçant la prochaine saison de l’Opéra national du Rhin : une forêt obscure et un ciel sombre se reflètent dans une étendue d’eau solitaire, où leurs couleurs rougeoient, alors qu’un étrange personnage se tient sur les rives. On peut lire également la devise du programme à venir : « Rêver d’un autre monde »… Ça m’a rappelé une autre phrase, lue sur quelques stickers apparus dans les replis de la ville recouverts de graffitis : « Il existe un autre monde. Il est dans celui-ci. » Ce rêve d’un autre monde sera inauguré par Don Giovanni aux enfers de Simon SteenAndersen, dans le cadre du festival Musica. L’opéra commencera par la fin, par la dernière scène du Don Giovanni de Mozart, alors que Don Giovanni, refusant de se repentir devant l’apparition de la statue du Commandeur, est englouti par les flammes de l’enfer…

À partir de là, Simon Steen-Andersen, metteur en scène et compositeur danois de musique contemporaine et électronique travaillant à Berlin, et Bassem Akiki, chef d’orchestre passé notamment par l’Académie de musique de Cracovie, le Festival d’Aix-en-Provence et le Théâtre de la Monnaie de Bruxelles, déroulent un fil sinueux, associant des scènes empruntées au répertoire classique, aux œuvres de Jean-Philippe Rameau ou d’Hector Berlioz. Ce détour par l’histoire de l’opéra nous entraîne, dans les pas d’Orphée, vers un au-delà dont on ne sait rien. Ou peut-être que ce monde étrange qu’on entrevoit n’est pas vraiment au-delà, qu’il est déjà là, que c’est simplement qu’on ne savait pas le voir.
Par Clément Willer
— DON GIOVANNI AUX ENFERS, opéra du 16 au 21 septembre à l’Opéra national du Rhin, à Strasbourg www.operanationaldurhin.eu

39
CRAZYBEATS

/10 BU$HI + MUSSY rap
/10
BEATS electro groove

/11 ZIAK rap
/11 YANISS ODUA reggae

/11 L.E.J. chanson pop






/11 SCYLLA rap
BROKEN BACK indie folk


.JE.L FAKEAR KOKO MO KAIZ AGARAGAR B U $ H I ALLYCS B R KCABNEKO 29
06
AGAR
07
13
31
02
11
18
01
/09 FAKEAR electro
/10
AGAR electro pop
/10 KO KO MO rock
CRAZY
17
/12
Entre deux battements
Areski nous parle d’amour – fou, toujours, Mona Soyoc ravive les braises de la vie – folle, aussi, Musica souffle ses 40 bougies – dément, évidemment. Tout aussi dérangé, l’Unblock Project fait corps contre un réel tétanisé, fuck yeah!, La Féline retourne aux sources en cultivant l’(a)normal, Coco Machine décloisonne la chanson frenchie (plus
que Récréation et Sinaïve ouvrent une version décalée, rembobinée, du champ des possibles.
on est de fous…), tandis

ARESKI, CET AMOUR-LÀ
APRÈS VINGT-DEUX ALBUMS ET PLUS D’UN DEMI-SIÈCLE
D’UNE FASCINANTE CARRIÈRE, ARESKI PREND CETTE FOIS
LE TEMPS D’UN ALBUM SOLO, LE TROISIÈME. UN LONG COURRIER SIMPLEMENT ÉBLOUISSANT.
Il est 20 h 16, ce 20 mai. Allo ? La communication s’ouvre sur une avalanche de sons, la télévision probablement. La mauvaise heure ? Pas du tout, il parait que c’est toujours comme ça, ce serait même plutôt une chance parce que souvent, Areski fait la vaisselle en téléphonant. L’écoute est pourtant immédiate, sa voix chaude si reconnaissable traverse l’espace et le temps. Rendez-vous est pris.
Il est 14 h 30, ce 28 mai. L’hôtel des Deux- Î les nous accueille dans sa salle de petit-déjeuner, une ancienne cave aux briques épaisses contre lesquelles le cliquetis des tasses se perd. Personne ne l’a vu arriver, mais il est là. Sapé de son élégance de toujours. Un jean, une veste bleu nuit architecturalement balafrée, un grand créateur japonais sans doute. Sous le célèbre petit chapeau, le regard est vigilant. « Ah oui ? C’est vrai ? » Son interrogation est sincère. Oui, c’est vrai, l’émotion a été intense durant toute l’écoute de l’album.
Définitivement, la magie areskienne est toujours aussi agissante. « Pas de nostalgie, surtout pas ! Tout a été pensé et écrit au présent. Je vis au présent. Bien sûr, il y a quelques phrases à l’imparfait, hein, mais voilà ! »
Il rit, souvent. Dans la boite à thé, il choisit celui des Lords, « tant qu’on y est, on ne va pas se gêner ! »
Le jeune Larezeki Belkacem devait avoir la même expression quand il déambulait dans les rues de Versailles, ignorant encore qu’il deviendrait l’un des plus grands compositeurs de son époque.
« Je ne sais pas vraiment pourquoi mes parents sont arrivés à Versailles, ça a dû se passer après la guerre de 14. Mon père est venu vers l’âge de 20 ans, il était ordonnance d’un général. Je suppose que c’est à cause de ça qu’il a pu partir d’Algérie, parce qu’il y avait des difficultés pour les Algériens qui voulaient venir en France. Ma mère a dû venir dans les années 1930, pas pour une raison d’immigration, mais parce que j’avais un frère malade qui ne pouvait être soigné qu’en France. Ils sont venus en bateau et mon frère a été guéri à l’hôpital de Versailles. Lorsqu’ils ont voulu retourner en Algérie, la guerre a éclaté en 40 et c’est là que je suis né. Quand ils ont voulu repartir, il y a eu la guerre en Algérie en 54, alors ils sont restés en France. C’est à peu près tout ce que je sais, ce n’étaient pas des causants mes parents, ils avaient une vie bien à eux et devaient considérer que ça ne nous regardait pas, que ce n’était pas important qu’on sache tout ça. De temps en temps, ma mère nous disait une ou deux choses, mon père jamais. »
Pour autant, après la guerre, le restaurant des parents d’Areski accueille les musiciens d’Algérie, on y chante, on y danse. La fête se poursuit à la maison où viennent les vedettes d’après-guerre, un univers déterminant pour Areski qui intègre plus tard les Chœurs de l’Armée française. La musique ne le quittera plus à moins que ce ne soit l’inverse. « Moi, j’étais dans la clique du régiment, la fanfare, mais aussi à la radio, j’y faisais du morse et il faut vraiment être branché pour le morse ! Les cours se faisaient le matin, les après-midi étaient consacrées à la musique. Il fallait travailler, les morceaux militaires sont difficiles à jouer, c’est pas de la tarte. Nous avions formé un petit
Par Nathalie Bach ~ Photo : Delphine Ghosarossian
43
groupe et on jouait pour le messe des officiers. C’est comme ça que j’ai rencontré Jacques Higelin, il était dans une autre compagnie, il nous manquait un pianiste et un guitariste, lui il faisait les deux. J’en ai parlé à mon supérieur qui a fait les démarches pour le faire venir avec nous. Puis on a fait ce disque, Higelin & Areski, en 1969. Juste avant l’enregistrement, Jacques est arrivé, défait, détruit. Il venait de perdre une amie, Françoise Dorléac. Il en a été très atteint, même plus tard. Il s’est isolé dans le studio et il a écrit ce texte, « Remember » et m’a demandé de faire la musique. C’est juste ça. Et puis on a fait pas mal de spectacles, enregistré pas mal de choses. Brigitte (Fontaine) venait souvent voir ce qu’on faisait, c’est Jacques qui me l’a présentée. Après, on a joué trois mois au Lucernaire un spectacle que Jacques avait intitulé Niok, on s’amusait bien. C’est vrai, on a inventé le café-théâtre, mais c’est grâce à un monsieur pour lequel j’ai beaucoup de respect et beaucoup d’affection qui s’appelait Maurice Alezra. Il avait un café à côté de la Grande Mosquée, rue du Puits-del’Ermite. Il nous voyait répéter dans le square d’en face et nous a proposé son lieu, il suffisait d’y monter une scène. C’est lui qui a inventé ça à Paris, c’est le premier. Il nous permettait de tout jouer. Jacques, Brigitte et Rufus y ont joué Maman j’ai peur, c’était vraiment une très belle pièce. Il y a eu un sacré nombre de personnes qui passaient là, Romain Bouteille, Zouk…
Un soir, par hasard, Peter Brook est venu nous voir jouer et j’ai reçu une lettre qui me donnait rendez-vous rue du Cirque. Je venais de rentrer du Maroc, j’avais été très touché par la musique de ce pays, j’essayais de jouer comme eux. Peter m’a posé un tas de questions, pourquoi j’étais parti, pourquoi le Maroc. Je lui ai raconté tout ce que j’ai pu et il m’a proposé de participer à une expérience qu’il menait au Centre international de recherche théâtrale. Je n’avais aucune raison de refuser. Je ne connaissais pas bien son théâtre, mais je savais ce qu’il avait fait sur la guerre du Vietnam, j’avais vu ses films, Marat-Sade, c’était magnifique. Avec Peter, c’était un autre travail, mais pour moi c’était comme la continuité du mien. Je n’aime pas l’application. Les choses existent, mais ça ne nous empêche pas de faire autrement. Je ne me suis jamais senti avant-gardiste de quoi que ce soit, ni Brigitte, nous n’avons pas vécu les choses comme ça, nous faisions ce dont nous avions envie et surtout ce que les autres ne nous demandaient pas de faire, c’est tout. »
Justement, Brigitte appelle. Pour dire qu’elle se sent mieux quand il est près d’elle, on ne peut pas ne pas entendre, la technologie est si souvent indiscrète. Entre la renarde et le bélier touffu, l’amour est donc toujours aussi fou. Ses mots à son sujet ne sont qu’admiration, son visage s’éclaire, il évoque aussitôt la parution imminente du livre (très intime) de Brigitte, mais aussi le prochain disque de Brigitte, « chez Verycords ! » auquel il a collaboré. On aimerait qu’il continue à ne parler que de lui, mais à ce stade commun d’amour, d’engagement musical, philosophique et politique, est-ce réellement possible ? Depuis leurs collaborations discographiques dont les majeures Comme à la radio (1970), Brigitte Fontaine (1972), L’incendie (1974), Vous et nous (1977), le couple mythique FontaineAreski ne cesse de fasciner, leur audience reste internationale. En ce début d’année, Flavien Berger et Bonnie Banane, lors de l’Hyper Weekend Festival, se sont emparés des chansons de l’album Vous et nous. « J’ai vu leur spectacle, j’ai trouvé ça magnifique. Je suis vraiment étonné, je n’ai pas d’explications, ils n’étaient pas nés, quoi ! J’ai été saisi par le spectacle, mais aussi par la façon dont ils se sont approprié les chansons. Deux individualités fortes qui ont su se rassembler. Je pense que tout est toujours possible, même si c’est beaucoup moins facile. Lorsque j’ai fait mon premier album solo, Un beau matin, en 1970, il était quasiment sans instrument, c’était au-delà du minimalisme. Il a pu se faire grâce à Pierre Barouh qui a fondé les éditions Saravah. Il nous avait donné un studio, on y faisait ce qu’on voulait, il venait de gagner une somme colossale avec les droits d’auteurs d’Un homme et une femme. Saravah, c’était une grande époque, tous les disques que Pierre a produits sont vraiment très beaux et très représentatifs de ce qu’on pouvait appeler la chanson française. Avec Brigitte, quand nous avons fait l’album Comme à la radio, cette liberté était la même. Elle m’a donné ses textes et m’a demandé de faire la musique, j’ai dit ok. Ça s’est fait comme ça s’est fait, avec l’Art Ensemble of Chicago. On se croisait en studio, mais je ne les connaissais pas, je suis allé les écouter, c’était superbe. On les disait musiciens de free-jazz, pour donner un nom, mais c’est comme l’avant-garde, c’est des conneries. Ce qui m’avait étonné, c’est qu’ils étaient tous passés par le classique, y compris leurs enfants. J’avais été frappé par leur talent, leur virtuosité et leur radicalité dans la forme, ça m’évoquait bien la rage d’une musique de ghetto. Ils n’étaient pas faciles et c’était bien compréhensible, la vie pour eux en Amérique, enfin c’était pas possible quoi ! Mettre du lait dans un café était pour eux une hérésie, Black is beautiful ! C’est là que j’ai pris conscience que la culture américaine est d’abord afro-américaine, mais afro dans un très fort pourcentage et à tous les niveaux, ce n’est pas une particularité aux États-Unis, c’est très profond. C’étaient des génies de la musique. »
44
— C’est la seule chose qui m’intéresse, cette gloire-là, le reste je m’en fous ! —
Il feuillette quelquefois le dernier numéro de Novo et pointe le slogan de couverture. « La culture n’a pas de prix », « Mais c’est bien, ça ! Parce qu’enfin qu’est-ce qu’ils ont tous à diminuer le budget culturel dans le monde entier, alors que c’est la chose la plus importante et surtout qui va être la plus rentable, c’est fatal, mais je ne sais pas comment ça va se passer ! Aujourd’hui, il y a des artistes que j’admire, comme Hubert-Félix Thiéfaine. J’aimais beaucoup Jean-Louis Murat, la personne et les chansons. Par exemple, je n’ai rien contre le rap actuel, d’une certaine façon on l’a inventé nous-mêmes en 1970, même si je considère que le véritable inventeur du rap, c’est Bobby Lapointe. Mais depuis, ce sont des clones ! Du point de vue du verbe, il y a une compression du texte qui à mon sens n’a pas d’intérêt. Il n’y a pas le temps de parler ni d’être écouté. Et du point de vue musical, à part quelques-uns, c’est du bidouillage de machines. Ça peut être très utile, mais pas systématiquement, ce n’est plus de la musique, en tous cas pour moi. De toute façon, je crains que dans les cinq ou dix ans qui viennent il n’y ait plus de musiciens puisqu’il y aura l’intelligence artificielle. C’est réel. C’est comme ça, ça tiendra ce que ça tiendra, mais pas indéfiniment, c’est impossible. En plus, la France, pour le disque, c’est que dalle, la diffusion n’est pas portée à destination. Le propre d’une maison de disques, c’est de faire des bénéfices, alors ils pensent ou ils supposent que ce ne sera pas le cas, bien souvent c’est faux. C’est ce que j’avais dit aux Japonais qui avaient produit un de nos disques avec Brigitte. Moi je tenais à ce que ce disque soit diffusé en France, ils ont été d’accord. Je me suis demandé pourquoi ils n’avaient opposé aucune résistance. Eux, évidemment, ce qui les intéressait, c’était l’Angleterre, les États-Unis. Alors, je suis allé voir le producteur et je lui ai dit : “Dites-moi, pour vous la France, c’est comme pour nous en France le Gabon, du point de vue discographique ?” Il m’a répondu : “Oui, c’est ça !” La France, c’est plutôt une vitrine, les multinationales ne sont pas françaises ! Pierre Barouh, ce qui l’intéressait, ce n’était pas l’argent, c’étaient les chansons. Même si je crois qu’une aventure comme Saravah peut encore exister aujourd’hui. Chez Universal, j’ai eu un éditeur, Jean-Philippe Allard, qui m’a permis de travailler sans rendre de comptes. Il a agi de même avec Brigitte lorsqu’il était directeur de Polydor. Il ne faut pas croire, il y a des gens qui ne désirent que ça, mais ce n’est pas ce qu’on leur demande. »
Le second album solo d’Areski voit le jour en 2010 et porte bien son nom, Le Triomphe de l’Amour. Cette production sporadique ne dénote pourtant pas un effacement amoureux face à sa « mystique et jalouse épouse qui éradique illico son blues. » Un acte féministe ? « C’est tout sauf un sacrifice de ma part, et puis mon ambition, si j’en avais une, a toujours été avant tout d’être compositeur. Paraitre ne m’intéresse pas
beaucoup et il ne faut pas oublier que pendant plus de vingt ans nous n’avons pas arrêté de faire de la musique et du théâtre ensemble. Si je sors un album seul, c’est que je me dis qu’avec mes textes et mes musiques, c’est le moment d’en faire quelque chose, alors je l’enregistre. Ce n’est jamais prémédité. Quant au féminisme, ça ne me regarde pas, c’est une histoire de femmes. Le combat le plus important du féminisme, c’est la bourse ! Que les femmes soient indépendantes et payées de la même façon et qu’elles vivent comme elles en ont envie, mais malheureusement, ce ne sont pas les hommes qui vont les aider. »
Si Long Courrier est avant tout une déclaration à Brigitte Fontaine, Areski n’est pas dupe de son époque « Dans les gares, les gens s’enivrent parce que la colère ne leur parvient plus. » Il s’inquiète d’un certain affaissement intellectuel, de la montée de l’extrême droite, il le dit si bien, si le serpent change de peau, il n’en est pas moins serpent. « Néanmoins, toutes les chansons devraient être des déclarations d’amour, quel que soit le sujet. Mais je n’ai jamais vraiment bien su ce qu’était l’amour, il faut le savoir ça ! C’est comme d’avoir une petite boule de mercure dans la main, vous essayez de l’attraper et elle se subdivise en plusieurs petites boules. Il faut garder cette innocence, la préserver. C’est ce que raconte « L’Onde », la seule chanson dont j’ai seulement fait l’accompagnement, au piano, sur un très beau texte d’Antoine Mathieu. »
Areski le sait mieux que quiconque, pour vendre la poésie, il vaut mieux en faire une chanson. Pierre Seghers en définissait la forme comme n’étant ni la cadette ni l’aînée de la poésie, mais faisant partie au même titre que la poésie du trésor d’une langue.
« La phrase de Gainsbourg disant que la chanson était un art mineur n’a pas été comprise. Il a été la première personne à faire chanter le téléphone, le rasoir électrique, la Harley-Davidson, il a apporté des mots qui n’avaient jamais été utilisés dans la chanson. C’était magnifique, incomparable, c’est même pas la peine de discuter. Rien n’est mineur chez lui, même quand il fait des choses pour s’amuser comme « L’Ami Caouette ».
J’étais fasciné par lui, j’avais 18 ans, il chantait avec Philippe Clay et déjà je trouvais ça top ! Avant lui, il y a eu Charles Trénet qui a beaucoup apporté à la chanson. Enfin, c’est de la poésie, quoi ! C’est comme les gens qui le trouvent laid, mais c’est une connerie, ça ne veut rien dire, il a une gueule, un caractère, un charme, il a la grâce, cet homme ! J’ai l’impression qu’il n’a pas été beaucoup heureux… La sortie de Melody Nelson n’a pas marché, avec Brigitte on vendait plus de disques que Gainsbourg à ce moment-là, puis avec le temps, c’est devenu culte, enfin ! Mais moi, ça m’avait immédiatement fasciné. Lors d’une émission de radio, on lui a demandé de passer un disque, il a choisi un des miens. Et lorsqu’on lui a demandé pourquoi, il a simplement répondu : “Parce que ça existe”. Je pourrais
45
dire à mon tour que le travail que je fais avec Mounia Raoui existe et je suis très heureux que l’album Thalia Tchou (Kuroneko) voie enfin le jour. Ça fait dix ans que nous travaillons ensemble, que nous fraternisons, diraitelle, dans une aventure théâtrale et musicale. Je trouve son album vraiment très beau, elle a écrit les textes, j’ai fait la musique. Le propos de Mounia, son verbe clair, sa démarche vont durer dans le temps et parvenir aux gens. Concrètement, c’est réel, c’est du théâtre ! Le dialogue, je ne sais pas comment faire autrement, parce qu’il n’y a rien de plus facile que de parler tout seul quand on est deux. Simplement, il faut éviter de s’endormir en chemin. Et puis il y a des choses indépendantes de notre volonté, c’est cher, mais c’est comme ça. »
Des ouvriers viennent faire des réparations dans la petite cuisine de la salle, maniant des outils de feu dans le son strident d’une perceuse. Ils s’arrêtent au bout de quelques minutes interminables, mais rien n’arrête Areski. Alors qu’est évoquée la notion de gloire, dans le sens de la célébration de la vie, il répond très fort : « C’est la seule chose qui m’intéresse, cette gloire-là, le reste je m’en fous ! » Il s’amuse de la situation et poursuit très bas : « Et sans chercher à être quelqu’un d’autre, j’ai déjà assez à faire avec celui auquel je crois, ou que j’imagine pour aller m’en inventer d’autres. Croire est un mot qui sert à quoi, à Dieu, bon d’accord, on peut ne pas avoir le même dieu, mais on peut avoir le même diable. Croire, ce n’est pas vraiment croire, c’est une chose plus intuitive, c’est une foi en une vie. C’est toujours la même religion, sous des formes différentes, depuis la nuit des temps. Depuis l’Égypte, Isis avec le gosse sur les genoux, c’est la Sainte Vierge, on peut dire ce qu’on veut. Les mythes s’articulent en permanence, c’est la même histoire qui s’active. Et puis, c’est la question de l’autre. Avec Peter Brook quand nous répétions Le Songe d’une nuit d’été, je me suis dit que le jeu n’existe que parce qu’il y a les autres. Tu peux écrire la pièce la plus géniale, si tu es seul, on s’en fout. “Connais-toi toi-même”, moi je veux bien, mais avec qui, contre quoi, qu’est-ce que ça veut dire toi-
même ? Tu ne peux pas s’il n’y a pas quelqu’un d’autre en face, il n’y a pas de théâtre, ça ne peut pas exister. Croire ne me convainc pas. Je peux croire une personne, il faut bien démarrer quelque part, tout en me disant, mais pourquoi je la crois, qu’est-ce qu’il faut croire làdedans, non, mais, c’est vrai ! Autrement, on est égaré. C’est comme pour la musique, ils sont tous en train de se cloner, particulièrement depuis une dizaine d’années, les maisons de disques ne sortent plus que du numérique. Où est l’autre ? La vocation est devenue le bénéfice… Le numérique a fait évoluer le son, mais pas la musique, elle est toujours la même ! Le jour où j’ai compris que j’allais plus vite que la machine avec un papier et un crayon, j’ai abandonné toute velléité d’apprendre les machines, j’ai tout laissé tomber, ça ne me sert à rien. La musique, c’est une langue. »
Brigitte rappelle, elle voudrait que son mari lui ramène « des esquimaux ». La foule de la rue SaintLouis-en-l’Île est encore baignée de soleil. Ici, c’est son île, depuis 1968 où il a d’abord logé chez son grand ami Georges Moustaki avant d’en habiter presque toutes les rues. « Je me suis demandé pourquoi j’y revenais toujours et j’ai fini par m’apercevoir que j’y retrouvais l’architecture de Versailles, les cours, les maisons, les appartements. L’île est construite sur pilotis depuis environ quatre cents ans, c’est dingue hein ? Je n’aime pas ce qui ne bouge pas, il faut que la vie bouge, on ne sait jamais d’où ça vient… Ce qui a été important pour moi et pour Brigitte, c’est qu’un homme et une femme puissent faire des choses ensemble comme nous l’avons fait, bien au-delà du duo, je crois qu’il n’y a pas d’autres exemples, d’ailleurs. C’est simplement une autre dimension de l’amour, c’est une manière ou une façon d’aimer et j’ai autant de plaisir à chanter qu’à composer. Le reste, c’est ce qu’ils racontent, enfin, comme dit Brel, “c’est parce qu’ils veulent pas !” »
Il s’en va, la boite d’esquimaux calée bien à plat entre ses deux mains. Le soleil a disparu.
— LONG COURRIER, Areski, Kuroneko www.kuroneko-media.com
46
— Le dialogue, je ne sais pas comment faire autrement, parce qu’il n’y a rien de plus facile que de parler tout seul quand on est deux. —
UN GOÛT D’ÉTERNITÉ

APRÈS LA DISPARITION EN 2019
DE SON COMPAGNON SPATSZ, MONA SOYOC RÉACTIVE LE PROJET
KAS PRODUCT EN TRIO.
Cela pourrait commencer par une chanson de Bo Diddley : “Mona, ooh-ooo-ooo / Tell ya, Mona, what I wanna do / Get-a my house next door to ya / Can I see ya sometime?” Mais ça commence autrement, par ce clip aperçu sur une antenne locale : un duo en noir & blanc dans un hangar désaffecté ; elle, merveilleuse figure post-punk, moulée dans son jeans et perfecto, nous défiant, les yeux eyelinés fixant la caméra, avec d’inquiétants Never Come Back ; et lui, penché sur son clavier jetant des regards furtifs, le visage barré d’une longue mèche sur le devant qui ne semble jamais finir. Le fantasme ultime et absolu ! Elle, Mona Soyoc, née aux États-Unis de parents argentins qui a
Par Emmanuel Abela ~ Photo : Anne Marzeliere – Portrait de KaS Product : Richard Dumas
47
transité par Londres ; lui, Spatsz, ex-infirmier en psychiatrie qui se consacre exclusivement depuis quelque temps à ses synthétiseurs. KaS Product entre dans nos vies.
Des gens comme ça, on en croise parfois dans les rues au début des années 1980. Ils nous fascinent. Comme David Bowie, surgissant de nulle part et disparaissant à peu près aussitôt, ils viennent d’ailleurs. En l’occurrence de Nancy où il se sont rencontrés, ce qui n’est pas sans faire notre fierté à nous, provinciaux de l’Est si éloignés de la capitale et encore plus de Rennes, là-bas au bout de la vie, où tout se passe en définitive. En cela, le duo KaS Product nous appartient, nous le revendiquons. Nous détenons notre Siouxsie Sioux à nous – ni plus ni moins ! – en la personne de Mona, plus belle encore et si envoutante avec son regard de chatte sur la défensive. Miaow. Nous la savons proche, en voisine, presque en amie, et guettons la moindre de ses apparitions.
Au début des années 1980, les boîtes à rythmes remplacent les batteries, les synthés se font plus robotiques, mais la chaleur mélodique demeure au cœur des machines. Un album, l’imparable Try Out en 1982 produit par Gérard N’Guyen, journaliste, disquaire et producteur incontournable de la ville, puis deux, By Pass enregistré en 1983 à New York, puis trois, Ego Eye en 1987, plus pop mais peutêtre moins convaincant. On se familiarise encore davantage avec un propos minimaliste qui ouvre de l’espace à la voix jazz et sensuelle de Mona.
Les souvenirs s’enchaînent, ils font parfois l’objet de récits enflammés : le concert à Nancy Jazz Pulsations en 1983 par exemple, dont on trouve des traces filmées sur Internet ou celui auquel nous avons assisté, en 1986, en première partie des Residents. Un sommet sans doute dans la popularité d’un groupe au charisme évident, préfiguration des Kills. Depuis leur décision de se séparer en 1988, Mona et Spatsz ne se sont pas perdus de vue pour autant, les choses ont simplement été rendues un peu plus compliquées quand cette native du Connecticut est retournée vivre chez elle aux États-Unis, du côté de Seattle. L’idée de retrouvailles officielles a finalement germé en 2012, avec une tournée à la clé. À l’occasion de ce come-back, on ne constate nulle nostalgie ni démarche rétrospective, mais l’émotion de l’instant autour d’un propos qui a conservé sa part de radicalité. « Basé sur une vraie énergie, quelque chose de très physique ! », précisait alors Mona en temps réel. KaS Product n’est pas le groupe d’hier, il s’affirme encore comme celui du moment avec un son approprié. Malheureusement, Spatsz disparaît le 1er février 2019 à l’âge de 62 ans.
Peu de temps après, Mona se lance dans l’expérience Alive au côté du guitariste Olivier Mellano, un temps pressenti pour rejoindre KaS Product. « Après la mort de Spatsz, j’ai souhaité travailler avec Olivier , nous relate-t-elle. Nous nous sommes retrouvés en studio sans vraiment nous connaître et sans même avoir joué ensemble. Lors d’une journée d’improvisation, plein de morceaux ont vu le jour. J’avais une émotion à exprimer. Cette aventure m’a donné beaucoup de courage pour recommencer avec KaS Product . » Alors qu’un deuxième album est en cours d’écriture avec Mellano, elle retourne à la source KaS Product et réactive le groupe dans sa version « reload » sous la forme d’un trio avec Thomas Bouetel, professeur, informaticien, programmateur, accessoirement guitariste et banjoïste, et Pierre Corneau, bassiste bien connu pour avoir été l’acolyte par le passé de Philippe Pascal au sein de Marc Seberg, à Rennes. Elle nous confirme son envie de « recréer l’essence même de KaS Product. Spatsz n’est plus là, mais j’ai de nouveaux complices : Pierre amène à la basse une touche plus colorée et Thomas, pas vraiment claviériste, est doué pour le son et la programmation. De toute façon, avec KaS Product nous avions déjà formulé le rêve de solliciter des musiciens complémentaires, comme ce fut le cas avec Daniel Paboeuf, le saxophoniste de Marquis de Sade ». La tentation est grande de s’adjoindre les services d’un batteur dans un dispositif plus rock, mais « j’ai souhaité rester minimaliste sur la forme ». Au-delà de l’hommage qu’elle rend à son ami disparu, on sent une volonté de montrer la permanence, voire l’éternité, de ce qu’ils ont composé ensemble. Et mieux que cela, de prolonger l’œuvre. « Oui, le travail de deuil a son importance, nous confie-t-elle, mais il s’agit pour moi d’affirmer que la vie continue ! »
Mona y voit également une revanche : une personne mal intentionnée s’est introduite dans le studio du groupe et a dérobé des disques durs avec les enregistrements d’un nouvel album. Elle ne se fait guère d’illusion à l’idée de les retrouver, mais une affaire en cours lui donne toutes les raisons de penser que la personne en question sera « mise hors d’état de nuire ». Les morceaux perdus renaissent avec la complicité bienveillante de Pierre et Thomas. Et l’on a bon espoir de voir un nouvel album de KaS Product publié dès l’année prochaine. Ce qui constituerait une vraie nouveauté. « Notre carrière est restée épisodique, estime-t-elle, quelques années tout au plus [un peu plus de sept ans finalement, ndlr]. Quand nous sommes revenus en 2012, nous n’avions pas de nouveaux morceaux à notre répertoire, à l’exception de chansons déjà existantes mais demeurées inédites. »
48
Et justement – heureux hasard du calendrier –certaines de ces chansons rares ont été publiées l’an passé à l’occasion d’une compilation, sobrement intitulée Tribute, avec cette belle pochette de Denis Chapoullié qui place Spatsz en pleine lumière alors que Mona, elle, apparaît à l’avant en ombre chinoise. On y trouve les classiques du groupe, « Man of Time », « Pussy X », « So Young but So Cold » ou « Shoo Shoo » tout comme, parmi les inédits, le magnifique « Taste Eternity », exhumé d’une K7 de 1988, ainsi que des b-sides comme « Mind », une étrangeté aux sonorités dissonantes, pas si éloignées de Devo ou des Residents qui situe encore davantage l’importance d’un groupe en totale connexion avec son époque. L’évocation de ce morceau précisément lui suggère une remarque : « Spatsz était dans la recherche sonore, mais sa métrique assez froide me permettait de danser et de chalouper avec la voix. »
Au moment de replonger dans ses enregistrements anciens pour en proposer une sélection cohérente, on suppose un exercice pas aisé pour elle. « C’était difficile de choisir et ça me semblait douloureux de réécouter tout cela. Il m’est arrivé d’en avoir ras-le-bol et d’avoir envie de tout envoyer balader. Mais la patience de ceux qui étaient autour de moi m’a permis d’aller au bout. » Il faut dire que chez Mona, la vitalité finit toujours par l’emporter. « Oui, ne jamais se laisser abattre ! », scande-t-elle comme un manifeste de vie. « Jeunes, nous étions animés par une impulsion énorme. Aujourd’hui, je retrouve cette impulsion ! » Et de nous évoquer son plaisir de retourner sur scène, un plaisir communicatif tant elle rayonne de mille feux avec son énergie débordante. « Oui, c’est une joie, comme une renaissance totale. Je suis
portée par une énergie de célébration, très positive ! » Elle en profite pour se « réapproprier les morceaux, les revisiter avec de nouvelles couleurs. » Elle rajoute qu’elle a « pu apporter son grain de sel » et nous avoue travailler sur un autre projet avec Daniel Paboeuf, « des balades mystico-gothiques pour lesquelles elle s’exerce à des formes plus lyriques » avant – pourquoi pas ? – de retourner à ses premières amours jazz. « Faire mon Ella ! », nous glisse-t-elle au détour d’un sourire désarmant.
On lui rappelle une phrase qu’elle nous avait formulée lors d’un entretien précédent, un peu plus de dix ans auparavant : « Plus on évolue dans les révolutions solaires, meilleurs on est ! » Reconnaissant son propos, elle rit de bon cœur : « Effectivement, plus j’avance dans le temps, mieux je me sens. Je reste positive, parce que consciente du regard qu’on porte sur le monde et notre manière de contribuer à changer ce monde. Je vois arriver de très belles choses pour l’humanité. Vraiment ! » Le propos peut surprendre en ces temps de profonde incertitude, mais elle se montre persuasive : « On garde cette prise sur la vie ! Je suis en relation avec des gens qui sont radicalement dans des inventions extraordinaires, dans des rêves et des potentiels. Avec eux, je prends conscience que le monde reste pleinement le reflet de ce que je rêvais moi-même. » Ce à quoi on a envie de lui répondre sous la forme d’une boutade pleine d’émotion, à la manière de Bo Diddley : “Hey Mona / Can you come in the front do’ / Listen to my heart go bumpbity-bump / I’ll lead you baby, that’s no lie / Without your love I surely die”.
— TRIBUTE, KaS Product, IDO

49
RÉJOUISSANCE
LE FESTIVAL MUSICA FÊTE SES 40 ANS

CETTE ANNÉE AVEC UNE PROGRAMMATION
À LA HAUTEUR DE L’ÉVÉNEMENT. L’OCCASION DE QUELQUES SOUVENIRS CHOISIS.
Par Emmanuel Abela
50
John Cage en Allemagne dans les années 1990 / United Archives GmbH
15.09.1988
On entre à Musica par la porte qu’on souhaite : pour nous, cette entrée s’est faite par hasard lors de la 3 e ou 4 e édition, en suivant en ami qui avait obtenu des places pour un concert au Palais des Fêtes J’y allais avec l’insouciance du néophyte fasciné, au point de ne guère me souvenir précisément du concert, mais plus du plaisir et même de la fierté d’y être – je jurerais le Vienna Art Orchestra, mais les archives me donnent tort. Par contre, quand je me rends à cette performance du violoncelliste fantasque Jon Rose, j’y vais en connaissance de cause. Les concerts de 23 h à l’École d’architecture sont ceux que je préfère : ils m’ouvrent à des formes incroyables, étonnamment libres. C’est le cas cette année-là de David Moss, avec son sampler intégré aux éléments de sa batterie – il s’était plaint, en chantant, d’une séance photo jugée trop longue, modulant sa voix dans les graves et les aigus –, de David Linton là aussi en solo batterie, du Rova Saxophone Quartet ou de Phil Minton. Au TNS, Heiner Goebbels de Cassiber présentait Der Mann im Fahrstuhl avec son auteur, Heiner Müller, au centre de la scène, entouré d’Arto Lindsay et de Fred Frith. Ces artistes, nous partions les voir au CCAM de Vandœuvre-lès-Nancy. Là, ils venaient à nous !
16.09.1989
Pour l’ouverture de cette édition que nous couvrions officiellement pour notre station radio, Tomawak, nous assistions à une représentation de Gruppen de Stockhausen. Le dispositif était impressionnant avec trois scènes déployées pour l’Orchestre Philharmonique du Südwestfunk Baden-Baden, à l’ombre d’un TGV aux ateliers SNCF de Bischheim – il serait amusant de relater Musica par les lieux que le festival a investis, entrepôts Cronenbourg, parc de l’Orangerie, etc. Il fallait se déplacer entre chaque interprétation de la pièce de Stockhausen pour mieux saisir les variations spatiales de l’œuvre. Je regardais d’un air amusé les rangs se clairsemer et les invités s’assoupir. Cette édition a été marquée par la présence du Kronos Quartet avec une interprétation saisissante de Different Trains de Steve Reich et de John Zorn pour trois concerts, trois soirs de suite. Lorsqu’il a présenté le deuxième soir son projet hard-core Naked City, Fred Frith à la guitare avait beau glousser : l’incompréhension s’était installée. Et personne n’a su réconcilier John Zorn et son public. Nous, on avait adoré !
30.09.1990
Nous sommes en 1990, le dimanche 30 septembre précisément. John Cage est à Strasbourg pour y présenter Europeras 3 & 4, des pièces qui se présentent sous la forme d’un dispositif : un chanteur, un gramophone et une lampe de bureau. Dans le tournoiement incessant, presque obsédant, des échantillons d’opéra qui envahissent le Palais des Fêtes, on mesure à quel point le célèbre compositeur est générateur de vie. À l’image de son mentor Marcel Duchamp, il ouvre des voies créatrices infinies, celles qui dépassent l’écoute de l’instant. Celles qui dépassent même la compréhension du monde pour la simple raison que le monde devient à la fois contenant et contenu, dans un mouvement tourbillonnant, vertigineux. À son habitude, John Cage était souriant en cette fin d’aprèsmidi, non sans dissimuler quelques incertitudes quant à la réception de l’étrange objet. Avec un brin d’insouciance – voire d’insolence –, nous étions allés lui parler. Nous comprenions alors l’extrême humilité d’un homme qui se déplace sur le côté, si loin des postures environnantes. De son sourire amusé, nous apprenions une leçon. Que cherchions-nous à le croiser ainsi, si ce n’est une parcelle de sa notoriété, dont il n’a que faire, plutôt que de nous concentrer sur l’essentiel : l’œuvre elle-même ?
À réécouter ses Sonates et Interludes , programmés cette année sous la forme d’une pièce chorégraphique de la danseuse, chorégraphe et écrivaine grecque Lenio Kaklea, la chose est claire : tout n’est que rayonnement, un écho, une suspension, un silence. Derrière la percussion engendrée par le piano préparé, un espace s’ouvre. Espace sonore certes, espace mental comme ultime connexion, avec une dynamique comme on en rencontre peu, qui incite autant à la projection qu’au mouvement. Des portes s’ouvrent comme un délice permanent. Et une incitation à dépasser la contingence de l’instant.
24.09.2009
Que dire ? Steve Reich interprétant lui-même Drumming puis Music for 18 Musicians à la Cité de la Musique et de la Danse, chose inespérée, savourée à peu près à chaque seconde. Et dire que j’avais failli ne pas avoir de place – thanks to Marie-Anne I. !
16.09.2021
Nous ne saurions décrire l’émotion engendrée ce soir-là par l’ensemble vocal Roomful of Teeth – quel nom ! – et l’interprétation de pièces de Carolina Shaw. La vaste étendue des États-Unis, la beauté de ses paysages et de ses villes nous y était révélée avec la conviction, après des mois de contraintes confinées, d’une nouvelle vie possible. Tout comme les artistes présents sur scène, si plein de gratitude, nous y voyions comme la promesse et la perspective de nouvelles découvertes. Parce que Musica, pour nous, n’a jamais cessé d’être cela : la promesse d’une réjouissance constante.
— MUSICA, festival du 15 septembre au 1er octobre à Strasbourg www.festivalmusica.fr
— SONATES & INTERLUDES DE JOHN CAGE, concert et spectacle de danse le 19 septembre à Pôle Sud, à Strasbourg www.polesud.fr
51
ÉPIDERMIE
LES PUISSANTS S’ENGRAISSENT ET LA PLANÈTE S’ASSÈCHE… LES TROUS SEMBLENT BÉANTS. PLUTÔT QUE DE S’Y ENGOUFFRER, ÉTIENNE ROCHEFORT ET SA CIE 1 DES SI (BESANÇON) PROPOSENT DE FAIRE CORPS, DE CONTINUER À RAVER. UNBLOCK PROJECT : REMÈDE

À LA PIRE DES ÉPIDÉMIES, L’INDIVIDUALISME.
Monde en guerre et peuples en galère. Burn-out généralisé et manifestants gazés. En cette période post-Covid, le monde semble s’effriter autant que les raisons d’espérer. En ce jour de répétition, il ne s’agit pas de lacrymogène : lorsque nous débarquons à tâtons dans la grande salle de La Laiterie, nous sommes aveuglés par un dense nuage de fumigène, mais attirés par des panneaux lumineux, comme des phares dans la nuit. Nous percevons des diodes étincelantes, des câbles entremêlés et, enfin, Mondkopf, gourou de la techno sombre, viscérale et cérébrale, qui fait trembler tout l’espace avec fréquences et basses. Un projecteur se braque discrètement au centre de la scène (saluons la créa lumière d’Olivier Bauer) et le danseur/batteur Joël Brown apparait, entrant doucement dans le rythme. Gestes saccadés, il marche sans avancer, comme empêché. Puis il se met derrière ses fûts et frappe, fort, tandis qu’Eli Finberg commence à déclamer son plaidoyer « sur l’extinction des espèces, le superflu qui nous submerge ou la manipulation de masse ». « Tout s’imbrique », nous expliquera le rappeur strasbourgoaméricain. Étienne Rochefort, chorégraphe, danseur, metteur en scène, monte sur le plateau et entre à son tour dans la transe, pris de convulsions, mimant des visages/masques, autant de cris figés, façon Munch ou Bacon. Les beats stoppent, mais la musique de Mondkopf – « sombre, remplie de drones », selon l’intéressé – gronde comme les hélices d’un hélicoptère, decrescendo. Silence. Lumière.
52
Par Emmanuel Dosda ~ Photos : Gilles Rondot
STOP OU EN CORPS ?
Lors du spectacle dans sa version finalisée aux Eurockéennes – plusieurs formats seront proposés –, la projection d’un film réalisé par Étienne épaulé par deux Grégoire (Orio et Couvert), accompagnera les sons, fusionnera avec les mouvements. Les images « créent une ligne narrative », selon le chef d’orchestre du Project, et composent une galerie de portraits d’hommes et de femmes au bord de la crise de nerfs, comme celle qui tapote de manière de plus en plus frénétique sur son clavier en plein open space. La pellicule tournera, et nous plongerons progressivement vers la plus totale des abstractions, à la mesure du pétage de plombs général. En surchauffe, les personnages incarnés par Étienne Rochefort, Sylvain Lepoivre, Megan Desprez, Joël Brown et Marine Wroniszewski sortent petit à petit de l’écran. Entre breaks hip-hop, syncopes krump et secousses electro, tous sont pris par le « bugging, danse évoquant la saturation de nos systèmes actuels ». Une épidémie avec réactions épidermiques en chaîne. Les raisons de ce dérèglement ? La période de crises en cascades que nous traversons. Face à cette violence, Étienne et sa bande proposent de « faire groupe », en brisant le quatrième mur et en allant dans le public pour le convier à bugguer en chœur. L’union crée l’espoir. Ici, pas de vedette ni d’étoile : tout le monde sur le même plan, comme dans Bugging, spectacle créé l’an passé à Chaillot dans le cadre de la résidence à Pole-Sud dont il est artiste associé depuis 2020. Unblock Project en est une d’émanation qui a fichu une énorme baffe à Thierry Danet, co-directeur de La Laiterie et boss du festival Ososphère : « Cette pièce a su désinhiber un mec comme moi, c’est dire ! Étienne s’inscrit dans cette longue tradition née à partir du punk où le concert devient performatif et le corps réagit en temps réel à l’époque. » Jean-Paul Roland, directeur des Eurockéennes, est exactement sur la même longueur d’onde (vibratoire) : « J’ai découvert son travail durant VIADANSE au Centre chorégraphique de Belfort. Sa démarche est… très punk-rock, osons l’expression ! Les gens pensent qu’avec la danse contemporaine, ils vont avoir mal aux dents, alors que non, et Unblock Project, show musclé, en sera la preuve. Le public partagera notre enthousiasme, j’en suis certain. On ne lâchera pas l’affaire : il n’y a pas que les blockbusters dans la vie ! » Joëlle Smadja, directrice de Pôle Sud : « Nous vivons une belle épopée avec ce jeune chorégraphe qui propage sa passion pour la danse chez les plus jeunes. Avec lui, elle devient virale. » La messe des temps présents dysfonctionnels est dite. Le système d’alarme « dû aux bugs sociaux révélés par les danses urbaines », pour reprendre les termes d’Étienne Rochefort a sonné. Le bug de l’An 2000 aura lieu… cet été.
— BUG PARTY, concert dansé (sorte de « préquel » d’Unblock Project) le 10 juin (19 h) sur la presqu’île André Malraux (avec 100 amateurs !), à Strasbourg www.pole-sud.fr

— UNBLOCK PROJECT, concert dansé le 19 juin aux Eurockéennes de Belfort sur la presque’île du Malsaucy ; le 23 septembre au festival Détonation à la Friche Artistique, à Besançon www.eurockeennes.fr detonation-festival.com
L’Ososphère travaille sur l’opportunité d’une programmation située dans le cadre du festival, à Strasbourg. www.ososphere.org
Les résidences de création ont eu lieu en diverses salles : La Rodia, La Laiterie, L’Espace Django et Pole-Sud CDCN de Strasbourg larodia.com www.artefact.org www.espacedjango.eu
53
LA FÉLINE DIALECTIQUE MÉLODIQUE
LA FÉLINE (AGNÈS GAYRAUD HORS DE LA SCÈNE) EST UNE CHANTEUSE NORMAL(IENN)E.
Lorsqu’elle n’enseigne pas à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon ou qu’elle n’écrit pas des textes plus théoriques sur la musique ou la jeunesse, Agnès écrit des disques pop, dont ce quatrième album concept autour de Tarbes, sa ville de naissance, d’adolescence. Entretien félin.
Tarbes, pourquoi y revenir ?
C’est une vraie question, car cette ville moyenne n’a même pas, à première vue, la poésie des villages d’enfance ! Mais j’y suis née, j’y ai grandi jusqu’à la fin de mon adolescence, et j’y retourne depuis régulièrement voir ma mère, parfois mon père. En 2020, avec le confinement, je n’ai pas pu y retourner. Privée de ce retour habituel, je m’y suis rapportée un peu différemment, j’ai songé à la nostalgie du pays natal, un peu dans l’esprit des musiques folk, voire hillbilly , puisque, après tout, à Tarbes, on est au pied des montagnes – les Pyrénées – et ça, c’est une sacrée beauté, j’ai trouvé des émotions que je ne m’attendais pas à trouver, et j’ai suivi ce fil. J’ai commencé à contempler la ville un peu plus pour elle-même, et à travers elle, mes souvenirs, à fixer des bribes de mon passé adolescent. Quand j’ai pu enfin y retourner en 2021, les chansons étaient déjà composées : elles avaient pour ainsi dire créé le désir d’y retourner. Alexandre Guirkinger m’a accompagnée, équipé de sa chambre photographique, pour associer aux chansons un ensemble de photos – que j’ai édité dans un tabloïd tiré à part, que l’on trouve sur mon
Bandcamp. En reconnaissant certains endroits que je décrivais, il avait l’impression de « débarquer à Hollywood », de faire un pèlerinage dans une sorte de lieu culte ! La réalité avait pourtant sa part de violence : trois magasins sur quatre avaient fermé dans le centre-ville. Comme dans de nombreuses villes de France, évidemment, après la crise du Covid. Rue Brauhauban, où j’ai grandi jusqu’à mes six ans, un des rares magasins ouverts était les Pompes Funèbres. Il y avait quelque chose de fantomatique dans ce retour, mais des affects très forts aussi en fait, liés au sentiment d’appartenance.
Vous haïssiez Tarbes ?
Absolument pas. Étrangement, j’ai l’impression d’avoir su très tôt que je n’y vivrais pas ma vie entière. Je suis la petite dernière d’une fratrie de quatre enfants : les autres sont vite partis. Une de mes sœurs aînées a fugué un jour, j’ai ressenti la brutalité de l’envie de s’arracher, mais presque plus par procuration. Donc je suis partie, sans heurts, en fait, sans reproches, après le bac. J’en ai parlé plus longuement dans un texte publié pour le journal en ligne AOC (Analyse Opinion Critique), « La ville où je suis née. » Je voulais déplacer l’approche habituelle par la thématique du transfuge de classe, plein de haine pour le trou qu’il ou elle a quitté. Il y a des affects psycho-géographiques bien plus ambigus. Et tout le disque est plutôt une déclaration d’amour paradoxale.
54
Par Emmanuel Dosda ~ Photo : Dorian Rollin
Vous avez vécu des moments constitutifs pour l’adolescente que vous étiez : vous vous preniez pour une rebelle en écoutant PJ Harvey avec votre t-shirt tête de mort… Alors pourquoi dites-vous que « Tout doit disparaître » ? C’est votre côté no future qui parle ?

C’est plus une lucidité générale sur l’existence qu’une déclaration punk. J’ai toujours été hypersensible au caractère périssable des choses, et ma sensibilité à la musique et aux chansons me semble complètement liée à ça. Les chansons permettent de fixer dans une forme d’éternité des bouts de finitude. C’est une chose qui m’émeut profondément. Vous citiez PJ, qui demeure une référence pour moi, mais adolescente, j’adorais le hard rock d’AC/DC, de Black Sabbath, mais aussi le metal, de Metallica, Megadeth, c’était mon truc – et c’était aussi assez mainstream à l’époque. D’ailleurs, le solo final de La Panthère des Pyrénées est un petit clin d’œil à cette émotion profonde que le metal a suscité en moi. Quand tu regardes de plus près, la mort, dans l’esthétique metal, ça n’est pas spécialement une évocation de la rébellion, ça vient plus d’une conscience gothique de la fin de toutes choses, de leur vanité. C’est une thématique très ancienne de l’art, tout simplement, dans son attrait pour le côté obscur de la vie. Mais c’est peut-être ça qui rend rebelle après tout.
Sur Tarbes , pas vraiment de metal, donc, mais beaucoup d’ambiances musicales qui semblent varier en fonction des sujets abordés…
Ma démarche est inverse : je n’écris jamais les chansons avant les morceaux, car ce sont bien souvent les climats musicaux qui me dictent les paroles. Sur Va pas sur les quais de l’Adour, ce clavecin et ce riff de guitare m’évoquaient les bandes-son de François de Roubaix et m’ont amenée à me représenter errant dans la ville, avec mon imper d’inspectrice, comme si je racontais une sorte de roman noir. Beaucoup de l’unité de l’album est liée à ce côté narratif. Moi, je déteste faire dix fois la même chanson, un peu comme si on écrivait dix fois le même chapitre. Pour autant, je ne crois pas que l’ensemble soit hétéroclite, il a une cohérence sonore très forte, avec les variations, les couches de complexité qu’on peut imaginer découvrir quand on se balade dans une ville justement. Xavier Thiry, qui a réalisé le disque, me disait que c’était comme si j’avais construit un train pour Tarbes et invité quelques amis à monter dedans, François Virot (batterie), Mocke Depret (guitare) et les jeunes chanteurs du Conservatoire de Tarbes : tous m’ont confié avoir ressenti le voyage de façon assez immersive.
C’est donc également le cas pour l’épique Jeanne d’Albret avec ses chœurs ?
Bien sûr, le processus est identique avec ce titre où je parle de Jeanne d’Albret, mère d’Henri IV, reine de Navarre, dont on sait peu qu’elle a eu un rôle important durant les guerres de religion, et notamment, en tant que protestante, comme ordonnatrice de massacres contre la Tarbes catholique. J’ai lu ça dans un ouvrage sur Tarbes. C’était l’occasion aussi de ne pas seulement raconter mon adolescence, mais de creuser dans des couches plus profondes de l’histoire de la ville. Les chœurs, je les ai tout de suite imaginés comme des chœurs d’enfants. « Nous ne sommes pas tes soldats ! » chantent-ils. Après tout, c’est une chanson sur la guerre et sur la haine qui court toujours.
55
Dans votre ouvrage Dialectique de la pop , vous analysez longuement les propos de Theodor Adorno, philosophe et musicologue allemand né en 1903 qui, sans avoir « connu Jay-Z ou Rihanna », parle déjà de « musique populaire standardisée ». Comment percevez-vous cette pop de nantis, très éloignée des coins qui « puent la baston et la mort » comme il y en a à Tarbes.
La pop est un vaste monde, dans lequel, qu’on le veuille ou non, les séparations de classes, de genres, de races, sont reflétées. Avec des moments d’idéologie aussi. J’ai conscience que d’une certaine manière, je fais la musique de ma classe, en tout cas une musique de blanche, de mon âge, de ma position sociale, de quelqu’un qui a acquis un certain capital culturel tout en continuant d’avoir un assez modeste capital économique. C’est ainsi. Ça ne me rend pas plus authentique que les autres, mais le savoir m’aide parfois à prendre un certain recul sur mes propositions esthétiques. J’ai envie d’être en phase avec la musique que je fais, sans quoi je ne me vois pas demander aux autres de l’aimer, d’être touchés par ce que je raconte. L’authenticité n’est pas un petit bijou précieux qui t’appartient : c’est une lutte, un combat avec soi-même, avec sa propre identité. Trop la marteler est parfois suspect. Quand Beyoncé se revendique comme figure militante de l’afro-féminisme absolument légitime, sans que son statut de méga-riche ne pose problème, il y a quelque chose qui me dérange. C’est une domination qui ne dit pas son nom. Je suis de fait moins touchée par son militantisme que par celui, par exemple, qu’a incarné Rosetta Tharpe, musicienne noire, excellente guitariste, qui a eu son heure de gloire dans les années cinquante, avant d’être redécouverte et introduite au Rock’n’Roll Hall of Fame il y a seulement quelques années. Mais c’est aussi plus facile de valoriser une figure plus lointaine sur ce plan de l’authenticité. Bref, il faut se méfier de ce genre de hiérarchie morale. Disons que, personnellement, j’essaie surtout d’être en quête de justesse… Tarbes en un sens a été un geste d’ajustement. Le côté intellectuel de mon parcours a fait parfois cataloguer La Féline dans un registre « parisien chic » alors que je viens de province, et d’un milieu ouvrier, immigré, par ma mère. Finalement, je ressens une certaine liberté à assumer plus ouvertement ces déterminismes.
Philosopher, analyser et décrypter la pop ne vous empêche pas de composer ?
Non, même dans un gros livre comme Dialectique de la pop, il ne s’agit jamais pour moi d’élucider les techniques et les recettes musicologiques, comme s’il s’agissait d’un stock depuis longtemps épuisé. J’aime que l’élan qui vous projette dans l’écriture
d’une chanson demeure un mystère. J’écris de la théorie bien sûr, mais je ne perds jamais de vue la part de passion presque instinctive que je ressens pour la musique. D’ailleurs, je n’ai jamais eu autant envie de faire de chansons, de sortir de disques…
La formule « Moderne c’est déjà vieux » vous a été empruntée par votre compagnon, Tristan Garcia, qui la cite en préambule de la nouvelle « Les Rouleaux de Bois » dans le recueil 7… Partagezvous la mélomanie ?
Bien sûr. Tristan est passionné de musique, mais nous y avons un rapport très différent. Il est « complétiste » : soucieux de connaître à peu près tout des artistes qui l’intéressent. Il fait des listes, a de longs débats sur la carrière de tel ou tel avec des amis. J’apprends souvent de lui, mais j’aime aussi infiniment faire de la musique, et j’ai parfois besoin de respirer des sons des autres pour creuser mon propre sillon.
Comment imaginez-vous votre « vie future » ?
J’aimerais que ça continue ainsi, dans l’amour et la joie de faire de la musique. Cet enthousiasme est précieux ! Comme je ne suis pas vraiment vieille, mais que je commence à avoir de l’expérience et à pouvoir en jouir, je peux même dire qu’à ce stade, j’aime vieillir. Mais j’aime aussi sentir en moi combien reste vive l’adolescente que j’étais. C’est une chose aussi que Tarbes m’a révélée.
— TARBES, La Féline, Kwaidan Records
www.kwaidanrecords.net
lafeline.bandcamp.com
Entretien mené mi-mars à Schiltigheim, le soir de son show solo chez Madame Café, veille de la lecture musicale de Vers la violence de Blandine Rinkel (du groupe Catastrophe) avec le danseur Clément Gyselinck, dans le cadre des Bibliothèques idéales de Strasbourg, à L’Aubette.
56
LE LABEL MESSIN COCO

MACHINE FÊTE SES TROIS
ANS D’EXISTENCE : UNE
MAISON PLEINE DE COPAINS
DONT L’IDENTITÉ S’AFFIRME
AUTOUR DE CHANSONS EN FRANÇAIS MAGNÉTIQUES ET ÉLECTRIQUES.
LE LOOK COCO
Par Benjamin Bottemer ~ Photos : Romain Gamba
57
Avec son logo au petit parasol de guingois et ses couleurs pastel, Coco Machine semble nous inviter à prendre quelques vacances. Destination : une sorte de disco-club tout droit sorti d’une réalité parallèle, où résonnent d’hypnotiques sonorités electro et des chansons étranges et mélancoliques. Une sensibilité douce-amère qu’annonçait déjà la musique de Romain Muller, co-fondateur du label associatif, qui a choisi de se lancer en solo (après l’aventure Posterboy Machine) à la tête de sa propre structure. Lui s’occupe de la direction artistique tandis que Mélodie Boubel se charge du travail de communication, de promo et d’administration. Ensemble, ils réunissent une équipe entre Metz, Nancy et Strasbourg : il y a d’abord 2PanHeads, le duo à l’efficacité redoutable en live avec son rock à facettes teinté d’acid-house et le Baguette crew, héritier d’une french-touch dansante chaude comme le bon pain. Récemment, trois nouveaux venus annoncent l’évolution du look Coco Machine vers « une chanson française hybride, en dehors des formats imposés ». Guitare, bricolages sonores et pensées murmurées pour Mr Pelican, beats entêtants et visions rêveuses pour Josy Basar (moitié de 2PanHeads), ambiance fermeture de night-club pour le petit nouveau Clément Visage, romantique désœuvré qu’on a tout de suite envie d’adopter. Une petite famille qui, à l’instar du papa Romain Muller, a attiré l’attention de Nova, FIP ou France Inter, qui ont mis du Coco Machine dans leurs playlists.
Romain, le label est né en mars 2020 avec ton premier EP : drôle de timing sachant qu’on était en plein confinement !
Romain Muller : Pourtant Bain de minuit a eu un joli succès, un bel écho dans la presse… si j’avais été dans une maison de disques ils auraient voulu temporiser, comme ça a été le cas pour beaucoup d’artistes obligés de repousser une sortie de deux ans, voire de l’annuler ! En plus, pendant cette période, j’ai participé au festival en ligne « Je reste à la maison » qui m’a permis de trouver mon éditeur et mon diffuseur.
Créer Coco Machine, c’est justement venu de ce désir de s’affranchir des stratégies des majors, de faire soi-même plutôt que de démarcher ou d’attendre que l’on vienne te voir ?
R. M. : Avec Mélodie, on avait un peu d’expérience dans le milieu de la musique, donc effectivement on s’est dit qu’on serait capables de se débrouiller nous-mêmes, pour mon projet, mais aussi celui des autres ; on était dès le début une petite équipe, avec 2PanHeads. On y gagne en
liberté, sans impératifs de rentabilité. Pour nous, un bon disque est un disque qui nous plaît et plaît aux artistes.
Que pensez-vous de cette tendance à l’autopromotion, selon laquelle on peut se passer des médias et des labels pour rencontrer son public ?
Mélodie Boubel : Un label dégage l’artiste de tâches qui prennent énormément de temps : la promo, l’administratif, les contacts avec les salles… pas sûr que l’artiste soit le mieux placé pour faire ce travail, et puis ça l’éloigne toujours de l’essentiel : la création.
R. M. : Certains jeunes artistes pensent qu’il faut d’abord percer sur les réseaux pour avoir du succès et pouvoir tourner. C’est une illusion, et lorsque ça arrive c’est qu’il y a une équipe derrière qui s’en occupe.
Un musicien à la direction d’un label, ça permet de mieux comprendre le processus créatif de ses propres artistes ?
R. M. : On aime être impliqués dans le processus créatif des artistes, jusqu’à faire la production ensemble. En ce moment, c’est ce que je fais sur le premier album de Josy Basar.
M. B. : Il y a un lien entre la pratique de Romain et le label : sa musique, ses références ont logiquement fait émerger la ligne artistique de Coco Machine.
C’est lors de votre installation à Metz que les planètes se sont alignées pour la création du label ?
R. M. : Être dans une ville de taille moyenne comme Metz a ses avantages : les connexions se font facilement, on y a rencontré notre photographe et vidéaste Romain Gamba, Sam Berdah qui s’occupe du mastering… et la Cité musicale [structure réunissant les Trinitaires, la BAM, l’Arsenal et l’Orchestre national de Metz Grand Est, ndlr] nous a tout de suite soutenus. À Paris, on n’aurait jamais eu un bureau comme aux Trinitaires ou des résidences dans une salle de l’envergure de la BAM. On peut aussi toujours compter sur leurs conseils : Patrick Perrin, le programmateur de ces deux salles, est toujours d’une grande aide pour cela.
Il y a des labels de la région dont vous vous sentez proches ?
R. M. : On est très amis avec October Tone à Strasbourg, où on a habité. Je les ai connus dès leurs débuts, c’était aussi une bande de potes, et dix ans plus tard ils ont vraiment réussi à construire quelque chose, ils ont apposé leur empreinte
58
dans le milieu rock indé. C’est un peu un modèle : j’aimerais bien que Coco Machine soit autant reconnu et identifié esthétiquement, que des festivals ou des salles viennent vers nous lorsqu’ils cherchent des artistes avec une identité précise.
Prévoyez-vous de faire entrer de nouveaux artistes chez Coco Machine ?
R. M. : Pour l’instant, nous avons une dimension à taille humaine qui nous convient bien, ça permet de se concentrer à fond sur les projets, c’est déjà beaucoup de travail pour une petite structure comme la nôtre. Si on ajoute un nouvel artiste, on aimerait que ce soit une femme, car pour l’instant nos groupes sont exclusivement masculins…
M. B. : Les projets 100 % féminins avec des autrices-compositrices et interprètes restent rares, ou alors ce sont des formations soumises au « syndrome Schtroumpfette » : une femme est mise en avant, mais avec plein d’hommes autour ! C’est une question de manque de modèles, il en faut pour s’identifier et faire avancer les choses.
Coco Machine, c’est un label de copains avant tout ?

M. B. : On vient tous d’Épinal, Nancy, Metz ou Strasbourg, au fil des années on s’est souvent croisés et des liens se sont tissés. On faisait tourner Ippon, le groupe nancéien de Clément Grethen [ alias Clément Visage, ndlr ] avec notre association d’Épinal, et on connaît les membres de 2PanHeads depuis longtemps. Mais ils sont venus vers nous avant tout car ils recherchaient un label pour leurs projets de chanson française, tout comme Mr Pelican.
R. M. : J’aime ce côté bande de copains qui se rapprochent, se structurent et apprennent sur le tas ensemble. Par exemple, on s’est mis à faire du booking pour répondre aux besoins de nos artistes, ce n’était pas prévu à l’origine. Coco Machine, c’est un peu une entreprise familiale ! Si un artiste a un doute, il peut passer à la maison pour discuter ; ce n’est pas quelque chose qui existe chez Universal.
— COCO MACHINE, Coco Machine fête ses trois ans, le 29 juin aux Trinitaires de Metz avec Dombrance, Clément Visage, Rodorama, Thierry Saveurs www.cocomachine.fr
Clément Visage – Des Restes, EP à paraître le 22 juin
59
FUTURE CLUB
À STRASBOURG, LES FORMATIONS
ROCK SONT LÉGION : À L’IMAGE DE RÉCRÉATION ET DE SINAÏVE, CERTAINES D’ENTRE ELLES EXPLORENT LES VOIES CRÉATRICES DE DEMAIN.

Il y a quelques mois, Olivier nous annonçait « une sorte de B-52’s très vitaminé », mais c’est bien du côté des Stooges qu’il faut chercher une telle approche libératrice. « Le meilleur groupe de rock, pour Leo, avant les Ramones ! » Inutile cependant de s’adonner au jeu des références tant Récréation vise à éprouver la notion même de groupe de rock. « Au départ, le groupe a été taillé pour le live, nous confirme Olivier, c’est peut-être pour cela que nous n’avons pas enregistré en studio et que nous n’enregistrerons probablement jamais en studio ! » Il insiste sur la dimension « imprévisible » qu’il attribue aux interventions de Peran. « Oui, je déclenche des éléments enregistrés sur K7, nous renseigne ce dernier, que je travaille avec des effets. »
RÉCRÉATION
L’histoire d’un groupe s’appuie souvent sur les hasards d’une rencontre : celle d’Olivier Stula, ancien membre de Second of June que l’on connaît également sous le nom de Vaillant, et de Leo Heitz-Godot, a déclenché de premières discussions musicales avant que celles-ci n’aboutissent à des répétitions sur la base d’un répertoire restreint, avant l’adjonction de nouveaux musiciens, Marie Lagabbe et Alicia Lovich, toutes deux à la batterie, et de Peran « Trrrnctrn » André, adepte des échantillons sonores générés à partir de son 4 pistes K7. Leo voit dans la formation « un champ des possibles » qui émancipe chacun de ses membres de la pratique traditionnelle des instruments, sans nécessité de justesse particulière. De leur propre aveu, ils « ont essayé plein de choses dans bien des directions », allant parfois jusqu’à tutoyer le contre-emploi : tout d’abord sans guitare, puis avec deux guitares, batterie et son de synthé en boucle, pour finalement aboutir à un line-up solide avec une guitare, une basse, deux percussions et des machines. La musique a gagné en densité au point de devenir étonnamment sonique avec des effets de strates superposées très engageants d’un point de vue rythmique.
Même s’il est question de structure avec l’ébauche de compositions, la part d’incertitude qui naît de cet échantillonneur particulier fait que Récréation s’adapte au tempo dans un contexte très DIY. Sans laisser trop de part à l’improvisation, cela permet aux musiciens d’agir ou de réagir en temps réel. Olivier avoue au final « une démarche assez conceptuelle autour de l’idée même de générer du chaos avec une esthétique qui s’apparente à celle du collage ». Quand on leur dit qu’on y voit presque autant une tentative plastique que musicale, à la limite du happening, l’allusion semble leur convenir. C’est sans doute l’une des raisons qui les a amenés à opter pour le format très étrange d’une VHS pour leur premier enregistrement live : une demi-heure brute en images triturées, comme si la captation datait des années 1980. Rien de vintage cependant, là aussi, le retour à une forme séminale, première et ultra-sonique, avec l’invocation hurlée récurrente d’A-SHE-TON du nom des frères Stooges, Ron et Scott, fidèles complices en subversion d’Iggy Pop. « Ce qui est assez plaisant, c’est que ça part parfois d’une mauvaise blague – et le coup de la VHS en est une –, mais à partir d’un certain moment on rend la chose sérieuse, constate Leo. C’est pareil pour la musique, on donne le sentiment de faire n’importe quoi, mais ça n’est pas le cas, le sérieux nous rattrape un peu. Moi, ce qui me plaît, c’est que nous cultivons une forme d’amateurisme, même si certains d’entre nous le sont moins, que ce soit avec nos instruments ou ne serait-ce que Marie avec la photo. Ça nous permet de beaucoup nous amuser avec cela. » En effet, le choix de cette VHS dit un peu cela : un support désuet, accessible, mais qui nécessite, en fonction de ses codes propres une certaine maîtrise. D’où une dimension d’autant plus jouissive, récréative comme le nom du groupe l’indique : un pas de côté qui se situe comme une invitation à les suivre, délicieusement ouverte et salutaire.
Propos recueillis par Emmanuel Abela
— RADIATIONS (33’), Récréation, Herzfeld disponible sur YouTube et en VHS
www.hrzfld.com
Par Emmanuel Abela et Valérie Bisson ~ Photos : Marie Lagabbe / 36poses
60
SINAÏVE
Les histoires préférées du jeune groupe strasbourgeois Sinaïve sont aussi les nôtres. Réminiscences de révolte, exigence à fleur de peau et écoute sans discrimination se fondent dans un récit sonique et poétique. Aux côtés d’Alicia Lovich aux percussions et de Séverin Hutt à la basse, Calvin Keller, guitariste, chanteur et parolier, évoque la naissance du groupe et la sortie de leur EP, Répétition, sur le label Antimatière, enregistré au studio Klein Leberau de la compagnie Rodolphe Burger, à Sainte-Marie-aux-Mines.
Post-punk, noisy-pop et shoegaze, on sent chez Sinaïve un grand sens de l’accumulation musicale. Peux-tu nous raconter ta relation à la musique ?

La musique a toujours eu une place très importante dans ma famille. J’ai été nourri par le folk, le punk et la new wave, il y avait chez mes parents un vrai désir d’émancipation et de construction identitaire par la musique. J’ai grandi dans un environnement d’autant plus porté sur la culture que nous vivions à la campagne. Il y avait de tout : disques, K7 pirates et VHS de live... Après ma passion pour le foot, j’ai naturellement voulu jouer d’un instrument, la guitare s’est très vite imposée, j’étais fasciné par Johnny Marr ou Robert Smith qui sont devenus des modèles de projection très forts. Au lycée, arrivent le premier ampli, le premier riff,
le son très fort. Il y a déjà les Stooges, Suicide, c’est comme un parcours à rebours. Avec Internet et YouTube, je visionne beaucoup de live et comprends que cette dimension produit aussi des situations de décalage très inspirantes. Une vidéo de The Fall m’avait marqué, leur musique très agressive et puissante avait pour cadre une émission TV cheap et lissée, un paradoxe tout aussi intéressant que la musique. Aujourd’hui, j’ai toujours une énorme curiosité musicale.
Une maturité qui ne cesse de se peaufiner depuis Dasein et Super 45T... Sans doute l’agrégation de tout ce que j’écoute Après avoir baigné dans le rock des années 1970 à début 1980 de mes parents, j’ai écouté un peu de gangsta rap et beaucoup de metal plutôt trash, au début du collège, des musiques étiquetées extrêmes mais en réalité très marketées. Ensuite arrive Radiohead, puis retour aux groupe des années 1980, The Cure, Echo and the Bunnymen et enfin l’indie. Mais avec toujours la guitare en fil rouge, une guitare saturée. À mon arrivée à Strasbourg, j’ai beaucoup joué seul puis j’ai rencontré Alaoui avec qui on avait en commun Joy Division, New Order ou les Smiths. Là, on a décidé d’y aller, de ne pas s’excuser. On a créé Sinaïve en 2017.
Esthétique années 1980, arty, paroles très écrites, vous n’êtes pas dans ce que l’on attend des enfants du siècle…
L’esthétique des années 2000 a été très « marketable », les White Stripes, les Strokes ou les Kills avaient une imagerie très travaillée, très clean, avec beaucoup de moyens. Nos finances sont en réalité plus proches de celles de My Bloody Valentine en 1987 que de celles des groupes qui passent sur MTV. Buddy Records, qui a produit notre maxi Dasein, nous montrait des groupes actuels australiens avec une esthétique proche de la nôtre mais je ne connais quasiment pas de groupes d’aujourd’hui. Le DIY est toujours plus attirant à mes yeux. Pour le son, je ne cherche pas à sonner comme un groupe ou un autre, je n’essaye pas de donner d’explications à ce qui me touche, tout est assimilé, transformé et recraché. Je passe aussi énormément de temps à écrire les textes.
Peux-tu nous parler de ton choix d’écrire et de chanter en français ?
C’est assez difficile d’écrire en français sur une musique rythmée et rapide. La langue française a sa propre musicalité, une prosodie particulière. On ne voulait pas être un groupe français qui chante en anglais avec un accent. De plus, je ne voyais pas l’intérêt de chanter en anglais sur une musique anglo-saxonne. Je ne souhaitais pas travestir l’écriture. J’ai été vraiment très influencé et inspiré par les paroles de Murat, Bashung, Christophe ou Dominique A. Ce qu’il fait ne ressemble à rien d’autre. C’est en écoutant son premier album, La Fossette, que j’ai décidé de n’écrire qu’en français, de faire mon truc unique. J’aime la puissance poétique et c’est la contrainte qui me fait avancer, le vocabulaire. Je lis beaucoup et j’espère surtout ne pas écrire comme quelqu’un d’autre.
Propos recueillis par Valérie Bisson
— RÉPÉTITION, Sinaïve, Antimatière sinaive.bandcamp.com
— SINAÏVE, en concert le 30 juin aux Eurockéennes de Belfort www.eurockeennes.fr
61


Artbsurde
Qu’il s’agisse des archives du présent de Bernard Plossu, des hybridations anonymes de Marc Desgrandchamps, du labyrinthe contaminé par l’humour d’Elmgreen & Dragset, des détournements déchaînés de Pippa Garner, des mythes décortiqués de l’âge d’or, du déluge et des chimères, ou encore des traces (sonores, graphiques ou mouvantes) du visible dans un monde gavé de visuels, l’art déploie cet été toute son ambiguïté.
PLOSSU, VIE OUVERTE
Par Nicolas Bézard
LA VIE DE BERNARD PLOSSU EST UN ROMAN SENTIMENTAL ET GÉOGRAPHIQUE. IL SE FEUILLETTE
COMME LES PAGES D’UN LIVRE INFINI.
PREMIÈRE PARTIE D'UNE CONVERSATION
SUR LE THÈME DES ARCHIVES DU PHOTOGRAPHE, DANS LESQUELLES SON
RÉCENT ALBUM DE TRAVAIL PERMET DE NOUS REPLONGER.
C’est un grand carnet de croquis à spirales, couverture terre de Sienne aux bords fatigués, pages jaunies par le temps qui a passé, tellement de temps, quarante années ou plus. Collées sur les pages numérotées à la main, des tirages contact d’époques et d’horizons variés sous chacun desquels se lit une formule secrète, à base de lettres et de nombres inscrits au crayon à bois. En haut des pages, un titre, comme une escale sur la mappemonde du voyageur : Niger, Andalousie, Paris, Taos… Quelquefois, non pas un nom de ville ou de pays, mais celui d’une émotion (« MICHÈLE »), d’une obsession (« LE VENT »), d’un enfant (« SHANE »). Quelques croix ici et là, quelques mentions barrées ou pas. Une page presque vierge où les légendes sont orphelines de leurs images. Une autre où la présence de petits carrés orange d’adhésif double-face trahit des photos manquantes – on dirait un Paul Klee.
Les éditions Marval-rueVisconti ont compris qu’il fallait conserver ce codex dans son jus. L’Album de travail reproduit à l’identique les pages du carnet orignal, sous la forme d’un fac-similé qui ne s’embarrasse d’aucun appareil explicatif, et restitue toute la beauté non-intentionnelle de cet outil technique devenu objet d’art. On retrouve cette idée, au fond, d’un photographe que les choses qui ont été préparées à l’avance pour « faire joli » ont toujours laissé de marbre, Bernard Plossu traversant régulièrement le miroir des apparences pour saisir la beauté là où elle semble la moins susceptible d’apparaître de façon évidente, la moins consciente d’elle-même – et donc la plus sincèrement émouvante.
À la manière d’un monteur de cinéma qui dérusherait encore avec de la colle et des ciseaux, Plossu se dévoile ici en artisan de l’ombre et met tout à trac son univers à notre disposition : à nous de reconstituer le film, ou plutôt les films de ses nombreuses vies, qui sont devenues aussi un peu les nôtres, depuis le temps qu’elles y pénètrent par voie de publication.
Une vie de photo, d’amour et de mouvement, dont on découvre ici les coulisses, la face cachée et bricolée, les images inédites comme des éclats de lumière immaculés, la méthode. La nostalgie aussi. Un ouvrage a-t-il concentré plus de rencontres vécues et de choses vues que celui-là ? C’est bien d’une vie ouverte qu’il s’agit, celle d’un orpailleur du réel passée au tamis des années, et de ce livre qui une fois reposé procure ce sentiment intense et vertigineux d’avoir tenu du temps, tellement de temps, entre les mains.
Bernard, d’où est venue l’idée de publier cet Album de travail ?
Très simplement. Un jour, j’ai sorti l’album pour trouver la référence d’une photo que je voulais montrer à Juliette Gourlat, mon éditrice chez Marval-rueVisconti, et quand elle a vu cet objet, elle a eu un coup de cœur immédiat, en me disant que ça ferait un beau livre. Finalement, elle est parvenue à le publier. Bien sûr, c’est mon livre de
64

référence, un livre technique qui m’accompagne au quotidien, et je ne pensais pas du tout en faire un ouvrage poétique. C’est grâce à Juliette que cette idée a germé. Cet album, c’est son livre.
Donc l’ouvrage tel qu’il est publié est une reproduction in extenso de l’album original.
Oui, tel quel. Aucune maquette arrangée pour ce livre. Les seules photos ajoutées, c’est le triptyque de Françoise que nous avons souhaité mettre au début, en sa mémoire.
Un triple portrait magnifique, dans une lumière qui rappelle Une partie de campagne de Jean Renoir.
C’était le jour de notre première rencontre, un pique-nique à la campagne chez Jean Dieuzaide. Pendant que je faisais ces photos d’elle, Françoise était en train de faire des photos de moi ! On est tombés amoureux à la seconde où l’on s’est vus.
Cet album est-il unique où as-tu d’autres carnets tels que celui-là et qui t’aident dans ton travail ?
Il n’y en a qu’un. Par la suite, j’ai continué de classer mes photos mais sous une forme différente, en utilisant des photocopies de toutes les images tirées. Aussi pratique, mais tellement moins beau, moins magique.
L’ouvrage te montre au travail et il dit que ce travail est tout sauf celui d’un dilettante. On comprend la rigueur, la patience et la minutie qu’exige l’archivage d’une œuvre aussi vaste et prodigue que la tienne.
Quand tu penses aux heures de travail que ce livre représente, c’est énorme. Regrouper, découper, légender, numéroter… ça m’a passionné de le faire, et ça m’a aidé ensuite dans le choix des photos. Un gain de temps considérable. Et puis, c’est vrai que mes archives sont sans fin. Par exemple, on vient de me demander si j’avais des images du MontSaint-Michel, et à ma grande surprise, en fouillant un peu, j’en ai trouvé une trentaine, faites comme ça, juste pour moi, sans but ni commande, avec ce thème de la pluie qui m’est si cher – quelle aubaine le mauvais temps, ce jour-là !
As-tu redécouvert des images en préparant L’Album ?
Beaucoup. Mais c’est toujours le cas lorsque je me replonge dans les planches contact. Et le temps peut modifier le regard. Six mois ou six ans après, il arrive que les choix changent.
Que signifient les lettres et les nombres inscrits à la main sous chaque contact ?
La lettre, c’est le pays – F pour France, M pour Maroc, etc. Le premier nombre, l’année. Le deuxième, le numéro du film. Le troisième, la vue. C’est pratique, et d’une logique imparable. Finalement, le meilleur titre pour une photo, c’est celui-là. Autrefois, on cherchait de grandes phrases pour légender les photos dans les livres. Je trouve que ça a très mal vieilli. Une légende trop verbeuse est toujours une surcharge. À mes yeux, la meilleure légende demeure la référence technique, et rien de plus.
On dit qu’archiver permet d’oublier. Est-ce que ces deux sentiments sont liés pour toi ? Je précise que je n’entends pas ici l’oubli comme manière de se débarrasser d’une image, mais tout simplement d’être en paix avec elle. Donc, est-ce qu’on fait des livres pour trouver la paix avec ses images ? Pour qu’une fois élues, imprimées ou collées sur des pages, elles cessent de nous obséder ?
Je n’ai jamais pensé à l’archivage comme à un moyen d’être en paix avec les images. Pour moi, archiver est juste quelque chose de technique, de pratique, pas du tout une activité sentimentale ou intellectuelle.
Tu m’as dit un jour qu’il était aussi important d’apprendre à regarder ses photos sur les planches contact, à retenir les bonnes, que de les faire. Le bon photographe est-il aussi celui qui est capable d’avoir la meilleure vue d’ensemble de son travail, le meilleur système de classement, d’organisation ?
Oui, absolument. Le photographe est accompli quand il sait faire tout cela, et surtout choisir ses images sur les planches contact, comme un peintre sait choisir sa couleur. Il y a quatre temps : photographier, choisir les images les plus intéressantes, tirer en sachant ce que l’on veut –pour moi le gris, le contraire de Salgado ou de Sieff. Et, last but not least, le format, car c’est en trouvant le bon format que l’on comprend ce que l’on veut exprimer. Le format miniature est le seul qui parle du gigantisme du Jardin de poussière, par exemple. Et jamais de recadrage, car c’est au moment de la prise de vue que l’on cadre une fois pour toutes : discipline !
Le format du contact découpé n’est-il pas celui qui correspond le mieux à ta philosophie, à ta croyance dans le pouvoir de la modestie en photo ?
Ce format est d’abord et avant tout technique. Il ne découle pas d’une pensée esthétique. Mais
66
c’est vrai que j’aime les petits tirages. Je les classe en trois formats : la miniature, le petit format, et le tout petit format « timbre-poste », si minuscule qu’il en devient surréaliste.
Le passé est-il une dimension du temps qui t’intéresse ? Les notions de souvenir et de mémoire sont indissociables de l’art photographique, et pourtant je n’ai pas le sentiment que ta photographie soit obnubilée par le « ça a été ». Tu es un photographe de la vibration du présent et tes images célèbrent la pure présence des êtres, des objets, des paysages. En les regardant, on s’exclamerait « c’est ça ! » plutôt que « ça a été. » Si tu étais un écrivain, il y a fort à parier que tu conjuguerais tes phrases au présent. D’ailleurs, quand tu dis que tu as toujours « voulu foutre le camp », j’ai l’impression qu’il y a un lien avec cela : une urgence à quitter le passé, pour vite aller vivre au présent.
C’est le moment présent qui m’intéresse, pas le souvenir ou le « ça a été ». Je déteste les milliers de pages de salon de thé de Proust, y préférant et de loin la notion du temps qui était celle des Indiens d’Amérique ou des tribus nomades de par le monde. Chez ces peuples, très souvent, le temps est lié au déplacement. On est loin des madeleines bourgeoises ! Le monde des Indiens et des nomades est un paysage où seul le temps règne, le vrai. Alors oui, j’ai foutu le camp pour fuir Paris et les mondains du tout savoir – qui ne savent rien, que des mots, pas du vécu –, et pour voir ailleurs si j’y étais.
En regardant la page qui rassemble les portraits que tu as réalisés en 1975 au Niger, je me rends compte que tu as rarement photographié les gens d’aussi près.
Découvrir les visages et les mains des nomades au Niger, c’était pour moi comme de rencontrer enfin les Indiens d’Amérique du temps de Cochise et de Sitting Bull. Musiques et comportements semblables. Dans mon esprit, les Peuls Bororos sont des Apaches !
Plus tard, bien après le Sahel, j’ai réalisé des photographies de Naples qui ne sont que des gens, des gens et encore des gens dans les rues. Plus aucune ambiance métaphysique. Au fond, c’est le sujet qui nous oriente, nous dicte ce qu’on va faire, ou plutôt ce qu’on doit faire.
On découvre dans L’Album d’autres ensembles étonnants. Par exemple, cette série sur des images de films égyptiens photographiées dans les cinémas du Caire.
Ce qui est très amusant dans cette série, ce sont les sous-titres en français que l’on ne peut malheureusement pas lire dans L’Album à cause du format des images. Dans un film, on lit « à la croisée des destins, l’amour nous a jetés ». Dans un autre, un père dit à sa fille : « je t’interdis de voir ce danseur de rumba et de samba ». Qu’est-ce que c’est chouette ! Je garde un merveilleux souvenir de ces vieux films égyptiens à l’eau de rose, et de leurs images en noir et blanc somptueuses.
— L’ALBUM DE TRAVAIL, Bernard Plossu, éditions Marval-rueVisconti
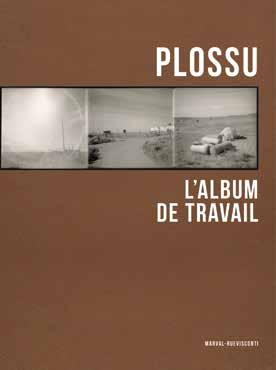
67
LA GRANDE BLEUE
Par Lucas Le Texier
MARC DESGRANDCHAMPS EXPOSE
DANS LE NOUVEL ESPACE DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE DIJON. DANS
L’INTERSTICE ENTRE FIGURÉ ET ABSTRAIT, SES SILHOUETTES BLEUTÉES
FONT ÉCHO À SA FASCINATION POUR LES ÉQUIDÉS, SON AMOUR DES PAYSAGES
MÉDITERRANÉENS, SES PASSIONS DE L’ARCHITECTURE GRECQUE AUX MODS.
Marc Desgrandchamps, casse-tête pour les conservateurs de ce monde. Depuis ses débuts au milieu des années 1980, le peintre et graveur la joue espiègle avec ses toiles anonymes. La nature a horreur du vide, les professionnels de l’institution muséale aussi. Féru des cultures, pop ou pas, les peintures du Savoyard s’imposent d’elles-mêmes, réactualisées par l’omniprésence de l’ultracontemporain, du téléphone portable aux smileys des tote bags. Première jambe de ces Silhouettes, des pastiches ou des inspis indirectes : Le Déjeuner sur l’herbe (Sans titre, 2012), mise à jour de Mannet et d’Alain Jacquet. La reprise de la Flagellation du Christ de Piero della Francesca (Sans titre, 2020), récente acquisition de la ville de Dijon, s’inspire de la construction du tableau originel tout en jouant avec les codes muséaux. Plus limpide, son amour pour la sous-culture britannique des Mods, amateurs de jazz moderne, de blues et de soul états-uniens au milieu du siècle donne naissance au dandy d’une peinture de 2012. Elle aussi acquise par la cité des Ducs.

Desgrandchamps défend dans ses toiles les hybridations et les associations. Favoris du peintre : les polyptyques, particulièrement par paires. Lui, adepte du faux raccord cinématographique, du collagemontage surréaliste et des combinaisons, crée des chimères : Le Centaure incertain (2022), moitié bas équidé-moitié bas humanoïde. Fasciné par les représentations d’étalons en bichromie de Susan Rothenberg, Marc Desgrandchamps fait la part belle à l’animal, figure plastique qu’il découpe et assemble ici et là. Une couleur domine toutes les Silhouettes, un bleu. Celui de la Méditerranée, couleur du Sud et des souvenirs qui vient à elle seule façonner ces faux raccords comme les têtes animales sur leurs pics dans Les Effigies (1995) : à son retour de l’ex-Yougoslavie où la guerre se réveillait au milieu des années 1990, le peintre fait l’analogie,
toujours par écho, aux têtes de cochon dans Sa Majesté des mouches de William Golding. Pourtant le bleu reste, ajoutant aux ruptures verticales des diptyques une résonance horizontale au niveau micro et transversale au niveau macro.
Reste l’amour du détail chez le peintre. La petite inscription dans le tableau des mods, « the young mod’s forgotten story ». La cocarde de Cible (2021).
68
La petite barque d’Un matin du temps de paix (2022). Si on s’approche apparaît la silhouette à la fenêtre de la flagellation de Desgrandchamps, fille du Covid-19 et marqueuse du présent. Petits indices et petites concordances d’un chemin de piste laissé par l’artiste hier, qu’il retrouve pensif et presque perplexe aujourd’hui. La preuve par la modestie que le spectateur a bien raison de chercher ses titres.
— SILHOUETTES, exposition jusqu’au 28 août au musée des Beaux-Arts de Dijon musees.dijon.fr

69
Le Centaure incertain, 2022, huile sur toile, diptyque 200 x 300 cm © Autorisation Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin © ADAGP, Paris, 2023
RÉVEILLEZ-NOUS
Par Benjamin Bottemer

70
Elmgreen & Dragset, All Dressed Up, 2022 © Autorisation des artistes / Adagp, Paris, 2023 © Photo : Elmar Vestner
AU CENTRE POMPIDOU-METZ, LE DUO ELMGREEN & DRAGSET NOUS INVITE À UN JEU DE PISTE SANS RÈGLE. UN PARCOURS OÙ L’ABSURDE BOULEVERSE NOTRE OBSESSION POUR UN MONDE FONCTIONNEL, LOGIQUE ET SEREIN.
Suite à leur rencontre au milieu des années 1990, Michael Elmgreen et Ingar Dragset, d’abord performeurs, commencent à contaminer l’espace public et les musées de leurs installations à l’humour grinçant, profondément politiques : une boutique Prada au milieu du désert texan, une station de métro au sein de la Fondation Bohen à New York, le centre d’art Ullens de Pékin réimaginé en foire d’art fictive… première exposition personnelle d’Elmgreen & Dragset au sein d’une institution française, « Bonne chance » a été développée, selon ses créateurs, « autour de la perception de la vie comme un jeu, un ensemble de jeux ou une sorte de réalité faisant suite au jeu ». Le duo cite comme référence la nouvelle « La Loterie à Babylone » de Borges, qui décrit un jeu-société où les règles, sans cesse changeantes, visent à maintenir les citoyens sous contrôle.

À travers une scénographie labyrinthique, on parcourt des environnements modifiés, entre rêve et cauchemar. L’aliénation et la solitude de la vie contemporaine transpirent de toutes ces structures familières (bureaux, aires de jeu, toilettes, salles d’attente, habitations…) où l’ordinaire est réinventé pour devenir extraordinaire.
VOIES SANS ISSUE
Où sont passés les employés de l’open space de Garden of Eden ? Qui viendra chercher le bébé au distributeur de billets de Modern Moses ? Qui sont les habitants de l’immeuble inspiré des Plattenbauten d’Allemagne de l’Est bâti dans le Forum ? Cette roue de la Fortune va-t-elle enfin s’arrêter de tourner, même si les candidats semblent avoir perdu patience ? L’absence marque profondément chaque installation, y compris celles où s’invitent de troublantes figures humaines.
Tous ces espaces, tous ces objets du monde moderne sont détournés : leur sens disparaît en même temps que leur fonction. Dans « Bonne chance », on est réduits à imaginer ce qui vient de se passer ou ce qui s’apprête à survenir. D’énigme en paradoxe, on se laisse porter, captivé, par cet univers surréaliste et loufoque qui arrache des sourires ; mais ce n’est pas pour autant que l’on met son cerveau en veille. « Tout le monde n’a pas besoin de comprendre l’œuvre, tout du moins pas de la même manière, mais il doit y avoir un moyen d’entrer dedans pour quiconque souhaite approfondir », indiquent les artistes. Quant à vouloir trouver une sortie… traditionnellement, le parcours d’un jeu, même sinueux, nous conduit toujours du point de départ au point d’arrivée. Un dénouement qu’il est vain d’espérer trouver au sein de cette succession d’impasses et de portes closes. Comme dans un rêve, aucune conclusion, juste le sentiment que ce labyrinthe bizarre n’était pas plus absurde que le monde dans lequel on évolue.
—ELMGREEN & DRAGSET, BONNE CHANCE
exposition jusqu’au 1er avril au Centre Pompidou-Metz, à Metz www.centrepompidou-metz.fr
71
PIPPA GARNER DURE À QUEER
DÉTOURNEMENTS EN RÈGLE
LE FRAC LORRAINE PRÊTE SES CIMAISES
À LA PLASTICIENNE AMÉRICAINE
PIPPA GARNER ET REVIENT SUR PLUS DE 50 ANS DE CRÉATION DÉBRIDÉE.
ENTRE BAGNOLES DÉTOURNÉES, OBJETS
ABSURDES ET PHOTOS DÉCALÉES,
RENCONTRE AVEC UN ESPRIT LIBRE
À LA VERVE INIMITABLE.
L’EFFET PIPPA
Pippa Garner n’est pas du genre à entrer dans une case. L’artiste américaine de 81 ans s’est taillé une destinée à rebrousse-poil, marquée par un anticonformisme joyeux, une savoureuse ironie et une créativité débridée. Depuis plus de 50 ans, son œuvre se joue des carambolages et des frictions entre les univers. Quand elle écrit Joy sur une poubelle, qu’elle se taille un crop top dans un costume ou qu’elle se tatoue un soutien-gorge, la plasticienne prend un malin plaisir à dézinguer les faux-semblants de l’Amérique des boomers et à en secouer les codes. À Metz, un ensemble de photographies, d’installations, de vidéos et d’objets nous balade au fil d’une carrière sans concessions, menée au contact de la scène californienne des années 1970 et 1980.
Bagnoles non binaires, parodies publicitaires, gadgets anticapitalistes ou vêtements androgynes, Garner débride le quotidien comme personne. Fascinée par l’American way of life, elle le revisite à la sauce douce-amère. Jusqu’à faire du détournement sa marque de fabrique. Sous son objectif, un palmier devient parapluie, un pare-chocs manteau de cheminée et le col d’une chemise se réinvente en guêtre. Exposée au FRAC, Heels on Wheels , photographie au croisement entre sexytude et sport de glisse, s’amuse de la rencontre improbable d’un stiletto, d’un bas résille et d’un patin à roulettes. Le sport et la mode, la liberté et la contrainte, le masculin et le féminin s’entrechoquent, jusqu’à trouver un (périlleux) terrain d’entente. À corps vaillant, rien d’impossible, nous souffle cette touche-à-tout, reine de la métamorphose.
HORS NORMES
Multiple, Pippa Garner l’est au moins autant que son œuvre. Designeuse automobile contrariée (elle a été formée au ArtCenter College of Design de Los Angeles), autrice de livres à succès, présentatrice d’inventions absurdes dans un talk-show, mais aussi artiste trans (née homme, Pippa Garner a procédé à une opération pour changer de sexe au cours des années 1980), elle n’a de cesse de bousculer normes et préjugés. Son rapport au monde est avant tout expérimental, qu’il s’agisse de modifier le châssis d’une voiture pour donner l’impression qu’elle roule à contresens ou d’expliquer sa transition :
« I did it for art », dit-elle publiquement. Imprégnée du matérialisme américain, Garner considère son corps comme une marchandise comme une autre, qui peut être embellie et reconfigurée. « J’aurais pu être belle, mais j’ai manqué d’argent », peut-on d’ailleurs lire sur l’un de ses T-shirts à slogan, dont une série est exposée au FRAC.
Badass androgyne, pionnière du « gender art », artiste conceptuelle féroce et facétieuse, outsider… Garner n’est pas en phase avec son temps, elle a décidément une longueur d’avance.
Par Mylène Mistre-Schaal
72
Future Man! (Leg-Suit) 1980/81, autorisation de l’artiste, STARSGallery et Tim Street-Porter
exposition jusqu’au 20 août au 49 Nord 6 Est Frac Lorraine, à Metz www.fraclorraine.org

73
RUÉE VERS L’OR
Par
Mylène Mistre-Schaal
LE MUSÉE COURBET DÉCORTIQUE
LE MYTHE DE L’ÂGE D’OR ET SES REPRÉSENTATIONS. SON DIRECTEUR, BENJAMIN FOUDRAL, NOUS ACCOMPAGNE SUR CES CONTINENTS RÊVÉS.
Paysages infinis et corps alanguis. Douceur des jours et principe d’harmonie. Au fil de toiles exceptionnelles, l’exposition estivale « L’âge d’or. Paradis, utopies et rêves de bonheur, de Brueghel à Signac » promène notre regard entre utopie et espoir d’une société meilleure.
Vous avez choisi Brueghel et Signac, à savoir le xvi e et le xix e siècle, comme jalons chronologiques pour cette exposition. Pourquoi cette période en particulier ?

C’est une histoire un peu personnelle, celle de ma rencontre avec Élinor Myara Kelif, la commissaire scientifique de l’exposition. Nous avons fait notre thèse d’histoire de l’art en même temps, dans le même laboratoire. Élinor travaillait sur l’imaginaire de l’âge d’or à la Renaissance et sa mise en image alors que je me consacrais à Léon Frédéric, un peintre belge du xix e siècle. Et nos sujets ont trouvé un point de convergence inattendu ! Nous nous sommes aperçus que le mythe de l’âge d’or, très connu à la Renaissance, est omniprésent au xix e. On peut même parler d’une véritable résurgence du thème à cette époque, à des fins utopistes, sociales et politiques notamment. Quelques années plus tard, « L’âge d’or. Paradis, utopies et rêves de bonheur » est là pour témoigner de la permanence du mythe et des questionnements sous-jacents qu’il véhicule.
Le thème de l’âge d’or rassemble des artistes issus d’écoles et de courants variés. Le réalisme de Courbet, bien sûr, le néo-impressionnisme de Signac, les Nabis, mais également des peintres plus académiques. Pouvez-vous nous en dire plus sur les déclinaisons picturales de ce motif ?
Ce qui est très intéressant avec ce mythe, c’est qu’il transcende les mouvements artistiques mais également les orientations idéologiques des artistes. Chacun va y trouver ce qu’il cherche. Ingres, par exemple, plus conservateur, va développer une vision très nostalgique de ce temps idéalisé. D’autres vont le critiquer et en proposer des versions plus satiriques. D’autres enfin, animés par une pensée plus sociale et utopiste, vont faire de cet âge d’or un avenir possible.
74
Jacopo Zucchi, L’Âge d’or, vers 1570 © Gabinetto Fotografico delle Gallerie degli Uffizi
À contempler les œuvres présentées, il semble que cette exposition évoque également le rapport que différentes générations de peintres ont pu tisser avec le paysage…
Le paysage y est effectivement fondamental et prend des formes très différentes en fonction des époques. À la Renaissance, le lieu de l’âge d’or ou locus amoenus s’appuie sur les récits d’Ovide ou Virgile. Les peintres dépeignent une nature généreuse, à la fois puissante et protectrice. C’est à cette époque que l’on constate l’éclosion de motifs très stéréotypés qui se diffusent de régions artistiques en régions artistiques.
Au xixe siècle, en revanche, les artistes incarnent pour beaucoup leur vision du mythe dans des environnements qu’ils connaissent parfaitement. Chez Courbet, ce sont les paysages franccomtois qu’il dépeint avec la force picturale qui le caractérise. Pour Signac, l’âge d’or est baigné par la lumière de Saint-Tropez tandis que Matisse lui donne les plages de Collioure pour décor.
Vous accueillez quelques prêts prestigieux et des œuvres d’une qualité exceptionnelle. Pouvez-vous nous donner un petit aperçu de quelques-uns des chefs-d’œuvre que l’on pourra voir à Ornans cet été ?
Nous avons effectivement eu plus de 30 partenaires nationaux et internationaux, dont, pour la première fois, la Galerie des Offices à Florence ! Elle nous fait le prêt exceptionnel d’une huile sur bois de Jacopo Zucchi (L’Âge d’or), connue pour être l’une des premières représentations de l’âge d’or à la Renaissance. C’est une œuvre rare,
fondamentale pour le sujet, qui fut commandée par la famille Médicis à des fins de propagande politique.
Je pense également à une œuvre qui m’est particulièrement chère, un triptyque de Léon Frédéric (L’Âge d’or, le matin, le midi, le soir) qui nous est prêté par le musée d’Orsay et présente un âge d’or ancré dans la ruralité.

En ces temps bousculés par la menace du dérèglement climatique, le thème de l’âge d’or, qui présente des rapports on ne peut plus apaisés entre l’homme et son environnement, prend un sens nouveau…
Ce choix est effectivement loin d’être anodin ! Nous avons la volonté de proposer des sujets d’exposition qui font sens pour le xixe siècle, mais qui résonnent également avec les questionnements de nos sociétés contemporaines. Un peu comme Gustave Courbet en son temps, qui s’est beaucoup interrogé sur la société de son époque. Le mythe de l’âge d’or questionne directement la notion de bonheur collectif et la manière dont nous faisons société. Qu’est-ce qu’une société idéale, finalement ? J’espère que nos visiteurs s’interrogeront au-devant de ces œuvres anciennes, pourtant très actuelles.
— L’ÂGE D’OR. PARADIS, UTOPIES ET RÊVES DE BONHEUR, DE BRUEGHEL À SIGNAC, exposition du 24 juin au 1er octobre au Musée Gustave Courbet www.musee-courbet.fr
75
Maurice Denis, Le Paradis © RMN-Grand Palais(musée d’Orsay) /Hervé Lewandowski
INTERSTICES MAGNÉTIQUES
CHRISTINA KUBISCH
COMME NOMBRE D’ENTREPRISES

ARTISTIQUES RÉALISÉES PAR DES FEMMES SAVANTES, CHRISTINA KUBISCH
FUT CONFINÉE À SA BLONDEUR ET À SA
BEAUTÉ, INVISIBILISÉE PAR UNE CULTURE
REPRODUCTRICE DE MÉDIOCRITÉ.
Musicienne et ingénieure berlinoise, Christina Kubisch défriche l’art depuis 1974, sublimant les clowneries Fluxus en jouant de la flûte avec des gants de boxe ( Emergency Solos ), composant des pièces abstraites ( Night Flights ), promenant les visiteurs hors les murs des whites cubes (Electrical Walks ). Elle fait aujourd’hui l’objet d’un culte sincère pour sa maîtrise pionnière de l’art sonore et de la musique electro.
L’Espace Multimédia Gantner propose d’explorer son travail autour des phénomènes électromagnétiques en quatre œuvres iconiques d’une quête ininterrompue pour rendre l’invisible visible, de 1981 à aujourd’hui :
En préambule, la présentation du titanesque projet Electrical Walks, déployé depuis 2003 dans plus de 75 villes du monde entier. De Köln à Besançon, en passant par Hong Kong, Lausanne ou Riga, armé d’un casque à induction, le public parcourt les rues à la recherche des pulsations des distributeurs automatiques ou du tempo des pantographes sur les caténaires des réseaux ferrés. Puisant dans le matériau prélevé dans la toile du système urbain et de ses équipements, Christina Kubisch rend tangible l’envers du décor. L’Espace Gantner propose une recension vidéo de différentes Electrical Walk , un
poste de bornes d’écoute d’ondes électromagnétiques classées par thématique : hurlements suraigus des néons et des enseignes lumineuses, brown noise des salles de serveurs de données, pulsations rythmiques des radars et des caméras de surveillance, nappes éthérées des réseaux de tram…
Dans la salle suivante, La Serra, composition de 12 canaux et autant de suspensoirs déversant ses câbles depuis le plafond. Acteur de l’œuvre, on déambule sous une tonnelle de cordons verts et jaunes, au gré des sons d’une nature imperturbable (cris d’oiseaux amplifiés, murmures d’eaux ruisselantes, stridulations de criquets, coassements de grenouilles) entrelacés avec la rumeur sourde des ondes électromagnétiques. L’interaction avec la composition est totale : s’éloigner d’un son, se rapprocher d’un autre, l’amplifier en plongeant la tête dans le réseau de fils suspendus. Le visiteur, investi, compose sa symphonie, décide de la durée et de la puissance. Grisant.
Remote Relations , l’allégorie hors du temps résonne aujourd’hui plus que jamais, aux prises avec le réel d’un futur incertain. Un large tuyau de cuivre sort du mur pour s’épanouir en une corolle de 16 branches reliées à des hydrophones, jusqu’aux pieds des visiteurs, évoquant Yggdrasil, le redoutable arbre-monde de la mythologie nordique. Enregistrés sur les îles du Gotland et de Fårö en 2014 et 2015, Christina Kubisch saisit les échos sous-marins d’une vie loin de tout, des pleurs de bébé sur une plage aux ondes électromagnétiques provenant d’une base militaire toute proche.
Enfin, cube Tesla à la main, on découvre Il respiro del mare. Dans ce travail précurseur de 1981, pour la première fois, le phénomène de l’induction est au cœur du concept d’une œuvre d’art. Deux câbles dessinent des résistances sur le mur, une structure rouge boucle la respiration de l’artiste, une bleue, le murmure des vagues s’écrasant sur une plage.
En lieu et place des cubes Tesla, l’œuvre se hacke avec l’aide du casque de La Serra : ainsi la régularité incantatoire de la respiration et du ressac se superposent dans l’intimité des écouteurs.
Par Luna Satie
76
L’exposition proposée par l’équipe de l’Espace Multimédia Gantner ouvre une infinité de questionnements. On ressort aussi fasciné par la multiplicité des signaux sonores, au-delà de nos capacités humaines d’écoute, qu’inquiet de leur omniprésence bourdonnante. Pour prolonger cette réflexion contemplative, ludique et dérangeante à la fois, plus d’informations à la médiathèque de l’Espace Gantner, sur le site de Christina Kubisch ou en regardant son intervention 50 years of trials and tribulations sur YouTube (sous-titres disponibles en multilingue). Le tout en attendant la prometteuse monographie de l’artiste à paraître cette année aux Presses du réel.

— CHRISTINA KUBISCH, INTERSTICES MAGNÉTIQUES, exposition jusqu’au 15 juillet à l’Espace Multimédia Gantner, à Belfort www.espacemultimediagantner.cg90.net
Du 10 juin au 13 juillet, le festival Bien Urbain propose l’Electric Walk dans les rues bisontines, à partir de la Maison de l’Architecture. bien-urbain.fr
77
Il respiro del mare, 2022 © Thor Egil Leirtrø
FAUX CONCOURS POUR VRAIE BIENNALE
LE RENDEZ-VOUS HAUT-MARNAIS DU
DESIGN GRAPHIQUE PASSE LE CAP DE LA TRENTAINE DE SON JOYEUX CONCOURS
INTERNATIONAL D’AFFICHES LORS DE SA QUATRIÈME BIENNALE INTERNATIONALE.
POPULAIRE, TRANSGRESSIF ET COLLECTIF, L’ART DE NOTRE TEMPS SI VISUEL PERPÉTUE ET INTERROGE SON HISTOIRE ET LES NORMES DE L’ÉPOQUE.
Il règne une atmosphère légère, au Signe. Pas forcément le genre de vocabulaire qu’on utiliserait pour parler d’une biennale dans et hors les murs. La nature propre au graphisme joue son rôle : à l’heure de la primauté de la vue dans nos sens, les engagements esthétiques et poétiques du trentième Concours international d’affiches nous bousculent, naturellement. La faute à ce concours qui n’en a jamais été vraiment un, mais surtout un prétexte pour créer un espace de rencontre et de dialogue entre créatrices et créateurs. Qui dit concours dit néanmoins sélection, et l’évènement organisé au Centre National du Graphisme depuis 2017 a bien dû départager près de 1700 affiches.
D’abord, l’évidence : Joseph Le Callennec. Iconiques, les créations du concepteur graphique du Mille Bornes dans l’expo As du crayon prouvent leur place dans l’inconscient collectif. Dessinateur

pour une vingtaine de jeux, de publicités et d’illustrations en tout genre, la biennale retrace l’histoire de ce breton absent des récits du graphisme de sa période. L’évidence à venir ensuite, grâce au Procès d’intention où fourmillent les expérimentations artistiques grâce à l’intelligence artificielle et les tentatives artistiques du medium algorithmique.
L’ambition transversale, la voici : interroger l’historiographie du graphisme. La titanesque « Parade » de Vanina Pinter déploie les créations de trente-neuf femmes graphistes, prolongement de la septaine « Variations épicènes » de 2020 à
Par Lucas Le Texier
78
Vue de l’exposition La Fabrique des caractères, Marc Domage, 2023
la Maison d’art Bernard Anthonioz. Traduction curative d’un manifeste de l’historienne Martha Scotford qui expose dans Messy History vs. Neat History l’invisibilisation des designers femmes et le façonnement normatif autour des designers masculins. L’accélération du monde décrite par Hartmut Rosa, corroborée par la sursollicitation de la vue, est déjouée dans les utopies à réflexion de la biennale. Les graphistes posent un temps de concentration, des paysages de Sarah Martinon aux corps des danseurs superposés d’Anette Lenz.
Le prolongement se fait par le biais de La Fabrique des caractères de l’Atelier Baudelaire. Étudier le « jouer » chez les enfants, grâce à un corpus de jouets issu de la grande distribution, met à nu la scission genrée des activités et habitus entre hommes et femmes. Des couleurs utilisées selon les jouets pour filles ou garçons aux vocabulaires inscrits sur les vêtements des jeunots, la mise en graphisme des déterminismes de genre et de leur origine font du médium affiche un outil d’éducation idéal.
Aux côtés du Concours international de l’affiche, la biennale accueille le 26e concours étudiant ainsi que la seconde édition du Prix unique du livre autour d’une sélection de 20 ouvrages français. Une curation décidément combinatoire, autant que la pratique du design graphique qui allie avec malice et finesse la légèreté de la forme, et l’épaisseur du fond.
— BIENNALE INTERNATIONALE

DE DESIGN GRAPHIQUE, biennale jusqu’au 21 octobre au Signe
– Centre National du Graphisme, à Chaumont www.centrenationaldugraphisme.fr/le-signe
79
Vue de l’exposition Procès d’intention, Marc Domage, 2023
 Abdelkader Benchamma, Lignes de rivage , 2023 © Steeve Constanty.
Abdelkader Benchamma, Lignes de rivage , 2023 © Steeve Constanty.
LE MYTHE DILUVIEN
Par Coralie Donas
À LA FONDATION FRANÇOIS SCHNEIDER.
Cette fois-ci, c’est le déluge qui s’abat à Wattwiller. La fondation d’art contemporain, dont les expositions explorent le thème de l’eau, accueille une carte blanche de l’artiste Abdelkader Benchamma. Le déluge présenté par l’artiste, à travers ses dessins, est doux, non vengeur, loin des représentations de l’Ancien Testament. « C’est très dur de trouver des images en dehors des représentations bibliques et de l’arche de Noé », note l’artiste. Habitué à constituer des fonds d’images dans lesquels il puise une partie de son inspiration, il est allé chercher, avec Virginie Jacquet qui a produit l’exposition, des mythes anciens autour du déferlement aquatique. Ainsi, dans la mythologie chinoise, le déluge est provoqué par l’effondrement des colonnes qui retiennent le ciel.
IN SITU
Dans la nef qui ouvre l’exposition, Abdelkader Benchamma a posé sa peinture sur un mur et sur des panneaux de placo, dressés dans la grande salle. Les panneaux, préparés sur place, ont été peints, découpés et entaillés au cutter par l’artiste, pour en casser la géométrie. Abdelkader Benchamma, qui a fait de la création in situ une de ses marques de fabrique, a passé deux semaines en résidence à la Fondation pour créer ses œuvres originales. Cette première salle fait référence aux traces géologiques que laisse l’eau sur les murs, et qu’elle inscrit dans les pierres.
« C’est un paysage mental qui évoque des restes de monticules, des histoires, des portes qui donneraient accès à d’autres mondes », évoque-t-il. Il dessine, puis ponce ses dessins pour en effacer certains traits, dont les déliés évoquent des arbres, des vagues ou convoquent un bestiaire fantastique de dragons et de phénix.
COMÈTES
Dans le deuxième espace de l’exposition, on change d’échelle pour découvrir une série de dessins à l’encre. Des petits formats (26 x 18 centimètres) réunis en une série, intitulée Kometenbuch en référence au Livre des Comètes, un ouvrage du xvi e siècle qui rassemble des illustrations sur l’origine des comètes. Menaçantes ou merveilleuses, elles nourrissent de nombreuses croyances que l’artiste relie aux théories scientifiques concernant l’apparition de l’eau sur terre, dont l’origine pourrait être extraterrestre. Ses dessins reprennent cette inquiétude et cet aspect miraculeux, dans des traits nerveux et minutieux. Il abandonne le noir et blanc, qu’il travaille depuis tant d’années, pour quelques éclats de couleurs. Ces dessins invitent à la lecture, tandis que l’installation de la nef interagit avec le lieu et son ambiance. Il a choisi d’exposer aussi en regard une série de cinq dessins et de cinq lithographies. Ces dernières, créées
pour l’exposition avec l’atelier Michael Woolworth à Paris, spécialisé en lithographie sur pierre, permettent à l’artiste d’explorer le mythe avec un motif qui se répète dans chaque lithographie, qu’il modifie à chaque épreuve, créant une histoire qui change au fil des tableaux. Dans les motifs de tornade et de pluie diluvienne apparaissent des visages, des oiseaux. « Il existe beaucoup d’histoires dans lesquelles l’eau vient autant du ciel que de la terre. »
Abdelkader Benchamma recrée son propre déluge, son propre mythe. « Le thème m’intéressait, car la question des croyances et des rituels autour de l’eau revient souvent dans la façon dont la création contemporaine aborde l’eau », explique Marie Terrieux, directrice de la Fondation et commissaire de l’exposition. La carte blanche fait plus écho aux croyances ancestrales, qu’à la crise climatique actuelle. Une idée qui se retrouve aussi dans l’installation vidéo qui clôt le parcours. Une planète qui tourne, des tentacules, une grotte infinie, l’espace, des vagues… Sur fond noir, les motifs blancs se détachent, bougent, sur une nappe sonore entêtante et subtile, et dans laquelle les interrogations de l’artiste, nourri de nombreuses références de science-fiction, ressortent : des objets sans matière définie apparaissent et disparaissent, à la manière d’ovnis, les matières vibrent. Juste avant la fin du parcours, l’exposition donne à voir des planches originales de la BD Random, publiée en 2014 aux éditions de l’Association, épuisée aujourd’hui. C’est la seule œuvre de l’exposition antérieure à cette année. « Nous terminons par une œuvre qui montre le début du travail de l’artiste », souligne Marie Terrieux. Et qui laisse au visiteur l’impression de sortir d’un monde aux contours flottants, peut-être encore à définir.
—
GÉOLOGIE DES DÉLUGES,
ABDELKADER
BENCHAMMA,
exposition jusqu’au 24 septembre à la Fondation François Schneider, à Wattwiller fondationfrancoisschneider.org
L’ARTISTE ABDELKADER BENCHAMMA DESSINE LE DÉLUGE
81
SPATIALITÉ VIBRATOIRE
LE MUSÉE WÜRTH REND HOMMAGE À LA GALERISTE DENISE RENÉ, QUI A EXPOSÉ
VASARELY DÈS 1944 ET IMPOSÉ CETTE
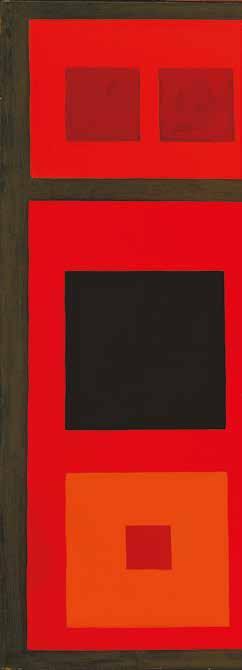
« NOUVELLE BEAUTÉ MOUVANTE ET ÉMOUVANTE », ET À L’ARTISTE ALLEMANDE
LORE BERT DONT LA MONUMENTALE
INSTALLATION, LES CORPS SOLIDES DE PLATON, INVESTIT LE REZ-DE-CHAUSSÉE.
Si la collection Würth compte nombre d’œuvres issues de l’abstraction géométrique, elles sont rarement montrées et, à Erstein, c’est une première avec la double exposition « Radical » et « Lore Bert ». Selon un dispositif aéré, « Radical » prend le visiteur dans un jeu de manipulation de l’espace par effets d’optique (Victor Vasarely) ; où la perspective génère des volumes fictifs (Josef Albers) ; et où l’affrontement de matériaux fins et mobiles (JesúsRafael Soto) ou d’aplats francs transcende le support. L’ambition est d’instituer, par l’invention plastique, un ordre dynamique qui fait bouger le visible. Une quête de la beauté évoluant au gré des déplacements avec une logique d’effraction du réel – le réel, c’est le corps du visiteur – ouvrant un espace ductile, protéiforme, trompeur quelquefois. Le geste artistique est le fruit d’une « morale anarchique » (Pontus Hultén).
Certains s’emparent d’autres matériaux pour mettre le regardeur en interaction ludique avec l’œuvre (les néons chez François Morellet ou Gun Gordillo). Yaacov Agam travaille sur l’épaisseur pour développer la troisième dimension et provoquer une tension cinétique. Et, tandis que les figures les plus connues sont représentées : Vasarely, Buren ou Sonia Delaunay-Terk, chez Aurelie Nemours, Richard Mortensen ou Auguste Herbin, un chromatisme vif, net et enlevé, sublime la représentation spatiale ; et chez Lothar Quinte ou Max Bill, les vibrations naissent de subtiles variations sur fond noir ou blanc.
Par Luc Maechel
82
De l’abstraction géométrique, « Lore Bert » préserve l’économie, la géométrie, la liberté. L’artiste trouve l’inspiration dans les motifs traditionnels et ancre ses œuvres dans Platon, Kant, Copernic. Attentive à la symbolique des couleurs, elle se permet quelques allusions figuratives (les flammes de l’incendie de la Fenice). Pour elle, le papier n’est pas le support, mais le matériau de ses œuvres. Un papier japonais fabriqué à partir de fibres de riz, qui, plié comme des fleurs, donne à la surface du tableau ce caractère vibratoire si particulier, à la fois touffu, duveteux et frémissant sous la lumière.
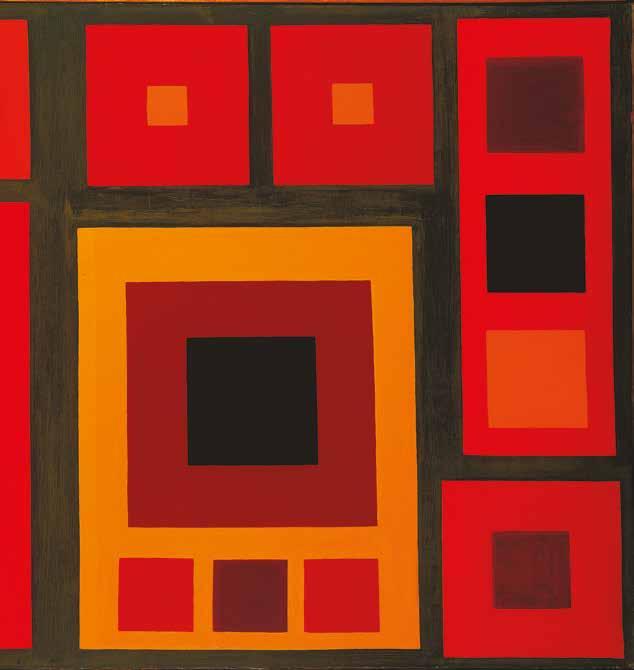
Ses pièces sont accrochées en orbite autour des Corps solides de Platon et se reflètent sur les cinq polyèdres associés aux éléments qui émergent d’une nappe buissonnante de papiers pliés immaculés. Le dialogue de l’ensemble évoque spatialement la giration copernicienne.
— RADICAL + LORE BERT, exposition jusqu’au 7 janvier 2024 au musée Würth, à Erstein www.musee-wurth.fr
83
Aurelie Nemours, Trois figures, 1952. Collection Würth, Inv. 2217 Photo : Philipp Schönborn, Munich © ADAGP, Paris, 2023
JULIEN CECCALDI
JULIEN CECCALDI, JEUNE ARTISTE

FRANCO-CANADIEN, EXPOSE LA DERNIÈRE
JOURNÉE DE MARIE-ANTOINETTE À
VERSAILLES, GRANDE TOILE CRÉÉE AU
ET POUR LE CONSORTIUM DE DIJON DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION
L’ALMANACH 23.
« La Dernière Journée de Marie-Antoinette à Versailles, c’est la chambre du roi où Marie-Antoinette s’est réfugiée », raconte Julien Ceccaldi à propos de son œuvre de 6 x 4 mètres, inspirée par les mangas et par la nuit du 6 octobre 1789, durant laquelle le peuple français vint chercher la reine au château de Versailles. « Ensuite, le peuple crie et demande à la voir, et elle se dit : “Dussé-je aller au supplice, j’y vais”. Elle se présente, et l’histoire raconte qu’elle a fait une révérence qui aurait ébloui le peuple, pourtant venu l’assassiner. Je l’ai faite en sept ou dix jours, je ne sais plus, tous les jours étaient les mêmes. Marie Antoinette est peinte sur la toile et le peuple à même le mur. C’est une toile très impressionnante avec un balcon en fer forgé intégré. Je ne savais pas que le balcon était si lourd parce que je l’ai commandé en ligne, il a brisé le pneu d’un camion. Le truc marrant, que j’ai réalisé
Par Martial Ratel ~ Photo : Vincent Arbelet
84
aujourd’hui, c’est qu’à la fin de l’exposition, la seule personne qui sera sauvée, ce sera la reine. Parce que la reine est peinte sur une toile qu’on peut enlever et empaqueter. Le peuple sera repeint à la fin. »
C’est une œuvre… royaliste ?
Je pense que non, mais si c’est interprété comme ça, je vais avoir du mal à le nier. [Rires]
Est-ce qu’elle a eu d’autres noms ?
J’avais envie d’un titre en français. Jusqu’à maintenant, tous mes titres étaient en anglais. Mais c’est la question : qui est-ce qu’on met en évidence ? Je pensais à la foule subjuguée par MarieAntoinette, mais le sujet, c’est la reine. C’était intéressant de dire que c’était la dernière journée qu’elle passe à Versailles, c’est un petit moment de gloire où elle séduit le peuple. Mais je voulais aussi rappeler que quelques heures après, on la forçait à quitter Versailles et elle n’y reviendrait plus jamais.
Est-ce que c’est parce que vous créez en France que vous vous intéressez à ce moment révolutionnaire ?
[ Rires ] Oui, désolé, ce n’est pas un hasard. Je trouvais que c’était marrant de revoir MarieAntoinette à travers le prisme du cinéma américain et d’un manga des années 1970. Dans le film de Sofia Coppola, elle fait cette scène de la révérence. Je trouvais que c’était drôle de refaire un thème presque trop commun, un peu surjoué. Et faire comme si je n’étais pas du tout français. Ouais, je crois que ça me faisait rire.
Il y a un vampire caché parmi le peuple. Oui. Dans la foule, j’ai caché des personnages de mes propres bandes dessinées. Celui qu’on remarque le plus, c’est une petite fille vampire, un peu noble. C’est le seul personnage qui ne regarde pas la reine. Elle a l’air de s’enfuir. C’est parce que c’est une jeune fille noble qui sent que le grabuge va arriver. Il est temps qu’elle se cache. Tous les autres regardent la reine éblouissante.
C’est une œuvre assez étonnante par rapport à l’ensemble de votre production, il n’y est pas question de genre ou de sexualité, en tout cas pas de manière explicite.
Oui, c’est vrai, j’ai fait une pause. [Rires] Là, je voulais me pencher sur Marie-Antoinette, sur ces questions de célébrité, sur ces moments à la Britney Spears. On idéalise quelqu’un, mais on aime en même temps la rabaisser ou la détruire. Ça parle de genre quand même, parce qu’il y a une lecture féministe contemporaine de Marie-Antoinette qui
s’est faite dans les années 1970. Mais oui, ce n’est pas très gay… enfin, c’est un peu gay, dans le sens où c’est Versailles : il y a l’allusion à une culture d’ornements et de maquillage, de cheveux bouclés, de perruques.
Il y a moins de malaise que d’habitude. Il est plus suggéré. Il y a des haches, mais il y a un truc beaucoup plus morbide, puisqu’il s’agit d’enlever la vie à la reine et à ses gardes. C’est vrai que c’est moins à propos d’un malaise personnel ou sentimental.
Pour cette grande pièce, qui vous a demandé pas mal de travail, il y a un côté un peu feignant que vous revendiquez ?
Oui, totalement. Il faut être honnête, c’est du travail. Je vais pas faire comme si c’était pas une corvée. Un petit peu. Peindre 10 jours d’affilée pendant 10 heures tous les jours, ouais, c’est pénible.
Votre univers est empreint de mangas. Il y a 10 ans, vous n’auriez pas été exposé au Consortium… Peut-être. Mon univers est fait de beaucoup de références aux mangas des années 1970 à 1990. Beaucoup ont été adaptés en dessin animé. Je suis franco-canadien, tous les étés, je visitais ma grandmère et je regardais ces dessins animés au Club Dorothée : Sailor Moon, Dragon Ball, et mes préférés étaient Lady Oscar et Laura ou la Passion du théâtre
Vous avez travaillé comme libraire et comme auteur de manga. Comment passe-t-on de la BD au monde de l’art contemporain ?
Mon frère aussi est artiste. C’est Nicolas Ceccaldi, il a fait une exposition au Consortium il y a cinq ans. Ça a beaucoup aidé, au début. Des gens de l’art contemporain étaient curieux de voir le « petit frère gay de Nicolas ». Ils se disaient : « Qu’estce qu’il fait ? » Après ma première expo collective d’art, avec Heji Shin, on m’a fait confiance. Il suffit d’une exposition pour qu’ensuite les gens se passent le mot et se disent : « Ah, c’est de l’art contemporain. » Tout d’un coup, on n’a plus à le prouver.
Vous-même, vous vous posez cette question ?
C’est de l’art, parce que c’est fait dans le contexte d’une galerie ou d’un musée. Je ne me pose pas la question plus loin que ça.
— L’ALMANACH 23, exposition collective jusqu’au 17 septembre au Consortium, à Dijon www.leconsortium.fr
85

© CEAAC 2023
HOP HOP HOP !
Par Valérie Bisson
RENCONTRE À BÂTONS ROMPUS
ENTRE LA NOUVELLE
DIRECTRICE DU CEAAC, ALICE MOTARD, ET L’ARTISTE-CURATRICE
MARIE-PIERRE BONNIOL.
Le Centre européen d’actions artistiques contemporaines accueille l’artiste pour une semaine de mini-résidence artistique et curatoriale. Hop, un format court imaginé pour soutenir la recherche autour du fil rouge de la pollinisation, de l’art partout, et de l’émergence de projets territoriaux exportables et durables.
Alice Motard : Le CEAAC est un lieu patrimonial exceptionnel, son programme de résidences existe depuis plus de 20 ans. J’ai eu envie de faire en sorte que la programmation artistique et culturelle et le programme de résidences ne fassent plus qu’un, que les deux s’imbriquent et vivent en harmonie. MariePierre Bonniol est la troisième à expérimenter ce format court autour d’un projet de recherche sur le livre. On a la chance d’avoir un appartement qui jouxte le centre d’art et l’équipe du CEAAC coordonne les rendez-vous. J’ai vraiment envie de faire découvrir ce territoire à des gens qui sont soit en poste dans des institutions ou occupés ailleurs, chercheurs, artistes, commissaires… Ce format de 2 à 5 jours permet souplesse et, pour l’avoir expérimenté moi-même, beaucoup d’émergences créatives.
Marie-Pierre Bonniol : Le format court crée de la densité, avec 4 à 5 rendez-vous par jour, on a vite une photographie précise de ce qu’on peut faire sur le territoire, il n’y a pas de perte de temps, l’accumulation permet de se mettre dans un état qui favorise l’intuition et le rapprochement. J’aime bien cette idée de pollinisation, de transporter des choses d’un rendez-vous à l’autre et d’être le lien entre des gens qui ne se côtoient pas forcément.
Alice Motard : Ce regard neutre est porteur aussi pour nous ; il y a des acteurs qu’on connait et d’autres qu’on ne connait pas. Le projet de MariePierre autour du livre va se faire en 2024, mais les résidences Hop sont sans contraintes réelles et ne sont pas vouées à la production même si de premières réalisations s’annoncent déjà.
Marie-Pierre Bonniol : En tant qu’artiste ou en tant que curatrice, je privilégie la recherche d’idées de productions qui soient en coopération avec des partenaires et qui permettent de faire circuler les œuvres. À mes yeux, l’effort de production doit s’inscrire dans une logique de résonance plus grande. Tout ce que je produis est pensé en termes de lieux et de déplacements, j’aime l’idée de rendre le travail « portatif ». Ce sont des logiques qui viennent de la musique. Il faut réfléchir à la durabilité, à la transportabilité et aussi au stockage. Alice Motard : Hangar à Barcelone, qui est une structure de production avec laquelle nous allons prochainement collaborer, mène toute une recherche sur la question du « stockage » (pas que physique). C’est essentiel de considérer ces questions de place, aujourd’hui. La nouvelle génération fait souffler un vent nouveau, le paysage se transforme depuis 3-4 ans. Je suis une curatrice institutionnelle et je suis assez à l’aise avec ça, mais on ne fonctionne pas de la même manière quand on est commissaire en chef du CAPC de Bordeaux ou directrice du CEAAC, mon désir de prendre la direction d’un centre d’art venait de l’envie de récupérer de la liberté mais, de fait, la gymnastique est plus intense. Ce qui m’importe est de rester au service des artistes, de mettre de l’artistique dans tous les champs, dans la communication et même dans l’administratif. Avec 90 % de financements publics, il faut cocher les cases du cahier des charges mais en termes d’évaluation on essaye d’augmenter les critères du qualitatif.
Marie-Pierre Bonniol : Hop a deux avantages : le format court qui autorise un emploi ailleurs et/ ou une vie de famille, et la rémunération d’une phase de travail qui arrive après l’intuition et avant la production. Cette résidence fait exister professionnellement le temps de mise en place et de pensée du projet. Ce sont tous ces petits actes qui changent le grand paysage.
— RÉSIDENCES HOP, La publication digitale de Marie-Pierre Bonniol –Studio Walter sur son temps de résidence curatoriale Hop est à retrouver sur ceaac.org
87
BOUCHE BÉE POUR OMAR BA
Par Mylène Mistre-Schaal
CET ÉTÉ, LA KUNSTHALLE MULHOUSE
PRÉSENTE UNE SÉLECTION D’ŒUVRES RÉCENTES D’OMAR BA, ÉTOILE
MONTANTE DE L’ART CONTEMPORAIN
DONT ON A PU ADMIRER LE TRAVAIL
Avec Destins communs, le peintre sénégalais dévoile son talent pour subvertir le réel tout en restant très en phase avec l’actualité. Plongée dans l’univers fabuleux d’un artiste prolifique.
RÊVES LUCIDES
Étrangement réelles, les œuvres d’Omar Ba ressemblent un peu à ces rêves où nos perceptions se mélangent. À même la toile, l’homme, l’animal et le végétal s’hybrident dans une jungle capiteuse de motifs. D’un pinceau que l’on devine leste, le peintre voyage d’une approche presque pointilliste à des recherches plus graphiques où fines nervures, poils ou cercles microscopiques déploient leurs textures. L’encre de Chine, la gouache, le crayon, le BIC ou le Tipp-Ex s’y superposent comme autant de strates, donnant à la composition une étonnante densité.

« Chez Omar Ba, urgence et abondance vont de pair. Il pose ses pensées sur la toile de manière très intuitive, dans une forme d’effusion. Quand sa pensée jaillit, il peut enchaîner des séries de toiles, de manière presque compulsive, jusqu’à l’épuisement parfois », raconte Sandrine Wymann, directrice de la Kunsthalle et commissaire de l’exposition.
Une profusion de tous les instants que Destins communs approche à sa manière. « Deux salles sont consacrées au “laboratoire mental” de l’artiste et aux revues, cartes postales, photocopies, photographies et autres pièces de monnaie qu’il collecte en guise d’inspiration », précise la commissaire. Un retour aux sources du processus créatif qui donne toute sa singularité à l’exposition mulhousienne.
AGITATIONS TROPICALES
Onirique et politique, le travail d’Omar Ba puise sa force dans un cocktail inédit de symboles et de formes où masques ancestraux, francs CFA, drapeaux, plumes, pelages et végétation luxuriante se mélangent dans une effusion de couleurs. « Omar peut passer des heures dans son atelier à lire la presse. C’est un véritable témoin du monde contemporain, un observateur qui se passionne pour les nouveaux équilibres géopolitiques, mais également pour l’histoire de l’Afrique et de son Sénégal natal. » D’une œuvre à l’autre, il
ne cesse d’explorer les problématiques du pouvoir, de la violence politique et de la domination pour mieux nous raconter les cicatrices mémorielles d’une Afrique marquée par le colonialisme et ses conséquences. Il y a quelque chose d’intensément beau et de cruel à la fois, comme quand il brosse le portrait d’ironiques superhéros aux allures de dictateurs ou l’envol contrarié d’un splendide homme-papillon.
Pour Sandrine Wymann, « dans tout ce qu’il raconte, Omar Ba cherche la place de l’Afrique et indirectement sa place à lui, en tant qu’Africain ». Ses œuvres sont autant d’allégories d’une Afrique tout en complexité où réalité et fiction, vie contemporaine et culture ancestrale s’entrechoquent.
— DESTINS COMMUNS – OMAR BA, exposition jusqu’au 29 octobre
à La Kunsthalle Mulhouse, à Mulhouse www.kunsthallemulhouse.com
À BRUXELLES, GENÈVE OU NEW YORK.
88
Omar Ba, Superman and The Constitution III. Autorisation Templon, Paris - Brussels - New York © photo : Isabelle Arthuis
i ns - i t u
Tills, Raphaël Lecoquierre

Surfaces délicatement marbrées, nuages dilués, sfumato contemporain… Le travail de Raphaël Lecoquierre appelle l’apesanteur. Avec « Tills », le plasticien s’invente alchimiste et transforme d’anciennes photos de famille en une singulière matière première. Dissoutes par oxydation, ces images du passé deviennent une substance colorée aux étonnants reflets. Les souvenirs devenus pigments nourrissent une approche sensible, aux confins de la métaphysique. (M.M.S.)
Jusqu’au 10 septembre
Au Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain, à Luxembourg ville www.casino-luxembourg.lu
in situ
90
© Raphaël Lecoquierre, documentation Nūbēs, 2022
Tina Gillen – Flying Mercury
Il y a un petit quelque chose de Hopper, dans la mélancolie silencieuse des paysages de Tina Gillen. Quelque chose de mystérieux et de contemplatif, dans ses aplats denses mais dépouillés. Sous son pinceau, les perspectives se fondent dans la couleur pour mieux explorer la relation entre mondes intérieurs et panoramas sauvages. À la Konschthal, la peintre luxembourgeoise propose un dialogue entre nouvelles productions et œuvres plus anciennes, au fil d’une trentaine de pièces. (M.M.S.)

Jusqu’au 12 novembre
À la Konschthal Esch, à Esch-sur-Alzette
www.konschthal.lu
in situ
Dune, 2022 © Photo : Tina Gillen - Autorisation de l’artiste et Nosbaum Reding, Luxembourg/Bruxelles
91
Du graffiti vers l’abstraction –RESO

Abstractions, calligraphie et lignes implacables qui empruntent un petit quelque chose au constructivisme : RESO est à l’intersection entre rationalisme géométrique et impro typographique. Depuis ses débuts dans les années 1980, le graffeur allemand s’est frotté au métro new-yorkais et aux murs de nombreuses capitales européennes. Passé à la peinture sur toile, il propose désormais une écriture singulière, qui relève de l’autoportrait et de la quête émotionnelle. (M.M.S.)
Du 10 juin au 24 septembre À l’Arsenal, à Metz www.citemusicale-metz.fr
in situ Ain't no smoke
© RESO – Patrick Jungfleisch
92
Passé, présent, futurs : le Verre dans tous ses éclats

La Région Grand Est fait « d’un verre deux coups » et explore deux facettes de ce médium, entre cristal et expérimentations contemporaines. Un premier parcours revient sur l’épopée verrière du Grand Est au fil des siècles et présente quelques beaux spécimens historiques. À ses côtés, une sélection de créations récentes, curatée par le designer Jean-Baptiste Sibertin-Blanc, révèle les métamorphoses d’un verre qui se prête à tous les imaginaires. (M.M.S.)
Du 19 juin au 8 septembre Au siège de la Région Grand Est, à Strasbourg www.grandest.fr
in situ
93
Les Infondus : Jouons © Nicolette Humbert
Charles Fréger. Souvenir d’Alsace
C’est une silhouette, une ombre chinoise presque. La pureté de ses contours lui donne une aura intemporelle. Pourtant, il s’agit bien d’une femme revêtant la coiffe alsacienne traditionnelle. Depuis toujours, le photographe Charles Fréger s’intéresse aux vêtements en tant que territoires ambivalents, porteurs de traditions et de rituels. Au Musée alsacien, mises en scène photographiques, céramiques ou encore broderies au point de croix interrogent l’iconographie pittoresque de l’Alsace, pour mieux en explorer les constructions identitaires. (M.M.S)

Jusqu’au 1er avril 2024
Au Musée alsacien, à Strasbourg
www.musees.strasbourg.eu
in situ
94
Charles Fréger, Les Alsaciennes, réalisé par la faïencerie de Lunéville-Saint-Clément, 2019 © Photo : M. Bertola, Musées de Strasbourg
Still Motion –Claire Lindner
Depuis quelques années, la céramique bénéficie d’un sacré retour de hype Claire Lindner fait partie des artistes qui dépoussièrent le genre avec talent. Familièrement étranges, ses sculptures organiques nous évoquent tantôt l’envol poudré d’une aile de papillon, la forme hybride d’une colonie de champignons ou la chorégraphie sous-marine des anémones de mer. Le grès, sableux et velouté, se pare de vifs dégradés de couleurs. Au musée Théodore Deck, Lindner présente le travail mené lors de sa résidence à l’Institut européen des arts céramiques et fait un clin d’œil à l’œuvre foisonnante du céramiste guebwillerois. (M.M.S.)

Jusqu’au 3 septembre
Au musée Théodore Deck, à Guebwiller
www.ieac-expo.com
in situ
Bloom n°1 © Claire Lindner
95
Matthieu Husser, Détournement, déplacement ou mutation ?
Lettres qui jouent les trompe-l’œil, pictogrammes inspirés, logos tridimensionnels ou vestiges contemporains… Les œuvres de Matthieu Husser traquent les mutations de l’espace urbain. Ses installations, volontiers sculpturales, cartographient la ville et ses vestiges. Quand il colle le « f » de Facebook sur le mur d’une chapelle, c’est pour mieux questionner la sacralisation grandissante des réseaux sociaux. Quand il donne de nouvelles dimensions au logo d’une entreprise disparue, c’est pour nous rendre plus attentifs aux indices mémoriels que l’urbanisation laisse derrière elle. (M.M.S.)
Du 8 juillet au 1er octobre à l’Espace d’Art Contemporain André Malraux, à Colmar www.colmar.fr/espace-malraux

in situ
96
Patrimoine industriel, 2010 © Matthieu Husser
Regards sur les collections –Aux frontières des avant-gardes
En avant-garde ! Destination le xxe siècle et ses précurseurs au musée des Beaux-Arts de Mulhouse. Expérimentations cubistes, détours fauvistes ou inspirations pointillistes, le musée propose un sémillant autoportrait de ses collections, dans toute sa variété. Un parcours à la pointe en compagnie d’une trentaine d’artistes tels qu’Héran Chaban (et ses voiliers cubistes), Armand Ingenbleek (et ses nus vibrants) ou Georgette Agutte (et sa Belle Italienne). (M.M.S.)

Jusqu’au
Au musée des Beaux-Arts de Mulhouse
www.beaux-arts.musees-mulhouse.fr
in situ
Héran Chaban, Voiliers à Martigues © Giannelli, MBA Mulhouse, dépôt de l’État
3 septembre
97
Le temps s’enfuit sans disparaître
La Filature remonte le temps de la jeune création avec une exposition collective rassemblant neuf talents contemporains (dont quelques-uns des lauréats du Prix Filature de la Biennale de la jeune création contemporaine de Mulhouse). Parmi les artistes présentés, Gaëtane Verbruggen capte la mélancolie poudrée des lieux oubliés, Cassandre Fournet transforme les mauvaises herbes en poésie urbaine et Jo Kolb dissèque la cruauté de l’enfance en dessin. Un contre-la-montre graphique hautement rafraîchissant. (M.M.S.) Jusqu’au 9 juillet

in situ
À La Filature, à Mulhouse www.lafilature.org
98
Sans titre © Gaëtane Verbruggen
Ottilia
En mode « Guérillères », un groupe de femmes se fond dans la beauté exubérante de la forêt tropicale. Au creux des grottes, dans le lit des rivières ou dans les vestiges des infrastructures industrielles et coloniales, elles renversent le patriarcat et le langage qui l’assoit. Au Crac Alsace, l’artiste portoricaine Beatriz Santiago Muñoz propose une expérience audiovisuelle peu conventionnelle inspirée des textes de l’autrice féministe Monique Wittig. Mêlant mythologies personnelles, empowerment, rituels guerriers et sons post-punk, ses vidéos sont portées par un souffle épique inédit. (M.M.S.)

Jusqu’au 17 septembre
Au Crac Alsace, à Altkirch www.cracalsace.com.
in situ
Image extraite d’Œnanthe, Beatriz Santiago Muñoz, 2023, installation film, 16 mm transféré en vidéo, 4K, son stéréo
99
Paul-Élie Dubois. Itinéraire(s) d’un peintre-voyageur
Une jeune femme tout de blanc vêtue. Sur son corps, les reflets blonds du soleil. Autour d’elle, palmiers, dattiers et autres fleurs sauvages offrent leurs reliefs. Datée de 1927, Au jardin du rêve dit la fascination d’un peintre pour l’Orient et ses lumières. Montagnes éclaboussées de soleil, campements berbères, scènes de la vie quotidienne dans le sud de l’Algérie ou dans les contreforts de la Tunisie : Paul-Élie Dubois n’a cessé d’arpenter le monde. Au fil de 200 œuvres exceptionnelles, le musée du Château des ducs de Wurtemberg nous fait voyager en couleur sur les traces du peintre franc-comtois. (M.M.S.)

Jusqu’au 29 octobre
Au musée du Château des ducs de Wurtemberg, à Montbéliard www.montbeliard.fr
in situ
100
Au jardin du rêve, 1927 © Jack Varlet
La Grande Mademoiselle.
Marie-Lucie Cornillot, une vie de musées
Qu’est-ce qu’une vie de musées ? Pour Marie-Lucie Cornillot, c’est de la passion et une belle dose de persévérance, un travail acharné et ce qu’il faut d’ambition. Entre 1946 et 1972, celle que l’on a surnommée la Grande Mademoiselle a piloté avec brio le musée classé de Besançon. Pionnière, figure centrale de la vie culturelle et patrimoniale de la ville, modernisatrice visionnaire, elle a su imprimer sa marque et faire briller les collections bisontines. À grand renfort d’archives et de photographies d’époque, les musées de Besançon reviennent sur le parcours d’une femme qui ne se laissait pas marcher sur les pieds. (M.M.S.)

Jusqu’au 7 janvier
Aux musées de Besançon (musée des Beaux-Arts et d’Archéologie et musée du Temps), à Besançon www.mbaa.besancon.fr
Anonyme, Marie-Lucie Cornillot et Christiane Marandet devant le portrait de Georges Besson par Pierre Bonnard © Besançon, doc. MBAA
in situ 101
FEUILLE DE ROUTES

102
Par Nicolas Comment
ÉTAPE 2 : MURAT
POUR NOVO, NICOLAS COMMENT S’EST RENDU EN AUVERGNE
POUR UN ULTIME HOMMAGE
J’étais en train de consulter les horaires de la SNCF, quand Philippe Schweyer m’appela samedi dernier, à point nommé. Philippe me téléphonait pour me suggérer de rédiger un texte en hommage à JeanLouis Murat dans les pages de Novo. Je lui répondis simplement que je venais de prendre la décision de descendre à Clermont pour me rendre à ses funérailles, qui devaient avoir lieu mardi, à Orcival.
Nous avions, il y a un ou deux ans déjà, tenté de consacrer un long papier à Murat, dans le cadre de mes Chroniques du temps qui passe. Nous souhaitions parler de l’artiste dans son atelier, du songwriter à sa table, mais – hors promotion – l’entourage du chanteur resta sourd à notre demande. Murat fut-il seulement informé de notre proposition ? Deux ans et demi plus tard nous attendions toujours la réponse.
Il était trop tard désormais... Mais la perte était sèche, le vide si béant, que nous ne pouvions laisser partir Murat, sans un dernier adieu. Plutôt qu’un article nécrologique, nous convînmes donc que je lui consacrerai ma prochaine feuille de routes. Pérégrin plutôt que pélerin, je prendrai dès le lendemain matin la route d’Auvergne en pariant sur le fait que la photographie m’aiderait à saluer l’Aède. (1)
« L’Aède »… C’est ainsi que Bayon nomma Murat en prenant discrètement la parole à la fin des obsèques. L’écrivain avoua d’abord qu’il aurait préféré, en ce triste jour, observer « un long silence » plutôt qu’avoir à prononcer un discours. Le « frère de lait » de Murat ne croyait pas si bien dire. Bruno Bayon était comme bâillonné par l’acoustique de la basilique : l’écho de la nef d’Orcival réverbéré par son micro brouillait ses dires. Depuis le banc où j’étais placé, son discours, très digne mais inaudible, ne me parvenait que par bribes, lambeaux et bandelettes... Je tendais l’oreille : le nom d’« Isis » fut prononcé… Bayon parlait de l’Égypte et de la Cité des morts. Il évoquait la Muratie – sise entre Tuilière et Sanadoire, la comparant à un mouroir, une nécropole.
Dans l’atmosphère contrite de l’enterrement, le brouhaha créé par les enceintes blanches de l’église m’arrivait d’autres mots, d’autres poèmes. Bayon citait Nerval mais je lisais sur ses lèvres ce vers de Paul Fort : « Dieu s’ouvrit-il jamais une voie aussi pure ? » (2). Puis une seconde, d’Aragon, commençant par le même incipit : « Dieu le fracas que fait un poète qu’on tue. » (3)
 (1) Poète antique chantant l’épopée sur sa lyre
(2) Paul Fort, L’enterrement de Verlaine
(1) Poète antique chantant l’épopée sur sa lyre
(2) Paul Fort, L’enterrement de Verlaine
103
(3) Louis Aragon, Un jour, un jour
« Murat ! C’est l’âme d’un cinéma
Et sur son cheval de bois
Un seul soldat le croit »

J.-L. Murat, Murat (1982)

104
Dans ce nuage cotonneux et mal sonore, tandis que le curé reprenait la parole pour réciter le Notre Père, j’entendais la voix essoufflée de Godard se remémorant la mort de Truffaut : « François nous protégeait. Et comme Romy, comme Langlois, il en est mort. C’est pour cela qu’ils l’ont tué [...] La télévision, les journalistes... Ils l’ont tué pour pouvoir l’enterrer avec de jolies phrases. »

Face aux cierges installés en rang d’oignon autour de la « Lady d’Orcival », j’ai pensé : tel Marat, Murat n’est-il pas mort assassiné dans le grand bain médiatique ? Lui qui avait – dès la fin des années 1990 –malignement conçu l’idée « de ne passer à la télé que pour apparaître au zapping... » et cherché à créer l’esclandre pour vendre en se vantant de « cracher sur Gainsbourg la veille pour pouvoir le traiter de génie le lendemain » ne s’était-il tout simplement pas trop exposé sur l’agora ?


Bayon avait raison de convoquer la vallée des Rois, mais la présence du corps dans le sarcophage n’y changeait rien. L’âme de Murat semblait absente. Elle errait dans les paysages alentours. Ainsi qu’il l’affirma luimême, toute l’œuvre de Jean-Louis Murat est une « errance ». Une dérive « psychogéographique » et son art de la chanson, un art de « situation ». Avec Debord, Murat ne partageait-il pas autant son dégoût du Spectacle que son goût pour l’art De la guerre (Clausewitz) ?
Pourtant si l’inspirateur de Murat fut un grand cavalier – « Au combat c’était un César, mais hors de là, presque une femme », écrivit à son propos Napoléon – Jean-Louis Murat fut aussi l’étendard d’un lieu-dit : Muratle-Quaire. Village depuis lequel l’artiste tira son nom de plume et son œuvre sa source.
Je m’y suis donc rendu pour y « observer le silence ». Son silence.

105
« Je me souviens de Murat aux portes de Naples » J.-L. Murat, Je me souviens (2018)
« Par mon âme et mon sang


Col de la croix Morand

Je te garderai »
J.-L. Murat, Col de la Croix-Morand (1991)
La Roche Tuilière vue depuis la D80
« Je pense à l’inconvénient d’être né quelque part Entre Tuilière et Sanadoire »
J.-L. Murat, Tuilière et Sanadoire (1993)
L’avant-veille, je m’étais d’abord arrêté à Clermont-Ferrand, près de la vaste place de Jaude où s’étaient réunis une poignée de fans sous un chapeau de paille et la statue de Vercingétorix. Clermont-Ferrand, où, au 7 de la rue Jean-l’Olagne, Jean-Louis Bergheaud, Christophe Dupouy et Denis Clavaizolle conçurent à l’extrême fin des années 1980 l’album Cheyenne Autumn et sauvèrent de ce fait leurs peaux d’Indiens arvernes « […] avec Marie, un revox, un 4 pistes K7, une TR808, une TR707, un minimoog et un DX7, guitare et basse dans un ampli pourri, des sons naturels qu’on sculptait à notre façon avec un sampleur Akai […] » (Denis Clavaizolle). C’est dans ce rez-de-chaussée sur cour « au décor terne (lumière chiche, rideaux de filet), canapé, pouf and co verts (?), salon replié, minichambre d’étudiant-studio » (Bayon) que Murat posa en train de faire la vaisselle pour illustrer un article paru dans Libération le 15 février 1988 dans lequel la plume de Bayon exprimait pour la toute première fois son intérêt pour cette langue de « déjà vu-verlainien » pourtant « à nulle autre pareille »
Quelques années plus tard, en 1993, je poussais la Lancia Y10 de ma mère sur la route du Col de la Croix Morand, toutes fenêtres ouvertes sur la brume une cassette du Manteau du pluie enfoncée dans l’autoradio. Je n’imaginais pas alors que, 30 ans plus tard, tandis que je m’engagerais dans la travée centrale de la basilique d’Orcival pour me recueillir devant le cercueil de Murat, c’est cette sublime chanson Col de la Croix-Morand qui s’élèverait sous la voûte romane : « O je meurs mais je sais / Que tous les éperviers / Sur mon âme / veilleront... »
Le 23 décembre de la même année, j’étais allé voir Murat au Transbordeur de Lyon, pour l’un de ses tout premiers concerts. Un verre étant donné en son honneur après le spectacle, j’entrepris de le saluer. Une fois n’est pas coutume, personne ne me barra la route. Dans cette salle où j’avais un soir, grâce aux largesses de Thierry Frémaux, eu la joie de converser avec John Cale, je m’approchais timidement de Murat. J’avais 20 ans, et lui 40. L’abordant facilement, la discussion s’engagea et je lui avouai peu à peu qu’encore étudiant aux Beaux-Arts, j’écrivais moi-même des chansons. J’enregistrais à l’époque des mini-albums guitare-voix sur un magnéto-cassette une seule piste, si bien que chaque cassette étant unique, j’imaginais lui envoyer une bande enregistrée tout spécialement pour lui. Mais tout à coup Murat se rabroua et me suggéra de plutôt lui donner ma guitare. Me demandant sa marque, il se ravisa en me disant que c’était « de la merde » et m’enjoignit plutôt à la casser. Entrant soudainement dans un accès de rage, l’Auvergnat m’expliqua qu’à mon âge, il avait été contraint de faire « des casses » pour réunir le matos de son premier album. Il vivait encore « au Smic » et déconseillait à quiconque de faire œuvre de chansonnier dans « ce pays pourri ». Pour lui, la chanson française, déjà, était une branche morte de ce qu’il nommera plus tard « l’arbre de la négativité ». Je comprends aujourd’hui seulement qu’il pensait sincèrement en être le dernier martyr. « Cruel envers lui-même et beaucoup envers les autres », comme précisa Bayon à son enterrement, peut-être cherchait-il seulement à nous protéger ? Toujours est-il que jamais plus je n’osai m’approcher du « beau dégoût » dont parle Yannick Haenel à son propos lorsque je le recroisai une ou deux fois par la suite.

107
Lac de Guéry
« La faux lancée
Nous coupe les jarrets
Plus de chants
Plus de lait
Pauvre Lady »
J.-L. Murat, Lady of Orcival (2009)
« Les enfants forment une ronde
Les monos sont jolies
Allez suer belles têtes blondes
Aux Thermes de Choussy

Allez soigner à l’arsenic
Vos souffles affaiblis
L’air est si doux dans la bruyère
Au Mont Sans-Souci »
J.-L. Murat, Au Mont sans souci (1999)
La veille de son enterrement à Orcival, le libraire d’anciens de la Bourboule me confia qu’il avait vu Murat entrer dans sa boutique quelques jours avant son décès. En traversant le pont sur la Dordogne qui prend sa source un peu plus haut, sur le Sancy, le poète d’Orcival avait observé un rare cincle plongeur. La présence du petit passereau (Cinclus cinclus), capable d’évoluer sous la surface comme une loutre, étant pour lui gage de la qualité des eaux, Murat poursuivit sereinement sa marche sur le quai Jeanne-d’Arc jusqu’au café de la Poste où il avait pour habitude de prendre son café. Quelques jours avant, il avait joué à Tulle et terminé son concert par une version décharnée de sa chanson Taormina : « La mort est dégueulasse. » Le soir même, sur la terrasse de l’hôtel Notre Dame qui fait face à la basilique d’Orcival, je rencontrai par hasard le tout premier carré de fans de Murat : Amparo, Barbara, Alexia, Virginie… Celles qui partout suivirent Murat sur la route durant plusieurs dizaines d’années – toujours debout au premier rang, même quand la fosse était à moitié vide – s’étaient en effet ici donné rendez-vous. La nuit fut longue de leurs récits et dans leurs yeux brilla comme jamais l’étoile du Berger, accrochée au dessus du clocher de l’austère basilique.
« Ma femme Joconde
Mon unique au monde
Dordogne
Fureur muette
Au cœur de mon être
Dordogne »
J.-L. Murat, Dordogne (1991)

108
La Dordogne de nuit, à La Bourboule
Au petit matin, sur la petite place pentue d’Orcival, une sono avait été installée. Tandis que les croque-morts veillaient sur le corbillard gris métallisé, en attendant la sortie de l’église du cercueil, le morceau de Murat « Les Hérons » planait au dessus du village : « Que dans les ronces vers la Sagne / Où se retirent les hérons / En larmes bleues / D’un bleu final / Savent mourir / Les compagnons ».

Puis la longue plainte de Jennifer Charles raisonna dans la vallée. « Bang bang bang / You shot my heart... »
Le « French Lynx » geignait : « Mais qu’auriez-vous fait sans moi mes petits chats ? »
Son lied s’entendait-il jusqu’aux rives du lac de Guery ?
« Qu’auriez-vous fait sans moi mes petits chats ? Obéi... Comme des cadavres ! »
Oui, sur la place vêtus de noir, c’était bien nous les « petits chats » ; mais le cadavre c’était lui. Qui pour nous protéger désormais ? Je levai les yeux vers la girouette pour me rassurer : point de héron mais un vol d’hirondelles dont les piaillements acides était couvert par la voix du chantre plaintif. Un Boeing passa, laissant une trainée blanche dans le ciel désespérément bleu, puis le cercueil de chêne clair de Murat s’éleva enfin Sous le soleil de Satan. Alors, alors seulement la voix d’or des monts Dore se tue, sous un tonnerre d’applaudissements.
La silhouette sombre de Gaspard Bergheaud dans son manteau de pluie se reflétait sur la vitre du fourgon qui brillait de tout son gris de héron sur la placette ensoleillée. Justine sa sœur, son demi-frère et puis ses nièces, dont l’une boitait, s’arc-boutant sur une béquille, complétaient le cortège. En voyant « de mes seuls yeux tranquilles » Gaspard courir derrière le corbillard qui démarrait, je songeai tout à coup à Kaspar Hauser, l’enfant sauvage chanté par Verlaine… (4) À ces deux mots – « Cheval, cheval ! » et à la seule phrase que ce probable fils de Prince su jamais prononcer de toute sa vie de gueux : « Cavalier veux comme père était ».
Comme Kaspar, comme Gaspard, je me sentis tout à coup « orphelin » du commandant en chef des Chevau-légers, Grand Lièvre et premier Rossignol de la France.
Sur le bitume la béquille de la petite fille du poète faisait un bruit de socques « clic, clac – et plus sourds, dans l’herbe humide – floc, floc » comme dans un livre de Bernanos. (5)
Au bout de la D27, où Jean-Louis tant de fois mouilla son maillot, le fourgon Fiat tourna au virage, puis disparut dans la bruyère. En contrebas, à La Bourboule, un film projeté sur l’écran nu du Ciné Vox, dans un « éclat mauve délétère », cassa.
(4) Paul Verlaine, La chanson de Gaspard Hauser
(5) Georges Bernanos, Sous le soleil de Satan
« […] Les souvenirs d’un palais
L’art d’écrire d’un écuyer
Au Ciné Vox Comme on regarde Comme on voyage jusqu’au glacier Quel jeune enfant en promenade Qui ne peut feindre Se séparer »
J.-L. Murat, Ciné Vox (2018))

109
Basilique Notre-Dame d’Orcival
REMBRANDT, C’EST UN VIN NATURE.
CHARLES BRAND
La préoccupation du beau et la sensibilité à la qualité des choses créent le geste attentif et l’art de vivre. Charles Brand porte cette générosité alsacienne. Il porte aussi un pull violet Mise Au Green. Droit debout au milieu d’un marasme entre photos souvenirs et linge jeté là. La cafetière italienne à portée de main, il aime offrir. Et ces choses passent par la bouche. La table est bien servie. Son savoir est direct, en totale symbiose avec la nature. Il a quarante ans d’expérience en tant que vigneron.
Il dit être tombé dans le vin quand il était petit. L’important est l’émotion et en témoigne sa vision artisanale. Il compare Rembrandt à un vin nature. Il a vu les plus beaux au musée de l’Ermitage. Il aime aussi la première période de Picasso.
Charles Brand est resté marié 25 ans avec la fille du menuisier du village voisin, a quatre enfants et est parapentiste. Ses enfants semblent être la plus belle partie de sa vie. Ils sont tous restés dans la boisson, deux dans le vin, et les deux autres dans la bière.
Il a des rapports difficiles avec sa mère, mais s’en occupe malgré tout. Son père, très important dans son histoire, était un Malgré-nous à 18 ans, un Alsacien incorporé de force dans la Wehrmacht durant la Seconde Guerre mondiale, traumatisé. « À cette époque, les enfants n’existaient pas, c’est la génération sacrifiée par l’État français », dit-il. Le seul objectif était de rester vivant.
Toutes les revendications sont passées par la religion ; il fallait bien transcender les choses. Les cauchemars du père ont laissé des traces. Qu’il dit retrouver chez les déportés juifs.

Il nous raconte – sous le manteau – quelques horreurs de la guerre. Comme les conteurs mélancoliques alsaciens, qui constituent notre humour.
La religion est devenue son éthique de vie, « aimez-vous-les-uns-les-autres » et « tu-ne-tueraspoint » sont ses mantras. Ils consolent et donnent
110
Par Stéphanie-Lucie Mathern ~ Photos : Benoit Linder
des repères dans un monde où la religion a été remplacée par l’ordre, pour finir par la dictature. Sa carrière est corporatiste, il aura toujours la volonté de rassembler. Le vin a une valeur matérielle et spirituelle. Il cite Monseigneur Doré, évêque de Strasbourg, qui disait que « c’est grâce au vin qu’au fil du repas, nos convives deviennent nos amis ».
La dispersion dans le grand virtuel nous fait perdre le sens du sacré. Les vignerons ont conscience des générations et des goûts qui changent. Le vin est un produit très contemporain. La seule norme est que tout le monde est différent et qu’il faut du temps pour changer les mentalités. Notre façon de manger a beaucoup évolué ; autant que les techniques et les changements climatiques. Il pense que la nature trouvera les réponses aux différents problèmes. « En musique, comme dans la nature, ce qui est beau jaillit comme l’éclair pour disparaître aussitôt devant la tentative de le fixer », nous dit Adorno.

Belle citation pour celui qui aurait aimé être chanteur d’opéra.
Nous évoquons notre double culture, germanique et latine, fossilisée dans nos comportements. La région est fertile. Nos vins sont blancs. Le blanc, c’est la pureté, l’ouverture. Le vin permet d’assumer les odeurs. On enregistre un goût et
on le lie à quelque chose de positif. Sa madeleine de Proust est l’odeur de la confiture de coing. Les émotions sont en éveil. En ouvrant une bouteille de vin, il s’esclaffe : « Ça sent la fourrure de lièvre ! Plus personne ne connaît ce goût ! Ça sent l’automne. »
Il a relié ce vin à la poésie d’Apollinaire. « Ça me parle beaucoup », dit-il. Il est persuadé que ce qu’il éprouve, l’autre l’éprouve aussi. La vie est belle. « La nature me manquera », conclut-il.
— La nourriture du meilleur restaurant n’est jamais aussi bonne que la moindre pomme de terre chez soi, où on peut la manger assis, debout, salement. —
111
Elsa Triolet, Bonsoir, Thérèse
UNE HISTOIRE DE VIEILLE FEMME

3 juin 1974. Voilà, on y est, j’ai 49 ans… ce chiffre pourri qui annonce le 50, et qui n’est pas encore vraiment la fin du 40. J’ai tellement mal vécu ce passage du 4, je me disais que je franchissais cette étape où tout redescend… l’énergie, les projets et même les organes. J’avais raison, mais pas tout à fait, le passage du 5 est encore plus effrayant. Maintenant, non seulement je ne vais plus pouvoir arrêter la longue descente… la peau qui pendouille et les rides profondes, mais mes recherches sur les sites de rencontres vont s’avérer être de la véritable archéologie. Je passe officiellement dans la catégorie dinosaure. Je
souffle de désespoir, comment expliquer que ce temps qui court comme une vipère qui s’échappe, me rend malade. Je n’ai pas envie de vieillir, je n’ai pas envie de me comparer à des acteurs et actrices qui quand j’étais enfant me semblaient vieux, et finalement étaient bien plus jeunes que moi aujourd’hui. Me dire que je vais bientôt devenir une « vieille femelle » comme me l’a si joliment dit une amie au téléphone… une vielle femelle, qui ne va plus être capable de se reproduire, qui va porter des chaussures confortables et ne plus prendre soin d’elle. Qu’est-ce qui pourrait me faire accepter que tout ça est mieux désormais…
i’m alive, i’m ready (ça fait rien). Crayon sur papier, 50 x 60 cm
112
Par Myriam Mechita
— Ah, mais non c’est super, moi je reviendrais pas à mes 20 ans…
— Ouais, moi aussi je suis bien mieux aujourd’hui.
Pas moi… Je me baisse pour me sécher les pieds au sortir de la douche, je me coince le dos, je marche sans rien faire de spécial et j’ai le tendon d’Achille en vrac, je suis allergique comme jamais au pollen au printemps, je chope une pneumonie en hiver… Bon, j’arrête là la liste…
Et quand j’ai mes amis au téléphone, on passe d’abord la première demi-heure à parler de tous nos problèmes de santé… et ensuite de ce qui nous arrive dans nos vies de vieux quinqua… l’horreur. Je me disais à 20 ans qu’à 30 ça irait mieux, financièrement surtout, et que je serais enfin apaisée, je me projetais dans un bonheur serein où tout serait plus simple…
Les 40 sont arrivés et j’ai décalé un peu, pensant que ça trainait à arriver… me voilà à 49, et je suis toujours dans les mêmes incertitudes, tout peut s’arrêter demain, et là, le miroir devient non pas terrible à affronter, mais grossissant sur les mauvaises décisions qu’on prend sans y réfléchir. C’est ça, au fur et à mesure que le temps passe, chaque minidécision a fait dévier le bateau, de quelques degrés. On pense que c’est pas grave, mais ça l’est. Une fois que tu te retrouves dans une autre direction, tu ne remets plus les pieds sur les territoires perdus… Les espoirs ont filé, comme un rouge à lèvres dans les rides d’une bouche mal dessinée. Je regarde souvent les vieilles femmes que je croise, en me jaugeant pour savoir si je ressemble à ce que je vois, j’avoue que je le fais aussi avec des jeunes femmes, mais là, c’est perdu d’avance. Je me jauge, je m’évalue, et parfois je constate que je ne suis pas aussi perdue que ça… et ça me rassure, quelques minutes.
— Mais, tu sais, c’est dans la tête tout ça… tu fais tellement jeune.
Non, ce n’est pas dans la tête, dans dix ans je serai ménopausée, moche, vieille et fatiguée… je le sais. Une vieille artiste, ça ne fait pas rêver, pas du tout… il faut que je me dépêche de trouver les solutions et surtout la quiétude qui me fera passer tous ces caps sans penser que chaque année de plus est un calvaire qui s’annonce. Et comment je ferais seule dans mon atelier, à ne plus pouvoir me baisser, ni déplacer une caisse ou même porter ces foutues sculptures qui me brisent en deux ? Comment je ferai pour me déplacer et voyager, tout le monde va m’oublier et je vais finir seule dans mon atelier en bordel, avec 50 chats, en pleurant toutes les larmes de mon corps.
Je sais, je suis un peu drama queen, et j’ai toujours préféré penser au pire pour que quand les choses arrivent elles soient finalement bien plus douces… Bon, ça marche pas à chaque fois. Je me dis que peutêtre je perdrais la boule et j’oublierais tout… On est pas malheureux quand on oublie sa vie, on oublie ses peines. Je ne veux juste pas oublier mon fils. Jamais. Je veux me souvenir que de lui, si je dois me souvenir que d’une chose. Ce sera lui. Je penserai à
quand il était dans l’atelier, allongé sur les mousses de transport à regarder des séries qui le faisaient rire pendant que je dessinais. Je veux entendre ce rire chaque jour. Je veux me souvenir quand je me réveillais et qu’il était allongé à mes côtés, venu dans la nuit alors qu’il n’en avait pas le droit… même si je lui disais :
— Minou, c’est mieux que tu dormes dans ton lit.
Alors que je pensais le contraire.
Quand on est une femme, une mère, à part vous faire culpabiliser sur tout, on ne vous aide pas… Alors moi, je veux me souvenir de tout ce qu’on a fait alors que c’était interdit, le laisser à la maison en mentant à l’école.
— Oui, il est pas bien ce matin, il a de la fièvre, il viendra demain. Alors que c’était pas vrai, je voulais juste rester avec lui, en me disant « bientôt, ce sera fini ». Et c’est déjà fini. Un jour, il m’appellera une fois par semaine, ou même par mois, et j’aurai mon cœur de vieille qui tremblera en découvrant son nom sur mon téléphone.
Je suis drama queen, ne l’oubliez pas…
Un jour dans le bus, le 96 pour être précise, j’ai senti une main qui s’est glissée dans la mienne, j’ai cru au départ a une main d’enfant, et quand je me suis retournée, j’ai été étonné de voir une vieille femme, toute petite, et qui me souriait.
— Excusez-moi madame, vous pensez que je suis dans le bon bus ? Je crois que je suis perdue.
— Alors on est deux, je suis aussi un peu perdue…
Nous souriions.
— Où allez-vous ?
— Je rentre chez moi.
— Et c’est où chez vous ?
— Près de la boulangerie…
J’ai su à cette minute que cette dame était vraiment perdue et surement malade de quelque maladie qui fait tout oublier. Je lui ai proposé de descendre du bus et de voir comment rentrer chez elle. Elle parlait, parlait, parlait et comme elle décrivait son quartier, à des détails, je suis arrivée à créer des cercles, et nous avons marché main dans la main. Elle reconnaissait des coins de rue, parfois on est revenu sur nos pas. Elle riait comme une enfant, et cette main que j’avais dans la mienne avait perdu des années au fur et à mesure. Je pensais qu’un jour, je serais perdue comme elle. Après deux heures à nous déplacer dans le Marais, à regarder parfois quelques vitrines et à décrire des choses comme si nous nous connaissions depuis longtemps.
— Oh, c’est joli ça…
— Ah oui, vous avez du goût…
— Oui, j’étais modiste quand j’étais jeune, j’adorais porter des chapeaux…
Et nous parlions de la mode, du temps qui passe… J’avais l’impression de faire des bonds dans le temps. Elle riait comme une enfant. Devant une boulangerie, sa boulangerie, son visage a changé, et elle est redevenue triste et fermée… Sa gardienne, sur le trottoir, s’est mise à hurler au loin. Visiblement, son inquiétude était à son paroxysme, la cherchant depuis des heures, son fils parti dans Paris, et sa belle-fille à la police pour déclarer sa disparition… Tout était bien qui finissait bien. Je me suis baissée pour la prendre dans mes bras, et elle m’a glissé dans l’oreille :
— Vivez !
J’ai donné mon numéro de téléphone à la gardienne au cas où…
Quelques semaines plus tard, j’ai reçu un sms dont le numéro m’était inconnu. Son fils : « Madame, merci encore pour ces heures que vous avez passées avec ma mère afin de l’aider. Sa maladie d’Alzheimer devient une vraie plaie. Elle oublie tout, et se perd en permanence. Nous veillons, mais cela devient difficile. Merci, sincèrement. Et ma mère qui oublie tout et ne nous reconnait plus que rarement, parle de vous tous les jours en souriant. Merci. » Alors, vivons, pour que cette beauté qui se fane n’ait pas le temps de se rendre compte qu’elle est éternelle finalement.
113
REGARD N° 19
Il dit je ne t’écrirai plus Elle dit je ne reviendrai pas Il restera
Une pensée comme une rose Une rose insensée Piquée
Dans un baiser mauve

114
Par Nathalie Bach ~ Photo : Mar Castañedo et Nathalie Bach par Manuel Kenneyrha


FEMME-VIE
Par Emmanuel Abela ~
JACHÈRE. PORTRAIT EN MOUVEMENT DE CHLOÉ MONS, INITIALEMENT PUBLIÉ CHEZ
MÉDIAPOP EST RÉÉDITÉ EN LIVRE DE POCHE.
L’ÉVÉNEMENT MÉRITE DE S’Y REPLONGER.
À la fin de l’année 1997, les nuits sont courtes. Le désœuvrement guette, et ce ne sont pas les clips, au milieu de la nuit, qui peuvent réconcilier avec quoi que ce soit. Et pourtant là, au milieu du marasme ambiant, une chanson fait surface. Serait-ce la plus belle chanson française jamais entendue ?
Pas loin. « La Nuit je mens » d’Alain Bashung est une fulgurance. Si troublante dans ce qu’elle nous indique comme destination : l’absolu.
Derrière une fenêtre, un corps se meut ; il emplit l’espace à la manière d’une figure baroque, sublime avec ses carnations amples et soyeuses : Chloé Mons.
En 2019, dix ans après la mort d’Alain, l’actrice et chanteuse nous livre un journal de deuil intimiste. Qui dit la disparition. L’abandon. L’acceptation.
Avec Jachère, portrait en mouvement, elle prolonge le geste profond, comme une invitation. Sous la forme de notes éparses, mais organisées de manière spontanée, elle nous relate comment elle renoue avec la sensualité. Que l’instant vécu soit furtif – quelques heures, une nuit, une semaine – ou sur la durée, chaque homme rencontré est l’objet d’une aventure intégrale – sans début, sans déroulement, sans fin, ou les trois à la fois, dans l’ordre et le désordre.
Un tout, une éternité.
Chloé s’abandonne au fantasme sans retenue, avec générosité, « transportée » et en amoureuse éperdue.
Au bout, une tendresse infinie.
On se prend à l’aimer – comme on l’aimait sans se l’avouer dans ce clip initial –, parce que son corps embrasse les mots, les enveloppe avant de les libérer en pleine lumière.

En cela, Chloé est entière. Elle est femme, Elle est feu, Elle est joie. Elle jouit, Elle est vie.
— JACHÈRE.
PORTRAIT EN MOUVEMENT, Chloé Mons, Médiapop éd., Livre de Poche
Photo : Delphine Kreuter
116


LE PALÉOPHONE DU COLONEL VAS-Y, FONTAINE !
Par Bruno Lagabbe
COUP D’ENVOI
Bon… Justo est bien meilleur footballeur que chanteur. Pour pouvoir me contrarier et argumenter à contresens, il vous faudra vous faire une idée par vous-même (les idées toutes faites étant aujourd’hui fabriquées en Chine dans des matériaux peu fiables, il est préférable de vous replier sur des idées toutes faites plus anciennes qui étaient quand même de bien meilleure qualité. Tout le monde vous le dira, même les Chinois). Aussi, je vous confie en bas de page l’adresse du blog où vous pourrez entendre ce 45 tours.
Canonnier de l’équipe de France pour la Coupe du monde 1958 (canonnier, c’est une image, une analogie militaire pour mettre de la poudre dans
les yeux du public qui en redemande.) Recordman du nombre de buts inscrits dans une seule édition de Coupe du monde, Just Fontaine est également buteur de l’équipe de Reims. Il pose ici à domicile sur la pelouse d’Auguste-Delaune en tenue rouge et blanc, en bon garçon, le maillot dans le short, boutonné au dernier stade. Gominé et rasé de frais, il tient d’une drôle de façon un drôle de micro qui a des allures de rasoir électrique ! (Je ne dirai rien sur Gil Bernard qui l’accompagne sur la photo, ce n’est pas dans mes habitudes de me moquer.)
PROLONGATIONS
Ici, nous faisons un bond de 30 ans dans le temps, je me souviens de la première fois que l’ami Julien m’a emmené dans ce stade voir une deuxième mi-temps gratos. D’abord, le folklore des vigiles traquant les supporters qui apportent leur boisson favorite dans des bouteilles de soda aux étiquettes assorties pour faire passer le vin rouge et le pastis. Puis, soudainement, on hausse le niveau culturel : on chante du Wagner dans les gradins ! Mais à la buvette, on boit du péteux dans des Blidas (ces petits verres à thé de fabrication locale destinés au marché algérien détournés en flûtes à champagne pour nous autres, plus solides et surtout plus stables). On suit le match un peu aussi. Soudain, c’est le but !! Bam ! Le ballon est au fond des filets, pendant trois secondes, j’attends… j’attends quoi ? Ben, le ralenti comme à la télé. J’éclate de rire tout seul ! Ha, ha ! Y a pas de ralenti ! Quel con je fais…* Voilà, le rédacteur en chef me presse, alors je rends l’antenne. À vous, Cognacq-Jay !
*à la fin des années 1980, y a pas encore d’écrans géants dans les stades.
— VAS-Y, FONTAINE, Just Fontaine (1933–2023) et Gil Bernard, orchestre sous la direction de Daniel White, 45 tours, durée prolongée, série Standard, disques Véga (la valeur par la qualité) lepaleophone.blogspot.com

118


WARHAUS
HORS CHAMPS
Par JC Polien
Malgré l’expérience et l’âge mûr, il est encore des artistes qui vous intimident quelque peu. Ce fut le cas avec Maarten Devoldere. Le fait d’être un grand fan du groupe Balthazar peut en partie l’expliquer…
Le festival GéNéRiQ de Besançon m’avait envoyé, le soir du 18 février 2017, dans la petite salle aux 99 places du Scénacle. D’emblée, les circonstances n’avaient pas joué en ma faveur : la salle était bondée, trop faiblement éclairée, et l’attachée de presse du groupe m’avait annoncé que ce dernier me consacrait en tout et pour tout une dizaine de minutes seulement. Après quelques clichés réalisés sous une lumière ambiante franchement dégueulasse, j’avais alors entraîné le trio au pas de course vers le Café du Jura, près de la Gare d’Eau. Connaissant les gérants de l’établissement, je pensais faire les choses « à la cool », et je n’avais pas jugé utile de faire des repérages en amont de l’entrevue. Bien mal m’en avait pris : ce samedi, bouche bée devant la porte close, le bistrot était fermé ! J’étais liquéfié. Il me restait deux minutes au chronomètre ! C’est alors que l’épicier de la place me tira du pétrin en acceptant que, sous les néons de sa supérette, j’expédie trois ou quatre images, l’adrénaline en ébullition. Pourquoi, à cet instant, j’ai pensé aux néons du chef opérateur Bruno Nuytten dans la station-service du film Tchao Pantin ? Aucune idée et, après coup, pas vraiment de rapport… J’ai coincé les garçons entre les bouteilles de sirop, l’eau pétillante et la purée de tomates, et cette lumière blanche du moment m’a sauvé la mise. Ce qui m’amuse aujourd’hui, c’est qu’à deux doigts de la noyade, j’avais affecté un complet détachement, une sorte de flegme à la british et, tout naturellement, le groupe avait pris mon improvisation pour un procédé savamment calculé et dont j’étais forcément coutumier…

120


I.
JAILLISSEMENT
Plus loin, une rupture, un silence, le piano reprend comme une vague, souligné par une basse dont il surprend le chatoiement.
Une guitare espagnole, la voix susurrante. Le garçon reçoit la caresse.
La beauté de la mélodie l’emplit intérieurement, Quelque chose de nouveau.
La petite voisine, avec ses beaux cheveux bruns très courts, acceptera-t-elle un rendez-vous ? Chaque soir, de longs tours à vélo dans le quartier. Sourire à la dérobée, échange bref, il espère tant la revoir.
Se penche vers l’avant, Geste lent & gracieux, Yeux clos au firmament,
Discontinu, vibrant, Pose sa main sur les cieux,
L’abîme est grand. L’instant joyeux.
II.
C’est l’histoire d’un garçon de 13 ans. À la maison, tout n’est que vice et infortune. La musique n’existe pas. Pourquoi se refuserait-elle à lui ?
Un disque vinyle 33T : sur la photo de couverture, la figure androgyne l’attire. Avec excitation, il pénètre en territoire inconnu. La fascination est là. Irrésistible force de subversion. Une impulsion qu’il partage avec un sentiment de culpabilité. Le disque, il le conserve à l’abri des regards, comme un secret qu’il lui faut dissimuler.
De titre en titre, la main sur la tête de lecture. Chaos et brisure, quelques notes de piano : la voix se détache, comme une fulgurance. « You – are not a victim / You – just SCREAAAM with boredom / You – are not evicting time. I had so many dreams / I had so many breakthroughs. » Le garçon ne saisit pas le sens, mais l’admet d’instinct : la chanson parle de lui !
Il se laisse glisser sur les effets suraigus de la guitare électrique. Tout en écoutant le disque, il observe le visage anguleux sur la pochette et parcourt du doigt les lignes du corps qui se refusait jusqu’alors à son regard.
Pulsion inavouée, rock’n’roll.
Dès lors, il le pressent : quelque chose de charnel s’offre à lui. L’aventure est sienne. Sensation irrésolue, quête de jouissance absolue, la vibration parcourt son corps tout entier. La vie est là.
III.
Un tableau de Mathieu Wernert, l’ami-peintre.

Le geste est sûr, il enserre la matière autant qu’il la libère. Avril 2020, signe des temps, la tentation de l’effacement est là. Mais les couleurs finissent toujours par l’emporter : e n pleine lumière ou dissimulées à l’arrière – comme autant de traces du passé –, elles se révèlent dans leur plénitude. Agissent en tourbillonnant et, dans un mouvement ascendant, tutoient le ciel.
Volupté et jaillissement.
Mathieu Wernert expose à la Galerie Chamagne-Hardy jusqu’au 3 juillet, à Paris
PLASTIC SOUL #7
122
Par Emmanuel Abela ~ Peinture : Mathieu Wernert


SCOTT WALKER, CHRONIQUE D’UNE OBSESSION

Par François Gorin — Le Boulon
Scott Walker n’a pas toujours fait l’unanimité, mais cette influence majeure de David Bowie – auprès duquel il a été notamment le passeur de l’œuvre de Brel –, a su générer de fortes sympathies continentales ces dernières années. Face à la complexité orchestrale de sa pop, peut-être la meilleure porte d’entrée nous estelle livrée là, sous la forme de ce bel ouvrage de François Gorin : sans chercher à tout dévoiler, le célèbre journaliste nous donne quelques clés de lecture personnelles de ce poète décidément singulier. On s’attache autant à son récit très impliqué qu’à chacune des possibilités qu’il nous offre de nous approprier une entreprise musicale unique et essentielle. (E.A.)
MASSIF

D’Alain
Giorgetti — Alma Éditeur
Après avoir abattu les sales types qui imposaient leur loi sur la vallée vosgienne où, épris d’une femme du coin, il pensait avoir trouvé une sorte de refuge où vivre, aimer et peindre, le narrateur tente de comprendre comment les événements se sont enchaînés.
« Ce qui m’intéresse aujourd’hui, c’est de rendre compte de ce fond silencieux gisant derrière les choses. Celles que j’ai vécues comme celles que j’ai rêvées. Traduire en images ce bruit blanc, tapi dans le moindre de nos silences, et qui pousse, qui grandit, accumule de la matière noire en faisant s’éloigner l’une de l’autre les galaxies. » L’auteur de ce court roman aussi beau et sombre que peut l’être la montagne décrit avec une précision folle les sentiments et les émotions qui traversent son personnage, « jouet de l’histoire des autres » mais aussi de ses propres pulsions. (N.Q.)
LES CHEVAUX
 De Vincent Vanoli — L’Association
De Vincent Vanoli — L’Association
Au cœur d’un paysage désolé erre un cheval. Il s’abreuve, hume l’air et ne tarde pas à croiser des créatures hybrides qui se lancent à sa poursuite, bientôt rejointes par un personnage aux airs de Mary Poppins. Dès les premières pages de ce récit muet, Vincent Vanoli (dernièrement Tartlepy et La Grimace, également chez L’Association) met en place un imaginaire étrange et charbonneux évoquant notre propre nature sauvage, à la fois charnelle et menaçante, la perte des êtres chers, la nostalgie d’une époque révolue. Un album ni rêve ni cauchemar où les songes s’invitent dans la réalité pour mieux prolonger et compléter nos existences. (B.B.)
PROGRAMME DE DÉSORDRE ABSOLU.

DÉCOLONISER LE MUSÉE
De Françoise Vergès — La Fabrique
Troisième ouvrage de Françoise Vergès publié à La Fabrique, Programme de désordre absolu. Décoloniser le musée emprunte la première partie de son intitulé au psychiatre et écrivain anticolonialiste Frantz Fanon (1925-1961). Dans cet essai, la théoricienne féministe décoloniale et antiraciste scrute le musée occidental encore trop souvent entendu comme universel et démonte son eurocentrisme persistant ainsi que sa pseudo neutralité. Retraversant l’histoire de ces institutions, mettant au jour le caractère illusoire des tentatives actuelles « d’ouverture » comme l’insuffisance de la restitution des œuvres, Françoise Vergès invite dans un regard aussi sensible que théorique à penser loin de ces espaces patriarcaux, coloniaux et impérialistes. À imaginer un « post-musée » ailleurs et autrement. (C.C.)
lectures
124




JONATHAN BREE
Pre-Code Hollywood / Lil Chief Records
L’homme sans visage revient nous enchanter une troisième fois avec Pre-Code Hollywood. Plus envoûtant que jamais, Bree nous sert une nouvelle galette de cette disco-pop froide et addictive dont il a le secret. Sa voix caverneuse nous balade de questions existentielles en réflexions mélancoliques à dos de synthés et de cordes dramatiques. Bree s’offre même les services du génial Nile Rodgers pour une touche funky sur Miss You. La nouveauté tient sans doute dans les variations vocales auxquelles il s’essaye. Lesquelles ne manquent pas d’apporter une dimension émotionnelle prenante comme dans le sublime « We’ll All Be Forgotten ». Déjà incontournable. (C.J.)

KING KRULE Space Heavy / Matador Records

La joie de vivre n’a jamais été la spécialité de King Krule, la virtuosité si. Le jeune homme de 28 ans revient avec un quatrième album studio brillant d’ingéniosité mais surtout de mélancolie. On n’a pas été vérifier mais Archie a dû expérimenter les affres de la rupture pour nous proposer autant de morceaux sur la déception empreints de fatalisme. Tout comme son nom l’indique, Space Heavy est lourd dans tous les sens du terme. Se mêlant comme à son habitude au rock, free jazz, punk et impro, la voix chantée/parlée de King Krule déferle sur ce mois de juin pour nous provoquer les frissons dont on avait besoin. (C.J.)
LA PRIEST
Fase Luna / Domino
On l’avait quitté en 2020 derrière la boîte à rythme qu’il avait conçue pour réaliser son deuxième album solo, Gene. Sam Eastgate aka Sam Dust, qui évolue sous le nom de LA Priest depuis 2015, nous revient avec un disque composé sur la plage de Puerto Morelos, au Mexique. Celui qu’on a connu en leader des magnifiques Late of the Pier et en sideman de Connan Mockasin, avec qui il a créé Soft Hair, s’attache à des formes toujours aussi épurées, soul-funk ensoleillées et psychédéliques, et continue de faire le grand écart entre Syd Barrett et Prince. Sam a beau se faire discret, il compte – et de loin ! – parmi les artistes les plus passionnants de sa génération. L’un des seuls à nous faire ainsi décoller vers la Lune et au-delà. (E.A.)
FEIST

Multitudes / Polydor
Avec des formes pop qui n’appartiennent qu’à elle, Leslie Feist a le don de nous émouvoir depuis bien longtemps. Alors, quand elle décide dans un mouvement insoupçonné de retourner à la forme folk la plus décharnée, on succombe encore davantage à son charme inné. La naissance de sa fille et la disparition de son père la conduisent à un travail introspectif fragile, sans fard et démultiplié comme le titre de l’album l’indique : il en résulte quelques-unes des plus belles chansons de son répertoire. Des plus touchantes qui soient. (E.A.)

sons
126

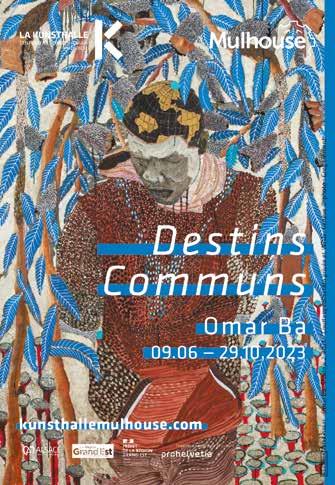


ÉPILOGUE
Par Philippe Schweyer
Pour finir en beauté, on vous explique la vie cachée de Novo, un magazine gratuit indépendant édité en province. Pour financer Novo , nous pouvons compter sur nos fidèles annonceurs (des collectivités, des structures culturelles et des associations plutôt que des banques ou des vendeurs de drogue) et sur nos abonnés (30 euros pour 4 numéros). Novo n’a pas de mécène, ne reçoit aucune subvention. Petite originalité, Novo est coédité par deux entreprises liées par une longue amitié : Chicmedias qui édite notamment le magazine Zut à Strasbourg et Médiapop qui édite des livres et des vinyles depuis Mulhouse. Ces deux entreprises prennent chacune en charge la moitié des coûts de production du magazine (impression, rédaction, correction, mise en page, distribution…). Né en mars 2009, Novo est passé d’un magazine de 80 pages à un magazine qui dépasse souvent 130 pages. Ainsi le numéro 50 imprimé sur du papier de création fourni par Lana
(magnifique entreprise qui vient d’être liquidée après plus de 400 ans d’activité…) faisait 180 pages. Cette augmentation de la pagination a entraîné une augmentation non négligeable de toutes les charges alors que les budgets com de nos annonceurs ont eu plutôt tendance à rétrécir. Depuis le numéro 5, Novo est imprimé par Estimprim, dans le Doubs plutôt qu’à l’étranger. Cette fidélité s’explique par la qualité du travail, mais aussi par une grande confiance et des délais de paiement sur mesure. Après le Covid qui a provoqué la disparition de Zut Lorraine et Zut Oberrhein, l’augmentation du prix du papier a contribué un peu plus à fragiliser Chicmedias. Avant qu’il ne soit trop tard et pour ne pas risquer la liquidation judiciaire qui vient de frapper les salariés de Lana, Chicmedias a lancé une campagne de soutien (voir pages 2-3). De son côté, Médiapop, qui connaît également des soucis de trésorerie récurrents, a créé le Club Médiapop (voir pages suivantes). La suite au prochain numéro ?

128




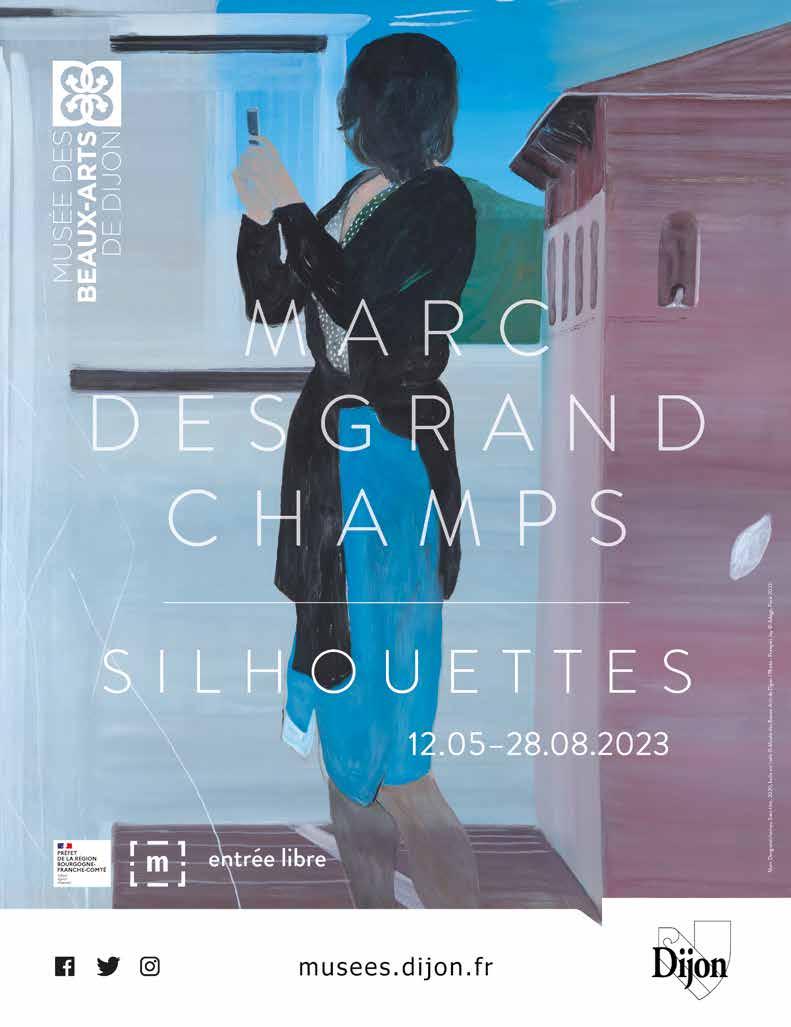




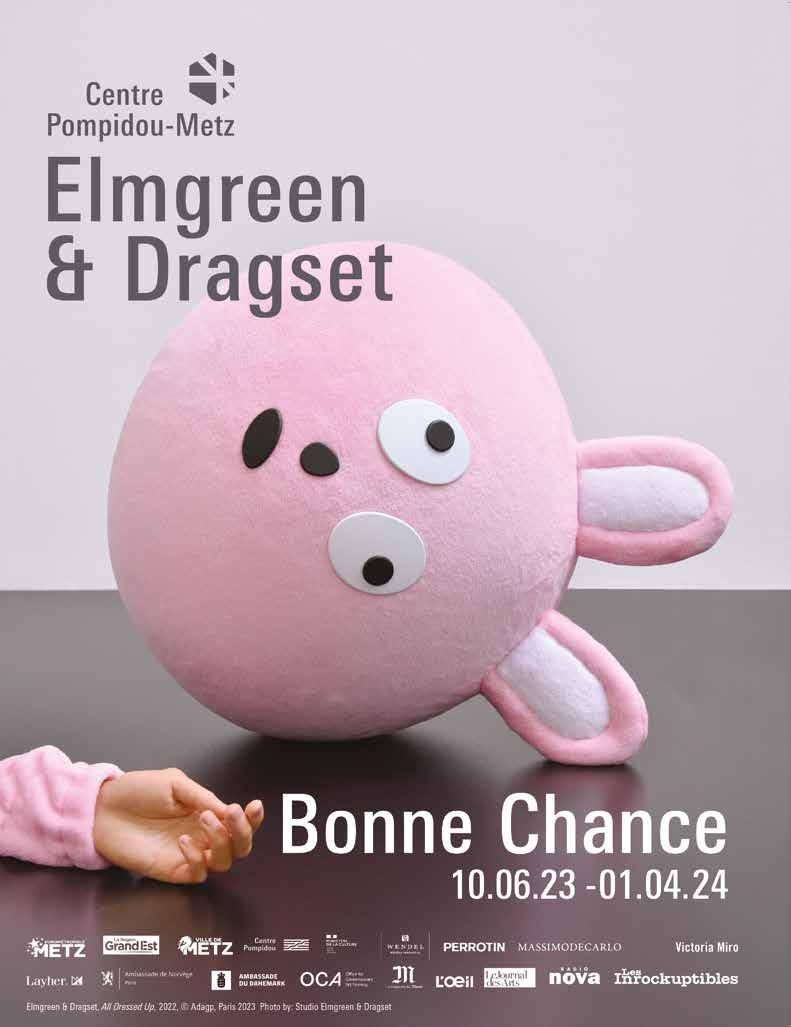

 Texte et photo par Nicolas Bézard
Texte et photo par Nicolas Bézard










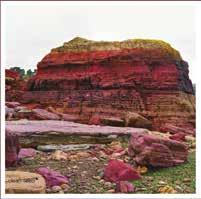





 Par Guillaume Malvoisin
Par Guillaume Malvoisin

 Par Aurélie Vautrin
Par Aurélie Vautrin


 Par Aurélie Vautrin
Par Aurélie Vautrin





 Par Philippe Schweyer
Par Philippe Schweyer








 Par Benjamin Bottemer
Par Benjamin Bottemer



























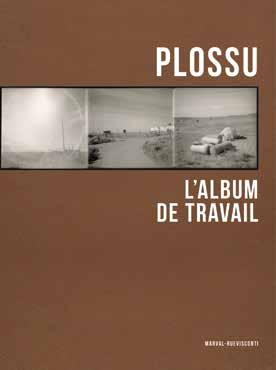











 Abdelkader Benchamma, Lignes de rivage , 2023 © Steeve Constanty.
Abdelkader Benchamma, Lignes de rivage , 2023 © Steeve Constanty.
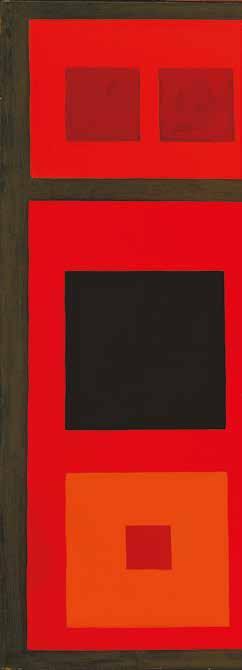
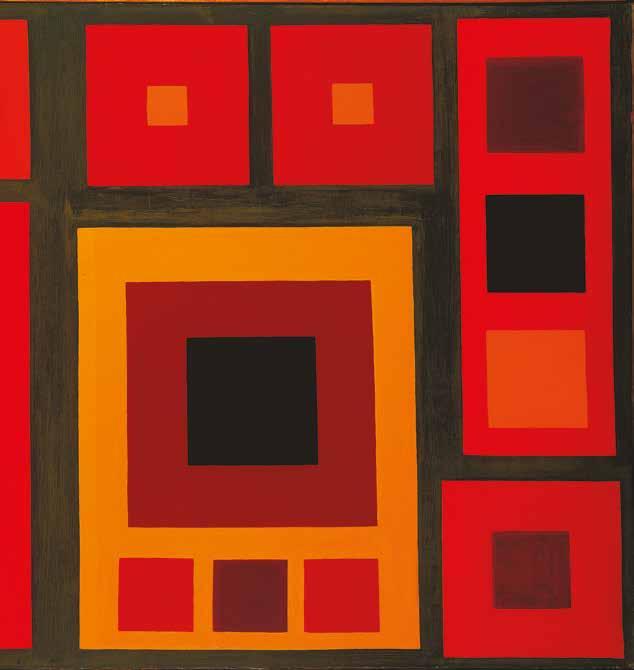
















 (1) Poète antique chantant l’épopée sur sa lyre
(2) Paul Fort, L’enterrement de Verlaine
(1) Poète antique chantant l’épopée sur sa lyre
(2) Paul Fort, L’enterrement de Verlaine


































 De Vincent Vanoli — L’Association
De Vincent Vanoli — L’Association