

VOUS DONNER UNE RÉPONSE RAPIDE, CE N’EST PAS UN DÉTAIL.







Les décisions de financement sont prises par ceux qui vous connaissent dans votre Caisse

















Directeurs de la publication et de la rédaction :
Bruno Chibane & Philippe Schweyer
Rédacteur en chef : Philippe Schweyer ps@mediapop.fr 06 22 44 68 67
Secrétaire de rédaction : Aude Ziegelmeyer
Relecture : Manon Landreau
Direction artistique : Starlight
Ont participé à ce numéro :
RÉDACTEURS
Nathalie Bach, Nicolas Bézard, Valérie Bisson, Benjamin Bottemer, Alma Decaix-Massiani, Claude De Barros, Emmanuel Dosda, Caroline Châtelet, Lucie Chevron, Nicolas Comment, Coralie Donas, Dominique Falkner, Christophe Fourvel, Clo Jack, Mathieu Jeannette, Bruno Lagabbe, Fanny Laemmel, Pierre Lemarchand, Lucas Le Texier, Guillaume Malvoisin, Stéphanie-Lucie Mathern, Luc Maechel, Myriam Mechita, Martin Möller-Smejkal, Martial Ratel, Mylène Mistre-Schaal, Nicolas Querci, Louis Ucciani, Aurélie Vautrin, Nathanaelle Viaux, Clément Willer, Gilles Weinzaepflen, Jean-Luc Wertenschlag, Aude Ziegelmeyer, Lisa Zimmermann.
PHOTOGRAPHES ET ILLUSTRATEURS
Vincent Arbelet, Pascal Bastien, Bearboz, Nicolas Bézard, Sébastien Bozon, Mar Castañedo, Nicolas Comment, Caroline Cutaia, Régis Delacote, Richard Dumas, Romain Gamba, Alicia Gardès, Delphine Ghosarossian, Anne Immelé, Nicolas Leblanc, Benoît Linder, Renaud Monfourny, Zélie Noreda, Arno Paul, Bernard Plossu, Olivier Roller, Dorian Rollin, Christophe Urbain, Henri Walliser, Nicolas Waltefaugle.
COUVERTURE
© Pascal Bastien. Mamie-Magique, Colmar 2021. http://pascalbastien.com/
IMPRIMEUR
Estimprim – PubliVal Conseils
Dépôt légal : octobre 2024
ISSN : 1969-9514 – © Novo 2024 Le contenu des articles n’engage que leurs auteurs. Les manuscrits et documents publiés ne sont pas renvoyés.
CE MAGAZINE EST ÉDITÉ PAR CHICMEDIAS & MÉDIAPOP
CHICMEDIAS
37 rue du Fossé des Treize / 67000 Strasbourg Sarl au capital de 47 057 € – Siret 509 169 280 00047
Direction : Bruno Chibane bruno.chibane@chicmedias.com — 06 08 07 99 45
Responsable administratif : Gwenaëlle Lecointe administration@chicmedias.com — 03 67 08 20 87
MÉDIAPOP
12 quai d’Isly / 68100 Mulhouse Sarl au capital de 1000 € – Siret 507 961 001 00017
Direction : Philippe Schweyer ps@mediapop.fr – 06 22 44 68 67 www.mediapop.fr
ABONNEMENT
Novo est gratuit, mais vous pouvez vous abonner pour le recevoir où vous voulez.
ABONNEMENT France : 4 numéros — 30 €
Hors France : 4 numéros — 50 €
DIFFUSION
Contactez-nous pour diffuser Novo auprès de votre public.
WWW.NOVOMAG.FR
PROLOGUE
5
FOCUS 7-32
La sélection des spectacles, festivals et inaugurations
ÉCRANS 33-44
Festival Entrevues 35-37, Robert Guédiguian 38-42 , Laurent Desmet 43-44
SCÈNES 45-56
Nathalie Béasse 46-47, Rubén Julliard 48-49 , Florence Martin 50-51, Comédie de Colmar 52-53 , Alice Laloy 54-56
ÉCRITURES
57-64
Peter Stamm 58-62, Martial Cavatz 63-64
SONS 65-76
Rodolphe Burger 66-67, Christine Zayed 68-71 , La Face Cachée 72-73, LA Priest 74-76
ARTS 77-87
Mode d’emploi 78-79, Jean Messagier 80-81 , Olivier Metzger 82-83, Ayline Olukman 84-87
IN SITU 89-103
Les expositions de l’automne
CHRONIQUES 105-122
Nicolas Comment 106-108, Stéphanie-Lucie Mathern 110-111, Myriam Mechita 112-113, Dominique Falkner 114-115 , Nathalie Bach-Rontchevsky 115, Bruno Lagabbe 116 , Martin Möller-Smejkal 118-119, Jean-Luc Wertenschlag 120-121, Claude De Barros 122
SELECTA
Livres 124 Disques 126
ÉPILOGUE
128

LA CARESSE DU VENT
Par Philippe Schweyer
L’été touchait à sa fin. Le soleil réchauffait à peine les vitres de mon bureau. Planqué derrière l’écran de mon ordinateur, j’observais le monde partir en sucette. Le chaos se généralisait à vitesse grand V. Pour me changer les idées, j’ai téléphoné à mon coiffeur :
— J’ai besoin de parler à quelqu’un.
— On est archi complet.
— J’ai le cerveau en vrille.
— Je suis coiffeur, pas psy.
— Mes cheveux poussent trop vite. Je ressemble à un vrai hippie.
— Si c’est que ça, j’ai un créneau.
Dans la rue aussi c’était le chaos. Partout des panneaux d’affichage numériques annonçaient une ville plus apaisée. En attendant, le déchaînement des marteaux-piqueurs et des pelleteuses rendait l’atmosphère irrespirable. Alors que je m’éloignais de la zone en voie de piétonnisation, une grosse balayeuse a surgi de nulle part. C’était comme un aspirateur géant lancé à mes trousses. Le chauffeur de l’engin m’a poursuivi jusqu’à l’entrée du salon de coiffure. À l’intérieur, la radio diffusait « Il venait d’avoir 18 ans » de Dalida. Je me suis installé dans un fauteuil pour écouter la fin de la chanson. Mon coiffeur s’est approché :
— Pourquoi tu pleures ?
— Dalida me fiche le cafard.
— Tu es vraiment trop sensible.
— Je repense à mes 18 ans.
Il a fait couler l’eau.
— C’est bon la température ?
— Oui.
Alors qu’il me massait consciencieusement le cuir chevelu, j’ai commencé à décompresser. Le shampoing sentait bon l’amande douce.
— Très court ou comme d’hab ?
— Comme d’hab.
— La nuque bien dégagée ?
— Oui, j’ai besoin de changement.
J’ai enlevé mes lunettes. Je n’avais plus qu’à me laisser faire.
— Beaucoup de travail en ce moment ?
— Oui, mais toujours pas d’argent.
— Plus tu bosses, moins tu gagnes. Putain de pays.
— Y a pire.
Il a dégainé sa tondeuse pour raccourcir mes pattes.
— C’est sûr qu’il y a pire.
Lui-même avait dû fuir la guerre. C’était il y a longtemps et il n’en parlait jamais. La radio diffusait à présent « Ce geste absent » de Dominique A. La mélodie et les quelques mots mis bout à bout me redonnaient envie de chialer. Les non-dits, les gestes involontaires ou mal interprétés, ça me parlait. Mon coiffeur m’a fait signe que c’était terminé. Je me suis regardé dans le miroir. Mes cheveux étaient de plus en plus blancs. Mon visage, une vieille pomme fripée. Il allait falloir m’y faire.
— Tu te sens mieux ?
— Je me sens vieux.
— Mieux vaut vieux que mort.
— Si tu le dis.
Nous étions tous les deux entourés de fantômes.
— Rien de tel qu’un bon coup de ciseaux pour se rafraîchir les idées.
— Merci pour ton aide.
— Arrête de faire cette tête.
— Partout c’est la guerre.
— Essaye de positiver. Pense à autre chose.
— C’est dégueulasse de penser à autre chose.
— Bien sûr que c’est dégueulasse.
— Qu’est-ce qu’on peut faire ?
Dans la rue, le conducteur de la balayeuse tirait sur sa cigarette. Alors que je m’éloignais en savourant la caresse du vent dans mes cheveux, je l’ai entendu démarrer son engin de malheur. Aussitôt, je me suis mis à courir comme un gamin. Arrivé au bout de la rue, je me suis baissé pour ramasser une poignée de marrons, puis j’ai attendu planqué derrière un arbre que la balayeuse soit à ma portée pour lui tirer dessus de toutes mes forces.
Le type était à cran. Il est sorti de sa cabine pour balancer une canette de bière dans ma direction. Cette fois, j’ai détalé pour de bon. En arrivant près de mon bureau, je suis repassé devant un panneau d’affichage numérique qui promettait une ville plus apaisée.
Ce numéro est dédié à Lily Burger, Marcelle Kauffmann et Jean-Pierre Cretin.

Festival du Disque Hiéro
Faute d’été enflammé, Hiéro Colmar a tout misé sur la rentrée. Du 6 au 13 octobre, le programme de la deuxième édition de son festival du disque présidée par l’éminent dandy Bertrand Burgalat aura de quoi combler les frustrés. Une résidence de création avec En Attendant Anna, KG et Eric Benz, les concerts de Kacim, de Bertrand Burgalat et A.S. Dragon, des DJ sets signés Didier Balducci (Memphis Mao) et El Vidocq dans des bars de Colmar, la projection du film VinylMania, des rencontres musicales, une bourse aux disques et un concours de danse… Une promesse d’été indien. (M.J.)
grillen.colmar.fr


Kamaraderie multimédia
Les teignes à Vans de Kamarad ne lâchent pas la rampe. Avant la sortie de leur nouvel album post-punk, Hugues Hestin et Guillaume Neff concrétisent un rêve de djeuns avec La Kamaraderie. Le 12 septembre, ils ont déposé leur skate chez Croconuts pour filmer une première live session avec les fougueux Deafslow. Éclairer la scène rock du Grand Est par le biais d’une nouvelle chaîne YouTube : mise en boîte, interviews surréalistes en jouant à Mario Kart ou Tetris (niveau pro), jeux débilos dingos mettant à l’épreuve la culture rock la plus pointue, mise en scène en lieux et situations incongrus, chroniques littéraires rock… Wooden Wolf aurait dû se préparer. Un projet haut-rhinois très ambitieux et exigeant sous ses airs de franche Kamaraderie. (M.J.)
youtube.com/@kamaraderieShow
Aube galopante
« Jamais assagi, toujours malpoli… À tes barbecues, à tes nuits d’été, j’ai baigné. » Sur ce nouvel EP Cheval Vestale de Vienne la Nuit, les chansons en suggestion de JB Raeth prennent une nouvelle ampleur avec une pop électro et les arrangements gracieux de guitares, cuivres et métallophones. Des atmosphères en clair-obscur raffinées qui vous extirpent du crépuscule vers une Vienne la Nuit aube d’espérance (« Un amour heureux »). Ajoutez à cela la délicatesse de la section rythmique, et dans les limbes vous chevauchez les déclamations de Dominique A frôlant l’élégance orchestrale de Tindersticks. (M.J.)
Des Haut-Rhinois à redécouvrir en CD chez Microclimat, sur musiquesactuelles.net, chez Feuilles D’Encre et au Discobole à Colmar, et à La Vitrine Chicmedias de Strasbourg © Fabrice Wittner

Bertrand Burgalat © SergeLeblon

Festival Densités #30
Et de trente ! Changement de dizaine pour Densités, le festival concocté avec soin par Vu d’un Œuf au cœur de la campagne meusienne. Une édition atypique – on n’en attendait pas moins de ce grand moment de partage autour des musiques expérimentales. Près de soixante artistes, de l’improvisation poétique, de l’électronique, de la transe, de la musique trad détournée, du rock supersonique… Et des propositions hors norme, comme un très grand orchestre de trombones, une œuvre musicale qui dure quatre heures et un bal en « surréalité » augmentée. Bon anniversaire ! (A.V.)
Du 1er au 3 novembre au Pôle culturel de Fresnes-en-Woëvre www.vudunoeuf.com
Spacing
Chloé Mons expose une sélection de photographies issues de Spacing son nouveau livre chez Médiapop. Un choix personnel et subjectif, amoureux et aventureux, reflet de sa vie personnelle et d’artiste. Une vie intense hors de tout sentier battu qu’elle partagea avec le regretté Alain Bashung : « Lors d’essais pour les images de la Tournée des grands espaces créées par Dominique Gonzalez-Foerster. Avant le concert, on avait décidé de mettre la musique des films de vampires de la Hammer car on adorait ça. Et les films, et la musique. Du coup, on a rêvé ensemble de ces vampires amoureux. Et comme le rêve est sans limite, on y a mis aussi du western et Venise. Tout ce qu’on aimait ».
(A.B)
Rencontre le 9 novembre à 15 heures. Expo du 8 novembre au 8 décembre, au Séchoir, à Mulhouse lesechoir.fr

Leurs enfants après eux

Récompensé par le prix Goncourt en 2018, Leurs enfants après eux du Vosgien Nicolas Mathieu a été adapté au cinéma par les frères Boukherma ! Et s’il faut patienter jusqu’au 4 décembre pour le voir en salle, le long métrage a marqué les esprits lors de sa présentation en compétition à la Mostra de Venise : le brillant Paul Kircher est ainsi reparti d’Italie avec le prix de la révélation pour son interprétation d’Anthony, (anti-)héros d’une jeunesse désœuvrée en pleine fracture sociale. On a hâte ! (A.V.)
Le 4 décembre au cinéma
Chi-Fou-Mi Productions – Trésor Film
France 3 Cinéma – Cool Industrie
Leurs enfants après eux © Marie-Camille Orlando
Acétylène

Moby Dick, œuvre abyssale
S’attaquer au grand classique d’Herman Melville Moby Dick, ce n’est pas rien. Pour ce faire, la marionnettiste et metteuse en scène Yngvild Aspeli – qui occupe avec sa compagnie Plexus Polaire une place de choix dans le monde de la marionnette – resserre la focale sur le narrateur Ismaël. Jouant du trouble entre manipulateurs et manipulés ; travaillant volontiers les clairs-obscurs ; faisant surgir les personnages de l’ombre, ce Moby Dick fascine par son esthétique. Sans évacuer la profondeur métaphysique des affrontements à l’œuvre. (C.C.)
Les 30 et 31 octobre à La Filature, à Mulhouse www.lafilature.org
Sous l’projo
Après avoir fêté ses quarante ans en décembre 2023, l’Atelier des Môles de Montbéliard sort aujourd’hui un bien bel objet pour les collectionneurs : Sous l’projo, un livre qui retrace l’histoire de ce haut lieu de la scène rock à travers le portrait de cinquante bénévoles et punks dans l’âme. Le tout livré avec des goodies et un CD exclusif regroupant une vingtaine de titres de groupes diffusés aux Môles, de Ange aux No Fuck Bébé en passant par TC Matic et Parabelllum. Dépêchez-vous, il n’y en a que 500 ! (A.V.)
Livre collector, disponible www.atelier-des-moles.com


Platonov et son envers
Metteur en scène rompu à l’utilisation de la vidéo, Cyril Teste est également un connaisseur d’Anton Tchekhov. Se saisissant de Platonov – première pièce du dramaturge – Teste imagine Sur l’autre rive (variation théâtrale), un diptyque visible pour l’un sur scène, pour l’autre sur arte.tv. Deux variations pour explorer à travers les itinéraires de Micha, instituteur et séducteur patenté ; d’Anna – jeune veuve à l’entregent conséquent – et de toute la constellation d’invités d’Anna les crises intimes autant que collectives qui secouent ce monde en déroute. (C.C.)
Les 17 et 18 octobre, à l’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône www.tdb-cdn.com © Simon Gosselin
Sous l’projo, le livre © Estelle Chardon
© Christophe Raynaud de Lage
Ce qui nous rend vivants
C’est en plongeant dans l’épaisseur obscure du Canal noir (Hommage à Nicolas de Staël) de Jean-Pierre Schneider, qui est reproduit en exergue et qui file vers l’horizon, qu’on entre dans le livre… Les Suites JeanPierre Schneider de Christophe Fourvel se déroulent comme une ligne de fuite dans l’interstice entre parole et peinture. Au fil des visites d’atelier et des conversations avec le peintre, elles nous rapprochent de ce qui nous rend vivants : « Nous croyons vouloir posséder, mais ce qui nous rend vivants est le fugace, l’insaisissable, le mystère. » (C.W.)
Suites Jean-Pierre Schneider, Christophe Fourvel, L’Atelier contemporain, coll. « Squiggle », en librairie le 18 octobre

Les Assoiffés

Corps sur le zinc
Duo de danseurs et chorégraphes fondateurs de la compagnie Psaodi, Benjamin Labruyère et Camille Chevalier créeront en 2025 Les Assoiffés. En attendant la forme définitive de ce solo mêlant danse, théâtre et musique, l’équipe révèle au public les étapes d’un travail en cours. L’occasion de (re)découvrir les bars de quartier, et d’approcher de façon sensible, par l’irruption d’un corps en mouvement, les joies, espoirs, et autres soubresauts intimes qui traversent celles et ceux qui fréquentent ces lieux. (C.C.)
Du 6 au 8 décembre, dans des bars PMU du Territoire de Belfort www.grrranit.eu
Nancy Jazz Pulsations 2024
Parmi les nombreux concerts et autres événements festifs programmés au NJP cette année, on ne cache pas une certaine excitation à l’idée d’assister à la tempête KOMPROMAT à L’Autre Canal. Car le duo fondé par Vitalic & Rebeka Warrior (Sexy Sushi, Mansfield.TYA) navigue en pleins phares entre accent allemand et langue française, electronic body music, cold wave et new wave. Autant dire que ça va envoyer du bois et les échardes avec pour une soirée techno radicale qui s’annonce à la fois dark et ravageuse. Youpi ! (A.V.)
Du 5 au 19 octobre
Au Chapiteau de la Pépinière et autres lieux, à Nancy www.nancyjazzpulsations.com
KOMPROMAT en concert le 16 octobre à L’Autre Canal, à Nancy À voir également le 20 février 2025 au Point d’Eau à Strasbourg, le 21 février 2025 à la Kulturfabrik à Esch-sur-Alzette et le 14 mars 2025 à la Vapeur à Dijon.

Les pierres noires, Jean-Pierre Schneider
KOMPROMAT © Erwan Fichou
Loin des jardins
Lauréate en 2020 du prix Résidence pour la Photographie de la Fondation des Treilles et ancienne photographe de guerre, Sophie Hatier a sillonné en solitaire l’Islande, la Namibie, la Norvège ou la France, parcourant le monde pour le capturer. Publiée aux éditions De l’air, des livres, avec une postface signée Emmanuelle de l’Ecotais, sa superbe monographie Loin des jardins retrace ces territoires en brouillant les pistes, les privant de toute identification. Mer, ciel, terre, savane, forêt, falaise, geyser… la Terre, dans sa multitude, est traitée comme une matière première à la limite de l’abstraction. (Z.Z.)
Éditions de l’air, des livres
En vente dans toutes les bonnes librairies et sur www.delair.fr

Festival du film italien
Le 47e festival du film italien de Villerupt rendra hommage à l’immense Marcello Mastroianni, virtuose de l’autodérision, alter ego inoubliable de Federico Fellini. Le festival, toujours engagé, se penchera également sur le sort des travailleurs et travailleuses de plus en plus soumis aux algorithmes à l’heure où les campagnes et l’industrie ont pratiquement disparu des écrans italiens, si ce n’est comme échos d’un passé qui n’entend pas mourir. (P.S.)
Festival du 25 octobre au 11 novembre à Villerupt (54) festival-villerupt.com

Fast Fashion Victims
Mode jetable, dérives textile et esthétique sans éthique : la plasticienne Marie Dew revient sur les frénésies d’une industrie délétère. Sous les sheds de la Filature de Ronchamp, elle a suspendu de fantomatiques moulages créés en hommage aux disparus de la meurtrière tragédie du Rana Plaza. Leurs oripeaux, déchirés et tachés de sang, évoquent des écorchés vifs. Plus loin, dans une performance filmée qui vire au monochrome, c’est l’hémoglobine encore qui macule les habits et la peau des protagonistes. Un ensemble de créations coup de poing qui lèvent le voile sur la face cachée de la mode. (M.M.S.)
Du 11 au 20 octobre
À la Filature de Ronchamp, à Ronchamp www.lafilaturederonchamp.fr

Extrait de la vidéo de Francis Malapris


Expression libre
Attention pépite. Voire carrément roche en fusion, tempête de grêle, éruption volcanique, tornade niveau EF5. Dites bonjour à Marion Roch, une artiste à la croisée des genres, chanteuse à textes, chansonnière, slameuse, rappeuse, prête à faire sauter toutes les frontières et les codes et les genres, la tête la première et le cœur en étendard. Originaire de Besançon, la demoiselle était jusqu’alors éducatrice spécialisée avant de se jeter dans le grand bain de la Musique. Le verbe haut, le regard fier, le stylo affuté comme un scalpel, elle raconte la vie, la vraie, celle des galères et des matins qui déchantent, les inégalités sociales, le sexisme ordinaire, la précarité – et puis la force des femmes aussi. L’amour, la liberté, la quête de soi et la maternité. Profondément engagée, dans son art comme dans la vie, elle a notamment sorti deux titres cette année, dont le bouleversant La bête au ventre, qui résonne encore longtemps après l’écoute, dans l’esprit comme dans les tripes. Une nouvelle voix rocailleuse, puissante et porteuse de sens, qui devrait, en toute logique, faire largement parler d’elle d’ici peu.
Par Aurélie Vautrin
— MARION ROCH, concert le 5 décembre à La Rodia, à Besançon www.larodia.com

Homme/Femme modes d’emploi
Sens dessus dessous. L’époque est ainsi tournée. Les vainqueurs à une élection se retrouvent tristement absents des bancs à pouvoir, mais les genres se mélangent joyeusement, la tradition passe joliment cul par-dessus tête. Pas trop tôt, dira-t-on à la lecture de l’argument de L’Uomo Femina, opéra-fable du xviiie troussé magistralement par Baldassare Galuppi. Le galopin vénitien inverse les rapports de sexes en vigueur à l’époque. Deux naufragés échouent sur une île gouvernée par les femmes, où les hommes sont dociles, coquets et même un peu craintifs. Pas mal pour lancer un dramma giocoso armé comme une amante, sans religion si ce n’est la passion du mouvement. Les affres et les roueries géniales de la princesse Cretidea pour soumettre Roberto sauvé des eaux deviennent flamboyantes. D’autant plus qu’elles sont confiées pour cette nouvelle production de l’Opéra de Dijon aux mains jointes d’Agnès Jaoui pour la mise en scène et de Vincent Dumestre pour la direction musicale. Rira bien qui voudra définir quel est le sexe faible, qui est légitime à gouverner. Pas mal pour un pays où les séquences politiques tirent sur la raison, pour le moins, la contrainte, pour le pire. Mais cette production ira sans doute bien au-delà d’un petit raccord d’actualité. La satire qui est contenue dans le livret de Pietro Chiari louche vers Goldoni et ses finesses incroyables quand il s’agit de remettre chacune et chacun de nous à sa place. Celle d’un·e observateur·rice aux yeux grands ouverts sur les changements nécessaires des rapports humains. Sans aucun regret ni morosité. Eyes wide open, et sourire aux lèvres.
Par
Guillaume Malvoisin
— L’UOMO FEMINA, opéra du 7 au 9 novembre 2024 à l’Opéra de Dijon opera-dijon.fr
Marion Roch © Laura Gilli
© Gilles Aillaud


Fugues étincelantes
« Les communs sont à la mode, tant mieux, Les Petites Fugues entendent en être ! » C’est ce qu’affirmaient lors de la précédente édition de ce festival littéraire en Bourgogne-FrancheComté les organisatrices Évelyne Geny et Marion Clamens. Les Petites Fugues fêteront cette année leurs 23 ans et poursuivront leur effort passionné de faire de la littérature un « commun », en essaimant dans les librairies, les écoles ou les médiathèques de la région pour faire battre le cœur de la vie littéraire contemporaine au fil des rencontres avec auteurs et autrices. Treize noms prometteurs sont au programme de ces rencontres itinérantes qui auront lieu du 18 au 30 novembre : Sébastien Berlendis, Rémi David, Jérémie Gindre, Lola Gruber, Léo Henry, Perrine Le Querrec, Sylvain Levey, Émilienne Malfatto, Eugène, Justine Niogret, Isabelle Pandazopoulos, Zinaïda Polimenova, Julie Rey. Au gré de leurs tournées, romans, littérature jeunesse, mais aussi poésie, essais, théâtre seront à l’honneur. On pourra se plonger dans ses rêveries en écoutant Sébastien Berlendis évoquer l’art italien de la passeggiata qui imprègne son récit Lungomare paru chez Actes Sud, ou encore Lola Gruber parler de son intrigant roman Horn venait la nuit chez Christian Bourgois, qui entretisse visions des banlieues de Budapest ou clapotis du Danube la nuit… Autant de présages de fugues étincelantes.
Par Clément Willer
— LES PETITES FUGUES, festival littéraire itinérant du 18 au 30 novembre en Bourgogne-Franche-Comté www.lespetitesfugues.fr

Réfection intime
Pour se débarrasser de son crépi intérieur, « le plus efficace est d’utiliser une décolleuse à papier ». Enfin, dixit les Internets… Parce qu’une autre possibilité peut être de raconter les déboires et catastrophes qui parsèment sa propre vie. Voilà la genèse succincte de ce spectacle réunissant Charlotte Clamens et Valérie Mréjen. La première, comédienne et pédagogue ayant débuté sa carrière avec Antoine Vitez et collaboré par la suite avec (entre autres) le metteur en scène Jean-François Sivadier ou, plus récemment, la compagnie belge de danse Peeping Tom, a une existence singulièrement truffée de catastrophes et autres accidents. La seconde, romancière, plasticienne et vidéaste, est rompue à une écriture aimant souvent à travailler les listes et énumérations, et captant dans une langue concise ces menues choses qui font une vie. Dans cette création écrite par Valérie Mréjen et dont toutes deux co-signent la mise en scène et l’interprétation, le duo s’amuse avec le reenactment, en mettant en scène l’opération de recueil de paroles que l’autrice a réalisé auprès de la comédienne. Dans un dispositif minimal et avec seulement quelques petits objets – accessoires a priori dérisoires, mais opérant comme des signes quant au témoignage de Charlotte Clamens –, elles réalisent autant qu’elles donnent à voir l’opération de construction du spectacle. Les écarts (parfois infimes) entre paroles et actions, comme l’auto-ironie subtile mâtinant l’ensemble du dispositif, n’évacuent ni la sincérité de la relation ni l’attention à l’autre. Alors, comment se débarrasser de son crépi intérieur ? En s’efforçant de le regarder et de le métaboliser, qui sait…
Par Caroline Châtelet
— COMMENT SE DÉBARRASSER DE SON CRÉPI INTÉRIEUR,
théâtre du 6 au 8 novembre au Nouveau Théâtre de Besançon CDN ntbesancon.fr
Comment se débarrasser de son crépi intérieur
Lola Gruber © Tamas Loky


Objet (bien) trouvé
Après trois (interminables) années de silence, les Frenchies de Isaac Delusion sont finalement sortis de l’ombre au début de l’année avec Lost and Found, un quatrième album inespéré et surprenant à plus d’un titre. Déjà parce que le groupe parisien fait figure de rescapé de la « scène pop 2010 » – la plupart de leurs comparses de l’époque ayant depuis longtemps disparu des radars. Ensuite, parce que le quatuor a su renouveler sa fameuse « musique somnambule », notamment en optant pour une direction en solo de Loïc Fleury – le claviériste Jules Pacotte ne signant cette fois que deux titres de l’album. De sa retraite en solitaire au cœur des forêts bretonnes, loin de l’euphorie parisienne, il a imaginé une nouvelle voie pour le groupe – dans tous les sens du terme d’ailleurs, puisque le chanteur nous fait découvrir sur Lost and Found une tessiture de voix très inattendue. À cela s’ajoute une collaboration poussée avec la jeune génération, notamment LUCASV, l’acolyte de Disiz, ou encore un duo de toute beauté avec Olivia Merilahti de The Do. Résultat, la pop-electro-folk angélique de Isaac Delusion se voit propulsée dans une sphère toujours plus mélancolico-lumineuse, mêlant ainsi onirisme réconfortant et spleen poétique. À noter que le concert au Moloco sera la dernière date du groupe avant… l’Olympia à la fin du mois de novembre ! Un vrai rêve éveillé.
Par Aurélie Vautrin
— ISAAC DELUSION, concert le 9 novembre au Moloco, à Audincourt www.lemoloco.com
Retrouvez également Isaac Delusion le 15 octobre au Nancy Jazz Pulsations, à Nancy

Sous le signe de
Marlene Dietrich
Augenblick, qui signifie en allemand quelque chose comme « le regard des yeux » et qu’on peut traduire par « l’instant présent », c’est un nom que j’ai toujours trouvé très beau pour un festival de cinéma. Il évoque ces scènes fugitives qui sont la matière secrète des films qu’on aime, ces plans silencieux qui durent seulement le temps d’un regard sur la pluie qui tombe dans les rues, sur les nuages qui passent, sur un sourire… Les cinéphiles peuvent noter dans leurs agendas que la vingtième édition de ce festival consacré au cinéma germanophone se tiendra du 5 au 22 novembre, dans une quarantaine de salles indépendantes à travers le Grand Est. Une occasion précieuse de voir nombre de films rares du cinéma contemporain, placée sous le signe d’une grande figure allemande du cinéma du siècle dernier, mais aussi de la résistance au nazisme depuis son exil américain : Marlene Dietrich. Cette dernière s’était entre autres réapproprié la chanson « Lili Marleen », grand succès dans l’Allemagne nazie dont elle modifia le titre et les paroles pour en faire un chant de la libération en 1944, « Lili Marlene ». Les paroles évoquent deux personnages qui s’aiment, se retrouvent près d’une lanterne dans les rues nocturnes, et disent : « Bei der Laterne wollen wir stehen… » Nous voulons rester près de la lanterne… Cette lanterne, c’est d’une certaine manière l’image de la lueur d’espoir dans la nuit qu’alluma la libération, mais pourquoi ne pas imaginer que c’est aussi une sorte de lanterne magique qui serait l’image du cinéma et nous convierait au festival Augenblick.
Par Clément Willer
— AUGENBLICK, festival du cinéma germanophone du 5 au 22 novembre, dans toutes les salles indépendantes du Grand Est festival-augenblick.fr
Isaac Delusion © Julien Mignot
Richard Fleischhut, Marlene Dietrich An Bord der “Bremen”, 1931


Zaoui Thérapie
On les connaissait notamment pour leurs « hits sales » et autres titres joyeusement irrévérencieux : Adé (Adélaïde Chabannes de Balsac) et Zaoui (Raphaël Faget-Zaoui) tracent à présent leurs routes en solo, et ce depuis 2021 et le split tonitruant de Thérapie Taxi au beau milieu de leur course folle vers les étoiles. Après un EP intitulé Mauvais Démons sorti en 2022, Zaoui signe aujourd’hui Pulsations, un premier album intense inspiré de la propre dualité du chanteur ; le « sale gosse de la pop » étant tiraillé entre ses démons intérieurs et le petit diablotin malicieux perché sur son épaule gauche. D’où un sacré cocktail carrément explosif entre beats solaires et mélancolie viscérale… La musique comme exutoire ? Et encore, c’est un doux euphémisme. « La musique, c’est un besoin primaire chez moi », explique-t-il. « J’ai besoin d’écrire des chansons. Pour mon équilibre mental, la musique a été essentielle. Sans elle, il y a plein de choses que je n’aurais pas su affronter. » Le voilà donc seul maître à bord d’une pop effrontée, ultra efficace, aussi insolente qu’intime et qui, sur scène, se la joue grenade dégoupillée pour faire parler aussi bien les corps que les cœurs. Oubliez ce que vous pensiez connaître de lui : Zaoui a bel et bien changé de véhicule, et file désormais à toute allure vers un ailleurs à découvrir avec lui.
Par Aurélie Vautrin
— ZAOUI, concert le 22 novembre au Noumatrouff, à Mulhouse www.noumatrouff.fr

L’image et le multiple
Dans un discours à l’institut antifasciste de Paris en 1934 intitulé « L’auteur comme producteur », Walter Benjamin suggère qu’une entreprise culturelle qui veut avoir une portée révolutionnaire doit impliquer avant tout une réappropriation des processus qui composent la chaîne de production des œuvres. Il est certain qu’il aurait été enthousiaste en flânant dans les salons de zines et de micro-édition, tels que la huitième édition de Microsiphon qui aura lieu du 4 au 6 octobre à Mulhouse, au tiers-lieu Motoco qui a réinvesti les friches de l’ancienne usine DMC. Ce week-end sera consacré « à l’image et au multiple ». En effet, les fruits d’une multiplicité de pratiques dans les domaines des arts graphiques seront présentés par une multiplicité d’artistes gravitant un peu partout, à Mulhouse (Léo Quievreux), à Strasbourg (Camille Renault), à Paris (Éditions infinies) ou à Winterthur (Samuel Jordi). Dans un esprit de détournement des chaînes de production les plus sérieuses, les ateliers Fopapiés permettront également de repartir avec une nouvelle carte d’identité pleine de fautes, un permis de mal conduire, une carte France Travail Premium ou une carte électorale à brûler. Tout cela dans une atmosphère musicale assurée par plusieurs noms de la scène indépendante, comme César Palace venu de Berlin, Frissson & Polyssson de Nevers et LordxGonzo de Belfort qui se produiront le samedi soir.
Par Clément Willer
— MICROSIPHON 8, salon de micro-édition du 4 au 6 octobre à Motoco, à Mulhouse www.microsiphon.net
Shohyung-Park
Zaoui © Fifou



Noces cosmiques
Sur la très belle affiche de Noces, programmé en octobre par le Ballet de l’Opéra national du Rhin, on peut voir une foule de pieds qui semblent s’élancer dans les airs, comme pour suggérer que les noces en question ne scelleront pas seulement l’union entre deux êtres qui s’aiment, mais entre une multitude d’êtres reliés par les forces terrestres énigmatiques de la gravité et de la légèreté. Durant la première partie de ce ballet en deux temps, qui a pour titre Nous ne cesserons pas, le chorégraphe Bruno Bouché proposera, de manière croisée, une réinterprétation de la Sonate pour piano en si mineur jouée par Tanguy de Williencourt ainsi qu’une relecture d’un célèbre épisode du Livre de la Genèse, racontant les visions de Jacob endormi, ébloui par un défilé d’anges sur une échelle qui les mène vers le monde céleste. Durant la seconde partie, la chorégraphe Hélène Blackburn donnera à entendre et à voir Les Noces composées par Igor Stravinsky entre 1914 et 1917, en pleine tourmente de l’Histoire, dans une nouvelle interprétation assurée par les solistes de l’Opéra Studio, le Chœur de l’OnR et les Percussions de Strasbourg. On peut imaginer que ces noces ressembleront aux noces cosmiques qu’Albert Camus définissait comme une manière de ne pas « se dérober à l’implacable grandeur de cette vie », de cette vie ici et maintenant.
Par Clément Willer
— NOCES, ballet du 3 au 7 octobre à l’Opéra de Strasbourg, le 12 octobre au Théâtre municipal de Colmar, et les 18 et 20 octobre à La Filature de Mulhouse www.operanationaldurhin.eu

Laurène Marx, jamais trop
« Déflagration », « coup de poing », « uppercut », côté substantifs. « Percutant », « explosif », « foudroyant », côté adjectifs. « Nous attrape par le col », « nous renverse », « nous foudroie », côté verbes. La liste (complétable à loisir) des qualificatifs fréquemment usités par les critiques – l’autrice de ces lignes y compris –pour définir certaines œuvres mériterait d’être interrogée. Quel rapport recherché à un film, un livre, un spectacle, racontent ces termes ? Pourtant, à découvrir le travail de Laurène Marx, il s’avère difficile de ne pas y recourir. Car depuis Borderline Love (joué en mai 2022 à Paris) et Pour un temps sois peu (lu en 2021 à La Mousson d’été puis créé à l’automne 2022 à Paris), le théâtre de l’autrice trans non-binaire s’affirme par une écriture et une interprétation fondée sur une intensité sans faille. Suffit, pour s’en convaincre, de découvrir ses deux spectacles Pour un temps sois peu et Je vis dans une maison qui n’existe pas. Dans l’un, la jeune femme expose et explore la violence de la transphobie et des assignations dans une société arc-boutée sur la binarité de genres. Dans l’autre, elle déploie un univers louvoyant avec le conte pour raconter l’histoire d’un enfant en prise avec des troubles dissociatifs. Dans les deux créations, seule en scène, elle porte avec une énergie magnétique son propos. Galvanisée par une écriture au cordeau, écriture aussi vive que travaillant les ruptures de rythmes, d’adresses, de registres de langues et de styles, Laurène Marx saisit par son introspection sans fard. Ça décape, ça déplace, et ça n’a rien d’un effet de style.
Par Caroline Châtelet
— POUR UN TEMPS SOIS PEU, théâtre du 26 au 30 novembre au TNS, à Strasbourg — JE VIS DANS UNE MAISON QUI N’EXISTE PAS, théâtre du 3 au 7 décembre au TNS, à Strasbourg tns.fr
Pour un temps sois peu © Pauline Le Goff



Ce(ux) qui reste(nt)
Bordée par la mer Baltique, Klaipėda est l’une des plus anciennes villes de Lituanie ; une cité portuaire, pittoresque – et au passé plus que douloureux, car maintes fois bombardée, vidée, occupée, annexée, par la Pologne, la Russie, le IIIe Reich, l’URSS. Dans le cadre de la Saison de la Lituanie en France 2024, la dramaturge
Lina Laura Švedaitė et l’ancien directeur du TJP Renaud Herbin se sont inspirés des blessures de la ville pour imaginer une microfresque universelle, un récit polyphonique et visuel porté par des marionnettes hautes de trente centimètres : Embrasser les cendres. Des objets animés vecteurs de mémoire, figures silencieuses qui dialoguent avec l’absence et le deuil. Qui incarnent ce qui reste, traces tangibles de vies révolues, évoquant la transformation comme la disparition. Tomber pour se relever, s’effondrer pour mieux renaitre, accepter les cendres comme symbole de fin et de renouveau. Se reconstruire, en regardant le passé avec dignité et l’avenir avec espoir. Puisant dans la mémoire païenne de cette contrée, pleine de magie et de sorcellerie, le duo explore ainsi la fragilité de la condition humaine à travers une mise en scène épurée, où le corps, la matière et le mouvement occupent une place centrale. Empreinte de poésie visuelle, la pièce interroge également notre rapport au temps, à la perte, et à la façon dont le corps, qu’il soit humain ou marionnettique, peut devenir le réceptacle de récits enfouis. Un langage unique, conjuguant art de la manipulation et réflexion existentielle.
Par Aurélie Vautrin
— EMBRASSER LES CENDRES, théâtre de marionnettes du 5 au 7 novembre au TJP, à Strasbourg www.tjp-strasbourg.com

Remontages du passé
Et si l’histoire et la critique du théâtre pouvaient ou devaient s’écrire sous une forme elle-même théâtrale et chorégraphiée ? C’est ce que propose la metteuse en scène Fanny de Chaillé, dans le cadre de sa résidence artistique à l’Université de Strasbourg dont le thème est « Petite histoire, grande histoire », à travers les représentations d’Une autre histoire du théâtre qui auront lieu sur les planches de Pôle Sud les 15 et 16 octobre. Cela s’inscrit dans le sillage d’une volonté constante de procéder à un remontage du passé pour mieux le comprendre chez Fanny de Chaillé, si l’on se souvient qu’elle a déjà travaillé à plusieurs réinterprétations enthousiasmantes de notre héritage littéraire et de notre histoire culturelle ces dernières années, depuis Karaokurt ou Schwitters karaoké en 1996 jusqu’à Répète en duo avec Pierre Alferi en 2013 ou Désordre du discours, d’après L’Ordre du discours de Michel Foucault, en 2019. Cette fois, avec Malo Martin, Tom Verschueren, Margot Viala et Valentine Vittoz qu’on avait déjà pu voir dans Le Chœur de Fanny de Chaillé l’an passé, on croisera les fantômes de Delphine Seyrig, de Henrik Ibsen ou de Stella Adler, tout en cherchant à déconstruire pour mieux les comprendre les enjeux de pouvoir, les structures de domination, les zones d’ombre qui trament plus de deux mille ans d’histoire de ce que l’on a l’habitude de nommer théâtre.
Par Clément Willer
— UNE AUTRE HISTOIRE DU THÉÂTRE, spectacle le 15 et 16 octobre à Pôle Sud, à Strasbourg www.pole-sud.fr
© Marc Domage
Embrasser les cendres © Kristijonas Lucinskas

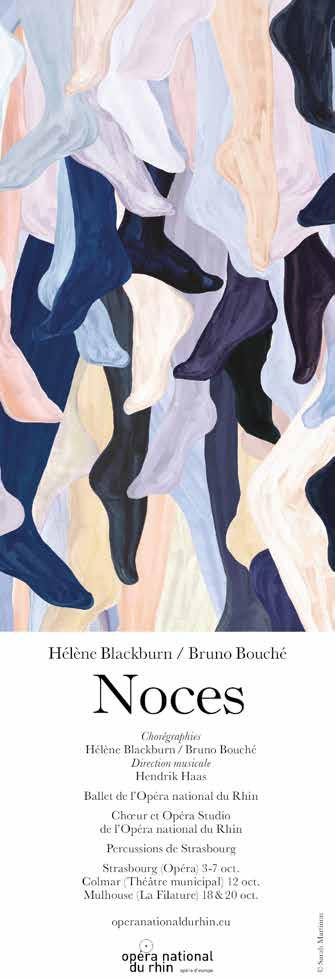

Quand la lumière baisse
Après un printemps passé à vagabonder entre Strasbourg, Berlin et Dresde, la scène de musiques actuelles Jazzdor est de retour pour une nouvelle saison dans la cité alsacienne parée de ses couleurs automnales, qui sont d’une certaine manière les couleurs rougeoyantes du jazz lui-même. Ainsi la lumière d’octobre sera-telle certainement idéale pour s’immerger dans les volutes jazz de I Still Follow You, pour prêter l’oreille aux ritournelles aériennes du trio composé du saxophoniste français Jérôme Sabbagh venu de Brooklyn, « étoile montante » selon le prestigieux magazine DownBeat de Chicago, du batteur suisse Daniel Humair, qui a joué avec les plus grandes figures du jazz de Bud Powell à Eric Dolphy, et le guitariste américain Ben Monder, habitué des célèbres clubs de jazz newyorkais comme le Sullivan Hall ou l’avant-gardiste Knitting Factory, dont on peut se souvenir aussi qu’il a collaboré au dernier album de David Bowie, Blackstar. Peut-être suffit-il d’aller écouter Heart, le très beau et élégant dernier album de Jérôme Sabbagh, dont les titres comme « Prelude to a Kiss », « Gone With the Wind », « When Lights Are Low » ou « Body and Soul » laissent rêveur, pour avoir une idée de l’atmosphère feutrée et envoûtante qui nous attend au Fossé des Treize, par un de ces soirs d’automne où la lumière baisse comme pour inciter de façon étrange le temps à ralentir…
Par Clément Willer
— I STILL FOLLOW YOU, concert le 8 octobre au Fossé des Treize, à Strasbourg, dans le cadre du festival Jazzdor jazzdor.com

Nombre d’or
Le festival de design graphique FORMAT(S) est de retour pour une troisième édition à Strasbourg. Le design graphique est partout, prendre le temps de poser son regard sur ce qui est en jeu dans la composition des images est un formidable outil pour réaffirmer sa liberté, ne nous privons pas d’allées et venues dans un programme riche et varié composé par de nombreux artistes plasticiens de Strasbourg et d’ailleurs. Performances, conférences, tables rondes, ateliers, Salon graphique, DJ set et expositions se déploieront dans ce petit festival qui a déjà trouvé son public et entraîné des partenaires et soutiens d’un peu partout, de la Ville de Strasbourg à Graphisme en France, jusqu’à la proche Suisse. Un rayonnement européen qui se lit dans cette édition avec les Allemands du duo VIER5, de Slanted et son magazine de référence internationale, des éditions Poem de Francfort, du fabricant de papier Metapaper, et dans une sélection de 40 affiches de toute l’Europe produites dans les cinq dernières années, issues du fonds du Centre national du graphisme à Chaumont et présentées au palais universitaire. En cette année de Strasbourg Capitale mondiale du Livre UNESCO, le salon graphique de la Coop exposera les plus beaux livres suisses et l’exposition « Sélections », écho de la biennale Exemplaires, déboule à Strasbourg grâce à la HEAR et à son réseau d’écoles partenaires belges, suisses et françaises. Le collectif bâlois Tristesse signe l’affiche et la création graphique du festival.
Par Valérie Bisson
— FORMAT(S) festival du 4 octobre au 17 novembre dans divers lieux à Strasbourg formats-festival.org
© Jean-Baptiste Millot
© Tristesse

Dématérialisé
Le projet Micro-Folie, ou Musée numérique, est un dispositif culturel de proximité porté par le ministère de la Culture et coordonné par La Villette en lien avec 12 établissements nationaux fondateurs dont le Centre Pompidou, le Louvre ou la RMN. Destiné à diffuser des expositions, des spectacles, des films et des conférences autour de la vie culturelle, artistique et éducative à travers la France et à l’international, le Musée numérique permet de découvrir les trésors des plus grandes institutions nationales et des institutions partenaires. Numérisées en très haute définition, les œuvres de cette galerie éclectique se rendent accessibles en fonction des lieux d’accueil : médiathèques, bibliothèques, centres socioculturels, maisons de quartier, afin de devenir une première étape vers la visite d’institutions voisines. Ce réseau de lieux culturels numériques propose une diversité de contenus et se décline au profit de publics diversifiés pour générer la circulation des œuvres et échanger les bonnes pratiques. En s’appuyant à la fois sur les trésors des grands établissements publics et sur les initiatives locales, Micro-Folie se veut lieu de vie et d’apprentissage, accessible à tous, visiteurs et acteurs du territoire. La nouvelle collection, créée en collaboration avec plus de cinquante institutions régionales de ChampagneArdenne, Alsace, Lorraine et Sarre, est l’occasion de célébrer la richesse de la Grande Région dont le parcours thématique se déclinera à travers neuf pistes historiques et artistiques.
Par
Valérie Bisson
— MICRO-FOLIES, lancement de la collection « Grand Est » le 8 octobre au Palais du Rhin, dispositif culturel du 9 octobre au 2 novembre, à Strasbourg www.lavillette.com/micro-folie

Sauvetage des vitraux, Bibliothèques de Reims © Bm Reims, Deneux R 48

Sans ordonnance
En 2020, LAAKE, de son vrai nom Raphaël Beau, nous offrait rien de moins qu’une symphonie électronique grâce à O ; un premier album sorti chez Mercury dans lequel brillait déjà son immense talent de pianiste autodidacte. Une musique expérimentale, organique, vibrante, élégante, virevoltant constamment de l’ombre à la lumière et inversement. Quelque part entre techno futuriste et classique ancestrale, mélopées instrumentales et voix fantomatique, beats virtuoses et envolées lyriques, bande originale d’un film de SF et trip sous acide d’une beauté vertigineuse. Quatre ans plus tard, son look a changé, sa musique aussi ; le talent, lui, est toujours aussi indéniable. VOLT, son second opus, est vaste, solaire, à contrecourant, et porté par une histoire plutôt originale : à l’origine, l’artiste imaginait les contours d’un album de piano solo, avant de changer subitement de direction suite à une électrocution durant l’enregistrement du premier titre – il finira aux urgences avec de multiples brûlures. Désormais, les boucles de piano s’entrechoquent avec les percussions dans un déluge progressif et maitrisé. L’énergie de l’album navigue dans des dimensions électroniques et classiques assumées, flirtant avec les sons d’orgues et les voix polyphoniques, comme témoins de l’urgence qui se dégage de chaque morceau. Pour info, « Laake » signifie « médicament » en finnois. On vous le conseille en perfusion matin, midi et soir.
Par Aurélie Vautrin
— LAAKE, concert le 21 novembre à L’Autre Canal, à Nancy www.lautrecanalnancy.fr

Inédits iNOUïs
Depuis bientôt cinquante ans (!), le Printemps de Bourges peut se targuer d’être le premier festival des musiques actuelles du pays. Un grand moment de fête durant lequel on garde toujours un œil (complètement) intéressé sur le line-up des iNOUïS, véritable tremplin 3XL pour les groupes émergents et autres futures pépites du surlendemain. C’est donc avec un intérêt non dissimulé que l’on suit chaque année le tourbus des lauréats à travers la France – sorte de baptême du feu tout habillés dans le grand bain des grandes tournées. Cette foisci, il s’arrête à L’Autre Canal pour un concert des trois lauréats de la saison : Noor, Prix du Printemps de Bourges Crédit Mutuel - iNOUïS 2024, auteure, compositrice, productrice et pianiste, avec son monde intimiste et ses subtils arrangements electro-pop ; Jean, Prix du Jury - iNOUïS 2024, chouchou d’Odezenne aux chansons joyeusement dépressives, la mélancolie chevillée aux textes, mais dont l’alliage de pop, de variété et de rap rallume toujours la lumière ; et enfin Marius, récompensé par le Prix Public Riffx - iNOUïS 2024, artiste à la voix puissante et performeur à fleur de peau pour qui l’écriture est comme un exutoire. À noter également qu’une réunion d’information concernant les futures candidatures de 2025 se tiendra un peu plus tôt dans la journée. Et si la pépite de l’année prochaine, c’était vous ?
Par Aurélie Vautrin — LA TOURNÉE DES INOUÏS, concert le 24 octobre à L’Autre Canal, à Nancy www.lautrecanalnancy.fr
Noor © Manon Awad
LAAKE © Xavier Dragon



Puccini superstar
L’Opéra-Théâtre de Metz ouvre sa saison avec un cycle consacré à Giacomo Puccini. On y retrouvera La Rondine, comédie lyrique décriée lors de sa diffusion en 1917 et rarement présentée au public.
À un moment où il souhaite opérer un changement radical dans son œuvre, le compositeur italien se détourne du format originel de l’opérette initialement prévu, offrant à son personnage Magda, dont le passé empêche son mariage avec Ruggero, l’un des plus beaux arias du répertoire lyrique. Tosca, également produite par l’Opéra-Théâtre et déjà montrée en 2019, est un quasi-huis clos où la Mort plane sur tous les personnages, liés par des rapports de passion, de jalousie et de domination. Décors et costumes respectent le cadre originel de l’œuvre, celui du xixe siècle, en y ajoutant la vidéo pour évoquer les différents lieux de l’intrigue.
Ce voyage dans l’univers de Puccini se poursuit avec un ballet, nouvelle création mondiale de l’Opéra-Théâtre par la chorégraphe Silvana Schröder. L’Animal del Lago est un portrait croisé de la vie privée de Puccini, tissé au gré d’évocations de ses œuvres les plus célèbres comme Madama Butterfly, La Bohème ou Tosca. Enfin, la cathédrale Saint-Étienne de Metz accueillera la Messia di Gloria, œuvre de jeunesse du compositeur, tombée dans l’oubli jusqu’à sa redécouverte en 1951. On y retrouve déjà certains de ses thèmes fétiches, et une inventivité qui augure celle qui présidera à l’ensemble de sa carrière.
Par Benjamin Bottemer — CYCLE PUCCINI, lyrique et ballet du 4 octobre au 29 novembre à l’Opéra-Théâtre de l’Eurométropole de Metz opera.eurometropolemetz.eu

Toujours indomptable
Après Annie Ernaux dans Le Quat’sous et Frida Kahlo dans Ni les chiens qui boitent ni les femmes qui pleurent, Laurence Cordier s’intéresse à un autre destin de femme indocile en adaptant Antigone de Sophocle. Le drame de l’auteur grec nous plonge dans les décombres de la guerre : Étéocle et Polynice, fils d’Œdipe, s’entre-tuent pour le trône de Thèbes. Seul Étéocle, souverain légitime, aura droit à une sépulture. Mais Antigone, la sœur des deux guerriers fratricides, est décidée à enterrer Polynice quoi qu’il lui en coûte. Pour Laurence Cordier, deux coups de cœur ont présidé à la création de ce nouveau spectacle au Théâtre de la Manufacture : la traduction d’Irène Bonnaud et Malika Hammou « pour leur langage tout à la fois extrêmement concret et puissamment poétique » et l’engagement scénique de Noella Ngilinshuti Ntambara, « qui incarne l’indocilité sereine, l’impertinence calme et puissante ». Son Antigone met en scène une figure fondatrice de l’insoumission à l’ordre établi, celui du patriarcat aveugle et sommaire incarné par Créon, oncle d’Antigone et héritier du trône. Entre terre volcanique et champ de ruines, symboles de forces qui s’affrontent, la scénographie s’attache à évoquer la force de la terre, où paysages féeriques de mousses épaisses succèdent aux coulées de lave… un écrin au conte d’Antigone, dans ce qu’il a de plus universel et intemporel.
Par Benjamin Bottemer
— ANTIGONE, théâtre du 12 au 16 novembre au Théâtre de la Manufacture, à Nancy theatre-manufacture.fr
© Marie Pétry
La Rondine di Puccini, Teatro Verdi di Pisa © Kiwi Photographer – Diego Bianchi



Come rain or come shine
Sans doute n’est-il plus possible de parler du temps qu’il fait seulement pour meubler une conversation, sans que cela dise quelque chose du désastre climatique. Ainsi le festival de musique contemporaine rainy days, organisé en partenariat avec la Philharmonie Luxembourg, nous parle-t-il au fond de notre étrange époque. Son slogan se résume d’ailleurs à un seul mot : « Extremes ». Dans l’enceinte de la Philharmonie Luxembourg aux lignes aériennes sur les hauteurs du plateau de Kirchberg, rainy days donnera lieu à de nombreux concerts de musique contemporaine. Parmi les diverses pièces programmées, on peut en citer quelques-unes qui donneront une idée de la teneur expérimentale et enthousiasmante de l’événement. Dès 8 heures le samedi 23 novembre, une multitude de pianistes se relaiera dans le Grand Foyer pour jouer en boucle les Vexations d’Erik Satie : soit 840 fois, ce qui durera 1 740 minutes, sans entracte. En parallèle, Catherine Kontz et Xenia Pestova Bennett interpréteront au piano un extrait de Treatise de Cornelius Cardew, une des partitions graphiques les plus radicales : « come rain or shine », est-il précisé, puisque la performance aura lieu en extérieur, à l’Externer Veranstaltungsraum. La performance d’Insect Hotel de Claude Lenners, étrange célébration en une multiplicité de langues du monde des insectes en voie d’extinction, ou l’hommage croisé rendu au cinéaste soviétique d’avant-garde Dziga Vertov et au compositeur suisse Victor Fenigstein avec Scenes from Urban Life, ne sont pas moins prometteurs. Qu’il fasse beau, qu’il pleuve, des lueurs s’allumeront dans la tempête de l’Histoire.
Par Clément
Willer
— RAINY DAYS 2024, festival du 20 au 24 novembre à la Philharmonie Luxembourg, à Luxembourg www.philharmonie.lu

Maison ouverte
Pas de crise de la quarantaine pour la Kulturfabrik : ce haut lieu des cultures alternatives et populaires du Sud luxembourgeois fête ses quarante-et-un ans de la manière la plus débridée possible, comme à son habitude. Le mois d’octobre sera donc émaillé de concerts, expositions, pièces de théâtre, projections, lectures… et ça commence dès le 4, avec un week-end pour jouer, bruncher et écouter Godspeed You ! Black Emperor. L’esprit libertaire et festif de la « Kufa » se dévoilera lors d’une visite guidée, suivie de la projection d’un docu-fiction sur les origines du lieu, issu du mouvement squat. Niveau musique, on laisse les clés aux groupes locaux avec une soirée spéciale « We have the keys », on découvre le film Le Roi et l’Oiseau remis en musique par Chapelier Fou, on se laisse envahir par le metalcore de Ghostkid… Il y en aura pour tout le monde. Même pour les adeptes de karaoké ou ceux aimant les dimanches une bière à la main, avec animations et spectacles. On n’oublie pas les enfants avec une série de rendez-vous jeune public entre ateliers, danse et musique notamment. Le site, un ancien abattoir retapé amoureusement au fil des ans, multiplie les propositions artistiques et regorge de salles et recoins pour voir une expo, assister à un concert ou manger un morceau. Si vous ne connaissez pas encore, c’est l’occasion de foncer à la frontière.
Par Benjamin Bottemer
— LES 40 +1, festival du 4 octobre au 2 novembre à la Kulturfabrik, à Esch-sur-Alzette kulturfabrik.lu
Godspeed You! Black Emperor
Regardeurs
Le festival Entrevues, Robert Guédiguian et Laurent Desmet nous ouvrent au prisme de leur regard. Avec eux, les graines germent, les convictions amènent à l’émotion, et la lumière capture l’instant.

VOYAGE, VOYAGES
Par Nicolas Bézard
DE L’ESTAQUE FILMÉ PAR ROBERT
GUÉDIGUIAN AU BRONX DE NANCY
SAVOCA, DE L’APPARITION DE LA VAMP
SUR LES ÉCRANS AUX VISIONS DU TOURISME À TRAVERS LES ÉPOQUES ET
LES STYLES, LE FESTIVAL DU FILM DE BELFORT ENTREVUES NOUS EMBARQUE
POUR UN VOYAGE AUTOUR DE LA PLANÈTE CINÉMA.
Dénicheur de jeunes pousses devenues pour certaines des autrices et auteurs incontournables du paysage cinématographique actuel – Leos Carax, Claire Simon, Rabah Ameur-Zaïmeche ou Kelly Reichardt ont présenté leurs premiers films à Belfort –, Entrevues s’applique chaque année à primer l’audace et la fraîcheur des premiers gestes cinématographiques, quels qu’en soient le genre, l’origine géographique ou le format. Si la programmation des films en compétition cette année n’a pas encore été dévoilée au moment où nous écrivons ces lignes (elle le sera dans le courant du mois d’octobre), les grandes lignes de ce qui fait aussi l’attrait de ce festival fondé en 1986, à savoir ses sections parallèles, se dessinent doucement, livrant comme à leur habitude un contrepoint historique et thématique à la découverte des nouvelles forces vives du cinéma international.

Invité d’honneur de cette 39 e édition, Robert Guédiguian sera accompagné de sa troupe bien connue de fidèles collaborateurs et acteurs – Arianne Ascaride, Jean-Pierre Darroussin – et présentera en avant-première son nouveau long métrage, La Pie voleuse , dont la sortie en salle est attendue en janvier prochain. Il en profitera pour échanger avec le public à l’occasion d’une masterclass lui étant dédiée. Le cinéaste marseillais fera également les belles heures de la Fabbrica, rétrospective retraçant quarante années d’une filmographie protéiforme à travers laquelle l’auteur de Marius et Jeannette a su faire preuve d’une constance admirable dans la fidélité à des idéaux sociétaux, politiques ou amicaux, sans parler de son attachement quasi amoureux à la cité phocéenne, personnage à part entière de ses histoires.
Pour qui ne connaît pas encore l’audace et la vitalité des premiers films de Nancy Savoca, le festival constituera une aubaine, tant sa manière de briser les codes de genres bien institués dans la nomenclature hollywoodienne – à commencer par ceux de la comédie romantique, qu’elle a joyeusement dynamités – aura inspiré tout un pan du cinéma américain indépendant. Pour les autres, il permettra de se replonger dans l’œuvre aussi passionnante qu’injustement éclipsée de cette grande portraitiste de la communauté italienne de New York dont elle est issue, audacieuse dans sa manière de regarder les femmes et dénicheuse de
Dogfight, Nancy Savoca, 1991


pépites tels que River Phoenix, comète inoubliable à l’affiche de son Dogfight, en cette année 1991 où le regretté comédien tenait également le premier rôle de My Own Private Idaho, de Gus Van Sant.
Aux côtés d’un hommage rendu au cinéaste Laurent Achard, proche du festival et disparu trop tôt, en mars dernier, mais aussi d’une programmation « Cinéma & Histoire » consacrée à la figure de la Vamp dans le cinéma muet, la « Transversale » proposera une traversée de l’histoire du Septième Art vue par le prisme du tourisme et de ses multiples représentations filmiques. Une programmation généreuse qui empruntera à tous les styles, genres, continents ou époques, du premier King Kong de 1930 à The Darjeeling Limited de Wes Anderson, du célèbre Voyage en Italie de Roberto Rossellini à l’édifiant The World, de Jia Zhangke. Une thématique qui nous offre ici l’occasion d’interroger cette fabrique des images du voyage au cinéma, elle-même génératrice et pourvoyeuse de clichés, tout comme de penser notre propre rapport au monde et à l’altérité.
Car qu’apprend-on sur le tourisme lorsque celui-ci est mis en scène par le cinéma ? Sous son acception la plus largement connue et répandue, l’apparition de cette manière singulière de voyager, au xixe siècle, a précédé de peu celle du cinématographe par les frères Lumière, en 1895. L’immense nouveauté que constitue l’invention de cette façon inédite de dépeindre la réalité représente d’ailleurs, à cette période, une forme de voyage touristique en soi. En effet, le public se rue en nombre dans les endroits où ces « vues » sont projetées pour vivre des excursions virtuelles à travers la France, puis très vite à travers le monde entier, à la faveur d’opérateurs engagés par la célèbre fratrie pour parcourir le globe, en quête d’images exotiques teintées de fantasmes postcoloniaux.
En ces premiers temps du cinéma, nombreux sont déjà les films qui font du tourisme et de la figure du touriste leurs motifs principaux. Il faut dire que le prétexte du voyage touristique sous-entend la garantie d’un dépaysement, une promesse d’actions et de péripéties pour les personnages projetés en terre inconnue, comme dans The European Rest Cure d’Edwin S. Porter, réalisé en 1904, ou Le Coffret de Tolède que Louis Feuillade met en scène dix ans plus tard. En ce début de xxe siècle, le tourisme ne sert encore que de toile de fond narrative et visuelle aux productions cinématographiques. Un canevas déjà fortement mité par des clichés colonialistes, pour ne pas dire racistes. À ce propos, ne pas rater, dans cette « Transversale » imaginée par les équipes d’Entrevues, la projection d’Images d’Orient, tourisme vandale . À partir de prises de vues tournées en Inde dans les années 1930, ce long métrage documentaire dissèque les rouages cannibalistiques d’un tourisme de masse prenant sa source dans l’exploitation des peuples et territoires annexés, ici par la bourgeoisie britannique.
Quand le parlant supplante le muet et qu’Hollywood impose au reste du monde ses codes esthétiques, son glamour et ses stars, la figure du touriste s’écrit différemment. Elle passe de l’occidental naïf ou peu scrupuleux qui souhaite s’encanailler sans rien céder de son confort, au dandy globe-trotteur, playboy habile et hâbleur, artiste en quête d’inspiration ou riche héritière désœuvrée. La dynamique induite par le tourisme se prête idéalement à l’écriture d’un genre qui connaît alors son âge d’or, celui de la comédie romantique, avec nombre de chefs-d’œuvre où il est question de trouver l’âme sœur à l’occasion d’un séjour à Paris (Sérénade à trois, de Ernst Lubitsch), en Italie (Vacances romaines de William Wyler), ou
Voyage en Italie, Roberto Rossellini, 1954
The World, Jia Zhangke, 2004
sur le pont d’un paquebot en croisière (Elle et lui, de Leo McCarey).
Quand, au mitan du siècle, un souffle nouveau venu d’Europe balaie les recettes un rien éculées des grands studios américains, le corps estivant a comme perdu de sa superbe : c’est celui – guindé et froid – d’un couple d’aristocrates anglais malmenés par la foule éruptive de Naples dans Voyage en Italie de Rossellini, qualifié dès sa sortie par Jacques Rivette de « premier film moderne ». Cette terre qui tremble, étrangère, ses gens, ses mœurs, deviennent opaques et indéchiffrables aux yeux des peu amènes voyageurs, renvoyant ces derniers à leurs propres insuffisances ou contradictions. L’expérience touristique fait alors le deuil de la légèreté pour devenir le décor d’une profonde crise existentielle, identitaire, amoureuse, mais aussi, et c’est heureux, le lieu d’une possible révélation qui est également celle de cinéastes prenant soudain conscience qu’un tournage peut sortir des studios et s’émanciper du carcan trop rigide d’un scénario pour accueillir la vie sous sa forme la moins galvaudée.
Emboîtant en ce sens le pas à Rossellini qu’il admirait, Eric Rohmer a donné au séjour touristique un parfum irrésistible de charme, de sensualité et de malice. Dans certains films de ce dernier, l’occasion d’un week-end à la campagne ou d’un séjour en bord de mer sert en effet de théâtre à des instants de révélation et d’épiphanie. On pense à la vue du fameux « rayon vert » délivrant une juillettiste éplorée de l’impossibilité d’aimer, dans le film bien connu de l’auteur des « Comédies et Proverbes ».
Le motif du tourisme tel qu’il a vécu dans les imaginaires d’un Rossellini ou d’un Rohmer fait parfois l’objet de relectures inspirées par les auteurs contemporains – voir Voyages en Italie de Sophie Letourneur ou le passionnant cinéma de Ryusuke Hamaguchi –, même si c’est souvent par son versant le plus sombre, celui où il s’envisage comme une pratique délétère et consumériste, qu’il se pare d’une dimension édifiante prompte à inspirer des propositions se voulant radicales ou transgressives. S’il a remarquablement su montrer, dans Snow Therapy, cette culpabilité latente du touriste gentrifié et mettre au jour une mécanique de violence régressive inhérente au commerce de l’évasion, le réalisateur doublement palmé Ruben Östlund semble aujourd’hui regarder le monde avec les mêmes œillères que les nantis qu’il dénonce. Car au fond, le pire qui puisse arriver à quelqu’un qui voudrait raconter notre temps avec une caméra, c’est le regard touristique, celui qui ne

donne forme à rien et qui n’a pas de point de vue. L’ironie étant que le tourisme a souvent le dernier mot sur le cinéma, quand bien même celui-ci serait le fruit d’une expression libre et personnelle. En témoignent ces films qui, forts de leur succès, ont influencé ou déterminé des pratiques touristiques, promouvant telle ou telle destination ou instituant des lieux de tournage en attractions, à l’exemple de ces voyagistes proposant à leurs clients de revivre les scènes de Vicky Cristina Barcelona moyennant une visite guidée dans les rues de la capitale catalane…
En dernier ressort, la plus belle émotion liée à la mise en scène du tourisme au cinéma est peutêtre celle qui touche aux voyages immobiles, ces films sur l’impossibilité de partir et l’attente des départs sans cesse ajournés. Il faut alors toute la puissance poétique d’un grand cinéaste tel que Jia Zhangke pour donner à ces piétinements globalisés une dimension métaphysique et tragique, et nous faire comprendre que ce que l’on voit (dans The World : un parc d’attractions composé de répliques de monuments célèbres qui promet en quelques heures de vous faire découvrir le monde) peut s’interpréter comme une vertigineuse métaphore du cinéma – ce que le long métrage susnommé et la vingtaine de films l’accompagnant au sein de ce moment fort des Entrevues n’auront de cesse, pour le plus grand plaisir des festivaliers, de confirmer.
— ENTREVUES BELFORT, festival du 18 au 24 novembre, au cinéma Kinepolis Belfort, à Belfort www.festival-entrevues.com
Le Rayon vert, Eric Rohmer, 1983
ROBERT GUÉDIGUIAN CONVICTIONS ET ÉMOTIONS
Par Caroline Châtelet ~ Portrait : Florence Behar Aboudaram
DURANT ENTREVUES, ROBERT GUÉDIGUIAN ACCOMPAGNERA (AVEC SON ÉQUIPE) UNE DIZAINE DE SES FILMS, DONT LA PIE VOLEUSE, QUI SORTIRA EN SALLE EN 2025.
À découvrir à la Fabbrica 2024 – programmation qui, en donnant à voir la dimension collective du cinéma, déjoue les visions aussi erronées que réductrices induites par le star-system –, c’est peu dire à quel point il y a une évidence quant au choix de Robert Guédiguian. Car depuis son premier opus Dernier Été sorti en 1981 – film « sous influence » de Pier Paolo Pasolini –, la question du collectif est au cœur de son travail. Et qu’il s’agisse des histoires dépliées comme de leur fabrication, le cinéaste né à Marseille en 1953 a, en vingt-trois longs métrages, toujours été fidèle à ses racines. Ses racines sociales (populaires) ; politiques – sa pensée de gauche infusant les récits comme les pratiques ; géographiques –Marseille constituant le cœur de nombre de ses films, le quartier investi devenant le sismographe de la société française. Avec une tribu présente dès les débuts pour la plupart, qu’il s’agisse des interprètes (Ariane Ascaride dont il est par ailleurs l’époux, Jacques Boudet – décédé en juillet dernier –, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan) ; des équipes techniques (citons le chef monteur Bernard Sasia) ; ou administratives (comme le directeur de production Malek Hamzaoui), Robert Guédiguian fait des films que l’on pourrait dire « situés ». Dans un travail d’arpentage des formes, le cinéaste embrasse d’un film à l’autre une diversité de genres. Citons le polar pour Lady Jane (2008) ; le conte ou la comédie pour Marius et Jeannette (1997) et Les Neiges du Kilimandjaro (2011) ; le film historique dans L’Armée du crime (2009) ou Twist à Bamako (2021) ; le mélodrame pour Marie-Jo et ses deux amours (2002), etc. Et à travers des histoires intimes, il se raconte au fil des ans et des œuvres une bascule, avec la désagrégation d’une certaine classe ouvrière et sa recomposition sous d’autres formes et dynamiques, et l’installation du néolibéralisme. Cinéaste de convictions, Robert Guédiguian fabrique inlassablement un cinéma d’émotions. Rencontre.
Vous dites dans un entretien à la revue Vacarme (1998) que l’origine de vos films « n’est jamais une démarche intellectuelle, c’est toujours : “Qu’estce qui se passe autour de moi ?” » Quid de La Pie voleuse ?
De manière directe, consciente et joyeuse, c’est lié un peu à mon âge. La pie est une dame d’un certain âge qui s’occupe de gens encore plus âgés. Il y a dans ce film les trois « mandarins » de mon cinéma, Gérard Meylan, Ariane Ascaride et Jean-Pierre Darroussin qui ont exactement mon âge. Ces septuagénaires se remettent en selle dans une combinaison différente pour parler de choses ayant à voir avec l’air du temps. Darroussin dit d’ailleurs une phrase extrêmement importante à la fin du film, au sujet de « l’air du temps qu’il n’aime pas ». Cet air du temps contient depuis plusieurs années beaucoup d’envie, de jalousie, de cupidité, de recherche égoïste plutôt que collective. On le voit à travers ces personnages et leurs enfants – joués par la bande « de la seconde génération » (Grégoire Leprince-Ringuet, Robinson Stévenin, Lola Naymark), présente dans mes films depuis quelques années. Après, c’est plutôt un conte, une comédie, et qui se passe de manière rigoureuse et quasi exclusive à L’Estaque, dans le quartier où je suis né.
La majorité de vos films s’y déroulent, même s’ils sont tournés ailleurs…
Dès mon quatrième film, j’ai lancé ce « mot d’ordre ». Mes quatre premiers films étant alors programmés à l’Utopia-Champollion, à Paris, j’ai

— Je crois que le monde en général est rassuré de voir que la condition humaine est universelle.


commence un film, je suis en prise avec l’air du temps. J’y tiens beaucoup, car la fiction doit inclure de l’information en la dépassant. La narration permet de raconter le monde d’une manière moins explicative à travers la biographie et la vie intime de chaque personnage.
Qu’est-ce qui fait qu’un film va pencher du côté de la comédie ou, plutôt, de la tragédie ?
fait moi-même le dossier de presse. Par opposition au terme de cinéaste régional – je déteste cette expression parce qu’elle est mensongère et disqualifiante – je me suis qualifié de cinéaste de quartier. Il y avait là un double jeu de mots avec une allusion aux cinémas populaires de l’immédiat après-guerre – tels qu’ils existaient dans tous les quartiers de France et de Navarre –, et une référence au fait que je tournais non pas en Provence, mais à L’Estaque. Insister sur cette idée de cinéma de quartier était ce que j’avais trouvé pour communiquer sur mon travail – et ça a pas mal fonctionné. Sauf quand je m’écarte vraiment comme pour Le Promeneur du Champ-de-Mars (2005), Twist à Bamako ou L’Armée du crime, tous mes films tournés dans le Sud sont considérés comme étant à L’Estaque. Or c’est faux, j’y vais grosso modo une fois tous les dix ans – le précédent étant Les Neiges du Kilimandjaro. Je pense avoir besoin de retourner dans un rayon de 500 mètres autour de l’endroit où je suis né. C’est un peu comme la rue Vilin où Georges Perec allait chaque année faire l’inventaire écrit de ce qui avait changé. C’est mon inventaire : je vais faire le point sur ce qui m’a fondé, sur l’état du moment ouvrier, les nouveaux habitants, l’état physique, et sur ce qui demeure.
Si tout film capte quelque chose de l’air du temps, votre cinéma en saisit un air social et politique… Cette dimension fait partie de ma biographie. En tant qu’auteur, quand je parle de moi, je parle aussi de mon point de vue sur les choses aujourd’hui, sur l’ordre et le désordre social, et sur les possibilités de transformer ou pas cet ordre. Dès que je
C’est presque mon humeur. Comme tout le monde, je suis parfois dépressif et parfois drôle et joyeux, donc ça dépend un peu de cela. Il m’est même arrivé d’arrêter un projet – une comédie –quasi fini. Dans une crise atrabilaire, j’ai réalisé que je ne pouvais pas faire un film aussi réjouissant à ce moment-là, j’aurais eu honte de faire ça. C’était pire qu’inopportun et j’ai téléphoné à Valletti [Serge, co-scénariste régulier du cinéaste] pour lui dire « jette tout, on va écrire autre chose ». Comme les dates de tournage étaient calées avec les acteurs – à qui j’avais annoncé une comédie – nous avons écrit le scénario en six semaines pour tourner Gloria Mundi. Donc ça peut correspondre à des choses très particulières. Mais ce qui m’a mis dans cet état le jour où j’ai pris cette décision, je ne sais pas…
Vous ne croyiez plus vous-même au film ?
Je peux croire à l’histoire, mais pas à la nécessité de raconter le monde de cette manière-là – ç’aurait été mentir. Alors que pour faire des contes il faut cette nécessité. Après je suis clair avec le public, j’ai annoncé ce terme de « conte » pour un certain nombre de films. Mais je ne pense pas un instant que le monde soit comme ça. Juxtaposez Gloria Mundi et Marius et Jeannette et là vous obtiendrez la réalité du monde, qui est une tragi-comédie. Mais au cinéma, ou au théâtre, il faut, je crois, tirer les choses d’un côté ou de l’autre.
Vous évoquez le théâtre. Hormis un spectacle en 2000, vous n’avez jamais eu envie d’en monter ?
Le théâtre me plaît beaucoup, mais ne correspond pas à mon rythme de travail. Rester dans une salle toute la journée à reprendre une scène, faire des filages, ça me donnerait des ulcères. Je suis
Au fil d’Ariane, Robert Guédiguian, 2014 © Jérôme Cabanel
Marius et Jeannette, Robert Guédiguian, 1997
beaucoup trop nerveux et impatient, je déteste les répétitions. Alors je peux répéter une fois ou deux – enfin ceci dit, au cinéma je travaille sans répétitions et quand on a tourné, sauf accident, on ne retourne pas. Ce que je voudrais, c’est être en état de découverte permanent, comme si je ne travaillais pas. Alors qu’évidemment je travaille beaucoup, mais c’est différent. C’est arriver sur le plateau, voir les acteurs lire le scénario, jouer la scène, puis aménager leur proposition en la faisant rentrer dans les contraintes du cinéma (découpage, décor, lumière). Le théâtre, avec les répétitions, les tournées, est un art de la patience et de l’insistance, là où au cinéma c’est de la vitesse : on passe d’une étape à l’autre – écriture, tournage, montage, etc. – et ça ne dure jamais trop longtemps. On m’a proposé des séries – et dont certaines me plaisaient – mais j’ai toujours répondu que jamais je ne travaillerais un an et demi ou deux ans sur une série. Même là je m’ennuierais. Peut-être estce pour cela que je fais autant de films : je ne peux pas rester longtemps sur le même. Je suis peut-être un peu hyperactif… ceci dit on disait ça de moi à la maternelle !
Co-fondateur du collectif de production AGAT Films & Cie/Ex Nihilo vous défendez la proximité entre réalisation et production. C’est-à-dire ?
Je le pense vraiment. Produire, c’est être là dès le premier mot. C’est un tandem. Le producteur est celui qui lit toutes les versions du scénario, y met son grain de sel, fait des remarques. Quand c’est amical et qu’il n’y a pas de rapport de force, ce ne sont pas des impositions, seulement des suggestions. Puis il y a la préparation, le casting, le tournage, la sortie, les ventes à l’étranger. Le producteur est le seul avec le réalisateur à être là du début à la fin et en ce sens-là, ça se ressemble énormément.
Cette conception a à voir avec un cinéma entendu comme artisanat…
C’est sûr. Je déteste dans le cinéma tout ce qui s’apparente à une industrie. Ce système, ce rapport à l’argent – non pas la quantité, mais comment on le gère –, c’est tout ce qui me déplaît dans le cinéma. À Agat Films, nous avons produit plus de cinq cents films et majoritairement dans des conditions artisanales. Si, quelquefois, il a fallu nous soumettre à un fonctionnement plus « normal » du cinéma, ça ne nous a pas convenu. Nous ne sommes pas là pour être dans un rapport de force économique, mais pour travailler comme des artisans. Je suis très content d’avoir pu produire d’autres personnes et à travers tout ce que nous avons accompagné (des fictions au documentaire aux magazines culturels d’Arte), nous avons développé nos idées et nos conceptions du rôle de la culture, de la politique, des médias. Et je crois que je n’aurais pas pu faire que mes films.
Pourquoi ?
Ça, c’est un vieux complexe de classe. Je pense qu’un fils d’ouvrier ou de paysan ne peut pas dire « je suis un artiste ». Ce n’est pas possible. Il y a eu des tonnes de livres écrits sur le sujet, la philosophe Chantal Jaquet [qui a développé le concept de « transclasse »] a écrit en particulier là-dessus. Alors comme ça fait plus de quarante ans que je fais ça, ça me passe un peu maintenant. Mais quand même… Dire que je fais de la production, pour moi, c’est un métier, alors qu’être artiste n’en est pas un.
Ce serait quoi : un travail ?
Oui. Après, quand je dis cela c’est très subjectif, ce n’est pas du tout un jugement de valeur sur les personnes ayant une parole différente. Mais je vois des gens à qui il semble naturel de gérer des millions d’euros pour faire un film. Ce sont majoritairement des « fils de », des personnes dont les parents faisaient du cinéma ou des professions s’y apparentant. Il y a une chose assez évidente pour eux qui ne l’est pas pour moi. Ce qui ne veut pas dire que je considère que les artistes ne travaillent pas. Être artiste, c’est être obsessionnel, travailler jour et nuit. Mais je ne peux pas l’employer pour moi-même.
Comment avez-vous composé avec ce complexe de classe ?
Je pense l’avoir transformé en énergie, en détermination. Mais j’ai toujours eu l’impression d’être dans une situation de combat. Je me suis battu pendant quarante ans pour faire des films, les miens et ceux des autres. Même si aujourd’hui cela m’est plus facile, ça reste un combat. Je pense que grosso modo 95 % des personnes travaillant dans le cinéma – dans tous les métiers – sont des bourgeois. Donc je ne travaille pas chez moi, mais chez les bourgeois. Dans mes films, j’ai donné plusieurs fois la parole à mon père – pas de manière directe, mais symbolique –, en essayant aussi de montrer que le peuple, au sens de plèbe, avait autant de dignité et d’humanité (et peut-être même plus) que la bourgeoisie. Et qu’il était donc plus chargé de potentialités d’émotions en général. Cela m’a donné une force, liée aussi à mon rapport à la politique – qui s’est construit sur la possibilité de changements dans la société. Et le cinéma pouvait participer à cela. J’ai grandi dans l’Union de la gauche [qui se scelle lors du congrès d’Épinay-sur-Seine en juin 1971] et du programme commun [programme adopté en juin 1972 et réunissant le PS de François Mitterrand, le PCF de Georges Marchais, et le Mouvement des Radicaux de gauche de Robert Fabre]. Je milite au PC jusqu’à l’élection de Mitterrand et quand il est élu, je fais mon premier film. Mais de mes 17 à mes 27 ans – qui sont des années essentielles – j’ai cru dans la possibilité d’un changement politique radical et cela m’a donné une force, y compris dans la volonté de faire du cinéma. Parfois, le désamour envers ce que la bourgeoisie croit être m’a quasiment aidé. De manière structurelle et inconsciente, la bourgeoisie estime qu’elle a le mode de vie le plus juste et légitime et qu’il faut inculquer ces valeurs-là à tous les autres. Elle se pense le centre du monde, tout le reste (paysans, ouvriers, employés, vendeurs, infirmiers, personnes issues des colonies, etc.) n’étant qu’exotisme. Elle veut toujours être hégémonique et je ne l’aime décidément pas.
Dans cette perspective, Le Promeneur du Champ-de-Mars, sur la fin de la vie de François Mitterrand, est singulier. Comment aujourd’hui le regardez-vous ?
J’aime beaucoup Michel Bouquet et j’aime ce que je lui fais dire ! Déjà à la sortie du film, je disais que « mon » Mitterrand ressemblait plus à Che Guevara qu’à Mitterrand. Pourtant, j’ai utilisé à 90 % ses textes –soit des écrits que j’ai dialogués, soit des choses qu’il a dites, y compris sur la marche du monde, la lutte des classes, la littérature, etc. Mais ce qui m’intéressait c’était l’impuissance des puissants, comme chez Shakespeare où l’on voit le roi démuni, confronté à la vieillesse et à la

maladie. Les tragédies existentielles que sont la mort, la fuite du temps, la perte des amis, les puissants les traversent aussi. Si j’ai fait ce film, c’est peut-être pour mieux comprendre pourquoi la vie des puissants fascine le monde. Enfant, ma mère lisait France Dimanche – enfin je l’ai toujours vue le lire. Et déjà à dix, douze ans, je me disputais avec elle : « Qu’est-ce qu’on en a à foutre de la vie de la femme du chah d’Iran qui ne peut pas avoir d’enfants ? » Elle, elle haussait les épaules et continuait à lire, se fichant éperdument de ce que je disais – elle avait bien raison. Mais je crois que le monde en général est rassuré de voir que la condition humaine est universelle. En faisant ce film, je pensais souvent à la passion qu’avait ma mère pour la reine Fabiola…
Il y a dans vos films certains motifs récurrents, tels la présence des bars – qui renvoie, à sa façon, au cinéma d’Aki Kaurismäki…
C’est un ami, je suis allé chez lui en Finlande, nous avons participé à des jurys ensemble. Et c’est vrai qu’il y a des choses… Il est aussi un cinéaste de la rue, des pauvres, des quais, et, évidemment, des bars. Mais le bar dans le monde ouvrier des années 50-70 est très important. C’est la vie. Avec des ouvriers là dès le matin au café et qui reviennent pour l’apéritif et restent parfois un peu trop longtemps. Et en particulier dans le Sud avec la terrasse, qui est un seuil en prise direct avec la rue et ce qui s’y passe. Là se tissent beaucoup de choses, il peut y avoir de la solidarité, de l’entraide, des informations sur du travail. C’est un grand lieu de création du collectif et c’est vrai que c’est un espace que j’aime beaucoup. Étant né au-dessus du bar du Centre dans L’Estaque-Gare – ça ne s’invente pas – ces lieux me sont familiers. J’y allais avec mon père quand j’étais très jeune, j’en ai de très beaux souvenirs, et c’est une image qui me tient à cœur.
Un autre motif est la présence d’enfants – sorte de collectif évoluant en parallèle avec ses propres jeux, négociations, relations… C’est lié à une question biographique et pas théorique, comme le bar d’ailleurs. Au Midi, incontestablement. Dans le Sud, les enfants sont dans la rue, ils y jouent, ils sont rois. Même si, comme le bar, c’est un peu moins vrai qu’avant, néanmoins, ils ont une part d’autonomie et tout le monde les surveille. Ce rapport à l’espace et aux places publiques fait partie de ma vie et m’est nécessaire. D’ailleurs, cela fait cinquante ans que je vis à Paris et ça me manque toujours. Dès que j’arrive à Marseille, je vais boire un verre en terrasse et il y aura là trois gosses qui passeront, que les adultes regarderont. Après, je crois que j’ai toujours essayé de faire des films qui embrassent plusieurs générations mêlées. La question de la reproduction étant centrale pour moi – pas que de la reproduction de
l’espèce, mais la reproduction sociale, culturelle – cela m’est nécessaire. Si les fils se rompent, cela génère des états de guerre, des états belliqueux qui me font peur.
La politique, également, qui surgit par la parole, dans des dialogues…
Selon les films, il faut trouver les formes pour ça. Ce peut être drôle, et tout à coup un personnage dit quelque chose au comptoir comme une répartie comique. Mais parfois ce peut être très assumé, ou déclaratif, comme de l’agit-prop. Par exemple, dans Et la fête continue !, à la fin Ariane regarde la caméra pour réclamer plus de justice sociale avec Mozart en fond. Avec ce discours en adresse directe (que je pourrais dire personnellement dans un meeting), on n’est pas dans l’enchaînement psychologique de la vie du personnage. C’était un choix formel nécessaire à la structuration globale du récit, pour montrer une parole qui importe énormément pour l’ensemble de la narration.
On qualifie souvent votre cinéma de populaire. Comment recevez-vous ce terme ?
Pour reprendre la formule du metteur en scène Antoine Vitez, c’est l’« élitaire pour tous ». Cela signifie que les personnages sont populaires, ils sont issus du peuple et en font partie. Même si c’est un professeur, un toubib, ces personnes sont d’extraction modeste, et on leur prête toutes les passions du monde, les mauvaises comme les bonnes. J’ai toujours essayé et j’essaierai toujours de faire du cinéma populaire. Après, il y a des formes de cinéma qui ne le sont pas et que j’aime, mais personnellement je ne pourrais pas faire ça. Parce que mon père ne comprendrait pas mes films, et je ne peux pas tenir un discours que mon père ne comprendrait pas – évidemment, c’est métaphorique, mon père étant décédé. J’ai une règle par rapport à ça : dans tous mes films, il y a un fil narratif lisible par tous. Après je peux faire des digressions, mettre des couches polysémiques, sophistiquées, mais il y a quand même une narration, des personnages qui ont une trajectoire avec des péripéties. Pour moi, c’est la clé d’un film qui veut être vu – parce que je veux l’être. Je pense que si on estime qu’on a des choses à dire, si on a envie d’intervenir, on veut que beaucoup de gens assistent à cette intervention.
— LA FABBRICA FESTIVAL ENTREVUES, festival du 18 au 24 novembre à Belfort www.festival-entrevues.com
Et la fête continue, Robert Guédiguian, 2023 © Agat Films, BiBi Film, France 3 Cinéma
DÉPLACER LE SOLEIL
Par Valérie Bisson ~ Photo : Renaud Monfourny
On vous connait comme le fidèle chef opérateur d’Emmanuel Mouret, un travail qui vous a aussi valu deux nominations aux Césars. Quel a été votre parcours avant cela ?
Je suis né à Roubaix et rien ne me prédestinait à ce parcours professionnel. Je suis d’abord entré en faculté de sociologie et d’ethnologie à Lille, j’étais aussi inscrit en auditeur libre en cinéma jusqu’à la licence. Je faisais beaucoup de photo et j’allais beaucoup au cinéma, mais c’était un rêve, un peu de l’ordre de l’impossible. Alors que j’allais continuer mes études à Lille, la prof de cinéma Louisette Faréniaux m’a dit : « Vous savez, il y a quelqu’un à Paris qui fait du cinéma et de l’ethnologie, il s’appelle Jean Rouch… » À Nanterre, Jean Rouch ne prenait qu’une poignée d’étudiants. Je suis allé à Paris, j’ai d’abord fait mon année de maîtrise de sociologie, puis Jean Rouch m’a accepté en année de DEA puis en thèse que je n’ai jamais terminée. J’ai énormément appris auprès de cette figure importante du documentaire qui a influencé Jean-Luc Godard, entre autres, avec des films tels que Moi, un Noir, Jaguar, Les Maîtres fous. Jean Rouch était aussi directeur de la Cinémathèque française, j’y ai travaillé pendant deux ans comme objecteur de conscience. J’ai croisé par hasard un copain de Lille qui avait fait la Fémis, il m’a dit : « Fais-la ! » J’avais atteint la limite d’âge et je ne pouvais passer le concours qu’une seule fois, je l’ai passé et je l’ai eu !
C’est à la Fémis que tout a commencé ?
Oui et non, la Fémis formait au métier de chef opérateur, mais pas à celui d’assistant caméra qui est le seul poste auquel on peut prétendre au début. J’ai fait le job sur des films des aînés de la Fémis, mais ça ne m’intéressait pas beaucoup, je voulais vraiment être chef opérateur, alors je me suis présenté comme tel ! Et j’ai eu de la chance, j’ai pu travailler à l’école Le Fresnoy à Tourcoing, une école post-Beaux-Arts qui forme aux « films plus ou moins expérimentaux ». Il leur fallait absolument quelqu’un qui connaisse le matériel 16 mm. J’y ai travaillé sept ans par intermittence sur des courts métrages, et puis un ami que j’avais rencontré à la cinémathèque, Frédéric PARCE QU’ON OUBLIE
LUMIÈRE.
Niedermayer, m’a appelé. Il était devenu le producteur d’Emmanuel Mouret qui m’a choisi sur ses conseils pour Changement d’adresse. On débutait tous et on s’est très vite liés d’amitié. Quand s’est posée la question du deuxième, Emmanuel s’est dit OK, on va continuer de grandir et d’apprendre ensemble. Depuis, j’ai fait tous ses films, j’ai une chance inouïe d’avoir rencontré un réalisateur qui vous garde aussi longtemps. J’ai la chance d’avoir la même complicité pérenne avec la réalisatrice Sarah Leonor.
À quel moment la photo s’est-elle imposée à vous ?
J’ai rencontré le processus photographique très jeune, dès l’âge de six ans, mon père était photographe amateur et faisait beaucoup de films 8 mm. J’ai fait beaucoup de labos, j’adorais ça. Au lycée, il y avait des groupes de rock et il y avait ceux qui ne faisaient pas de musique. Je photographiais les copains qui en faisaient. J’aime l’instant, le moment fugace, ça raconte quelque chose, parfois les lieux, la lumière suffisent.
Comment préparez-vous les repérages ?
Avec Emmanuel Mouret, on passe beaucoup de temps à se balader dans les endroits pressentis, on ne dit jamais non à un lieu. Les scénarios d’Emmanuel sont peu écrits, en dehors des dialogues, on s’adapte en fonction de ce qui s’offre à nous, pas de ce qu’on cherche. Dans Trois amies, on avait une séquence au parc de la Tête-d’Or, un

long travelling était déjà installé et il y a eu une alerte tempête, le parc a été fermé. On est sortis du parc et, au final, on a tourné dans une rue pleine de vie qui fonctionne peut-être mieux par rapport à la scène ; la contrainte et l’errance nous ont rendu service. Pour Mademoiselle de Joncquières j’ai passé une semaine à arpenter le parc du château ou nous tournions et à repérer les mouvements du soleil. Ensuite, on se déplaçait en fonction pendant le tournage. La lumière naturelle est à mes yeux ce qu’il y a de plus beau, mais aussi de plus difficile à maîtriser au cinéma, car fugace par nature. Pour Et il devint montagne de Sarah Leonor, je suis resté sur place pendant un mois à faire des plans, alors qu’on a tourné en cinq jours avec l’équipe complète.
Lumière omniprésente, claire et puissante sans jamais être agressive, ostentatoire ou froide, comment parvenez-vous à restituer ce paradoxe, cet équilibre, entre douceur et éblouissement ?
Il y a d’abord un goût personnel forgé à la cinéphilie de mes années à la cinémathèque. Un goût que l’on partage avec Emmanuel Mouret, notamment sur les films de Truffaut ou Woody Allen… Un penchant pour la douceur sur le visage des acteurs et actrices. Il y a ensuite des choix techniques depuis que l’on tourne en CinémaScope. On a tourné en CinémaScope pour la première fois sur Mademoiselle de Joncquières avec de vieilles optiques carrossées à la main. Il n’y en a jamais deux identiques, c’est un peu la loterie et comme c’est extrêmement compliqué à avoir,
on ne sait jamais si on va avoir un bon ou un mauvais numéro. Pour Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait, on a pu avoir des optiques qui étaient jusque-là gardées dans un musée ! Ces optiques anciennes donnent de l’approximation contrairement aux techniques d’aujourd’hui où tout est calculé par ordinateur. On a plus de sensibilité aux lumières parasites, plus de flare, moins de définition… À la Fémis, on nous apprenait à tout nettoyer, il ne devait surtout pas y avoir de flare, mais nous on adore ça ! Le numérique a tendance à être extrêmement défini et peu flatteur sur un visage, on essaye au contraire d’apporter quelque chose de plus doux, de moins dermatologique. J’ajoute aussi un filtre pour vraiment casser le contraste.
Quelles sont vos sources d’inspiration en photographie ?
Je suis d’abord très cinéphile, j’ai regardé énormément de films, j’analyse, j’essaye de comprendre. J’aime beaucoup Gordon Willis, le chef opérateur des premiers Woody Allen, on y fait souvent référence avec Emmanuel puisqu’il y a énormément de paroles et qu’on ne montre pas toujours les gens en train de parler, on trouve autre chose à faire, on ne fait pas non plus forcément de plan serré quand quelqu’un pleure. Dans Mademoiselle de Joncquières, la scène du baiser est filmée de loin, on essaye d’éviter le surlignage. Sinon je viens du documentaire et j’ai appris à « faire avec rien ». Nestor Almendros est un des premiers à avoir travaillé en lumière naturelle avec Rohmer, il est aussi le premier Français à avoir eu l’Oscar à Hollywood pour Les Moissons du ciel, c’est juste splendide. Néstor Almendros avait un assistant caméra qui s’appelle Philippe Rousselot, le chef op’. de La Reine Margot, vous pouvez le voir 600 fois, vous ne saurez jamais comment il a fait, même s’il y a des making of. Il existe aussi un petit livre qui s’appelle La sagesse du chef opérateur de ce même Philippe Rousselot, un livre que j’aurais aimé écrire.
— TROIS AMIES, Emmanuel Mouret
Envers du décor
Dans un esprit de préservation autant que de décloisonnement, Nathalie Béasse donne voix à la matière ; Rubén Julliard s’empare du Casse-Noisette ; Florence Martin prend les commandes de la Cité musicaleMetz ; la Comédie de Colmar fait le mur ; et Alice Laloy manipule les codes du game.

L’ÉTOFFE DES RÊVES
Par Valérie Bisson
POUR ÉVOQUER VELVET, UNE PIÈCE HYBRIDE CRÉÉE PAR NATHALIE BÉASSE, EN RÉSIDENCE AU MAILLON, IL FAUT POUVOIR SAISIR
L’INFRAMINCE ET FAIRE CORPS AVEC LA MATIÈRE.

Dialoguer avec Nathalie Béasse ne se résume pas à simplement évoquer un parcours et des techniques, au fil des mots, l’artiste nous fait très vite entrer dans un monde sensible fait de résonances, d’images et de sensations.
Votre spectacle velvet convoque à la fois théâtre, danse et arts visuels ; comment parvenez-vous à associer tous ces univers ?
J’ai été formée aux Beaux-Arts d’Angers avec une option en arts visuels, mais mon vrai point de départ, mes envies, mes rêves, c’était de monter des films. Quand j’étais adolescente, j’allais voir plein de films au festival Premiers Plans à Angers, ainsi que des cycles de cinéma italien, norvégien, allemand… Je me suis beaucoup nourrie de cette matière-là. Étudiante, j’ai continué à en voir beaucoup puis, lors d’un échange artistique en Allemagne, on m’a demandé d’être performeuse, pas du tout ce dont j’avais envie, mais j’ai découvert le travail autour du corps et de l’espace, ce qui, petit
à petit, a pris plus de place dans mon travail de plasticienne-vidéaste. À la fin de mes études, j’ai voulu creuser cet aspect et je suis entrée au conservatoire, mais je sentais que ce n’était pas complètement pour moi. J’ai ensuite travaillé avec le collectif ZUR (Zone Utopiquement Reconstituée) qui mêlait les arts de la rue à des images poétiques, convoquant à la fois le spectacle vivant, le cinéma, l’installation. Et puis j’ai voulu monter une compagnie pour raconter mes histoires et ça dure depuis plus de 20 ans…
Vous avez dit lors d’une interview avoir mis du temps à prendre conscience du fait que vous aviez un corps…
Je crois que cette matière-là, le corps, est à la fois un espace, une image, une musique, et je traite tout sur un même niveau ; je prends tout à bras le corps, dans tous les sens du terme. Quand j’essaie d’avoir une vision globale du plateau, je compose sur des thématiques récurrentes avec des choses qui se creusent, qui se révèlent, qui s’approchent. J’ai fait des spectacles très différents, des adaptations de textes comme Richard III, des pièces plus visuelles et d’autres plus fragmentaires, plus poétiques. Les formes varient, mais ce qui me plait véritablement, c’est d’être dans ce rapport au sensible, à l’imaginaire, d’ouvrir d’autres portes que celles de la narration classique. Le théâtre est une matière qui vibre avec son public, tous les sens sont développés. Quand j’étais étudiante, j’étais beaucoup assise, face à un écran ou une feuille, et il y avait une sorte d’oubli de sa chair, de la matière dont nous sommes faits. Après l’expérience très intense avec les camarades allemands qui avaient eu Marina Abramović comme enseignante, ce n’était plus possible de faire sans mon corps. Aujourd’hui, je relie le corps et la tête, nos pieds sont ancrés dans la terre et la parole est mouvement. C’est aussi pour cela que mes comédiens dansent autant que la danseuse, que j’essaie de casser les codes, de faire vivre la machinerie, celle du corps et celle du théâtre.
Vous vous êtes emparée de ce chemin sensible pour en faire une nouvelle matière ? C’est le propos de velvet ?
Quand on est arrivés au Maillon au printemps, on était encore sur une période de recherche scénographique. Le lieu est idéal avec le grand plateau, techniquement avancé, un espace magnifique pour faire des recherches et développer cette idée d’habiter la scène. J’ai apporté des éléments de mes anciens spectacles comme s’il s’agissait d’un personnage. Le velours a été le seul décor de la plupart de mes spectacles : une boîte de rideaux blancs pour happy child , rideau gris pour roses , vert pour le bruit des arbres qui tombent, moutarde pour wonderful world… Pour velvet, ils sont tous réunis. Cette matière textile intemporelle réchauffe, elle est douce, impose sa noble histoire, évoque les drapés de la peinture italienne. La forme parfois crée le fond et j’avais vraiment envie d’être dans cette idée de fantôme, de traces… velvet est aussi très inspiré d’une peinture de Whistler qui représente une femme habillée de blanc devant un rideau blanc, cela a été l’un des points de départ du spectacle. À partir du moment où quelque chose résonne très fort, il faut s’y accrocher, sans être ni dans la figuration, ni dans l’illustration, ni dans l’intellect, mais plutôt en cherchant à affiner l’écho sensible que ça a réveillé. À partir de là, j’ai eu très envie de faire l’inverse de ce que j’avais déjà fait, aller explorer derrière le rideau, l’inconscient, la frontière avec l’illusion, le paraître. Je ne suis pas costumière, mais j’aime les étoffes, la frontière est là. Je choisis les costumes et chaque matière est importante parce que c’est une vie à chaque fois, qui fait aussi lien avec mes précieux interprètes qui sont dans cette grande fluidité et cette disponibilité à entrer dans tous ces inconscients-là.
— VELVET, théâtre les 6, 7 et 8 novembre au Maillon, à Strasbourg maillon.eu
Velvet © Nathalie Béasse
TROIS QUESTIONS À… RUBÉN JULLIARD
APRÈS UN PARCOURS
INTERNATIONAL, RUBÉN
JULLIARD A REJOINT
LES RANGS DU BALLET DE L’OPÉRA NATIONAL DU RHIN.
CETTE SAISON, LE JEUNE
DANSEUR ET CHORÉGRAPHE
SE MET AU SERVICE DU SOMMET DU RÉPERTOIRE
POST-ROMANTIQUE QU’EST CASSE-NOISETTE.

Par Valérie Bisson ~ Photo : Marina Terechov
En revenant à l’esprit fantastique du conte original d’E. T. A. Hoffmann, sur l’inoubliable musique de Tchaïkovski interprétée par l’Orchestre philharmonique de Strasbourg, Rubén Julliard offre une version moderne du ballet sans rien trahir de la magie de l’enfance.
Comment s’empare-t-on d’un monument de la danse et de la musique classiques tel que CasseNoisette à seulement 33 ans ?
J’ai la chance d’avoir eu une formation classique et pendant mon passage aux Grands Ballets Canadiens de Montréal, j’ai pu danser CasseNoisette un grand nombre de fois. La tradition du « spectacle de Noël » est très nord-américaine ; au mois de décembre, on fait salle comble pendant vingt-cinq dates. J’ai dansé Casse-Noisette pendant sept ans, j’en ai visité tous les rôles possibles, je ressens toutes les inflexions de la musique, je connais l’histoire par cœur. Je peux ressentir diverses émotions à partir du moment où la musique commence parce que j’en ai vécu tellement sur scène que mon imaginaire est très vite mobilisé, mais c’est aussi un point négatif, car le plus difficile a finalement été de réussir à se détacher de la version que j’ai dansée plus de cent cinquante fois. L’idée du projet est arrivée au moment du Covid, il n’était d’abord question que d’un petit extrait, puis tout le spectacle s’est imposé…
Pouvez-vous nous parler de votre passage de danseur soliste à chorégraphe ?
La création chorégraphique est arrivée assez tôt dans ma carrière, cela m’a énormément plu. À Montréal, à chaque saison, nous avions l’opportunité de « cartes blanches » pour se vivre chorégraphe, régisseur ou éclairagiste pour une soirée. Pendant ces années, j’ai aussi eu d’autres opportunités et j’ai toujours essayé de trouver du temps libre pour créer. C’est un vrai besoin dont je m’étais aussi ouvert à Bruno Bouché dès mon arrivée dans la compagnie des Ballets du Rhin, il m’était important d’être certain que j’allais pouvoir continuer à travailler cet aspect du métier. Me retrouver devant des danseurs pour créer est devenu assez naturel, il n’y a pas de stress. L’aspect studio, le partage, la création font totalement partie de qui je suis aujourd’hui. S’emparer de Casse-Noisette n’est pas un saut dans le vide. Danseur ou chorégraphe, j’ai du mal à me mettre une étiquette, idem pour le style classique ou contemporain, on peut se permettre de faire les deux et se sentir légitime de le faire. On peut ainsi mieux respecter la technique, ne pas demander des choses impossibles. L’avantage d’être ici aux Ballets du Rhin depuis six ans, c’est que je connais
les danseurs. Le casting n’est pas plié en deux heures, c’est une observation, une lente maturation. Le travail se fait dans un échange, on mélange les styles, on utilise les atouts de tout le monde et on les met en avant, ça crée de la richesse. Et puis comme tout se passe dans le corps, on ne développe pas des hiérarchies très appuyées… Mais je garde en tête le mentorat de Stephan Thoss qui avait le travail, la générosité et l’exigence pour guide.
Quels ont été vos partis pris pour réinterpréter cette œuvre phare ?
Il y a eu une phase de déconstruction importante, j’ai travaillé pendant plus de six mois avec ma dramaturge Éline Malègue, elle était avec moi aux Grands Ballets de Montréal et elle a dansé Casse-Noisette au San Francisco Ballet ainsi qu’à l’Opéra de Paris où elle était élève. Elle le connaît par cœur. Nous avons eu ensemble un temps de transformation de l’histoire sans jamais vouloir la dénaturer au point de ne plus la reconnaître. Nous voulions la retravailler pour qu’il y ait une signature. Le plus gros challenge a été celui-là : anticiper ce qui allait se passer en studio, ne faire l’impasse sur aucun point important, sur aucune question. C’est à partir de la dizaine de pages du script que nous avons vraiment commencé à créer une nouvelle trame narrative sans défaire l’ancienne ni trahir l’imaginaire collectif. Le respect du « pays de Noël » qu’est l’Alsace faisait aussi partie de l’enjeu. Les partis pris sont très contemporains, l’envie d’avoir un couple de narrateurs, une voix dialogique du début à la fin de l’histoire. On a aussi fait l’impasse du Prince au bénéfice du Cassenoisette, cet automate à taille humaine, qu’on garde tout le long du ballet. À côté de ça on va avoir les personnages des rats qui vont être très terriens, avec beaucoup de travail au sol, plus contemporain, aux côtés d’un travail de pointe très classique et très pointilleux des ballerines des boîtes à musique. On reste aussi avec Clara tout au long de son passage initiatique qui réserve autant de surprises chorégraphiques que scéniques. Chaque détail a été soigné, je me suis attelé à tous les aspects de la création, ce qui est aussi un engagement pour chacun, danseurs, techniciens et public.
— CASSE-NOISETTE, danse du 6 au 13 décembre à l’Opéra national du Rhin, à Strasbourg, et du 20 au 23 décembre à la Filature, à Mulhouse www.operanationaldurhin.eu
ENTRÉE DANS LA CITÉ
Par Benjamin Bottemer ~ Photos : Romain Gamba

FLORENCE MARTIN EST LA NOUVELLE
DIRECTRICE ARTISTIQUE DE
En cette fin du mois d’août, le calme règne à l’Arsenal : une période que Florence Martin met à profit pour rencontrer ses nouveaux collègues, écouter beaucoup de musique et nous accueillir pour évoquer sa nouvelle aventure. En avril dernier, elle a pris la suite de Michèle Paradon, la directrice
artistique historique en place depuis l’ouverture de l’Arsenal en 1989. Pour Florence Martin, pas question de faire table rase : « Il s’agira de conserver l’existant sur les traces de Michèle et de l’Orchestre, qui ont su attirer un public nombreux qui a ses attentes, et aussi proposer autre chose pour convaincre un nouveau public. »
Aux manettes d’une programmation de deux cents concerts par an, les occasions seront multiples, à l’Arsenal, aux Trinitaires et à la Boîte à Musiques (BAM), rassemblées depuis 2016 en une entité unique, la Cité musicale-Metz. L’arrivée de la nouvelle directrice artistique acte un nouveau rapprochement : le rattachement de l’Orchestre national de Metz Grand Est (ONM) à la structure, avec une direction artistique mutualisée. Si l’expérience accumulée par Florence Martin au sein de l’ensemble luxembourgeois Lucilin sera précieuse dans ce cadre-là, celle-ci fait plutôt valoir son attrait pour l’éclectisme et le travail en équipe, avec l’envie de jeter des ponts entre les publics. Indispensable pour une Cité musicale où des concerts de metal dans une chapelle, de hip-hop dans une BAM de 1 100 places, de musique baroque ou symphonique s’affichent sous la même bannière. « Pour un tel poste, il faut aimer toutes les musiques, on ne peut tourner qu’à ça », formule-t-elle.
VOYAGES INITIATIQUES
Pendant son enfance près d’Angers, Florence Martin se fascine pour les grands concerts symphoniques à la télévision, les concertos de Rachmaninov et de Tchaïkovski, les affiches du festival de La-Roque-d’Anthéron… Pianiste depuis son plus jeune âge, elle n’a jamais rêvé d’être sur scène, mais plutôt de passer de l’autre côté du miroir. Elle suivra un cursus à Sciences Po Rennes, car « ce sont des études qui peuvent ouvrir beaucoup de portes et permettent d’aller dans de nombreuses directions ». Pour son stage à l’étranger, elle prend celle de Berlin et du prestigieux Konzerthaus. Durant un an, elle va au concert plusieurs fois par semaine et découvre le fonctionnement d’une institution vénérable, puis déménage au Luxembourg pour participer à la création de la Philharmonie et à sa première saison. « C’était génial de travailler au Konzerthaus, qui fait partie de l’histoire de la musique symphonique, à
l’époque encore un peu marquée par l’esprit de l’exRDA, puis de passer à une nouvelle salle qui laissait des espaces à une musique contemporaine plutôt radicale, aux musiques du monde, au jazz, dans un pays très cosmopolite », raconte Florence Martin. En 2007, elle relève un autre défi en devenant directrice de production puis co-directrice de l’ensemble Lucilin. Auprès de son fondateur Guy Frisch, elle défend la musique contemporaine auprès du public et des politiques, avec la volonté d’imposer un ensemble national au Luxembourg, avant d’accompagner son développement à l’étranger. « Pendant cette période, j’ai beaucoup voyagé, découvert énormément de musiciens, de compositeurs, avec un orchestre tourné vers l’expérimental comme le grand répertoire », décritelle. « Nous étions tous des passionnés, et on prenait les décisions de manière collégiale. »
LES GOÛTS DES AUTRES
Une dynamique collaborative qui s’applique également à la Cité musicale-Metz, à commencer par l’ONM : chargée de proposer des œuvres aux compositeurs invités, Florence Martin intègre également la commission de l’Orchestre, qui choisit les pièces jouées par celui-ci. La nouvelle direction artistique mutualisée permettra « d’optimiser » le travail avec l’Arsenal, d’éviter les doublons avec deux responsables différents pouvant avoir les mêmes idées. En termes de musiques actuelles, elle peut compter sur Patrick Perrin, programmateur de la BAM et des Trinitaires, sur Sibylle Brunot pour le jeune public… Intégrée au sein de cette grande machine, Florence Martin a-t-elle le sentiment d’un changement d’échelle après son aventure avec Lucilin ? « On sous-estime le volume de travail et de responsabilités dans les petites structures, répond-elle. Avec Lucilin, je faisais cinq ou six jobs en même temps ! Ici aussi j’ai beaucoup de responsabilités, mais avec un poste concentré sur l’artistique et le concours d’une vaste équipe. »
Depuis sa création, la notion de passerelle entre les salles, les genres et les publics est au cœur de la politique de la Cité musicale-Metz. Pour Florence Martin, « l’idée n’a jamais été de tout mélanger, ce n’est ni souhaitable ni pertinent ; mais brouiller un peu les pistes peut permettre de montrer toutes les nuances de la musique. Le plus intéressant est de faire voyager les publics, pour qu’ils ne se sentent pas appartenir plutôt aux Trinitaires ou à l’Arsenal. » Ayant œuvré à « décloisonner la musique contemporaine » avec Lucilin, la directrice artistique souhaite-t-elle poursuivre dans cette voie à Metz ? « Je le souhaite, et pour cela il faut travailler
sur les formats, aller au-delà du concert 100 % contemporain », avance-t-elle. « Dans un festival, on peut y aller à fond, car on a affaire à un public de convertis ; dans une salle comme la Cité musicale, il faut aller le chercher. Avec son répertoire symphonique et contemporain, l’ONM peut faire découvrir beaucoup de choses, notamment une nouvelle génération de compositeurs influencés par la drone music, le baroque, les musiques du monde… »
NOUVELLES CLÉS
La direction artistique est un travail d’équilibriste : associer l’audace et l’exigence à des concerts plus fédérateurs, conserver les spectateurs historiques et en inclure de nouveaux… il s’agit aussi d’imprimer sa marque. « La direction artistique, c’est aussi faire des choix sans savoir si le public va y adhérer : il est important de conserver sa sensibilité, ou bien on prend le risque de livrer une programmation sans âme », précise Florence Martin, dont la volonté de repenser les formats ne se limite pas à la musique contemporaine : « Je pense par exemple à une offre multiple, une grande invitation où avec un seul billet on pourra venir découvrir des propositions différentes sur une même journée. » Elle considère aussi les cinéconcerts comme un bon moyen d’attirer un public plus large, souhaite programmer plus de spectacles de danse avec de la musique live et proposer des thématiques axées sur des questions de société. « Tous les musiciens, du rap à l’opéra, se saisissent de ces sujets-là », fait-elle remarquer. « Cela pourrait permettre de faire de la Cité musicale une cité au sens premier du terme : un lieu où l’on vient réfléchir et échanger sur le monde qui nous entoure. » Des idées qu’elle pourra mettre en œuvre au sein de sa première saison, dès septembre 2025. Pour nous raccompagner, Florence Martin se saisit de son imposant trousseau de clés, où tintent tous les sésames de la Cité musicale. Elle y a accroché un porte-clé représentant Mafalda, le personnage créé par Quino, souvenir d’une tournée en Argentine avec Lucilin. Comme le symbole d’une transition au fil d’une vie consacrée à faire entendre la musique.
— CITÉ MUSICALE-METZ, www.citemusicale-metz.fr
BEAUCOUP DE BRUIT POUR BIEN
POUR LE HORS-LES-MURS DE LA COMÉDIE DE
COLMAR, LA METTEUSE EN SCÈNE MAËLLE
DEQUIEDT INVITE LA REMUANTE, BRUYANTE ET JOYEUSE JEUNE TROUPE À FAIRE LE MUR À PARTIR DE FRAGMENTS SHAKESPEARIENS.
Indisciplinée, la jeune troupe #4 de la Comédie de Colmar – récemment sortie d’une école de théâtre – ne se laisse pas facilement capturer par l’appareil d’Anaïs, notre photographe. Le trio infernal s’échange bisous et caresses, alterne grimaces monstrueuses et sourires Ultra Brite , bondit, bouge dans tous les sens. La jeune troupe est une originalité colmarienne (mutualisée avec le Centre dramatique national de Reims), un « souffle d’air frais et de joie vive », selon Émilie Capliez, codirectrice de la Comédie et metteuse en scène du Château des Carpathes , « la » création maison de la saison à laquelle François Charron, Rayan Ouertani et Léna Rossetti sont associés. Émilie : « Les trois jeunes ont des sensibilités et identités différentes, mais ils ont en commun une capacité d’investissement et d’adaptabilité à des projets sur la durée de toute une saison. » Impeccable ambassadeur de la Comédie, « ce beau trio est déjà très populaire auprès des Colmariens ».
UN PARFAIT CASTING…
… validé par Maëlle Dequiedt qui met en scène Faire le mur, dans le cadre du dispositif itinérant « Par les villages » alsaciens. Très librement inspiré du Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare, ce spectacle qui sera joué dans les salles des fêtes des alentours colmariens se construit en intelligence avec les trois jeunes interprètes, « intégrés dans le processus de création », d’après Maëlle et son dramaturge Simon Hatab. Les passages du Songe choisis par eux évoquent des néophytes, artisans de profession, contraints de monter Pyrame et Thisbé Ces amateurs vont « bricoler » un spectacle en se posant des questions essentielles : « Quelle relation au public adopter ? Comment exposer la violence au plateau ? » Simon : « Notre pièce est une réponse poétique aux défis lancés par Shakespeare qui demande à ses comédiens de dépasser le réel et de jouer la lune ou un mur, avec peu de moyens. »

Par Emmanuel Dosda ~ Photo : Anaïs Connac

COMME LES DOIGTS DE LA MAIN
Durant notre entretien, François, Rayan et Léna ne cesseront de se masser mutuellement « le point de tension » des mains, soit « la poubelle du corps ». Même vidé de son stress, le trio se chahute, se marre, imite le rugissement du lion, fait beaucoup de bruit et de bien. Les trois se bagarrent pour le titre honorifique de « clown de la bande » et ont d’autres points communs : François, Rayan et Léna ont très tôt été touchés par le virus du théâtre, souvent avec le rire comme porte d’entrée. Léna tempère : « On n’apprend jamais aux femmes à êtres drôles ! Elles peuvent être touchantes, mais pas marrantes. Ceci dit, comme je suis sensible, je peux aujourd’hui aisément passer du rire aux larmes. » C’est une aubaine pour la création d’Émilie Capliez où l’on hésite entre frousse et poilade, et pour Faire le mur qui floute les frontières émotionnelles, « sur le fil entre comique et tragique », selon Maëlle Dequiedt. Autres atomes crochus : un bluffant talent musical à découvrir durant la création de Maëlle, une réelle « porosité » vis-à-vis du monde et des gens qui les entourent, le désir intense de se « rendre disponibles au moment présent » et de « faire corps ». Avec ou sans massage manuel.
— FAIRE LE MUR, théâtre du 3 au 6 décembre à la Comédie de Colmar, à Colmar
Par les villages (du 5 novembre au 7 juin) à Zimmerbach, Orbey, Eguisheim, Kunheim, Sundhoffen, Vogelgrun, Munster, Rombach-Le-Franc, Muntzenheim, Turckheim, Thannenkirch, Andolsheim, Aubure
— LE CHÂTEAU DES CARPATHES, théâtre du 27 février au 8 mars à la Comédie de Colmar
— ENCRAGES #5, spectacle amateur dirigé par Thierry Simon et Léna Rossetti les 19 et 20 juin à la Comédie de Colmar
Léna jouera dans les deux Courts-circuits mis en scène par Matthieu Cruciani : l’un sur le harcèlement scolaire, l’autre sur la peur et le mystère (d’après Stephen King)
comedie-colmar.com
ALICE LALOY LE JEU ET SON ENVERS

Par Caroline Châtelet ~ Photo : Simon Gosselin
AVEC LE RING DE KATHARSY, LA MARIONNETTISTE
METTEUSE EN SCÈNE ALICE LALOY ENTRELACE
LES CODES
DES JEUX VIDÉO AUX CONVENTIONS THÉÂTRALES POUR
EXPLORER LA QUESTION DE LA MANIPULATION.

Pour cette nouvelle création, l’artiste réunit des interprètes issus de diverses disciplines – cirque, danse, jeu, musique, chant – et tisse les médiums. Ce faisant, elle imagine avec son équipe un spectacle aux allures de jeu. Un drôle de jeu, régi par ses règles comme par ses arbitres, et proposant quatre matchs où des personnages, tels des avatars de jeu vidéo, vont s’affronter sous la direction de « vrais » joueurs. Mais où s’arrête le jeu et où commence la manipulation, voire, l’exercice d’une domination ? Comment notre environnement nous pousse-t-il à accepter ou à faire subir des dispositifs de pouvoir ? Rencontre avec Alice Laloy.
Vous êtes dans la dernière ligne droite avant la création du spectacle. Voyez-vous la première comme un moment de « stabilisation » du travail ?
Actuellement nous travaillons sur des ajustements entre tous les paramètres et éléments réunis sur ce spectacle (la conduite des écrans, celle du son, celle des acteurs, des actions, des objets). Après, même si évidemment il faut que la forme se tienne, il n’est pas question pour moi de « stabiliser », je ne cherche pas cela. La recherche n’est jamais stabilisée et un spectacle, lorsqu’il se joue, révèle toujours de nouvelles choses. C’est plus une question de maturité. J’accompagne mes spectacles le plus possible et j’adore continuer à nourrir le dialogue avec les équipes. Il y a des choses qui m’apparaissent à moi comme aux interprètes plus tard. Un spectacle est un corps organique qui mûrit et il m’importe que chaque création continue de se réinventer.
Comment la présence d’une pluralité d’éléments, comme d’interprètes de diverses disciplines, s’est-elle affirmée ?
Cela s’est fait par nécessité. Je suis partie d’un travail où je séparais les corps des voix et c’est à partir de cette expérience de dissection et séparation – comme pour la marionnette où l’un interprète la voix, tandis que l’autre manipule le corps – que je suis arrivée à l’idée de fabriquer des figures par dédoublement. Pour concevoir ces avatars extra-humains et parvenir à obtenir ces présences très plastiques, il était primordial d’avoir des personnes sachant manier leur corps et d’autres maîtrisant leur voix. Après, il y a toujours dans mon travail une multiplicité de médiums et de disciplines. Ce qui est nouveau ici c’est le rapport à la vidéo et aux écrans – une présence liée au match, permettant de compter les scores, les bonus, le temps. Si c’est une dimension nouvelle pour moi, c’est juste un paramètre supplémentaire pour m’emparer de cette dimension de l’écriture.
Le jeu et l’idée de manipulation étaient donc présents depuis les débuts ?
Le rapport à la manipulation est ici central, c’est l’une des envies de départ. Je travaille sur la marionnette depuis quelques années et
tous ces rapports à l’enfance, à l’animé-inanimé, à la vie et la mort, à la magie – dans le sens de vaudou, ce à quoi l’on veut bien croire –, comme à l’histoire de la marionnette, m’intéressent. Il y a quand même quelque chose de troublant avec la marionnette, avec ce fait que les adultes acceptent de croire à ce qui est un jeu d’enfants. Et ce rapport à la dépendance de la marionnette à son manipulateur, le fait que l’un n’existe pas sans l’autre, me donnait envie de transposer cela à travers aussi le jeu vidéo, où le joueur devient le manipulateur de son avatar, qui devient, lui, une sorte d’esclave. Derrière son écran, le joueur a la main, mais il est aussi pris dans le système du jeu : c’est le jeu qui fixe les règles ; c’est le jeu qui rend accros les joueurs, qui peut leur faire perdre distance et regard critique. Il y a dans Le Ring de Katharsy une relation de service et d’obéissance totale – qui font partie du jeu. Tout le monde se retrouve pris au piège de cette hiérarchie et de ces rapports de domination qui se révèlent terribles – et à l’image des relations de pouvoir à l’œuvre dans notre société – lorsqu’ils sont incarnés par des humains.
Il y a souvent dans vos spectacles quelque chose de très ludique, une façon de jouer avec les formes, comme avec les positions des protagonistes et des médiums au sein même de chaque forme…
Pour moi tout est organique et logique. Si chaque spectacle est différent et a son univers, il y a une filiation et tous se donnent la main. Comme ils s’inscrivent dans la continuité les uns des autres, j’ai le sentiment d’aller toujours plus loin – ou en tous les cas ailleurs – à chaque nouvelle création. Le paramètre du jeu est central pour moi : outre que me déplacer m’importe, que réinventer mes outils me stimule, j’ai besoin de fabriquer un nouveau jeu avec d’autres règles à chaque fois. J’ai, aussi, envie que le plateau trouve son propre corps, avec son organicité et son atmosphère propres. Pour Le Ring de Katharsy, je souhaitais conserver ce point de départ de dystopie déjà présent pour Pinocchio(live)#2 [précédent spectacle créé en 2021]. Mais pas plus qu’elle n’était visible sur Pinocchio(live)#2, elle n’est visible dans Le Ring. C’est ce que je me raconte pour me stimuler au début de la création, mais ça ne se raconte pas sur scène.
Êtes-vous vous-même une gameuse ?
Non. Je vois des personnes jouer, mais je ne joue pas moi-même. Je me suis intéressée à cet univers avec de la distance, en regardant beaucoup de vidéos de joueurs comme de game designers (les concepteurs de jeux) et en suivant les nouvelles sorties chaque semaine. Ce qui m’attire est un rapport formel : comment la structure du jeu vidéo peut-elle être mise en parallèle de celle de pièces de théâtre, avec la catharsis notamment. Le théâtre présent dans le jeu vidéo m’a interpellée et je me sens proche de ce qu’expliquent les game designers. Lorsque je fais un spectacle, j’ai recours à des ressorts (de surprise, d’apparitions, de transformations) qu’ils utilisent également. La façon dont ils conceptualisent leurs jeux, dont ils créent un univers où tous les paramètres (visuels, sonores, les bonus et surprises) sont cohérents, où ils travaillent le suspense, faisant espérer des choses aux joueurs pour, au final, leur amener autre chose, résonne avec mon travail. Je me sens proche également de leur manière d’aborder l’écriture dramaturgique selon un prisme éclaté, avec des arborescences à choix multiples et sans être centrée sur une seule narration.
Ces ressorts que vous évoquez participent dans votre travail à mettre en jeu la question des places et des assignations, des interprètes comme des personnages…
Je ne fais pas du théâtre psychologique et dans mon travail, tout est action et mouvement. Les formes que je fabrique ne reposent pas sur des complexités psychologiques. Les éléments avec lesquels j’écris sont là pour agir comme des activateurs. Ce sont les règles du jeu de chaque spectacle qui vont assigner à chacun (humain ou non-humain) une
mission et délimiter ses fonctions sur le plateau. Étant obsédée par le fait d’organiser mes « outils », je dissèque, je dissocie et je sépare mes idées et principes pour en extraire des formes épurées avec lesquelles écrire.
Vous parlez de simplicité, mais en même temps, vos spectacles se révèlent à chaque fois élaborés, avec des jeux et réflexions enchâssés… Oui, le spectateur accède à la vision composée et donc complexe de l’écriture. À l’image de la complexité du monde qui m’inspire, je travaille pour que les éléments épurés et disséqués avec lesquels j’écris, lorsqu’ils entrent en connexion les uns avec les autres, refabriquent de la complexité, des échos, des parallèles, etc. Plus que la complexité psychologique, c’est la pensée et ses arborescences qui m’inspirent. Face à cet entrelacement de formes et de réflexions simples, le spectateur va en relire une toute autre et se faire sa propre lecture. Instaurant des règles strictes dans mon écriture, je joue aussi à rebattre les cartes en déjouant mes propres règles – quitte à ne plus les respecter. Je travaille aussi à troubler les perceptions des spectateurs, ce qui s’ajoute à ces jeux de réflexions.
Vous êtes depuis début 2023 installée avec votre compagnie au Bercail, lieu de fabrication, d’exploration, de recherche. Qu’est-ce que cela change dans le travail ?
Tout. C’est une immense différence avec notre vie de nomade où nous étions tout le temps invités (et très bien accueillis) dans plein de lieux. D’un côté, c’est une nouvelle charge puisque c’est un endroit auquel il faut donner du sens, doter d’un projet artistique. Mais par ailleurs, ça nous a énormément portés pour Le Ring de Katharsy. C’est lors d’une résidence au Théâtre de Gennevilliers que sont apparues les lignes de force du spectacle, mais ensuite tout s’est fait ici, à Dunkerque. D’un coup, pouvoir poser nos objets, les réparer, ajouter du temps de travail, revenir en arrière, ou ne serait-ce même que traverser le décor (resté installé entre deux résidences) alimente toute la réflexion. Dialoguer avec un espace rend le travail plus concret. Cette histoire de troupe, de vie de compagnie prend aussi autrement corps quand elle a une maison. Et puis il y a maintenant la possibilité de partager cet outil avec d’autres compagnies. Accueillir et découvrir d’autres expériences rend très actif, cela donne du sens. Pour nous, il y a vraiment un avant et un après le Bercail.
— LE RING DE KATHARSY, théâtre du 20 au 29 novembre au TNS, à Strasbourg tns.fr
L’heure sombre
Peter Stamm et Nicolas Bézard
ajoutent un chapitre bleu à sept ans de discussion tandis que Martial Cavatz nous raconte son monde, ce qu’il a de plus beau et de plus terrible.
BLUE HELVÈTE
Texte et photo : Nicolas Bézard
DANS SON NOUVEAU ROMAN ÉDITÉ PAR CHRISTIAN BOURGOIS,
PETER STAMM SE MET À L’HEURE BLEUE ET SONDE LES MYSTÈRES
DE LA CRÉATION LITTÉRAIRE. EN CETTE RENTRÉE, L’AUTEUR D’AGNÈS
SE CONFIE SUR L’ART D’ÉCRIRE ET LE MÉTIER DE VIVRE À TRAVERS
UN LIVRE D’ENTRETIENS PUBLIÉ PAR MÉDIAPOP ÉDITIONS.
Nous avions laissé Peter Stamm sur les quais animés de la Limmat, en plein centre de Zurich, sous un ciel indécis de début d’été. « J’adore cette météo », nous avait-il alors confié, sans doute parce qu’elle était au diapason de sa propre incertitude, l’auteur se demandant ce qu’il allait bien pouvoir écrire après avoir entamé, avec son dernier roman, un virage formel significatif, pour ne pas dire radical. Un an a passé et nous retrouvons Peter Stamm dans un parc de Bâle, fidèle à lui-même dans sa chemise repassée de frais – un stylo toujours épinglé à sa poche poitrine –et cette insaisissable « part de bleu » en lui, ce vif-argent d’où « viennent ses histoires. Pas toutes mais les meilleures », comme le précise Andrea pour décrire Richard Wechsler, énième avatar de l’écrivain qui hante L’Heure bleue, traduit par Pierre Deshusses pour les éditions Christian Bourgois. Dans ce roman incisif et joueur, où le sentiment amoureux est une nouvelle fois mis à l’épreuve du temps, une réalisatrice de documentaires tente de faire un film sur un auteur suisse qui ressemble de façon troublante à Peter Stamm, les deux hommes faisant plus que partager ce bleu perçant du regard – ils ont sensiblement le même âge, sont nés et ont grandi dans le même village, ont écrit des livres plus ou moins identiques. Dans un geste stylistique d’une liberté qu’on ne lui avait jamais connue, Stamm nous donne accès au flux de conscience de sa narratrice, tisse un riche réseau de sensations et de souvenirs, intègre ses propres ressentis, fantasmes et méditations à la structure complexe de son récit. Une complexité qui acquiert une dimension supplémentaire quand on apprend que le texte a été écrit en réponse, ou plutôt en écho, à un film réellement consacré à sa personne. Mais Peter Stamm a pris de vitesse les cinéastes en charge du projet en leur remettant sa copie avant que le film ne soit achevé, incitant ces derniers à faire entrer les éléments fictionnels de L’Heure bleue, personnages et histoires, dans le dispositif documentaire du long métrage. Bien leur en a pris, car ce Wechselspiel – Wenn Peter Stamm schreibt n’a plus rien du portrait classique d’écrivain qu’il devait être au départ. Sa nature hybride, entre réalité et fiction, lui permet de mettre au
jour une certaine aporie de la forme documentaire tout en investissant des espaces peu explorés par le genre. Fort de son « échec » astucieusement mis en scène et de ses angles morts où l’on découvre un Peter Stamm passé maître dans l’art de l’esquive, cet objet cinématographique tout aussi inclassable que le livre apparu dans son sillage – une sorte de fausse autofiction – s’affirme aussi et surtout comme un film sur l’impossibilité de faire un film, a fortiori quand ce film est censé percer le secret d’une existence vouée à l’écriture.
Notre prétention n’est pas si grande en ce matin de mai où la silhouette discrète mais néanmoins affable de Peter Stamm se matérialise devant nous, l’idée étant d’apporter un nouveau chapitre à une conversation épisodique, forcément lacunaire, entamée il y a sept ans. Si l’on devine que le ciel du jour, chargé d’électricité et de nuages bleus de pluie, ravit intérieurement l’écrivain, il nous oblige à nous réfugier dans le premier café venu avant d’entamer la discussion. Un établissement que Stamm connaît déjà pour y avoir rencontré, dans le cadre des recherches qu’il effectue afin de préciser les choses avec le plus d’exactitude possible, un universitaire travaillant sur les mutations du film documentaire à l’ère de YouTube, sujet qui est aussi celui de la thèse de l’ex-petit ami d’Andrea dans L’Heure Bleue. « Cet homme à qui j’ai posé quelques questions était un peu distant », sourit-il. « Il n’a pas souhaité que j’utilise le titre de sa thèse dans le roman. Il devait se méfier un peu de moi, je crois. »
Parce qu’il faut se méfier des écrivains ?
Oui, absolument. Surtout de moi.
Vraiment ?
Non, non… [Sourire.] Enfin, pas trop, je l’espère.
On retrouve souvent, chez vous, cette manière d’aller sur le terrain, à la rencontre des personnes et des lieux susceptibles de donner de la véracité à vos histoires.
En effet. J’ai gardé cette habitude de mes années dans le journalisme. C’est quelque chose d’important pour moi : juste parler avec les gens, observer ce qu’ils font, où ils vivent. On peut trouver beaucoup d’informations dans les livres ou sur internet. Mais la façon dont les gens parlent et se comportent ne peut se découvrir qu’en allant sur le terrain.
Cela me fait penser à votre nouvelle intitulée « Le Mur de flammes », dans le recueil D’étranges jardins. Vous décrivez le quotidien d’une troupe de cascadeurs itinérants. Cette histoire est-elle née d’une immersion de votre part dans cette communauté ?
Tout à fait. Elle est basée sur un reportage que j’avais fait pour la NZZ , non loin d’ici, dans le canton de Bâle-Campagne. J’ai passé plusieurs jours avec eux. Au début, ils étaient très méfiants et ne m’adressaient pas la parole, mais je n’ai pas jeté l’éponge, j’ai insisté. Comme souvent, les femmes étaient plus ouvertes que les hommes. C’est par leur intermédiaire que j’ai pu nouer le contact. C’était une troupe intéressante, un monde spécial que j’ai découvert à cette occasion. J’ai senti qu’il y avait des mensonges dans ce qu’ils me racontaient, des choses louches, pas très sérieuses, mais en même temps, j’avais à faire à des artistes. Ils allaient de villages en villages, en évitant les grands centres urbains où il n’y a pas de place pour eux et où l’on a tendance à mépriser ce genre de spectacles.
Quand j’étais enfant, une troupe de ce type se produisait en Bretagne, ma région natale, et s’arrêtait quelques jours dans mon village. Mes amis et moi étions fascinés, car c’était comme si un petit bout d’Amérique débarquait chez nous. L’été dernier, à ma grande surprise, ils sont revenus. [Je sors un flyer du spectacle et le montre à Peter Stamm.]
Ça alors. Ils existent toujours… [Peter Stamm lit à voix haute en prenant une voix de speaker comme pour annoncer le spectacle.] CASCADEURS… AMERICAN HELLS-DRIVERS… FLASH MCQUEEN… [Rires.]
Je suis allé voir le show. C’étaient juste des grosses voitures qui en écrasaient de plus petites.

À l’image du cirque, ce genre de spectacle est souvent un peu triste. On s’attend à voir des choses extraordinaires et au final, on est déçu. C’est beaucoup plus terre à terre que ce qu’on avait imaginé. Il n’y a pas la magie, la grande féerie promise sur les affiches.
Pour en venir à votre dernier texte, L’Heure bleue, vous me parliez, dans l’échange de mails qui a précédé cet entretien, de vos difficultés et de vos doutes depuis l’écriture de ce nouveau roman.
Oui, car c’est un texte qui sans aucun doute marque une rupture avec les précédents. Il n’est pas non plus totalement différent des autres, mais l’écriture a changé et je ne sais pas très bien si je dois continuer sur cette route, ou reprendre la manière d’écrire qui était la mienne jusqu’à ce
—
Avec
ce livre, je voulais
échapper à ce « et puis, et puis, et puis » qui rythme nos vies.
livre. D’un côté, je ne peux pas refaire L’Heure bleue, car c’était un geste assez unique. Et de l’autre, je ne peux me résoudre à revenir à ce que je faisais avant. C’est une situation frustrante, mais aussi très ouverte et donc intéressante.
« Ouverture » est un mot qui convient pour parler de ce livre qui laisse le monde contemporain imprégner généreusement ses pages, alors que vos textes antérieurs ressemblaient davantage à des univers étanches, difficiles à situer dans l’espace et dans le temps.
Oui, et je m’aperçois que j’ai peut-être légèrement perdu ma confiance dans la fiction. J’ai encore des idées, ce n’est pas le problème, mais je n’ai plus très envie de construire des histoires, de raconter.
Dans L’Heure bleue, Wechsler, l’écrivain, et Andrea, la cinéaste qui le filme, expriment également leur lassitude des histoires : « Le paradis, ce serait l’endroit où il n’y a pas d’histoires », dit la jeune femme.
Ce ne sont pas tellement les histoires qui me posent problème. C’est plutôt la manière habituelle que nous avons de les raconter, avec un début, un développement, une fin, des personnages, un conflit, une morale, etc. Trop d’histoires sont fondées sur ce schéma qui a tendance à me lasser.
Dans le roman, vous faites référence à une vidéo postée sur YouTube dans laquelle des jeunes gens sont filmés au sommet d’un plongeoir de dix mètres. L’écriture de L’Heure bleue, ce fut votre grand plongeoir à vous ?
On pourrait dire ça, en effet. C’est drôle, car je viens de parler à Judith Hermann qui elle aussi a changé quelque chose dans sa façon d’écrire. Son dernier livre contient des éléments ouvertement autobiographiques, ce qui n’était pas le cas avant, et elle me dit qu’elle ne sait pas quel chemin suivre à présent. Nous sommes un peu dans la même situation, alors on essaie de se soutenir, de partager nos réflexions. C’est très enrichissant.
Il n’est pas évident de vous interroger sur votre travail après L’Heure bleue , car ce personnage d’écrivain qui vous ressemble compare les journalistes littéraires à des « cannibales », estimant qu’ils exercent un métier « plus que douteux ». En répondant à bien des questions que j’aurais aimé
vous poser, Richard Wechsler me coupe l’herbe sous le pied. Ce texte ne serait-il pas aussi une sorte de traité de littérature déguisé en fiction ?
Oui, pourquoi pas ? Mais en même temps, vous avez remarqué que je décide de faire mourir Wechsler. Cela veut dire quelque chose. Ce n’est pas un hasard s’il meurt après un tiers du livre. Je commençais à m’ennuyer d’avoir juste cet homme qui parle de son écriture et de son rapport à la littérature. Au fond, ce n’était pas ça qui m’intéressait. Alors je l’ai fait disparaître.
Au profit d’Andrea, cette femme plus vraiment jeune mais pas encore dans l’âge mûr, en lutte contre la solitude et une forme de désenchantement.
Oui. Ce personnage m’a davantage intéressé. Elle doit faire face à des déceptions, des difficultés, mais elle ne capitule pas, elle reste fidèle à elle-même. C’est quelqu’un de très vivant à mes yeux.
Paradoxalement, si Wechsler a des idées arrêtées sur la littérature et son travail d’écrivain, il n’aime pas les communiquer aux autres.
Au contraire de moi. J’aime parler de mes livres.
Notre rencontre en est effectivement la preuve. Vous avez toujours eu à cœur d’échanger avec vos lecteurs ou avec les journalistes, que ce soit à travers des lectures, des rencontres publiques ou des conférences à l’Université.
Disons qu’une grande partie de mon travail consiste à réfléchir à ce que je fais en tant qu’auteur et qui ne se résume pas seulement à écrire des livres, mais également à penser aux raisons qui me motivent à le faire. Comprendre par exemple pourquoi mes textes prennent la forme qu’ils ont. Et j’aime avoir ces réflexions quand je vais à la rencontre des lecteurs. Les gens qui me sont chers n’écrivent pas forcément des romans et je parle rarement de littérature dans mon quotidien. Mais si on m’offre l’opportunité d’en parler, j’essaie d’en faire quelque chose qui puisse à la fois éclairer les personnes intéressées par mes livres et m’aider à comprendre ce que je fais. Ces échanges ont autant d’importance à mes yeux que ceux que je peux avoir avec des auteurs et des autrices dont je me sens proche littérairement parlant, comme Judith Hermann dont je parlais tout à l’heure, ou Judith Kuckart.
Cela vous aide à écrire ?
Peut-être pas à écrire, mais à savoir ce que je veux écrire, oui, assurément.
Wechsler dit qu’un texte « n’exige pas seulement un effort, il exige aussi des sacrifices. Le texte est
l’enveloppe qui contient le sacrifice. » Il ajoute : « Un texte sans sacrifice, c’est comme une église sans rituel. » Vous avez le sentiment de sacrifier quelque chose lorsque vous écrivez ?
Oui, mais je ne peux pas formuler exactement quoi. Les lecteurs veulent toujours savoir de quels sacrifices je parle et j’ai du mal à leur donner une réponse. Cela a peut-être à voir avec cette vie réelle que l’on ne vit pas lorsqu’on écrit et que l’on sacrifie en partie. Je ne voudrais surtout pas donner une dimension héroïque à la chose. Il y a des professions bien pires. Mais celle qui consiste à écrire des livres ne commence pas chaque jour à 8 heures pour se terminer à 17 heures. C’est plutôt une sorte de tension permanente qui pénètre votre vie et chaque chose que vous faites. Sacrifice est sans doute un mot un peu trop fort pour expliquer ça.
L’écriture conduit-elle à la dépression et à l’isolement ? Un écrivain peut-il avoir une vie familiale et sociale épanouie ?
Bien sûr qu’il le peut. L’écriture ne mène pas nécessairement à la dépression. Je dirais même que c’est le contraire. L’écriture est quelque chose de positif, de valorisant, avec parfois des moments plus compliqués que d’autres, comme celui que je traverse actuellement, mais même dans cette période de questionnements, j’ai toujours le sentiment d’avoir mon destin en main, de pouvoir décider d’une direction à prendre. C’est tout sauf un emprisonnement. La plupart des écrivains que je connais sont des gens qui vont de l’avant. Ils peuvent se montrer critiques envers ce qu’ils font, voire pessimistes parfois. Mais jamais dépressifs. La dépression, comme je l’ai compris en étudiant la psychologie à l’université, ce n’est pas la tristesse, mais plutôt le manque d’énergie, une sorte de paralysie. Quand tu écris, tu ne peux pas te permettre ça. Tu es plutôt dans un état positif, revigorant. La littérature, ce ne sont pas seulement des mots. C’est aussi de l’énergie.
Depuis votre entrée en littérature avec Agnès , vous avez publié quatre « leçons de poétique » dans lesquelles vous revenez en détail sur le processus d’écriture de vos livres. Considérezvous ces recueils de conférences comme des œuvres à part entière ?
Leur statut est différent dans le sens où il n’est pas nécessaire de les avoir lus pour comprendre mes nouvelles ou mes romans. Je les vois plutôt comme des compléments, des sortes de retours sur image. Et pour moi, ils ont un intérêt, car ils me poussent à organiser, à structurer ma pensée dans un texte, ce qui m’aide ensuite à y voir plus clair. La leçon de Bamberg est un peu différente
des autres, car elle contient aussi des moments de littérature qui sont plus proches de ce que je fais lorsque j’écris de la fiction. Quant aux trois autres, ce sont plus ou moins des journaux de travail.
Ces écrits sont-ils également motivés par la volonté de transmettre quelque chose, de laisser une trace ?
Pas de laisser une trace, non, mais il y a tant de bêtises qui sont dites sur l’écriture et la littérature, de nos jours, que je veux tout de même défendre mon point de vue, ma position, et quand cela concerne mon travail, corriger quelques malentendus. Ce soir par exemple, je vais parler de Franz Kafka à la radio, dans un programme proposé par la SRF. Il y a tellement d’idioties qui sont dites sur lui qu’il m’a semblé important d’accepter cette invitation. Je m’étonne d’ailleurs qu’ils aient pensé à moi, car si j’ai lu Kafka, je ne me considère pas comme un grand spécialiste de son œuvre.
Cela m’étonne moins que vous, car L’Heure bleue est marquée par cette présence de choses existantes en vous et autour de vous au moment où vous étiez en train d’écrire. Des pensées, des observations, des interactions issues de votre quotidien et que vous avez introduites dans le texte de façon directe et spontanée. Je me suis demandé si cette manière d’écrire sur le motif ne rapprochait pas ce livre d’un journal, un journal maquillé en roman, bien sûr, mais qui comme chez Kafka ou Pavese, propose une réflexion sur la mort, sur l’amour, sur l’écriture. Tous mes livres, au fond, ressemblent à ce que vous décrivez. Avant L’Heure bleue, les personnages que j’inventais avaient tous plus ou moins mon âge. Leurs réflexions ou leurs préoccupations étaient aussi les miennes. Quand j’étais plus jeune, j’écrivais sur des jeunes couples qui ne parvenaient pas à se trouver et aujourd’hui, j’écris sur des familles ou sur des gens plus âgés. Mais comme vous le dites, ils n’étaient pas à ce point proches de ma réalité quotidienne. Par exemple, lorsque Andrea décrit ce qu’il y a au menu de son dîner, il est probable qu’il y ait eu la même chose dans mon assiette peu de temps auparavant [sourire].
L’Heure bleue est un livre qui nous réveille. L’écriture est plus mordante qu’à l’accoutumée. Plus directe aussi. Elle ne craint pas la crudité. D’une certaine manière, elle me fait penser à de l’Art brut.
Oui, elle est plus sautillante, plus disparate. Elle va souvent d’un sujet à un autre, fonctionne par associations d’idées ou de perceptions, sans souci apparent de hiérarchiser les choses. Au cinéma, cela pourrait ressembler à du montage cut
Vous parlez de montage cut, et en effet le roman prend la forme d’un grand collage dans lequel vous mélangez des éléments aussi divers que des vidéos sur YouTube, des marques de produits de consommation, du vocabulaire médical, des listes de courses, des menus, des sketchs populaires, des poèmes baroques, etc.
J’avais déjà utilisé cette technique de collage pour certaines pièces radiophoniques. Ce livre marque un retour à ce procédé qui consiste à prendre des choses telles quelles, puis à les monter ensemble. Une fois, j’ai expliqué que je recherchais la réduction dans mon travail. Réduire le nombre de personnages, de lieux, de péripéties. Réduire l’histoire ou le style à leur plus simple expression. Peut-être que cette méthode employée dans L’Heure bleue est la plus grande des réductions possibles.
Ce fantasme de la réduction revient souvent chez vous. Je pense au discours que vous avez prononcé lorsque vous avez reçu le prix de l’édition aux Journées littéraires de Soleure, en 2018. Vous formuliez alors le vœu d’écrire « une histoire sans aucun personnage. Mais, même à supposer », poursuiviez-vous, « qu’un jour mes personnages me quittent et qu’il ne reste plus que des lieux déserts, il faudra que je continue à écrire, pour représenter leur disparition ». Cette idée d’une œuvre qui tend vers sa propre dématérialisation revient souvent dans L’Heure bleue , où vous citez notamment la célèbre partition de John Cage, 4’33’’ , ou les Skyspaces de l’artiste plasticien James Turrell.
Même s’il n’est pas directement cité, j’évoque aussi à plusieurs reprises le récit de Georges Perec, Tentative d’épuisement d’un lieu parisien . Quand Andrea est à Paris par exemple, et qu’elle se tient debout derrière la fenêtre de sa chambre d’hôtel pour contempler la ville, le trafic. Je crois que j’ai toujours aimé la réduction en art. Mais la réduction est aussi, en certaines circonstances, un danger. Elle peut déboucher sur une forme de maniérisme. Il y a peu, j’ai écrit à une amie que je trouvais qu’il y avait toujours trop de tout en art. Des plasticiens, des acteurs, des chanteurs, qui en faisaient trop…
La réduction, c’est l’idée de ne garder que ce qui est nécessaire. Et pourquoi pas de s’approcher du vide, du silence. C’est ce que j’aime tant en littérature. Je pense à une autrice que j’adore, Natalia Ginzburg, qui dans une langue épurée raconte des histoires très simples. Souvent, elle décrit des situations dénuées d’action ou de drame. Et quand il se passe quelque chose, comme une femme qui tue son mari par exemple, cela ne débouche sur rien de spectaculaire.
Cela m’évoque Ernest Hemingway qui n’avait besoin que d’une ou deux images fortes et d’un champ lexical limité à quelques mots pour raconter une histoire.
Hemingway était un grand maître de cela, oui. Je pense à sa nouvelle intitulée « Un chat sous la pluie ». De quoi ça parle ? D’un couple qui s’ennuie dans une chambre d’hôtel. D’un chat. De la pluie qui tombe dehors. De presque rien. Mais de ce presque rien il construit un tout qui suffit à vous donner le sentiment d’un monde vivant.
Est-ce cela la plus grande réussite d’un écrivain : parvenir à concentrer dans une goutte d’eau un univers entier ?
De mon point de vue, oui, mais je sais que tout le monde n’est pas de cet avis. Il y a aussi la littérature baroque, qui certainement a des vertus même si elle ne correspond pas à ma sensibilité. Je n’ai rien contre, bien sûr. Et au fond, je n’aimerais pas que tout le monde écrive comme moi.
L’Heure bleue est un livre conceptuel dans sa forme, assez postmoderne, avec quantité d’ellipses, de retours en arrière, de temporalités qui se superposent. Il ressemble à un rêve éveillé, comme Huit et demi, le film de Federico Fellini dont Wechsler parle à un moment. D’où vous vient ce goût pour les structures spéculaires, les constructions gigognes ? La linéarité vous ennuie-t-elle ?
Absolument. Avec ce livre, je voulais échapper à ce « et puis, et puis, et puis » qui rythme nos vies et la plupart de nos histoires. Je voulais m’amuser avec le temps, le tordre, en devenir maître. Une maîtrise que permet l’écriture et qui est aussi, selon moi, une façon d’échapper à la mort.
L’écriture serait donc un abri, un refuge, contre le cours inexorable, parfois absurde, du temps ?
Je le pense, oui. Je dois avoir pas loin de 4 000 livres chez moi. Et dans chacun de ces livres, il y a un monde fixé pour toujours, un monde qui ne changera plus. Dans un sens, un livre est une revanche sur le temps qui passe.
La suite de l’entretien est à lire dans Peter Stamm. Écrire est un travail humain, ouvrage qui rassemble sept années de rencontres et de conversations entre le journaliste Nicolas Bézard et Peter Stamm (disponible depuis le 13 septembre aux éditions Médiapop).
— L’HEURE BLEUE, Peter Stamm, éd. Christian Bourgois
GOSSE DE PAUVRES
Par Aurélie Vautrin ~ Photo : Arno Paul

Une « boule de haine » façonnée au cœur de la cité des 408 de Besançon au début des années 80, ballotée entre violence ordinaire, racisme exacerbé et institut spécialisé. Un départ de vie cabossé façon derby de démolition qu’il conte par bribes, sans victimisation ni excuses, dans son récit sur l’enfance drôlement touchant (et inversement). Car le « gamin à problèmes » est désormais titulaire d’un double master, et enseignait à l’université avant de devenir responsable du service du personnel de l ’ UFR Sciences du langage, de l’homme et de la société de Besançon. L’homme, pourtant, ne cache ni sa surprise ni son humilité quand on le félicite pour sa nomination au Prix Stanislas du Livre sur la Place - prix qui récompense le meilleur premier roman de la rentrée littéraire. C’est pourtant ce que l’on peut appeler une entrée en matière réussie. Rencontre.
« J’ÉTAIS CASSOS ET BIGLEUX, UNE BELLE
ADDITION D’EMMERDES. »
DÈS LES PREMIÈRES PAGES DES CARACTÉRIELS, PARU EN AOÛT DERNIER
CHEZ ALMA ÉDITEUR, MARTIAL CAVATZ
DONNE LE TON : SON LIVRE SERA BRUT, SANS FILTRE NI CONCESSION AUCUNE
– COMME LUI ÉTANT GOSSE, AU FOND.
On attaque directement avec les choses qui fâchent : qu’avez-vous contre l’expression « transfuge de classe » ?
C’est son usage public qui me gêne ; c’est devenu une notion journalistique qui menace les différences. Prenons par exemple deux auteurs classés comme tels, Annie Ernaux et Édouard Louis. Édouard Louis vient d’un milieu très populaire, Annie Ernaux non : elle est la fille de petits épiciers. Or l’épicier pour le pauvre, c’est un peu le riche chez qui il a une ardoise… Ce ne sont déjà pas les mêmes catégories sociales. Résultat, tout le monde finit par dire : « Moi aussi, je suis un transfuge de classe, mes parents étaient profs en lycée, je suis prof d’université. » On mélange tout, et ça n’a plus vraiment de sens.
Si cette expression est galvaudée, par quoi la remplacer ?
Je ne sais pas. En vérité, cette notion est-elle vraiment utile ? Des gens qui ont connu des ascensions sociales, il y en a toujours eu. Ce qui, d’une certaine manière, entretient aussi une illusion : « Regardez, untel a écrit un livre magnifique pour expliquer comment il s’en est sorti, donc vous voyez que c’est possible. » Mais cela ne pose pas la question de tous ceux qui restent, ceux qui ne s’en sont pas sortis justement, et qui forment pourtant la grande majorité.
Votre livre est-il le témoignage d’une époque ?
Pas uniquement. Pas vraiment. Parce que l’utilisation d’outils d’écriture en fait, je crois, un véritable objet littéraire. Je tenais par exemple à inclure l’humour, avant tout pour rendre un peu moins obscène une description de misère sociale. Je dis « moins obscène », parce que Les Caractériels reste l’histoire d’un pauvre en Occident, ce qui, par rapport à
—
J’avais
envie de faire un livre qui traite des classes populaires, qui ne soit ni démagogique ni misérabiliste. —
Le 15.09, au Livre sur la Place, à Nancy
la situation d’autres personnes dans le monde, est à relativiser. Ensuite, j’ai prêté beaucoup d’attention aux microdétails, tout en essayant de reconstituer les pensées d’un enfant – avec cette limite qu’on ne peut jamais se rappeler exactement ce qu’on pensait à l’époque.
Qu’est-ce qui vous a poussé à écrire votre histoire ?
Disons qu’au-delà de l’aspect « bilan personnel » (j’ai quarante-six ans, qu’est-ce que j’ai fait de ma vie), j’avais envie de faire un livre qui traite des classes populaires, qui ne soit ni démagogique ni misérabiliste. Les écrire dans leur ensemble, avec leurs défauts, le racisme, la violence, l’homophobie, mais également les aspects positifs, comme la générosité. Et je tiens à dire qu’ici le narrateur ne s’exclut pas : il n’y a pas de position de surplomb, il est au même niveau que les autres, il est le produit de ce milieu, lui aussi a participé à ces défauts. Comment aurait-il pu en être autrement ?
Toutes les situations décrites ont été vécues, ou certaines sont-elles romancées ?
Elles sont toutes vraies, cependant elles sont reconstituées avec une subjectivité assumée : ce n’est qu’un point de vue, le mien. Ce livre n’a pas la prétention de donner la réalité de ce qu’est la vie d’une cité – d’ailleurs, la famille elle-même n’est pas intégrée dans le quartier, donc rien que là, ce n’est pas représentatif. Je ne prétends pas non plus décrire toutes les classes populaires ; ici, au-delà de la pauvreté, il y a l’aspect dysfonctionnel, la violence, le handicap… J’aime beaucoup une phrase de Marc Bloch dans Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien, qui dit : « Le danger commence quand chaque canton du savoir se prend pour une patrie. » Il dit ça par rapport aux sciences, mais c’est la même chose ici. Je ne dis qu’une vérité éventuelle qui est contestable, et qui ne prétend pas éteindre tout ce qui a été et sera dit sur le sujet. Ma vérité.
Une vérité sans filtre ?
Pendant longtemps, je n’ai rien raconté sur mon enfance ni sur le milieu duquel j’étais issu, ou alors j’arrondissais les angles – jamais toute l’histoire. Mais quand l’idée du roman s’est imposée, ça a dépassé toute question personnelle : je n’ai jamais cherché à écrire un livre de révélations sur moi. Oui, j’y raconte des choses que j’ai faites et qu’il faut assumer, comme l’histoire des dessins de croix gammées par exemple. J’ai tenu à le mettre dans le livre aussi parce qu’après les attentats de 2015, quand on a commencé à arrêter des enfants de huit ans pour apologie du terrorisme, ça m’avait renvoyé à moi. À l’époque, je n’avais aucune conscience de la Shoah. Il n’y avait pas de nazis dans mon entourage. Simplement en regardant des films, j’avais compris que c’étaient les méchants, et que si je voulais foutre le bordel, c’était là qu’il fallait taper. Peut-être que si j’avais eu dix ans en 2015, j’aurais dit des bêtises de ce genre. Alors pour croire qu’un enfant de huit ans fait l’apologie du terrorisme, je me dis que nous sommes quand même dans une société qui déconne vraiment. Attention, ces comportements ne doivent pas être
excusés, loin de là, simplement il faut se poser la question de comment ils doivent être traités. Bien sûr, ce n’est pas normal qu’un enfant de dix ans dessine des croix gammées, mais selon moi ça ne nécessite pas de le mettre un an en tôle non plus. Il y a un vrai travail éducatif à faire.
Vous avez un engagement politique assumé. Estce que vous avez envie d’aller plus loin ? [ Rires .] J’ai essentiellement un engagement syndical, qui me prend déjà beaucoup de temps, donc je ne suis pas certain de pouvoir en faire plus ! Mais je suis content parce que j’ai vu que la presse de droite parlait de mon livre. L’Express, La Tribune du dimanche … Il fait même partie de la sélection du Figaro des huit romans de la rentrée chez les premiers romanciers. J’aime bien l’idée qu’il n’y ait pas que les journaux d’extrême gauche qui soient intéressés. Moi-même, je lis des écrivains de droite ! Je veux dire, il est évident que le narrateur est de gauche dans cet ouvrage, et on suppose que l’auteur l’est aussi. Mais je n’ai pas écrit un tract politique ; j’ai écrit un texte qui est avant tout une histoire à partir de laquelle on peut tirer des conclusions politiques.
Vers la fin du livre, vous expliquez que le dessin fut à l’époque un exutoire. Dans ce cas, qu’est-ce que l’écriture pour vous aujourd’hui ? Un exorcisme ?
J’ai arrêté le dessin il y a longtemps, alors je dirais que c’est peut-être mon exutoire actuel. C’est vrai que le dessin fut important à une époque de ma vie, notamment au lycée, où le fanzine que j’avais créé avait son petit succès ; comme j’étais quelqu’un de très timide, ça m’a permis de rencontrer beaucoup de monde, j’ai même été publié dans Charlie Hebdo Mais je ne me trouvais pas assez bon, alors j’ai fini par abandonner, et je n’ai jamais repris.
On peut également lire : « J’étais d’un naturel pessimiste, je ne croyais pas trop aux possibilités de s’extraire de son milieu. » Est-ce toujours valable aujourd’hui ?
Oui. Au programme de terminale de sciences éco, il y a un document qu’on fait étudier aux élèves : les tables de mobilité. Donc ce que je dis peut être vérifié statistiquement. On y compare la profession du père et celle de l’enfant ; et ces tables montrent qu’il y a une assez grande stabilité sociale, avec tout ce que cela induit. Évidemment, vous avez des professions qui évoluent avec le temps. L’instituteur au temps de Pagnol, c’est le notable du village ; aujourd’hui, c’est plutôt petite classe moyenne. Mais de manière générale, les milieux sociaux restent identiques au fil du temps. Donc oui, je suis toujours pessimiste. J’ai très peu de raison de ne pas l’être.
— LES CARACTÉRIELS, Martial Cavatz, Alma Éditeur
Aux sources
Pour Rodolphe Burger, Christine Zayed, La Face Cachée et Sam
Dust, les genres se mélangent, se partagent, puisent dans la poésie de la vie, la terre des origines, ou encore au fond de l’océan.
LE TEMPS DE LA VIE
Par Emmanuel Abela
EN CET AUTOMNE, L’ACTUALITÉ EST RICHE POUR RODOLPHE BURGER : UN ENREGISTREMENT AVEC LES
SONNENBLUME, UN CONCERT AUTOUR DE RADIOACTIVITY DE KRAFTWERK
À BISCHHEIM ET UN NOUVEL
ALBUM SOLO, AVALANCHE.
UN PUR CHEF-D’ŒUVRE DE POÉSIE.

1. SONOTONE
Certains ont assisté à un concert singulier organisé au rayon poissonnerie du Super U de Sainte-Marie-aux-Mines dans le cadre du festival C’est dans la Vallée. Rodolphe Burger était entouré d’une joyeuse bande, les Sonnenblume. Olivier Berger, les deux Dominique, Frendel et Pavarati, ainsi que Victoria François, souffrant de handicaps variés, sont résidents d’un foyer d’accueil spécialisé, les Tournesols, et participent à l’aventure d’un groupe initié par leur éducateur, Jean-Noël Gnozden, pour égayer les fêtes de Noël dans un premier temps avec quelques reprises, avant de passer à la composition. Accompagné par Bertrand Belin, Rodolphe est tombé un jour sous le charme de la belle équipée, au point de les programmer dans la partie off de son festival. L’aventure a pris bonne tournure, notamment à l’occasion d’un concert de prestige au Palais de Tokyo, à Paris, devant un parterre de personnalités en mars dernier. Les tubes du groupe comme « L’Horloge parlante » ou « L’Horoscope », résultant d’ateliers d’improvisation dirigée ont conquis un public fasciné par la densité électrique et la présence scénique sidérante de ces gars qui agissaient, sans se mettre la pression, en stars d’un soir. « Toujours rêveurs, selon Rodolphe, ils agissent en parfait entertainers , si drôles et si sympathiques. » En août, le groupe vient d’enregistrer son premier album, Sonotone, qui fait la part belle au répertoire naissant dans une tonalité rock et électronique « à la limite de la transe » qui accorde un bel espace à la poésie du quotidien. Nul doute qu’on entendra reparler très vite de cette formation si réjouissante et nécessaire.
2. RADIOAKTIVITÄT
Nombreux sont ceux qui se souviennent de la reprise du célèbre hymne de Kraftwerk, « Radioactivity », par Kat Onoma, généralement en rappel, dans une version très électrique proche de la saturation. Forcément, lorsque Rodolphe Burger a été sollicité pour interpréter l’album de son choix à Bordeaux en 2021 dans le cadre d’une carte blanche au festival Discotake, il n’a pas hésité une seconde avec Julien Perraudeau, son fidèle acolyte depuis bien des années. Le choix s’est porté sur l’album du célèbre groupe allemand. « Oui, cet album constitue un instant de bascule en 1975 », admet Rodolphe, qui nous explique qu’il leur a fallu, à Julien et lui-même, « retourner à l’essence même du disque en l’observant au microscope afin de le recréer. » Selon lui, « Julien s’est lancé dans une opération quasi archéologique afin d’identifier tous les éléments pour comprendre comme il a été
fabriqué. » Sous-entendant qu’il était hors de question de le reproduire à l’identique, mais de s’inspirer de son processus de création. Ce qui peut surprendre c’est qu’outre le titre-phare, il s’agit d’un disque relativement abstrait, sans concession du moins, plus contemporain sur la forme que ces prédécesseurs, le classique déjà electropop Autobahn (1974), et ses successeurs, les chefs-d’œuvre Trans-Europe Express (1977) ou The ManMachine (1978). « Oui, c’est effectivement le cas, mais ce qui me semble important c’est que Kraftwerk ne constitue pas un groupe uniquement instrumental : les textes sont précis, excessivement bien écrits. Et même si on a tendance à réduire le groupe à ses apports électroniques par la suite, je trouve qu’il a su développer une vraie force dans les messages qu’il souhaitait faire passer. »
3. AVALANCHE
Sans l’afficher, Rodolphe Burger creuse un sillon profond. Album après album, il tend à l’épure d’une forme de chanson poétique d’un genre qui n’appartient qu’à lui. Dès le titre « L’Inattendu », on mesure l’étendue d’un dispositif minimaliste qui accorde son importance à la présence de la voix. Et aux mots, chantés, susurrés avec sa voix grave, comme il l’avait fait parfois avec Kat Onoma – « La Chambre » ou « Que sera votre vie ? » –ou en solo. L’émotion est d’emblée au rendez-vous, et pourtant selon lui, rien n’annonçait la réalisation d’un album complet. À l’origine du projet, un hommage à Pierre Alferi sous une forme qui associe les chansons à des références imagées précises, puisées dans la mémoire cinématographique du poète disparu, par ailleurs auteur de plus de 50 chansons de Kat Onoma. « “Avalanche” est le dernier poème qu’il a publié », nous relate Rodolphe. Même affaibli, Pierre est resté impliqué dans ce projet qui devrait se prolonger sous la forme de concerts augmentés, musique et image. « Dans sa dernière année de vie, c’est quelque chose qu’il faisait avec plaisir. » Il en ressort une certaine gravité, et forcément une pointe de mélancolie, laquelle révèle cependant la force de sa vitalité. Avec l’appui de Blaise Caillet et de Christophe Calpini, Rodolphe étend le champ de ses possibilités, comme si Avalanche constituait une destination magnifique sous la forme d’un chef-d’œuvre poétique absolu. Un disque qui, en phase avec son temps, dit nos inquiétudes, mais aussi nos immenses espoirs.
— RODOLPHE BURGER, concert le 28 novembre à la Salle du Cercle, à Bischheim www.bischheim.alsace
— AVALANCHE, Rodolphe Burger, Dernière Bande/PIAS, sortie le 8 novembre
CHRISTINE ZAYED MUSIQUE, VIE, LIBERTÉ
Par Pierre Lemarchand ~ Photo : Renaud Monfourny
LA MUSICIENNE ET CHANTEUSE
PALESTINIENNE CHRISTINE ZAYED, INSTALLÉE EN FRANCE DEPUIS
HISTOIRE ET PLONGE LA MUSIQUE
CLASSIQUE ARABE DANS LE BAIN DU MONDE.
Le disque s’ouvre avec la chanson « Safartu », adaptation du poème « Séparation » de Hussein Al-Barghouti. Pourquoi avoir choisi de l’adapter ? En France, quand on parle de poésie palestinienne, on évoque souvent Mahmoud Darwich. Je suis attachée à Hussein Al-Barghouti et à ses écrits depuis mon adolescence. C’est quelqu’un qui était aussi professeur de philosophie à l’université de Bir Zeit. J’avais déjà lu beaucoup de ses livres quand j’ai découvert son poème « Safartu ». Tout s’est passé très vite : l’inspiration de la mélodie et de la couleur de la chanson. J’étais très émue en la composant, car elle s’imprègne de deux histoires tragiques qui se sont déroulées au moment où je découvrais ce poème. Ce sont les histoires de deux garçons. Le premier vivait à Jérusalem : il s’appelait Iyad Al-Hallaq, il était autiste et il a été tué pour rien. Il se promenait juste ; il ne faisait rien d’autre que vivre. En même temps s’est déroulée l’histoire de George Floyd aux États-Unis. Cette chanson parle, dans mon esprit, des disparus.
Vous sauriez dire ce qui vous avait tant touchée, adolescente, chez ce poète ?
Votre album, comme l’un de ses morceaux, s’appelle Kama Kuntu, ce qui veut dire « Comme j’étais » en arabe littéraire. Ce titre est-il guidé par la volonté de vous présenter dans votre histoire ?
Le disque parle de mes racines ; il puise dans mes expériences personnelles, profondément liées au contexte plus large de mes origines. J’y évoque mon passé, mais aussi son influence sur ce que je suis aujourd’hui. Le titre « Kama Kuntu » est inspiré d’un texte de l’écrivain syrien Mohammed Al-Maghout. Je porte cette chanson en moi depuis très longtemps. L’album évoque différents tableaux de ma vie, depuis ma naissance jusqu’aujourd’hui, mais ma vie envisagée dans un contexte plus universel. C’est-à-dire ce qui lie ma vie aux autres vies autour de moi.
Sa poésie est accessible ; il parle concrètement, de manière si proche, de l’expérience humaine en Palestine. Il y a vécu, il y a souffert. Ce qui m’a touchée, c’est son expérience de voyage et d’exil, quand il a quitté la Palestine pour aller étudier aux États-Unis. J’étais intiment convaincue qu’un jour, je ferais la même chose. Son livre Lumière bleue , dans lequel il utilise de nombreux symboles, tels que la lune, pour narrer son expérience de mort, m’a profondément émue.
Cette chanson, « Safartu », est interprétée avec Piers Faccini : quel rôle joue-t-il dans votre disque ?
Le choix des musiciens a été crucial. Je les ai choisis pour leurs talents d’instrumentistes, mais aussi pour le lien humain qui m’unit à eux. Toutes les personnes qui jouent sur le disque m’accompagnent depuis dix années maintenant – depuis mon arrivée
en France. Piers, dès notre rencontre, est devenu un membre de ma famille, un ami cher : tous deux nous respectons et nous soutenons. Il a tout de suite aimé « Safartu » ; il m’a dit qu’il aimerait beaucoup la jouer avec moi, en concert et sur l’album. Pour le disque, on a travaillé ensemble sur un deuxième morceau, « Animal ». C’était un morceau instrumental, mais Piers a écrit un texte pour cette chanson, que j’ai adapté en arabe ensuite.
Le disque s’achève avec un morceau instrumental, que vous interprétez en duo avec Alexis Paul à l’orgue de barbarie, intitulé « Jeudi 16 h 53 », au cours duquel se mêlent tourment et apaisement. Que s’est-il passé, ce jeudi après-midi ?
Je suis née. Mais je suis née morte. Et ma mère, en me donnant naissance, est tombée dans le coma. Je suis là aujourd’hui, ma mère aussi a survécu. À chacun de mes anniversaires, ma mère me raconte avec précision cet événement. Elle dit toujours qu’en ce jour, elle est née une deuxième fois. Ce souvenir reflète un traumatisme collectif, une blessure profonde que partagent aujourd’hui de nombreux enfants et nouveau-nés, en Palestine et ailleurs. Mais en même temps, il incarne une force vitale : la détermination simple d’exister, de persister, d’une manière à la fois puissante et légère. Cette chanson, je voulais la mettre au début du disque. Comme une déclaration, un préalable à tout ce qui pourrait suivre. Mais ça ne fonctionnait pas. Ce morceau clôt finalement l’album. C’est la musique qui a dicté l’ordre des morceaux. La narration est avant tout musicale.
C’est une histoire qui explore des climats, des rythmes et des genres musicaux très différents. Entre le morceau titre, « Kama Kuntu », un solo de qanûn dans la tradition de la musique classique arabe, et « Animal », où les guitares, avec leurs échos, sonnent très rock, il y a un monde ! Comment s’est construit le son du disque ?
Les morceaux, dans leur singularité, ont façonné ce son. Je voulais que chacun puisse s’exprimer pleinement. Prenons, par exemple, « Al’an » – ça veut dire « Maintenant ». Je voulais qu’on y entende les tablas indiennes de Prabhu Edouard avec leurs multiples couleurs, ainsi que la flûte bansurî de Sylvain Barou. Je tenais à ce que, sur le disque, soit célébré un instant de vie, un moment de joie que m’apportent les sonorités mêlées de ces deux instruments-là, joués par ces deux musiciens-là. Et à travers ce morceau, je voulais aussi qu’il y ait le mode jiharkah, qui ouvre une porte vers la joie et l’espoir.
Qu’il y ait une telle fenêtre ouverte sur l’espérance, la félicité, c’est quelque chose que vous désiriez fermement pour cet album ?
Oui, je le voulais vraiment. Pour cet album, j’avais une vision très précise des choses. Pour le morceau « Avant que je ne photographie les oiseaux », j’avais

— Les premiers temps en France, je ne trouvais jamais le bon tempo, tout allait trop vite.
Une partie de moi était restée là-bas, j’étais comme dissociée. —
le désir que ce morceau contienne deux tableaux, deux tempos bien distincts, deux mondes différents en somme, qui coïncident avec mes deux vies.
Quelles sont vos deux vies ?
Ma vie en Palestine et ma vie en France. Ma vie avant et ma vie aujourd’hui, depuis dix ans. Ce morceau raconte mon arrivée en France, en 2014, quand une vie chasse l’autre. Ma vie d’avant, qui est devenue ma « vie intérieure », c’est le tempo lent ; ma vie d’aujourd’hui, que j’appelle ma « vie extérieure », obéit à un rythme bien plus rapide. Les premiers temps en France, je vivais ce décalage de rythme : je ne trouvais jamais le bon tempo, tout allait trop vite. Une partie de moi était restée là-bas, j’étais comme dissociée – dans ce morceau, c’est symbolisé par le jeu entre le qanûn et la flûte. Le contraste entre ces deux instrumentslà, l’un staccato et l’autre legato, l’un percussif et l’autre tout en langueur, raconte ce qui se jouait en moi à ce moment-là, et qui continue à se jouer.
Cet album, et ce morceau en particulier, ne seraitce pas une manière de réconcilier ces deux vies-là ?
Je ne l’ai jamais pensé comme ça. Mais c’est certainement cela, oui.
— Mon qanûn est fait de bois et de peau, j’y exprime mes émotions depuis 23 ans. Je crois que tous ces sentiments qu’il a transmis ont fait de lui un être vivant. —
Sur tous les morceaux, vous jouez du qanûn, une cithare aux cordes pincées. Vous dites de cet instrument qu’il est une « boîte magique ». Quelles qualités possède-t-il pour que vous vous soyez consacrée à lui, qu’il ait supplanté tous les autres instruments, notamment le violon et l’oud ?
Avec le qanûn, j’ai trouvé ma liberté en tant que soliste ; j’ai arrêté le violon parce que j’étais étouffée par le système d’orchestre au conservatoire. J’aime le qanûn pour sa palette de couleurs qui court du grave à l’aigu, des possibilités qu’ouvrent ses microtonalités – il a tant de notes ! J’avais cinq ans quand j’ai vu un jour mon professeur en jouer et je me souviens avoir été bouleversée. J’étais une petite fille de neuf ans quand j’en ai joué pour la première fois. Que les sons circulent dans cette boîte, vibrent et sortent par tous ces trous – les « shamsats » –, ça m’a semblé de la magie. Dès lors que j’ai commencé à en jouer, je ne l’ai plus quitté.
Il est si important pour vous que vous lui avez donné un prénom, Bilal !
Il est fait de bois et de peau, j’y exprime mes émotions depuis 23 ans. Je crois que tous ces sentiments qu’il a transmis ont fait de lui un être vivant. L’objet le plus précieux de ma vie est la clé de mon qanûn. Elle permet de l’accorder, de trouver l’équilibre – le sien comme le mien ; cette clé permet de m’accorder, moi aussi. Cet instrument, chez les Arabes, est très mélodique tandis que chez les Turcs, il est autant mélodique qu’harmonique. J’ai tenté de le faire sortir de ces deux cadres – celui de la musique arabe traditionnelle et classique ainsi que celui de la musique ottomane, qui sont les deux répertoires que l’on étudie au conservatoire. De plus, ce n’est pas un instrument qui accompagne le chant, d’habitude. Or moi, je chante.
La musique s’est invitée tôt dans votre vie ?
Je suis née avec la musique. Mes deux frères [Yusef et Basel, de 13 et 10 ans plus âgés qu’elle, sont musiciens ; ils figurent sur Kama Kuntu] en jouaient déjà quand je suis née. L’un des deux était déjà connu en Palestine, quand j’avais quatre ou cinq ans. Mes parents n’étaient pas musiciens, mais ma mère chantait beaucoup. C’est elle qui a poussé Basel, le premier de mes frères à faire de la musique. Mes premiers souvenirs me ramènent dans le salon ; dans les maisons palestiniennes, c’est une pièce qui est rarement utilisée, elle est destinée aux invités. Chez nous, c’était une pièce remplie d’instruments. Il y avait un piano, plusieurs neys, trois guitares, des ouds et des percussions. J’avais trois ans, il m’était interdit d’aller dans cette pièce, mais j’y entrais, bien sûr. Je voulais regarder ces instruments, les caresser. J’essayais d’en jouer.
Quels autres souvenirs gardez-vous de votre enfance, de ces jours heureux en Palestine ?
Je me souviens des soirées familiales où la musique se mêlait à l’air comme une seconde langue. Il y avait une sérénité dans ces instants, mêlée cependant à la certitude silencieuse que nous allions la perdre. Le bruit de ma petite balançoire accrochée au figuier, l’arôme doux et terreux des figues incarnent plus que tout ce réconfort éphémère. Tout tend à s’effacer, mais des fragments du monde lointain de mon enfance demeurent saillants. Ce sont eux que je tente de fixer avec Kama Kuntu. Le réveil au son lointain de la prière. La voix de ma mère. Les interminables journées chaudes d’été, le parfum du café se mêlant à la vue des cerfs-volants dans le ciel bleu, si silencieux quand il n’y avait ni bombardements ni hélicoptères. Mon frère Basel qui joue du oud dans sa chambre à côté. La voix de ma grandmère lorsqu’elle arrive de Jérusalem. Mon autre grand-mère qui jardine. Les oiseaux et les insectes de la montagne au printemps. Les cyprès, les pommiers et les bigaradiers. Mes pas rapides
lorsque je courais pour cueillir ma fleur préférée, le coquelicot.
Vous avez dit un jour : « La musique arabe est ma passion, mon outil et mon but. » Que vouliez-vous dire exactement ?
J’ai grandi avec cette musique – ces musiques, plutôt, tant il y a de genres. Elle est l’outil le plus puissant pour partager mon histoire et communiquer les émotions qui nous relient tous, nous humains, de quelque endroit que nous venions. Elle est mon but, car j’ai le sentiment que c’est une musique très peu connue. En France, peu de musicologues s’y intéressent et le public l’approche souvent comme une chose exotique. Qui se souvient, aujourd’hui, d’Henry George Farmer, qui a écrit sur la musique arabe et son influence sur les autres musiques, notamment européennes ? J’ai envie de transmettre cette musique, avec le plus de justesse et de profondeur possibles.
Il y a dans ce disque le désir de transmettre ; il y a aussi, n’est-ce pas, le désir d’exprimer vos émotions ?
Si cet album a pris autant de temps avant de naître – j’ai pris la décision de le réaliser en 2019 –, c’est que j’étais dans un état de refoulement de mes émotions. Mais, en même temps, j’avais tant d’histoires à raconter… Il m’a fallu accomplir un long chemin pour guérir, pour me regarder dans un miroir et accepter ce que j’y voyais. Me définir moi-même et ne pas laisser le monde me définir. C’est complexe de venir d’un endroit comme la Palestine et d’arriver en France dans une grande ville, apprendre une langue nouvelle, bouleverser ses habitudes. Apprivoiser cette liberté de mouvement que je ne connaissais pas : je n’avais pas la possibilité de marcher quatre ou cinq kilomètres, par exemple. Au début, en France, je ne me suis pas permis de le faire. Je demeurais comme emprisonnée. Ça m’a pris beaucoup de temps avant de me dire qu’ici, je pouvais recréer ma propre réalité.
La musique a déclenché le mouvement. Grâce à elle, vous avez beaucoup tourné de par le monde. Qu’avez-vous appris de ces voyages ?
Elle m’a permis de faire des rencontres : les musiciens qui figurent sur l’album en sont le témoignage. Ils m’ont beaucoup appris, comme j’ai appris du public. La première fois que je me suis produite seule sur scène en France, au chant et au qanûn, je m’attendais à entendre dans le public des paroles ou des exclamations de satisfaction. Ce qu’on appelle, dans le monde arabe, le tarab – l’expression du plaisir de l’oreille. Mais là, c’était le silence total et j’ai eu très peur ! Ce n’est qu’ensuite que j’ai appris que ce silence n’était pas de l’ennui, de l’indifférence, mais une forme de respect, la manifestation que le public apprécie ce
— Cette réalité que je vivais a construit dans mon esprit plein de petites prisons. Je comprends aujourd’hui que c’est la liberté que je recherchais dans la musique. —
qu’il entend. À mes élèves [Christine enseigne le qanûn au Conservatoire de Gennevilliers], j’apprends cette notion de tarab, je leur enseigne les mots que l’on peut dire pour remercier la musique ! Je les invite à s’exprimer. De mon côté, j’apprends à recevoir ce silence.
La tonalité de votre album est assez « bleue » – bleue, comme le blues –avec les thèmes de l’amour déçu ou de la nostalgie. Vous reconnaissezvous dans cette couleur ?
J’aime le bleu. Ces chansons et ces morceaux parlent de ma vie –et ce que j’ai vécu, c’était plutôt bleu. Mon disque est rempli de ma vie en Palestine. Des moments de perte que j’y ai vécu. Je pense que mon enfance s’est arrêtée quand j’avais neuf ans. À partir de là, j’ai éprouvé le poids des responsabilités et le vide causé par les pertes. Il y eut la deuxième intifada et mon adolescence, très dure. De la famille perdue ; des amis perdus ; des rêves perdus aussi. Le sentiment constant d’être emprisonnée. À quinze ans, je n’avais plus le droit de me rendre à Jérusalem où je suis née. C’est tout ça qui m’a poussée à me plonger dans la musique, ainsi qu’à voyager. Je suis allée aux États-Unis et je demandais aux autres ados : « Est-ce que vous êtes obligés d’aller dans un autre pays pour prendre l’avion ? » ; « Est-ce que vous avez des checkpoints entre une ville et une autre ? » Cette réalité que je vivais a construit dans mon esprit plein de petites prisons. Je comprends aujourd’hui que c’est la liberté que je recherchais dans la musique.
— KAMA KUNTU, Christine Zayed, T-Rec, sortie le 8 novembre 2024
« SÉPARATION »
Tu as choisi de partir sous la lune argentée, laissant mon cœur sur les marches, brillant comme une épingle d’argent.
J’aurais tant voulu que tu l’entrelaces dans tes tresses.
Tu as choisi de partir sous la lune argentée, ton choix.
Tu as laissé mon cœur flotter dans les airs, volant comme un mouchoir au-dessus des arbres.
J’aurais tant voulu que tu l’emportes dans tes bagages.
Hussein Al-Barghouti
PASSEUR DE DISQUES
Par Benjamin Bottemer ~ Photos : Romain Gamba
AVEC SES BACS TOUJOURS BIEN
REMPLIS ET SES LABELS DÉFRICHEURS, LA FACE CACHÉE FAIT FIGURE DE BASTION POUR LES ACCROS DU VINYLE ET LES MUSICIENS LOCAUX, SOUS
LA MENACE CONSTANTE D’AMAZON ET CONSORTS.

Demain à Metz, c’est la Foire aux disques. Attablés autour d’un café avec Médéric Kéblé, organisateur de l’événement et fondateur de La Face Cachée il y a tout juste vingt ans, on évoque ces foires et ces brocantes où il a fait ses armes, repérant les raretés, récupérant les stocks… La première fois qu’il pose ses bacs dans une vente, tout juste majeur, il se retrouve à côté de Denis Bombardier, le créateur de L’Oiseau rare, magasin légendaire né dans les années 80 à Metz. « À ce moment-là, j’avais quelques centaines de disques, je faisais le DJ dans les mariages, je bossais dans l’industrie, mais les boîtes capotaient et je me faisais virer », raconte Médéric, qui décide alors de « faire son propre truc ». Comme un clin d’œil au destin (ou plus probablement du fait d’un loyer peu élevé), il s’installe à dix mètres de l’ancien local de L’Oiseau rare, quartier des Allemands. Puis il rencontre un Américain qui vend des rééditions US du label Scorpio records, des raretés à des prix imbattables. Les affaires décollent. Suivra l’ouverture, quelques années plus tard, d’un second local à un jet de disque de la boutique : Face B. « À l’époque, Amazon ne faisait pas de vinyles, la Fnac et Virgin presque pas », explique Médéric.
DES GROUPES PRESSÉS
En 2012, la place vient à manquer : le disquaire déménage rue du Lancieu, en centre-ville. Actuellement, ce sont plus de 10 000 vinyles et 30 000 CD qui y attendent l’acheteur. « Il y a eu toute une vague de clients DJ, collectionneurs, des trentenaires de la scène post-punk, on faisait tout le temps des apéros où on se faisait découvrir des trucs… C’est en discutant avec les clients que je me suis rendu compte que je ne connaissais pas tant de choses que ça ! » raconte celui que ses clients et amis appellent volontiers « Médé ». À La Face Cachée, les punks se mettent au hip-hop, les rockeurs virent jazzeux… et toute la scène locale s’y retrouve. Du coup, pourquoi ne pas créer un label pour la défendre ? Depuis le premier disque du Cœur Noir (Saigne Rouge) il y a seize ans, huit labels sont nés, pour environ 200 références : Hoboken Division, Tequila Savate, Le Singe blanc, Double Nelson, mais aussi des rééditions de new wave des années 80 et quelques jolis coups comme ces albums de la chanteuse japonaise Haru Nemuri, repressés trois fois… C’est aussi le temps des showcases enfiévrés dans l’arrière-boutique. « On va peut-être en refaire à l’avenir, mais c’est vrai que la scène locale actuelle est un peu moins dynamique. Dans les années 2010, tu avais des groupes comme Noir Boy George, la Triple Alliance, Le Singe blanc qui faisaient marcher le bouche-à-oreille, leurs disques aussi se vendaient bien », remarque Médéric.

(ANTI)TRUST
Le fameux retour du vinyle, il y a dix ou quinze ans, a aussi eu son revers de médaille : « Tout le monde s’y est remis, les gros labels ont repris la main en accordant plus de remises à Amazon ou à la Fnac, qui sont en dépôt-vente alors que nous on achète tout… mais les majors ne veulent rien savoir », déplore le disquaire. « Et nous, en bout de chaîne, on gratte sur nos marges. » Restent le conseil, les relations privilégiées avec les petits labels, eux aussi noyés dans les sorties mainstream. Comme de nombreux commerces indépendants, La Face Cachée tire la langue face à la hausse des prix, tandis que certains clients mettent leurs euros ailleurs. « Le plus dur, ça va être de faire revenir les plus jeunes vers le support physique », ajoute Médé. Auprès de ses comparses Hervé, Sébastien et Delphine, on fouille un peu dans les bacs, on fait défiler les nouveautés des groupes du cru toujours vaillants, que le disquaire militant met en dépôtvente gratuitement. Supporter les locaux, envers et contre tout : un état d’esprit sur lequel La Face Cachée doit pouvoir compter pour continuer à nous en mettre plein les oreilles.
— LA FACE CACHÉE, www.la-face-cachee.com
ILS EN PARLENT (MIEUX QUE NOUS)
En tant qu’auditeur et musicien, Xavier Kemmlein a eu « des phases, que La Face Cachée a accompagnées, voire impulsées ! C’est grâce au magasin que j’ai découvert les Cramps. On a signé deux albums avec mon ancien groupe The Swamp. Ça marchait beaucoup à l’affect : entre coups de main et échanges de bons procédés, Médé veut toujours “faire ensemble”, c’est son credo. C’est important dans une scène culturelle locale où tout le monde se connaît, mais où finalement les gens font peu de choses ensemble. »
Avec son projet Le Cœur Noir (Saigne Rouge), Hugues Reinert a été le premier à signer sur Les Disques de la Face Cachée ; et aussi le dernier avec son groupe Corde Raide cette année. « J’ai été élevé avec des disquaires : c’est là que je découvrais la musique. Je ne peux pas compter les rencontres faites à La Face Cachée, qui aboutissaient parfois à monter des groupes. La Face Cachée, c’est vraiment un lieu du rock à Metz. »
Illustrateur et musicien (Oï Boys, Frau Trofea), Val l’Enclume garde un souvenir ému de ses années fac où il arrivait plus tôt, depuis Thionville, pour passer à La Face Cachée. « Mon premier album acheté, c’était Damaged de Black Flag. Il y avait aussi du pointu, des petits labels introuvables ; et encore aujourd’hui, alors que les disquaires des grandes enseignes n’ont plus du tout la main sur ce qu’ils vendent. J’y ai fait mes premières expos, pendant les showcases du vendredi. La Face Cachée et ses labels ont fait énormément pour la scène musicale à Metz. »
KINDNESS IS THE KEY!
séparer. Nous avions fait dès lors notre deuil de cette petite bande généreuse.
Il est des rencontres qui marquent plus que d’autres ! Quand nous avions croisé le groupe Late of the Pier à La Laiterie, le 30 janvier 2009, nous étions loin de supposer l’affection que nous porterions à son leader pourtant déjà si charismatique, le très jeune Sam Eastgate alias Sam Dust. Le set impressionnant ce soir-là avait tout pour nous alerter cependant, même si ce groupe constitué dans la petite ville de Castle Donington, au cœur de l’Angleterre, pouvait encore s’apparenter à une génération pop fluo dont on ne savait guère si elle allait perdurer – elle se prolonge aujourd’hui avec le brio de Metronomy, par exemple… L’histoire a malheureusement voulu qu’un décès survenu parmi les membres (Ross Dawson, le batteur) conduise à la fin prématurée de ce groupe si prometteur. Ainsi, ils disparaissaient de manière à peu près aussi surprenante qu’ils n’étaient apparus, prétextant des side-projects pour les membres restants, sans véritablement se
C’était sans compter la capacité de Sam Eastgate à réapparaître au moment où l’on s’y attendait le moins. La première fois, ce fut à l’occasion d’un concert du trublion psychédélique néo-zélandais Connan Mockasin en novembre 2011 au club de la Laiterie. Sam y apparaissait en side-man de luxe, y compris à la batterie, lui, le guitariste qui nous avait habitués à se consacrer jusqu’alors au chant et au clavier. Face à une maigre audience, le set est absolument magnifique – on croit voir une sorte de Soft Machine des débuts avec de longues plages psychédéliques azimutées ! La complicité des deux, Sam et Connan, a conduit au projet Soft Hair peu de temps après, qui reste l’une des plus belles expériences d’une soul électronique blanche délicieuse, comme en témoigne le clip hilarant de « Lying Has to Stop Now ».
Les deux inséparables ne tardaient pas à nous surprendre une fois de plus. Alors que nous avions rendez-vous avec Charlotte Gainsbourg en 2012, toujours à La Laiterie, qui ne voyons-nous pas débarquer, l’un en peignoir roulant sur un minivélo dans le hall – Connan Mockasin, forcément ! –, l’autre plus discret et souriant – notre ami Sam ! –, tous deux curieux d’assister à l’entretien. Nous étions sincèrement touchés et amusés de les retrouver en pareille circonstance autour de Charlotte, visiblement fière de s’afficher avec ces deux surdoués de la pop comme membres d’un backing-band inespéré.
Mais il nous a fallu trois longues années de plus avant de voir apparaître – à un moment où l’on ne s’y attendait plus guère ! – un premier enregistrement personnel de Sam Eastgate sous un nouveau pseudo : LA Priest (prononcez « Lah Pree-st »).
Par Emmanuel Abela et Françoise Abela-Keller ~ Photo : Joseph Bird
Alerté par notre ami peintre, le Strasbourgeois Mathieu Wernert, nous nous étions précipités sur un disque qui ne risquait pas de nous décevoir tant il recelait l’essence subversive et tendre du personnage : une pop électronique qui n’était pas sans rappeler l’esprit d’aventure de quelques laborantins, à mi-chemin entre Syd Barrett et Neu ! avec une touche soul-funk intimiste évoquant les expérimentations de Prince. Nous y trouvions tout ce qui nous attachait à lui, ce côté anglais totalement décomplexé et généreux. Parmi les petites merveilles de ce disque, l’inaltérable « Mountain », pour lequel Sam monte haut dans les aigus sur un clavier d’infortune.
En plein confinement, nous recevions comme par miracle un exemplaire de Gene en provenance d’Angleterre, son deuxième album pour lequel cet artisan du son avait fabriqué une machine, « The Gene Drum Synthesizer », une boite à rythmes modulaire très élaborée qu’il a fini par commercialiser et autour de laquelle il avait construit un album encore plus chaleureux : les rythmes maîtrisés, mais contenant leur part d’« irrégularités », selon ses propres mots, conduisaient à des formes anguleuses qui deviendraient sa marque de fabrique. Une forme qu’il prolongea avec son troisième album, Fase Luna, enregistré au Costa Rica et publié l’an passé, comme un hommage si fluide à l’océan environnant. Il ne restait plus qu’à organiser les retrouvailles sur scène. Et le hasard voulut que notre présence à Londres, coïncidant avec une de ses apparitions, nous en offrît la possibilité. C’était le 7 juin dernier.
L’affaire était entendue, le rendez-vous était pris grâce à l’antenne française de Domino, son label, mais il s’en est fallu de peu pour que la rencontre soit compromise : un accident dans le métro londonien nous a engagé in extremis dans une odyssée incertaine en taxi à destination de No90, un bar-restaurant et salle de concert loin dans la périphérie Est de la capitale anglaise, à Hackney Wick, sans garantie de retour.
Après quelques sueurs froides, nous arrivions haletants, pile une minute avant l’horaire fixé, avec la possibilité précieuse d’assister au sound-check. Nous remettant de nos émotions, nous découvrîmes sur scène un amoncellement d’appareils plus vintage les uns que les autres, dont certains totalement reconfigurés en mode sound-system avec une foultitude de loupiottes dignes d’une fête foraine aussi inquiétante qu’engageante.
Avec la gentillesse qui caractérise certains Anglais, Sam vient à notre rencontre. L’un de ses amis et collaborateurs nous demande de le ménager – il sort lui aussi d’une journée éprouvante ! On lui promet de ne pas dépasser les 20 min – sans jamais regarder la montre, nous nous limiterons à 19’46”. On nous conduit sur une péniche qui sert de loge, et l’endroit semble absolument idyllique. On l’interroge tout de go sur La Fusion qu’il utilise
en français comme titre à son dernier EP 4 titres. Il nous précise avec une grande douceur que ses titres, il les choisit « autant pour le son que pour la signification ». Mais il admet qu’il a voulu exprimer par ce titre « la tentation de baser ses disques sur le son de sa guitare, avec une approche organique. J’ai le sentiment, poursuit-il, que cet EP constitue la parfaite fusion entre le traitement électronique que j’apporte à mes enregistrements et une nouvelle dimension acoustique ».
On lui signale que cette fusion passe aussi par la construction de ses propres instruments et des éléments de diffusion sur scène – son ami nous signalait quelques minutes auparavant qu’il expérimentait ce soir-là, sans filet, un nouveau dispositif qu’il venait d’achever. Est-ce une manière pour lui d’embrasser l’ensemble de la création, de la composition à l’enregistrement, jusqu’à la scène ? « Oui, définitivement ! Pour les deux premiers albums, je ne m’étais pas posé la question de savoir comment écrire des chansons. Il m’arrivait parfois

d’attendre une année pour capter la moindre idée. L’utilisation intensive des machines sur ses disques constituait pour moi une manière d’accélérer le processus de composition, afin de faciliter une forme d’inspiration. Et sur le troisième album, j’ai appris à écrire dans l’instant, afin d’écrire le plus grand nombre de chansons que je pouvais. Je me consacrais un peu moins aux machines, mais c’est bien de pouvoir faire les deux, je crois. »
Nous insistons sur un élément distinctif de sa production, un son de guitare qui n’appartient qu’à lui, avec des motifs répétés, fragiles mais porteurs d’une émotion subtile. « Vous savez, concernant la guitare, je ne me suis jamais montré particulièrement porté sur la technique. Quand j’étais môme, tous les gars s’entrainaient pour obtenir une bonne pratique ! [Il imite avec la voix un solo parfait à la guitare, en souriant] Ce que je cherche, c’est l’expression première de la guitare dans sa double dimension rythmique et mélodique. » Nous lui signalons l’approche hautement inventive de sa pratique – il apprécie la remarque ! – à la manière si particulière d’un Holger Czukay, du groupe allemand Can, qui multipliait les volutes électriques et autres distorsions subtiles. Sam nous avoue qu’il n’est pas très familier du groupe, même s’il les a écoutés un jour en chemin en Écosse. « Et il est vrai que certaines personnes associent ce que je fais au krautrock. » On lui suggère l’écoute de « Moonshake », cette sorte de dub sautillant qu’on retrouve sur Future Days, il nous dit qu’il l’a déjà écouté, mais précise : « J’ai sans doute beaucoup écouté de gens qui ont été influencés par Can, et ça doit se ressentir. Je suppose que tout cela, additionné, crée de la cohérence dans ce que je fais. »
Le titre de son album, Fase Luna , évoque un alunissage sur notre satellite peuplé de mille et une créatures, en référence à la présence de singes criards à proximité de son studio. Il confirme la chose, mais précise que l’intention était plutôt de se consacrer aux sons de l’océan. « Beaucoup de musiques peuvent s’inspirer de la mer, mais là, en l’occurrence, le but était de permettre d’y plonger pleinement. Je souhaitais que ça soit parfait pour cela. Le rapport à la Lune ne concerne finalement que la variété de ses positions vues de la mer. J’essayais d’expliquer par là que la Terre si grande, qui finit par se connecter intégralement, continue de subir l’influence de la Lune. C’est quelque chose qu’on perçoit quand on situe la présence de celle-ci, dans un rapport si étroit à l’océan justement. Elle relie le tout. » Sur la Lune, on ressent une certaine légèreté, une légèreté qu’on retrouve à l’écoute du disque, sans que la gravité – en jouant un peu sur les mots – ne soit totalement écartée. « Oui, la Lune est suspendue dans l’espace au-dessus de l’océan », affirme-t-il avec poésie. « Avais-je le sentiment d’achever ce disque comme je le souhaitais alors que c’était la première fois que je le mixais moi-
même ? Ce que je peux en dire, c’est que je me suis senti submergé par la joie qu’il me procurait. Je pense qu’il est plus sauvage et plus libre que je ne l’avais imaginé. C’est une chose particulière d’avoir le sentiment de contrôler les choses alors que celles-ci s’émancipent de tout contrôle. C’est un peu magique ! »
On lui confirme une certaine immédiateté à l’écoute et cette forme de candeur, au sens premier du terme, qui l’ouvre en tant qu’artiste constamment sur le monde. « Je pense que c’est le cas. Ce qui m’importe, c’est d’investir un espace. Cela me permet de tendre vraiment à une forme d’expressivité. Et j’ai le sentiment de ne pouvoir atteindre ce niveau d’expression qu’à partir du moment où je me montre en capacité de répondre à la fois à l’urgence de notre temps. »
Nous en profitons pour lui parler de sa présence sur scène, qui s’apparente plus à un happening contemporain qu’à un dispositif frontal de concert. « Il me semble que l’on gâche une belle occasion si l’on se contente de rejouer nos morceaux. J’aime l’idée de l’implication totale du public. Je souhaitais lui prouver, même s’il pense le contraire, qu’il fait partie intégrante de cette expérience commune. » De manière connectée ? « Oui, en quelque sorte, ce qui peut sembler surprenant dans la mesure où je ne suis pas une personne particulièrement extravertie moi-même… » Il en sourit.
Nous le supposons effectivement très timide, mais Sam Eastgate sait sortir de sa réserve pour se livrer entièrement dans le cadre d’un set extatique. À la croisée d’un Iggy Pop ou d’un David Bowie, il s’offre sur des rythmes électroniques et funk que ne renierait pas Daft Punk, se mouvant seul sur scène avec une générosité sans pareille et faisant corps avec son public de manière fusionnelle. On mesure à quel point il ne fait également qu’un avec ses appareils, brillant de mille feux dans la nuit londonienne, lui l’homme-machine ultime, animé et libéré, qui n’hésite pas à disparaître, allongé au cœur de la foule, ni à escalader dangereusement son équipement instable. La raison n’est plus de mise, le don de soi est total. Le concert qu’il donne ce soir-là à Hackney Wick est peut-être l’un des plus beaux auquel nous ayons eu l’occasion d’assister : la maîtrise technique se trouve contredite par l’improvisation, comme si cet artiste, l’un des plus passionnants qui soient depuis plus de quinze ans, luttait, luttait encore, luttait désespérément pour maintenir dans ce monde une ultime pulsion de vie.
—
FASE LUNA, — LA FUSION, LA Priest, Domino
Mise en œuvre
Le besoin de faire œuvre ensemble
imprègne les événements de la rentrée. Les modes d’emploi s’y
attèlent au MAMCS, l’œuvre psychopompe de Jean Messagier mime notre devenir à la Fondation
Fernet-Branca, les photographies d’Olivier Metzger se révèlent à la lumière de la Filature, et celles d’Ayline Olukman retournent à l’état sauvage.

STRATÉGIES OBLIQUES
Par Valérie Bisson
Vera Molnar, OTTWW, 1981-2010, Fils et clous noirs. Centre Pompidou, Paris, Musée national d’Art moderne –Centre de création industrielle. Exposition « mode d’emploi », MAMCS, 2024. Photo : M. Bertola, Musées de Strasbourg © ADAGP, Paris 2024
LE MAMCS S’EMPARE DE « L’ŒUVRE À PROTOCOLE », OU INSTRUCTION WORK, ET DÉPLIE UNE SURPRENANTE EXPOSITION ÉLABORÉE DANS LE SOUCI DU MOINDRE COÛT ET DANS UNE MISE EN
Visite guidée avec Anna Millers qui co-signe sa première exposition avant de s’envoler pour le Mucem.
Pensée dans le cadre de Strasbourg Capitale mondiale du livre UNESCO 2024, en partenariat avec le Centre Pompidou, le Frac Lorraine, le CEAAC et le Festival Musica, l’exposition « mode d’emploi » déconstruit nos traditionnelles représentations de ce qui fait une œuvre d’art en soulevant une simple question : une œuvre d’art peut-elle être réalisée à partir d’un mode d’emploi ?
La réponse est une plongée dans un chapitre de l’art contemporain peu connu dont l’origine va de Marcel Duchamp à László Moholy-Nagy. L’œuvre à protocole se manifeste à partir d’un énoncé formulé par l’artiste qui décrit les conditions de son apparition. À partir d’instructions écrites, dessinées ou orales, l’œuvre est réalisée par un tiers remettant ainsi en perspective les notions d’auteur, d’originalité ou encore de pérennité.
Dans un itinéraire qui s’organise autour de huit verbes, sorte de guide de conduite pacifiste et humble face à la réalité de notre humaine condition – déléguer, concevoir, interagir, programmer, interpréter, activer, laisser faire et disparaitre –, l’exposition regroupe plus de 50 œuvres activées à partir d’instructions émanant d’une quarantaine d’artistes internationaux dont Alice Aycock, Daniel Buren, Latifa Echakhch, Esther Ferrer, Yona Friedman, Dora García, Kapwani Kiwanga, Larva Labs, Sol LeWitt, Yoko Ono et Ian Wilson.
Anna Millers explique : « Lorsque l’artiste décide de placer sa création sous le signe du concept et que sa matérialité est déléguée à une autre personne, cela nous parle du faire-ensemble, de la délégation d’autorité, de rapports de pouvoir. Les artistes s’interrogent à la fois sur leurs pratiques et sur l’inscription et l’impact de l’art sur la société, remettant en question le capitalisme et le statut de l’œuvre d’art comme marchandise. »
Le grand lettrage inaugural de Lawrence Weiner nous permet d’entrer de plain-pied dans le monde des idées. L’itinéraire est marqué par des installations spectaculaires et par des œuvres participatives mobilisant l’esprit et le corps. Il est ponctué par des salles documentaires offrant une plongée dans différents domaines de la création, partitions de Cornelius Cardew, Morton Feldman ou John Cage, design DIY ou architecture collaborative de Yona Friedman confiée aux élèves du Lycée Pasteur. Imaginée dans une démarche écoresponsable, sans transport d’œuvres et avec la participation de chaque corps de métier du musée, ainsi que la coupe dans le mur pour le menuisier ou l’œuvre du peintre sur les pièces blanches du jeu d’échecs monochrome de Yoko Ono : « L’exposition bouleverse complètement notre perception », précise Anna Millers. « L’œuvre n’est plus unique parce que réactivée à chaque fois. Aucune œuvre
n’a été transportée, tout a été fait sur place par les équipes des musées, avec les moyens du bord, de la peinture, de la ficelle, du papier, des choses assez simples proches de l’art conceptuel des années 60 et aussi parfaitement contemporaines avec le discours d’artistes sur la crise climatique ou les enjeux décoloniaux. »
La troublante et méditative œuvre de Marianne Mispelaëre, La bibliothèque des silences, inscrite à même les murs, vient clore le parcours, nous laissant témoin d’une foultitude de langues disparues depuis 1988, année de la naissance de l’artiste, et qui sont en majorité des langues du Sud. Témoin silencieux, invité, peut-être, à agir, sûrement à prendre conscience. Il y a quelque chose d’imperceptiblement poétique dans ces œuvres imaginées pour s’inclure, s’adapter, interagir avec un espace sans forcément s’affirmer comme des œuvres d’art en tant que telles, quelque chose de poétique et d’éminemment politique.
— MODE D’EMPLOI, exposition jusqu’au 1er juin au MAMCS, à Strasbourg www.musees.strasbourg.eu

Michel Blazy, Mur de pellicules (rouges), 2011-2015, Agar-agar, eau et colorant alimentaire. Centre Pompidou, Paris, Musée national d’art moderne – Centre de création industrielle. Exposition « mode d’emploi », MAMCS, 2024. Photo : M. Bertola, Musées de Strasbourg © ADAGP, Paris 2024
PLUIE DE PAILLETTES
Par Clément Willer
À LA FONDATION FERNET-BRANCA, CONÇUE PAR LES
COMMISSAIRES BERNARD CEYSSON ET ANNETTE KLEIN, SUGGÈRE QUE L’ŒUVRE DU PEINTRE EST UNE MESSAGÈRE.
Mais si c’est une messagère, c’est une messagère qui ne transmet aucun message ; ou alors un message dans une langue inconnue, une langue infrahumaine, une langue traversée par les bruissements du vent, les couleurs miroitantes des saisons, les pluies de sable magique des instants d’une intensité particulière qui parsèment nos existences.
« Car l’existence n’a guère d’intérêt que dans les journées où la poussière des réalités est mêlée de sable magique », écrivait Marcel Proust dans À l’ombre des jeunes filles en fleurs en 1922, comme s’il avait étrangement pu voir les peintures fascinantes de Jean Messagier avant l’heure et s’imprégner de leurs atmosphères scintillantes. C’est en m’attardant devant une toile de 1990 intitulée On accroche la mer à la terre , que cette phrase de Proust m’est revenue et que je l’ai notée à la hâte dans mon carnet. Je ne me lasse pas de continuer à la contempler dans le très beau catalogue de l’exposition édité par la Fondation Fernet-Branca, même si sa reproduction photographique ne permet pas de bien distinguer ce qui en fait toute l’énigme :
cette pluie de paillettes qui perce la brume à travers laquelle on devine que s’entremêlent en tourbillonnant les éléments terrestres et maritimes. Dans ces dernières œuvres des années 1990, dont certaines sont exposées pour la première fois grâce à la complicité de son héritier Élie Messagier, le peintre, qui est sans doute l’un des représentants les plus intéressants de l’École de Paris et de l’abstraction française avec Pierre Soulages ou Serge Poliakoff, ne craint plus d’affronter le chaos. Il semble que les traînées de paillettes ou les coulures de la peinture soient en quelque sorte les traces de gestes fiévreux qui accueillent le chaos de la nature et de l’univers comme s’il nous apportait une sorte de salut.
À sa manière, Jean Messagier, qui avait peint Les rivières meurent en 1973, était déjà singulièrement conscient et inquiet du désastre écologique qui est l’envers de la modernité. Avec ses toiles qui laissent libre cours à tous ces achèvements et tous ces commencements venus d’ailleurs, il paraît nous dire qu’on ne pourra entrevoir un salut qu’en renonçant à nous barricader contre les puissances

cosmiques qui nous traversent, en nous raccordant plutôt à elles. Alors que je longe d’autres œuvres saisissantes comme Septembre hard-core, Inondations d’été avec jeunes couleuvres ou Apocalypse du printemps qui datent des mêmes années, d’autres phrases me reviennent, des phrases de Gilles Deleuze qui parle dans ses Dialogues d’un très étrange « devenirimperceptible » : « Là nous n’avons plus de secret, nous n’avons plus rien à cacher. C’est nous qui sommes devenus un secret, c’est nous qui sommes cachés, bien que tout ce que nous faisons nous le fassions au grand jour et dans la lumière crue. Nous nous sommes peints aux couleurs du monde. »
Depuis l’intrigante Mère de l’artiste de 1944, accrochée seule sur un vaste mur dans la première salle et dont le visage est peint d’un vert presque fluorescent, c’est comme si toute la peinture de Jean Messagier manifestait cette volonté de se peindre aux couleurs du monde et des saisons, de retrouver le secret troublant de la pure apparence.
Plus tard, en sortant de l’exposition, alors que je viens de monter dans le train pour Strasbourg,
je me souviens que l’historien de l’art Bernard Ceysson a laissé entendre, au cours de la visite à laquelle j’assistais, que la une de Libération ce matin même aurait sans doute retenu toute l’attention de Jean Messagier : « Feu l’Amazonie. » Il ajoute qu’il aurait peut-être choisi cela comme titre pour une œuvre à venir… Je regarde par la fenêtre du train et j’essaie d’imaginer ce à quoi pourrait ressembler cette peinture. Dehors, il fait un temps bizarre, un temps de septembre hard-core sans doute. Averses brutales et percées d’une lumière éblouissante s’alternent sans logique. Je remarque que les gouttes de pluie, dans la lumière blanche, ressemblent à des paillettes, des paillettes dont on ne sait pas vraiment si elles portent une promesse d’achèvement ou de commencement.
— L’ŒUVRE-MESSAGIER – UNE MIMÈSIS
ABSTRAITE DU MONDE – LES COMMENCEMENTS ET LES ACHÈVEMENTS, exposition jusqu’au 2 février à la Fondation Fernet-Branca, à Saint-Louis fondationfernet-branca.org
Jean Messagier, Voyages sous un aigle, août 1963, huile sur toile, 191 × 221,5cm. Collection particulière © Studio François Vézien
OLIVIER METZGER PREMIER À ÉCLAIRER LA NUIT
Par Nicolas Bézard
DANS UNE EXPOSITION QUI RETRACE
LES MOMENTS MARQUANTS DE SON
ET DES AMBIANCES MÉLANCOLIQUES.
Les nocturnes du photographe Olivier Metzger sont peuplées de présences évanescentes ou magnétiques. Celle d’une biche à l’orée d’un bois ou d’une automobile abandonnée sur le parking d’un motel. Celle d’une diva fanée en lice pour un dernier tour de chant. Celle de l’obscurité pesant de tout son poids contre une baie vitrée exhibant un petit théâtre hopperien – de l’autre côté du verre, dans une lumière glaçante d’appartement témoin, un téléphone a sonné, une jeune femme a décroché et le temps s’est, semble-t-il, arrêté. Semble-t-il, car cette image demeurera, comme toutes les autres réalisées par ce stakhanoviste du hors-champ et de l’ellipse visuelle, une énigme, une question sans réponse.
Magnétique est un adjectif qui revient souvent dans la bouche de celles et ceux qui ont connu l’artiste décédé tragiquement dans un accident de la route en novembre 2022, à l’âge de 49 ans. Emmanuelle Walter a fait la rencontre du futur photographe de presse et portraitiste chéri des rédactions parisiennes – Libération, Elle, Télérama, etc. – à l’époque où cet autodidacte hésitait à quitter son métier d’infirmier dans les hôpitaux publics de Mulhouse pour se consacrer pleinement à sa passion pour l’image. Non sans émotion, la coordinatrice de l’exposition lui rendant hommage
à la galerie de La Filature se souvient : « Olivier était quelqu’un de réservé, mais aussi de très attentif. Il avait une sorte de magnétisme, non pas une lenteur, mais une patience, une façon tranquille d’imposer un rythme, une fréquence singulière dans la relation. Ils sont rares, ces gens qui parviennent à vous amener à leur fréquence. »
Sa capacité à rêver les autres, à les rallier à sa cause pour en extraire toute la quintessence, lui a valu de passer maître dans la mise en scène, en lumière et en corps, de ses modèles. Sous son regard précis et méticuleux, jamais Isabelle Huppert, Tilda Swinton, Quentin Tarantino ou le chanteur Christophe n’ont paru si proches de leurs propres mythes. Christophe, autre génie insatiable et perfectionniste regretté à qui les mots du titre de l’exposition, « Toutes les nuits tu restais là », sont élégamment empruntés.
« Olivier avait toujours des images latentes en tête, explique Emmanuelle Walter. Ces images réveillaient des fantasmes, des histoires qui toutes étaient enveloppées par cette vision nourrie par des références cinématographiques, notamment David Lynch qui avait été très impressionné par sa série Smile (Forever) lors de Paris Photo en 2012, mais pas que. » L’exposition permet en effet de prendre la mesure de cet imaginaire qui semble autant puiser chez les grands cinéastes de l’ambiguïté –Lynch, De Palma, Hitchcock – que dans l’univers de Jean-Pierre Melville, le roman noir américain ou la peinture paysagiste anglaise du xxe siècle. « J’ai le sentiment qu’il y avait toujours quelque chose en attente dans ses photographies », poursuit la responsable des Arts Visuels de La Filature. « Il ne s’y passe rien de dramatique, nous ne sommes pas dans un scénario à suspense, mais on y sent une attente, une sorte de tension sous-jacente à ce qui est montré. »
Une irréalité aussi, comme lorsqu’il photographie en 2022 la nuit landaise à la lumière cuivrée des éclairages au sodium, condamnés à disparaître.

© Olivier Metzger – modds
Dans le cadre d’une grande commande nationale pour le photojournalisme financée par le ministère de la Culture et pilotée par la BnF, Olivier Metzger poursuivra sa recherche avec Aux lumières de la ville, série qu’il n’aura pas eu la chance de voir produite et exposée de son vivant, d’odieuses ténèbres ayant bien trop tôt éclipsé à notre vue et à celle de ses
proches celui qui restera dans les mémoires comme un des talents les plus notables de sa génération.
— TOUTES LES NUITS TU RESTAIS LÀ, exposition jusqu’au 22 décembre à la Filature Scène nationale, à Mulhouse www.lafilature.org
LA NOSTALGIE DU TEMPS PRÉSENT
Par Emmanuel Abela

PEINTRE, PHOTOGRAPHE ET POÉTESSE, AYLINE OLUKMAN
NOUS LIVRE UN BEL OUVRAGE CHEZ MÉDIAPOP, NOS VIES SAUVAGES, QUI
INTERROGE LA FORCE DE L’ACTE CRÉATEUR.
On sent que ton dernier ouvrage, Nos vies sauvages, s’inscrit dans le prolongement de tes précédentes publications, mais avec une interrogation renforcée. Quelle en est l’origine ?
Je menais une interrogation sur nos parts indomptées et je souhaitais mettre en image cette part sauvage, ce flux en nous qu’on ne maîtrise pas. Une bonne partie est venue de l’étude de mes rêves : le temps de l’endormissement, où l’on part vers des lieux incertains avec nos yeux qui enregistrent ces images, ces narrations. Poétiquement, j’ai envie de poser en images ces données qui nous traversent et nous constituent.
Peut-être peux-tu nous toucher un mot de cette présence de la reproduction d’un tableau médiéval en ouverture ? Il s’agit de Saint Jean l’Évangéliste à Patmos, une représentation du xve de St Jean L’Évangéliste conservée à Gênes.
Il est vrai qu’un détail de cette première image, qui ouvre le livre, m’a accompagnée durant tout le temps où j’ai travaillé sur l’ouvrage. Elle était mon fond d’écran. J’y trouvais quelque chose à quoi

je revenais sans cesse. Dans mon travail s’établit un lien constant à la peinture qui dialogue avec la photographie. Je souhaitais que, comme souvent, le point de départ soit une peinture, cette fois-ci pas la mienne, et qu’elle constitue l’ancrage poétique et visuel de ma démarche.
Dans cette œuvre-là, saint Jean reçoit la parole de l’Ange pour écrire l’Évangile ou l’Apocalypse. Audelà de cela, je vois là une forte symbolique liée à l’acte créateur en lui-même, et cette chose qui se transmet qu’on peut appeler « inspiration », qui peut même venir d’ailleurs – sans évoquer forcément une quelconque transcendance. Oh, mais si tu écartes la transcendance, moi j’aimerais garder la notion de « transe », cette chose qui nous traverse et qui est plus forte que nous. Elle vient de toutes ces informations que nous avons pu glaner, qu’elles soient visuelles, mémorielles, olfactives… L’état créatif fait partie du questionnement au cœur de mon travail. Comment il naît, d’où vient cette faculté à nous partager une image dans l’instant.
Nous avons déjà eu l’occasion d’en parler à propos de La Mue , ton ouvrage précédent : chez toi, on situe un temps d’avant et un temps d’après, comme si l’image comprenait des temps imbriqués, ce qui vient, ce qui advient et ce qui est au moment précis où tu déclenches la prise de vue.
Je le dis souvent, au moment de la captation, je ne vois vraiment rien. Que je sois en train de peindre ou de photographier, je sais qu’il se passe quelque chose, j’arrive un peu à canaliser l’énergie, j’arrive à la cadrer, j’arrive à la comprendre – je regarde les bords des choses, mais je ne regarde pas vraiment ce qui se passe à l’intérieur. Je me laisse porter et je sais que si je parviens à toucher ce moment, c’est que je travaille vraiment. Dès lors, je me laisse guider par cette transe de l’état créatif qui me fascine. Par rapport à ce que tu disais du temps, dans ce livre, j’ai souhaité narrer une histoire, mais avec la complexité d’une narration onirique. On sait que dans le rêve des événements se produisent à la suite, non pas de manière aléatoire, mais avec un rapport à un temps absorbé, étendu. Dans le séquençage de mes images, j’ai eu


envie de travailler cet aspect. Une tension naît de la suspension – ou de la superposition – des images. J’ai eu envie d’explorer ce temps-là, notamment dans les images en couleurs du livre.
Ce qui me semble nouveau ici, et ce qui explique en partie le titre de l’ouvrage, c’est qu’on se situe à un commencement. Le temps que tu décris est justement celui d’une Genèse, celui peut-être même d’avant la Chute. Tu magnifies tout cela avec des compositions minérales, végétales, au sein desquelles apparaît la figure humaine – des femmes, des hommes, parfois indistincts. Et tu sembles inscrire quelque chose de la nostalgie de ce temps-là, celui d’avant.
Effectivement, nous en sommes tous à questionner la destination de notre humanité. Où en sommes-nous ? Et qu’allons-nous devenir ?
Aurions-nous la possibilité de retourner à l’état naturel ou du moins à cette nature ? Il est important de se poser la question, de regarder cette nature, de la protéger et de s’interroger sur ce qu’elle représente. Avec cette prise de conscience de la chance qui est encore la nôtre, tout en cultivant notre rapport à l’éblouissement.
— NOS VIES SAUVAGES, Ayline Olukman, Médiapop



Luxembourg Art Week
En 10 ans, la Luxembourg Art Week a pris sa place dans le grand jeu des foires d’art contemporain européennes tout en restant fermement ancrée dans le paysage artistique local. Cette année, elle rassemble une sélection de galeries triées sur le volet et issues de 18 pays et 5 continents. Une édition anniversaire, qui risque de marquer les esprits avec une série de réjouissants temps forts : parcours artistique dans la ville, programme OFF en collaboration avec les institutions artistiques du Grand-Duché, collabs pointues avec des artistes internationaux… Le rendez-vous arty de l’hiver, à la croisée géographique et culturelle de l’Europe. (M.M.S.)
Du 22 au 24 novembre À Luxembourg ville, au Luxembourg www.luxembourgartweek.lu
Installation view, Luxembourg Art Week 2023 © Mike Zenari
Voir le temps en couleurs, les défis de la photographie
Pensée comme une grande promenade dans l’histoire de la photographie, « Voir le temps en couleurs » propose un véritable chassé-croisé temporel. On y croise Saul Leiter, pionnier de la photographie couleur dans les années 50, Étienne-Jules Marey inventeur de la chronophotographie, Constantin Brancusi en sérial photographe ou les clichés en apesanteur de la NASA. Structuré en trois grands chapitres (reproduire une image, retenir le temps et fixer la couleur), le parcours se permet également des détours du côté de la création contemporaine. De la reproductibilité de l’œuvre d’art à la maîtrise de l’instantané, on découvre un médium passionnant qui n’a jamais cessé de repousser les frontières du visible. (M.M.S.)
Jusqu’au 18 novembre
Au Centre Pompidou-Metz, à Metz www.centrepompidou-metz.fr

Helen Levitt, N.Y., 1971 © Film Documents LLC. Autorisation Thomas Zander, Cologne
Gris et Bleu - Nicolas Muller
Au premier regard, l’œuvre de Nicolas Muller nous évoque quelque chose des facéties dadaïstes. Comme quand il collectionne les roues de vélo tordues ou qu’il colle une semelle de bronze dans le pli d’un mur. Mais son travail s’oriente aussi vers un minimalisme graphique, alors que son pinceau flirte avec le tachisme ou la calligraphie. Ou que ses crayonnés sont volontairement effacés par un énergique coup de gomme. À Nancy, « Gris et Bleu » se joue justement de cette oscillation permanente entre la rigueur géométrique de la ligne et le geste imprévisible qui frôle l’accident. Un bel entre-deux, pour mieux se faufiler dans l’univers pluriel de l’artiste strasbourgeois. (M.M.S.)
Du 25 octobre au 21 décembre À Octave Cowbell, à Metz www.octavecowbell.fr

Public, Nicolas Muller

Visions
Le musée des Beaux-Arts de Nancy nous aiguillonne avec un titre prophétique qui voit triple. Il fallait bien cela pour être à la hauteur des 200 ans de la photographie. « Visions » rassemble trois expositions dans son sillage, mêlant tirages contemporains (Leurs regards), retour sur les prémices de ce médium avec la Société lorraine de photographie (Pionniers !) et projet social sur les vertus de la photo (Pour l’amour de soi). Et parce que la photographie s’inscrit aussi de façon permanente dans les collections nancéiennes, un accrochage consacre les nouvelles acquisitions en la matière. Avec Jean-Luc Tartarin, Françoise Saur ou Jin Robardet… (M.M.S.)
Du 24 octobre au 2 février
Au musée des Beaux-Arts de Nancy, à Nancy musee-des-beaux-arts.nancy.fr
Gabou et Stephane. Photo : Emmanuelle Henry © Compagnie Sans Sommeil - MBAN

Melita, −ml , Refuge
Prenant pour point de départ l’île de Malte et son héritage, la photographe Anne Immelé propose une séquence visuelle où passé et présent, références historiques et actualité ne cessent de se croiser. Avec une sensibilité mêlant la précision du photoreportage et les détours poétiques de la fiction, « Melita, −mlṭ, Refuge », aborde la notion d’hospitalité. La photographe a promené son objectif là où les routes des conquêtes commerciales des Phéniciens concordent avec celles des migrants d’aujourd’hui. Ruines antiques à Malte, carrières de pierre en Sicile, ports tunisiens ou cimetières de réfugiés : elle saisit les fragments de ces trajectoires trop souvent contrariées et explore les complexités géopolitiques de la Méditerranée. (M.M.S.)
Du 4 octobre au 11 janvier
À Stimultania, à Strasbourg www.stimultania.org
Melita, Carrière phénicienne, Favignana, Sicile, 2023 © Anne Immelé
ST-ART 2024
L’art contemporain est dans les starting blocks pour la 28e édition de l’incontournable foire strasbourgeoise. Et ST-ART n’emporte pas que la scène artistique locale et nationale dans son sillage. C’est avant tout la création européenne qui bat son plein au rythme des 57 galeries internationales participantes. Pays invité, la Belgique aura l’occasion de faire rayonner la vitalité de sa scène contemporaine, tandis qu’un focus sur l’art verrier permettra de renouer avec le patrimoine régional des arts du feu. Entre cristal et verre contemporain, le Musée Lalique mettra sa touche, secondé par le grand Joan Crous, sculpteur catalan spécialisé dans les arts du verre chaud. (M.M.S.)
Du 29 novembre au 1er décembre, Au Parc des expositions de Strasbourg www.st-art.com

Yann-Bagot, Askërofjorden (Suède, Tara Europa, #40), 2023 © Galerie Robet Dantec
TransFORM
Poussins multicolores, paysages corporels, lettres d’amour pour un mariage blanc, mainates cristallisés ou chiens errants érigés en totems : voici quelques-unes des perspectives empruntées par TransFORM. Vitrine des nouvelles acquisitions effectuées par le FRAC Alsace depuis 2021, cette exposition thématique rassemble une série d’œuvres qui croient au changement et partagent l’envie de secouer le monde. Émigration, travail des enfants, néo-colonialisme, rebuts transfigurés ou envoûtants phénomènes optiques, la révolution du regard est en marche ! (M.M.S.)
Jusqu’au 17 novembre
Au Frac Alsace, à Sélestat www.frac.culture-alsace.org

Moffat Takadiwa, Fast Track Land Reform. Photo : A. Mole

Capucine Vandebrouck,
Un regard sur l’impermanence
Faire des ronds dans l’eau, contempler le temps qui passe au creux de poétiques flaques ou laisser la lumière doucement faner la couleur… Capucine Vandebrouck développe une œuvre traversée par la mutation des formes et l’impermanence des choses. La lauréate de la 8e édition du concours Talents Contemporains (initié par la Fondation François Schneider) revient à Wattwiller avec une proposition mêlant ses emblématiques Puddles à de nouvelles recherches plastiques. On retiendra notamment ses étonnants photogrammes aquatiques qui saisissent la beauté parfaite de l’onde et de ses fluctuations. Une série hypnotique, sensible et sensorielle à découvrir jusqu’au 23 mars prochain. (M.M.S.)
Du 26 octobre au 23 mars À la Fondation François Schneider, à Wattwiller www.fondationfrancoisschneider.org
Capucine Vandebrouck, Ondulations
Les Phalènes
Voici une exposition comme un poème qui s’inspire des fulgurances de l’écriture de Virginia Woolf. En voguant sur l’atmosphère si particulière des écrits de la poétesse anglaise (Les Vagues et La mort de la phalène) 8 artistes de tous horizons s’emparent du centre d’art. Emporté dans leurs courants, le spectateur croisera des papillons de nuit humanoïdes, traversera masses d’eau insondables et sculptures aquatiques avant de glaner quelques fragments d’éternité. (M.M.S.)
Du 13 octobre au 12 janvier Au Crac Alsace, à Altkirch www.cracalsace.com

Io Burgard, Silhouette a dentro, 2024. Photo : Arthur Péquin

Marie Lorenz, Confluence
Entre odyssée urbaine, taxi-marée et autres expéditions aquatiques pour écouter le chant des huitres ou rencontrer les sirènes de demain, Marie Lorenz mène sa barque dans le port de New York. Depuis près de 20 ans, elle visite inlassablement les rives de l’Hudson River, ses baies, criques et îlots, dans une passionnante exploration de proximité. En véritable cartographe, elle consigne ses découvertes et rencontres, animales ou végétales, dans son journal de bord. À Montbéliard, la New-Yorkaise décline son concept localement et propose une exploration mentale de la rivière de l’Allan. Documents sonores, sculptures réalisées à partir d’objets collectés et vidéos prises in situ restituent « la voix de l’eau » et ses impénétrables mystères. (M.M.S.)
Jusqu’au 5 janvier Au Crac Le 19, à Montbéliard le19crac.com
Marie Lorenz, Gyre, porcelaine, 2017.

FEEL’ART
Cet automne, la rentrée de l’art contemporain trouve également des échos dans le pays de Montbéliard. Pendant deux semaines, les beaux volumes de l’ancienne filature Japy d’Audincourt accueillent une vingtaine d’artistes aux horizons variés (céramique, sculpture, peinture ou performance) pour un événement d’art contemporain sous le signe de la découverte. Au catalogue 2024, retrouvez notamment les sculptures minimalistes de Bruno Bienfait, les mystérieuses concrétions de Sylvie Cairon ou le poétique arborétum gravé de Francis Hungler. Une 8e édition qui risque de décupler nos sensations ! (M.M.S.)
Du 18 octobre au 3 novembre
À la Filature Audincourt, à Audincourt www.audincourt.fr
© Marie-Rose Gutleben

Carroll Dunham & Laurie Simmons
Il est des familles que le talent n’épargne pas. C’est visiblement le cas des Dunham-Simmons, couple à la ville, parents de la célèbre Léna Dunham (réalisatrice de la série Girls) et tous deux peintres hyperactifs sur la scène new-yorkaise. En mêlant les univers de ce détonant duo, le Consortium propose un accrochage croisé mêlant références ultrapop et clins d’œil glamour. Quand Carroll Dunham sublime la nudité pulpeuse de ses cartoonesques bonhommes, Laurie Simmons tire des portraits photographiques de poupées aussi lisses que dérangeantes. Un « mariage » tout sauf arrangé entre les toiles de Monsieur et les tirages de Madame ! (M.M.S.)
Du 25 octobre au 23 mars Au Consortium, à Dijon www.leconsortium.fr
Laurie Simmons, How We See/Tatiana (Green). Autorisation de l’artiste et 291 Agency, New York

Dirty Rains
Femmes fontaines ou sirènes urbaines ? Êtres de chair ou filles de marbre ?
C’est entre insolence joyeuse, érotisme soft et humour décomplexé que balance l’esthétique de Marianne Marić. Dans Dirty Rains, la photographe nous propose une série shootée dans la moiteur des thermes de Budapest. Sur sa pellicule, maillots mouillés, douces vapeurs et esprits alanguis disent quelque chose de nos corps et décors dans l’espace public. Déroulant encore plus loin le tropisme hongrois, le CEAAC présente également le travail d’Endre Tót. Son approche graphique et conceptuelle, copieusement arrosée d’ironie, matche parfaitement avec celle de sa cadette. Un duo qui coule de source ! (M.M.S.)
Jusqu’au 23 février Au CEAAC, à Strasbourg
www.ceaac.org
© Marianne Marić, série Chair/Pierre, Paris, 2015




Là-bas
Folie passagère
Passées les chroniques de nos gardiens du temps, Nicolas Comment, Stéphanie-Lucie Mathern et Myriam Mechita, se déploient celles de nos cultivateurs de liberté : Dominique Falkner, Nathalie Bach-Rontchevsky, Bruno Lagabbe, Martin MöllerSmejkal, Jean-Luc Wertenschlag, et Claude De Barros.
FEUILLE DE ROUTES
Par Nicolas Comment
À L’OCCASION DU CENTIÈME ANNIVERSAIRE DU MANIFESTE DU SURRÉALISME, NICOLAS COMMENT S’EST RENDU
À SAINT-CIRQ-LAPOPIE, POUR Y RELIRE LES
MERVEILLLEUSES LETTRES À AUBE D’ANDRÉ BRETON.
Ne pas être là par hasard ; descendre objectivement jusqu’au Château Étoilé d’un « fauve hors de prise » (Radovan Ivšić) pour visiter l’Auberge des Mariniers du « duc… de la montagne noire » : « La Majesté même… L’un des êtres les plus intimidants qui fussent au monde. » (André Pieyre de Mandiargues) Loin des derniers cafés – Le Musset, La Promenade de Vénus – loin de Beaubourg et de « l’infracassable noyau de nuit », en plein jour, à Saint-Cirq-Lapopie (ce village de Dupond et Dupont glissant sur des peaux de bananes dans des ruelles escarpées) : souhaiter un joyeux centenaire au Manifeste du surréalisme (1924-2024) et y relire les merveilleuses Lettres à Aube sur la terrasse de l’auberge Aux Bonnes Choses, ou sous la treille du petit restaurant (depuis longtemps fermé) de Madame Julia ; ne pas pouvoir y prendre un dernier traditionnel verre de vin blanc en compagnie de Toyen ou de Joyce Mansour, mais se fendre quand même de quelques (dérisoires) photographies pour essayer de se

souvenir de Celui qui voulait « être enterré debout dans une horloge » et qui passa dru le seuil de la porte de sa maison de Saint-Cirq avant d’accepter de s’allonger à l’arrière d’une ambulance précédée d’une escorte de motards à gants blancs filant toutes sirènes hurlantes entre deux rangées de platanes sur la Route mondiale n° 1 jusqu’au 42 rue Fontaine où cet Orphée moderne fut enfin hissé en Cygne ascendant au dessus de la place Blanche, du Moulin Rouge et de l’ex-brasserie Cyrano... Bref, venir expressément saluer ici – en coup de vent –17NDRÉ 13RETON dans le brouillard s’épaississant au dessus du Lot. Oublier la peinture surréaliste, gratter sous le vernis, se saisir d’un caillou « en manteau d’Arlequin » et le porter à l’oreille comme un coquillage pour réentendre (toujours grâce à Ivšić) ses ultimes paroles : « Quand on aime, le plus fort, c’est quand le désir n’est pas accompli », et puis aussi, cette avant-dernière phrase : « Rappelez-vous cela, rappelez vous bien de tout. »


Damien McDonald, Le rayon invisible, Denoël / Centre Pompidou, 2024
André Breton, Lettres à Aube, Gallimard, 2009

— Le Surréalisme est le Rayon invisible qui nous permettra un jour de l’emporter sur nos adversaires. —
Unica à la borne kilométrique de la route sans frontière n°1, Saint-Cirq-Lapopie, 2024 © Nicolas Comment

« C’est au terme de la promenade en voiture qui consacrait, en juin 1950, l’ouverture de la 1re Route mondiale – seule route de l’espoir – que SaintCirq embrasée aux feux de Bengale m’est apparue – comme une rose impossible dans la nuit.
Cela dut tenir du coup de foudre si je songe que le matin suivant, je revenais dans la tentation de me poser au cœur de cette fleur : merveille, elle avait cessé de flamber, mais restait intacte. Par-delà bien d’autres sites – d’Amérique, d’Europe –, Saint-Cirq a disposé sur moi du seul enchantement : celui qui fixe à tout jamais. J’ai cessé de me désirer ailleurs. Je crois que le secret de sa poésie s’apparente à celui de certaines illuminations de Rimbaud, qu’il est le produit du plus rare équilibre dans la plus parfaite dénivellation des plans. Ses toits, c’est toi. L’énumération de ses autres ressources est très loin d’épuiser ce secret… Chaque jour au réveil, il me semble ouvrir la fenêtre sur les Très Riches Heures, non seulement de l’Art, mais de la nature et de la vie. »
André Breton, Livre d’or de la mairie de Saint-Cirq-Lapopie, le 3 septembre 1951.


Saint-Cirq-Lapopie,
2024 © Nicolas Comment
André Breton et sa fille Aube, anonyme, 1940
Max Ernst et André Breton dans le Lot, borne kilométrique de la route sans frontière n°1 © Atelier André Breton, 1950-53


LOUIS ROY J’AI ACHETÉ LE MÊME PANTALON EN CUIR
QUE JOHNNY ROTTEN
Par Stéphanie-Lucie Mathern ~ Photos : Benoit Linder
La rencontre s’est faite à la bibliothèque universitaire où je venais renouveler mon abonnement. Il y travaillait depuis 1996. Louis a la dégaine d’un éternel adolescent qui refuse l’avenir qu’on lui prépare.
Ma désinvolture fait écho. Il m’avait proposé, comme pour tromper l’ennui, de l’accompagner à un concert de Jean-Louis Murat – qu’il n’aime pas plus que moi.
Des années plus tard, chez lui, les toiles côtoient les jouets dans une superstition ordonnée. Il accumule et entasse.
Les réseaux virtuels amènent au street art. « Banksy m’a invité au Dismaland, le mélange de l’art contemporain et de la fête foraine, dit-il, où j’ai fait un selfie avec les Pussy Riot. » Pour le reste, les secrets de Banksy seront bien gardés.
Louis a vécu trois ans en Angleterre, de 1978 à 1981, en travaillant au Royal Albert Hall après avoir été punk à Chalon-sur-Saône. Il voulait quitter au plus vite son petit village bourgeois bourguignon, mais se souvient encore de l’odeur de cire de son voisin antiquaire. « Tous les rugbymen me tombaient dessus parce que j’étais maigre et qu’ils n’aimaient pas ma tête », confesse-t-il.
Du mouvement en permanence. Fuir, toujours fuir. Bouger, même à vélo. Faire les choses rapidement. Au jour le jour. Tout voir. Ne pas sentir le danger – jusqu’à aller rencontrer les artistes dans leurs loges. Des photos dans la salle de bains illustrent sa rencontre avec Bowie.
Louis écrit de la poésie au tipex et fait des collages. Il dépensait son salaire à la boutique Sex de Westwood/McLaren, portait des rangers qui lui faisaient mal aux pieds, avait plusieurs groupes de new wave, a enregistré dans le studio de Karen Cheryl, traîné avec Béatrice Dalle et les Bérus – grâce à qui il a eu des autoproductions.
Aujourd’hui, son fait de gloire, c’est de se retrouver sur Bide et Musique avec le groupe Simbad, sur le label EMI

Louis se demande encore par quelle magie les choses arrivent aux autodidactes et se souvient avec nostalgie des concerts au Gibus où tout le monde se mettait sur la gueule. À l’époque, Johnny Thunders y zonait en cherchant de la drogue.
Ancien voisin de la photographe Gisèle Freund à Paris, il sait que Mitterrand ne sourit jamais sur les photos et que Matisse est un poseur. Ce qu’il a préféré dans cette ville est le métro et les cimetières. Des endroits où l’on est tous égaux finalement.
Il traverse les époques, les gens, les réseaux, pour donner son avis et se faire des amis. Les choses se font et se défont vite. On soigne sa tête malade en créant. Que les choses sortent enfin et que l’angoisse se dissipe un peu.
En suivant les conseils de Batskin : « Si tu rencontres quelqu’un, tu le tapes d’abord et tu lui parles ensuite. »
Aujourd’hui, il ne touche plus sa guitare. Il a vécu plutôt libre, comme ses cheveux. Ils ont connu plusieurs vies.
UNE HISTOIRE
D’AMOUR (TU QUOQUE MI FILI)
Par Myriam Mechita

L’été est passé avec la frayeur de l’extrême droite qui nous siffle encore dans les oreilles. Comme si une balle de 22 long rifle nous avait frôlés… et qu’elle ne rôde pas très loin…
Normalement je n’aime pas le mois de juillet et le mois d’août, je déteste quand le rythme ralentit, jusqu’à devenir inexistant. La chaleur qui alourdit tout et le silence de tout le monde qui se réfugie dans les maisons de famille, avec frères, sœurs, neveux, nièces, père, mère, grand-mères, moi je n’ai rien de tout ça. Personne à rejoindre. Pas de jolie maison en pierres cachée quelque part au fin fond de la Bretagne ou de l’Auvergne. Ces villages, qu’on nomme comme un endroit si familier que ça sent déjà les rires d’enfants éclaboussés par les tuyaux d’arrosage ou les chiens qui courent en rattrapant une balle. Un labrador beige, si c’est possible.
J’aime pas le soleil qui crame tout, la chaleur dans la voiture pour aller à la plage, j’aime pas la plage, j’aime pas les siestes qu’on fait après un déjeuner trop lourd, dans une chambre où les volets noircissent la pièce et un filet de lumière court autour du bois.
Je déteste cette lumière qui filtre et les silences des après-midi chauds.
Je déteste sortir à 17 h 30 en entendant les grillons et tout le monde qui se met tranquillement à l’apéro alors que la journée a été vide de tout… Tout le monde fatigué de ne rien faire…
J’ai toujours détesté.
La fin de l’école sonnait le glas des amis, des rires, des jeux, et les deux mois à venir allaient s’égrener si lentement… C’était ça, presque la mort. La mort par ennui ou par chaleur…
Cette année, j’avais anticipé, je m’y étais préparée psychologiquement. Premier été sans mon fils. Autant dire l’été de la double mort.
Ulysse, 17 ans, qui préfère désormais passer ses étés n’importe où tant que c’est loin de sa mère.
On a beau me dire : — Non, mais t’inquiète, c’est normal, tous les ados sont comme ça, il redeviendra câlin plus tard. Faut qu’il se détache…
Moi, je m’en fous de ce qui est normal, j’avais tout sauf envie de passer 62 jours sans lui, à répondre à des messages en faisant semblant que tout a l’air merveilleux. Attendre qu’ils viennent de lui surtout, pour ne pas l’oppresser, pour ne pas le
les fatigues d’Ulysse Cassius, crayon et encre sur papier, 64 × 50 cm, autorisation de l’artiste
faire fuir encore plus devant les mots empressés de sa daronne qui guette le moindre bip annonciateur d’une possible pensée ou photo sur son téléphone.
Je suis une mère, je suis comme toutes les mères, ou quasiment.
Je suis de celles qui, quelle que soit la situation, imaginent toujours le pire…
Il m’écrit : « T’inquiète je me fais un sandwich […] On est partis faire une balade à vélo. »
Et moi j’entends : on est partis sur l’autoroute à contre-sens, sans casque, à faire du vélo entre les voitures qui déboulent à toute blinde. Je vois un énorme couteau plus grand que lui, trancher un morceau de fromage qui ne va pas se laisser trancher et sa petite main ne va pas pouvoir retenir ce couteau qui va évidemment voler dans le ciel pour finir sa course dans le corps de mon fils… Et encore, là, je vous parle pas des scénarii avec les cœurs plantés, les têtes arrachées ou les mains tranchées…
Ce goût très certain qu’ont les mères pour le gore doit bien venir de quelque part.
Bon, évidemment tout se passe toujours bien, les sandwichs sont faits sans une seule coupure, il va a des soirées où il ne se passe rien.
Inutile de préciser que je l’ai prévenu de faire très attention, car cette soirée peut se trouver être un fief de mafieux dealers de drogue et qu’il finira dans un réseau de prostitution s’il boit un seul verre rempli de GHB…
Je ne comprends pas ce qui s’est passé, une minute il était dans mes bras, à me regarder avec les yeux de l’amour infini, et une semaine plus tard le voilà à 17 ans avec une amoureuse qui recueille toutes ses pensées, ses histoires, ses rires, et ses doutes… et moi rien… ou presque rien. je n’etais pas préparée à ça.
Je me souviens de ce moment où, pour un de ses anniversaires, nous étions allés à la piscine avec l’un de ses amis proches. Épuisée, j’avais dormi quasiment toute la journée sur l’un des transats en bord de bassin. L’entrée à 18 euros, je vous laisse apprécier le prix de la sieste…
Dès que j’émergeais de cet état de sommeil qui m’envahissait, je cherchais du regard les deux garçons dans les bassins. Un slip rouge et un slip noir. Impossible de les identifier, je cherchais sans relâche quand tout à coup mon fils assis sur le transat à côté de moi me lance un :
— Tu cherches quoi, maman ?
— Eh bien, vous deux…
— On est là… assis depuis tout à l’heure. À force de chercher deux corps d’enfants, j’avais oublié qu’ils étaient déjà des ados de 15 ans, avec des corps de jeunes hommes. Mon fils avait disparu dans les vagues de ce foutu temps qui court plus vite que prévu.
Cette année, qui s’ouvre avec sa rentrée en terminale, marque le début du festival des dernières fois. Dernière année de lycée, dernière année où je vais l’entendre rentrer alors que je suis dans la cuisine à préparer le diner. Dernière année où je vais lui demander s’il a des devoirs, dernière année où nous allons être ensemble les soirs à discuter longuement de tout et rien.
Je n’ai jamais pu regarder cette scène de Toy Story quand Andy met les cartons dans la voiture et part pour l’université. Je pleurais comme une madeleine en sachant qu’un jour ça serait mon tour. À mon tour de ranger pour la dernière fois cette chambre avec des habits qui trainent partout.
Je le veux encore et encore ce désordre, je veux la vaisselle qui traine dans l’évier, je veux râler parce qu’il n’écoute pas quand je lui parle, je veux être dérangée à minuit parce que je dois faire en dernière minute un sandwich pour la sortie scolaire du lendemain. Je veux recevoir des SMS qui me disent qu’il m’aime plus que tout, je veux arriver devant l’école et le voir courir les bras en l’air en me voyant au loin. Je veux voir son sourire quand il m’aperçoit dans le groupe des parents assis sur des petits bancs pour voir les spectacles où il est déguisé en champignon ou récite une poésie en butant sur chaque mot. Je veux l’entendre me murmurer dans la nuit : « Maman, je peux venir ? » et sentir son petit corps se glisser sous la couette à mes côtés. Je veux ouvrir mes yeux le dimanche matin et le voir allongé à côté de moi en train de lire ses bandes dessinées et rire à gorge déployée. Je veux l’entendre chantonner dans son bain. Je veux tout recommencer, encore et encore, et ne rien oublier. À jamais mon fils, mon amour.
LE MONDE À VENIR
Par Dominique Falkner
On pense à Baudelaire ici : « Eh ! qu’aimes-tu donc, extraordinaire étranger ? J’aime les nuages… les nuages qui passent… là-bas… là-bas, les merveilleux nuages ! »
Et c’est vrai qu’au Wyoming, il aurait été servi en termes de nuages, si singuliers qu’on a souvent l’impression de les avoir déjà croisés quelques heures plus tôt ou même le jour d’avant vers Cody ou Sheridan. Enfin à cent ou trois cents kilomètres de distance du lieu où l’on se prend à les contempler de nouveau en proie au doute, éberlué, se jurant à soi-même qu’il n’y a pas d’erreur possible, qu’il s’agit bien du même cumulonimbus plus chargé de pluie encore que la veille, mais ne donnant pas plus l’impression qu’hier d’être sur le point de libérer l’orage, qui tombe rarement, il est vrai, sous ces latitudes aux faibles précipitations. Profitant d’une pause dans un routier, je marchai à l’écart des passagers d’un bus qui faisaient la queue à l’extérieur d’un food truck afin de filmer à mon aise ces mêmes nuages dont les ombres couraient dans la contrée aride jusque sur les flancs des Rocheuses où le soleil se couchait déjà, pan de montagne après pan de montagne, avant de bientôt engloutir le tout pour de bon. J’étais tout à mes images qui défilaient sur l’écran LCD que je ne remarquai pas l’homme qui portait une casquette Mao verte, étoile rouge au front, des bottes de gaucho, un poncho de laine bigarrée et un long poignard à la ceinture et dont je sentis soudain l’haleine sur ma nuque avant même de constater sa présence dans mon dos, les yeux rivés sur l’écran de mon appareil.
— Oui, sans doute que la dernière chose à faire après le Covid-19, l’Amazone qui brûle et la bêtise mondialisée au pas de course, c’est de filmer les nuages.
Je lui expliquai que je travaillais à un film, enfin une sorte de documentaire.
— A movie?
— Oui.
— Qui s’appelle comment ?
— Le Monde à Venir… Enfin c’est le titre provisoire.
— La même chose qu’on dit à l’église… pendant la messe ?
— C’est bien ça, et qu’on trouve aussi sous la plume de l’écrivain Cormac McCarthy tout à la fin de son livre De si jolis chevaux
— Cela ne me dit rien.
Je lui déclamai le fameux passage : « Il allait avec le soleil qui lui cuivrait le visage et le vent rouge qui soufflait de l’ouest à travers les terres du soir et les petits oiseaux du désert voltigeaient en pépiant parmi les fougères desséchées et le cheval et le cavalier et le cheval passaient et leurs ombres allongées passaient l’une derrière l’autre jumelées comme l’ombre d’une seule créature. Passaient et s’enfonçaient pâlissantes dans la contrée toujours plus sombre, le monde à venir. »
— Beautiful!
Profitant de son émotion, je lui demandai s’il me permettait de le filmer de près avec les pics et les arêtes des Rocheuses en arrière-plan, le long zoom final sur son visage impassible que je projetais d’arrêter sur l’étoile rouge de la casquette.
Il accepta sous condition que je lui laisse déclamer une phrase qui lui tenait à cœur, « de votre compatriote Lévi-Strauss ». J’acquiesçai et il sortit un petit calepin de la poche de son veston tandis que j’installais le microphone externe pour une qualité optimale de prise de son.
— Prêt ?
— Always
— Allez-y alors.
— Le marxisme, commença-t-il lentement après avoir d’abord relu ce qu’il voulait dire afin de ne pas se tromper alors que je filmais en 4K son visage en gros plan l’œil collé à la lunette de l’objectif, the marxism, reprit-il donc, articulant ses mots comme s’il cherchait à les broyer entre ses mâchoires avant de les recracher, est une ruse de l’histoire pour occidentaliser le tiers-monde.
Je le filmai vingt secondes encore, en silence, passant de ses traits abîmés à ses mains usées de stakhanoviste qui avait passé sa vie à trimer dans les mines de cuivre et d’or de Copper King avant de prendre sa retraite près de Cheyenne, puis j’éteignis mon appareil, le remerciai et lui proposai un verre au saloon d’en face d’où nous parvenaient des airs de country.
La quasi-injonction suivante était tracée à la craie sur une ardoise au-dessus des bouteilles alignées derrière le comptoir : « Le mot latin pour alcool est spiritus , c’est-à-dire esprit. Dans un verre de gnôle ou à l’église, c’est un peu de chaleur qu’on recherche, and nothing more. »
— Mais parlez-moi encore de ce McCarthy que vous évoquiez tout à l’heure, me fit-il après une longue rasade d’un tord-boyaux du cru dont il semblait raffoler, allumant un cigarillo.
— Par où commencer…
— Up to you
— Bon, eh bien, Cormac McCarthy a lu la Bible, pas seulement parce qu’il est Américain, mais plutôt parce qu’il sait y trouver, comme beaucoup d’écrivains, une source d’inspiration continue, ainsi que des pépites en forme de titres-béliers dont les couvertures de romans raffolent : Le soleil se lève aussi ; Absalon, Absalon ; Gaspard, Melchior et Balthazar ; Barabbas ; etc. Et Le Monde à Venir renvoie à la Bible, c’est vrai, vous avez raison, au Credo, mais plus précisément au cinquième verset du second chapitre de L’Épître aux Hébreux, manière
de lettre dont on ne connaît pas le destinataire, si tant est qu’il s’agisse d’une lettre, pas plus que l’identité de l’épistolier qui la rédigea, problème qui a longtemps divisé les Pères de l’Église qui finirent par l’attribuer à l’apôtre Paul, bien que les historiens disputent la tradition chrétienne et s’entendent pour dire qu’elle est l’œuvre d’un auteur anonyme. Bien sûr, des noms circulent : Barnabé, le diacre Philippe, Silas, Timothé, Apollonios, mais personne n’en sait rien et le débat reste ouvert.
— Tout cela est passionnant.
— Reste le verset qui, dans la traduction de Louis Segond, donne ceci : « En effet, ce n’est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. »
— I see.
— Mais dans la Bible du roi Jacques, fruit de cinq années de travail et de la collaboration d’une cinquantaine de traducteurs, la fameuse King James Version si chère aux Anglo-Saxons et vénérée par Hemingway, Faulkner, Flannery O’Connor et bien d’autres, dont Cormac McCarthy bien évidemment qui y chaparde donc la dernière phrase du premier tome de La Trilogie des Confins que je vous récitais tout à l’heure, la traduction anglaise est la suivante :
« For unto the angels hath he not put in subjection the world to come, whereof we speak. »
— J’en ai la chair de poule.
— Ce qui, dans la traduction de David Martin, donne ceci : « Car ce n’est point aux Anges qu’il a assujetti le monde à venir duquel nous parlons. »
— « Assujetti » me plait bien.
— Not bad , en effet, et qu’on retrouve d’ailleurs aussi chez John Nelson Darby avec une petite variante tout de même : « Car ce n’est point aux anges qu’il a assujetti le monde habité à venir dont nous parlons.
— Just great
— Bon, les traductions diffèrent, mais tous s’entendent pour conserver le monde à venir
(Haolam haba en hébreu), croyance fondamentale du judaïsme et de l’eschatologie juive selon laquelle le monde actuel serait mal en point, voire maudit. On peut être d’accord ou pas, c’est selon.
— Like always. — Oui, comme assez souvent, en effet.
REGARD N° 24
Par Nathalie Bach-Rontchevsky ~ Photo : Mar Castañedo

Le souffle d’un aveu entre deux téléphones
Retient l’air que le temps vient d’arrêter
Tu ne dis rien, je ne dis rien
Trois voyelles et deux consonnes
Sale temps dans ce bel été
Amour nous ne dirons plus
Le bruit des voitures plisse le silence
Je ne dis rien, tu ne dis rien
Flambant nos bouches tenues
Les je t’aime d’une dernière chance
Il me semble entendre ton cœur
Il me semble vivre ta voix
Il me semble embrasser ta bouche
Il me semble croire en ta foi
Il me semble que plus rien ne se ressemble
Tant et fort cette nuit crie un autre chemin
À la croisée d’un lilas
Mauve comme ton sourire malin
Emportant avec lui ses matins de cendres
Le monde continuera d’avoir ton visage
Tourné vers l’horloge de mes bras
Loin de tout loin de tout
Quand légers comme les nuages
Nous boirons aux eaux vives d’autrefois
LE PALÉOPHONE DU COLONEL
Par Bruno Lagabbe
EN LOUCEDÉ

Fin 70, pour entendre les groupes évoqués par les magazines de rock, il fallait acheter LE disque ! Peu de radios et très peu de télé pour illustrer les articles de presse qui nous révélaient une fois par mois seulement les artistes que l’on aurait aimé connaître un peu plus. Nous lisions les groupes avant de les écouter…
Désargenté, je traînais chez les disquaires à contempler les 33 tours exposés sous les néons. Elles étaient tentantes ces pochettes, hautes en couleur : les Sex Pistols, néo-dadaïsme jaune acide et rose bonbon, Les Damned, dripping à la Never Mind the Pollocks , les grandes oreilles de Robert Gordon comme peintes par Grant Wood, le costume brillant constellé d’oiseaux et de papillons de Wreckless Eric, la photo vert et rose de Mik Mellen pour le Datapanik in the Year Zero de Pere Ubu… Tentation.
Un long manteau de gabardine acheté pour trois fois rien dans une vente de charité sera ma couverture pour commencer mes premiers larcins ! Il fait très chaud quand pour la première fois après
une longue hésitation et un bref coup d’œil vers le vendeur affairé on sort avec un premier 33 tours sous le bras, les jambes ont envie de courir, mais il faut rester digne et nonchalant, respirer, avancer l’air de rien les mains dans les poches, tourner à gauche sous les arcades, traverser la place et prendre la petite rue devant l’église et enfin se mêler à la foule de la grand-rue.
Les grandes poches intérieures de ce pardessus engloutiront aussi à l’occasion champagne et saucissons. On ne vit pas que de musique.
Mais le manteau, c’est bien pour un ou trois disques. C’est beaucoup d’émotion à répétition et ça ne marche que l’hiver.
Au printemps, reconverti à la méthode « sac de sport » par un ami, à l’abri derrière les bacs à disques de l’îlot central, on enfourne en loucedé par poignées jusqu’à une vingtaine d’albums pour repartir le sac à l’épaule chargé comme un baudet… Au début l’accumulation est jouissive, mais à la longue ça devient lourd, le risque de se retrouver au commissariat est plus grand et on se retrouve avec des disques inécoutables (pour ne vexer personne, je tairai les noms) et ça gâche la fête. Fin de la période industrielle pour moi.
Je vais me reconvertir dans le coup de cœur, le coup de foudre, l’aventure, et alléger la situation : le 45 tours !
Le 45 tours, c’est petit, ça tient dans la culotte et c’est l’époque des premiers jets de toute la nouvelle vague : Surfin’ Bird des Cramps, Little Johnny Jewel de Television, Sex Pistols, Warm Gun, Nerves, Metal Urbain, Starshooter, Buzzcocks, Magazine… ! De vraies vendanges pour moi, en grandes surfaces ou le dos tourné à la caisse des petites boutiques, sans stress, les doigts dans le nez, sans bagage, en chemise, mais avec pantalon !
Ces disques restent mes plus intenses moments de bonheur musicaux. Encore actuellement je les écoute avec une joie plus grande que l’écoute de n’importe quelle nouveauté. Je ne dois pas avoir l’esprit si ouvert que ça…
Magazine : My Mind Ain’t So Open

SALAUD, MON AMI ! DISC-COURS DIALECTIQUE
Par Martin Möller-Smejkal ~ DJ Hercules

Il y a quelques semaines, mon pote Simon Burger m’a appelé depuis le Val d’Argent.
En décrochant, j’hésitais à répondre en français (« Salut ») ou en allemand (« Hallo »).
Je l’ai donc salué d’un « Sallo ! » chaleureux. Silence.
Puis nos rires lorsque je lui ai expliqué comment cela m’était venu ! Probablement un bon exemple qu’il ne faut pas tout mélanger.
Malgré cela, il est toujours intéressant d’avoir un ami allemand qui comprend la langue presque oubliée de ta région. Ce dialecte qui était déjà
trop embarrassant pour tes parents. Ou que tu ne connais qu’à travers des personnes que tu considères comme simples, rétrogrades ou même de droite. Si ce n’est les trois en même temps. Ou encore par ta grand-mère adorée, dont la vérité ne semble plus guère compter aujourd’hui.
Cet ami peut te rappeler qu’un jour, tu devras choisir entre la liberté et Alexa, l’égalité et l’uniformisation, la fraternité et Facebook. Qu’avant de chanter, il faut écouter, avant de protester, il faut comprendre et se serrer les coudes. Qu’avant de manger, il faut récolter, et avant de récolter, il faut semer. Ton ami peut te dire que ta terre ne t’appartient pas tant que tu n’as pas mis tes mains dans le sol et à quel point tes bottes deviennent lourdes lorsque la boue colle à tes semelles. À quel point il est difficile de débarrasser le champ des mauvaises herbes une fois qu’elles ont tout envahi. À quel point le dos fait mal, jusqu’à ce que ça passe. Et que ça revient toujours.
D’où je le sais ? Par mon potager. Parce que j’ai des yeux et des oreilles. Et par ces chansonniers de ton pays, que tu ne peux plus comprendre !
Ils étaient au cœur des victoires du mouvement citoyen et écologiste composé de Suisses du Nord, d’Alsaciens et d’Allemands badois du Dreyeckland des années 1970 et 1980, victoires que j’ai relatées dans Novo 73 : constructions des centrales nucléaires de Kaiseraugst (CH) et Wyhl (D) empêchées, celle de l’usine de Javel de Marckolsheim (F) repoussée, centrale nucléaire de Fessenheim (F) fermée après des années d’incidents.
Le potager – n’est-ce pas un peu trop simple ?
Louis Schittly, médecin du Sundgau, paysan, cinéaste, auteur, défenseur de la langue alsacienne et cofondateur de Médecins sans Frontières dit en 2022 dans une interview à France 3 à propos de son film redécouvert, D’Goda (la Marraine), de 1973 : « Le progrès est positif quand il apporte plus de liberté, pas plus de chaines. Aujourd’hui, ils sont
tous enchainés. Plus personne n’a de poules ou de potager. Ils sont tous dépendants du Super U. »
Dans les années 1970, la petite agriculture était encore très répandue. Les gens à la campagne pouvaient subvenir à leurs besoins ou connaissaient quelqu’un qui pouvait leur donner ce qu’ils ne pouvaient pas cultiver eux-mêmes. Bien sûr, ils ne pouvaient pas prendre l’avion pour partir en vacances, mais ils étaient indépendants en moyens de subsistance. Ce qui pouvait aussi contribuer à une certaine indépendance de pensée. Car soyons honnêtes : à partir du moment où nous avons l’impression d’être dépendants, nous le sommes déjà depuis longtemps.
Nous vivons une époque où nos acquis culturels sont sur le point d’être liquidés par les grands groupes. Par « culturel », j’entends tout, de la conversation à la communication, de la pâtisserie à l’architecture et la construction, de l’agriculture à la photographie. En réalité, notre savoir, notre temps et notre expérience nous sont dérobés, pour pouvoir nous les revendre ensuite en petites doses diluées.
Ils prétendent que tous ces produits sont pareils à ceux que nous fabriquions nous-mêmes, mais ce ne sont en fait que des copies bon marché. Et même si ce n’est pas le cas, ils nous auront de toute façon dépossédés du temps que nous y passions. Tout évolue rapidement. Ce à quoi nous essayons encore de nous raccrocher est déjà abandonné par nos propres enfants. Et lorsque nous n’avons plus rien à quoi nous raccrocher, ce ne sont plus ces grands groupes qui répondent à notre demande, mais nous qui satisfaisons leur offre. Cette machine écrase tout, notre environnement, nos valeurs, nos sentiments, la solide agriculture paysanne, la langue de nos ancêtres. Conservateurs ! Qu’est-ce que vous conservez, au juste ?
Alors que faire ?
1) Je n’ai jamais acheté de smartphone. Ce que certains appellent l’ennui, je l’appelle la vie. Quand d’autres sourient parce que je ne suis pas au courant de tout en temps réel, j’ai la certitude d’arriver à destination en suivant mon propre chemin.
2) Cultivez quelques légumes si vous trouvez un endroit. Cela rend un peu indépendant. Dans la tête aussi. Mais cela fait aussi parfois mal au dos.
3) Soutenez vos boulangers, bouchers, bars, agriculteurs, éditeurs culturels, disquaires, groupes locaux. Achetez chez Cœur Paysan et autres initiatives similaires.

Ils sont le dernier rempart avant que les grands groupes ne prennent complètement le pouvoir. Et ensuite, il ne s’agira plus que de trois choses : l’argent, l’argent et l’argent.
4) Écoutez ma mixtape avec vos enfants. En fait, je pensais que mon fils de huit ans ne comprenait pas l’alémanique. L’autre jour, j’ai écouté une fois de plus la chanson bouleversante de six minutes de Aernscht Born, « Victor Jara », en suisse allemand (Mixtape Song 4). Mon fils m’a regardé et m’a demandé : « Papa, c’est vraiment arrivé ? »
5) Je recommande le livre Momo de Michael Ende (1974). Comment a-t-il pu tout prévoir ?
La suite au prochain numéro ! D’ici là : Sallo, mes amis !
— DJ Hercules – DREYECKLAND FOR SALE ! Au cœur de cette mixtape, il y a les chansonniers contestataires du Dreyeckland. Mais il s’agit aussi de s’amuser avec la langue et les dialectes. Cette mixtape ne se veut pas un musée, c’est pourquoi on y entend de la musique de 1976 à 2024.
Mixtape digitale : soundcloud.com/hercules-soundtruck Paroles et infos : hercules-soundtruck.de DJ Hercules est actif en tant que DJ, musicien, organisateur et mixeur depuis 2002 dans le sud du Pays de Bade et depuis peu en Alsace.
PART II
TON VOISIN CET INCONNU
Par Jean-Luc Wertenschlag
LE SUPER POUVOIR RADIOPHONIQUE DE LA QUETSCH
Toute l’Alsace est occupée par des médias qui vendent du temps de cerveau disponible. Toute l’Alsace ? Non, certains villages résistent encore. Rendons visite à Jeanne, Luc et Alex, pionniers d’Altkirch, capitale du Sundgau, région frontalière de la Suisse et de l’Allemagne, pour découvrir Radio Quetsch et sa joyeuse vitalité associative.

Luc, Jeanne et Alex
LA RADIO, C’EST MAGIQUE
Radio Quetsch naît un jour de fête, dans la nuit du 31 décembre 2018 à Bretten, dans le Sundgau évidemment. Mais pourquoi créer une radio ? « Parce que la radio, c’est magique ! » Et pourquoi le Sundgau ? « Parce qu’on est sundgauviens ! » Simple comme un transistor FM.
Porte Sud, dernière radio locale du coin, a disparu il y a bien longtemps. L’apparition d’un nouveau média « pas pareil » en 2019 bouleverse les certitudes avec son format sans pub où chacun et chacune peut proposer une émission. Elle aurait pu s’appeler Radio Carpe Frite, mais les végétariens de l’équipe refusent d’avaler un poisson et préfèrent s’enivrer de quetsches, prunes qu’on distille en schnaps ou qu’on mange en Zwatchkawaya, la fameuse tarte aux quetsches.
L’énergie des principaux fondateurs Jeanne et Luc attire des motivé es de tous côtés, qui s’entassent dans une vieille Citroën transformée en studio mobile. Un studio provisoire est créé à Dannemarie. La renommée de Quetsch grandit vite. La radio participe aux événements locaux, invite associations et artistes, intrigue les élu es et les commerçants, connecte anciens et ados, rassemble Mulhousiens et Strasbourgeois et déniche en 2021 un local dans les remparts d’Altkirch, aménagé en magnifique studio radio, à côté du seul cinéma de la ville.
L’expérience acquise à Radio MNE Mulhouse – où Luc et Jeanne ont travaillé – est mise à profit. Des ateliers d’éducation aux médias sont proposés aux collèges et lycées, la Maison de la Nature du Sundgau devient le premier partenaire, la Région Grand Est finance un premier investissement, une antenne pour diffuser en FM temporaire est installée à la Halle aux Blés… Lors de l’été 2020 se déroule à Guewenheim le premier SONORE QAMP, résidence radiophonique estivale qui se renouvelle chaque année, à Bellemagny, Ligsdorf, Bendorf. Des dizaines d’Italiens, des Allemands et même des Français « de l’intérieur » participent à ces cinq jours de rencontres improbables où on expérimente et bien plus. Quetsch réussit le pari de mobiliser des gens très différents, dialectophones alsaciens, DJ rémois ou parisiens, passionnés de politique, de musique, de sport, de sexe ou de cinéma, personnes en situation de handicap et autres personnages hauts en couleur. Plusieurs membres de l’association déménagent même à Altkirch pour se rapprocher de la radio !
DEUX SACS À MERDE OBLIGATOIRES
Car Altkirch et le Sundgau sont des territoires un peu particuliers. Promener son chien sans avoir sur soi au moins deux sacs à déjection canine ? Interdit sous peine d’amende ! Devenir maire d’une des 108 communes du Sundgau ou prendre la présidence d’une des deux communautés de communes si on est une femme ? Cela ne va pas être facile… Exemple : parmi les 19 membres du bureau de la ComCom Sud Alsace Largue, on compte une seule femme.
Le Sundgau est vert, rural et naturel, avec ses villages pittoresques, sa gastronomique route de la carpe frite, sa pratique vivante de la langue régionale, ses vallons et son Jura alsacien si particulier. Mais il est aussi victime de préjugés citadins. Il serait peuplé de bourgeois trop riches qui roulent en Tesla, de paysans incultes, de travailleurs frontaliers qui gagnent en Suisse trois ou quatre fois le salaire qu’ils auraient en France et qui dépensent des fortunes en nains de jardin, d’électeurs du RN pour le moins xénophobes, de vieux Alsaciens qui ne sortent jamais de leur village. Quetsch lutte contre ces stéréotypes, raconte le Sundgau autrement, cette terre dynamique peuplée de 250 associations, son folklore historique d’elfes, de chansons, de culture, d’initiatives originales et rapproche la campagne de la grande ville voisine, Mulhouse, la « capitale du monde » aux 136 nationalités. Laquelle, trop jeune, trop pauvre, trop vivante, fait parfois peur à certains Sundgauviens.
MÉDIA DE PROXIMITÉ & ESPACE DE VIE SOCIALE
Aujourd’hui, Quetsch compte des milliers d’auditeurs, plus de 3 200 podcasts à écouter en ligne, et surtout une centaine de membres actifs de 7 à 70 ans, la moitié produisant des émissions radio, presque tous participant aux événements radiophoniques. La professionnalisation avance, l’association compte trois salariés et bientôt une apprentie tchèque. Le ministère de la Culture soutient ce « média de proximité », la caisse d’allocations familiales a accordé le label « espace de vie sociale ». Tout va pour le mieux dans le paysage audiovisuel sundgauvien ?
Non, car pour exister pleinement, Quetsch a besoin d’une autorisation définitive pour émettre sur la bande FM – qui reste la « champion’s league » de la radio. Aucune radio associative n’est autorisée en FM de façon permanente dans le Sud Alsace, ni à Mulhouse, ni dans le Sundgau, si on excepte une radio religieuse où Jésus assure la permanence de l’antenne. Mais que fait l’Arcom (ex-CSA) censée garantir le pluralisme sur les ondes hertziennes ? Pourquoi aucun appel à candidatures FM n’a été lancé dans le Haut-Rhin depuis des décennies ? À l’heure où l’information non biaisée et le dialogue de proximité deviennent des enjeux cruciaux pour l’avenir de notre démocratie, il est urgent que le régulateur de la communication audiovisuelle et numérique se réveille, et propose à Radio Quetsch la fréquence FM qu’elle mérite.
— RADIO QUETSCH,
Radio Quetsch, 1 bis boulevard Georges-Clémenceau à Altkirch
Accueil public du mardi au vendredi de 10 h à 17 h
Écoutez 24 h/24 dans le monde entier radio-quetsch.eu ou dans le Sundgau quand elle est autorisée par l’Arcom sur le 89,1 FM
App faite maison pour smartphones Android : app.quets.ch
Pour diffuser un message, une info à l’antenne, appelez la Qabine nuit et jour au 09 52 36 61 48
Par Claude De Barros
LA SAGESSE DU RIEN

J’aurais pu titrer la sagesse de la vacuité. Ça fait lettré. Je ne suis pas lettré.
Ou la sagesse du vide. C’est physique et moins abstrait. Ça tient dans l’espace ; c’est moins à l’aise dans le temps. Je ne suis pas physique.
Si j’ai choisi « rien », c’est parce que j’aime ce mot. 4 lettres avec un R qui crisse, un R de paysan. Un mot qui parle d’une absence ou, plutôt, de ce qui n’existe pas au moment où il est dit. J’aime le mot « rien » comme j’aime le mot « avec ». Pour « avec », j’ai la fausse idée que c’est une sorte de relique latine arrangée par des hordes germaniques. 4 lettres avec un V qui hésite dans un souffle et un final sec comme un uppercut. Deux mots, deux mondes. L’un annonce l’invisible, l’absence ou l’insignifiant, l’autre réclame la présence, l’accompagnement et l’explication. Deux mondes qu’il est possible de lier par une farce : c’est fait « avec presque rien ».
C’est aussi que je suis victime de la nostalgie du rien. Celle de l’enfance. Celle où les choses arrivent sans explication, sans le vouloir, sans préméditation. Celle où il n’y a pas à réfléchir, c’est comme ça, c’est tout, c’est la vie. Un ordre bien établi, sans autre raison que son existence, une existence immuable. Tu as, tu prends. Tu n’as pas, tant pis, on va jouer. C’est bien, petit, de ne pas trop réfléchir, ça autorise la découverte du monde, les joies simples, puis, après, les douleurs inconsolables. Mais un jour, plus tard, ça autorise la bêtise ancestrale, la supériorité morale et l’autorité injuste. Ne rien penser, ne rien dire, ne rien changer. Ça devient la force de l’habitude qui donne tous les droits. « — Quoi qu’a dit ? — A dit rin. — Quoi qu’a fait ? — A fait rin. — À quoi qu’a pense ? — A pense à rin. — Pourquoi qu’a dit rin ? Pourquoi qu’a fait rin ? Pourquoi qu’a pense à rin ? — A’ xiste pas. » (La Môme néant, Tardieu) Rien, avec le temps, c’est le Néant. Même si, de temps en temps, c’est le soulagement. Paul Veyne, devant l’immensité ou la complexité de sa tâche d’historien, ose envier la placidité du bétail. Attention, ne penser à rien, ce n’est pas « ne rien penser », cette lubie des dictateurs et des petits caporaux : « Je veux autour de moi des hommes qui soient gras, au cheveu bien lissé, et qui dorment la nuit. Cassius, là-bas, est maigre, il a l’air affamé. Il pense trop. Qui lui ressemble est dangereux. » (Jules César, Shakespeare)
Je ne crois pas beaucoup aux valeurs morales du dénuement : qui peut croire aux valeurs éducatives de la misère ? Tu ne peux rien ou tu peux faire avec. Tu ne peux pas faire grand-chose sans rien. Tu peux beaucoup avec. Avec des idées, avec des paroles, avec des esprits, avec des mots, avec des rencontres, « avec ». Avec les autres. C’est le concept de Novo Faire avec, mettre le pied en enfer (puisque ce sont les autres) et empêcher que la sagesse du rien ne s’installe : celle qui fait des habitudes une force qui s’impose, celle qui autorise la bêtise ancestrale, celle qui espère un paradis, blanc et cotonneux, sans bruit et, surtout, sans un mot. « Avec » pour éviter le « un point c’est tout » et l’arrivée des kapos en costume-cravate. C’est ce que j’ai cru lire dans le prologue du Novo n°73




LE CULTE DE L’AUTEUR.
LES DÉRIVES DU CINÉMA FRANÇAIS
De Geneviève Sellier — Éditions La Fabrique
Alors que les Cahiers du cinéma font leur couverture de septembre sur Francis Ford Coppola (accusé d’agressions) sept mois après avoir dédié un numéro aux plumes et créatrices féminines – le terme « féministe » devait être trop dur à affronter –, Le culte de l’auteur rassure. Oh, pas par son propos, mais plutôt par le fait qu’existent dans le champ de la cinéphilie des travaux se coltinant au sexisme et aux mécanismes officiels comme artistiques permettant la diffusion de schémas d’oppression. Autrice d’un précédent opus qui a fait date (La Nouvelle Vague : un cinéma au masculin singulier, 2005), Geneviève Sellier signe ici un ouvrage sur le vif. À partir d’une traversée d’une dizaine de films, la professeure émérite en études cinématographiques analyse la permanence du terme et de l’idée de l’auteur – et ses désastres. (C.C.)
DOCUMENTS RELATIFS À L’ÉDITION
PIRATE DU TRAITÉ DE STYLE DE LOUIS
ARAGON PAR GÉRARD BERRÉBY
Entretien entre Gérard Berréby et Aurélie Noury — Éditions Incertain Sens
Quand le futur créateur des éditions Allia s’autorise en 1979 à publier une édition pirate du Traité de style de Louis Aragon, il n’a que 29 ans. Dans un long entretien accompagné de témoignages et de reproductions de documents d’époque, il raconte en détail cette plaisanterie menée avec le plus grand sérieux. Une première expérience éditoriale qui entraîna la réédition par Gallimard d’un livre génial, mais renié par son auteur qui n’assumait plus ses positions surréalistes contre l’armée, contre l’État… et qui n’avait plus été publié depuis sa parution en 1928. Passionnant. (P.S.)


ROMAN DE RONCE ET D’ÉPINE
De Lucie Baratte — Les éditions du Typhon
Dans un Moyen Âge de conte de fées, deux sœurs jumelles grandissent au rythme des saisons dans un château entouré d’une forêt maudite, car « quiconque en verra le cœur sera avalé par le diable ». La brune Épine aime s’y aventurer et y chasser (elle rêve de devenir chevalier, mais pas de bol : c’est une fille !), autant que Ronce la blonde préfère rester enfermée pour broder en silence. Tandis que Ronce est frappée par un mal mystérieux, Épine finit par s’enfoncer dans la forêt… L’horreur et le merveilleux abondent dans ce roman qui détourne les formes de la littérature médiévale pour tisser une magnifique histoire d’amour sororale et aborder des thèmes intemporels, comme la nature et le désir, dont la force suscite autant d’attirance que d’effroi. Un roman dans lequel on a plaisir à se perdre comme dans une tenture médiévale, pour débusquer les détails et symboles qu’il recèle. (N.Q.)
LES NUITS SANS KIM SAUVAGE
De Sabrina Calvo — La Volte
« Holy fucking flute » : voici le roman le plus déjanté de cette rentrée. Dans un Paris transformé en galerie commerciale, où pour échapper à une vie terne les gens se réfugient dans le virtuel, Vic, une jeune femme transgenre, abandonnée enfant dans un magasin Ikea, puis adoptée par une maison de mode, est chargée par le magazine qui l’exploite comme stagiaire de « faire un petit topo sur les fringues » d’un vieux clip de Laurent Voulzy. Avec son mug Phil Collins et l’aide d’une assistante virtuelle un brin jalouse, celle qui se voit comme une « nobody » se retrouve propulsée au cœur d’une vaste machination dont la clé pourrait être une veste portée par Lady Di… On est scotché à l’intrigue foutraque et la prose survitaminée de ce livre où les niveaux de réalité et les révélations se succèdent plus vite que les collections de fast fashion. (N.Q.)








TINDERSTICKS
Soft Tissue – City Slang
Loin des frasques du temps, les Tindersticks ont toujours affiché une certaine sécheresse. Une intégrité qui les honore. Et pourtant, on sent depuis quelque temps cette appétence naturelle vers une forme soul à la façon d’un Curtis Mayfield, avec des cuivres présents, mais contenus. Stuart Staples nous épate par son brio et sa manière sobre de s’engager sur la voix de la lumière. Oui, 30 ans après la sortie de leur premier album, nous cultivons ce jardin secret qui mériterait d’être ouvert aux grands vents. Assurément, le plus majestueux des groupes anglais d’hier, d’aujourd’hui et bien sûr de demain. (E.A)
CASS MCCOMBS
Seed Cake On Leap Year – Domino
Oh, lui, on lui garde une certaine affection, même si on le sentait un peu en perte de vitesse ces derniers temps. Alors, pourquoi ne pas retourner à l’essence de la pop lo-fi de ce Californien inclassable, qui marchait sur les traces des somptueux Big Star ? Avec cette série d’inédits enregistrés à San Francisco, alors qu’il résidait à Berkeley à la fin des années 90, ce trublion partage cette vision de l’Amérique de la marge – sans pour autant devenir rétrograde. On croirait entendre parfois une cassette de Daniel Johnston, tant l’émotion est présente. Il est toujours appréciable d’assister à la naissance d’un grand artiste, à l’écoute d’un instant séminal. Cette compilation vaut bien plus que son aspect documentaire, elle est une œuvre à part entière, magnifique. (E.A)
FONTAINES D.C.
Romance – XL Recordings
Nos amis irlandais s’encanailleraient-ils depuis que Grian Chatten, leur chanteur, s’est aventuré sur le terrain d’une pop colorée ? Nous serions en mesure de nous interroger, et pourtant la gravité demeure. Noyée sous une poussière de particules fines, la ville n’en devient pas moins inquiétante. Un éclair de lumière nous parvient sous la forme subtile d’une ritournelle au mellotron. Mais pas de « champs de fraise » à l’horizon, tout au plus un beat assourdissant qui se transforme en un rap blanc, incisif et mordant. Les Dublinois montrent que rien ne les compromet. Et si le cœur leur disait d’aller vers plus de notoriété, nul problème pour nous. Le monde a besoin d’eux. (E.A)
ALEX IZENBERG & The Exiles – Domino
Il serait quand même bon de se pencher sur le cas de cet artiste de Los Angeles, si fragile, mais si obstinément génial. Une sorte de Van Dyke Parks de notre temps ou de Randy Newman dans sa version secrète. Avec ce quatrième album, l’on retrouve son sens subtil des arrangements pour une pop qui aimerait tellement s’émanciper, sortir de son carcan et voler de ses propres ailes. Il y a effectivement quelque chose de réjouissant dans cette approche désuète, hors temps, et pourtant extatique. On va finir par le croire indispensable, ce gaillard-là. Lui-même en rougirait sans nul doute et irait se cacher sous le lit jusqu’à la prochaine fois. (E.A)




ÉPILOGUE
Par Philippe Schweyer

Pour refermer ce numéro, une banale photographie de bureau. On y voit un jeune homme joufflu et chevelu en plein travail, c’est-à-dire pendu au téléphone (filaire), clope au bec face à un ordinateur iMac G3 au design révolutionnaire. Une guitare rose (gonflable ?) et des dessins – sans doute de sa fille Maya – sont accrochés au mur. La photo a été prise au début du siècle dans les bureaux du Noumatrouff, la scène de musiques actuelles de Mulhouse. Pascal Thomas, que tout le monde appelait Scalpa, était le régisseur de la salle depuis près de trente ans. Avant cela, il avait été guitariste de Frayeurs, un groupe de punk hardcore devenu Crusher en 1991 et qui écuma les scènes metal de toute l’Europe jusqu’à son split en 1995. Derrière le blagueur jamais à court d’histoires drôles, derrière le mec parfois bougon, se cachait un homme au cœur tendre. Si la musique qu’il aimait pourrait faire croire le contraire, Pascal détestait la violence. Avec le temps, il avait appris à détecter
les groupes prometteurs. Il aimait les musiciens qui le lui rendaient bien. Surtout, il n’hésitait pas à dire franchement ce qu’il pensait et à distiller des conseils souvent précieux. C’est lui qui s’y collait quand il fallait chasser les derniers fêtards accrochés au bar les soirs de concert. Amoureux de la musique, il était au service des artistes. Le 12 juin, pourtant très affaibli par un cancer diagnostiqué fin mars, il avait fait l’effort de se rendre une dernière fois sur son lieu de travail. Il se réjouissait de voir les groupes américains Hatebreed et Crowbar. En arrivant, il avait semblé reprendre des forces, tellement content d’être là et de retrouver ses amis, ses collègues. C’était pour lui comme un gros shoot d’énergie. Installé dans un canapé, il s’était assoupi malgré les décibels. Au Nouma, il était chez lui. Le 18 août, ses amis à Mulhouse et aux quatre coins du pays ont appris que Scalpa ne serait plus jamais là pour les accueillir au Noumatrouff. Comme il le disait : « Là où tu Go… j’ira. »




















BIENVENUE AU CLUB !
4 DISQUES MÉDIAPOP RECORDS *
4 LIVRES MÉDIAPOP ÉDITIONS * OU
2 DISQUES + 2 LIVRES *
Cadeau Bonus : Médiapop vous offre un livre ou un disque au choix si vous parrainez un ami ! * Dans la limite des stocks disponibles et pour une valeur de 100 € maximum.

