

VOUS DONNER UNE RÉPONSE RAPIDE, CE N’EST PAS UN DÉTAIL.







Les décisions de financement sont prises par ceux qui vous connaissent dans votre Caisse

















Directeurs de la publication et de la rédaction : Bruno Chibane & Philippe Schweyer
Rédacteur en chef : Philippe Schweyer ps@mediapop.fr 06 22 44 68 67
Secrétaire de rédaction : Aude Ziegelmeyer
Relecture : Manon Landreau
Direction artistique : Starlight
Ont participé à ce numéro :
RÉDACTEURS
Florence Andoka, Nathalie Bach-Rontchevsky, Nicolas Bézard, Valérie Bisson, Benjamin Bottemer, Caroline Châtelet, Nicolas Comment, Claude De Barros, Alma Decaix-Massiani, Coralie Donas, Emmanuel Dosda, Dominique Falkner, Christophe Fourvel, Clo Jack, Mathieu Jeannette, Bruno Lagabbe, Fanny Laemmel, Pierre Lemarchand, Lucas Le Texier, Luc Maechel, Guillaume Malvoisin, Stéphanie-Lucie Mathern, Myriam Mechita, Mylène Mistre-Schaal, Martin Möller-Smejkal, Nicolas Querci, Martial Ratel, Öykü Sofuoğlu, Louis Ucciani, Aurélie Vautrin, Nathanaelle Viaux, Gilles Weinzaepflen, Jean-Luc Wertenschlag, Clément Willer, Aude Ziegelmeyer, Lisa Zimmermann.
PHOTOGRAPHES ET ILLUSTRATEURS
Vincent Arbelet, Pascal Bastien, Bearboz, Nicolas Bézard, Sébastien Bozon, Mar Castañedo, Nicolas Comment, Caroline Cutaia, Régis Delacote, Richard Dumas, Romain Gamba, Alicia Gardès, Delphine Ghosarossian, Anne Immelé, Joan, Nicolas Leblanc, Olivier Legras, Benoît Linder, Renaud Monfourny, Zélie Noreda, Arno Paul, Bernard Plossu, Olivier Roller, Dorian Rollin, Christophe Urbain, Henri Walliser, Nicolas Waltefaugle.
COUVERTURE
© Célia Muller, MÀMME (ÀÀNGST#1), Pastels secs, 21 × 28 cm, 2022. Autorisation de l’artiste et Galerie Maia Muller.
IMPRIMEUR
Estimprim – PubliVal Conseils
Dépôt légal : janvier 2025 ISSN : 1969-9514 – © Novo 2025 Le contenu des articles n’engage que leurs auteurs. Les manuscrits et documents publiés ne sont pas renvoyés.
CE MAGAZINE EST ÉDITÉ PAR CHICMEDIAS & MÉDIAPOP
CHICMEDIAS
37 rue du Fossé des Treize / 67000 Strasbourg Sarl au capital de 47 057 € – Siret 509 169 280 00047
Direction : Bruno Chibane bruno.chibane@chicmedias.com — 06 08 07 99 45
Responsable administratif : Gwenaëlle Lecointe administration@chicmedias.com — 03 67 08 20 87
MÉDIAPOP
12 quai d’Isly / 68100 Mulhouse Sarl au capital de 1000 € – Siret 507 961 001 00017
Direction : Philippe Schweyer ps@mediapop.fr – 06 22 44 68 67 www.mediapop.fr
ABONNEMENT
Novo est gratuit, mais vous pouvez vous abonner pour le recevoir où vous voulez.
ABONNEMENT France : 4 numéros — 30 €
Hors France : 4 numéros — 50 €
DIFFUSION
Contactez-nous pour diffuser Novo auprès de votre public.
WWW.NOVOMAG.FR
PROLOGUE
5
FOCUS 7-24
La sélection des spectacles, festivals et inaugurations
SCÈNES 27-36
Momix 28-29, Émilie Capliez 30-31, Marianne Basler 32-36
ÉCRITURES
37-62
La Fabrique 38-45, Alice Zeniter 46-49, Louis Ucciani 50-51 , Olivier Haralambon 52-55, Aude Ziegelmeyer 56-57 , Martine Delvaux 58-62
SONS 63-84
Jean-Louis Murat 64-66, Dominique A 67-75, Hyperrêve 76-77 , Malik Djoudi 78-79, Juniore 80-81, La Kamaraderie 82-83 , The Hook 84
ÉCRANS
85-90
Nancy Savoca 86-87, Jinho Myung & Alexandra Simpson 88-90
ARTS 91-101
Cerith Wyn Evans 92-93, Étonner la catastrophe 94-95 , Camille Brès 96-97, La bibliothèque fantastique 98 , Jean Alessandrini 99-101
IN SITU 103-114
Les expositions de l’hiver
CHRONIQUES
115-134
Nicolas Comment 116-121, Stéphanie-Lucie Mathern 122-123 , Myriam Mechita 124-125, Dominique Falkner 126-127 , Nathalie Bach-Rontchevsky 127, Martin Möller-Smejkal 128-129 , Jean-Luc Wertenschlag 130-131, Claude De Barros 132-133 , Bruno Lagabbe 134
ÉPILOGUE
136

LES YEUX POUR PLEURER
Par Philippe Schweyer
Après avoir commandé un café, j’ai commencé à lire le journal à la recherche des avis de décès. Comme je ne connaissais aucun des morts du jour, j’ai continué à tourner les pages. Des catastrophes, des vols, des guerres, des coups de folie, des incendies, des crimes, du trafic, des viols, des grèves, des pauvres, des migrants, des riches, des puissants, du froid, du chaud… En relevant la tête, j’ai jeté un œil en direction d’une femme plongée dans un gros livre de poche, son téléphone à portée de main.
Cela faisait des semaines que je ne la quittais pas des yeux. Elle lisait quelques pages, jetait un œil à son téléphone, lisait quelques pages, jetait un œil à son téléphone… J’ai commandé un deuxième café.
Le patron avait quelque chose à me dire.
— Je peux m’asseoir ?
Je n’avais aucune envie de parler. La femme a levé la tête puis s’est replongée dans son livre.
— J’ai un projet.
Je détestais le mot « projet ».
— Je voudrais écrire un livre.
La femme tapotait sur son téléphone.
— Je voudrais laisser une trace.
Tout le monde, même les patrons de bar, voulait laisser une trace.
— J’ai le concept.
J’ai bâillé. C’était plus fort que moi. Je détestais le mot « concept ».
— Par contre, je n’ai pas un rond.
— Plus personne n’a d’argent. Surtout pour faire un livre. C’est quoi le concept ?
Il a regardé autour de lui. Il ne fallait pas que les rares clients qui fréquentaient encore son établissement nous entendent.
— Je prends aussi des photos.
Les photos, c’était du concret. La femme s’était replongée dans son livre.
— Tu vois la caméra à l’entrée ? Chaque fois qu’un client entre ici, elle prend une photo.
— Ce n’est pas très légal.
La radio diffusait « California Dreamin’ » un vieux tube de The Mamas and the Papas. J’ai repensé à un tas de moments heureux. Tout ça pour en arriver là… J’avais envie de m’enfuir, mais il n’était pas disposé à me laisser filer.
— Je voudrais que tous mes amis soient dans mon livre. C’est ça le concept.
J’ai attendu la fin du morceau pour répondre.
— Tu as commencé à écrire ?
— Tout est dans ma tête.
Il a regardé autour de lui. La femme a enlevé ses lunettes pour jeter un œil dans notre direction.
— Je sais où je veux aller. Il suffit que je m’y mette.
— Qu’est-ce que tu attends ?
— Une étincelle. Je voudrais savoir ce que tu en penses.
J’aimais bien l’idée, même si ça n’avait rien de nouveau.
— Tu vas parler de moi ?
— Oui.
— Et la femme qui lit chaque matin dans ton bar, elle sera aussi dans ton livre ?
Il s’est retourné comme pour vérifier qu’elle ne s’était pas envolée.
— Presque tous les habitués seront dans mon bouquin.
J’avais envie de commander un autre café.
— Qu’est-ce que tu vas raconter sur moi ?
— Tu es mon seul client qui s’intéresse aux morts. La radio diffusait une chanson en italien de Fabio Concato chantée par Rodolphe Burger. C’était beau à pleurer.
— Tu ne t’intéresses pas aux morts ?
Il s’est passé la main dans les cheveux.
— La moitié de mes clients sont morts. Je me demande chaque matin pourquoi je suis encore là.
— C’est comme ça. Arrête de te poser des questions. La femme tapotait sur son téléphone. Elle allait bientôt partir.
— Alors, tu en penses quoi ?
— Il faut faire ce que tu as envie de faire. Crois-moi, c’est la seule chose à faire.
— Et l’argent ?
— Ce qui compte, ce sont tes amis. L’argent ce n’est rien. Pense à Cassavetes qui a passé sa vie à s’endetter pour faire ses films.
J’ai deviné qu’il se frottait les yeux pour chasser une larme.
— Promis, tous les amis seront dans le livre. J’ai replié le journal. Dehors, il faisait froid.
Ils ont fait l’Histoire

21 novembre
21 janvier

Les Compagnons de la Libération vus par le Studio Harcourt

Lundi au vendredi
8h30 - 17h30
Entrée libre
Siège de la Région
1 Place Adrien Zeller à Strasbourg



Charles de Gaulle / Jean Moulin - Studio Harcourt ®
Ils
ont fait l’histoire, les compagnons de la Libération vus par le studio Harcourt
Depuis 1934, le studio Harcourt tire le portrait des grands de ce monde et nimbe célébrités de tous horizons d’une aura incomparable. S’éloignant des paillettes du « Tout-Paris », « Ils ont fait l’histoire » revient sur un pan moins connu de l’iconographie Harcourt et rassemble les portraits photographiques d’hommes politiques, résistants et autres héros de la libération. Outre l’inimitable silhouette du général de Gaulle, on y croise Jean Moulin, Pierre Kœnig ou René Cassin ainsi qu’une centaine de compagnons de la Libération, sublimés par le clair-obscur iconique de la maison parisienne. (M.M.S.)
Jusqu’au 21 janvier
À l’Hôtel de la Région Grand Est, à Strasbourg www.grandest.fr

Animal poétique

Le dernier numéro de la revue de poésie animal vient de paraître. Édité par l’association Poema, qui organise chaque année en Lorraine le festival du même nom, animal « sort de sa tanière » deux fois par an, alternativement en papier et en numérique. Et comme chez Novo on aime les bons mots, surtout lorsque l’on peut les humer sur un matériau fabriqué à partir de fibres végétales, nous nous faisons un plaisir d’annoncer la sortie du dernier numéro papier d’animal. Sur 150 pages, celui-ci propose des textes inédits de quatorze auteurs et autrices de sensibilités et d’horizons divers. La revue est disponible dans une trentaine de librairies, dont plusieurs en Grand Est (voir site) et sur abonnement. (B.B.)
revue-animal.com
Intimes combinaisons
La galerie messine Modulab accueille l’ébéniste Nicolas Mazzi et la céramiste Virginie Descamps pour un dialogue intime où leurs deux pratiques s’entrelacent afin de créer des peintures en trois dimensions. Chez le duo, le bois, le papier et la céramique se répondent, se confrontent et s’unissent à travers différents formats, émergeant à partir de motifs, d’ornements, de matières… Comme pour raconter leur désir de se réinventer sans cesse et de s’enrichir l’un l’autre, les deux artistes donnent naissance à des espaces et des environnements nouveaux, dans lesquels leurs hiérarchies se transforment et s’assemblent pour mieux se reconfigurer à l’infini. (B.B.)
Du 10 janvier au 7 février à la Galerie Modulab, à Metz modulab.fr

Nicolas Mazzi et Virginie Descamps © Galerie Modulab
Charles de Gaulle. Studio Harcourt


MAILLON
Théâtre de Strasbourg Scène européenne
PRÉSENTATIONS
VE 10 + MA 14 JAN
EN GRAND COMITÉ
JE 16 JAN
EN PETIT COMITÉ
FOCUS
24 jan – 1er fév PREMIÈRES
Festival de l’émergence européenne
VE 24 + SA 25 JAN
Théâtre d’objets / Hong Kong, Pays-Bas GPO BOX NO.211
Chun Shing Au / Theatre du Poulet
première française
VE 24 + SA 25 JAN
Théâtre / Autriche PENELOPE
Leonora Carrington / Giulia Giammona
première française
VE 31 JAN + SA 1er FÉV
Théâtre / France, Iran I’M DERANGED
Mina Kavani
VE 31 JAN + SA 1er FÉV
Théâtre / Belgique RAGE
Émilienne Flagothier
Theater Straßburg Europäische Bühne
maillon.eu +33 (0)3 88 27 61 81 billetterie@maillon.eu
ME 5 + JE 6 + VE 7 FÉV
Danse / Belgique VOICE NOISE
Jan Martens / GRIP
ME 26 + JE 27 + VE 28 FÉV
Danse, musique / Rwanda, France UMUKO
Dorothée Munyaneza / cie Kadidi
FABRIQUE D’EXPÉRIENCES
espresso, warm-up, bord plateau, atelier, midi-sandwich, avant-scène, rencontre, café linguistique, garderie créative, pique-nique coulisses, DJ set, projection...
TEMPS FORT
12 mars – 4 avril
CORPS POLITIQUES
entre assignation et résistance
ME 12 + JE 13 + VE 14 MARS
Théâtre immersif / France RECONSTITUTION : LE PROCÈS DE BOBIGNY
Émilie Rousset et Maya Boquet
JE 13 + VE 14 + SA 15 MARS
Danse / Chine
NEW REPORT
ON GIVING BIRTH
Wen Hui / Living Dance Studio
JE 20 + VE 21 MARS
Danse, performance / Philippines, Sri Lanka
MAGIC MAIDS
Eisa Jocson / Venuri Perera première française coproduction Maillon
ME 26 + JE 27 + VE 28 MARS
Théâtre / Hongrie PARALLAX
Kornél Mundruczó / Proton Theatre coproduction Maillon
ME 2 + JE 3 + VE 4 AVRIL
Théâtre / Grèce
ROMÁLAND
Anestis Azas, Prodromos Tsinikoris première française
JE 24 + VE 25 + SA 26 AVRIL
Cirque / Belgique EXIT
Circumstances
MA 13 + ME 14 MAI
Cirque, danse, vidéo / France INTÉRIEUR NUIT
Jean-Baptiste André
ME 21 + JE 22 + VE 23 MAI
Théâtre / Argentine
WAYQEYCUNA
Tiziano Cruz
ME 4 + JE 5 + VE 6 + SA 7 JUIN
Magie nouvelle / Suisse PRÉPARATION POUR UN MIRACLE
Marc Oosterhoff

Flâner dans son spleen
Rien n’est plus agréable que de musarder aux côtés de Romain Muller. Ses chroniques sensibles et rêveuses ont doucement envahi nos oreilles dès 2020 avec un premier EP, Bain de minuit. Avec Azur, son second album, toujours sur son label Cocomachine, le charme opère à nouveau. Levant le nez vers le ciel, les pieds dans les herbes folles, le Messin quitte la ville et nous emmène avec lui sur les bords de Moselle ou les falaises de Bonifacio, au fil d’une electro planante parsemée de touches groovy. Dix balades pour autant d’histoires douces-amères, entre souvenirs d’enfance et peur de vieillir, moments de quiétude et spleen tenace. (B.B.)
cocomachine.fr
Particules élémentaires
La galerie Octave Cowbell accueille une magnifique double exposition mettant en résonance le travail de l’artiste américaine Sarah Nance, Mirages, rendue possible grâce au soutien de l’Université d’État de New York et du Département de la Moselle, et Cornicello, de Léa Cammarata et Louise Talarico, un travail de résidence mené au Centre d’art contemporain – la synagogue de Delme en partenariat avec Octave Cowbell et réalisée dans le cadre du programme Perspectives de l’Ensad de Nancy et du dispositif Émergence de la Région Grand Est. (V.B.)
Du 24 janvier au 6 avril 2025 à Metz www.octavecowbell.fr


No title, 2019 © Saran Nance
Un petit truc bleu
C’est dans une chambre d’hôpital que commence Tangentes, où un homme voit surgir des spectres du passé tout en contemplant « la masse bleue des Vosges ». Dans une autre chambre, une jeune femme est en proie elle aussi à des visions : tout prend « des teintes bleues », si bien qu’elle préfère s’enfuir plutôt que de faire l’amour avec l’homme à ses côtés. Peu à peu, cette atmosphère bleue imprègne tout le très beau roman de Mathilde Hug. C’est le bleu de la mélancolie, mais c’est aussi le « petit truc bleu » dont parle Michel Butel quelque part, qui laisse entrevoir une autre vie possible. (C.W.)
Tangentes, Mathilde Hug, éditions Gorge bleue, gorgebleue.fr
Romain Muller © Romain Gamba







Sombres divinités
Pour célébrer la fin de l’hiver et l’équinoxe de printemps, l’Opéra de Dijon nous convie du 19 au 23 mars à admirer et à écouter Les pêcheurs de perles de Georges Bizet, une des grandes œuvres de jeunesse du compositeur romantique qui avait alors vingt-cinq ans à peine et brûlait d’un feu inconnu. La mise en scène signée Mirabelle Ordinaire, qui est passée par les très prestigieux Opéra de Paris et Metropolitan Opera de New York, s’annonce prometteuse dans sa manière d’actualiser toute l’intensité tragique de l’intrigue amoureuse triangulaire qui est au cœur de cet opéra, dont le livret fut écrit par Eugène Cormon et Michel Carré. Rapidement, on comprend que Zurga (PhilippeNicolas Martin), à la tête des pêcheurs de Ceylan, et son ami Nadir (Julien Dran) sont tous deux amoureux de Leïla (Hélène Carpentier), prêtresse dont le chant magique est censé protéger les travailleurs de la mer de la colère des dieux maritimes. Les orages déchaînés et les tempêtes meurtrières, tout comme l’acharnement des frères ennemis à s’entretuer et à mettre le feu à tout ce qui voudrait vivre pour une raison qu’à la fin eux-mêmes ne comprennent plus très bien, ne seront pas sans résonner avec certaines catastrophes contemporaines… À la fin du troisième et dernier acte, on peut se souvenir d’ailleurs que les personnages entament en chœur un air très beau, qui nous parlera aujourd’hui encore, et qui s’intitule « Sombres divinités ».
Par Clément Willer
— LES PÊCHEURS DE PERLES, opéra du 19 au 23 mars à l’Opéra de Dijon, opera-dijon.fr

Êtres et vacillements
« Qui sommes-nous ? » À cette question posée (en catalan), l’équipe de circassien·nes de Baro d’evel n’entend – surtout – pas apporter une réponse ferme ni définitive – pas plus qu’en une seule langue. Voyez plutôt cette adresse comme une mise en partage, le spectacle ne cessant ensuite de déplier – et rappeler – la multitude de « nous » qui nous composent, leur plasticité et labilité, aussi. Dans ce nouvel opus créé lors du dernier festival d’Avignon, la compagnie emmenée par le duo Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias embrasse, à l’image de cette pluralité, une multiplicité d’atmosphères. Ce qui réunit l’ensemble serait, outre le soin toujours aussi sincère de l’équipe apporté à l’hospitalité (ainsi que le signale la clôture), une fragilité intrinsèque. Les certitudes sont, en effet, bien minces dans le monde que les douze personnages traversent, et la scénographie, les accessoires, les matériaux – notamment la céramique – comme les situations ne cessent de s’effriter et se remodeler. Entre recherche permanente d’un équilibre – alors que tout ne cesse de balancer entre grotesque et tragique – et vacillements liés à l’aléatoire et l’impermanence de nos vies, Qui som? est autant une bourrasque qu’une caresse. Mêlant savamment danse, théâtre, cirque, chant, musique et arts plastiques, s’amusant avec l’histoire du théâtre et de la danse – le spectacle travaillant les citations en les déplaçant –, l’ensemble use sans compter de la poésie et de la métaphore. Sans oblitérer les violences ni les égarements politiques les plus contemporains de notre monde.
Par Caroline Châtelet
— QUI SOM?, cirque du 19 au 21 mars au Théâtre Dijon Bourgogne, à Dijon www.tdb-cdn.com
Qui som? © Christophe Raynaud de Lage
Gilles Aillaud, Nil à Philae, huile sur toile, 1987































direction Julia Vidit

Philippe Dorin / Sylviane Fortuny


EN ATTENDANT LE PETIT POUCET


RODEZ-MEXICO
Julien Villa
L’ARBRE À SANG
Angus Cerini / Tommy Milliot
LE MENTEUR
Pierre Corneille / Julia Vidit
AMAZONIA


MICROPOLIS Festival dédié à l’itinérance

FIDÉLITÉ(S) OU LA PANENKA DE HAKIMI Mona El Yafi / Ali Esmili
LES YEUX NOIRS
Céline Delbecq / Jessica Gazon

Aurélien Labruyère / Jean-Baptiste Delcourt
D’AUTRES FAMILLES QUE
LA MIENNE Estelle Savasta
En coréalisation avec le CCAM Scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy

QUARTIERS LIBRES #8
Guillaume Cayet



ON N’A PAS PRIS LE TEMPS DE SE DIRE AU REVOIR Rachid Bouali
MA RÉPUBLIQUE ET MOI
Issam Rachyq-Ahrad
LA DARONNERIE
Rébecca Chaillon
LE PARTAGE DU BUTIN




Aurianne Abécassis / Morgane Deman

La puissance du collectif
C’est un titre dans lequel ne figure aucun point d’interrogation. Peut-être parce que les personnages de Qui a besoin du ciel ne se font guère d’illusions sur un sauvetage venu d’une puissance extérieure. Dans cette pièce aux riches enjeux féministes et politiques, deuxième volet de la trilogie que l’autrice dramatique américaine Naomi Wallace (née en 1960) consacre aux méfaits du néolibéralisme – en s’ancrant dans le Kentucky –, la majorité des protagonistes sont empêtrés dans des problématiques de survie. À travers des dialogues incisifs où la farce la dispute à la tragédie, l’on croise l’addiction aux opioïdes, la pauvreté, les accidents du travail, la maladie, la mort, les violences intrafamiliales, etc. Pour autant, le cheminement de cette petite communauté que met en scène le directeur du Nouveau Théâtre de Besançon Tommy Milliot est soutenu par un même désir d’émancipation face au déterminisme social. Par l’entremise de deux femmes, Wilda (en sevrage de son addiction aux médicaments) et Annette (qui tente de regagner la confiance de sa fille), le groupe se met en branle. Si on ne connaît pas l’issue finale de leur entreprise – d’autant qu’elle s’annonce sous une forme balançant entre réel et merveilleux –, c’est à mille lieues du ciel et via une grotte que leurs espérances avancent. Leur première réussite étant de parvenir, en dépit de leurs différences (d’âge, d’histoires, d’origines ethniques, etc.), à unir leurs forces dans un mouvement commun. Rappel de la puissance de la solidarité face aux ravages du néolibéralisme.
Par Caroline Châtelet
— QUI A BESOIN DU CIEL, théâtre du 11 au 15 mars au Nouveau Théâtre de Besançon www.ntbesancon.fr

Poésie du chaos
Que pourrait-on écrire sur The Libertines qui n’aurait pas déjà été dit ? Pete Doherty et Carl Barât ont fait couler tant d’encre qu’on pourrait sans doute en remplir la Tamise – autant pour leurs mélodies déglinguées et la poésie opiacée de leurs titres que pour leurs punk-attitudes, symboles bien sapés d’un vent de révolte onirique et générationnel. Un hymne à l’imparfait, comme en témoignent leurs bromances dévastatrices façon éruption volcanique, qui conduisirent d’ailleurs le groupe à l’explosion en 2004. Digression en solo, dérives chimiques et autres vagabondages musicaux n’auront cependant pas éteint la tension high voltage qui les caractérise ; en 2014, The Libertines remontaient sur scène avec Anthems for Doomed Youth, rugissement plus mature, mais toujours aussi percutant, qui montrait bien que, malgré les années, le groupe gardait son pouvoir d’attraction. Dix ans plus tard, All Quiet on the Eastern Esplanade, leur dernier album en date, prend des airs de fresque sonore ; une ode aux amours brisées et aux errances intérieures portée par la voix éraillée de Pete Doherty, guitares rugissantes et harmonies fragiles tissant un équilibre parfait entre chaos et sérénité. Aujourd’hui moins agité, mais toujours fidèle à son énergie, le groupe continue d’influencer le paysage du rock indépendant, reliant les générations et rappelant que dans le tumulte réside toujours une forme de beauté. Début 2025, The Libertines fait escale en France pour son tour d’Europe, avec cinq dates dont une à Besançon. Amen !
Par Aurélie Vautrin — THE LIBERTINES, concert le 12 février à La Rodia, à Besançon www.larodia.com
Qui a besoin du ciel © Pierre Gondard
The Libertines © Ed Cooke










Blues au coeur
Le blues, c’est une langue qui danse au bord du gouffre et trouve encore la force de chanter. C’est le cri feutré d’une guitare qui grince sous des doigts usés, un souffle rauque qui fend la nuit, un rythme qui bat comme un cœur blessé, mais indomptable. Ce sont les âmes en peine qui errent sur les bords du Mississippi, la poussière des chemins sans fin, les rivières gorgées d’histoires, la lumière timide d’un espoir qui refuse de mourir. Chaque accord est une confession, chaque silence, une prière. Né dans le sud des États-Unis à la fin du xixe siècle, le blues continue de résonner, encore aujourd’hui, comme un (le ?) langage universel de l’émotion brute. C’est pourquoi le Nouma devient pour une soirée la Mul’House Of Blues, une vraie Maison du Blues comme celles enracinées en Louisiane ou au fin fond de l’Alabama. Au programme, trois performances qui respirent l’authenticité et la chaleur nue : Circle of Mud, un blues rock à la fois roots et moderne, mené par le charismatique
Flo Bauer ; les briscards de Mojo New Line, dont le trio écume les routes depuis vingt ans avec leur patchwork savoureux de compos originales et reprises de standards… Sans oublier l’inclassable Aurel King, guitariste et chanteur aux multiples voyages musicaux, qui puise dans les racines des musiques américaines pour créer un univers personnel entre Robert Johnson et Bob Dylan. Sweet Home Noumatrouff
Par Aurélie Vautrin
— MUL’HOUSE OF BLUES, concert le 1er février au Noumatrouff, à Mulhouse www.noumatrouff.fr

Par les villages, contre la dépossession
Publiée en 1981, Par les villages constitue la pièce de l’écrivain et dramaturge autrichien Peter Handke (né en 1942) la plus montée en France. Se saisissant de ce texte qui tresse dans une structure protéiforme enjeux politiques et histoire familiale, présence des morts et importance de l’enfance, le metteur en scène Sébastien Kheroufi transpose l’action d’un petit village d’Autriche à une cité d’une banlieue française dans les années 90. Pour autant, il s’agit toujours du retour là d’où il vient de Gregor. Cet écrivain ayant quitté depuis longtemps son milieu d’origine débarque pour régler avec son frère Hans et sa sœur Sophie – eux restés là – l’héritage de leurs parents. Si ce retour vers le lieu de l’enfance va mettre au jour le gouffre entre Gregor, Hans et Sophie et raviver d’anciennes rivalités, il révèle également un sentiment de dépossession multiple. Dépossession de la maison parentale qui revient à Gregor – et qu’Hans lui demande de céder à Sophie –, dépossession, aussi, de ce qui fonde le quotidien de celles et ceux qui sont resté·es. Ou comment, sous couvert de modernisation, les chantiers en cours ne font qu’œuvrer à la marginalisation des habitant·es des périphéries. Réunissant des interprètes tel·les qu’Anne Alvaro, Reda Kateb, la rappeuse Casey ainsi que des comédien·nes amateur·rices, Sébastien Kheroufi déploie une critique des processus concrets comme symboliques d’éviction et d’exclusion sociales et urbaines. Face à cela, les personnages revendiquent leur place et affirment leur désir, préférant la fierté à la plainte.
Par Caroline Châtelet
— PAR LES VILLAGES, théâtre les 25 et 26 février à La Filature, à Mulhouse www.lafilature.org
Aurel King © Monsieur Cantin
Par les villages © Christophe Raynaud de Lage






Le silence dans le bruit
Si « écrire, c’est hurler sans bruit », comme le disait Marguerite Duras, on peut imaginer qu’à l’inverse, certaines fois, donner de la voix, c’est retrouver le silence au cœur du bruit. C’est ce que suggère avec subtilité Silence Vacarme, la pièce conçue par Antoine Cegarra, Claire Rappin et Pauline Ringeade, présentée par la Comédie de Colmar les 23 et 24 janvier, au Théâtre municipal de Colmar. Silence Vacarme nous raconte l’histoire de cette suspension rêveuse qui peut survenir dans le bruit, à travers celle de Claire Rappin, actrice et musicienne qui est aussi le personnage central de la pièce. Récit de soi, histoire des femmes de sa famille, dont celle de sa grand-mère qui fut une émigrée espagnole, chansons et bruissements, tout cela s’entremêle. Cette atmosphère sonore nous renvoie à la dimension la plus silencieuse de la mémoire, où surgissent des images qui ne savent pas parler, mais qui savent nous faire voir des paysages d’enfance, une maison, un jardin. Comme c’était déjà le cas dans N’avons-nous pas autant besoin d’abeilles et de tritons crêtés que de liberté et de confiance ? (2020), cette nouvelle pièce de Pauline Ringeade entrelace l’intime et l’extime, interrogeant ce que signifie le fait étrange et fascinant d’une existence toujours prise dans un réseau infini d’existences autres.
Par Clément Willer
— SILENCE VACARME, création théâtrale les 23 et 24 janvier au Théâtre Municipal de Colmar theatre.colmar.fr

Voix désordonnées
La saison à venir du Maillon est placée sous le signe d’une « contre-histoire sonore et gestuelle » visant à défaire les entraves millénaires qui étouffent les voix et les possibilités d’expression des femmes, avec des créations scéniques telles que Rage d’Émilienne Flagothier qui sera présentée du 24 janvier au 1er février, ou VOICE NOISE qui sera présentée du 5 au 7 février par le chorégraphe flamand Jan Martens du collectif GRIP, basé à Anvers. Sorte d’anthologie flamboyante, VOICE NOISE donne corps à 13 pièces musicales créées et chantées par des femmes, issues d’un vaste corpus moderne et contemporain, qui seront interprétées pour l’occasion par Elisha Mercelina, Steven Michel, Courtney May Robertson, Mamadou Wagué, Loeka Willems, Sue-Yeon Youn, Pierre Adrien Touret et Zora Westbroek. Les voix des femmes ont depuis longtemps été associées à l’irrationnel, à la monstruosité et au désordre, comme le note l’écrivaine Anne Carson dans l’essai The Gender of Sound (1992), ou encore la philosophe Carolyn Merchant dans The Death of Nature (essai fondateur qui date de 1980 et dont une traduction française est parue récemment chez Wildproject). Cette dernière écrivait à ce propos : « Désordonnée, la femme devait être contrôlée, tout comme la nature chaotique. » L’idée enthousiasmante qui anime VOICE NOISE est de montrer que ce qu’on considère comme désordonné, chaotique, ingouvernable est en fait l’indice d’une puissance de vie secrète.
Par Clément Willer
— VOICE NOISE, création scénique du 5 au 7 février au Maillon, à Strasbourg maillon.eu
Silence Vacarme © Laetitia Piccarreta
VOICE NOISE © Phile Deprez





















Va dans la forêt
Après J’aime, un solo construit à partir de l’œuvre de Nane Beauregard, Laure Werckmann et sa Compagnie Lucie Warrant, fondée en 2019 à Strasbourg, s’emparent d’un autre texte de femme, celui de Nastassja Martin, Croire aux fauves, publié en 2019 aux éditions Gallimard. Dans son récit autobiographique, l’anthropologue retrace l’expérience traumatisante qui la confronta à l’attaque et à la morsure au visage d’un ours lors d’un voyage de recherche sur le peuple Even vivant dans les montagnes du Kamtchatka. En s’emparant de ce récit, Laure Werckmann crée un solo théâtral faisant émerger une nouvelle figure de femme capable de bouleverser les limites de son identité et de ses représentations et de faire imploser les frontières entre des mondes apparemment séparés. Les limites du vivant se frottent et ouvrent des failles… Le récit d’une métamorphose ainsi débutée juste après l’accident se déploie au fil de quatre saisons de transformation, nourries de fragments de mémoire qui font d’une histoire intime un récit collectif. Laure Werckmann a poussé les résonances du collectif au-delà du plateau puisque le projet se dévide dans une pluralité de liens mis en place avec plusieurs acteurs du territoire : élèves en illustration et scénographie de la HEAR, tisseuses d’Illzach, salariés en insertion professionnelle de Vetis et Emmaüs Mundo, pour ne citer que quelques-uns des représentants d’un monde polymorphe audacieusement inclus dans un processus créatif théâtral.
Par Valérie Bisson
— CROIRE AUX FAUVES, théâtre les 11, 14, 15 et 16 janvier au TJP, à Strasbourg tjp-strasbourg.com

© Sarah Martinon
Une inquiétante étrangeté
Les contes d’Hoffmann qui seront présentés par l’Opéra national du Rhin en ce début d’année peuvent être considérés comme l’un des chefs-d’œuvre du compositeur allemand Jacques Offenbach, depuis leur première représentation posthume en 1881 à l’OpéraComique de Paris. Ils donnent voix à l’écrivain romantique E. T. A. Hoffmann, qui nous raconte sa vie légendaire et ses amours perdues en nous faisant pénétrer dans l’étrange labyrinthe que forment ses souvenirs entremêlés à des récits tirés de ses contes, qu’il s’agisse des Contes nocturnes (Nachtstücke), des Frères de Saint-Serapion (Die Serapionsbrüder) ou des Fantaisies à la manière de Callot (Fantasiestücke in Callots Manier). La mise en scène fantasmagorique de Lotte de Beer et les mélodies romantiques se déroulant sous la baguette de Pierre Dumoussaud promettent de faire tourbillonner la réalité ordinaire, pour qu’elle se mette à scintiller d’inconnu. D’ailleurs, c’est en lisant Les contes nocturnes que l’idée est venue à Sigmund Freud qu’il existerait une « inquiétante étrangeté » (das Unheimliche), une étrangeté qui viendrait troubler notre rapport à la réalité qu’on avait cru à tort familière. C’est bien cela qui est au cœur des Contes d’Hoffmann, un désir de réveiller la dimension nocturne qui gît sans qu’on s’en rende toujours compte dans les événements petits et grands qui peuplent la trame de nos vies quotidiennes.
Par Clément Willer
— LES CONTES D’HOFFMANN, opéra du 20 au 30 janvier à l’Opéra national du Rhin à Strasbourg, et les 7 et 9 février à la Filature, à Mulhouse www.operanationaldurhin.eu www.lafilature.org
© Adrien Berthet



L’année commence avec elles
Depuis quatre ans à POLE-SUD, le mois de janvier est purement féminin grâce à « L’année commence avec elles » : un festival follement engagé visant à donner plus de visibilité aux œuvres de femmes chorégraphes – une manière également de célébrer la richesse et la diversité des perspectives féminines dans le monde de la danse contemporaine. Ainsi cette année encore, dix artistes très singulières, d’origines, de pays et de générations différentes sont mises en lumière sur la scène strasbourgeoise. Leur point commun ? Être portées par le désir de dire – dire l’intime, dire l’amour ou le désamour, l’injustice, la différence. Avec audace et sincérité, droit dans les yeux et le poing levé, avec humour ou gravité, par ellipse poétique ou suggérée. Témoignage d’une lutte permanente toujours plus d’actualité dans notre monde abimé… Parmi les spectacles figurent notamment Reface de Chandra Grangean et Lise Messina, recherche physique et musicale autour de l’idée de transformation, de déformation et d’altération des matières ; Kanashimi d’Akiko Hasegawa, une création explorant les danses traditionnelles japonaises sous un prisme contemporain. Ou encore Zebra de Silvia Gribaudi, dans lequel la chorégraphe italienne poursuit son dynamitage en règle des normes, l’humour bravache en étendard grâce à un cours d’aérobic pas comme les autres. Enfin, ne passez pas à côté de Black Lights de Mathilde Monnier, Grand Prix du syndicat professionnel de la critique, qui interroge toute la panoplie des violences faites aux femmes. Un pas de danse pour chaque pas vers l’égalité ?
Par
Aurélie Vautrin
— L’ANNÉE COMMENCE AVEC ELLES, festival du 14 au 29 janvier à POLE-SUD CDCN, à Strasbourg www.pole-sud.fr

Un couple parfait
Dans les années 70, la série télévisée Scènes de la vie conjugale avait traumatisé toute la Suède et bien plus encore ; pendant le confinement, près de cinquante ans plus tard, le cinéaste israélien Hagai Levi avait réinventé l’œuvre d’Ingmar Bergman en inversant les personnages. Dans les deux cas, un couple parfait, un mariage réussi, une union sacrée, une famille modèle. Le meilleur des mondes. Et puis les fissures. Les petits drames du quotidien, les grandes frustrations, le chantage affectif, la solitude dans le couple. La déchirure amoureuse et le grand vide de la séparation. Chez Bergman, c’est l’homme qui part ; chez Hagai Levi, la femme. À chaque fois, le public se projette, car tout à chacun se retrouve dans les épreuves traversées, les apparences à sauver et l’espoir qui s’estompe peu à peu, malgré tout. Et le navire si fier, si droit, qui prend l’eau doucement. « Ce qui finira par apparaître, explique le metteur en scène Mathias Moritz, c’est qu’un couple – quel que soit le genre – ce ne sont pas seulement deux personnes, c’est tout un flux de conditionnements, de fantômes et de rêves. » Le Groupe Tongue s’attaque aujourd’hui à une nouvelle version de ce mélodrame petit-bourgeois : « On ne choisit pas ses fantômes sera ma mise en scène de l’os, continue Moritz. Pour l’atteindre, il faudra dégarnir la chair du couple. Forer jusqu’au squelette. Réinventer la consistance du cœur… » Dissection à vif et incision au scalpel sans anesthésie : attention, voilà qui va faire mal – dans tous les sens du terme.
Par Aurélie Vautrin
— ON NE CHOISIT PAS SES FANTÔMES, théâtre du 14 au 17 janvier au TAPS, à Strasbourg, et les 14 et 15 mai à La Filature, à Mulhouse www.taps.strasbourg.eu www.lafilature.org
Black Lights © Marc Coudrais
On ne choisit pas ses fantômes, Cie Tongue © Vincent Muller

CHANDRA GRANGEAN & LISE MESSINA > REFACE
MATHILDE MONNIER > BLACK LIGHTS
CHARA KOTSALI > TO BE POSSESSED
AKIKO HASEGAWA > KANASHIMI
CHLOÉ ZAMBONI > MAGDALÉNA
LARA BARSACQ > LA GRANDE NYMPHE
SOA RATSIFANDRIHANA > FAMPITAHA, FAMPITA, FAMPITÀNA
FANNY BROUYAUX > TO BE SCHIEVE OR A ROMANTIC ATTEMPT
MARINE COLARD > LE TIR SACRÉ
SILVIA GRIBAUDI > R. OSA - AVEC
CLAUDIA MARSICANO
+++ RENCONTRES / PROJECTIONS / ATELIERS...


@ Françoise Saur
Souvenirs à faire vivre
La Galerie de l’Arsenal propose un panorama du fonds exceptionnel réuni par la galerie La Conserverie, consacrée à la photo de famille. Depuis 2011, cette autre institution messine a rassemblé quelque 70 000 images, issues en grande partie d’appels à collecte ; une matière saturée d’émotion dans laquelle Anne Delrez, sa fondatrice, a puisé pour donner naissance à de nombreuses expositions entre ses murs situés rue de la Petite-Boucherie. Dans « S’écrire », vous pourrez admirer des extraits du fonds de Madame Permerle, soit un siècle d’histoire familiale racontée à travers 5 000 photos, des images issues de l’exposition « La Photographie du Portefeuille », des clichés parsemés d’écritures et de collages, ou encore des centaines de photos qui semblent documenter toute la vie d’une seule et même personne. Après treize années passées à effectuer un travail remarquable de commissariat d’exposition, d’accueil en résidence, d’édition et de sensibilisation à un art vernaculaire trop souvent déconsidéré, la Conserverie est en péril : l’immeuble qui l’accueillait est mis en vente. À l’heure où nous écrivons ces lignes, Anne Delrez n’a toujours pas trouvé de nouveau point de chute, ne bénéficiant ni des moyens ni des soutiens pour louer un nouvel espace. Au risque de voir disparaître un lieu unique en France.
Par Benjamin Bottemer
— S’ÉCRIRE, exposition du 24 janvier au 16 mars à la Galerie de l’Arsenal, à Metz www.citemusicale-metz.fr laconserverieunlieudarchives.fr

Tromperies et dilemmes à la Manuf’
On vous propose d’étrenner votre calendrier 2025 tout neuf avec trois événements à ne pas rater au Théâtre de la Manufacture à Nancy. À commencer par Le Menteur, où Julia Vidit revisite la pièce de Corneille en préservant son texte. Après une première création en 2017, la metteuse en scène, frustrée par ces deux dernières saisons marquées par les annulations liées à la crise sanitaire, décide de retravailler la pièce pour nous la proposer dans une version renouvelée. Le Menteur conte l’arrivée à Paris de Dorante, qui usera de son charme et de ses mensonges pour parvenir à ses fins. Julia Vidit y met en scène la puissance du langage et un choix : celui de l’utiliser comme une arme. Le début de saison se poursuivra avec le festival Micropolis, dédié aux formes itinérantes. Pour l’occasion, huit lieux seront investis autour de la rue Baron-Louis, avec des spectacles, des ateliers et de la musique. Début avril, Fidélité(s) ou la panenka de Hakimi d’Ali Esmili abordera la question de l’identité à travers le prisme du football féminin : lorsque Lila, 16 ans, se voit proposer d’intégrer l’équipe de France ou celle du Maroc, son choix va bousculer l’histoire familiale sur plusieurs générations. En questionnant le sentiment d’appartenance, la double culture et la binationalité, le spectacle met en évidence la complexité de l’expérience migratoire.
Par Benjamin Bottemer
— LE MENTEUR, du 25 février au 1er mars au Théâtre de la Manufacture, à Nancy
— FESTIVAL MICROPOLIS, du 20 au 23 mars
— FIDÉLITÉ(S) OU LA PANENKA DE HAKIMI, du 1er au 3 avril theatre-manufacture.fr
Le Menteur © Anne Gayan

ADÉ FACS PNEU
SOLANN KAZY LAMBIST
AFTERLIFE COLLECTIVE
BENJAMIN EPPS CORDE-RAIDE
FESTIVAL HAUNTING
THE CHAPEL # 12
HATIK JEANNETO JRK 19
KELLY FINNIGAN & THE ATONEMENTS
MALIK DJOUDI SYNAPSON
FATOUMATA DIAWARA
MAMMAL HANDS
YOUSSOUPHA
WINNTERZUKO...
JAN. → MARS 2025
JAN. → MARS 2025
ETIENNE DE CRÉCY THE LIBERTINES
FATOUMATA DIAWARA ALTA ROSSA
JAN. → MARS 2025
ETIENNE DE CRÉCY THE LIBERTINES
LANDMVRKS NADA SURF LACRIM
FATOUMATA DIAWARA ALTA ROSSA
UNE SEMAINE AVEC LAËTITIA SHÉRIFF
ETIENNE DE CRÉCY THE LIBERTINES
LANDMVRKS NADA SURF LACRIM
ZAMDANE ROOTIKALY YOURS #9
FATOUMATA DIAWARA ALTA ROSSA
UNE SEMAINE AVEC LAËTITIA SHÉRIFF
DIDIER SUPER HØLLS JAHNERATION
LANDMVRKS NADA SURF LACRIM
ZAMDANE ROOTIKALY YOURS #9
JAZZ SESSION #8 VALÉRIE ÉKOUMÉ
UNE SEMAINE AVEC LAËTITIA SHÉRIFF
DIDIER SUPER HØLLS JAHNERATION
ÄRSENIK SHAO BESAK METAL FEST #3
ZAMDANE ROOTIKALY YOURS #9
JAZZ SESSION #8 VALÉRIE ÉKOUMÉ
DIDIER SUPER HØLLS JAHNERATION
ÄRSENIK SHAO BESAK METAL FEST #3
JAZZ SESSION #8 VALÉRIE ÉKOUMÉ
LES INSOLITES DE LA RODIA #6 : 60s PARTY avec THE DUSTBURDS + FANTOMAS CREW
ÄRSENIK SHAO BESAK METAL FEST #3
LES INSOLITES DE LA RODIA #6 : 60s PARTY avec THE DUSTBURDS + FANTOMAS CREW
MESSE BASS by MERQLAB X OKUMA SOIRÉE
MESSE BASS by MERQLAB X OKUMA SOIRÉE "SIMONE" by BOOM RANG SUPPORT YOUR LOCAL BAND avec RAJA BECHICHI + KLO&ANGE
LES INSOLITES DE LA RODIA #6 : 60s PARTY avec THE DUSTBURDS + FANTOMAS CREW
"SIMONE" by BOOM RANG SUPPORT YOUR LOCAL BAND avec RAJA BECHICHI + KLO&ANGE
MESSE BASS by MERQLAB X OKUMA SOIRÉE
"SIMONE" by BOOM RANG SUPPORT YOUR LOCAL BAND avec RAJA BECHICHI + KLO&ANGE
4, avenue de Chardonnet Besançon www.larodia.com
4, avenue de Chardonnet Besançon www.larodia.com
4, avenue de Chardonnet Besançon www.larodia.com
Scène de musiques actuelles de Besançon
Scène de musiques actuelles de Besançon
Scène de musiques actuelles de Besançon

(Re) Découvertes
Sur scène, les chemins se croisent : Momix poursuit sa trajectoire buissonnière, Émilie Capliez marche sur les traces de Jules Verne et Marianne Basler fait l’événement avec Annie Ernaux.
MOMIX, CHEMINS BUISSONNIERS
Par Caroline Châtelet

POUR SA TRENTE-QUATRIÈME ÉDITION, MOMIX PROLONGE CE QUI
LE FONDE : PERMETTRE À TRAVERS ET AUTOUR DE LA DÉCOUVERTE D’ŒUVRES ET D’ARTISTES D’EXPÉRIMENTER, D’EXPLORER, DE SE RENCONTRER, DE
Tout le monde est là de Mike Kenny, mise en scène de Simon Delattre © Simon Gosselin
Avec ses trente-six spectacles, le festival international jeune public permet aux enfants et aux adolescent·es (ainsi qu’aux adultes !) de pérégriner parmi une multiplicité d’univers, de formes, d’enjeux. Autour de l’édition 2025, Novo a rencontré sa nouvelle directrice artistique, Marie Normand. Après avoir arpenté Momix avec sa compagnie Rêve général !, l’artiste en imagine désormais avec toute l’équipe les cheminements buissonniers vers et autour des spectacles.
Qu’est-ce qui vous a amené à souhaiter quitter la vie de compagnie pour la direction artistique de Momix ?
J’ai toujours été très intéressée par la politique culturelle et la question de la démocratisation culturelle. Comment est-ce que l’on amène une œuvre devant un public – particulièrement un public qui pense que ce n’est pas pour lui, et un jeune public qui n’en a pas l’habitude – est une question qui m’a toujours passionnée dans mon travail de compagnie, comme dans ce qui constitue « l’autre » partie de ma vie. J’ai, en effet, un double cursus administratif et artistique, et j’ai créé et dirigé pendant huit ans Coup de théâtre, festival en milieu rural qui rayonnait dans la communauté de communes de Mirecourt, dans les Vosges. Ma compagnie ayant toujours travaillé pour le jeune public et proposé des actions de médiation avec une implantation en milieu rural, cette évolution est assez naturelle.
Qu’est-ce qui vous intéressait dans l’histoire et le projet du festival ?
Mon histoire avec Momix est assez longue : en compagnie, j’y ai fait à peu près tout ce qu’on peut y faire : résidences, actions culturelles, représentations à Kingersheim ou en balade, etc. Ce festival a un projet magnifique et rare, puisqu’il est à la fois tourné vers son territoire et vers l’international, avec un double axe d’exigence et d’accessibilité vers le jeune public.
Comment avez-vous construit l’édition 2025 ?
Une partie de la programmation se construisant sur des tournées avec des lieux de la région – des partenaires qui, eux, bouclent leur programmation de la saison suivante en avril –, ça a été assez rapide ! Et comme nous travaillons très en amont, c’est une programmation où il y a encore des spectacles programmés par Philippe Schlienger. J’ai dû à la fois apprendre et produire dans un double mouvement d’apprentissage, de réception, et de prise de décisions et de mise en partage de cellesci. L’équipe du Créa à Kingersheim, tout comme les partenaires, m’ont vraiment bien accompagnée. Cette année a été extrêmement dense, j’ai vu deux-cent cinquante spectacles – aussi pour me constituer un fichier de compagnies avec qui travailler dans le futur.
Quelles lignes dessine la programmation de cette édition 2025 ?
Nous proposons des spectacles qui conjuguent une grande exigence dans la forme, le fond et qui offrent une vraie accessibilité à la tranche d’âge à laquelle ils sont destinés. Même si la sensibilité de Philippe Schlienger n’est pas forcément la mienne (et inversement), là-dessus, ça ne bouge pas énormément. Là où ça bouge, c’est plus sur la forme du festival : j’ai pris la décision d’accueillir moins de compagnies mais que celles-ci jouent plus longtemps. C’est un objectif de durabilité et de visibilité – une chose qui revient souvent étant la difficulté à trouver des places pour Momix. On peut imaginer que les enfants venus à des représentations scolaires reviennent avec leurs parents – chose qui fonctionne bien pendant la saison. L’idée est de permettre le bouche-àoreille, que les enfants aient une chance d’être prescripteurs et que les spectacles puissent se développer artistiquement. La deuxième chose, c’est que nous proposons un festival encore plus « à hauteur d’enfants » avec des rencontres, des ateliers artistiques, des animations, etc. Ces moments permettent de partager en famille, d’entrer dans une démarche artistique. Il y a également un focus sur les auteurs, pour montrer par le sensible qu’un spectacle vient souvent d’un livre et que cet objet-livre est important. Enfin, nous avons mis en place une politique tarifaire avec des pass, afin que les tarifs ne soient pas un obstacle pour les familles. L’idée est que le festival permette de créer des souvenirs ensemble autour de découvertes artistiques et de temps conviviaux.
Parmi tous les spectacles, avez-vous le sentiment que certains enjeux reviennent particulièrement ?
Il y a toujours eu des courants… Là, l’écologie comme la place des jeunes face au monde (le harcèlement, la difficulté de parler avec les adultes et inversement, etc.) sont présents. Après, je suis vigilante à conserver un équilibre dans la programmation. Et le fait d’avoir des spectacles pour tous les âges de l’enfance et jusqu’à l’adolescence fait que les questions abordées ne sont pas les mêmes.
Le festival a traversé une période difficile financièrement. Où en est-il aujourd’hui ?
Il faut rendre à César ce qui lui appartient : Philippe Schlienger a laissé une situation extrêmement saine avant de partir. Et Thierry Belzung (directeur général du Créa) ainsi que les partenaires (Ville, CEA, État, Région) ont beaucoup travaillé pour que l’arrivée de la nouvelle personne à la tête du festival se fasse dans de bonnes conditions. Le projet a été stabilisé avant mon arrivée, depuis, des financements ont été retrouvés et nous recommençons à faire du soutien à la création pour les compagnies. C’est important, notamment pour les compagnies régionales, puisque plusieurs lieux ont fermé dans le Grand Est. Si le contexte global est incertain pour tout le monde, Momix a pris un nouveau départ et c’est réjouissant.
Vous avez découvert le théâtre au Théâtre du Peuple : que retenez-vous de Bussang que vous souhaiteriez amener à Momix ?
C’est difficile, parce que ce sont quand même deux projets éloignés l’un de l’autre en termes de temporalité, de public, de format. Mais s’il y a une chose que j’aimerais qui les réunisse, c’est la question de l’humanité dans l’art ou de l’art dans l’humanité. Cela renvoie au fameux « Par l’art, pour l’humanité » de Maurice Pottecher (fondateur du Théâtre du Peuple). C’est pour moi une chose qu’on peut aussi appliquer à Momix.
— MOMIX, festival du 30 janvier au 9 février à Kingersheim et dans toute l’Alsace www.momix.org
SCIENCEFRICTION
ÉMILIE CAPLIEZ, CODIRECTRICE DE
LA COMÉDIE DE COLMAR, OSE PÉNÉTRER DANS
LE TERRIFIANT CHÂTEAU DES CARPATHES DE JULES VERNE. UN CONTE (C)HANTÉ, PLANTÉ DANS LA FORÊT TRANSYLVANIENNE.
Après Winsor McCay (Little Nemo ou la vocation de l’aube), Colette (L’Enfant et les Sortilèges), la metteuse en scène gravit un autre monument littéraire, Jules Verne, pour un nouveau conte musical, une partition entre mots et notes. Un voyage extraordinaire où les arts – images, théâtre, musique – se frictionnent, s’articulent et fusionnent. Avec Nemo , Émilie Capliez se jetait dans le vertigineux infini des possibles : « Le rêve n’a pas de limites », affirmet-elle. Ici, la metteuse en scène revisite le roman drapé de noir selon Verne, scientifiquement inspiré et faisant souffler un vent glacé sur la Transylvanie de Dracula. Le célèbre ouvrage éponyme de Bram Stoker sortira d’ailleurs cinq ans après Le Château des Carpathes : il y a déjà du gothique dans l’air en 1892. Les protagonistes de cette sombre fable ? Comme d’habitude chez Émilie, ils évoluent dans

un univers hostile, finalement pas si éloigné du monde actuel : l’envoutante cantatrice La Stilla qui se fait vampiriser par le comte Franz de Télek et son rival le baron Rodolphe de Gortz. Un savant fou, au service de ce dernier, a mis au point un système permettant de ressusciter la danse et la voix de la divine diva. Gortz est propriétaire du « personnage » principal de ce fantastique récit : le château. Libérant une fumée nimbée de mystère, il semble hanté par le fantôme de l’artiste à la voix d’or.
ATMOSFÉÉRIQUE
Au plateau, plusieurs comédiens et comédiennes (parfois membres de la jeune troupe de la Comédie), des musiciens et musiciennes et une chanteuse/actrice. La BO jazzesque est signée
Par Emmanuel Dosda ~ Photo : Simon Gosselin

par la trompettiste Airelle Besson. Toutes et tous baignent dans une ambiance ésotérique créée grâce à un « malin » dispositif scénographique et une astucieuse projection d’images vidéo qui participent à la description, ou plutôt « l’évocation », des lieux (de la terne taverne au faste de l’opéra) et des temporalités. Les changements de décor d’Alban Ho Van – minimalistes sur la forme, maximalistes dans l’effet – accompagnent déplacements et flashbacks. Une technologie au service de la dramaturgie.
SCIENCES & AVENIR
En enquêtrice, Émilie Capliez est allée « à la source » de cette histoire qui la fait « vibrer » : les deux hommes « sont obsédés par la magnétique
héroïne et ils veulent littéralement la posséder. Ici, elle est indépendante et en lutte ! » La metteuse en scène a dépoussiéré le personnage féminin, fruit de l’imagination débridée de Verne, véritable « puits de savoir », très au fait des progrès scientifiques de son époque. Transmetteurs, récepteurs ou cohéreurs. Les avancées techniques pensées par Hertz, Morse ou Branly fascinent Verne et l’inspirent. Il redonne corps à La Stilla grâce à une forme holographique. Le xix e siècle est friand de sciences, d’ectoplasmes, de spiritisme, de machines à remonter le temps. Téléportation imminente en ce Château des Carpathes dont les innombrables pièces, recoins et cachettes secrètes se visitent sur la pointe des pieds.
— LE CHÂTEAU DES CARPATHES, théâtre du 27 février au 8 mars à la Comédie de Colmar, à Colmar, et les 6 et 7 mai à l’Opéra de Dijon, à Dijon comedie-colmar.com opera-dijon.fr
MARIANNE BASLER, LA VIE DEVANT SOI
Par Nathalie Bach-Rontchevsky ~ Photo : Delphine Ghosarossian
AVEC L’ÉVÉNEMENT, MARIANNE BASLER
SE TUTOYER L’IMPLACABLE ÉCRITURE
D’ANNIE ERNAUX ET LA VÉRITÉ DU THÉÂTRE.
C’est un escalier en colimaçon d’où monte une voix de femme. Une voix d’actrice aux harmoniques infinies, mais dont la gravité ne siège pas que dans le timbre. Et puis elle apparait, poignée de main franche et sourire enfantin. Un visage à la beauté définitive. Il y a quelques décennies à peine, c’est du haut d’un escalier dans un plan tourné à Paris que l’on découvrait l’une des plus belles démarches du cinéma français. L’une des plus grandes actrices surtout. C’était elle, Rosa la rose, fille publique, crevant l’écran dans l’étrange et très ambivalent film de Paul Vecchiali. C’était elle dans les Noces barbares, surplombant là aussi le long-métrage de Marion Hänsel. C’est elle, incandescente toujours, poursuivant dans le même temps une carrière mêlant la scène et l’écran. Au Théâtre de l’Atelier et son exquis petit bar qui nous accueille ce jourlà, Marianne Basler est en pays ami. Il est vrai qu’elle vient d’y triompher avec l’adaptation de L’Événement d’Annie Ernaux et s’y produira à nouveau à la rentrée 2025, le temps d’une tournée.
« Vous savez, lance-t-elle, j’oublie souvent que je suis comédienne. » Ce pourrait être une coquetterie, mais elle y reviendra plus tard. Pour l’instant, on y entend sa volonté de ne pas être à ce moment précis dans une sorte de représentation d’elle-même, sans fards à son propre endroit. Dans un rire, elle s’excuse de trop parler, voudrait tout dire à la fois, déplace sa chaise avant de s’installer vraiment. Inconsciemment et quoi qu’elle fasse, elle trouve invariablement la lumière, et dans ce matin de novembre c’est un défi, un mot qui lui va bien.
« C’est un immense bonheur de reprendre L’Événement parce que j’ai eu l’impression d’être sur les genoux après chaque représentation, raconte-t-elle. C’était un poids énorme d’aborder ce texte, de l’adapter, de
trouver la forme qui me paraissait juste. En même temps ça a été assez rapide parce qu’au départ, Rose Berthet (la directrice du Théâtre de l’Atelier) a voulu prendre chez elle L’Autre Fille qu’elle a vu à Avignon, mais j’avais déjà dit oui à un autre théâtre. C’est elle qui m’a dit : “Alors, tu fais L’Événement.” J’avais déjà consacré un certain nombre d’années à L’Autre Fille, je l’ai tellement joué, l’idée d’enchaîner sur un autre monologue, en plus d’un sujet aussi immense, je ne le sentais pas. Mais très vite m’est venue l’idée de faire une lecture publique, ce que j’ai fait à Trouville et là vraiment ça a été un choc. J’ai immédiatement retrouvé le dialogue avec le public. Les gens ne voulaient pas partir, et ça, c’est extraordinaire et épuisant. On met beaucoup de soi dans ce genre d’aventure, ça a été mon cas pour L’Autre Fille . J’ai recommencé avec L’Événement , mais aussi, on apporte aux gens des histoires lourdes. Certains se sont évanouis dans la salle et ce n’est pas dû à moi, mais bien à ce texte. C’est arrivé à d’autres actrices, notamment à Françoise Gillard. Le sujet de l’avortement parle aux femmes, mais aux hommes aussi. Il se trouve qu’au moment où on l’a joué ici, l’IVG (interruption volontaire de grossesse) a été inscrite dans la Constitution avec autour une polémique incroyable qui a libéré la parole et nous a fait découvrir que nous n’étions peut-être pas le monde dans lequel on croyait être. C’est amplifié aujourd’hui par l’élection de Trump et je suis désespérée. Alors oui, je rejoue L’Événement par plaisir, mais aussi par nécessité. J’ai envie de sortir de l’ornière de la caricature en parlant des femmes parce que dès qu’on parle d’avortement on a l’impression qu’on parle de féminisme et qu’en parlant de féminisme, on est caricaturale. Comment peut-on dire que défendre les droits des femmes donc de la moitié de l’humanité est caricatural ? Mais l’élection de Trump, c’est bien plus que la victoire des masculinistes. Olympe de Gouges l’avait mis en avant dans son parallélisme entre sa Déclaration des droits de la femme et sa lutte contre l’esclavage, le racisme et le colonialisme, ce

sont des causes qui se rejoignent. Tout ça nous renvoie tellement loin… ça me renvoie à mon enfance, à ce qu’on se cache à soi-même, quand on découvre pour la première fois qu’on est traité différemment, quand on en prend conscience, parfois très tard. Pour la globalité de ces différences de traitements, il n’y a vraiment que ces dernières années où j’en ai pris réellement conscience. Entre actrices, on se dit, mais qu’est-ce qu’on a vécu ? C’est fou ! Je me souviens du moment où le regard sur moi a changé. On m’a regardé comme une bimbo, une proie, et brusquement comme une adversaire. Je n’ai pas compris tout de suite. Cela s’est passé quand je suis devenue mère, en ce qui me concerne, la maternité m’a rendue plus forte. Quand on a un petit pouvoir, et on en a tous à un moment ou un autre, je veux dire quand on pense, qu’on a une opinion sur ce que l’on va jouer et comment le jouer, c’est être confrontée à des hommes en répétition qui s’expriment comme ils le veulent et me disent à moi que c’est comme ça, et pas autrement. En réalité, j’ai toujours manifesté le désir de dire ce que je pensais et, à un moment, ça a changé. Je ne peux même pas dire que c’est parce que j’avais vieilli, je pense que le regard et le rapport ont changé bien avant que ça ne se voie, d’ailleurs. Simplement parce que j’avais plus d’assurance, plus d’idées et que je commençais à en prendre conscience. L’Événement est un texte nécessaire et je pense que le monde va très très mal. Le droit à l’avortement est le symbole de la liberté de disposer de son corps. Aux États-Unis, dans les cercles masculinistes, ce qui circule c’est Your Body, My Choice. »
Dans Trois guinées paru en 1938, Virginia Woolf écrivait : « Le patriarcat est dans la maison ce que le fascisme est dans le monde. » Il a fallu attendre en France l’année 2000, date de parution de L’Événement chez Gallimard pour que soit relaté de cette manière l’atroce et si banal parcours d’une femme qui désirait recourir à l’avortement, alors puni par la loi. C’est Annie Ernaux (prix Nobel de littérature en 2022), c’est son histoire et celle de tant de femmes. Il lui aura fallu trente-sept années pour y mettre des mots. Elle a 23 ans, c’est en 1963, soit quatre ans avant la légalisation de la pilule et douze ans avant la loi Veil. Un accueil médiatique glacial, même Bernard Pivot ne l’invitera pas sur le plateau d’Apostrophes dont elle est pourtant familière. La loi du silence. Ce qui n’est pas nommable, Annie Ernaux, elle, en brandit crûment les faits, rien que les faits, pointant comme à son habitude leur charge collatérale.
« J’étais rattrapée par le cul et ce qui poussait en moi c’était, d’une certaine manière, l’échec social. » C’est une des phrases clés de L’Événement.
Est-elle encore tout à fait d’actualité ? Je pense que oui, on fait tout pour que la sexualité d’une femme soit honteuse, pour que le fait d’être séduite soit honteux, il y a des hommes « très bien » qui sont encore dans cette vision-là. Moi, j’adorais Kierkegaard quand j’avais vingt ans, mais qu’estce que c’est machiste ! Le Journal d’un séducteur… Il y a quand même une violence inhérente aux rapports hommes-femmes qui est vertigineuse. Je ne suis pas sûre d’être capable d’exprimer les choses à cet instant précis, je ne suis pas sûre de trouver toujours les mots et les réponses, et c’est pour ça que c’est un besoin pour moi d’être là sur scène à dire ce texte, à me cacher presque derrière, à ne pas le surinterpréter, je n’incarne pas un personnage, je transmets un fait, ce qui est difficile. Ce n’était pas le cas dans L’Autre Fille où je mettais de mon histoire. Pour L’Événement, c’est un fait de société, la réflexion appartient au public et c’est peut-être pour ça que s’il le prend si violemment, c’est que c’est lui l’acteur. Dans L’Autre Fille, je m’adresse à la sœur disparue. Dans ma situation, c’était
beaucoup de monde, je m’exprimais avec plein de gens de mon histoire, pour Annie Ernaux, c’était sa sœur. Mais dans L’Événement, je me suis demandé avec qui j’étais. Et je me suis dit que j’étais avec toutes les femmes.
On se dit que lorsqu’il existe une telle alchimie entre un texte et une actrice, c’est qu’il existe un point de jonction si intime qu’il dépasse le cœur même du sujet.
L’écriture d’Annie Ernaux me parle énormément. Je suis du nord, je suis d’un milieu où il n’y avait pas d’acteurs, ma mère avait fait droit, mon père médecine, mon frère polytechnique. La génération d’avant, il y avait beaucoup d’hommes et de femmes politiques socialistes, mon arrière-grand-père s’est battu pour les conditions de travail des mineurs dans le Borinage, donc j’ai un atavisme, un désir social de m’exprimer à travers mon travail sur la défense des droits sociaux. J’ai été plus rattrapée par l’histoire de ma grand-mère écrivain (Marianne Pierson-Piérard) et de mes grands-parents politiciens socialistes que par ma propre famille. J’y viendrai probablement un jour, à ma propre famille, mais pour le moment, je reste attachée à cette histoire. Et puis, dans ma famille, et d’autres personnes d’un certain milieu, j’entendais souvent cette phrase : « Jouer, c’est mentir » et je disais non, jouer, c’est aller vers la vérité. Et Annie Ernaux veut aller vers la vérité, la vérité la plus précise de sa pensée et des faits vécus. Moi, je n’étais que dans cette démarche-là, je cherchais la vérité d’une manière obsessionnelle, probablement parce que le mensonge a été très présent dans mon enfance. Et je suis toujours à me dire, qu’est-ce que je vais découvrir ? Et là, j’ai dû vider pas mal de maisons et je découvre, parfois des choses merveilleuses, parfois pas.
Les Armoires ne sont pas vides…
Oh non, et depuis, beaucoup de choses me sont arrivées. C’est pour ça que je dis souvent que je ne me sens pas vraiment comédienne, peut-être parce que je traverse beaucoup de choses depuis quelques années, notamment depuis la création de L’Autre Fille qui rejoignait une histoire familiale qui était celle de ma mère, dont j’ai appris bien longtemps après sa mort que ma grand-mère Marianne avait eu un fils mort avant la naissance de ma mère. Et j’en ai pris conscience, comme Annie Ernaux qui a dû l’entendre avant d’en prendre conscience. Ne plus être dans le déni. Et ce fils mort a entrainé toute une chute de dominos derrière. Annie Ernaux a dit qu’elle a écrit ce texte parce qu’elle devait le faire et moi je dis que je dois monter ce texte parce que je dois le faire. Cette rencontre avec Annie Ernaux a
été un vrai tournant, de par cette histoire, la mienne, qui m’est tombée dessus et de par son écriture à laquelle d’ailleurs je n’ai pas tout de suite su adhérer. Je l’ai découverte vers l’âge de 25 ans avec La Place et ça ne me parlait pas. Je l’ai relu plus tard et là j’ai tout dévoré, c’était comme des retrouvailles incroyables, elle me prenait par la main, elle m’aidait à vivre.
En 1971, elle refuse pourtant de co-signer le fameux Manifeste des 343 appelant à la légalisation de l’avortement en France au motif qu’à ce moment-là, elle se sentait « n’être rien ». Je l’ignorais. C’était une femme au foyer qui avait intégré qu’elle était d’une classe inférieure, enfin toutes ses croyances qui étaient les siennes, dont elle est sortie et qui lui ont sûrement permis d’écrire toute son œuvre. Moi-même, en tant qu’actrice, j’avais intégré qu’une femme qui fait mon métier doit montrer ses fesses, ses seins. C’était notre place, un passage obligé. On ne peut avoir envie d’en faire une matière à agir que parce qu’on sait qu’on a été à cet endroit-là et il faut du temps, quelquefois beaucoup de temps. Si j’ai eu envie de jouer L’Événement, c’est parce que je sais où j’ai été, comme toutes mes comparses comédiennes. Nous savions très bien que nous avions trois fois, quatre fois moins de chances qu’un homme, à talent égal. C’est une violence sourde qui explose – ou pas, d’ailleurs, puisque pendant des décennies ça n’a pas explosé. Ce sont des femmes très courageuses qui nous l’ont permis, je pense, là tout de suite, bien sûr à Simone Veil, mais aussi à Simone Weil. Quand j’ai commencé à jouer Ernaux en 2017, le public était d’abord composé de vieilles dames. Tout ça a complètement changé parce que pour les gens de vingt ans, Annie Ernaux est devenue une icône. Elle est comme eux, elle y va, elle est cash et ils en ont besoin. On a été tellement formatées… Je pense à certains comédiens… J’ai été tellement formatée, là aussi, pour penser oui, bon il est comme ça… Mon fils m’a ouvert les yeux. Il m’a fait comprendre qu’on ne peut plus parler comme ça ni accepter tout ça. J’ai connu les dérapages, même si je devais maintenir à distance une catégorie de dérapages, mais les dérapages verbaux, le harcèlement, je les ai bien connus, venant majoritairement des hommes, mais aussi de quelques femmes. Ce métier a baigné dans une impunité honteuse.
Ce travail que vous faites avec l’écriture d’Annie Ernaux sur la mémoire ou, plus précisément, sur la réminiscence réveille beaucoup de choses. Évidemment. Même ma mère qui était très avant-gardiste – elle était avocate – avait du mal à travailler. Elle n’avait pas confiance en elle, elle était timide et même si son père était un mec
formidable, il a privilégié le frère et lui a donné le cabinet d’avocat. Ma mère se rongeait. J’entendais ce qu’elle disait, et elle les avait intégrées ces différences. Elle me disait : ton frère doit faire polytechnique, toi c’est moins grave, tu trouveras un bon mari. Finalement, j’ai fait ce que j’ai voulu, on ne m’a pas dit fait ci ou ça, contrairement à mon frère. Il en est mort. D’être projeté dans un avenir qui n’était pas le sien. Il y a aussi pour certains hommes un fardeau très lourd, le masculinisme pèse aussi sur eux.
— On ne peut avoir envie d’en faire une matière à agir que parce qu’on sait qu’on a été à cet endroit-là et il faut du temps, quelquefois beaucoup de temps. —
C’est la seconde fois que vous adaptez un texte, que vous l’interprétez tout en vous mettant en scène. Il semble que de plus en plus vous aimez être le bateau et sa proue, pourtant être seule en scène ne vous est pas étranger.
Oui, c’était l’année de la mort de ma mère…. Jean-Michel Ribes m’avait proposé La Bancale se balance, un texte de Louise Doutreligne sur la libération sexuelle. Il y avait un homme sur scène avec moi, mais qui ne parlait pas. C’était aussi, je crois, l’année de mon divorce et je l’ai vécu comme une sorte d’exutoire. Je voulais me dépasser, faire quelque chose de provocant, montrer une liberté. Ça a été très bien monté par Antonio Arena et très mal pris par certains journalistes qui trouvaient ça vulgaire, ça parlait du sexe de la femme [ elle rit]. Et après, on m’a demandé de participer à un festival à la Collégiale de Grignan pour lire la Correspondance de Marie-Antoinette. J’avais adoré la biographie qu’en avait faite Stefan Zweig. Et puis on m’a demandé de le reprendre et j’ai très mal vécu cette idée parce que je me suis rendu compte qu’il y avait tout un monde, les amis de Marie-Antoinette… Mais, moi, la royauté, je m’en fous ! Le personnage de Marie-Antoinette est passionnant, c’est un destin extraordinaire, mais ce que j’avais envie de raconter, ce n’était pas ça.
Est-ce qu’il y a des choses que vous ne referiez pas ?
Oui. Des films. Il y a un film de Philippe de Broca où j’ai tout fait pour qu’on m’en évince. C’était terriblement archétypal et pourtant, à cette époque, tout le monde voulait tourner avec lui.
Certaines scènes dans Rosa la rose ?
C’est un film d’un magnifique cinéaste, qui m’a appris beaucoup et en même temps un homme très éloigné de moi. C’est vrai, qu’aujourd’hui, je me battrais plus, même si Rosa la rose est très soft. Par rapport à d’autres comédiennes, je pense à Catherine Wilkening, à Valérie Kaprisky, j’ai été très préservée et je ne regrette pas d’avoir tourné Rosa. Je regrette certains films par leur vulgarité morale, la bêtise. Comment certains hommes pourtant intelligents peuvent-ils avoir un regard aussi plat sur les rapports hommes-femmes ? C’est pour moi une grande douleur, je n’ai pas toujours su tirer mon épingle du jeu. Et il faut ajouter : que ce soit par des hommes ou des femmes, les comédiennes sont toujours plus durement traitées que les comédiens.
Depuis, il y a eu les prix, les distinctions, les nominations aux Molières, mais en 1987, après avoir obtenu le prix du meilleur espoir féminin pour Rosa la rose, dans quel état étiez-vous ?
Dans une grande inquiétude. J’ai lu le livre de Dominique Blanc, elle est extraordinaire, d’une grande honnêteté. Elle a commencé sa carrière très fort et puis plus rien. Dépression, internement.. Mais pour elle, tout plutôt que se résoudre à faire des choses médiocres. J’ai eu la chance d’avoir toujours été très résiliente et très forte même si à l’intérieur je me fissurais, mais chez Dominique, ce qu’elle traversait était insoupçonnable. Moi je voulais jouer, je voulais faire ce métier, rencontrer des gens, mais j’étais bien entourée. J’ai eu deux maris magnifiques, j’ai créé une belle famille d’amis et une famille personnelle.
Vous avez une fidélité avec les gens avec lesquels vous travaillez, qui est réciproque.
J’ai adoré travailler avec Jacques Lassalle. Je sais que c’est un homme qui a été très dur avec certaines personnes et que ce n’est pas admissible, je ne l’exonère pas, mais ça a été une rencontre professionnelle. Nous avons fait une dizaine de pièces ensemble et il m’a beaucoup apporté, notamment avec Monsieur X, dit ici Pierre Rabier de Marguerite Duras. Il m’a donné une liberté, et je ne suis pas la seule. Je ne me vante pas, je constate. Il me disait peu de choses, mais qui me faisaient avancer, et lui n’a pas eu de rapport misogyne avec moi. Comment l’expliquer, c’est comme ça. De la
même façon, j’ai adoré tourner les neuf films avec Vecchiali tout en étant hermétique à certaines choses de son monde, surtout dans Rosa qui parle quand même de la dépendance d’une femme visà-vis des hommes et qui en meurt ! Annie Ernaux, c’est une grande aventure, une chance magnifique d’avoir pu porter à la scène son œuvre, c’est arrivé au bon moment, c’est la plus grande aventure de ma vie d’actrice. C’est une femme très généreuse, qui me faisait un peu peur au début, elle est tellement positive, elle a su transformer tout ce qui lui est arrivé pour le donner. Même si je ne mets pas tous mes pas dans les siens, elle est essentielle. Et de savoir que d’autres femmes se reconnaissent entre elles, parlent d’elle, essaient de prendre le relais de cette parole et de la transformer en action, comme Ernaux le fait, c’est un soulagement. Je ne sais pas ce que ça va produire comme effet, mais j’ai envie de continuer.
Les révolutions sont fragiles. Nietzschéenne à sa façon, Annie Ernaux ne cesse par ses romans de s’emparer de la vie à bras-le-corps. Dans la forme, on est loin de Beckett qui tendait à vouloir forer le langage pour laisser apparaitre des choses à voir et à entendre. Loin de Duras pour qui écrire était de raconter l’histoire, mais aussi l’absence d’histoire. C’est vrai, la sublimation n’est pas son affaire, Annie Ernaux, le langage, elle le crève. Ses détracteurs lui reprochent de revenir inlassablement sur son passé et de tenir une écriture narcissique. C’est peut-être vrai aussi. Quand les récits dits autobiographiques explosent en France, il reste cette méfiance, cette peur à leur égard qui passe par un mépris de classe si on veut prendre cette brèche, on pense bien sûr à Édouard Louis. Et si ce n’est pas une misogynie foncière contre l’une, il est facile de s’attaquer à l’homosexualité de l’autre. Simone de Beauvoir nous l’a assez répété, les droits des femmes et des minorités resteront une bataille. Sur scène, Marianne Basler redonne de sa vigueur au terme de performance, si souvent galvaudé. Dans un total corps-à-corps avec l’écriture-scalpel d’Annie Ernaux semble émerger de la comédienne la frêle silhouette de l’écrivain, son visage, ses cheveux, faisant éclore chaque mot jusqu’à l’os du sens. Et à cette dernière question, à savoir si l’écriture du réel d’Annie Ernaux fait pour autant littérature, elle répond, le regard droit : « Elle en est la preuve. Les personnes qui ont lu Annie Ernaux disent toutes la même chose, qu’elle les aide à vivre. Si ce n’est pas de la littérature… »
— L’ÉVÉNEMENT, théâtre le 27 février au Carreau, à Forbach, et le 4 mars à l’auditorium de La Louvière, à Épinal www.carreau-forbach.com
Hommages
Tandis que La Fabrique et Louis Ucciani ont pour mission la transmission des savoirs et Alice Zeniter celle d’interroger l’éthique de la littérature, Olivier Haralambon, Aude Ziegelmeyer et Martine Delvaux explorent les frontières entre corps, œuvre et traces.

DÉMONTER LES BOBARDS
Par Nicolas Querci ~ Photo : Delphine Ghosarossian
DEPUIS PLUS DE 25 ANS, LA FABRIQUE
PUBLIE DES LIVRES QUI ONT POUR VOCATION DE SE RETROUVER EN TÊTE DE CORTÈGE PLUTÔT QU’EN TÊTE DE
GONDOLE. RENCONTRE AVEC STELLA
MAGLIANI-BELKACEM ET JEAN MORISOT, À QUI ERIC HAZAN A PRIS SOIN DE TRANSMETTRE LA MAISON QU’IL A FONDÉE.
Lorsqu’il monte La Fabrique en 1998, Eric Hazan a déjà derrière lui une vie bien remplie. Né en 1936 dans une famille juive, il se tourne d’abord vers la chirurgie cardiaque, et développe dans le même temps une forte conscience politique qui se traduit par des engagements en faveur de l’indépendance de l’Algérie, de la cause palestinienne ou du droit à l’avortement. En 1983, il quitte son poste de chirurgien pour reprendre les éditions Hazan, fondées par son père en 1946, qui publient des livres d’art. En 1992, il revend la maison à Hachette pour éviter le dépôt de bilan, avant d’en partir en 1997, pour fonder avec l’aide de quelques amis La Fabrique, un nom qui correspond bien à sa conception de l’édition comme un artisanat.
La Fabrique publiera des livres de sciences humaines et de critique sociale couvrant tout le spectre de la gauche radicale. À l’époque de sa création, elle fait partie avec Raisons d’Agir et Agone des petites maisons qui au milieu des années 1990 participent au renouveau de l’édition politique. D’autres boutiques verront le jour, comme Amsterdam et Libertalia, ou récemment Anamosa et Divergences. Ces différentes structures ont grandement contribué à faire bouger les lignes sur des sujets comme le féminisme ou l’écologie, auxquels s’intéressent désormais les mastodontes de l’édition.
Le catalogue de La Fabrique se construit au gré des rencontres que fait l’éditeur. Celle de Jacques Rancière d’abord, qui lui confie Aux bords du politique , le premier titre publié par la maison, avec Le Corps de l’ennemi d’Alain Brossat, à l’automne 1998. Celle d’André Schiffrin, qu’il encourage à écrire un texte dénonçant les effets de la concentration dans le monde du livre, L’Édition sans éditeurs, paru en 1999 et très soutenu par les libraires. Celles de l’intellectuel palestinien Edward Said, dont il publie en 1999 Israël-Palestine, l’égalité ou rien , et de la journaliste israélienne Amira Hass, dont le livre Boire la mer à Gaza , paru en 2001, connaît un grand succès, qui ont initié une série d’ouvrages apportant un éclairage nouveau sur la question palestinienne. La Fabrique publie aussi des classiques révolutionnaires et des livres d’histoire. D’autres lignes se dessinent chemin faisant, autour des féminismes, de l’antiracisme, de l’écologie, de l’éducation, de la politique, qui se recoupent entre elles et tendent vers la subversion de l’ordre établi. Le sentiment d’unité du catalogue






Le design des couvertures, le logo, la maquette intérieure ont été créés par Jérôme Saint-Loubert Bié et n’ont pas changé depuis la création de La Fabrique. Les seules choses qui changent sont les couleurs du fond et des cartouches. De temps en temps, certains livres ont une illustration de couverture. L’unité de l’ensemble rend les ouvrages immédiatement identifiables.
tient aussi aux couvertures colorées immédiatement reconnaissables, une identité graphique créée par Jérôme Saint-Loubert Bié, qui n’a pas changé depuis le début.
Ce qui ne change pas non plus, c’est la volonté de publier des textes qui ne se contentent pas de dresser un état des lieux, mais qui fournissent des bases théoriques aux luttes existantes et qui apportent des pistes. Avec une prédilection pour les sujets qui divisent au sein même de la gauche, comme le voile et l’islam (Les filles voilées parlent, 2008), ou les limites de l’action non violente face au réchauffement climatique dans Comment saboter un pipeline, d’Andreas Malm.
Cet ouvrage, cité en 2023 dans le décret de dissolution des Soulèvements de la Terre, laquelle sera finalement annulée, n’est pas le premier à retenir l’attention des autorités françaises. En 2009, Eric Hazan est entendu par la police dans le cadre de l’affaire de Tarnac pour avoir publié L’insurrection qui vient du Comité invisible, derrière lequel se « cacherait » Julien Coupat, accusé d’être à la tête d’un groupe de saboteurs… L’affaire tourne au fiasco judiciaire, mais le livre, publié en 2007, se vendra grâce à ce coup de pub involontaire à plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires, ce qui fera dire à Eric Hazan : « On n’a pas tous les jours la chance d’avoir une attachée de presse du talent de Michèle Alliot-Marie ! » Convaincu que le maintien de son indépendance passe par une petite structure économiquement solide, Eric Hazan n’a jamais cherché à publier plus d’une douzaine de titres par an ou à quitter les locaux situés dans le quartier de Belleville. Préparant la relève, il s’est entouré de Stella MaglianiBelkacem et Jean Morisot, avec qui il formait depuis une quinzaine d’années un trio dans lequel la voix de chacun avait le même poids. C’est à eux qu’il a transmis la maison. Eric Hazan s’est éteint le 6 juin 2024, à l’âge de 87 ans, sans avoir vu le grand soulèvement auquel il aspirait. Aujourd’hui, La Fabrique poursuit son œuvre avec le même esprit de révolte.
Comment avez-vous rencontré Eric Hazan et rejoint La Fabrique ?
Stella Magliani-Belkacem : Je viens des luttes antiracistes radicales nées dans les années 2000, à l’époque des pseudo-débats contre le voile à l’école, des révoltes des quartiers populaires et de la proposition de loi sur le « rôle positif » de la colonisation française. Un antiracisme plus politique, contre l’islamophobie, contre les violences policières, et dont les premiers acteurs sont des Noirs et des Arabes. Je viens de ces franges-là. Puis, en 2007-2008, quand Brice Hortefeux décide de créer un prix de l’intégration, j’écris un texte qui s’érige contre ce prix et que je fais signer par différentes personnes ayant un profil de « bon intégré », dont le rappeur Hamé, de La Rumeur. Le texte a dû paraître dans Politis et La Revue internationale des livres et des idées. Pour me remercier, Hamé m’invite à l’écoute de son prochain album. Il invite aussi Eric Hazan qui doit avoir un peu plus de 70 ans… Eric, à peine arrivé, lui lance : « Ah ! ce texte-là, je n’en aurais pas changé une ligne ! » Hamé lui dit que c’est moi qui l’ai écrit. Eric me propose alors de passer quelques jours après à La Fabrique. À ce moment-là, j’ai dû lire À travers les murs d’Eyal Weizman, un peu de Rancière, quelques trucs. Quand j’arrive à La Fabrique, il y a Eric, ainsi que Valérie Kubiak et Stéphane Passadéos, qui travaillent avec lui. Ils me posent des questions… Ce que je ne saisis pas, c’est que c’est un entretien d’embauche ! Parce qu’Eric ne me demande pas ce que j’ai fait comme boulot ou comme études. On parle des livres et des luttes du moment. Après cela, il me demande de passer chez lui le dimanche soir. Dimanche soir ? Un vieux monsieur ? J’y vais un peu en traînant les pieds. À peine arrivée chez lui, il me fait asseoir et me demande si je veux un verre d’eau, ce qui me met en confiance. Alors je jacasse… Il m’arrête et me dit : « Bon, Stéphane t’a trouvée comme ça [la main vers le bas]. Moi, comme ça [la main vers le haut]. Et moi je me dis que… » Je crois que j’ai mis des années à comprendre ce qu’il a vu. Parce qu’à l’époque, je ne sais rien faire. J’ai été en littérature comparée parce que les filles arabes qui étaient de bonnes élèves allaient en littérature, et les garçons en écogestion. Aujourd’hui, je comprends mieux ce qui lui a plu : mon intérêt pour les luttes, pour la chose théorique… Voilà comment j’arrive à La Fabrique. Ensuite, Eric m’a appris le métier en étant assis à côté de moi sur un petit tabouret. Peu après, Jean arrive en stage, avec beaucoup de qualités que je n’ai pas. Entre-temps, on a connu un succès avec L’insurrection qui vient – grâce au « travail » de Michèle Alliot-Marie. La maison ne se porte pas trop mal et on a vraiment envie qu’il reste.
Jean Morisot : Je suis arrivé en stage en 2011, à la fin d’un master des métiers de l’édition. Avant cela, j’avais fait des études d’histoire. Je connaissais un peu le catalogue. J’avais aussi une expérience dans le syndicalisme étudiant. J’arrive à un moment où La Fabrique a la capacité de payer des salariés – Stella ayant été la première salariée, moi le deuxième.
À quel moment la reprise s’est-elle dessinée ?
S. M.-B. : Très tôt. Et en même temps, ça s’est fait très lentement, par étapes. Quand je rencontre Eric, il a plus de 70 ans, il se pose sérieusement la question de la suite. Il a envie que La Fabrique perdure après lui, et perdure dans de bonnes conditions. Il y a eu tout un processus avant qu’on devienne cogérants, en 2017. Ça ne consistait pas juste à nous transmettre des parts. Eric avait aussi la volonté de nous apprendre le métier, sur tous les plans possibles. Il nous a aussi appris à être décisionnaires. Il a fait en sorte qu’il y ait une passation avec les auteurs et les libraires. Et puis un jour, au cours d’un repas, il nous lâche : « Vous voyez, là, on est en 2017. En 2019, je ne propose plus rien… » Bien sûr, ça ne s’est pas passé comme ça. Il a continué de proposer des projets, tout en nous disant : « Cette maison, c’est vous, on ne va pas attendre que je casse ma pipe pour que vous apportiez les titres. »
J. M. : C’était une grosse responsabilité de reprendre La Fabrique, mais on ne s’en est rendu compte que plus tard. Notamment quand il est décédé. Il y a eu beaucoup de témoignages d’auteurs, de gens pour qui les livres de La Fabrique avaient transformé leur vision des choses. C’était assez vertigineux ! Mais tout a été fait pour que ça se passe bien, ce qui n’est pas toujours le cas lors des transmissions. Transmettre une maison indépendante, c’est transmettre la structure économique et la gérance, mais aussi le catalogue et le savoir-faire. Il nous a transmis tous ces éléments. Il tenait aussi depuis le début à ce que l’entreprise ne soit pas endettée.
Comment se forment les projets de livres ? Ce sont des commandes – c’est-à-dire, vous proposez à quelqu’un d’écrire sur un sujet ? Ou bien ce sont les auteurs qui vous les soumettent ?
S. M.-B. : Il y a plusieurs façons de procéder. Avoir un thème mais pas d’auteur, en général c’est une catastrophe. Il vaut mieux avoir quelqu’un et réfléchir à ce qu’on va faire ensemble. Il nous arrive de réfléchir pendant des années à un sujet de livre, jusqu’à trouver la bonne personne pour le faire – le livre sur Sciences Po, celui sur Kollontaï… Mais le plus souvent, ce n’est pas la meilleure méthode.
Une bonne méthode, en tout cas la nôtre, c’est de rencontrer beaucoup de gens. Et puis, nous sommes aussi des lecteurs. Les libraires sont une excellente source de conseils. Et quand quelqu’un écrit un article de revue intéressant, mène une lutte, on fait en sorte de se rencontrer. Pas forcément pour signer tout de suite. Mais pour s’informer, avancer doucement. Entre le moment où on rencontre quelqu’un à La Fabrique et celui où on fait un livre, il peut se passer deux ans, souvent plus.
J. M. : Parfois, il y a des textes qui arrivent par la poste et qui coïncident avec une envie que l’on a depuis longtemps. C’est le cas du livre sur les écrits socialistes du poète, artiste et décorateur William Morris, pour la plupart inédits. C’est le traducteur qui nous les a envoyés. On a façonné les choses avec lui, ajouté une postface… Et puis, un catalogue de 260 titres s’alimente aussi tout seul. On échange avec les auteurs pour avancer sur d’autres projets, ou pour voir s’ils connaissent des personnes qui travaillent sur d’autres sujets.
S. M.-B. : On pourrait regarder les prochains titres. Pour la Palestine comme pour la Terre est un livre d’Andreas Malm, un auteur emblématique du catalogue. On fait en sorte de mener une discussion et d’être au courant de ses travaux. La doctrine du consentement, de Clara Serra, c’est un éditeur espagnol qui me l’a apporté, qui n’est même pas son éditeur, parce que nous avons une relation privilégiée. Jean-Christophe Bailly, qui a écrit La ville en éclats, est un ami d’Eric, il a collaboré avec lui aux éditions Hazan et a publié à La Fabrique. Et si je reviens sur les titres qui ont paru récemment… Contre l’antisémitisme et ses instrumentalisations est un ouvrage collectif, un livre de commande autour d’un thème auquel on demande à plusieurs figures de répondre. Pour Mayotte, c’est l’auteur qui nous a écrit. Il avait publié chez un autre éditeur un très bon livre sur l’intervention militaire française au Sahel, passé un peu inaperçu. Il est venu à La Fabrique parce qu’il avait envie que son livre sur Mayotte vive en librairie. Une histoire de l’imprimerie, c’est une envie très ancienne d’Eric. On a toqué à plusieurs portes, et c’est finalement Stéphanie Grégoire, qui était là à la fondation de la maison, qui a trouvé l’auteur. Au loin la liberté, Jacques Rancière, le premier auteur de La Fabrique, nous l’a envoyé au moment où il l’a fini – il ne nous parle jamais de projets de livres –, alors qu’il aurait pu le donner au Seuil. Le culte de l’auteur, c’est Kristin Ross, une de nos autrices, qui suggère à Geneviève Sellier de venir nous voir avec son manuscrit. Le nettoyage ethnique de la Palestine d’Ilan Pappé, un auteur de La Fabrique, est à l’origine un livre que Fayard a arrêté de commercialiser en novembre 2023, après les attaques du 7-Octobre, alors qu’il se vend mieux que jamais. On l’a repris et on l’a recommercialisé en mai 2024, pour la cause, avec un peu de toupet. Au final, on en a déjà vendu 18 000 exemplaires. C’est notre meilleure vente de l’année.
Dans Pour aboutir à un livre, Eric Hazan écrit : « Le principal critère pour choisir un texte ou passer commande d’un sujet, c’est son caractère offensif. » C’est toujours le cas ?
S. M.-B. : D’abord, et c’est le cas pour tous les livres de La Fabrique, il ne faut pas qu’un texte se contente de décrire une situation, ou de dénoncer le joug sous lequel on ploie. Il faut qu’il sache dessiner des perspectives émancipatrices. Certains secteurs de la pensée contemporaine sont saisis de manière opportuniste par le monde éditorial, comme l’écologie ou le féminisme. C’est finalement très consensuel : qui se dirait aujourd’hui contre le féminisme, ou contre la préservation de la nature ? A priori, pas les gens qui entrent dans une librairie. Nous, plutôt que de participer à cette inflation éditoriale, nous allons choisir des livres qui se situent sur des points de fracture, qui divisent au sein du camp progressiste. C’est le
cas avec celui de Clara Serra sur le consentement, ou celui d’Elsa Deck Marsault sur les violences sexistes, mais aussi avec Comment saboter un pipeline d’Andreas Malm, qui fait le point sur les échecs et les apories du mouvement écologiste.
J. M. : C’est quelque chose qui a toujours aiguillé les choix de la maison. Même pour les livres d’histoire. Quand Eric a publié des livres sur l’insurrection ouvrière de Juin 1848, c’est parce que ces événements, au cours desquels la bourgeoisie a montré son véritable visage en tirant sur les ouvriers, contredisaient le roman national existant. Pareil pour la Commune, même si on en parlait un peu plus.
La rigueur intellectuelle est-elle compatible avec la pratique militante ?
S. M.-B. : Cette pratique-là est souvent d’une grande rigueur ! Si on s’intéresse aux livres écrits par des militants – dans notre catalogue, la littérature antiraciste et féministe –, on comprend que les auteurs comme les lecteurs écrivent et lisent ces livres pour se doter d’arguments, pour étayer ce qu’ils racontent. Si on achète des livres féministes, c’est aussi pour avoir des arguments lorsqu’on se retrouve dans le coin du ring, au repas de famille. Les militants antiracistes qui ont publié à La Fabrique ont dû, au tournant des années 2000, lire toute une littérature anglo-saxonne ni traduite ni investie par les milieux académiques qui ne connaissaient rien du marxisme noir ou des cultural studies. Pareil pour le féminisme. Ces domaines-là, ce sont les luttes radicales qui ont obligé l’université à s’en saisir.
J. M. : Nous publions des essais. Et le principe, c’est de donner son opinion sans forcément s’embarrasser de certaines précautions que l’on prend dans l’écriture académique, qui d’ailleurs ne relèvent pas toujours de la rigueur. Évidemment, cela n’autorise pas tout, et quand on reçoit des projets, on regarde ce qui se publie, les bibliographies auxquelles les auteurs se réfèrent… Nous sommes garants de ça. Mais les auteurs, en général, le font d’eux-mêmes.
Comment se passe le travail éditorial ? Vous intervenez beaucoup sur les textes ?
S. M.-B. : Ça dépend des auteurs. Quand on reçoit Au loin la liberté de Jacques Rancière, il n’y a pas grand-chose à faire. Il y a d’autres auteurs pour qui c’est le premier livre. Dans ce cas-là, on les accompagne dans la construction et dans l’écriture du livre.
J. M. : Nos auteurs ont des idées à défendre. Il y en a pour qui la pratique de l’écriture vient très facilement, d’autres pour qui c’est plus
compliqué. Notamment les gens qui sont passés par l’université, ce qui est le cas d’un certain nombre d’auteurs. On leur demande tout un tas de choses dans l’écriture académique, comme les annonces de plan, la manière de citer, etc., qui entravent la lecture et dont il faut se défaire. Et en général, ils ne sont lus que par des pairs. Nous, on leur demande de tenir la main du lecteur et de l’amener à faire siennes ses hypothèses. Il y a aussi l’évolution des sciences humaines à l’université, qui amène les chercheurs à être de grands spécialistes d’un tout petit sujet, ce qui fait qu’ils ont un peu de mal à avoir une perspective élargie de leur domaine, ou à puiser dans d’autres domaines. Ça aussi, ça affaiblit l’écriture. Quand on écrit un livre qui vise un plus grand public, il faut prendre de la hauteur, du recul, et mobiliser des pensées qui viennent d’ailleurs.
Est-ce que vous faites relire certains textes par un avocat ?
S. M.-B. : Nous travaillons avec des avocats spécialisés dans le droit de la presse. En 2010, nous avons publié Boycott, désinvestissement, sanctions. BDS contre l’apartheid et l’occupation de la Palestine au moment où Alliot-Marie émettait une circulaire interdisant l’appel au boycott. Nous l’avons fait relire par un avocat qui nous a conseillé d’ajouter une petite phrase au début du livre. On fait relire certains livres sur la police, sur l’antiracisme. La plupart du temps, c’est aussi pour que l’avocat sache ce qui risque de lui tomber dessus.
J. M. : Les éditeurs sont soumis aux lois qui régissent la liberté d’expression. J’imagine que, la plupart du temps, ils font relire leurs textes pour éviter les poursuites en diffamation. Les questions qui se posent à La Fabrique sont plutôt celles qui concernent l’appareil législatif servant à poursuivre des opinions. En ce moment, c’est la loi sur l’apologie du terrorisme. Aujourd’hui, dire que la résistance palestinienne est légitime, c’est risquer des poursuites. C’est ce qui fait qu’on a parfois besoin du conseil d’un avocat, comme pour le livre d’Andreas Malm, Pour la Palestine comme pour la Terre. Dans lequel on a d’ailleurs laissé le mot « résistance ».
Est-ce qu’il y a des sujets qui vous valent plus d’ennuis ou d’inimitiés que d’autres ?
S. M.-B. : Ça dépend des périodes ! En ce moment, tout ce qui touche à la Palestine. Avant, c’était l’écoterrorisme. Et il y a des périodes où ça se focalise sur Houria Bouteldja.
J. M. : Moi, j’ai plutôt l’impression que les livres de La Fabrique nous valent beaucoup d’amitiés. On sait qu’il y a des gens qui ne sont pas d’accord avec les idées de nos auteurs, mais on les entend





déjà assez… Nos livres font aussi venir beaucoup d’autres auteurs vers nous. Et il y a les libraires qui défendent nos livres. Des inimitiés, donc, quelquesunes. Mais surtout beaucoup d’amitiés.
Comment définissez-vous votre programme de parutions ? En fonction des thèmes ? De l’actualité ?
J. M. : On ne se pose pas la question du thème, même s’il vaut mieux éviter que deux livres se marchent sur les pieds. Le programme est défini en fonction de l’état d’avancement des projets, tout simplement.
S. M.-B. : Les auteurs sont souvent plus pressés qu’il ne le faut. Alors que ce n’est pas grave si un livre sort un peu plus tard, ou pas exactement au point culminant du débat sur un sujet. Quand on a acquis les droits de La doctrine du consentement de Clara Serra, début 2023, on ne pouvait pas savoir l’ampleur que prendrait l’affaire Pelicot. Le livre arrive au bon moment.
L’équilibre entre des titres supposés plus ou moins « vendeurs » entre aussi en compte ?
J. M. : Le fonds de La Fabrique – plus de 200 titres toujours disponibles – permet de publier des livres sans être trop obsédé par leur rentabilité immédiate. Le fonds représente à peu près la moitié de notre chiffre d’affaires, sauf les années où des nouveautés se vendent très bien.
S. M.-B. : Ça, c’est aussi le fruit du travail de la librairie et de son attachement au catalogue. Et c’est aussi le fruit du travail de Belles Lettres Diffusion Distribution. Le fonds a été extrêmement bien entretenu par les représentants commerciaux.
Comparés à d’autres, les livres de La Fabrique sont assez peu chers.
S. M.-B. : Quand on fait nos courses, on se rend bien compte que tout devient plus cher. Et ce n’est pas en augmentant le prix des livres que les gens vont les acheter. D’ailleurs, je pense que certains livres à La Fabrique ont été particulièrement achetés parce qu’ils n’étaient pas chers. Un livre féministe, on veut que les gens puissent l’acheter,


écologie, révolutions, féminisme, Proche-Orient…
donc on ne va pas fixer un prix trop élevé. Ou un livre d’Houria Bouteldja, qui sera lu par des Noirs et des Arabes appartenant aux classes défavorisées de ce pays, on ne va pas le faire trop cher. À l’inverse, un livre d’histoire qui ne va peut-être pas coûter si cher que ça à produire, on peut légèrement augmenter son prix sans que ce soit un frein pour les gens qui vont l’acheter.
J. M. : La traduction impacte aussi le prix de vente. Après, au niveau de la fabrication, nous n’avons jamais été attachés à un papier spécifique, par exemple. Ce qui aide sûrement à ce que la hausse du prix du papier n’ait pas eu trop d’impact sur le prix de nos livres.
La Fabrique semble avoir la cote auprès des libraires. Comment l’expliquez-vous ?
S. M.-B. : La Fabrique bénéficie de l’amour des libraires qui défendent notre catalogue depuis plus de 25 ans. C’est d’abord parce qu’Eric a créé une relation particulière avec eux. C’est aussi parce qu’on a conscience de ce qu’on leur doit. Dès qu’on va quelque part ou qu’on part en weekend, on s’arrête dans des librairies pour discuter. On s’évertue aussi à faire savoir aux libraires qu’ils peuvent nous contacter s’ils ont besoin d’un service de presse ou s’ils veulent organiser une rencontre avec un auteur. Nous, on paye au moins le transport et on insiste auprès des auteurs pour qu’ils acceptent de participer à des rencontres. Enfin, deux fois par an – une fois à Paris, une fois en région – on organise un
Antiracisme,
Les grandes lignes du catalogue sont apparues au fil des ans. Certains titres ont connu un grand succès en librairie (L’Édition sans éditeurs, Boire la mer à Gaza, Un féminisme décolonial, Le partage du sensible, etc.). D’autres ont suscité la polémique. Mais tous ont vocation à nourrir le débat.

petit déjeuner libraires durant lequel les auteurs viennent présenter leur ouvrage.
J. M. : La librairie, c’est là où la vie du livre commence. Quand un livre paraît, on a fait notre part du travail, et ce sont les libraires qui font le reste. La librairie indépendante représente 80 % du chiffre d’affaires de la maison. C’est le maillon essentiel.
Est-ce qu’il y a aujourd’hui une nouvelle génération de libraires plus sensible aux sujets que vous portez ?
S. M.-B. : Je vais faire de la sociologie de comptoir. À l’époque où je faisais mes études, un certain nombre de mes camarades se dirigeaient vers les métiers de l’Éducation nationale. Ces dernières années, avec les différentes réformes, le gel du point d’indice, le dénigrement permanent des fonctionnaires de l’Éducation nationale, j’ai l’impression que bon nombre des diplômés de gauche se détournent de ce secteur. J’ai le sentiment qu’une partie d’entre eux se tourne vers la librairie, où l’on a une génération très diplômée, avec le cœur du bon côté. Ces gens-là défendent très facilement notre catalogue et celui de nos confrères.
J. M. : Depuis quelques années, on observe aussi une sorte de boom des sciences humaines et des livres critiques au sens large – parfois avec un certain opportunisme –, avec des livres sur le féminisme, l’écologie, l’économie, etc., qui tirent le secteur. Les espaces consacrés à ces livres ont grandi, avec des tables de sciences humaines.
S. M.-B. : Quand j’ai commencé ce métier, on avait l’impression qu’une librairie indépendante
fermait par semaine. Depuis le Covid, il y a 600 librairies indépendantes qui ont ouvert en France. C’est prodigieux ! Ce qui a aussi beaucoup changé depuis mes débuts à La Fabrique, ce sont les rencontres en librairie. Pas seulement le fait qu’il y ait plus de rencontres autour des sciences humaines, mais aussi qu’elles drainent plus de monde. Quand j’ai commencé, on était contents si on avait dix personnes à une rencontre. Aujourd’hui, on arrive facilement à 30, parfois à une centaine, avec des gens qui ne peuvent pas entrer dans la librairie. Les libraires jouent un rôle extrêmement important dans le débat d’idées, qui autrefois était peut-être tenu par les partis politiques ou l’université.
La presse ne joue plus ce rôle ?
S. M.-B. : Dans la presse, il n’y a pratiquement plus de grand espace de recension. À part Le Monde des livres, qui est loin d’être favorable aux idées de La Fabrique ou à celles qui ne font pas consensus. Une recension, c’est faire part de la publication d’un livre ou de plusieurs, et c’est l’occasion de dresser un portrait intellectuel, la cartographie d’un champ, ou de montrer des lignes de fracture. Ces espaces-là se réduisent à peau de chagrin.
J. M. : La presse a été beaucoup plus touchée que l’édition non par la concentration, mais par les effets de la concentration. Il est clair qu’un écart s’est creusé entre ces deux mondes.
S. M.-B. : On défend tous les livres auprès de la presse. Pour certains, on a parfois recours aux services d’un attaché de presse. Ce qui sert aussi à rassurer l’auteur, qui a l’impression que l’on parle de son livre. De notre point de vue, ce n’est pas la presse qui fait vendre des livres. Il y a moins de médias très prescripteurs comme avant. Certains livres ont bénéficié d’une couverture presse hors du commun et ne se sont pas particulièrement bien vendus. D’autres n’ont eu aucun écho et se sont très bien vendus, grâce aux libraires, comme Un féminisme décolonial, de Françoise Vergès.
Quels rapports entretenez-vous avec les autres acteurs de l’édition critique ?
S. M.-B. : On n’est pas très mondains… Par contre, dès qu’on est sollicités par d’autres éditeurs indépendants, on ouvre grand la porte, on n’est pas avares en conseils ou en contacts. On y trouve notre compte : plus il y a de maisons qui nous ressemblent, plus on occupe de place en librairie, et mieux on se porte. Mais ça ne se limite pas aux éditeurs français. À La Fabrique, nous avons des rapports très forts avec des éditeurs étrangers. J’échange presque tous les jours avec l’éditeur de Verso Books. Je parle très régulièrement à des
Eric Hazan, le fondateur de La Fabrique. © La Fabrique/Hannah Assouline
camarades espagnols. J’ai une amitié profonde avec une éditrice italienne. Il y a une forme de camaraderie qui s’instaure, notamment lors des foires auxquelles on participe, à Francfort, à Londres.
J. M. : À part pour la place en librairie, on a la chance de ne pas être en concurrence directe avec les autres éditeurs qui nous ressemblent, puisque nos livres sont différents. Ça simplifie les relations. On se rencontre lors de salons, et puis nous avons souvent les mêmes diffuseurs-distributeurs. Donc on est amenés à se croiser, à échanger sur le métier. Maintenant, c’est vrai qu’il n’y a pas non plus de grand rassemblement pour essayer de peser davantage face à la grande édition industrielle, qui a récemment pris un tour plus réactionnaire. L’écart avec les grosses maisons s’est accentué, et la faculté de peser au niveau institutionnel s’est réduite.
Vous parliez des foires internationales. Vous vendez beaucoup de droits à l’étranger ?
J. M. : Les cessions de droits représentent environ 7-8 % du chiffre d’affaires. Ce qui est assez conséquent. Le fait est que certains livres de La Fabrique, du fait de leur sujet, présentent un intérêt pour des pays étrangers. Ils sont traduits, ils sont visibles, et ça, c’est très positif.
S. M.-B. : Même des livres qui pourraient paraître très franco-français, sur l’antiracisme, notamment, comme Rester barbare de Louisa Yousfi, vendu en neuf langues. Un livre de Jacques Rancière peut être vendu entre 10 et 16 langues. Les auteurs savent que nous menons un travail important sur les droits étrangers qu’ils ne trouvent pas dans les grandes maisons qui s’occupent de 160 auteurs en même temps. Et puis, quand on arrive à la foire de Francfort, les éditeurs que l’on rencontre savent qu’on connaît leur catalogue, qu’on va leur montrer des livres qui leur correspondent. Il y a certes des livres plus faciles à vendre à l’étranger parce qu’ils ont une portée internationale. Mais quand même, il y a des livres à mon avis très franco-français qui se vendent parce que c’est La Fabrique qui les porte.
En avril 2023, Ernest Moret, votre responsable des droits étrangers, s’est fait arrêter à la gare de Londres, où il se rendait à la Foire du livre. Comment avez-vous réagi ?
S. M.-B. : J’étais avec lui à ce moment-là, donc je l’ai appris de manière directe ! Ce qui a fait que très vite, il a eu un avocat, avant même d’entrer en garde à vue. Les policiers étaient venus à la gare avec sa photo entre les mains et lui ont dit : « Alors, vous avez vexé le gouvernement français ? » Sauf qu’ils ne se rendent pas compte qu’ils arrêtent un éditeur ! Moi, sur le moment, dans le feu de l’action,
je retrouve mes réflexes. Je passe plein de coups de fil, j’engueule les flics pour pouvoir garder quelques-unes de ses affaires. Et puis je travaille avec Jean qui est à Paris, et des éditeurs à Londres pour que paraisse immédiatement une tribune d’éditeurs internationaux dénonçant cette arrestation, pour qu’il y ait des rassemblements à Londres et à Paris, pour mobiliser la presse. Tout ça se passe vite. À La Fabrique, on a déjà traversé quelques tempêtes. Rarement des arrestations, même si, pendant l’affaire Tarnac, on a quand même eu droit à un spectacle compliqué. Mais nous avons l’habitude de nous défendre.
Vous vous êtes sentis soutenus par le milieu de l’édition, la presse et l’opinion ?
S. M.-B. : Les soutiens, d’abord, on s’en assure nous. C’est nous qui avons écrit les appels et qui les avons fait signer. Mais on s’est sentis soutenus, oui. Il faut savoir que la législation antiterroriste britannique est une des pires au monde. En France, on ne peut pas arrêter quelqu’un dans la rue comme ça et extraire le contenu de son ordinateur et de son téléphone. Une fois qu’ils ont placé Ernest en garde à vue, les policiers découvrent qu’il travaille pour une maison d’édition. Ils lui posent des questions sur ladite maison, doutant même de son existence. Mais quand ils s’aperçoivent que dehors, ça s’agite – parce que ça a aussi fait du bruit en Grande-Bretagne, où même la presse conservatrice était outrée par cette arrestation… Tout cette agitation a poussé un rapporteur indépendant à se saisir des conditions d’arrestation d’Ernest, ce qui a fait que la Met s’est excusée publiquement et qu’il a reçu une compensation financière.
En juin 2023, vous avez publié une tribune dénonçant « les nouvelles formes de censure, d’atteintes aux libertés et de mesures d’intimidation qui pèsent sur les maisons d’édition ». Qu’entendiez-vous par là ?
S. M.-B. : Cela faisait suite au décret de dissolution des Soulèvements de la Terre pris par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. Cette dissolution a depuis été annulée, mais dans la première phrase du décret, il cite comme le grand gourou de tout ça Andreas Malm et son livre Comment saboter un pipeline. C’est en réaction à ce décret qu’on a fait paraître une tribune, ainsi qu’une tribune des éditeurs étrangers qui ont traduit ce livre et qui disent qu’ils n’ont pas eu droit au même maccarthysme dans leur pays… Et puis il y a aussi eu une tribune d’Andreas Malm dans Le Monde pour répondre à Darmanin.
Est-ce qu’il est plus difficile de publier des essais critiques dans le contexte actuel ?
S. M.-B. : En 2023, La Fabrique a réalisé son meilleur chiffre d’affaires, et 2024 est aussi une excellente année. Nos livres se vendent de plus en plus et de mieux en mieux, donc c’est compliqué de dire que c’est plus dur.
J. M. : Ce n’est pas forcément plus difficile, mais il y a un réel durcissement. Ce n’est pas la liberté d’expression qui est en jeu, c’est l’expression de certaines positions. C’est compliqué d’attaquer un livre. Par contre, on peut se servir d’un livre pour attaquer ses lecteurs. Sur la Palestine, par exemple. Avec la législation sur l’apologie du terrorisme, on fabrique des dangereux terroristes partout. Les écologistes aussi ont été attaqués là-dessus. Si ça ne rend pas la publication des livres plus difficile, les militants qui s’emparent de ces combats sont réprimés plus facilement.
lafabrique.fr
ALICE ZENITER ÉCRITURE ÉTHIQUE
Par Caroline Châtelet ~ Photos : Renaud Monfourny
RENCONTRE AVEC ALICE ZENITER, DONT LE TRAVAIL
SE SAISIT TOUJOURS DE RÉFLEXIONS AUSSI STIMULANTES
QUE POLITIQUES.
Lorsqu’on évoque Alice Zeniter, c’est souvent et d’abord par l’écriture, qu’il s’agisse de romans –dont L’Art de perdre , récompensé en 2017 par le prix Goncourt des lycéens et celui du Monde – ou d’essais – citons Toute une moitié du monde (2022) qui scrute certains biais (voire, impensés) patriarcaux de la littérature. Mais l’écrivaine est aussi cinéaste, dramaturge, metteuse en scène. Cet automne 2024, Alice Zeniter a enchaîné les actualités : outre la co-écriture avec Alice Carré de Petite Casbah, dessin animé abordant la guerre d’Algérie ; outre, encore, la publication de Frapper l’épopée (chez Flammarion), roman passionnant permettant d’approcher l’histoire coloniale de la NouvelleCalédonie, l’autrice et metteuse en scène a monté un nouveau spectacle. Dans Édène, elle s’inspire du roman Martin Eden de Jack London pour raconter l’ascension littéraire d’une jeune femme noire et pauvre. L’occasion à travers ce portrait de transfuge de classe d’interroger la littérature, son éthique, et de scruter la violence du fonctionnement du champ littéraire – comme des rapports de classe. Autour de l’écriture, de ce qu’elle projette comme de ce qu’on y projette, rencontre avec Alice Zeniter.
Pourquoi n’avez-vous pas souhaité directement adapter Martin Eden ?
Martin Eden est l’un de mes romans préférés, mais comment l’adapter sans déplacer le propos, que faire de ce qui a vieilli ? Comment éviter le « folklore charmant » face à la représentation de la lutte des classes en sépia ? Ce risque que les gens ne voient plus la lutte mais uniquement le sépia me faisait un peu peur. Comment faire, également,
avec la question du sexisme de Jack London ? Ayant envie qu’Édène soit une autrice, que faire du fait que ce roman se déroule dans un monde pensé par London, pour qui il est évident que la création est un acte masculin. Créer relève d’une puissance d’imagination, d’invention et de travail, et cette puissance-là équivaut à la force virile. Il y avait un peu de tout cela… Je commençais à réfléchir à ce projet quand une amie qui galérait pour trouver du travail m’a dit qu’elle envisageait d’aller travailler à la blanchisserie de l’abattoir. Cette idée de la blanchisserie s’est mêlée avec ce vieux rêve de Martin Eden. Je me suis dit que j’allais moi-même y travailler et écrire une version d’aujourd’hui du roman.
Pourquoi cette expérience de travail ?
Voulant représenter ce travail sur scène, il fallait que je sache ce qu’il fait dans l’espace et le corps. Du coup, beaucoup de choses ressemblent à ce que j’ai expérimenté – même si je ne recherche pas absolument le réalisme. D’ailleurs, il y a souvent des débats de spectateur·rices à la sortie sur : estce stylisé, réaliste ? Mais c’est un travail qui ne ressemble pas non plus à une chaîne de montage en usine. Quand Édène arrive, toutes lui disent « Ici, tu crois que c’est peinard », car ce travail n’a pas les apparences de la pénibilité – alors qu’il fait 40 degrés, qu’il y a un taux d’humidité de 90 % et douze tonnes de linge mouillé à déplacer par semaine. Tout cela, c’est très pénible…
Vous évoquez les retours de spectateur·rices. Il se joue parfois dans ces réceptions un procès de véracité intenté à l’auteur·rice…

Absolument. Le rapport à une œuvre de fiction fonctionne sur la suspension de notre incrédulité, sur le fait d’accepter que dans le monde créé par un·e auteur·rice, les choses se passent de telle façon. Cette acceptation n’est que conditionnelle et ces conditions proviennent des préjugés personnels, des lectures du monde, des pensées qu’on a sur l’auteur·rice. Typiquement, certaines personnes sont persuadées que je ne peux pas savoir ce qu’est le monde du travail – parce que je suis écrivaine et de gauche – et que je vais forcément rater la représentation de ce monde. À cela, je réponds
non. Qu’il s’agisse de la représentation d’une blanchisserie ou de la coutume chez les Kanaks, je travaille. C’est mon devoir d’autrice de veiller à cela et je trouverais absolument irrespectueux de raconter n’importe comment un univers auquel je n’appartiens pas. Cette question du « je n’y crois pas » peut s’appliquer aux techniques narratives de la fiction, quand on parle de littérature – et uniquement de cela. Ce qui m’inquiète un peu dans toute cette ère de post-vérité, c’est que le « je n’y crois pas » est en train de déborder. Par exemple, pour la rentrée littéraire, une journaliste a déclaré
—
À aucun moment je n’ai souhaité que le livre participe d’une crise politique précise.
Je veux qu’il soit une rencontre entre ce territoire et des gens qui ne le connaissent pas. —
au sujet de Frapper l’épopée ne pas croire du tout à cette histoire d’Algériens déportés en NouvelleCalédonie. Deux mille cent six hommes ont été envoyés au bagne là-bas ! Ce n’est pas possible de dire cela. On peut me dire que je raconte mal leur histoire, que le roman est mal écrit, mais dire que cette histoire n’est pas crédible déplace le domaine de la croyance sur des faits, et cette confusion me fait très peur.
Édène est traversé de beaucoup de questions sur la littérature, notamment sur une éthique de l’auteur·rice…
C’est une question qui m’intéresse énormément et à laquelle je n’ai pas de réponses. À la Comédie de Valence, une rencontre a eu lieu avec Tristan Garcia [écrivain et philosophe] sur le thème « vivre pour écrire ». Nous y avons parlé d’écriture, de la place que ça occupe, des formes que ça prend et nous avons évoqué le fait qu’existent deux pôles opposés. D’un côté, il y a Toni Morrison, selon qui il faut faire de la fiction et que de la fiction. De l’autre, il y a Emmanuel Carrère qui, au milieu d’un livre sur sa mère (Un roman russe), révèle que celleci ne veut pas qu’il fasse ce livre – le livre étant pour lui plus important que l’opinion de sa mère. Je crois que ces deux pôles n’existent jamais dans leur forme pure, qu’aucune des deux positions n’est tenable. Disant cela, Toni Morrison est-elle certaine de n’avoir jamais aspiré quelque chose de la vie de personnes pour les intégrer dans ses livres sans leur opinion ? Et pour autant, peut-on considérer la littérature comme un passe-droit sur tout en considérant qu’à la fin l’art en sorte grandi ? Si je penche plus du côté de Toni Morrison, je sais que j’utilise des choses qui appartiennent aux vies des autres. Mon garde-fou, c’est de prévenir, de dire que je suis écrivaine et en train d’écrire. Cela me paraît un guide pratique pour ne pas faire trop de mal, ne
pas croire que tout est permis. Mais je n’ai pas une immense admiration pour la figure de l’artiste. Si j’aime beaucoup les œuvres, je suis très peu dans la fétichisation et je considère qu’à aucun moment le statut d’artiste ne dégage des autres conventions sociales. Après, c’est aussi du cas par cas. Être écrit, parlé par quelqu’un peut être une violence absolue, mais peut, aussi, être un hommage, une plaisanterie partagée, un jeu commun…
Édène critique, aussi, l’instrumentalisation de l’écrivain · e : lorsqu’iel atteint une certaine notoriété, peu importe ce qu’iel écrit – iel sera sollicité·e pour des questions (politiques, sociales) n’ayant rien à voir avec le champ littéraire…
Pour Édène, au départ, il y a quelque chose de l’ordre d’une croyance : l’amour de la littérature, des beaux textes, serait partagé par toutes les personnes appartenant au champ littéraire. Elle découvre progressivement qu’il y a des systèmes de positions dans ce champ social. Ces positions font que certaines personnes sont des faiseuses de rois et que ça n’a pas vraiment de rapport avec les textes. Des personnes qui refusent plusieurs fois ses écrits la recontactent lorsqu’elle a du succès – la qualité n’ayant plus d’importance. Elle se pose aussi des questions sur le geste d’écrire : est-ce espionner ? Est-ce que publier, c’est vendre des secrets qui ne sont pas les siens ? À qui s’adresse-t-elle ? Des personnes – non concernées par le monde sur lequel elle écrit – viennent lui dire qu’elle a rendu une dignité à ces travailleuses, qu’elle leur a donné une voix. Mais elle est en permanence hantée par la question d’avoir fait une représentation de ces femmes les dépossédant. À partir du moment où on transforme des récits de la pauvreté en poèmes, ce ne sont plus vraiment des récits de la pauvreté ou de la précarité – ce qui n’empêche pas que ce puisse être des textes géniaux (comme, par exemple, chez John Fante où les pauvres sont des voyous-artistes sublimes qui s’enfuient par la fenêtre arrière pour ne pas payer le proprio, écrivent quand même, draguent la serveuse, etc.).
L’idée de l’adresse est-elle centrale dans votre travail d’écriture ?
L’une des questions que j’ai en tête, c’est pourquoi certains pans de telle ou telle vie ne sont-ils jamais racontés ? Est-ce parce que cela ne marche pas avec nos formes traditionnelles de récit ? Ou estce parce que les personnes qui écrivent venant majoritairement de certains milieux, ce sont des choses qu’elles n’ont jamais traversées ? Tristan Garcia évoquait le fait que la littérature étant majoritairement écrite par des bourgeois·es, jusqu’à récemment les scènes de cuisine comprennent la
domestique qui cuisine. Comme Jean-Paul Sartre ne s’est jamais fait une escalope milanaise, il ne peut pas raconter ça. Je m’interroge sur l’absence de certains pans de vies et je tente de les rendre visibles, sans complaisance. Une autre question qui peut me travailler est la passion pour les récits de conflits, les « Nous sommes en guerre » qu’on retrouve dans les discours politiques. Comment fait-on pour raconter des luttes qui ne se racontent pas d’ennemis à ennemis (personne n’a prévu de casser la gueule du réchauffement climatique) ? Que fait-on de cela ?
Pour Patrick Chiha, réaliser un film répond à un besoin de se coltiner une énigme. Et l’écriture pour vous ?
Pour moi, cela tient du vertige qui me saisit devant quelque chose. Pour reprendre les paroles de Toni Morrison, l’écriture me permet de mettre en ordre le chaos du monde. Je peux avoir plein d’autres rapports au monde par ailleurs, mais c’est celui-là ma colonne vertébrale. Généralement, avant de commencer un livre, je passe du temps à me renseigner sur un sujet. Si en faisant des recherches celles-ci m’apportent une réponse claire, je n’écris pas dessus. Si le vertige continue, je sais qu’il faut que j’écrive. Il faut que je trébuche sur quelque chose pour me rattraper par l’écriture.
Dans Frapper l’épopée, est-ce la découverte de la déportation d’Algériens en Nouvelle-Calédonie qui vous a fait trébucher ?
Oui. Je savais théoriquement que dans l’histoire de l’empire français, il y avait eu une colonie pénitentiaire. Mais je n’y avais jamais vraiment pensé en termes d’événement. Quand j’essaie de me représenter le fait que des personnes décident de déposséder une population de son archipel – qui est un paradis – pour faire une colonie pénitentiaire de remplacement, je trébuche, je perds pied. Je commence à me renseigner sur l’idéologie derrière la colonisation pénitentiaire – puisqu’à ce moment-là, l’Angleterre fait la même chose en Australie. Comment sont pensés l’enfermement, la transportation, la déportation, la relégation, etc. Qu’est-ce que cet étrange ballet colonial où l’on arrête des personnes en Algérie pour les envoyer purger une peine à 18 000 kilomètres. Et comment on permet à ces Algériens – qui sont la partie basse de la hiérarchie raciale du système colonial –d’évoluer dans ladite hiérarchie une fois à l’autre bout du monde, s’ils oppriment les Kanaks.
Vous avez terminé votre roman avant les révoltes du printemps en Nouvelle-Calédonie. Comment avez-vous traversé cette période ?

Le traitement médiatique de ce soulèvement était vraiment un cas d’école. Lorsqu’il éclate, la plupart des rédactions s’aperçoivent qu’elles n’ont personne qui connaît le sujet. Cet archipel à l’autre bout du monde censé être français, personne n’a aucune idée d’où il se situe. Sur les plateaux, on raconte des histoires dans la précipitation, les journalistes confondent les différentes communautés – c’est difficile de réaliser que pour une fois que l’on parle de ce territoire, on entend plein d’erreurs. Et il y a aussi cette chose très violente : le temps médiatique et la forme de la plupart des entretiens ne peuvent pas accueillir la parole kanake. Dans la pratique solennelle de la parole chez les Kanaks, il est courant de baisser le volume de sa voix et de ralentir le débit. Ce qui en fait les pires clients possibles sur les plateaux télé. Donc les seules fois où on passe la parole aux concerné·es, on leur coupe la parole juste après. Quand arrive ce moment-là, je me retrouve dans une situation de porte-parolat que je ne veux absolument pas. À aucun moment je n’ai souhaité que le livre participe d’une crise politique précise. Je veux qu’il soit une rencontre entre ce territoire et des gens qui ne le connaissent pas. Il y a deux semaines encore, on m’a demandé si je pensais qu’il y avait une possibilité que la Kanaky obtienne son indépendance sans que la Chine obtienne un contrôle économique et commercial. Mais je suis écrivaine ! Et le gouvernement chinois m’appelle assez peu pour me faire part de ses projets…
— FRAPPER L’ÉPOPÉE, Alice Zeniter, Flammarion
UN PHILOSOPHE À NEW YORK
EN 2004, LOUIS UCCIANI VIT QUELQUES
MOIS À NEW YORK AUX CÔTÉS DE L’ARTISTE BARBARA PUTHOMME, ALORS EN RÉSIDENCE. LE PHILOSOPHE
FRÉQUENTE LE SALON DOMINICAL DE LOUISE BOURGEOIS, OÙ IL PUISE LE
DÉSIR D’ÉCRIRE LE PREMIER CHAPITRE
DES ESSAIS D’ESTHÉTIQUES NEWYORKAISES, CLÔTURÉS VINGT ANS PLUS TARD À L’OCCASION D’UN NOUVEAU
VOYAGE OUTRE-ATLANTIQUE.
Vous partez toujours de situations qui deviennent autant de phénomènes à penser, comment s’opère ce passage ? J’ai le sentiment que la question est aussi formelle, on passe au sein de chaque chapitre, de la narration à la conceptualisation, presque de la littérature à la philosophie. D’ailleurs, tous les chapitres ont leur autonomie, comme quelque chose qui s’égrène, mais progresse. Est-ce que vous aviez des modèles en tête pour produire cette forme ?
Oui, effectivement, s’il s’agissait de proposer quelques arrêts sur images, quelques réflexions sur des rencontres artistiques, je ne tenais pas à restituer
cela sous la forme d’un simple recueil d’articles. Le contexte était à engager comme partie prenante à ce qui naissait de théorie. Toute monumentalité pousse sur le terrain du simple et pourrait l’étouffer, or ce que je pense comme philosophie veut engager les contrastes. Le simple est condition du monumental. Pas de Platon sans doute sans Antiphon, ou sous une autre forme, les « platons » naissent des « antiphons ». Ce qui signifie, pour ce qui nous concernait ici, que Louise Bourgeois, la prêtresse, Soulages le conquérant, et Serra le maître des lieux, sont d’un monde et que ce monde ne se résume pas à eux, ils sont ce qu’ils sont de ce qu’il y a de ce monde. Et dans ce monde le petit est grand d’eux. C’est dans ce partage que là où vous voyez « littérature », je place la contextualisation qui est grande d’eux, mais aussi qui les interroge comme en négatif. Alors y avait-il des modèles, oui bien sûr, tout dans ce domaine est déjà, et bien, balisé. Deux grands livres néanmoins ; quelque chose, qui dans un champ autre que le politique, donc celui de l’esthétique, aurait eu à voir avec Tocqueville, et puis bien sûr, que l’achèvement se situe 20 ans après, ne pouvait que me renvoyer à Alexandre Dumas et aux mousquetaires vieillis. Il fallait restituer comment en ces quatre lustres, débutant après l’épisode tragique du World Trade Center, resurgit une bouillonnante activité qui s’autorisait des modèles anciens, enfin du siècle achevé, et aboutissait à une morne ballade.
Vous écrivez : « L’esthétique est alors ce quelque chose qui est plutôt que le rien. » On pense à la formule de Leibniz, qui, dans mon souvenir, renvoyait plutôt à la métaphysique. Comment opérez-vous ce basculement ? Si l’être a toujours une forme, est-ce que cela explique votre lien à la psychogéographie de Debord ou à la géophilosophie de Deleuze ?
Oui, l’époque vit de l’effacement, de l’apparaître fugitif, de la sempiternelle naissance des formes et de leur irrémédiable dissolution jusqu’à l’effacement. L’esthétique apparaît comme l’instance de résistance à la logique de l’ Erase , de l’effacement, elle est la forme des formes, elle en est la présence « éternelle », de cette éternité « humaine », qui en fait son horizon. Alors évidemment, oui, tout ça confine au métaphysique, à ce qui nous délimite, cette naissance que l’on porte et cette mort qui nous attend : entre ces deuxlà, eh bien !... Plus que les illusions des vérités, des lois et des morales, je choisis celles du paraître, de son apparaître et de son maintien. Alors oui,
Par Florence Andoka ~ Photo : Renaud Monfourny

tout cela conduit à repenser l’être au monde, l’être à sa présence, dira le métaphysicien, c’est ce qui donne naissance à ces investigations, référencées à Debord, à Deleuze, dont un des modèles littéraires pourrait bien être le Sur la route de Kerouac. La ville n’est que par ceux qui l’habitent, certes, mais elle est aussi ce qui fait et trame ces vies. Ces psychogéographies ou géophilosophies, ce que Debord théorisait comme dérives, en reviennent à être des récupérations de ce que le spectacle s’approprie en en faisant sa chose. Elles sont l’axe de la résistance à la logique de l’effacement.
Yoko Ono, Louise Bourgeois, Patti Smith, Richard Serra, William Burroughs, John Giorno, Bob Dylan, etc. Il y a comme un paysage qui se dessine, composé d’artistes célébrés depuis bien longtemps. Leurs œuvres, leurs vies, sont devenues comme des mythes et donc une matière collective à penser, à rêver. Mais vous utilisez cette expression latine : quaerens quem devoret, cherchant quelqu’un à dévorer . Pourquoi, voyez-vous dans cet intérêt collectif sans doute nécrophage de l’époque, outre un souci généalogique, quelque chose d’un devenir idiot ?
Le chercher quoi bouffer, brutal en français est plus énigmatique en latin. Ici c’est pris à Lacan et cela réfère à la problématique suscitée autour
de l’œuvre de Louise Bourgeois, mais effectivement, cela dit quelque chose de l’ensemble du propos. On peut y voir les démêlés du conflit des images dans le vaste ensemble de l’esthétique, et ce que cela entraîne de jaillissements. Tous ces noms issus de la veine poétique de la Beat Generation participent de la recomposition du monde de l’image après la Seconde Guerre mondiale. Cela fonctionne comme un non à l’empire naissant de l’image et comme une réappropriation de la fonction image. En quelque sorte pour éviter d’être dévoré par l’image, il nous faudrait la dévorer. C’est d’avoir été portée par cette intelligence-là que cette culture s’est développée. Mais le non à l’image s’il devient lui-même image est perdu pour la négation, il ne devient que l’aliment de l’image. C’est sur quoi s’arrête ce que je peux appeler mon enquête. Au sortir du Chelsea Hôtel, qui vient d’être restauré, je rapporte ce que je vois de la grande exposition Cattelan, l’épisode de la banane achetée à coups de millions ne viendra que plus tard, tout comme l’élection de Trump. Mais ce n’est pas de ce que cela clôt le livre que ce qu’il livre est désespérément condamné. Le devenir idiot, c’est le constat de Taylor Swift qui semble avoir la lucidité de comprendre que perdue dans le monde des images, elle est perdue à elle-même. Pour nous dans un monde devenu idiot, seule l’intelligence, c’est-à-dire la compréhension de ce monde, permet de penser et agir son renversement.
— ESSAIS D’ESTHÉTIQUES
NEW-YORKAISES, Louis Ucciani, Presses du réel
Voir aussi chez le même éditeur :
Avant-Garde et contre culture, Louis Ucciani, Charles Dreyfus, Antigone Moutchouris

ANATOMIE D’UNE CHUTE
Par Nicolas Bézard ~ Photo : Delphine Ghosarossian
PENSEUR AU REGARD VIF ET AU VERBE AFFÛTÉ,
OLIVIER HARALAMBON POURSUIT SON EXPLORATION
INTIME DU CORPS MIS À L’ÉPREUVE DANS UN CORPS
D’HOMME, PUBLIÉ AUX ÉDITIONS PREMIER PARALLÈLE.
Coureur de haut niveau dans les années 90, Olivier Haralambon a continué d’enfourcher son vélo en marge de son activité d’écrivain et de philosophe jusqu’à cette grave chute survenue en 2019 dans la roue du champion cycliste Romain Bardet. Si ce dernier apparaît sans être directement nommé dans le livre, c’est bien de l’expérience de la déchéance physique et de la nécessaire reconfiguration du corps après 50 ans qu’Haralambon nous parle, en éclaireur au physique meurtri mais à la prose immaculée.
Avec Un corps d’homme, vous approfondissez votre travail sur une écriture que l’on pourrait qualifier d’anatomique, en ceci qu’elle part de l’ossature pour mieux dépeindre et raconter le corps.
Un ami avec qui je courais à l’époque est devenu ostéopathe. L’hiver, quand on s’entraînait ensemble, il avait une fâcheuse tendance à commenter ma posture sur le vélo, décelant ici un blocage, là un déséquilibre. Cela avait le don de m’exaspérer, mais il faut croire que j’ai repris à mon compte cette façon de regarder la démarche des gens, de voir où se situent les nœuds, les endroits où ça coince, avec cette idée qu’un corps porte les stigmates de son vécu non seulement sur son épiderme, mais aussi dans la manière dont il bouge.
Dans un passage mémorable du livre, vous décrivez sans surplomb la faune bigarrée d’un bar PMU où vous avez vos habitudes, en faisant parler les os, les articulations, la façon dont les corps s’ajustent à cet environnement. Dans un autre passage, vous sous-entendez que c’est par l’ossature que pourrait advenir, dans certaines circonstances, le désamour de l’être aimé. Quand on commence à bien connaître les gens, on les voit sans doute plus en profondeur. Et en effet, l’enveloppe désirable de la personne aimée peut se mettre à transpirer soudain autre chose, qui transparaît dans la façon de se mouvoir, dans le rapport du corps à l’espace. Ce qui m’a frappé dans mes histoires d’amour et de désamour, c’est par exemple le fait d’avoir pu adorer la manière qu’une femme avait de manger, de mastiquer les aliments, de déglutir, puis finir un jour par ne plus supporter ce spectacle. Ce qui m’intéresse au fond, ce sont les micro-gestes. La façon dont la posture s’adosse à l’esprit. La façon de se tenir debout ou de poser ses doigts sur un instrument à cordes. La manière dont, après qu’on lui ait cassé les dents, Chet Baker a dû apprendre à placer différemment sa langue dans sa bouche pour sortir un son de sa trompette. Tout ça, c’est déjà du rapport à l’espace. Non pas cet espace dans lequel le corps objectif se déplace, mais celui que le corps propre fait exister.
Peut-on appeler ça le style ?
Je n’y avais pas songé mais oui, on pourrait.
Par style, j’entends la projection visible de l’âme d’un sujet. Je pense au corps des grands solistes en musique ou à celui des champions cyclistes dont semble émaner, lorsqu’ils sont perçus dans l’instant où ils jouent au mieux leur partition, une vérité profonde.
Avec l’omniprésence des neurosciences, il y a maintenant cette idée que le cerveau serait le producteur de notre pensée. Or, pour moi, c’est le corps qui sécrète du style. Le corps est moins une substance qu’un état. Il est produit parce que l’on pense, et pas l’inverse. Pour le style des coureurs, c’est sans doute assez vrai. Il y a dans le style de Romain Bardet une tentative désespérée de mise à jour. Le style de Tadej Pogačar est assez inhabité. Celui de Remco Evenepoel, au contraire, est particulièrement intense – on le sent très présent à ce qu’il fait. Quant à Bardet, il y a chez lui de l’application mais aussi une forme d’absence, comme s’il ne se sentait pas entier dans la course cycliste, comme s’il lui fallait prouver qu’il n’est pas que ça – un champion, un corps pédalant. Du reste, en dehors du vélo, il a à cœur de montrer son érudition et sa conscience des enjeux qui agitent notre monde. Cette attirance pour la chose intellectuelle semble le désajuster à sa seule posture de coureur.
L’ombre de Romain Bardet plane sur l’ensemble du texte, telle une figure de Némésis. Vous lui consacriez déjà un chapitre dans Mes coureurs imaginaires . J’ai le sentiment que ce n’est pas un hasard si c’est encore lui, et pas un autre coureur, qui se retrouve involontairement lié à cette chute qui marquera pour vous le début d’un questionnement existentiel.
Ce n’est certainement pas un hasard, vous avez raison. Cette forme d’inquiétude ou de malaise que je sens chez lui me parle beaucoup. Cette inquiétude, c’est l’idée que le vélo vous tiendrait éloigné d’un certain nombre de choses. En conduisant de front des études supérieures et une grande carrière de cycliste, il s’est engagé sur une voie qu’il ne m’était pas possible d’emprunter à la période où je faisais du vélo. De mon temps, l’engagement dans la vie de coureur était vécu comme un renoncement quasi monacal. Lui n’a pas renoncé à ses études, et il incarne à mes yeux une époque dont je me suis toujours demandé si elle ne m’aurait pas été plus favorable.
N’incarne-t-il pas aussi pour vous, qui l’avez côtoyé de près et avez pédalé avec lui, quelque chose de l’ordre d’une émotion esthétique ?
Bardet n’est pas le coureur dont on va spontanément louer la beauté. Nous n’avons pas affaire au plus grand styliste du peloton. Il a ce côté échassier, avec ce je-ne-sais-quoi de presque aviaire
dans la maigreur du cou. Il paraît un peu déplumé mais en effet, lorsque vous êtes en sa présence et que vous roulez à ses côtés, vous ne pouvez qu’être frappé par la densité de son corps, la puissance et la solidité qui en émanent. Cette ambivalence visuelle m’intrigue. On n’est pas loin d’une aberration esthétique, d’une faute de goût, et pourtant c’est extrêmement beau à voir.
Votre regard sur Bardet est un peu celui du peintre devant son modèle. Cette obsession de la peinture qui revient toujours dans vos textes, irrigue votre écriture, alimente votre pensée. On la retrouve à plusieurs endroits d’Un corps d’homme , avec des renvois à Titien ou au Caravage. D’où vous vient cette fascination pour le pictural ?
Je suis un être lent et tardif. J’ai entamé des études de philosophie à 37 ans. Plus tard encore, je me suis intéressé à l’histoire de l’art. Ces deux disciplines m’ont offert la formule de choses qui me préoccupaient depuis longtemps. Dans la peinture, j’ai retrouvé ce qui m’avait particulièrement marqué chez Merleau-Ponty. Cette idée que la vision est le résultat d’une opération de la pensée, qui met de l’ordre dans le chaos, qui donne forme à un regard. Ce sont des choses qui m’intéressent beaucoup, et en même temps, la peinture a une présence charnelle, corporelle. Il y a l’empâtement des tableaux. Il y a la coulure. Il y a la question de la représentation en peinture et celle de la présentation de la peinture pour elle-même. Cette question se pose aussi pour les corps et leur présence. Les corps sont des images dans notre champ visuel, et il arrive parfois qu’ils se montrent pour ce qu’ils sont, comme la peinture se donne également à voir en tant que matière, épaisseur. Une chose qui m’a fasciné à la lecture des ouvrages de Merleau-Ponty, c’est de réaliser que les lignes n’existent pas dans la nature. L’histoire de la peinture est ainsi truffée d’artistes qui dans l’évolution de leur style ont accordé de moins en moins d’importance à la ligne, à la délimitation des figures par le trait. Et en effet, plus vous vous approchez d’un corps, et plus vous constatez l’inexistence d’un contour qui le séparerait nettement du reste du monde.
Le livre met en lumière ce qui apparaît après coup comme une évidence mais que nous n’ignorons que trop : la chute est une action consubstantielle à notre être. Nous passons notre vie à nous installer dans la chute. Cette dernière définit notre bipédie, qui n’a d’ailleurs rien d’évident, car elle requiert une biomécanique de la marche très complexe. Pourrait-on dire, pour paraphraser paresseusement Descartes : je chute donc je suis ?
Je n’irai pas jusque-là mais marcher, cela s’apprend. Nous naissons tous avec des fémurs droits comme ceux des chimpanzés, et c’est la
pratique de la marche qui au fil du temps stimule plus fortement la croissance de la face interne du fémur en oblique, nous donnant l’équilibre nécessaire pour tenir debout. Apprendre à marcher est culturel. Les enfants dits « sauvages », privés de vie relationnelle, développent un squelette qui n’est pas compatible avec la marche. Ensuite, rien de moins évident que la marche dans le sens où elle contredit une tendance naturelle que nous aurions de rester allonger, plutôt que de nous échiner à rester en équilibre sur une si petite – et donc inconfortable – surface d’appui. Maine de Biran l’a bien perçu : nous vérifions notre existence dans l’effort, c’est-à-dire dans la tension qui existe entre une intention que nous projetons et quelque chose qui lui résiste. Or la marche est précisément cela, cette tension, cette injonction à produire un effort pour pouvoir avancer.
À l’image d’une douloureuse épiphanie, la chute vous a contraint à envisager autrement la relation que vous aviez avec votre corps. Vers la fin du livre, vous plaidez néanmoins pour une révélation douce, qui ne serait pas induite par un traumatisme.
Derrière l’idée d’épiphanie, il y a celle de soudaineté, et je me dis qu’il existe sans doute des façons moins brutales de vivre une révélation. Pourquoi pas, par exemple, en étant plus attentif à notre manière de traverser le temps. D’ailleurs, qu’est-ce que la chute ? Est-ce qu’on peut cesser de chuter ? Nous sommes des êtres chutant par nature. On n’a de cesse de chuter dans le temps. Peut-être pourrait-on développer une qualité d’attention à cette déchéance, pour charger ce terme plutôt négatif d’une aura positive. Et peut-être qu’il y a des révélations qui se font très doucement, très lentement. On dit souvent que la vieillesse est quelque chose qui nous tombe dessus soudainement, qu’on ne l’avait pas vu venir. C’est vrai, mais n’estil pas dommageable de ne pas nous voir vieillir ? Parce que ce serait un moyen de « positiver », même si je n’aime pas ce terme, l’avancée dans l’âge. Bien sûr qu’on perd beaucoup de choses en vieillissant – des capacités, de la puissance musculaire – mais en même temps je me sens tellement mieux aujourd’hui qu’à 20 ans, tellement plus fort, plus riche, plus épais, plus consistant.
L’oubli est « plus qu’un décharnement de la mémoire », c’est « une révélation de sa chair la plus vive », dites-vous. Cette idée très proustienne m’a fait penser à une phrase que l’on prête à Jean Renoir : « Les seules choses importantes dans la vie sont celles dont on se souvient. »
On revient à cette histoire du langage et de la distance qu’il met entre nous et les choses dès lors que nous en faisons l’acquisition. Mais la perte de la mémoire de ce langage, à un âge déjà avancé, est beaucoup plus rapide que celle de certains souvenirs
d’impressions, je pense aux comptines de l’enfance. Cela signifierait que le son d’un mot s’imprime plus profondément en nous que son sens, et qu’il y aurait un rapport au monde plus fondamental que celui qui est médiatisé par le langage. Bien sûr, je ne suis pas en train de faire l’apologie de la maladie d’Alzheimer mais il y a peut-être, dans le déclin de la mémoire, une forme de présence plus directe aux choses qui se rétablit.
Le souvenir de l’ancien coureur cycliste est-il toujours imprimé en vous ?
Le pédalage est presque autant imprimé en moi que la marche. Mon squelette doit en porter la trace, indépendamment des traits de fracture. Il est encore là dans la posture du lecteur ou de l’écrivant, une attitude physique assez similaire à celle du pratiquant du sport cycliste. Être assis à une table en face d’un texte qu’on lit ou qu’on écrit me rappelle beaucoup l’alignement sur le vélo, cette torsion vers l’avant, sans compter qu’il est aussi difficile de lire ou d’écrire que de pédaler.
Mes années de coureur cycliste sont derrière moi, mais quand je regarde une course de vélo à la télévision, on me fait remarquer que j’ai les mains moites, comme si c’est moi qui tenais le guidon. Il me reste un peu de cette sensation, mais devant une retransmission je ne crois pas avoir les mains moites. Il se passe plutôt quelque chose au niveau de mes paumes. Je peux encore sentir les vibrations des cocottes ou du guidon dans mes mains, cette façon d’aller vers le monde avec les bras ouverts et les mains tournées vers le sol.
Avez-vous une idée de ce que sera votre prochain livre ?
Mes intuitions sont souvent trop graves ou mélancoliques et je voudrais bien trouver un moyen de les convertir en légèreté. En ce moment, j’aimerais travailler sur le thème de l’amitié trahie. La trahison est un vaste sujet mais il me plairait bien de l’amener vers quelque chose de léger.
Une légèreté présente dès l’épigraphe d’Un corps d’homme – vous citez ces paroles d’une chanson de Bashung : « J’ai des doutes sur la remise à flot de la crème renversée. » C’est dans la légèreté que l’on trouve la bonne distance avec son sujet ?
Oui et c’est peut-être à cela que sert l’écriture. Écrire sous le coup de la mélancolie des choses graves, c’est prendre le risque de verser dans une forme de premier degré. Mon éditrice Amélie Petit m’a dit que je n’étais jamais meilleur que lorsque j’étais léger. Et en fin de compte, écrire est peutêtre cet effort par lequel je cherche à alléger ma vie, et à me bonifier avec le temps.
— UN CORPS
D’HOMME,
Olivier Haralambon, Premier Parallèle
LE SOUFFLE NOUVEAU

Par Emmanuel Abela ~ Photo : Pascal Bastien
LE TOME I DE SON PREMIER ROMAN, PEAU D’ÂME, UNE TOTALE RÉINVENTION DU CÉLÈBRE CONTE DE CHARLES
PERRAULT, PEAU D’ÂNE. ELLE OUVRE AINSI LA VOIE À UNE NOUVELLE FORME DE LITTÉRATURE.
La littérature a ceci de merveilleux, c’est qu’elle trouve toujours sa voie. Elle est ce souffle capricieux qui ne s’offre pas si aisément. Et pourtant, sous la plume d’Aude Ziegelmeyer, elle s’affirme comme une évidence à chaque ligne, presque à chaque mot, tant la virtuosité est là, naturelle et spontanée.
Quelle idée saugrenue que de revisiter Peau d’Âne, un conte déjà complexe et si chargé de sens, et qui a fait l’objet, comme on le sait, de cette version hautement subversive de Jacques Demy en 1970 avec, rappelons-le, un casting de rêve, Catherine Deneuve, Delphine Seyrig et Jean Marais ? Nous avons tous en mémoire ces images pop d’un monde féérique qui peut tourner au cauchemar. Si Aude Ziegelmeyer, par ailleurs critique d’art et illustratrice, a une bonne connaissance des images qui environnent les contes en général, que ce soit dans un style préraphaélite, pop, chez Walt Disney, en bande dessinée ou dans une approche plus proprement fantasy, elle ne s’en libère pas moins pour nous livrer sa version très personnelle et très éloignée de tout ce qu’on peut imaginer.
Dans un style limpide comme l’un des plus beaux soli du guitariste d’Iron Maiden, Dave Murray, fluide et lumineux – style qui risque vite de faire école ! –, elle atteint des sommets, là-haut au firmament, dès les premières pages. En effet, on trouve quelque chose de proprement vertigineux dans sa manière de raconter les vicissitudes de la princesse Blanche, à la fois si mûre et si ingénue, au sein de la cour avant qu’elle ne vienne hanter la forêt dans sa forme la plus bestiale.
Ce que l’auteure retient du conte initial, c’est la part du sang. Elle la livre par flots, de manière gourmande – sans complaisance – pour alimenter un imaginaire inquiétant qui nous fait comprendre que la créature n’est pas celle qu’on croit : l’homme devient la créature véritable par ses actes malveillants, sa duplicité, sa voracité aveugle et son appétit sexuel assassin, et la créature identifiée comme telle, elle, est femme par sa capacité de survivance dans un monde qui pourrait lui
échapper. De nombreuses lectures faites ici ou là de l’ouvrage sur les réseaux y voient du féminisme, et même si celui-ci n’est pas absent dans la manière de décrire des personnages féminins puissants d’intelligence et de conviction – certains hommes ne sont pas en reste dans un propos loin d’être manichéen –, il n’en demeure pas moins que Aude Ziegelmeyer situe le débat ailleurs, avec une langue et un sens du rythme de la narration très enlevé qui n’appartiennent déjà qu’à elle.
Quelqu’un a relevé à très juste titre la dimension charnelle de son écriture sur Instagram, mais la question que pose l’auteure est bien celle de la littérature en valeur absolue dans ce que les mots expriment de sensualité. Il est donné à peu de réussir cela, surtout en ces temps d’un profond marketing littéraire, avilissant par bien des aspects, mais Aude Ziegelmeyer, comme d’autres – Audrée Wilhelmy, auteure d’un Peau-de-sang fascinant chez Le Tripode –, ouvre la voie à une génération nouvelle d’écrivains. Celle porteuse d’un souffle nouveau, qu’on attendait désespérément et qui ne tardera pas à soulever de hautes vagues, ici en France et partout ailleurs.
— PEAU D’ÂME,
Aude Ziegelmeyer, Gulf stream éditeur, mars 2025

LA VIE HANTÉE MARTINE DELVAUX
Par Clément Willer ~ Photos : Pascal Bastien
RACONTE UN FILM QUI N’A JAMAIS VU
LE JOUR, EN MÊME TEMPS QU’ELLE
INVENTE UNE FORME DE VIE HANTÉE,
En lisant Ça aurait pu être un film, il m’a semblé que vous aviez trouvé une forme complexe et particulièrement juste pour raconter l’histoire de la peintre Hollis Jeffcoat, entremêlée à celles des artistes Joan Mitchell et Jean Paul Riopelle. C’est une forme qui tient à la fois du scénario, de l’enquête, de l’essai, de la biographie, ou du récit de soi, une forme envoûtante, non linéaire, en fragments, en spirales. Cette genèse fut-elle difficile ? Et vous souvenez-vous du moment où vous avez ressenti la nécessité de cette forme en train de se trouver ?
Pour chaque livre, l’essentiel, c’est la recherche de la forme. Le livre commence à exister quand la forme commence à être trouvée. Oui, c’est douloureux, plus douloureux que ça ne l’était il y a vingt ans, quand j’ai commencé à écrire. Il y a des mois assez douloureux, où j’accumule des morceaux. Je suis en pleine enquête, et en même temps, je cherche cette forme du livre. La forme de Ça aurait pu être un film est tributaire de tous les autres livres. Je travaille la fragmentation depuis le début, dans tous les récits ou les essais que j’ai écrits, et c’est comme si tous mes livres précédents s’étaient entrelacés, entretissés, pour donner cette nouvelle forme. J’essayais d’effectuer un maillage entre tout ce qui m’anime, tout ce qui est de l’ordre de la recherche, de l’enquête, de la transmission du savoir, du récit de soi, de la biographie. Mais comment je l’ai trouvée cette forme, je ne sais pas, c’est le grand mystère. Ce n’est pas une forme prédéterminée, c’est une forme qui naît au fil de l’écriture. Il y a un moment où je sais que c’est la bonne, où je sens cette justesse. Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai peut-être compris que c’était ça quand j’ai eu l’idée d’utiliser l’adresse à la deuxième personne, qui était nécessaire.
Par ailleurs, tous les synopsis, tous les plans de coupe, les morceaux de scénario que j’ai intégrés dans le récit, c’était plus un choix. Je me suis dit que le point de départ, c’est l’échec de ce film qui ne se fera pas, donc pourquoi ne pas se servir des formes filmiques pour raconter cette enquête. C’est aussi une petite vengeance, j’avais envie de faire vivre ce film, même s’il n’aura pas lieu. Il n’existera pas à l’écran, mais il va exister dans mon livre. Quand j’ai reçu l’invitation du producteur de cinéma, je
lui avais dit d’emblée : « Peut-être qu’il y aura un film, mais il va y avoir un livre, c’est sûr. » Je ne peux pas être écrivaine, écrire un scénario, et ne pas écrire un livre à partir de toute cette recherche que j’aurais faite. Mais le livre, dans ma tête, n’allait pas être une biographie, mais un récit du processus de fabrication du film, parce que j’ai énormément appris sur la pratique cinématographique : que fait le réalisateur, que fait le monteur, la monteuse surtout, qu’est-ce qu’un synopsis… D’où toutes ces citations d’écrits sur le cinéma que j’intègre dans le récit. Quand le projet de film est tombé à l’eau, j’ai pris tout cela à rebours, et je me suis dit : bon, je ne vais pas faire un making of du film, mais je vais faire un making of de ce qui n’a pas été fait.
Un peu comme l’indique en exergue du livre la référence au Camion de Marguerite Duras : « Ç’aurait été un film »…
Cette référence au Camion est indissociable du lien que j’ai établi avec le producteur québécois. À la fin de notre première conversation, il m’avait dit : « Mais on ne fera pas Le Camion quand même. » Il n’y a pas mille personnes au Québec qui peuvent un matin à dix heures à L’Express sortir Le Camion comme référence… Ça m’a séduite. Après, retournant vers Duras, parce que je retourne tout le temps vers Duras, rouvrant encore Le Camion, qui est un texte que j’avais enseigné et que j’aime beaucoup mais que je n’avais pas lu depuis longtemps, ça a été le début de ce film.
Avez-vous eu finalement, comme Marguerite Duras qui finit par revendiquer un cinéma pauvre, la volonté d’affirmer la dimension plus économique du médium auquel vous avez abouti : un livre, qui coûte beaucoup moins d’argent qu’un film ?
Ce n’est pas au premier plan, mais la question de l’argent, du coût de l’art, traverse le livre. Dans le milieu du cinéma, c’est tellement une question d’argent, plein de projets qui sont lancés et très peu qui voient le jour, parce qu’après il faut obtenir les subventions, et les producteurs ont tout de même des moyens limités. Quant au livre, il nous coûte en temps, il faut avoir les moyens d’acheter des livres, de se documenter, et ça reste un privilège que d’écrire des livres, mais ça n’a rien à voir avec le cinéma. Le cinéma, c’est à des années-lumière de ce qu’on connaît dans le monde de la littérature.
La littérature que vous pratiquez, en plus de la prise de conscience qu’elle permet de ces processus économiques, a également une dimension qui me semble émancipatrice.
La fragmentation du récit, la scansion des blancs entre chaque fragment, ces procédés nous laissent un espace au fil de notre lecture pour comprendre, ressentir les choses nous-mêmes. Cette marge d’indétermination qui laisse ouverte la réception de vos textes, est-ce quelque chose que vous travaillez ?
Ce n’est pas conscient. C’est compliqué l’écriture… Mais j’ai toujours dit aux lecteurs et aux lectrices : vous pouvez lire mon livre comme vous voulez, vous pouvez l’ouvrir au hasard, vous pouvez le lire dans le désordre… Je n’ai pas envie de prescrire la manière dont on doit lire mes livres. Des lecteurs et des lectrices m’ont dit à propos du Boys club ou des Filles en série qui sont des essais : « Je ne comprends pas tout. » J’ai répondu que ce n’était pas grave. C’est ma folie à moi, ce sont mes références, c’est ma manière d’avancer pour essayer d’attraper une figure… Mais faites le chemin qui est le vôtre. Sans m’en rendre compte, et sans le décider, ça se décide tout seul, j’écris en étant portée par une certaine fragilité, par une certaine porosité. Je n’ai pas envie de dicter les choses, je n’ai pas envie d’arriver comme celle qui a acquis tout ce savoir et qui va l’imposer.
Du point de vue de cette fragilité et de cette porosité assumées qui donnent toute sa justesse à la forme fragmentaire du livre, Ça aurait pu être un film m’a fait penser à certains livres de Maggie Nelson…
Je n’ai pas tout lu de Maggie Nelson, mais presque. On parle beaucoup des Argonautes, mais ce n’est pas mon préféré. Mon préféré, c’est Bleuets. Je l’ai lu et relu, et souvent il est là, ouvert sur ma table quand j’écris. D’ailleurs, il y a dans Bleuets un fragment sur Joan Mitchell, un petit fragment parmi tous les fragments, à moins d’être sensible à Joan Mitchell, on ne le voit pas passer… Maggie Nelson, c’est une de ces autrices qui permet les choses, qui permet d’écrire comme ça, en spirales, dans cette ouverture, et dans ce refus d’affirmer.
Ça me rappelle une phrase de Ludwig Wittgenstein qui est citée dans Bleuets : « Si on ne cherche pas à exprimer l’inexprimable, rien n’est perdu, parce qu’il sera exprimé, quoique de manière inexprimable, dans l’exprimé. » Je crois que cette phrase traduit bien le sentiment que j’ai eu en lisant Ça aurait pu être un film . Certains fragments s’arrêtent au moment où on pourrait attendre une explication de ce qui vient de se passer. Ce suspens produit une densité d’émotions, on a l’impression de comprendre quelque chose sans que ce soit entièrement dit.
C’est la part de mystère ou de magie. Les blancs permettent ça, ils écartent les choses trop affirmatives, ils nous laissent en suspens. C’est vrai que Ça aurait pu être un film est construit en spirales, c’est vrai que ça tourne. C’est l’image du faucon qui tourne, et puis qui attrape sa proie. Cette image me revient souvent…
En effet, les mêmes événements resurgissent plusieurs fois, comme l’accident de voiture de Hollis et de Phyllis sur la route d’Auxerre. À chaque fois, on en apprend un peu plus, ou on voit les choses un peu différemment.
C’est le problème de la variation et de la répétition, de la différence et de la répétition. J’adore la répétition. On a tellement reproché aux femmes de répéter, de toujours raconter les mêmes histoires. On l’a reproché à Duras qui n’a pas cessé de raconter l’histoire de l’amant ou celle de son amour avec son petit frère. Chez elle aussi, on est dans des systèmes d’échos et de spirales, certaines figures reviennent sans arrêt comme une hantise. On trouve aussi cela chez Angot, chez Ernaux, chez Sigrid Nunez… Il y a énormément d’autrices qui se servent de la répétition et qui avancent de répétition en répétition. Un regard masculin classique, peu ouvert, va leur reprocher cela en disant qu’elles ressassent. Duras, on lui a tellement cassé de sucre sur le dos à cause de ça. Mais pour moi, c’est l’essentiel de l’écriture, cette fragilité. D’une certaine manière, ces réflexions se situent au plus près de la philosophie de Deleuze et de Derrida. C’est comme si toute cette pensée avait été intégrée et qu’on lui avait donné une forme littéraire.
Ces hantises qui le traversent donnent aussi à votre livre une dimension subtilement politique. Vous travaillez à l’étoilement des vies oubliées, exclues de la grande histoire. Vous racontez la vie d’Hollis Jeffcoat, laissée dans l’ombre de l’histoire de l’art, mais vous mentionnez aussi, dans son sillage, Phyllis, qui fut elle aussi une jeune artiste encouragée par Joan Mitchell. On pourrait penser que vous racontez ces vies pour les sauver de l’oubli, pour les transmettre aux siècles à venir. Mais, comme vous l’évoquez à plusieurs reprises, ces siècles sont très incertains, notamment en raison de la crise climatique que nous traversons… Est-ce qu’au fond cette remémoration vise à se donner du courage, d’aimer, de lutter, d’écrire, ici et maintenant ?
En effet, je ne sais pas si je raconte ces vies pour la postérité, parce que je n’ai pas tellement d’espoir. Tout ne va pas s’arrêter d’un coup demain,
— Comme je travaille en fragments, pendant longtemps les morceaux sont dans le désordre, avant que lentement je ne trouve la forme, que je commence à les monter ensemble. —
Le 10.10.24, sur la terrasse de l’Hôtel Suisse, à Strasbourg
mais on fonce dans le mur. Quand on me parle de legs, d’héritages, de livres qui vont rester dans les bibliothèques… Non, les bibliothèques vont brûler. Mon horizon n’est pas celui-là. Mon horizon, c’est peut-être plutôt de dire la fragilité de la vie, pour qu’on n’oublie pas combien la vie est fragile. J’ai eu du mal à le comprendre moi-même, mais c’est vrai que j’ai toujours envie d’aller voir du côté de celles et ceux à qui on ne pense pas, qui sont dans l’ombre, dans les coulisses de l’histoire, et de les faire exister, même si ce n’est que le temps de la lecture. Ne pas oublier que ces gens-là ont existé, pour moi c’est important : cela a à voir avec notre ici et maintenant, avec la manière dont on vit en ce moment même de manière hantée. Derrida disait à la fin de sa vie, dans Apprendre à vivre enfin : « Il faut apprendre à vivre avec les fantômes. »
J’avais écrit Histoires de fantômes à partir de cette idée. C’est un peu ancien, mais ça fait partie de moi. Cet apprentissage de la vie hantée, ça m’a complètement fabriquée. C’est comme être dans une maison qui semble vide : je veux faire surgir les visages qui sont cachés dans le papier peint ou dans les placards, je veux animer cette maison. Cela signifie aussi qu’on n’écrit jamais seul, qu’on n’invente rien. Il n’y a pas de véritable originalité, sinon dans la manière dont on raconte les choses, dont on fait nos montages. Écrire, c’est un geste qui nous rend humbles, qui devrait nous rendre humbles. C’est un geste qui nous donne la mesure de tout ce qu’on ne sait pas, de tout ce qu’on ne maîtrise pas, de tout ce qui nous échappe.

Cet apprentissage de la vie hantée peut rappeler aussi la nécessité de « prendre l’histoire à rebrousse-poil », dont parle Walter Benjamin, de raconter l’histoire « du point de vue des vaincus », pour ouvrir une brèche dans le présent, dans la reproduction des logiques de domination… Oui, pour mieux vivre maintenant, aujourd’hui même, dans une perspective éthique. Derrida, Deleuze, Agamben, Didi-Huberman, Benjamin, toutes ces lectures sont dans ma tête. Même si on n’en trouve pas forcément la trace dans mes livres, elles m’animent. Ce sont comme nos maîtres à penser aujourd’hui, je me tourne tout le temps vers leurs textes, même quand j’écris un récit qui est plus de l’ordre de la fiction, qui ne se veut pas de l’ordre de la pensée, ou de la métapensée. Ils sont là, sur ma table de travail.
Sur votre table de travail, vous racontez que se trouvent aussi vos carnets, vos grands carnets moleskine et vos petits carnets japonais. Ça m’a rappelé un passage dans Ce que je ne veux pas savoir de Deborah Levy, où elle dit à propos de ses carnets : « J’y amassais sans cesse quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. » Estce que vos carnets vous emmènent souvent dans des directions inattendues, que vous n’aviez pas prévues ?
Oui, sans doute. Le geste de prise de notes est semi-inconscient, c’est de l’ordre du rêve. J’attrape le carnet et je note une phrase, vraiment sans savoir si ça va me servir. C’est pour déposer quelque chose, pour ne pas perdre une sorte de flash, même s’il n’a peut-être pas de sens au moment où je le note. Puis, à plusieurs reprises, j’ouvre tous les carnets, je les retraverse, avec un système de surlignage et de post-its. À chaque fois que je me dis « là il se passe quelque chose », c’est comme une étincelle, ça peut rallumer un autre feu. Dans le processus d’écriture, il y a des moments où on s’arrête, où on ne sait plus… Souvent je ne sais pas dans quelle direction je vais aller. Comme je travaille en fragments, pendant longtemps les morceaux sont dans le désordre, avant que lentement je ne trouve la forme, que je commence à les monter ensemble. À ce moment-là, toute l’information est dans ma tête d’une manière ou d’une autre pour que je puisse savoir comment placer chaque fragment et où, quel trou je dois remplir. Quand ça bloque, quand je panique, quand je ne sais plus, alors je vais ouvrir les petits carnets japonais, et j’en fais défiler les pages en essayant de trouver ce mot qui peut me ranimer. C’est aussi ce que je fais avec ma bibliothèque finalement. J’ouvre Guibert et je lis une phrase, pour rallumer l’imaginaire, pour remettre les choses en marche. Ce rapport aux carnets est curieux. Les moleskines, c’est de l’ordre de l’information, de la recherche universitaire, de tout ce qui est vérifiable. Mais les petits carnets blancs sont le lieu du moteur de l’écriture. C’est de l’ordre de tout ce qui est privé, de tout ce qui m’échappe, que je dépose là mais que je ne comprends pas. Hier ou avant-hier, on m’a demandé si j’aurais peur de révéler ce qu’il y a dans ces carnets, mais en fait non. Ça ne m’appartient pas, pas vraiment.
— ÇA AURAIT PU ÊTRE UN FILM, Martine Delvaux, Éditions Héliotrope
Compatibles
Franck Vergeade et Jean-Louis
Murat, Dominique A et la lumière, Samuel Lequette et le rêve, Malik Djoudi et l’ardent amour, Anna Jean et sa seule voix, la Kamaraderie et YouTube, The Hook et une promesse… tous font superbement la paire.
JEAN-LOUIS MURAT : UNE PRÉSENCE
Par
FRANCK VERGEADE, ACTUEL RÉDACTEUR EN CHEF DES INROCKUPTIBLES, APRÈS AVOIR DIRIGÉ LA REVUE MAGIC, S’ATTACHE
À UNE FIGURE QU’IL A BIEN CONNUE : JEAN-LOUIS MURAT. IL NOUS LIVRE UN POINT DE VUE SUR CE PERSONNAGE COMPLEXE, DISCRET, PLEIN DE CONVICTION ET D’HUMILITÉ.
Dans l’ouvrage que tu lui consacres, tu ne dissimules guère l’affection que tu lui portes. Mais tu cherches à nous livrer un Jean-Louis Murat vivant, et j’ai presque envie de dire vibrant.
J’ai souhaité m’appuyer sur les entretiens que j’avais pu avoir avec lui durant 25 années. Finalement, il s’est dessiné un portrait en creux. Chacun d’entre nous n’en avait qu’une vision – une vision un peu déformée –, l’animal médiatique, le stakhanoviste, le fan de sport, de littérature, l’amoureux des États-Unis… Nous avions tous ces personnages en tête, mais il me semblait intéressant de m’appuyer sur sa discographie, ses mots à lui, que ce soit en interview ou dans ses chansons, pour raconter ce qu’il pensait.
Lui-même te l’avait annoncé : « Un jour, tu écriras ma bio quand je serai mort. »
Oui, c’était à la fois une promesse en l’air, sous la forme d’une boutade. Mais il est vrai que l’allusion est devenue un peu récurrente au fil du temps. De fait, j’avais déjà commencé à écrire sur lui régulièrement.
À partir de quand êtes-vous devenus amis ?
La première fois que j’ai chroniqué l’un de ses disques – à l’époque, pour moi, le disque ! –, c’était Dolorès en 1996. Et la première fois que je l’ai rencontré, c’était en 99, pour Mustango. Pendant ces 25 ans-là, nous avons tissé une relation d’abord professionnelle et puis extra-professionnelle.
Les seules possibilités de croiser Jean-Louis, c’était soit de le voir en concert soit de le retrouver en promo à Paris. Et parfois en me rendant chez lui en Auvergne. Mais il se passait toujours quelque chose. C’est pour cela qu’aujourd’hui encore, sa disparition me paraît irréelle : il n’était pas comme toutes ces autres personnes que je peux croiser à Paris… Il me semble encore là. De même, quand nous nous sommes rendus en Auvergne pour le premier anniversaire de sa disparition [survenue le 25 mai 2023], il me semblait troublant de revenir en Auvergne : j’avais l’impression qu’il était quelque part dans la montagne ou dans sa maison en train d’enregistrer. Présent et absent, absent et présent.
Comme entrées du livre, tu poses quelques repères discographiques en t’accordant parfois des libertés chronologiques dans l’enchaînement, avec des décrochages et des focus. Cette manière a le mérite de révéler qu’à l’égal d’un Neil Young, par exemple, Murat pouvait être passionnant, y compris dans ses instants intermédiaires.
Oui, il faut rappeler qu’il a commencé sur le tard. On lui connaît quelques années d’injustice, et il a failli tout arrêter. Ça n’est qu’avec le single Si je devais manquer de toi en 1987 et l’album Cheyenne Autumn , disque d’or à l’époque, qu’il rencontre ses premiers succès. Il le disait lui-même que c’était bon signe d’avoir débuté par un échec commercial, même s’il estime perdre du temps
Emmanuel Abela ~ Photo : Richard Dumas

dans les années 80 et 90. C’est pourquoi il décide d’augmenter la cadence discographique au point qu’au final on lui connaît 21 albums officiels et une quinzaine de projets, des lives, des projets littéraires avec Isabelle Huppert ou autour de Ferré et Baudelaire, etc. Je me souviens qu’à l’époque de Lilith en 2003, il était tellement fier d’avoir son triple album vinyle, à l’image de ceux qu’il écoutait. Il considérait ses confrères français trop lents. À un moment, il a décidé de sortir deux disques par an, ce qui semblait forcément inconséquent en pleine crise du disque. Mais il a réussi à garder le rythme d’une sortie annuelle jusqu’à quasiment la fin, ce
qui constitue un miracle. Ça a malheureusement eu pour conséquence de faire décrocher les gens, parfois. Ce qui l’affectait. Certains projets, comme Travaux sur la N89, n’ont atteint que les 5 000 exemplaires vendus, par exemple.
Parmi ses chefs-d’œuvre, tu sembles revenir comme un running gag sur Dolorès. Il s’en amuse et s’en agace parfois. Pourquoi ce disque précisément ?
C’est un disque qu’il a mis beaucoup de temps à peaufiner avec son complice de l’époque, qui l’est resté jusqu’à la fin d’ailleurs, Denis Clavaizolle. Au milieu des années 90, l’arrivée des musiques électroniques a irrigué la pop et la chanson. Par rapport à cela, il avait plein d’idées. Il voulait travailler avec des producteurs anglais, mais finalement ça ne s’est
pas fait. Au moment de l’écriture de ce disque, il était en pleine rupture. En rupture sentimentale, mais aussi en rupture artistique avec ce son très moderne. Ce disque reste pour moi – je le pense aujourd’hui encore ! –son plus grand disque. Un disque qui résiste au temps, aux modes. On y trouve quelques-unes de ses plus belles chansons, que ce soit « Aimer » ou « Le Train bleu » ou « Fort Alamo ». Il a été trahi par la pochette d’une fille dénudée, imposée par la maison de disques. Mais après coup, il a fini par reconnaître lui-même que c’était un grand disque.
Nous avons eu l’occasion de le voir sur scène, c’était un étonnant personnage, loin de l’artiste parfois austère qu’il semblait être parfois. Une pure apparence, j’imagine. Six mois avant sa mort, j’ai vu l’un de ses derniers concerts. Enfin, le dernier en région parisienne. En trio. Et c’était vraiment bien. On le découvrait très différent de ce qu’on savait de lui, effectivement. Au milieu des années 90 et puis surtout au cours des années 2000-2010, il a beaucoup tourné. Notamment quand il a trouvé sa formule en trio, guitare et chant, basse, batterie. Après, il a aussi fait des tournées en solo ou avec une formation élargie, notamment quand il a fait l’album avec le Delano Orchestra, un groupe de Clermont-Ferrand. De manière générale, il aimait prendre les gens à contre-pied, comme ce fut le cas à l’époque de Mustango, un album électrique, pour lequel il tournait à deux ou à trois ou simplement accompagné de bandes. L’idée avec son groupe était d’étirer les versions jusqu’à ce qu’elles ne ressemblent quasiment plus aux originaux, comme on l’entend sur le live Muragostang.
Sur scène, on lui découvrait aussi beaucoup d’humour. Dans ton livre, tu le décris un peu moqueur, un peu railleur, mais surtout pince-sans-rire. Il avait cette image faussée du chanteur sentimental, un peu triste et neurasthénique. Mais il n’était pas cela – même s’il l’était un peu quand même ! C’était surtout un bon camarade pour refaire le monde, lever le coude, dire du mal des autres. Pendant toute la période où je l’ai côtoyé, j’ai pu constater qu’il n’y avait pas de décalage entre le personnage public et le personnage privé, ce qui est parfois le cas chez les artistes.
Autre chef-d’œuvre que tu juges immense, Taormina (2006), son hommage à Mark Hollis de Talk Talk. L’occasion pour lui de revenir sur une double thématique qui traverse son œuvre : l’amour et la mort. Oui, l’amour et la mort, comme une récurrence. Cette présence de la mort était liée à ses lectures, je pense.
Tu le situes dans la droite ligne des plus grands, tels que Gérard Manset – il y a pas mal de parallèles qu’on pourrait établir entre les deux –, mais de manière plus étonnante, tu cites assez régulièrement Robert Wyatt, l’ex-Soft Machine. Quel lien établis-tu ? Une certaine approche de l’intime ?
Jean-Louis Murat ne cherchait pas toujours la justesse. C’est pour cela qu’il avait envie de travailler avec le Crazy Horse [le backing-band de Neil Young]. Il n’avait pas le budget, ils ont dit « non » dans un premier temps, puis finalement « oui » et c’est lui qui a dit « non ». De même pour Nellee Hooper de Soul II Soul ou Brian Eno. Concernant Robert Wyatt, il faisait partie – tout comme Mark Hollis – de ces figures anglo-saxonnes qu’il admirait. La rencontre a-t-elle eu lieu ? Jamais ! Pour en revenir à Manset qui a failli produire l’un de ses premiers 45T, c’était un peu une relation amour-haine. La rencontre entre ces deux personnes très égales s’est mal passée, Murat s’en est détaché. Voilà tout.
Selon toi, a-t-il réussi à concilier pleinement son amour des mots et de la langue avec ces sons qui venaient d’ailleurs, d’Angleterre et d’Amérique ? Il rêvait d’enregistrer aux États-Unis, et le fit en 99 sur Mustango , entre New York et Tucson, en Arizona. Il voulut travailler avec le leader de l’American Music Club, Mark Eitzel, mais ça ne se fit pas non plus. Et après, il trouva la section rythmique de Calexico, il eut envie de travailler avec eux. Il était également très proche d’Elysian Fields, et de sa chanteuse Jennifer Charles. Dix ans après Mustango , il renouvelle l’expérience à Nashville, berceau de la country, pour l’album Le Cours ordinaire des choses en 2009. Avec ces musiciens américains, il se sent comme un poisson dans l’eau. C’est documenté dans un film de la réalisatrice Laetitia Masson, Falling In Love Again, où, on le voit bien, il est comme chez lui. D’avoir des compliments de ses homologues anglo-saxons, ça le rassurait par rapport à un contexte francofrançais qui souvent le déprimait.
À la lecture, on lui découvre un bel esprit d’ouverture. Derrière l’ermite de façade, on sent une grande curiosité mais qui n’est pas seulement orientée vers l’indie ou l’americana, mais vers des choses qui auraient pu être éventuellement plus mainstream quand il travaille avec Mylène Farmer ou Isabelle Huppert.
Oui, il aimait beaucoup chanter avec les filles, Camille ou Morgane Imbeaud de Cocoon, et il avait aussi eu un projet d’album pour Jeanne Moreau qui était tombé à l’eau, malheureusement. Mais comme il était très curieux effectivement, il ne faisait pas attention à la notoriété de la personne quand il décidait de collaborer avec elle.
On lui connaît une affection pour Kendrick Lamar.
Oui, il l’adorait, il aimait bien toute cette scène, Frank Ocean, Kendrick Lamar, etc. Et donc, il montait en famille à Paris avec sa femme et ses deux derniers enfants pour voir Kendrick Lamar se produire sur scène. Et ça s’entend sur la production de ses disques à la fin, il travaillait beaucoup avec les samplers…
C’était une personnalité assez controversée, parfois frondeuse. Mais ce que l’on sent surtout traverser le livre, c’est son sourire permanent. Dans l’intimité, il était absolument charmant.
Tu insistes sur quelque chose d’assez surprenant, une forme d’ambivalence concernant sa propre identification, et notamment l’identification sexuelle. Lui-même affichait une affection
pour les personnalités à l’identification floue comme Howard Devoto, l’ex-Buzzcocks, leader de Magazine.
Oui, il exprimait une fascination pour ce type de personnalité, ou plus récemment à propos de gens comme Mykki Blanco [rappeuse, poète et militante LGBT américaine ] ou Antony Hegarty, devenu Anohni. Murat disait que cette ambiguïté sexuelle l’intéressait lui-même en tant qu’artiste, alors qu’il ne se montrait guère ambigu. Il trouvait que ça apportait quelque chose en plus.
Il a tout de même l’âme du séducteur, même s’il affiche un air un peu blessé. Fondamentalement, ne cherchait-il pas à plaire ?
Quand on est artiste, on cherche a priori à plaire à un auditoire. Malgré son physique pauvre, avec ses yeux bleu délavé et son petit sourire en coin, il était très séducteur. Il était même redoutable ! Les personnes avec qui il a travaillé, certaines d’entre elles pendant vraiment des années, voire durant une ou deux décennies, étaient sous le charme. Elles lui passaient certains caprices – il pouvait être têtu et même colérique parfois. Mais ça opérait et il obtenait ce qu’il voulait.
Il y a un autre parallèle possible – je ne crois pas que tu l’établisses – avec une figure comme Dick Annegarn, qui à un moment ou à un autre a même quitté le show-business, et qui pouvait manifester, à la fois le même niveau d’exigence, et parfois le même refus du show-business.
Oui, il est vrai que ce sont des personnes qui ont tracé leur sillon un peu indépendamment du succès ou de l’insuccès, et qui ont su garder une ligne exemplaire, une intégrité.
Grâce à toi, puisque tu le cites beaucoup, on redécouvre sa plume, et notamment ses textes qu’on lit et qu’on réécoute avec plaisir. C’est un peu large comme question, mais en quoi ces mots nous donnent-ils la clé, cette énigme Murat ?
La force de Jean-Louis, c’est que ses textes se lisent indépendamment de la musique. Ce qui n’est pas le cas de tous les auteurs-compositeursinterprètes. Je sais qu’il y a un projet de livre – je ne sais pas s’il sortira un jour, mais j’espère que oui –, qui rassemblerait uniquement ses textes. À les relire, on situe ce goût pour la littérature qui le faisait utiliser des mots rares, même s’il pouvait se montrer un peu frivole par ailleurs en utilisant un langage parlé dans ses textes.
Il y avait aussi ce contraste très intéressant chez lui, cette manière de cartographier son Auvergne natale, que ce soit dans les titres des chansons, les paroles ou dans le vocabulaire lié
à la faune, la flore, les paysages… Il faut rappeler qu’il écrivait quasiment une chanson par jour. J’ai discuté il n’y a pas si longtemps avec sa femme, elle m’évoquait l’existence de tiroirs pleins de textes et de caisses entières. Il avait même un projet de livre dont il n’a jamais voulu révéler la teneur et qui malheureusement ne verra jamais le jour. Il en était même obsédé. Il se disait que ce serait bien de passer par une phase d’écriture sans placer de mélodie dessus.
La poésie semble aller grandissante au fil des années, il manifestait ce lien à Baudelaire sur lequel il a travaillé via Léo Ferré. Oui, et puis c’était un lecteur insatiable de Proust, il avait lu trois ou quatre fois La Recherche, et il pouvait en parler pendant des heures.
Ton livre est une invitation à nous replonger dans son œuvre, y compris à investir des chansons de son œuvre qu’on méconnaît. Pour le titre de ton ouvrage, tu as choisi Le Lien défait, un choix qui donne une tonalité mélancolique à l’ensemble.
Je pense que s’il fallait retenir une seule chanson de son répertoire, ce serait celle-ci. C’est une chanson où tout est dit sur l’amour et le désamour. Elle faisait partie des deux ou trois titres de travail durant la rédaction, elle est devenue une évidence. De même pour la photo de Richard Dumas pour la couverture. Jean-Louis Murat détestait faire des photos. Avec Richard, je supposais que ça pouvait bien se passer parce qu’il évolue sans assistant. Il ne lui faut qu’un quart d’heure pour faire trois images, dont une définitive. Sur celle-ci, on a le sentiment que Jean-Louis est là – et déjà plus là –, qu’il est ailleurs. Et pour moi, ça résonnait avec le titre du livre : Le Lien défait.
— JEAN-LOUIS MURAT, LE LIEN DÉFAIT
Franck Vergeade, Séguier
DOMINIQUE A TRENTE ANS ET DES LUMIÈRES
TROIS DÉCENNIES CONSACRÉES À L’ÉCRITURE DE
CHANSONS ET À LA QUÊTE DU SON : IL FALLAIT BIEN
UN DOUBLE ALBUM POUR CÉLÉBRER LA CARRIÈRE DE DOMINIQUE A.
En Quelques lumières, il reprend ses propres chansons ; sur le premier disque avec un orchestre symphonique, sur le second au sein d’un trio à l’esprit jazz. Trois décennies (32 ans, exactement) valaient bien huit pages dans Novo.
Le mois dernier a paru Quelques lumières, double album rétrospectif, revisitant des chansons de toute ta discographie avec, pour le premier disque, l’Orchestre de Chambre de Genève et, pour le second, deux musiciens de jazz1. Revenir sur ces chansons t’a apporté du plaisir ? Pas trop de nostalgie ?
Du pur plaisir. Je me suis dit que c’était le moment, que j’avais maintenant assez de matière pour me le permettre, pour piocher tous azimuts dans ma discographie. Bien sûr, reprendre avec un orchestre une chanson comme « L’Écho », extraite de La Fossette, ou même « La Mémoire neuve », a une
1 — Sébastien Boisseau (contrebasse) et Julien Noël (piano) accompagnent Dominique A (guitare, chant).
saveur particulière. Je revois le jeune homme qui a écrit ces morceaux-là, et parfois même le moment où je les ai imaginés. La nostalgie est peut-être tapie en embuscade, mais je n’en ai pas peur. Je ne regrette pas le « temps d’avant ». Je regrette juste d’avoir moins d’années devant moi que derrière.
Quelle a été l’étincelle de Quelques lumières ?
Le point de départ a été un concert symphonique que j’ai fait en Suisse, avec l’orchestre de Genève. Il n’y a pas eu d’enregistrement de ce concert ; or, il a occasionné un important travail d’arrangement des morceaux, pour lequel j’avais sollicité mon complice David Euverte. D’un autre côté, je n’ai jamais, depuis plus de trente ans, fait paraître de « best of ». Pour ces raisons, j’ai proposé à mon label d’organiser un enregistrement de ces versions, avec le même orchestre, mais en studio, en vue d’une parution sur disque. Nous partions sur une quinzaine de morceaux et pour une rétrospective, cela ne me semblait pas assez. J’avais aussi envie d’autre chose.

Pierre Lemarchand ~ Photos : Richard Dumas

— La nostalgie est peut-être tapie en embuscade, mais
je n’en ai pas peur. —
Le 29.11 à Paris
Tu désirais contrebalancer cet enregistrement avec un autre, plus intimiste ?
Oui. J’avais fait un concert à l’Hôtel de Ville de Paris pour Fnac Live en duo avec le pianiste Julien Noël, en 2018. C’était la première fois que je lâchais la guitare. Depuis trottait dans un coin de ma tête l’idée de tourner avec Julien dans cette configuration piano/voix. Entre-temps, j’ai travaillé à mon album Le Monde réel, que nous avons ensuite joué en concert, en quintet. De là est née l’envie d’un trio plutôt qu’un duo : le piano de Julien, mais aussi la contrebasse de Sébastien Boisseau – soit les deux pivots du son acoustique du Monde réel J’avais conscience que les versions symphoniques n’occasionneraient pas beaucoup de concerts : c’est trop onéreux. Tourner en trio permettra de porter le disque dans son ensemble. Quelques lumières est finalement le résultat de différentes envies, mais aussi de la prise en compte de ce qu’est le monde de la musique aujourd’hui : les disques ont une durée de vie de plus en plus courte (en gros, la même que celle d’un film) et ce sont les concerts qui permettent de leur offrir une longévité. Enfin, j’ai toujours aimé les diptyques : j’avais déjà exploré cette forme avec La Musique / La Matière , Toute latitude / La Fragilité , Le Monde réel / Reflets d’un monde lointain2
Pourquoi affectionnes-tu à ce point cette forme du diptyque ?
J’aime cette idée de réponse et d’équilibre, mais c’est avant tout, car cela me permet de « tout mettre ». Ne rien laisser de côté, pour ne pas occasionner de regrets. Ici, la cohérence entre les deux disques de Quelques lumières, c’est le travail sur des sources acoustiques. Le lien entre eux, c’est Julien Noël : il est pianiste au sein du trio ainsi qu’avec l’orchestre. David Euverte et moi nous sommes dit qu’il fallait un élément « lead » qui fasse le lien entre la voix et l’orchestre. Il apporte une culture chanson, pop, dans un ensemble qui n’y est
2 — La Musique, huitième album de Dominique A, a paru en 2009 ; une édition spéciale l’a proposé augmenté d’un deuxième album, La Matière. Les albums Toute latitude et La Fragilité ont paru à quelques mois d’écart, l’année 2018 : le premier est joué en groupe et intègre des machines, tandis que le second, acoustique, est réalisé dans la solitude du home studio. Enfin, Reflets d’un monde lointain (2023) est issu des mêmes sessions que Le Monde réel (2022), et lui a succédé d’à peine six mois.
pas accoutumé. Le dialogue entre les musiciens et moi se fait par l’entremise de Julien ; les parties de piano arpégées remplissent cette fonction de lien. Dans le même esprit, David a invité une harpiste, qui ne fait pas partie de l’orchestre de Genève, pour consolider ce lien.
Comment s’est déroulé le travail avec David Euverte, qui a arrangé les orchestrations du disque symphonique ?
Je lui ai laissé une grande latitude, mais j’ai donné mon assentiment pour chaque morceau. Je suis en quelque sorte l’interprète de mes chansons comme si elles étaient des reprises. Je lui ai confié des enregistrements guitare/voix et il a travaillé les arrangements sur cette base. À de rares exceptions près, je ne lui ai pas donné d’indications. Une des exceptions est « Le Courage des oiseaux » : j’ai orienté David, lui demandant de travailler dans l’esprit des minimalistes américains, tels Steve Reich ou Terry Riley. Il a ajouté des sonorités ravéliennes, proches du Boléro. Il a eu parfois des difficultés pour recréer les morceaux que nous avions joués sur la tournée du Monde réel , car il faisait partie du groupe et c’était difficile pour lui de se détacher des versions « live ». Ça a été le cas pour « Tout sera comme avant » et « Le Twenty-Two Bar ». La première, nous l’avons finalement jouée avec le trio et c’est parfait ainsi, car elle est une de mes préférées. Pour le « Bar », je lui ai suggéré d’accentuer le côté narratif de la chanson, de la dramatiser en trois parties – autant que de couplets.
La version du « Ruban » ou celle de « Rue des Marais » obéissent-elles aussi à ce désir d’accentuer l’aspect narratif ?
Oui, absolument. « Le Ruban » appelait cela. Pour « Rue des Marais » 3 , David a imaginé des arrangements qui me font penser à Nino Rota, à sa musique pour Amarcord de Fellini. C’est une autre façon de parler de l’enfance, de la dédramatiser. Il a réussi à apporter de la légèreté, un peu plus de distance, à des paroles chantées, dans la version originale, de manière très sombre – « Christelle est la première / À ne pas vouloir m’aimer / Je pressens une liste / Longue à se dérouler », c’était à se flinguer !
Il y a peut-être moins de solitude : les arrangements « peuplent » la chanson. Estil arrivé que David Euverte te propose des arrangements que tu n’as pas aimés ?
Oui, ça a été le cas pour « Eleor ». Je n’ai d’abord pas aimé sa proposition d’un quatuor à la manière des Beatles, mais je me suis laissé convaincre. Et puis,
3 — « Le Ruban » raconte, à la première personne, les souvenirs de guerre d’un enfant. « Rue des Marais », qui puise dans un terreau plus autobiographique – on y reconnaît Provins, ville d’enfance de Dominique A –, épouse également le regard d’un enfant.
le côté « Eleor Rigby »4, ça me faisait rire ! Je ne suis pas très « beatlesien », mais j’ai trouvé bien que dans un cadre où l’orchestre était très présent, hormis les passages arpégés au piano, il y ait cette respiration où seulement une petite partie de l’instrumentarium est sollicitée. David a souhaité offrir à chaque morceau une identité forte plutôt que de tenter de les relier esthétiquement. Il est parti tous azimuts, comme s’il voulait mettre tout ce qu’il aimait – et je le comprends, car c’était la première fois qu’il réalisait un tel travail d’arrangement pour orchestre. Il avait arrangé les cordes sur le Monde réel, le quintet de vents de Vers les lueurs5, mais ici l’orchestre n’accompagne pas un groupe ; il est seul. Tour repose sur lui. C’était une plus grande responsabilité.
Le disque en trio a-t-il été une manière de retourner sur des terres plus familières, revenir « à la maison » ?
Les versions en trio ont été en effet une manière de revenir à la maison, mais aussi la possibilité de participer plus activement, d’être plus libre aussi qu’avec le grand orchestre. Ce travail s’est bâti sur une année de tournée ensemble, avec le sextet du Monde réel6. Nous avons avancé à trois, creusant des pistes, en abandonnant d’autres, sur la base d’une trentaine de morceaux que j’avais apportés. Au final, il en demeure une quinzaine, dont trois inédits. Ils étaient une demande de ma maison de disques et bien leur a pris, car c’est grâce à l’un d’eux que le disque peut exister sur les ondes.
Tu parles de « L’Humanité »7 ?
Oui. J’ai été surpris que ce soit cette chanson qui soit retenue par les programmateurs, j’imaginais que ce serait plutôt « Les Animaux ». Mais avec le recul, je comprends, je vois que « L’Humanité » a une sorte d’évidence. C’est paradoxal, car j’y ai beaucoup travaillé. D’habitude, quand une chanson me donne autant de mal, je la lâche, me disant que le plaisir ne sera pas au bout du chemin. Je tenais à son propos, mais je tournais autour de la musique. Elle revêt une forme classique – [il compte à voix haute] c’est de l’octosyllabe, comme d’habitude ! –, mais je pressentais qu’elle ne devait pas se dérouler sur une boucle de quatre accords. Il fallait que la musique épouse la narration, d’où ses nombreux accords et ce point final, irrésolu, qui ne débouchent pas sur un refrain. C’est cette conclusion qui m’a demandé beaucoup de travail. Je ne suis pas accoutumé à un tel « dolorisme », mais je me disais que les paroles
4 — Dominique fait bien sûr référence à la chanson « Eleanor Rigby » (1966) des Beatles, où la voix de Paul McCarney est accompagnée par un seul quatuor à cordes classique.
5 — Vers les lueurs, neuvième album de Dominique A, a paru en 2012.
6 — Dominique A : chant/guitare - Julien Noël : progs/claviersSébastien Boisseau : contrebasse - Étienne Bonhomme : batterie
- David Euverte : claviers/piano - Sylvaine Hélary : flûte.
7 — « L’Humanité » est narrée par un père dont l’enfant est devenu militant d’extrême droite.
en valaient la peine… Je réalise que je suis plus attaché aux paroles qu’auparavant. Et Quelques lumières me permet de réaliser ce désir de « narrer », de deux manières différentes : tout d’abord, en tant qu’interprète avec l’orchestre et, ensuite, comme chanteur et guitariste au sein du trio.
Tu désirais donc, à travers les deux disques de Quelques lumières , accorder une place plus importante que d’habitude aux textes ? Sortir de l’héritage du rock anglo-saxon où les paroles se fondent beaucoup plus dans la musique ?
Oui, c’est ça. Je désirais être un interprète convaincant, que l’on croie à ce que je raconte. C’est une vision très traditionnelle de la chanson française, que j’ai appris à accepter. Particulièrement avec l’orchestre, étant dépossédé de toute participation musicale, je devais justifier ma place, non par une présence accrue de ma voix, mais par mon pouvoir de persuasion en tant qu’interprète. J’ai toujours été fasciné par les chanteurs qui, sans posséder de capacité vocale inouïe, te persuadent véritablement de ce qu’ils sont en train de raconter. L’exemple flagrant est Daniel Darc : il te touche profondément avec un filet de voix, certes, mais un tel investissement du texte ! C’est pour cela que je pense qu’il avait renoncé au rock’n’roll et adopté ce positionnement très français par rapport au texte.
Cette posture d’interprète t’a permis de redécouvrir certains de tes textes ?
Oui, j’ai redécouvert la force de certains d’entre eux. Tu me parlais du « Ruban » : ça a été le cas pour cette chanson. Dans ce contexte, elle s’est imposée, alors qu’elle est, dans mon répertoire, peu attendue. Elle ouvrait la voie à une « narration » musicale. Il y a eu aussi des passages obligés : « Le Courage des oiseaux », « Immortels » et « Au revoir mon amour », nous ne pouvions pas ne pas les faire ! C’est une sorte de « contrat » avec le public – en aucun cas c’est un poids pour moi. La question n’était pas de les choisir (elles étaient là d’emblée), mais d’en imaginer des versions convaincantes.
« Le Twenty-Two Bar » était-elle, pour les mêmes raisons que ces trois-là, incontournable ?
Le « Bar », c’est différent. Je ne me sens aucune obligation envers elle. Les trois autres sont de bonnes chansons, bien écrites, j’ai un devoir envers elles. Sa version orchestrale donne au « Bar » plus de corps – elle en deviendrait presque une bonne chanson !
Ce choix d’être avant tout un interprète t’a fait mettre de côté la guitare. T’a-t-elle manqué ?
Oui, elle a fini par me manquer et j’y reviens aujourd’hui, méchamment ! Je ne voulais pas, avec cet exercice, verser dans l’anoblissement, devenir un artiste mature. J’aimerais réintroduire un peu de « grain » dans ma musique.
Ta voix a beaucoup évolué depuis La Fossette8 ; tu désirais alors être un fantôme vocal, affranchi de toute incarnation. Aujourd’hui, tu t’assumes comme interprète, dans une tradition de la chanson française, d’une voix qui incarne son propos. Elle aussi a acquis du « grain » ?
À l’époque de La Fossette, tout ce qui relevait de la présence corporelle me rebutait. C’était paradoxal, car on me parlait déjà de ma présence sur scène. Aujourd’hui, mon corps ne me fait plus peur. Éventuellement, il me gêne, mais pas sur scène. Il y véhicule cette énergie qui monte du sol et me traverse dès que je suis sur les planches, et que j’ai plaisir à transmettre. Même les mauvais soirs, c’est là. Du coup, la voix a suivi le chemin de cette incarnation assumée.
Sur France Inter, en 2022, tu as interprété « Ils s’aiment » de Daniel Lavoie. Et auparavant, « Les Enfants du Pirée » de Dalida sur Auguri (2001), « Chiqué chiqué » de Christophe (avant qu’il ne revienne à la mode) sur Si je connais Harry (1993). Il semble que tu souhaites depuis longtemps tordre le cou à une image trop « indé » ou élitiste. Que cherches-tu à travers ces reprises de chansons, lointaines de ton image ?
Disons que ce sont des pas de côté pour mettre à mal le snob en moi, le gars qui ne jure que par ECM9 et des disques indés vendus à 300 exemplaires (que j’aime sincèrement, par ailleurs). J’ai toujours voué à ces trois chansons une réelle affection. Je suis un chanteur français, attaché à chanter dans sa langue, il est donc impossible de faire totalement l’impasse sur une culture populaire qui m’a nourri au même titre que certaines musiques confidentielles. Ce sont des chansons qui m’interrogent sur ce que je suis capable d’écrire moi-même dans la perspective de m’adresser à des gens différents – je ne parle pas du « plus grand nombre », ça ne veut pas dire grand-chose pour moi –, et qui me permettent précisément de porter des mots qui me plaisent et que je ne serais pas fichu d’écrire.
Ce projet de reprises de tes propres morceaux t’a-t-il permis d’offrir une « seconde chance » à certaines de tes chansons ?
Une seconde chance, dans le sens où j’estimerais que la version originale n’est pas à la hauteur, je dirais ceci pour « Music-Hall ». Dans la version originale, sur L’Horizon, on n’entend pas la force du texte, car je le chante d’une voix mourante ; je n’aime pas mon interprétation. « Music-Hall » a été l’un de mes chevaux de bataille. Il y a sinon « Valparaiso », qui figure également sur le disque en trio : elle n’est pas la plus connue de mes chansons,
mais j’ai toujours cherché, via les concerts, à la remettre dans l’oreille du public. Si « Music-Hall » nous a donné du fil à retordre, avec « Valparaiso », il s’est passé l’inverse. Ce qu’on entend sur le disque, c’est la première prise, sur le vif, sans répétition. One take, good take. C’est justement parce que nous butions sur « Music-Hall » que j’ai suggéré que nous passions à autre chose, une chanson à la structure très simple… « Valparaiso », donc. Ça a été magique.
Les versions en trio de Quelques lumières ont été enregistrées au studio La Buissonne, où a été enregistré, en 2023, Memento 10, ton album autour de l’univers de l’écrivain Patrick Modiano. Retourner à La Buissonne était important ?
Oui, j’adore ce studio. Je savais qu’à La Buissonne, on allait pouvoir « spacialiser » les chansons. Il y a un confort vocal et de son incroyable. Sur la console, tous les potards sont à zéro – c’est-à-dire que l’ingénieur du son, Gérard de Haro, ne touche à rien, n’apporte aucune égalisation11. Yann Arnaud, qui a réalisé le son du disque symphonique, aurait aimé réaliser aussi celui-ci, mais je lui ai expliqué que je souhaitais deux approches totalement différentes : il a apporté un pendant pop à l’enregistrement orchestral tandis que Gérard de Haro amenait lui tout un pan jazz à l’enregistrement en trio.
Quelle est ta relation avec le jazz ?
Je détestais ça quand j’étais jeune. Je ne comprenais pas. J’ai commencé à en écouter tard, à l’âge de 28-29 ans. Le déclic a été John Coltrane. J’étais à Toulouse avec Michel Cloup12 et il a mis un disque. Ce n’était pourtant pas un disque « facile », qui m’aurait fait entrer en douceur dans cette musique – c’était Ascension13. Je suis devenu obnubilé par le free jazz, en particulier les disques du label Impulse!. Je n’écoutais que ça et un peu de musique électronique, comme Tarwater et Pan Sonic. C’est pour ça que Remué , l’album que je faisais à ce moment-là, est un disque de chansons qui ne veut pas en être un. Ce sont des chansons, mais je fais tout pour qu’elles n’apparaissent pas comme telles. À part peut-être « Comment certains vivent », ce sont des textes que je n’ai plus envie de chanter. C’est pourquoi il n’y a aucune chanson de Remué sur Quelques lumières. Je ne suis plus le
10 — Memento a paru en février 2024. Dominique A y chante les textes, inspirés de l’univers de Patrick Modiano, écrits spécialement par le critique de jazz Jean-François Mondot. Il y est accompagné de Stéphan Oliva au piano, Sacha Toorop à la batterie et Sébastien Boisseau à la contrebasse.
11 — L’égalisation est une technique qui permet de modifier les fréquences d’un son de façon sélective, en permettant par exemple d’ajouter plus de basses ou d’aigus.
8 — La Fossette, premier album de Dominique A, a paru en 1992. Il en a depuis publié quatorze autres.
9 — ECM est un label allemand fondé en 1969, consacré notamment au jazz et à la musique contemporaine.
12 — Michel Cloup a réalisé le deuxième album de Dominique A, Si je connais Harry , publié en 1993. La même année, avec son groupe Diabologum, il a repris « Le Courage des oiseaux ».
13 — Enregistré en 1965, Ascension a paru en 1966 sur le label Impulse!, un an avant la mort de Coltrane. Il est considéré comme son premier album « free jazz ».

jeune homme qui a écrit ces chansons-là… Je n’ai jamais cessé, ensuite, d’écouter régulièrement du jazz. Cette année, j’ai écouté essentiellement le catalogue du label ECM – parmi ses 1 400 albums environ, 180 ont d’ailleurs été enregistrés à La Buissonne. Les disques ECM entretiennent un rapport au son, à la dynamique qui me passionne et que j’ai exploré avec Le Monde réel, Memento et Quelques lumières . Les écarts de volume, le désir de faire respirer le son, ne pas l’enfermer, c’est le travail que je poursuis en ce moment.
Il y a donc une circulation entre ce que tu crées et ce que tu écoutes ?
Oui. Je me suis remis à écouter des chansons récemment, mais ces derniers temps, je n’ai écouté quasiment que de la musique instrumentale. Dans le catalogue ECM : beaucoup le trio du pianiste Tord Gustavsen, mais aussi des artistes qui ne sont pas réductibles au jazz, comme l’oudiste Anouar Brahem, la pianiste Areni Agbabian. ECM propose une musique « mystique », à la croisée de divers mondes. Le disque en trio s’est inévitablement nourri de ces écoutes. Ces deux dernières années, j’ai passé beaucoup de temps sur mon perron, qui surplombe mon jardin, à regarder la Loire, en buvant un verre de blanc et en écoutant un disque ECM ! Ce que je me suis dit, en entrant en studio pour le disque en trio, c’est que j’aimerais réaliser un disque que l’on peut écouter dans ces
—
Le désir de faire respirer le son, ne pas l’enfermer,
c’est le travail que je poursuis en ce moment. —
conditions. C’est-à-dire une musique bien présente – ce n’est pas une musique d’ameublement – mais dans laquelle on peut aller et venir ; une musique que l’on ne subit pas, ce qui est souvent le problème des disques de pop, qui entrent par effraction dans l’espace sonore. Je recherche une musique qui offre à l’auditeur une certaine liberté.
Avec Le Monde réel, c’était la première fois que tu insufflais dans ta musique l’esprit du jazz ?
Il y avait eu quelques incursions sur Remué, sur les morceaux acoustiques comme « Le Détour » ou « Avant l’enfer ». Mais c’était avant tout l’influence de Mark Hollis qu’on entendait, comme on l’entend dans Le Monde réel. Avant d’entrer en studio, j’ai demandé à chaque musicien d’écouter Laughing Stock de Talk Talk. Je l’avais fait découvrir à Sébastien Boisseau avant que nous ne fassions de la musique ensemble et le fait qu’il l’ait aimé a scellé quelque chose entre nous.
Avant Le Monde réel , tu as publié en 2020 un disque très différent, Vie étrange . Après La Fossette, La Musique/La Matière et La Fragilité, il est un nouvel épisode d’enregistrement domestique que tu réalises seul. Qu’est-ce qui le distingue, néanmoins, de ses prédécesseurs ?
Les conditions dans lesquelles il a été fait, qui sont les conditions que nous avons tous connues, celles du confinement. Tout a commencé avec ma reprise de « L’Éclaircie » de Marc Seberg 14 , réalisée sur mon 8-pistes numérique. Cette chanson m’obsédait et me semblait parler de ce que nous étions en train de vivre alors. Après en avoir réalisé la reprise, j’ai eu envie de la partager et les réactions des auditeurs ont été enthousiastes. Elle a commencé à passer à la radio – et je ne l’avais même pas masterisée. Cet intérêt pour « L’Éclaircie » m’a mis le pied à l’étrier et j’ai enregistré les quatre chansons de l’EP Le Silence ou tout comme : des chansons uniquement composées au synthé, à partir d’une simple boucle rythmique – comme pour La Fossette, en fait. Mon idée était de jouer sur le souffle, avec une voix comme confinée. Cela supposait des micros très ouverts ; techniquement, ça a été un défi. Mais l’écriture des chansons a été plutôt simple. À ce moment-là, je butais sur l’écriture des chansons du Monde réel – des morceaux décomposés qui me jetaient dans l’impasse. Là, je creusais quelque chose de simple, élémentaire ; quelque chose que je savais faire.
Tu fantasmes le son du Monde réel – un son acoustique, ample, collectif –, mais c’est un son à l’opposé – synthétique, confiné, conçu dans la solitude – que tu crées alors…
Oui, car c’était la seule façon dont je pouvais faire de la musique et ça a été une respiration bienvenue. J’ai eu l’envie de faire un deuxième EP, plus ouvert, plus lumineux, avec l’arrivée de guitares : je ne me l’avouais pas, mais je désirais faire un disque ! Ces deux EP sont devenus les deux faces d’un album. Qui aura coûté, au final, moins cher encore que La Fossette, pour lequel nous avions dû financer deux jours de mixage au Garage Hermétique. Vie étrange a coûté les 600 euros de mastering, et basta.
Ce disque, qui est arrivé sans prévenir, a bouleversé tes plans…
Oui. Je venais de faire La Fragilité qui était déjà un disque solo, enregistré à la maison, sur le même matériel… Je ne pouvais pas refaire la même chose. C’est néanmoins ce que j’ai fait, mais je ne l’ai pas assumé. C’est ma faiblesse, de parfois ne pas
assumer mes choix, de trop écouter ce qu’on me dit. Et ce qu’on me disait alors, c’était que je produisais trop, que je devais laisser passer plusieurs années après la parution, la même année [2018], de Toute latitude et La Fragilité . Qu’il fallait privilégier la rareté, créer de l’attente, disparaître pour mieux réapparaître.
Cette rareté n’est pas ton mouvement naturel ?
Non, cela n’épouse pas mon rythme de création – Murat avait le même problème. Je ne sais pas ce qui m’arrivera demain, alors je veux créer sans cesse. Écrire, concevoir, c’est mon mouvement naturel. Il y a bien cette fameuse citation de Camus : « Un homme, ça s’empêche. » Mais je pense qu’un artiste ne doit pas s’empêcher ; il doit se jeter à l’eau. À ce titre, Vie étrange a été une bénédiction. Je l’aime toujours beaucoup.
Tu réécoutes donc tes disques ?
Oui. C’est un plaisir ! Parfois de courte durée, quand ce que j’écoute m’énerve trop et que j’interromps l’écoute. Mais je n’ai jamais interrompu l’écoute de Vie étrange . Je le trouve juste et c’est la chose à laquelle j’aspire par-dessus tout : la justesse. J’ai le sentiment que ce disque représente parfaitement la personne que j’étais au moment où je l’ai fait.
Cette justesse est-elle liée aux conditions solitaires de sa création ?
Oui, le rapport de proximité que tu souhaites établir avec l’auditrice ou l’auditeur va se diluer si tu travailles avec d’autres musiciens. Mais le renouvellement, les expériences et les souvenirs que ces derniers t’apportent, c’est irremplaçable. Je ne pourrais pas être toujours seul.
Où réside la justesse du Monde réel ?
14 — Marc Seberg est le second groupe du chanteur Philippe Pascal, après Marquis de Sade. « L’Éclaircie » a été créée en 1985. En même temps que Vie étrange, Dominique A a fait paraître à l’automne 2020 le livre Fleurs plantées par Philippe aux éditions Médiapop, dans lequel il explore son attachement à la musique de Philippe Pascal.
Dans le projet de départ et l’idée qu’il porte du collectif. C’est un disque qui me représente moins moi que la réussite d’un collectif autour de chansons. Je m’y sens comme un élément parmi d’autres, à l’instar de Memento . C’est une expérience de studio inoubliable, dans le procédé, les échanges, la douceur des rapports. Tellement forte qu’écouter Le Monde réel me renvoie plus aux conditions dans lesquelles il a été réalisé qu’au disque lui-même. Cet album a été un sacré chantier ! J’amenais les chansons guitare-voix et il nous fallait tout inventer en studio. Je voulais que les musiciens découvrent les chansons, qu’ils n’y soient pas aguerris. Je désirais exploiter la fragilité de bons musiciens. Une fois la chanson exposée, Yann Arnaud [ le réalisateur artistique du Monde réel] suggérait de ne pas jouer les accords à la guitare. Je n’ai joué au final que des nappes, des ondes, sur une des quarante guitares des studios La Frette, une Gretsch avec laquelle je serais bien reparti ! J’avais ramené mes propres réverb’ et c’est
ainsi que j’ai créé ce son si particulier, cet effet « Leslie » 15. Je pense qu’il concourt à donner son identité sonore au disque ; en creusant une matière extra-acoustique, il ramène un peu d’étrangeté, du « grain » que nous évoquions tout à l’heure.
Dans une telle expérience collective, ce qui demeure ta part irréductible, ce que tu passes de ta singularité, ce sont les paroles. Peux-tu me parler de celles d’« Avec les autres ». « Nous n’irons bien/Nous n’irons loin/Qu’avec les autres » : s’il te faut le chanter, c’est que ça n’allait pas de soi ?
Cette chanson a été entièrement écrite sur place. Le matin, je me levais avant les autres – je ne dors pas beaucoup – et j’allais me promener sur les bords de Seine. L’album a été enregistré à la Frette-surSeine, c’est très beau là-bas, les impressionnistes en ont peint les paysages. Nous en étions encore aux premiers jours de studio et le tour que prenait l’enregistrement dépassait mes espérances. J’étais tellement heureux de l’alchimie entre les musiciens – ils se découvraient alors, se connaissant à peine. Le début de la chanson m’est venu tandis que je marchais.
Ce que l’on reçoit comme une considération générale (l’indispensable solidarité quand la Terre vacille) naît en fait d’une impulsion plus intime ?
Eh oui ! Quand je rentre, tout le monde est levé alors je leur joue à la guitare et chante ce qui m’est apparu. Le « talk over », ça passe ou ça casse, mais là, ça fonctionnait. Yann me dit : « Allez, on l’enregistre ! » Il fallait quand même que je l’écrive d’abord ! Alors, j’ai pioché dans mes carnets des bouts de phrases, j’ai puisé dans un texte ancien qui s’intitulait « L’Instant présent », j’ai écrit les parties manquantes et j’ai constitué un cut-up. Puis j’ai structuré la chanson en en définissant la grille d’accords. Le jour même, la chanson était écrite et le lendemain, nous l’avons enregistrée. Sébastien et Julien ont trouvé tout de suite ce balancement, Étienne ce jeu avec les balais. La prise voix du disque est la première prise. C’est un autre petit miracle. Cette chanson n’aurait jamais pu naître ailleurs que dans ce studio, avec ces musiciens-là, dans ces conditions-là.
Ta manière de créer des chansons, en écrire les textes, composer les musiques, a-t-elle beaucoup changé avec le temps ?
Non, pas tant que ça, je pars souvent des mots, et la musique se greffe dessus. Ce qui a changé, c’est mon rapport au travail collectif. Avant, je considérais les musiciens avec qui je travaillais comme des associés au service de mes idées,
15 — Inventée par Donald Leslie, la « cabine à son tournant » soumet le son d’un instrument à des fluctuations, en intensité (effet trémolo) comme en fréquence (effet vibrato).
— Avant, je considérais les musiciens avec qui je travaillais comme des associés au service de mes idées, maintenant plus comme des compagnons avec lesquels je suis en quête d’un son. —
maintenant plus comme des compagnons avec lesquels je suis en quête d’un son, avec les chansons comme matière première, prétexte, si j’ose dire, à l’élaboration de ce son commun.
Combien de temps a duré la session d’enregistrement du Monde réel ?
Nous avions prévu deux sessions. Une première en mars 2021 puis une autre en juin. Une douzaine de jours à chaque fois. Mais en mars, au bout de six jours, la session est interrompue : mon fils tombe d’un mur et souffre d’un traumatisme crânien. Je rentre en catastrophe. Nous étions dans une dynamique de travail dingue, mais la vie s’est engouffrée et l’a coupée net. Sur la deuxième session, nous n’avons jamais retrouvé cet état de grâce. Nous n’étions plus dans la nouveauté ; nous avions eu le temps de beaucoup réécouter les cinq morceaux que nous avions déjà réalisés. Nous étions heureux de nous retrouver, mais quelque chose s’était envolé. Nous ferions de beaux morceaux encore, mais dans un coin de nos têtes flotterait le souvenir de cette magie perdue.
Dans Le Monde réel , tu chantes un monde qui s’effondre, mais aussi le sentiment plus intime du temps qui passe – qui file, dans « Le Manteau retourné de l’enfance ». As-tu vu le temps passer ? Ah oui, je ne vois que ça. Depuis que je suis gosse, je le vois passer avant qu’il ne passe vraiment. Rien de très original. Chacun de mes albums balise une période, un état d’esprit. Faire des disques me permet de voir passer le temps avec une relative sérénité.
— QUELQUES LUMIÈRES, Dominique A, Cinq 7
L’ÉTRANGETÉ DE LA RITOURNELLE
Par
AVEC SON DEUXIÈME ALBUM, RIEN
PERSONNE NULLE PART JAMAIS, SAMUEL
LEQUETTE, ALIAS HYPERRÊVE, CREUSE
SON SILLON D’UNE POP FRANÇAISE SENTIMENTALE ET CONCERNÉE.
Après votre premier album très marqué politiquement, Nos absences futures , et un EP plus sentimental, Delphine , votre deuxième album semble offrir un équilibre entre les deux : il parle d’amour, mais aussi des préoccupations du moment…
Avec des motifs qui ont peut-être davantage trait à l’enfance, à la fuite mentale et géographique, à la réinvention de l’amour. Mais ce que vous dites est assez vrai, on y trouve cet équilibre-là.
On constate sur cet album des contributions marquantes, avec la présence des guitaristes Lee Ranaldo de Sonic Youth et de Marc Ribot qui a joué avec Tom Waits, John Zorn ou Alain Bashung. J’ai le sentiment que tous deux apportent une forme d’âpreté.
Le principe de collaborations est probablement ce qui caractérise mes disques. C’était le cas avec ces duos – Françoiz Breut, Barbara Carlotti ou Chloé Mons – sur le premier album… Je ne me vois pas comme un chanteur accompagné de musiciens. C’est pour ça que j’ai rassemblé ce que je fais sous un nom de groupe : Hyperrêve. Concernant Marc Ribot, la rencontre s’est faite à distance, par lettre et e-mail. Effectivement, il apporte quelque
chose de très émotionnel, de sensible et d’assez distancié. J’aime cela chez lui et il me semblait qu’il pouvait justement s’introduire de manière intéressante dans la manière dont moi-même je fais des chansons. Et puis, Lee Ranaldo, c’est vraiment l’un des héros de mon adolescence. J’ai eu la chance de le rencontrer il y a deux ans en France, l’entente a été assez immédiate. Je connais vraiment très bien sa musique, à la fois sa voix, ses ponctuations, ses inflexions et textures. Sur le disque, il a posé des intentions très nettes, bien exprimées. Il en a fait un usage assez parcimonieux qui lui convient, qui nous convient aussi, et qui effectivement apporte ce que vous dites.
On sait que la pop peut flirter parfois avec une forme d’abstraction. N’avez-vous pas été tenté de vous laisser entraîner vers cette forme. Je pense à des expériences comme celles d’un groupe comme Yo La Tengo, par exemple.
Ce sont des aspects que j’explore avec l’artiste CoH, autrement dit Ivan Pavlov, avec qui j’ai fait un disque de musique instrumentale. De même, j’ai écrit une sorte de poème sonore pour l’artiste danois Thomas Knak qui travaille sur des accidents électroniques.
Sur cet album-là, quelle a été votre approche de l’écriture des textes ?
Je crois que les textes sont peut-être frappés par une apparente simplicité. Et c’est tant mieux ! Des chansons sonnent presque comme des comptines. J’aime beaucoup cela, quand la simplicité côtoie l’étrange avec cette impression d’avoir un accès immédiat à un langage tout en percevant autre chose.
Votre voix a également évolué, je crois.
C’est-à-dire qu’elle est plus lyrique, même si je maintiens quelque chose du mi-chanté mi-parlé. Je me sens en quête d’émotions nouvelles.
Emmanuel Abela ~ Photo : Richard Dumas

Vous explorez la fin d’un monde et les possibilités de rêves collectifs ou individuels. Quelle vision portez-vous sur l’avenir en cette période si préoccupante ?
Elle m’intéresse beaucoup, cette période ! Oui, elle est inquiétante et suppose en même temps beaucoup d’invention. À titre personnel, je lis beaucoup de penseurs de l’écologie. Et puis, j’écris aussi sur des questions d’écologie globale, profonde. Une figure comme Timothy Morton par exemple, qui évolue sur la thématique d’une mélancolie écologique, peut paraître très provocante quand
il expose l’idée que la fin du monde a déjà eu lieu avec l’invention de la machine à vapeur. Mais il dit surtout ceci : que tout est à imaginer et à réinventer. Et je trouve cela très stimulant.
Justement, vos chansons ouvrent des perspectives, naturellement imaginaires mais presque sensuelles.
Ce qu’on peut percevoir quand même en cette période c’est ce qui s’ouvre. C’est la relation ou les relations en général. Et l’invention de nouvelles solidarités. Oui, ça me semble central.
— UN SEUL MATIN DOUX, Hyperrêve, Médiapop Records

SON TEMPÉRAMENT
Par Emmanuel Dosda ~ Photo : Julien Mignot
AU REVOIR TRISTESSE. BONJOUR ALLÉGRESSE. PLUS ARDENT QUE
JAMAIS,
BOOSTÉ PAR L’AMOUR ENFIN TROUVÉ, MALIK DJOUDI – AVEC
SA PALETTE VOCALE TOUJOURS PLUS PRODIGIEUSE – NE S’EST PAS
TOUT À FAIT
DÉFAIT DE SA
MÉLANCOLIE. C’EST SON TEMPÉRAMENT.
« J’étais à bout de souffle. Maintenant, je nage sur notre presqu’île », chantes-tu. Qu’est-ce qui te rend si vivant ?
J’essaye d’accepter la vie telle qu’elle est. Et d’en jouir un maximum. J’arrête de me prendre la tête sur des choses futiles, car c’est un immense privilège d’être vivant, ici, dans un pays en paix. La minuscule personne que je suis observe la manière dont le monde tourne et comprend la chance qu’elle a. J’ai changé d’axe, de regard, et je me concentre sur l’essentiel. Ça faisait un bail – au moins le temps de sortir mes trois précédents albums – que je n’avais pas rencontré l’amour. Mes créations s’en ressentent forcément.
Tu te sens plus vivant que jamais, mais le rythme des morceaux n’est pas davantage soutenu. Thomas Bangalter de Daft Punk t’a épaulé, mais pas de virage club pour autant…
J’adore faire groover une basse/batterie en midtempo, sans aller dans le 120 BPM. C’est presque un défi.
Et une douce mélancolie plane sur tout le disque…
En effet, c’est ma patte musicale.
Tu étais à la Villa Médicis pour ébaucher ce nouvel album. Une résidence de création est-elle synonyme de mise sous pression ?
Oui, au début, c’était la page blanche. Puis, un jour, j’ai observé un couple, de dos, main dans la main, dans le jardin. J’ai pris ça pour une lueur d’espoir, un signe… De retour chez moi, je suis tombé amoureux et ça m’a donné des ailes.
La tristesse n’est pas un moteur ?
Si, bien sûr. Et la musique est parfois un refuge.
Tu t’imposes une discipline d’écriture ?
Je travaille dans mon home studio tôt le matin : c’est ma fenêtre de temps créatrice. Je cherche les choses, parfois sans rien trouver. Je sais à présent qu’il est impossible de provoquer l’inspiration. Je commence par le squelette, puis viennent le son, la forme… J’aime ce moment de recherche, de réflexion, d’ajustement. Je n’arrive jamais en studio
d’enregistrement sans idées de composition. J’ai déjà les arrangements en tête.
Tu chantes « Viens, on prend le temps. »
C’est important de flâner, de se poser à un café et de profiter des choses simples, ici et maintenant.
J’ai l’impression que l’histoire de tes chansons n’a pas vraiment de début ni de fin. Comme si on les prenait en route…
Car elles parlent d’un moment de vie. Il n’y a pas de temporalité. Les portes sont ouvertes : chacun peut s’identifier. Je fais de la chanson pour essayer de faire du bien, d’amener les gens à moi.
Quel est ton point sensible ?
La peur que tout s’arrête.
Un « Dernier cri » à pousser ?
Y’en a marre des cons ! Ceux qui coupent dans le budget de la culture qui va forcément se niveler vers le mainstream. Personnellement, je ne ferai jamais de concession et continuerai à me battre. Seule la beauté peut changer le monde !
— VIVANT, Malik Djoudi, Cinq7
concert le 16 janvier aux Trinitaires, à Metz ; le 17 janvier à La Vapeur, à Dijon ; le 28 mars à l’Espace Django-Reinhardt, à Strasbourg ; et le 6 juillet, aux Eurockéennes de Belfort www.citemusicale-metz.fr www.lavapeur.com www.espacedjango.eu www.eurockeennes.fr malikdjoudi.com
JUNIORE
DE PASSAGE À LA VAPEUR DIJONNAISE À L’OCCASION DE LA TOURNÉE
DU GROUPE JUNIORE, ANNA JEAN (CHANT, GUITARE ET CLAVIERS) NOUS PARLE
ET
NOUVEL ALBUM TROIS, DEUX, UN. UN ALBUM QUI MARIE AVEC GRÂCE ET CLASSE L’ÉCRITURE PRÉCISE D’ANNA À UNE MUSIQUE 60S YÉYÉ, RENFORCÉE DE CE QU’IL FAUT DE SURF ROCK ET DE SON ROCK PSYCHÉ.
LA FORMULE
La formule live du groupe bouge tout le temps, et va encore bouger. J’aime bien notre formule à quatre. On se sent bien. J’ai l’impression qu’il y a une vraie conversation musicale entre nous, ce qui n’est pas forcément évident pour moi. Je ne suis pas une grande musicienne, même si j’ai l’impression que je commence à me roder – je suis comme une vieille voiture –, mais je ne suis pas suffisamment musicienne pour être compatible avec n’importe qui. Notre conversation musicale est assez délicieuse. C’est plaisant.
LA TOURNÉE
La tournée 2024 a été très intense, d’autant plus qu’on a tous des métiers ou des projets musicaux à côté. On ne s’est pas encore soûlés les uns les autres, on aurait pu passer au moins le double de temps avant de ne plus se supporter, mais je crois qu’il y a déjà entre nous le projet de recommencer un disque, parce qu’on a attendu trop longtemps. Ce serait bien d’accélérer un petit peu le rythme : trois disques en dix ans, ce n’est pas très rapide.
L’ÉCRITURE
J’ai toujours des idées d’histoires, je suis quelqu’un d’assez fantaisiste, et elles me viennent spontanément. Je crois qu’elles comblent des moments de vide. Je me raconte aussi les histoires des autres. C’est Jacques Brel qui disait que les chansons c’était… tout ce qu’on ne vit pas. Je crois que c’est un peu ça. Et en même temps, c’est quelque chose de très autobiographique, parce qu’il faut que ce soit familier, proche de soi. C’est important pour moi qu’il y ait une forme de sincérité, mais ça ne peut pas être la lourdeur de ta propre vie. Il faut trouver une façon d’être
à la fois sincère et rigolo. Il faut trouver le ton et c’est un truc qui m’a posé beaucoup de questions parce que c’est particulièrement important pour assumer, incarner… Moi, je ne suis pas très douée pour incarner ce que je fais. Maintenant ça va mieux, mais j’ai mis dix ans. Personne n’a jamais voulu chanter mes chansons, du coup, je me suis retrouvée à les chanter. Ce qui n’est pas forcément une mauvaise chose en soi, après coup. Pour le morceau « Le Silence » que j’ai écrit sur le nouvel album, c’était très facile, très rapide. Mais ça dépend, il y a des chansons pour lesquelles j’ai plus réfléchi. J’avais envie de raconter des choses précises. Pour « Je fais le mort », j’avais envie d’une histoire de ghosting aujourd’hui, mais d’une façon à l’ancienne. Je me suis dit : « Comment on peut parler de gens qui disparaissent du jour au lendemain ? » et « pourquoi ? » J’avais envie de le faire d’une manière un peu romantique. J’aime bien l’idée aussi que, bien que je sois une fille, je dise : « Je fais le mort. »
FACILITÉ
J’ai un héritage un peu particulier. J’ai un papa (J. M. G. Le Clézio) qui écrit très facilement. Dans ses manuscrits, il n’y a pas une rature, c’est assez miraculeux. Je le voyais écrire de façon naturelle, il s’asseyait à son bureau à 21 h-22 h, et repartait à 1 h du matin. Il avait rempli des pages avec
Par Martial Ratel ~ Photo : Vincent Arbelet

une écriture très jolie. Encore une fois, sans une rature. J’ai grandi avec ça, toute mon enfance, toute mon adolescence. Pour moi, écrire c’était ça. Il n’y avait pas d’autre façon de faire. J’ai aussi une grand-mère musicienne, pianiste, qui jouait très bien, mais qui n’avait pas pu faire son métier de cette passion parce qu’à l’époque, les femmes ne travaillaient pas. Ce n’était pas facile de s’imposer de cette façon-là.
HÉRITAGE
Rencontrer Samy Osta, musicien et producteur, m’a aidée. La musique, c’est un art mineur que les gens ne respectent pas trop, c’est un peu nul, la musique. Donc, je me suis dit que, finalement, moi aussi, j’avais le droit de faire de la musique, que je n’allais pas écrire de grands essais philosophiques [rires]. M’affranchir de l’héritage paternel, c’était écrire de petites chansons pop, des textes qui étaient très inspirés des années 1960, parce que c’est ce format de chansons avec des gimmicks que j’aimais bien, qui donne l’apparence d’être naïf et simple, et qui ne l’est pas du tout. Une fausse légèreté. Je ne suis pas sûre d’avoir réussi ça, mais par contre, les auteurs qui dans les années 1960 faisaient des traductions presque littérales des chansons anglaises, j’ai toujours aimé ça. Ça m’a dédouanée de devoir faire des textes trop léchés.
LE FANTASME AMÉRICAIN
On grandit en se disant qu’un jour on va aller vivre en Californie, parce qu’il y a… les Beach Boys. C’est aussi pour ça qu’on s’est appelés « Juniore ». C’est grâce aux Beach Boys qu’on est des ados attardés pour toujours… Il y a aussi le Nouveau-Mexique qui enrichit la musique de Juniore. On a au moins trois morceaux country. C’est une région qui est très imprégnée de musique mexicaine et américaine, c’est vraiment un mélange des deux. J’ai grandi là-bas entre mes 10 et mes 14 ans. À un âge où on a l’impression qu’on vit les choses très intensément, pour le meilleur et pour le pire.
LE MONDE ÉLECTRONIQUE
Je viens de faire une collaboration avec Golden Bug et The Limiñanas sur le morceau « L’effet domino ». La rencontre avec cet artiste electro était très simple, très fluide. Elle s’est faite via Sammy. Lors d’un de ses passages à Paris, on s’est vus, on a bu une bière ou deux et on a discuté. Il m’a ensuite envoyé le morceau avec le titre. Il voulait que ça s’appelle « L’effet domino » et j’ai écrit le texte à partir de ça. J’aimais l’idée de ce mot. Golden Bug ne le sait pas mais je me suis inspirée de son histoire pour écrire. J’avais travaillé avec Bot’Ox, Jackson & His Computer Band et Justice. Même si ce n’est pas ma famille musicale de cœur, j’ai rencontré des gens que j’apprécie particulièrement comme Jackson. C’est un garçon hyper brillant et complètement farfelu. J’ai refait un morceau récemment avec Bot’Ox puisqu’ils se sont reformés et qu’ils vont sortir un album dans pas longtemps.
— UN, DEUX, TROIS, Juniore, Outre

FRANCHE KAMARADERIE
EN UTILISANT TOUS LES CODES DU LIVE ET DE L’INTERVIEW, LA NOUVELLE CHAÎNE VIDÉO DES COMPÈRES DE KAMARAD MET EN LUMIÈRE ET À L’ENVERS LA SCÈNE ROCK RÉGIONALE.
Par Mathieu Jeannette
Quand Hugues Hestin ne déploie pas sa fougue sur scène avec Kamarad, il la met au service des groupes régionaux en vidéo. Ce brun à moustache filmera cette spéciale Ramones de novembre dans le magasin de glisse tenu par son acolyte Guillaume Neff, ex-bassiste de leur groupe post punk. Les teignes de Deafslow avaient inauguré la première session de cette nouvelle chaîne YouTube au concept original et protéiforme. Promouvoir la scène rock et la mettre sur le grill par le biais d’interviews surréalistes (en jouant à Mario Kart ou au Tétris), jeux absurdes et quiz de culture rock, tournages en lieux incongrus, chroniques littéraires trash… Un projet haut-rhinois hybride entre le format du late show et de l’esprit Switch. Trois fauteuils rouges cernés de dizaines de planches et d’une rampe de skate où prendront place trois intervenants de choix. Un conférencier en costard noir et frisettes grises à côté d’un metalleux jovial. Pour finir, un généraliste viendra confier sa pathologie chronique pour les concerts et les groupes émergents. Le son lancinant de roulements ponctué par le claquement des trucks sur le haut de la rampe donnera le rythme et le ton de la soirée. Si Hugues est devenu vidéaste professionnel, c’est certainement à ses premiers films d’ado de skate et de snowboard qu’il le doit. Ses amis présents au bar et lui ont gardé ce goût de l’humour foireux, de la mise en boîte subtile, cet amour potache, attachant, propre à l’esprit skate. Judd de Fragiles Figures sera d’ailleurs un des prochains sur la liste de la chaîne à y faire souffrir sa basse lancinante.
Cette franche Kamaraderie est le fruit d’influences diverses balayant un spectre allant de Tony Hawk pour le skate aux jeux vidéo vintage, au punk rock, mais aussi d’un goût inattendu pour la folk et la pop mélancolique… En atteste la diversité des prochains invités du soir. Derrière la caméra fixe de Stéphane Forjan, vidéaste attitré, Mathieu Marmillot, chanteur et bassiste des Manson’s Child, lisse son costard sixties et ses boots avant d’entamer un panégyrique drôle sur les Dalton du punk. Avec cette mydriase propre aux vrais fondus, se devinent déjà toute l’érudition et la passion qui nous en apprendront beaucoup en peu de temps sur les pieds nickelés. Ses frisettes gigotant au rythme de ses propos, il déclare : « Les Ramones constituent la meilleure porte d’entrée dans le punk rock grâce à leurs morceaux, presque pop, composés des mêmes trois accords et de paroles simples qui plaisaient autant aux filles qu’aux garçons. Ils ont complètement influencé le punk anglais par la rapidité de leur jeu et leur talent pour le marketing. Ils vendaient plus de t-shirts que d’albums dès le début. » Érudition toujours, le chanteur pop colmarien nous apprend maintenant que pendant le shooting de la pochette du premier album, Dee Dee avait marché dans une merde de chien. Que Joey était un Trumpiste avant l’heure. Que leur nom provenait d’un pseudo de Paul McCartney, Paul

Ramone, et qu’ils pissaient dans les canettes de bière de leurs invités… Alan Simon, l’ancien batteur de Maltdown à la tignasse de metalleux, est plus succinct. Il parlera de sa passion du début pour les morceaux les plus pop en esprit et humour. L’intermède des dingos de la rampe tout en claquements et râles sourds laissera Syd, généraliste et manager de groupes, nous confier son trouble pour le rock et les apéros. « Mon but était de faire revenir le rock au Nouma avec les Rock After Work. Une fois par mois, généralement le jeudi, les Mulhousiens peuvent venir prendre l’apéro en sortant du boulot et assister à un concert gratuit. » Ce gaillard grisonnant et hyperactif est devenu manager de groupes locaux sur les demandes insistantes des Hooks. « Puis, on a créé Rock Around The Border, en référence aux trois frontières, pour structurer tout ça. C’est une agence de booking, d’accompagnement de groupes locaux, on s’occupe aussi de la programmation des RAW. » Au sein de cette écurie financée par mécénat, on retrouve notamment Kamarad, Prokop, The Prisoners ou Nina Campani. Quant à la liste de programmation, elle s’allonge avec goût : Howlin’ Jaws, You Said Strange, Laurie Wright, Laetitia Shériff, Mad Foxes, The Shivas ou After Geography… Avant les au revoir, tout le monde se fendra d’une félicitation et d’une tape sur l’épaule d’Hugues pour la naissance d’Antoine.
Hugues, qu’on a retrouvé fin novembre pour un somptueux concert privé d’Hicks & Figuri à Colmar. Arrivé le dernier d’un autre tournage, il dégaine son portable avec système anti-secousse et capture un gaillard à barbe grise, Pierre Walter. Il avait déjà irradié de sa grâce des groupes comme Loyola, Spide, Marxer ou Original Folks, c’est maintenant avec son projet solo Hicks & Figuri qu’il nous émouvra de sa voix profonde, captivante. Au rythme d’un album par an, il puise dans un répertoire conséquent des compositions pop épurées et bouleversantes. Hugues s’accroupit pour filmer au milieu du public le titre The Pines. Pierre était en présentation de son album live Au lavoir, mais aussi pour annoncer son successeur, l’élégant The Girls From the Lab. En pantalon ocre et gilet bleu, ce Strasbourgeois de 47 ans se livre en émotion jusqu’à en toucher certains aux larmes. Puis Hugues l’interviewera pour la Kamaraderie sur le tapis persan de la pièce. Je n’en divulguerai rien, à voir sur YouTube en 2025. Un projet ambitieux qui fonctionne au mécénat, à la passion et à la franche Kamaraderie.
— KAMARADERIE SHOW, un projet haut-rhinois très ambitieux sous ses airs de franche kamaraderie www.youtube.com/@kamaraderieShow
DIG IT UP… AND THROW IT OUT!
Par Alma Decaix-Massiani ~ Photo : Jérôme Jean

Cela faisait deux ans que Hugo et Joe avaient décidé de mettre leur groupe de rock The Hook au placard. Après dix ans de bons et loyaux services pour la scène musicale alsacienne, ils l’avaient annoncé, rock and roll is dead . Mais si le rock est mort, le blues, lui, n’a jamais cessé de respirer, d’exister au creux de leurs doigts. The Hook est et a toujours été un groupe de rock and roll qui donne envie de faire partie d’un groupe de rock and roll. Sur scène, c’est à vous transcender l’âme. Les solos de Hugo pourraient atteindre les neurones de Rory Gallagher et le réveiller de sa sieste éternelle tant la puissance est palpable. La voix de Joe est un appel à la révolution. Laissez-vous emporter par les tambours d’Éric, que vos jambes cèdent au groove de Massimo à la basse. C’est le rêve de deux adolescents qui, sans se le dire, se sont toujours secrètement promis de ne jamais s’arrêter, de toujours vivre pour et par la musique, de ne jamais se lâcher, peu importe les obstacles, afin de toujours et à jamais faire bouger les corps et les cœurs.
Tchekhov écrivait dans Platonov qu’il faut « enterrer les morts et réparer les vivants ». Il est donc l’heure pour The Hook d’enterrer la hache de guerre et réparer le rock mulhousien. Ils sont de retour avec une surprise de fin d’année : un EP de quatre titres qui s’annonce prometteur, car il comporte autant de morceaux aux rythmes frénétiques que de mélodies vibrantes témoignant aussi du fait que les esprits se sont apaisés. Dig It Up! est à vous, et la sortie de l’EP est accompagnée d’un clip pour le morceau au titre éponyme. Chacun des morceaux de l’EP signe une facette du groupe et s’écoute en fonction de l’humeur : « Dig It Up! » réveille et remue. Pour un moment de douceur, « By My Side » vous rappellera aux tendres soirées amoureuses. Dans la même ivresse, « Chasing the Light » vous propose un voyage astral au cœur du trip psychédélique. Enfin, quand l’heure est à la passion, « Shake Shake Shake » s’écoutera comme un hymne sensuel.
Le nouvel EP de The Hook est le symbole fort d’un retour tant attendu en Alsace. Un retour en studio, mais aussi sur scène, car après avoir joué à La Laiterie en première partie de KO KO MO en novembre dernier et au bon vieux Noumatrouff de Mulhouse pour le festival Locomotiv’, ils sont back on track ! It’s only rock and roll but I like it. Eux aussi, et ils le font avec brio.
— THE HOOK, DIG IT UP!, Médiapop records
The Big Picture
Le talent made in America crevait l’écran de la 39e édition d’Entrevues ; Jinho Myung, Alexandra Simpson et Nancy Savoca en étaient les représentants.
NANCY SAVOCA THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN'
LA CINÉASTE AMÉRICAINE NANCY SAVOCA ÉTAIT L’INVITÉE D’HONNEUR DU FESTIVAL ENTREVUES, DONT LA

Originaire du Bronx, ses premiers films dépeignent avec amour, humour et franchise la communauté italo-américaine, bien avant qu’Hollywood ne l’épuise en en faisant des stéréotypes liés à la mafia. Hollywood dont la réalisatrice n’a jamais cessé de défier les contraintes en affirmant son regard lucide et attendri. Rencontre.
La 39 e édition du Festival Entrevues met en lumière vos premiers films, y compris vos courts métrages. Lorsque vous voyez ces œuvres avec votre regard d’aujourd’hui, quelles sont vos impressions à l’égard de la jeune cinéaste que vous étiez ?
C’est très intéressant que vous posiez cette question, car lorsque nous avons entrepris la restauration de Household Saints (1993), j’ai mentionné que nous avions passé très peu de temps sur le montage, et je me suis demandé s’il y avait quelque chose que j’aurais aimé faire différemment. L’opportunité s’est présentée, et on m’a demandé si je souhaitais proposer une version director’s cut En réalité, ce n’était pas une situation où le film m’avait été retiré et où je n’avais pas pu monter la version à laquelle je tenais. J’avais fait tout ce que je pouvais avec les moyens dont je disposais.
En étudiant le film, j’ai décidé de le laisser tel qu’il est. J’ai réalisé ce film il y a 30 ans, et je ne voulais pas trahir les intentions que j’avais à l’époque. C’est pour cette raison que je ne regarde pas mes propres films. J’aurais probablement envie de changer tellement de choses. Mais ces films appartiennent à cette période, et la personne qui
Par Öykü Sofuoğlu ~ Photo : Olivier Legras
les a réalisés est différente de celle que je suis aujourd’hui. Cela dit, quand j’y pense, je peux voir une jeune femme très, très combative.
En écoutant vos entretiens passés, on a l’impression que vous tenez beaucoup aux potentiels explorateurs du cinéma. Diriez-vous que le fait d’aller de l’avant, sans regarder en arrière, correspond à cette prédilection pour l’exploration ?
Je n’ai jamais fait de films sur des choses que je savais déjà ni pour les raconter à l’audience. Tous les films que j’ai réalisés, je les ai tournés parce que j’étais confuse, je me posais des questions. Je me demandais si le public ressentirait la même chose, et à partir de là, un dialogue pourrait se créer entre nous. Faire des films, c’était plus lié à se poser des questions qu’à faire des affirmations.
Au cours de votre parcours, vous avez travaillé à partir des scénarios aux provenances et contextes de production variés. Comment avez-vous navigué entre ces récits pour les faire vôtres ?
Je trouve que travailler avec différents types de textes est fascinant. True Love (1989), mon premier film, était basé sur des expériences personnelles. Pour être honnête, pour poser des questions, au lieu de prétendre que je savais tout, je procédais comme une anthropologue dans mon propre monde. Dogfight (1991) ressemblait à une mine terrestre avec plein de problèmes éthiques et moraux que j’ignorais. Après avoir accepté le projet, j’ai dû me battre pour creuser mon chemin. Mon troisième film, Household Saints, était basé sur un roman de Francine Prose que j’avais lu au collège. À l’époque, je lui avais écrit une sorte de lettre d’amour où je disais que « j’apprenais à faire du cinéma et que j’aimerais bien adapter votre récit un jour, car vous connaissez très bien mon enfance ». C’est vrai que je ressemblais beaucoup à Teresa.
À part vos expériences familiales et intimes, aviezvous d’autres sources d’influence qui vous ont poussée à explorer le médium cinématographique, qui vous ont fait dire : « Moi, je vais faire du cinéma ! »
Pour moi, c’était le cinéma et la musique – deux choses qui ont permis à ma famille d’immigrés d’accéder à la culture américaine. Par ailleurs, comme mes parents venaient d’un pays différent, le cinéma international n’était pas perçu comme exotique ou bizarre. Nous regardions des films de n’importe quel pays, et pour l’occasion, toute la famille se réunissait. Si nous regardions un film américain, je devais être l’interprète. Les films qui m’ont le plus touchée étaient des films néoréalistes,
ainsi que le réalisme social des années cinquante aux États-Unis. Puis, en grandissant dans les années soixante-dix, regarder les films de Martin Scorsese, Sidney Lumet ou encore, dans les années quatre-vingt, ceux d’Euzhan Palcy, m’a permis de pénétrer un monde que je croyais avoir peu de points communs avec le mien, mais qu’en réalité je connaissais très bien.
Il n’est pas difficile de voir que vous recherchez l’authenticité chez vos personnages. Cependant, le rapport au temps dans vos films est bien plus complexe qu’il n’y paraît. On vous applaudit pour votre volonté de rester fidèle à l’esprit d’une période, alors que, dans les récits qui se déroulent à l’époque où ils ont été tournés, cet aspect découle naturellement. Que pensez-vous de ces interprétations quelque peu anachroniques ?
Je trouve très amusant quand les gens viennent me dire que True Love est tellement un film des années quatre-vingt. Il l’est, parce que nous l’avons tourné à cette époque : ces cheveux, ces vêtements sont tels qu’ils étaient. Dans le cas de Dogfight, nous avons mené des recherches approfondies, tout comme pour Household Saints , où il y avait trois époques différentes. En revanche, je suis consciente que, autant que l’on puisse faire des recherches, notre vision découle toujours d’une nostalgie de ce qu’aurait pu être le passé, et pas nécessairement de ce qu’il était réellement.
Votre film Household Saints a été restauré et ressorti en salles aux ÉtatsUnis. Le fait qu’il ait été cru perdu a été largement souligné lors de sa ressortie. Aujourd’hui, l’industrie cinématographique américaine ne se sert-elle pas de l’invisibilisation de certains cinéastes comme outil marketing, alors qu’elle en a été, en grande partie, responsable en premier lieu ?
C’est intéressant ce que vous dites… Je me demande s’ils sont conscients de ce qu’ils font aujourd’hui. Désormais, je sais très bien comment les personnalités disparaissent de l’histoire du cinéma. J’ai été tellement choquée d’apprendre tout ce qui est arrivé à Alice Guy-Blaché ou à Oscar Micheaux. J’ai étudié à l’Université de New York, l’une des meilleures écoles de cinéma, mais je n’avais pas d’exemple à suivre. J’étais seule et espérais devenir comme les « mecs ». J’aurais aimé savoir que tant de personnes différentes s’étaient, en réalité, engagées dans le cinéma. Mon grand souci pour aujourd’hui et pour l’avenir est de m’assurer que les gens sachent que nous avons une vaste diversité parmi celles et ceux qui font du cinéma et racontent des histoires importantes de femmes, de personnes queer, de personnes racisées.
Dans le contexte des restaurations, une cinéaste en marge est vouée d’emblée à disparaître. Pourquoi ? Parce que ses œuvres n’ont pas fait de grosses entrées, qu’elles sont considérées comme ayant peu de valeur et que les gens s’en fichent. Si nous en sommes tous conscients, nous devons trouver des moyens de sauver ces films. Je parle ici de gestes simples, à l’échelle locale et individuelle. Même si un film existe en format DVD, il faut aussi le numériser, en prendre soin. Peu importe si c’est toi qui l’as réalisé ou non, nous devons préserver ces films pour nous tous.
JINHO MYUNG, ALEXANDRA SIMPSON
AMERICAN BEAUTIES
LA JEUNE GARDE DU CINÉMA INDÉPENDANT AMÉRICAIN A
ÉCLABOUSSÉ DE SON TALENT LA 39e ÉDITION DU FESTIVAL
ENTREVUES. FOCUS SUR DEUX DE SES PLUS BRILLANTES PROMESSES, JINHO MYUNG ET ALEXANDRA SIMPSON.
Ils sont jeunes – respectivement 23 et 27 ans –mais tout dans leur geste de cinéma témoigne d’une maturité que l’on prête habituellement à des auteurs plus confirmés. Jinho Miyung, lauréat à Belfort du Grand Prix Janine Bazin pour son film Softshell et Alexandra Simpson, qui signe No Sleep Till, un premier long métrage remarqué pendant cette semaine festivalière, apportent la preuve que le cinéma « indé » a encore de beaux restes dans une Amérique aujourd’hui minée par le repli identitaire et le retour de l’ultraconservatisme.
S’il n’est dupe de rien, le propos n’est toutefois jamais frontalement militant chez ces deux cinéastes. Simpson et Myung insistent plutôt sur
la dimension intime de leurs personnages pour nous parler d’une Amérique des minorités et des marges – un frère et une sœur new-yorkais d’origine thaïlandaise dans Softshell ; les résidents d’une banlieue de Floride parmi lesquels une adolescente, un « chasseur de tempête » ou un duo d’apprentis humoristes dans No Sleep Till
Dans cette dernière fiction, un cyclone menace une zone côtière du sud-est des États-Unis. Alors que la population s’organise pour quitter les lieux, le film nous met en présence d’une poignée de quidams ayant choisi de contrevenir à l’ordre d’évacuation. « Mes personnages sont des gens plutôt précaires ou fragiles », remarque Alexandra Simpson, « mais tous sont porteurs d’une force au
Par Nicolas Bézard ~ Photo : Olivier Legras

sein même de leur vulnérabilité qui les encourage à saisir ce prétexte de l’ouragan pour changer quelque chose dans leur vie. »
La place de cet ouragan dans le film est à la fois centrale et parfaitement abstraite, tel un vortex autour duquel les personnages graviteraient, puissance de libération jamais montrée à l’écran, mais que la mise en scène suggère habilement. Car le mouvement commun à ces longs métrages – auxquels il conviendrait d’associer l’épatant Invention de Courtney Stephens, également sélectionné à Belfort –, c’est le « pas de côté » vers des géographies périphériques, des figures d’anonymes ou d’outsiders, une jeunesse trouvant dans les ruines d’un héritage familial, territorial ou culturel – ces mythologies usées de l’entertainment américain – les fondations d’un lieu à habiter, d’une identité à construire. Décentrée et éclatée, la narration de No Sleep Till s’épanouit en marge des moments cardinaux et du bruit. Elle privilégie la forme chorale et la langueur étirée des nuits bleues de la vieille Floride aux tumultes d’une intrigue qui avancerait bêtement vers sa résolution. « Je n’aime pas sentir le scénario quand je vais au cinéma, cela me sort systématiquement du film. Je cherchais donc à raconter plus abstraitement les choses », confie Simpson. « J’ai regardé en direction de la
Nouvelle Vague taïwanaise et j’ai trouvé dans l’œuvre de Tsai Ming-liang une façon libre et non prévisible de raconter les histoires, avec l’idée d’être dans le moment présent aux côtés des personnages sans avoir à les inscrire dans une temporalité précise, ou à les traiter au même niveau. » No Sleep Till est parcouru de somptueux moments de cinéma. Avec l’aide du chef opérateur Sylvain Marco Froideveaux, la réalisatrice parvient à donner une matérialité, une texture presque palpable au temps qu’elle explore pour sa capacité à injecter de l’étrangeté dans des histoires a priori sans relief. Cette ronde de figures esseulées dans une Amérique en voie de disparition évoque l’univers de Raymond Carver, un écrivain cher aux yeux de cette Franco-Américaine ayant principalement grandi en Europe : « Je suis touchée par le regard qu’il porte sur des personnages qui n’ont pas conscience d’être aliénés », explique-t-elle. « Chez Raymond Carver, les gens sont prisonniers d’une situation familiale ou sociale, d’un métier, d’une routine. Dans ses nouvelles, il y a toujours ces moments vertigineux où la banalité quotidienne se transforme en gouffre existentiel. »
On pense moins à Raymond Carver qu’à J. D. Salinger en découvrant Softshell. Si l’auteur de Franny et Zooey était aujourd’hui un cinéaste d’une vingtaine d’années, nul doute que ses films ressembleraient beaucoup au premier long métrage de fiction de Jinho Myung. « Soft shell », ou carapace molle, désigne une espèce de tortues chétives utilisée dans certaines recettes traditionnelles de la cuisine thaïe – leur fragilité les rendant inaptes à la survie en milieu naturel. Au début du film, Jamie et Narin ressemblent eux aussi à des créatures désarmées et peu amènes de faire leur entrée dans le monde des adultes. Une entrée néanmoins précipitée par le décès tout récent de leur mère, garante d’une histoire familiale dont ils n’ont conservé que des bribes. Pour dresser ce portrait d’une jeunesse Jinho Myung
américaine issue de l’immigration asiatique, Jinho Myung, Californien d’origine coréenne, a souhaité revisiter les codes esthétiques du Mumblecore. Ce sous-genre du cinéma indépendant s’est développé dans les années 2000 au travers de films à petits budgets mettant en scène de manière improvisée des jeunes gens blancs et bourgeois. « J’ai été particulièrement touché par cette esthétique que l’on retrouve aujourd’hui dans la plupart des films indés », explique-t-il. « J’ai donc décidé d’en reprendre certains traits caractéristiques tels que l’utilisation de la caméra portée, pour raconter des histoires et dépeindre des personnages peu représentés au cinéma. »
Si Softshell est empreint de l’énergie et du naturalisme propre à cette mouvance, Myung assume aussi de s’en démarquer en optant pour la pellicule, là où le Mumblecore revendiquait une cinématographie « fauchée » justifiant l’utilisation de caméras numériques bon marché. Un choix audacieux qui a contraint le cinéaste à prendre un emploi alimentaire pour couvrir les frais de laboratoire, mais un médium susceptible d’apporter la dimension physique et sensuelle essentielle à son projet : « Aujourd’hui, la plupart des spectateurs connaissent l’esthétique de la pellicule, qui propose un rendu immédiatement séduisant. Cela relève peut-être d’une forme de paresse, mais je voulais que le public puisse se sentir d’emblée proche des personnages que je mettais en scène, une proximité favorisée par la matérialité de l’image argentique. » Mobile et attentive, la caméra dirigée par le chef opérateur Rhys Scarabosio confère au film un supplément de véracité et d’intensité émotionnelle. Par la seule manière dont elle se positionne dans l’espace, elle peut changer le cours d’une scène, en modifier la texture dramaturgique ou en briser la linéarité. « Rhys travaille avec une caméra 16 mm de marque française équipée d’une focale fixe et qui n’a donc pas de fonction zoom », précise Jinho Myung. « C’est très intéressant, car si l’on veut filmer de près les personnages, il faut déplacer son corps dans l’espace. Cela crée un dynamisme imprégné d’un certain style vu chez les frères Dardenne notamment. »
Il y a une générosité constamment à l’œuvre dans ce long métrage qui refuse de choisir entre fiction et documentaire, acteurs de métier et non professionnels, profondeur et surface. Tout s’entremêle avec grâce à la faveur d’une écriture désireuse d’ouvrir cette esthétique identifiée de la pellicule à d’autres régimes d’images, comme celles émanant du jeu vidéo lo-fi auquel s’adonne Jamie. En recourant parfois au split-screen, ce langage reflète l’identité hybride des deux protagonistes et soulève un champ d’interrogations très contemporaines :
qu’est-ce qu’être multiple ? Comment parvenir à faire tenir ensemble plusieurs identités ? Myung n’apporte pas de réponses univoques à ces questions, mais laisse son film se parer d’une charge d’hétérogénéité et d’imprévu, dans une forme de mise à jour constante de ses enjeux, de ses effets.
L’inattendu surgit enfin dans la façon dont le film décline toute la gamme des rapports que peuvent entretenir les hommes avec les animaux, du plus tendre au plus brutal. Si le deuil de la mère semble longtemps occulté par le quotidien nonchalant de Narin et Jamie, il revient en force lors d’un quiproquo tendu impliquant une tortue à carapace molle, malentendu qui forcera la jeune femme à se confronter pour de bon à la perte. Climax d’un film jusqu’alors constitué d’une suite de glissements narratifs, ce tournant émotionnel réinterprète astucieusement la célèbre scène de la douche dans Psychose pour amener le public à repenser ses propres perceptions face à certaines situations qu’on lui présente. « Je pensais effectivement à la scène de la douche dans Psychose » , confirme le réalisateur. « J’avais à l’esprit cette idée de quelqu’un qui s’introduit dans un espace intime pour y commettre un acte terrible. C’est ce qui se passe dans Softshell, mais à la différence du personnage inventé par Hitchcock, l’homme qui en est à l’origine, dans mon film, n’est pas violent, et agit par pure ignorance. Il y a eu une période où je regardais des chaînes YouTube dédiées à des vidéos tournées par des touristes occidentaux en Asie. Elles montraient différents aspects de ces cultures sous un angle un peu folklorique, un de ces aspects étant la cuisine d’aliments et de créatures plus ou moins inconnus chez nous. On y voyait des animaux se faire massacrer avant d’être cuisinés. Devant ce spectacle insoutenable, j’ai pu constater à quel point un contexte culturel donné pouvait rendre acceptables certains agissements, ou le fait de regarder ces derniers sur YouTube comme si de rien n’était. Je crois qu’il est essentiel de penser la manière dont on perçoit les autres, en prenant conscience des filtres qui peuvent influer sur notre regard. »
— SOFTSHELL, Jinho Myung
— NO SLEEP TILL, Alexandra Simpson
Retrouvez l’intégralité des entretiens réalisés pour Entrevues sur toutes les plateformes de podcast, sur le site de Flux4 : www.flux4.com/index.php/entrevues et du festival : www.festival-entrevues.com /fr/entrevues-numerique
Au-delà des cadres
Cerith Wyn Evans dépasse les limites de la perception au Centre Pompidou-Metz, le Frac
Franche-Comté témoigne d’un monde en bascule, Camille Brès reflète le réel, le musée Würth s’empare des livres et la BNU déploie l’œuvre protéiforme de Jean Alessandrini.
ÉCLATS À DÉPLIER
Par Benjamin Bottemer
EN SUPERPOSANT LUMIÈRES, SIGNES
ET SONS DANS UN ESPACE OUVERT SUR
L’INFINI, PERCHÉ SUR LES HAUTEURS DU CENTRE POMPIDOU-METZ, CERITH WYN
EVANS JOUE AVEC NOS PERCEPTIONS ET OFFRE UN VERTIGE.
L’écran était trop étroit pour lui : cinéaste expérimental jusqu’au début des années 90, Cerith Wyn Evans se tournera ensuite vers la sculpture et l’installation. Mais les concaténations d’images, de sons, de références encapsulées sur la surface cinématographique continueront à résonner dans ses œuvres. Lorsque réunies au sein de « jardins », dont le Centre PompidouMetz propose deux variations, elles se (re)constituent en visions complexes, enrichies de nouveaux jeux de superposition, de lumière et de perspective. Moustache blanche, crâne dégarni et lunettes rondes, le Gallois a tout du professeur mais se garde de toute interprétation lorsque nous naviguons avec lui au cœur de « Lueurs empruntées à Metz ». Il préfère nous laisse évoluer dans la « chorégraphie » installée dans la Galerie 3, la plus élevée du musée. Un perchoir idéal pour ouvrir notre regard sur l’horizon ; libre à nous de plonger ensuite dans la multitude de références littéraires, musicales, philosophiques nichées au creux de ses sculptures transparentes, traversées par la lumière naturelle et celle des néons.
GAZ CAMÉLÉON
Si à l’heure des LED le néon semble un objet du passé, pour Cerith Wyn Evans, il a même quelque chose d’antique : dans le Forum, deux colonnes se dressent vers la toiture, éteintes, laissées là comme les ruines d’un temple. À leurs pieds, des plantes en pots et trois imposantes géodes d’améthyste, comme un dialogue entre nature et culture. « La technologie, en soi, est une transmutation de matériaux naturels : les chakras ou l’intelligence artificielle sont des technologies ; ça peut être un processus organique, commente l’artiste. Mais je n’entretiens pas moi-même de relation intime avec la technologie : chacun a la sienne, moi je m’en sers pour instaurer un climat. »
Dans la Galerie 3, les frontières sont abolies : les baies vitrées aux extrémités sont ouvertes sur la cité tandis que des miroirs recouvrent les murs, plongeant œuvres et visiteur dans l’infini. En fonction de son point de vue, celui-ci aura une perception différente d’une exposition qui, prise dans sa totalité, augmentée par les vues sur la ville, constitue une œuvre en elle-même. Au centre de la galerie, les Neon Forms tracent dans l’air des motifs complexes. Signatures pleines de sens cachés, qui s’inspirent des diagrammes kata traduisant les mouvements du théâtre Nô, elles dessinent aussi des formules chimiques, comme celle du LSD… un clin d’œil à la transformation des perceptions qui opère ici ? Quant aux lignes de Neon After Stella, qui reproduisent en négatif les peintures noires de l’artiste américain, leur superposition forme un double labyrinthe dans lequel déambuler. On pourrait toucher l’ensemble des œuvres rassemblées dans la galerie : une proximité indispensable à une immersion véritable.
PARTITIONS EN ACCORDÉON
L’ouïe est également sollicitée : sonorités et musiques résonnent à diverses fréquences, tout comme les lumières. « C’est comme une bande-son, mais la musique n’a pas vraiment de relation avec les œuvres, qui sont des véhicules pour le son », précise Cerith Wyn Evans. Glissés au milieu de dixsept panneaux de verre suspendus transformés en haut-parleurs, dont le titre fait référence à la pièce de Pierre Boulez Pli selon pli, on peut entendre les sons émis par des satellites en orbite ainsi qu’une composition pour piano. L’instrument résonne un peu partout : autour de ce gong entouré d’une couverture argentée, dans les clignotements de Mantra , qui traduit une composition de Stockhausen en lumières… On ne peut s’empêcher de comparer l’alignement des touches noires et blanches du piano, et les combinaisons infinies qu’elles permettent, au travail de l’artiste gallois, où répétition et superposition jouent un grand rôle. Porteuse d’une énergie issue « d’images de pensées », qualifiée de « techno-animiste », le travail de Wyn Evans se déploie au sein d’une exposition hautement photogénique. Si ce dernier

qualifie les smartphones d’« appareils tyranniques omniprésents régis par des algorithmes conçus pour servir nos désirs picturaux », nul doute que les images capturées de « Lueurs empruntées à Metz » apparaîtront sur les réseaux de nombreux visiteurs. Sans parvenir à reproduire la profondeur et les sensations provoquées par une exposition en forme
de leporello, ces livres-accordéons à plier et à déplier pour mieux les observer sous toutes les coutures.
— LUEURS EMPRUNTÉES À METZ, exposition jusqu’au 14 avril au Centre Pompidou-Metz, à Metz www.centrepompidou-metz.fr
Cerith Wyn Evans, *Neon Forms (after Noh I)*, 2015. Autorisation Cerith Wyn Evans et White Cube. Vue de l’exposition au Centre Pompidou-Metz © Cerith Wyn Evans. Photo : Lewis Ronald

Jordan Paillet, La petite fille aux allumettes, 2023-2024. Vues de l’exposition Étonner la catastrophe au Frac Franche-Comté, 2024
© Jordan Paillet.
Photos : Blaise Adilon
LE MONDE DE DEMAIN QUOI QU’IL
ADVIENNE NOUS APPARTIENT…
Par Nathanaelle Viaux
AU FRAC FRANCHE-COMTÉ, ÉTONNER LA CATASTROPHE BOULEVERSE, AU TRAVERS DU REGARD D’UNE NOUVELLE GÉNÉRATION D’ARTISTES.
Ce matin, j’ai reçu un message d’une amie qui m’écrivait ceci : « On a vu l’ expo « Étonner la catastrophe » au Frac et je trouve ça très cool, on y est restés plus d’une heure, on a dû partir, car ça fermait. Je te la conseille, c’est passé hyper vite, on a carrément kiffé de ouf ! » Je lui ai répondu immédiatement que je l’avais déjà vue et que je devais écrire un article dessus. Elle m’a répondu : « T’as vu ? Y’avait même Pedro de la série Un, dos, tres . » Évidemment ! C’était mon personnage préféré !
Et, soudain, je me rends compte que le monde a changé. La pop culture des années 2000 est présente dans les musées, Pedro le prolo, la star du petit écran est devenue une œuvre d’art. Un personnage que toute une génération a kiffé. Mégane Brauer en fait une Madone.
« Étonner la catastrophe » est un titre qui déstabilise un peu. Ce bout de phrase est issu d’un passage des Misérables de Victor Hugo : « L’aurore ose quand elle se lève. Tenter, braver, persister, persévérer, s’être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu’elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête ; voilà l’exemple dont les peuples ont besoin, et la lumière qui les électrise. »
Cette exposition rassemble cinq artistes, anciens élèves de l’Institut supérieur des beaux-arts de Besançon. Aujourd’hui, ils ont tous une trajectoire artistique très distincte. Aucune ne se ressemble, et, pourtant, en filigrane une même préoccupation éclot : la crise mondiale, le dérèglement climatique… Entre anxiété, colère et stupeur, leur cœur balance. Et c’est dans la création qu’ils vont agir pour que demain existe encore. Le futur est une catastrophe tapie dans la forêt qui brûle, qui attend son heure. Ça y est ! C’est déjà l’heure ! Les cinq artistes nous interpellent. À travers leurs œuvres, par cette colère qui nous dépasse, qui nous illumine, drôle et pétillante, ils provoquent l’enfant qui sommeille en nous.
Pour « Étonner la catastrophe », chacun d’entre eux a eu pour commande de choisir une œuvre du Frac qui fait écho à leur travail. June Balthazard nous propose donc Millennials , un récit filmique d’anticipation, accompagné d’une installation qui raconte la croisade d’enfants qui veulent sauver une forêt. L’artiste s’est inspirée d’un mouvement de jeunes porté par Greta Thunberg. Hippolyte Cupillard offre aux visiteurs le visionnage de ses films d’animation, dont un film sur les salles de cinéma vides pendant la crise du Covid. Son écriture spontanée et onirique aborde des thèmes universels comme l’enfance, la vieillesse, le monde qui se transforme sous nos yeux contemplatifs ou terrorisés. Mathilde Chavanne, la réalisatrice du court métrage Pleure pas Gabriel, nous balance
comme ça : « J’aime bien utiliser l’humour pour taper plus profond, c’est un film sur des gens qui vont mal dans un monde qui va mal. » Son désir de cinéma est une façon d’étonner la catastrophe, une pulsion de vie.
Mégane Brauer, quant à elle, écrit beaucoup. Elle utilise le langage inclusif, c’est fluide, c’est beau, j’aime l’écouter. Elle laisse reposer ses écrits et crée, quelques années plus tard, des œuvres en lien avec ceux-ci, preuves de son existence, ou de celle des autres. « Ceux qu’on ne voit pas… » Son travail est une sorte de témoignage, attestant de la vérité. Dans ses œuvres qui tapent à l’œil, les invisibles deviennent des héros à paillettes.
L’exposition se termine avec Jordan Paillet. On se retrouve face à des vêtements accrochés au mur sur lesquels on peut lire des bouts de phrases d’un conte populaire : La petite fille aux allumettes « Le vêtement est un support d’expression fort », explique Jordan Paillet, qui aime la mode et ça se voit. Pour autant, il vient d’un milieu modeste, et il distingue la mode et le luxe. Il compte utiliser le vêtement de manière détournée, dans un souci d’éthique, en se servant de vêtements de seconde main qu’il mettra en vente pour verser l’argent gagné à Emmaüs.
Malgré l’anxiété qui s’est emparée de la jeunesse, elle trouve encore à nous montrer la beauté qui existe, qui subsiste dans un monde qui bascule.
— ÉTONNER LA CATASTROPHE,
exposition jusqu’au 30 mars au Frac Franche-Comté, à Besançon www.frac-franche-comte.fr

CONTEMPLATIONS
Par Valérie Bisson
CAMILLE BRÈS EST PEINTRE. DIPLÔMÉE EN 2011 DE LA HEAR AVEC
LES FÉLICITATIONS DU JURY, ELLE TRAVAILLE DÉSORMAIS AU SEIN
DES ATELIERS DES HAUTES PLAINES À STRASBOURG ET EXPOSE À LA GALERIE EAST.
Ses sujets de prédilection prennent vie dans la fugacité des visions du quotidien, scènes familiales et amicales , paysages et lieux coutumiers ; la persistance rétinienne vient alors s’ornementer d’une matière colorée qui va transformer le réel.
Par le choix des sujets, le quotidien semble occuper tout votre espace de création ?
Ma production s’est longtemps articulée autour d’autoportraits et de portraits de proches ainsi que de scènes du quotidien. Cependant, il n’y a pas de velléité autobiographique, c’est important que mes modèles soient des proches, mais ma peinture leur confère une place d’acteurs. La captation de moments intimes renvoie à une certaine banalité que je reconnecte à des sujets plus éloignés. Mon travail a toujours été figuratif, mais il n’y a jamais eu de sujet prétexte, tous les sujets que je propose ont leur importance et je fonctionne par allersretours entre ce que je veux dire et la matière. Je peins depuis peu des paysages comme les jeux de reflets aquatiques présents dans l’exposition. La photographie est souvent la première image source avant d’entrer dans la matière. J’aime intégrer des rapports de symétrie dans mes compositions, le réel et son reflet montrent un envers, ouvrent un espace dans l’espace. Je suis très inspirée par le réel et les jeux de mélanges foisonnants qu’il offre constamment, beaucoup de signes y cohabitent de manière naturelle et paradoxale. C’est aussi comme cela qu’a été construite l’exposition, en considérant chaque tableau comme autonome et entrant en résonance.
Quelles sont vos techniques de prédilection ?
J’ai commencé avec l’huile, puis la gouache, et j’utilise les pastels gras sur papier depuis quelques années. Je complète avec des crayons à la cire pour les détails très graphiques, j’utilise des NéocolorTM et des pinceaux qui me permettent une plus grande précision. Cette technique me permet de travailler une pâte, des couches en aplats uniformes coloriés puis unifiés au doigt ou en touches avec des petites gouges en guise de spatules pour enlever ou ajouter de la matière. Le pastel gras est incroyablement souple et je peux composer avec des zones floues et des zones de tension plus grandes. J’aime la vibration et l’éclat de la couleur sur des surfaces planes confrontées à des couleurs plus sourdes, beiges, gris, blancs… Je suis entrée dans la peinture par la couleur mais il est vrai que, depuis peu, le noir et le blanc commencent à s’y inviter.
Qu’entendez-vous par zones de tension ?
La mise en œuvre de la réalité n’a pas d’ordre précis, je fais attention à ce qu’il n’y ait pas de hiérarchie, le rapport à une expérience esthétique ou émotionnelle prédomine, autant de raisons pour que je me concentre sur le reflet et que cette thématique émerge dans mon travail. Toutes les histoires que je me raconte finissent par « comment vais-je les représenter avec mes couleurs et ma matière ? » Cette recherche d’équilibre est constante. Je suis très attentive à la tension qui émerge dans la rencontre entre une recherche de séduction et une composition rigoureuse, presque artificielle. J’essaye de recadrer le réel avec des prises de risques incursives, par la couleur, un élément, ou un autre espace.
— CAMILLE BRÈS, EFFET MIROIR, exposition du 8 février au 12 avril à la Galerie EAST, à Strasbourg www.galerieeast.com camillebres.com
LE POIDS DES MOTS
Par Luc Maenchel

L’exposition « Bibliothèque Fantastique », conçue par l’équipe du musée, présente à la fois des œuvres qui se sont emparées des mots, de l’écriture et des livres d’artistes issus tant du fonds Würth, que de la collection personnelle du généticien Jean-Louis Mandel. S’y retrouvent des noms prestigieux de l’art contemporain, mais aussi de la littérature. Dans le hall, Lost (1996), œuvre maligne et hypnotique de Patrick Hughes, est une jolie entrée en matière : on croit voir une vidéo, sauf que c’est une pièce en volume où tout est peint et statique. Les déplacements assurent la cinétique avec l’impression d’évoluer dans une bibliothèque ! Deux pièces monumentales d’Anselm Kiefer dominent
ensuite la salle du bas. Mutterkorn (2007) est un gisement fuligineux vers les mots de Paul Celan écrits en haut de la toile et, fermant la perspective avec ses gigantesques livres en plomb, la Bibliothek mit Meteoriten (1991) pèse onze tonnes… Avec le banc en marbre de Jenny Holzer, les grès de Susanne Egle, les terres cuites de Günter Grass, perce comme une instinctive volonté d’ancrer la légèreté des mots dans le dur et le lourd… Et conjurer ainsi leur volatil destin ?
L’imposant G raphein (Günther Uecker, calligraphies d’Hans Peter Wilberg, 2002) donne un avant-goût des livres d’artistes exposés à l’étage. Si le pop-artiste britannique Eduardo Paolozzi crée les pages de Bunk! (1972) avec des images issues de magazines, la plupart du temps, la démarche est collective, avec l’envie de proposer une œuvre moins onéreuse. Bien qu’ils soient vingt-huit pour 1 ¢ Life (1964) avec une couverture d’Andy Warhol, le plus souvent ce sont des binômes qui les imaginent : les Arp, Breton/Éluard/Dali, Prévert/ Ernst, Butor/Alechinsky…
Enfin, l’illustration s’invite dans la dernière salle avec les planches d’El Conejo y el Coyote (Le Lapin et le Coyote, 1979) de Francisco Toledo, plusieurs dessins de Max Ernst et Tomi Ungerer qui suggérait joliment : « Pour moi, s’il devait y avoir un paradis, ce serait une bibliothèque. »
—
LA BIBLIOTHÈQUE FANTASTIQUE, COLLECTION WÜRTH ET PRÊTS, exposition jusqu’au 6 avril, au musée Würth, à Erstein
Le catalogue est une traduction française de l’exposition de 2018 « De A à Z, les livres d’artistes dans la Collection Würth » au Hirschwirtscheuer, Künzelsau www.musee-wurth.fr
Günter Grass, Was alles sie in zu großen Köpfen, 1982-1983, photo : Pascal Bastien
RENCONTRE DU TROISIÈME TYPE
Par Valérie Bisson
JEAN ALESSANDRINI EST TYPOGRAPHE, ILLUSTRATEUR, ÉCRIVAIN, CINÉPHILE ET BIEN D’AUTRES CHOSES ENCORE.
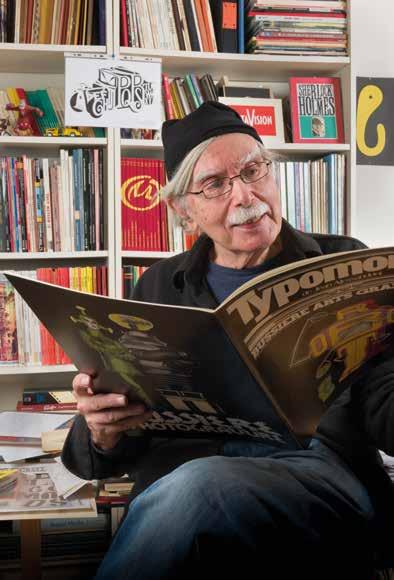
Il a signé nombre de logos et d’illustrations pour ELLE, LUI, Pilote, J’aime lire, et les éditions Folio Gallimard. Il a écrit et illustré des textes pour J’aime Lire, Hatier, Nathan, Grasset Jeunesse… Installé à Strasbourg depuis maintenant plus de trente ans, il a légué en 2022 à la BNU la plus grande partie de son œuvre graphique et typographique. Une exposition intitulée « Aventures alphabétiques » revient sur l’incroyable diversité des disciplines qu’il a abordées au cours d’une carrière bien remplie et qui se poursuit encore aujourd’hui.
Vous êtes né en 1942 à Marseille ; quel regard portez-vous sur votre longévité professionnelle et votre exceptionnelle polyvalence ?
Franchement, je ne me pose jamais la question. Curieux et volontiers aventureux, je crois que j’ai tout simplement essayé de traverser toutes ces années du mieux que j’ai pu sans pour cela me cantonner à un seul domaine d’activité.
Quand avez-vous rencontré le dessin et plus particulièrement la typographie ?
J’ai toujours dessiné. Quand j’étais enfant à Marseille, je voyais mon grand-père peindre des écriteaux commerciaux avec des lettres qu’il improvisait. De mon côté, je préférais dessiner des bonshommes en mouvement, mais je n’en retenais pas moins sa leçon… Après mon BEPC, j’ai été admis au Collège technique d’Arts graphiques de la rue Corvisart à Paris et puis j’ai eu la chance de débuter comme assistant chez Raymond Gid, un affichiste assez connu à l’époque dont l’atelier avait


une vue imprenable sur la tour Eiffel. Raymond Gid était un personnage sympathique, un peu grandiloquent, et surtout grand amoureux de la typographie. Mais moi, j’avais déjà contracté le virus. J’ai ensuite été embauché au département mise en pages de Paris Match et Jazz Magazine (plus tard Mademoiselle Âge Tendre , Pariscope et les Cahiers du Cinéma ) où je composais manuellement le découpage et collage de lettres, les titrages d’articles. Après mon service militaire à l’Imprimerie de la Marine nationale, je trouve un emploi à demeure comme maquettiste chez Daniel Filipacchi qui publiait alors Salut Les Copains. Et qui s’apprêtait à lancer LUI (dont, au passage, je dessinai le logo).
J’ai commis là mes premières illustrations et mes premiers textes, des nouvelles de science-fiction. J’y suis resté cinq ans, le temps d’acquérir un minimum de confiance en moi dans ces matières avant de devenir indépendant, très indépendant. Je vais alors présenter mon dossier à ELLE (après LUI, ELLE, je ne suis pas sexiste) dont Peter Knapp est le talentueux directeur artistique. Il crayonnait chaque semaine le chemin de fer du journal, un peu comme un réalisateur de cinéma le storyboard d’un film. Malheureusement, beaucoup de ces
précieux documents considérés sur le moment comme anecdotiquement utilitaires ont disparu. C’est lui qui m’a confié mes premières illustrations en externe.
À quel moment arrive l’écriture ?
J’ai écrit (et illustré) Bon Coeur et Mauvaise Tête en 1972 à L’École des Loisirs. J’entame donc une carrière d’auteur-illustrateur pour la jeunesse en même temps que je débute une activité de journaliste-pigiste à l’hebdomadaire Pilote sous la direction éclairée de René Goscinny qui était directeur de la publication. J’y écris surtout des textes humoristiques d’actualité dans la mouvance de mai 68. Plus tard, en 1983, je publierai chez Rageot mes premiers romans policiers et encore plus tard, en 2003, chez Phébus, mon premier livre pour adulte, un roman d’aventures, L’Île de Pingo-Pongo
Et la typographie dans tout ça ?
Oui c’est vrai, n’oublions pas la typographie, discipline très contraignante, mais c’est peut-être ce qui en fait son charme. Revenons donc à 1959. Lettera N°1, recueil périodique suisse de référence, lance un appel d’offres et je dessine alors une égyptienne italique grasse que j’appelle l’Akenaton. Cette
Typographie Cléopâtre dans Typomondo 3 publié en 1984 chez Bussière
© Jean Alessandrini.
Typomondo 4 publié en 1984 chez Bussière.
Typographie et illustration
© Jean Alessandrini
police paraitra dans Lettera N°3. À cette époque, je fréquente alors le milieu graphique parisien qui compte beaucoup de professionnels d’origine suisse justement, dont Peter Knapp déjà cité. Au milieu des années 60, la pleine époque du Pop Art, je rencontre Albert Hollenstein, qui vient de fonder un atelier de photocomposition. Dix années durant, il distribuera mes caractères (une quinzaine) qui obtiendront un certain succès. En 1977, je publie un premier bilan de mon travail typo et graphique sous la forme d’un ouvrage intitulé Typomanie.
Dessiner des mots-images, cela vous est venu comment ?
J’avais acquis, au début des années 80, une certaine expérience comme illustrateur et comme typographe ; je n’ai donc eu aucun mal à combiner les deux fonctions. Cela a donné le mot-image qui est en quelque sorte une branche ludique de la typographie consistant à dessiner des objets, des personnages ou des concepts, avec les lettres des mots qui les désignent.
Qu’en est-il maintenant de la polémique du Codex 80 ?
En 1979, j’ai moins de travail que d’habitude, c’est l’été, tout le monde est en vacances. Désœuvré, j’en profite pour mettre de l’ordre dans la documentation de caractères typo que j’accumule depuis des années. Je commence à la répertorier selon la classification Vox, la seule opérationnelle au dire de beaucoup. Je réalise alors à l’usage qu’elle ne fonctionne pas si bien que ça et qu’elle est même nettement inopérante. Je me lance donc dans l’élaboration d’une nouvelle classification que je présente dans un article de Communication et Langages , la revue de François Richaudeau. Inexpiable sacrilège ! Les tenants de la classification Vox, Compagnons de Lure pour la plupart, se déchainent contre moi. Richaudeau, qui n’est pas ennemi de la polémique, ouvre ses colonnes à mes détracteurs et je leur réponds à mon tour dans le numéro suivant puis dans ma propre revue Typomondo créée en 1981.
Morale de tout cela, j’ai appris tout récemment que la sacro-sainte classification Vox était tombée dans les poubelles de l’histoire, comme quoi, une victoire même tardive est toujours bonne à prendre.
J’aimerais conclure en disant qu’Olivier Nineuil accomplit aujourd’hui un travail formidable en numérisant mes caractères anciens et récents. C’est ainsi que la Showbiz, dessinée en 1969 et qui fait partie du fonds acquis par la BNU en 2022, sera utilisée l’année prochaine pour titrer le catalogue et les affiches de l’exposition célébrant cent ans d’Art déco.


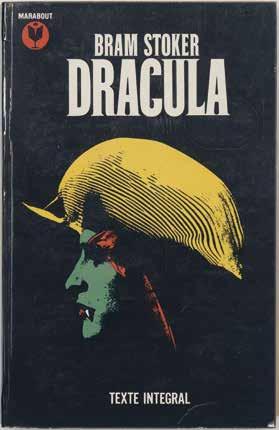
— JEAN ALESSANDRINI, AVENTURES ALPHABÉTIQUES
exposition du 29 janvier au 22 mars à la BNU, à Strasbourg bnu.fr
Illustration avec essai de couleurs pour Le Zapoyoko, J’aime Lire, 1984 © Jean Alessandrini
La bestiola minuscula typographica, 2012 © Jean Alessandrini
Couverture du livre Dracula aux éditions Marabout, 1980.
Graphisme de couverture, illustration et typographie
(caractère Vampire) de Jean Alessandrini © Jean Alessandrini
Quoi de neuf chicmedias ?
01— ZUT Strasbourg, magazine trimestriel lifestyle 100% local #60
02— ZUT Haguenau et alentours / Alsace du Nord, journal trimestriel #19
03— Novo, magazine culturel trimestriel du Grand Est #75
04— 79A by ZUT, publication pour l’agence d’architecture globale K&+
05— ZUT Hors-série, Un seul amour et pour toujours #5 - Club de cœur
06— ZUT Hors-série, L’artisanat dans L’Eurométropole de Strasbourg et en Alsace #6, À livre ouvert







Boogie
Avec ses sonorités dansantes et son étymologie foutraque, le mot « Boogie » ne laisse pas indifférent. Un nom comme un ovni, qui tombe à point pour un projet curatorial expérimental, vivant et évolutif. Porté par Charles Rouleau et Stilbé Schroeder, deux têtes chercheuses du Casino Luxembourg, « Boogie » est ludique, participatif et tente de susciter des nouvelles perspectives. Avec la complicité d’artistes (dont Christine Sun Kim qui pare les murs du Casino d’une fresque sur mesure ou Stephen Korytko qui signe la bande sonore de l’expo) ce labo créatif s’affirme comme un manifeste et propose une expérience de visite singulière. (M.M.S.)
Jusqu’au 21 avril Au Casino Luxembourg, à Luxembourg www.casino-luxembourg.lu
© Christine Sun Kim : Ghosted in the Shell + Nicholas Vargelis : F For Fake of 20th Century Light
Salon international de la peinture de Delme
Voir la vie en peinture est une bien belle chose. Négligée dans les années 60 et 70, cette matière sainte, reine des beaux-arts et des cimaises, connaît récemment un beau retour de flamme. Pour sacrer la reviviscence de ce médium, la Synagogue de Delme invite douze peintres contemporains à faire salon. Inspiré des grandes messes de l’art du xixe siècle, le Salon international de la peinture de Delme revendique un éclectisme assumé et nous balade du portrait à l’abstraction psychédélique tout en donnant un bel aperçu des circuits parallèles de l’art contemporain. (M.M.S.)
Du 8 février au 8 juin
À la Synagogue de Delme www.cac-synagoguedelme.org

© Audrey Couppé de Kermadec, Négligé fanm nwé ki queer sé on péché, repanti ! (Négliger les femmes noires et queer est un péché, repentissez-vous).
Pause
« Pause » propose un arrêt sur image, une trêve dans le flux incessant qui inonde nos écrans. En faisant un pas de côté, cette exposition collective interroge les contenus diffusés par les médias. Coupures de journaux, images d’archives ou reportages télévisés sont ainsi détournés, sous le regard ironique, désenchanté ou décalé des artistes convoqués. Parmi eux, Rehaf Al Batniji et Oraib Toukan redonnent des couleurs aux rues de Gaza pour mieux raconter les turbulences d’une vie quotidienne sous occupation, tandis que Nidhal Chamekh défie le présent en reconfigurant le passé. Qu’il s’agisse d’ajouter du contraste à nos représentations, de faire l’archéologie de nos aprioris ou de mettre à jour l’autre face de l’histoire, « Pause » affûte notre sens critique. (M.M.S.)
Jusqu’au 9 février
Au 49 Nord 6 Est Frac Lorraine www.fraclorraine.org

Rehaf Al Batniji, Gaza Timezone. © Autorisation de l’artiste

Julien Gérardin, pionnier de la couleur
Cerisiers en fleurs et femmes à ombrelle, promenades endimanchées et scènes de la vie quotidienne : bienvenue dans le monde cossu de la belle époque. Notaire et photographe à ses heures perdues, Julien Gérardin (1860-1924) nous épate avec ses chroniques photographiques de la bourgeoisie nancéienne. Conservés par l’École nationale supérieure d’art et de design de Nancy, ses remarquables autochromes (premières photos en couleur), sont exposés pour la première fois. Entre chimie photographique, effervescence des images et fécule de pomme de terre, l’exposition permet de se familiariser avec cette technique qui contribua grandement à nous faire voir le monde en couleur ! (M.M.S.)
Jusqu’au 21 mars À l’École nationale supérieure d’art et de design de Nancy www.ensad-nancy.eu
Julien Gérardin © Ensad Nancy

Wild Rose, Gabrielle Duplantier
Le halo délavé d’un papier peint vieilli, les magnolias ombrageux d’un jardin qui entre par les fenêtres, la douce langueur des siestes d’été dans la blondeur des prés… Avec Wild Rose, Gabrielle Duplantier explore ses souvenirs d’enfance et raconte l’histoire de sa maison familiale, une vieille bâtisse déglinguée vouée aux assauts du temps et de la mémoire. Mais, aussi et avant tout, un refuge. Ses photos en noir et blanc se lisent comme un conte sauvage, âpre et mystérieux, où les enfants jouent dans les bois, les jeunes filles sont en fleurs et les lacs se voilent de brumes. (M.M.S.)
Du 1er février au 23 mars À La Chambre, à Strasbourg www.la-chambre.org
Gabrielle Duplantier, Maxime contre le chêne, Série Wild Rose, 2012
Se faire plaisir
Joies artificielles ou caprices charnels, menus plaisirs ou péchés mignons… Le plaisir est aussi fugace qu’indéfinissable tant il embrasse une large palette d’émotions et de sensations. Pour tenter de saisir les contours de ce Saint Graal de l’existence, la Kunsthalle a nommé un triumvirat créatif composé de deux artistes (Mireille Blanc et Marianne Marić) et d’une curatrice (Sandrine Wymann). Avec une grande liberté, ce qu’il faut de subversion et des choix qui chahutent volontiers le bon goût, elles mêlent sculptures, photographies, peintures et installations. Un projet ambitieux qui fait vriller nos pupilles, aiguillonne nos sens et aiguise nos curiosités. (M.M.S.)
Du 14 février au 27 avril À La Kunsthalle, à Mulhouse www.kunsthallemulhouse.com

Mireille Blanc, Chatte meringuée (M.M), 2024. Huile sur bois, 30 x 40 cm © Mireille Blanc
Arno Brignon, Mathieu Farcy et Marine Lanier
La Filature offre un triplé photographique et se frotte aux récits, visuels et textuels de trois artistes singuliers. Avec des propositions aux horizons distincts, ils se racontent en images. Entre récit initiatique et road trip photographique, Arno Brignon parcourt l’Amérique des motels, du macadam brûlant et des grands espaces. Oscillant entre nostalgie et fascination, sa série mêle mythes désenchantés et clichés bien vivants. C’est une lumière plus trouble que jette Marine Lanier sur la vie sauvage de deux jeunes garçons, dans une fable documentaire nimbée de mystère. Un duo enfin, formé par Perrine Le Querrec et Mathieu Farcy, s’empare du mythe des Amazones. Poings et mâchoires serrés, faits d’armes et portraits de criminelles, ils déclinent la violence au féminin dans une forme originale qui emprunte aux archives et à l’atlas visuel. (M.M.S.)
Du 25 janvier au 23 mars À la Filature, à Mulhouse www.lafilature.org

Amazones n’existent

Territoires mouvants
Talents contemporains 12e édition
Depuis 2011, la Fondation François Schneider défriche la scène artistique et fédère les jeunes talents autour de la thématique de l’eau. Dans cette lignée, « Territoires mouvants » se construit autour du travail des six lauréats de la 12e édition de Talents contemporains. D’une grande variété, leurs propositions voyagent en eaux troubles, explorent les abysses et mettent la géographie au défi. Alors que Bilal Hamdad revoit le mythe d’Ophélie au prisme des migrations, Aurélien Mauplot fait éclater le planisphère avec la complicité de Jules Verne. À leurs côtés, les hypnotiques cyanotypes de Manon Lanjouère déploient leurs corolles luminescentes pour mieux dénoncer les ravages de la pollution sous-marine. Qu’elle soit douce, tumultueuse, claire ou abyssale, l’eau nous tend un miroir à la hauteur de nos contradictions. (M.M.S.)
Jusqu’au 23 mars
À la Fondation François Schneider, à Wattwiller www.fondationfrancoisschneider.org
Manon Lanjouère © Steeve Constanty

L’œuvre-Messagier,
une mimesis abstraite du monde
L’univers de Jean Messagier est d’une intense douceur. « Nuagiste » à ses heures, il déroule de vertigineux paysages où le geste s’éprend de liberté. À rebours, l’exposition de la Fondation FernetBranca remonte le temps. Après un focus important sur les œuvres de la maturité datées des années 90, elle raconte les premières expérimentations post-cubistes de l’artiste, puis ses détours du côté de l’abstraction lyrique. Jaillissements colorés, abstractions feutrées, volutes infinies et titres comme des aphorismes, Messagier l’Enchanteur nous happe dans ses filets. (M.M.S.)
Jusqu’au 2 février À la Fondation Fernet-Branca, à Saint-Louis www.fondationfernet-branca.or
Jean Messagier, L’Après-midi de Louis XIV, collection particulière © Studio François Vézien
Devenir Courbet
En confrontant sources biographiques et toiles exceptionnelles, « Devenir Courbet » revient sur la genèse et la jeunesse du peintre ornanais. On le découvre en ambitieux aux accointances romantiques, jeune Rastignac roulant sa bosse de la campagne jurassienne aux salons de la capitale. Des premières œuvres, charmantes copies, aux évolutions plus personnelles de son style jusqu’au culte de l’autoportrait (il fut surnommé le « Narcisse paysan »), l’exposition revient aux origines de ce mythe de l’histoire de l’art. Et Gustave créa Courbet ! (M.M.S.)
Jusqu’au 20 avril
Au musée Gustave Courbet, à Ornans www.musee-courbet.fr

Gustave Courbet, Étude de nu © Corentin Le Goff

FRESH WINDOW. Art et vitrines.
À l’avant-garde, les devantures ? Entre voyeurisme et publicité, la vitrine flirte depuis toujours avec les arts. Pour attirer le chaland ou révéler un produit, afficher le luxe ou la luxure, elle déploie tout un univers de sens, à même la rue. De la pub à la performance, la nouvelle exposition du musée Tinguely met l’inventivité en tête de gondole. Parmi les artistes présentés, la performeuse Martina Morger prend le lèche-vitrine au premier degré, la grande Marina Abramović s’expose dans la peau d’une travailleuse du sexe tandis que Christo voile la vitrine d’un intrigant drapé. (M.M.S.)
Jusqu’au 11 mai
Au musée Tinguely, à Bâle www.tinguely.ch
Prada Marfa © 2024/2025 ProLitteris, Zürich - Elmgreen & Dragset
Encore, avant
Nos chroniqueurs sont d’humeur rétrospective : Nicolas Comment voyage dans le passé de Brisa Roché, Stéphanie-Lucie Mathern dans celui de Laurent Schirch, Myriam Mechita récidive, Dominique Falkner nous raconte Michel Auder, Nathalie Bach-Rontchevsky regarde passer le temps, Martin Möller-Smejkal s’interroge sur celui-ci, Jean-Luc Wertenschlag déclame l’histoire du slam, Claude De Barros chérit son Wilson retrouvé, et Bruno Lagabbe grimpe un sentier souvent oublié.
FEUILLE DE ROUTES
Par Nicolas Comment

Brisa
Roché, chez elle à Paris © Nicolas Comment, 2023
POUR NOVO, NICOLAS COMMENT S’ENTRETIENT AVEC BRISA ROCHÉ.
CETTE AMÉRICAINE DE PARIS, AUTEUR(E)-COMPOSITRICE MAIS
AUSSI POÈTE ET PEINTRE, LUI FAIT VISITER SA CALIFORNIE NATALE :
UN VOYAGE EN ENFANCE QUI N’OMET PAS DE SOULEVER LES
QUESTIONNEMENTS ACTUELS ENTRE LES FILLES ET LES GARÇONS.
Échangeant au téléphone un beau lundi du mois dernier, comme à l’accoutumée, avec Philippe Schweyer, je lui avais – tout feu, tout flamme –proposé de dédier désormais cette chronique… aux « femmes ». Il me semblait, en effet, avoir un peu trop parlé en ces pages de garçons (pour ne pas avoir à prononcer ici le nom d’« homme »…). Je lui suggérai donc la création d’une nouvelle série de chroniques, que j’aurais intitulée « Woman » en rapport à la célèbre chanson de John Lennon. Je ressentais en effet le besoin de saluer celles qui comptaient ou avaient compté à mes yeux. Il va sans dire que je souhaitais encore et toujours m’adresser à des artistes qui me fascinaient, non pas seulement aux membres d’une catégorie sociologique, et encore moins à un « genre ». Ainsi, pour contrer le caractère politiquement correct et généralement hypocrite de ce genre de déclaration d’intention pseudo féministe, j’avais même imaginé un soustitre, volontairement problématique : Entretien avec une vamp…
Par vamp , j’entendais la femme puissante et mystérieuse telle qu’admirée par les surréalistes sous la cagoule d’Irma Vep et par eux reconnue dans les yeux noirs de Musidora : la femme moderne, « héroïsée, sacrée aventurière » (Aragon), femme de tête. En stigmatisant d’emblée une partie extrêmement précise et rare de la population féminine, je m’épargnais donc d’avoir à parler des femmes en général. Aussi, quoique prêtant d’emblée le flanc à la vindicte woke il me semblait en même temps flatter son amour des quotas et des minorités. En quelque sorte, je retournais mollement le sablier de l’air du temps en le tenant par la taille, sans occulter le fait que ses bulbes de verre sont de formes féminines… Le courageux rédacteur en chef
de Novo ayant accueilli favorablement mon idée saugrenue, j’ai tout de suite eu envie de dédier la première de cette nouvelle série de chroniques à mon amie californienne de Paris, Brisa Roché : auteur(e)-compositrice-interprète, mais également poète et peintre… J’avais envie qu’elle me raconte sa vie, son œuvre, mais aussi qu’elle me parle de l’invention de son personnage d’artiste. Nous nous sommes donc donné rendez-vous non loin de chez elle, à la brasserie Nord Sud, de Jules Joffrin. Arrivé en terrasse, j’ai tout de suite repéré Brisa, assise de dos : avec sa coiffure singulière (composée de deux petits chignons), elle ressemblait un peu à Minnie Mouse. Une Minnie devenue grande… Minnie en maxi-femme ? J’ai candidement osé frôler l’hélix de son oreille gauche avec l’auriculaire de ma main droite pour lui signaler ma présence, accueillie d’un franc sourire, et nous avons commencé à parler :
NC : Ta bio officielle commence par… « Brisa Roché grandit sans électricité ». BR : C’est un raccourci. Mon père était à l’origine un col bleu, pauvre de la côte Est. Il avait une facilité pour tout : intellectuel et manuel. Il a fait beaucoup d’études malgré ses origines… Sans chaussures, sans famille. Il a travaillé dans une boucherie quand il était enfant pour pouvoir aller à l’école. J’aimerais bien savoir – maintenant que j’ai fait ma vie en Europe – qui, de ma famille, est venu le premier aux États-Unis. Il y avait des riches qui ont émigré aux États-Unis, mais il y a eu surtout beaucoup de pauvres. Ces gens-là étaient quasiment des esclaves, blancs. Ils n’ont donc aucune trace de leur passé. Comment tenir compte de tes racines quand tu es en train d’essayer de survivre ?
NC : C’est peut-être aussi la force des États-Unis que d’avoir permis d’oblitérer le passé ?
BR : Oui, aux États-Unis, le passé n’existe pas. À part pour les aristocrates de la côte Est dans les manoirs. Mais moi, je suis de la « côte Ouest ». Du côté des gens dénudés. Des « squelettes » à l’air libre…
NC : Des Raisins de la colère
BR : Côte Ouest, ce sont les gens les plus tenaces. Des aventuriers individualistes. Capables de s’adapter. Les plus nus, les plus tristes… Mais aussi les plus versatiles, les plus « couteaux suisses », les plus hargneux… Et là d’où je viens, cela existe toujours. Il y a encore des chercheurs d’or, encore des hippies. Il y a encore une vraie sensation de fronti ère dans cette nature complètement surdimensionnée, comme si des explorateurs allaient arriver sur les plages pour y trouver des dinosaures. C’est perdu dans les temps. Perdu dans plusieurs temps. Et donc à propos d’électricité, mon père, au moment où il rencontre ma mère, avait déjà commencé à construire ce… bateau.
NC : Tu serais née… sur un bateau ?
BR : Non je suis née sous un bateau… [ rire ] Ce bateau qui s’appelle « Tatzelwurm » (Petit Dragon) est la ligne conductrice du roman que j’écris depuis 15 ans. Il faut que je le termine, car des épisodes extraordinaires sont arrivés depuis, plus magiques que tout ce que j’aurais pu imaginer. Et donc mon père avait commencé à construire un grand bateau à voile avec un Allemand, Martin. Il était parallèlement prof d’anglais. Très passionné, très poète , tr ès enflammé et très habité par la littérature, l’écriture.
NC : Il était proche des Beats, m’as-tu dit ?
BR : Mon père est né en 1942, et donc il est encore rattaché à la génération beatnik, plus dure. Ma mère est née dix plus tard. Elle a grandi à San Francisco. Elle a vu Hendrix, Janis Joplin, etc. Elle était skateuse. Pieds nus, en jean retroussé et tee-shirt blanc ; les cheveux blonds plaqués. Tr ès athlétique.
NC : La grande époque de Haight-Ashbury… Elle a connu Jerry Garcia, le Grateful Dead ?
BR : Pas particulièrement. Mais les deadheads étaient partout et ils existent encore aujourd’hui… Elle était assez défoncée… Surtout par la fumette et le LSD. Elle m’a dit qu’elle avait pris assez de LSD pour que moi-même – encore au stade de fœtus – j’aie ma dose pour toute la vie ! À l’époque, il y avait un groupe hippie à S.F. : Family Dog1 qui regroupait des personnes qui voulaient retourner vers la Nature. Il y a eu des exodes en bus, un tas de gens sont partis. Et ma mère était proche de cet idéalisme, naturaliste…
NC : Plus « hippie » que ton père ?
BR : Ce que je peux dire, de cette expérience, c’est que les hommes ont pu profiter de ces mouvements plus que les femmes. Que ce soient les beats ou les hippies. Les femmes étaient intégrées au mouvement, mais avec toutes leurs responsabilités, les enfants notamment. Et elles sont au final devenues amères, frustrées et déçues. Victimes de l’idéalisme… Mais lorsque je suis née, selon ma mère, c’était une parenthèse de grâce. J’étais désirée de part et d’autre. Je suis le seul enfant de mon père qui s’est pourtant marié sept fois…
NC : Sept fois ?!
BR : Oui et tu connais le nom de sa dernière femme ? « Patience Prudence Cryst » ! Tu vas nulle part après ça. Et donc mon père vivait au bout d’une péninsule, car il avait le projet du bateau qui devait pouvoir sortir de la baie de Humboldt pour prendre la mer. À sept heures au nord de San Francisco. Il pleuvait tout le temps. Et quand il ne pleuvait pas, c’était le brouillard total. Comme si tu rentrais dans Mists of Avalon. Une terre ancienne, et isolée par les brumes qu’on appelle encore « The Lost Coast » ou bien « Behind the Redwood Curtain »…
NC : « Derrière le rideau de séquoia… »
BR : Mon père habitait là, dans une sorte de cercle d’eucalyptus et de cyprès au centre duquel se trouvait un grand manoir de treize pièces en rezde-chaussée qui s’enfonçait dans le sable, jusqu’aux fenêtre. Dégradé par l’ humidit é… Non loin d’un aéroport construit précisément pour tester les atterrissages sans aucune visibilité, dans la brume. Juste derrière, il y avait la falaise et une jungle de pluie : « The Rain Forest ». Une jungle avec des rhododendrons hauts comme un immeuble de trois étages, des fougères qui font deux fois ta taille, des séquoias immenses… Enfant, mes parents me laissaient y aller avec un sac de nouilles chinoises sèches, une machette et une boussole. Avec un copain, on suivait alors les chemins des ratons laveurs, des cerfs, en nous enfonçant loin dans la jungle. Parfois des troncs d’arbre s’ouvraient sous nos pieds et nous plongeaient dans une sorte de petit ruisseau où poussaient des fleurs comme des… choux, qui sentaient le putois.
NC : Et donc, le bateau ?
BR : Mon père avait loué ce terrain pour construire le bateau. Il s’était installé dans la petite maison du gardien du manoir où vivait cet Allemand… C’est là que j’ai été conçue et que je suis née : sous l’ombre du bateau qui se construisait.
NC : Tu es retournée sur les lieux ?
BR : Oui… mais je n’ose plus y aller, car le lieu a été rénové. J’ai juste vu quelques photos… Je ne veux pas en savoir plus. Mais j’y retourne constamment dans mes rêves. Ma vie de rêve est parallèle à ma vie éveillée : aussi intense ! Donc j’y vais souvent,
à vrai dire ! D’autant que ce lieu où je suis née se trouve juste à côté d’un cimetière d’Américains natifs, first people
NC : Un cimetière indien
BR : Il était à vingt mètres de la maison du gardien… Il y a eu des massacres horribles. Les massacres d’Indiens ont duré jusqu’au moment où la grande maison a été construite. L’horreur ! Il y avait des îles au milieu de la baie, protégée par la péninsule qui l’entoure et où vivaient les Indiens. Tous ont été tués, cela me donne encore la chair de poule… Lorsque les Indiens enterraient leurs morts, sur le sable, ils plaçaient une pyramide de coquillages blancs…
NC : Et donc, enfant, tu repérais leurs traces ?
BR : J’ai vu des endroits où il y avait çà et là, soudainement, une masse de coquillages blancs brisés…
NC : Présence des âmes ?
BR : Oh my God! Oui… C’était complètement habité J’ai vu des silhouettes… Des lumières, des bottes qui brillaient. Et entendu des BO de choses qui se passaient à une autre époque. Tant de fois.
NC : Des « Bandes Originales »… On peut donc dire que ta musique vient de là ?
BR : Oui. En fait… oui ! Tu viens de résoudre un grand mystère dans ma vie. Car quand je me suis lancée dans le jazz… Le folk, c’était ma mère. Le rock, plutôt mon père (Rolling Stones, Beach Boys, Talking Heads et même… Dylan). Mais je me suis demandé pourquoi j’ai toujours été obsédée par les années 40.
NC : Ton premier album est signé sur Blue Note, un label de jazz.
BR : Oui, mais mon premier album est en fait un album anti-jazz, c’est un disque de pop qui faisait suite à huit ans de pratique du jazz… En fait, c’était ma rupture avec le jazz ! Mais alors pourquoi le jazz ? Il y a sans doute un lien esthétique, parce que les années 70 reproduisaient les années 40. Il y avait une réappropriation des années 40 dans les vêtements, les décors des maisons des années 70. Dans un certain « glamour » féminin.
NC : Une sophistication qu’on retrouve à l’œuvre chez toi…
BR : Ce dès mon plus jeune âge… En fait, j’ai eu la chance de pouvoir m’abonner à un magazine quand j’étais petite. Et j’ai choisi… Architectural Digest ! J’étais obsédée par le design et comme je n’avais ni le droit de regarder la télévision, ni de jouer aux poupées Barbie qui imposaient certaines normes féminines, j’ai découvert le glamour des années 80 – qui, en fait, faisait référence aux années 40 – dans les pubs de AD. Les femmes y étaient puissantes, en costume, cheveux plaqués avec un regard fort. Et sur les murs de ma chambre d’enfant, j’avais des couvertures originales des années 1930-40 du
magazine Cosmopolitan : pas des photographies, mais des dessins, des aquarelles.
NC : Je voudrais, si tu veux bien, qu’on revienne à l’histoire du bateau. Car il y a un petit côté Robinson Crusoé dans cette histoire.
BR : En fait, j’ai commencé à lire à deux ans selon mes parents…
NC : … Je ne te crois pas.
BR : Demande à ma mère ! Et donc, à cinq ans j’ai commencé à écrire de la poésie. J’ai retrouvé des histoires que j’avais écrites. Ce sont des aventures avec des phares, des tunnels sous des phares avec des courants sous-marins, des bateaux qui entrent dans la baie… D’ailleurs, je fantasmais sur le fait d’être enlevée par un bateau… J’ai écrit un morceau là-dessus, qui se nomme « Coco ». Un de mes rares titres en français :
Je t’enlève d’ici
Dans un sac en toile
Que j’ai découpé
D’un bateau à voile
J’ai pris mon couteau
Ils ont eu très peur
J’ai couru sur l’eau
Te trouver mon cœur Coco (2007).

Brisa dans son bar préféré à Paris © Nicolas Comment, 2022
NC : Mais qu’est devenu le bateau ?
BR : Le bateau est sur l’eau… C’est une des choses dont je suis la plus fière dans ma vie : j’ai mis ce fucking bateau on the water ! Après la mort de l’Allemand et de mon père. Je l’ai fucking fait ! Il est arrimé dans la baie de Humboldt, et il est à flot. Tout le monde m’avait découragée : la cabine était recouverte de ronces, comme dans La Belle et la Bête , couverte de sable et de vigne vierge ; un troupeau de chèvres venaient y brouter… Mais cette petite enfance m’a donné la solidité et la force d’aller droit au but, même si ma fontanelle ne s’est jamais refermée [rire]… C’était avant l’arrivée de la cocaïne ; avant la « Night Life », la disco, etc. Après, la descente a été hardos : séparation, absence du père, beau-père ensuite… Les femmes ont ramassé les pots cassés de la fin du rêve détruit. Et la fin du rêve coïncidait avec la séparation de mes parents. Mon père est parti avec une femme, hawaïenne… Je suis restée avec ma mère, artiste, qui faisait des petits boulots pour survivre. On avait froid. On se chauffait au feu… La société pétrolière ExxonMobil menaçant la communauté de la baie de Humboldt pour y implanter une plateforme, mon beau-père et ma mère ont décidé d’aller vivre de l’autre côté de la montagne, sur les terres arides. Mais je faisais un rejet de ce projet. J’avais une phobie des falaises. Là même où mon père faisait pousser la weed sur des sentiers de bucherons… Sur les chemins escarpés, dans le van Volkswagen avec les parents drogués, hilares : des heures de route dans l’odeur de joints mêlée à l’essence, au bord de cette falaise aride. Tout cela pour arriver sur un terrain paumé avec une mini-cabane, sans eau, sans électricité.
NC : Nous y voilà…
BR : Moi, je ne voulais pas aller vivre avec mon beau-père, d’autant qu’ils se disputaient avec ma mère. Et quand j’ai eu 12 ans, mon père m’a expliqué qu’il était englué dans la hiérarchie du business de la drogue dont il n’était évidemment pas « le roi ». J’ai d’ailleurs mis les noms précis de ces personnes dans mon album Father (2018). Il m’a alors proposé de m’inscrire dans une grande école à Hawaï et de partir avec lui et sa femme Patience pour recommencer une nouvelle vie. J’ai été reçue au concours d’entrée, mais ma mère s’est demandé ce qui se passait quand la lettre d’admission est arrivée à la montagne. Je culpabilisais de devoir la laisser seule avec mon beau-père. Et ensuite, j’ai culpabilisé de ne pas avoir suivi mon père, car il est mort peu de temps après… J’ai été tiraillée entre le côté féérique (de ma mère) et le côté Bukowski (de mon père) : et aujourd’hui, ça continue ! Mais, surtout, j’étais dans une chorale d’enfant. C’était la fin de la guerre froide : nous avions l’opportunité de pouvoir voyager en Russie pour chanter dans les églises. Dans des cathédrales !

NC : C’est vrai que si les Russes étaient interdits d’Amérique pendant la guerre froide, les Américains eux aussi étaient interdits de Russie ! BR : Mais oui ! Nous chantions même en macédonien ! J’ai eu une professeur de chant entre mes deux et treize ans. Très intimidante. C’était une hippie… rigide. Sexy et nerveuse. Ensuite, j’ai voulu être batteuse. Un ami de la famille m’avait fabriqué un kit de répétition avec… un pneu. Il s’appelait Dee et c’est lui qui m’a offert ma première guitare. C’est donc là, loin d’Hawaï et perdue dans la montagne, sans téléphone, sans électricité, que j’ai commencé à écrire mes premiers morceaux… Voilà, je pense que maintenant tu sais tout.
Nous avions tous deux les larmes aux yeux, mais je me rendais compte que notre entretien n’avait pas dépassé le stade de l’enfance… Je lui lançai donc une seconde question : « Maintenant, j’aimerais bien que tu me racontes ton arrivée à Paris. » Mais Brisa, bouleversée pas les souvenirs qu’elle venait de me confier, m’expliqua qu’elle n’en avait plus la force. Alors – mal m’en pris ? – je tentai d’aborder avec elle un autre sujet, visiblement déplacé ou qui n’eut en tout cas pas l’air de lui plaire : « À quel moment as-tu pris conscience de ta beauté ? » Il s’agissait pour moi de poursuivre la discussion sur le glamour des années 40, la questionner sur ce mystère, cette manière d’apparaître (plus que de plaire) dont certaines femmes ont le secret. Ce truc
Brisa Roché durant le tournage de Nahui © Nicolas Comment, 2024
qui échappe aux garçons – tenus à l’écart que nous sommes depuis des siècles du… gynécée. Pas seulement la coiffure, le make-up, les crèmes ; mais aussi le style, l’élégance : Brisa crée elle-même ses tenues de scène. D’où tenait-elle ce savoir, cet… Art ?
En prononçant le mot « beauté », que n’avais-je pas dit ?! J’eus en tout cas droit à quelques amicales remontrances. À propos de mes photographies notamment, où apparaissent des talons aiguilles sur certains clichés... Talons, bas couture, porte-jarretelles ou « corsets » qui – selon elle –contraignent et entravent la femme. Je répondis que j’avais peut-être tendance à magnifier la femme dans mes photographies, mais que je ne prétendais pas témoigner du réel et assumais cette part de « fiction » dans mes images en acceptant la séduction de certains modèles usant eux-mêmes de certains accessoires (bien que de « corsets » à proprement dit, il n’y eut jamais trace dans mes photographies)… Je m’emmêlais les pinceaux en songeant aux jolies jambes que j’avais photographiées : aurais-je dû plutôt choisir sur la planche-contact des images où la femme était moins mise en valeur, pour qu’elle paraisse plus naturelle ? Ne savons-nous pas tous pourtant que le naturel se fabrique ? Ou bien, devrais-je photographier des femmes moins belles pour satisfaire à une

pseudo égalité ?! Et puis, le sempiternel costumecravate imposé aux hommes ne les contraint-il pas tout autant ?! Deux citations me sont venues sur le moment : « Un soir, j’ai assis la Beauté sur mes genoux – Et je l’ai trouvée amère. – Et je l’ai injuriée », immédiatement suivie par : « Ce qu’on te reproche, cultive-le. » J’ai susurré la phrase trop connue de Rimbaud, mais me suis retenu de prononcer celle de Cocteau. J’ai alors vu défiler dans ma tête une scène du Testament d’Orphée : celle du procès final où l’ange Heurtebise se retrouve au purgatoire, condamné à « juger les autres ». Un peu agacé par la critique de Brisa, j’ai ajouté que j’allais dorénavant me consacrer exclusivement aux paysages… Ironique déclaration qu’elle commenta lassement d’un : « Mais non, mais non… » en me conseillant néanmoins de briser les clichés. « Cassage, cassage ! » prononça-t-elle en partant avec son accent américain… me laissant seul à ma table, un peu abasourdi.
J’ai médité dans le métro en rentrant. J’ai réfléchi. Brisures : Brisa… Dans ma tête, je pensais : « Est-ce que l’érotisme peut se passer de clichés ? Est-ce que le fétichisme est masculin ou féminin ? Est-ce que la séduction est une soumission ? » ou bien : « Est-ce que le désir, c’est mal ?! » et encore : « Est-ce qu’aimer est coupable ?!! » Pendant toute une semaine, je me suis remis en question. Incapable d’écrire. Infoutu de rédiger cette chronique. Alors, j’ai regardé sur Google Maps des images de la baie de Humboldt. J’ai vu les énormes séquoias, retrouvé des images anciennes qui montraient des Amérindiens sur la plage. J’ai voyagé sur ces rochers aux côtés de Brisa Roché. Au fond, ne parlait-elle pas aussi de ma propre enfance ? N’avions-nous pas tous deux, au même âge, le même petit Pinocchio de bois suspendu au lustre de notre chambre d’enfant ? Elle, perdue dans sa montagne californienne, moi dans mon petit village de Bourgogne ? Comme pris à la gorge par je ne sais quelle culpabilité vague, j’ai décidé de momentanément laisser tomber l’idée de la série des Entretiens avec une… vamp. Ne s’agissait-il pas là encore – bien que vécue par procuration –d’une nouvelle étape de mes Feuilles de Routes ?


Paris, Moon , La Brisa Day Roché, Merle Leonce Bone, Éd. Le boulon, 2024
Father, Brisa Roché, 2018
LAURENT SCHIRCH
LE MUSCAT, C’EST PAS MON ALSACE
Par Stéphanie-Lucie Mathern ~ Photos : Benoit Linder

—
La musique n’est émouvante que parce qu’elle est mouvante. —
Vladimir Jankélévitch
Laurent Schirch est un chef d’orchestre qui s’ignore – il a la coiffure aléatoire et la chemise trop habillée ou pas assez – en attendant, il officie au milieu d’une timbale d’élèves dans un lycée de Strasbourg. Fidèle du festival Musica, il a gardé tous les livres, connaît la programmation par cœur – du dissonant, mais pas que – il vous parlera de la meilleure version du Boléro de Ravel, de la différence entre musique allemande et française, du gothisme torturé de Mahler, de l’introduction la plus bouleversante de Bruckner, de Boulez endormi à Baden-Baden après avoir produit ce chef-d’œuvre d’architecture qu’est Répons. Mais qui s’intéresse encore à la musique ? Elle tient pour lui la plus
grande charge émotive, langage qui ouvre sur l’éternel dans un monde où le sens s’effondre de plus en plus. Les émotions et les sentiments ne vieillissent pas.
Le langage comme la musique a besoin de silence pour exister. Nous nous sommes rencontrés autour de ça. « Musicienne du silence », disait Mallarmé ou Lautréamont ? Il faut savoir rendre grâce à l’imprévu et à la spontanéité. Laurent n’a jamais hésité à faire des kilomètres pour vivre un moment – trophée du meilleur G.O. Demandez-lui conseil si vous cherchez un hôtel en Forêt-Noire –, s’assouplir l’esprit après une journée avec les élèves.
Il sait que l’éducation doit ressembler à un apprentissage du changement, un flux continu, s’adapter. Ses études de sociologie lui font croire aux possibilités de l’homme et à la révolution par l’éducation. Il arrêtera après une maîtrise sur le journal intime. Debord et les situationnistes sont ses maîtres. Il a d’ailleurs toujours aimé les avantgardes. Société secrète pour les égarés de la vallée de la Thur, lieu de ses origines. Rêvons d’une élite quand la vie est trop étriquée. Tout ça en jean blanc – même en hiver.
Jean blanc, mais aussi vin blanc – qu’il nous sert pétillant dans des verres qu’il lave méticuleusement. Esclave du temps qui passe, des autres, c’est un anarchiste qui cherche désespérément le sens de ce qui est dit, de ce qui n’est pas dit, de ce qu’on voudrait dire. Saisir la vie avec des mots justes et simples.
Il faut être vrai, en politique comme en art, s’élever par la pensée et échapper à la limitation (une peluche du lapin Duracell trône fièrement dans sa chambre). Laurent préfère écouter à parler – la musique encore. Celle de l’eau aussi, des bains qu’il prend, rituellement, tous les matins. Eau chaude, pour quelqu’un qui aime le Sud et le soleil – il nous confiera, lyrique, le souvenir d’une classe verte à Saint-Jean-de-Monts, et des lèvres bleues au sortir de l’Atlantique.
Il estime que le mal existe, mépris parfois de son être qui imagine un diable dans les détails. Néanmoins, quand le concert a réussi à insuffler un supplément d’âme, il se lève et crie « Bravo » avec les applaudissements les plus forts de la salle.

UNE HISTOIRE DE DÉESSE (OU DE DÉSESPOIR, OU LES DEUX)
Par Myriam Mechita

J’avais promis à tout le monde de ne plus jamais mettre un pied sur les sites de rencontres et de laisser la vie faire les choses… Bon, je sais pas si la vie est occupée ailleurs, mais visiblement elle ne se préoccupe pas vraiment de mon cœur en jachère.
J’ai beau sortir, aller à des soirées, des vernissages, je crois que mon aura de femme à séduire est cassée ou quelque chose comme ça. Je discute avec plein de personnes, j’en croise dans mon travail, dans les trains, sur les réseaux… mais je n’ai jamais d’opportunités ou quelqu’un qui finirait par dire après un échange drôle et passionnant : « Je vous laisse mon numéro, si ça vous dit qu’on aille boire un café un de ces jours… » Non, ça n’arrive jamais. Parfois, dans le métro ou dans un train, mon voisin sur une appli fait passer les profils… Alors que nous sommes là vivants, l’un en face de l’autre, à attendre que la réalité surpasse le virtuel. Mais le réel s’en fiche, il préfère regarder des vidéos courtes de gens qui se font mal en sautant dans une piscine ou comment on isole un plafond…
Au début, je me disais que c’est mon âge qui provoque l’arrêt de tout, ou alors ma coupe de cheveux, mes allers-retours incessants en Allemagne, à New York, ou alors le fait que je sois artiste, ou peut-être même juste que je sois un monstre d’indépendance, finalement ça doit être tout ça réuni… Mais en réalité, j’ai autour de moi des femmes plus jeunes, mignonnes à souhait, intelligentes, drôles, et qui n’en finissent plus de galérer avec des hommes qui soit ne veulent pas être en couple, ne veulent pas s’engager ou tout simplement veulent vivre une vie tranquille à commander une amoureuse comme on commande un menu sur Uber Eats. Ces applis de rencontres sont une fusion d’Uber Eats, LinkedIn et YouPorn… Les trois réunis. On passe de l’entretien d’embauche à des échanges cul, comme un choix de menu… Tiens, je vais prendre plutôt des nuggets que des nouilles chinoises, ah non… une pizza… et on swipe à gauche quand finalement on change un riz cantonnais pour des sushis. Les échanges sont assez médiocres en général, et la question qui tue : « Qu’est-ce que tu cherches ici ? » sonne le glas en général de l’entretien d’embauche pour passer à : « Tu aimes quoi comme position sexuelle ? »
Rien qu’en écrivant, je soupire de fatigue…
Je suis assise dans le métro ligne 7 et tout le monde a le nez collé sur l’écran de son téléphone.
la fille desirs
sur papier
D’ailleurs, personne ne remarque une situation qui vient de se dérouler sous mes yeux à l’instant et qui a duré une seule station, de Château-Landon à Gare de l’Est… Personne n’a rien vu.
Un jeune homme habillé d’un ensemble rose vif en papier, chaussettes noires, et t-shirt manches courtes a sauté dans la rame. Il a dû s’échapper d’un hôpital, à son poignet droit un bracelet en plastique avec ses informations, et à gauche un cathéter planté dans le bras, qu’il arrache devant mes yeux. J’ai l’impression d’être dans un film, ce jeune homme visiblement ne veut pas être soigné… Il trépigne devant les portes fermées et à la station suivante, il bondit du wagon et court vers la sortie.
Personne n’a rien vu. Mais réellement personne.
Ce qui vient de se passer me laisse songeuse, j’imagine tous les scénarios possibles et me dis qu’il est peut être poursuivi par des agents doubles qui veulent lui faire dire des vérités qui vont faire basculer la paix mondiale… Ou alors a-t-il été interné parce que c’est un tueur en série… Ou peut-être qu’il est violent avec sa compagne ou sa famille…
Ce coup de folie qui vient d’apparaître sous mes yeux me traverse comme cette minute où on ne réfléchit plus, on se jette du haut d’une falaise accrochée par un élastique. « Et puis merde… On s’en fout. »
Et je télécharge à nouveau l’une de ces foutues applis qui rendent addict à la relation zéro.
En me disant : « On ne sait jamais, y a surement des gens bien, moi aussi, j’y suis… » le piège se referme.
Premier match, c’est toujours assez drôle comment les tonnes de likes arrivent en grappe, alors que personne ne veut réellement ni échanger, ni rencontrer quelqu’un. C’est comme mettre un pouce à un post qui n’a aucun intérêt ou mettre des étoiles à des repas ou à des films qu’on n’a pas vraiment vus.
Avoir un avis sur tout et n’agir sur rien.
Je matche avec un homme plus jeune de quatre ans, grand, yeux bleus, les photos sont assez simples, mais dessinent un homme plutôt classique. Nous échangeons un peu, c’est courtois et poli, et je lui propose de le retrouver au Louvre en fin de journée.
Je vois sa silhouette au loin qui correspond totalement avec les photos de son profil. Aucune surprise. Il me fait la bise et je lui propose de nous poser dans un café à proximité. En marchant, il me dit qu’il est célibataire depuis six mois et qu’il cherche activement, rencontre énormément de femmes.
— Comment ça se fait que tu sois célibataire depuis six mois si tu enchaines les rencontres ?
— Peut être que je cherche la perle rare que je n’arrive pas à trouver…
— Mais tu te bases sur quels critères, parce que tu as dû en croiser des centaines de femmes incroyables.
— J’aime les relations DS…
Et là, le bruit de la rue couvre légèrement sa voix et je comprends de travers.
— Tu cherches une déesse ?
Je ris, et réponds de manière assez spontanée.
— Eh bien, si tu cherches une déesse, je suis là ! Il rit.
— Non, j’aime les relations DS.
À nouveau, je comprends pas vraiment.
— Tu aimes faire l’amour dans les vieilles
Citroën ?
Je trouve la situation comique et complètement surréaliste, en même temps plus rien ne m’étonne… Il rit.
— Non, non, j’aime les relations Dominant–Soumis.
— Aaaaaaaah je comprends, et tu es le dominant ou le soumis ?
— Le soumis.
— En même temps, je préfère te dire de suite que ça ne sera pas moi cette perle rare, ni dominatrice ni soumise.
Je le regarde un peu différemment et son côté classique prend une autre dimension.
— Et tu sais d’où ça vient ce désir-là ?
— Non, mais déjà enfant je cherchais à me faire punir. J’aime me faire humilier.
— D’accord… et tu étais en couple pendant longtemps ?
— Non, j’ai enchainé les petites histoires, les femmes n’aiment pas vraiment ce rapport-là quand elles sont exclusives et amoureuses, ça doit être « normal » parfois aussi. Ma plus longue histoire a duré deux ans et elle est partie un jour sans me prévenir.
— Tu en as souffert ?
— J’étais effondré…
— Tu as eu la punition suprême en quelque sorte… Le plaisir infini…
— Ah oui… J’avais pas vu ça comme ça… Tu as raison.
Il se met à sourire.
La pluie crée des éclats vibrants sur le trottoir et le froid nous saisit. Encore un rendez-vous qui s’achève par un « bonne continuation » et je me demande « ce soir bobun ou pizza ? » Ce sera spaghetti bolognaise avec des copeaux d’amour dessus… mangées allongée comme une déesse.
NI VRAI, NI FAUX, MAIS VÉCU
Par Dominique Falkner ~ Photo : Sebastian Kim

Exilé à New York depuis plus de cinquante ans, un temps acolyte de la Factory de Warhol, pendant longtemps furieux junkie, aficionado expert du journal intime filmé au quotidien depuis les premières bobines super 8 jusqu’au iPhone d’aujourd’hui, Michel Auder demeure inconnu en France alors qu’il est aux US un des papes de l’underground cinématographique new-yorkais. Celui qui répondait à un reporter des Inrocks, « Je suis une grande pute quand on s’intéresse à moi » est né en France en 1944 à Soissons où il découvre la photographie à l’âge de 17 ans avec le Rolleiflex de son père, puis met la main sur une caméra et réalise un premier film pompé sur L’Année dernière à Marienbad d’Alain Resnais. Il monte à Paris, bosse comme photographe de mode, intègre dans la foulée le groupe Zanzibar auquel collaborent Philippe Garrel et Henri Langlois.
Subjugué par l’esthétique marginale de la Nouvelle Vague, Godard et Pasolini pêle-mêle, il sort un soir d’une projection du Chelsea Girl de Warhol quand, au détour d’une rue du Quartier Latin, il tombe sur Nico, la future Walkyrie teutonne du Velvet Underground, en vadrouille avec Viva, l’égérie de Warhol qui fera d’elle une « Superstar », selon sa propre terminologie. Il se marie avec cette dernière à Las Vegas en 1969, déménage à New York, s’installe au Chelsea Hotel où il filme une version trash et hypersexuée de Cléopâtre avec Viva dans le rôle principal.
Langlois montre le film à Cannes qui, même dans sa version aseptisée, fait scandale, mais en plein tournage, Michel Auder pressent déjà qu’il doit trouver une autre forme, tant il méprise le cinéma traditionnel, les studios et la course au fric et aux producteurs. Il adopte le format vidéo et dès lors ne filme plus que son entourage au quotidien comme une sorte de journal intime ininterrompu. Le taulier excentrique du Chelsea pense qu’il a affaire à un noble français et lui donne carte blanche, le laisse vadrouiller à sa guise dans les couloirs de l’hôtel, caméra à l’épaule, où gravitent la jetset et la bohème des sixties et seventies : acteurs, actrices, paumés, toxicos, drag-queens, wannabees, prostituées, demi-monde, libres-penseurs, loubards, anarchistes, branleurs et musiciens qui s’extasient et pantomiment devant son objectif.
Michel Auder invente sur le tas une forme de vidéo-art et fait la connaissance de Jonas Mekas, l’autre atome européen expatrié du septième art avec qui il semble partager une même esthétique de ce que pourrait être le cinéma. Auder s’en défend : « Mes films sont plus punks et plus bordéliques. » Quant à Mekas, en 1991 : « Auder est un poète des humeurs, des rencontres brèves, des moments tragiques de notre civilisation misérable. Sa caméra est toujours en marche, c’est une obsession magnifique, le grand amour de sa vie. » Jour après jour après semaines après mois après années après décennies, il filme sans discontinuer avec ses tripes ses colères ses coups de cœur ses envies son désir ses fracas et archive, catalogue, chronique et comprime sa vie et celles de ses proches. Les premiers pas de sa fille, ses propres ébats sexuels, un shoot d’héroïne sur le pouce, une fête chez John Lennon, un gueuleton entre potes, une beuverie qui s’envenime et finit mal. La caméra tourne
encore quand il décharge son fusil ou s’engueule avec son ex-femme qui lui reproche de glander et de ne pas l’aider à élever leur fille. Il encaisse et filme. À la périphérie et au cœur de l’action. Il filme et se filme. Le filmant filmé. Voyeur magnifique qui pose son objectif où ça palpite, jouit ou/et fait mal. Scalpel celluloïd, bistouri numérique. Milliers d’heures où il se passe quelque chose, parfois, presque rien, souvent, ou carrément que dalle. Peu importe. Roi de la récup, il ne jette jamais rien, bon ou mauvais, car il sait bien qu’avec « le temps, les choses prennent un sens différent. » L’écrivain et prix Goncourt Jean-Jacques Schuhl, l’ami de longue date qui lui aussi se pense plus « un monteur à haute dose qu’un écrivain » aime « la manière de travailler de Michel avec ses kilomètres d’archives et ses tas de bobines et ses piles de photos et ses montagnes de documents et plusieurs écrans de montage allumés en même temps, seul à un étage d’un building anonyme de Canal Street, comme le capitaine Nemo aux commandes du Nautilus. »
Après sa rencontre fusionnelle avec Cindy Sherman, aujourd’hui star de l’art contemporain, avec qui il vivra 18 ans, Michel Auder entame une cure de désintoxication et parvient finalement à se défaire de l’emprise de l’héroïne dont il tire une vidéo déchirante, My Last Bag of Heroin (For Real). S’ensuivent des dizaines et des dizaines de vidéos, courts métrages et happenings, puis il change de braquet, et s’attelle soudain en 2007 au montage de The Feature. Travail herculéen, tâche titanesque. Fouiller et faire le tri dans le grand fatras de 5 000 heures de films couvrant une période de quarante ans pour en tirer un long métrage (« feature » en anglais) de trois heures. Tournant définitif de son œuvre. Documentaire sans précédent dans l’histoire du cinéma. Bordélique et époustouflant. Sensuel, magique, obscène, excitant, profond… Oui, bien sûr, et non, trop évident ; dégoulinant de vraie vie plutôt, comme une plaie béante qui suppure, tarde à cicatriser, se rouvre pour un rien, resaigne à la moindre incartade, nous force à faire attention. The Feature . On visionne le film et on se dit que le génie, ça doit être ça : la peur du vide. Alors, remplir et remplir pour le remplir. Jour après jour. Day and night. Sans répit et sans trêve. Pas question de baisser sa garde. Manière d’assigner à demeure le train-train des jours, de tenir à carreau la routine du quotidien. Et les méninges noyées dans le flot continu des scènes et des séquences qui s’enchainent pendant trois heures consécutives sur l’écran, se heurtent, se complètent, s’exacerbent et sautent du coq à l’âne dans une sorte de sarabande infernale, on pense soudain à Malraux : « Ce n’était ni vrai, ni faux, mais vécu. » Ouais, on peut dire ça comme ça.
— THE FEATURE,
Michel Auder, Andrew Neel, SeeThink Films
REGARD N° 25
Par Nathalie Bach-Rontchevsky ~ Photo : Mar Castañedo

Les journées s’emplissaient au rythme du soleil et des changements soudains du ciel. Vers quinze heures, une brume à l’allure dramatique tombait sur la ville. Les hautes tours argentées cessaient de briller, la vulgarité des banques et des hôtels de luxe ne se masquait plus. Puis vers dix-sept heures, une dernière fournaise reprenait le pouvoir. Les vendeurs de maïs réapparaissaient comme par magie à chaque coin de rue. Des bananes frissonnaient dans une huile indéterminée au fond de vieilles cuves brûlantes avant d’atterrir sur de petites barquettes en carton, recouvertes de crème fraiche, de miel et de confiture de fraise. La vie claquait à nouveau. Et la misère.
Je n’étais que moi. Mais j’étais aussi les arbres, les écureuils familiers, la pluie et l’orage la nuit. J’étais ce que je voulais, si je le voulais.
(Journal mexicain, extrait)
À Dominique Offner
MAUVAISE CONNEXION ? DISC-COURS DIALECTIQUE PART III
Par Martin Möller-Smejkal ~ DJ Hercules

Il se passe des choses étranges dans le club de football de mes deux garçons (5 et 8 ans). Nous arrivons tous les trois en retard au lieu de départ pour le tournoi… alors que nous pensions être à l’heure. Les entraîneurs organisent une aprèsmidi en équipe… dont nous apprenons l’existence la veille. Les joueurs des deux équipes ont soudain de beaux sacs à dos neufs… sauf mes garçons. Quand je demande ce qui se passe, on me répond : « Mais tu n’es pas sur WhatsApp ! » Ah, c’est donc de ma faute. On m’accuse de chercher la petite bête. J’ai raté le coche. Les enfants me demandent si je téléphone avec une calculatrice et s’il y a des jeux dessus. À en croire ma mère, je développerais ces derniers temps des penchants égoïstes, parce qu’elle ne reçoit pas à tout moment des photos de mes enfants. Pour y remédier, tout serait si simple : il suffirait que j’achète les yeux fermés.
En d’autres termes, je dois signer au plus vite un contrat avec une société américaine, certes spécialisée dans l’échange de messages, mais contre laquelle les préoccupations en matière de sécurité et le casier judiciaire s’étalent sur des pages entières. Cette société propose une utilisation gratuite, mais se réserve le droit d’exploiter au maximum toute communication (textes, microphone, caméra).
C’est étrange. Les gens calculent pourtant froidement, d’habitude. Personne n’achèterait une voiture en ne connaissant son prix qu’après coup. Il n’y a que la vie privée qui semble ne plus avoir de valeur. Au passage, aux États-Unis, ce seront très bientôt les républicains MAGA de Donald J. Trump et Elon Musk qui écriront les lois pour notre communication. Mais pas de quoi s’inquiéter ! En revanche, lorsqu’une personne lambda comme moi demande à des parents le numéro de téléphone d’autres parents de l’équipe de foot de mon fils, les premiers demandent tout d’abord l’autorisation aux seconds. Pour des raisons de protection des données !
Couverture du journal Was Wir Wollen
Les gens autour de moi font tellement confiance à l’entreprise et à son pays d’origine (ou font juste comme les autres) qu’ils ne communiquent plus autrement. En tout cas, ils ne disent plus les choses, parce que « tout le monde » les lit de toute manière. Bon, ça se cantonne généralement à des détails d’organisation. Comme par exemple lors du décès de mon ami Carmelo « Chico » Policicchio, le tenancier du bar culte Swamp à Freiburg, organisateur de concerts et grand supporter du SC Freiburg. Lorsque ses amis se sont réunis au Swamp le jour de sa mort pour ne pas rester seuls dans leur deuil, j’étais encore convaincu que je sonoriserais les concerts à venir en automne 2021. Ce n’est que quatre jours plus tard que j’ai appris cette perte, par hasard.
Mais bon. Une fois le contrat signé et les doutes littéralement balayés, les clients devraient être heureux et disposer de beaucoup de temps, puisqu’ils sont si bien informés. Je constate quotidiennement que c’est exactement le contraire ! Par manque de discipline en matière de communication, les prises de décision durent des jours. Ceux qui ne suivent pas en temps réel doivent reprendre tout le fil pour ne pas être perdus. Harcèlements, malentendus et trous noirs dans la perception collective. Tout le monde se doit d’avoir une opinion immédiate. Hum ! Peutêtre que cela a un rapport avec notre nouveau partenaire commercial ? Peut-être ne veut-il pas du tout que nous soyons heureux et détendus ? Comme on le sait, les meilleurs clients sont des gens insatisfaits qui ont de l’argent, qui passent le plus de temps possible sur leur smartphone et qui sont fermement convaincus que leur prochain achat n’a pas d’alternative.
Et quel est le rapport avec le Dreyeckland ? Heureusement, pas grand-chose ! Au milieu de toute la folie actuelle, je fais l’éloge de la communication du mouvement citoyen du Dreyeckland des années 1970 et 1980. Trop lente ? Ils ont tout de même réussi à empêcher la construction des centrales nucléaires de Kaiseraugst (CH) et de Wyhl (D), à repousser celle de l’usine de blanchiment de Marckolsheim (F), à faire fermer la centrale nucléaire à Fessenheim (F) après des années d’incidents. Est-ce que vous y arriveriez aussi ? Je veux dire, malgré le smartphone !
J’ai posé la question à mon ami Roland « Buki » Burkhart, car il doit bien le savoir : dans les années 70 et 80, il était l’un des auteurs de chansons protestataires les plus connus dans le sud du pays de Bade, en Alsace et dans le nord de la Suisse. « L’arme la plus importante dans la lutte pour l’information des années 70 était le téléphone », dit-il. En cas de
nouvelles, l’un appelait l’autre, avec le numéro qu’il trouvait dans l’annuaire téléphonique ou sur une liste. Il fallait réfléchir un peu et se méfier du fait que toutes les personnes concernées avaient conclu un contrat avec la même entreprise américaine, et que Big Brother suivait déjà attentivement. Ou alors, on se rendait simplement visite. Mais qui a encore le temps pour cela ? Tout le monde doit surveiller son smartphone. Je pense à nouveau à mon livre préféré Momo (1974) de Michael Ende. On y voit de mystérieux messieurs gris commencer à fumer notre temps libre, que nous leur avions auparavant vendu sans nécessité. Un autre moyen était les magazines que l’on éditait soi-même, comme par exemple Was Wir Wollen. Mais ohlala ! Avec des articles aussi longs, il fallait s’y plonger bien plus de dix secondes ! Impensable à l’époque de TikTok ! Et puis les éternelles discussions sur Radio Dreyeckland, le tableau noir complètement surdimensionné dans le Freundschaftshus… Des dinosaures !
Dernièrement, quelqu’un m’a demandé : pensestu qu’un seul juif aurait survécu si les nazis avaient eu à l’époque les moyens de communication et de surveillance actuels ? Mais une telle chose ne pourrait donc plus se produire, aujourd’hui ! Tout comme une guerre en Europe. Ou un dictateur en Amérique. Il faut que j’y réfléchisse. Et la conclusion ? À suivre !
— DJ HERCULES -
DREYECKLAND FOR SALE !
Les chansonniers contestataires du Dreyeckland constituent le cœur de cette mixtape. Mais il s’agit aussi de s’amuser avec la langue et les dialectes. Cette mixtape ne se veut pas un musée, c’est pourquoi on y entend de la musique de 1976 à 2024.
Mixtape digitale : soundcloud.com/hercules-soundtruck Paroles et infos : www.hercules-soundtruck.de
DJ Hercules est actif en tant que DJ, musicien, organisateur et mixeur depuis 2002 dans le sud du pays de Bade et depuis peu en Alsace.
TON VOISIN CET INCONNU
Par Jean-Luc Wertenschlag
~ Dessin : Joan
BIENVENUE EN RÉPUBLIQUE SLAMMIQUE !

Slam ? Was ist das ? Un barbu tatoué qui plonge dans la foule depuis la scène d’un concert metal pour se faire transporter par des dizaines de mains chatouilleuses jusqu’aux toilettes sans toucher le sol ? Un jeu TV sur France 3 réservé aux plus de 75 ans ? Une forme de poésie, de narration scandée librement, de manière rythmée ?
C’est bien sûr cette dernière version qui nous intéresse. Les puristes se déchirent sur la définition du slam, « poetry slam » en allemand. Des mots qui claquent ? Une manière d’applaudir, en claquant des doigts ? Presque tout le monde reconnaît que c’est un ouvrier du bâtiment appelé Marc Smith qui invente le slam dans les années 80 à Chicago. Son
but est de dépoussiérer et démocratiser la poésie en la transformant en performance scénique. Français, il aurait demandé une subvention au ministère de la Culture. Mais nous sommes aux États-Unis, empire du sport spectacle. Alors, les règles du tournoi de slam sont édictées. Chacun déclame un texte écrit de sa propre main en trois minutes maxi, sans costume ni accessoire. On n’est pas au théâtre ! Les grosses mises en scène et la musique sont interdites. On n’est pas au Noumatrouff !
Des juges sont choisis dans le public et notent chaque performance de 0 à 10. La compétition peut commencer… tout comme l’exportation !
Si tous les ouvriers du BTP se lançaient dans la poésie, que deviendrait le monde ?
Le slam débarque en France dans les années 90, sous l’impulsion notamment de Pilote le Hot, plutôt saltimbanque qu’ouvrier du bâtiment. Grand Corps Malade permet à partir de 2005 à la discipline d’accéder à la notoriété. Cet art oratoire se développe dans tout le pays, se structurant avec deux organisations principales, le Grand Poetry Slam et la Ligue Slam de France, et de multiples rendez-vous. Des événements rythment l’année poétique de façon sportive, comme la coupe du monde et le slam national en mai 2025 à Paris. Une multitude de structures peuplent le pays, d’Amiens à Lille, du Havre à Toulouse, de Pau à Reims, de Nancy à Troyes. Même à Colmar ? Non, n’exagérons pas…
Strasbourg et Mulhouse sont les places fortes du slam en Alsace. Slammeurs et slammeuses se recrutent partout, du Sundgau aux vallées vosgiennes. Des rendez-vous réguliers sont proposés et tout le monde peut monter sur scène. Même toi ! À Strasbourg, le collectif Slam Is Not Dead organise le dernier mardi du mois une scène slam à la maison Mimir. Rémy et ses amis promettent un verre offert à chaque texte dit. À Mulhouse, le premier vendredi du mois, direction le restaurant solidaire La Table, à Bourtzwiller. Après une vingtaine d’éditions de Paye Ton Vers, place au Slammerstein à partir de janvier 2025. À suivre, un festival cet été dans la cité du Bollwerk.
Comment l’aventure slam a-t-elle démarré à Mulhouse, capitale du monde ? Ce premier âge d’or débute à la fin des années 2000, au bar Les Copains d’abord, tenu à l’époque par JP & Régine, patrons punks ouverts à toutes les expériences – ils ressusciteront ensuite le mythique bar à bières de la rue des Franciscains, le Gambrinus. Des précurseurs comme JDHZ (Jhon Do Hazar), Fred ou Frantz se lancent les premiers. Jeunes et vieilles se succèdent sur scène. Une grand-mère peine à lire son texte en tremblant, l’émotion gagne son visage,
elle est au bord des larmes, c’est la première fois qu’elle s’exprime en public. Un ado s’empare du micro, partage ses sentiments amoureux sans pudeur. Un poète interprète une ode souriante à la vie d’ici. Le monde défile, la salle s’enflamme, l’humanité a encore gagné !
Des patrons punks ouverts à toutes les expériences
Aurélien Crifo, alias Karl, découvre alors cette forme poétique populaire. Artiste, auteur, interprète, il s’intéresse à la poésie sous toutes ses formes. Rappeur d’abord avec plusieurs albums révoltés à son palmarès, il devient accro au slam, rencontre Marc Smith, Pilote le Hot, s’illustre en devenant vice-champion de haïku en 2023 avant de terminer 2e au Grand Slam national 2024 avec l’équipe de La Table, en compagnie de Samuel « Lunik », Charlotte « Trikotte » et Jo Welcome X. Surtout, il relance des rendez-vous mensuels avec Jouons avec les mots. Mais pourquoi le slam, Karl ?
« À l’échelle collective, pour passer un bon moment autour de la poésie, de l’art des mots, c’est distrayant, on partage plein d’émotions. Ces rencontres créent du lien, des projets émergent. Au niveau perso, on se sublime par une discipline à l’écrit, puis à l’oral pour celles et ceux qui pratiquent et montent sur scène. On écrit sans se cantonner aux livres, on raconte, on se raconte, on raconte les autres, on amuse le public, c’est parfois émouvant. J’ai déjà pleuré, ri, j’ai pris de grandes gifles. Le slam, c’est l’art d’apprécier des poètes vivants très talentueux. »
L’art d’apprécier des poètes vivants
Comme au théâtre, on peut expurger ses passions par l’observation d’une scène, on peut vivre une expérience forte. À l’image d’une tragédie grecque, voir un meurtre, se représenter la scène, l’analyser peut éviter de tuer quelqu’un. Osez donc le slam la prochaine fois que vous avez envie d’égorger un voisin !
Le slam est multigénérationnel, réunit toutes les classes sociales, un peu comme le foot qui intéresse autant Bernard Arnault que le premier hooligan venu. Personnalités artistiques, ouvriers, chômeurs, handicapés, hommes, femmes, vieux, jeunes, enfants, ce terrain de jeu poétique accueille la francophonie mondiale. C’est ouvert à toutes et tous, sauf aux nazis, aux racistes et aux misogynes. Avec les ateliers d’écriture à Strasbourg, Mulhouse et dans la plupart des villes de France, se lancer, écrire son premier texte, oser sa première scène est un baptême vivifiant.
Dans ce monde socialement violent où le dialogue est souvent difficile, le slam est un rare moment d’échanges, de liberté, de rencontres où tout devient possible. Déclamer un texte devant un public empathique, jouer avec les mots, inventer une rime magique, raconter une tranche de vie en riant ou pleurant est une expérience forte qu’il convient absolument de tenter. C’est gratuit, surprenant, touchant, curieux et valeureux. Changer sa vie avec un stylo et une feuille de papier… Hopla on y va ?
facebook.com/SlamIsNotDead facebook.com/groups/565195955630618 instagram.com/karllerouge
Par Claude De Barros
À CHACUN SON WILSON

monde du septième art (et à l’univers en général). Un jour, si vous avez le temps, je vous parlerai de l’attirance de la balle de base-ball que l’on devine dans les amours contrariés de Billy Beane/Brad Pitt, manager des Oakland Athletics pour son sport dans Moneyball/Le stratège (Bennett Miller, 2011). Avec Wilson, Chuck Noland (notez l’humour pince-sans-rire du scénariste)/Tom Hanks ne met pas fin à sa solitude de naufragé longue durée, il résout une douleur psychologique bien plus grave, celle du désespoir, cette tristesse incommensurable pourvoyeuse des pires chagrins. À ce titre, Wilson vaut bien une tentative désespérée de sauvetage et une nomination aux Oscars.
Vous souvenez-vous de Wilson ? Jamais un ballon n’a mieux mérité un Oscar pour un second rôle. Avec Cast Away/Seul au monde (2000), Robert Zemeckis a célébré la performance artistique du ballon de volley, au contraire du ballon de football dans Escape to Victory/À nous la victoire (John Huston, 1981), malgré les appels de pieds de Pélé et Bobby Moore, ou du ballon de rugby dans Invictus (Clint Eastwood, 2009) dont la tension dramatique a échappé au
À chacun son Wilson. En ce qui me concerne, c’est après la lecture récente d’un article du Monde que j’ai retrouvé mon Wilson. Je vais évidemment vous parler de l’article, mais, avant, je dois vous avouer qu’il m’arrive de pleurer – c’est quand on a les yeux bien mouillés – en lisant certaines littératures. Primo Levi m’a durablement troublé et je garde de cette lecture l’oppressante sensation d’une bulle invisible coincée dans l’œsophage, m’empêchant de déglutir normalement et pesant de toutes ses forces sur mon appareil respiratoire. Des Récits de la Kolyma de Varlam Chalamov, je me rappelle avec exactitude les larmes coulant de leur propre chef un soir de décembre sous les lumières glauques de la gare TER de Besançon. Un jour, si vous avez le temps, je vous parlerai des larmes insolentes et mécaniques qui me tenaillent dans les dernières scènes du Ladri di biciclette/Voleur de bicyclette (Vittorio de Sica, 1948) et de Hotaru no haka/Le tombeau des lucioles (Isao Takahata, 1988). Enfin, le récit rétrospectif de Carlos Liscano , L’écrivain et l’autre, son obsession à comprendre la cruauté de ses tortionnaires m’ont étourdi d’un sombre chagrin.
Ce sont ce désespoir, cette peine perçante et cette tristesse inconsolable qui m’ont submergé à la lecture de l’article du Monde , plongeant mon âme dans la mare crasse et puante de la férocité humaine. Le récit est effrayant. Il dit malheureusement ce qu’est aussi l’humanité. Il
doit être lu. Le Monde, mardi 15 octobre 2024. « Le courage de Milly, survivante d’un viol collectif », un reportage de Lorraine de Foucher.
Pendant la lecture, la petite bulle pesait mille tonnes. J’ai dû m’y reprendre à plusieurs fois pour lire quelques lignes, les plus dures. Le barrage a cédé sous la pression des eaux noires et nauséabondes. J’étais vulnérable comme Noland sur son île. Je souffrais d’un trop-plein de peine. Longtemps, dans l’après-midi, j’ai pensé au calvaire de cette jeune fille. J’ai cherché à apaiser la colère sourde qui me tourmentait et ma tristesse. À la quête d’un air frais, réconfortant, j’ai lancé ma playlist de Jonathan Wilson dans mes écouteurs.
J’ai découvert Jonathan Wilson en 2018, en écoutant une radio éclectique vantée depuis par un multimilliardaire vantard et populiste. Le titre « Trafalgar Square » m’a immédiatement plu : ancien ado accro au rock progressif, la composition de Jonathan Wilson a touché juste. Par la suite, j’ai découvert d’autres titres magnifiques, oscillant entre folk, rock psychédélique, funk et blues. Un enchaînement de titres plaisants et apaisants chantés d’une voix tendre. En réécoutant « Gentle Spirit », « Valley of the Silver Moon », « Illumination », « All the Way Down », « Her Hair Is Growing Long1 » et les reprises de « Fazon2 » et « Angel3 », j’ai fini par retrouver une part de sérénité ce jour-là. Je n’ai pas oublié Milly mais j’ai pu avaler ma salive et croire que nous sommes nombreux à rêver d’une vie douce et belle, pour moi, pour vous, pour tous ; que nous sommes une multitude à nous battre contre notre bestialité et nos instincts mauvais en étreignant chaque parcelle de bonheur comme un fétiche contre le pire.
Dans l’immensité de la médiocrité, chaque indice d’humanité, chaque célébration du beau sont bons à prendre. Alors je prends. Je prends ce que je peux. Je veux être un gamin de trois ans, étourdi par l’abondance des points jaunes, qui titube dans l’herbe rase et sale pour offrir une poignée de fleurs de pissenlits. C’est pourquoi, fatigué de l’actualité maussade, lassé du mauvais ordinaire, je fonce dès que possible dans Novo : j’observe, je regarde, je découvre, j’entends, j’apprends, je m’extirpe, je courre, je cueille.
Oh ! les belles photos ! Robert Guédiguian par Florence Behar Aboudaram (p. 39) ; Velvet par Nathalie B éasse (p. 47) ; Peter Stamm par Nicolas B é zard (p. 59) ; un lit défait par Olivier Metzger (p. 83) ; Ayline Olukman (p. 87) ; Melita par Anne Immelé (p. 94).
Oh ! les beaux titres ! Déplacer le soleil (p. 43) ; Blue Helvète (p. 58) ; Pluie de Paillettes (p. 80) ; J’ai acheté le même pantalon en cuir que Johnny Rotten (p. 111) ; Salaud, mon ami ! (p. 118), etc.
Oh ! les bons mots ! « Dans la rue aussi, c’était le chaos. Partout des panneaux d’affichage numériques annonçaient une ville plus apaisée » (p. 5) ; « Normalement, je n’aime pas le mois de juillet et le mois d’aout, je déteste quand le rythme ralentit, jusqu’à devenir inexistant. La chaleur qui alourdit tout et le silence de tout le monde qui se réfugie dans les maisons de famille (…) moi je n’ai rien de tout ça. Personne à rejoindre » (p. 112), etc.
Oh ! les belles idées ! « Nous croyons vouloir posséder, mais ce qui nous rend vivants est le fugace, l’insaisissable, le mystère » (p. 11) ; « Car au fond, le pire qui puisse arriver à quelqu’un qui voudrait raconter notre temps avec une caméra, c’est le regard touristique, celui qui ne donne forme à rien et qui n’a pas de point de vue » (p. 37) ; « Plus que la complexité psychologique, c’est la pensée et ses arborescences qui m’inspirent. Face à cet entrelacement de formes et de réflexions simples, le spectateur va en relire une toute autre et se faire sa propre lecture » (p. 52) ; « Je tenais à ce que, sur le disque, soit célébré un instant de vie, un moment de joie que m’apportent les sonorités mêlées de ces deux instruments-là, joués par ces deux musicienslà » (p. 69) ; « Le bruit des voitures plisse le silence/ Je ne dis rien, tu ne dis rien. » (p. 115), etc.
Oui, je veux que Novo me sorte de mon « trou », je veux voir d’autres paysages, je veux respirer un autre air, parfumé, je veux survoler des villes où les gens sont bons et meilleurs ! Je veux croire qu’ils sont bons et meilleurs. Et nous quitterons nos caves, débarrassés de nos perversions quotidiennes, des douleurs du monde, pour nous retrouver dans la vallée. Et nous éprouverons du plaisir à regarder, ensemble et en silence, fascinés par l’idée de l’infini, enveloppés par la douce sérénité de la nuit, la lune d’argent.
1 — Jonathan Wilson, 2013, Fanfare : “I am saved by her rainbow eyes / Now I’ve placed her in this song / She smokes she sees / Her hair is growing long / And we dance (x3) / And the night goes on...”
2 — Sopwith Camel, 1973, The Miraculous Hump Returns from the Moon: “Who’s going to live / In all those cities underground? If they move there / Will they ever come out, of the ground?”
3 — Bob Welch pour Fleetwood Mac, 1974, Heroes Are Hard to Find: “Angel / You know I want to see you / Angel, I really want to see you, right now”
LE PALÉOPHONE DU COLONEL
Par Bruno Lagabbe
AU-DESSUS DE MA TÊTE

Monter le sentier qui mène au jardin avec les bottes en caoutchouc qui vous scient les mollets, c’est pas de la tarte quand on a six ans, mais c’est mieux que de rester coincé à regarder par la porte du hall d’entrée la gouttière de la maison voisine déborder. Au plus fort de l’averse, la cascade gicle sur les cailloux dans un grésillement tonitruant qui s’atténue decrescendo pour ne laisser à la fin que quelques gouttes çà et là résonner pizzicato dans la cour. La pluie s’est arrêtée, je sors. J’ai la permission de la grand-mère. La pente est raide. À mi-chemin, un tonneau de récupération d’eau finit de déborder. Je passe sans m’arrêter devant le réservoir à poissons pour aboutir dans l’allée bordée à gauche par une haie tachetée de petites boules blanches qui explosent dans un bruit de
pétard mouillé quand on les fracasse sur le sol, et à droite par un bosquet de noisetiers dont on fait les arcs et les flèches.
Une pause s’impose. Essoufflé par l’effort, je n’entends plus que ma respiration dans le silence puis, au loin, une plainte inconnue, inquiétante et répétée, mais sans régularité se mêle aux roucoulements des tourterelles. C’est la scierie près du cimetière, je l’apprendrai plus tard. Mes oreilles décollées ne ratent rien du concert, mon ventre fait caisse de résonance : revoilà les tambours du 11 novembre.
En suivant les bulles d’air du tuyau d’arrosage vert et translucide qui court dans le jardin, je débouche sur le potager. Là, c’est la féerie, l’extase ! Les carrés sont délimités par des alignements de centaines de cadavres de bouteilles de vin enfoncés aux deux tiers dans la terre, tête en bas. Le soleil revenu, les rangées de culots remplis d’eau projettent en tous sens des éclats lumineux qui m’éclaboussent le visage, le cœur et la cervelle. Je suis ivre, j’accuse le coup. Tout le jardin se réchauffe et moi avec. Les papillons blancs sont de retour et les cloches de l’église sonnent quatre heures.
— OVER MY HEAD,
Pere Ubu, LP The Modern Dance – Blank Records 1978 écoutable sur le blog : lepaleophone.blogspot.com
Le Colonel et ses amis réalisent « Opération Kangourou » : émission radiophonique de microsillons hors d’âge sur p-node.org (DAB+ Paris/Mulhouse) le samedi à 15 h.
Père Ubu, The Modern Dance



















































































ÉPILOGUE
Par Philippe Schweyer

Pour refermer ce numéro, une photographie prise à Raqa (ou Raqqa) en Syrie durant l’été 2010. On y voit un enfant photographié par Marin, le fils de l’écrivain Christophe Fourvel. Quand celui-ci lui a proposé un Coca-Cola, l’enfant a préféré emprunter son appareil photo. Les portraits qu’il a pris sur un marché de Raqa avec cet appareil rudimentaire se sont retrouvés dans Raqa. L’Histoire n’est encore qu’un regard d’enfant, un livre qui n’aurait jamais dû exister. Depuis la fuite de Bachar el-Assad, je repense à ce petit livre et à cet enfant. Dans le livre publié en octobre 2011, alors qu’en Syrie les manifestations pacifistes nées dans le cadre du Printemps arabe ont été réprimées brutalement et que le mouvement de contestation s’est transformé en rébellion armée, Christophe Fourvel écrit : « Un enfant se saisit d’un appareil photographique pour la première fois à Raqa, durant l’été 2010 et cadre des visages dans la rue. Il s’amuse parfois à en rogner une partie. Cette situation et la fiction qui va peu à peu en naître est encore un brouillon. Les visages montrés
ici respiraient tous l’air commun d’un seul bout de rue, il y a de cela treize mois. Ils se croisaient, s’apercevaient. Le drame syrien n’est pas encore perceptible parmi ces présences qui absorbent notre regard. Il est ici un film transparent, le faisceau d’une intention dont nous choisirons sans doute de recouvrir ces photographies ; un casting. Car regardons encore : les visages disposés sous nos yeux sont ceux de manifestants, de policiers, d’indics, de chabihas, de mukhabarats, de victimes ; de rebelles, d’indifférents, de pleutres, de torturés. Mais aucun des costumes n’est encore endossé. Chacun est le personnage qu’il sera bientôt mais dans la plus grande discrétion. L’enfant sait-il de quel côté de l’Histoire vont tomber les visages qu’il fixe ? » Alors que l’Histoire vient de basculer en Syrie, je me demande à mon tour de quel côté de l’Histoire sont tombés les visages fixés par cet enfant. Je me demande – sans oser croire à une réponse heureuse –ce qu’est devenu cet enfant dont le visage n’aurait jamais dû se retrouver dans ce magazine.


















LE PRIX DE L’INDÉPENDANCE !
ABONNEMENT À NOVO = 30 €
ADHÉSION AU CLUB MÉDIAPOP = 100 €
(ABONNEMENT À NOVO + 4 DISQUES MÉDIAPOP RECORDS * OU 4 LIVRES MÉDIAPOP ÉDITIONS * OU 2 DISQUES + 2 LIVRES *
Cadeau Bonus : Médiapop vous offre un livre ou un disque au choix si vous parrainez un ami ! * Dans la limite des stocks disponibles et pour une valeur de 100 € maximum.)

centrepompidou-metz.fr
#apreslafin
Saison croisée Brésil - France 2025
Belkis Ayón, Sans titre, 1993. Collographie, gélatine, 78,5 × 66, cm Béziers, Collection Reynald Lally - Photo Patrick Brunet © Adagp, Paris, 2024
