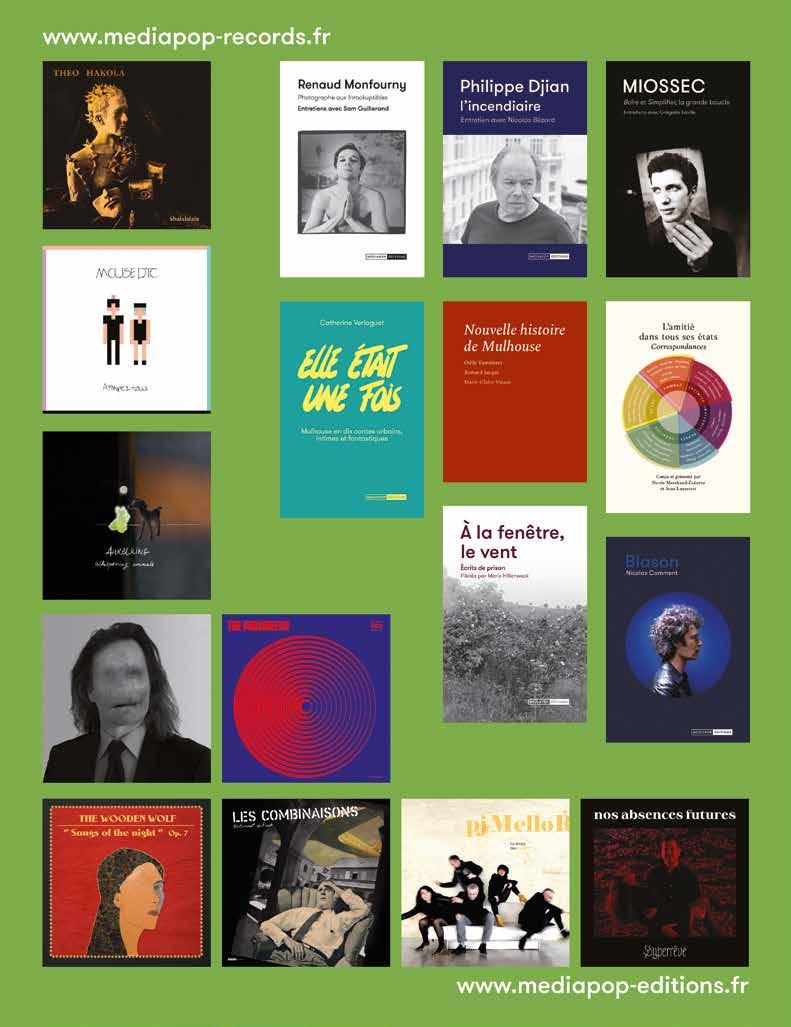Directeurs de la publication et de la rédaction :
Bruno Chibane & Philippe Schweyer
Rédacteur en chef : Philippe Schweyer ps@mediapop.fr
06 22 44 68 67
Secrétaire de rédaction : Aude Ziegelmeyer
Relecture : Manon Landreau
Direction artistique : Starlight
Ont participé à ce numéro :
RÉDACTEURS
Nathalie Bach, Nicolas Bézard, Valérie Bisson, Benjamin Bottemer, Alma Decaix-Massiani, Claude De Barros, Emmanuel Dosda, Caroline Châtelet, Lucie Chevron, Nicolas Comment, Coralie Donas, Dominique Falkner, Christophe Fourvel, Marion Guilbaud, Clo Jack, Mathieu Jeannette, Bruno Lagabbe, Fanny Laemmel, Pierre Lemarchand, Robert Lenoir, Lucas Le Texier, Guillaume Malvoisin, Stéphanie-Lucie Mathern, Luc Maechel, Myriam Mechita, Lisa Mertz, Martial Ratel, Mylène Mistre-Schaal, Nicolas Querci, Louis Ucciani, Aurélie Vautrin, Nathanaelle Viaux, Clément Willer, Gilles Weinzaepflen, Aude Ziegelmeyer, Lisa Zimmermann.
PHOTOGRAPHES ET ILLUSTRATEURS
Vincent Arbelet, Pascal Bastien, Bearboz, Nicolas Bézard, Sébastien Bozon, Thaïs Breton, Mar Castañedo, Tanguy Clory, Nicolas Comment, Stan Cuesta, Caroline Cutaia, Régis Delacote, Richard Dumas, Romain Gamba, Alicia Gardès, Delphine Ghosarossian, Teona Goreci, Anne Immelé, Nicolas Leblanc, Benoît Linder, Myla Lelion Savre, Renaud Monfourny, Zélie Noreda, Arno Paul, Bernard Plossu, Ritchie Rabaraona, Olivier Roller, Dorian Rollin, Christophe Urbain, Henri Walliser, Nicolas Waltefaugle.
COUVERTURE
© Jean-Claude Fingenwald. Fête de l’Huma, 1977. https://jeanclaudefigenwald.com/
IMPRIMEUR
Estimprim – PubliVal Conseils
Dépôt légal : juin 2024
ISSN : 1969-9514 – © Novo 2024 Le contenu des articles n’engage que leurs auteurs. Les manuscrits et documents publiés ne sont pas renvoyés.
CE MAGAZINE EST ÉDITÉ PAR CHICMEDIAS & MÉDIAPOP
CHICMEDIAS
37 rue du Fossé des Treize / 67000 Strasbourg Sarl au capital de 47 057 € – Siret 509 169 280 00047
Direction : Bruno Chibane bruno.chibane@chicmedias.com — 06 08 07 99 45 Responsable administratif : Gwenaëlle Lecointe administration@chicmedias.com — 03 67 08 20 87
MÉDIAPOP
12 quai d’Isly / 68100 Mulhouse Sarl au capital de 1000 € – Siret 507 961 001 00017
Direction : Philippe Schweyer ps@mediapop.fr – 06 22 44 68 67 www.mediapop.fr
ABONNEMENT
Novo est gratuit, mais vous pouvez vous abonner pour le recevoir où vous voulez.
ABONNEMENT France : 4 numéros — 30 €
Hors France : 4 numéros — 50 €
DIFFUSION
Contactez-nous pour diffuser Novo auprès de votre public.
WWW.NOVOMAG.FR
PROLOGUE 7
FOCUS 9-29
La sélection des spectacles, festivals et inaugurations
ÉCRITURES
31-41
Philippe Garnier 32-37, Franck Courtès 38-41
SONS 43-64
Musica 44-47, Last Train 48-51, Lescop 52-53, Beans 54-55 , Miki Berenyi Trio 56-57, La Guerre du Son 58-59 , Hoboken Division 60-61, So Young But So Cold 62-64
ARTS
65-89
La peinture germanique 66-70, La Bnu 71, Julie Doucet 72-73 , Katharina Grosse 74-75, Dan Flavin 76-77 , Esther Ferrer et La Ribot 78-79, Gaëtan Gromer 80-82 , Younes Rahmoun 82-83, La Biennale Photo de Mulhouse 84-89
IN SITU
91-103
Les expositions de l’été
CHRONIQUES
105-124
Nicolas Comment 106-111, Stéphanie-Lucie Mathern 112-113 , Myriam Mechita 114-115, Emmanuel Abela 116-117 , Martin Möller-Smejkal 118-119, Jean-Luc Wertenschlag 120-121 , Nathalie Bach 122, Claude De Barros 124
SELECTA
Livres 126
Disques 128
ÉPILOGUE
130
SOMMAIRE OURS

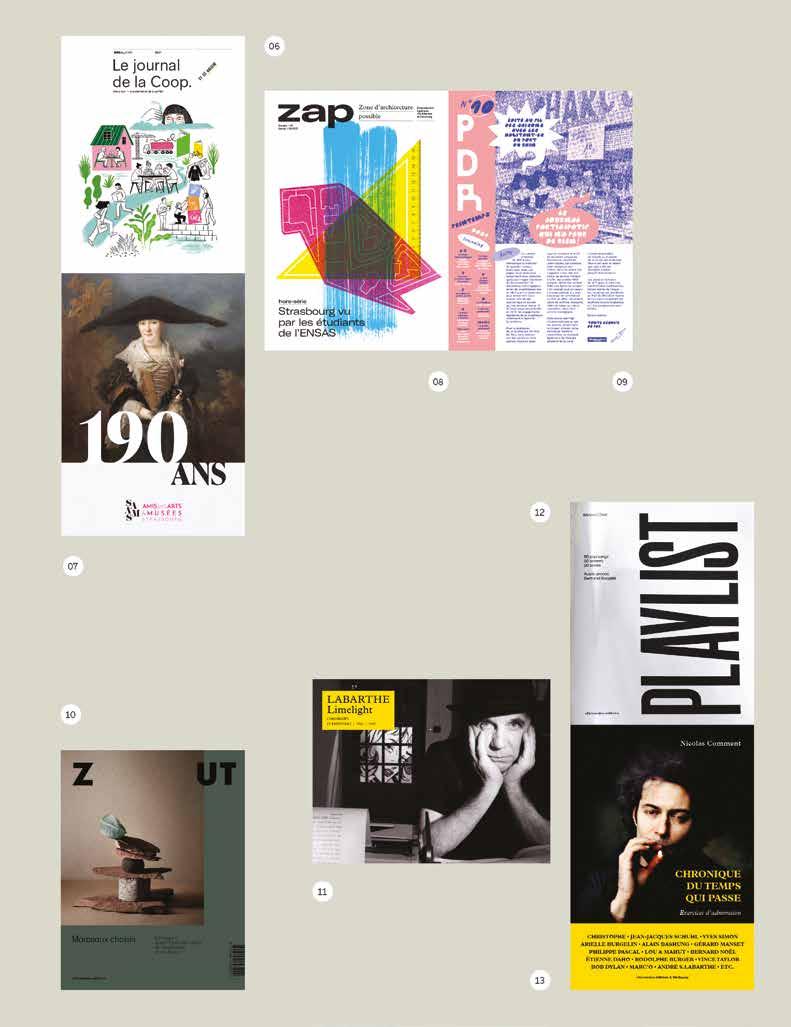

UN POINT C’EST TOUT
Par Philippe Schweyer
J’avais roulé toute la nuit en écoutant en boucle un vieux CD de Françoise Hardy. Alors que le soleil venait de se lever, j’ai décidé de m’arrêter pour faire une pause. Dans l’immense station-service encore déserte, j’ai suivi les flèches jusqu’aux toilettes. Les haut-parleurs diffusaient de la musique produite par une intelligence artificielle bas de gamme. Un jeune homme en costard planté face à la rangée d’urinoirs sifflotait gaiement. J’ai tourné légèrement la tête le temps de reconnaître Jordan Bardella. Malgré une envie pressante, j’étais incapable d’uriner en sa présence. De son côté, il continuait de siffloter comme si de rien n’était. Il avait dû passer la nuit à écluser des bières. Quand il eut terminé, je suis enfin arrivé à me détendre. De son côté, Jordan Bardella était maintenant occupé à se savonner méticuleusement les mains, toujours en sifflotant. Il s’est approché de la glace pour inspecter son visage tout en tirant un peigne minuscule de sa veste. On aurait dit qu’il n’avait pas remarqué ma présence. Seul dans son monde, il a rangé son peigne et extirpé un rasoir jetable de sa veste, puis il a étalé un peu de savon sur son menton pourtant imberbe avant de se raser précautionneusement. On aurait dit un chirurgien calculant au millimètre près chacun de ses gestes. Toujours en sifflotant, il a rangé son rasoir et fait apparaître comme par magie deux cotons-tiges bien blancs pour se nettoyer délicatement les oreilles. Le mieux était de faire comme si je ne l’avais pas reconnu :
— Les toilettes sont propres ce matin.
— Oui.
— Ça fait plaisir.
— Oui.
— Je ne dirais pas que ça sent la rose, mais ça sent bon.
Il s’est arrêté de siffloter. Il semblait soudain sur ses gardes.
— Ce n’est pas toujours le cas.
— Vous n’êtes pas content que les toilettes soient propres ce matin ?
— Je suis super content.
— Alors pourquoi ?
— Pourquoi quoi ?
— Pourquoi tant de haine ?
Soudain, il a semblé très fatigué. On aurait dit qu’il venait de vieillir de dix ans. Il a sorti un petit pot de fond de teint de la poche de son pantalon. Il s’en est étalé une bonne couche autour des yeux, mais il n’y avait pas moyen de faire disparaître ses cernes. Une immense lassitude se lisait à présent dans son regard habituellement conquérant. J’ai répété ma question :
— Pourquoi tant de haine ?
Je devinais qu’il ne s’était jamais posé la question. Ou plutôt qu’il avait enfoui la réponse très profondément. À présent, il me faisait presque de la peine. Je ne pouvais pas le laisser repartir comme ça. Je me doutais bien qu’il ne devait pas avoir beaucoup d’amis. Je lui ai donné une petite tape sur l’épaule et lui ai proposé de boire un café avant de reprendre la route. Un serveur qui aurait dû être à la retraite depuis longtemps pressait des oranges tout en accueillant les clients, le sourire aux lèvres. Nous sommes restés assis face à face sans rien dire en attendant que nos cafés refroidissent. Le vieux serveur nous a demandé si tout allait bien. Jordan Bardella était perdu dans ses pensées. J’ai répondu que tout allait bien. Ensuite, j’ai fixé Jordan Bardella droit dans les yeux et relancé la conversation : — Le personnel est attentionné. — Oui.
— C’est agréable quand les gens sont sympas. Jordan Bardella a poussé un long soupir. Il n’avait plus la force de débattre. Il rêvait d’une bonne nuit de sommeil. Tandis que son garde du corps venait de faire irruption, j’ai répété une dernière fois ma question :
— Pourquoi tant de haine ?
Jordan Bardella m’a regardé d’un air las. Son garde du corps n’était plus qu’à quelques mètres. On aurait dit qu’il hésitait à me livrer un secret, mais il s’est contenté de resserrer son nœud de cravate. Il n’était pas programmé pour répondre à mes questions. C’était comme ça, un point c’est tout.
7

-
f oc
u s
Du mur à la page
Première rétrospective complète consacrée à l’auteur du roman graphique Ici, chantre d’une œuvre audacieuse au graphisme singulier, Richard McGuire, « Then and There, Here and Now » revient sur quarante années de carrière de l’artiste américain. Ses débuts dans le street-art, ses affiches pour son groupe post-punk Liquid Liquid, ses illustrations et couvertures pour le New Yorker, pour des ouvrages pour enfants ou des films d’animation, côtoient des originaux de ses albums, notamment tirés de son roman graphique à venir. Le tout au sein d’une scénographie inspirée des formes minimalistes, à l’esthétique subtile, qui composent le langage d’Ici. (B.B.)
Richard McGuire, Then and There, Here and Now Jusqu’au 3 novembre au Cartoonmuseum de Bâle, à Bâle www.cartoonmuseum.ch
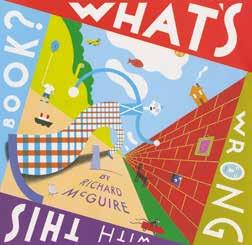
 © Romain Vadala
© Romain Vadala
Des mots pour le voir
Quatre-vingt-un dossiers : c’est l’héritage transmis à Julie Luzoir par son père, qui a numérisé chaque cliché familial pris entre 1924 et 2012. « Une mémoire qui ne pèse presque rien », explique l’artiste, qui s’est rendu compte que la qualité des photos était insuffisante pour en faire une exposition. Elle a donc entrepris un travail d’écriture, littéralement déroulé ici sous forme de textes et d’enregistrements sonores pour nous raconter sa famille, et d’autres : celles des quartiers populaires, des repas de mariage dans la salle à manger, des tapisseries à fleurs. (B.B.)
L’héritage, première partie – 1924-1986 Jusqu’au 3 août à La Conserverie, à Metz www.laconserverieunlieudarchives.fr
Consortium Design Market
Après une première édition couronnée de succès, le Consortium Design Market reprend ses marques au centre d’art contemporain dijonnais ! Vous pourrez une nouvelle fois y chiner toutes sortes d’objets et autres mobiliers des années 50 à aujourd’hui ; et même découvrir le savoir-faire des jeunes créateurs de la région avec l’apparition cette année d’un espace dédié. Le tout rythmé par des projections, conférences, expositions, et bien évidemment une grande vente aux enchères accessible à tous. Adjugé ! (A.V.)
Du 27 au 29 septembre au Consortium Museum, à Dijon leconsortium.fr

focus
Richard McGuire, What’s Wrong With This Book?
Consortium Design Market 2023 © Boris Masson
10
focus

Dijon electronic story
C’est bien connu, l’histoire des musiques électroniques à Dijon démarre en 1990 à l’An-Fer, le paradis des clubbers, où vont officier pendant une douzaine d’années une belle brochette de DJs légendaires : Laurent Garnier, les Daft Punk, Bob Sinclar, Vitalic, David Guetta, Derrick May, Jeff Mills… Tout le reste, Martial Ratel, pilier de Radio Dijon Campus et collaborateur fidèle de Novo, le raconte de manière très vivante en passant au tamis une centaine d’entretiens avec les principaux protagonistes de chaque époque. Richement illustré, ce livre « kaléidoscopique », qui s’avale d’une traite ou se savoure en picorant au hasard, est publié par les jeunes éditions Selma & Salem dont on guette avec impatience les prochaines parutions. (P.S.)
selmaetsalem.fr
Que la montagne est belle
Quand Gunther Marisa via son asso The Woof et le réalisateur Arnaud Masson via son asso Balance Ton Son décident de monter un beau projet, ils ne font pas les choses à moitié. Pour leur toute première « Aube Session », ils invitent le magnifique Christophe Calpini et le fabuleux Erik Truffaz à se produire dans un cadre idyllique à un horaire qui fera autant plaisir aux couche-tard qu’aux lève-tôt. Cerise sur le gâteau, toute cette aventure sera mise en boîte pour en faire profiter les malheureux absents. Rendez-vous le 13 juillet à 5 heures du matin au cœur du vignoble alsacien pour une expérience sensorielle qui s’annonce inoubliable (le lieu précis sera communiqué la veille). Attention : les places sont limitées et il est fortement conseillé de réserver sans tarder. (P.S.)
www.balancetonson.alsace/aubesession

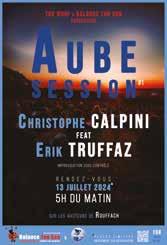
Les Eurockéennes de 7 à 77 ans
Les Eurocks restent le rite de passage obligé des jeunes assoiffés de musique en quête d’expérience collective XXL. Qui n’a pas expérimenté le camping en plein cagnard ou sous la boue n’aura rien à raconter à ses enfants. Quant aux ancêtres largués par la prog, ils y reviennent pour s’incliner devant de vieilles gloires (Lenny Kravitz, The Prentenders…), découvrir les sensations du moment et repérer dans la foule quelques amis perdus de vue –qui commencent souvent à prendre un sacré coup de vieux. Cette année, outre des énervés de première (Sum 41), un DJ énervant (David G.), l’inévitable Zaho de Sagazan et quelques pépites dénichées par le festival, on se réjouit de retrouver sur les rives du Malsaucy le heavy blues de Dirty Deep et la pop impeccable des Manson’s Child, qui eux ne vieillissent absolument pas. (P.S.)
Festival les 4, 5, 6 et 7 juillet, à Belfort www.eurockeennes.fr
Manson’s
Régis Delacote 11
Child ©

Belleville 2024 © Gilles Aillaud, Intérieur’ 1964
Une saison loin de l’enfer
Hors du tintamarre, point de salut. Mais ce boucan, au sens poétique et détourné, de celui qui fait tinter les mares. Aux canards ou autres gros mammifères chantants. C’est un peu, en très gros résumé, l’esprit affiché aux prémices du lancement de saison de l’Opéra de Dijon. Faire tinter la mare, des boucans, d’harmonies, bien entendu, et d’autres sons familiers qu’on peine à reconnaitre, qu’on aime à savoir pas très loin de nous. Des symphonies, oui, il y en aura. Citons comme illustre exemple, la Septième de Beethoven dirigée en mai prochain par Philippe Herreweghe. Mais avant cela, des mini-sinfonias, des harmonies encore juvéniles, Marine Chagnon et Joséphine Ambroselli, en décembre, des chants profonds et doux, Dream House Quartet en novembre. Si l’Opéra de Dijon n’ignore rien du spectaculaire, la maison se surprend elle-même en découvertes. Dominique Pitoiset, actuel directeur de l’établissement, est metteur en scène maître de plateau. Voir son Château de Barbe-Bleu, sur la partition de Bartok en janvier. C’est aussi De Keersmaeker revisitant Vivaldi et ses Quatre Saisons (avril 25), c’est Le Poème Harmonique se livrant à son Carnaval Baroque (juin 25). C’est, début décembre 24, une relecture casse-briques moderne de Casse-Noisette, par la pianiste Alexandra Dariescu. Ce sont aussi les musiques d’un monde bousculé de toutes parts, d’un monde et de son besoin de consolation. Pas impossible alors qu’un des premiers concerts de la saison réponde à cette exigence. Fatoumata Diawara, accompagnée de l’Orchestre Dijon Bourgogne, fera entendre ce que le continent africain a de ressources musicales encore inexplorées. Le pays mandingue et ses récits miniatures, la mise à jour de manuscrits à Tombouctou, la rigueur des combats de l’âme malienne devraient pouvoir renverser la morosité ambiante. Lui conférer des airs de fête lucide et inflexible.
Par Guillaume Malvoisin
— OPÉRA DE DIJON, saison culturelle à l’Opéra de Dijon, à Dijon opera-dijon.fr

L’âge sans raison
Fin août 2023, Météo a eu quarante ans. À quarante et un ans, le festival n’a rien d’autre en tête que d’enfoncer le clou. La programmation mulhousienne entend bien continuer de foncer dans une joie de vivre consacrée à fêter le paritaire et l’organique. Preuve à l’appui de ses forces, avec ce nouveau quartet insurrectionnel, The Sleep of Reason Produces Monsters. Créé par Mariam Rezaei aux platines, avec Mette Rasmussen au saxophone alto, Gabriele Mitelli à la trompette piccolo et à l’électronique, et Lukas Koenig à la batterie, TSORPM a l’élégance punk de l’improvisation libre et démonte jazz, bruitisme, hip-hop, techno et musique nouvelle pour créer son propre maelström sonore. Paritaire et organique, on l’a dit. Lettré et référencé, aussi. Ce quartet tire son nom d’une gravure de Francisco de Goya, dont le titre est tristement un signe de nos temps modernes. La raison en berne, le monde d’aujourd’hui. Et, si un festival comme Météo s’empare de notre tentation à se résigner, c’est pour la déconstruire à bras battants, à grandes morsures.
Car on fait dans le tranchant et les dents pleines pour Météo 2024. Nouveautés façon clubbing, circulation intérieur/extérieur de Motoco au son du Zam Zam DJ Set, set ambient nourri de fausse tranquillité (Ingrid Schmoliner, Shane Aspegren ou Emilie Skrijelj), abstractions classe et sans concessions (Still House Plants, Deborak Walker). Mais ce qui est acéré, c’est le regard et la volonté de tenir éveillé. La volonté d’accueillir, elle, reste, une fois de plus, nourrie à l’épaule. Bienveillante, chaleureuse, humaine.
Par Guillaume Malvoisin
— FESTIVAL MÉTÉO, festival du 21 au 24 août, à Mulhouse www.festival-meteo.fr
focus
Alicia Gardès © Mette Rasmussen
12


UNIK en son genre
Dans le cadre de son label « Capitale française de la culture 2024 », Pays de Montbéliard Agglomération organise une grande soirée consacrée aux musiques actuelles, la biennommée UNIK ! Pensé comme un one-shot, l’événement sera entièrement gratuit, avec une ambiance de festival et de chouettes groupes triés sur le volet par Matthieu Spiegel, le directeur du Moloco. Les têtes d’affiche ? Rien de moins que les Anglais de Morcheeba !
Groupe phare des années 90-2000 avec dix millions de disques vendus à travers le monde, l’ex-trio devenu duo est revenu sur le devant de la scène en 2021 avec Blackest Blue ; un dixième album dans lequel downbeat, chill, trip folk, electro-pop & soul fusionnaient pour mêler petit plaisir old school et curiosité new age. Programmés également, Étienne de Crécy, DJ made in French touch qui transformera le terrain en dancefloor ; suivi du projet de l’Italien masqué The Bloody Beetroots et son electro trash teinté de dubstep, histoire de clôturer la soirée en bonne compagnie. N’oublions pas également toute une série d’artistes attendus sur les deux autres scènes, en mode découvreurs de talents et autre music-positivisme. À noter d’ailleurs que pour limiter son empreinte écologique, ce temps fort éphémère se tiendra sur le site Japy à Audincourt la veille du festival Rencontres et Racines, permettant ainsi de mutualiser le cadre et les infrastructures techniques. Bien vu !
Par Aurélie Vautrin
— UNIK, festival le 27 juin sur le site Japy, à Audincourt www.lemoloco.com
Retrouvez également Morcheeba au festival Décibulles à Neuve-Église le 14 juillet

Onde de choc
Le changement, c’est maintenant : après une édition spéciale « passage à la dizaine », le festival Détonation se réinvente presque complètement cette année ; une évolution nécessaire, voire carrément indispensable, pour s’assurer un avenir dans le contexte culturel et sociétal que l’on connaît. La ligne directrice ? Se poser en tant que « festival défricheur » ; entendez par là, ne pas inviter de têtes d’affiche, mais programmer tout un tas d’artistes en devenir. Pas moins de 58 talents viendront ainsi mettre le feu chacun à leur façon – d’ailleurs, jamais Détonation n’aura accueilli autant de groupes : 30 sur les trois scènes principales, et presque autant sur le dancefloor du soundsystem animé par les forces vives locales ! Si l’on s’attend à pas mal d’éclectisme, on retient quand même l’accent mis sur une certaine idée de la French touch, avec des artistes français qui rayonnent à l’international comme Nouvelle Vague, Slift ou Jennifer Cardini ; des personnalités fortes et singulières de la scène actuelle (Bonnie Banane, Astéréotypie…) ; le retour en force des guitares avec pas mal de rock indé ; les nouvelles figures de la scène anglaise avec Finn Foxell, Cucamaras, Getdown Services ; sans oublier le coup de projo sur Sierra, sensation de l’electro féminin darkwave à suivre de près. Autre nouveauté : l’ensemble des concerts se dérouleront cette année dans, sous et autour de La Rodia, le site sera du reste totalement relooké pour l’occasion par le collectif Grand Géant, qui s’occupe de la déco des Vieilles Charrues ou des Eurockéennes. Explosif !
Par Aurélie Vautrin
— DÉTONATION, festival du 26 au 28 septembre à La Rodia, à Besançon www.detonation-festival.com
focus
Morcheeba © DR
14
Sierra © Benoit Julliard


L’Est au Sud
Considéré comme le marché mondial du spectacle vivant, le festival d’Avignon entame sa 78e édition du 29 juin au 21 juillet. Et parmi les 1 500 spectacles répartis dans 150 lieux, onze compagnies et quatre ensembles musicaux issus et sélectionnés par la Région Grand Est vont se produire à Avignon OFF. Théâtre, marionnettes, pièce jeune public, cirque, danse, spectacle musical… Les spectacles Mentez-moi, Bougrr, dé-corrélation/corrélation, La Tristesse de l’Éléphant, France, Les guêpes de l’été nous piquent encore en novembre, Le Mensonge, Après les ruines et La Team représentent la diversité de création de la région. On retrouve également Et puis, de la Soupe compagnie, qui propose un spectacle de marionnettes jeune public donné au Totem. Adapté d’un album du duo d’auteurs-illustrateurs Icinori, ce choix de spectacles résonne avec Strasbourg Capitale Mondiale du Livre 2024. « Qu’est-ce qui fait qu’on vit ensemble, qu’est-ce qui fait qu’on est des êtres humains ? » Ces questions sont abordées à travers une fable de la forêt sans paroles et en musique. Autre spectacle du Grand Est à ne pas manquer au théâtre des Halles : la compagnie Longtemps je me suis couché de bonne heure raconte à travers son théâtre musical, Un pas de chat sauvage, le récit fascinant de Marie NDiaye. Au cœur de l’intrigue, une chanteuse cubaine décédée, Maria Martinez, que deux femmes veulent s’approprier. Entre beauté, étrangeté, compassion, le spectacle a été salué par l’auteure elle-même, le décrivant « furieusement féérique ».
Par Lisa Zimmermann
— FESTIVAL D’AVIGNON, OFF AVIGNON, festival du 29 juin au 21 juillet à divers lieux à Avignon, et le festival 0FF du 3 au 21 juillet festival-avignon.com festivaloffavignon.com

Scènes de rue, le retour !
Après une édition PopUp ! dédiée aux kids l’année dernière, le festival mulhousien fait son come-back cet été sous sa forme habituelle – celle d’une grande fête du spectacle vivant à la programmation follement éclectique. Vingtsix compagnies vont ainsi investir la ville pour présenter plus de trente performances variées ; autant d’invitations à rire à chaudes larmes ou pleurer à gorge déployée – ou peut-être l’inverse, on ne sait plus, il faut dire qu’à Scènes de rue, tout se mêle avec une passion sans bornes, qu’il s’agisse de s’ambiancer comme jaja ou de se questionner sur des problématiques contemporaines. On citera pêle-mêle Fantôme du Collectif La Méandre, un ciné-concert XXL ambiance 1984 intensément poétique ; Les gros patinent bien, odyssée poétique et déjantée sacrée Meilleur Spectacle de théâtre public aux Molières 2022 ; Hiboux de la compagnie Les 3 points de suspension, une (sublime) pièce sur la mort absolument pas mortifère, ou encore Juliette Hecquet et Jouir, pamphlet protéiforme sur l’orgasm gap vertigineux mais hautement invisibilisé entre les hommes et les femmes dans notre belle société. Enfin la Compagnie Volubilis organisera une grande Panique Olympique, entendez par là un immense ballet urbain coloré et ultra-festif, dans lequel des centaines de participants volontaires reprendront en chœur et en corps les règles de la danse et la gestuelle du sport. Sans oublier de nombreuses propositions pour guincher jusqu’au bout de la night. Vous allez transpirer !
Par Aurélie Vautrin
— SCÈNES DE RUE, festival du 4 au 7 juillet à Mulhouse www.scenesderue.fr
focus
Les gros patinent bien © Fabienne Rappeneau
16
BOUGRR ! Voleurs de chansons © Paola Guigou
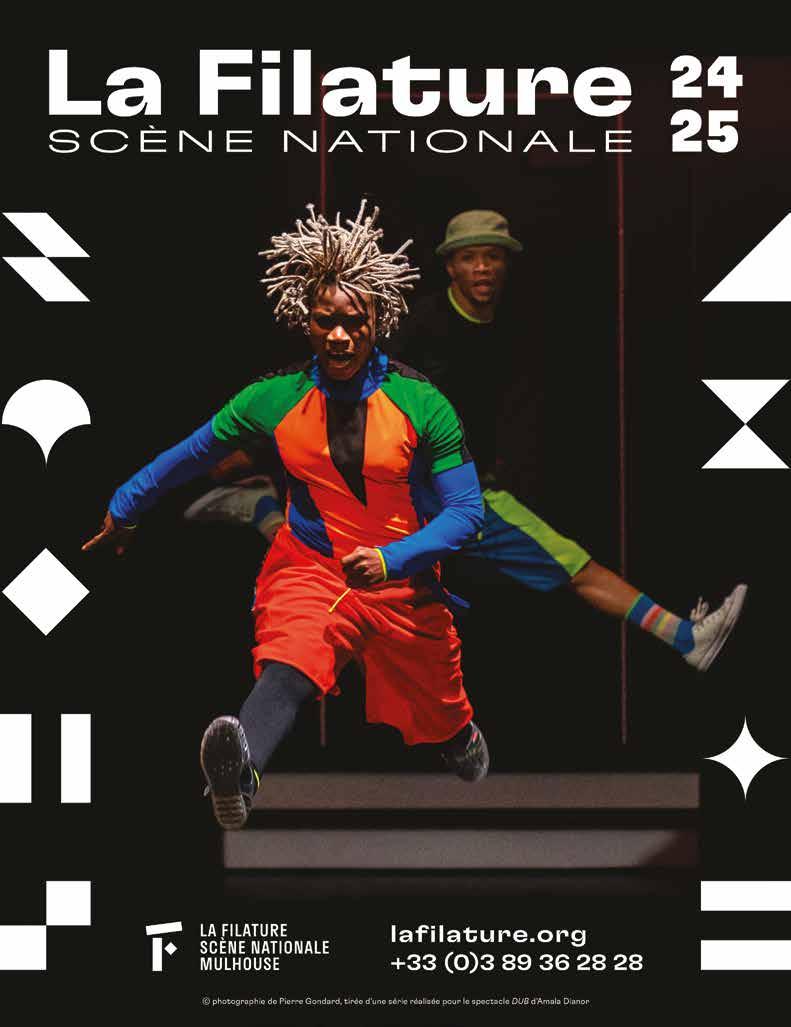
focus

Transes lunaires
Parmi les joies que promet l’été qui vient à Strasbourg, on peut compter celle de sentir la caresse du temps assis en terrasse ou celle de flâner dans les librairies de la ville, sacrée capitale du livre. Mais il ne faudrait pas négliger celle de danser, de fermer les yeux et de rentrer lentement en transe jazzy. C’est ce que rendra possible le festival Jazz à la Petite France, au croisement du jazz et des musiques actuelles. Plus d’une dizaine de concerts auront lieu du 12 au 14 juillet, à l’ombre des tilleuls de la place Saint-Thomas. Ce qui caractérise ce festival depuis ses débuts, c’est son engagement pour une slow culture, en cherchant à inventer un modèle durable, une alternative à la frénésie de certains grands rendez-vous, dont on n’a pas toujours conscience des flots de pollutions qu’ils engendrent… Il va de soi que ça ne signifie pas renoncer à une exigence dans la programmation musicale : c’est même tout le contraire. Dans la programmation paritaire de Jazz à la Petite France se côtoient des formations prometteuses venues de diverses régions du monde : on peut citer Louise Knobil et son trio hard bop originaire de Suisse, Lucia Cadotsch avec son trio Speak Low mêlant influences traditionnelles et avant-gardistes, venu de Suisse et de Suède, ou encore Exotica Lunatica, formation franco-grecque en quête de transcendance spirituelle, qui vient de sortir son premier album, Enter the Moon. C’est un peu cela qui nous est promis, cheminer en transe dans la douceur des soirs d’été, jusqu’à la lune.
Par Clément Willer
— JAZZ À LA PETITE FRANCE, concerts du 12 au 14 juillet, place Saint-Thomas, place du Château et à la médiathèque Olympe-de-Gouges, à Strasbourg www.sturmprod.com

Une langue d’eau
Au fond, on peut se demander pourquoi les formes d’existence naturelle non humaine, fleuves, forêts, montagnes, glaciers ne se verraient pas elles aussi donner la parole, pour qu’elles puissent contester les logiques d’exploitation, de prédation, de destruction qui les menacent… C’est l’idée qui était au cœur du « Parlement des choses », voulu avec enthousiasme par plusieurs personnalités scientifiques et littéraires dans le sillage de Bruno Latour, parlement novateur qui visait à rendre possible un soulèvement légal terrestre. Quelque chose de cette idée est aussi au cœur du très beau spectacle nommé Rivières…, programmé au TAPS Laiterie en juillet. Rivières… est un des huit spectacles s’adressant aux esprits rêveurs de tous âges, qui seront programmés au TAPS Laiterie et au TAPS Scala du 16 juillet au 8 août, conçus comme autant de propositions théâtralement et poétiquement engagées. L’écriture, la mise en scène et l’interprétation sont signées Leslie Montagu. « Avancez sur la pointe des pieds, bavardages en sourdine, mouvements feutrés… Chut, vous allez bientôt pénétrer dans son univers. Elle vous attend. Prenez place sur une berge ou sur l’autre. Et bientôt, elle va raconter. » La rivière, ainsi, va se mettre à parler. Leslie Montagu traduira l’énigme de sa « langue d’eau », en donnant voix aux existences animales ou végétales qui la peuplent, en abordant des questions climatiques et poétiques avec une même délicatesse et une même douceur.
Par Clément Willer
— RIVIÈRES…, spectacle les 16 et 17 juillet au TAPS Laiterie, à Strasbourg taps.strasbourg.eu
Louise Knobil © Valentine Bonafonte
18
Rivières… © Mélie Néel



Ghost writing
Pour cette cinquième édition, le programme annuel « Spectres d’Europe » offre une soirée sous le signe d’un nouveau triptyque qui fait dialoguer les univers de trois jeunes chorégraphes aux styles déjà bien affirmés. Sous les jupes, pièce pour dix danseurs, de Pierre-Émile Lemieux-Venne fait résonner la légèreté profonde et communicative d’airs de la culture populaire, tels que ceux de Céline Dion, Muse, Françoise Hardy ou Andrea Bocelli. Le jeune danseur-chorégraphe du Ballet de l’OnR brise les codes en animant d’une joie simple les portraits dansés, singuliers et décomplexés, d’une jeunesse avide de vivre sa vie, en chantant à tue-tête ses airs préférés sous la douche, en savourant les frémissements de l’amour naissant, en riant à gorge déployée. La danse spectrale pour sept danseurs, Rex, de Lucas Valente, lauréat du dernier Concours de jeunes chorégraphes de Biarritz, s’inspire du mythe intemporel d’Œdipe immortalisé par Sophocle dans Œdipe roi, qui plonge ses protagonistes dans un jeu de clair-obscur où la lumière danse avec les ombres pour mettre en relief la complexité du destin, de la quête de vérité et de la condition humaine. Enfin, les circonvolutions métaphysiques de l’artiste espagnole Alba Castillo surprennent dans une pièce composée en 2020 pour 15 danseurs, Poussière de Terre, n’ayant pas encore pu rencontrer son public à cause de la pandémie. Quand les spectres s’éveillent, que le temps file, inexorable, vers un futur hypothétique, sans que l’on ne puisse jamais suspendre sa course. Les Anciens le mesuraient grâce à l’écoulement d’un sablier. Sans doute avaient-ils remarqué que le temps s’apparente au sable : plus on essaie d’en retenir dans sa main, plus il s’écoule rapidement. Une soirée où les fantômes du passé traversent le présent et présagent du futur.
Par Valérie Bisson
— SPECTRES D’EUROPE, danse les 18-19 juin à La Sinne, à Mulhouse, et du 30 juin au 4 juillet à l’Opéra national du Rhin, à Strasbourg
www.theatre-sinne.fr www.operanationaldurhin.eu/fr

Dialogue entre fous
À quoi pouvaient bien ressembler une institution psychiatrique et ses patients au début du xxe siècle ? Réponse à La Trézorerie, où l’exposition « Waterlöo Divin » invite à découvrir les lettres et le cahier d’internement de Joseph Chazelas, détenu à l’asile civil d’aliénés de Bron de 1908 à 1917. Lumières, cadres, écrans…, la scénographie immersive ainsi que les reconstitutions de voix (historiques, généalogiques, médicales et personnelles) nous plongent dans l’histoire de cet homme, dont le carnet est une véritable pièce d’art brut, possédant son propre langage graphique. « À partir du moment où il est déclaré fou, le patient perd tous ses droits. La seule chose qui le fait encore exister, c’est l’écriture », affirme Alain Berizzi, directeur de La Trézorerie. Émouvants et tragiques, ces textes dénoncent le système qui cherchait à faire taire Joseph Chazelas, tout en révélant sa grande lucidité sur son époque, et l’anticipation de la Première Guerre mondiale.
Par Lisa Mertz
— WATERLÖO DIVIN, exposition jusqu’au 27 octobre à La Trézorerie, à Strasbourg latrezorerie.com
focus
Poussière de Terre, Alba Castillo
20

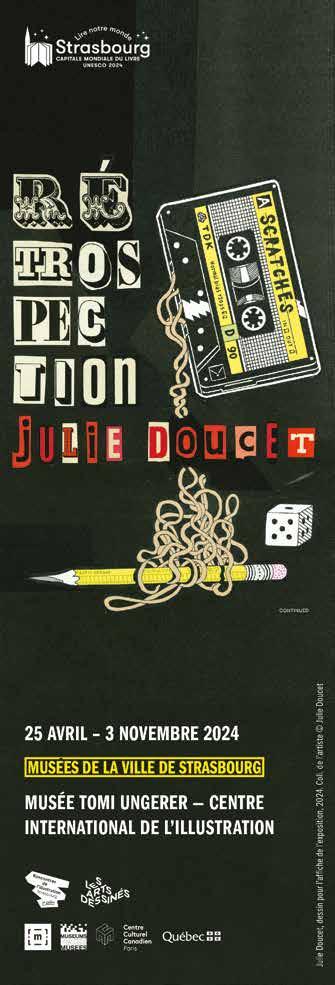

L’été à pleine vapeur
On s’inquiète un peu pour les équipes du centre culturel Les Rotondes, là-bas à Luxembourg : voilà 16 ans qu’à l’approche de l’été, ils proclament fièrement sur leur site : Congés Annulés. Une démarche stakhanoviste qui va ravir tous ceux qui, comme eux, préfèrent la fièvre de la musique à la brûlure des coups de soleil. Entre la fin du mois de juillet et celle du mois d’août, l’événement estival des Rotondes propose une série de concerts où l’accent est mis sur la découverte. Ainsi, Congés Annulés s’ouvre le 26 juillet avec la performance de Billy Nomates, qui allie des textes empreints d’humour noir avec une approche Do It Yourself revendiquée. Le festival se poursuivra avec l’énergie post-punk et les expérimentations synthétiques des Américains Protomartyr et John Maus, les fulgurances au piano de Sofi Paez, ou encore un plongeon dans les traditions de l’île de Java aux côtés des Indonésiens de LAIR. La scène locale n’est pas oubliée : on pourra se lancer dans le sillage de Mutiny on the Bounty (« gros riffs, paysages sonores luxuriants et rythmiques complexes » au programme) ou de Bartleby Delicate et leur electro-folk. En tout, une quinzaine de concerts sont à l’affiche, ainsi que l’exposition « Les Voyeuses », qui propose d’observer sous toutes les coutures les anciens espaces de stockage pour locomotives de la gare luxembourgeoise. Foire aux disques, DJ sets et apéros à la fraîche sur le parvis font également partie des réjouissances en ligne de mire.
Benjamin Bottemer
— CONGÉS ANNULÉS, Du 26 juillet au 21 août aux Rotondes, à Luxembourg. www.rotondes.lu

Géopoétique appliquée
Vous avez sans doute déjà aperçu certaines de ses constellations, non pas en regardant les cieux mais bien en scrutant le béton parisien : depuis près de trente ans, l’artiste de « mythologie urbaine » Aleteïa décroche les étoiles de la voûte céleste et les fait apparaître sur les trottoirs de France et de Navarre. Des cartes stellaires réalisées à la craie ou au ruban adhésif pour illuminer le quotidien de citadins aux yeux toujours rivés au sol… Mais également pour rendre visible la beauté du cosmos là où, habituellement, la pollution lumineuse en masque toute la splendeur. Souhaitant reconnecter les citadins avec l’univers, la plasticienne se fait ainsi porte-parole de la géopoétique de Kenneth White, mouvement philosophique qui vise à rattacher l’humain au monde qui l’entoure. Et si Aleteïa occupe généralement l’espace public, elle se lance pour la première fois à l’assaut du dedans grâce à « Egotarium », une expositxion organisée dans le cadre des Rencontres Urbaines de Nancy (RUN) 2024. Il y est évidemment question d’ego artistique, d’ego d’humain du xxie siècle et de son rapport à la nature ; mais surtout de la difficile construction quand on est une femme dans le milieu artistique contemporain : comment, en plein patriarcat, devient-on Aleteïa ? La réponse en images au musée des Beaux-Arts de Nancy.
Par Aurélie Vautrin
— EGOTARIUM, exposition jusqu’au 1er septembre au musée des Beaux-Arts, à Nancy dans le cadre des Rencontres Urbaines de Nancy musee-des-beaux-arts.nancy.fr
focus
Opening Congés Annulés 2023 © Rotondes
22
Ex-voto Les chevelures de Bérénice, 2023 © Aleteïa



Groove toujours
Ils ne sont pas beaucoup à pouvoir se targuer d’avoir passé la cinquantaine : le Nancy Jazz Pulsations en fait partie, le festival ayant fêté son demi-siècle l’année dernière ! Et l’aventure reprend de plus belle à l’automne prochain, avec une cinquante-et-unième édition placée encore et toujours sous le signe de l’éclectisme ; dix jours de fête et cent-cinquante concerts, au chapiteau de la Pép et au Magic Mirrors, à Nancy, et même hors les murs avec plusieurs dates dans la métropole. Côté programmation, on annonce donc un joyeux melting-pot, avec des têtes d’affiche comme Keziah Jones, Véronique Sanson, Ayo et The Stranglers, ou la venue d’immenses stars du jazz comme Brad Mehldau, Chief Adjuah ou Pat Metheny. On attend également de pied ferme la nu-soul futuriste de Hiatus Kaiyote : les Australiens menés par Naï Palm ne feront que deux (!) dates en France et cinq en Europe - gage de leur volonté de rester résolument underground malgré un succès international grandissant. On note aussi dans notre agenda la venue de Arthur Teboul, le chanteur de Feu Chatterton ! accompagné au piano par Baptiste Trotignon, ou encore celle de Marion Rampal, nommée artiste vocale aux Victoires du Jazz 2022. Enfin, l’un des grands rendez-vous du festival sera probablement celui de Kompromat, réunion du producteur de musiques électroniques Vitalic et de la poétesse punk Rebecca Warrior (Sexy Sushi) à l’Autre Canal. La billetterie est d’ores et déjà ouverte !
Par Aurélie Vautrin
— NANCY JAZZ PULSATIONS, festival du 5 au 19 octobre au Chapiteau de la Pépinière et autres sites, à Nancy nancyjazzpulsations.com

Terre nourricière
Seconde exposition de la galerie messine Octave Cowbell dans ses nouveaux locaux de la rue du Change, « De gestes et de paroles » constitue la fin d’un cycle entamé en 2018 par Vanessa Gandar, sa directrice artistique, autour des rapports entre l’homme et l’environnement et des paysages en transformation. Selon cette dernière, Claire Hannicq, fondatrice de l’atelier Faires dans les Vosges, et Christelle Enault sont des « semeuses » : « En s’inspirant des lignes naturelles du monde végétal, elles cultivent une attention aux formes du vivant. Leurs gestes ancestraux racontent, à partir de matières organiques et séminales, nos histoires et façonnent des passerelles d’amour et de vie, des prières méditatives et sensibles. »
Célébration païenne revendiquée, « De gestes et de paroles » présentera les œuvres d’un duo d’artistes qui, chacune avec leur approche, font dialoguer le vivant avec l’objet, l’image avec son modèle, la galerie avec l’au-dehors. Leurs empreintes, glanages et transformations voisineront dans les 300 m² du lieu, où résonneront aussi quelques sons avec le lancement du disque Sawé Ta Lulwa : la geste des sèves par Christelle Enault, à l’occasion du vernissage. À noter que le jeudi 27 juin, Octave Cowbell accueille le lancement du nouveau Hors-série de Novo réalisé en partenariat avec Plan d’Est, groupement des professionnels de l’écosystème des arts visuels en Grand Est. Une table ronde suivie d’une performance débutera dès 16 h 30.
Par Benjamin Bottemer
— DE GESTES ET DE PAROLES, exposition du 21 juin au 22 septembre à la galerie Octave Cowbell, à Metz www.octavecowbell.fr
focus
Bardane © Christelle Enault
24
Marion Rampal © Alice Le Marin

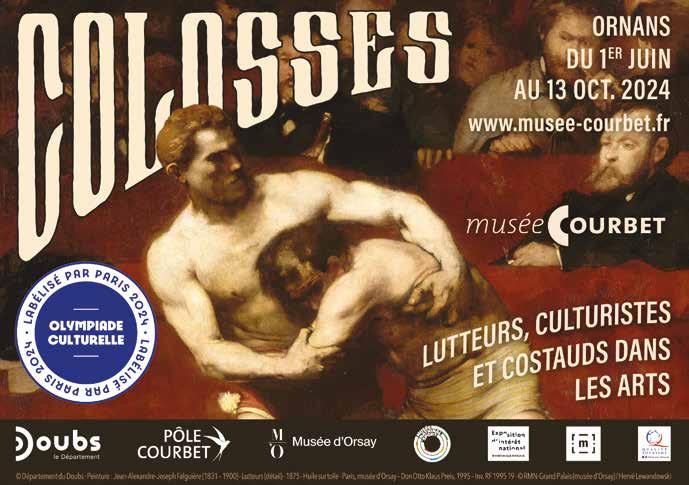

Carpe Diem
Cet été, les plus belles carpes de France ne seront pas dans les étangs mais bien entre les murs du Site Verrier de Meisenthal : le CIAV accueille en effet une grande exposition pluridisciplinaire - la première, d’ailleurs, depuis sa réouverture après d’importants travaux de rénovation. Avec, pour point de départ, l’emblématique Vase à la Carpe imaginé ici même par Émile Gallé en 1878 ! Chefd’œuvre de l’art décoratif, l’objet est également considéré comme un exemple de l’innovation technique et artistique de la verrerie française de la fin du 19e : gravure à l’acide, marqueterie de verre, inclusion de divers matériaux pour obtenir des effets de couleur et de texture… Des pratiques avant-gardistes qui valurent au Lorrain la réputation de pionnier du genre. Au-delà des secrets de fabrication de ce vase, l’exposition du CIAV tisse également des liens entre les époques et les médiums en présentant en parallèle de nombreux documents historiques, objets scientifiques et autres œuvres d’hier et d’aujourd’hui - art contemporain, littérature, illustration, design… Levant ainsi le voile sur la diversité d’interprétations formelles, poétiques ou fantasques de ce poisson d’eau douce. Enfin, les visiteurs profiteront par la même occasion d’un voyage sensible dans le monde des carpistes, tout en survolant les nombreux étangs qui façonnent le Pays de Bitche. Prêts pour un petit plongeon ?
Par Aurélie Vautrin
— MUETTE, LA CARPE ?, exposition jusqu’au 20 octobre, puis du 14 novembre au 30 décembre au CIAV, à Meisenthal www.ciav-meisenthal.fr

Ce n’est qu’un au revoir
C’est ce que l’on appelle une page qui se tourne : l’emblématique cabane en bois du NEST va laisser sa place à un nouvel espace flambant neuf en 2028. D’ici là, le CDN transfrontalier de Thionville Grand Est renouera avec ses origines itinérantes en se produisant dans les salles des fêtes, bibliothèques et autres lieux insolites du territoire mosellan. Rappelons en effet que le Théâtre en Bois, installé sur les berges de la Moselle, fut initialement pensé comme un espace éphémère –la transition aura finalement duré plus de trente ans ! Alors, pour fêter la fin d’une aventure et le début de nombreuses autres, l’équipe du NEST organise une grande soirée le 28 juin prochain ; un moment de communion empli de souvenirs afin d’en créer un dernier à partager tous ensemble. Des « stands-autels » ludiques et participatifs offriront ainsi un drôle de parcours dans l’histoire intime du théâtre, à visiter comme un musée, une église ou une kermesse ; avec, pêle-mêle, un marché d’été, un stand photos en costumes, une balade dans les anciens décors, de la pyrogravure… Les équipes du NEST – actuelles et anciennes –joueront ensuite Le Dernier Spectacle du Théâtre en Bois ou Comment déménager ses fantômes, qui retracera 32 années de représentations en 32 minutes… Puis place au grand brasier orchestré par la compagnie La Machine, un feu libérateur pour brûler le bois comme les souvenirs qui hantent, suivi d’un Grand Bal sur les berges et d’une veillée au cœur du bâtiment. Voilà qui s’annonce riche en émotions.
Par Aurélie Vautrin
— FÊTE D’ADIEU, théâtre le 28 juin au site du Théâtre en Bois, à Thionville www.nest-theatre.fr
focus
Le Théâtre en Bois © Mohamed Louridi
26
Muette, la carpe ? © CCPB


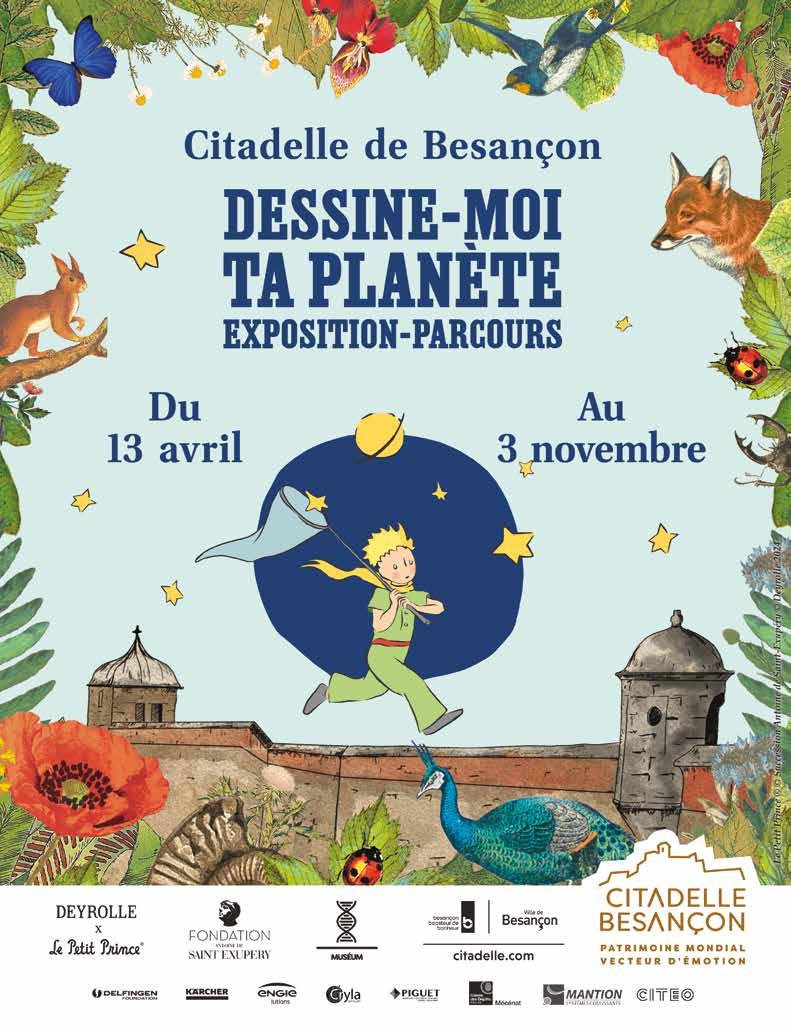
L’indicible
Tout part de notes. Une poignée seulement, essentielle à Philippe Garnier pour flotter parmi les séquoias géants, et à Franck Courtès pour transcender la précarité du métier d’écrivain.
SÉQUOIA BLUES
CRITIQUE ROCK DÈS LES ANNÉES 70, JOURNALISTE, TRADUCTEUR, ROMANCIER, PHILIPPE GARNIER FAIT PARAÎTRE AU PRINTEMPS 2024 LE RÉCIT NEUF MOIS. NOUS LE RENCONTRONS POUR NOVO À PARIS,
LOIN DE LOS ANGELES OÙ IL VIT DEPUIS BIENTÔT 50 ANS.
 Par Pierre Lemarchand ~ Photos : Richard Dumas
Par Pierre Lemarchand ~ Photos : Richard Dumas
30
Parlons de ce livre que tu viens de faire paraître aux É ditions de l’Olivier, Neuf mois , qui conte la mort d’un cancer de ta femme Elizabeth Stromme 1 . Vous avez passé les derniers mois de sa vie loin de tout hôpital, dans une maison isolée au cœur d’une forêt de séquoias géants au nord de San Francisco. Tu l’as accompagnée jusqu’aux derniers instants dans cette « drôle de mort ». Puis ton récit s’attache à la « drôle de vie » que vous aviez menée ensemble les trente années précédentes…
Est-ce que le livre t’a surpris ?
Énormément.
Je crois que c’est un peu mon problème. On ne sait jamais où me classer. Les libraires me connaissent pour mon journalisme, pour traiter des sujets pointus. Et là, c’est personnel.
Ah, je ne pensais pas « surpris » en ce sens. C’est la manière dont tu le traites qui m’a surpris, pas forcément le sujet en lui-même.
Ah, c’est un compliment ! Ça t’a surpris parce que je n’avais jamais écrit comme ça ?
Oui. Et aussi, car, sur un thème comme celui-ci, je m’attendais à tout sauf à ça. L’émotion surgit comme par effraction. Mais avant de parler de style, parlons du temps qui a passé entre l’événement conté dans le livre – la disparition d’Elizabeth en 2006 – et son écriture. Dix-sept années. Pourquoi ? Tu avais peur de ne pas être à la hauteur ?
La peur de ne pas être à la hauteur du thème, ou d’elle, non, pas du tout. Ce qui m’est arrivé c’est que, quelques mois après sa mort, je n’en pouvais plus d’entendre les gens me dire que j’avais été fort, qu’elle avait eu de la chance que je la soutienne ainsi. J’en avais marre de cette figure de saint, de héros. Parce qu’en réalité, elle a toujours tout fait elle-même – y compris mourir. J’ai décidé d’écrire cette histoire pour dire les choses comme elles avaient été, comme je les avais senties, vécues. En réaction, j’avais envie d’un ton presque estival, vacancier. C’est pourquoi j’insiste sur les baignades, les repas, les ramassages de pommes. Car ça a autant compté que les soins. C’étaient des vacances au sens de vide : une sorte d’attente qui ne ressemblait en rien à la vie que nous avions menée. Pour le faire ressentir, il me fallait donner des clés de compréhension sur ce qu’avait été notre vie justement. Mais au début, je voulais en livrer moins, être plus dans la retenue. Quand la nécessité de faire ce livre s’est imposée, j’ai fait face à une difficulté technique. Pour la première fois
de ma vie, j’ai vu la forme du livre tel qu’il devait être, alors que pour tous mes autres livres, c’est l’écriture elle-même qui me conduisait à la forme. C’est pourquoi mes livres sont toujours assez mal foutus ! Je ne les renie pas ; c’est ma façon d’écrire. Je pense que ça vient de mon journalisme.
Pourquoi cela viendrait de ton journalisme ?
Parce que j’écris vite. Celui-ci aussi, je l’ai écrit vite. Ça ne m’a pas pris quinze ans ! Je ne suis pas un mec qui cisèle – on ne se refait pas. Mon habitude n’est pas d’écrire une page chaque jour, puis d’y revenir, réécrire, peaufiner. Je l’ai commencé l’été dernier et ça m’a pris trois mois. Mais j’avais déjà commencé plusieurs fois, pour essayer d’arriver à la forme qu’il revêt aujourd’hui. Ce n’étaient pas les Tables de Moïse, mais j’avais donc une vision assez claire : un objet très mince, plus court encore – ce que j’ai remis aux Éditions de l’Olivier était plus sec, presque aride. Olivier Cohen l’avait accepté tel quel. Quand il l’a mis en lecture à ses collaboratrices, elles ont trouvé que je ne donnais pas assez de clés pour comprendre pourquoi Elizabeth était ainsi. Comment elle avait pu décider de mourir comme ça. D’où lui venait un tel courage. Il m’a donc fallu donner plus : je n’avais pas assez insisté, dans la seconde partie, « La drôle de vie », sur notre jeunesse et notre rencontre. Beaucoup de gens étaient étonnés que nous soyons ensemble : elle avait l’air difficile… Mais ils ne l’avaient pas connue comme je l’avais connue jeune : marrante. J’ai voulu faire revivre ces années-là. Parler de la vie de deux écrivains et évoquer la culpabilité que j’ai longtemps ressentie, avec le plus de franchise possible, quand elle n’a pas réussi à faire publier son premier livre. J’ai eu toutes les facilités et elle, toutes les difficultés – c’est intéressant sur le plan du récit. Mais ça m’a pourri la vie, j’en suis parfois venu à détester son activité. Alors que je ne désire que la célébrer.
— Pour la première fois de ma vie, j’ai vu la forme du livre tel qu’il devait être, alors que pour tous mes autres livres, c’est l’écriture elle-même qui me conduisait à la forme. —
1. L’Américaine Elizabeth Stromme était journaliste et autrice de romans policiers. « Elle avait l’art d’inventer des histoires gaies sur des sujets graves », écrivit Patrick Raynal dans Le Monde à sa mort. Son attention à l’environnement a irrigué son œuvre.
L’écriture s’est libérée à partir du moment où tu as trouvé cette architecture en deux parties, la mort puis la vie ?
Oui, à chaque fois que je commençais, je bloquais. J’ai même tenté d’écrire en anglais, mais
31

rien ne marchait. J’abordais l’histoire de manière linéaire, chronologique : la mauvaise nouvelle, le diagnostic – le début des neuf derniers mois. Ça ne marchait pas. Quand on arrivait aux dernières semaines, on savait tout d’elle, de nous et ça perdait de sa force. Et l’été dernier, m’est venue cette pensée : pourquoi ne ferais-tu pas comme dans tes articles ? C’est-à-dire, plonger le lecteur dans le bain tout de suite, sans explication, sans précision de lieu, rien. Une dynamique se crée, une curiosité, mais c’est casse-gueule, car on peut aussi perdre le lecteur au troisième paragraphe. Mais si on sait y faire, c’est beaucoup plus intéressant. Commencer au commencement, les bras m’en tombent d’avance. Tandis que là, on se demande ce qui se passe, ce que ce couple fait au milieu des bois. Pourquoi cette morphine à la porte ? Livrer les clés au comptegouttes donne une dynamique au récit. Une fois cette drôle de mort écrite, raconter la drôle de vie qui la précède s’est imposée. Ça m’a libéré. Je ne me suis plus posé de questions : j’ai simplement écrit. Cette « méthode » piquée à mon journalisme m’a permis d’écrire naturellement – mais toujours avec la préoccupation de ne pas en donner trop.
D’où te vient ce désir de retenue, de « ne pas en donner trop » ?
D’avoir traduit l’autobiographie de James Salter, Une vie à brûler2. Ce n’est pas un livre parfait, mais je l’admire. Et en le traduisant, j’en ai mieux compris les raisons : il sait dire une chose en peu de mots
et passer aussitôt à une autre. C’est peut-être cela que tu veux dire quand tu parles d’une émotion qui jaillit par effraction. Elle trouve un chemin entre deux blocs de texte, elle se faufile dans un interstice, une fissure. Ce que j’aime chez Salter, et qui m’a je pense influencé, c’est cette prose propulsive, cette manière de passer d’une chose à l’autre très vite. On a à peine le temps de se poser. Neuf mois doit beaucoup à Salter, mais, tandis que je l’écrivais, je ne pensais pas à lui. Je veux dire : ce n’était pas conscient…
Dans la postface que tu as écrite en 1983 à Bandini de John Fante3, tu cites cette phrase de Bukowski : « Enfin, voilà un homme qui n’a pas peur de ses émotions. » L’émotion, quand on traite d’un sujet comme la mort, est immanquablement un matériel avec lequel il t’a fallu composer. Quel rapport entretiens-tu avec elle ? Tu t’en méfies ?
Fante, « he was not afraid of emotions », et pourtant il s’en cachait beaucoup. Ses livres étaient d’une incroyable dureté, sauvages, parfois méchants… Personnellement, je suis émotionnel. En tant que lecteur, je déteste l’étalage, la sensiblerie. Mais qu’une émotion monte des lignes de ce livre, que les gens soient touchés, cela ne me gêne pas. Mais oui, je m’en méfie, de l’émotion. Des gens m’ont dit que les deux parties du livre n’étaient pas écrites de la même manière, ça me chagrine un peu. On me dit que dans la seconde partie, on retrouve mon style habituel. Peut-être est-ce parce que, pour donner une idée de la vie qui était la nôtre, j’ai choisi d’y écrire une série de scènes où on était ensemble ; et comme j’y suis présent, cela ramène à mes écrits précédents – mes écrits rock ou pour Libé, c’est-à-dire une mise en scène de moi-même. Je n’avais pas pensé à cette différence qui se créerait entre les deux parties…
Je ne dirais pas que les deux parties sont écrites différemment. Elles sont toutes deux irriguées par ce style retenu, tranchant, nourri du même désir de ne pas s’épancher et avançant par épisodes, par « blocs ». Ce qui les distingue, c’est ce qu’elles racontent – et qui s’opposent. Dans la première partie, il y a une unité de temps (qui se resserre aux derniers mois), de lieu (la maison de Guerneville et la nature autour) et d’action (l’attente de la mort d’Elizabeth). Il y a là quelque chose de presque dramatique ! La seconde partie court sur des décennies, s’inscrit dans des lieux différents, conte divers épisodes de vie. Elles agissent l’une avec l’autre dans un jeu de contraste. C’est la matière du récit qui me semble différer, non le style.
C’est intéressant. Mais il y a un problème avec ce livre. Il a reçu de bonnes critiques, mais aucune ou
2. Burning the Days, publié en 1997, a paru aux éditions de l’Olivier en 1999, dans la traduction qu’en a fait Philippe Garnier, sous le titre Une vie à brûler : Mémoires
3. Philippe Garnier a traduit certains ouvrages de John Fante et Charles Bukowski, contribuant à les faire connaître en France.
32
La maison d’Elizabeth et Philippe photographiée par Richard Dumas (qui en était amoureux).
presque ne donne envie de le lire. Elles font peur. Ça ne m’étonnerait pas qu’il ne marche pas du tout. On se dit que ça va être triste alors que non – ça ne l’est pas. Je me souviens que quelques mois après la mort d’Elizabeth, quand est né le projet d’écrire, j’ai lu des livres sur le sujet – mais ils ne parlaient que d’absence et de deuil, comme Joan Didion4 par exemple. Je ne m’y reconnaissais pas. Ce n’est pas ce que je voulais faire. Ce n’est pas sur le mort ou la perte que je souhaitais écrire. Je voulais faire un récit sur ce qui s’était passé ; c’est tout. Le chemin qu’a pris Elizabeth est rare. Et qu’elle soit arrivée à bon port, jusque dans les derniers instants, est plus rare encore. C’est une drôle de mort. Loin des hôpitaux, elle a été une aventure amoureuse, une histoire de couple. Ça me semblait valoir le coup d’être raconté.
Pour écrire ce livre, tu confies t’être basé sur des notes prises lors de ces derniers mois. Elizabeth n’en avait pas connaissance ?
Ce ne sont que douze pages ! Pas même un journal, des notes éparses. Elle n’était pas au courant, non. Elle était graphomane. Je pensais qu’elle faisait la même chose de son côté, qu’elle me laisserait des messages, ferait état de ses interrogations ou de ses peurs. Mais non, rien. Sans ces notes, il n’y aurait pas de livre. J’aurais tout oublié ou tout affabulé. Toute ma vie, j’ai refusé de tenir un journal. Car à mes yeux, c’est être littérateur, se regarder vivre. La « self importance », j’ai toujours eu beaucoup de mal avec ça. Et pourtant, tous mes livres sont partis de notes. Quelques mots griffonnés parfois suffisent. Quand quelqu’un me raconte une histoire qui lui est arrivée, je lui dis toujours « écris-la ! ». Pas des pages et des pages, mais quelques phrases qui contreront l’oubli. Aujourd’hui, la mémoire, il n’y a plus que ça qui m’intéresse. Tout ce que j’ai oublié, tout ce que j’ai transformé, c’est terrifiant. Ça me hante dans mon travail journalistique. Génériques, mes trois livres sur le cinéma, ne parlent peut-être que de ça : la difficulté, l’impossibilité presque, de raconter une histoire telle qu’elle s’est vraiment passée. Et sur le plan personnel, ça me hante de voir à quel point la mémoire me joue des tours. Des gens me racontent parfois des histoires, dont certaines remontent à l’époque où je tenais un magasin de disques5, dont je n’ai absolument aucun souvenir. Pour moi, ça n’a pas existé. J’ai eu une discussion récemment avec Serge Kaganski, qui aime mon travail et le suit depuis longtemps. Je lui dis un
regret : n’avoir jamais vu les Clash en concert. Et lui me répond : « Si, tu les as vus. Au Forum, avec Elvis Costello en première partie ! ». Le mec a une meilleure mémoire que moi de ce qui m’est arrivé ! Terrifiant. Il me parle de l’article dans lequel je raconte ce concert – cet article, je n’en ai aucun souvenir non plus. Mais je m’éloigne du sujet – de ces douze pages de notes…
— Elizabeth a toujours tout fait elle-même - y compris mourir . —
Quand tu écris ces pages, es-tu guidé par le souci de les utiliser plus tard, pour écrire ce qui deviendrait Neuf mois ?
Pas du tout. Je note juste des détails qui m’interloquent. L’histoire de l’éponge verte avec laquelle elle s’humecte la bouche, car elle a cessé de boire. Le fait qu’elle insiste pour le faire elle-même. Que je la soupçonne de boire en cachette… c’est une pensée horrible. Elle est en train de faire quelque chose de surhumain et moi je pense cela : c’est sale, dégueulasse. Je sais que c’est la première chose qui devra disparaître de ma mémoire, des pensées comme ça on les oublie. Alors je les note. Mais je n’ai pas noté seulement mes propres pensées. J’ai aussi noté des détails sur l’environnement – les animaux, la nature, –, son comportement et le mien. Sur comment je tenais le coup. Car enfin, ce n’étaient pas des vacances. Ma femme était en train de se tuer. Ces notes, j’avais besoin de les écrire. Elle, n’a jamais ressenti un tel besoin – et à ses pensées, je n’ai pas eu accès. Ces choses, si je ne les avais pas notées sur le moment, sont des souvenirs que je n’aurais jamais repêchés. Le voyage que nous avons fait dans le Minnesota, si je n’en avais pris note, me semblerait aujourd’hui inconcevable. À neuf mois de mourir, faire du tapecul sur des chambres à air dans un torrent, nager dans le Mississippi, c’est presque aberrant.
Vous vous retrouvez Elizabeth et toi dans une maison isolée, à Guerneville au nord de San Francisco. « Loin de tout, au bout d’une route. » Vous rendiez-vous compte de la portée métaphorique de sa localisation ?
4. Joan Didion a publié en 2005, soit l’année qui précède la mort d’Elizabeth, L’année de la pensée magique (The Year of Magical Thinking), hanté par la mort soudaine de son mari Gregory Dunne.
5. Au début des années 70, Philippe Garnier ouvre un magasin de disques rock d’occasion, Crazy Little Thing, dans sa ville natale, Le Havre. Il est alors critique pour le magazine Rock’n’Folk. Il mettra fin à l’aventure pour s’installer définitivement aux États-Unis, d’abord à San Francisco en 1976 puis, l’année suivante, à Los Angeles où il vit encore aujourd’hui.
Non… Mais c’est utile, ensuite, quand on écrit. La maison était bien au bout de la route, on ne pouvait pas monter plus haut. La seule chose que nous avions remarquée, c’était qu’elle était suffisamment éloignée du patelin pour qu’on ne croise personne, pas même le facteur. Non pas qu’il y ait eu beaucoup de courrier : on s’était déjà coupés de tout.
33




« Nous ne nous parlions plus depuis des semaines et auparavant, nous parlions surtout pour ne rien dire », écris-tu dans ce livre. Comment vous disiez-vous les choses tous les deux ?
Par de petites paroles quotidiennes. « Qu’aimerais-tu manger ? » « Es-tu bien installée ? » « Veux-tu sortir ? » Par des choses toutes simples, comme de jouer aux cartes : nous ne l’avions jamais fait ensemble. Ce jeu idiot nous donnait tant de plaisir. Je me suis rendu compte de cela en écrivant : nous ne faisions rien comme auparavant, rien de ce qui caractérisait notre fonctionnement de couple.
C’est Didion qui a écrit « Nothing applies », dans Play It as It Lays6. « Ça ne marchait plus, ça n’avait plus cours. » Son habitude d’écrire sans cesse, notre habitude d’écouter beaucoup de musique, c’était terminé. Pourquoi n’écoutions-nous plus de
6. Deuxième roman de Joan Didion, publié aux États-Unis en 1970, il s’intitule dans sa plus récente traduction française Mauvais joueurs
musique ? Nous n’avions pourtant rien d’autre à faire. Nous avions apporté plein de films, mais nous regardions plutôt le feu dans la cheminée. C’est étrange. Était-ce notre façon de parler de la mort ? Je ne lui ai à aucun moment demandé ce qu’elle pensait, si elle avait peur, ce qu’elle imaginait qu’il y avait de l’autre côté. C’est comme les dernières paroles : c’est du pipeau. C’est bon pour les livres d’Histoire. Tout ce à quoi je m’attendais, ça ne s’est pas passé comme ça. C’est ça qui est intéressant.
La surprise ?
Cela a révélé un pan d’elle que j’avais toujours ignoré. Quand le diagnostic est tombé, son acceptation de la mort a révélé une très grande force, une immense détermination. Ces derniers mois m’ont fait comprendre que j’étais passé à côté de quelque chose, que je n’avais peut-être pas suffisamment fait attention à elle pendant qu’on était ensemble. Du livre transparaît cette incompréhension.
34
La maison d’Elizabeth et Philippe, 2411 Sunset Boulevard à Los Angeles, photographiée par Richard Dumas en 2005, juste avant sa mise en vente.
Le livre serait alors le portrait d’une femme décidée et d’un homme qui l’est moins ?
Oui. J’étais indolent, je manquais totalement d’ambition, surtout lors de nos premières années de vie commune. Je n’avais alors aucun projet de vie, de carrière, d’écriture. Je me laissais porter. Ça venait aussi de l’époque, les années 70, qui nous permettaient de retomber facilement sur nos pieds. Elle souhaitait une maison, des bases solides tandis que j’attendais, informe… Tout m’est arrivé si facilement – les contrats d’édition, l’opportunité de faire de la télévision7. Ça a été longtemps comme ça. Ce contraste, c’est aussi la vérité de notre couple.
Et l’écriture de ce livre, a-t-elle été porteuse de son lot de surprises ?
Ce qui m’a surpris, c’est que ça marche. J’avais certes une idée nette de ce que je souhaitais faire, je ne savais pas si ça allait fonctionner. Les retours positifs des lecteurs me font penser que oui. Ceux de mes amis aussi. J’ai toujours offert mes livres à mes amis, mais je savais bien qu’ils ne les lisaient pas. Trop pointus. Si on n’est pas passionné de musique, quel intérêt de lire Les coins coupés ? Comment lire les trois volumes de Génériques8 si on n’est pas féru de cinéma ? Là, le sujet a fait qu’ils l’ont lu. Et m’ont fait des retours rapides, émus. Surpris aussi, car ils me lisaient pour la première fois ! Ils ont peut-être été étonnés de voir que j’étais capable d’écrire… sérieusement. De faire de la littérature. Mais est-ce de la littérature ?
Oui, que serait-ce sinon ?
Tu as raison. Ce doit donc être de la littérature. Mais ce mot me renvoie à tout ce que je déteste. Ces gens qui écrivent un livre par an, se connaissent tous entre eux. Enfin, c’est un monde que j’ignore plus que je ne le déteste. Je n’ai rien à voir avec lui – je suis un voyou, qui est entré dans l’écriture par le rock en poussant des portes qui étaient soi-disant interdites à des gens comme moi.
Durant l’écriture de Neuf mois , pensais-tu au lecteur ? Comment as-tu négocié le passage de l’intime au public ?
Je ne me pose à aucun moment la question du lecteur. Je n’ai aucun égard pour lui. Même si ça a toujours été salutaire quand on me l’a rappelé. Pendant très longtemps, on m’a laissé faire et c’est comme ça que j’ai pris mes sales habitudes. Mes vingt premières années à Libé, j’étais un ovni. Mais on m’a laissé l’être, on a même peut-être encouragé ça. J’étais loin, je vivais à Los Angeles et ne mettais jamais les pieds dans la rédaction. Mon seul contact était Bayon9 et il me laissait faire. Je ne savais pas que
7. Il collabore à l’émission Cinéma, Cinémas dans les années 80 sur Antenne 2.
8. Les coins coupés – Sous le rock : une allégorie, Grasset, 2001 ; Génériques, la vraie histoire des films, The Joker Films, 2022. 9. Bayon, à partir des années 80, dirige la rubrique rock dans le quotidien Libération
mes sales habitudes étaient aberrantes : les sujets que je choisissais, la manière dont j’écrivais et la place que je prenais dans le journal – trois ou quatre pages. Des articles tellement longs qu’ils s’étalaient parfois sur deux ou trois numéros. Quand la rédaction recevait mes articles, on me l’apprendrait plus tard, c’était la panique. Comment publier les trucs de ce fou ? Mais Bayon ne me disait rien. Ce n’est que bien plus tard, dans les années 90, que j’ai compris que personne ne faisait ça. J’ai alors commencé à travailler pour d’autres rédactions, comme Vogue, GQ , Air France, Madame – bref, le parcours du combattant du free-lance – et là, j’ai vite compris que ce que j’avais toujours fait était une folie.
Comment les décrirais-tu, ces sales habitudes ?
Suivre mon instinct. Prendre plaisir à paumer le lecteur et le rattraper au moment où il va se barrer. Le bombarder de noms et de titres que personne ne connaît. Mais mon seul espoir, c’est qu’un sur cent aura la curiosité d’aller chercher ce que veut dire ce titre qui n’est pas traduit, qui se cache derrière ce nom que l’on ne connaît pas. S’il y en a un sur cent, j’ai fait mon boulot. Ce n’est peut-être pas le plan de carrière idéal, mais c’est ce que je fais, car c’est le genre de choses que j’aime lire. J’ai appris l’anglais sur les pochettes de disques de Dylan ; j’y ai recherché le sens de mots étranges. « Go watch the geek »10 – un terme de cirque très spécifique. Je me souviens avoir lu une interview où on lui demandait qui était son poète préféré et Dylan avait répondu Smokey Robinson11. J’ai couru à la bibliothèque de l’université où j’étais alors à LA, ai recherché ce nom dans les anthologies de poésie… Je ne connaissais alors pas le label Motown, je ne savais pas qu’il était un génie de la chanson. La réponse de Dylan était faite pour perdre le lecteur, le dérouter ; mais pour moi, il a été l’allumeur. C’est ce que je veux être aussi. Quelqu’un qui suscite la curiosité.
— NEUF MOIS, Philippe Garnier, Éditions de l’Olivier
Extrait du livre (p. 58)
« La majorité de notre temps se passait sur le deck en bois, la terrasse et les chaises longues nous servaient d’aile d’hôpital. C’était sa revanche sur la catastrophe. Elle l’avait. Elle m’avait. Le bleu en haut, sans nuage aucun, jamais. L’odeur de térébenthine qui tombait en fin d’après-midi des séquoias chauffés par le soleil toute la journée. Le murmure de la brise dans les arbres qui s’enflait parfois comme la mer. La netteté de tout cela, comme à travers des jumelles. Nous attendions, sans en avoir l’impression. Nous flottions, plutôt. »
10. In la chanson Ballad of a Thin Man, qui figure dans le sixième album de Bob Dylan, Highway 61 Revisited (Columbia, 1965).
11. Bob Dylan qualifie l’artiste du label Motown de « plus grand poète vivant » lors d’une interview donnée pour le magazine Rolling Stone en novembre 1969.
35
L’ÉCRIVAIN À TOUT FAIRE
Par Nicolas Querci ~ Photo : Pascal Bastien
Lorsque vous avez décidé de vous consacrer à l’écriture, imaginiez-vous qu’il serait aussi difficile d’en vivre ?
Non, je n’imaginais pas la misère dans laquelle cela allait me plonger. J’avais une image très stéréotypée de l’écrivain à cause de mon métier de photographe. Les écrivains que je rencontrais habitaient toujours dans des appartements superbes, ou dans des maisons de campagne de rêve. Je ne rencontrais que des écrivains « consacrés », en fait. De temps en temps, il y avait quand même des gens plus modestes, avec qui je me suis lié d’amitié. Éric Holder, par exemple, qui m’a donné une image de l’écrivain qui me plaisait énormément. Le choc, ça a été de découvrir le petit pourcentage que l’on gagnait sur le prix de vente d’un livre. Et ensuite, les chiffres de ventes… Par rapport à la photo où je gagnais très bien ma vie, c’était le jour et la nuit.
C’est d’autant plus surprenant que l’effort et le temps consacrés à l’écriture d’un livre sont plus importants que ceux consacrés à la réalisation d’un portrait.
Ce n’est pas aussi simple. Il faut des années d’expérience pour arriver à réaliser en dix minutes un portrait qui tienne la route. C’est l’aboutissement d’un long cheminement. L’écriture ressemble un peu à ça. Pour arriver à faire 300 pages, il faut compter deux ans et demi de travail, de relecture, de réécriture. On jette le manuscrit, on recommence tout. Après, quand on
rapporte le revenu tiré d’un livre au temps qu’on y a consacré, c’est dérisoire. Je n’ose même pas le dire à certaines personnes, de peur de casser un mythe.
À partir de quand, lorsque vous avez commencé à faire des petits boulots, avez-vous senti qu’il y avait là la matière pour écrire un livre ?
Un ou deux ans après avoir commencé. À l’époque, je travaillais sur les nouvelles qui composeraient Les liens sacrés du mariage . Je ne prenais pas de notes sur ce que je faisais comme petits boulots. Puis j’ai commencé à tenir un journal. Pas très longtemps, parce que c’était assez ennuyeux de raconter ces anecdotes les unes après les autres. Je me suis dit qu’il valait mieux en faire une sorte de condensé, de donner une forme romanesque à ces expériences. C’est le côté comique qui m’a attiré, le grotesque de ce bourgeois plongé dans la précarité. Il y avait là un sujet assez léger, assez drôle, et en même temps, c’était une façon de raconter le monde du travail d’aujourd’hui, d’apporter un peu de réflexion. J’ai alors commencé à écrire certaines scènes.
Pensez-vous que le fait d’écrire des nouvelles en même temps a influé sur l’écriture de ce livre, divisé en courts chapitres qui constituent presque des petites histoires autonomes ?
Sûrement ! Bien que, dans un roman comme À pied d’œuvre, j’ai surtout travaillé par scènes. Une nouvelle, c’est très différent, ça ne s’articule pas de la même manière avec le reste du livre. Un recueil de nouvelles, c’est vraiment difficile à construire. Et puis, c’est le type de livre qui se vend le moins, qui est le moins bien considéré… Alors que pour moi, c’est ce qu’il y a de plus long, de plus complet, ce qui mobilise le plus de forces. Dans Les liens sacrés du mariage, il y a quatorze nouvelles, avec à chaque fois au minimum un couple. Donc 28 personnages en tête pendant deux ans ! Tout ce que je vois, tout ce que j’entends pendant deux ans va nourrir la psychologie de ces personnages. Avec un roman, l’obsession tourne autour de deux, trois, quatre personnages au maximum. Ce n’est pas le même effort.
Il y a des moments où le travail manuel, la fatigue engendrée, ont pu menacer le travail d’écriture ?
Mes petits boulots n’ont jamais mis en danger le travail littéraire. Je pense qu’un travail de
PHOTOGRAPHE RECONNU, FRANCK
A TOUT PLAQUÉ POUR SE CONSACRER À L’ÉCRITURE AU DÉBUT DES ANNÉES 2010. DANS SON DERNIER LIVRE, À PIED D’ŒUVRE, IL RACONTE AVEC SINCÉRITÉ, HUMOUR
PATHOS,
IL
EN
36
ALORS QU’IL ÉTAIT UN
COURTÈS
ET SANS
LA PAUVRETÉ DANS LAQUELLE
EST TOMBÉ ET SA TRANSFORMATION
HOMME À TOUT FAIRE.

professeur ou de journaliste, qui épuise les mêmes forces mentales, nécessite le même genre de concentration, serait plus difficile à concilier. Quand on est journaliste et qu’on écrit déjà toute la journée, je ne sais pas comment on fait pour se poser le soir et se dire « Là, je ne suis qu’écrivain »… Je ne pourrais pas.
Votre entourage semble avoir eu du mal à comprendre et à accepter votre décision de vous consacrer à la littérature. Vous en souffrez toujours ?
Un peu, oui. Surtout de la part de mes enfants qui ne me lisent pas. Ils disent qu’ils vont le faire, mais je sens bien qu’ils ne sont pas intéressés. Cela étant, j’en souffre moins qu’au début. Parce que je rencontre des jeunes qui lisent mes livres. Ça compense un peu. Mais au début, j’étais vraiment seul. Je vendais entre 3 000 et 5 000 exemplaires, ce qui n’est pas si mal, mais insuffisant pour avoir une activité paralittéraire intéressante. On participe à trois rencontres en librairie, ça s’arrête là… J’avais besoin du soutien de ma famille, je ne l’ai pas eu. Mais ça ne m’a pas empêché de continuer !
Vous avez toujours le sentiment de devoir vous justifier ?
C’est toujours le cas. À pied d’œuvre, au départ, c’était ça : laisser un témoignage, parce que j’étais accusé d’avoir choisi un métier de paresseux. Je voulais montrer, notamment à mes enfants, ce que c’était qu’écrire, pratiquer une profession artistique. Sans succès, en plus. Je voulais leur montrer que ce n’était pas une partie de plaisir, mais que quand on avait un but, il fallait tout donner pour l’atteindre. Ils ne l’ont pas lu… Cela dit, ils n’ont pas besoin de ma pédagogie à deux balles !
C’est une activité d’autant plus difficile à comprendre qu’il s’agit d’un travail invisible. Complètement. Quand vous entrez dans l’atelier d’un peintre, il y a des esquisses, des tableaux, des taches par terre, on sent le cerveau et les mains à l’œuvre. Un écrivain ? C’est le mec au bistro avec son calepin en train de noter des trucs, ou avec son ordi. Y a rien ! Je travaille dans ma cuisine, en plus. Sans témoins.
Vous partez toujours d’expériences personnelles, intimes, pour trouver vos sujets ?
C’est peut-être un défaut, mais c’est vrai que je pars toujours de mes expériences. Les liens sacrés du mariage , c’est mon divorce. Le prochain livre, je l’ai commencé juste avant que paraisse À pied d’œuvre . C’était au mois d’août, Gallimard avait prévu de sortir le livre pour la rentrée littéraire, en m’avertissant : la rentrée littéraire, c’est un ascenseur émotionnel, quand on n’a pas l’habitude. Parler aux médias, parler en public, rencontrer du monde, être critiqué, être sélectionné à un prix, échouer sur la
dernière marche… On me demande si je suis prêt, comment ça va dans ma vie. On me conseille même de voir un psy, pour être sûr ! J’ai accepté que le livre paraisse à ce moment-là, parce que je suis joueur, et puis parce que ça ne se refuse pas. Mais avant que le tourbillon m’emporte – ou pas ! parce que c’est encore plus violent quand il ne se passe rien –, je me suis dit que j’allais commencer un nouveau livre. Sauf que je n’avais pas d’idée. Je me suis un peu forcé à en trouver une. J’avais entendu une interview de Blanche Gardin et de Pierre Richard, et j’adore la manière dont les humoristes construisent leurs sketchs : on prend ses défauts et on les accentue, on les caricature. J’ai commencé comme ça. J’ai très vite atteint les limites de l’exercice. En revanche, comme j’avais commencé à accentuer un de mes défauts, ce défaut m’a fait évoluer vers autre chose et tout à coup le futur texte est arrivé.
En tant que photographe, vous ne vous intéressiez pas trop aux « grands sujets », à l’actualité brûlante, à la guerre, par exemple, mais davantage à l’intimité, aux détails, aux petits objets qui racontent une histoire, même chez les gens dont vous faisiez le portrait. Il semblerait que ce soit la même chose en littérature. En photographie, c’était mon défaut : je n’avais pas de domaine spécifique. Une de mes amies est spécialiste des femmes en Russie, et toute sa vie, elle travaille sur les femmes en Russie, c’est sans fin. Déjà à l’école on nous disait de traiter un sujet, la boxe, n’importe quoi. Moi, ça m’emmerdait. On retombait dans la commande, dans l’obligation. Ce qui m’intéressait, c’était la photo en tant que telle, en tant que poésie du quotidien. En littérature, c’est pour une autre raison : je ne me sens pas légitime. Je n’ai pas une grande culture. Je n’ai pas énormément lu. Je n’ai pas une concentration dingue non plus. Je ne suis pas capable de m’intéresser à un sujet pendant des mois. Dans À pied d’œuvre , pour parler de l’uberisation du travail, je ne me suis pas documenté. J’essaye d’atteindre une vérité, ce qui n’est déjà pas si mal.
Vous écrivez : « Si cette nouvelle vie sur l’autre rive sociale enrichit un peu mes sentiments politiques, je ne profite pas de ma situation ni d’une colère dont la légitimité serait incontestable, pour m’engager dans une révolte quelconque. » Sans parler de littérature engagée, À pied d’œuvre est tout de même un livre assez politique.
C’est un livre politique qui s’adresse à tout le monde. Dès sa parution, j’ai eu des retours de gens appartenant à la gauche. Ça, je m’y attendais : je dénonce des conditions de travail, une révolution néolibérale qui détruisent les individus. C’est ce que j’ai vu et vécu dans ma chair. La surprise, ça a été que le livre plaise à une certaine droite conservatrice, qui prône le patronat à l’ancienne, presque paternaliste. Parce que la forme de
38
capitalisme que je critique ne lui plaît pas non plus. Je me suis retrouvé avec un grand spectre de lecteurs enthousiastes. Ce n’était pas calculé : mon but, c’était de dénoncer ce qui m’énerve viscéralement, sans en faire un concept politique. Quand on est sincère, on arrive à toucher les gens.
Pourriez-vous, un peu à la manière de Florence Aubenas, vous plonger dans d’autres milieux socioprofessionnels pour en tirer un matériau littéraire ?
Il faut que j’aie une approche émotive avec le sujet. Je n’ai pas le réflexe journalistique. Florence Aubenas est capable de se motiver, de trouver la force de se plonger dans un milieu, d’aller au front. Admettons que l’on soit en guerre contre quelque chose. Elle, elle monte en première ligne. Moi, je me compare plus à la population bombardée, qui subit la guerre. Nos témoignages se recoupent, parce qu’on raconte des choses très similaires, mais ce n’est pas la même démarche. Je n’ai pas l’intention d’aller chercher des sujets. Je suis assez perméable. J’arrive à trouver des idées en vivant, en sortant, en parlant aux gens.
Votre livre va un peu à contrecourant des récits de transfuges de classe que l’on voit en ce moment, en racontant l’histoire d’un déclassement. Pourtant, le livre est assez drôle, il évite l’écueil du misérabilisme, de l’auto-apitoiement. C’est dans ma nature. Je déteste la fausse modestie. L’écueil, quand on se met à écrire, c’est de jouer à l’écrivain, d’exposer sa belle âme, les bons sentiments supposés éclairer le monde… J’espère que l’on ne retrouvera jamais mes carnets, parce qu’il m’arrive de relire des notes d’une prétention insupportable. Tout ce que je déteste, il m’arrive de le faire. Mais ça reste à l’état de notes. Au moment où j’écris, où je retravaille, tout ça disparaît. Tout est passé à l’eau de Javel.
Avez-vous l’impression d’avoir souffert de mépris de la part de gens chez qui vous posiez des étagères ? Est-ce qu’il s’agit de la même forme de mépris que celle venant des personnalités que vous preniez en photo ?
Tout dépend de la façon dont on perçoit les choses. Je connais plein de photographes qui ne ressentent aucun mépris de la part des stars. Pour eux, ça fait partie du jeu. Et j’ai rencontré des ouvriers qui n’avaient pas conscience d’un certain mépris de classe. Donc c’est vraiment une question de ressenti. Néanmoins, le mépris que j’ai pu ressentir en tant que photographe était plus dur à supporter. Parce que je savais que je faisais du bon travail ! J’étais envoyé par des journaux comme Télérama ou Libération. J’arrivais chez quelqu’un, et on me prenait pour la dernière des merdes. Ça, c’est insupportable. Parce que ce n’est pas que le rendez-vous qui est gâché. C’est toute une chaîne
sur laquelle on crache, du journaliste au graphiste qui font ces journaux. Alors que quand je rentrais chez quelqu’un et qu’on me traitait comme un domestique, je savais que ça ne durerait pas. Je l’avais accepté de toute façon. J’entrais dans le rôle. Et puis, j’étais réellement pauvre, je ne pouvais pas envoyer promener la personne. Pour deux euros de pourboire, j’étais prêt à accepter beaucoup de choses. Tandis qu’en photo, j’étais très exigeant. Comme en littérature. Je ne faisais pas n’importe quoi pour de l’argent. Ça me paraît dingue, quand j’y repense. Psychologiquement, c’est incroyable, la façon dont on entre dans un personnage. Quand j’ai commencé ces boulots manuels, je m’étais acheté des vêtements exprès pour ça. J’ai eu un plaisir physique à me plonger dans un domaine que je ne connaissais pas et à me débrouiller. Je regardais beaucoup de tutos sur Internet. J’étais devenu un excellent homme à tout faire !
Vous n’avez pas peur d’éprouver un jour la même lassitude pour la littérature que pour la photo ?
Ça ne viendra pas de la littérature elle-même, parce que j’adore ça. Le milieu pourrait me lasser. Mais avec la littérature, il y a beaucoup d’ouvertures possibles. Là, par exemple, À pied d’œuvre va être adapté au cinéma par Valérie Donzelli : il y a la joie du coup de fil, de se dire que ça existe vraiment… Avec la photo, il n’y avait plus que des portes qui se fermaient : plus le droit de photographier dans tel ou tel endroit, un attaché de presse derrière chaque people… En revanche, avec l’écriture, je suis presque sûr de ne jamais gagner beaucoup d’argent. Je ne peux pas être plus riche dans ce monde-là. Ou alors il faudrait faire des choses que je ne suis pas prêt à faire. Je me réserve le droit d’évoluer sur la question, bien entendu !
Dans La dernière photo, vous écrivez : « Je me servis de ma façon de travailler en photo pour composer de courts textes, les plus denses possible. Là où, en photographie, il était nécessaire d’attirer l’œil, de capter le regard entier du spectateur, en littérature, il importait de donner l’envie de tourner la page suivante. Le travail me semblant proche de celui de photographe, je ne me sentis pas entièrement perdu. » Vous procédez toujours de la même manière ?
J’ai évolué. Par rapport au début, où je tâtonnais, j’ai l’impression de maîtriser un peu mieux ma palette. Je visualise mieux ce que je dois faire, ce que je suis capable de faire. Techniquement, aussi, stylistiquement, je préfère ce que j’écris maintenant. Il y a ce « classicisme » de l’écriture que je redécouvre aujourd’hui, en lisant Emmanuel Bove ou Colette, par exemple. Et en même temps, j’ai cette fibre américaine, que l’on trouve chez Raymond Carver, l’efficacité, la simplicité, le côté page-turner. J’adore aussi René Goscinny, Le Petit Nicolas, cette espèce de candeur, très travaillée. Je mélange tout ça de plus en plus facilement. C’est comme ça que je définirais pour le moment ce que j’aime faire.
Ça ne vous gêne pas que l’on vous parle toujours de votre passé de photographe ?
Absolument pas. Sans la photo je ne serais pas devenu écrivain. J’ai un œil photographique dans l’écriture. Je ne renie pas ce passé, au contraire. C’est une très belle progression. J’encouragerais beaucoup de photographes à faire la même chose. Les photographes ont un sens de la narration, du cadrage, qui peut donner forme à une littérature extrêmement intéressante. Maintenant, je suis content d’être reconnu comme écrivain. J’étais moins bon photographe qu’écrivain. Quand j’étais photographe, je ne recevais pas autant de messages qu’aujourd’hui. Le jour où je serai blasé de ça, ce sera horrible.
— À PIED D’ŒUVRE, Franck Courtès, Éditions Gallimard
39

Les obstinés
Sons engagés, rock symphonique, pop noire, rap expérimental, rock cristallin, metal échevelé, rock’n’roll viscéral, underground nancéien — la nécessité de penser et d’inventer leur musique anime les artistes d’hier et d’aujourd’hui.

FAUT QU’ÇA GLITCHE
MUSICA S’OBSTINE, PERSISTE ET SIGNE AVEC UNE PROGRAMMATION
OUVERTEMENT POLITIQUE.
L’objectif : dessiner les contours du monde de demain quitte à foutre le feu à la musique à papa, avec l’aide des visions extra-terrestres de Karlheinz Stockhausen et Jennifer Walshe, militantes de Louis Andriessen, Ted Hearne et Moor Mother.
« On nous a appris à adorer Mozart ou Bach ! » Selon Stéphane Roth, le poids de cette éducation, cette vénération obligée, a pour conséquence un système de « classes et de valeurs esthétiques ». On mettra toujours l’opéra en haut et l’électronique plus bas sur l’échelle culturelle. « Il y a un véritable marché de la nostalgie en musique et mon envie est de contredire cette idée. » Le directeur de Musica prend un spectacle de l’édition précédente pour exemple : Place de Ted Hearne, donné au Maillon l’an passé. Cette pièce traite de la gentrification d’un quartier de Brooklyn. « Tout semble commencer de manière harmonieuse… puis ça glitche tout à coup comme pour signaler qu’il faut passer à autre chose. Ce sentimentalisme, c’est celui de ton père ! Ton émotion du présent, est-ce vraiment celle-ci ? »
Et de poursuivre : « Souvent, je me questionne : qu’est-ce qui fait converger une génération ? » Quel son est fédérateur aujourd’hui ? « Le larmoyant et l’héroïque, c’est fini. Faire l’expérience du monde dans lequel nous vivons, et moins celui de nos ancêtres. Voilà le sens de la création artistique. Montrer qu’il y a d’autres forces en jeu, d’autres sonorités pour “faire commun”. » En finir avec le patrimoine ? En rendant toutefois hommage à la grande figure néerlandaise du minimalisme, Louis Andriessen (1939-2021), « nettement moins connu que Philip Glass ou Steve Reich, ici, alors que géographiquement plus proche de nous ». Le compositeur, qui a notamment travaillé auprès de Peter Greenaway, est un artiste engagé : en 1971, en compagnie du saxophoniste Willem Breuker, il fonde De Volharding (« la persévérance », en VF) pour amener la création musicale dans les rues à grand renfort d’instruments à vent. Sortir les partitions exigeantes des conservatoires pour les mener sur les trottoirs, voilà une belle utopie. Cette Persévérance, interprétée à Musica par l’Ensemble Klang & Asko/Schönberg, à la fois répétitive et rythmique, invite à entrer dans la transe.
Musica 2024 s’ouvre le 20 septembre au Maillon avec une œuvre rare et résolument politique du même Andriessen : De Staat, une lecture critique de La République de Platon. Le compositeur néerlandais avait l’intime conviction que la musique a la faculté de « changer les lois de l’État ». Sous les pavés, une nouvelle page, celle de la
Par Emmanuel Dosda ~ Photos : Thaïs Breton
43

révolution instrumentale et sociale. S’enchaîne une série de projets bataves, les Pays-Bas étant mis à l’honneur lors de cette quarante-deuxième édition, ainsi que deux soirées cartes blanches au festival Rewire (La Haye), au Maillon ou en l’église Saint-Paul, avec une programmation orientée club : dubstep subversive (Kode9), ambient microtonale insurrectionnelle (Orphax) ou synthés libertaires (Thomas Ankersmit). Il y aura des fumigènes sur le dancefloor.
« Tu savais que Stockhausen avait appris la musique sur Sirius ? » me demande le plus sérieusement du monde Stéphane Roth. Ce bon
vieux Karlheinz (1928-2007), sorte de Sun Ra version Ircam, pensait vraiment, à la fin des années 1970, venir d’une autre planète, habitée exclusivement par des musiciens. Sirius est un space opera visionnaire en sept chapitres pour voix, instruments solos et dispositif électronique. Il s’agit d’un conte zodiacal, d’un spectacle intergalactique menant vers une constellation inconnue où la fusion des genres – musique contemporaine, sérialisme, afrofuturisme, pop, electro, opéra… – est de mise. Une vision cosmique, une ouverture vers la lumière divine, un horizon meilleur, humaniste et musical. « Stockhausen est allé très loin dans ses obsessions, jusqu’à systématiser les couleurs de ses vêtements
44


en fonction des jours de la semaine ! » Et Musica d’inviter le public à en faire de même, les 28 et 29 septembre, le samedi en bleu et le dimanche en blanc. Veuillez respecter le dress code.
Récital scientifique protocolaire (La Prédiction des oscillations), musique expérimentale participative ( The Great Learning ), virtuosité instrumentale performative (Frontière, point de rencontre) ou spoken word activiste (Moor Mother, avec Pelicanto - Chœur LGBTQ+ d’Alsace) : cette édition de Musica s’apprête à briser les tabous, les frontières et à couper les barbelés. Illustration de ce projet de destruction des barrières avec la création de la
pièce de théâtre musical documentaire Les Murs meurent aussi (François Sarhan). Pétons-les plutôt que de continuer à en ériger. Mort aux murs !
— MUSICA, festival du 20 septembre au 3 octobre à Strasbourg, au Maillon, l’église Saint-Paul, la HEAR, le MAMCS, la Cité de la musique et de la danse, le Palais des fêtes, le TNS et la Pokop ; et du 4 au 6 octobre à Metz, à l’Arsenal, le Centre Pompidou-Metz et La Douche Froide festivalmusica.fr
45

LAST TRAIN À FOND LES VIOLONS
Par Philippe Schweyer
46
Last Train et l’Orchestre symphonique de Mulhouse à Motoco © Rémi Gettliffe
DÉLAISSANT
LA FORMULE
GUITARE-BASSE-BATTERIE QUI A FAIT SON
SUCCÈS, LE GROUPE DE ROCK LAST TRAIN SORT UN ALBUM CONCEPT
AVEC L’EXCELLENT ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MULHOUSE. UNE
RELECTURE DE SON RÉPERTOIRE QUI S’ÉCOUTE COMME LA BANDE-SON
D’UN FILM À IMAGINER. RENCONTRE AVEC LE CHANTEUR, AUTEUR ET COMPOSITEUR DU GROUPE, JEAN-NOËL SCHERRER.
D’où vient l’envie d’enregistrer votre nouvel album Original Motion Picture Soundtrack avec l’Orchestre symphonique de Mulhouse qui vous avait déjà accompagné sur trois titres de The Big Picture en 2019 ?
Nous sommes tous les quatre fans de musique instrumentale, de musique assez imagée, de musique de film, de post-rock, d’ambient. Si tu incorpores tous ces éléments à notre musique, tu peux vite te retrouver dans des endroits pas très sexy, quelque part entre le rock progressif et le rock symphonique. Enregistrer avec l’orchestre était une manière de s’affranchir de la formule guitare-bassebatterie et de se lancer un nouveau défi, quitte à se retrouver à la marge de l’esthétique à laquelle on a habitué notre public.
Quels ont été vos rapports avec les musiciens de l’Orchestre symphonique de Mulhouse ?
On se connaissait déjà un petit peu. Ils savaient où ils mettaient les pieds et notre objectif était que ce soit intéressant pour eux aussi. Certains musiciens étaient très curieux, avaient envie de travailler avec nous, étaient contents de changer leurs habitudes, de sortir du répertoire. Quand on s’est retrouvés à Motoco pour faire la captation vidéo quelques mois après la semaine d’enregistrement, on a senti qu’on avait gagné leur confiance. La session d’enregistrement s’était bien passée, ils avaient compris que ce disque n’était pas qu’un délire fait d’emprunts aux codes du cinéma. Du coup, les musiciens se sont vraiment pris au jeu de la captation et on a passé un très bon moment.
Comment s’est passé le travail avec l’orchestrateur Fabien Cali ?
On lui a donné une base qui était à 80 % déjà écrite. J’avais programmé tout le registre de l’orchestre avec mon ordinateur : les violons,
les cors, les timbales, le tuba… Mais entre la programmation sur mon ordinateur et le moment où l’orchestre se met à jouer, une traduction était nécessaire et c’est là qu’est intervenu Fabien. On a exporté toutes mes programmations et Fabien a fait des relevés avant d’écrire chaque partie pour que l’orchestre puisse les jouer. Fabien est aussi compositeur et comme tous les compositeurs, il expérimente, il teste. De notre côté, on avait travaillé pendant un an et on avait une vision très précise de ce qu’on souhaitait. Quand il changeait des choses, c’était souvent excellent… mais parfois, ça allait un peu à l’encontre de ce qu’on avait envie de dire. Heureusement, le dialogue avec Fabien était toujours agréable.
Il ne vous a pas embarqués dans des directions non souhaitées ?
Malgré son bagage plus classique, on a du vocabulaire et des références communes. Il vient plutôt du rock et des musiques actuelles. Ça aide beaucoup et on s’est super bien entendus. C’est surprenant de confier notre musique à quelqu’un, mais le résultat est proche de ce qu’on avait écrit.
Écoutez-vous tous les quatre les mêmes musiques ?
On écoute des musiques très différentes, mais on a beaucoup de goûts en commun. Antoine (le batteur) est un gros digger [les diggers fouillent inlassablement les bacs des magasins de disques, des brocantes et des soldeurs, à la recherche de la pépite rare et précieuse], c’est celui qui écoute le plus de musique. Tim (le bassiste) est celui qui a les goûts les plus populaires. Chacun de nous écoutait déjà un peu de classique, très présent dans la musique de film, avant de collaborer avec l’orchestre.
47
Arrives-tu à mettre des mots sur les émotions que tu cherches à transmettre ?
Je ne vais pas mettre de mots, surtout sur ce disque, mais on adorerait que les gens se fassent leur propre film en écoutant notre BO ! Les penchants mélancoliques ou épiques font partie de notre écriture depuis toujours. Par contre, pour ce disque, on a mis les grosses guitares et la batterie au placard et on a sorti les violons.
Quand on regarde le documentaire réalisé par Julien (le guitariste), l’enregistrement semble avoir été douloureux. Quelle est la part de plaisir et celle de souffrance ?
98 % de souffrance, 2 % de plaisir ! [Rires]
Avez-vous envie de continuer à collaborer avec l’Orchestre symphonique de Mulhouse ?
J’espère qu’un jour on pourra jouer Original Motion Picture Soundtrack sur scène. Ce n’est pas à l’ordre du jour, mais si on arrive à dégager du temps pour proposer un concert à la hauteur de nos ambitions, je pense que l’orchestre en aura envie autant que nous. Ce qui est sûr, c’est qu’on ne veut pas faire du Last Train et que derrière il y ait l’orchestre. Monter ensemble sur scène pour présenter ce qu’on a fait sur cet album-là, avec éventuellement quelques extras, nécessiterait de l’écriture. Écrire pour un disque et écrire pour du live, ce n’est pas la même chose.
Le prochain album de Last Train est-il déjà dans les tuyaux ?
L’album est prêt, mais on n’a pas encore fixé de date de sortie. On s’est vite retrouvés avec les gars pour écrire de nouvelles chansons sans violons, sans tuba…
Que reste-t-il de cette expérience avec l’Orchestre symphonique de Mulhouse ?
On ne peut pas dire que l’on repart comme avant, ça a été un an et demi de travail quotidien. J’ai dû apprendre à utiliser des instruments que je ne connaissais pas, à programmer, à lire la musique, à écrire la musique, j’ai découvert l’effectif d’un orchestre… La collaboration avec Fabien a été très enrichissante parce que j’ai appris le métier d’orchestrateur et aussi de producteur artistique. C’est vraiment un disque que l’on a coréalisé, Rémi Gettliffe (grand manitou du studio White Bat Recorders) et moi. Je n’avais jamais fait ça et j’en sors grandi. C’est évident que ça a énormément influencé le prochain album de Last Train, mais esthétiquement, par contre, ce nouveau disque sera plutôt une réaction à cette expérience qu’une suite logique. On a envie de trancher dans le vif !
Sais-tu pourquoi tu fais de la musique, pourquoi tu composes ?
Je dirais que j’en ai besoin, même si je n’aime pas me forcer à écrire. Je crois que c’est surtout pour me fixer de nouveaux défis, pour me tirer vers le haut.
Rémi Gettliffe est très présent dans le documentaire, est-il le cinquième membre de Last Train ?
Depuis les premiers EP, il a une place très importante. Malheureusement pendant nos tournées, qui sont souvent longues, on ne le voit plus. Là ça m’a fait beaucoup de bien de passer plus d’une année en studio avec lui pour vraiment bosser, aller au fond d’un truc tous les deux. On voit dans le docu que c’était dur, vraiment pas évident, mais heureusement on se connaît par cœur puisque ça fait maintenant une douzaine d’années qu’on travaille ensemble. On a vraiment de la chance d’avoir un Rémi en Alsace, avec cette vision et cette sensibilité !
Qu’est-ce qui vous a décidés à faire presque tout vous-mêmes, quasiment depuis vos débuts ?
Il y a dix ans, un groupe autoproduit était mal considéré. Aujourd’hui, c’est le nec plus ultra. Être un artiste indé est devenu un argument de vente. On a appris en commençant à travailler avec différents partenaires pour la production phono, la production de tournées, les éditions, mais à chaque fois on se disait qu’on était capables d’aller plus loin. L’indépendance pour nous, c’est se donner les moyens de casser ce plafond de verre.
Tout le temps que tu passes à organiser des tournées, tu ne le passes pas à composer… Cela pourrait être problématique pour plein d’artistes, mais pas pour moi. Je ne suis pas méga prolifique. Je n’aime pas écrire quand je n’ai rien à dire. Je n’aime pas me forcer à écrire. Quand ça sort, c’est viscéral. Le reste du temps, je suis derrière mon ordi et je fais des budgets [rires]. Je trouve une poésie là-dedans. Je sais ce que ça représente de développer une histoire pour un groupe de rock. Je sais tout le travail que ça demande chaque jour, toute l’année en non-stop. La musique n’est qu’une toute petite partie de notre travail, mais je ne trouve pas ça triste.
La plupart des groupes splittent au bout de quelques années. Vous êtes toujours ensemble alors que vous vous connaissez depuis dix-sept ans.
Ce qui a changé, c’est qu’on a grandi. Les petites tensions ne servent pas à grand-chose et on a de plus en plus de respect les uns pour les autres,
48
pour le travail que chacun fournit, qui concerne la musique, mais aussi la stratégie, la production, la partie audiovisuelle. On arrive à mettre les tensions de côté pour se recentrer sur l’essentiel. On a appris à ce que ce soit notre métier et plus juste une histoire de fun où on va faire des tournées pour se déglinguer la tête dans des bars. On a des concerts à assurer et on a envie qu’ils soient au top. On a installé une certaine rigueur entre nous.
C’est votre côté alsacien, cette rigueur, cet amour du travail ?
C’est sûr ! Marie, notre attachée de presse, saura te dire que les récaps mail et les objectifs à atteindre font partie du quotidien de Last Train.
Olivier Dieterlen, le directeur du Noumatrouff, me racontait comment vous bossiez comme des dingues pour trouver des dates à vos débuts. Il y a une partie de moi qui me dit de vivre la vie de musicien, de profiter. On aurait la possibilité d’avoir des producteurs, des tourneurs, des manageurs, mais on aime garder la maîtrise. On arrive bien mieux à proposer ce qu’on a envie de proposer en faisant beaucoup de choses nous-mêmes. J’ai fait la paix avec ça depuis longtemps. Je suis hyper heureux comme ça. Je ne cherche pas un autre mode de fonctionnement. Jean-Luc Gattoni qui bossait à la Laiterie m’a dit un jour une phrase qui est restée gravée dans ma mémoire : « Un groupe, c’est comme une boîte, comme une entreprise. » Ce n’est pas très sexy, mais il m’avait dit que comme une entreprise, un groupe a son image, sa marque… J’avais seize ans à l’époque et quand j’y repense, c’est exactement ce qu’on a fait. On en est arrivés là après avoir mis beaucoup d’espoir dans le travail de certaines structures. Mais à de rares exceptions près, comme Marie notre attachée de presse, on s’est rendu compte que personne ne croira jamais davantage en notre projet que nous.
Êtes-vous encore sollicités ?
On est très sollicités et c’est nous qui sollicitons aussi. Ce n’est pas parce qu’on est indépendants que l’on n’a pas le droit de travailler avec des gens. Au contraire, on est représentés par des agents, on a des distributeurs, une attachée de presse, tout un entourage. L’indépendance, ce n’est pas que se faire chier à envoyer ses vinyles tout seul ; c’est la question de savoir qui finance quoi. Il est là le nœud. Les artistes ne sont pas indépendants quand ils n’ont pas de droit de regard sur leurs finances. Taylor Swift est bien plus indépendante que la plupart des artistes sur terre. Elle sait où va son argent et c’est elle qui investit alors qu’elle a des milliers de partenaires. Ce n’est pas un modèle fait

pour tout le monde. Beaucoup d’artistes n’ont pas la sensibilité pour ça. Nous, on y trouve du plaisir, mais on a beaucoup de copains qui n’ont pas envie de se charger de ça.
Quel est votre rapport à Mulhouse ?
Mulhouse, c’est d’abord le Noumatrouff qui a cru en nous dès le début et nous a toujours soutenus. Le Noumatrouff est un peu notre quartier général. On y a domicilié les sièges de nos sociétés, on y a tourné nos clips…
Avez-vous toujours la même excitation à jouer sur scène ?
Après deux ans sans tourner, on est impatients de remonter sur scène, peut-être avant la fin de l’année. On a toujours dit que notre objectif était de remplir des salles de 1 500 places en Europe. En France ça va, mais dès qu’on franchit les frontières, il y a tout à faire. On va vraiment se concentrer là-dessus pour la suite. Il faut travailler avec la promo, la distribution, le marketing… On y allait uniquement par le live jusqu’à présent. C’était la limite du travail avec des partenaires qui s’en foutaient d’investir en Allemagne ou aux Pays-Bas pour gagner que dalle. Alors que nous savons que notre avenir passe par un développement à l’international. On est un groupe de rock, donc on ne va pas pouvoir grossir indéfiniment en France. On ne fait pas la même musique que Shaka Ponk !
Quels sont les groupes de rock valables en France à part Last Train actuellement ?
Lysistrata, The Psychotic Monks, Johnnie Carwash… Des groupes relativement confidentiels, même s’ils sont très bons. Les Hook font-ils encore quelque chose ?
Ils rejouent samedi soir.
Ils se reforment ? Ah la vache ! Excellent ! Ils sont plus rock’n’roll que nous… pas le genre à appliquer nos méthodes de travail.
— ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK, Last Train, Last Train Productions, 2024
49
Julien, Jean-Noël, Tim, Antoine et Rémi Gettliffe le sorcier du studio White Bat Recorders niché au fin fond du Sundgau.
CHERCHER LE GARÇON
 Par Emmanuel Dosda ~ Photo : Christophe Urbain
Par Emmanuel Dosda ~ Photo : Christophe Urbain

PAS MOINS DARC. AVANT L’INTERVIEW, À QUELQUES HEURES DE SON CONCERT À LA LAITERIE,
CET OISEAU DE NUIT DÉPLACE
NOTRE TABLE AU SOLEIL. ENTRETIEN AVEC UN EX-VAMPIRE.
Que veulent « Les garçons » ? Se donner des airs de durs à cuire pour cacher leurs failles ?
Avec ce morceau, je parle de ma génération, d’une typologie de mecs qui masquent leur fragilité sous un masque, derrière une épaisse carapace. Je porte un regard poétique, sans jugement, mais heureusement que le modèle masculin change, qu’il y a aujourd’hui plusieurs manières d’être un homme. Hélas, nombreux sont ceux qui persistent à rouler des mécaniques… Valoriser la loi du plus fort est un aveu de faiblesse.
« Quand je suis là, je ne suis pas là. » Ces paroles semblent vous résumer…
« Tu es toujours absent ! » Ma mère n’arrêtait pas de me faire ce reproche. Tout comme ma meuf et mon fils. Je ne sais jamais comment me situer, sauf sur scène. Là, je sais quelle place j’occupe. En dehors, j’ai peur de ne pas être compris. Ça m’arrive et c’est assez violent ! L’écriture permet de m’approcher des gens tout en les tenant à l’écart. Je suis un peu nostalgique de la période où les artistes pouvaient être des énigmes. Les réseaux sociaux ont évacué toute part de mystère. À l’instant, dans le hall de La Laiterie, j’ai vu une affiche de Descendents, que j’avais complètement oublié. En deux clics, j’ai eu toutes les infos imaginables sur ce vieux groupe punk que j’écoutais il y longtemps. Je préfère les mauvaises questions aux bonnes réponses. J’aime les équations, mais pas leur résolution.
Vous vivez la musique comme une religion ?
Disons que j’ai la foi. La musique est une forme de spiritualité : je garde le cap et j’essaye d’avancer.
Dans le clip réalisé par Ovidie, vous chantez « Exotica » durant des auditions façon Nouvelle Star. Vous sentez-vous érotisé par sa caméra, comme dans un deep-show ?
Oui, surtout avec mes fringues en cuir, le jeu de lumière, les fumigènes, face à un jury de femmes blasées. Ce clip va dans la continuité de la série d’Ovidie, Des gens bien ordinaires, uchronie où les rapports hommes-femmes sont inversés. Dans le clip, je n’ai pas le bon rôle, je me sens en danger… comme parfois dans la vraie vie.
Il y a trois duos sur votre nouveau disque : une manière de tenter un dialogue ?
C’est une manière de voir les choses, mais je n’y avais pas pensé. Tous les morceaux sont des monologues au départ. Sur « La Plupart du Temps » [avec Izïa], je parle d’une rupture : le couple se sépare et pourtant lui et elle s’aiment, ressentent du désir, du manque, des pensées… Les deux ont exactement la même lecture, j’aurais donc très bien pu chanter seul ce texte, car il et elle disent la même chose. En songeant à « La Femme Papillon », par exemple, j’ai vu le visage, si particulier, d’Halo Maud que j’ai invitée à interpréter la chanson avec moi. Izïa et Laura Cahen se sont également imposées naturellement.
Quels images ou sons aviez-vous en tête au moment d’écrire Rêve parti ?
Pasolini, Matthew McConaughey dans Dazed and Confused , Les enfants après eux de Nicolas Mathieu, Siouxsie and the Banshees, Le Théorème de Marguerite, film qui parvient à être passionnant alors qu’il traite de mathématiques… En réalité, lorsque je compose, je vois surtout des formes qui s’emboîtent et des couleurs qui se répondent.
Pourquoi Rêve parti est-il au singulier ?
Il s’agit d’un rêve en particulier, un rêve d’ado qui s’est évaporé : mon fidèle compagnon s’est détourné de son adolescence et m’a laissé seul à la barre. Finalement, je me dis qu’avant je naviguais à vue, comme un somnambule, mais qu’aujourd’hui je sais enfin où je vais. Ce qui m’intéresse, c’est la poésie ! Le plus important, ça n’est pas les notes que tu joues, mais celles que tu ne joues pas.
— RÊVE PARTI, Lescop, Labréa Music
UN PEU AVEC RÊVE PARTI, TROISIÈME ALBUM
LE
FAIT MOINS DARK,
LA POP NOIRE DE LESCOP S’ILLUMINE
OÙ
CHANTEUR SE
MAIS
51
ROBERT ET LES HARICOTS MAGIQUES
Par Guillaume Malvoisin ~ Photo : Vincent Arbelet
BEANS A EU UNE VIE AVANT ANTIPOP
Tu sais que « Bean », c’est aussi le surnom de Coleman Hawkins ?
Oui, mais je n’ai jamais su vraiment pourquoi.
C’est à cause de sa position courbée quand il jouait du sax. Il ressemblait à un haricot. J’évoque le jazz parce que c’est un de mes tout premiers contacts avec ta musique.
Le truc avec Matthew Shipp ?
Exactement. D’abord avec Knives From Heaven, en 2011, puis Antipop Consortium vs Matthew Shipp, sorti en 2003. Knives est vraiment meilleur. Le moment était un peu mal choisi en 2003. Quand nous avons commencé, nous étions à l’unisson, mais nous nous sommes séparés au milieu de la production du disque. J’ai donc dû finir certains morceaux seul. Les gens ont été plutôt réceptifs à ce disque. Mais pour être honnête avec toi, je ne pense pas qu’il soit vraiment réussi.
Sur Knives, il y a ce track, « This Is For My brother the Wind ». Oui. Le titre en réf’ à Sun Ra ? Regarde ! [Il me montre une énorme chevalière, posée à l’auriculaire de sa main droite. La tête de Sun Ra.]
Matthew Shipp m’avait expliqué dans ce magazine que Priest et toi, vous étiez de grands fans de jazz.
Peut-être qu’il y a un sample de Sun Ra dans ce track, je ne me souviens pas. C’est vraiment Priest qui a terminé cette prod.
Sun Ra était un free jazzman, mais il a aussi enregistré ses poèmes. Quel est ton lien à la poésie ?
Une fille qui m’a emmené en 99 au Nuyorican Poets Café. Ça m’a ouvert les yeux parce qu’il fallait que tes mots soient très forts sans la béquille du rythme. Honnêtement, ça a fait de moi un meilleur auteur d’expérimenter grâce à la scène poétique. J’ai pu développer mon style, j’ai
commencé à modeler, à moduler mes textes. C’est ce qui m’a donné la latitude et l’aisance nécessaires pour essayer de dire des choses intéressantes.
Quelle est ta technique d’écriture ?
J’aime bien écrire quand tout le monde dort. Je suis plus conscient de ce que j’essaie de dire, et j’ai d’horribles habitudes de sommeil. Les maisons sont si calmes, la nuit. En général, j’arrive avec un petit truc du genre [il chantonne] et j’essaie d’écrire en fonction de ça. Je l’enregistre et j’essaie de développer le rythme de ce que j’ai trouvé. Mais c’est très récent, ça…
Justement. Nous sommes à près de 25 ans de ton premier concert…
C’est tellement fou de continuer à faire ça après tout ce temps.
Et est-ce que tu penses avoir validé aujourd’hui quelque chose à propos de ton langage ou ton style ?
Est-ce que je me sens validé ? Oh, ça, c’est une sacrée question.
Merci. Tu as expérimenté beaucoup de choses.
C’est là tout le problème, et c’est là tout l’intérêt. L’essentiel, c’est de faire ce qu’on a à faire. Et, tu sais, continuer d’essayer différentes choses.
Qu’est-ce qu’il te reste à découvrir ?
Oh, j’ai un tas d’idées et je travaille dessus, mais rien n’est encore terminé. C’est juste une indication d’une direction à prendre.
Quel était ton désir avant la période Antipop ?
Le seul truc à retenir, c’est que le hip-hop est né d’un branchement sur un réverbère. C’est une forme d’art expérimentale basée sur le fait de faire beaucoup avec très peu de moyens. C’est, en gros, l’esprit du truc. Mes années d’adolescence ont été l’âge d’or 88. À l’époque, il y avait une grande diversité dans ce qu’on appelait le hip-hop.
CONSORTIUM. CELLE QUI CONTINUE AUJOURD’HUI, ENTRE EXPÉRIMENTATIONS ET ACCOMPLISSEMENT.
52

Tout était hip-hop. Je me souviens de la réaction du South Bronx quand BDP est apparu pour la première fois, à l’écoute de Rebel Without a Pause, et de la première fois que j’ai entendu Big Daddy Kane, Eric B for President. Je travaillais quelque part comme concierge pendant l’été. C’est ainsi que j’ai découvert une grande partie de ma musique, en voyant que tout et n’importe quoi était hip-hop.
C’était une nouvelle forme véritable alors que tout le monde disait que le hip-hop était juste une mode. On m’a répondu qu’il ne fallait pas trop me prendre au sérieux quand j’ai annoncé que je voulais devenir rappeur, parce que le breakdance et le hip-hop n’étaient qu’une mode, qu’il n’y avait rien à faire. Je me souviens de l’époque où les seuls rappeurs que les Blancs aimaient étaient les Beastie Boys. Tu sais, les Blancs détestaient la musique rap et ne s’y sont pas vraiment intéressés pendant les années 90.
C’était l’époque des Shiny Suits. J’ai éteint la radio et j’ai découvert la musique classique noire, le jazz.
Herbie Hancock ?
La seule chose que je connaissais de lui, alors, c’était « Rockit », je ne savais pas encore que les gens samplaient les Headhunters.
C’était l’héritage à la création d’Antipop ?
Quand on a commencé, tu sais, on voulait faire quelque chose qui soit dans la continuité de ce qui existait, comme revenir à l’ère électro des boîtes à rythmes et des synthétiseurs. On voulait créer notre musique et notre propre son. Nous jouions beaucoup pour des galeries d’art, Priest, Mani, et un saxophoniste, Micah Goth. En gros, on a appris quoi faire pour l’importer dans des contextes hiphop. Nous avons toujours pensé à ce qu’était la musique. Nous venions d’un milieu de poésie, nous étions exposés au jazz, nous en prenions l’esprit et l’incorporions à ce que nous avions compris du hiphop. Et c’était expérimental. Essayer de nouvelles choses, essayer des sons différents.
— ZWAARD, Beans, produit et mixé par Vladislav Delay (Warp Publishing)
53
MIKI BERENYI TRIO ÉTERNELLEMENT VÔTRE
Par Mathieu Jeannette ~ Photo : Vincent Arbelet

Deux heures et demie de trajet de Colmar à Dijon à ressentir cette crainte d’ado. Tomber au mauvais moment, sur des Anglais anxieux qui n’ont guère de temps à accorder, ou être reçu par des émules d’Anton Newcombe. J’ai une demi-heure d’avance sur le rencard avec Vincent Arbelet, le photographe de Novo. Garé à deux cents mètres du Consortium, mes jambes molles me conduisent bizarrement vers l’allée centrale du centre d’art contemporain. Une structure blanche vitrée futuriste qui en impose. Je l’ai immédiatement reconnu à ses flux de guitares cristallines en reverb qui émanaient du sous-sol pour ruisseler le long de la façade. Trente et un ans après LE concert de Moose à la Salamandre, devant la porte d’entrée fermée, tout est remonté… Une jeunesse idéalisée, des heures à flotter au-dessus de mon canapé. Demi-tour. Je me suis accordé un quart d’heure et deux ballons de rouge pour aborder moins fébrile cette rencontre inoubliable. Cette soirée est un défi.
J’y retourne, et les événements s’enchainent très vite. Sébastien (Faits Divers) m’aperçoit après avoir filmé Vertigo le premier clip de cette nouvelle formation entourée des kimonos en collages de l’artiste italienne Isabella Ducrot. Il m’ouvre la porte tout sourire : « Salut, c’est toi Mathieu ? Viens, ils viennent de finir les balances, je pense qu’ils ont le temps ». Pendant qu’il transbahute ses caméras et câblages, nous traversons la grande cour déserte pour prendre un ascenseur à diodes rouges. Tout s’accélère au rythme de mon cœur. Arrivés au soussol, au milieu d’une salle de concert sombre aussi longue qu’une coursive d’aéroport, il m’ouvre les loges derrière la scène à tenture rouge. Juste derrière, Moose (Kevin McKillop) souriant en casquette, lunettes et blouson bleu. Bonjour, je m’appelle Mathieu. Chaleureux et curieux, il me demande : « Mathieu, est-ce que je peux te racheter ton t-shirt ? » Euh faut voir, j’y tiens… « Viens, assieds-toi, tu bois une bière ? » Voilà, c’est lui, compositeur pop brillant aux mélodies d’une classe inouïe, aux arrangements foisonnants et exotiques. Le digne héritier d’Arthur Lee et frère de cordes et de cuivres des Pale Fountains. Le signataire de quatre chefs-d’œuvres aussi intemporels que confidentiels en Angleterre. Moose, son surnom et mon groupe culte de toujours.
APRÈS VINGT ANS DE SILENCE RADIO ET UNE PREMIÈRE FORMATION, PIROSHKA, ACCOMPAGNÉS D’OLIVER CHERER (AIRCOOLED), MIKI BERENYI (LUSH) ET SON ÉPOUX KEVIN MCKILLOP (MOOSE) SE PRODUISENT À DIJON CE SOIR. MIKI BERENYI TRIO, COMMENT RÉINVENTER LES HORDES DE GUITARES SATURÉES, LES HARMONIES CRISTALLINES ET LES VOIX DE TÊTE FÉMININES DES NINETIES. 54
Je me sens tout de suite mieux, Miki Berenyi, brune au carré et robe rouge vient me saluer. Accompagnés d’Oliver Cherer, bassiste hilare coiffé aux couleurs de son magasin de disques de Bexhill, on s’assoit pour un apéro rigolo qui fera office d’interview. « Miki Berenyi Trio est né des rencontres littéraires pour la sortie de ma biographie Fingers Crossed , commence Miki. On voulait faire des petits concerts après les dédicaces pour jouer des morceaux de Lush et de Piroshka. »
Lush s’est formé à la fin des années 80 et a occupé le devant de la scène dream pop, shoegaze jusqu’en 96 en ayant marié des voix féminines éthérées aux nappes de guitares vaporeuses, comme le voulait l’époque. L’ouverture et la clôture de soirée nous ont d’ailleurs offert tout le cortège noisy pop de rigueur ; Pale Saints, Ride, My Bloody Valentine… « Comme Mick Conroy vit maintenant aux ÉtatsUnis et tourne aussi avec Modern English, ça devenait une logistique très compliquée pour tourner en Europe ; et puis l’avantage d’être en trio, c’est que ça coûte moins cher, je ne sais pas si Chan Masson avec l’association Sabotage auraient pu nous programmer ce soir. On a choisi Miki Berenyi Trio pour nous identifier plus facilement. Sous Piroshka, certains n’avaient pas réalisé qui jouait dans le groupe », ajoute Miki. Ce couple historique de la scène londonienne (28 ans de vie commune) a attendu plus de vingt ans pour enfin jouer ensemble, épaulés par leur ami bassiste et très cool, Oliver Cherer. « On compose à trois en répet’ ou on s’appelle pour échanger des idées, chacun apporte sa pierre à l’édifice, sans schéma établi », précisent Moose et Oliver. Après Barcelone, ils ont foulé la scène de l’Aéronef de Lille, celle des Vinzelles en Auvergne pour finir à Dijon. « C’est une ville à laquelle je n’ai pas fait vraiment honneur, je suis allergique à la moutarde, je deviens tout rouge puis je gonfle », déclare Moose en se marrant. Autre allergie, celle de l’avion et des aéroports, soixante pour cent de malaise et quarante de peur… Qui priveront Kevin McKillop de la tournée américaine de juin. « The worst thing on earth, no more damage to the planet. »
Comme ils ont bien compris que j’étais un peu une quiche en anglais, Moose, qui gagne sa vie comme prof d’anglais depuis vingt-cinq ans, fait tout pour me soulager et manie aussi bien le français que la gentillesse. Il me dédicacera quelques-unes de ses raretés (qu’il ne possède même pas) en français. Un trio très sympathique. Les blagues et les rires s’enchainent, j’ai presque l’impression d’un verre entre amis. Miki et Oliver finissent l’entretien en le ponctuant de réjouissance. Ils espèrent enregistrer un album pour le printemps prochain chez Bella Union (label de Simon Raymonde, ex-Cocteau Twins et vieille connaissance du groupe) qui avait déjà sorti les deux précédents albums de Piroshka.
Morceaux de Piroshka et Lush qui se succèderont en alternance sur scène ce soir : « V.O », « Everlasting Yours », pour les premiers et « Kiss Chase », « Covert », « Light From a Dead Star »… comme bréviaires pour les fans de Miki venus en nombre. Ils n’auront pas été trop dépaysés par les nouveaux morceaux de Miki Berenyi Trio. Plusieurs générations ont été transportées par ces sons de guitares millésimés et saturés, ces harmonies fines et cette voix de tête incisive qui scande au cordeau ses refrains enfantins. Stances courtes d’émotions contenues vers les aigus. Les textes sont généralement moins légers que les envolées de voix faussement insouciantes de cette brune (ou rouge) qui chantait la douce amertume de la jeunesse en quête de sa place dans le monde. Si Lush était plus bruyant, l’absence de batteur lisse quelque peu les différences mais fait tout de même entrevoir une plus grande prise de risque dans les récentes compositions de Piroshka ou de Miki Berenyi Trio. Ce qui était perceptible sur album l’est moins sur scène, mais la variété des arrangements (forcément), les ruptures de rythmes fréquentes et des tonalités variées démontrent bien l’esprit de collaboration qui opère dans leur processus de composition. Un certain contraste avec les autoroutes d’accords redoutables de Lush, quand les Black succédaient aux Peel Sessions. La basse d’Oliver a apporté une vraie fraîcheur à ce set sous l’intime jeu de lumière bleu et rouge. À l’écoute de « Light From a Dead Star », sentiment éprouvé à chaque écoute de leurs groupes pendant vingt ans, j’ai réalisé la chance et le soulagement de les voir réunis ce soir. Puis vint « Everlasting Yours », parfait condensé de Lush et de Moose avec son intro fulgurante à la John Barry signée McKillop et suite logique de « The Only Man in Town ».
Le moment pour eux d’accorder leur Fender Mustang et Stratocaster douze cordes m’offre le temps d’aller commander une menthe à l’eau en prévision du trajet retour quand j’entends tout devant : « Maintenant une reprise de Moose, Suzanne, pour Mathieu… Où est-il ? » Je gesticule bêtement du bar couleur menthe à l’eau… J’ai eu l’opportunité de les remercier lors d’un dernier verre dans les loges avant qu’ils ne remballent leurs instruments. J’ai pris les adresses mail des adorables Dijonnais, serré des mains, claqué des bises dans tous les coins, ponctuées de See you soon in France, la gorge un peu serrée. Grâce à ces émissaires pop d’un âge d’or vaporeux et lumineux, j’ai pu tester la lévitation de Dijon à Colmar, la nostalgie faisant place à la réjouissance.
Everlasting yours.
55
COMME UN ROCK
Par Aurélie Vautrin
SI POUR CERTAINS, « FÊTE DE VILLAGE » RIME AVEC ACCORDÉON ET BAL
MUSETTE, À LANDRESSE, LES FAITS SONT LÉGÈREMENT DIFFÉRENTS :
CHAQUE ANNÉE À LA MI-JUILLET, CE PETIT BOURG DU DOUBS SE
MÉTAMORPHOSE EN VÉRITABLE TEMPLE DU HARD ROCK GRÂCE À LA
GUERRE DU SON ; UN HAUT RENDEZ-VOUS POUR LES METALHEADS
CHEVELUS ET AUTRES AMATEURS DE MUSIQUE (FIN) ÉNERVÉE, ACCUEILLIS À BRAS OUVERTS PAR LES HABITANTS DU HAMEAU DEPUIS PLUS DE VINGT ANS. LE CO-PROGRAMMATEUR PHILIPPE BERTEAUX NOUS EN DIT PLUS SUR CE FESTIVAL HAUT EN COULEUR.

56
La Guerre du Son © PIM (Metal in Franche-Comté).
En deux mots, ce serait quoi la philosophie de La Guerre du son ?
Du plaisir, de la bière, et du rock. Voilà, tout est dit ! [Rires] C’est un peu un cliché, mais c’est la vérité. On est au milieu de la campagne, dans un petit village où tout le monde se mobilise pour organiser une grande fête. Il y a un côté bon enfant, très familial, avec de la bonne bière locale, des produits artisanaux, des prix accessibles… L’idée, c’est vraiment de se rassembler pour partager quelque chose tous ensemble. D’ailleurs à la base, le festival était organisé par le comité des fêtes ! C’est l’aventure d’un village, les habitants en sont très fiers, même s’ils n’écoutent pas du tout ce genre de musique. En revanche, bien sûr, pour les festivaliers, il y a le côté rock’n’roll – mais attention du rock bien énervé, à découvrir sur deux scènes, la « Warzone » pour les têtes d’affiche, et le « P’tit Gibus » pour les groupes régionaux.
… Le « P’tit Gibus » ?
[Rires] En référence à La Guerre des boutons de Louis Pergaud. Il était instituteur dans le village à l’époque, et l’histoire des Lebrac se passe ici, à Landresse ! On a voulu garder ce côté-là aussi.
Comment pense-t-on la programmation d’un événement comme celui-ci ?
Avec la co-programmatrice, Hélène Schmitt, on a vite été d’accord. Elle connaît très bien le milieu – c’est la chanteuse des Fallen Lillies, un groupe de heavy rock qui tourne au Hellfest cette année. On voulait équilibrer entre grosses têtes d’affiche, comme les New-Yorkais de The Casualties, les Espagnols de Crisix ou les Finlandais de Korpiklaani qui s’annoncent monstrueux. Mais également laisser de la place aux découvertes, c’est le cas avec Imparfait, March ou Broken Bomb qui sont connus de manière internationale, mais un peu moins en France. C’est l’occasion de les mettre en avant. Il y a neuf groupes, c’est moins que l’année dernière (il a fallu faire avec la hausse des cachets), mais ils vont jouer plus longtemps, donc les festivaliers auront exactement le même temps de musique. Et quand le Hellfest a sorti sa programmation, on s’est rendu compte qu’on avait trois groupes en commun. On était plutôt fiers de nous.
Il y a une « très légère » différence entre les deux événements… Comment arrive-t-on à faire venir les mêmes groupes ?
Parce qu’on négocie très bien. [Rires] Plus sérieusement, c’est aussi la pérennité du festival –et son état d’esprit. C’est une manifestation qui n’a jamais grossi : on ne sera jamais les Eurockéennes, tout simplement parce que l’on n’a pas envie d’être les Eurockéennes. On veut garder cet espace, une jauge à maxi 1 800, 2 000 personnes, pour que cela reste un festival convivial, familial, dans lequel on


peut croiser les artistes au milieu de la fosse, boire une bière ou ramener un truc sans débourser des sommes folles. On n’a aucune prétention à devenir le plus gros festival de l’est de la France… Ce n’est pas dans l’ADN. On est un peu le village d’Astérix dans l’idée – d’ailleurs ce n’est pas pour rien qu’il y a des sangliers à la broche au menu ! Un petit côté irréductible…
Le petit village d’irréductibles face au géant Hellfest ?
[Rires] Encore une fois, on n’ambitionne absolument pas de prendre de l’envergure ! Mais c’est vrai que l’on draine beaucoup de monde, notamment parmi ceux qui n’ont pas pu avoir de place pour le Hellfest vu que tout le stock disparaît en vingt minutes, que le weekend là-bas revient souvent très cher… Maintenant, l’expérience n’a absolument rien à voir. Néanmoins, dans un sens, on revendique un peu un côté mini-Hellfest – mais on ne va pas trop le dire parce qu’ils vont nous voir sinon !
— LA GUERRE DU SON, festival les 12 et 13 juillet à Landresse www.laguerreduson.fr
Crisix © Arnau Montfort.
57
Korpiklaani © DR.
AT THE CROSSROADS
Par Benjamin Bottemer ~ Photo : Arno Paul
ARTISANS D’UN ROCK’N’ROLL VISCÉRAL TRAVERSÉ DE MULTIPLES INFLUENCES, LES NANCÉIENS D’HOBOKEN DIVISION
SORTI EN FÉVRIER DERNIER LEUR
ALBUM, PSYCHOLOVE.
Dans la maison de Mathieu Cazanave et Marie Rieffly, fondateurs et têtes pensantes d’Hoboken Division, le rez-de-chaussée est envahi de fétiches, de disques et de bouquins sur la musique rock et blues, et le grenier consacré aux répétitions et aux bricolages. Un environnement intimiste, où leur son se nourrit d’inspirations diverses et de quelques motifs familiers : fuzz omniprésent, reverb sur la voix, fulgurances du sitar et du tanpura… Mais Hoboken Division aime aussi, au fil des albums, s’affranchir de ses propres références. Blues-garage, rock psyché, deltablues… les étiquettes ne collent pas à l’organisme hybride que constitue le groupe. Après un Arts & crafts très brut, bricolé à deux avec la boîte à rythmes au cœur du processus, The Mezmerizing Mix Up of the Diligent John Henry annonçait déjà une évolution, marquée par l’arrivée d’un batteur. Elle se poursuit aujourd’hui avec Psycholove , tourné vers un son plus direct, avec même des soupçons de pop-rock ; mais qui reste une œuvre sans concessions, née de la volonté du couple de fabriquer une musique qui leur ressemble.
D’où venez-vous en termes d’influences musicales ?
Mathieu : Je suis arrivé au blues en découvrant « You Gotta Move », la reprise de Fred McDowell par les Stones. Puis je suis tombé dans le trashblues et le delta-blues, des sons rentre-dedans, issus d’une culture rurale. The Brian Jonestown Massacre m’a donné envie de monter des groupes, et je suis aussi un grand fan du Velvet Underground.
Marie : Moi, j’étais plutôt rock tendance White Stripes, et jazz. J’ai toujours chanté, testé plein de trucs, le jazz m’a ouvert l’esprit en me montrant que l’on pouvait faire des choses moins « clean », crier, et que se planter, c’était pas grave ! J’aime beaucoup Ella Fitzgerald car elle prouve qu’on peut être une grande chanteuse en se marrant.
Comment est né Hoboken Division ?
Mathieu : Je bossais sur un projet de covers du Velvet Undergound et on m’a présenté Marie. L’idée de disséquer et de dépouiller les morceaux du Velvet pour pouvoir les jouer à deux, ça a vraiment été le point de départ de la démarche d’Hoboken Division.
Marie : Arts & crafts , notre premier album, sonnait très crade, garage : c’était une photographie de nous à un moment donné, de ce que l’on savait faire techniquement et aussi d’une certaine urgence. Aujourd’hui on a évolué, mais le côté sauvage est toujours là.
La boîte à rythmes, qui vous a permis de pallier l’absence d’autres musiciens, reste emblématique de votre son, avec ces boucles apportant un côté transe, assez proche du blues justement… mais vous sonnez quand même très rock.
Mathieu : Comme j’explorais la technique de l’open-tuning, propre au blues, pour trouver de nouvelles manières de jouer à la guitare, on parlait de « garage-blues », mais effectivement notre entourage nous disait qu’on était plutôt rock ! La boîte à rythmes, on ne la lâchera jamais, elle fait partie de notre identité, mais ça imposait d’être hyper-précis sur scène : si tu te rates, c’est irrattrapable.
Marie : Et si tu tombes sur un ingé son qui n’est pas fan, tu auras un son pourri !
C’est ce qui a motivé les arrivées du batteur Thibaut Czmil puis du claviériste et bassiste Clément Kipper ? Ils vous ont rejoints à chaque fois au moment d’aller défendre les albums sur scène.
Marie : C’est clair qu’avec un batteur, sur scène tu sonnes plus fort ! Thibaut a apporté de la précision et plus de souplesse au son du groupe, et il a compris qu’on ne voulait pas qu’il remplace la boîte à rythmes, mais qu’il cohabite avec.
Mathieu : Quant à Clément, son arrivée a permis à Marie de se libérer de la basse pour se concentrer sur le chant. Il faut aussi parler de Lo’Spider du studio Swampland à Toulouse : il nous suit depuis nos débuts et a été déterminant pour forger notre son. Laurent travaille sur bandes magnétiques, ça donne un son plus crade et nécessite d’enregistrer d’une traite, quitte à conserver les erreurs.
Sur Psycholove, on sent que le chant de Marie est plus « devant ».
Marie : Dans Arts & crafts , je m’adaptais aux compositions de Mathieu, je cherchais ma place entre la boîte et les guitares. Ensuite, j’ai pris confiance en moi, je me suis ménagée des espaces
ONT
58
TROISIÈME

pour ma voix et mes idées. Sur le dernier album, en studio on a vraiment bossé la voix comme un instrument, pour la mettre plus en avant.
Il y a aussi moins de fuzz, de reverb, un son moins dense… Ce troisième album inaugure-t-il une approche différente de votre musique ?
Marie : Avant, on réalisait des pré-productions très travaillées avant de les envoyer à Laurent. Pour Psycholove on a laissé plus de place au travail en studio, et à davantage de spontanéité.
Mathieu : On évolue, mais on veut toujours garder cette tension propre au delta-blues ; on la recherche à chaque morceau. Et même si c’est compliqué de vivre de sa musique dans un système qui privilégie la nouveauté et te pousse à faire des concessions, on prendra toujours le temps qu’il faut pour faire de la musique selon nos principes.
— PSYCHOLOVE, Hoboken Division / Les disques de La Face Cachée
59
ICI, NANCY
Par
UN
ÉVÉNEMENTS ET PERSONNAGES MARQUANTS.
La date du 17 octobre 1986 semble ne correspondre à rien, et pourtant ce soir-là, au cœur de Nancy, sous un chapiteau au parc de la Pépinière, les Residents se produisent dans le cadre de Nancy Jazz Pulsations. Ils constituent la tête d’affiche d’une soirée d’exception, avec Stephan Eicher seul derrière ses machines, et KaS Product en pleine ascension. Je me souviens que nous étions nombreux, les petits Alsaciens, à nous y rendre lors d’une nuit particulièrement brumeuse. Avec cette excursion hors des sentiers battus du jazz et des musiques du monde, Nancy s’inscrivait en lettres scintillantes sur la carte du rock. En toute logique, tant la ville s’attachait à des genres musicaux faits pour elle, depuis longtemps déjà.
Certains seraient tentés de faire débuter cette histoire par un hommage à un précurseur, JeanClaude Berthon, l’enfant de la ville qui a créé dès 1961 la première revue rock en France : Disco Revue. Si la vague yé-yé est très représentée, avec la présence incontournable de Johnny Hallyday
– l’occasion de sa première couverture d’un magazine ! –, de Sylvie Vartan et Françoise Hardy, cette petite revue très confidentielle s’attachait tout de même à Buddy Holly, aux Beatles et aux Stones. Après avoir quitté Nancy pour la capitale, le jeune homme se fit le relais de ce qui se passait au Bus Palladium et au Golf Drouot, hauts lieux d’un rock hexagonal, mais face à la concurrence croissante – la naissance de Rock&Folk en 1966 –, il fut obligé en 1967 de mettre un terme à la parution d’un bijou encore très prisé par les collectionneurs. N’empêche, la rock critic made in France est quasiment née à Nancy, et ça n’est en rien un hasard. D’autres situeraient l’acte de naissance du rock à Nancy au concert de Jimi Hendrix au cinéma Le Rio le 14 octobre 1966, en première partie de Johnny Hallyday. Un document d’archives récemment exhumé par la RTS montre Johnny et Jimi en pleine joute de ronds de fumée dans le restaurant Le Foy, place Stanislas. L’événement est de taille, il est sans doute marquant de manière symbolique et surtout rétrospective. Gérard Nguyen se souvient d’avoir assisté à ce concert, mais sa première grande « claque », il l’attribue à la présence de Soft Machine, un soir de décembre 1969, salle Poirel. Le célèbre groupe de Robert Wyatt interprète le répertoire du disque qu’il s’apprête à enregistrer : Third. À l’époque des premiers enregistrements de Pink Floyd et de Led Zeppelin, Nguyen est naturellement sous le charme. Quelques années plus tard, alors qu’il est déjà disquaire, il se fait l’apôtre de ces musiques pop du début des années 70, progressives ou krautrock, très souvent en marge des courants dominants. « Nous constations que les groupes passaient ailleurs, et pas chez nous. » Après avoir créé une association avec des amis, il organise un concert de Can, puis d’Hatfield and the North et d’Henry Cow, le premier groupe de Fred Frith et Chris Cutler. L’autre constat, c’est que la presse ne s’intéresse pas beaucoup à ces scènes-là, même si certains chroniqueurs comme Paul Alessandrini de Rock&Folk leur consacrent des articles : « Il n’existait que Rock&Folk et Best. Nous nous sommes dit : pourquoi ne pas créer notre petit journal ? » Atem voit le jour en 1975. Gérard le baptise ainsi en référence à un morceau du deuxième album de
Emmanuel Abela ~ Photo : KaS Product par Richard Dumas
SO
RAPPELLE COMBIEN LA VILLE DE NANCY A COMPTÉ DANS L’HISTOIRE DU ROCK
L’OCCASION DE REVENIR
QUELQUES
DOCUMENTAIRE CONSACRÉ À LA SCÈNE NANCÉIENNE DES ANNÉES 80,
YOUNG BUT SO COLD, D’APRÈS UN TITRE DE KAS PRODUCT, NOUS
HEXAGONAL.
SUR
60

Kraftwerk et à un album de Tangerine Dream. Dès le numéro 2, il se rend en Angleterre, dans les locaux de Virgin à Vernon Yard en exprimant à l’attaché de presse son envie d’interviewer Robert Wyatt, Henry Cow et Kevin Coyne. Quelques minutes plus tard, Kevin Coyne en personne se pointe dans les locaux, Robert Wyatt échange avec lui au téléphone, puis il obtient un rendez-vous avec Kevin Ayers et les membres d’Henry Cow. Bref, la fine fleur. En 1977, il quitte Nancy pour la capitale, si bien que sur certains numéros on peut reconnaître les caractères de Libération, dont il utilisait le matériel la nuit Quand on feuillette rétrospectivement de vieux exemplaires de ce fanzine devenu revue, on retrouve les grandes figures d’une époque, Tim Buckley, Peter Hammill, Brian Eno à New York et les Residents. À Paris, il ne reste que très peu de temps et retourne à Nancy. « Moins pour des raisons financières, se souvient-il, que pour des raisons personnelles. Tous mes amis étaient à Nancy ! »
Nous sommes à la fin des années 70, le punk déferle sur l’Europe tout entière, Gérard Nguyen n’est pas en reste. Les boîtes à rythmes remplacent les batteurs, les synthés se font plus robotiques. Qu’importe, il était déjà en contact avec ses musiques via Brian Eno ou Heldon. Quand il rencontre Spatsz, un ancien infirmier psychiatrique reconverti expert ès synthétiseurs, et Mona Soyoc, une sublime chanteuse d’origine argentine, il n’hésite pas une seconde : il produit ce qui constitue le premier album du duo qui évolue
sous le nom de KaS Product. Il le sait, le groupe n’a rien à envier à ses figures qui, que ça soit outre-Manche avec The Slits ou Siouxsie & the Banshees, mais aussi outre-Atlantique avec Suicide ou Laurie Anderson, sculptent les sons d’une époque incertaine. L’histoire du rock s’écrit en temps réel à Nancy aussi. Rien d’étonnant au fait que le célèbre label britannique Soul Jazz Records, défricheur des trésors cachés, ait publié il y a quelques années une sélection d’inédits de ce duo qui a compté en France au même titre que Taxi Girl ou Marquis de Sade.
« À l’époque, nous avions beaucoup tourné, y compris en Angleterre, nous étions distribués à l’international et nous avions enregistré à New York, nous relatait Spatsz quelque temps avant sa disparition. Les gens nous ont écoutés, certains nous ont vus sur scène, tout cela se transmet. » Les souvenirs font parfois l’objet de récits enflammés : le concert à Nancy Jazz Pulsations en 1983 par exemple, dont on trouve des traces filmées sur Internet ou celui que nous évoquions, en 1986, en première partie des Residents. Un sommet sans doute de popularité d’un groupe au charisme évident, préfiguration des Kills d’aujourd’hui. La troublante Mona Soyoc souriait avec fierté quand elle nous signifiait « un mouvement de retour au son des années 80 », elle qui prolonge aujourd’hui l’aventure KaS Product avec une configuration nouvelle et notamment la présence de l’ex-bassiste de Marc Seberg, le très séduisant Pierre Corneau. Elle le fait avec un enthousiasme toujours aussi communicatif sur scène.
Ce qui s’est fait jour lors de ce fameux concert de 1986, c’est que Nancy n’était pas seulement devenue une ville de rock importante, mais bien l’épicentre de ce qui se jouait esthétiquement worldwide. C’est bien ce qui transparaît dans le documentaire d’Otomo de Manuel, So Young But So Cold , dans lequel on retrouve la fine fleur de l’époque, OTO, Dick Tracy ou Candidate, dont nous étions familiers en temps réel en voisins strasbourgeois. Étrangement, ce soir-là, le set de KaS Product nous révélait les signes de la fin d’une époque. De même pour les Residents, avec l’une des dernières apparitions du fantasque Snakefinger. Mais on le sait, désormais
61
— À Nancy, nous avons toujours connu ce côté underground plaqué sur un grand
rien ! —
Stéphane Grégoire
une ville comme Nancy sait anticiper. L’ouverture qu’affichait NJP sur ces éditions-là annonçait l’extrême diversité des musiques populaires à venir, elles seront rythmées, mondialisées, métissées, débridées et colorées. À deux pas de là, à Vandœuvrelès-Nancy, on poussait même plus loin l’exploration des sons du futur. Le centre culturel André-Malraux accueille depuis 1984 un festival, Musique Action Internationale – rebaptisé Musique Action –, qui ouvrait de nouvelles perspectives intéressantes, dans la lignée justement d’une esthétique que défendait Gérard Nguyen avec sa revue Atem. Le regretté Dominique Répécaud se souvenait, il y a quelques années de cela, avoir lui aussi assisté à ce fameux concert de Soft Machine en 1969 – ce qui dénote déjà à 15 ans d’une belle ouverture d’esprit ! Tout comme Nguyen, il a été passeur d’idées et de sons avec une vision de l’art très élargie. Il l’affirmait avec beaucoup de justesse : « Pour moi, il n’y a pas de domaine que je place au-dessus des autres. Ça se retrouve dans la philosophie de la programmation. J’ai toujours eu l’intuition que d’autres langages que le langage écrit, la littérature voire la philosophie, nous permettaient une compréhension du monde, et c’est le cas du langage sonore. » Si bien qu’à Vandœuvre, tous les publics se croisaient, amateurs de musique contemporaine, férus de jazz, mais aussi punk et rockers, pour assister à une performance de John Zorn, un concert de Fred Frith ou de Tom Cora. Ils s’y croisent aujourd’hui encore avec la même ferveur et surtout une curiosité qui semble caractériser l’état d’esprit de la ville. Une ville qui a vu naître quelques labels d’importance, Les Disques du Soleil et de l’Acier (DSA) créés par le décidément incontournable Gérard Nguyen, producteur des premiers disques de Pascal Comelade et de Sylvain Chauveau – excusez du peu ! –, mais aussi Ici d’Ailleurs. Le label a été initié par un autre passionné de musique, Stéphane Grégoire. Non, il ne nous citera pas le concert de Soft Machine en 1969, il était trop jeune pour cela. Mais son impulsion musicale première vient d’un morceau de la même époque, I Want You (She’s So Heavy) des Beatles et sa boucle répétitive finale. Cet ancien vendeur de chez Wave, le fameux magasin de disques de Gérard Nguyen, rue des Sœurs-Macarons, et du label indépendant Sémantic, se voit glisser une K7 d’un certain Yann Tiersen. « J’ai appelé ce Yann Tiersen, se souvient-il, que je ne connaissais pas. Il s’avère que j’étais le premier label à prendre contact et nous nous sommes fixé rendez-vous :
nous étions tous les deux surpris de constater qu’on était jeunes. Surtout, nous tenions le même langage, et j’ai donc publié La Valse des monstres en 1995 et Rue des cascades en 1996 sur mon premier label, Sine Terra Firma, avant de poursuivre sur Ici d’Ailleurs. C’est d’ailleurs une constante : toutes les signatures peuvent se faire parce qu’avec les artistes nous regardons dans la même direction, et même au-delà de la musique, d’un point de vue politique par exemple. Nous nous découvrons au fur et à mesure des aspirations similaires et des croisements possibles. » La longue fidélité de Yann Tiersen et le succès d’Amélie Poulain ont conforté le label dans ses choix autour d’artistes tels que The Married Monk, Matt Elliott, mais aussi le Messin Chapelier Fou. Identifié ici à Nancy, Stéphane Grégoire aurait pu rêver d’ailleurs, mais sa réponse en dit long sur les raisons qui singularisent décidément sa ville : « Ça n’est pas par calcul, je suis né ici, je vis ici. De toute façon, le caractère indépendant d’une ville ne se crée qu’à partir d’une réaction à l’existence d’un désert culturel. Des personnalités créent quelque chose, et de cette réaction naissent des enfants. Je ne suis pas à l’origine de cette histoire-là, mais je suis un enfant de ces personnalités-là. Nous pourrions remonter aux KaS Product, Gérard Nguyen, Dick Tracy, Punk Records, etc. À Nancy, nous avons toujours connu ce côté underground plaqué sur un grand rien, avec un petit noyau qui créait une identité par envie, sans se mettre de limites, et générait une scène. La contre-culture s’alimente ainsi, ce qui ne veut pas dire qu’on est dans le vrai. Cette contre-culture est la culture de demain, il faut juste qu’elle soit filtrée pour qu’un public plus large puisse se sentir concerné à un moment donné. » Contre-culture et culture de demain, l’histoire du rock à Nancy s’écrit depuis près de 60 ans, et les ramifications de ce récit semblent infinies tant les personnalités, les lieux ou les structures semblent nombreuses. Cette richesse transparaît à merveille, même si le sentiment reste forcément parcellaire ou dispersé, dans le documentaire de Otomo de Manuel, artisteréalisateur franco-américain, qui nous conduit dans une sorte de road-movie urbain à la recherche des lieux et des personnalités. Il a le mérite de nous replonger au cœur d’une ville déterminante, on l’aura compris, dans l’évolution du rock hexagonal voire au-delà, avec des initiatives qui lui sont propres : punk, new wave, électronique, musique industrielle et d’avant-garde, la somme est vertigineuse. Elle dit un état d’esprit, elle dit aussi une singularité, à une époque où tout semblait possible jusqu’à l’expérience ultime. Ce qui ressort de tout cela, c’est peut-être une envie, sans nostalgie aucune, de renouer avec des formes débridées, vaines parfois même, mais si libres et si vibrantes de vitalité.
— SO YOUNG BUT SO COLD, Otomo de Manuel, 2XDVD+CD, Ici D’ailleurs/L’Autre Distribution
62
Faire monde
La peinture germanique rayonne à Colmar, Besançon et Dijon, tandis que sont mis à l’honneur la création contemporaine à la Bnu, la renversante Julie Doucet au musée Tomi-Ungerer, la spectaculaire Katharina Grosse au Centre Pompidou-Metz, l’étincelant Dan Flavin au Kunstmuseum de Bâle, les incontournables Esther Ferrer et La Ribot au Frac Franche-Comté, la fiction sonore de Gaëtan Gromer à Belfort, l’œuvre-livre de Younes Rahmoun à la Kunsthalle de Mulhouse, et l’impossible à la BPM 2024.
ODE À LA LUMIÈRE
Par Emmanuel Abela
TROIS MAGNIFIQUES EXPOSITIONS À COLMAR,
ET DIJON NOUS AFFIRMENT L’ACTUALITÉ DE
LA PEINTURE GERMANIQUE
DE LA FIN DU XVe AU MILIEU DU XVIe.
Il est toujours surprenant de constater que la peinture germanique souffre de sa comparaison avec les grands maîtres de la Renaissance italienne et des Flandres. Or des noms comme Martin Schongauer, Matthias Grünewald, Hans Baldung Grien, Lucas Cranach et bien sûr l’immense Albrecht Dürer n’ont rien à envier à leurs prestigieux contemporains. Ils abordent simplement les choses différemment au cours d’une période charnière de l’Histoire, du xve et du xvi e, durant laquelle le foisonnement artistique fait se côtoyer des expériences diverses, toutes plus magnifiques les unes que les autres, avec des allersretours formels étourdissants. À la jonction de deux mondes, l’Italie et l’Europe du Nord, sur les voies de passages empruntées par les marchands, artisans et penseurs, les peintres germaniques explorent des voies qui sont les leurs, alternant les approches pleines de piété et celles, lumineuses, qui tendent vers une forme céleste. Il suffit de s’attacher au Retable d’Issenheim de Matthias Grünewald pour mesurer l’étendue de ces possibilités.

BESANÇON
64
Martin Schongauer, Volets du Retable d’Orlier : Annonciation (détail), 1475-1480, peinture à l’huile sur bois (tilleul) © Musée Unterlinden, Colmar. Photo : Christian Kempf
UNE VISION SACRIFICIELLE
La coïncidence – est-ce une coïncidence ? −, les éditions Arfuyen, basées à Orbey en Alsace, publient la traduction d’un texte remarquable consacré à cette œuvre majeure de la Renaissance germanique. Il suffit de lire ces quelques lignes rédigées en 1980 par la poétesse italienne Margherita Guidacci pour situer l’étendue de l’abîme qui s’ouvre à ses yeux : « Le silence est trop vaste, Madeleine, il n’est rompu pas même par tes pleurs. Mieux vaut, comme la mère, se voiler le visage ou le baisser, blême, accablé d’une muette pitié, comme le disciple. »
Que voit-elle, Margherita, dans cette « muette pitié » qui fasse écho au drame d’une humanité en proie au désespoir ? La noirceur qui enveloppe la Crucifixion centrale d’un halo d’obscurité étouffant ou la brisure de ce « corps inerte » comme révélateur de la violence de son temps ? Celui de la fin du Moyen Âge, la sienne, la nôtre ? Il y a de fortes chances qu’elle établisse un lien temporel, comme la marque d’une constance. On se souvient du martyre du poète et cinéaste Pier Paolo Pasolini, survenu peu de temps avant la rédaction de ce poème, en novembre 1975 – figure christique s’il en est ! – dont la dépouille n’était pas loin de ressembler, dans ses meurtrissures mêmes, au Christ de Grünewald. Il avait vécu lui-même sa Passion. Peut-être a-t-il réuni les conditions de sa propre exécution, avec cette vision sacrificielle du poète ?
L’ÉBLOUISSEMENT PLASTIQUE
On le sait, le danger du Retable d’Issenheim , c’est qu’il avale tout sur son passage. Dans cette manière d’associer le sublime de l’art médiéval tardif à la brillance de la Renaissance, il réduit les autres œuvres, les idées et les regards à son seul profit. Mais il ouvre également à des formes encore insoupçonnées et le chef-d’œuvre ne cesse de rayonner un peu plus à chaque vision. Davantage encore depuis sa restauration magnifique. Comme Picasso, Otto Dix et tant d’artistes, nous restons subjugués par tant de magnificence, bouche bée face au génie inespéré d’une œuvre qui continue de se situer parmi les plus belles au monde. En soi, le Retable constitue tout à la fois un jalon, un acte ultime de l’ordre de l’achèvement, mais aussi un instant fondateur d’une pensée esthétique nouvelle, dont les développements ne cesseront plus, dès lors, de conduire vers plus d’expressivité, plus de matérialité dans la couleur. Plus d’éblouissement plastique, en définitive, et d’accès à l’essence même d’une souffrance sourde, celle-ci s’exprimant de manière intérieure, comme si le peintre avait tenté de la contenir pour mieux la libérer.
LE FEU SACRÉ
On se souvient d’un court métrage du célèbre critique et cinéaste André S. Labarthe qui trouvait aux pieds du Christ une correspondance avec les traits cabossés des Souliers de Van Gogh au son d’un solo du percussionniste jazz américain Max Roach. Ce raccourci peut prêter aujourd’hui à tendrement sourire, et pourtant il signifie clairement l’instant de redécouverte de l’œuvre avec les déploiements esthétiques à venir, notamment chez les Expressionnistes allemands. L’œuvre a traversé le xxe, a croisé le regard de bien des artistes majeurs, des membres de Cobra à Beuys, parmi tant d’autres, jusqu’à inspirer le réalisateur David Fincher pour l’un des meurtres – « la paresse » –dans son thriller nineties étouffant, Seven. Et nous ne sommes pas peu à considérer le panneau de la Résurrection comme une œuvre proprement psychédélique avec la sublime apparition céleste d’un Christ vainqueur, extatique et lumineux. D’autant plus qu’on sait que le Retable s’adressait aux malades atteints de l’ergotisme, une maladie dont souffraient des personnes contaminées par un champignon parasite, l’ergot du seigle. Cette maladie, on l’appelait « feu sacré » ou feu de saint Antoine, du nom de la confrérie des Antonins chargés de la soigner. Les symptômes : dans certains cas, une gangrène extrêmement douloureuse, accompagnée d’une sensation de brûlure intense des extrémités, les mains, les pieds, qui pouvait conduire à l’insensibilisation puis au détachement de ces parties du corps – les Antonins avaient pour mission de les amputer de manière anticipée − ; dans d’autres cas, la maladie entraînait des hallucinations terrifiantes, dont certaines ont sans doute inspiré à Grünewald la représentation de la Tentation de saint Antoine, en écho à celle réalisée en gravure par Martin Schongauer quelques décennies auparavant. Et en définitive, n’est-ce pas en synthétisant des molécules de l’ergot du seigle qu’on a expérimenté le LSD au fort pouvoir hallucinogène, qui a entrainé tant de bouleversements au sein de la génération des années 60 ?
65

LA FUSION DE L’ESPACE ET DES CORPS
Aujourd’hui, le Retable, placé au sommet d’un vaste dispositif de trois expositions, au musée Unterlinden à Colmar donc, mais aussi au musée des BeauxArts et d’Archéologie de Besançon et au musée des Beaux-Arts de Dijon, consacrées à la peinture germanique du xve au xviie. Sa maestria ne doit pas occulter les centaines de tentatives d’artistes qui, parfois inégales, partageaient une même veine sensible. La distinction que l’on peut établir avec les grands peintres italiens de la Renaissance et certains grands maîtres du Nord, c’est la permanence d’une fusion typiquement médiévale : celle de l’espace et des corps. Fusion ou solidarité des éléments, qui ne s’explique pas seulement par la méconnaissance de la perspective, que celle-ci soit linéaire ou atmosphérique. Dans la négation de l’espace, une pensée persiste. Elle participe de l’élaboration logique, voire philosophique de l’image médiévale : le gothique tardif tend à unifier ce que la Renaissance va désolidariser, individualiser, au profit d’une quête d’idéal. En peu de mots, au Moyen Âge, la représentation se fond dans un tout compact, sans profondeur – et le terme dans ce caslà ne revêt aucune dimension péjorative – au profit d’une compréhension ou d’une narration. Bien sûr, l’avènement des polyptyques dès le xiii e et leur développement dans les églises aux xiv e , xv e et début xvie offre une matérialité nouvelle, avec la présence d’éléments sculptés ou de nouvelles formes narratives sur plusieurs panneaux. Si l’on reprend l’exemple du Retable d’Issenheim, les deux approches coexistent : une Crucifixion sans fond, dans
l’immensité d’un événement sans fin, et la présence de panneaux très renaissants qui représentent saint Sébastien et saint Antoine, avec des relents très italiens, voire même vénitiens. Et ce de manière on ne peut plus troublante.
LA RICHESSE D’UN TEMPS
Le mérite de ces trois expositions est de nous plonger dans la vaste production de l’époque, avec ce souci de s’attacher à des formes quotidiennes. Celle de petites églises, qui n’ont pas forcément la possibilité de s’offrir les services d’un grand maître, mais plutôt d’un peintre localisé, lui-même s’inspirant des œuvres existantes ou créant ses propres chemins, en fonction d’une iconographie florissante. La multiplicité des expressions dit la richesse d’un temps, où le commanditaire – parfois un notable en quête de rachat de ses péchés par anticipation, un religieux, une corporation, une confrérie −, les ecclésiastiques en charge du programme iconographique, les artistes et les artisans rivalisaient de trouvailles pour distinguer l’église destinataire de l’œuvre réalisée d’avec sa voisine à proximité. On le constate dans les trois expositions, l’émulation est constante.
DE NOUVELLES ATTRIBUTIONS
Il a fallu du temps pour recenser, identifier et restaurer bon nombre de tableaux existants. Avec, ô bonheur, d’excellentes surprises comme ces nouvelles attributions : des panneaux attribués à Martin Schongauer, qu’on connaît généralement pour ses gravures, à l’exception toutefois de l’autre chef-d’œuvre colmarien, La Vierge au buisson de roses, admirable dans l’église des Dominicains à Colmar ou Le Retable d’Orlier du musée Unterlinden ; puis, une œuvre d’Albrecht Dürer, sans doute réalisée alors qu’il s’était mis en quête de rencontrer Schongauer justement, arrivant trop tard pour que l’échange pût avoir lieu effectivement. Il s’agit d’une crucifixion assez sobre, pas encore révélatrice du génie de l’artiste, mais d’une facture qui dit son potentiel à venir. Cette œuvre, si son attribution était confirmée, ne serait que la huitième de Dürer présente dans un musée français, ce qui en situe l’importance. Et si l’on admettait que le portrait de saint Jean dans ce petit tableau n’était autre qu’un autoportrait du peintre – la ressemblance reste troublante, même si personne n’ose s’aventurer sur ce terrain-là −, les perspectives historiques seraient vertigineuses. L’émotion d’une telle découverte, qu’on met en lien avec un dessin de Dürer au Louvre, est grande et justifie à elle seule la découverte de l’exposition colmarienne.
66
Albrecht Dürer (?), Crucifixion, 1492-1493, peinture à la technique mixte sur bois (tilleul) © Musée Jeanne d’Aboville, La Fère. Photo : RMN-Grand Palais. Photo : Benoît Touchard

LES DÉTAILS DU QUOTIDIEN
L’autre enseignement est celui d’un monde, celui du Saint-Empire romain germanique, mouvant, fourmillant, brillant de mille feux, avec cette itinérance qui conduit les artistes de site en site, de chantier en chantier, tout en diffusant un langage formel très homogène dans ses coloris, dans son raffinement ornemental et avec ce souci permanent d’inscrire les détails du quotidien au cœur de scènes à vocation universelle. Une Vierge à l’écritoire autrichienne, que l’on peut contempler au musée des BeauxArts de Dijon est ravissante de délicatesse, avec son effet de perspective encore malaisé mais déjà prononcé, et la représentation de l’Enfant Jésus en train de tracer des lettres avec son stylet, touchante de légèreté. Face à une telle sensualité dans le trait et une telle virtuosité, on ne peut que se laisser submerger.
LA RÉALITÉ D’UNE ŒUVRE
L’ensemble de ces trois expositions nous révèle avec un vrai souci de pédagogie la réalité d’une œuvre, de sa conception à sa réalisation : c’est le cas de sa destination dans un contexte rituel – à quel moment la dévoile-t-on, l’ouvre-t-on, l’exploite-t-on dans le cadre liturgique ? −, tout comme sa mise en œuvre à l’atelier du peintre, lieu de création, de formation, mais aussi de négoce. On se consacre de manière subtile à son exécution, sa préparation, ses supports et ses modèles, tout en abordant la question du style en fonction des foyers de création. L’étonnant Maître de la légende de sainte Ursule de Cologne réalise des prouesses formelles pleines de noblesse dans L’envoi des ambassadeurs de la cour du roi païen, une œuvre à la croisée des chemins presque anachronique, voire intemporelle, qui pourrait avoir influencé jusqu’à certains peintres préraphaélites, voire les adeptes du style fantasy dans la deuxième moitié du xxe. On pense au Britannique Alan Lee, illustrateur des œuvres de Tolkien.
UN MONDE NOUVEAU
Et que dire de la présence des sublimes Hans Baldung Grien, dans un style ouvertement renaissant ou Lucas Cranach avec sa Mélancolie, inspirée de celle de Dürer, si pleine d’étrangeté ?
Ou enfin de ce sublime portrait réalisé par Georg Pencz, prêté par le musée de Grenoble pour figurer dans l’exposition de Besançon, un Portrait de femme de 1545, hors temps et à la modernité désarmante, si révélatrice d’un humanisme triomphant qui pour l’occasion attribue une place noble à la femme : le regard insistant, déterminé, montre à la fois une intimité, mais aussi une individualité qui a fini par s’exprimer et triompher. Au point d’effacer la pensée antérieure au profit d’un monde nouveau, celui des temps modernes. La bascule a fini par s’opérer, les temps ont changé, mais ils conservent – et conserveront à jamais – ce quelque chose de ce qu’ils sont venus remplacer.
67
Georg Pencz, Portrait de femme, 1545, musée de Grenoble © Ville de Grenoble/Musée de Grenoble. Photo : J.L. Lacroix
LORS DE LA PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION COLMARIENNE, NOUS AVONS PU ÉCHANGER
AVEC ISABELLE DUBOIS-BRINKMANN, ACTUELLE DIRECTRICE DES MUSÉES MUNICIPAUX DE MULHOUSE ET EXPERTE SCIENTIFIQUE DE LA PÉRIODE.
Nous restons sous le coup de l’émotion après la découverte de l’attribution d’un nouveau tableau à Dürer. Pourrionsnous voir un autoportrait dans la figure de saint Jean au pied de la croix ?
Il est vrai que nous possédons au Louvre un autoportrait assez ressemblant de la même époque. Cette crucifixion se rapproche d’un autre petit dessin, également présent dans les collections du Louvre. Peut-on voir là une volonté de l’artiste ?
Il est difficile de l’affirmer ainsi…
Ces deux nouvelles attributions, Schongauer et Dürer, ne risquent-elles pas de l’emporter sur la richesse des autres œuvres présentées ?
L’idée, c’est de montrer que nous pouvons encore découvrir des pépites dans les réserves des collections, dans de petits musées ou des églises. Cela prouve que les collections françaises sont riches, elles restent assez peu étudiées dans le domaine de la peinture germanique. Ça sera pour nos collègues allemands et suisses l’occasion de découvrir des œuvres qu’ils ne connaissaient pas et sur lesquelles ils vont pouvoir se prononcer. Ce sera le cas des experts de Dürer en Allemagne. Après, même si on met l’accent sur des grands noms, le sens de ces expositions est de montrer qu’au-delà des maîtres, on découvre un entourage avec des artistes dont on ne connaîtra jamais l’identité précisément alors qu’on recense pour eux une production fertile.
Et qui présentent des qualités.
Oui, ils présentent de réelles qualités effectivement.
Ces expositions donnent le sentiment d’une mise en lumière de cette période de la fin du Moyen Âge. Un nouvel intérêt se fait-il jour ?
En 2001, une exposition avait été organisée à Karlsruhe sur l’art du Rhin Supérieur et on sentait déjà un frémissement, mais avec de nouvelles choses à affiner. Cette série d’expositions nous permet aujourd’hui de faire un point d’étape sur la recherche avec cette idée de favoriser l’évolution d’une certaine perception autour d’échanges nourris. Rassembler certaines œuvres à Colmar nous semblait important, parce qu’il s’agit d’une grande collection d’art du Rhin Supérieur, à la fois de peintures et de sculptures, tout cela en résonance avec les musées de Dijon et de Besançon, sans occulter la collection permanente de l’Œuvre NotreDame à Strasbourg. C’était aussi l’occasion de lancer un vaste programme de restauration pour ces œuvres, avec cette idée de montrer aux habitants qu’ils passent parfois devant des chefs-d’œuvre sans le savoir.

— COULEUR, GLOIRE ET BEAUTÉ, exposition jusqu’au 23 septembre au musée Unterlinden, à Colmar www.musee-unterlinden.com
— MAÎTRES ET MERVEILLES, exposition jusqu’au 23 septembre au musée des Beaux-Arts de Dijon beaux-arts.dijon.fr
— MADE IN GERMANY, exposition jusqu’au 23 septembre au musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon www.mbaa.besancon.fr
DES CHEFS-D’ŒUVRE SI PROCHES
68
La Vierge à l’écritoire, Vers 1420, peinture sur bois (tilleul), Paris, musée du Louvre, inv. RF 2047 © RMN – Grand Palais (musée du Louvre) Photo : Gérard Blot
DERNIER CRI
Par Valérie Bisson
À LA BNU SE (RE) DÉCOUVRENT DIX ANS D’ACQUISITIONS SPECTACULAIRES.

Le travail d’acquisition patrimonial mené par les conservateurs de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg est apparenté dans l’imaginaire collectif à l’acquisition de livres anciens. S’il est vrai que cet aspect représente une part importante de la politique d’acquisition, les conservateurs opèrent également des recherches et actions moins connues autour de l’acquisition de fonds de littérature ou d’œuvres graphiques contemporaines, mettant ainsi en exergue l’incroyable vivacité du bassin intellectuel et artistique rhénan et, plus particulièrement, du foyer de l’illustration strasbourgeoise.
L’exposition « Dix ans de trésors, acquisitions patrimoniales 2014-2024 », est une remarquable occasion d’admirer les trésors acquis par la Bnu au cours de la dernière décennie. Dont, notamment, ce petit livre de la sagesse éternelle, Büchlein der ewigen Weisheit , de la première moitié du xve siècle, cette carte spectaculaire du canal du Rhône au Rhin de 1835, long dépliant entoilé de plus de trois mètres, plié en biais à hauteur d’Altkirch-Mulhouse pour mieux suivre le trajet du canal, ou encore ces manuscrits polonais clandestins écrits sur tissu au stylo Bic et naviguant dans des sacs de linge sale. Réalisé sous le commissariat scientifique d’Aude Therstappen, directrice adjointe du Pôle des services et des collections, avec la collaboration, entre autres collègues, de Catherine Soulé et Gwénaël Citérin, ce parcours met en lumière la richesse du volet contemporain. Pour preuve, un tapuscrit de Jacques Maritain, penseur démocrate et humaniste, et une photo de lui, entouré d’Henri Michaux et d’un Stefan Zweig effondré lors du 14 e congrès international des PEN Clubs en 1936, en pleine guerre d’Espagne et
montée du nazisme, font face à Jeu de l’oie. Cette sérigraphie de Caroline Sury, co-fondatrice avec Pakito Bolino des éditions du Dernier Cri, a été acquise peu après la menace de procès, par une association affiliée à l’extrême droite, qui planait sur l’éditeur à la suite d’une exposition organisée en 2015 à la Friche la Belle de Mai, à Marseille.
Abordant des thèmes tabous, Le Dernier Cri est un des principaux représentants en France de l’underground international. En 2022, la maison d’édition cherchait une institution susceptible de conserver sa production d’estampes, livres d’artistes, affiches, revues, disques et films d’animation. La Bnu répondit présente, via le responsable du centre de l’illustration, et collabora ainsi avec la médiathèque Malraux pour accueillir le don et se concentrer sur les sérigraphies, en apportant son soutien à l’éditeur.
La Bnu reflète la vitalité de la création contemporaine et de son territoire, des Éditions 2024, dignes héritiers des pionniers de l’édition indépendante comme l’Association. Mais aussi des graphistes, photographes, sérigraphes tels que Boyan Drenec, qui travaille sur la stylisation des formes jusqu’à l’abstraction, ou Clément Vuillier et son Explosion acquise en 2019. Et ce, sans contrainte de forme ni de thématique, dans la pluralité des approches artistiques, dans le respect des rencontres avec des galeristes, des artistes imprimeurs ou des éditeurs.
— 10 ANS DE TRÉSORS,
ACQUISITIONS PATRIMONIALES 2014-2024, exposition sur rendez-vous jusqu’au 2 décembre, à la Bnu, à Strasbourg Bnu.fr
Boyan Drenec, Axolotl, sérigraphie
69
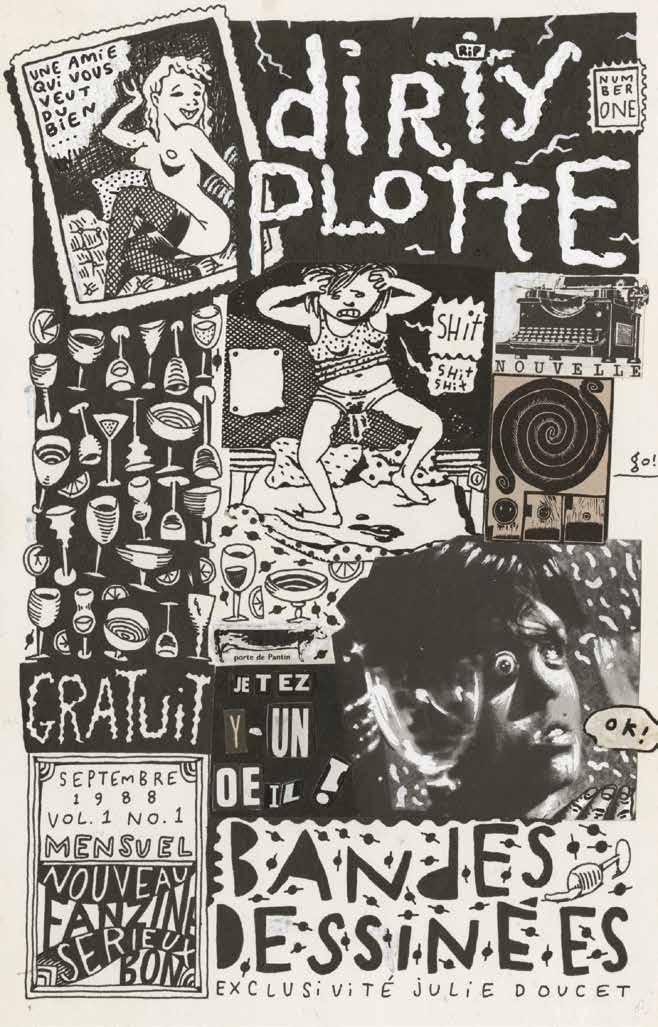
70
AVEC UN GRAND F
Par Emmanuel Abela
À 58 ANS, LA QUÉBÉCOISE PUNK ET UNDERGROUND JULIE DOUCET MÉRITAIT
SA RÉTROSPECTIVE. C’EST CHOSE FAITE AVEC UNE BELLE EXPOSITION AU MUSÉE

TOMI-UNGERER QUI SECOUE BIEN DES CERTITUDES.

On se souvient d’avoir pris en pleine figure ses premières publications qui, au-delà de la provocation qu’elles affichaient revêtaient quasiment une dimension expiatoire, à la limite de l’irrecevable. Qu’expiait-elle, Julie Doucet, si ce n’est d’être femme ? Elle qui s’est jugé « garçon manqué » un temps avant de s’assumer dans sa pleine féminité ? Dans ses premières autoproductions qu’elle imprime elle-même, cette féminité, elle l’aborde sans détour avec un sens inné de l’irrévérence – qu’est-ce que la norme, au fond ? – qui conduit à une forme d’immédiateté : menstruation débordante, masturbation effrénée, sexualité veule ou toxique, tentation de la castration, toute son intimité se révèle avec force. Il en va de même pour ses fantasmes ou ses rêves qui virent parfois aux cauchemars. L’un de ses premiers fanzines s’appelait Dirty Plotte – Dirty pour « sale », Plotte pour la vulve, mais aussi la traînée –, on surprend aujourd’hui encore une forme d’outrance, libérée plutôt que délibérée, effrayante mais salvatrice. On sent une forme compulsive qui la conduit à poser sur le papier ce qui lui vient en tête dans l’instant, avec une virtuosité graphique, un sens des cadrages quasi expressionniste. Son personnage, vrai-faux alter ego, mène une vie trash en conservant cette part de lucidité qui lui donne une vraie crédibilité. Une humanité, et bien sûr une pleine féminité. Ce qui est plaisant dans l’exposition que lui consacre le musée Tomi-Ungerer
– Centre international de l’illustration, c’est de lui découvrir d’autres filiations, plus dada voire Fluxus, dans le travail qu’elle mène autour des collages, détournements et autres romans-photos. On relève une dimension jouissive dans son expression permanente, faite de bric et de broc, mais toujours avec les pieds sur terre. Julie Doucet sait ce qu’elle fait, elle l’a su quand elle a quitté la BD, s’extrayant, elle, la féministe, d’un monde trop masculin ; elle l’a su également quand elle est revenue. Ce qu’elle ne sait pas en revanche, c’est combien on a besoin d’elle, les femmes bien sûr, mais les hommes tout autant.
— JULIE DOUCET, exposition jusqu’au 3 novembre au musée Tomi-Ungerer – Centre international de l’illustration, à Strasbourg www.musees.strasbourg.eu
Julie Doucet, Mon forcast, 2010, collage sur papier. Collection de l’artiste © Julie Doucet
71
Julie Doucet © Prune Paycha
NOUVELLE VAGUE
Par Benjamin Bottemer
Katharina Grosse est connue pour ses peintures in situ réalisées dans le monde entier, recouvrant des espaces entiers et les débordant. Son invasion par la couleur débute à la fin des années 1990 : ses créations prennent du volume, s’échappent des murs et des angles des « white cubes » grâce à la technique du vaporisateur, qui deviendra son outil fétiche. Ce sont ensuite les bâtiments qu’elle recouvre ; puis la marée monte jusqu’à déferler sur le bitume, les rochers, les arbres. Après avoir découvert le Centre Pompidou-Metz, qui lui est apparu comme « une usine ou un hangar à avions » tout autant qu’un musée, elle imagine un dialogue de haut vol avec le bâtiment conçu par Shigeru Ban et Jean de Gastines.
Au fil de la visite, l’artiste allemande témoigne de son goût pour les jeux d’échelles et de perspectives. La pièce maîtresse de l’exposition « Déplacer les étoiles », constituée de 8 000 m² de toile, est hissée haut dans la Grande Nef, culminant à plus de vingt mètres de hauteur. Ses drapés, ses ondulations et ses dimensions rappellent la voile d’un navire, le rideau du théâtre ou les mouvements de l’océan. Déménagée depuis le Carriageworks de Sydney, où elle fut d’abord installée en 2018, l’œuvre a été recouverte de nouvelles nuances. On peut se glisser entre ses pans immenses pour y déambuler sur des dizaines de mètres carrés, observer les variations de la lumière sur la matière : l’effet est évidemment saisissant. On peut aussi la contourner ou l’observer depuis le parvis, à travers les grandes baies vitrées. « J’ai voulu inventer une peinture qui développe une
écologie avec le bâtiment : pourquoi construire des murs pour y accrocher des tableaux ? » interroge l’artiste.
La couleur déborde : Katharina espère que les skateurs, danseurs, jongleurs, cyclistes parfois présents sur le parvis du musée surferont sur ses vagues multicolores. « Je crée des structures qui parlent à tous les sens, au corps et pas seulement au cerveau », indique l’artiste, dont l’engagement physique a impressionné les équipes du Centre Pompidou-Metz. Armée d’une lance de trois mètres de long reliée à cinquante tonneaux de trente litres de peinture, elle effectuait d’amples mouvements circulaires pour imprégner la toile et le béton ; comme une danse, discipline pour laquelle elle se passionne. « C’est comme peindre avec les yeux, sourit Katharina Grosse. Dans la nature, dans le corps humain, il y a uniquement des courbes, aucune ligne droite… dans la vie non plus d’ailleurs. La ligne droite est un concept mathématique, et ma propre nature, en tout cas, ne peut pas en produire. » Attirés d’emblée par la monumentalité de l’œuvre, on ne se rend même pas compte qu’un arbre repose dans un coin de la galerie… une facétie scénographique plutôt réussie. Clin d’œil à la toute première œuvre in situ de Katharina Grosse, réalisée dans une forêt allemande en 1982, les branches de cet arbre venu tout droit des Vosges évoquent les pinceaux, laissés là, qui auraient pu servir à peindre la toile voisine. Dans le Forum adjacent est installée une version déstructurée de Das Bett, sa chambre à coucher de Düsseldorf qu’elle a vaporisée en 2004. Un lit, quelques vêtements et de nombreux livres s’échappant de cartons, le tout balayé de peinture sombre : une nouvelle image, réactivée, de ce qui fut le lieu de vie et l’atelier de l’artiste. Entre la fluidité d’une toile immense échappée du cadre, l’aspect frontal et la dureté d’un arbre déraciné, et les fragments de la chambre à coucher, les contrastes donnent naissance à autant de points de vue à explorer.
— DÉPLACER LES ÉTOILES, exposition jusqu’au 24 février au Centre Pompidou-Metz, à Metz www.centrepompidou-metz.fr
Katharina Grosse, Déplacer les étoiles , 2024. Vue de l’exposition Centre Pompidou –Metz, 1 er juin 2023 –24 février 2025. Acrylique sur tissu et sol, acrylique sur asphalte.
NAVIGATION, DÉPLACER LES ÉTOILES, L’EXPOSITION
AU
INVITE
QUITTE
BAPTISÉE D’APRÈS UN TERME DE
DE KATHARINA GROSSE
CENTRE POMPIDOU-METZ, NOUS
À VOGUER ENTRE LES COULEURS,
À Y BASCULER.
Envs. 1 400 × 4 250 × 3 250 cm ; 6 000 × 3 000 cm. Photo : Jens Ziehe. Autorisation Centre Pompidou –Metz; Gagosian; Galerie Max Hetzler; Galerie nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder © Adagp, Paris 2024 72

DAN FLAVIN LE TUBE DE L’ÉTÉ
Par Mylène Mistre-Schaal
LE KUNSTMUSEUM DE BÂLE CONSACRE UNE EXPOSITION RÉTROSPECTIVE
EXCEPTIONNELLE À DAN FLAVIN. ENTRE MINIMALISME MYSTIQUE, HOMMAGES FLUORESCENTS ET PAYSAGES LUMINEUX, DAN FLAVIN, DÉDICACES EN LUMIÈRE PROPOSE UNE RENCONTRE SENSIBLE AVEC L’ARTISTE
DE L’ART DANS LE GAZ
Dan Flavin utilise la lumière comme un prestidigitateur. D’un coup de néon, il te repeint la pièce, en arrondit les angles ou en subvertit les contours. Avec quatre tailles d’ampoules et une palette de dix couleurs pour étalon, ses installations lumineuses dégagent une intensité proportionnelle à leur simplicité. « Le matériau utilisé peut sembler basique, mais son effet est incroyable. Il donne à l’artiste la possibilité de libérer la couleur de manière radicale, spatiale et presque physique », nous confie Olga Osadtschy, co-commissaire de l’exposition. Pionnier de l’art minimal sans le vouloir, Flavin a fait du tube fluorescent son eurêka. Dès les années 60 et jusqu’à sa mort, en 1996, il produit des œuvres lumineuses exclusivement composées de ces lampes achetées dans le commerce. Au premier abord, elles éveillent en nous tout un univers de références allant de la lumière crue de certains plafonniers aux aguicheuses enseignes des grands boulevards. Mais ce sont surtout les états visuels
AMÉRICAIN.
particuliers qu’elles provoquent et leurs effets sur la perception de l’espace qui fascinent l’artiste. Avec ce qu’il appelle ses « images gazeuses », il fait sortir l’œuvre de ses limites, jusqu’à imprégner de son halo l’ensemble de l’espace d’exposition. S’ouvre alors une troisième dimension, immatérielle et presque mystique, dans laquelle les 58 pièces présentées au Kunstmuseum nous entrainent.
Du geste radical des débuts (Diagonal of May 25, sa première œuvre intégralement lumineuse) aux compositions plus élaborées, mêlant tailles et couleurs de tubes différentes, Flavin l’autodidacte ne cesse de titiller l’espace. « I want to abuse architecture », aimait-il à dire. C’est l’effet que nous fait son insolente sculpture de 1973, untitled, to you Heiner, with admiration and affection. Barrière verte de 16 mètres de long, elle quitte le mur pour mieux affirmer sa beauté incandescente. Comme un ovni fluorescent, elle imprime les rétines et éclabousse murs et plafonds de son aura. À ses côtés, les gardiens du musée portent même d’incongrues mais nécessaires lunettes de soleil !
74

PANTHÉON NÉON
C’est d’un délicieux paradoxe que se nourrit l’exposition bâloise. Toutes les œuvres exposées ont une spécificité : dans leurs titres se cache une dédicace. Un hommage rendu aux amis, aux artistes ou événements qui ont inspiré Flavin. Les esprits de Matisse, Brancusi, Jones ou des soldats morts lors de la guerre du Vietnam, s’infiltrent ainsi dans les tubes de l’Américain. Et Olga Osadtschy de compléter : « Le minimalisme est souvent associé à l’objectivisme, aux objets utilitaires ou industriels, à une certaine froideur en somme ! Alors que les dédicaces renvoient à quelque chose de plus personnel, de l’ordre de l’amitié ou de l’admiration. Ce contraste est au cœur de l’exposition. »
Truffés d’anecdotes, ces titres-dédicaces font contrepied à la rigueur esthétique des œuvres et permettent une rencontre plutôt intime avec l’artiste new-yorkais. On y croise le souvenir de sa chienne, un golden retriever dont il était fou (et auquel il dédie une œuvre exposée au sous-sol du
musée), on y apprend son engagement politique (il a soutenu le candidat George McGovern, opposant à Nixon en 1972) ou ses valeurs pacifistes (il dédie une sculpture, Monument 4 , aux soldats morts pendant la guerre du Vietnam) le tout porté par un vrai sens de l’ironie.
Rare occasion d’admirer le travail de Dan Flavin dans toute sa diversité, « Dédicaces en lumière » déconstruit volontiers nos a priori sur le minimalisme et lui donne un petit supplément d’âme. Une expo qui nous allume, quoi qu’elle s’éteigne d’un simple coup d’interrupteur !
— DAN FLAVIN, DÉDICACES EN LUMIÈRE, exposition jusqu’au 18 août au Kunstmuseum Basel, à Bâle www.kunstmuseumbasel.ch
75
Dan Flavin, untitled (to Don Judd, colorist) 1-5 © Stephen Flavin / 2024, ProLitteris, Zurich. Panza Collection, Mendrisio. Photo : Florian Holzherr
DIALOGUES DE FEMMES
Par Nathanaelle Viaux
FIGURES INCONTOURNABLES DANS LE MONDE DE L’ART, ESTHER FERRER
ET LA RIBOT UTILISENT LE CORPS COMME MATIÈRE PREMIÈRE. LE FRAC
FRANCHE-COMTÉ INVITE À DÉCOUVRIR CES DEUX GRANDES ARTISTES
ESPAGNOLES À TRAVERS UNE MISE EN DIALOGUE DE LEUR TRAVAIL :
UN MINUTO MÁS ET ATTENTION, ON DANSE !
Née en 1937, Esther Ferrer a grandi sous la dictature de Franco, période qui l’influencera tout au long de sa vie. Elle commence la visite au Frac Franche-Comté avec cette question : « Qu’est-ce que la performance ? » D’emblée le spectateur devient acteur, il peut écrire sa réponse sur un postit qu’il collera ensuite sur la vitre du Frac.

L’œuvre de Ferrer est une prolongation, un dialogue. Elle se meut, elle se tord, elle nous convoque et nous questionne. La performance est le contraire de la mort. Esther nous rappelle que nous sommes libres : « Pour s’investir dans la performance, l’unique chose est de vouloir le faire. » Alors, faisons !
Son dada, c’est l’improvisation, courir le risque de mieux faire, de mal faire, de défaire. L’artiste nous invite à nous déplacer, physiquement et psychiquement. La façon de se mouvoir dans l’espace appelle à ressentir le monde différemment, à le voir autrement. « Pour moi, la performance c’est la vie, c’est quelque chose que l’on vit avec son corps, et qui est ouvert à toutes les possibilités. »
En face d’Esther, La Ribot, chorégraphe et danseuse. Née en 1962, elle a vécu son enfance sous Franco. Adolescente, elle n’aspirait qu’à une chose : la liberté. Elle fait partie des artistes qui ont modelé l’Espagne en un pays critique. Son travail mêlant théâtre, cinéma et photographie a énormément influencé le champ de la danse contemporaine.
Le dialogue entre ces deux femmes est présent dans leurs œuvres respectives. Certaines sont parallèles, d’autres s’entrecroisent et se répondent. Leur admiration mutuelle se ressent tout au long de l’exposition.
La Ribot : « On aime Esther dans le milieu de l’art vivant. Un phare. »
Au rez-de-chaussée, elle nous présente Despliegue quand soudain, Esther l’alpague : « Tu te souviens à Madrid ? Les spectateurs étaient au-dessus de ton œuvre, comme s’ils étaient la caméra ! C’est intéressant d’être au-dessus, tu ne crois pas ? » Et les voilà à discuter toutes les deux. Le vivant s’empare de l’œuvre.
La Ribot et Esther Ferrer. Photo : Blaise Adilon



Les spectateurs tout comme les figurants sont des éléments qui passionnent La Ribot. Elle a d’ailleurs créé une pièce où passent des bouts de films sur lesquels nous ne voyons plus que les figurants, les acteurs principaux étant recouverts par un cache noir. Elle raconte avec passion les chorégraphies et les mises en scène, les « extras qui sont dans les coins, mais qui sont d’une importance inestimable ! » explique-t-elle avec enthousiasme. La Ribot aurait pu écrire cette fameuse réplique dans Dirty Dancing : « On ne laisse pas bébé dans un coin ! » Forcément, l’image de Jennifer Grey, assise sur une chaise, s’impose à nous.
En l’occurrence, la chaise revient souvent dans le travail de ces deux artistes. Objet du quotidien, objet chéri des designers, pour La Ribot, elle est « la métaphore du corps par excellence… Elle est détournée, contextualisée et décontextualisée en permanence. » « Pourquoi la chaise ? Parce que j’adore les chaises », répond Esther Ferrer.
— ESTHER FERRER, UN MINUTO MÁS, — LA RIBOT, ATTENTION, ON DANSE !, expositions jusqu’au 27 octobre au Frac Franche-Comté, à Besançon www.frac-franche-comte.fr
Esther Ferrer, Le mur des immortel.les, 1987 - 2024. Vue de l’exposition : Esther Ferrer, Un minuto más (Une minute de plus). Frac Franche-Comté, 2024
© Adagp, Paris 2024. Photo : Blaise Adilon
77
La Ribot (avec Piera Bellato, Mathilde Invernon et Lisa Laurent), Pièce distinguée N°54, 2020. Vue de l’exposition : La Ribot, Attention, on danse ! Frac Franche-Comté, 2024 © La Ribot. Photo : Blaise Adilon
L’EMPIRE DES SONS
Par Nathalie Bach
OUWA, FICTION SONORE GÉOLOCALISÉE PROPOSÉE PAR
GAËTAN GROMER, COMPOSITEUR ET DIRECTEUR ARTISTIQUE
DES ENSEMBLES 2.2, CAPTE LE MONDE AUTREMENT.
PEUT-ÊTRE COMME NOUS EN RÊVIONS SANS LE SAVOIR.
 © Matëo Granger
© Matëo Granger
La conscience d’un langage qui soit autre que celui de l’être humain est assez récente en Occident.
Oui, d’ailleurs le projet OUWA est né avec l’autrice luvan en plein confinement, avec l’ambiance dont on se souvient. Elle qui écrit de l’anticipation n’avait pas envie d’écrire une dystopie. D’ailleurs, sa maison d’édition trouve que c’est devenu plus subversif de parler d’utopie que de dystopie parce qu’on vit en dystopie. Il y a eu le mouvement Solarpunk où déjà était imaginé un avenir postapocalyptique un peu plus sympa. Et puis j’ai lu une nouvelle de luvan (qui est aussi traductrice) dont l’idée est géniale. Elle part du principe que par exemple, à l’instar d’un mot comme umami en japonais, difficilement traduisible en français sans en faire une phrase pour l’expliquer,
78
les humains auraient intégré à leur langage des mots qui viennent des plantes et qu’on ne peut pas expliquer par un mot humain. Il a fallu imaginer une poésie des plantes et un langage interespèces.
luvan fait partie du collectif Zanzibar, pour lequel, entre autres, il est important de « désincarcérer le futur ».
C’est un collectif avec lequel nous désirons continuer à travailler ces prochaines années. Il est vital d’imaginer des futurs différents, de nous sortir du tout technologique qu’on nous vend à longueur de journée, ou « techno-critique » comme dirait Alain Damasio. Dans OUWA, nous sommes dans un futur très lointain où les humains sont partis vivre en orbite pour que la Terre puisse se régénérer. Il y a quelques irréductibles qui ne veulent pas quitter notre planète et mènent une vie plus tribale, comme peuvent vivre les aborigènes aujourd’hui, donc très en lien avec la nature. Et de temps en temps il y a des orbitaux qui descendent visiter la terre. OUWA, en langue indigène, est donc le nom donné au Territoire de Belfort. Ce qui est proposé est une sorte de visite guidée par des chantres (incarnés par des comédiens) qui traduisent le son des plantes en poésie humaine. Le travail de son d’Antoine Spindler et moi-même a été d’inventer une musique des plantes. Au bord de l’étang des Forges, dans des zones d’hypersynesthésie apparaissent des poèmes, des textes, rendus audibles par des moyens de géolocalisation. C’est un parcours sonore spécifique, comparable à une fiction radiophonique créée sur mesure pour un territoire donné. Il suffit de télécharger l’application GOH, gratuite, sur son smartphone. Et si les parcours sont téléchargés à l’avance, on peut tout à fait les écouter en mode hors-connexion.
Comme l’exploration d’un monde quantique ?
En tous cas, quelque chose qui dépasse totalement la dimension humaine et son visible. On pourra entendre ce que dira par exemple un saule pourpre, et toute une série de choses qui appartiennent à un glossaire peu banal.
Peut-on dire qu’ OUWA fait partie du domaine de la science-fiction, mais dans le sens où il est possible de se servir de cette littérature sur le terrain social ?
Oui, nous sommes diamétralement à l’opposé de Star Wars ! Il s’agit surtout de s’extraire du présent pour mieux en parler. Chez luvan, il y a aussi une réflexion forte sur la place de la femme. D’ailleurs, même si j’étais allié avant, le fait d’avoir eu mes deux filles a creusé cette question chez moi. Mais tout le travail des Ensembles 2.2 est de toute façon
— Rencontrer l’art a changé ma vie, mais en parler en dehors d’un circuit fermé aussi, la sensibilité est partout . —
éminemment politique. On ne fait pas de l’art dans l’espace public par hasard, ce qui est vraiment notre particularité, sinon on serait restés au théâtre. J’adore le plateau, j’en viens, mais ce qui m’a donné envie d’un ailleurs, c’est un public qui n’est peutêtre pas déjà acquis à la cause, je veux dire qui ne reste pas entre bourgeois éduqués, moi j’ai envie d’aller vers tout le monde. Rencontrer l’art a changé ma vie, mais en parler en dehors d’un circuit fermé aussi, la sensibilité est partout. Traverser les grandes questions et faire culture ensemble est la base du projet. Il y a aussi bien sûr un propos écologiste évident, mais sans agressions et sans ordres, ce qui n’empêche pas d’interroger l’écologie radicale dont on sait qu’elle est bien plus facile pour un bourgeois que pour quelqu’un qui galère à finir ses fins de mois. L’idée est de faire de l’art tout en étant dans le réel, ce qui ne veut pas dire qu’on déguise la politique en art.
— OUWA, parcours sonore à partir du 18 juin autour de l’étang des Forges à Belfort, dans le cadre de l’exposition « Dans la nature, rencontres sonores et visuelles » à l’Espace multimédia Gantner www.espacemultimediagantner.cg90.net
79
UNE CHAMBRE VERTE
Par Clément Willer
« CETTE EXPOSITION PERSONNELLE, C’EST COMME UN LIVRE, AVEC UN DÉBUT, UNE FIN, DES CHAPITRES », CONFIE L’ARTISTE MAROCAIN
YOUNES RAHMOUN, À L’ORÉE DE SON
l’attention, une plongée dans un état de rêverie spirituelle. Hajar-Dahab (Pierre-Or), l’œuvre qui ouvre l’exposition, invite à sa manière à ce ralentissement. Posé sur un modeste tabouret de bois se trouve un panier tressé, qui vient du Maroc, où vit et travaille Younes Rahmoun. On ne verra ce qu’il contient que si l’on s’approche et que l’on se penche délicatement : quelques morceaux de charbon récoltés en Belgique, et quelques pierres, dont l’une est peinte à la feuille d’or. Avec la discrétion qui lui est propre, l’artiste laisse entendre que cette pierre est pour lui l’image d’un être qui parviendrait à convertir les dimensions les plus sombres de l’existence pour « donner de la lumière » malgré tout.
Avec ses murs rouges où sont tracées à la craie des silhouettes de montagnes lointaines, la salle suivante est imprégnée d’un calme chaleureux. Son vaste espace gravite autour d’une œuvre intrigante, nommée Zahra-Tal (Fleur-Colline), reproduisant une petite colline où poussent des végétaux de la région, où vivent quelques insectes, où la lumière d’été se faufile avec grâce. Ce dont Younes Rahmoun cherche à donner l’idée ou le sentiment, c’est une forme de coexistence harmonieuse : « Les plantes savent très bien vivre ensemble », dit-il. Leurs racines se connectent, leurs feuilles s’entrelacent : ainsi finissent-elles toujours par former d’ellesmêmes une harmonie sans cesse mouvante.
C’est un livre, mais c’est en même temps un labyrinthe, où de nouveaux chemins s’ouvrent chaque fois qu’on prononce certains mots magiques venus de l’enfance : Zahra (Fleur), Jabal (Montagne), Hajar (Pierre), Darra (Atome), Ghorfa (Chambre).
Si « Darra-Zahra-Jabal » se parcourt comme un livre, il m’a semblé que c’est d’abord parce qu’elle laisse se produire une sorte de ralentissement de
Après avoir médité en faisant quelques pas autour de cette colline, on pourra, dans la salle suivante, s’arrêter devant la série de dessins intitulée Ghorfa, Al-Âna/Hunâ (Chambre, Maintenant, Ici). Ces dessins cherchent à ressaisir l’esprit d’un des lieux qui fut d’une très grande importance pour l’artiste, dont parlent nombre de ses œuvres : la petite chambre-atelier qu’il a occupée sous les escaliers, chez ses parents, lorsqu’il était étudiant aux BeauxArts de Tétouan. Sur un de ces dessins, très beau, elle est entièrement colorée de vert. Le vert, c’est la couleur de ce paradis dont on rêve dans l’enfance, de ce lieu ardemment espéré qu’on ne cesse pas de chercher au-devant de soi tout au long de sa vie, alors qu’il se trouve peut-être finalement en soi, enfoui au fond de soi… À l’image de cette petite chambre scrupuleusement reproduite sur plusieurs dessins, avec sa table de dessin, sa modeste bibliothèque, chambre qui pour Younes Rahmoun dispense encore sa lumière, ici et maintenant.
— DARRA-ZAHRA-JABAL, exposition jusqu’au 27 octobre à la Kunsthalle de Mulhouse, à Mulhouse kunsthallemulhouse.com
DARRA-ZAHRA-JABAL, À LA KUNSTHALLE DE MULHOUSE. 80
EXPOSITION

Younes Rahmoun, Ghorfa, al-Âna/Hunâ 1, 2006

BPM 2024, DES IMAGES QUI FONT MONDE(S)
82
Par Nicolas Bézard ~ Photo : Benoît Linder
DIRECTRICE
ARTISTIQUE ET FIGURE DE PROUE D’UN
ÉVÉNEMENT DONT LE RAYONNEMENT EN FRANCE ET À
L’ÉTRANGER
NE CESSE DE S’ACCROÎTRE, ANNE IMMELÉ
VIENT ICI NOUS PARLER DE LA SIXIÈME ITÉRATION DE
LA BIENNALE DE LA PHOTOGRAPHIE DE MULHOUSE, COMME UNE INVITATION À PENSER ET À RÊVER DES
MONDES IMPOSSIBLES.
Voici un intitulé – Mondes Impossibles – qui s’inscrit dans une continuité thématique avec Corps Célestes (2022) et This is the end (2020). Absolument. Mondes Impossibles prolonge et approfondit des sujets portés par la biennale lors des deux éditions précédentes, pour ajouter un nouveau volet à ce qui compose une trilogie. À l’origine de ce titre, il y a des livres qui m’ont accompagnée ces dernières années et qui ont nourri la préparation des dernières éditions : La vie des plantes : une métaphysique du mélange d’Emanuele Coccia, Le champignon de la fin du monde : sur la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme d’Anna Tsing, Vivre avec le trouble de Donna Haraway. Ces ouvrages prennent le point de vue du vivant. Ils disent l’urgence qu’il y aurait à changer nos modes de vie à l’ère de l’anthropocène, et parmi les nombreuses idées développées dans leurs pages, j’aime particulièrement celle de la connexion, de l’interaction de l’humain avec ce qui l’environne. Par exemple, Emanuele Coccia constate que les plantes ont modifié la structure métaphysique du monde. Selon lui, c’est aux plantes qu’il faut demander ce qu’est le monde, car ce sont elles qui « font monde ». J’ai aussi trouvé cette notion de mondes impossibles en me référant à celle, chère à Jean-Christophe Bailly, d’ Umwelt , un concept forgé au tout départ par le biologiste allemand Jakob von Uexküll. Nous vivons dans les limites du monde que nous pouvons percevoir. D’une certaine manière, ce que nous ne voyons pas ne fait pas partie de notre univers. Mais dans sa propension aveugle à l’industrialiser, l’humanité a rendu le monde impossible à vivre pour de nombreuses espèces. L’éco-anxieté est un phénomène bien réel. Nous sommes dans une sorte d’urgence existentielle qui appelle cette prise de conscience relative à ce monde ou à ces mondes devenus impossibles. Car à l’image de l’insecte, de son point de vue restreint étudié par Jakob von Uexküll,
l’humain ne peut saisir le monde qu’à partir de ses propres outils de perception, qui sont eux aussi limités. Parmi ces outils, il y a l’œil, mais il y a aussi l’œil augmenté, via l’appareil photo, permettant de repousser les frontières de notre vision. Dès lors, de l’appréhension de l’environnement par nos sens à la perception du monde par la photographie, il n’y a qu’un pas ouvrant sur une infinité de mondes impossibles, d’où l’intitulé de cette édition 2024.
Alors que les deux précédentes occurrences de la Biennale s’intéressaient particulièrement au monde minéral, l’accent est mis cette année sur le végétal.
Les enjeux qui concernent le monde végétal tissent en effet une sorte de fil conducteur. On les retrouve dans les expositions thannoises de Terri Weifenbach et Vanessa Cowling, mais aussi dans l’exposition au musée des Beaux-Arts de Mulhouse. J’ajoute que ces questionnements s’inscrivent dans le contexte d’une civilisation postindustrielle en train d’émerger. Cette conscience que nous sommes en train de vivre aujourd’hui dans les ruines du capitalisme sera active dans nombre des travaux photographiques exposés. C’est un des axes privilégiés par l’exposition collective PEP (Photographic Exploration Project), initiée par Bénédicte Blondeau. Une exposition qui a fait l’objet d’un open call international et qui concentre tous les thèmes soulevés par la BPM cette année, notamment cette question du capitalisme extractiviste présente chez le photographe allemand Felix Lampe. Ce dernier s’est interrogé sur le devenir des mines de charbon dans son pays. Dans le même ordre d’idée, la Suissesse Lisa Mazenauer a travaillé à partir des archives laissées par son grand-père, engagé dans un projet d’exploitation d’une mine d’or au Zaïre, tandis que Maximiliano Tineo a photographié une mine d’argent en Bolivie. Ces propositions puisent
83

dans l’approche documentaire ou le recours à des archives pour traiter d’un enjeu transversal dans notre festival. Nous le retrouvons aussi dans l’exposition pensée par Sonia Voss, commissaire invitée, qui mettra à l’honneur, aux côtés de Léa Habourdin, le photographe lituanien Andrej Polukord dont le regard porte sur l’exploitation de la forêt dans son pays, mais aussi en Suède.
Cette édition interroge la manière de regarder la nature, de s’y ressourcer, mais également de l’exploiter et donc de la menacer. Quelle est la spécificité de la photographie lorsqu’elle s’empare de ces sujets ? Elle est multiple. La photographie peut être notamment utilisée comme un instrument permettant d’approfondir notre connaissance du vivant. Au contraire, elle peut servir à glorifier l’industrie, comme dans les images du photographe allemand Paul Wolff, né à Mulhouse à la fin du xixe siècle, et dont Michaël Guggenbuhl retrace le parcours dans une exposition à la bibliothèque Grand’Rue, en lien avec la question de l’image éditée. Dans l’exposition « those eyes – these eyes – they fade » présentée au musée des Beaux-Arts, la photographie est utilisée d’une manière sensiblement différente, dans une forme de remise en question de l’objectivité photographique. Au lieu de s’en servir comme moyen de clarifier les choses, ou de donner l’illusion que par son biais, on les connaîtrait mieux, la photographie va au contraire les obscurcir, les mettre en doute, et j’aime particulièrement cette façon d’interpeller l’usage du médium en lui-même.
En parlant de doute relatif à l’usage du médium photographique, on observe depuis deux années un recours de plus en plus massif à l’intelligence artificielle dans les processus de création des images. Comment, en tant qu’artiste, enseignante et directrice artistique d’un festival photo, perçois-tu cette tendance ? As-tu souhaité l’intégrer dans la programmation, sachant que les IA génèrent une confusion entre réalité et fiction, ce qui est de l’ordre du possible et ce qui relève de l’impossible ?
Pour moi, cette bascule entre le monde réel et une dimension fictionnelle est déjà présente depuis fort longtemps avec l’usage dit classique de la photographie. Je pense même que cette question de la véracité de la photographie existe depuis l’invention de la photo elle-même. Même la pratique argentique sous sa forme la plus minimaliste, avec un boîtier simple et un objectif qui ne déforme pas la vision humaine, permet de créer des images très ambiguës, déjà porteuses d’une charge d’étrangeté, d’imaginaire. Il est évident que plus on a d’outils technologiques à notre disposition, et plus on décuple les possibilités de trouble entre réalité et fiction. Pour ce qui est de l’intelligence artificielle, je préfère garder une certaine retenue, à cause de l’effet de mode que cette nouveauté suscite. L’IA peut sans nul doute produire des images intéressantes, je dirais que tout dépend du contexte dans lequel on l’emploie. À ce sujet, il y aura une photographie assez déterminante qui sera montrée dans l’exposition « PEP », générée à l’aide d’une IA, et qui nous met au contact d’un temps futur où l’organique serait hybridé avec la machine. Néanmoins, ce qui a compté pour nous dans le choix de cette image n’est pas le fait qu’elle ait été créée à l’aide d’un algorithme, mais bien ce qu’elle disait, ce qu’elle racontait d’un état possible de notre monde, où d’un côté la technologie a tendance à nous couper de nos origines biologiques, et où de l’autre nous ne pourrions exister si d’autres organismes vivants ne dépérissaient pas. Tout cela bouscule nos regards, nos conceptions du présent, nos projections dans l’avenir.
Tu es commissaire de l’exposition collective au musée des Beaux-Arts de Mulhouse. On y retrouve, aux côtés de photographes qui exposent pour la première fois dans le cadre de la biennale, des artistes qui ont une histoire particulière avec le festival, tels que Bénédicte Blondeau, Bernard Plossu ou Raymond Meeks.
En tant que biennale photographique, nous nous sommes questionnés sur ce qui faisait notre spécificité. Pourquoi met-on en place ce festival ? Qu’a-t-il de singulier ? Je crois qu’une
84
Awoiska van der Molen, Raymond Meeks, 2017. Exposition au musée des Beaux-Arts.
des réponses à apporter est de dire que nous portons ici des pratiques liées à des manières poétiques d’habiter le monde, tout en demeurant sensibles à un renouvellement constant d’artistes, de commissaires, de sensibilités. Le but n’est pas de rester en vase clos, avec toujours les mêmes interlocuteurs au sein d’une communauté étanche. Néanmoins, nous avons à cœur de défendre une idée de la photographie qui ne cherche pas à tout prix la production d’effets spectaculaires, pour au contraire intégrer les notions de discrétion, de fragilité, de contingence, à son modus operandi . L’œuvre de Bernard Plossu, présente dans la biennale depuis 2012 et dont un aspect sera mis à nouveau en lumière cette année au musée, est emblématique de cela. La biennale ne pourrait pas non plus exister sans la communauté artistique et culturelle qui la porte à l’échelle de la ville de Mulhouse. Le festival se fait avec ces énergies locales, je pense aux éditions Médiapop qui nous accompagnent depuis le début, mais aussi à tous ces lieux partenaires qui nous suivent à chaque nouvelle édition. Ces fidélités multiples font aussi partie de ce que nous sommes.
Il y a donc l’idée de créer une émulation, un dialogue entre des personnes qui partagent la même exigence dans leurs visions, parfois éloignées, de la photographie.
En effet, nous nous devons d’être un lieu où les artistes rencontrent le public, mais aussi d’autres photographes, quels que soient leurs nationalités, leurs approches, leurs usages du médium. Beaucoup se sont connus grâce à la biennale et continuent de dialoguer aujourd’hui. Nous nous inscrivons dans une continuité avec des auteurs qui reviennent régulièrement exposer ou concevoir des expositions chez nous, je pense à Pascal Amoyel, à Thomas Boivin ou à Olivier Kervern. Ils ne seront pas présents cette année, mais je continue d’être proche de leur manière d’utiliser la photographie argentique. Dans cette même communauté d’esprit et de gestes, tu as cité le photographe américain Raymond Meeks, déjà présent lors de l’édition 2020, et qui montrera dans « those eyes » des images produites à la chambre, dans le désert californien. Un travail inédit, radical, minimaliste, qui veut montrer une sorte d’état des choses. Une poétique à la fois sèche, soustractive, et néanmoins lyrique, dans la droite ligne de certains travaux que l’on a pu défendre par le passé.
En regard de cette vision très forte, il me semble que la BPM est soucieuse d’investir tous les champs de la photographie, y compris des approches plus installatives ou conceptuelles.

La biennale a toujours été ouverte à la photo plasticienne. Cette année, nous présentons le travail de la photographe argentine Ingrid Weyland à Hombourg, dans l’espace public. Une photographie en lien avec des problématiques de peinture, de matérialité, de mise en abyme, qui questionne aussi, à sa façon, notre connexion à la nature. Dans cet esprit d’ouverture, Steve Bisson propose à Thann une double programmation de femmes photographes qui s’interrogent sur les représentations du monde végétal, dont une, Vanessa Crowling, travaille sur cette dimension installative dont tu parles. L’idée est de permettre au public de prendre de la hauteur sur les enjeux esthétiques, écologiques et sociétaux actuels. Et l’exposition PEP, qui se tiendra dans un endroit mulhousien nouveau pour nous, symbolique à bien des égards – la Tour de l’Europe –, cristallise bien cela, car elle mêle à la teneur intime de certaines propositions d’autres approches, d’autres directions – documentaires, historiques, hybrides, etc.
Une particularité de la Biennale vient aussi de cette réflexion menée autour des lieux et de leur réinvestissement par et pour la photographie. À chaque fois, j’ai l’impression qu’il existe une vraie volonté de questionner l’espace en fonction de ce qu’on va y montrer, de transformer le lieu en un autre lieu possible.
Comme tu l’as très bien dit, chaque exposition est pensée par et pour le lieu qui l’accueille. À Thann, Fixing the Shadows de Vanessa Cowling transforme la perception de l’espace de la mairie en une expérience perceptive, avec à l’intérieur un jardin suspendu composé de centaines de phytogrammes, de lumen-prints et d’anthotypes originaux. L’artiste a aussi imaginé une installation translucide sur les vitres de l’édifice. On y voit le ciel d’Afrique du Sud – son pays d’origine – dans une œuvre qui joue sur les variations lumineuses en fonction de
85
© Jason Pinckard, Progeny, 2024. Exposition PEP, Tour de l’Europe.

la lumière extérieure. Pour Cloud Physics, exposé le long du Rangen, les photographies de Terri Weifenbach ont été spécifiquement choisies pour entrer en résonance avec la rivière, les arbres et les vignes environnantes. Ainsi, nos commissaires invités ont entamé un long processus de réflexion sur l’exposition en rapport avec son environnement. Steve Bisson, par exemple, s’est rendu plusieurs fois à Thann pour visiter et s’approprier le site. Pour comprendre ses origines et son évolution également, en visitant le musée historique de la ville, avant d’aboutir aux choix des deux photographes retenus. Ce temps a été mis à profit pour imaginer diverses modalités d’intervention dans ces espaces, avant de trouver les artistes et les œuvres qui s’y inscriraient le mieux. Cela montre l’importance de ce travail de programmation dont bien souvent le public ne soupçonne pas la complexité.
Le festival avait traditionnellement lieu pendant l’été, chevauchant notamment Les Rencontres d’Arles. Il se compose désormais d’un prélude débutant en juin à Thann, puis d’un acte majeur à partir de septembre. Pourquoi ces changements de calendrier ?
Il y a différentes raisons à cela. Ce nouveau positionnement à la rentrée nous permet de profiter de l’énergie qu’il y a toujours à cette époque de l’année. Nous l’avions testé un peu malgré nous en 2020, dans le contexte de la pandémie, et cela avait été une expérience positive. Septembre nous permet aussi d’attirer davantage le public scolaire, une dimension pédagogique qui se perdait un peu lorsque nous commencions à la mi-juin. Si une majorité d’expositions se tient à Mulhouse et ses environs, nous avons conservé l’idée d’une première phase à Thann dès le mois de juin avec les belles propositions de Vanessa Cowling et de Terri Weifenbach. C’est le premier temps fort, celui qui donne un avant-goût de la totalité du festival. Du fait de la présence d’un parcours photographique en extérieur au bord de la Thur, il nous semblait important de le maintenir en été. La grande nouveauté cette année concerne les partenariats que nous avons noués avec d’autres festivals de photographie, en Suisse avec les Journées photographiques de Bienne et Alt+1000, en France avec la ville de Montpellier et le Pavillon populaire, qui nous confie les tirages de l’exposition Paul Wolff. Nous avons aussi ces coopérations importantes avec PEP et la Biennale d’art contemporain de Malte, dont la première édition prend forme cette année.
Le lien avec Malte est multiple, puisque « those eyes » est le prolongement d’une exposition que tu as initiée sur cette île en 2022, sous une autre forme, mais avec les mêmes artistes. Malte qui est aussi au cœur de ton travail photographique le plus récent, comme paysage tellurique, espace de projection métaphysique, berceau d’une histoire antique, et bien sûr, de par son positionnement central en Méditerranée, théâtre d’une tragédie, qui est celle des migrants. Ces personnes risquent leurs vies dans l’espoir d’une vie meilleure, d’un bonheur possible, après avoir quitté un monde devenu lui « impossible ». La programmation de cette année s’en fait-elle l’écho ?
Pas de manière directe, je dirais, mais c’est une question qui me tient évidemment à cœur, un enjeu de société essentiel. S’il n’est pas abordé cette année, il le sera assurément dans le futur de notre manifestation.
Puisque nous parlons de projection dans l’avenir, comment envisages-tu l’évolution de la BPM dans les prochaines années ?
Ma première envie serait de confirmer cette dimension internationale du festival en développant les résidences ouvertes aux photographes étrangers. J’aimerais aller aussi vers davantage de médiation à travers des actions de médiations de type workshop ou atelier de sensibilisation du public à la photographie. Un autre souhait, enfin, serait d’avoir plus d’expositions hors des frontières de Mulhouse, voire de la France, via un système d’échanges et de prêts avec des institutions ou manifestations partenaires. C’est envisageable à la condition de produire nous-mêmes des expositions, ce que nous avions fait pour celle de Matthew Genitempo en 2022, une série présentée aux Journées photographiques de Bienne en mai de cette année. La BPM est une manifestation résolument ouverte sur le monde et nous œuvrons pour que ses créations, ses artistes phares, puissent voyager et diffuser l’esprit singulier, ce qui a lieu tous les deux ans ici à Mulhouse, depuis plus d’une décennie.
— BPM 2024, MONDES IMPOSSIBLES, biennale du 13 septembre au 13 octobre à Mulhouse, Thann, Hombourg et Fribourg www.biennale-photo-mulhouse.com
© Andrej Polukord, série Wood Statues , 2020en cours. Exposition à La Chapelle Saint Jean. Manifestation organisée dans le cadre de la Saison de la Lituanie en France 2024 et en co-production avec MACMulhouse Art Contemporain. 87
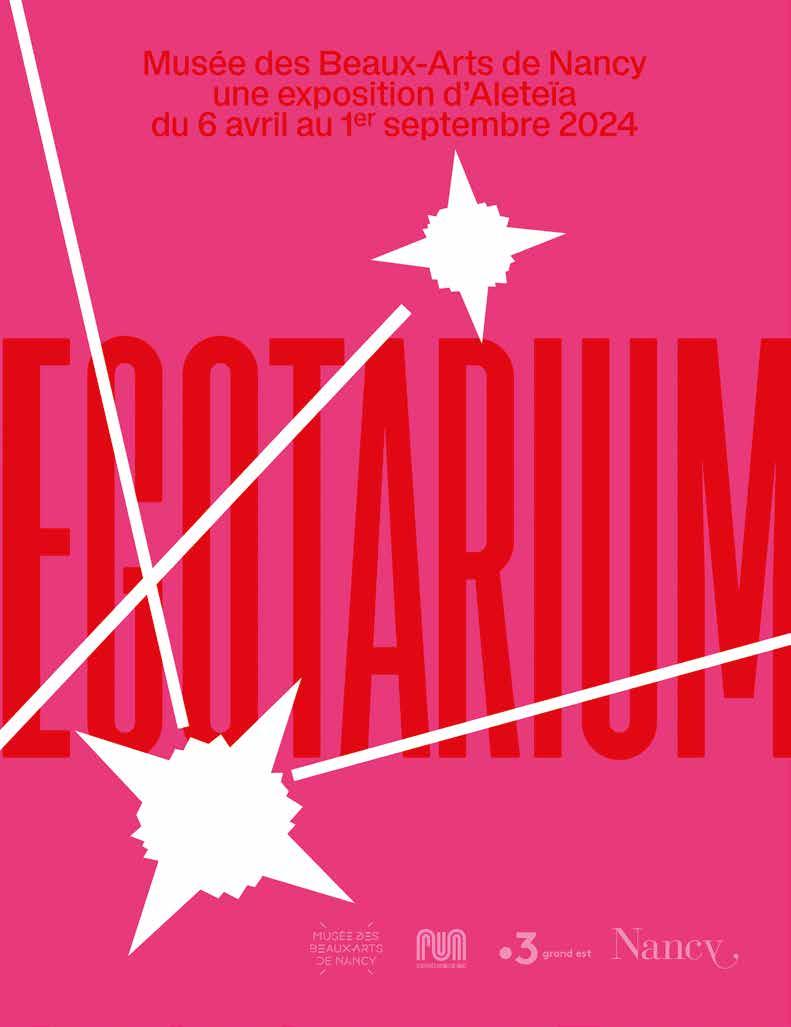
ns - i t u
i

My Last Will
À l’heure de nos dernières volontés, que retiendrons-nous ? Comme un écho à l’actualité morose qui impacte nos perspectives et nos valeurs, « My Last Will » propose à 32 créateurs contemporains de questionner leur héritage. En partant sur les traces d’un avenir inconnu, ils explorent leur histoire familiale, creusent leur individualité, empruntent des voies politiques ou questionnent la mort. Un robot humanoïde, un chant archaïque sur la dangerosité des déchets nucléaires, des fétiches en peau animale ou des portraits engagés façonnés par une IA : de l’individuel à l’universel, chaque artiste convoqué envisage le futur à son échelle. (M.M.S.)
Jusqu’au 8 septembre Au Casino Luxembourg, à Luxembourg www.casino-luxembourg.lu
situ
in
90
My Last Will, Vue de l’exposition au Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain. © Photo : Jessica Theis.
Récits décoloniaux. Faut-il brûler les musées ?
Avec un titre volontairement provocateur, le musée des Beaux-Arts de Nancy et le palais des ducs de Lorraine - Musée lorrain s’interrogent sur le rôle et la légitimité même du musée. Démystifier ce temple de la culture, c’est décortiquer l’histoire des collections, questionner la provenance des œuvres et leur trajectoire. Creuser au-delà du chef d’œuvre. Entre saisies révolutionnaires, spoliations nazies et blessures coloniales, les dessins, peintures et objets d’art convoqués permettent d’évoquer diverses formes de domination et de violence. Une exposition dossier qui pose des questions essentielles et un regard critique sur l’héritage parfois trouble de nos institutions culturelles. (M.M.S.)
Du 28 juin au 30 mai 2025
Au musée des Beaux-Arts de Nancy, à Nancy musee-des-beaux-arts.nancy.fr

in situ
D’après Georges de La Tour, Le Souffleur à la pipe. © Nancy, palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain, photo M. Bourguet.
91
Luca Bertolo, l’hésitation
Il n’y a rien de plus attachant que les gens qui doutent. L’artiste italien Lucas Bertolo a placé l’hésitation au cœur de son travail pictural. Non finito évocateurs, gestes suspendus, taches et coulures intrépides trahissent la fébrilité de son pinceau, volontiers expressionniste. Avec cette exposition monographique, le CEAAC explore vingt années de création à tâtons. Pour compléter ce panorama peint, une seconde exposition, montée dans un ancien atelier d’artiste à Meisenthal, s’attardera sur un autre pan créatif de l’artiste : ses dessins et photographies. (M.M.S.)
Du 15 juin au 8 septembre Au CEEAC, à Strasbourg et à Atelier Meisenthal, à Meisenthal www.ceaac.org

in situ
Luca Bertolo, Tramonto in un bosco di betulle. Photo : Camilla Maria Santini. Autorisation de l’artiste et SpazioA, Pistoia.
92

Oreille coupée –Julien Coquentin
Entre conte photographique et enquête sociologique, Julien Coquentin saisit les mystères des sous-bois et les réalités de la vie rurale. Oreille coupée documente en images le retour du loup dans les forêts du Massif central et le cortège de représentations qui l’accompagne. Alternant portraits au réalisme criant, paysages sublimes et instantanés d’animaux sauvages, il confronte la réalité des habitants, la beauté indomptable des grands espaces et le discret ballet de la faune qui y vit. Parfois, le loup y pointe le bout de son oreille. (M.M.S.)
Du 29 juin au 1er septembre À la Chambre, à Strasbourg www.la-chambre.org
in situ
Oreille coupée, 2020-2023 © Julien Coquentin
93

Frisbee ! Sport et Loisirs. Collection Würth
Les lignes sont nonchalantes, douces. Les formes s’entremêlent dans une composition au calme contagieux : ici, un vélo enfourché. Là, une femme allongée, un enfant sur les épaules ou un homme qui, discrètement, ajuste son col. C’est un dessin à l’encre de Chine de Fernand Léger, récemment acquis par la Collection Würth, qui sert de point de départ à l’exposition « Frisbee ! Sport et Loisirs ». De la flânerie du dimanche à l’intensité des sports de haut niveau, elle mêle corps affutés et âmes vagabondes, impassibles boxeurs et campeurs franchouillards. Un parcours d’une grande variété à l’occasion duquel Andy Warhol, Camille Pissarro ou encore Donna Stolz s’emmêlent joyeusement les pinceaux. (M.M.S.)
Jusqu’au 15 septembre, Au musée Würth, à Erstein www.musee-wurth.fr
in situ
Fernand Léger, Les Loisirs, 1944, Collection Würth. Photo Jakob Jägli-Schmelz © ADAGP, 2024.
94
Aqua Terra
Cet été, les éléments trouvent un point de convergence à la Fondation François Schneider. Entre terre et mer, une centaine de céramistes contemporains explorent le monde aquatique et ses nuances. Icebergs sculpturaux, couleurs balnéaires, trésors des abysses et bouteilles à la mer rythment la traversée d’Aqua Terra. Parmi les œuvres convoquées, notons les élégantes vagues émaillées de Félicien Umbreit, les porcelaines lacustres comme des fanons de Bénédicte Vallet ou les crevettes diaboliques de l’ironique Johan Creten. (M.M.S.)
Jusqu’au 22 septembre
À la Fondation François Schneider, à Wattwiller www.fondationfrancoisschneider.org

in situ
© Agathe Brahami-Ferron
95
Même Mot
Une vieille paire de pompes, la métamorphose d’une brique de lait, les pérégrinations d’une boîte en carton ou le graphisme aléatoire d’une éclaboussure allument le regard de Julia Spínola. Entre bricolage, arte povera et rigueur minimaliste, l’artiste espagnole s’attache au geste créatif sous toutes ses formes. « Même Mot » invite tout un chacun à se frotter aux œuvres pour en découvrir la langue, à déconstruire ses perceptions pour mieux voir ce qui se cache derrière la représentation. Avec une simplicité de moyens manifeste, Spínola transfigure les objets qui nous entourent et sème le doute des apparences. (M.M.S.)
Du 13 juin au 15 septembre Au Crac Alsace, à Altkirch www.cracalsace.com


Un cocktail peut-il être le point de départ d’une exposition d’art contemporain ? La Fondation Fernet-Branca dit trois fois oui ! Et qu’importe la boisson, pourvu qu’il y ait l’ivresse. Celle, irrésistible, qui s’empare de l’institution ludovicienne pour sa réouverture après plusieurs mois de réfection. Placée sous le signe de la joie, cette exposition inaugurale célèbre également les 20 ans de la Fondation. C’est avec l’allégresse des jours de fête que « Splendore » se promène du côté des rêves, emprunte les sentiers de l’inconscient, court après d’évanescentes visions et traque les lumières de nos nuits d’insomnie. (M.M.S.)
Jusqu’au 7 juillet à la Fondation Fernet-Branca, à Saint-Louis www.fondationfernet-branca.org
in
situ
Julia Spínola, Rojamente #3, 2022. Autorisation de l’artiste et de la galerie Carreras Múgica.
Geneviève Morin, Sous-couches, 2022. Autorisation de l’artiste.
Splendore – joie, joie, joie…
96

Oro Verde
« Oro Verde » est une exposition photographique du collectif Ritual Inhabitual, qui raconte l’histoire de la ville de Cherán, dans la région mexicaine du Michoacán. En 2011, les femmes de la communauté ont allumé l’étincelle d’un vaste soulèvement populaire, qui est parvenu à renverser le climat de terreur instauré par les narcotrafiquants qui contrôlaient le marché de l’avocat et n’hésitaient pas à décimer pour cela les terres et les forêts de la région. Depuis, la communauté de Cherán a pu renouer son rapport sacré avec la terre. Dialoguant avec ses membres, Ritual Inhabitual en fait le récit photographique, en invoquant trois personnages, à travers trois masques, qui reviennent au fil de l’exposition : l’enfant, le narcotrafiquant, et la guêpe, divinité étrange venue des forêts, qui veille sur Cherán… (C.W)
Jusqu’au 15 septembre
À La Filature de Mulhouse, à Mulhouse www.lafilature.org
in situ
Oro Verde © Ritual Inhabitual
97

Assemble, Blood in the machine
Avec « Blood in the Machine », Le 19 emprunte les voies de son passé industriel et en explore les diverses facettes. Pour l’occasion, ce sont les touche-à-tout du collectif londonien Assemble qui s’emparent des lieux. Mêlant design, architecture et histoire, ils proposent une exposition participative qui prend les contours d’une expérience sociale. À partir du patrimoine et de l’étude des ressources sociales, culturelles et économiques de Montbéliard, ils scénographient une réflexion critique et imaginative sur l’avenir de la ville et du territoire. (M.M.S.)
Jusqu’au 25 août Au 19, Crac à Montbéliard www.le19crac.com
in situ
Assemble, The Rules of Production, 2019 ©Assemble
98
Dessine-moi ta planète
Une carlingue d’avion prête à décoller, un boa géant, un parterre de roses capricieuses et quelques astéroïdes… Il n’en faut pas plus pour évoquer la poésie légendaire d’Antoine de Saint-Exupéry. Son Petit Prince s’est posé entre les épaisses murailles de la Citadelle de Besançon qui propose une relecture écologique de ses aventures. En douze étapes, le parcours évoque les mystères du cycle de l’eau, l’indispensable préservation de la biodiversité, la ronde des planètes et de l’infiniment lointain. Cabinet de curiosité, installations artistiques, lieux de rencontre ou de contemplation : la scénographie, interactive et pédagogique, est signée par le Muséum d’histoire naturelle de Besançon et la Maison Deyrolle en partenariat avec la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse. (M.M.S.)
Jusqu’au 3 novembre
À la Citadelle de Besançon, à Besançon www.citadelle.com

in situ
Dessine-moi ta planète © Adrien Crucet
99
COLOSSES.
Lutteurs, culturistes et costauds dans les arts
Chaque été, fit-girls et autres Apollons 2.0 nous vendent les contours d’un summer body plus affuté que jamais. C’est donc à point nommé, et dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques que le musée Gustave-Courbet revient sur le motif des lutteurs dans l’histoire de l’art. De l’impassible statuaire antique à la représentation moderne des costauds, le musée aborde un pan méconnu de la culture visuelle du tournant du xxe siècle. Entre affiches musclées, biceps d’airain, culturisme artistique et beauté plastique, COLOSSES offre un corps-à-corps frappant avec les œuvres de Gustave Courbet, Honoré Daumier, Gustave Courtois et bien d’autres… (M.M.S.)
Jusqu’au 13 octobre, Au musée départemental Gustave-Courbet, à Ornans www.musee-courbet.fr

in situ
100
Anonyme, Edmond Desbonnet de dos, n.d., collection Christian Gaildraud © Christian Gaildraud

Mika Rottenberg, Antimatter Factory
En mixant absurdités capitalistes et créativité débridée, Mika Rottenberg nous ouvre les portes d’un véritable labyrinthe mental, saturé de couleurs et de références. Éternuements intempestifs, cascades capillaires ou plongée cosmique dans l’antimatière ponctuent le voyage visuel dans sa « factory » imaginaire. Au fil de ses vidéos et installations, l’artiste argentine manie un surréalisme social foisonnant qui tacle volontiers la sacro-sainte productivité industrielle et se moque avec allant de nos mythes contemporains. (M.M.S.)
Jusqu’au 3 novembre Au musée Tinguely, à Bâle www.tinguely.ch
in situ
Mika Rottenberg, Cosmic Generator, 2017. Autorisation de l’artiste et Hauser & Wirth / Commande de Skulptur Projekte Münster.
101

Folie passagère
Nicolas Comment passe entre les gouttes, Stéphanie-Lucie Mathern s’aventure chez Peter Ulrich, Myriam Mechita fait le ménage, Dominique Falkner cite Donald Trump, Emmanuel Abela rend hommage à Frank Darcel, Martin Möller-Smejkal dépoussière l’Histoire, Jean-Luc Wertenschlag pogote au fond de la vallée, Nathalie Bach se brûle, et Claude De Barros cabriole.
FEUILLE DE ROUTES
Par Nicolas Comment
UNE PROMENADE AVEC GÉRARD MANSET AU DOMAINE DE SAINT-CLOUD,
UN RENDEZ-VOUS AVEC THEO HAKOLA AU PIED DE LA BUTTE MONTMARTRE ET LA VISITE DU MYTHIQUE CHÂTEAU D’HÉROUVILLE.


4 avril 2024
Une fois n’est pas coutume, Gérard Manset m’a demandé de réaliser un « reportage » pour Paris Match. Et me voici embarqué avec lui dans la voiture d’un journaliste depuis l’habitacle de laquelle Gérard nous guide sur les lieux de son enfance à Saint-Cloud. À travers le pare-brise, je photographie à la volée le modeste et pourtant flamboyant immeuble de brique rouge où Manset vécut sa prime enfance, son école maternelle, une statue de Charles Gounod, et même la grille bleue de la maison où il aurait (dit-il) « fait l’amour pour la première fois »…
Nous déjeunons ensuite au Stade français, où le chanteur à décidé de donner son interview. J’y assiste muet en l’écoutant distraitement : Manset y parle essentiellement de peinture et des Nabis dont une amie de sa mère fut l’intime et mécène. Après le déjeuner, Gérard prend congé du journaliste en déclarant, aristocratiquement : « Cher ami, vous pouvez disposer. Maintenant, nous allons aller nous promener avec Nico pour réaliser les images de notre “reportage”. »
Ce fut une belle journée, les averses menaçaient mais nous sommes passés entre les gouttes. La longue promenade dans le vaste parc de SaintCloud fomentée par Manset fut un de ces moments qui restent. On ne sait jamais pourquoi ils restent ces moments suspendus comme un badge sur une veste, un caméléon sur un tee-shirt de coton. Ewt la balade dura :
Au fur et à mesure que nous avancions sur la grande allée de La Marne, les écureuils et les lapins fuyaient dans les bosquets. Moi, j’observais la veste militaire que portait Gérard – tout spécialement achetée pour les besoins du « reportage » (la semaine précédente ; aux puces de Clignancourt) – se modifier sous la frondaison des hauts frênes. Les reflets sur son dos, comme dans une vidéo IA, peu à peu se métamorphosaient en d’élégants brocarts.
Sur le parterre des 24 jets, Gérard fit bientôt claquer une canne à pommeau d’argent, dont la sphère renvoyait de tout petits éclairs sur ses chausses de soie grise et ses souliers de satin. Tout à coup, j’étais avec Honoré d’Urfé. J’étais avec Ronsard, le cul posé sur un bloc de pierre moussue. Non loin du restaurant Brumaire (fermé), nous nous assîmes sur le socle d’une Vénus pour reprendre notre souffle.
104
Allée des Statues, domaine national de Saint-Cloud, avril 2024.
ÉTAPE 5 : MANSET, HAKOLA ET LE CHÂTEAU D’HÉROUVILLE
POUR NOVO, NICOLAS COMMENT ENTREOUVRE LES PAGES HUMIDES DE SON JOURNAL D’UN PRINTEMPS PLUVIEUX ET NOUS PARLE DE SA MANIÈRE DE PASSER ENTRE LES GOUTTES.
Dans l’allée des Statues, Manset ajusta son chapeau à plume d’où débordait, tel les nuages qui assombrissaient le ciel, une perruque à boucles argentées. Avec sa canne gravée à ses initiales, il désigna nonchalamment le bassin de la Cascade puis suivit d’un geste vertical la courbe du Grand Jet. Face au château disparu, dont les ifs taillés en cônes matérialisaient l’ancien plan, je crus bon de l’entretenir de l’état du pays, mais il ne goûta guère aux nouvelles du réel, perdu qu’il était dans ses rêveries et la métempsychose.
J’ai tout photographié de cette « transmutation » mais Match n’a publié au final que des photographies que nous avions réalisées trois ans plus tôt pour la Warner. Il faut ici avouer que ce qui s’est réellement passé cette après-midi-là ne se voit pas sur les images. Ce sont les limites de la photographie : la vérité échappe toujours aux preuves. Nulle trace des Nabis non plus dans le compte rendu de Match. Allez comprendre…
Sur l’ultime plage de L’Algue bleue, Manset conclut son dernier disque par une sorte de comptine, un genre de rondeau sombre, blues de Saint-Cloud : « Nous nous cacherons ensembles / Ni porte ni sortie / Rien qu’un chemin qui nous ressemble / Une trouée dans les orties » Nous nous cacherons ensemble, 2024.
Manset la chante d’une façon un peu hargneuse, comme un clebs vous saisit le bas du pantalon en s’acharnant à vous tirer sur la jambe, pour jouer avec vous. Il secoue nos pattes d’éléphant en répétant, de sa voix de porcelaine fêlée, l’un des plus beaux mots de la langue française : « Oui, oui, oui, oui… » Oui, oui. Gérard Manset au Stade français, avril 2024 © Nicolas Comment.

105
L’horizon est bouché. C’est une campagne sans charme. Un collège de ciment aux escaliers de béton poli. Au sous-sol, un bunker où trône (c’est le mot) une table de ping-pong en contreplaqué. L’univers pénitentiaire de ma préadolescence. Mais, dans ce cadre, dans cette cache, il y a cette pionne sympa et débordée, plantée au milieu des balles et des raquettes qui claquent, habillée tout en noir près d’un babyfoot grinçant et qui nous parle de Joy Division et Trisomie 21. Une pionne gothique, disons ; millésimée 86/87. Alors avec mon pote Tony, on lui explique qu’avec les Woodentops, nous on écoute Passion Fodder. Qu’on écoute même Passion Fodder, avec passion.
Moi j’ai 14, 15 ans et cette chance d’avoir, dans une petite ville de souspréfecture, une mère sous-bibliothécaire. C’est à cause des pochettes.
C’est grâce à l’art de Ricardo Mosner – et à sa figuration libre – que je tire des bacs de la discothèque municipale les disques de Passion Fodder. Observant ce manège de vinyles, quelques mois plus tard, le discothécaire en chef me conseillera d’emprunter le premier EP de Noir Désir sur la seule foi que « c’est Theo Hakola qui l’a produit »...
Il y eut ainsi en France une alternative au rock alternatif (Bérus, Métal Urbain et cie), une réplique sismique à Marquis de Sade et aux Jeunes gens modernes... Non pas un rock français mais un rock de France, tout autant influencé par le krautrock allemand (Neu!, Can, Kraftwerk) – et c’était Kat Onoma – que par le Maghreb, le bled – c’était Carte de séjour – ; l’Irlande (Van Morrison, The Pogues) – c’était (peut-être ?) les Têtes raides – que par le punk New-Yorkais (et le violon de Scarlet Rivera dans le Desire de Dylan) – c’était... Passion Fodder. Pas « pop » : un rock en France, très à distance de la City et non assujetti à la couronne anglaise...
Longtemps plus tard, à Paris, je croiserai régulièrement Theo Hakola, durant une dizaine d’années, sans jamais oser l’aborder. Et puis, tout récemment – coup de théâtre –, à l’anniversaire de Brisa Roché (dont nous partageons tous deux l’amitié), c’est Theo qui vient me parler le premier. Comme je bredouille que nous nous étions déjà croisé, il me rappelle que
la toute première fois était lors d’un backstage de Nick Cave, avec Mick Harvey. Je ne m’en souvenais pas… Theo m’avoue qu’il me surnommait alors ironiquement « Bouclette », se demandant un peu qui était ce frisé qui assistait à certains de ses concerts et discutait parfois dans un coin de la salle avec sa jeune compagne de l’époque...
Toujours est-il que rendez-vous fut prit la semaine suivante pour une séance photo chez lui, à Pigalle, où je pus enfin avouer à cet éternel jeune homme combien il fut et reste un exemple pour moi ; voire même – j’ose ici l’écrire noir sur blanc – un genre de « maître ès punk ».
J’ai pu, depuis, observer que je n’étais pas le seul à le penser… La semaine dernière, au bar Le Chair de Poule où Hakola donnait une « release party » pour fêter la sortie de son impeccable dernier album Shalalalala (Microcultures + Médiapop, 2024), mon ami Éric Simonet (Mouvement) m’expliqua qu’Hakola avait tout simplement « changé sa vie », et qu’il y eut un avant et un après Orchestre Rouge, pour lui. Un quart d’heure plus tard, tandis que je raccompagnais timidement sur le trottoir Theo et Benedicte Villain – sa fidèle violoniste –, le chanteur italo-disco Alex Rossi, passablement déchiré, manqua de s’agenouiller dans le caniveau pour joindre ses deux mains en prière devant Theo. Haussant la voix au fur et à mesure que la haute silhouette de l’Américain de Paris disparaissait dans la nuit de la rue Saint-Maur, Alex répétait, de plus en fort : « Merci, merci, merci ! » Merci, oui.

3 mai 2024
Theo Hakola chez lui, à Paris, le 3 mai 2024 © Nicolas Comment.
Theo Hakola m’ouvrant sa porte, chez lui, à Montmartre, le 3 mai 2024.

Le temps nous est ici compté : il y aurait trop à dire sur le mythique château d’Hérouville-en-Vexin, haut lieu du son en France et premier studio d’enregistrement résidentiel d’Europe – inventé par le génial compositeur Michel Magne – qui abrita sous ses ailes (Nord et Sud) toute la fine fleur du rock anglo-saxon des 70s : de T. Rex à Pink Floyd, d’Elton John à David Bowie, etc. Pour les besoins d’un documentaire d’Arte sur Higelin, j’ai la chance d’y retrouver Diabolo, son merveilleux harmoniciste. En laissant courir (le temps d’une ITW), ma fille de six ans autour du vieux puit où se dresse un arbre extraordinairement noueux, je pense à Zowie, fils de David, qui, dit-on, joua ici avec Ken, le fils de Jacques. Le printemps est enfin là, les fleurs imprimées sur le tissu de la robe d’Unica attirent les papillons... En jetant un coup d’œil vers la piscine verdâtre, j’essaie de situer le carré de gazon exact où Jerry Garcia posa le pied de son micro, le soir du 21 juin 1971, lors d’un mythique concert des Grateful Dead donné dans le parc (et filmé par Pop 2). J’imagine même voir briller sur le gazon le diapré des coupes de champagne dans lesquelles quelques gouttes de LSD avaient été scientifiquement versées pour faire que la fête batte son plein, avec tous les paysans du coin, les flics et les pompiers du village plongeant dans la piscine au petit matin. Je me reconnecte doucement avec un temps de paix et d’utopie, une parenthèse enchantée… À ces souvenirs imaginaires mêlés à la mémoire lointaine de ma petite enfance perdue dans les années 70, accédait-elle un peu aussi, ma fille, en humant le fumet de l’herbe du jardin anglais d’Hérouville ?
Cela dit, comme le domaine national du parc de Saint-Cloud, il fut aussi parfois taillé à la française , le parc du Château d’Hérouville : parmi la quantité d’albums de qualité française enregistrés ici ( Obsolete de Dashiell Hedayat, Heureusement en France on ne se drogue pas d’Alain Z. Kan , Attends de Pierre Vassiliu, Macadam d’Yves Simon, Poèmes rocks de Charlélie Couture, Champagne… d’Higelin) – je tire (pour l’exemple) une seule et unique chanson du chapeau de… Patrick Coutin : « J’aime regarder les filles ».
Seul titre de rock en français que j’entendis jamais en boite, de l’autre côté de l’Atlantique. Et voici pour finir, ce que m’a raconté Patrick lui-même, lors d’une vadrouille à Montpellier, en compagnie de Stan Cuesta : Coutin qui écrivait à l’époque pour Rock & Folk était venu réaliser un « reportage » au château. Laurent Thibault, alors ingénieur en chef du studio, lui expliqua qu’Higelin avait disparu. Jacques qui vivait pourtant à l’année dans la « bergerie » du château (située 100 mètres plus bas), avait déserté les lieux sans prévenir pour rejoindre une blonde dans le sud de la France. La console était resté allumée et clignotait désespérément dans l’ombre. Thibault qui s’ennuyait ferme sous le soleil proposa alors à Coutin d’enregistrer quelque chose. À son tour enfermé dans ce château hanté par les fantômes de Chopin et de George Sand (qui s’aimèrent en ces murs), Coutin pensa à Higelin et à ses potes parisiens descendus dans le Sud sans lui : il improvisa alors les paroles de ce tube où s’exprime toute sa frustration d’être coincé en plein été dans un petit village désert du Vexin, loin de la mer. J’aime regarder les filles qui marchent sur la plage / Les hanches qui balancent et les sourires fugaces...
La réécouter aujourd’hui, c’est comprendre ce que fut hier Hérouville : la basse est tellurique, la fuzz est fabuleuse… Un son de stentor saisit le chanteur à la gorge tandis qu’il nous répète, à son tour inlassablement et en crescendo : « J’aime, J’aime, J’aime ! » Oui, j’aime.

Patrick Coutin, Montpellier, mai 2023
© Nicolas Comment
17 mai 2024
108



 Château d’Hérouville, mai 2024 © Nicolas Comment
Château d’Hérouville, mai 2024 © Nicolas Comment
PETER ULRICH
J’AI FAIT PIPI AVEC UNE MITRAILLETTE
DANS LE DOS
Par Stéphanie-Lucie Mathern ~ Photos : Benoit Linder

« Toute religion est une cristallisation du désir », Feuerbach
Peter Ulrich est un aventurier. Sa mystique côtoie celle des avant-gardes.
Cartier-Bresson alsacien (il le parle encore parfaitement), sa galerie photo fait se côtoyer les femmes fatales et les derviches-tourneurs, les prêtres défroqués et Indira Gandhi – à qui il a été présenté comme « yoga teacher ».
110
La photo, il l’aime au point de collectionner les livres – puis de les revendre – car il faut apprendre à se détacher des choses.
Il affectionne la philosophie orientale, surtout le zen, qui éclaire le problème de la condition humaine et apaise les pensées. Et puis l’Inde, avec la figure de Radha Krishna et l’utopie de Pondichéry. Peter a séjourné en Inde en 1968, après avoir rencontré en pleine Forêt-Noire un maître de yoga, premier hindou à Strasbourg, à qui une baronne allemande a donné un château.
Sa passion des voyages se conjugue avec celle des grandes utopies. Venise en Lambretta, la Suède en Jaguar, URSS année 1965 avec la jeunesse communiste. « Je suis allée au musée Dostoïevski –que j’ai commencé à lire à 17 ans, c’est encore plus beau de ne pas tout comprendre. »
Il a connu les maoïstes et les situationnistes, tout en se tenant à l’écart.
Peter Ulrich garde intacte son indépendance et passe pour un anarchiste.
Il brise tranquillement les portes de la perception, découvre le cri primal, la scientologie, les groupes végétariens et macrobiotiques, le pouvoir d’attraction des faussaires.
Sa mère, une protestante réformée, finira par lui dire « Tu as trahi le Christ » et l’emmènera voir les gitans du Polygone. Pour elle, Rudolf Steiner était Albert Schweitzer. Il a d’ailleurs une photo du Goetheanum de Dornach, image de l’école libre des sciences de l’esprit.
Son père, luthérien, est mort quand il avait six ans. C’était un ancien libraire qui est devenu Malgré-nous, un personnage mythique. Peter Ulrich est né le 4 septembre 1943 et rit du fait d’avoir été allemand pendant deux ans.
Il a grandi à la Robertsau dans un intérieur style chippendale, mobilier anglais du xviii e. Il travaillait au service vieillesse de la Sécurité sociale pour finir photographe d’entreprise.
Ses récits semblent sortis d’un James Bond ou d’un Pierre Loti, et pourtant tout est vrai. On y rencontre la Baronne de Saxe avec des dobermans chez les Templiers, les yeux sont bandés jusqu’à Munich, la police militaire italienne au monastère San Giorgio de Venise, le prince Paléologue à Rouen, une accusation d’espionnage pendant la réunion ultra-secrète de l’OTAN. Peter a réussi à infiltrer les milieux religieux pour saisir les tendances. Garder son esprit libre aura été son mantra.
Dans l’appartement 1904 où nous nous trouvons, sa décoration couple Heidi au Bouddha, des madones à Hansi, un mélange d’art brut et d’objets sacrés du meilleur goût. Il nous dit vouloir

reproduire l’environnement de sa jeunesse. Nous entendons chanter une soprano à l’étage du dessus en buvant du café noir.
Tout est question d’équilibre. Aujourd’hui, il le trouve toujours dans le zen, tout en pouvant regarder CNews. Peter Ulrich ne s’empêche pas et garde l’esprit fraternel.
111
UNE HISTOIRE DE MÉNAGE ET DE NUIT (OU D’INCENDIE)
Par Myriam Mechita

31,47 %… Ce chiffre tourne en boucle, 31,47 % pour l’extrême droite. À l’heure où je vous parle, sans doute que le deuxième tour des élections législatives est bouclé et définitivement acté. Et ce chiffre a été soit explosé par un sursaut socialiste, soit par un sursaut de haine. La France est spécialiste en sursauts à ce qu’il parait. L’énergie du dernier souffle… la dernière convulsion.
« Non, la France n’est pas un pays de haine », m’a-t-on dit. Les Français donnent des leçons, c’est tout… Nous donnons des leçons comme des maîtres d’école menaçant des enfants indisciplinés. Ah, d’accord…
Et le reste de l’Europe ? Ils donnent des leçons aussi ? Comme ça, on a bien appris, ça nous rentre dans le crâne une fois pour toutes.
« C’est juste pour faire peur, rien de plus, pour que les politiques comprennent. » Jusqu’au moment où il faudra vivre dans des pays fascistes. À force de jouer avec le feu, parfois on se brûle, n’est-ce pas ? L’incendie ravage déjà la cave, bientôt le salon, la cuisine et, la maison tout entière, c’est pour dans trois semaines… ou dans deux ans. Et personne ne comprend que les politiques, c’est nous. Nous sommes les politiques chacun, chacune, c’est le principe même de la démocratie. Non ?
« Ah ben, peut-être qu’il faut en arriver là pour que les gens comprennent. »
112
Myriam Mechita, Les mains grises et le cœur bleu – les mains jaunes et le cœur noir, crayon sur papier, 56 × 76 cm
Mais comprennent quoi ? Comprennent quoi, bordel ?
« Ben que la France, c’est pas une terre d’asile où on fait n’importe quoi. »
Mais qui fait n’importe quoi ? Les étrangers font n’importe quoi ?
« Oh, tu sais, il faut faire le ménage chez ces gens-là. »
Chez ces gens-là…
Je suis une de ces gens-là. Je suis née en France d’un père algérien et d’une mère française, je suis ces gens-là… et quel ménage faut-il faire ? Celui de trier les gens par ordre social ? Par couleur de cheveux ? La couleur de peau ? Par compétences ?
La migration qualitative, comme ils disent ?
On commence le ménage par où ? Par ranger les chaussettes, passer l’aspirateur ou jeter les poubelles ?
Je sais ce que c’est que de grandir dans une ville où il vaut mieux avoir la peau claire, les cheveux lisses et les yeux bleus. Je sais ce que veut dire le « T’es de quelle nationalité exactement ? » et à la réponse « Française, je suis née en France », entendre un « Ah bon ».
— Maffi ?
— Présent.
— Mechita ?
— Présente.
— Ah non, toi, c’est Mohamed.
— Non, moi c’est Myriam.
— Pour moi, tu seras Mohamed, je trouve ça drôle.
Je sais ce que veut dire la tristesse des Sonacotra, pour y avoir été une fois enfant avec mon père, y avoir demandé « C’est une prison ? » et avoir vu un vieil homme, assis sur son lit en métal dans une chambre digne d’une cellule, et sans avoir eu aucune vie. Littéralement aucune vie. Avoir été de la maind’œuvre à moindre coût, à presque rien.
Une vie faite de travail assourdissant de dureté. « Moi, je fais le travail que personne ne veut faire, il faut bien que quelqu’un le fasse », et ce quelqu’un, c’est lui, Hocine, aussi âgé que le bâtiment qui l’enferme, aussi vieux que ce que son âge peut lui permettre. Paraitre 60 ans quand on en a 40. En paraitre 70 quand on en a 50 et mourir le plus vite possible, tout l’argent envoyé au pays, avec les mensonges d’une vie idyllique alors que c’est l’enfer et non le paradis. Mais il faut faire croire qu’en France, c’est mieux, ce sera toujours mieux.
On commence le ménage par où déjà ? J’ai oublié…
J’ai connu Fatou, Samira, Aicha, Ayana, dans une équipe de nettoyage de bureaux à la Défense. Courir le matin, RER B, depuis leur banlieue, et repartir le
soir dans leur banlieue, pour espérer attraper un baiser de leurs enfants endormis. Ne connaître que la nuit. Ne jamais les voir. Ne jamais partir en vacances, rêver devant des vitrines, et ne rien s’autoriser. « Ah, mais oui, ici c’est toujours mieux que chez nous, là-bas, je n’avais aucun avenir. »
Et je me disais qu’il vaut mieux un présent rempli de rêves, qu’une réalité sans avenir.
Il vaut mieux un présent rempli de rêves qu’une réalité sans avenir.
Les femmes de l’ombre, les hommes de la nuit, les gens cassés, les gens sans dents comme il disait, avec des cheveux pas beaux, des peaux horribles, des habits pas chouettes, de la nourriture gonflée aux produits merdiques, et plus de rêves. Aucun rêve. Se lever à 3 h 30 le matin, être dans les premiers trains, les premiers métros, les premiers toujours et finir les derniers. Toujours.
Le ménage, c’est eux qui le font, le ménage de la honte. Je l’ai fait avec eux. Entrer à 1 h 30 du matin dans des bureaux refroidis, le chiffon à la main et le casque avec de la musique sur les oreilles pour ne pas m’endormir, et nettoyer le bureau en soulevant tous les objets et les replacer au même endroit. Comme si nous étions des fantômes, des petites fées. Personne ne remarquait rien. L’invisibilité parfaite.
Alors, on glisse un papier dans l’urne avec ce sentiment de pouvoir faire le ménage par le vide, derrière ce rideau, c’est plus facile, plus simple. Allez, hop, tous dehors.
Je ne voulais pas vous parler de politique, je voulais vous faire sourire, vous faire rire même…
J’avais regardé avec attention autour de moi, j’ai cherché en vain. J’ai vu dans un train un homme couper du fromage avec la petite lame d’un coupe-ongles… J’ai vu un enfant s’allonger en étoile par terre sur le quai de la gare et être trainé par un père poussant des valises avec peine… J’ai vu un homme de 2 m, aussi balaise qu’une armoire à glace normande, regarder La Reine des neiges et un autre dessin animé pour enfants durant un vol Paris-New York.
J’ai fait deux trois rencontres sur les sites qui ont été lunaires… et je me suis dit que j’avais assez de choses pour vous écrire quelques lignes amusantes…
Mais depuis, il a fait 62 degrés à Rio.
Depuis, Poutine a placé ses vaisseaux nucléaires près de Cuba.
Depuis, 37 124 personnes sont mortes en Palestine.
Un enfant tué ou blessé toutes les 10 min… 1 minute… 2 minutes… 3 minutes… 6 minutes… 10 minutes… voilà, c’est fait.
Depuis, on perd le sens de l’humour et on ne peut plus rien dire sur rien.
Depuis, à force de vouloir inclure de force, on exclut plus que de raison.
Depuis, à force d’avoir peur, nous nous enfonçons dans la nuit.
Depuis, j’ai du mal à vivre dans ce monde où ni le présent ni l’avenir ne se couvrent de rêves infinis.
Alors, je vous le demande une dernière fois, le ménage, on le commence par où ?
Je vous donne mon secret…
Moi, je commence par sourire et me dire que ce bazar me ressemble, que la vie est un monde en mouvement où tout doit se déplacer pour que nous restions vivants, et je sors me mettre sur un banc au soleil, et je fais fuir la nuit.
113
PENDANT CE TEMPS-LÀ, EN AMÉRIQUE
Par Dominique Falkner
Trump caracole en tête des sondages, fait le beau, en rajoute, s’esclaffe, vitupère, se moque, menace, intimide, fait appel, cherche un demimilliard de dollars, déjeune donc avec Musk, se voit contraint de payer une caution de 200 000 dollars en Géorgie, qu’à cela ne tienne, puis une autre de plus de 80 millions celle-là, aïe aïe aïe, mais on ne sait plus trop en fait, on s’y perd, sauf lui peut-être, encore que. C’est un showman à l’américaine, avec plus de la moitié de l’électorat en adoration derrière lui, et ses « turpitudes » plus graves les unes que les autres, qu’on lui pardonne comme à un gamin effronté qui ne sait pas se tenir. Interrogé hier soir en direct sur CNN à propos des frasques sexuelles de l’ancien président et de ses divers procès en cours, dont un viol pour lequel il vient d’être condamné, un ardent supporter républicain du 45e locataire de la Maison-Blanche, de nouveau en lice pour les élections de novembre, et son ancienne gâche, rétorque au reporter abasourdi : « Et alors, il aime la chatte ! Moi aussi j’aime la chatte. Mais lui, il a plus de pognon que moi, donc il a plus de chattes. Eh bien moi, je dis tant mieux pour lui ! » Sens de la répartie à l’emporte-pièce qui n’est pas sans rappeler celles de son idole, dont voici un florilège choisi, en attendant le 5 novembre 2024 :
Hillary Clinton : « Si Hillary Clinton n’est pas foutue de satisfaire son mari, qu’est-ce qui lui fait penser qu’elle peut satisfaire l’Amérique ? » (Twitter, 16/4/15)
« Le seul atout qu’elle possède est d’être une femme. Elle n’a rien d’autre à offrir et franchement, si elle était un homme, elle obtiendrait 5 % des voix. Être une femme, elle n’a que ça, et le plus beau, c’est que les femmes ne l’aiment pas. » (Vox, 26/4/16)
États-Unis : « Si on devient encore plus gentil qu’on ne l’est déjà, on va littéralement cesser d’exister. » (Playboy, mars 1990)
Immigration : « Nous les rassemblons de manière très humaine. Et ils sont heureux parce qu’ils souhaitent être américains. Bien sûr, ça ne parait pas plaisant comme ça, ces conditions, dans les camps, mais tout n’est pas plaisant dans la vie. (60 Minutes, 27/09/15)
Réfugiés syriens : « Ce que je ne ferai pas, c’est accueillir cent mille Syriens potentiellement membres de Daech. Des hommes. Ce sont surtout des hommes, et des hommes forts. Jeunes et forts, qui font des soldats de première bourre. On se demande d’ailleurs, où sont les femmes ? Il n’y en a pas. On se dit alors deux choses. Premièrement, pourquoi ne se battent-elles pas elles aussi pour leur pays ? Et deuxièmement, je ne veux pas de ces gens-là ici dans mon pays. » (Face the Nation, 11/10/15)
Les contrôles aux frontières : « Je vais construire un grand mur le long de la frontière mexicaine et je vais le faire payer rubis sur l’ongle au Mexique. » (Twitter, 15/6/15)
Éducation : « À l’étranger, nous construisons une école, une route, et ils font sauter l’école, ils font sauter la route. Nous construisons alors une autre école, une autre route, et ils les font de nouveau sauter, mais nous continuons néanmoins de construire. Pendant ce temps, on n’est pas foutu d’ouvrir une putain d’école à Brooklyn. » (Discours à Las Vegas, 28/4/11)
Aide aux femmes : « Je serai phénoménal avec les femmes. Qu’on me comprenne, je souhaite aider les femmes. » (Face the Nation, 9/8/15)
Avortement : « Il doit y avoir une forme de punition. »
« ? »
« Oui. »
« Pour la femme ? »
« Oui, il doit y avoir une forme de punition pour la femme. » (MSNBC, 30/3/16)
Mariage gay : « C’est comme au golf. Beaucoup de joueurs de nos jours se servent de longs putters à l’esthétique douteuse. Et c’est bizarre, tous ces joueurs avec ces longs putters à la mode qui sont pourtant bien laids. Personnellement, je déteste ça. Je reste quelqu’un de traditionnel, au fond. J’ai beaucoup d’amis gays fabuleux, mais je reste attaché aux traditions. » (New York Times, 1/5/11)
Les Noirs : « J’ai une excellente relation avec les Afro-Américains, comme vous l’avez peutêtre entendu dire. J’ai un grand respect pour eux. Et ils m’apprécient. On s’aime bien. ( Anderson Cooper 360°, 23/7/15)
Système de santé : « Les États-Unis ne peuvent pas autoriser le retour des personnes infectées. Les gens qui voyagent dans des endroits exotiques doivent en subir les conséquences ! » (Twitter, 2/9/14)
Réchauffement climatique : « Il fait vraiment froid ces jours-ci, on parle même d’un hiver record avec les plus basses températures jamais enregistrées depuis longtemps. Et on se dit qu’on aurait bien besoin d’une bonne dose de réchauffement climatique, non ! » (Twitter, 19/10/15)
« Le concept de réchauffement climatique a été créé par et pour les Chinois afin de rendre l’industrie manufacturière américaine non compétitive. » (Twitter, 6/10/12)
Contrôle des armes à feu : « Peu importe les lois, armes, pas armes, cela n’a aucune importance. Il y a aura toujours des malades qui passeront à travers les mailles du filet. » (Meet the Press, 4/10/15)
Amérique : « Notre pays est en grande difficulté. Nous ne savons plus gagner. Nous avions l’habitude de gagner, mais c’est fini. De quand date la dernière fois qu’on nous a vus dérouiller, disons, la Chine,
114
par exemple, dans un accord commercial ? Non, ils nous tuent. Mais moi, je mets des torgnoles à la Chine tous les jours. Tout le temps. » (Lancement de la campagne, 15/6/15)
Mexicains : « Des gens bourrés de problèmes. Drogue, criminalité. Ce sont même des violeurs. Enfin certains, j’imagine, sont des gens corrects. » (Lancement de campagne, 15/6/15)
Lutte contre le terrorisme : « Quand on les voit couper des têtes, le waterboarding , la torture par l’eau, ne semble pas bien sévère. » (This Week with George Stephanopoulos, 2/8/16)
Raisons pour lesquelles les gens voteraient pour lui : « Pour être franc, peut-être parce que je suis beau. » (New York Times, 19/9/99)
Make America Great Again (« rendre à l’Amérique sa grandeur » était l’un des slogans de campagne les plus connus de Ronald Reagan). « Cette phrase, c’est la mienne, je l’ai inventée il y a environ un an. Les gens l’adorent et je suppose que je devrais éventuellement la protéger avec une sorte de copyright. » (My Fox New York, mars 2015)
Lutte contre le terrorisme : « Si vous regardez Saddam Hussein, il en a tué des terroristes. Je ne dis pas que c’était un ange, mais au moins, il en a tués. » (The Big Idea, 2006)
Arianna Huffington : « C’est une femme peu séduisante, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Je comprends tout à fait pourquoi son ex-mari l’a quittée pour un homme. Il a bien fait. » (Twitter, 28/8/12)
Pulp Fiction : « Mon passage préféré est celui où Sam sort son flingue au restaurant et intime au type de dire à sa “femelle de fermer sa gueule” et d’être cool. Bitch, be cool. Reste cool, lapin. J’adore ce passage. » (The Art of Being the Donald, 2005)
Sa réussite financière : « J’ai hâte de montrer mes gains financiers aux électeurs, parce qu’ils sont énormes. » (TIME, 14/4/11)
Je le dis sans me vanter, j’ai gagné des milliards et des milliards de dollars. » (Débat républicain sur CNN, 16/9/15)
Serrer la main : « C’est une chose dangereuse et les statistiques me donnent raison. » ( Playboy , octobre 2004)
Son intelligence : « Désolé, losers et baltringues, mais mon QI est l’un des plus élevés qui soit ! Ne vous sentez pas pour autant stupide ni jaloux, ce n’est pas de votre faute au départ. » (Twitter, 9/5/13)
« Je suis intelligent. Certaines personnes diraient même que je suis très, très, très intelligent. » (Fortune, 3/4/00)
« Personne ne respecte mieux l’intelligence que Donald Trump. » (CNN, 11/8/17)
Viagra : « C’est un médicament merveilleux si vous en avez besoin au lit. Si vous avez des
problèmes médicaux. Si vous avez subi une intervention chirurgicale. Je n’en ai jamais eu besoin quant à moi. En ce qui me concerne, franchement, cela ne me dérangerait pas qu’il y ait un anti-Viagra, quelque chose à l’effet inverse. » (Playboy, octobre 2004)
Relations amoureuses : « Certains hommes disent qu’ils préfèrent les femmes de caractère, fortes et indépendantes, aux beaux mannequins. C’est parce qu’ils ne peuvent pas avoir de beaux mannequins. Point à la ligne. » (New York Times, 19/9/99)
Sur sa fille : « Elle a fière allure. Si Ivanka n’était pas ma fille, je sortirais volontiers avec elle. » (The View, 2006)
Mariage : « Je n’achèterai jamais à Ivana de beaux bijoux ou des tableaux de renom. Pourquoi lui donner des actifs négociables ? » ( Vanity Fair , septembre 1990)
Coca : « Je n’ai jamais vu une personne mince boire du Coca Light. » (Twitter, 14/10/12)
Ego : « Montrez-moi quelqu’un qui n’a pas d’ego et je vous montrerai un loser. »
Son corps : « Mes doigts sont longs et beaux, tout comme, et cela a été maintes fois noté, diverses autres parties de mon corps. » (New York Post, 2011)
Ses légions d’électeurs : « Je ne peux pas me tenir au milieu de la 5e Avenue et tirer au hasard sans perdre d’électeurs. » (CNN, 8/8/15)
Immigration : « Pourquoi tous ces gens de tous ces pays de merde veulent-ils venir ici ? » (Réunion à la Maison-Blanche, 11/1/18)
Sa présidence : « J’adorais ma vie d’avant. Président, c’est du boulot. Je pensais que ce serait plus facile. » (Reuters, 28/8/17)
La diversité dans son cabinet : « Et mon Afro-Américain ! » (Redding, Californie, 3/6/16)
Mariage et parentalité : « Je ne fais rien pour m’occuper d’eux. Je fournis les fonds et elle s’occupe des enfants. Manquerait plus que ça que j’aille promener les gamins dans Central Park. » (Interview d’Howard Stern, 2005)
Le judaïsme : « Je suis un négociateur, comme vous. » (Discours devant la Coalition juive républicaine, 3/12/15)
Les mères qui allaitent : « Vous êtes dégoûtantes ! » (New York Times, 28/7/15)
L’histoire : « Dans la vie, il faut s’appuyer sur le passé, et c’est ce qu’on appelle l’histoire. » (Celebrity Apprentice)
La Russie : « Poutine aura beaucoup plus de respect pour notre pays lorsque je le dirigerai et, si Poutine aime Donald Trump, c’est un atout pour l’Amérique. » (Conférence de presse à la tour Trump, 11/1/17)
Sur le fait de s’inspirer d’autres dirigeants : « Kim Jong-un parle et son peuple s’agenouille ou se met au garde-à-vous. Je veux que mon peuple fasse de même. » (Fox & Friends, 15/6/18)
Diplomatie : « Le leader nord-coréen déclare que le bouton nucléaire est sur son bureau à portée de main à tout moment. Quelqu’un de son régime, épuisé et affamé, peut-il l’informer que j’ai moi aussi un bouton nucléaire, mais qu’il est beaucoup plus gros et puissant que le sien, et que le mien fonctionne ! » (Twitter, 2/1/18)
Racisme : « Je suis la personne la moins raciste qui soit. » (14/1/18)
Sa dernière défaite électorale : « Nous sommes loin devant, mais ils essaient de nous voler l’élection. Nous ne les laisserons jamais faire. »
Covid-19 : « Nous avons la situation bien en main. Il s’agit au départ d’une personne qui vient de Chine. Tout va bien se passer. » (22/01/2020)
115
UN MONDE AU-DELÀ DU MONDE
Par Emmanuel Abela ~ Photo : Anne Marzeliere
HOMMAGE
À FRANK DARCEL,
AUTEUR ET COMPOSITEUR, COFONDATEUR DE MARQUIS DE SADE, DISPARU LE 14 MARS DERNIER.

Tu es entré chez nous par effraction, comme une déflagration.
Un sujet sur le rock à Rennes dans l’émission d’Alain Maneval, Mégahertz, en début d’après-midi le samedi, nous met face à une image à jamais gravée dans nos mémoires : Marquis de Sade y apparaît furtivement en concert. Ô bien sûr, je m’attache à l’image de Philippe Pascal au premier
plan, entière et envoutante, mais la classe que tu affiches en léger décalage à l’arrière me fait prendre conscience de l’existence d’un monde au-delà du monde.
D’un temps au-delà du temps.
Je suis très jeune pourtant, vierge de tout sentiment musical. Et si mon attirance personnelle se porte déjà sur des figures comme David Bowie, en marge des stars du moment, je ne mesure aucunement l’importance de cette fameuse scène rennaise en temps réel ni de sa correspondance avec le mouvement post-punk émergent au début des années 80 en Angleterre. Je sais qu’il existe quelque chose, vers quoi je tends, et ta présence conforte cette intuition.
Il n’aura guère fallu de temps pour m’attacher à tes contemporains, Television, Wire ou Joy Division, et me rapprocher de toi. Comme si ma quête était de reconstituer le fil qui me permette de mieux comprendre la fulgurance de votre apparition télévisée. Mais étrangement, avant de plonger en Marquis, c’est par Étienne Daho que je recroise ta route : sur disque tout d’abord, puis sur scène lors de sa première tournée française encore assez confidentielle. Comme un faisceau de lumière, à ce moment précis où la pop retrouve des couleurs partout dans le monde, et surtout en France.
Avec mes amis, on s’habille Daho – ah, les fameux cols roulés ! −, on danse Daho, on vit Daho comme la résurgence d’une insouciance : celle des années 60.
Peu s’en soucient, mais je te sais là, Frank. Un peu dans l’ombre, mais bien présent. À l’écriture aussi bien qu’à la production. Et je remonte le courant, plonge plus profondément en Marquis de Sade, trouve tout à fait par hasard les deux albums chez un disquaire d’occasion – certains s’en souviennent comme d’une institution, place Sainte-Madeleine à Strasbourg –, tout content de me les destiner. Me suggérant au passage qu’il était temps pour moi de m’y attacher vraiment au moment où, heureuse coïncidence, je comptais offrir en radio un vaste panorama de la scène post-punk hexagonale. Les extraits proposés ce soir-là, je les situais comme des morceaux de choix : « Conrad Veidt », « Final Fog » (Brouillard définitif), « Cancer & Drugs ».
PLASTIC SOUL #9
116
Pour moi, les choses sont désormais claires : une ligne droite est tracée entre Strasbourg et Rennes, en passant par Nancy et Paris bien sûr. Mais ce qui me surprend à la découverte de vos deux albums, c’est la tonalité de « Rue de Siam », avec cette approche d’un funk blanc mâtiné de cuivre, qui renvoie à d’autres modèles déjà familiers, les Talking Heads bien sûr, mais aussi Tuxedomoon fraîchement débarqué à Bruxelles, en provenance de San Francisco.
Je trouvais l’étrangeté des textes de Philippe magnifiée par cette orchestration très contemporaine, presque jazz, avec la présence généreuse de nos deux compères Philippe Herpin et Daniel Paboeuf, ex-membres remuants des Sax Pustuls, que j’avais eu l’occasion de voir sur scène à cette époque-là avec Anches Doo Too Cool devant un public restreint. Aujourd’hui, je sais bien que cette orientation esthétique a été l’objet même de la séparation de Marquis de Sade, toi adepte d’une forme de chaleur musicale et Philippe souhaitant maintenir une approche plus sèche, plus anguleuse.
Lors de notre rencontre, à l’occasion d’un concert de Marquis de Sade reformé à l’Opéra national du Rhin, à Strasbourg, nous avions échangé à ce propos, sans que le débat ne soit véritablement tranché entre vous. Mais je vous retrouvais l’un et l’autre, entiers et si complémentaires, dans votre vision d’un rock sans concession, comme si finalement la parenthèse de plus de 35 ans n’avait jamais existé.
Vous m’évoquiez vos déboires télévisés et l’opération de sabotage délibéré lors d’un passage chez Thierry Le Luron, avec la disparition soudaine de la musique à l’antenne. Vous me rappeliez la situation de défiance que vous provoquiez parfois, y compris en arborant des tenues soignées inspirées de Kraftwerk, costards-cravates et coupes plutôt courtes, en rupture avec les canons post-hippies de l’époque − à ce propos, tu étais absolument magnifique sur la fameuse couverture de la revue Actuel datée de février 1980. Et je confirmais chez toi un esprit frondeur demeuré intact, toi qui t’abreuvais à Camus, en amateur de philosophie politique. Une position ferme qui s’opposait à ce que tu appelais – et j’aime tant la formule ! − le « conformisme pseudo-révolutionnaire ». Tu insistais sur l’affection que tu portais à un funk blanc inspiré par Remain in Light des Talking Heads – « Un virage important », selon toi – ou par le groupe Material du bassiste Bill Laswell. Ce qui avait le don de faire sourciller Philippe à côté de toi, plus enclin à citer le Pop Group ou les Slits de son
côté. Vous vous accordiez cependant sur un refus : celui de toute forme de reconstitution d’un schéma rock classique. Vous aviez trouvé votre propre voie, au point qu’elle reste aujourd’hui encore unique, en puisant dans la culture européenne, avec cet imaginaire avant-gardiste de l’entre-deux-guerres et cette position romantique qui vous avait amené à explorer des formes anarchistes, voire nihilistes, au point de vanter la dimension sexy d’Andreas Baader et Ulrike Meinhof pour qui vous exprimiez une « vraie fascination ». Comme si tu avais cherché à nous rassurer, tu avais quand même précisé qu’« ils foutaient sacrément les jetons ».
Ce jour-là, Philippe et toi, vous étiez à nouveau ensemble comme les deux faces d’une même pièce, mais qui, au lieu de se tourner le dos, se regardent avec un brin de tendresse, tout en conservant une pointe de méfiance tout de même.
Je me souviens de m’être rendu au concert à l’Opéra de Strasbourg avec un sentiment étrange : quel sens pouvais-je attribuer à cette reformation et à cette présence sur scène si longtemps après ? Certains ne se privaient pas de rappeler qu’ils les avaient vu jouer à la Salle de la Bourse en 1980. Or j’avais tort : vous m’avez prouvé ce jour-là que rien n’avait changé, que votre propos gardait la même force subversive. Je m’en étais réjoui et j’en suis ressorti profondément ému.
Puis, Philippe s’en est allé.
Tu as formé Marquis avec lequel tu as enregistré un premier album puis un second, avec un enthousiasme évident. Tu étais prêt à revisiter les bandes de Marquis de Sade pour des rééditions d’importance, avec son lot d’inédits. Bref, tu avais renoué avec cette part du récit. Celui de ta vie.
Puis tu t’en es allé aussi. De manière aussi brutale que surprenante.
Un bref message le 14 mars de Anne M., notre amie photographe rennaise. « J’ai le cœur brisé, bien évidemment. Tragédie », nous écrivait-elle pour nous annoncer ta disparition. Elle avait réalisé des photos de toi durant l’enregistrement du nouvel album et nous racontait la personne magnifique que tu étais. Bien sûr, à la lecture de son message, l’incrédulité a laissé la place à la sidération : tu étais entré chez nous par effraction, tu en es sorti dans les mêmes conditions.
En poussant la porte très fort. Pour un ultime envol.
117
DREYECKLAND DISC-COURS DIALECTIQUE

Unifier la société, éliminer les vieux nazis, freiner les multinationales multimilliardaires, se débarrasser des politiciens obnubilés par le pouvoir, repenser le rôle des sexes, abattre les frontières nationales, générationnelles, linguistiques, éducatives et les limites des partis, tout en protégeant l’environnement et en cultivant son héritage culturel ?
Ne serait-ce pas là le bon état d’esprit et la bonne approche pour relever les défis actuels ? Le changement climatique, la toute-puissance des grandes entreprises, l’aliénation sociale, le recul de la démocratie, le glissement vers la radicalisation politique, le grignotage des terres, la gentrification, le manque de temps, et tant d’autres ?
Comment est-ce possible ?
Français et Allemands se souviennent relativement bien des événements tragiques qui ont eu lieu il y a environ 80 ans et qui sont partis d’Allemagne.
Trente ans plus tard, des viticulteurs, des étudiants, des agriculteurs et des citoyens engagés de France et d’Allemagne (des « ennemis héréditaires » présumés) se sont organisés avec des hordes de Suisses pas si neutres que ça, sans smartphone, et ont remporté des victoires incroyables, mais cela ne semble pas être entré dans les manuels d’histoire.
Bilan (a minima) :
– constructions des centrales nucléaires de Kaiseraugst (CH) et Wyhl (D) empêchées, – construction d’usine chimique à Marckolsheim (F) empêchée, – centrale nucléaire de Fessenheim (F) finalement fermée après des années d’incidents.
C’était il y a seulement 50 ans.
Ne serait-ce pas l’histoire d’une réussite à transmettre aux générations futures ?
Pour ceux qui ne le savent pas, je parle du mouvement citoyen des années 70 et 80 du Dreyeckland, ce « croissant » entre l’Alsace, le nord de la Suisse et le sud du pays de Bade.
Le bilan de leurs combats est impressionnant, même pour leurs opposants.
Une bonne raison pour se poser la question : qu’est-ce qui était différent à l’époque ? Comment ont-ils réussi ? Qu’ont-ils fait de mieux ?
À propos, il n’y a aucune honte à ne rien savoir à ce sujet.
Moi-même, bien que participant depuis plus de 20 ans en tant que DJ, musicien et organisateur de concerts à la scène culturelle de Freiburg (pourtant l’un des épicentres à l’époque), je n’en avais pas la moindre idée !
Jusqu’à ce qu’un jour de septembre 2021, Walter Mossmann (1941-2015) entre dans ma vie, par le biais de mon autoradio qui s’est arrêté par pur hasard sur la fréquence 102,3 - sur Radio
118
Par Martin Möller-Smejkal ~ DJ Hercules ~ (traduit de l’allemand par Rémy Bux)
Dreyeckland donc, l’ancienne station pirate issue de « Radio Verte Fessenheim ».
Avec sa « Chanson pour mes Amis Radicaux » (sa version revisitée en allemand de la « Chanson pour l’Auvergnat » de Brassens), Walter, auteurcompositeur-interprète, journaliste et réalisateur du sud du pays de Bade, m’a ouvert les yeux et les oreilles sur un âge où il y avait plus de dialecte, plus de temps, plus d’agriculture paysanne, plus de réalité commune, plus de biodiversité, mais aussi plus de frontières et de hiérarchie.
Grâce à lui, j’ai découvert et aimé d’autres auteurscompositeurs-interprètes comme François Brumbt (qui a inventé le mot « Dreyeckland »), René Egles et Roger Siffer (F), Aernscht Born (CH) et Buki (D).
Ils font partie d’une génération de chansonniers souvent profondément enracinés dans la tradition, l’agriculture paysanne et la langue alémanique, mais qui regardent aussi avec curiosité dans toutes les directions, et ne mâchent pas leurs mots. Les derniers de leur espèce ?
Au passage, ils nous livrent un exemple de la manière dont on peut préserver ce qui nous est propre et l’unir à ce qui nous semble étranger pour créer quelque chose de nouveau. Dans leurs compositions ils ont intégré par exemple des éléments folk, blues, tango, chanson, ceux de la musique sud-américaine.
Bien que célébrés dans les années 70 et 80 dans toutes les occupations de site, à chaque manifestation et dans toutes les « maisons de l’amitié » (maisons de rassemblement autoconstruites sur les lieux de lutte), il est aujourd’hui difficile de trouver beaucoup d’information à leur sujet, car une grande partie de leur œuvre n’a jamais été numérisée.
Qu’y avait-il de si différent à l’époque ?
AGRICULTURE
Dans les années 70, davantage de personnes avaient le même niveau de vie. La société était plus agricole qu’aujourd’hui, et beaucoup cultivaient encore des champs, des vignes et/ou élevaient des animaux de ferme.
Un accident dans une centrale nucléaire proche n’aurait pas seulement été dangereux pour la santé des gens, mais aurait également mis en péril l’ensemble de leurs moyens de subsistance.
LANGUE
La langue alémanique permettait aux habitants du Dreyeckland de communiquer directement entre eux. Il suffisait de s’écouter attentivement pour se comprendre.
INFORMATIONS
À l’époque, il y avait en Allemagne trois chaînes de télévision et quelques stations de radio, quelques journaux interrégionaux et quelques journaux locaux. Il y avait donc une base de réalité commune. Bien sûr, il y avait toujours la question du choix des sujets traités. Afin de pouvoir diffuser leurs informations sans censure, de petites stations pirates comme Radio Dreyeckland (D) et les magazines Klapperstei 68 (Mulhouse) et Uss’m Follik (Strasbourg) ont été créés.
Beaucoup de nouvelles se propageaient par le bouche-à-oreille, il y avait un immense tableau d’affichage au Frendschft’s Huss (maison de l’amitié) sur lequel étaient épinglées les dernières informations.
Plus de temps grâce à moins de distractions.
Dans les années 70 et 80, il y avait peu de distractions. Bien sûr, on trouvait quelques discothèques et cinémas en ville, mais pas une surabondance de divertissements comme aujourd’hui (streams vidéos et musicaux, médias sociaux…).
Cela laissait du temps pour les discussions, les manifestations et les occupations de sites.
PROTESTATION
Les protestataires savaient qu’ils n’avaient de chance de réussir que s’ils rassemblaient la population derrière eux. Ainsi, des étudiants aux cheveux longs ont joué sur leurs guitares des chansons populaires réécrites pour les chanter en chœur avec toutes les générations, citadines et rurales. Souvent, ils étaient accompagnés de fanfares, afin de correspondre aux habitudes d’écoute rurales. Dès que l’occasion se présentait, ils recomposaient les chansons pour les adapter à leur cause.
Et la conclusion ? À suivre !
— DJ
HERCULES DREYECKLAND FOR SALE!
Les chansonniers contestataires du Dreyeckland constituent le cœur de cette mixtape. Mais il s’agit aussi de s’amuser avec la langue et les dialectes.
Cette mixtape ne se veut pas un musée, c’est pourquoi on y entend de la musique de 1976 à 2024.
Mixtape digitale : soundcloud.com/hercules-soundtruck Paroles et infos : hercules-soundtruck.de
DJ Hercules est actif en tant que DJ, musicien, organisateur et mixeur depuis 2002 dans le sud du pays de Bade et depuis peu en Alsace.
119
TON VOISIN CET INCONNU
Par Jean-Luc Wertenschlag
C’EST DANS LA VALLÉE VERSION PUNK

QUELQUE PART EN ALSACE
Au fond de la vallée de la Bruche, à côté de Schirmeck, presque en Moselle, pas loin du département des Vosges, voici le village de Grandfontaine, sur la route qui monte au col du Donon, mythique sommet celte que les Romains ont consacré à Mercure et où Napoléon III a édifié un pastiche de temple antique. Grandfontaine est connu pour sa mine de fer, plus riche gisement des Vosges durant des siècles, fermée en 2006. À une petite heure de voiture de Strasbourg, il n’y plus aucun commerce dans cette bourgade qui compte un peu plus de 400 habitants. C’était sans compter l’arrivée d’un nouveau maître brasseur il y a une dizaine d’années…
NO FUTURE POUR BIG PHARMA
C’est ici que Jean-Yves Salmon, originaire du Ried, a choisi de s’installer. Ce quadragénaire, titulaire d’un DUT scientifique, a tenté une école d’ingénieur, mais l’ambiance trop élitiste donneurs de leçons le pousse à travailler dans l’industrie pharmaceutique pour quelques années. Mais
là « où un jeanfoutre qui lèche le cul de son maître sera bien mieux vu qu’un gars qui bosse bien », c’est loin du paradis professionnel, et bien trop proche du grand capital : No future pour Big Pharma !
L’EAU DE SOURCE AU ROBINET
À la recherche d’une nouvelle maison, ce père de famille, alors technicien régulateur, découvre en 2009 l’ancienne demeure du maître des forges de Grandfontaine à vendre. Hopla, on y va ! Jean-Yves s’installe en 2012, proche de la nature, amoureux de la bière, adepte du Do It Yourself, attiré par « l’eau de source qui coule directement du robinet ». Pourquoi ne pas inventer la microbrasserie qui va bien avec ? La brasserie de Framont naît en 2017. Jadis, le minerai de fer y était chauffé et refroidi pour créer l’acier. À présent, malts et houblons y rencontrent l’eau de source des minières en ébullition pour en faire jaillir la bière, une fois refroidie et fermentée. C’est aujourd’hui une gamme de douze bières qu’on peut directement acheter à Grandfontaine, certaines parfumées avec le miel du voisin.
ACHETEUR COMPULSIF DE GROUPES PUNK
Il aménage deux chambres d’hôtes pour touristes, randonneurs ou visiteurs d’un soir. Et crée le café-concert « Le Faucon Malté » à la gloire du « Punk’s Not Dead » tatoué sur son crâne. Ce bar associatif d’une capacité d’une centaine de places, a accueilli plus de 150 concerts, avec des groupes emblématiques comme Les Ramoneurs de Menhirs, The Lords of Altamont, Les Sales Majestés, The Rumjacks ou Guerilla Poubelle. Les régionaux ne sont pas en reste, exemple avec les Mulhousiens The Hook, en concert, ou Kamarad pour réaliser un clip live. Jean-Yves est un « acheteur compulsif de groupes punk », rêvant d’accueillir les stars mondiales du genre juste sous sa chambre à coucher.
120
Jean-Yves Salmon. Photo : Lisa Giannarelli

Mais pas seulement ! Ouverte au jazz, au blues, au rock et même à la techno, l’association « Le Faucon Malté » créée en 2019 n’est toujours pas déposée au tribunal. Heureusement, les particularités du droit local d’Alsace-Moselle autorisent les associations non déclarées, tout à fait légales. De la rencontre de deux mondes, entre punk alsacien et droit allemand, est né un enfant associatif hyperactif… Évidemment, l’arrivée d’un entrepreneur punk ne laisse pas les villageois indifférents. Lorsque la fenêtre derrière la scène reste ouverte par erreur pendant tout un concert hurlant, lorsqu’une soirée techno dure 24 heures, lorsque des rockeurs inconnus au poste se perdent sur la route du Donon, cela provoque certaines incompréhensions. Et si Jean-Yves a lié des relations presque amicales avec la gendarmerie de Schirmeck qui le visite régulièrement, le dialogue avec Philippe Remy, maire de Grandfontaine, n’est pas toujours très constructif. Pourtant, un bistro du village ouvert à toutes et tous serait un lieu unique de rencontre pour les Grandfontains. Joint au téléphone, Monsieur le Maire dit apprécier les « bonnes bières de Framont » et assure que si un bar associatif ouvrait, « on ne l’embêterait pas ». Chiche ?
Aujourd’hui, pour éviter les complications administratives, les concerts du Faucon Malté sont devenus des soirées privées réservées aux ami·es de Jean-Yves. Pour découvrir la punkitude de la vallée de la Bruche, pour connaître les concerts à venir, vous savez ce qu’il vous reste à faire… Vive l’amitié qui pogote !
www.brasseriedeframont.com www.facebook.com/lefauconmalte67130
— C’EST AUSSI DANS LA VALLÉE !
Des musiques qui s’accouplent en se foutant des genres, de la joie, de la bonne humeur, des rires et des chants arrosés de breuvages houblonnés. « Allez voir là-haut sur la montagne si j’y suis ! » Surtout samedi 29 juin de 14 h à 1 h. Pour le festival annuel d’une journée à tendance punk naturaliste. Sur une divine prairie avec un DJ set des Lillois Amikal Sonic. À l’église à 18 h, avec le folk post-punk spoken word de Zoé Heselton. Sur la place de la mairie enfin : l’electro-rock de Spleen Club, le rap de Mister E, le punk néo-nasique de Zarga, le post-punk de Pales, l’old wave de KG et le retour d’Amikal Sonic pour le final electro, feat. Les projections hypnotiques de VJ Spock. Plus des associations, Ithaque, Papier Gâchette (édition artisanale d’ouvrages et d’affiches), En Rut. À boire et à manger. Une entrée pour le prix modique de rien du tout, c’est gratos ! En rut à Ranrupt le 29 juin
— NUNATAK
Faim de médias un peu différents ? Osez Nunatak, revue d’histoires, cultures et luttes des montagnes, qui développe et partage critiques et opinions depuis les régions montagneuses, en opposition au monde tel qu’il se présente, pour dévier du sentier balisé des flux de la marchandise et de l’autorité, attaquer ce qui sépare les uns des autres, raconter les ruisseaux, les êtres, les arbres ou les rochers… La rédaction disséminée entre Alpes, Pyrénées et Vosges s’empare de sujets comme le syndicat des gardien nes de troupeaux, les procès en sorcellerie en Alsace aux xvie et xviie siècles ou la Légion étrangère qui achète une ferme dans les Cévennes. La vallée de la Bruche sera-t-elle le berceau d’une nouvelle révolution paysanne ? revuenunatak.noblogs.org
121
The Devils (Italie) en concert au Faucon Malté. Photo : Benoît Gilbert
REGARD N° 23
Par Nathalie Bach ~ Photo : Nathalie Bach et Mar Castañedo par Kenneyrha Manuel

J’écoute
Les secondes de mille morts
Qui ne passent jamais
Le vent qui lève les coups du sort
Crevant un à un leur secret
J’habite ce visage
Ou est-ce le tien
Comme une nuit vaste et blonde
Ou s’est perdu mon nom
J’habite ce mirage
Et c’est le mien
À cette heure du jour et d’un monde
Au devenir vagabond
Je parle
Derrière cette mémoire à l’envers
D’une absence si longue à nous-mêmes
Ramenant pourtant la vie par-devers
Des sentiers inconnus que le temps parsème
Il faudrait se lever
Il faudrait marcher
Il faudrait un soleil de marbre
Aux veines rougies par un ciel de juin
Courant sur ta peau et sur les arbres
Pour me convaincre d’un bonheur certain
Il faudrait se lever
Il faudrait marcher
Et te regarder
Jaillir d’une autre nuit
Un mouchoir blanc au bout de ton âme
Tremblante mais éblouie
D’une joie que rien ne condamne
Je brûle
De te trouver
De ne pas te trouver
Je me brûle et je le ferai toujours
122

MAUVAIS ESPRIT
Par Claude De Barros
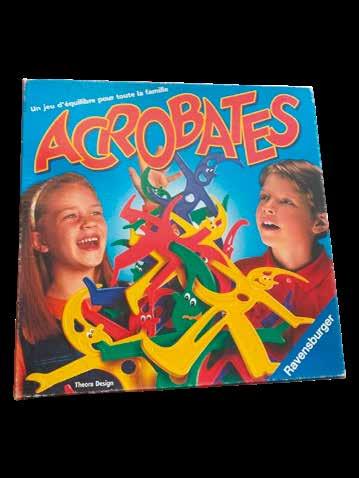
« La forme c’est le fond qui remonte à la surface », fait-on dire à Victor Hugo et c’est pourquoi je prends peur quand je me rends compte des idées qui se forment dans mon esprit. Pour preuve, mes ratiocinations quotidiennes par lesquelles je suis arrivé à trois sentences que j’affiche fièrement comme une formule de punchlines punks définitives : « Quand on n’a plus les moyens de la performance et du succès, il reste le style » + « Le talent c’est une suite d’acrobaties réussies » + « À quel moment, quand je caresse mon chat, je lui caresse les poils du cul ? »
Le truc du chat, c’est marrant ; je le sors en soirée, quand l’ivresse gagne, pour exprimer l’idée qu’un moment magnifique peut être sordide. Souvent, mes interlocuteurs s’arrêtent à l’absurdité de l’affirmation. On pourra donc conclure, dans l’hilarité générale, que le chat n’a pas de poils de cul. Humour. Remplaçons le chat par un enfant de chœur glabre. C’est la même question, la beauté du geste en moins. Sordide.
Le truc du style, ça m’est venu pendant ma course à pied hebdomadaire. Je n’aime pas courir mais j’aime beaucoup ma récompense : douche, bière, cacahuètes. Dans la souffrance physique et respiratoire, dans le chagrin des dépassements par des joggeuses trop âgées pour moi, je me suis appliqué à bien poser mon pied sur une ligne
ACROBATIES
imaginaire et à bien enrouler ma foulée. Après dix minutes d’exercices appliqués, un trait d’esprit : « Le style, c’est un semblant de dignité quand tout est perdu. » Une pensée inspirée d’un documentaire consacré à Charles Bukowski où il affirme qu’il vaut mieux accomplir une banalité avec style qu’un exploit sans style (!), que César, García Lorca, le Christ, Socrate et Jeanne d’Arc avaient du style (!), que le style c’est aussi une façon d’allumer une cigarette (!). Derrière l’ironie incendiaire, du style comparé entre une cigarette consommée et Jeanne d’Arc consumée, et les injonctions poétiques et fatiguées de Bukowski, je vois bien que Charles est d’abord un ratiocineur.
Reste le truc de l’acrobatie. Ça vient des prologues de Novo et du souvenir de mon premier ciné-club universitaire. Un prof présentait La Soif du mal d’Orson Welles. Il avait insisté sur la prouesse du planséquence d’ouverture. Un long travelling sans coupure. Depuis, à chaque fois que le film passe à la télé, je ne peux m’empêcher de rechercher dans ce plan-séquence des éléments significatifs qui donneraient, en partie, la clef de ses intentions cinématographiques. Sinon pourquoi Welles aurait-il tenu à cette prouesse ? Au fil du temps, j’ai fini par conclure qu’il n’y a aucune intention. Welles a seulement une volonté d’acrobate ou de magicien : épater le spectateur ou impressionner Hollywood. Cela n’empêche pas la dimension artistique de l’acrobatie et du tour de passepasse mais l’objectif, c’est d’abord de réussir le saut périlleux et retrouver la Dame de cœur déposée dans l’enveloppe scellée.
C’est ainsi que j’ai pensé les prologues de Novo : des écrits acrobatiques. Des acrobaties qui tirent de la routine et de l’ordinaire. Des divagations réussies. Des élucubrations rassurantes (« Je veux croire au pitbull qui ronronne comme un gros chat inoffensif ! » p. 7). Et cela s’applique à l’ensemble du numéro : Novo est un magazine acrobatique. Novo soixantedouze, c’est une acrobatie avec des histoires, des images (Red Autumn I, Otto Piene, p. 99 ), des affiches, des programmes et des annonces publicitaires, des titres intrigants (« Graisse de chien » , p. 112), des « gueules » en couverture, des réflexions intimes (« Mais j’aime ma vie. Elle est incroyable. Et « sera » ou « était » – ça n’a plus d’importance », p. 36), de longs entretiens, des découvertes, et parfois, des indiscrétions avec des instants de poésie (« Le lendemain, en redescendant les 250 marches (et quelques) du phare des Baleines, j’avais la mélancolie. Il pleuvait sur la mer », p. 106).
Tout ça tient ensemble. Tout se tient. Tout ça, c’est beau. Une nouvelle acrobatie. Une autre acrobatie. On applaudit. On attend le prochain tour.
124



lectures


DE MES NOUVELLES
De Colombe Boncenne — Zoé
D’emblée, il ne faut pas se fier au titre : pris dans leur ensemble, les 14 textes qui composent le livre forment une sorte de « roman éclaté » dans lequel la narratrice, une écrivaine que le « je » pourrait inciter à confondre avec l’autrice, entremêle fiction et réalité, au point qu’on ne puisse plus les distinguer. Une rencontre, une discussion, une remarque, un souvenir, un rêve, une observation, une coïncidence, et c’est le cerveau de l’écrivaine qui s’emballe. Tout peut servir de point de départ pour quelqu’un dont le métier est de raconter des histoires. Et tout peut prendre des proportions incroyables. Ça a l’air épuisant. Difficile. Et gratifiant, quand le texte prend forme. Ces nouvelles offrent une merveilleuse réflexion en actes sur l’écriture, pleine d’humilité. Séparément, chacune d’entre elles éclaire la vie et les sentiments de la narratrice, avec une justesse, une douceur et une précision rares. (N.Q.)
WILDERNESS
De Jim Morrison — Christian Bourgois
Lors de son fatal exil parisien, Jim Morrison se rêvait poète. Or il était déjà poète ! En témoigne ce merveilleux petit recueil, figurant parmi les carnets manuscrits rapportés à Los Angeles par Pamela Courson après sa disparition tragique. Ces textes auraient pu être oubliés, mais ils ont été découverts dans une caisse par les parents de Pam, elle-même décédée peu de temps après. On y retrouve toute la candeur céleste du beau Jim, sa ferveur, son esprit pugnace face à l’incompréhension d’un monde en plein déclin. Il en ressort une lumière irradiante, celle des immenses poètes, Blake, Rimbaud ou Mallarmé. Un groupe restreint qu’il a intégré – et il serait enfin temps de l’admettre – depuis bien longtemps déjà. (E.A.)


OBJETS PERDUS
De Denitza Bantcheva — Éditions DO
Qu’ont en commun un rouge à lèvres, une paire de lunettes ou un dé à coudre ? En dix-neuf chapitres-objet sans discrimination de taille ou de genre, Denitza Bantcheva tente de conjurer la perte, le déroulé inexorable du temps, et de s’interroger sur l’histoire contenue dans les objets que nous laissons en disparaissant, comme autant de traces de notre vie intime. Anecdotique et singulière, chacune des vignettes révèle dans ses nuances les objets en question. La palette, et les formes après usage, du rouge cosmétique formant un écho subtil à la nuance de nos émotions, la perte d’une vue nette se met au profit d’un accessoire peu flatteur, ou encore la quête du dé à coudre perdu de la grand-mère marque au fil rouge les particularités de son héritière. (V.B.)
LES FLEURS SAUVAGES
De Célia Houdart – P.O.L
Précieux sont les livres aptes à nous rendre plus attentifs aux personnes et aux choses qui nous entourent, ces livres dont on aimerait toujours pouvoir parler la langue. Depuis son premier texte publié chez P.O.L, Les Merveilles du monde (2007), Célia Houdart cultive l’art discret de savoir faire roman de tout. Dans Les Fleurs sauvages, au titre réunissant dans une même occurrence Bergman et Baudelaire, il est question de pêche et de dessin, de la fonte d’une cloche, d’une champignonnière, de missiles antichars et de fusils d’assaut. Du portrait d’une jeune fille en fleur d’aujourd’hui, le texte se déplace vers d’autres vies, d’autres territoires, pour nous cueillir à un endroit où nous ne l’attendions pas : le thriller. On y retrouve tout ce qui nous touchait déjà chez l’autrice dans sa manière subtile et ouverte de percevoir le monde, avec une écriture qui s’attache à dire sans ironie notre époque – ce qui reste si rare, au fond. (N.B).
126


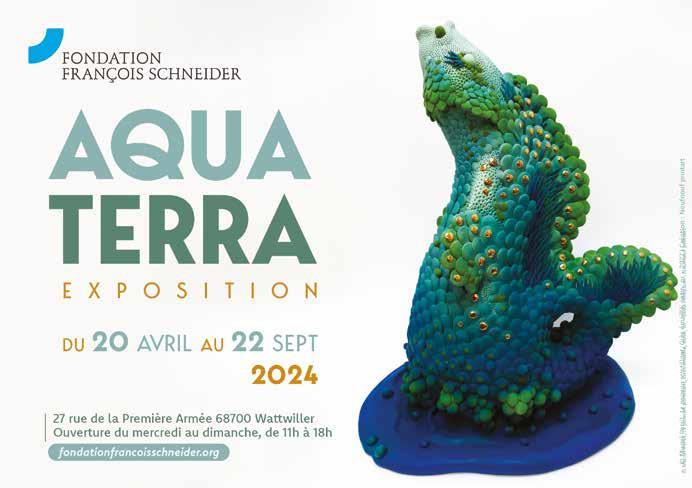

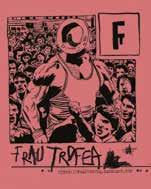 DOG PARK Festina Lente – Géographie/Modulor
DOG PARK Festina Lente – Géographie/Modulor
Les 90s en force avec le premier album noisy et sensible de ce quatuor americano-brésiloparisien né en 2021, avant d’enchaîner de belles dates à Paris, sets pendant lesquels les musiciens interchangent instruments et voix tout en maintenant une harmonie d’ensemble. Ici, pas de leader ni de rôle attribué, mais une musique à l’identité marquée. Dans un bain lumineux, Festina Lente déroule ses dix titres indie-pop aux sonorités mélancoliques et new wave parvenant à créer des mélodies entêtantes aux touches lo-fi et pointes de jazz. L’incroyable alchimie partagée par les musiciens s’harmonise dans leurs influences respectives et donne naissance à un album aux tonalités enivrantes parfaitement réussi. (V.B.)
FRAU TROFEA
Scansion 1
On a tous entendu parler de cette fièvre dansante qui aurait sévi dans les rues de Strasbourg en 1518. Frau Trof(f)ea, qu’elle ait existé ou non, est devenue le symbole de cette épidémie : la patiente zéro qui danse frénétiquement jusqu’à ce que mort s’ensuive. Mais sur quoi donc ? Certainement que la noise de ces trois Messins aurait fini par échauffer le sang des danseurs fous. Loin d’en être à leurs premières gammes, Val, Vincent et Joël nous font revivre cette sensation de transe sur des morceaux qui flirtent autant avec la no wave, le punk ou encore le math-rock. Après un premier album en 2022, Premier Sang, ils sont de retour avec un EP aussi direct que prometteur. (C.J.)


PALACE
Ultrasound 2024 – Universal
Si le deuil est un thème maintes fois traité en musique, il est assez rare d’y trouver autant d’espoir et de sérénité que dans Ultrasound, le dernier opus de Palace. Fort de leur indéniable crédibilité sur la scène indie, le groupe londonien qui a vu les débuts de Will Dorey de Skinshape, s’essaie ici à un mélange de sonorités organiques et électroniques avec renforts de cordes classiques (« Son ») et de boîtes à rythmes (« Love Is a Precious Thing »). Le résultat est d’une cohérence et d’une maîtrise parfaites qui font de ce quatrième album le meilleur et le plus abouti de leur carrière. Palace sait très bien comment exprimer les émotions dans chaque détail de leur musique. Pour autant, ils ne tirent pas profit du pathos de la situation et préfèrent témoigner de ce que les épreuves difficiles peuvent faire naître comme sentiments de solidarité et d’amour. (C.J.)
DRAHLA
Angel Tape – Captured Track
Avec ce groupe de Leeds réuni autour de l’intrigante chanteuse et guitariste Luciel Brown, nous voilà replongés dans la noirceur du post-punk le plus urbain. Sur ce deuxième album remarquable, la perte, la frustration et la désespérance sont éclairés des seuls traits du saxophone de Chris Duffin, collaborateur de longue date. Cela faisait quelque temps qu’on n’avait rien entendu de tel, depuis le mythique Blurt de Ted Milton peut-être : une forme anguleuse, free-rock, étouffante et fascinante en même temps. (E.A.)
sons
128



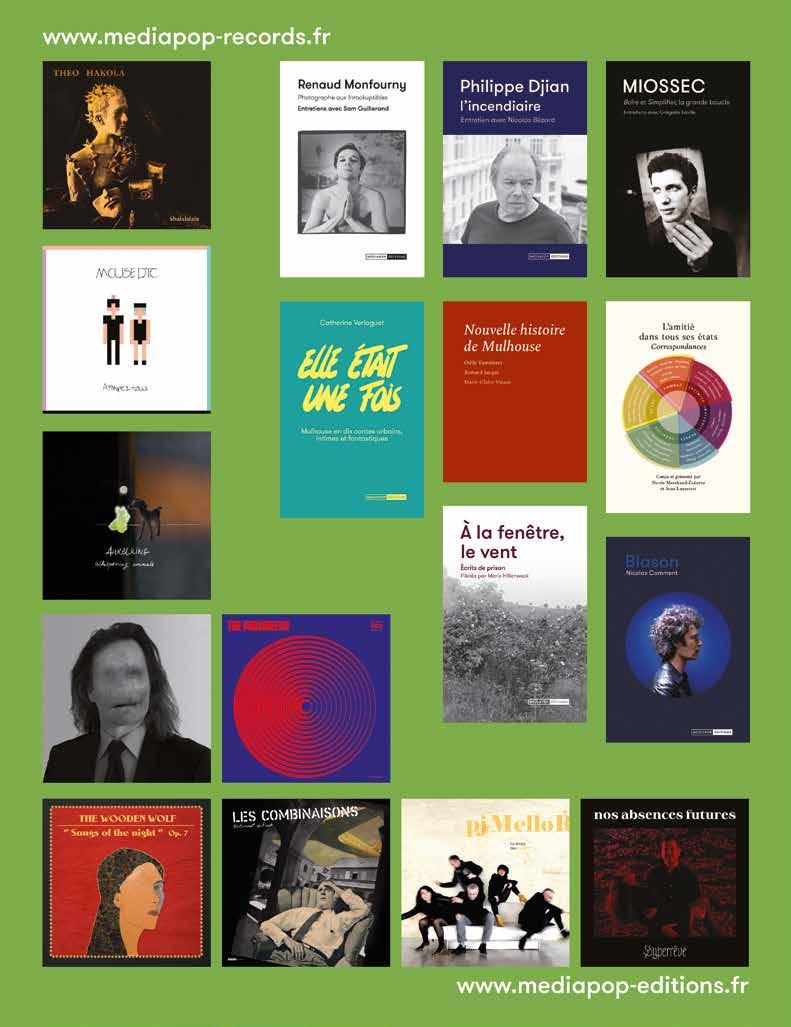
BIENVENUE AU CLUB !
Cadeau Bonus : Médiapop vous offre un livre ou un disque au choix si vous parrainez un ami
* Dans la limite des stocks disponibles et pour une valeur de 100 € maximum.
CLUB MÉDIAPOP / ADHÉSION 2024 1 ABONNEMENT À NOVO + 4
MÉDIAPOP RECORDS * OU
OU
100 €
DISQUES
4 LIVRES MÉDIAPOP ÉDITIONS *
2 DISQUES + 2 LIVRES * =
Rendez-vous sur club.mediapop.fr pour adhérer au Club Médiapop. Vous pouvez également adhérer au Club Médiapop en envoyant un chèque à Médiapop, 12 quai d’Isly, 68100 Mulhouse Novo est diffusé gratuitement dans les musées, centres d’art, galeries, théâtres, salles de spectacles, salles de concerts, cinémas d’art et essai et librairies des principales villes du Grand Est.
!




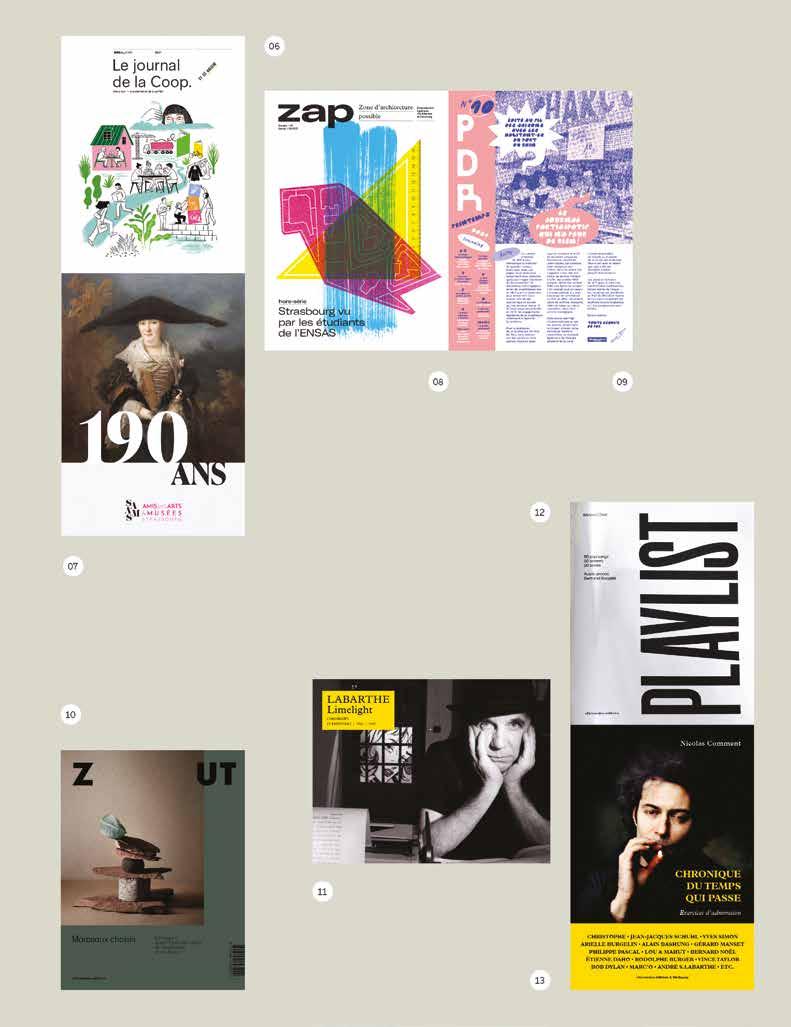



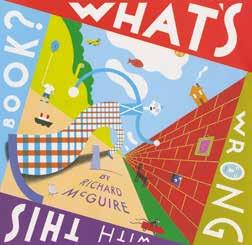
 © Romain Vadala
© Romain Vadala



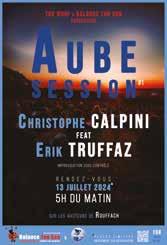








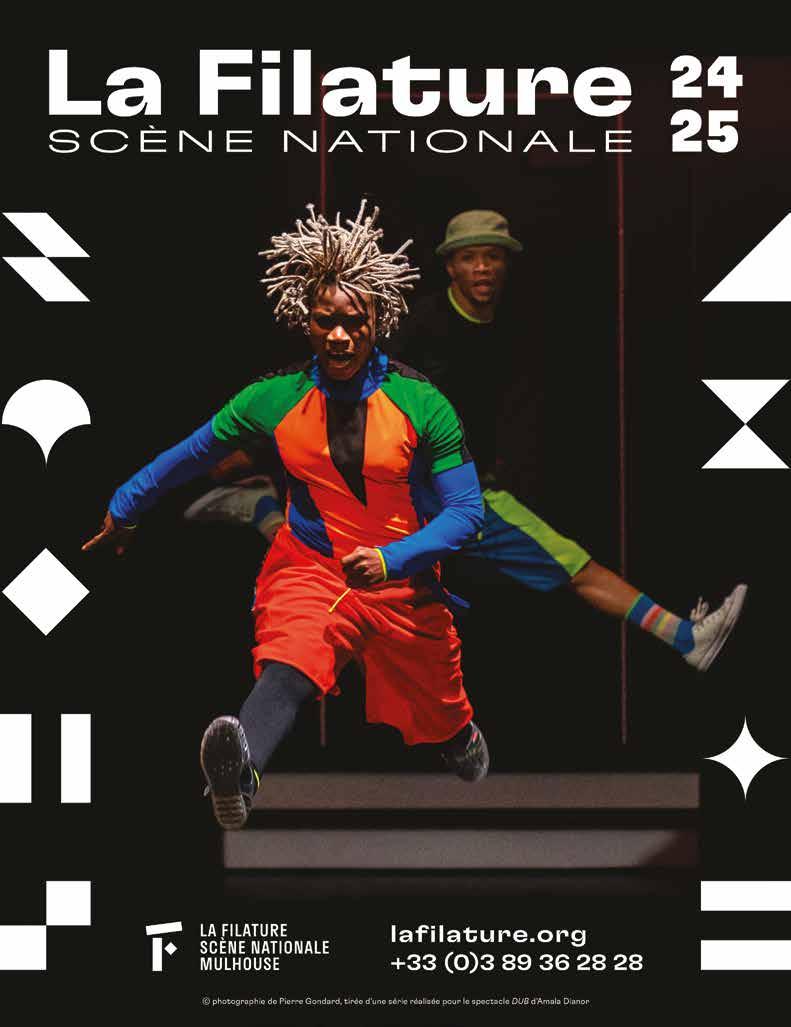







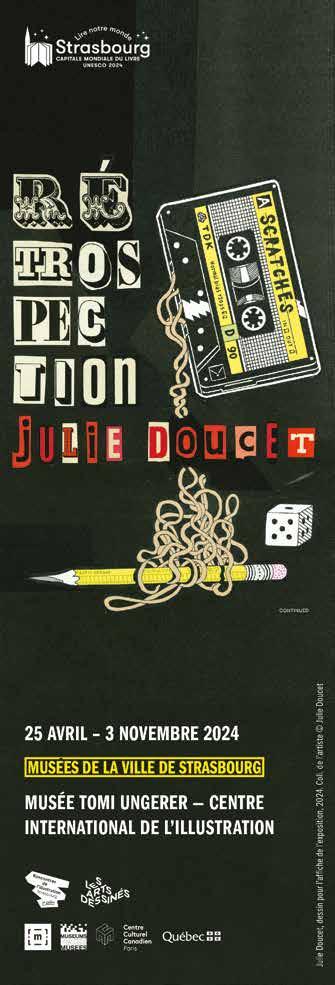







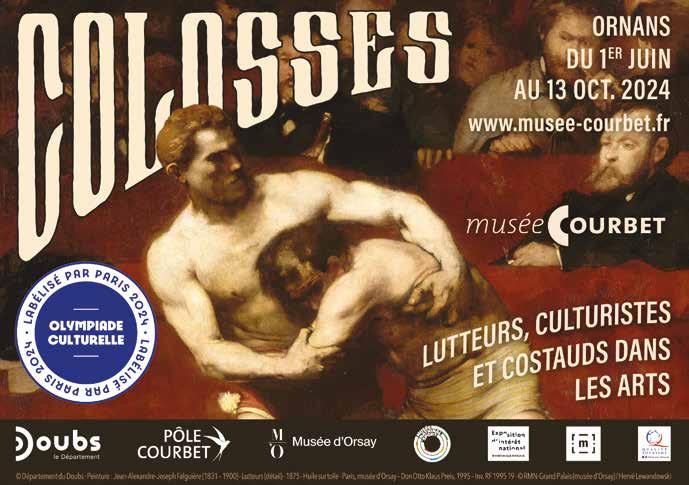




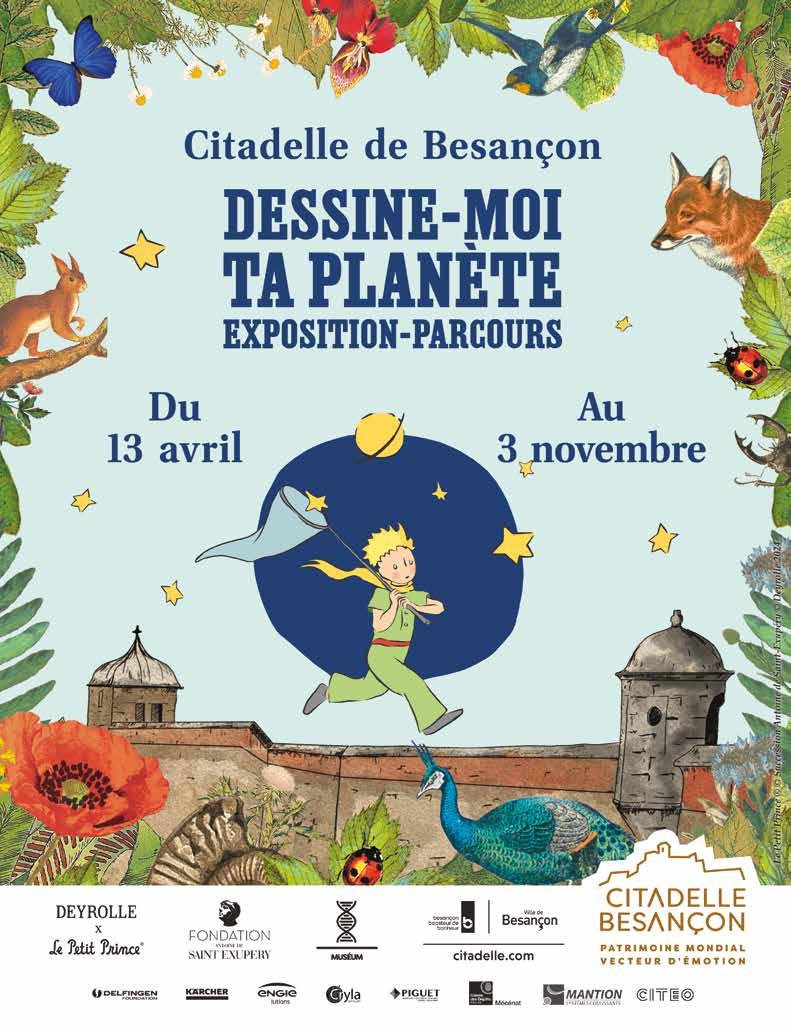
 Par Pierre Lemarchand ~ Photos : Richard Dumas
Par Pierre Lemarchand ~ Photos : Richard Dumas













 Par Emmanuel Dosda ~ Photo : Christophe Urbain
Par Emmanuel Dosda ~ Photo : Christophe Urbain













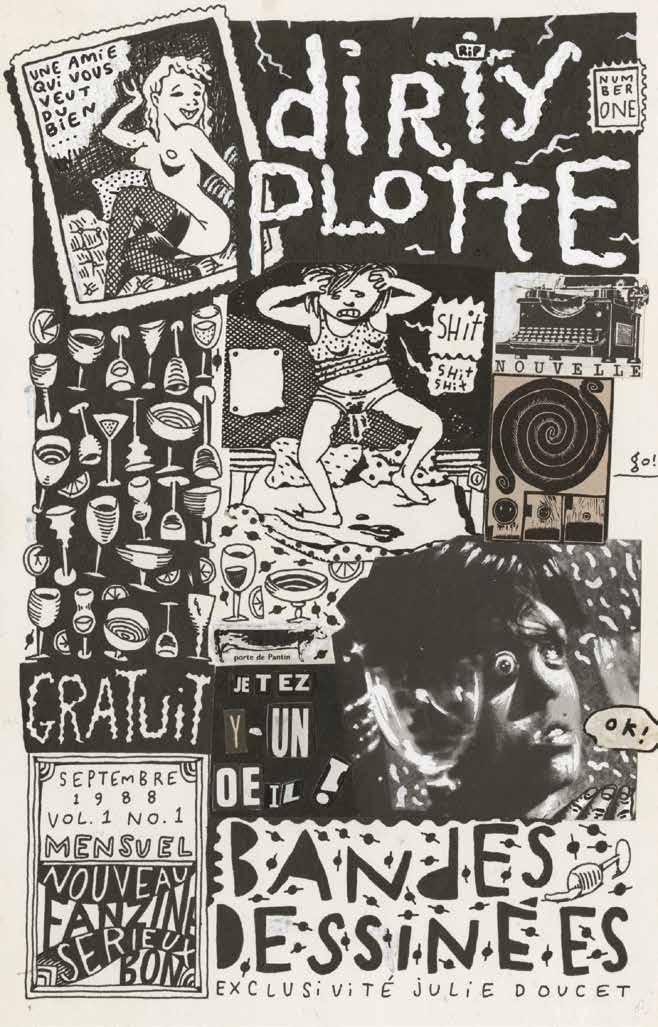








 © Matëo Granger
© Matëo Granger





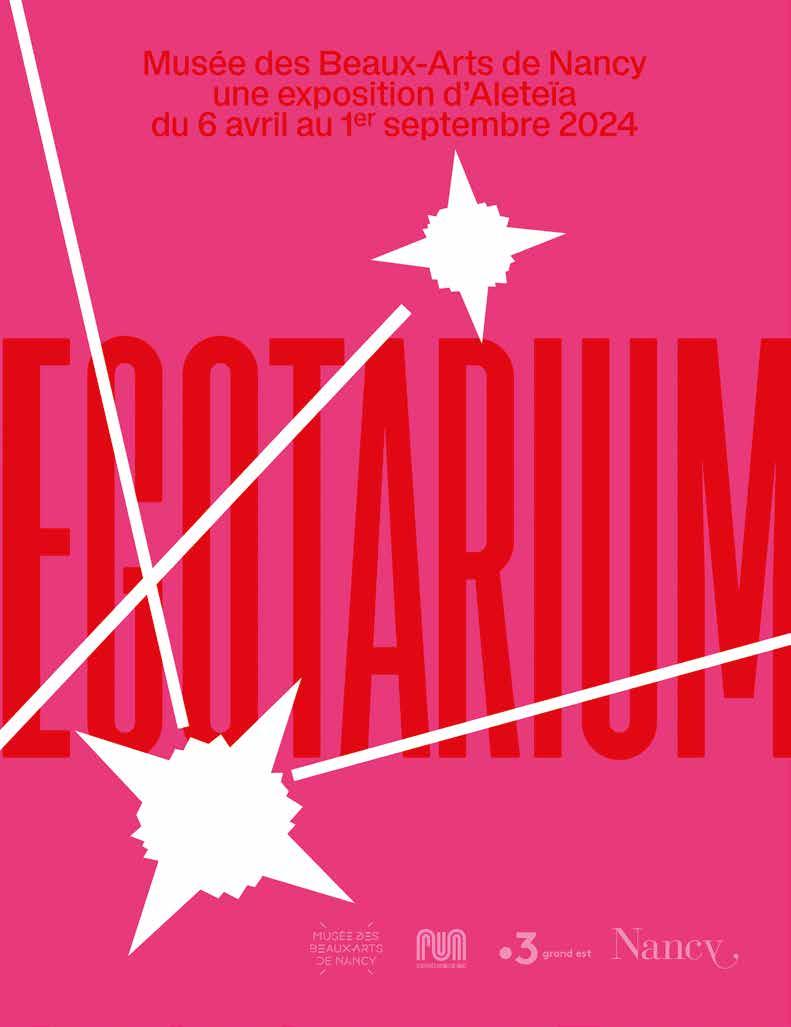























 Château d’Hérouville, mai 2024 © Nicolas Comment
Château d’Hérouville, mai 2024 © Nicolas Comment









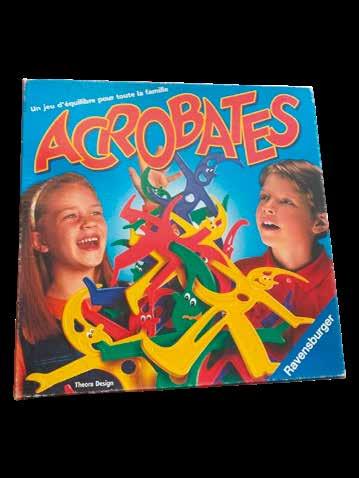









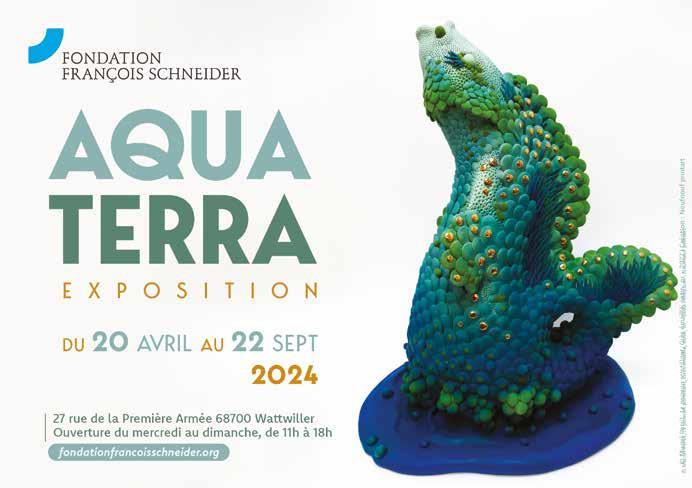

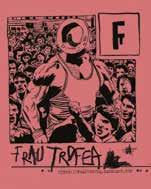 DOG PARK Festina Lente – Géographie/Modulor
DOG PARK Festina Lente – Géographie/Modulor