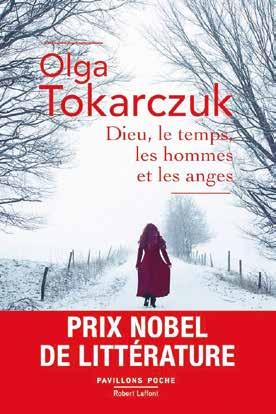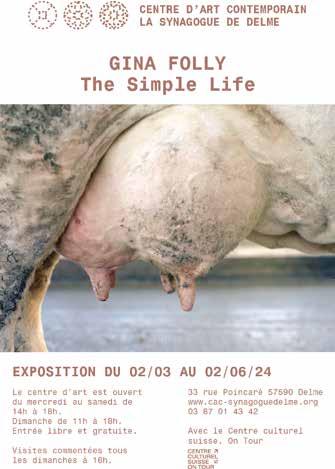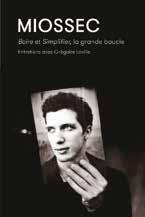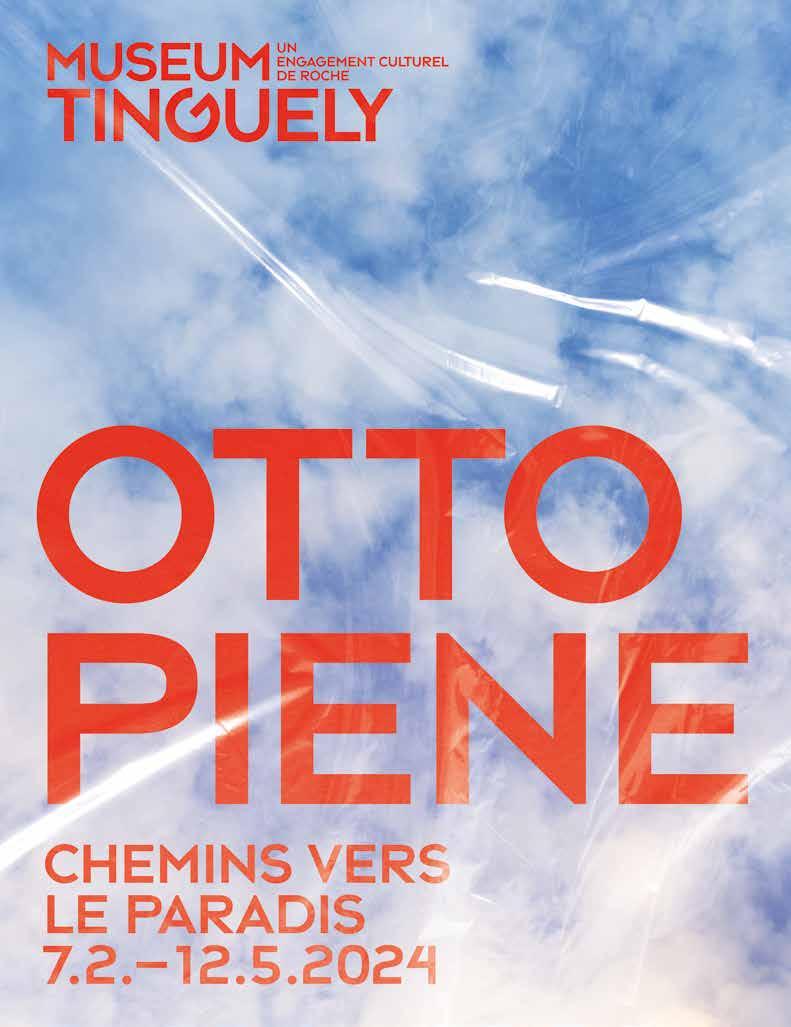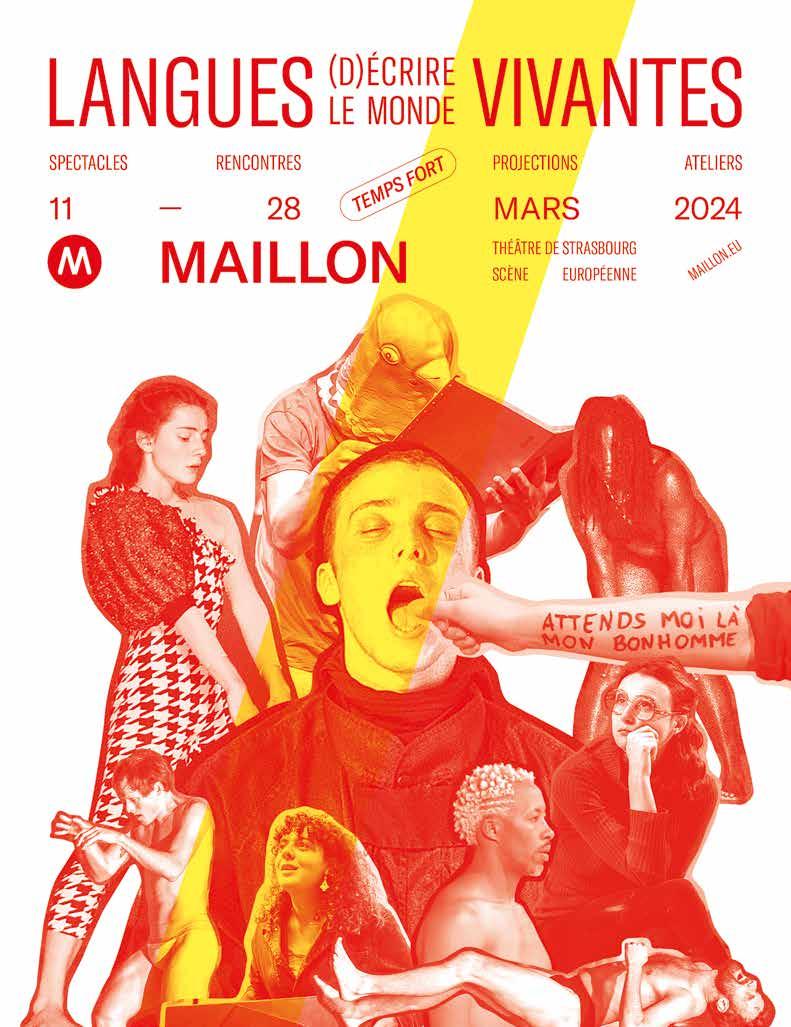
Directeurs de la publication et de la rédaction :
Bruno Chibane & Philippe Schweyer Rédacteur en chef : Philippe Schweyer ps@mediapop.fr
06 22 44 68 67
Secrétaire de rédaction : Aude Ziegelmeyer
Relecture : Manon Landreau
Direction artistique : Starlight
Ont participé à ce numéro :
RÉDACTEURS
Nathalie Bach, Nicolas Bézard, Valérie Bisson, Benjamin Bottemer, Alma Decaix-Massiani, Claude De Barros, Emmanuel Dosda, Caroline Châtelet, Lucie Chevron, Nicolas Comment, Coralie Donas, Dominique Falkner, Christophe Fourvel, Marion Guilbaud, Clo Jack, Mathieu Jeannette, Bruno Lagabbe, Fanny Laemmel, Pierre Lemarchand, Robert Lenoir, Lucas Le Texier, Guillaume Malvoisin, Stéphanie-Lucie Mathern, Luc Maechel, Myriam Mechita, Martial Ratel, Mylène Mistre-Schaal, Nicolas Querci, Louis Ucciani, Aurélie Vautrin, Nathanaelle Viaux, Clément Willer, Gilles Weinzaepflen, Aude Ziegelmeyer, Serafyma Zhytnia.
PHOTOGRAPHES ET ILLUSTRATEURS
Vincent Arbelet, Pascal Bastien, Bearboz, Nicolas Bézard, Sébastien Bozon, Mar Castañedo, Tanguy Clory, Nicolas Comment, Stan Cuesta, Caroline Cutaia, Régis Delacote, Richard Dumas, Romain Gamba, Alicia Gardès, Delphine Ghosarossian, Teona Goreci, Anne Immelé, Nicolas Leblanc, Benoît Linder, Myla Lelion Savre, Renaud Monfourny, Zélie Noreda, Arno Paul, Bernard Plossu, Ritchie Rabaraona, Olivier Roller, Dorian Rollin, Christophe Urbain, Henri Walliser, Nicolas Waltefaugle.
COUVERTURE
© Olivier Hodasava. https://www.instagram.com/ohodasava/ https://dreamlands-virtual-tour.blogspot.com/
IMPRIMEUR
Estimprim – PubliVal Conseils
Dépôt légal : mars 2024
ISSN : 1969-9514 – © Novo 2024
Le contenu des articles n’engage que leurs auteurs. Les manuscrits et documents publiés ne sont pas renvoyés.
CE MAGAZINE EST ÉDITÉ PAR CHICMEDIAS & MÉDIAPOP
CHICMEDIAS
37 rue du Fossé des Treize / 67000 Strasbourg
Sarl au capital de 47 057 € – Siret 509 169 280 00047
Direction : Bruno Chibane
bruno.chibane@chicmedias.com — 06 08 07 99 45
Responsable administratif : Gwenaëlle Lecointe administration@chicmedias.com — 03 67 08 20 87
MÉDIAPOP
12 quai d’Isly / 68100 Mulhouse Sarl au capital de 1000 € – Siret 507 961 001 00017
Direction : Philippe Schweyer ps@mediapop.fr – 06 22 44 68 67 www.mediapop.fr
ABONNEMENT
Novo est gratuit, mais vous pouvez vous abonner pour le recevoir où vous voulez.
ABONNEMENT France : 4 numéros — 30 €
Hors France : 4 numéros — 50 €
DIFFUSION
Contactez-nous pour diffuser Novo auprès de votre public.
WWW.NOVOMAG.FR
NICOLE MARCHAND-ZAÑARTU 8-11
FOCUS 13-33
La sélection des spectacles, festivals et inaugurations
PORTFOLIO
Serafyma Zhytnia 34-45
SCÈNES 47-52
On achève bien les chevaux 48-49, Marion Siéfert 50-52
SONS 53-64
Anika 54-59, Aurel King 60-61, En Attendant Ana 62-64
ÉCRANS 65-72
Rosalie Varda 66-69, Jordan Tetewsky 70-72
ARTS 73-86
Philippe Ramette 74-77, CRAC Alsace 78-79, Ministère de l’Impression 80-83, Vanessa Gandar 84-86
IN SITU 87-100
Les expositions du printemps
CHRONIQUES 101-122
Nicolas Comment 102-107, Stéphanie-Lucie Mathern 108-109 , Myriam Mechita 110-111, Dominique Falkner 112-113 , Nathalie Bach 113, Stan Cuesta 114-116, Bruno Lagabbe 118 , Claude De Barros 120, Christophe Fourvel 122
SELECTA
Livres 124 Disques 126
ÉPILOGUE 128
SOMMAIRE OURS PROLOGUE 7

VIVE LA POÉSIE
Par Philippe Schweyer
Le ciel était gris, à peine égayé par les avions easyJet qui striaient l’horizon, avant de percer la couche nuageuse, pour acheminer leur cargaison de touristes aux quatre coins de l’Europe. Je marchais au hasard, espérant une rencontre quelconque, même si les rues étaient désespérément désertes. Alors qu’il commençait à pleuvoir, je me suis engouffré à l’intérieur d’un supermarché, à la recherche d’un peu de chaleur humaine. Je n’avais qu’un but, dépenser le peu d’argent qui me restait, en espérant sans doute inconsciemment que ça m’aiderait à combler un manque voire à me sentir vivant. Après les dernières mesures d’un slow de Scorpions à deux doigts de me faire chialer en me rappelant ma jeunesse envolée, la sono manifestement branchée sur Nostalgie enfonça le clou avec une chanson de Claude François (Si j’avais un marteau. Je cognerais le jour. Je cognerais la nuit. J’y mettrais tout mon cœur. Je bâtirais une ferme. Une grange et une barrière. Et j’y mettrais mon père, ma mère. Mes frères et mes sœurs. Oh oh, ce serait le bonheur…). Ça m’a donné envie de me diriger vers le rayon Bricolage. Entre les scies sauteuses et les perceuses à percussion, je suis tombé sur une bombe de peinture rouge à 13,90 euros, pile ce qu’il me restait en poche. C’était un signe. Je me suis faufilé entre les caddies remplis à ras bord de produits sans saveur jusqu’à une caisse sans caissière. Dehors, il pleuvait toujours, mais j’étais pressé d’utiliser ma bombe aérosol. À l’arrière du Leclerc, un long mur immaculé bordait une ancienne usine textile en briques rouges à l’abandon. J’ai secoué la bombe, puis je me suis approché du mur pour écrire en grandes lettres rouge sang bien droites : « MARRE DE LA GUERRE », « HALTE AUX MASSACRES » et « RÉARMEMENT PIÈGE À CONS ». En reculant de quelques pas, j’ai constaté que les lettres de la fin de chaque phrase étaient un peu plus petites que celles du début. On allait me prendre pour un putain de pacifiste dépressif. J’ai secoué ma bombe et j’ai écrit « NON À L’INJUSTICE », « COMBATTONS LA PAUVRETÉ » et « VIVE LA POÉSIE ». Là encore, les lettres de la fin de chaque phrase étaient un peu plus petites que celles du début. C’était trop tard pour rectifier le tir. J’ai écrit « À MORT LA MORT ». Cette
fois, j’ai fait exprès d’écrire de plus en plus petit pour qu’on comprenne que c’était mon style. J’ai encore écrit « RÉSISTANCE À LA CONNERIE », « BIENVENUE AUX ÉTRANGERS » et « VIVE LA DANSE ». Après ça, j’ai balancé la bombe vide pardessus le mur. J’aurais voulu que quelqu’un vienne admirer mon travail. Malheureusement, il n’y avait pas une voiture, pas un vélo, pas une trottinette, pas un piéton dans les parages. J’étais un artiste révolté sans public ni avenir. Alors que je commençais à penser que tout ça ne servait sans doute à rien, un pitbull s’est approché de moi tel un félin se préparant à sauter sur sa proie. J’étais prêt à me laisser dévorer sans résister. Au lieu de ce scénario dans l’air du temps, le pitbull m’a contourné pour aller pisser contre le mur, à l’endroit exact où j’avais écrit « VIVE LA POÉSIE », puis il est revenu se frotter à mes jambes. Il me fixait tendrement pour me signifier que je n’avais pas à avoir peur. Je me suis baissé pour le caresser jusqu’à ce qu’il se mette à ronronner comme un gros chat inoffensif. Au bout de quelques minutes, le pitbull est reparti comme il était venu. C’était l’heure des infos et il était temps de rentrer à mon tour. J’ai longé le mur une dernière fois, en regrettant un peu de ne pas avoir écrit « VIVE L’AMOUR », « VIVE L’AMITIÉ » et « VIVE LA VIE ».
PS 1 : Vive Novo qui fête ses 15 ans d’existence (voir l’épilogue à la fin de ce numéro).
PS 2 : Tino Rossi is not dead ! Luvah , revue transdisciplinaire fondée en 1982 (!), est de retour avec un numéro 31 passionnant autour du thème de la chanson. À commander sur le site des Presses du Réel.
7
AMICALEMENT VÔTRE
Par Emmanuel Abela ~ Visuels : Isabelle Chabot

DANS LE CADRE D’UN OUVRAGE CHORAL VERTIGINEUX, NICOLE MARCHAND-ZAÑARTU REND COMPTE DE CORRESPONDANCES PARMI LES PLUS ILLUSTRES. AVEC POUR THÈME CENTRAL, L’AMITIÉ PROFONDE QUI LIE DEUX CRÉATEURS.
D’où est venue l’idée de centrer votre propos sur l’amitié à partir d’un corpus de correspondances ?
Les idées ne viennent jamais seules, elles marinent sans qu’on ne sache plus d’où elles proviennent. Mais l’une de ces correspondances m’a beaucoup émue autant par son contenu que par sa préface, c’est celle dont j’ai choisi de rendre compte : Paul Celan et Nelly Sachs. C’est un tout petit volume de quelques lettres. Il s’avère que je connaissais Gisèle [ Celan-Lestrange, une artiste française, peintre et graveuse, épouse de Paul Celan] et son fils, Éric. Chaque fois qu’il était fait allusion à chacun d’entre eux dans les lettres, ça me touchait particulièrement. Dans la préface que Mireille Gansel a rédigée pour ce volume, c’est l’intensité, dans le malheur il faut bien dire, qui m’a donné envie de comprendre d’autres correspondances et de les réunir. Ces correspondances, je les connaissais pour la plupart, mais je voulais surtout rendre hommage à ces personnages qui ont lutté contre l’oubli et qui y ont laissé leur vie, parfois. C’est le cas de Varlam Chalamov, l’exemple d’une vie tragique – plus que fracassée – d’un homme qui parvient à écrire, malgré tout.
Avec souvent, quelles que soient les situations des épistoliers choisis, la création au cœur des préoccupations.
Oui, c’est souvent le cas. Et cela montre que la création n’est jamais lisse. On croit toujours qu’un livre, un poème, un film ou une partition, ça vient comme ça, au bout d’une trajectoire. Mais
quand on constate tous les cahots, tous les heurts – ces cailloux qui viennent se glisser –, c’est là que l’amitié prend toute son importance. Face à toutes les difficultés rencontrées, le poids de l’amitié vient apporter toute son aide. Dans ces moments, elle apporte du soutien, elle relance la machine. Avec ce choix de correspondances, je souhaitais montrer le rôle de l’Autre dans la création. De manière générale, et c’est un peu le souci de ces expositions qui réunissent beaucoup d’œuvres d’un artiste, quarante ou cinquante à la fois, alors que nous ne devrions nous intéresser qu’à une œuvre à chaque fois. Nos yeux sont volages, désinvoltes face à la création, je trouve, alors qu’il faudrait nous permettre d’approfondir notre regard. Une amie anglaise, qui a rédigé pour l’édition de Vogue en Angleterre, me relatait qu’après la guerre, la National Gallery, à Londres, a commencé à faire revenir les œuvres une par une – pendant un temps, bien sûr – ; c’était le cas d’un Rembrandt, par exemple, pour lequel les gens se précipitaient. Ils se pressaient pour regarder une peinture. Je trouve que c’est un excellent exemple qui permet d’entrer dans l’œuvre sans être saturé. Ces correspondances favorisent cela, cette entrée dans le processus de création. Dans les lettres que Dylan Thomas adresse à Vernon Watkins – l’une des correspondances qui ne figurent malheureusement pas dans l’ouvrage –, le poète gallois demande quasiment à son ami de terminer ses phrases. Ça démontre que le rôle de l’Autre est très souvent capital.
8
Herman Melville et Nathaniel Hawthorne


Quel est-il, ce rôle ?
Il est de tous ordres, affectif bien sûr, intellectuel… Ce rôle prend bien des formes – ses habits, en quelque sorte – dans la relation amicale entretenue au fil des lettres. L’amitié n’est pas une, ni indivisible, elle ne constitue pas une fusion. Au contraire, elle présente bien des nuances, et je trouve cela très beau. On peut manifester du désaccord, se montrer sceptique. Cette confrontation peut parfois faire émerger autre chose qui n’existerait pas si l’Autre n’était pas là.
On le constate au fil des lettres, alors qu’on juge le sentiment d’amitié souvent inférieur au sentiment amoureux, il est parfois plus intense même que l’amour.
Oui, absolument. L’amitié vous dépasse. Elle se montre plus constante que l’amour, plus permanente. Elle est d’une autre teneur. Parfois, elle peut s’apparenter à une forme amoureuse. Dans ce cas, elle est aussi forte qu’une histoire d’amour…

En cela, l’amitié peut susciter bien des déchirures…
Oui, après une rupture, effectivement. On dit toujours que les amis se ressemblent, or, ils ne partagent pas toujours la même chose. Bien sûr, ils ont des points communs, un partage, mais ils restent très différents. On rencontre forcément des « semblables », c’est le cas de Pierre Bonnard et Édouard Vuillard qui sont d’une même onde. Mais certains sont totalement dissemblables. Regardez Sam Shepard et Johnny Dark – qui porte bien son nom, puisqu’il reste dans l’obscurité. Alors que Dark semble être la nature la plus fragile des deux, la plus domestique – la plus à la maison –, c’est pourtant lui qui, par sa force tranquille serais-je tentée de dire, porte beaucoup plus Shepard que Shepard ne le porte, lui. Mais vous avez raison, l’amitié peut être beaucoup plus violente, forte, que ne l’est l’amour lui-même. Après, pour moi, l’amitié ouvre plus à la création : un peintre partage plus avec un ami qu’avec une compagne ou qu’un proche issu de sa propre famille. L’altérité dans laquelle l’amour n’est pas mêlé peut être plus parlante grâce à l’amitié.
Ce projet, vous l’avez mené avec le philosophe Jean Lauxerois. Finalement, cette suite de correspondances, ne contient-elle pas ce que vous souhaiteriez dire de votre propre amitié ?
Absolument. En réalité, Jean était l’ami d’un de mes premiers compagnons qui était philosophe. Pour la petite histoire, nous avons été « rejetés » tous les deux. Quand j’ai écrit Images de pensée avec MarieHaude Caraës, j’ai demandé à Jean de rédiger la postface et il l’a fait. Ça s’est remarquablement bien passé. De même, quand j’ai travaillé sur Les Grands Turbulents (1880-1980), j’ai interrogé Jean sur ce qui m’a semblé constituer le premier groupe de « turbulents » en prenant en compte leur façon de vivre, de penser et de révolutionner la langue : les Romantiques allemands. Il m’a donné entièrement raison. C’est pourquoi je lui ai demandé d’écrire le texte en question. Ce texte, je le trouve si beau et la façon de travailler avec Jean si facile que je lui en fais part. Il me répond ceci : « Vous le savez, dans un travail à deux, il faut que l’attelage soit bien réparti. » J’ai beaucoup aimé cette phrase, je nous voyais comme deux bœufs avec un attelage royal comme le montrent les Japonais [Rires]. Si bien qu’au moment de débuter le travail sur 32 grammes de pensée, essai sur l’imagination graphique, je lui ai demandé d’y apporter sa contribution. Ce à quoi il a répondu qu’il le ferait « avec un immense plaisir ». Le travail s’est fait en toute amitié, sans le moindre nuage, chacun se complétant : je suis moi-même immédiate dans l’écriture alors que Jean est beaucoup plus conceptuel, avec une approche philosophique élaborée. C’est pourquoi j’ai
Pierre Bonnard et Édouard Vuillard
Stefan Zweig et Joseph Roth
9
Sam Shepard et Johnny Dark

souhaité, pour L’Amitié dans tous ses états, reconstituer cet attelage parfait. J’ai sélectionné les correspondances, mais nous ne souhaitions pas une simple suite de textes. D’où l’idée des nuances.
C’est effectivement lui qui apporte cette classification méthodique des nuances de l’amitié, en catégories, intimité, fraternité, pensée, création, quête, combat, et leurs sous-ensembles.
Oui, il a une grande part dans ces choix. Nous avons passé une semaine à établir le cercle des catégories et les nuances au cours de l’été dernier chez lui, à Figeac dans le Lot, près de Capdenac. Jean a écrit ce très beau texte – sans doute l’un des plus beaux ! – sur la correspondance entre Pier Paolo Pasolini et Silvana Mauri, ainsi que la postface sur l’amitié. Dans cette aventure, il m’a semblé capital. Pour moi, c’est un homme très libre. Quand je lui soumets un texte à relire, il me répond qu’il n’est pas « un correcteur ». Il regarde, mais laisse à chacun exprimer son univers. En cela, il est le compagnon de travail idéal.
À la lecture, on sent cette complicité, presque un sourire.
Oui, ça se sent [Rires]. Après, ça ne nous a pas empêchés de débattre du choix de ces nuances. Il allait très loin. Moi, j’ai souhaité en rester aux déclinaisons. Il me semblait que de placer des définitions de chacune de ces déclinaisons risquait de voiler la correspondance elle-même.
Cette classification reste indicative. Exactement.
Le lecteur est tenté de déplacer les nuances choisies et de les attribuer à d’autres correspondances.
Chaque lecteur lit autre chose, il peut avoir envie de les classer autrement.
Concernant la quarantaine de contributeurs à l’ouvrage, pourquoi leur attribuez-vous le nom d’« explorateurs » ?
C’était pour effectuer une distinction par rapport aux « auteurs » des correspondances euxmêmes, les duos dont il est question pour chacun des textes. J’aime assez l’image de l’explorateur ou de l’exploratrice qui, avec sa petite lampe au front, ramène à la surface le fruit de ses recherches pour nous partager sa connaissance. Le fait de révéler ce dévouement à un univers connu ou familier pour certains d’entre eux – comme c’est le cas pour Marion Graf, traductrice de l’œuvre de Robert Walser –, ou inconnu pour d’autres, me semblait rendre compte de ce travail à la fois de découvreurs ou de véritables initiateurs. Parmi les plaisirs occasionnés par l’ouvrage, la généreuse contribution de ces explorateurs a conduit à des choix souvent inattendus comme celui de notre plus jeune contributeur, Sacha Czertok qui a écrit sur Hermann Hesse et Thomas Mann. La preuve que Le Loup des steppes n’a pas totalement disparu du paysage des jeunes lecteurs. Il est réjouissant de constater que d’autres jeunes explorateurs se sont lancés, comme lui, sans hésiter.
Au moment de la réception des textes, nous imaginons une excitation particulière. Vous êtes-vous laissé surprendre par la variété des formes proposées, comme cette pièce de théâtre composée à partir de la correspondance entre Bonnard et Vuillard ?
Oui, bien souvent. Pour cette pièce, j’ai interrogé Ana Orozco – qui fait sa thèse sur Saint-Pol-Roux et Victor Segalen – et lui ai demandé : « Mais comment es-tu parvenue à entrer ainsi dans la tête des deux peintres pour composer ton texte ? » Elle m’a répondu que c’était contenu dans la correspondance et qu’elle a simplement repris les phrases des deux peintres. Il aurait été sans doute ennuyeux, voire systématique, si tout le monde avait composé une présentation avec des extraits de lettres. Chacun a abordé son texte de manière très inventive, y compris pour Víctor Erice et Abbas Kiarostami, avec un texte qui leur est directement adressé à tous deux.
Vous ne donniez pas de consigne particulière, si ce n’est le respect d’un certain calibrage. Et pourtant vous découvrez cette variété de formes au point qu’un texte prend la forme d’un courrier qui vous est personnellement adressé.
Oui, c’est le texte très étonnant de Nicolas Comment autour de la complicité entre André S. Labarthe et Jean-Luc Godard. Mais effectivement, je n’ai donné aucune consigne si ce n’est le nombre de signes, avec bien sûr l’indication de la correspondance à explorer. Je dois dire que j’aime tous les textes. Quelle que soit la forme ou la manière de dire, je leur voue une certaine
10
Pier Paolo Pasolini et Silvana Mauri
affection. Et j’ai pu le constater : les explorateurs ont été des merveilles, ils ont fait preuve d’une grande générosité avec des textes qui, parfois, pour certains d’entre eux, les sortaient de leur quotidien.
Concernant le graphisme de l’ouvrage, là aussi vous avez offert beaucoup de liberté à Isabelle Chabot, en charge de la mise en forme.
Oui, nous avons souhaité lui accorder cette liberté : il en résulte une façon presque ironique de « correspondre » – je n’aime pas le terme « illustrer » – avec ces correspondances, justement. Elle s’est emparée de chacun de ces textes pour situer le cœur de la correspondance et lui donner sa pleine tonalité. En cela, elle a effectué un travail harmonieux.
Au-delà de l’amitié, vous interrogez la rencontre et ce en quoi celle-ci, avant même de s’exprimer sous la forme d’une amitié, rend compte de belles émulations créatives…
Oui c’est le cas d’Arnold Schoenberg et Vassily Kandinsky par exemple, je ne connaissais que la participation du compositeur à L’Almanach du Blaue Reiter , et là je découvrais une histoire complexe entre ces deux grands créateurs, extrêmement novateurs chacun dans son domaine artistique, la musique et la peinture. Avec cette invitation du peintre au musicien de contribuer à L’Almanach, c’est vraiment inattendu et impressionnant !
Dans ces correspondances, on ressent une étonnante vitalité : des récits, des pensées, des idées. Implicitement, vous nous incitez à les parcourir toutes, ainsi que les œuvres respectives de chacun des auteurs.
Oui, je fais ce constat : ces correspondances sont vivantes. Cette incitation, je l’ai vécue moimême par de belles découvertes. En tant qu’usagère régulière de la Bibliothèque Publique d’Information à Beaubourg, je me rends bien compte qu’un ouvrage consulté sur une étagère incite à explorer celui qui se trouve juste à côté.
Vous ont-ils révélé des éclairages nouveaux, une intensité particulière, une singularité peut-être ?
Oh oui, je ne connaissais pas, par exemple, l’intensité de la relation entre Herman Melville et Nathaniel Hawthorne, ni celle d’Henry Miller et Blaise Cendrars. Ce qui est beau dans ces correspondances, c’est la constance. La création, contre vents et marées. On ne mesure pas aujourd’hui combien il était difficile de correspondre ainsi : en fonction des délais, la personne qui envoyait une lettre restait, anxieuse, dans l’attente d’une réponse qui tardait à lui parvenir.
Ce qui surprend c’est l’extrême précarité matérielle de ces vies – Dylan Thomas demande à Watkins de lui faire parvenir des timbres ! – et
L’amitié vous dépasse. Elle se montre plus constante que l’amour, plus permanente.
de ces artistes qui, pour rien au monde, n’auraient abandonné. Ils ont cela en eux, chevillé au corps. C’est la question du destin qui se pose là, cette forme d’abnégation que je trouve très belle. Je ne connaissais pas non plus les échanges entre Stefan Zweig et Joseph Roth, alors que j’étais familière de leurs œuvres respectives. Cette correspondance est bouleversante. Roth lutte tous les jours, mais il en arrive quand même à donner des leçons de mise en forme à Zweig. À juste titre, il sent la montée du nazisme. Zweig, dont je découvre la grande générosité, ne sent malheureusement rien venir. En tant que Juifs, ils sont en première ligne tous les deux, mais Roth perçoit avec une telle intensité le mal en train d’advenir qu’il peine à convaincre Zweig qui, lui, pense que tout cela va s’arranger. C’est parmi la grande force de ces correspondances que de nous révéler tout cela. Après, à titre plus personnel, je me sens bouleversée par le destin des écrivains et poètes juifs. Et je souhaitais leur rendre hommage.
Aujourd’hui, les correspondances prennent de nouvelles formes, plus volatiles, par le biais du numérique. Avec votre recueil, ne nous invitezvous pas à renouer avec la correspondance écrite ?
Oui, je crois que l’ouvrage est une invitation à correspondre.
— L’AMITIÉ DANS TOUS SES ÉTATS. CORRESPONDANCES, Conçu et présenté par Nicole Marchand-Zañartu et Jean Lauxerois, Médiapop Éditions mediapop-editions.fr
—
— 11

f oc - u s

Salut à toi
La BnF met à l’honneur le groupe phare des années 80, les Bérurier Noir (1983-1989), premier représentant du punk français à entrer dans les fonds d’une institution publique grâce au don de ses archives par deux membres du groupe, le chanteur Fanfan et le saxophoniste mastO. À travers une centaine de pièces, affiches, pochettes d’albums, carnets de notes, fanzines, photographies, vidéos ou autres nez de cochon, l’exposition nous rappelle la force des slogans anti-Front national et ravive un parcours d’engagement, d’indépendance et de résistance de toute une génération. Un rafraichissant retour sur l’aventure collective d’une scène alternative et de contre-culture qui ne se limitait pas à « faire de la musique ». (V.B.)
Même pas mort ! Archives de Bérurier Noir
À la BnF jusqu’au 28 avril
Nos régions ont du talent
Plutôt que sur le bout de la langue, l’artisan d’art a le talent au bout des doigts. Renouant avec la beauté du geste et le savoir-faire manuel, les Journées Européennes des Métiers d’Art mettent à l’honneur le patrimoine vivant de nos régions. Rencontre avec des corps de métier qui ne manquent pas d’âme (plumassiers, dominotiers, doreurs, fresquistes ou selliers), visites guidées d’ateliers (plus de 200 répertoriés dans le Grand Est) ou rendez-vous dans des monuments historiques dont l’histoire s’écrit à fleur de décor : de Plombières-lesBains à Bouxwiller, Lunéville, Colmar ou Mouzon, l’artisanat d’art ne se tourne certainement pas les pouces ! (M.M.S.)
Du 5 au 7 avril de 10 à 18 heures
Dans tout le Grand Est metiersdart.grandest.fr


Dans ma bouche
Parmi les propositions Temps fort du Maillon, une série de spectacles, ateliers, projections et rencontres ouvrira le printemps autour de la question primordiale de la langue, de toutes les langues. Depuis une vingtaine d’années, les réseaux sémantiques s’emparent de nos représentations et de nos connaissances. Leurs nœuds, arcs et liens tissent notre contemporanéité, parfois à notre insu, souvent avec notre accord, et nous dépossèdent de notre singularité analogique. Rendre la langue vivante, c’est s’emparer de sa réalité intime, se créer son vocabulaire, telle Simone de Beauvoir, dire le monde avec les 10 000 gestes de Boris Charmatz, recréer du sensible, de la liberté et de l’humanité. Un programme essentiel. (V.B.)
Langues vivantes, (D)écrire le monde Du 11 au 28 mars au Maillon, à Strasbourg www.maillon.eu
focus
Mirecourt luthier © A. Carbonare - P. Bodez
14
Festival Central Vapeur
Les mélopées orientales d’Ibrahim El Hasnawi, d’Ahmed Malek ou de Magdy El Hussainy : la parfaite BO accompagnant la contemplation du travail graphique de Raphaëlle Macaron. Connue pour son artwork des sorties de l’excellent label Habibi Funk, cette artiste originaire de Beyrouth réalise affiches, comics, couv’ de presse… et participe au Dialogue de Dessins, s’opposant à l’artiste strasbourgeoise Violaine Leroy pour la quatorzième édition de Central Vapeur. Le festival célèbre l’illustration, la bande dessinée, le dessin contemporain et nous convie à naviguer sur la/les « Méditerranée(s) », thématique 2024. (E.D.)
Du 24 avril au 19 mai Au Garage Coop, à La Menuiserie, au 5e lieu… centralvapeur.org
Dans le cadre des Rencontres de l’illustration (médiathèque AndréMalraux, Galerie Heitz, musée Tomi-Ungerer, Haute École des arts du Rhin…) Et dans le cadre de Strasbourg Capitale Mondiale du Livre UNESCO lirenotremonde.strasbourg.eu


Un ticket pour la lumière
La puissance de la voix de Vonfelt traverse le sombre bitume et le brouillard. Elle affronte la peur du noir pour venir caresser le velouté des cumulus violets. L’homme-orchestre, batteur de Jacques, sort un premier mini-album sous forme de nécessaire thérapie astrale élasticopop-wave hypnotique. Une invitation à prendre la poudre d’escampette, à draguer les dragons parmi les beats d’une lourde basse, à clamer des hymnes à l’amour déçu, sous le soleil de Satan, exactement. (E.D.)
Vonfelt (Vraiment records, Modulor) modulor-records.com En concert le 22 mars aux Trinitaires de Metz (première partie de Lescop) www.citemusicale-metz.fr
Like a bird
14 × 14 cm. Un petit carré cartonné et coloré. Pour les Éditions du livre, l’artiste multi-support (toile, textile, bois, bouse de vache…) Damien Poulain a réalisé un ouvrage de 16 pages, un livre pêle-mêle plein de piafs. Il suffit de tourner les pages pour créer une cinquantaine de drôles d’oiseaux à partir de formes géométriques simples. Des têtes de Birds bien plus chouettes que chez Hitchcock. (E.D.)
editionsdulivre.com

focus
Vonfelt © Ph. Lebruman
Where is the Friend’s House?, Raphaëlle Macaron (Even/ Odd Studio)
15

La Guerre sous l’étoile
« Et les étoiles brillaient/Et la terre embaumait », pleines d’une sorte de cruauté que même Shakespeare avait épargné à Macbeth, économisant le Ciel avant l’assassinat de Banquo, Puccini et Victorien Sardou laissent les étoiles allumées, laissent flotter le parfum de l’amour mis à mort. Après le Ciel, il y a ceux qui y croient, et il y a les autres. Ceux qui, en tapinois, font avancer Tosca, à force de croyances et de dogmes peu fréquentables. Tosca devrait s’imposer, en cela, comme une pièce des Temps Modernes. Un truc ancien, à voir pour comprendre un peu de ce qui se trame aujourd’hui. Contempteur des croyances faciles, du privé révélateur et d’une humanité radicale, Dominique Pitoiset, acteur directeur de l’Opéra Dijon, fait sonner clair le tube de Puccini. Après un Turandot pop et inquiet, en janvier dernier, la grande maison dijonnaise remet une nouvelle production de l’Italien sur le métier. Debora Waldman à la baguette, Orchestre et Chœur maison, Maîtrise de Dijon en grande maîtrise face au trio infernal, rôti par le baron Scarpia dans les murs de la Ville éternelle. Résumé : Des troupes réactionnaires du pouvoir monarchique napolitain s’activent et ficèlent au lendemain de la victoire de Bonaparte à Marengo. Floria Tosca, cantatrice et amoureuse du peintre humaniste Cavaradossi, ira jusqu’à assassiner Scarpia, chef de la police et baron, liberticide fan de soutane. Très habile pour nuire, ce dernier livre, très froid, le plat de sa vengeance posthume. Au-delà de toute étoile.
Par Guillaume Malvoisin — TOSCA, opéra du 12 au 18 mai à l’Opéra de Dijon, à Dijon opera-dijon.fr

La vénérable légèreté de l’être
Merci, de rien. Voilà du théâtre de rien. Ou plutôt du théâtre de force, taillé dans le peu et animé de la force de la vie elle-même. Jugez plutôt. Côte d’Ivoire, 1981, Nadia Beugré nait dans un quartier populaire d’Abidjan. C’est au même endroit que la danseuse et chorégraphe rencontre la communauté transgenre. De ces entretiens et de ces échanges, elle cisèle Prophétique (on est déjà né·es). Théâtre dansé, spectacle de peu. Aboiements, Ravel-boléro-popisé, Chewinggum et une puissance vulnérable poussée à son paroxysme. Le plateau de Prophétique est un ring où on s’y bat et débat avec soi. Amateurices et pros, compris es. Fracturé dans son histoire et dans son rapport aux genres, le plateau de théâtre s’active d’une modernité impressionnante, où chacun et chacune fait le choix de ses armes et du courage pour s’affirmer, être soi, se révéler au public et au monde, ce qui n’est jamais loin d’être la même engeance. Programmée en partenariat avec Le Dancing CDCN, dans le cadre du Festival Art Danse, la pièce met le corps au centre du mouvement de son ensemble, explicite les recherches de Nadia Beugré sur les marges, l’exclusion et les identités mouvantes, ignorées dans le meilleur des cas, souvent malmenées, toujours stigmatisées pour ce qui est du côté d’Abidjan. On avance, on se confronte, on prend soin de soi et de la beauté des autres, on dresse des dancefloors où le voguing et le coupédécalé explose l’espace dessiné par la pauvreté plastique de quelques choses et ficelles. Nadia Beugré déjoue les codes et les clichés avec un violente douceur, celle de l’invention de soi et des autres.
Par Guillaume Malvoisin
— PROPHÉTIQUE (ON EST DÉJÀ NÉ·ES), théâtre le 6 avril au Théâtre Dijon-Bourgogne CDN, à Dijon www.tdb-cdn.com
focus
Prophétique (on est déjà né·es) © Werner Strouven
16
Tosca © Mattotti


Viens voir les musiciennes
Parce qu’il reste encore beaucoup de travail (acharné) avant d’arriver à un certain équilibre de genre dans un milieu majoritairement masculin, le dispositif Musiciennes propose une nouvelle semaine de sensibilisation à la diversité et à l’inclusion dans la scène musicale française. Fruit de la collaboration du Bastion, de la Rodia et de Mazette!, ce temps fort dédié à la création féminine offre ainsi, pour la troisième année consécutive, la possibilité aux pros de participer à de nombreux ateliers, tables rondes, coaching, temps d’échanges (…), et au public de profiter de diverses rencontres thématiques centrées sur l’accès en égalité à la pratique musicale.
Résolument engagé, forcément décapant, Musiciennes se veut également bigrement festif, avec une soirée de clôture en mode « all night long » à la Rodia, electro 100 % féminine, et réalisée en partenariat avec le collectif Boom Rang à l’occasion de son premier anniversaire. Derrière les platines, des demoiselles qui ont ce qu’il faut là où il faut, notamment Sérotonine, ponceuse de dancefloor et activiste de la scène électro féminine depuis plus de dix ans ; sans oublier la jolie rose Irène Drésel et sa techno haute en couleur aussi sensuelle que frontale, véritable artiste polymorphe à l’univers fleuri quasi hypnotique. Ou comment allier le (très) utile à l’agréable !
Par Aurélie Vautrin
— MUSICIENNES À BESANÇON,
concert le 20 avril à la Rodia, à Besançon larodia.com musiciennes-mab.fr

Engagez-vous
Créé en 1988 par deux enseignantes, danseuses et chorégraphes passionnées, le festival Art Danse est devenu au fil des années « le » grand rendez-vous de danse contemporaine en région Bourgogne Franche-Comté. Trois semaines d’installations et de performances sur la métropole dijonnaise pour apprécier la création chorégraphique actuelle. Ici, les esthétiques se croisent, les sensations et les renommées aussi – les artistes sont internationaux, nationaux, locaux, avec pour point commun la danse comme langage universel, et la nécessité d’exprimer par le corps leur vision du monde d’aujourd’hui. La version 2024 se veut donc percutante, avec pléthore de créations militantes et engagées, façon cri d’alarme et constat amer d’une société à la dérive, le tout matérialisé avec rage, révolte, esthétisme – humour et poésie aussi. D’autant que le festival fait la part belle à la parité, à la diversité, à la fidélité, mais aussi à la découverte, en accueillant cette année des artistes comme Gaetano Cunsolo ou César Vayssié, Lenio Kaklea, Étienne Rochefort, Malika Djardi, Marc Lacourt ou Betty Tchomanga. On retient également la programmation en soirée de clôture du très apprécié Prophétique (on est déjà né.es) de Nadia Beugré, spectacle consacré aux femmes transgenres d’Abidjan, divas de nuit, coiffeuses de jour, invisibilisées par une société qui fait semblant de ne pas les voir, mais qui, pourtant, tiennent une place essentielle dans le fonctionnement du pays. Follement beau !
Par Aurélie Vautrin
— ART DANSE, festival du 16 mars au 6 avril au Dancing et autres lieux, à Dijon ledancing.com
focus
Prophétique (on est déjà né.es) de Nadia Beugré © Werner Strouven
18
Irène Drésel © Valérie Mathilde
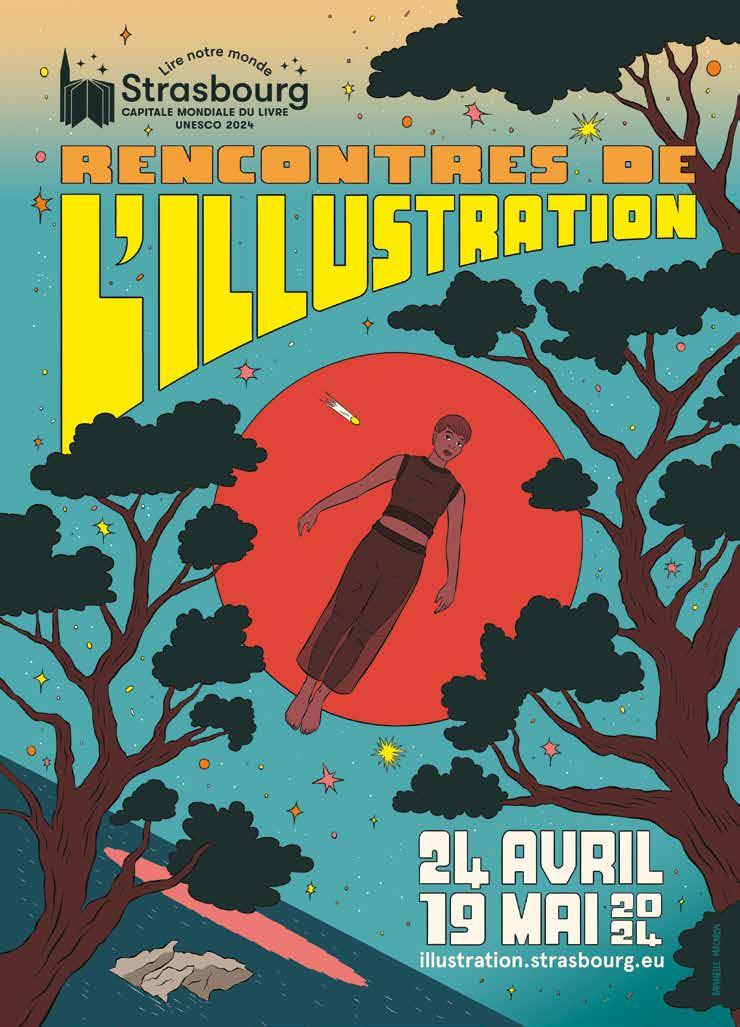

La classe éco
Fidèle à ses valeurs, le festival Rencontres & Racines version 2024 promet un nouveau tour du monde des musiques, des saveurs et des cultures, le tout sans faire exploser son empreinte carbone puisque tout se passe du 28 au 30 juin dans l’enceinte du parc Japy à Audincourt. De la Côte d’Ivoire aux Balkans en passant par la Belgique, le Royaume-Uni, le Midwest américain, le Congo ou le Maroc, le voyage s’annonce à la fois éclectique, coloré et, bien évidemment, ultra festif, avec plus d’une trentaine d’artistes, confirmés ou pépites en devenir, à découvrir sur les quatre scènes du site. Sont ainsi notamment attendus Selah Sue, Goran Bregović, Tiken Jah Fakoly, Dub Inc, Chinese Man, Babylon Circus, Caravan Palace, Simone Ringer, Kikesa, Féfé, pléthores de jeunes artistes locaux… Sans oublier la venue d’une sorcière réconfortante, « tu sais, la chanteuse avec les points sous les yeux » comme elle aime se décrire, l’ensorcelante Solann… La nouvelle étoile de la pop-folk frenchie viendra en effet hypnotiser le public avec ses douces mélodies – tout en bousculant le patriarcat avec ses textes brûlants comme de l’acide citrique. On n’oublie pas non plus la journée du dimanche dédiée aux kids et la visite du grand village associatif et citoyen, tout en prenant le temps de déguster la cuisine des restaurateurs du coin, proposée en filière courte, avec produits locaux et matériaux recyclés. Vous avez dit incontournable ?
Par Aurélie Vautrin
NDLR : On a failli oublier le magnifique duo formé par le chanteur d’opéra Serge Kakudji et David Demange, qui a décidément plus d’une corde à sa guitare. Une occasion unique de découvrir la musique classique en toute simplicité et dans un très beau cadre
— RENCONTRES & RACINES, festival du 28 au 30 juin, à Audincourt rencontresetracines.audincourt.fr
focus
20
Solann © Adriania Pagliai



Jours de fête
En Suisse, la Fête de la Danse est un événement national, avec pléthore d’événements à retrouver dans une trentaine de villes, au bord des lacs et sur les places publiques, dans les parcs, les musées, les cinémas et les zones piétonnes. Le tout porté par une « énergie du renouveau », qui se veut à la fois fédératrice et joliment multicolore… Grande nouveauté cette année, VIADANSE, le Centre chorégraphique national de Bourgogne Franche-Comté s’associe à la manifestation ! Ainsi, du 3 au 5 mai prochains, se tiendront également à Belfort trois jours de rencontres, de spectacles, de projets participatifs et de découvertes en écho aux festivités proposées par le Théâtre Nebia à Bienne. L’occasion notamment de découvrir en avant-première Fantaisie pour passement de jambes, la nouvelle création de Héla Fattoumi et Éric Lamoureux. Dans ce nouveau projet, le duo à la direction de VIADANSE depuis 2015 explore cette fois les liens entre la danse et les gestes du football. Aile de pigeon, brossé intérieur, coup du foulard et reprise de demi-volée donnent ainsi une composition inattendue, entre corps performant et corps poétique, une mi-temps chorégraphique étonnante et pleine de poésie, inclusive et populaire. Sans oublier également sur la période des temps d’échanges, des spectacles in situ, une scène ouverte et une soirée dancing avec DJ-set et food truck. Alors, on danse ?
Par Aurélie Vautrin
— FÊTE DE LA DANSE, festival du 3 au 5 mai à VIADANSE, École d’art et avenue de l’Espérance, à Belfort www.viadanse.com
focus
22
Fantaisie pour passement de jambes de Héla Fattoumi & Éric Lamoureux © Mohamed Lamqayssi



D’un sommet à l’autre
Vingt-quatre battements par minute. L’un des cœurs au rythme le plus bas recensés au monde. Si la façon dont pulsent les veines de Martin Fourcade appartient à peine au réel, il est bien le sportif français le plus titré de toute l’histoire aux Jeux olympiques. Cinq médailles d’or et un parcours unique depuis ses débuts en 2007, le meilleur biathlète de son temps pouvait se permettre d’emprunter la route tranquille des adieux. En mars 2020, ce qui aurait dû prendre des allures de jubilé lors de la dernière course et victoire de sa carrière sur les pistes de Kontiolahti en Finlande se déroulera à huis clos, les ailes du Covid se refermant en confinement.
Privé de son public et d’un dernier partage, Martin Fourcade quitte définitivement ses skis et décide de monter sur scène. Avec Hors-Piste, il entreprend avec audace de mettre en mots, avec la complicité du documentariste Sébastien Deurdilly, des pleins feux inattendus sur sa propre légende, mais aussi une mise en abyme plus intime. « Ma première médaille, c’était des pleurs, pas de la joie. » Digne d’une tragédie du théâtre antique, on se souvient de ce moment intense où son frère ainé, promis au podium, se fait évincer par le cadet. Tour à tour drôle, émouvant, Martin Fourcade se déploie dans une sincérité qui interroge aussi avec vigueur les enjeux d’une vie totalement dédiée. Largement suivi par son ancien et nouveau public dans une tournée déjà triomphale, le champion et désormais acteur excelle dans ce spectacle mis en scène par Matthieu Cruciani.
Par Nathalie Bach
— HORS-PISTE, théâtre les 14 et 15 mars à la Comédie de Colmar, à Colmar www.comedie-colmar.com

Jeu, set et match
Six ans déjà que la Quinzaine de la Danse est devenue le rendez-vous chorégraphique incontournable du territoire mulhousien. Initiée par Thomas Ress, directeur de l’Espace 110 d’Illzach, portée par Benoît André, le directeur de La Filature et par Bruno Bouché, le directeur du Ballet de l’Opéra national du Rhin, la nouvelle édition permet de faire rayonner un travail axé sur la quête de sens tout en favorisant l’accès au plus grand nombre. Dans un monde à interroger, comprendre et poétiser, les propositions chorégraphiques mettent en perspectives les multiples enjeux esthétiques du mouvement et résolvent, peut-être, quelques-unes de nos grandes questions de société. La programmation incroyablement riche, plurielle et multiple sera à découvrir d’une structure à l’autre grâce au pass Quinzaine : On achève bien les chevaux de Bruno Bouché, Clément Hervieu-Léger et Daniel San Pedro ; Gounouj de la Cie Zimarèl/Léo Lérus ; Tout-Moun de Héla Fattoumi et Éric Lamoureux ; Kamuyot d’Ohad Naharin ; Body Bagarre - Le jeu de la Cie R/Ô ; Charcoal de la Cie Pièces Détachées ; Grains de la Cie Simon Feltz ; et du côté des compagnies québécoises Le Patin Libre, Murmuration, et Marie Chouinard, M. Sans oublier les Visites dansées de la Cie Callicarpa – Aurélie Gandit, les Yellow Party de Mickaël Phelippeau avec un DJ set de Barbara Butch ou encore les ateliers pour se frotter à la puissance créative du corps.
Par Valérie Bisson
— QUINZAINE DE LA DANSE, événement du 7 au 26 mars à l’Espace 110, à Illzach, à La Filature, à Mulhouse, et au CCN Ballet de l’Opéra national du Rhin, à Strasbourg www.operanationaldurhin.eu www.lafilature.org
focus
© Pascale Cholette
24
Murmuration - Le Patin Libre © Rolline Laporte



Mythe & Légende
Pour toujours et à jamais, Marylin Monroe restera une icône, un symbole, une légende. Bien au-delà de la femme, du corps, de sa représentation, du personnage. De celle qui tutoie les étoiles, qui transcende tout, les frontières, les genres, les générations, ange tombé du ciel aux ailes qui ont continué de saigner malgré les pansements et les artifices et le maquillage. À partir de textes écrits par Marilyn elle-même à différents moments de sa vie – des interviews, des lettres, des notes biographiques, des poèmes, des écrits personnels… – la comédienne Nathalie Bach cherche à lever le voile sur la véritable personnalité d’une femme devenue star. Raconter l’intelligence non autorisée, malmenée, la solitude omniprésente, écrasante, la douleur et la nécessaire futilité aussi. Accompagnée au piano par Christophe Imbs, Nathalie Bach se lance ainsi dans une lecture passionnante, sans mimétisme, sans volonté d’incarner ou d’imiter, comme un long planséquence sublimé par une musique hypnotique aux accents jazzy. Si la pièce a été créée il y a plus de dix ans, le fond, lui, n’a pas pris une ride. En même temps, les légendes ne meurent jamais, n’est-ce pas ?
Par Aurélie Vautrin
— NORMA JEAN BAKER… MARILYN MONROE, théâtre le 5 avril à la Salle du Cercle, à Bischheim salleducercle.fr

On est quand même tous des Européens
Pensée après la crise Covid et partie du constat d’un repli social et professionnel autour des scènes du spectacle vivant et de la filière des musiques actuelles (téléchargement en ligne, fermeture des salles de concert, concerts retransmis), la convention professionnelle Strasbourg Music Week, initiée par Isabelle Sire, a vocation à remettre en perspective les métiers, acteurs et créateurs de la scène musicale professionnelle. Et ce, en allant également retrouver les musiciens trop isolés dans leurs lieux de répétition ou leurs home studio. Pendant trois jours, bookers, producteurs, communicants, gérants, managers issus des scènes suisses, allemandes, belges, luxembourgeoises et françaises (avec une priorité au Grand Est) se rencontrent autour de conférences, workshops et showcases pour échanger sur leurs pratiques, mutualiser leurs savoirs, s’inspirer les uns des autres et rencontrer ceux sans qui rien n’adviendrait : leurs publics. Plus de 180 professionnels dans un rayon de 300 km ont répondu présents en 2023 et des échanges entre les pays se mettent déjà en place puisque dix étudiants stagiaires seront accueillis lors de cette deuxième édition de Strasbourg Music Week dédiée à la réflexion et à l’exploration des marchés frontaliers. Parmi les nouveautés : un slow meeting, des pitchs et des blitz sessions s’ajoutent au programme et il sera toujours temps de discuter de manière informelle avant ou après les mini-showcases en soirée. Penser global, agir local est une formidable preuve de bonne santé démocratique. À bon entendeur !
Par Valérie Bisson
— STRASBOURG MUSIC WEEK, événement du 21 au 24 mai à Strasbourg strasbourgmusicweek.eu
focus
26
Nathalie Bach © Michel Nicolas

L’énigme Jean-Sébastien Bach
À l’occasion de ses concerts qui ont lieu les dimanches matin, dans une atmosphère intime, l’Orchestre philharmonique de Strasbourg reprend cette fois une célèbre messe sacrée, en la sécularisant. Ce printemps, il jouera quelques-unes des œuvres rituelles composées par Jean-Sébastien Bach, dont aucune interprétation n’épuise l’énigme. On pourra entendre le Concerto pour violon et hautbois, le Concerto pour violon en la mineur, le Concerto pour deux violons en ré mineur, mais aussi l’air « Erbarme dich », dans un arrangement pour violon et hautbois d’amour, extrait de La Passion selon saint Matthieu Le violoniste virtuose franco-serbe Nemanja Radulović, en résidence au sein de l’Orchestre cette saison, emmènera dans le sillage de ses envolées envoûtantes Charlotte Juillard, Thomas Gautier et Hedy Kerpitchian aux violons également, Joachim Angster à l’alto, Olivier Garban au violoncelle, Thomas Kaufman à la contrebasse, Sébastien Giot au hautbois, et Eva Valtova au clavecin. Si l’on en croit Aziz Shokhakimov, le chef d’orchestre strasbourgeois, Nemanja Radulović « a une influence presque magique sur les musiciens et le public ». Ce dernier, il est vrai, est passé par les plus grands orchestres : l’Orchestre philharmonique de Munich, le Deutsches SymphonieOrchester de Berlin, la Staatskapelle de Dresde, l’Orchestre symphonique de Montréal, ou encore l’Orchestre philharmonique de Radio France. Interprétant avec l’Orchestre philharmonique de Strasbourg La Passion selon saint Matthieu, il donnera à entendre la lamentation de Pierre, qui fond en larmes en comprenant qu’il vient de renier son ami Jésus de Nazareth et qu’il n’a pas su écouter la voix de l’amour en lui. Schaue hier, Herz und Auge weint vor dir bitterlich… Regarde, mon cœur et mes yeux pleurent amèrement pour toi… Telle est l’histoire à laquelle l’OPS donnera un nouveau souffle, histoire de larmes qui sont aussi un geste esquissé vers l’autre.
Par Clément Willer
— LES DIMANCHES MATIN DE
L’ORCHESTRE, concert le 21 avril à la Cité de la musique et de la danse, à Strasbourg philharmonique.strasbourg.eu

En un éclair
« Pour ce spectacle, j’imagine une forêt chorégraphique dans laquelle aucun geste n’est jamais répété par aucun des danseurs en présence. 10 000 gestes qui ne seront visibles qu’une seule fois – disparus aussitôt que tracés, comme une ode à l’impermanence de l’art de la danse. » Figure majeure de la nouvelle vague française, Boris Charmatz signe avec 10 000 gestes une véritable prouesse dans tous les sens du terme. Sur scène, une vingtaine de danseurs, la plupart chorégraphes de niveau international, qui accomplissent à la vitesse de l’éclair des milliers de gestes avec leur corps, leurs mains, leurs pieds, leurs jambes, chacun d’eux formulant sa propre partition sur l’inégalable Requiem de Mozart. 10 000 gestes jamais répétitifs, sans lien ni symétrie entre eux, comme une explosion chorégraphique pour figurer l’éphémère, un pari hors normes, un tour de force à la fois euphorisant, hypnotisant, une humanité grouillante, bouillante, vivante, aux prises avec ses propres mouvements, propositions, états d’âme. « Dans 10 000 gestes, c’est la fugacité poussée à son paroxysme qui génère le regard et la pensée du spectateur. Le chaos de dépense est tellement parfait qu’il confine à l’immobilité. » Présentée par POLE-SUD en collaboration avec le Maillon, cette pièce nous invite à un véritable voyage hors du commun, aussi collaboratif qu’introspectif – et pas loin pour certains de ressembler à une masterpiece.
Par Aurélie Vautrin
— 10 000 GESTES, danse les 20 et 21 mars au Maillon, à Strasbourg pole-sud.fr maillon.eu
focus
10 000 gestes © Tristram Kenton
27
© Nicolas Rosès

L’exposition d’une femme
Saviez-vous que la célèbre Fontaine de Marcel Duchamp, mondialement connue pour être l’œuvre à l’origine même de l’art conceptuel, aurait en réalité été créée par « une femme », la baronne et poétesse allemande Elsa Von Freytag-Loringhoven ? Un exemple parmi (tant) d’autres de ces personnalités féminines purement et simplement effacées de l’Histoire, femmes sacrifiées dans la course au patriarcat glorifié. Une invisibilisation banalisée qui sert aujourd’hui de point d’ancrage à Juliette Steiner et la compagnie strasbourgeoise Quai n°7 pour leur nouvelle création sobrement intitulée Une exposition, pièce de théâtre en forme de point vengeur à l’Histoire de l’art dans toute sa splendeur. Au cœur de la pièce, le travail (fictif) de Julia Armutt, plasticienne récemment disparue, bien plus célèbre pour avoir été « la femme d’ » un célèbre sculpteur que pour ses propres œuvres. Après sa mort, sept de ses proches sont réunis dans une galerie d’art contemporain pour suivre ses dernières volontés : réaliser le montage de sa dernière œuvre – une exposition posthume qui prend rapidement la forme d’un malicieux requiem pour la liberté. Après le succès de Services, créée la saison dernière, Juliette Steiner et Olivier Sylvestre s’allient donc à nouveau pour mêler leurs langages hybrides, follement vivants, entre écriture dramatique et écriture de plateau. De quoi (vivement) attiser notre curiosité.
Par Aurélie Vautrin
— UNE EXPOSITION, théâtre du 4 au 6 avril au TJP, à Strasbourg et les 30 et 31 mai à la Filature, à Mulhouse tjp-strasbourg.com

Sans contrefaçon
On l’a découverte les cheveux orange en lice pour Eurovision France avec « Navigateure », extrait de son album-concept Sérotonine. Elle détonne dans le paysage, tente la chose pour l’expérience, petite bombe à retardement prête à dégainer ses titres à chaque attaque du patriarcat établi. À l’époque, la demoiselle se cherche encore, mêle electro, pop et RnB, fait des feats avec des rappeurs et des expériences avec la musique comme un savant fou dans son labo. On la rapproche de Mylène Farmer ; elle répond qu’elle fait partie de son ADN, comme Björk ou Rosalia. Ancienne étudiante en cinéma, elle réalise elle-même ses clips, prône le poing levé le droit au désir féminin et profite de sa musique pour rugir son combat contre le sexisme et l’homophobie. Aujourd’hui, la demoiselle a négocié un virage à la corde avec des influences plus rock, plus dark, plus ambient ; les mots, eux, sont toujours tranchants comme des rasoirs. « J’apprends à vivre avec ma sensibilité, ses trésors et entrevoir la lumière malgré l’ombre très présente dans notre quotidien, explique-t-elle. Au-delà d’un projet musical, j’ai imaginé cet album comme un processus menant vers la guérison sous toutes ses formes : revendiquer son humanité, sa liberté, faire taire son égo, brûler d’amour, se sentir en phase avec soi pour aller chercher l’extase. » Avec Where’s the Light?, elle continue ainsi son processus et sa lutte, telle une exploratrice à la douceur foudroyante en recherche perpétuelle d’une nouvelle terre à inventer.
Par Aurélie Vautrin
— JOANNA, concert le 16 mars à la chapelle des Trinitaires, à Metz www.citemusicale-metz.fr
Une exposition, cie Quai n°7 © Michel Grasso
focus 28
Joanna © E.Bowes

Printemps francophone
Certains linguistes qui se disent pourtant atterrés nous l’affirment : le français va très bien, merci pour lui. Certes, il emprunte mais il donne aussi, il cède à son tour des mots et vient enrichir le grand dictionnaire du monde. En somme, la langue française vit sa vie de langue. Forte de ce constat, l’Alliance française Strasbourg-Europe poursuit son exploration de la diversité des cultures. Tout d’abord, il s’agira de célébrer la Francophonie en se plaçant au diapason des festivités mondiales. La fête commencera avec l’exposition située « Par-delà les frontières » par François Burland, puis elle fera résonner les accents afro-caribéens le temps d’une soirée musicale et poétique, avant de lancer un cycle de conférences destiné à dresser un état des lieux résolument pluriel du français tel qu’on le pratique aujourd’hui. D’ailleurs, de l’autre côté du monde, au Japon pour être précis, des artistes et intellectuels témoignent eux aussi de leur francophonie choisie. En retour, l’Alliance française se propose de saluer cette fascination réciproque. Loin des clichés, ces Semaines japonaises permettront de croiser des modes d’expression traditionnels et contemporains, qu’il s’agisse de faire dialoguer calligraphies, yukata (le kimono d’été) et les photographies issues de la collection de Madeleine Millot-Durrenberger, de faire découvrir au public français le rakugo, l’art captivant des conteurs itinérants ou bien encore d’interroger l’écrivain Akira Mizubayashi pour évoquer les modifications qui opèrent chez celui qui a choisi d’embrasser une autre langue d’écriture.
Même le manga ne sera pas oublié, pour attester, s’il le fallait, de la vitalité de la culture populaire japonaise. Alors, oui, le français n’est pas la langue de tout le monde, mais c’est bien une langue où chacun peut se retrouver. Un bien commun à partager comme l’illustre cette programmation encore une fois marquée par un éclectisme roboratif.
Par Robert Lenoir
— SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE, exposition, musique, poésie, conférences du 15 au 22 mars
— SEMAINES JAPONAISES
(sous le patronage du Consulat général du Japon à Strasbourg), exposition, conte, rencontres du 10 avril au 7 juin dans la Grande Salle de l’Alliance française Strasbourg-Europe, à Strasbourg www.afstrasbourg.eu

Sororité absolue
Après deux saisons musicales de Ah ! Les Femmes…, faites place aux Music&lles, un tout nouveau festival dont l’objectif principal est d’explorer encore plus en détail les thématiques et liens entre femmes, musiques et genre(s). « Il est vital pour l’équilibre de ce monde de faire entendre vos voix, nos voix, d’autres récits, les vôtres et ceux d’artistes encore trop méconnues », explique en préambule Séverine Cappiello, directrice de la Sturm Production et organisatrice, en parallèle, du festival Jazz à la Petite France, à Strasbourg. Poussée par l’envie de faire découvrir un « matrimoine musical créatif et bien vivant », elle lance aujourd’hui un événement entièrement dédié aux projets menés par des femmes dans le milieu des musiques actuelles, « l’un des secteurs les plus verrouillés et discriminés de France ». Avec au programme des ateliers thématiques ou de pratique artistique, des rencontres, des conférences, des créations et, bien entendu, des concerts follement hétéroclites, jazz, pop, electro et autres projets sonores en pleine mutation. Sans oublier un atelier DJ avec WOM·X, accessible aux jeunes filles, trans et non binaires à partir de 8 ans ! On ne manquera pas également d’assister à la prestation forcément envoutante d’Hannah Featherstone, autrice-compositrice-interprètepianiste franco-britannique, dont la voix habille le silence et tisse une musique electro-pop contemplative, aussi ciselée que délicate.
Par Aurélie Vautrin
— LES MUSIC&LLES, festival du 8 au 16 mars à la Maison des associations, à la BNU et à Nootoos, à Strasbourg, et au Château, à La Petite-Pierre sturmprod.com/lesmusicelles
focus
Hannah Featherstone © Alfredo Salazar
29
Œuvres de François Burland exposées pendant la Semaine de la Francophonie

Le corps en jeu
L’exposition « Frisbee ! Sports Et Loisirs » bénéficie du label Paris 2024, mais a été imaginée pour la Kunsthalle de Schwäbisch Hall autour du dessin de Fernand Léger, Les loisirs (1944). L’envie était de confronter les œuvres évoquant les « sports, loisirs & jeux », activités proscrites pendant les restrictions. Le musée Würth France Erstein se l’approprie en cette année olympique, préservant avec près de 80 œuvres l’ambition de l’originale. D’emblée, l’ancien et le contemporain s’affrontent : un coureur cycliste à terre (sculpture hyperréaliste de Jan Nelson) et les répliques romaines en plâtre du guerrier blessé, du discobole devant le joueur de frisbee sur son pénétrant fond vif orange (Donna Stolz) cinglent la perspective. Au rez-de-chaussée, les œuvres souvent de grand format montrent le corps martyrisé par l’effort, la mécanique, les mêlées, la vitesse (trait enfiévré des encres d’Höckelmann), mais aussi par la tauromachie et la danse. L’ironie (Tomi Ungerer) ou deux plongeuses en apesanteur (Christine Gallmetzer) suggèrent leur alternative à la rage compétitrice, tandis que l’étage pose le nouveau rapport à l’espace et au temps né de l’industrialisation (pertinent catalogue). La marche s’approprie la nature, surtout la montagne teintée d’un romantisme assagi ; le balnéaire ou la fête virent avec le tourisme de masse à l’oppressif. Le jeu achève le parcours avec les échecs et la volonté de célébration collective (affiches des JO 1972). Entre Pissarro, Miró, Grosz, Ernst, Morellet… les bronzes tourmentés d’Alfred Hrdlicka affirment en Leitmotiv que « toute la force de l’art vient de la chair ».
Par Luc Maechel
— FRISBEE ! SPORTS ET LOISIRS, exposition jusqu’au 15 septembre au Musée Würth, à Erstein musee-wurth.fr
focus
30
Michael Halsband, Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol, 1985. Collection Würth, Inv. 7018 Photo : Archiv Würth © DR

Good Morning America
Ils ne sont pas américains, mais leur musique semble tout droit sortie d’un garage US des années 60, le son rugueux, âpre et rêche en prime. Un mélange de delta blues et de rock underground, de kraut et de fuzz, une musique de connaisseurs qui anime autant qu’elle soulage. Eux, c’est Hoboken Division, basé du côté de Nancy, mais dont le son a résonné jusque sur la BBC et les radios de l’Oncle Sam. À l’origine, il n’y avait que Marie et Mathieu, elle au chant, lui à la guitare, les percus gérées avec une boite à rythmes. Depuis, ils ont été rejoints par Czmil à la batterie, sans pour autant renier leur identité musicale : l’authenticité, la démarche rocailleuse, un son brut de décoffrage et les tripes sur la table, le tout porté par des pédales d’effets faites maison. Si leur premier album est sorti en 2015, voilà qu’ils sortent déjà leur quatrième disque, Psycholove, affirmant s’il le fallait encore leur caractère bien trempé, à la fois un poil insubordonné et parfaitement maitrisé. Sur scène, c’est une visite des tréfonds de l’Amérique, quelque part entre Détroit et le port de New York, avec des escales en Allemagne et à Manchester à la rencontre d’autochtones bourrus, mais furieusement sympathiques. D’autant qu’ils vous invitent aujourd’hui à leur release party à L’Autre Canal le 26 avril, en compagnie de César Palace et Marie Madeleine, d’autres produits du terroir burinés à l’authentique. Mais ceci est une autre histoire…
Par Aurélie Vautrin
— HOBOKEN DIVISION, concert le 26 avril à L’Autre Canal, à Nancy www.lautrecanalnancy.fr
focus
31
Hoboken Division © Perisse

Ciel, mon Mari !
Il nous toise de ses grands yeux craintifs. Sorte d’E.T. en bronze, vestige d’un passé très lointain, le lion du temple du Seigneur-du-Pays observe le visiteur, comme il l’a longuement fait au cours des siècles à Mari en Syrie (titre de l’expo de la Bnu). Ce protomé (avant-corps) date du xxiie siècle av. J.-C. et a été découvert lors des fouilles réalisées par le pasteur André Parrot en 1937. Missions poursuivies plus tard par Jean-Claude Margueron et ses « disciples » de l’Université de Strasbourg. De son air tristouille, le fauve vert semble raconter sa douloureuse séparation : depuis 2011 et l’arrêt forcé des recherches archéologiques sur site, le pensionnaire du Louvre n’a plus aucune nouvelle de son compagnon félin domicilié au Musée national d’Alep, ville saccagée. Que le gardien du temple se réjouisse : l’exposition de la Bnu retrace la fantastique aventure de cette ville proche-orientale du iiie millénaire, de l’époque des Shakkanakkus (2250-1810 av. J.-C.).
Mystérieuse cité plusieurs fois détruite et aujourd’hui malmenée par missiles et tractopelles, Mari est à la fois puissant carrefour commercial du bord de l’Euphrate, riche productrice d’artisanat métallurgique, pieuse contrée où sont vénérées les divinités… Parmi les chefs-d’œuvre montrés, il y a la statue en albâtre d’un porteur de chevreau prêt au sacrifice, de complexes tablettes administratives en argile – ancêtres des tableaux Excel –, de fins bijoux en lapis-lazuli ou encore l’immense corps du Shakkanakku Puzur-Ishtar qui, magie du moment, retrouve sa tête. Miraculeux alors que l’on sait d’Emmanuel Marine, conservateur à la Bnu, que « dans l’histoire de Mari, le thème de la destruction revient comme un couplet ».
Par Emmanuel Dosda
— MARI EN SYRIE :
RENAISSANCE D’UNE CITÉ AU 3E MILLÉNAIRE, exposition jusqu’au 26 mai à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, conçue en partenariat avec le Domaine et Musée royal de Mariemont (Belgique) et le musée du Louvre www.bnu.fr

Un jour, peut-être
Lors d’une résidence à Berlin, le comédien et metteur en scène Cédric Djedje découvre que plusieurs rues de l’Afrikanisches Viertel – le « quartier africain » – portent le nom de colonisateurs allemands. Depuis plusieurs années, des associations africaines et afroallemandes luttent pour les faire renommer, afin d’honorer plutôt des figures de la résistance africaine. Mais le projet, embourbé dans les méandres de la justice, stagne depuis des mois – et ces plaques, aussi communes que symboliques, soulignent toujours l’hommage du pays à son passé colonialiste. Lui-même artiste afro-descendant, Cédric Djedje décide alors de s’emparer du sujet pour explorer les questions d’identité, de mémoire et de réparation. Premier projet de sa compagnie nommée Absent·e pour le moment, Vielleicht (« Peut-être », en allemand) mélange documentaire et fiction, conférence, performance et autobiographie pour répondre à la question : comment Histoire, intime et quotidien dialoguent-ils dans la ville ? « Avec Vielleicht, je voudrais mêler questionnement intime sur ma place d’afro-descendant vivant dans différents espaces européens et questionnements politiques sur la place des afro-descendant·e·s dans les récits nationaux et les espaces urbains en Europe postcoloniale », résume Cédric Djedje. Accompagné sur scène par la comédienne Safi Martin Yé, il explore les répercussions des fantômes du passé sur notre mémoire, sur nos corps, sur nos vies, nous poussant ainsi à nous interroger, très justement, sur le monde d’aujourd’hui.
Par Aurélie Vautrin
— VIELLEICHT, théâtre du 12 au 19 avril au TNS, à Strasbourg www.tns.fr
focus
Protomé de lion en cuivre, Temple « aux lions » de Mari. Vers le xxiie siècle av. J.-C. Musée du Louvre, département des Antiquités orientales - inv. AO 19520 © musée du Louvre/Raphaël Chipault
32
Vielleicht © Dorothée Thébert

À portée de main
Pour la troisième année, le festival Micropolis va investir le Théâtre de la Manufacture et ses environs. Du jardin à la Grande Salle, de La Fabrique aux locaux de répétition, le théâtre devient une « place de village » propice aux croisements entre visiteurs et artistes. Le Goethe Institut, le Conservatoire, l’Institut européen du cinéma et de l’audiovisuel, la Maison de l’architecture et le gymnase JacquesLeblanc ouvrent également leurs portes pour l’occasion. Micropolis est dédié à des formes théâtrales conçues pour pouvoir être jouées en itinérance et hors les murs, en grande proximité avec le public. La programmation, composée de neuf spectacles, convie notamment Morgane Deman à présenter Le Pain de la bouche, où une jeune vendeuse en boulangerie est entraînée dans une déambulation nocturne déroutante interrogeant ses rêves et sa condition. De la fantaisie cartoonesque Les Hamsters n’existent pas à la performance du duo Bertrand Lesca et Nasi Voutsas, empêtrés dans l’absurde autour d’une table de restaurant (L’Addition), Micropolis propose des instants de comédie, mais aussi des sujets plus graves. Ainsi, Seuil de Pierre Cuq aborde le thème du harcèlement scolaire, et Jeune mort la radicalisation d’une jeunesse sans perspectives. Des rencontres, des ateliers et des lectures de Quartiers libres, « enquête poétique » à la rencontre des travailleurs du Grand Nancy sont également au programme.
Par Benjamin Bottemer
— MICROPOLIS, festival du 21 au 24 mars au Théâtre de la Manufacture et alentour, à Nancy theatre-manufacture.fr

Youngblood
Au NEST, Centre dramatique national de Thionville, les adolescents ont leur festival : la Semaine Extra, ce sont des moments et des spectacles qui leur sont directement adressés, sélectionnés ou joués par eux, assortis de rencontres et d’ateliers. Les journées du 2 au 5 avril sont exclusivement consacrées à des représentations avec les établissements scolaires partenaires de l’événement ; les séances grand public ne débutent qu’à partir du 9 avril. Les thématiques sont proches des préoccupations de la jeunesse d’aujourd’hui, déclinées à travers les formes et les esthétiques les plus variées. On peut par exemple mixer cirque, electro et fait-divers tragique (Pourvu que la mastication ne soit pas longue) ou se pencher sur l’œuvre de Zola avec La Terre, qui nous mène auprès d’une famille d’agriculteurs et dresse un parallèle entre xixe et xxie siècle. Un jour, j’irai à Tokyo avec toi ! revient sur le phénomène de société que représente le manga, dont la metteuse en scène Natacha Steck revisite les thèmes et les codes graphiques. Autre incursion au cœur de la culture populaire, Motel se réapproprie les procédés du thriller, sur les pas d’une tueuse en série. Création issue de l’atelier-théâtre du NEST pour les 14-18 ans, 66 pulsations par minute plonge dans l’été tragique vécu par dix ados, qui mettront leur courage à l’épreuve à travers une expérience qui les marquera durablement.
Par Benjamin Bottemer
— LA SEMAINE EXTRA, festival du 8 au 13 avril au NEST et au Puzzle, à Thionville nest-theatre.fr
focus
Motel © Pierre Planchenault
33
Les Hamsters n’existent pas © Christophe Raynaud de Lage
Le journal d’un enfant (presque) adulte
Par Serafyma Zhytnia

Une collection de notes des premiers jours de la guerre, quand le temps était perçu différemment, les choses étaient perçues différemment, les mots étaient perçus différemment, les actions étaient perçues différemment, la vie était différente.
34
24 II 2022
La journée a commencé à 5 h 38, et je ne peux pas dire que la matinée a bien démarré. Avant de me réveiller, j’ai entendu des coups de feu, mais je n’y ai pas prêté attention. À ce moment-là, ils ont commencé à bombarder Boryspil, mon quartier natal de Boryspil, où j’ai passé mon enfance.
C’était à peine l’aube quand ma mère a pris l’avion et nous a réveillés, mon frère et moi, en nous disant :
« Les enfants, réveillez-vous, nous sommes dans la merde. » Ma mère nous a fait lever et j’ai commencé à faire ma valise, angoissée, j’ai mis les choses les plus nécessaires dans un sac à dos. J’ai regardé par la fenêtre, des gens couraient partout avec un tas d’objets, des animaux, des enfants. Je pouvais sentir le chaos dans l’air.
Toute la matinée, je suis restée assise devant la télévision, à regarder les informations, en essayant de ne pas paniquer. J’ai pris nerveusement un petit déjeuner avec un café et une cigarette, et puis encore et encore.

Personne ne pouvait imaginer qu’au xxie siècle, il pourrait y avoir une guerre du niveau de la Seconde Guerre mondiale, dont on ne parle que dans les livres d’Histoire. Qu’est-ce qui ne va pas avec l’humanité ?
Pourquoi cela arrive-t-il maintenant ?
Pourquoi à moi ?
Pourquoi à l’Ukraine ?
Je n’ai jamais eu peur de regarder le ciel avant, jusqu’à aujourd’hui.
Le premier raid aérien. Herman, mon frère, est parti emmener les chats chez notre grand-mère. Ma mère et moi sommes à la maison, une sirène retentit. J’appelle mon frère et lui demande de revenir rapidement puis nous partons. L’alarme se déclenche et on demande à toute la maison de descendre au sous-sol.
J’imagine que 25 étages vont tomber et que la sortie du sous-sol va s’effondrer. C’est une tombe vivante. Et c’est pire qu’une mort rapide. Qui va nous sortir de là ? Non ! Nous allons quitter la ville.
16 h 47, je porte des affaires à la voiture et je regarde le ciel, j’ai tellement peur de regarder le ciel, j’ai peur d’y voir quelque chose de nouveau.
Nous jetons tout ce que nous avons dans la voiture et nous quittons la ville pour aller à la maison. Maman, Herman, grand-mère et moi, le chien, deux chats et une montagne de sacs, tout ce qu’il y a dans le frigo est jeté tel quel. La voiture est pleine, nous avons miraculeusement réussi. C’est un vrai miracle.
Je n’ai jamais eu aussi peur pour ma famille, mon Ukraine natale et pour demain. Qui sait ce qui se passera demain, dans une semaine, dans un mois.
Mais aujourd’hui, je m’endors au son des avions et des bombes qui explosent.
Et maintenant, je m’inquiète seulement de ne pas avoir dit bonne nuit à ma grand-mère et à ma mère, parce qu’elles se sont couchées plus tôt dans la chambre voisine.
Et j’ai peur de ne jamais le faire.
35
Ma mère panique, bien sûr, mais nous sommes heureux d’avoir quitté Kyiv à temps. Maintenant, c’est l’horreur.
Les gens essaient de quitter la ville comme des animaux sauvages, il y a des embouteillages sur les routes jusque dans les centres villes.
Il n’y a presque plus de nourriture dans les magasins, les gens achètent tout.
Mais nous allons survivre, nous le pouvons, nous sommes forts. Je crois en nous et en mon pays. Je crois en nous et en tous les Ukrainiens.
Nous avons trouvé un sous-sol avec nos voisins.
Nous avons vu nos amis.
Nous devons changer de chaîne.
Nous entendons tout le temps le bruit des bombes, cela nous fait peur.
20 h 17
Nous entendons un autre «boom». Nous tenons bon.
Si vous devez quitter cette vie pendant cette guerre, vous le ferez. Je n’ai plus peur.
Mais j’aime ma vie. Elle est incroyable. Et « sera » ou « était » – ça n’a plus d’importance. Dieu sait ce qu’il y a de mieux.
Vous savez, ce qu’il adviendra de ces documents n’a pas d’importance. Seront-ils lus par un chercheur qui souhaite étudier les événements de l’invasion terroriste de l’Ukraine, les actions militaires en 2022 ?
Ou bien ce journal restera quelque part dans une boîte au fond de mon placard et je ne voudrai plus jamais le lire, ou bien ces documents brûleront tout simplement et personne n’en saura rien. Mais j’espère que je finirai d’écrire jusqu’à la fin du carnet.
Et la dernière inscription ici sera :
« Nous avons gagné ! »

25 II 2022



37

Herman et moi avons bien dormi, sans doute enfin suffisamment.
Je n’arrive toujours pas à croire que cela arrive, que cela arrive à mon pays bien-aimé. Ce pays, ma capitale, ma Kyiv natale, cette Kyiv incroyablement belle, qui est magique de jour comme de nuit.
Elle est pleine de gens créatifs et talentueux.
Elle compte de nombreux cafés, qui regorgent de sous-cultures différentes et de liberté de parole, de pensée et d’expression.
Une belle Kyiv toujours illuminée par les lanternes des cafés et des restaurants, par les fenêtres où dînent des familles heureuses. Concerts et événements – maintenant est maintenant brûlant en feu.
La Kyiv qui a toujours été remplie de rires et de commérages autour d’un café, de fêtes nocturnes, de musiciens de rue, de chants d’oiseaux au début du printemps, de cloches qui sonnent le premier septembre, de rassemblements dans tout le centre de la ville – maintenant aujourd’hui n’est plus que bruit d’avions des bombes et la peur.
C’est un sentiment terrible lorsque la vie est divisée entre « avant » et « après ».
Nous avons tous eu ce sentiment depuis le début de la quarantaine en 2020, lorsque le Covid-19 a commencé.
18 h 57
J’ai regardé par la fenêtre, il fait sombre dans les rues. Nos voisins ont éteint toutes les lumières. Il fait noir comme dans une jarre fermée.
J’espère que c’est une bonne chose et que cela n’aggravera pas notre situation. Toutes les rues sont plongées dans l’obscurité, tout cela pour nous protéger. L’ennemi lance des bombes sur les immeubles résidentiels si les lumières sont allumées ou si de la fumée s’échappe de la cheminée.
Maintenant, vous n’avez plus peur de l’obscurité, vous vous y sentez plus en sécurité.
26 II 2022
39
Les jours passent vite, mais la période qui s’est écoulée depuis le 24 février semble s’éterniser. C’est le quatrième jour de l’invasion totale, mais c’est plus facile. Je lis à peine les nouvelles, seulement les plus drôles. Je suis tellement fière de nos hommes, de nos militaires, de notre défense territoriale, des gens ordinaires qui n’ont pas peur et qui vont à l’ennemi les mains nues.
Je suis fière de mon pays et des Ukrainiens !
On s’habitue progressivement et on s’adapte. On s’adapte à tout. Je commence déjà à apprécier un peu le café. Comprendre la situation aide à s’y habituer et à percevoir les choses différemment. Il y a moins de peur, je pense que nous sommes simplement en train de nous y habituer.


27 II 2022

Aujourd’hui, on nous a appris à prodiguer les premiers soins, ou plutôt à arrêter les hémorragies. Je pense que c’est très important, car qui sait ce qui peut arriver. Il faut être prêt à tout.
J’étais chez mes amis à côté, à quelques rues de là. Quand je suis revenue, il faisait déjà nuit. J’ai marché dans le noir complet. Je connaissais juste ces rues et j’ai marché de mémoire, comme mes pieds s’en souviennent.
41
J’ai de nouveau senti que c’était la guerre quand Dasha, une de mes amies, a dit qu’elle allait partir d’ici pour je ne sais combien de temps. Les derniers jours (j’ai perdu le compte) ont été légers, nous avons été distraits, jouant aux cartes, cherchant à oublier la situation, et sentant la présence de l’autre dans nos vies.
Et le fait qu’une partie de moi parte, sans savoir jusqu’où et pour combien de temps, m’a fait ressentir à nouveau la guerre.
Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai le sentiment que nous ne nous reverrons pas de sitôt, bien qu’elle dise qu’elle sera partie pour 2 ou 3 semaines.
Je ne pense pas que nous nous reverrons de sitôt.
J’entends à nouveau les avions voler au-dessus de nos têtes et quelque part au loin qui est si proche des fusillades, des bombes, la guerre.
Une fois de plus, je commence à en avoir assez de contrôler une situation que l’on ne peut pas contrôler.
Je recommence à penser que cela peut prendre beaucoup de temps et que ce monstre continuera à étrangler mon pays et à abréger la vie d’innocents.
Je me dis à nouveau que personne ne sait ce qui se passera demain, ni s’il y aura un lendemain.

8 III 2022

Mais il y a de l’espoir. Mais il y a la foi. Et, probablement, ce sont là quelques-unes des choses importantes qui nous maintiennent à flot.
La famille et les amis, qui sont là pour nous et qui sont ailleurs, ils sont toujours là.
43
Denis est décédé.
Il a été abattu dans la voiture devant sa mère et sa jeune sœur par des soldats russes lors de l’évacuation.
Il a 17 ans pour toujours.
11 III 2022
Beaucoup de temps a passé.
Le 26 juin est sur le calendrier, mais dans mon cœur, c’est toujours le 24 février.
Le 19 mars, ma famille et moi sommes partis pour la France.
C’était dur ?
Je peux dire avec certitude que ça l’a été, mais je n’y croyais pas.
Je ne pensais pas que ça serait aussi long, même si mon esprit savait que ce ne serait pas pour un mois ou trois, mais que cela prendrait beaucoup de temps.
Est-ce difficile aujourd’hui ?
Parfois oui.
Parfois, c’est très dur.
Mais nous tenons bon.
Nous essayons de vivre et nous le faisons.

Je ne suis pas prête à relire ces notes que j’ai écrites auparavant, mais je me souviens parfaitement de l’objectif pour lequel je les ai écrites.
Merci, mon Dieu, d’être en vie. Merci que ma famille soit en vie et en bonne santé. Merci d’avoir de quoi manger et de quoi dormir.
Je suis reconnaissante, très reconnaissante.
avril 2023
Texte : notes de l’auteur, Serafyma Zhytnia, écrites à partir du 24 février 2022, début de l’invasion totale de l’Ukraine par la Moscovie (Russie).
Les réflexions sont écrites dans un vieux carnet conservé par l’auteure. Le texte a été transposé avec une précision absolue, afin de ne pas perdre l’atmosphère et les pensées vécues pendant cette période.
Photos : pages 34-43 – photos prises par l’auteure entre 2020 et mars 2022. page 45 – photographe : Marina Levchenko, Alsace, Rixheim, juin 2022
Merci à Lizon Duchesne pour la relecture du texte.
Je suis reconnaissante aux Français de tous âges (des plus jeunes aux plus âgés) pour leur grand et bon cœur.
26 VI 2022
45


(En)Jeux
Sur les planches de l’OnR, On achève bien les chevaux danse la misère jusqu’à l’épuisement, tandis qu’au Maillon, Marion Siéfert interroge les pulsions, virtuelles ou non, qui tourmentent l’enfance.
TOURNEZ MANÈGE

DÉNONÇANT L’EXPLOITATION TRAGIQUE DES INDIVIDUS AINSI QU’UN TROUBLANT ET SYSTÉMATIQUE VOYEURISME, ON ACHÈVE BIEN LES CHEVAUX PREND
CORPS SUR LA SCÈNE DE L’OPÉRA NATIONAL DU RHIN.
Par Valérie Bisson ~ Photo : Agathe Poupeney
48
À partir d’une volonté commune de continuer à interroger l’idée de danse-théâtre chère à Pina Bausch, Bruno Bouché, Clément Hervieu-Léger (de la Comédie-Française) et Daniel San Pedro ont réuni leurs compagnies respectives, le Ballet de l’Opéra national du Rhin et la Compagnie des Petits Champs, pour créer un spectacle chorégraphique inspiré du roman noir de l’auteur américain Horace McCoy, On achève bien les chevaux, publié en 1935.
Après une création hors les murs à Châteauvallon en juillet 2023 et une tournée à travers la France, le spectacle chorégraphique arrive ce printemps sur les scènes de l’OnR. Entre fiction et réalité, les trois créateurs souhaitaient questionner et repousser les limites de la vulnérabilité du corps, et donner à voir son exploitation de masse. Il en résulte un spectacle athlétique et transgressif inspiré par la mise en écho d’une langue puissante et par les réminiscences stylisées de Jane Fonda dansant dans le manège sans pitié du film éponyme de Sydney Pollack, sorti en 1969.
Sur fond de Grande Dépression américaine de 1929, Horace McCoy mettait en scène des individus tombés dans la misère, réduits en esclavage pour quelques dollars ou l’espérance de la gloire, dansant jusqu’à épuisement pour divertir un public en mal de sensations fortes. Il marquait ainsi au fer rouge un lecteur captif d’une trame narrative subtile et brutale, entrecoupée de dialogues altérés ou modifiés par l’effort physique, dans une écriture travaillée au corps, une matière perdant ou reprenant son souffle.
Entrelacer les écritures, romanesques, théâtrales et chorégraphiques a servi de toile de fond et de lieu de rencontre entre les quatre musiciens, les trentedeux danseurs du Ballet et les huit comédiens de la Compagnie des Petits Champs. Tous se sont lancés dans cette aventure en poussant les corps jusqu’à l’expression de l’épuisement. Bruno Bouché avait « envie d’entraîner les artistes du Ballet du Rhin dans une rencontre avec des comédiens pour leur donner d’autres moyens d’exprimer leur rapport au monde, leurs angoisses, leurs colères, leurs désirs, bref, de se sentir encore plus libres, plus libres avec l’expression de leurs émotions ».
Dans une nouvelle forme de danse-théâtre, la course folle, orchestrée par deux implacables et tyranniques animateurs du show, s’entrecoupe de succès américains, rock, jazz, swing, de sonorités urbaines et d’annonces du temps qui passe. Bruno Bouché témoigne de l’intensité des frottements entre les artistes « chacun à leur endroit, comédiens et danseurs se sont rencontrés avec leur fragilité. Ils ont appris à se connaître, à s’observer. Ils se sont aidés mutuellement, donné des conseils, échangés des clés. Cela a donné lieu à une atmosphère de

travail sereine pour faire œuvre commune dans la bienveillance et souvent dans la joie. C’était comme un réel envers du décor, un négatif du spectacle : au quotidien et face à la complexité de ce projet hors norme, réunir nos singularités et nos différences nous procurait une force vitale alors que nous mettions en scène cette dystopie cruelle et inhumaine ».
Avec ce thème résolument contemporain de la monstration et de la productivité, le travail sur la course, notamment pour le derby, a été au cœur de la recherche de création d’une danse forte et transgressive. La tyrannie du marathon de danse, interdit en 1937 après le suicide d’une danseuse, la complicité passive du public face à l’insoutenable de la compétition, de l’absence de limites et de la recherche de succès jusqu’à la mort, sont autant de lieux de questionnements de notre bonne santé démocratique.
— ON ACHÈVE BIEN LES CHEVAUX, danse du 7 au 10 mars à La Filature, à Mulhouse, et du 2 au 7 avril à l’Opéra national du Rhin, à Strasbourg
www.operanationaldurhin.eu
49
MARION SIÉFERT, PRENDRE CHAIR
Par Nathalie Bach ~ Photo : Matthieu Bareyre
AUSSI BRILLANTE QUE SINGULIÈRE, UNE FOIS ENCORE, MARION SIÉFERT SIGNE AVEC DADDY UN SPECTACLE DE HAUTE DENSITÉ. ENTRE JEUX ET ENJEUX DANGEREUX, VIRTUEL ET ENFANCE SE FONDENT EN VERTIGES TANGIBLES.
L’enfance est souvent le thème prégnant de vos créations. Si vous l’interrogez tant, c’est qu’elle vous interroge intensément ?
Oui, mais ce n’est pas quelque chose de vraiment conscient. Quand on crée, on est porté par ce qui nous appelle, par des intuitions, des désirs.
La forme proposée par Daddy est assez unique, l’exploration de la psyché en direct qui met en scène à la fois le regardant et la regardée.
Moi-même, que ce soit d’ailleurs au cinéma ou devant une peinture, j’aime me plonger dans l’âme humaine, y faire une percée. C’est un voyage. Et tout le long de la création, c’est vraiment une impression que j’ai cherché à faire ressentir, à savoir d’être dans quelque chose de pulsionnel et de mental. Avec Matthieu Bareyre, le co-auteur de Daddy, on s’était dit, quitte à parler de la question de la pédophilie puisque c’était vraiment le point de départ de la pièce, autant en parler dans sa forme la plus contemporaine, c’est-à-dire celle qui a lieu dans le monde virtuel de manière très large, que ce soit dans les jeux vidéo, par messages, sur des forums, sur les réseaux, etc. C’est intéressant d’aller regarder ce qui s’y passe, parce que ça parle aussi de notre manière de vivre. J’ai donc mené une enquête sur la pédophilie dans le monde virtuel à plein d’endroits différents et puis on a eu cette idée de jeu vidéo. Mais c’est vrai que je ne voulais pas faire un spectacle qui soit dans la surenchère technique et qui veuille rivaliser avec les outils actuels.
Dans une forme théâtrale quasi-quantique, d’ailleurs, qui vient bouleverser beaucoup de conventions.
Avec Matthieu, nous voulions que le plateau devienne l’espace du jeu vidéo, mais en utilisant les outils du théâtre, et cette idée nous a
énormément libérés à plein d’endroits dans l’écriture. Ça ne nous intéressait pas de rester dans un naturalisme, nous voulions être dans l’espace de la pulsion. Et en même temps, ça nous libérait aussi d’un point de vue formel puisqu’on pouvait passer d’un registre à un autre et s’autoriser quelque chose en fait d’assez baroque, tant du point de vue des costumes que de la scénographie ou de l’alternance des registres en passant du comique au bouffon, de la farce à l’horreur. Le théâtre de l’époque baroque était le lieu de l’illusion et, aujourd’hui, ce sont des questions que l’on se pose par rapport au monde virtuel, c’est-à-dire où est la réalité ? La vie est-elle un songe, le virtuel est-il réel, notre réalité est-elle moins réelle que ce que nous vivons dans le virtuel ? Toutes ces questions se rejouent avec le numérique. Le théâtre a cette force d’être le lieu où nous avons pu poser toutes ces questions. Le théâtre et le jeu vidéo ont comme un air de famille, puisque ce sont deux univers de jeu et de fiction, tout en étant éloignés temporellement, et c’est cela qui permet, je crois, de renouveler le langage théâtral d’une certaine façon.
Si la question de la pulsion est essentielle, vous y ramenez dans le même temps celle de sa représentation.
50

Je suis une grande spectatrice de David Lynch, entre autres. La question de la pulsion est d’autant plus intéressante qu’elle est forcément amorale alors que, dans Daddy, on se retrouve face à des grandes questions éthiques et que l’on doit se positionner face au Bien, au Mal. Les personnages se trouvent aux prises de cette tension, notamment l’héroïne, Mara, treize ans, qui arrive avec une morale, une éthique, des codes. Elle se retrouve projetée dans un espace purement pulsionnel, victime de la pulsion des autres toute en se retrouvant face à la sienne, à se demander qu’en faire.
Le virtuel est souvent condamné alors que tout n’est pas si univoque. Ce serait comme de s’attaquer à un symptôme sans en connaitre la cause. Qu’il y a-t-il de si défaillant dans notre société qui soit de l’ordre de cette avidité du regard, donc de son manque ?
Le monde de Daddy est effrayant parce que la pulsion peut s’exercer complètement librement, alors que normalement, nos pulsions rencontrent des limites, des contraintes, des obstacles. Comme le dit le personnage de Julien, ce jeune homme de vingt-sept ans, prédateur, arriviste, mû par l’argent et des envies capitalistes : « Ici, c’est no limit, et c’est ça qui est génial. » Il peut donc s’éclater dans un
monde qui est purement pulsionnel. Je n’ai pas de réponse précise, mais au-delà même de la question du virtuel, ce sont des espaces marchands, capitalistes à un degré très sauvage et Mara le vit dans sa vie quotidienne en voyant ses parents se faire humilier par des gens qui ont plus d’argent qu’eux. Dans Daddy, elle se retrouve projetée dans un monde où la valeur centrale est l’argent et elle expérimente quelque chose de faustien. On lui fait sentir qu’elle peut vendre son sourire, son corps, son apparence physique et elle l’accepte, car cela ne lui semble pas très grave puisque c’est virtuel et qu’elle a été préparée à cela par toute la culture de la marchandisation de soi que les jeunes gens et les enfants expérimentent sur Instagram, TikTok, YouTube et autres plateformes. Et puis, au cours du jeu, on lui fait comprendre qu’elle peut vendre aussi son âme, dans le sens où un élan de colère qu’elle a peut être récupéré par Julien et remis en vente. Sa colère devient une scène que les gens peuvent acheter et rejouer dans Daddy et qui va rapporter de l’argent à Mara et à Julien. Elle se retrouve dans un espace ambivalent où sa jeunesse est à la fois une force et une grande vulnérabilité grâce à laquelle elle peut gagner de l’argent. Elle se sent dans une sorte de surpuissance dangereuse. Or, il est impossible de se construire en se vendant et en étant dans des rapports de possession extrêmement violents. Le viol n’est pas tant l’acte sexuel que l’envie de prendre complètement possession de l’autre, en même temps de le nier et de manifester ainsi un pouvoir absolu. C’est bien pour ça qu’il est utilisé comme arme de guerre. Ce qu’on nomme pédophilie est cette volonté de l’adulte de prendre le contrôle sur l’enfant qui est aussi une puissance qui lui échappe parce qu’un enfant est extrêmement puissant avec une énergie vitale énorme. Ce que Daddy interroge, c’est l’envie de posséder l’autre.
51
— Je suis animée par le désir d’éclairer ces zones d’ombre, de regarder ce que l’on nomme « monstrueux », pour tenter de le comprendre. —
Il y a encore cette illusion que cela ne peut que concerner les enfants des autres.
On le voit avec les récentes prises de paroles de Camille Kouchner et d’autres, les récits qui ont éclaté dans l’Église, bien sûr, toutes les catégories sociales sont touchées. Mais je pense que le déni vient moins de la peur des actes en eux-mêmes que de la peur de ce que la révélation du viol va venir remettre en cause. Parler d’un viol, c’est venir remettre en question un pouvoir, ainsi que la façon dont sont structurées nos sociétés. On préfère reléguer ça dans les faits divers, dans la marge des zones un peu sordides qui ne concerneraient qu’une minorité de personnes.
Que voulons-nous vraiment voir, ou pas ?
Le juge pour enfants, Édouard Durand qui a présidé la CIIVISE, a été démis de ses fonctions récemment, car il luttait réellement contre l’omerta autour des abus sexuels sur mineurs. Son éviction de la présidence a été un choc pour tous les défenseurs des droits de l’enfant. Il parle très bien de la posture collective du déni qui construit des réalités alternatives à la parole des victimes. On préfère que les victimes se taisent ou on ne reconnait pas la légitimé de leur témoignage. Il y a actuellement quelque chose d’assez pervers dans le fonctionnement de la parole autour de ces questions. On encourage à parler et, dans le même temps, on referme le couvercle en disant : « Oui, c’est super, vous avez parlé, mais, attention, il y a la présomption d’innocence. » La présomption d’innocence est utilisée de manière abusive dans le cadre de la révélation des viols. Elle est utilisée pour interdire de nommer ce que les victimes ont vécu et/ou ce que les témoins ont vu. Donc les victimes se retrouvent en retour attaquées pour diffamation et il y a tout un système qui se met en place pour protéger le violeur et, derrière lui, un ordre du monde, une structure du pouvoir. On le voit bien quand le président de la République prend la défense de Gérard Depardieu. Quand on sait le séisme personnel que c’est, pour les victimes, de parler, d’affronter, d’oser regarder une réalité qui fait souffrir de façon si douloureuse et souvent depuis si longtemps. C’est un acte de courage énorme. Et quand on se rend compte que sa parole n’a ni effet politique ni n’est suivie d’actes de justice, c’est extrêmement violent. Le message envoyé est que ça peut continuer, que l’on tolère le viol.
Bachelard disait qu’imaginer c’était hausser le réel d’un ton. Vous en avez une manière très personnelle, vous dites d’ailleurs être entrée dans le monde du théâtre par la fenêtre.
J’ai essayé de faire des écoles de théâtre, de passer par des conservatoires. Souvent, je n’ai pas été prise et j’ai dû chercher d’autres manières, aller dans d’autres pays, notamment en Allemagne. J’ai eu cette chance d’avoir pu former mon regard et de ne pas être tout de suite placée
sur des rails. Quand on rentre dans une école, il y a toute une pédagogie qui donne les mêmes outils à tous. Les miens, je les ai trouvés en me dirigeant à ma façon vers des choses qui m’attiraient, qui me parlaient de manière intime et personnelle.
Depuis la création de Ziferte Productions, votre compagnie, vous êtes aussi artiste associée au CNDC d’Angers et au Parvis-Scène nationale de Tarbes. Une manière bien à vous de contourner les institutions tout en les retrouvant en restant droite dans vos bottes. Vous faites de l’entrisme ?
C’est-à-dire que pour créer et manger, à un moment donné, en France, il faut bien rejoindre les institutions [rires]. L’art est toujours un rapport à la contrainte, à une certaine forme de censure, à un contexte dans lequel on s’insère et à un cadre que l’on peut avoir envie de faire trembler. J’ai beaucoup observé avant d’y aller, pour comprendre aussi comment ça fonctionnait, avec bien sûr aussi, la peur que ce que je pouvais faire soit nul.
Une des grandes forces de Daddy est d’avoir rapatrié l’indicible de ce virtuel au cœur même du sacré, je veux dire par là dans l’anti-pulsion de mort.
J’ai été élevée dans une culture catholique dont je me suis éloignée, donc spontanément j’ai plus envie de désacraliser les choses même si par exemple j’admire beaucoup Angélica Liddell pour qui la scène est un endroit sacré. Disons que, pour moi, le théâtre est plutôt habité par une forme de spiritualité. La peur, la honte, le cauchemar sont des choses qui m’animent lorsque je crée, car ils nous donnent accès à l’intimité, à ce qui n’est pas encore formulé, dit. Qu’est-ce qui nous anime, c’est ça ma question. Et pour comprendre, il faut aller loin dans les âmes des uns et des autres et ne pas avoir peur de regarder le mal en face. Dans le processus de création de Daddy , j’ai senti que ça a pu effrayer chacune des personnes de l’équipe, à un moment donné. Ce n’est pas confortable que de se confronter au mal, à la violence, à celle qui est à l’extérieur de nous, mais aussi à celle qui est en nous. J’ai pu observer que souvent on a envie de détourner les yeux, de ne pas y aller, de rester bien protégé dans son petit cocon. Mais je crois que si on ne met pas de la lumière, des mots sur cette violence, on rentre dans quelque chose qui est faux. On cherche simplement à se rassurer. Je suis animée par le désir d’éclairer ces zones d’ombre, de regarder ce que l’on nomme « monstrueux », pour tenter de le comprendre. Et il y a une joie à faire cela.
— DADDY, théâtre les 4 et 5 avril au Maillon, à Strasbourg maillon.eu
52
Intemporels
Qu’il s’agisse de sortir des ténèbres pour panser ses plaies, de faire résonner l’éternité en toute humilité, ou encore de transformer les contraintes en libertés, l’espoir imprègne la musique d’Anika, d’Aurel King et d’En Attendant Ana.

ANIKA LA MUSIQUE ET LE MONDE
Par Pierre Lemarchand ~ Photos : Renaud Monfourny
INSAISISSABLE, INCLASSABLE, ANIKA EST UNE ARTISTE EN PERPÉTUEL MOUVEMENT.
Annika Henderson est poète, musicienne, chanteuse, DJ, photographe et tant d’autres choses encore. Alors journaliste et figure underground de la scène electro berlinoise, elle est révélée par un premier album gravé avec les musiciens de Beak en 2010. Ainsi naît Anika.
Ce soir, mercredi 24 janvier, au Centre Pompidou, tu interprètes, entourée du Solistenensemble Kaleidoskop, l’album Desertshore de l’artiste à laquelle on t’a sans doute la plus comparée, Nico. Pourquoi as-tu choisi cet album en particulier ?
Ce n’est pas mon choix, mais celui du Solistenensemble. Ils me l’ont proposé en 2019 et je n’étais pas sûre d’accepter parce que Nico est quelqu’un qui hante ma carrière depuis mes débuts. Mais j’ai toujours désiré faire un album avec des cordes et j’ai réalisé que c’était une opportunité extraordinaire. Et je connaissais leur travail, leur position d’outsiders et de rebelles sur la scène de la musique classique. J’ai accepté. J’allais me rendre aux séances de travail quand le confinement a été prononcé. J’ai eu le temps de me documenter sur la vie de Nico et j’ai réalisé à quel point c’était un
54
esprit dérangé, en même temps qu’une personnalité fascinante et talentueuse. Je me suis retrouvée isolée en pleine campagne à écouter des disques de Nico et je me suis demandé si je n’allais pas devenir folle moi-même !
Tu avais donc, toutes ces années, évité la rencontre avec Nico ?
Oui. J’ai toujours fui sa musique. Mais elle a toujours été dans les parages. Je me souviens être allée sur sa tombe à Berlin avec un ami norvégien. Nous nous sommes dit : « Allons rendre hommage à ce fantôme qui rôde et me hante. » Je suis une grande fan du Velvet Underground, je connaissais donc son travail avec le groupe ; mais son œuvre solo, je ne la connaissais presque pas.
Qu’est ce qui t’a touchée dans ce que tu as découvert de Nico ?
La fréquence dans sa voix transperce l’âme. Elle est traumatisée et traumatisante, mais elle peut aussi être chaleureuse – elle est un monde en soi. Un monde qui ne se préoccupe guère de la manière dont il sera perçu, et dans lequel la plupart des gens n’ont pas envie d’aller. Son comportement public, notamment ses dérives racistes, peut à juste titre dissuader. Elle était manifestement perturbée. Elle m’intrigue, moi qui suis à moitié allemande et ai hérité du traumatisme de la guerre. Mes grandsparents et arrière-grands-parents sont liés à cette histoire et je porte cette culpabilité moi aussi. Dans sa musique, on ressent ce trauma. Elle aspire à son foyer, mais, dans le même temps, le rejette. C’est ce que ressentaient nombre d’Allemands. Ils recherchaient un ancrage, mais on leur a appris à vouloir se débarrasser de cette partie d’eux-mêmes. Nico a grandi dans ce climat et sa musique s’en est ressentie. Son comportement extrême, ses addictions y sont certainement liés. La montée de l’extrême droite dans différents pays, aujourd’hui, nous ramène à ces années. Pourtant, quand j’étais enfant, il semblait impossible que cela se reproduise. Et je pense que l’on peut être plus à même de comprendre ou d’arrêter cela si l’on embrasse, d’une certaine manière, un personnage comme Nico. De nombreux électeurs d’extrême droite ne sont pas simplement mauvais ; il y a des raisons plus complexes à l’œuvre derrière leur comportement.
Continuons de filer les résonances avec Nico. Il y a un an, le 23 février 2023, tu t’es produite au planétarium Zeiss à Berlin. Dans l’endroit même où Nico a donné son dernier concert, le 6 juin 1988, six semaines avant sa mort.
Tu me l’apprends. Aussi incroyable que cela puisse paraître, je n’en savais rien…
C’est étrange en effet. Elle avait été invitée par le planétarium à créer une œuvre originale, comme cela t’a été demandé 35 ans plus tard. Peux-tu parler de l’œuvre que tu as créée et jouée à Zeiss, Eat Liquid ?
En août 2022, j’ai dû faire une pause dans ma carrière musicale. J’avais traversé un événement qui m’a conduit à tout stopper. C’est cette commande qui a enclenché mon lent retour à la musique. J’ai disposé d’un mois et demi pour la créer. J’ai souhaité faire quelque chose d’expérimental et jouer plus de guitare. À Berlin, les gens étaient hantés par la guerre en Ukraine. Tout le monde avait peur. Il faisait sombre, l’hiver était rude. Je me suis dit qu’il me fallait faire quelque chose de positif, pour nous sortir des ténèbres. J’ai toujours été fascinée par les expériences menées dans les années 60 avec les trips à l’acide. Je venais de découvrir la théorie d’Aldous Huxley sur la façon dont la musique peut nous transporter dans différents états de conscience. Avec Beak, puis Exploded View, il m’était arrivé de perdre la tête, ne plus savoir ce que je chantais, me laisser porter par le texte et n’en découvrir le sens caché que plus tard. J’avais commencé à chercher comment la musique pouvait élever la conscience. Parce que je ne prends pas de drogues, je suis un peu trop sensible pour ça… J’ai de toute façon l’impression d’être naturellement droguée ! Enfin, c’était l’idée derrière Eat Liquid : composer un voyage qui permettrait aux gens de s’affranchir de leurs problèmes, leur mal-être, ne serait-ce que le temps d’un concert. J’ai donc emprunté des synthétiseurs et j’ai improvisé, puis j’ai enregistré des parties de basse que je pouvais superposer en direct. J’ai lu de larges parties de L’expérience psychédélique de Timothy Leary, son manuel basé sur Le Livre des Morts tibétain. Et puis j’ai joué beaucoup de guitare. Le résultat m’a fait penser à la fois aux performances expérimentales du Velvet Underground ainsi qu’à celles de Kim Gordon de Sonic Youth…
Étrangement, pour parvenir à ce résultat, je me suis inspirée des accordages de guitare de Joni Mitchell ! Je voulais faire sécession avec mes habitudes et ils m’ont ouvert de nouvelles voies où je pouvais me perdre et explorer « au-delà ». C’était intéressant de prendre quelqu’un comme Joni Mitchell, qu’on n’imagine a priori pas dans un tel contexte. Son jeu de guitare est brillant. Ses accords ne se posent pas, ils restent comme en
55
— Les musiciens les plus talentueux sont souvent ceux qui manquent de confiance en eux. —
suspension ; ce questionnement se retrouve dans sa voix. Cette indétermination me semble un trait féminin. C’est peut-être pour cela que beaucoup d’hommes ne peuvent pas l’écouter. En tout cas, ses accords m’ont semblé adaptés à ce voyage vers l’inconnu qu’est Eat Liquid . Ce n’était pas aussi conscient que cela, j’essayais juste certaines choses pour ce concert… Mais les motivations finissent toujours par s’éclaircir ; il ne vaut mieux pas tenter de les percer avant d’avoir terminé.
Tu t’es récemment produite en concert pour l’émission d’Arte Echoes , produite par Jehnny Beth. Tu y confies que tu souhaites régulièrement arrêter la musique. Pourquoi ?
J’avais un trac terrible quand j’ai commencé à faire des concerts. La première fois que je suis montée sur scène, c’était avec Beak, pour un caméo avec Liquid Liquid en 2010, je crois. Une véritable épreuve. Aujourd’hui, j’arrive à me sentir relativement à l’aise sur scène… Mais je sais au fond que je ne suis pas faite pour ça. Ça m’a appris, au fil des années, qu’il ne me faut jamais être trop à l’aise, en sécurité. Si je l’étais, il serait probablement temps de partir. Cette tension, cette peur, j’en ai besoin – c’est ce qui me pousse à explorer. Je ne suis naturellement ni musicienne ni chanteuse. C’est une quête qui souvent me blesse et, quand c’est le cas, il me faut m’arrêter. Parfois, je m’égare et oublie les raisons profondes pour lesquelles je me suis lancée dans cette aventure – dans ce cas aussi, il me faut m’arrêter. Mais d’une manière ou d’une autre, ça me rattrape toujours. Je me reconnecte aux raisons profondes, je retrouve le désir.
Saurais-tu dire quelle est la raison profonde pour laquelle tu fais de la musique ?
L’espoir, je crois, de mieux comprendre les gens et le monde. Mon deuxième album, Change, découle de mon incompréhension face à l’actualité, la marche du monde. Partager cet album avec les gens était d’une certaine manière entretenir avec eux une conversation ouverte. Le premier album,
Anika, était lui aussi mu par une recherche, mais beaucoup plus personnelle. Il me fallait alors évacuer la frustration, libérer les démons qui étaient enfermés dans ma tête. Je ne sais pas si je parviendrai à t’apporter une réponse claire, mais ce que je sais, c’est que j’en ai besoin.
Et ces blessures que l’environnement musical t’inflige, quelles sont-elles ?
C’est une éternelle histoire. Le monde de la musique fonctionne comme le monde du cinéma, de la politique ou même du journalisme : ce sont des systèmes qui t’exploitent, car ils sont bâtis sur tes rêves. Les musiciens les plus talentueux sont souvent ceux qui manquent de confiance en eux. Des gens dans l’ombre les repèrent, les mettent dans la lumière et les vendent, sans se soucier des conséquences sur leur santé mentale. Certains ont su rester les patrons. Je pense à David Bowie, Dusty Springfield ou, plus récemment, Madonna et Beyoncé. Pour les quatre, j’ai un grand respect. Mais cette charge de tout contrôler, je ne suis pas sûre que cela ait rendu leur musique meilleure. L’industrie musicale est très dure, mais je considère que la musique a un rôle important à jouer dans la société. Aussi, j’accepte de faire partie de cette industrie, mais tout en essayant de faire les choses à ma façon et de manière juste, comme de rémunérer de la même manière les hommes et les femmes. Il faut de la transparence et du respect, ainsi qu’un désir inaltéré d’inventer, de chercher.
La musique est entrée tôt dans ta vie ?
J’ai commencé à jouer du piano quand j’étais très jeune. Le problème, c’est que j’étais si timide que je n’osais pas m’entraîner, de peur que mon frère s’énerve et crie : « Pourquoi joues-tu toujours aussi mal le même morceau ? » Avec le recul, j’aurais dû acheter un piano électrique avec un casque. J’ai passé quelques examens théoriques puis j’ai abandonné à partir du moment où il fallait aussi chanter. J’ai auditionné pour la pièce de théâtre de l’école, mais j’avais tellement peur de parler qu’ils m’ont donné tous les rôles muets : j’ai fini par jouer l’un des deux croque-morts dans Bugsy Malone C’était le problème d’être la plus jeune : quoi que je fasse, les autres étaient toujours meilleurs que moi. Il fallait que je fasse vite, que j’apprenne vite, que je grandisse vite. Ma sœur était douée pour le piano et jouait des sérénades pour la famille. Mon frère était DJ. Et moi ? J’étais la petite, j’observais. Ils ont aussi été mes professeurs : ma sœur m’a fait découvrir la jungle, la dance, le RnB dans les années 90. Mon frère m’a montré comment utiliser les premiers logiciels de musique et mixer.
56
Notre locataire me montrait les galettes de dance et de transe qu’il achetait au magasin Slammin’ Vinyl à Woking. Quand je voyais mon père, nous regardions l’émission de Jools Holland, ainsi que ses vidéos du Old Grey Whistle Test et d’autres émissions musicales des années 60. Il fabriquait des guitares et en possédait beaucoup, mais il était très discret à ce sujet. Ma mère était également une grande fan de musique : c’était une vieille hippie qui aimait Janis Joplin et allait aux concerts de BB King. Je suppose que tout ça a fait un bon cocktail.
Tu as donc d’abord appris en écoutant, en observant ?
Oui, c’est en observant que j’ai créé des liens et que j’ai appris la musique et le monde. Je ne disais pas grand-chose, alors j’écrivais d’étranges contes gothiques, des histoires effrayantes qui inquiétaient un peu mes professeurs. J’adorais les films d’horreur de la Hammer, les films de vampires – le cinéma qui savait faire monter la pression en suggérant les choses. Ils étaient de bonnes métaphores des peurs de la société. Le cinéma a une influence considérable sur mon travail… Écrire ces histoires était une activité privée que j’ai poursuivie jusqu’à l’université. Je ne jouais pas dans des groupes : j’étais encore trop timide. Mais je m’occupais des interviews pour le journal étudiant : je suis allé voir de nombreux concerts et ai pu faire plein de rencontres. Les gens m’ont toujours paru difficiles à comprendre et j’aime apprendre : c’était une excellente façon de mener mon enquête sur le monde ! Après l’obtention de mon diplôme, j’ai trouvé un emploi comme responsable des relations publiques pour des salles de concert de Cardiff, puis j’ai commencé à booker des groupes, j’ai lancé un fanzine gratuit et fait des compiles pour soutenir la scène locale. Je souffrais d’insomnies terribles, j’avais des horaires de travail déments, si bien que je ne rentrais chez moi que pour quelques heures ; j’étais épuisée et c’est alors que je prenais ma guitare et écrivais des paroles. Je ne partageais mes chansons avec personne – tout le monde était meilleur que moi de toute façon. Mon ami, qui faisait partie d’un groupe et à qui j’avais montré les paroles de ce qui allait devenir « Officer Officer », une murder ballad qui allait figurer sur mon premier album Anika, m’a dit que ce n’était pas vraiment une chanson et que, de toute façon, elle était mauvaise. Après avoir demandé de percevoir le même salaire que mon collègue masculin, et me l’être vu refuser, j’ai plaqué mon travail. Et là, pure coïncidence : juste après mon rendez-vous, je reçois l’appel d’un inconnu, un ami d’ami. Il me dit qu’il fait partie d’un groupe à Bristol, qu’il avait entendu dire que
— Faire mon premier album a été comme nager dans le noir.
je chantais de manière étrange et m’invitait à passer le voir en studio. Comme je n’avais plus de boulot, j’y suis allée. J’ai rencontré le type, on a essayé quelques chansons bizarres, je ne savais pas trop qu’en penser.
Cet ami d’ami, c’était Geoff Barrow, membre des groupes Portishead et Beak, n’est-ce pas ?
Oui, mais je n’en savais rien alors ; je n’ai pas fait le rapprochement ! Je me suis retrouvée coincée à Bristol, à m’échiner à concevoir un site web contre la location d’une chambre de la taille d’un lit. C’était une période horrible. Mais j’ai réussi à trouver un stage comme journaliste à Berlin et j’ai déménagé. C’est là que Geoff m’a rappelée pour me dire qu’il était en train de réécouter les morceaux et que nous devrions les sortir. J’étais heureuse à Berlin, je faisais enfin le travail auquel j’aspirais. Mais je me disais qu’avec la musique, ce serait peut-être plus facile de changer les choses, d’avoir prise sur elles. Ce qui ne m’emballait pas, c’était d’être dans la lumière. J’ai vraiment détesté ça. Les séances photos, le maquillage, devenir l’interviewée plutôt que l’intervieweuse, me tenir sur le devant de la scène. Mais je l’ai fait.
Être journaliste était donc ton désir premier ?
Oui. Je voulais parcourir le monde et le raconter à travers des histoires personnelles. J’aimais beaucoup la journaliste britannique Kate Adie. J’aimais aussi tous les poètes qui utilisaient des métaphores pour décrire le réel. Ça me semblait la meilleure façon de le comprendre – plus physique, plus sensible. J’ai du mal à me faire à l’idée que chaque chose obéisse à une définition, une signification, une valeur définitives. Tout est toujours en mouvement, tout vibre, c’est la nature du monde. Essayer de le fixer, de l’étiqueter, c’est une tendance que je réprouve. La première chanson que j’ai écrite s’intitulait « The sad story of the dodo » (La triste histoire du dodo) – elle parlait exactement de cela : le besoin de posséder, à tel point qu’on en vient à détruire ce qu’on étudie, juste pour pouvoir l’épingler sur son mur et donner son nom à cette espèce désormais éteinte. D’une certaine manière, cela ressemble au mariage – du moins au mariage à l’ancienne.
— 57
Il faut soutenir et faire résonner les voix qui veulent le changement, refusent l’injustice. La musique doit servir à construire des ponts et non des murs. —
Pourquoi as-tu arrêté le journalisme ? Tu étais fatiguée de la réalité ? Désespérée par l’état de notre monde ?
J’ai commencé comme journaliste stagiaire à Berlin. Mon objectif était d’aller à Bruxelles pour couvrir les politiques européennes. Le problème, c’est que je suis une femme, que je ne suis pas allée à Oxford ou Cambridge, et que mes chances d’occuper un jour un poste important étaient minces. Mon travail aurait probablement consisté à classer des dossiers et, au cours des 40 années suivantes, mes opinions libérales auraient été mises à mal et je serais devenue une conservatrice aux idées respectables. Alors, j’ai pris le risque de faire de la musique. Elle me permet de créer des interactions directes avec les gens. Ces échanges gardent vif mon désir de changer les choses. Pour ça, la musique est belle et puissante. Mon premier album symbolisait toutes les frustrations que j’éprouvais face à la situation de l’époque : la récession en Grande-Bretagne, la montée des peurs et leur exploitation par la droite, la fermeture des salles de concert, la domination de la musique par l’industrie, le désintérêt croissant pour la politique. Cette poursuite tranquille, polie des affaires. La seule fois où le public britannique avait protesté en masse contre l’invasion de l’Irak, il avait été complètement ignoré. [Anika évoque la manifestation du 15 février 2003. À Londres comme dans 600 villes du monde, les peuples se lèvent pour dire non à la seconde guerre du Golfe .] Je me souviens que ça m’avait rendue folle.
Après ton premier album Anika (2010), réalisé avec Beak, tu as multiplié les collaborations. Mais pourquoi as-tu attendu dix années avant de sortir Change (2021), ton deuxième album sous ton nom ?
Je ne me sentais pas prête. Pour le premier album, je n’avais rien écrit ou presque et c’est le groupe Beak qui avait signé tous les arrangements.
Je ne savais pas comment faire un album – je ne savais qu’écrire des chansons. Quand j’ai quitté Bristol, j’ai perdu mon groupe. Alors a commencé mon véritable apprentissage. J’ai rencontré de merveilleux professeurs sur le chemin : Shackleton (avec qui j’ai fait un album), Michael Rother de Neu !, Tricky, pour ne citer qu’eux. Et puis il y a eu Exploded View. Quand j’ai rencontré ces gens, j’ai su qu’il nous fallait faire un groupe ensemble – un projet équitablement partagé entre nous quatre. Je ne connaissais pas vraiment les musiciens de Beak – faire mon premier album a été comme nager dans le noir. Je ne savais même pas, la plupart du temps, que nous enregistrions. Je me contentais de jeter dans la bataille mes émotions. Avec Exploded View, nous étions amis, et ça a été formidable de vivre cette expérience. J’avais au départ prévu de produire Change toute seule, mais j’ai réalisé qu’il me restait encore beaucoup à apprendre. J’ai donc demandé à mon ami Martin Thulin d’Exploded View s’il voulait bien le produire avec moi. Nous nous sommes très bien entendus.
Change a paru il y a plus de deux ans, en juillet 2021. Quel regard portes-tu sur lui ?
C’est un disque étrange, car je l’ai réalisé pendant la pandémie. Je crois que je ne l’ai pas digéré encore – il me faudrait une vingtaine d’années pour le comprendre. En général, quand je travaille, j’évite de penser à ce que j’ai fait avant. Et puis ça me met mal à l’aise, car j’ai tendance à focaliser sur les défauts. Quand je sors un disque, il ne m’appartient plus. C’est comme si je le jetais dans un champ : la végétation le recouvre, les animaux le mangent, la pluie l’érode. Je n’ai plus le contrôle. Dans le domaine de l’art, ce peut être pour le pire – je pense à la récupération financière des œuvres de Bansky – mais aussi pour le meilleur. Le public peut emmener une œuvre plus loin que ce que vous aviez imaginé – c’est un peu comme une course de relais. En ce qui concerne Change , je ne suis pas sûre d’en être heureuse, mais je lui suis reconnaissante d’exister, car il a brisé la malédiction du deuxième album. Ça a été très long – onze ans – mais il a fini par advenir.
Ces dix années auront été comme un voyage initiatique ?
Oui, il s’agit d’un voyage, une exploration pour comprendre le monde. Mes plans de tournée paraissent parfois étranges : je désire aller dans les endroits qui m’intriguent, que je souhaite mieux cerner. Lorsqu’on joue quelque part, ce n’est pas du tourisme : on débarque dans une communauté, on rencontre les gens et on découvre leur quotidien,
—
58
on peut parler avec eux de leur vie ou de politique. C’est pour cela que je suis allée jouer en Russie, en Israël, en Iran. Partout, on peut prendre attache avec des personnes ouvertes d’esprit, progressistes, qui ne soutiennent pas les gouvernements en place. Plutôt que de boycotter complètement un pays, je préfère y soutenir et faire résonner les voix qui veulent le changement, refusent l’injustice. La musique doit servir à construire des ponts et non des murs.
Tous ces voyages ont-ils eu une influence sur ta musique ?
Oui, et ils ont fait de moi ce que je suis. Je voyage généralement seule, souvent dans des endroits un peu louches. C’est assez risqué, mais j’ai toujours trouvé des gens gentils et intéressants en chemin. J’ai pu me retrouver dans des situations bizarres, mais j’ai toujours réussi à m’en sortir. J’ai aussi appris petit à petit que je ne devais rien à personne, même si on me le fait croire. C’est le prix de l’apprentissage pour toute femme qu’on culpabilise de travailler, de parler ou de se balader seule comme n’importe quel gars. Cela arrive, surtout dans l’industrie de la musique. Nombreux sont ceux qui profitent de la naïveté et du manque d’assurance des femmes. Mon conseil : dites-leur d’aller au diable et prenez conscience de votre véritable valeur ! Je me souviens de mes débuts, j’avais 23 ans et tout le monde disait que j’étais trop jeune et que je ne savais rien. Aujourd’hui, je suis plus âgée et tout le monde dit que je suis trop vieille – et que je ne sais toujours rien… La chose importante à retenir, c’est que la musique est quelque chose de personnel. Il s’agit de raconter sa propre histoire. Il y a bien les connaissances techniques, mais elles s’apprennent. Et de toute façon, ce sont nos erreurs qui façonnent notre caractère, qui nous définissent. Il n’existe pas de bonne façon d’écrire une chanson – il faut juste décider de ce qu’on veut réaliser. Et si personne n’est là pour écouter, ce n’est pas une raison pour arrêter. Peut-être que dans cinquante ans, on m’écoutera. Je reste fidèle à moi-même, j’écoute mon cœur. Ainsi, tout ira bien.
— ANIKA.
ECHOES WITH JEHNNY BETH, émission disponible jusqu’au 4 janvier 2026 arte.tv

DISCOGRAPHIE SÉLECTIVE
Anika. Anika (Invada records, 2010)
Exploded View. Exploded View (Sacred View, 2016)
Shackleton With Anika. Behind The Glass (Woe To The Septic Heart!, 2017) Anika. Change (Sacred Bones Records, 2021)
Anika. Eat Liquid (Dussmann das KulturKaufhaus Berlin, 2023)
59
MEISENTHAL MON AMOUR

60
Par Emmanuel Abela ~ Photo : Monsieur Quentin
INUTILE DE SE RENDRE AUX ÉTATS-UNIS POUR Y CHERCHER L’ESSENCE MÊME D’UN FOLK-BLUES MÂTINÉ DE POP. UN DÉTOUR PAR MEISENTHAL PERMET DE DÉCOUVRIR L’UNIVERS GÉNÉREUX D’AUREL KING DONT LA DERNIÈRE PETITE MERVEILLE VIENT D’ÊTRE PUBLIÉE CHEZ MÉDIAPOP RECORDS.
Il arrive que les plus belles aventures naissent d’un tout petit rien. Une clé USB glissée dans une boîte aux lettres, un matin de février, peut conduire à l’enregistrement d’un petit chef d’œuvre d’intimité comme celui que vient de nous livrer Aurel King, Whispering Animals . Que contenait cette clé USB et à qui était-elle destinée ? Qu’on se rassure, rien de bien compromettant ni de révélation ultime qui pourrait compromettre l’équilibre du monde : une poignée de chansons tout au plus, signées par Aurélien Troesch à destination de son ami, le batteur Jérôme Spieldenner. Les deux garçons ont souvent contribué aux disques des autres, en sidemen avertis, mais jamais ils ne se sont consacrés véritablement à leur propre projet. En soumettant ces chansons, la plupart écrites pour accompagner les projections de Fragments Folk , le film documentaire de Thomas Lincker, Aurélien lance une invitation implicite à une belle collaboration sur quelques titres. Jérôme les écoute et répond qu’il placerait volontiers sa batterie sur l’ensemble des dix chansons. Et mieux que cela, qu’il aimerait contribuer aux arrangements en leur donnant leur pleine dimension. Qu’entend-il qu’Aurélien n’osait imaginer ? Nul ne le sait, mais il exprime une vraie ambition avec des rajouts de piano, d’accordéon et de cuivres.
Aurélien admet une approche très spontanée dans cette orchestration : « Oui, c’était quelque chose d’assez naturel, rien ne nous semblait forcé. Ce n’est pas une rencontre de mondes diamétralement opposés. Pour moi, les instruments permettent de souligner des accords que j’avais personnellement imaginés dans un dispositif plus restreint. C’est comme si une résonance leur permettait de prolonger leur durée. Le fait qu’elles soient orchestrées sur le disque n’empêche cependant pas de revenir à l’ossature d’origine de ces chansons sans trahir le propos initial. »
À l’écoute, l’on se surprend à découvrir un classique du genre, qui mêle folk et blues, avec une tonalité jazz, de manière intemporelle, avec une grande humilité, mais aussi un certain goût pour l’éternité. On entend spontanément Townes Van Zandt mais aussi Randy Newman, ou des déclinaisons qui partent d’un esprit lo-fi à la Elliott Smith ou Lou Barlow pour tendre vers des formes très élaborées. En amoureux de la musique, Aurélien se reconnaît dans ses références, mais il rajoute volontiers Wilco ou Jim O’Rourke « dans la relation d’une écriture pop et des sons issus de la musique traditionnelle américaine. Une des portes à l’origine d’un titre comme « A Certain Kind of Fame » », selon lui. On apprécie les rajouts de ces références, mesurant combien cette dimension pop est présente, prenant parfois même des accents franchement psychédéliques comme sur « Even Try ». « Oui, je relate des petites complications liées à des soucis familiaux, cet instant où l’on ne maîtrise plus rien. J’ai voulu le signifier ainsi par cette manière de “lâcher le truc” et d’aller jusqu’au bout de l’idée. »
Ce qui semble très appréciable dans le disque, c’est la tonalité enjouée, très chaleureuse qui émane de ces chansons faussement insouciantes. « Oui, ça vient de la musique que j’écoute de la Nouvelle Orléans notamment, et de la présence du soleil. » Qu’en est-il du soleil de Meisenthal et surtout qu’est-ce qui amène de si nombreux musiciens du coin – on pense également à Goetzenbruck, la voisine à la scène musicale si florissante – à explorer ces formes-là au point que le documentariste Lincker ne voyait aucune différence avec ce qu’il connaissait des États-Unis. « L’atmosphère particulière laisse de la place à la musique, nous relate Aurélien qui s’est installé dans le village en 2009. On constate une sorte de recul, quelque chose de paisible ici que je ne connaissais pas ailleurs. C’est sans doute lié au rapport direct à l’environnement, mais aussi au regard des gens. On ne te pose pas la question traditionnelle adressée au musicien : “Mais à part ça, tu fais quoi pour vivre ?” Non, au contraire, on t’interroge sur la prochaine salle dans laquelle tu vas jouer. » Il complète son propos au sujet de Meisenthal : « J’ai découvert qu’avec l’influence de l’art verrier, notamment celui d’Émile Gallé, des clubs encourageant les artisans à développer les aspects artistiques de leurs travaux se sont popularisés il y a environ 50 ans. Ce qui semble être à la base du bouillonnement manifesté actuellement notamment – il y a différents lieux consacrés à l’art dans le village – par ARTOPIE, un lieu ouvert où il est facile de se poser pour développer des idées. J’aime beaucoup ce mélange de calme et d’énergie. » Oui, ça fait rêver, on accepte volontiers l’invitation qui nous est faite de nous y rendre très vite. « Oui, tu verras, s’empresse-t-il de rajouter, on s’y sent bien ! »
— WHISPERING ANIMALS, Aurel King, Médiapop Records médiapop-records.fr
61

DEVOIRS DE VACANCES
EN RÉSIDENCE CHEZ HIÉRO COLMAR, LA POP FRAÎCHE ET RYTHMÉE D’EN ATTENDANT ANA SE DÉSTRUCTURE POUR RETOMBER SUR SES PIEDS.
Les Franciliens sont arrivés à l’heure dans une volée de graviers devant le perron d’une villa de maître colmarienne. Trois trentenaires d’En Attendant Ana sortent exténués d’un van blanc. Margaux Bouchaudon, chanteuse brune élancée en boots noires et jean évasé, suit leur guitariste Maxence Tomasso. Un petit brun espiègle à moustache en bombers qui prête main-forte au batteur idéal pour les valoches. On reconnaît Adrien Pollin à sa raie au milieu surplombant des lunettes rondes, l’athlète du rythme s’active calmement. Pour leur troisième visite à Colmar, ils déposent leurs bagages dans un couloir à haut plafond et moulures en stuc près d’une cheminée entourée de vitrines d’art des quatre coins du monde. Du 12 au 17 novembre, ils sont présents pour une résidence qui ressemblera à une colonie de vacances studieuse. Bassin à lotus et belvédère orné de glycines pour s’aérer, escaliers à tapis tringlés et bibliothèque à échelle pour les insomnies, l’association Hiéro sait recevoir. Ses bureaux sont aussi hébergés chez Brigitte, cette femme généreuse et passionnée qui souhaite perpétuer cette tradition d’accueil culturel qu’avait instaurée son défunt mari. Le lendemain, Camille Fréchoux, multi-instrumentiste du groupe et Vincent Hivert, leur échalas de bassiste à mèche, viendront les rejoindre en train pour un dîner dans le caveau secret et boisé de la villa. Ils y feront la connaissance de quelques membres Hiéro de la première heure, dont Dorian le photographe officiel des grandes rencontres. Tous les matins, avec grasse matinée parfois, ils prendront le
chemin du Grillen, la salle de concert de Colmar, pour un jeu rigolo. Leur défi de la semaine sera de balayer tous leurs automatismes, de rebattre les cartes de leurs schémas créatifs par le principe de l’OuMuPo (Ouvroir de Musique Potentielle). Une forme d’OuLiPo musical qui vise à déstructurer leur façon de composer, acquise depuis trois albums.
Découper un morceau en huit parties, puis tirer un gage sur un dé à vingt faces… Retirer un couplet, monter d’un ton, jouer en mineur, chanter a cappella, ou ralentir le tempo. Autant de contraintes qui, à terme, déconstruiront un morceau pour le réagencer, libéreront la créativité et changeront l’angle d’approche de leurs compositions.
La fédération Hiéro Colmar avait déjà accueilli ces prodiges de la pop garage dans un magasin de vélo sous un son épouvantable en 2018 et en plein air au festival Natala l’année suivante. Après Lost and Found et ses guitares en réverb’ enchevêtrées, Juillet fut sa suite logique aboutie de pop acidulée réjouissante. Le chant varié et pétillant de Margaux vient encore sublimer leur nouvel album Principia. Moins de guitares, plus de claviers et un joli travail sur le son, en particulier les cuivres et les ruptures de rythmes, ont placé ce dernier volet dans le top 20 des magazines musicaux de fin d’année.
« Comme on est assez scolaires, on est venu là pour bosser », déclare Margaux. Derrière leurs instruments, devant un grand tableau blanc sur la scène noire du Grillen, ils laissent le hasard
Par Mathieu Jeannette ~ Photo : Dorian Rollin
63
réinventer leur répertoire devant le traiteur qui livre ses plats pour la semaine. Ils se mettent au boulot, déterminés, les sourcils froncés, en constant dialogue. Pour l’apéro, c’est juste à côté, à cent mètres, à la brasserie du Grillen, lieu chaleureux en périphérie de la ville épargné par la marée de touristes. Ils nous présentent leurs excuses, penchés sur leurs smartphones en sirotant une « Liberté », ils peaufinent les derniers détails de leur tournée anglaise de mai. Huit dates, dont une au festival The Great Escape de Brighton avant de mettre le cap sur l’Allemagne. Hôtesse de l’air et multi-instrumentiste à la coupe au carré, Camille papote gentiment en trinquant timidement : « Après soixante dates cette année, dont vingttrois aux États-Unis, on est tous un peu claqués. Heureusement que nous sommes de bons amis, car au bout d’un mois de tournée, parfois à dormir tous dans la même chambre, ça peut devenir pesant, voire tendu, c’est normal. »
« Mais les Américains ont été adorables, ils sont très bienveillants, optimistes et accueillants. Ils ont vraiment l’amour des groupes et t’invitent naturellement à dormir à la maison », rajoute Maxence.
« Puis comparés aux Américains qui ont l’habitude d’avoir plusieurs boulots, on a la chance de pouvoir toucher l’intermittence, bizarrement, on se sent légitimes quand c’est officialisé », avoue Adrien, l’ingé son bassiste.
Margaux, qui travaille dans un studio d’enregistrement avec son compagnon, se confie un peu sur ses goûts et influences : c’est en écoutant l’album Funeral d’Arcade Fire, en particulier « The Back Sit », qu’elle a eu envie de se mettre à composer. Si elle consent à revendiquer l’influence electro-pop de Stereolab ou de groupes pop indés comme Electrelane dans le son d’En Attendant Ana, les penchants de ses membres sont très variés. Le surlendemain, ils se rendront à Ostwald pour le concert immersif math rock de La Colonie de Vacances, composée de membres d’Electric Electric, de Pneu et de Papier Tigre. Concert expérimental pendant lequel le public s’est retrouvé encerclé de quatre formations à la rythmique tournante et hypnotique aspirant ses spectateurs dans l’ivresse d’une force de Coriolis brutale.
Pendant toute la semaine, la pluie n’a cessé de tomber. La traditionnelle Boat Session Hiéro sur la Lauch qui traverse le centre-ville naviguera sur et sous l’eau. Camille couvre de son imper beige à capuche sa trompette quand Margaux, en gilet matelassé, s’inquiète pour son ampli de voyage et sa Stratocaster blanche. Black Morning, « The Fears, The Urge » ont enchanté une famille de canards et quelques touristes hollandais courbés sous l’averse.
En rejoignant leur van, Margaux et Maxence pactisent en clins d’œil pour valider leur visite de l’expo du musée d’histoire naturelle de l’après-midi. Dinosaures, proies et prédateurs. Des gravures de plésiosaures, d’ichtyosaures, des fossiles de dinos à bec de canard (edmontosaure) et la reproduction d’un squelette de T-rex leur auront fait digérer spätzle et tartes flambées d’un coup. On aurait rêvé d’un clip attendrissant dans ce cadre cheap et pittoresque. En fan de Miyazaki, Maxence fasciné a reconnu dans les maisons à colombages colorées de Colmar l’inspiration des décors du Château ambulant. Un après-midi de récréation pour oublier l’angoisse de la scène finale du soir. « C’est vrai que, parfois, j’envisage les concerts comme un mal nécessaire, le regard de l’autre, le jugement sousjacent sont parfois difficiles à gérer, même après des centaines de dates », avoue Margaux qui sourit à Maxence. « Mais je suis persuadé que sans, la scène finirait par nous manquer », poursuit Adrien. Comme toujours, c’est inutile de s’en faire. On a retrouvé dans leur set l’insouciance et la précision rythmique de groupes pop réjouissants comme Allo Darlin’ ou Real Estate. Quant à la version inédite et revisitée par un dé du titre « Principia », elle montre l’étendue infinie des possibles qui peut bloquer des groupes six mois sur l’arrangement d’un morceau, sans que le résultat soit absolument bouleversant pour le public. On les a raccompagnés au van. Les instruments rangés et les bises claquées, les fondateurs de Hiéro les ont vus partir avec émotion. Comme on regarde ses petits frères et sœurs de vingt ans de moins quitter la province pour le vaste monde. En Attendant Ana (hommage à une serveuse belge), on pourra patienter avec deux nouveaux titres chez Sub Pop Singles Club, avant qu’ils ne se mettent au boulot pour l’album anniversaire de leurs dix ans en 2025.
— EN ATTENDANT ANA, soundcloud.com/enattendantana hiero.fr
64
Le bonheur
Rosalie Varda fête Agnès Varda, son œuvre protéiforme, cinématique, photographique, plastique, et son éternelle liberté.
À EntreVues, Berman’s March, de Jordan Tetewsky et Joshua Pikovsky, part en quête de l’âme, là où il est encore possible de respirer sans suffoquer.
— Si tu as l’appétit de la vie, sois gourmande ! —
Agnès Varda

Agnès saute , Agnès Varda, 1956
L’ART DE LA JOIE
Par Valérie Bisson
PHOTOGRAPHE, CINÉASTE ET
ARTISTE, AGNÈS VARDA (1928-2019) A CRÉÉ UNE ŒUVRE CINÉMATOGRAPHIQUE ET PLASTIQUE RARE BASÉE SUR UNE PERSPECTIVE HUMANISTE ET UNE LIBERTÉ INCORRUPTIBLE.
Sa filmographie compte plus de 40 courts et longs métrages, qui naviguent entre la fiction et le documentaire. Rosalie Varda, sa fille, a choisi de se consacrer à la transmission de ce matrimoine, et les années 2023 et 2024 apparaissent particulièrement riches en événements rendant hommage à la cinéaste. De la rétrospective ludique et joyeuse à la Cinémathèque de Paris « Viva Varda ! », qui a accueilli plus de 48 000 visiteurs, en passant par une biographie signée Laure Adler aux éditions Gallimard, une exposition à la fondation LUMA à Arles et des rétrospectives sur Arte et LaCinetek, cette impulsion se poursuit avec plusieurs expositions en préparation notamment à Barcelone, à l’Institut pour la photographie des Hauts de France situé à Lille, et au musée Carnavalet en 2025.
RENCONTRE
AVEC ROSALIE VARDA.
Pourquoi cette année 2023 fut-elle autant marquée par l’œuvre d’Agnès Varda ?
L’idée était de fêter Agnès. Depuis son décès en 2019, un temps de deuil fut nécessaire. Mon frère, Mathieu Demy, et moi-même n’étions pas prêts pour faire quelque chose tout de suite après, il y avait le chagrin et aussi une maison-atelier, rue Daguerre, à ranger, des objets à classer. Agnès habitait là et y travaillait depuis 1951, nous y avions grandi. Ce deuil était à faire par nous, « toute » la famille, mais aussi par tout le monde, le monde entier… On avait besoin d’un temps de réflexion pour penser l’après, ce qu’on allait faire et comment on allait le faire. Nous étions déjà passés par là avec Mathieu, en 1990, lors du décès de Jacques Demy, notre père. Nous avions déjà pu aborder certaines questions : qu’est-ce que cela signifie de laisser et de transmettre une œuvre qui continuera à vivre sa vie, petitement, grandement… Cette notion est revenue assez intensément après le décès d’Agnès, puisqu’elle avait elle-même travaillé sur la

transmission des films de Jacques Demy. Beaucoup de choses se sont mises en place petit à petit. Toute l’équipe de Ciné-Tamaris nous a aidés à structurer les projets qui se sont mis en route.
En rangeant la rue Daguerre, nous avons aussi retrouvé et répertorié près de 27 000 négatifs de planches contact, un autre aspect important du travail d’Agnès. Ceci nous a conduits à signer une convention avec l’Institut de la photographie des Hauts de France pour la conservation de ces pièces photographiques. Et nous continuons bien sûr tout l’aspect valorisation des films avec la société MK2 qui gère les ventes des films de notre catalogue, et les plateformes Netflix, MUBI ou LaCinetek qui nous aident et nous soutiennent, bref, il faut aller un peu partout et surtout aller vers les spectateurs.
Ciné-Tamaris valorise le travail d’Agnès Varda et de Jacques Demy, mais c’était avant tout sa société de production. Depuis combien de temps existe-t-elle ?
Tamaris Films a été créé en 1954 par Agnès, elle avait créé sa propre maison de production tout
67
Rosalie Varda © Ciné-Tamaris

d’abord sous forme d’une coopérative pour produire son premier film La Pointe courte . Elle tenait absolument à son indépendance et l’a toujours défendue. Elle s’est battue toute sa vie pour financer ses films et garder sa liberté. Tamaris Films est devenu Ciné-Tamaris en 1975 pour produire son film féministe L’une chante l’autre pas et a continué avec la production de Sans toit ni loi… et des suivants. En 2002, la maison s’est lancée dans l’édition de DVD avec des « bonus » toujours très amusants. J’ai arrêté mon métier de costumière en 2006-2007 pour me consacrer au projet familial. Accompagner un parent quand il se trouve que c’est un artiste, c’est aussi créer de nouvelles projections, inventer un futur. Agnès avait une énergie vitale, une énergie de création assez extraordinaire et elle a finalement ouvert son troisième cycle de travail, celui d’une artiste plasticienne à un âge relativement avancé. Elle m’a demandé de collaborer avec elle pour concevoir son exposition à la Fondation Cartier, « L’Île et Elle », ce travail commun nous a connectés différemment, notre relation mère-fille était un atout pour travailler ensemble, on faisait une fine équipe de partners in crime, on se renvoyait la balle
des idées. On a aussi eu une formidable assistante, Julia Fabry, pour tous les projets artistiques entre 2006 et 2019. Lorsqu’elle tourne Les Plages d’Agnès en 2008, elle a déjà 80 ans, et elle va rayonner dans le monde entier pour présenter son film, puis donner des masterclass et obtenir la reconnaissance de ses pairs. C’est la seule femme à avoir reçu les trois grandes distinctions, le César d’honneur en 2001, la Palme d’or d’honneur en 2015 au Festival de Cannes et l’Oscar d’honneur à Hollywood en 2017.
Comment passe-t-on du métier de costumière à celui de directrice artistique et productrice ?
J’ai fait une formation de couture. C’est une formation exigeante, qui demande un sens de la minutie et aussi une vision très globale de ce qu’on va produire comme costumes. J’ai commencé ma carrière de costumière comme assistante, puis j’ai continué à faire ce métier et, c’est assez rare, j’ai travaillé avec mes deux parents. J’ai fait le costume de Sandrine Bonnaire dans Sans toit ni loi et, avec Jacques, plusieurs films, dont Une chambre en ville Puis j’ai fait du théâtre, de l’opéra, de la danse. J’ai aussi eu trois garçons. C’est un métier où on apprend beaucoup l’humilité, si le comédien doit chanter, il ne doit pas être entravé, idem s’il danse, c’est un vrai métier d’accompagnement. Le costume doit aussi disparaitre, cela nécessite beaucoup de réflexion et renouvelle sans cesse la question du travail en équipe. Reprendre, gérer et faire vivre Ciné-Tamaris n’est pas si différent de ce premier métier. Je dois disparaitre au profit d’une œuvre, travailler avec ma formidable équipe.
Vivre avec Agnès, c’était quoi ?
Elle avait beaucoup de joie, de fantaisie et de curiosité. J’aime à dire qu’elle avait un tapis volant, magique, et qu’elle se déplaçait avec à sa guise, d’un endroit à l’autre de son imaginaire. Elle avait ce sens de la liberté, elle l’incarnait et la savourait. Elle a pu aussi profiter, de son vivant, de la reconnaissance. Mais on oublie que la vie des artistes est aussi faite de projets qui restent inaboutis, il y a des doutes, des projets très longs, beaucoup de chutes, de choses qui ne se font pas. Il y a énormément de projets dont on ne parle jamais mais qui existent, tous les matériaux de recherche qui restent cachés. C’est aussi pour cela qu’on a ouvert les archives à Laure Adler. On savait, avec Mathieu, qu’elle s’y pencherait avec respect et on aime sa façon d’écrire, ce fut un réel engagement. Aujourd’hui, on reçoit beaucoup de chercheurs qui travaillent sur ses films et viennent trouver des informations.
Il y a aussi un formidable renouveau de toute l’œuvre, la redécouverte par la jeunesse de certains films très marquants
Le public oublie parfois que les films ont été faits dans les années 50, 60, 70, 80, 90… Nous avons aussi une vraie mission d’éducation, c’est un réel
68
Autoportrait aux ailes d’ange, Paris, novembre 1955
travail de transmission. Le travail et l’écriture cinématographique d’Agnès étaient ceux d’une femme libre, et singulière, un pur modèle pour tous les cinéastes, les féministes, toutes générations confondues. Elle incarnait l’humanité et la proximité. L’aura de son œuvre grandit avec les années, Cléo de 5 à 7 est d’une modernité sans égal, elle parle à des gens très différents. L’avantage de toutes ces œuvres, c’est qu’on peut s’y replonger quand bon nous semble !
3 X VARDA
J’aime tous les films, je n’en ai pas de préféré, c’est assez impossible. Je suis sensible à certains plus qu’à d’autres mais ils font tous partie de l’œuvre de ma mère, donc de moi.
LE BONHEUR, 1965
« Le Bonheur est un film cruel, il pose la question de l’amour, s’ajoute-t-il ou se soustrait-il ? » Prix LouisDelluc en 1965, c’est un film dont le titre n’est pas l’histoire, il est une notion, un non-événement. L’histoire met en scène trois personnages qui ont le don du bonheur et qui combattent pour y avoir droit, sans morale ni psychologie mais avec une lumière. L’image impressionniste, vive, proche de l’été, est composée comme un tableau, les taches de couleurs éveillent le plan sensible. « C’est aussi un film qui montre qu’une personne est unique mais remplaçable… »
L’UNE CHANTE, L’AUTRE PAS, 1977
« Un film qui raconte la sororité, l’autodétermination, la condition féminine, mais surtout une voie vers le choix ! » D’une modernité rafraîchissante et absolue. Deux jeunes femmes prennent leurs destins en main pour s’en sortir. « Ce film m’est dédié, pour mes 18 ans, j’ai été très émue et je le suis encore… Le film raconte que les femmes ont été mises de côté par les hommes, il montre un progrès, il me rattache aux engagements de ma mère. C’est un film que j’ai accompagné et qui m’est très cher. » Film qui pousse un cran plus loin la réflexion sur le féminisme et creuse des sillons qui ont toujours besoin d’être ensemencés, pour exemple, la joie d’être enceinte en restant maîtresse de ce qui arrive, ni médicalisée ni sacralisée, la vraie sororité qui s’abstient de la rivalité et redit la tendresse et la liberté. Un film qui dit aussi qu’on peut tout avoir, vie de famille, vie de femme, vie d’artiste sans faire de choix.
DOCUMENTEUR, 1981
La parole et ses silences, l’image et ses manquements, le creux traumatique, les impressions et les fixations. Un film sur le



désamour. Mais Agnès brouille tout, les pistes, le titre, le choix des comédiens, les dialogues. Dans un jeu dédoublé, reflété, le miroir du langage tente de recréer du sens, le mirage de l’image explore l’abîme. Les mots filent, la tendresse persiste. On s’y entraide, on se soutient, on s’amuse, on y fait famille. « C’est le film le plus personnel d’Agnès, elle l’a écrit et réalisé. C’est un très beau film. Sabine, sa monteuse à la ville, y interprète son double, et Mathieu, mon frère y joue Martin, son fils… Les émotions sont perçues aussi à travers les autres, les anonymes qui accompagnent tous les films d’Agnès. Un film qui n’a jamais marché, qui n’a jamais rapporté d’argent ! Et cela n’est pas important, car c’est un film qui bouleverse le spectateur. Il y a des films qui continuent leurs vies sans être dans le box-office. »
Aujourd’hui toute l’œuvre d’Agnès nous permet de la découvrir encore et encore. www.cine-tamaris.fr
L’une chante, l’autre pas ©
Ciné-Tamaris
Documenteur © Ciné-Tamaris
69
Le Bonheur © Ciné-Tamaris
L’AMÉRIQUE ET LA VIE
VÉRITABLE COUP DE CŒUR
DU DERNIER FESTIVAL ENTREVUES, À BELFORT, BERMAN’S MARCH DE JORDAN TETEWSKY ET JOSHUA PIKOVSKY NOUS RAMÈNE À UNE AMÉRIQUE ÉTERNELLE, LOIN DES FRASQUES DU MONDE. RENCONTRE RADIO AVEC JORDAN.

Le récit de Berman’s March porte sur le voyage de Charlie à la rencontre de ses vieux amis qui ont bien changé. D’où une prise de conscience assez brutale chez Charlie, qui est déçu par la relation qu’ils entretiennent à la vie.
Dans un premier temps, la question qui se pose à lui est de savoir si c’est lui ou si ce sont ses amis qui ont changé. Le film met en lumière les différentes trajectoires qu’ils ont empruntées séparément. Malheureusement, la nostalgie ne suffit pas à faire vivre ces amitiés-là. Le film montre la difficulté qu’ils ont tous les quatre à se reconnecter entre eux. C’est d’autant plus compliqué pour Charlie qu’il vient d’un milieu prolétaire et qu’il n’a pas aussi
70
Par Emmanuel Abela (avec l’aimable contribution de Cécile Becker) ~ Visuel : Berman’s March

bien réussi que ses amis. Dès lors, l’on constate que le fossé se creuse davantage pour lui.
Ses amis vivent l’insouciance de ceux qui sont installés dans la vie alors que lui, il vit de petits boulots. Ce qui est amusant, c’est qu’il découvre à la radio que des docteurs ont trouvé l’emplacement physique de l’âme dans le corps. Sa quête de l’âme des choses est-elle la nôtre ?
Je me dois d’expliquer que je vois dans tout cela une sorte d’allégorie dans le film. L’idée d’aller rechercher où se situe l’âme illustre un petit peu la manière qu’a Charlie de chercher les connexions dans sa propre vie. Deux lectures du film sont
possibles : d’une part, la recherche constante du sens de la vie et d’autre part le constat malheureux que ce sens n’existe pas. À la fin, on se demande si Charlie va s’en sortir…
Nous avons le sentiment que l’espoir demeure et l’emporte sur la résignation. Après, on s’interroge sur une constante dans le film : du fait des calculs rénaux dont il souffre, Charlie doit boire beaucoup d’eau. Cette eau, vous semblez lui attribuer un sens particulier : comme si elle purifiait quelque chose à l’intérieur.
Je pense que cette constante de l’eau n’est pas consciente. Peut-être peut-on y voir un symbole
71
quelconque, d’autant que le film s’achève avec une scène où Charlie se retrouve face à la mer, lorsqu’il rend visite à sa tante. Les avis sont partagés quant à cette scène, certains spectateurs l’aiment alors que d’autres se montrent dubitatifs. Je m’interroge : qu’en pensez-vous vous-même ?
En la voyant, je me faisais la réflexion qu’il retournait à la source, auprès d’un membre de sa famille pour tenter de réunir ce qui avait été éparpillé.
Oui, pour moi, ce passage est très signifiant. J’avais tenté d’établir deux directions possibles : cet éventuel retour aux sources ou le néant.
Ce dont Charlie doit se débarrasser est également symbolisé par l’omniprésence des publicités et autres messages intrusifs à la radio ou sur son portable.
Même si cela dénote la part d’humour que j’essaie de placer dans le film – et j’espère que ça fonctionne ! –, nous sommes effectivement bombardés par l’ensemble de ces messages et ça nous empêche d’être présents à la vie. C’était pour moi aussi une manière d’habiller tous les passages du road trip en voiture. J’ai voulu compenser cela par la scène du lac qui n’était pas prévue au départ. Là aussi, je suis assez curieux de savoir comment le public français reçoit ce type de scène, en sachant que lors de la première projection à New York certains spectateurs ont manifesté leur interrogation.
Nous aurions envie de dire que, quand Charlie sort de sa voiture pour prendre l’air, nous aussi on respire. Ce qui est amusant c’est de constater que ça a été improvisé. Lors de son trajet, il fait la rencontre de curieux personnages, plus généreux, plus ouverts, moins préoccupés par leurs propres intérêts.
Oui, sur sa route, il croise des personnes honnêtes et sincères. Il semble intéressant de constater qu’il se sent plus proche de ces gens que de ses propres amis. Dans un restaurant, une femme lui offre le couvert parce qu’il n’a pas d’argent. C’est une manière de montrer que l’on peut se connecter à des gens qui ne sont pas comme nous, mais qui nous rappellent quelque chose de nous.
De manière générale, la réalisation est centrée sur le personnage de Charlie, qui devient le sujet presque plastique du film. La caméra le suit, en plan serré, la plupart du temps, et ne le délaisse que pour s’intéresser à l’environnement.
Tout a été très intuitif et, bien sûr, beaucoup de choses ont bougé durant la réalisation par rapport
au film que nous avions en tête, mais effectivement le but était de suivre la manière dont Charlie perçoit la vie. Son expérience et son regard ont dicté l’orientation de la caméra. C’est le cas lors d’une sortie en forêt, au cours de laquelle ses amis échangent sur des considérations financières ; lui, il se sent très isolé et la caméra se rapproche de lui pour signifier sa solitude.
Jordan, vous vous occupez également du son dans le film. Un soin particulier semble y avoir été apporté, avec une profondeur et une chaleur véritables.
J’apprécie le fait que vous le notiez. Oui, j’ai tenté de faire de mon mieux avec le son au regard du budget dont nous disposions et de mes compétences. Ça n’est pas forcément le meilleur mixage, mais je peux assurer que chaque son entendu est celui que j’ai cherché à placer là. J’y attache une importance particulière et j’espère bien à l’avenir travailler avec un expert sur ces questions-là.
Au-delà de tout cela, vous renouez avec une aspiration très américaine : le mouvement, l’itinérance magnifique, celle des pionniers et celle de ces grands artistes qui sont partis sur la route. Charlie est leur héritier, il aspire malgré lui à suivre leurs traces.
Je suis entièrement d’accord. Ce film est un hommage à tout ce qu’on aime, à tout ce qui nous inspire et nous procure de la joie.
— BERMAN’S MARCH, Jordan Tetewsky et Joshua Pikovsky
72
Vitalité pure
L’énergie jaillit du travail de Philippe Ramette, photographe-sculpteur de l’irrationnel. Elle irradie la galerie messine Octave Cowbell, dont le savoir-faire se déploie dans de nouveaux locaux. Elle crée du liant entre les œuvres, les artistes et les institutions d’Altkirch et d’Ivry ; et elle se partage au Ministère de l’Impression, l’atelier mulhousien sérigraphie et édition de la HEAR.
PHILIPPE RAMETTE
Par Martial Ratel ~ Photos : Vincent Arbelet
DEPUIS LES ANNÉES 1990, PHILIPPE RAMETTE DÉVELOPPE UN TRAVAIL
PHOTOGRAPHIQUE BASÉ SUR LA MISE EN SCÈNE DE SITUATIONS IMPOSSIBLES, EN PARALLÈLE DE SCULPTURES PLEINES
D’HUMOUR ET D’INTERROGATIONS MÉTAPHYSIQUES. À L’OCCASION
D’UNE EXPOSITION À LA GALERIE
DIJONNAISE INTERFACE, NOUS LUI
AVONS SOUMIS DES MOTS-CLEFS INSPIRÉS PAR SON ŒUVRE.

74
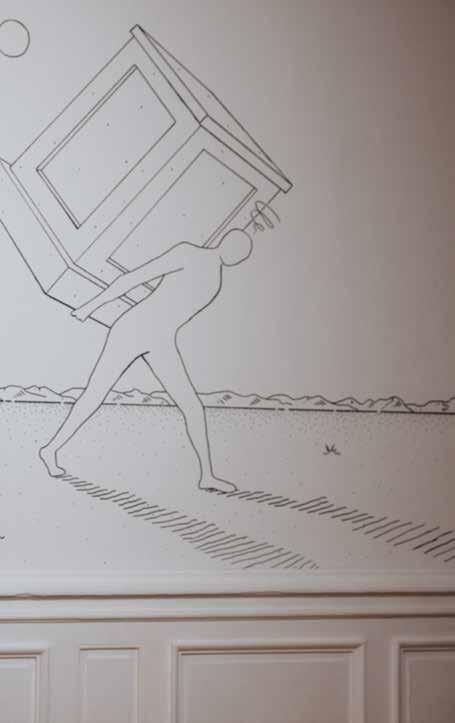
EAU :
« J’ai réalisé un certain nombre de photos sous l’eau, ce qui révèle une sorte d’attirance pour cet élément. Quand je prenais ces photos, pour rendre l’impression que je me déplaçais comme à l’air libre, j’étais lesté. C’était proche du déplacement de cosmonautes sur la Lune ; je pouvais marcher sous l’eau comme j’aurais pu marcher dans la rue. C’est un souvenir absolument extraordinaire. J’ai eu l’impression d’un rêve éveillé. Il m’apparaît tout de suite que, pour moi, l’eau est associée à des réminiscences de rêves où l’on a l’impression qu’on flotte. Avec l’eau, ce qui semble impossible et irrationnel est possible. »
SCULPTURE :
« Ça me fait plaisir que ce mot vous soit apparu comme une évidence, puisque je me considère, et je revendique pleinement mon statut de sculpteur, ce qui n’est pas toujours facile puisque je suis d’abord passé par la photographie. Je mets toujours un point d’honneur à préciser qu’en réalisant ces photographies, je ne me suis finalement jamais éloigné de la sculpture. Elle est omniprésente. Pour les photos, je fais réaliser en amont des sortes de prothèses, des structures métalliques qui me permettent d’être dans les positions où je suis photographié, et j’ai toujours considéré ces prothèses comme des sculptures. Il y a longtemps, j’avais réalisé une Prothèse à humilité et une Prothèse à dignité . Et, avec mes dernières productions, comme Éloge de la déambulation ou Proposition de monument en l’honneur de ceux qui se trompent toujours de direction, on peut dire que je suis dans la sculpture et la statuaire la plus classique : j’utilise le bronze et des socles en pierre. C’est volontairement cliché. »
ÉLÉGANCE :
« Quand j’étais étudiant à la villa Arson à Nice, dans les années 1980, j’ai eu une période un peu à la Gilbert & George. Je mettais un point d’honneur à venir habillé en costume-cravate. Il y avait chez moi un désir assez évident de me démarquer par rapport à mes collègues. C’était un costume que j’avais trouvé en fripes, trois fois trop grand pour
75

moi. Même lorsque je tondais la pelouse à la villa Arson, je portais une cravate. C’était une manière de donner le change. L’élégance est une forme de politesse.
Le costume est un élément du scénario de mes photos, mais c’est arrivé par hasard. Lorsque j’ai réalisé ma première photo, j’étais habillé comme je l’étais tous les jours, avec mon costume. Après, je me suis dit qu’il pouvait avoir une importance. Il suggère que le personnage s’est apprêté pour l’occasion. Et donc la photographie va restituer un moment qui est important pour lui. Il y a un côté endimanché. »
IRRATIONNEL :
« C’est un terme que j’utilise toujours en le couplant avec celui de rationnel. Un jour, je ne sais pas ce qui m’a pris, je ne sais pas quelle heure il était ni ce que j’avais fait avant, j’ai dit que je cherchais à “rationaliser l’irrationnel”. [ Silence ] Bon, ça laisse un champ assez ouvert. J’ai du travail pour un petit moment [ rires ]. Je crois que ça concernait surtout mon travail photographique, qui montre souvent un personnage libéré des contraintes de la rationalité. Ce rendu dit irrationnel passe par toute une préparation extrêmement rationnelle et mécanique. Je suis fasciné par les quiproquos ; quand le hasard restitue une réalité différente, quand, très brièvement, il y a une perte de rationalité. Ces brefs moments dépourvus de repères, ce sont des notions que je recherche dans mon travail, que j’essaye de suggérer. Face au monde, on peut choisir d’adopter un point de vue ultra rationnel, c’est assez affligeant, ou, au contraire, s’accorder la possibilité de moments de poésie où on se dit : “peut-être que c’est possible”. L’irrationnel peut se rapprocher d’une forme d’utopie. Ce qu’on considère comme irrationnel peut, peut-être, après un certain processus de pensée, devenir rationnel. »
DÉSÉQUILIBRE :
« Je ne peux pas m’empêcher d’évoquer une de mes sculptures, L’Éloge du déséquilibre. Le déséquilibre m’est très important. Ce n’est pas tant la recherche du déséquilibre ou de la chute, que celle d’un temps suspendu, dégagé de la rationalité. J’ai souvent cette image en tête du dessin animé Bip Bip et Coyote, où le coyote coure dans le vide jusqu’à ce qu’il se rende compte qu’il est… dans le vide. Et cette prise de conscience provoque sa chute. Ça m’a toujours amusé et fasciné. Dans le déséquilibre, il y a aussi cette idée, si on l’accepte, d’incitation à sortir de sa zone de confort, de se… déséquilibrer. Ce n’est pas mauvais à partir du moment où on retrouve un nouvel équilibre. Le déséquilibre peut être extrêmement constructif, il peut nous faire ressentir le monde. »
DESSIN ET BD :
« Ces deux mots ensemble me parlent, bien évidemment. J’étais un très grand lecteur de bande dessinée. Adolescent et jeune homme, j’avais une forte admiration pour Yves Chaland. La bande dessinée, c’est la construction d’un scénario et d’une histoire. C’est un peu comme dans mes photographies ou mes dessins. Je dis de ma photographie que c’est une image arrêtée d’un film imaginaire, et je signe toujours mes dessins de la même manière : Philippe Ramette la date… C’est une façon de les relier entre eux, comme si chaque dessin était un arrêt sur image dans la constitution d’un ensemble. Avec mes dessins, il y a une grande liberté dans la mesure où ils sont libérés de la notion de scénario. »
AUTOPORTRAIT :
« Je suis dans l’autoportrait sans y être. Il ne faut pas y voir un excès d’égo démesuré, surtout pas. Au fur et à mesure de l’évolution de mon travail, je me suis rendu compte qu’il y avait comme la constitution d’un personnage, dont il n’est pas important de savoir que c’est moi et qui n’est pas revendiqué comme étant Philippe. Ce n’est d’ailleurs pas dans les titres.
Il y a aussi un rapport à une forme de solitude, ce personnage est le plus souvent seul. Étudiant, j’ai été très marqué par l’œuvre de Caspar David Friedrich, Le Voyageur contemplant une mer de nuages. Je pense que je m’en suis beaucoup inspiré. J’assume l’idée que ça puisse être vu comme une sorte d’autoportrait à l’échelle de ma propre vie. On dit aussi souvent : “j’achète un Mondrian, un Buren” Donc là, on “achète un Ramette”, avec un sens beaucoup plus accentué. [Rires] »
PHILOSOPHIE ET MÉTAPHYSIQUE :
« L’attitude et les questionnements que je peux avoir face au monde, tout le monde se les pose. Quitte à ne pas forcément y répondre. Il y a cette expression qui dit que le chemin parcouru est plus important que l’arrivée. À partir de cette idée, j’ai réalisé une photographie qui s’intitule Objet à voir le chemin parcouru. C’est la question du sens : quel sens donner à tout ça et y en a-t-il un ? [Rires] Depuis l’enfance, je me suis toujours posé ce genre de questions. Je crois avoir matérialisé des intuitions que j’avais alors eues. Je suis resté contemplatif. C’est un grand luxe pour moi de pouvoir être artiste. J’ai toujours vu ça comme un engagement. Pour devenir artiste, je crois à cette idée du point de non-retour. »
77
HISTOIRE DE LIENS
Par Coralie Donas ~ Photos : Donna Gottschalk
EN COLLABORATION AVEC LE CRÉDAC D’IVRY-SUR-SEINE, LE CRAC ALSACE ORGANISE UNE EXPOSITION QUI EXPLORE
LA NOTION DE LIENS À TRAVERS LES ŒUVRES D’UNE QUINZAINE D’ARTISTES ET DE LEURS INVITÉS.

Faire partie du « club d’amis » imaginé par Boris Achour en repartant de l’exposition avec un de ses pin’s ; s’immerger dans l’installation d’Anna Byskov qui convoque père, mère et amies pour réaliser une œuvre composite… La nouvelle exposition du CRAC Alsace, « L’amitié, ce tremble », parle de liens. Malgré le titre, l’amitié n’est pas le sujet de l’exposition mais a servi de méthode de travail pour la concevoir. Une amitié professionnelle, entre le centre d’art alsacien et le centre d’art contemporain d’Ivry-sur-Seine, le Crédac. Les deux directrices, Claire Le Restif et Elfi Turpin, ont élaboré un travail commun en s’inspirant du Temple de l’Amitié, une bâtisse parisienne qui a accueilli, pendant près de 60 ans, au xxe siècle, des salons littéraires organisés par l’écrivaine américaine Natalie Clifford Barney. Elle y réunissait les écrivains et les artistes de son époque. Deux phrases tirées de son poème éponyme, « Au temple de l’amitié », ont d’ailleurs été envoyées avec l’invitation du CRAC Alsace et du Crédac aux artistes : « L’amitié, ce tremble » et « Comme la coquille de l’escargot, notre amitié s’accroît d’un nouveau cercle chaque année. » L’exposition s’est donc construite sur des échanges permanents entre les centres d’art, dont les équipes ont appris à se connaître. L’équipe d’Ivry est venue à Altkirch pour l’accrochage et le montage de l’exposition, qui démarre en Alsace et se poursuivra à Ivry à partir du 28 avril. Les œuvres exposées ne seront pas toujours les mêmes, certaines apparaissent dans l’une, pas dans l’autre.
CERCLES INTIMES
De ces quelques éléments, les artistes ont tiré des interprétations diverses. La Norvégienne Marthe Ramm Fortun a été complètement fascinée par
78
Helaine on her girlfriend’s lap, Provincetown [Helaine sur les genoux de sa copine, Provincetown], 1974. Tirage gélatino-argentique sur papier. 31 x 20 cm. Autorisation de la Galerie Marcelle Alix.
Natalie Clifford Barney. Elle s’est plongée dans les archives de l’écrivaine, conservées à la bibliothèque littéraire Jacques-Doucet à Paris et en a tiré une œuvre performative. Dans les objets personnels de l’écrivaine, elle a aussi trouvé des cheveux. Ce qui a occasionné une installation mettant en scène les cheveux de ses propres enfants, mis en parallèle avec un tableau réalisé à partir de cheveux, issu des collections du musée sundgauvien, situé à quelques pas du CRAC.
Plusieurs artistes ont choisi de convier des proches, artistes eux-mêmes ou non, pour réaliser une œuvre collective. Dans une installation où les visiteurs sont invités à retirer leurs chaussures, déguster un thé et s’installer sur des tapis, Hatice Pinarbaşi met en scène des peintures commencées sur des nappes trempées dans des courants d’eau chargés de fer, qui servent de support à des motifs aériens. Ils se poursuivent hors champ, cousus sur des coussins, inscrits sur des tapis. Le père de l’artiste a réalisé l’installation électrique des lustres, sa mère a cousu les coussins, la bandeson est enregistrée par un ami, son compagnon a conçu les sculptures. Un poème de sa sœur est reproduit sur un mur.
La Mulhousienne Anna Byskov a adopté une démarche similaire. Dans une mise en scène bigarrée, elle expose les peintures réalisées par ses propres parents et les dessins de deux amies artistes, Camila Farina et Sophie Lamm. Une constellation personnelle et artistique, inspirée de la relation de Natalie Clifford Barney avec sa mère artiste, Alice Pike Barney. Boris Achour a imaginé des panneaux couverts de pin’s, disséminés dans l’exposition, intitulés Légions d’ami.es, et invite les visiteurs à se servir. Il convoque aussi une curatrice, Émilie Renard, pour parler de son travail. Edit Oderbolz incarne la métaphore de l’escargot du poème dans de petites coquilles moulées en résine, peintes à la main et agglomérées, soudées sur des fils de fer.
AMOUR, SOUVENIRS
Sarah Tritz, artiste suisse, met en scène une correspondance de quatre ans avec un ami. On y trouve quelques objets, des enveloppes et beaucoup de dessins au trait enfantin, caractéristique de son travail. « Cela constitue une sorte d’archive de son œuvre sur cette période », souligne Maria Gamboa, chargée de médiation au CRAC Alsace. Autant de clés de lecture pour le visiteur sur l’œuvre récente de Sarah Tritz.
Au fil du parcours de l’exposition, les liens sont envisagés de multiples façons. L’amour filial est relaté dans cette vitrine qui met en regard les réalisations ultracolorées, en paillettes et perles, semblables à des gâteaux, de Sarah Pucci, pour sa fille Dorothy Iannone (1933-2022). À ces ex-voto

maternels, l’artiste répond par de tendres messages sur des cartes de fête des Mères.
Thomas Cap de Ville évoque des liens et des souvenirs, pas toujours heureux, dans des collages et scrapbooks qui mêlent photos, textes, dessins, végétaux, objets. L’exposition montre aussi une série de portraits de proches, famille, amis de la photographe et militante américaine Donna Gottschalk, qui a fait l’objet d’une rétrospective à New York en 2018-2019.
Entre Altkirch et Ivry-sur-Seine, l’exposition va continuer à évoluer. Des œuvres exposées en miroir, des performances partagées, des installations qui se répondent. Une manière d’incarner des liens solides, parfois poignants, toujours mouvants.
— L’AMITIÉ, CE TREMBLE, exposition jusqu’au 12 mai au CRAC Alsace, à Altkirch, et du 27 avril au 13 juillet au Crédac, à Ivry-sur-Seine cracalsace.com credac.fr
79
Sally and Mama, 1973. Tirage gélatino-argentique sur papier. 20 × 14 cm. Autorisation de la Galerie Marcelle Alix.

80
MINISTÈRE PAS AMER
Par
Emmanuel Dosda ~ Photos : Myla Lelion Savre
30 ans ! L’éphémère Amélie Oudéa-Castéra doit pester de jalousie face à la longévité de Christian Savioz, ministre depuis trois décennies, rejoint plus tard par Claire Morel. Ils sont le Ministère de l’Impression, petit nom humblement donné à l’Atelier sérigraphie et édition de la Haute École des arts du Rhin (HEAR) à Mulhouse. Pour fêter cet anniversaire, la galerie de La Filature lui offre une rétrospective qui donne une idée de la feuille de route du duo, entre punk, anarchisme, abstraction géométrique et minimalisme.
Le bureau de Claire et Christian est recouvert d’affiches, flyers, pages de magazines, photos, images découpées on-ne-sait-plus-trop-où… On remarque aussi des hosties, t-shirts, carrelages, papiers peints ou canettes de bière imprimées. Ces dernières, sérigraphiées à même le verre rebondi, sont des pièces de la « Pyramide de la soif » prévue pour le vernissage de l’exposition de La Filature. Des œuvres à voir, à décapsuler, à boire… Partout dans l’immense atelier, du trash bêta, du satanico-puéril, des bondieuseries détournées et autres provocs politico-potaches. Nous baignons pourtant dans un climat serein, groggys par l’odeur des produits chimiques et le bruit des machines mécaniques, bercés par la bande-son diffusée : Ambient 3 : Day of Radiance de Laraaji, produit par Brian Eno. Parmi les posters de leurs idoles rock ou des ex-groupes de Christian, on remarque des calques à l’effigie de Darmanin affirmant « J’ai la patriotrique », un « Fuck the Police » bien senti et bien typographié ou un emballage de savon « Jésus me lave plus blanc ». On l’aura compris : les esprits trop étriqués ne sont pas en odeur de sainteté

81


C’est un lieu transversal, d’échanges, d’interactions et d’expérimentations, qui préserve une forme d’excellence, de qualité et de justesse. »
dans cet atelier rempli à craquer de travaux du tandem et de réalisations des étudiants de toutes les années des options Art et Design. Claire Morel résume ainsi ce qui est bien « plus qu’un atelier d’édition classique ! Le Ministère est un espace de recherches qui se réinvente constamment en diversifiant les supports, détournant la technique de la sérigraphie, utilisant des encres particulières…
C’est en 1994 que Christian reprend le flambeau de Daniel Burgin, professeur visionnaire qui monta l’atelier sérigraphie en 1986. Christian, à l’époque adepte de gravure et sculpture, « des techniques académiques », ne connait pas grandchose de l’édition, mais il s’est vite passionné par le sujet au contact de son mentor. Aux manettes de l’atelier, il produit fanzines ou tracts dans un esprit punk et art brut. Le membre de Denum et France Mutant fait souffler un vent de rébellion rock en les murs de la HEAR. Si celui-ci ne tournera jamais vraiment le dos au DIY sexpistolien, sa rencontre en 2009 avec la peintre Marie-Thérèse Vacossin (des éditions Fanal) l’a « marabouté ». Autre personnalité déterminante : Jean-Charles Kien (du studio Symetria qu’il co-fonda) l’aide à glisser de l’anarchique à l’abstraction géométrique. Du pied de nez anticlérical à Olivier Mosset. Du vitriol au minimalisme. Du doigt d’honneur à
82

l’art conceptuel. Tous ces éléments coexistent en l’atelier qu’on appelle dorénavant Ministère de l’Impression, en toute modestie.
Dans son bleu de travail maculé de taches multicolores, Claire Morel nous présente ses productions personnelles, des travaux qui interrogent l’objet-livre. Celle qui a rejoint Christian en 2011, représentée par la galerie parisienne Martine Aboucaya, sort quelques ouvrages des étagères. Par exemple Sans titre (35), réplique d’un Que sais-je ? sur la relativité. Le contenu de chaque page est matérialisé par un aplat noir relatif à la quantité d’encre nécessitée pour l’impression du livre original… La folie du jour est la reproduction du bouquin éponyme de Maurice Blanchot dont le texte a été surimprimé plusieurs fois « jusqu’à l’illisibilité », s’amuse Claire, héritière du courant oulipesque. Une démarche à la fois radicale et caustique, avec textes floutés, ISBN recensés, encyclopédies percées…
Emmanuelle Walter, responsable des Arts visuels à La Filature, se réjouit que ses amis
fêtent leur anniversaire en même temps que la scène nationale mulhousienne : ils ont souvent collaboré, notamment pour l’impression de t-shirts liés aux expos photo, celle de SMITH par exemple. Pourquoi exposer le Ministère de l’Impression dans un espace dédié à la photographie ? Au-delà de l’aventure amicale, sérigraphie et photographie sont des arts de « la révélation de l’image », selon Emmanuelle qui félicite la longévité des deux ministres : « Trente ans qu’ils tiennent la boutique ! » Avec toujours autant de ferveur. Il suffit d’écouter le duo parler de son art. Face à l’explosion chromatique accrochée dans l’atelier, Claire et Christian s’exclament d’une seule voix : « La sérigraphie, ça décharge beaucoup de pigment sur le papier ! Une fois la technique parfaitement maîtrisée, ton inspiration est totalement débridée. »
— MINISTÈRE DE L’IMPRESSION, exposition du 12 mars au 18 mai à La Filature, à Mulhouse www.lafilature.org
83
RESTER DANS LA PLACE
Par Benjamin Bottemer ~ Photos : Romain Gamba
À METZ, LA GALERIE D’ART CONTEMPORAIN OCTAVE COWBELL
DÉMÉNAGE POUR INVESTIR UN ESPACE DIX FOIS PLUS GRAND.
ÉTAT DES LIEUX DES ENJEUX ET DES AMBITIONS AVEC
SA DIRECTRICE ARTISTIQUE, VANESSA GANDAR.

84
Au 5 rue des Parmentiers, les volets sont définitivement fermés, l’escabeau servant à entrer par la fenêtre (une originalité emblématique du lieu) remisé. Lors de son ouverture en 2002 dans une galerie-appartement atypique, Octave Cowbell faisait figure de pionnière à Metz. À cette époque, seul le centre d’art Faux Mouvement jouait le rôle d’oasis dans le désert ; Modulab, La Conserverie, le LEE ou le FRAC Lorraine n’existaient pas encore, et le Centre Pompidou-Metz n’ouvrirait ses portes que huit ans plus tard. C’est justement dans les anciens locaux de la galerie fondée par Maryse Jeanguyot qu’Octave Cowbell et sa directrice Vanessa Gandar se sont installés fin janvier. La surface d’exposition, qui passe de 25 m² à plus de 300 m², constitue un nouveau terrain de jeux, avec ses possibilités en termes de scénographie et de programmation, mais aussi les contraintes logistiques et économiques qui accompagnent les projets d’ampleur. Il n’y a que quelques centaines de mètres entre la rue des Parmentiers et la rue du Change, mais le volume, la localisation, la visibilité amènent leur lot de nouvelles questions quant à l’identité du lieu et au public qui s’y rendra. Mais selon Vanessa Gandar, « un espace différent ne changera pas notre identité ; c’est nous qui donnerons notre identité à l’espace ».
Peux-tu revenir sur le contexte de votre déménagement, qui n’était pas vraiment souhaité au départ ?
On a su il y a deux ans que le propriétaire de notre immeuble souhaitait le réhabiliter, nous ne pouvions plus rester. Nous voulions vraiment continuer à travailler à Metz, au contact de notre public, des écoles qui venaient nous visiter, et ne pas devenir une galerie nomade, un statut difficile à tenir sur la durée. Faux Mouvement avait arrêté son activité et Patrick Thil, l’adjoint à la culture de la Ville de Metz, avait évoqué la possibilité d’investir les locaux, dont la Ville est propriétaire. Il y avait un souhait de ne pas perdre deux lieux de diffusion de l’art contemporain en même temps.
Je venais à Faux Mouvement quand j’étais au lycée, jamais je n’aurais imaginé prendre la suite de Maryse Jeanguyot et du travail incroyable qu’elle a effectué.
Est-ce que tu étais parfois frustrée par l’espace réduit de la galerie rue des Parmentiers ?
On s’est beaucoup amusés avec cet espace, à chaque fois il y avait quelque chose à construire : on pouvait jouer avec la rosace au plafond, la cheminée, le parquet… pour ce qui est des œuvres volumineuses, on avait quand même la possibilité de mettre en valeur une unique pièce d’un artiste, un élément fort qui permettait d’entrer en contact avec sa pratique.

Qu’est-ce que ce nouvel espace va changer en termes de programmation ?
C’est certain, on pourra accueillir plus d’œuvres, plus d’artistes, avec plus de volume… on peut aussi plus facilement imaginer des expositions monographiques dans un tel espace. Si muove, le mobile imaginé par Cécile Beau qui fait partie de notre exposition inaugurale « La Tempête des échos », aurait difficilement trouvé sa place dans nos anciens locaux… aujourd’hui, on doit penser à faire des formations pour pouvoir travailler en hauteur !
Est-ce que ça comporte aussi son lot de contraintes ?
Pour l’instant, on manque simplement un peu de matériel. Le musée de la Cour d’Or nous a aidés pour réaliser les adhésifs de notre exposition, le Centre Pompidou-Metz et le FRAC nous ont prêté des luminaires… S’impliquer depuis si longtemps dans une ville, ça crée des réseaux d’amitiés qui aident beaucoup.
85
— Ce qui est génial c’est qu’en plus du public d’Octave Cowbell qui nous a suivis, nous avons aussi le public de Faux Mouvement. J’ai pu constater le fort attachement des Messins à ce lieu. —
Et du point de vue économique ?
Le loyer est compris dans nos subventions, mais les charges seront trois fois plus élevées. Se pose aussi la question des frais de transport des artistes, de leur hébergement… tout est forcément démultiplié. La production coûtera aussi plus cher, et nous tenons à continuer à payer les artistes convenablement. Il y a aussi les questions de sécurité : désormais nous avons un statut d’ERP (Établissement Recevant du Public) alors qu’auparavant nous étions dans un logement privé.
Est-ce que tu penses que ce déménagement va amener un nouveau public ?
Ce qui est génial c’est qu’en plus du public d’Octave Cowbell qui nous a suivis, nous avons aussi le public de Faux Mouvement. J’ai pu constater le fort attachement des Messins à ce lieu. C’était aussi le cas rue des Parmentiers, je pensais que c’était dû en partie au côté atypique de la galerie ; mais on le retrouve ici aussi.
Et concernant le volet médiation culturelle (visites, ateliers…) ?
C’est sûr que ce sera plus confortable qu’à l’époque, lorsque les ateliers débordaient dans la rue ! On va continuer à organiser des rencontres avec des artistes, accueillir des scolaires, mais aussi poursuivre les interventions dans les écoles, une partie importante de notre travail. Les enseignants sont très demandeurs de ces moments-là, malgré le fait que c’est compliqué à organiser au sein de l’institution. Pour moi, ce genre d’échappatoires a
été salutaire ; on veut vraiment aider à donner une nouvelle dimension au cadre scolaire.
Est-ce la fin d’un cycle et le début d’une nouvelle période en termes de direction artistique ?
Lorsqu’Hervé Foucher était directeur artistique d’Octave Cowbell, de sa fondation jusqu’en 2018, il voulait avant tout mettre en lumière la jeune création contemporaine. Moi j’aime mettre en regard et en relation des artistes émergents et d’autres plus confirmés. Quand je suis arrivée, j’ai proposé une ligne dans le prolongement de ma pratique d’artiste plasticienne : les rapports entre l’homme et l’environnement, les paysages en transformation m’ont toujours beaucoup intéressée.
« La Tempête des échos », qui rassemble une dizaine d’artistes que j’ai déjà exposés à Octave Cowbell, constituera la fin d’un cycle : ensuite nous nous axerons davantage sur le thème du geste et de la parole, du savoir-faire et de la transmission. Je pense que travailler par cycles est assez sain en termes de direction artistique, et attirant pour le public aussi.
Aucune nostalgie pour tes anciens locaux ?
Pas vraiment, sauf pour ces petites marches qui servaient à entrer par la fenêtre. On les a gardées, elles sont quelque part par là… ça reste un fragment de notre identité et de notre histoire.
Vous êtes à un emplacement vraiment animé, entre la sortie du centre commercial, la place Saint-Louis et ses bars, les commerces alentour… le challenge est presque de rester visibles dans la masse.
On y travaille ! Faux Mouvement était déjà un « ailleurs » presque invisible depuis la rue, avec juste cette petite vitrine que Maryse investissait souvent. Mais il y avait un vrai plaisir à aller à la découverte de cet « ailleurs », et je crois que c’est toujours le cas.
— LA TEMPÊTE DES ÉCHOS, exposition jusqu’au 27 avril à la galerie Octave Cowbell, 4 rue du Change à Metz octavecowbell.fr
86
n
s
i t u
i
-
-
Presque Partout
L’art de rien, la créativité s’infiltre partout. Avec cette nouvelle exposition, le Frac Lorraine décadre le musée tout en célébrant ses 20 ans. Imaginée comme un espace à géographie variable et inspirée par les lieux d’art alternatifs, « Presque Partout » multiplie nos points de vue sur les œuvres qu’elle présente. Une sélection de pièces issues des collections du Frac entre ainsi en résonance avec une étonnante scénographie signée Soshiro Matsubara. L’artiste japonais y a tendu d’opulentes tentures rouges, comme un labyrinthe pour mieux regarder au-delà des murs du musée. (M.M.S.)
Jusqu’au 18 août
Au 49 Nord 6 Est Frac Lorraine, à Metz fraclorraine.org

in situ
88
Mark Cohen, Sans titre, Photo : Frac Lorraine © M.Cohen

The Simple Life – Gina Folly
C’est le détail velouté d’un pis de vache. Le paysage intrigant d’une mamelle, avec ses plis, ses marbrures et ses reliefs. Ce gros plan, qui relève autant du portrait que de l’abstraction, en dit long sur l’essence du travail de Gina Folly. Pour The Simple Life, la plasticienne suisse a embarqué au sein d’une ferme flottante hollandaise, présentée comme une Arche de Noé 2.0. À mi-chemin entre le documentaire et la chronique de l’absurdité du monde, son travail s’empare du quotidien de vaches hors-sol qui y paissent pour mieux questionner ce modèle d’agriculture. Utopie ou nouvelle manne financière ? (M.M.S.)
Du 2 mars au 2 juin À la Synagogue de Delme, à Delme cac-synagoguedelme.org
in situ
89
Gina Folly, Milk I, centre d’art contemporain - La synagogue de Delme.

Lacan, l’exposition – Quand l’art rencontre la psychanalyse
L’art et la psychanalyse font-ils bon ménage ? C’est la question, épineuse mais centrale, que se pose le Centre Pompidou Metz à l’occasion de cette ambitieuse exposition. En prenant la figure de Jacques Lacan pour point de départ, elle pointe les accointances entre les grands thèmes lacaniens et l’art. De L’origine du monde de Gustave Courbet (dont Lacan fut le propriétaire), à Annette Messager ou Cindy Sherman en passant par l’univers nébuleux de René Magritte, on déambule parmi une quantité exceptionnelle de chefs-d’œuvre. Objets de désir, lapsus artistiques, regards croisés et méandres de l’inconscient font partie de la traversée. (M.M.S.)
Jusqu’au 27 mai
Au Centre Pompidou Metz, à Metz centrepompidou-metz.fr
in situ
René Magritte, The False Mirror [Le Faux Miroir], 1928 © Adagp, Paris, 2023. Photo © Digital image, The Museum of Modern Art, New York. Scala, Florence
90
Mathieu Boisadan, Le vent enflamme la roche
Choc entre antiques titans et actuels tyrans, combat de divinités mythologiques et gladiateurs des temps modernes, marche funèbre de pèlerins épuisés et valse de membres arrachés à un Géricault.
Les grands formats de Mathieu Boisadan décrivent des paysages en clair-obscur où corps, éléments architecturaux, drapés et roches sont indissociables : la matière entre en fusion, perturbant la possible douceur des instants méditatifs. Les citations, références et couches picturales se superposent et la toile devient Saint-Suaire, écran où se projette un monde à feu, à sang, à l’ammoniaque. (E.D.)
Du 9 mars au 21 avril
À La Lune en Parachute, à Épinal laluneenparachute.com
Sortie de la première monographie (224 pages) de Mathieu Boisadan aux Éditions Lord Byron (préface de Richard Leydier, texte de Benjamin Bianciotto) editions-lord-byron.fr

in situ
Introspection douce (200 × 130 cm, huile et feuilles d’or sur toile, 2019), Mathieu Boisadan © ADAGP
91
La Constellation Gustave Doré
Sombres forêts éclairées de lune, compositions dramatiques au goût sublime, terres imaginaires frôlant la science-fiction… Gustave Doré est un créateur d’atmosphère hors pair ! C’est avec un véritable esprit d’aventure que cette exposition nous propulse au cœur de l’univers graphique foisonnant de l’illustrateur strasbourgeois. En plus de dévoiler sa mise en image des textes de Dante, Perrault ou encore Rabelais, elle nous montre comment Doré s’est inscrit dans le paysage éditorial complexe du xixe et comment il l’a transformé. (M.M.S.)
Du 25 avril au 15 juillet
À la Galerie Heitz, à Strasbourg www.musees.strasbourg.eu

in situ
Gustave Doré, Charles Barbant (grav.), « Ils entrent dans l’empire de la lune ». Gravure hors-texte pour l’Arioste, Roland furieux. Poème héroïque © Photo : M. Bertola/Musées de la Ville de Strasbourg.
92

Ateliers Ouverts 25e édition
Les ateliers d’artistes parlent à l’imagination. Antichambres d’un univers, ils nous aident à percer les mystères de l’art en train de se faire. Cette année encore, Ateliers Ouverts propose d’aller à la rencontre de nos artistes de proximité, d’Altkirch à Lauterbourg. Du labo intimiste à la grange reconvertie en chantier collectif jusqu’au méga-atelier ayant fait son nid dans une friche industrielle, chaque lieu de création porte en lui un petit secret. D’un univers à l’autre, dressez votre propre cartographie des talents contemporains au fil des 150 ateliers représentés cette année. (M.M.S.)
Les 18 et 19 mai, et les 25 et 26 mai Dans toute l’Alsace ateliers-ouverts.net
in situ
93
Ateliers Ouverts 2023, Cannelle Preira – Bastion 14 Strasbourg © Alex Flores

Et le feu transforma la matière – Hors d’œuvre 2
À l’ombre de sa tutélaire cheminée, le Séchoir s’active pour déplier nos imaginaires. Dès le 1er mars, le centre d’art mulhousien prête son plateau à une exposition collective célébrant les pouvoirs de transformation du feu. Une variation autour de la matière où, entre autres propositions, la poésie verrière de Laure Fradin, les céramiques organiques de Pascale Klingelschmitt et les variations monochromes de Jonathan Naas trouvent écho. Vitrine ouverte sur l’art contemporain local, lieu de résidence et d’expérimentation, le Séchoir empruntera également les sentiers du goût avec « Hors d’œuvre 2 ». Une proposition culinaire mêlant palettes et recettes, concoctée par le cuisinier et photographe Arnaud Knecht en compagnie des artistes résidents. (M.M.S.)
Du 1er mars au 7 avril (Et le feu transforma la matière) et du 26 avril au 26 mai (Hors d’œuvre 2) Au Séchoir, à Mulhouse lesechoir.fr
in situ
© le Séchoir, Arnaud Knecht
94
Luigi Pericle, d’un monde à l’autre
Il y a quelque chose d’insaisissable chez Luigi Pericle. Homo universalis aux accents mystiques, fasciné par la philosophie zen, polyglotte acharné et illustrateur à la plume acérée, il possède la spiritualité du sage et la curiosité de l’électron libre. Pour sa première exposition monographique en France, le musée des Beaux-Arts de Mulhouse et le musée national de l’Automobile présentent ses carnets noircis de signes runiques, d’horoscopes et d’alphabets anciens, ses illustrations humoristiques et une série de toiles proches de l’abstraction gestuelle. En déployant un ensemble incroyable d’archives et d’œuvres, Luigi Pericle, d’un monde à l’autre fait tout sauf séparer l’homme de l’artiste. (M.M.S.)
Du 16 mars au 18 août
Au musée des Beaux-Arts de Mulhouse et au musée national de l’Automobile, à Mulhouse beaux-arts.musees-mulhouse.fr

in situ
Luigi Pericle, Sans titre, été 1962, encre de Chine sur papier, 30 × 42 cm, collection privée
95

Power Up, imaginaires techniques et utopies sociales
Peut-on se réapproprier la culture technique ? Revenir sur nos choix technologiques et réviser notre définition du progrès ? À travers la question de l’électricité, « Power Up » s’empare de nos imaginaires techniques pour mieux en traquer les failles, ouvrir le champ des possibles et déconstruire nos représentations. De l’utopie énergétique des centrales nucléaires à la désobéissance sociale en passant par l’obsolescence programmée, la « pétromasculinité » ou les cosmogonies technochamaniques, La Kunsthalle fait vaciller la toute-puissance de l’ordre électrique et esquisse la possibilité d’autres mondes énergétiques. (M.M.S.)
Jusqu’au 28 avril
À La Kunsthalle, à Mulhouse www.kunsthallemulhouse.com
in situ
Jürgen Nefzger, Fluffy Clouds, Sellafield, England, 2005. Autorisation de l’artiste et de la galerie Françoise Paviot, Paris
96
Cum Panis – Le pain et ses écologies
« Cum Panis » nous invite à poser nos miches dans la popote de l’art contemporain. Mêlant pratiques artisanales, réflexions sociologiques et goût du terroir, cette exposition collective oscille entre pain surprise et baguette magique. L’ondoiement des épis de blé, le paysage accidenté d’un quignon bien cuit, les métamorphoses du levain ou la boulange comme baromètre social font partie des angles abordés par les 15 artistes participants. Politique, parfois polémique et volontiers poétique, voici un projet qui casse décidément la croûte. (M.M.S.)
Jusqu’au 5 mai
Au Crac Le 19, Centre régional d’art contemporain, à Montbéliard www.le19crac.com

in situ
97
© Lúcia Prancha, Bread Story
Le Déjeuner sur l’herbe à Besançon
Monet, Manet, toujours la galère pour celui qui débute en histoire de l’art ; contemporains, ils en arrivent à peindre sous le même titre, un Déjeuner sur l’herbe. Celui de Manet est daté de 1863, celui de Monet, réponse hommage au maître, de 1865. On est dans le jeu et le compagnonnage, les femmes sont rhabillées, Courbet, l’invité, trône. Il est l’autre maître. Le musée de Besançon, qui rend l’invitation, accueille Monet, il promet même un déjeuner sur l’herbe de son esplanade en cours de végétalisation. La toile lumineuse éclaire le sombre février bisontin, annonce un radieux printemps. (L.U.)
Jusqu’au 2 juin
Au musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon mbaa.besancon.fr

in situ
98
Claude Monet, Le Déjeuner sur l’herbe, entre 1865 et 1866, Paris, musée d’Orsay © Photographie RMN-Grand Palais (musée d’Orsay)/Sylvie Chan-Liat

Otto Piene – Paths to Paradise
À l’orée des années 70, Otto Piene colorait les cieux avec ses œuvres gonflables. Ici, il semait au vent un arc-en-ciel géant (Olympic Rainbow), là il laissait d’étranges fleurs déployer leurs corolles (Fleurs du mal), quand il ne s’envoyait pas en l’air le temps d’une performance (Sky Kiss). Prenant le Sky Art pour point de départ, « Paths to Paradise » rend hommage à l’étendue des talents du créateur allemand. Sculptures, peintures, installations, dessins et croquis nous plongent dans la fabrique créative de cet artiste pionnier qui jamais n’a craint de mêler art et technologies. Un joli Piene de nez ! (M.M.S.)
Jusqu’au 12 mai
Au musée Tinguely, à Bâle www.tinguely.ch
in situ
Otto Piene, Red Autumn I, 1975 © ProLitteris, Zurich, Otto Piene Estate. Foto 2024 Museum Tinguely, Basel, Daniel Spehr
99
Marc Camille Chaimowicz
Rideaux vaporeux comme une sculpture, boules à facettes éclaboussant les murs de leur éclat, mobilier aux lignes inédites et profusion de motifs, voici quelques-uns des éléments récurrents qui ponctuent l’univers de Marc Camille Chaimowicz. Scénographies dreamy, intérieurs conçus sur mesure et autres espaces fantasmés : l’œuvre de l’artiste franco-londonien fait l’effet d’un showroom géant. À l’occasion de cette expo monographique, le Consortium Museum présente des œuvres de sa collection, des années 80 à aujourd’hui, et offre un beau panorama de l’aura Chaimowicz. (M.M.S.)
Du 26 avril au 8 septembre
Au Consortium Museum, à Dijon leconsortium.fr
 Marc Camille Chaimowicz, Festivity, 1987. Collection Consortium Museum, Dijon. Vues des œuvres de la collection du Consortium Museum dans les salles du musée des Beaux-Arts de Dijon. Photo : Musées de Dijon.
Marc Camille Chaimowicz, Festivity, 1987. Collection Consortium Museum, Dijon. Vues des œuvres de la collection du Consortium Museum dans les salles du musée des Beaux-Arts de Dijon. Photo : Musées de Dijon.
100
in situ
Vues dissimulées
Nicolas Comment poursuit les vestiges d’un passé conçu pour la musique par le petit écran. Stéphanie-Lucie Mathern nous dévoile Christophe Bogula. Myriam Mechita rit pour ne pas pleurer. Dominique Falkner goûte à l’innommable.
Nathalie Bach s’échappe au soleil. Stan Cuesta ouvre les portes de La Louisiane de Charlotte Saliou. Bruno Lagabbe fait chanter les accordéonistes. Claude De Barros accorde au perdant de réécrire l’Histoire, et Christophe Fourvel nous rappelle la nécessité de suivre Olga Tokarczuk par-delà les frontières.
FEUILLE DE ROUTES
Par Nicolas Comment
POUR NOVO, NICOLAS COMMENT NOUS RACONTE UNE SOIRÉE
MÉDIAPOP À PARIS EN COMPAGNIE DE CHRISTOPHE MIOSSEC ET DOMINIQUE A, PUIS NOUS PARLE DE LA MANIÈRE DONT ON PEUT
ÊTRE POURSUIVI JUSQU’À L’ÎLE DE RÉ PAR LES VIDÉO-CLIPS ET LA MUSIQUE QU’ON ÉCOUTAIT ADOLESCENT.
La semaine dernière, ou celle d’avant – une fois n’est pas coutume –, Philippe Schweyer et Christophe Miossec étaient à Paris. L’Alsace et la Bretagne réunies s’étaient donné rendez-vous passage Molière où une signature/rencontre était organisée conjointement par la librairie EXC et la Maison de la poésie à l’occasion de la parution du livre Miossec. Boire et Simplifier, la grande boucle, de Grégoire Laville. La communication avait-elle failli ? Une bouteille était-elle tombée à la mer ? Le message, semble-t-il, n’était pas passé dans les tuyaux. Va comprendre… Dans la petite salle de la Maison de la poésie, nous étions cinq. Avec Christophe Miossec rien que pour nous.
Visiblement non affecté par ce public restreint, Miossec répondit posément aux questions de Julien Viteau, le libraire d’EXC. Sous la voûte de pierres apparentes et son bonnet côtelé, c’était comme s’il arrivait dans une capsule spatiotemporelle. Comme s’il nous venait de « l’Ancien Monde », des cabines téléphoniques encore en fonctionnement ou bien de l’habitacle d’une Renault 12 blanche faisant des boucles sur un parking en face de l’océan. Là d’où on se tenait encore tous, les cinq dans la salle, comme les cinq doigts d’une main.
« Que devient ton poing quand tu tends les doigts ? » Miossec, 1995
Miossec s’exprima consciencieusement, presque dans un murmure, comme s’il nous parlait à l’oreille. Il parla de sa versification tordue, du fait que c’est au forceps, au chausse-pied, que Miossec rentre certains mots dans ses vers qui sont comme une « prose de travers » (Perros). Manière peut-être de s’excuser d’être un poète, il témoigna du fait que la chanson n’est pas la poésie – qu’imprimée, elle perd sa saveur. À ce propos, il convoqua Georges Perros, ses « Mots de granit et mots de laine/ Entre le sauvage et le tendre » ; et glissa cette chose poignante à propos de l’écrivain d’Une vie ordinaire dont le chanteur se sentait si proche qu’il en avait chopé la même maladie aux cordes vocales : « l’hameçon du ciel dans la langue » (Poèmes bleus, Georges Perros).
À la fin de la rencontre, depuis mon banc, j’ai demandé à Miossec ce qui l’avait décidé à chanter. Il a répondu : « Ne plus avoir à travailler » (un truc comme ça). Dans le livre de Grégoire Laville, il précise : « J’avais eu tellement de boulots différents jusque-là – journaliste d’accord un peu, mais aussi désamianteur à fond de cale dans les bateaux, peintre en bâtiment, libraire, rédacteur chez Gallimard et j’en passe – que je voyais bien que la musique pourrait peut-être me sauver. Je ne me voyais pas pouvoir continuer à évoluer dans le monde du travail, sous une autorité. » J’ai relancé une question en l’interrogeant sur son placement de voix, tellement particulier mais qu’il semblait d’emblée avoir trouvé : « C’est ma voix… naturelle. » Miossec a ensuite évoqué son passé de guitariste dans le groupe Printemps noir ; expliqué qu’il n’était pas un débutant quand est sorti son premier album (1995), même s’il avait arrêté la musique entre-temps. Dans le livre de Laville, il ajoute : « Après avoir été critique rock quelques temps – même si j’écrivais beaucoup plus sur le social ça te fait gamberger sur la musique –, j’ai eu presque douze ans de réflexion. » À propos de Recouvrance – semble-t-il sa première chanson – il indique, toujours à Grégoire Laville, qu’elle était déjà écrite trois ans avant la sortie de « Boire » (1995). Si on compte bien, cela fait tout de même quinze ans de maturation.
Après la rencontre, j’ai entraîné timidement Miossec sous un porche, dans cette venelle où l’Internationale lettriste avait, dans les années cinquante, lancé la « galerie du Double Doute » (du nom ancien de la ruelle). Je n’ai pas osé lui en parler. De Debord, Gil J. Wolman, Ivan Chtcheglov… Il
102
ÉTAPE 4 : PASSAGE DU DOUBLE DOUTE

est difficile pour moi de parler en photographiant. C’est tout l’art de Richard Dumas, que de réussir à parler et à photographier en même temps. Cela, je ne sais pas faire. Car devant Miossec, j’ai bien sûr pensé à Richard – à ses sublimes photographies de pochettes : « Boire », « Baiser », « 1964 ». Alors, pour m’excuser de ne pas être Richard Dumas, j’ai dit que j’étais plutôt de la famille de Bernard Plossu. Histoire de dire que la photo que je venais de prendre pourrait même être carrément floue… Christophe Miossec a rétorqué que Bernard l’avait photographié à Vannes, tout récemment. Je suis certain que la photo est nette.
En photographiant Miossec sous le porche, je me sentais comme dans l’habitacle d’une Renault 12 blanche sur un parking en face de l’océan. Je voyais tout ce gris – le grand Gris océanique qu’il trimballait dans son manteau de pluie. J’apercevais
l’horizon, sous son « bonnet docker », 100 % pure laine mérinos. Sur le mur gris, il était transparent et semblait « comme une carte repliée » à l’intérieur de lui-même. Voyant qu’il n’était pas vraiment là, j’appuyai juste trois fois sur le déclencheur, pour ne pas le déranger de trop.
Pour m’aider, il m’a raconté qu’il avait été photographe lui aussi, pour Ouest France, je crois. Je l’imaginais très bien photographier Philippe Pascal dans la fosse de l’Ubu, à Rennes, ou bien depuis celle du Vauban à Brest du temps de Marquis de Sade ; mais non. Il a dit qu’à l’époque, il faisait des photographies sociales, de gens du cru (je crois) et a ajouté : « Philippe Pascal, quelle gueule tout de même… » J’ai manqué de répondre : « La tienne est pas mal non plus. » Le genre de truc qui ne se dit pas. D’ailleurs, je n’ai rien dit.
Dans le hall orangé de la Maison de la poésie, nous sommes encore restés à causer – les cinq brigands - Schweyer, Laville, Viteau, Miossec et moi – de la correspondance entre Georges Perros et Bernard Noël et de la gentillesse de Johnny Hallyday. À propos de Johnny, j’ai balbutié maladroitement qu’il était comme un poteau planté dans le décor –
103
Le banc de la Mélancolie, La Couarde-sur-Mer, 2024

je voulais dire « balise », mais le mot n’est pas venu – ; on pouvait tout autant s’en rapprocher que s’en éloigner, il n’empêche qu’elle manquait au paysage, la balise. Miossec m’a encore aidé à conclure en disant, tout doucement : « Oui. C’est comme un grand trou dans le ciel. »
Là, on est tous devenus transparents – le club des cinq hommes gris dans le hall orangé de la Maison de la poésie. L’effervescence autour de nous était palpable. La librairie EXC était déjà pleine d’un autre débat, un concert allait débuter dans le Théâtre Molière. La foule envahissait l’ancien passage du Double Doute.
Julien Viteau nous a emmenés diner dans un restaurant de la rue SaintMartin où passait de la musique lounge. Malgré la bande sonore, je me disais que c’était chouette de se retrouver en face de Miossec, que j’avais écouté dans toutes les piaules de ma jeunesse perdue. Je revoyais très bien la lumière de l’appartement des pentes de la Croix-Rousse, quand la cassette de « Boire » est arrivée sur une étagère de la rue des Tables. Ce n’est pas moi qui l’avais achetée. Bruno peut-être, Bruno sans doute sur la foi d’un article de JD Beauvallet, du temps où les Inrocks étaient moins corruptibles. « Boire » fut, avec quatre ou cinq autres albums, la bande-son de nos années Beaux-Arts.
À table, j’ai évoqué Higelin, un séjour à l’île d’Oléron avec Higelin. Et Miossec, un concert avec Jacques, en première partie de Renaud. Higelin devant le public de Renaud qui attendait Renaud et ne voyait tout simplement pas Jacques, se démenant, se surmenant, devenu tout à coup invisible lui aussi (comme quoi même Higelin pouvait être invisible, parfois). Miossec me raconta comment ils avaient passé toute une nuit ensemble, à boire, pour éponger l’angoisse d’Higelin devenu d’un seul coup transparent. J’ai alors osé l’interroger plus intimement sur ses maisons de bois, en disant que c’était Christophe Acker – un ami commun réalisateur – qui m’avait raconté que Miossec avait récemment simplifié sa vie et qu’il vivait désormais dans un genre de maisons Castors, près de la mer.
Miossec approuva et me surprit en me racontant la rencontre de Christophe Acker avec sa nouvelle compagne, Théodora, qui marchait sur la route juste devant sa petite longère bretonne où je venais de passer une partie de la semaine précédente à finaliser un clip avec lui. Je méditais en fait depuis quelques jours sur ce bizarre objet qu’est le « clip » auquel j’avais proposé à Philippe Schweyer de dédier ma prochaine chronique pour Novo . Pour m’aider dans ma tâche, Christophe Acker – qui a filmé Miossec, mais également Bashung, Lavilliers ou Murat (etc.) – m’avait écrit l’avant-veille : « Pour moi, en tant que genre cinématographique, le vidéo-clip est une forme d’art multidimensionnelle. J’entends par là qu’à travers l’étude de ses aspects narratifs, esthétiques, techniques, et culturels, on peut mieux comprendre non seulement l’œuvre elle-même, mais aussi son rôle dans le paysage culturel plus large. En venant des beaux-arts, j’ai toujours réalisé des clips comme je réalisais des vidéos pendant mes études. L’expérimentation et la surprise de l’instant ne sont jamais très loin. Et j’ai toujours considéré le clip comme une forme libre d’exercice cinématographique. »
À propos de celui qu’ils avaient réalisé ensemble
– On vient à peine de commencer – Miossec me dit : « Christophe m’a filmé sur un rocher, juste en bas de chez lui, face à la mer. Et le clip… c’est ça. » En fait, « c’était quand même un peu plus compliqué », m’a expliqué le lendemain Acker qui avait bien vu, lui aussi, que Miossec est un paysage. « Je crois beaucoup plus aux influences qu’on ne maîtrise pas en fait, aux influences corporelles, aux influences du temps, des paysages, tout ce qu’on n’analyse pas, tout ce qui nous pose en tant qu’animal dans un endroit. On est l’accumulation de ce qui nous entoure. » (Miossec, entretien avec Grégoire Laville)
Après le repas, Miossec, qui chantait le lendemain soir à l’Olympia pour l’hommage à Jane Birkin –Jane by Friends – s’excusa, car il devait protéger ses
104
Miossec, passage Molière, Paris, 2024
cordes vocales pour le concert. Mon pote Acquin était venu me retrouver et nous allions partir quand Philippe Schweyer me dit discrètement : « Reste un peu, Dominique A va nous rejoindre. » Grégoire Laville, pendu au téléphone dans la rue SaintMartin, demandait le nom d’une adresse de bistrot pour pouvoir la donner à Dominique. J’ai proposé le Bistrot des Halles, situé juste à côté du studio Alphaville, que je connaissais bien pour y avoir mixé mon dernier album. Un des derniers vrais bistrots des Halles. Un des seuls bistrots de Paris où on peut encore fumer le soir tard, à l’intérieur. Avec Grégoire, Acquin et Philippe, nous filâmes donc aux Halles.
Dominique arriva, accompagné de Marc Darc Dufaud et d’une petite bande d’éditeurs. Comme je saluais Dominique en lui disant simplement : « Ben… on ne se connaît pas », il répondit, blagueur : « Nicolas… Comment ? » Moi qui, comme tous les jours de ma vie, me sentais ce soir-là encore plus parfaitement invisible, j’étais mouché. J’ai failli lui répondre « Dominica… ? », mais en apprenant sur-le-champ qu’il lisait mes chroniques dans Novo – il les cita même, une à une –, je suis resté bouche bée. À cause de la matière de son pull-over pourtant bleu, je repensais à sa marinière rouge dans le plan séquence du clip de son tube Twenty-Two Bar. À l’apparition de Françoiz Breut vêtue d’une guitare demi-caisse qu’elle portait comme une seconde robe. N’étaient-ils pas tous deux le prototype du couple cool auquel on s’était tous identifiés ? Je parle de nos couples des années 90. De ceux qui ont, depuis belle lurette, explosé. Nos couples cool du temps où on s’aimait sans se poser vraiment la question de savoir qui était la fille ou le garçon. Dominique A et Françoiz Breut avaient écrit un bout d’histoire de nos intimités… Ou bien c’est leur intimité qui avait fait Histoire dans la nôtre. Enfin bref.
Assis à mes côtés, Dominique A parlait de Modiano dont il allait bientôt chanter les louanges d’après des textes de Jean-François Mondot (présent également à la table), tandis que moi, je le revoyais debout près d’un métronome, avec ses grandes mains de mime Marceau posées sur son jean noir. En face de lui, Philippe planait. Il planait en souriant plus ou moins aux anges. Quelle bonne blague il me faisait : certes, il n’y avait pas eu grand monde à la soirée Médiapop ce soir, mais il n’empêche que me présenter, coup sur coup, les deux vrais patrons de « la chanson d’ici », c’était beaucoup pour mon petit cœur.
« À la télévision française, je chantais Je ne sais plus pourquoi c’était non… non ! En face moi les gens dormaient Si par hasard ils s’réveillaient Ils sentaient
Leur vieux décor se balancer Plusieurs fois sur toi Manquait de tomber
Même si le petit pont de bois S’écroulait
Les cocoricos s’élevaient La chanson d’ici Ils y croyaient »
Dominique A, Paroles transformées du Twenty-Two Bar, lors des Victoires de la Musique, 1996.

Il était déjà presque deux heures du matin. Comme je lui demandais l’autorisation de faire une photographie de lui, Dominique me répondit, gentiment : « Oui, mais seulement de profil. Car je suis cuit. » D’accord. Juste de profil. Comme sur la pochette de « La Fossette », son chef-d’œuvre d’introspection. Tellement introverti que cet album nous autorisa tous à oser chanter. Et dans mon cas, à oser chanter contre le Spectacle, disons tout contre. Je n’étais pas le premier à le lui dire ni le dernier ; Miossec lui-même, à propos de « La Fossette », n’avait-il pas confié à Grégoire
105
Dominique A, Bistrot des Halles, Paris, 2024
Laville (assis juste en face de nous) : « Dédé de D3 m’a fait écouter le disque à trois heures du matin. Le lendemain, je l’écoutais en boucle. J’étais enthousiasmé, et, d’une certaine façon, rassuré. »
Dominique A rétorqua, modeste : « Mais c’est juste parce qu’il n’y avait rien à l’époque. Rien, sauf peut-être Jean-Louis Murat, “Cheyenne Automne”. » Mince… Cette fois, c’est L’Ange déchu que je voyais défiler dans ma psyché : Jean-Louis Murat une main sur la tempe, mélancolique, se projetant pour lui tout seul un film en super 16 dans un de ses tout premiers clips. Mais de quel film s’agissait-il au fait ? Un train s’avançait dans la neige, des Indiens en descendaient, ils attaquaient le convoi… Murat dodelinait de la tête : il dansait juste du bout des lèvres. Même concept dans son dernier clip – Je me souviens – où il se passe le film de sa vie. Sauf qu’à un moment, Murat se lève et s’approche de l’écran rouge. Quelques images – subliminales – nous montrent alors ce qu’il regarde et qui l’observe : des portraits de lui-même, coiffé en chef indien. Je n’avais pas fait le raccord, pas vu le collage jusqu’alors… L’effet de boucle, testamentaire… Philippe, c’était quoi cette soirée Médiapop où les chanteurs de la jeunesse perdue apparaissaient les uns après les autres dans les cafés de la jeunesse perdue ? Debord, Modiano, même combat. « Quand on est adolescent, ce que l’on écoute, ça vous poursuit. » (Miossec, entretien avec Grégoire Laville)
Le lendemain, j’ai repensé à ma chronique consacrée au vidéo-clip. Christophe Acker m’avait écrit dans sa lettre : « Notre génération a grandi avec le clip de Michael Jackson de John Landis diffusé au journal de 20 h et annoncé comme un événement culturel majeur. Dès lors, j’ai pris le vidéo-clip au sérieux. Je me souviens surtout des frayeurs nocturnes qui suivirent. Le rythme, la chorégraphie, la voix off, la musicalité de ce film. Car il ne s’agissait pas d’une comédie musicale, mais plutôt d’un morceau de musique qui enfantait un film. Comme dans The Brood de Cronenberg, une forme de “Psychoplasmie”, le morceau créait un être fantastique sous forme de film. (Mais n’allons pas trop loin.) »
Acker avait raison, le clip était un monstre. Thriller de Michael Jackson, personnellement, je l’ai subi, moi aussi. N’avons-nous pas tous subi l’invasion dans nos vies de MTV ? Les morts-vivants, les zombies… Ils nous poursuivent encore. Pour illustrer son propos, Acker m’avait envoyé des exemples, tous effrayants. Unkle - Rabbit in Your Headlights (1998) de Jonathan Glazer avec Denis Lavant ; Depeche Mode – Wrong (2009) de Patrick Daughters où un type roule à rebours… Arrgh… Les zombies de MTV, Denis Lavant mille fois renversé, Murat revenant en chef sioux, tout ça était beaucoup trop nervalien pour moi. Je reportai l’écriture de ma chronique.
Deux jours plus tard. Milo m’annonça qu’un ami venait de lui proposer les clefs d’une maison située à l’extrême pointe nord-ouest de l’île de Ré. Nous partîmes dans la confusion – Unica, Milo et… moi, déjà en retard sur ma chronique. Sur la route de La Rochelle, avec Milo, on se passa le Best Of de Miossec, entrecoupé de quelques-uns des tubes de Dominique A : Au revoir mon amour, Les hauts quartiers de peine, Éléor. Enfin peut-être pas vraiment des tubes, mais rien que des grands titres.
Le lendemain, en redescendant les 250 marches (et quelques) du phare des Baleines, j’avais la mélancolie. Il pleuvait sur la mer. Tout là-haut, je venais de revoir le même grand Gris que celui que portait Miossec sur son manteau de pluie, dans le passage du Double Doute. Un gris de tube de peinture. En voyant passer un cargo, au loin, j’ai songé au Cargo de nuit d’Axel Bauer et Mondino. Bon dieu, il fallait à tout prix que j’écrive ma chronique ! Je tournais autour du pot au pied du phare des Baleines.
Mondino, Modiano… J’ai laissé Milo et Unica dans la boutique de souvenirs et suis vite rentré à pied dans la cuisine de la jolie maison de l’île de Ré.
J’ai cherché sur YouTube des clips de Mondino. Et je suis retombé sur Osez Joséphine et Volutes… Bon sang ! Avec ma double casquette de photographe et d’auteur-compositeur, je devrais quand même bien réussir à dire quelque chose sur ces chefs-d’œuvre. Je n’y arrivais pas. J’ai écrit une seule phrase : Les rapports de la musique avec l’image sont comme ceux des domestiques avec la direction de l’étage. Bof, bof… Je suis revenu à la lettre que Christophe Acker m’avait envoyée : « Les vidéo-clips peuvent varier de manière significative en termes de structure narrative. Et je pense en avoir exploré pas mal. Certains clips racontent une histoire cohérente du début à la fin, d’autres adoptent une approche plus fragmentée ou expérimentale. Mais le plus important pour moi, les questions que je me pose et que je me poserai toujours sont de comprendre comment la structure narrative du clip soutient ou enrichit la chanson. Comment le clip peut offrir des insights sur les intentions du réalisateur et de l’artiste. Qu’une vision commune puisse exister. »
Le sujet semblait vaste. Même si je me cantonnais aux clips français, il eût fallu que je parle de la French Touch, d’Alex Gopher ; du Rap et des merveilleux clips de Odezenne, de Orelsan, tout ça, tout ça. Et puis, le clip c’était aussi les filles, les femmes : Madonna, Cindy Lauper, etc. C’était aussi… l’érotisme. Étienne, Étienne… En France, c’était Lio – Les brunes comptent pas pour des prunes – c’était Elli… Bien à l’abri dans leurs beautés et dans mon souvenir. J’ai griffonné dans mon carnet : Leurs jambes immarcescibles. Dans le même cahier, j’avais noté des trucs aussi sur Gondry. À propos de son clip pour Jean-François Cohen, La Tour de Pise, où paroles et images s’imbriquent comme deux corps – chef-d’œuvre encore, immarcescible. Mais je n’arrivais à rien. Comme l’océan face au phare des Baleines, c’était trop vaste.
Peut-être aussi parce que j’avais commencé par parler de la soirée parisienne de Médiapop. De Miossec, de Dominique A, et que le simple fait que je sache qu’ils me liraient peut-être dans Novo me bloquait. Milo et Unica allaient à la mer et moi je restais à procrastiner dans la cuisine de la maison de rêve de l’île de Ré sur cette notion complexe de « clip ». Je retournais aux notes que Christophe Acker m’avait envoyées : « Je considère le clip comme une expérience synesthésique. En mariant la musique à l’image, le clip peut amplifier l’impact émotionnel de la chanson, en donnant au spectateur non seulement quelque chose à écouter, mais aussi à voir. »
106
Le soir, au diner, j’ai dit à Milo qui me questionnait sur l’avancée de ma chronique : « Je n’arrive à rien. Je crois que j’ai la mélancolie… » Cela a eu le don de l’énerver. Genre : « On est pour une fois tranquilles en famille sur l’île de Ré, et toi, tu as la mélancolie ?! »
Pour m’excuser devant ma fille qui me fixait désespérément, j’ai dit : « Mais ce n’est pas triste la mélancolie, c’est même du luxe, la Mélancolie ! »
Et là, ça a tilté. J’ai revécu la première discussion que j’avais eue avec Philippe Schweyer à propos de cette putain de chronique que j’avais souhaité dédier au vidéo-clip. À ce moment précis où Philippe avait dit « Les clips… Je les regarde pas. Je préfère la musique sans image. » Ce avec quoi je n’étais pas vraiment en désaccord ; mais au bout du téléphone, j’avais quand même défendu mon truc en parlant de Robert Smith balançant la caméra de Tim Pope dans la vidéo d’In Between Days. « En fait, dans ma chronique, j’aimerais parler de ce genre “volatile” qu’est le clip… Tu vois ? » Philippe m’avait alors répondu : « D’accord, mais pour moi un clip marquant c’est La Mélancolie de Miossec. Juste quelques rushs tournés à l’arrache, sur l’île de Ré. »
J’ai repassé le clip sur mon téléphone. Ça ressemblait vraiment à là où on était. Ces rues, ces maisons blanches, ces volets verts. J’ai dit aux filles qui écoutaient les paroles désespérées de la chanson et étaient toutes interloquées. « Mais… C’est là !? » Sur YouTube, il y avait en vignette une image du bar-tabac Les Mouettes. J’ai tapé le nom du restau. C’était à quelques kilomètres. Sur place, la typo verte de la façade qu’on voyait dans le clip avait changé. J’ai eu un doute… Ce n’était peut-être pas là… le bar de la Mélancolie ? On était dimanche, le bistrot allait fermer. J’ai dit au type qui fermait la porte : « Vous connaissez Miossec, le chanteur ? » « Miossec ? Ben oui, on l’a vu souvent ici. Il jouait à La Maline, la salle de spectacle à deux blocs. Par contre, La Mélancolie, je ne connais pas. » J’ai tendu mon portable avec la vignette. « Regardez ». « Oui, il y a cinq ans, c’était encore comme ça. La façade vient d’être repeinte. »
Avec Milo et Unica, on est allés voir La Maline. Derrière le grand cube blanc de la salle, on a poursuivi dans la bruine vers la mer en prenant le chemin « Du peu des hommes ». Unica a tracé dans le sable, vers les vagues. Il pleuvait toujours sur la mer. Une toute petite pluie fine. Partout, c’était un grand monochrome gris dans le crachin. J’ai pris mon appareil recouvert de minuscules gouttelettes et j’ai cadré un banc. Le banc de la Mélancolie dans la purée de pois.
En repassant par le village, j’ai reconnu dans le brouillard le clocher de l’église devant laquelle s’arrête la Renault 12 blanche, avec les musiciens de Miossec dedans (dont Arnaud Dieterlen, sous une perruque) qui font… des conneries.
« Quand on est adolescent, ce que l’on écoute, ça vous poursuit. »
Le soir même, je me suis rejoué le morceau de Miossec dans la cuisine de la maison de l’île de Ré. En fixant par-dessus les toits une cheminée de brique qu’éclairait le phare dans la nuit, j’ai senti que sa Mélancolie m’avait guéri de la mienne. Je tenais enfin ma chronique et pouvais aller à la mer.
« La mélancolie qui vient qui cogne
À la porte si souvent
Que l’on s’y abandonne
Que l’on se roule même dedans
La mélancolie
De nos meilleures années
Nos compagnes nos conneries
Ne doivent pas un jour s’oublier »
Christophe Miossec, La Mélancolie (2006)

Unica et Milo, La Couarde-sur-Mer, 2024
107
CHRISTOPHE BOGULA MES CHEVEUX ONT TOUJOURS FAIT PARLER
Par Stéphanie-Lucie Mathern ~ Photos : Benoit Linder

Rien n’a d’importance pour Christophe Bogula. Il a grandi dans la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines et beaucoup de ses amis se sont suicidés.
Nous sommes liés par une sorte de résonance obscure, celle qui fait le pont entre le petit désespoir et le charme seventies.
La rencontre se fait en deux temps ; chez lui, boulevard de la Marne, « j’habite à côté des vendeurs de sapins », précise-t-il quand on demande l’adresse exacte. Presque un titre de SAS ; à peine arrivés sur le pas de la porte, il nous dit : « je n’ai besoin de rien », et pourtant on finit par tous boire des cocktails avec Isabelle, sa compagne. Son esprit est fait de blagues absurdes et potaches dans un monde de plus en plus aseptisé. On se fait chier dans la ouate.
La suite se fera dans un garage à motos près d’Ernolsheim, sorte de garçonnière où il peut réparer, rouler, et jouer d’une complicité de l’amour des vieux objets. Ses motos sont des pièces de musée : une OMB 175 Corsa de 1935, une Gilera Saturno Competizione de 1947, une Moto Guzzi Airone de 1955. La favorite, une BSA M24 de 1939, a été achetée avec sa première paye : 600 francs. Elle est aujourd’hui protégée par le drapeau européen. On y trouve aussi une Yamaha 350 TZA orange de 1973.
On y voit son goût pour les séries B, le cinéma pointu, à la limite du monstrueux. Il aime particulièrement Freaks, « un film qu’on n’oublie jamais ». La question du monstrueux hante nos vies : suis-je comme les autres ou suis-je un monstre ? La question conditionne ou soumet une existence.
Christophe est un esthète. Il sait qu’au restaurant, il est préférable de prendre deux entrées plutôt qu’un plat, et que si le dessert n’est pas fait par un pâtissier, c’est non.
Il cuisine lui-même très bien, une cuisine instinctive, de marché. Christophe aime Swans, Bill Brandt, et est certainement un des meilleurs photographes (méconnus encore) que je connaisse. Sa vision du Val d’Argent dans les 70′ mélange présence de la mort, alcoolisme, antimilitaria et esprit libertaire. Il a aussi documenté Lourdes dans les années 80, époque où il partait un mois en Turquie, en 304. Il continue aujourd’hui à faire des diptyques, clashs, avec un juste regard sur le réel qui pourrait être illustré par Flaubert : « La meilleure manière de critiquer quelque chose, c’est de le décrire. » Une expo est en prévision au Port du Rhin.
Christophe a raté le concours des Beaux-Arts de Mulhouse et travaille pour Rubis Terminal. Il a toujours montré ses copains à l’œuvre, dans le spectacle comme dans le béton des usines. C’est

— Nous vivons en enfants perdus nos aventures incomplètes. —
Guy Debord, Hurlements en faveur de Sade
une sorte de Charles Fréger de la CGT. L’homme est ce qu’il cache, un petit tas de secrets. Christophe cache ce que les autres exposent – souvent par pure vanité. Il sait que plus tu vieillis, plus le temps passe vite. C’est un enfant échappé d’un vieux HaraKiri avec les cheveux bouclés d’un putto exubérant.
109
UNE HISTOIRE DE SAINT-VALENTIN (LES VERGES MALADES)
Par Myriam Mechita

Tout est gris en ce moment, le ciel, le visage des gens, notre espoir commun à vouloir sortir de cette période de merde qui s’éternise, et ne parlons pas de l’impossibilité à trouver l’Amour. Tous les jours, une catastrophe en chasse une autre…
J’avais décidé que je n’allais pas me laisser abattre et que, peut-être, ce serait bien de continuer à rencontrer des hommes par le biais de ces applis qui vous broient le cœur et l’esprit au passage.
Il est assez simple de comprendre justement que ces échanges sur ces applis sont sans intérêt, ou tout simplement voués à l’échec. Sorte d’enchaînement de questionnaires. Presque faudrait-il que je me mette en tailleur et jupe serrée tant j’ai l’impression de passer un entretien d’embauche, arrivant frêle au rendez-vous, mon CV à la main.
À la fin, je me demande toujours en riant : « Alors, j’ai le job ou pas ? »
En vrai, je ne le veux pas cet emploi de femme qui entre dans les cases…
Je discute avec un expert-comptable. Fred, 46 ans, échange simple, fluide, plutôt drôle.
Il me faire rire, c’est vraiment ce qui fait la différence, parce que souvent, les discussions sont plates, mornes et focalisées sur les hobbys, et le sport de haut niveau.
Comme je ne fais pas de sport, et que je n’ai pas de hobby, en général, c’est assez rapide. D’ailleurs, je me demande, comment est-ce possible que 95 % des hommes sur ces applis font du kite surf, du surf, du fitness ou des sports d’altitude… Et quand je les rencontre en vrai, leurs corps ne rendent pas vraiment compte de tout ça… Déjà faudrait-il que je les reconnaisse vu l’écart avec les photos…
Cet homme est sympa, pour un expertcomptable, si j’ose dire. Je vais pouvoir écrire un livre bientôt sur les échanges amoureux par catégories socioprofessionnelles, je commence à en connaitre un rayon. Vu que moi on me range dans les esthéticiennes en institut… ou dans les hystériques excentriques…
« C’est cool d’être artiste, tu dois être complètement déjantée. » Oui, voilà, c’est ça…
Je me dis que c’est bien qu’on s’écrive pas trop longtemps, histoire de ne pas fantasmer pour rien,
110
Le grand amour n’existe pas, crayon sur papier 65 × 50 cm
et de se retrouver hyper déçus quand on se verra en vrai.
Il est d’accord et, même si on a fait un visio, très court, je lui propose de le retrouver le surlendemain dans Paris.
Il me dit que c’est parfait pour lui, il habite en grande banlieue, très grande banlieue, me précisant au passage que ça va être dur de se voir régulièrement, si jamais on se plait… Ça promet…
On échange quelques mots en attendant, rien de fou, ni même de surprenant. « Bonjour, bien dormi ? Bonne journée, tu manges quoi… ? »
Je lui donne rendez-vous à la fontaine Niki de Saint Phalle et, après lui avoir expliqué ce que c’était, Beaubourg y compris, je l’attends assise sur le banc en métal qui me glace les fesses. Il fait si froid.
Je regarde des skateurs faire des ollies avec brio, et je repense au soleil de Venice Beach.
Il arrive, sa silhouette pataude et sa démarche me font dire que ça ne sera pas lui. C’est étrange de deviner cette chose très animale en deux secondes. Il a 46 ans et s’habille comme un homme de 60, traînant un sac sur roulettes… Pour le glamour, ça ne sera pas pour cette fois, c’est certain, et j’étais loin de deviner la suite.
Il s’assoit, et c’est toujours émouvant de tout rassembler, passer du SMS à la voix, et au corps tout entier.
On se sourit.
Je reconnais sa voix et ses mots.
Je vois qu’il ne me plaît pas du tout pourtant lui semble très heureux de ce moment.
On échange quelques banalités, et je suis transie de froid, je lui propose que nous marchions. Il me dit :
— Super, je dois passer faire une course chez l’herboriste.
Je vois où se trouve cette boutique. Je calcule à peu près le chemin et je me dis : « Parfait, dans 20 minutes, je suis libre. »
Nous marchons rue des Archives, avec un vent glacial. Toutes les banalités de circonstances y passent, la Covid bien évidemment, en évoquant que ce monde est fou, et que ce sera chouette quand tout ira mieux (oui, voilà), ensuite nous enchaînons sur la température très froide qui nous saisit (voilà, voilà) pour finir sur la difficulté à être sur les applis… (voilà voilà, voilà voilà)
Et là, nous arrivons devant la porte de la boutique… Je lui dis que je l’attends dehors, s’il en a pour quelques minutes, ça ne me dérange pas…
Il insiste :
— Non viens, mets-toi au chaud, je dois prendre très peu de choses.
Je monte les deux marches et je me retrouve dans la petite boutique.
Fred discute avec le vendeur :
— Avez-vous de la verge d’or, parce que j’ai une cystite carabinée.
J’écarquille les yeux et j’esquisse un sourire, en me disant : « Mais ça va pas ou quoi, ce type est fou… au premier rendez-vous. »
Et là, la discussion enchaîne sur les types de brûlures de pipi…
— Ça vous brûle plutôt au jet ou alors plus haut ?
Je me tourne vers la vitrine pour ne pas exploser de rire, regardant les cailloux posés sur le socle faisant semblant d’être experte…
— Et sinon, ça brûle aussi le gland ou pas ?
— Ah oui, ça me brûle à fond, je crois même que j’ai des boutons…
Je pense que je fais une tête impensable. Heureusement que je suis de dos… Faisant semblant de ne rien écouter, au bord du fou rire.
— Mais comment sont les boutons… petits, transparents, ça gratte ?
Là, je tousse pour ne pas entendre la réponse, et je ferme mes oreilles et mes yeux pour ne plus assister à cette scène surréaliste.
Quand j’étais enfant, je faisais ça, ça marchait assez bien.
Je me mords les joues pour ne pas rire.
Ce type est soit génial, soit complètement cinglé, j’opte pour la deuxième… à notre première date… And I swear to God, que ce sera la dernière…
Et il parle de sa bite malade pendant dix minutes sans problème…
Je suis sans voix.
J’oscille entre courage et inconscience… Et je me demande s’il trouve ça glamour ou juste peut-être est-ce un homme nature qui ne met pas de barrière entre la pudeur et les autres.
Nous sortons et je reparle du froid, en pressant le pas. Arrivée au premier croisement, je dis :
— Ah voilà, c’est là que nous nous séparons.
— Ah déjà ? D’accord… Alors, on se revoit quand ?
J’esquive.
— Faut que je file, on se dit ça plus tard par SMS…
Je n’ai pas marché, j’ai couru, laissant derrière moi ce type qui me répugnait.
Son visage, sa silhouette vieillotte, ses fringues de vieux, sa bite malade…
Je n’avais pas encore fini ma course que j’ai reçu un SMS…
— Merci pour ce rendez-vous, je sens une grande attirance entre nous, tu es, je crois, une belle évidence. Je viens cuisiner demain, chez toi ?
J’ai réfléchi pendant un moment à la réponse, parce que je n’avais aucun mot…
— L’attirance n’est malheureusement pas réciproque.
Sa réponse a été magique :
— L’attirance, ça se travaille, ça se découvre…
J’ai ajouté avant de le bloquer :
— Ou pas.
111
L’AMÉRIQUE DANS LE RÉTRO
Par Dominique Falkner ~ Gravure : Henri Walliser
GRAISSE DE CHIEN
« Souvent, vers quarante ans, l’homme se fatigue. Il ne veut plus courir, il aspire à plus petit », écrivait Nicolas Bouvier. J’en avais soixante et le Suisse avait raison, je commençais à donner de sérieux signes d’épuisement. Je pensai ensuite que si on voyage longtemps pour goûter ce qui nous différencie de l’autre, un jour c’est fini, et c’est même l’inverse, car dès lors, ce qui nous pousse encore sur les routes du monde, c’est au contraire ce qui nous rapproche des autres. Je ruminai tout cela quand, de fil en aiguille, je compris soudain que mes divagations signifiaient simplement que j’en avais assez de la Colombie-Britannique, qu’il était temps de rentrer au bercail, et je réservai illico un billet retour par le vol de nuit du soir même, le fameux red-eye des Anglo-Saxons où on se tourne et se retourne engoncé inconfortablement dans son siège, ceinturé à l’étroit, et les yeux rouges, justement, de sommeil.
Mon voisin de droite est Polonais, guide de haute montagne et en route vers les Rocheuses où il se rend à une compétition internationale d’escalade libre. Volubile à souhait, il m’entretient depuis le décollage de sa passion et de sommets lointains aux noms exotiques : Dhaulagiri, 8 167 m, Lhotse, 8 516 m, Makalu, 8 481 m, Cho Oyu, 8 201 m, Kangchenjunga, 8 586 m, Nevado Ojos del Salado, 6 893 m, quand il extirpe soudain de son sac de voyage un flacon de substance jaunâtre dont il me conseille d’avaler une bonne cuillère, m’assurant que c’est autrement plus efficace que les 1 000 mg de paracétamol que je viens de prendre. Je le remercie, mais ça va aller, un simple mal de tête. Il insiste : « Justement, allez-y, vous allez voir, la graisse de chien est implacable, la panacée universelle, un vrai miracle, mais pas n’importe laquelle, bien sûr. La meilleure, comme celle-ci, provient de mastiffs tibétains. Les vertus curatives sont légendaires. C’est immédiat, sans bémol, et ça marche pour tout. J’en mets même dans le café de ma fille pour qu’elle ait de bonnes notes à l’école ! » Il regarde alors autour de lui, se penche
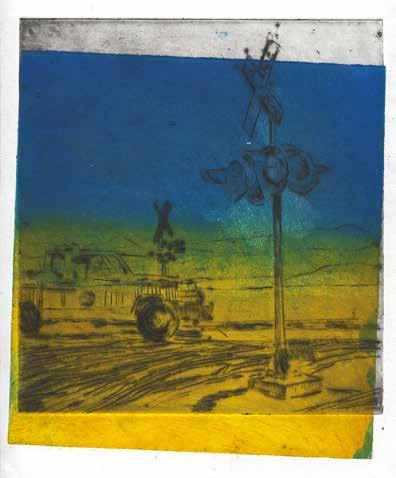
vers moi, presse le flacon dans ma main et baisse la voix : « Secret de mecs, mais deux bonnes cuillérées coup sur coup et tu bandes comme un cerf pendant des heures. »
Huit heures plus tard, de retour à Key West, j’allume mon ordi et relis son dernier e-mail. Elle préfère « courriel » et ne manque jamais de me le rappeler. Elle m’écrit que les hommes et les femmes ne sont pas faits pour s’entendre, mais que ça ne fait rien, s’aimer n’est déjà pas si mal. Elle m’écrit un autre truc qu’elle a aussi lu elle ne sait plus où, et noté, me dit-elle, à savoir que c’est bien beau de se parler dans un couple, encore faut-il s’entendre. Deux phrases distinctes pour dire la même chose.
112
Elle ajoute qu’elle est à Las Vegas maintenant où elle a vu Lady Gaga en concert et perdu beaucoup d’argent au blackjack. Elle ne précise pas combien, écrit juste a bunch of dough, « un paquet de pognon ». L’argot n’est pas son truc et j’en déduis qu’elle ne voyage pas seule ou s’est acoquinée sur place à un type à qui elle emprunte, le temps d’un mail, cette expression familière qui ne lui ressemble pas. Je renonce à répondre, m’éloigne de l’ordinateur et regarde par la fenêtre de la chambre. L’asphalte de la US1, la route qui relie Key West à Miami loin au nord, fond au soleil dans les vapeurs de goudron. On est en janvier et la température extérieure plafonne exceptionnellement depuis trois jours à 98 degrés Fahrenheit à en croire le thermomètre de la terrasse, 37°C de chez nous. Aussi chaud qu’à l’intérieur d’un corps, je pense alors qu’une touriste en bikini noir traverse le parking du motel d’en face au ralenti, abrutie de chaleur, comme un hydrofoil à la dérive, les boucles de ses cheveux ondulant dans la brise océane, le corps bronzé, la quarantaine. Elle hésite à traverser la route, revient sur ses pas, allume une cigarette, scrute l’océan de l’autre côté de la chaussée, qu’elle ne semble toujours pas décidée à franchir. Son hésitation confère un sentiment de désarroi palpable à ses actes, comme si elle hésitait à commettre un acte irréfléchi soudain, se jeter sous une voiture, par exemple. Sentiment renforcé par les deux tâches rouges de ses espadrilles sur le macadam noir uniforme, le bikini de couleur identique disparaissant quant à lui complètement, comme happé par l’immense carré noir du parking, tant et si bien qu’elle paraît soudain complètement nue. Je la filme depuis quelques minutes déjà, en 4K à 60 images par seconde, incognito, planqué derrière ma fenêtre, le puissant zoom numérique de mon appareil recouvrant de millions de pixels les hanches miraculeuses et les seins lourds. Je pense à Candice Bergen dans Vivre pour vivre de Lelouch, à Jessica Lange dans Le facteur sonne toujours deux fois , à Gena Rowlands dans n’importe lequel des dix longs métrages qu’elle tourna avec John Cassavetes, Faces et Une femme sous influence notamment. Long plan immobile sur son visage. Gros plan interminable. Caméra au poing, je récris le story-board de sa vie à ma guise et en toute impunité. Elle se tourne soudain de nouveau vers l’océan et je la filme de dos maintenant, longuement, puis j’éteins la caméra. Une chose de sûre, une cuillérée de graisse de chien et je ne donne pas cher du bikini.
REGARD N° 22
Par Nathalie Bach

113
Nathalie Bach par Mar Castanedo
LE REFUGE DES ÉTOILES
Par Stan Cuesta ~ Photos : Olivier Roller
ÉTIENNE
Dans l’entrée du mythique Hôtel La Louisiane, rue de Seine à Paris, je suis accueilli par une immense affiche du livre de Charlotte Saliou, Le Refuge des étoiles. C’est ici que j’ai rencontré Charlotte pour la première fois, il y a deux ans, à l’occasion du vernissage de la très belle exposition de Nicolas Comment consacrée à Étienne Daho, « Hôtel des infidèles » – titre emprunté à une chanson de Daho, elle-même inspirée par cet hôtel où il a séjourné quand il était jeune homme. Une soirée mémorable. Depuis, Charlotte a écrit un recueil de poésie, Et vivre, ma folle vagabonde, paru en janvier chez Unicité. Et ce premier « roman », Le Refuge des étoiles , plus ou moins autobiographique, dont l’action se déroule à l’hôtel. L’héroïne, Charly, y travaille comme réceptionniste, tout comme l’autrice, qui décrit ce livre comme une autofiction : « La partie historique est forcément vraie parce que je ne peux pas mentir sur la mort de Juliette Gréco ou sur des événements de ce genre, mais la partie personnelle… Je m’amuse un peu avec ça. »
PATTI
La Louisiane, c’est bien sûr cet hôtel légendaire de Saint-Germain-des-Prés qui a vu défiler les plus grands artistes du vingtième siècle, de Sartre à Tarantino, en passant par Pink Floyd – c’est là qu’ont été tournées les scènes d’ouverture du film More de Barbet Schroeder – ou Albert Cossery, le grand écrivain franco-égyptien qui y a habité de 1945… à sa mort en 2008. Ce qui en fait une sorte d’équivalent parisien du célèbre Chelsea Hotel new-yorkais, comme le souligne Charlotte : « C’est Patti Smith, le lien essentiel entre les deux… Elle est venue ici, elle en parle dans des livres. »
Alors, bien évidemment, ce roman à clés ne s’intitule pas pour rien Le Refuge des étoiles, il joue avec la célébrité de ses visiteurs : « Ici, on est obligé. Il y a tellement de grands noms qui sont passés. L’occulter serait de la fausse authenticité. Je préfère assumer le snobisme. Mais ça n’est pas à gros traits, je ne parle que de dix pour cent des gens qui sont venus ici… Et il y a un dissimulé, un chassé-croisé, un jeu d’ombres. »
AMÉLIE
Charlotte Saliou vient de La Réole, en Gironde, d’un milieu qu’elle décrit comme « bourgeois et bohème. Mais je retiens plus la bohème que la bourgeoisie » Après des études de Lettres modernes à Bordeaux, elle monte à Paris : « J’avais envie d’écrire mais j’ai fait un mauvais choix, je voulais être journaliste et j’ai choisi la communication… Je travaillais à Saint-Ouen, je m’ennuyais, donc entre midi et deux, j’écrivais des petites fictions, des histoires… Tous les jours. Des nouvelles. »
Parmi les auteurs et les textes qui lui ont donné envie d’écrire, elle cite Le Théâtre et son double d’Antonin Artaud, ou Pierre Michon pour Les deux Beune, qui vient d’être réédité, et Rimbaud le fils. Mais aussi André Gide, L’Immoraliste, pour ce qu’elle appelle « les récits à la marge ». Et surtout les Lettres à un jeune poète de Rilke : « Je pense que c’est ce qui m’a le plus marquée, dans l’écriture. D’autant plus que c’est une écrivaine qui me l’a conseillé… Amélie Nothomb. Quand j’avais quinze ans, j’ai lu Stupeur et tremblements et, comme tout le monde, je lui ai écrit une lettre pour lui dire que ça m’avait plu ! Elle m’a conseillé de lire Les Jeunes Filles de Montherlant et Lettres à un jeune poète… »
114


FRÉDÉRIC
Elle commence donc par écrire des histoires courtes se déroulant à l’hôtel, ce qu’elle appelle des microfictions, dont une première, évoquant Rimbaud et Verlaine, est publiée dans un numéro de la revue Littérature-Action consacré à La Louisiane. Mais très vite, elle comprend qu’il faut qu’elle les lie entre elles pour en faire un roman : « C’est Frédéric Beigbeder qui me l’a conseillé. Au tout début, je lui avais fait lire une douzaine de microfictions… Il m’avait dit “pour moi, ce sont des portraits de voyageurs fictifs”. Mais il avait trouvé que la plume était sympa, il m’en avait dit du bien…
Et aussi, “par contre si tu veux être publiée, il faut que tu en fasses un roman”. Alors j’étais partie sur l’histoire d’un étudiant qui faisait une enquête à l’hôtel… Fred m’en a dissuadé en me disant “parle de toi, c’est plus intéressant de partir de soi”. Il est comme ça. C’est toujours du jeu. Et il a raison. » L’ombre de Beigbeder, lui-même un vieil habitué de La Louisiane, plane sur ce premier roman, puisqu’en plus d’en avoir été l’initiateur, il en a signé la préface : « C’est une bonne relation, un copain, j’aime bien discuter avec lui. Il m’a écrit un petit SMS super pour me dire qu’il avait aimé le livre, et puis il a dit “OK, je fais la préface !” »
ALI
Quand je demande à Charlotte la rencontre faite à l’hôtel qui l’a le plus marquée, elle répond immédiatement, sans hésiter : « Ali MacGraw. Je l’ai adorée. Elle m’a énormément marquée. L’élégance et la gentillesse incarnées. Je l’avais vraiment aimée dans Love Story. Je le raconte dans le livre, c’est vrai, quand elle est arrivée, je ne l’ai pas reconnue ! Mais quand on m’a dit que c’était Ali MacGraw, j’ai entendu la musique du film dans ma tête… Elle n’arrêtait pas de discuter avec moi, c’était hyper bizarre, elle venait tout le temps me voir, pour parler de moi : “Alors vous, votre histoire ?” C’était incroyable, je n’en revenais pas. Elle s’intéresse énormément aux autres, elle est souriante, simple… Et très belle. Je voulais faire une photo avec elle, elle a réfléchi, elle m’a dit peut-être… mais finalement, elle a décliné. Par coquetterie. Pourtant, elle est toujours tellement belle, à 80 ans… Grande, longue, avec ses beaux cheveux blancs. On voit que ça a été une très belle femme. Comme je le raconte, elle a laissé un petit mot pour nous tous, où elle dit “peace and love”. J’ai trouvé ça super mignon. Une hippie des années 1970, coiffée comme une Indienne, avec sa longue queue de cheval basse, très élégante. Tu sens une femme qui a les pieds sur terre, indépendante. J’aimerais vieillir comme ça. »
— LE REFUGE DES ÉTOILES, Charlotte
Saliou, Blacklephant Éditions
116

LE PALÉOPHONE DU COLONEL
Par Bruno Lagabbe ~ Photo : Ferembach
LA BOITE À PUNAISES

Prud’homme, Aimable, Privat Verchuren, Attard, Noguez Duleu, Horner, Boisserie Bazin, Baselli, Lorenzoni…
Vous allez me dire : Que viennent faire ces petits rigolos à côté de géants de la musique ?
Eh bien, ce sont aussi des musiciens !
Des virtuoses ou des tâcherons, autodidactes ou sortis du conservatoire ; ils ont tous un point commun : aller à la riflette sans peur du rififi. Ils jouent « musette » chez le populo, les airs qui font tourner les couples et valser les chaussons, ça sent la socquette humide et le tabac de contrebande. On guinche jusqu’au petit matin à condition de « passer la monnaie ». C’est les années 1940 du temps du Balajo et des mauvais garçons. Gus Viseur a déjà fait swinguer les dancings et jazzer la java de la Belgique au Hot Club de France ; Jo Privat improvise sur Caravan avec les manouches de Paris, le boogie, le mambo et le rock’n’roll viendront côtoyer valse, tango et paso doble…
En France, les accordéonistes ne chantent pas, ils se contentent de sourire pour tenter de rivaliser avec l’éclat des boutons de nacre de leur instrument. Emile Prud’homme, présente, plaisante et chante un bout de refrain à l’occasion ; c’est tout. Linette Dalmasso issue du même milieu prendra la parole dans les années 1970 pour chanter l’écologie, c’est une exception. Yvette Horner qui a promené son sourire de ville en ville perchée sur le toit d’une voiture publicitaire de la caravane du Tour de France avait, dit-elle, des moucherons plein les dents à la fin de la journée.
Là, c’est la faute au twist si ce disque existe, nous sommes en 1961 et le label Festival surfe sur le succès des Chaussettes noires (« Daniela ») et d’Adriano Celentano pour continuer à exploiter le filon. Complété de deux standards rayés et étoilés, Marcel Azzola signe ce super 45 tours ou les reprises sont traitées à l’instrumental : l’accordéon remplace la voix et exécute la mélodie de la chanson originale. Ce système de « cover » des succès du jour nourrira tous ces accordéonistes pendant des décennies pour prendre fin faute de combattants au début des années 1980 avec l’accordéon-disco. Le soufflet est retombé !
Pour moi, l’accordéon c’est le piano à bretelles. Le piano du pauvre, disait Ferré, et même si vous ne lui accordez que peu de crédit, « accordez donc l’aumône à l’accordéon », comme disait Gainsbourg. Ce qui nous amène à ma conclusion : de Marcel à Zola, il n’y a qu’un pas !
Voilà, je terminerai tout à fait cette fois avec une citation d’avant-guerre de Fréhel rapportée par un accordéoniste dont j’ai oublié le nom : « Joue plus fort, petit, il faut que je pisse ! »
— MARCEL AZZOLA : NEW ACCORDION ROCK’ – SUPER 45 TOURS FESTIVAL – 1961, lepaleophone.blogspot.com
Le Colonel et ses amis réalisent « Opération Kangourou » : émission radiophonique de microsillons hors d’âge sur p-node.org ’ (DAB + Paris/Mulhouse) le samedi à 15 h
118


MAUVAIS ESPRIT
Par Claude De Barros ~ Photo : Pascal Bastien
HIER CE SERA BIEN
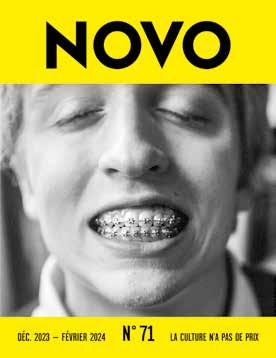
Il m’arrive souvent d’espérer que mon ordinaire sera modifié par un petit rien, une pierre mal tombée qui bloque la branche mal placée qui crée le mauvais tourbillon du maigre ruisseau. Et ma petite embarcation qui devançait toutes les coques de noix de mes concurrents, projetée contre la rive, reste bloquée. Définitivement. Sur le moment, c’est embêtant. La victoire s’envole, mais finalement, c’est le début des regrets, d’une histoire et de multiples explications. C’est même plus enviable qu’une victoire nette et sans accrocs. Un perdant magnifié, à défaut d’être magnifique, donne le droit de changer l’histoire. Pas le gagnant. Le gagnant profite au présent et se souvient au futur. Le perdant, lui, aurait pu gagner si. Ce « si » est le début de mes histoires.
La fatalité latine me promet plus que le diagnostic, lucide et expert, britannique ou saxon. Sauf si un single malt comble les silences entendus. Je sais que je partage cette envie d’histoires avec mes compatriotes. Des preuves ? Poulidor-Anquetil. Séville 1982. J’accorde à mes détracteurs Twickenham 1999. Mais c’est un exploit et les exploits sont, avant toute chose, de grandes histoires. Un exploit, c’est le gagnant qu’on n’attend pas (ou qu’on n’attendait plus) ; c’est le grain de sable ; c’est ce qui empêche de savourer son single malt dans son fauteuil club et qui multiplie les verres de rouge sur la nappe cirée. L’exploit, c’est le gagnant inattendu : ça ne se résume pas à une somme de victoires ou à un empilement de médailles, de performances et de gains. L’exploit, c’est un dérapage, c’est un accident.
Novo, c’est mon accident domestique sans gravité. Le mauvais ingrédient ou la mauvaise proportion qui justifie l’appellation « fait moi-même » et les multiples regrets. Le rhumatisme du matin ou la douleur lombaire qui vous rappellent que vous n’êtes plus celui d’avant, que vous ne penserez plus à demain sans vous souvenir de ce que vous avez fait hier. Novo, c’est souvent le temps raté et, certainement, la multiplication des « si ». Longtemps posé à une portée du regard plutôt qu’à portée de main, je finis par y lire ce que j’aurais pu voir, je découvre ce que j’aurais dû savoir. Les deux trajectoires de nos histoires ne se sont pas croisées à temps. Mais elles finiront par se trouver. Un jour ; ailleurs ; à un autre moment. Et je fermerai les yeux comme Martin (c’est l’OURS qui m’a soufflé son nom), les dents légèrement serrées en pensant que j’ai manqué une exposition, un concert, un livre ou un spectacle et un plaisir à ma portée. J’imaginerai alors la satisfaction probable d’hier et maudirai ma paresse chronique. Et dans ma petite cervelle, je sèmerai un champ de possibles – des « si » à perte de vue – en espérant l’accident. L’exploit de lire ou relire un article ou un texte qui annonce une joie passée. L’exploit de trouver dans le passé, un moment qui se situe dans le futur. Archives et nostalgie à venir : hier ce sera mieux. J’espère de Novo (soixante et onzième du nom) un ordinaire modifié par un petit rien : la découverte photographique de Pascal Bastien, les mots de Blutch et le dessein de Nicolas Comment. Et les voix de tous ceux que je ne connais pas encore.
Post-scriptum. Lundi 8 janvier, 14 h 58. Je feuillette Novo en écoutant FIP, le morceau qui passe ressemble à du Steely Dan – à vrai dire, sur le moment je le pense, mais je réécoute le morceau en terminant cette chronique et ça ne ressemble pas du tout à Steely Dan. Je cherche le nom du groupe. C’est Mac DeMarco, un artiste que ma fille écoute depuis plusieurs années et m’a fait découvrir récemment avec « Chamber of Reflection ». C’est nouveau et pourtant j’ai cru que c’était une composition des années 70. L’aujourd’hui d’hier, c’est bien aussi.
120

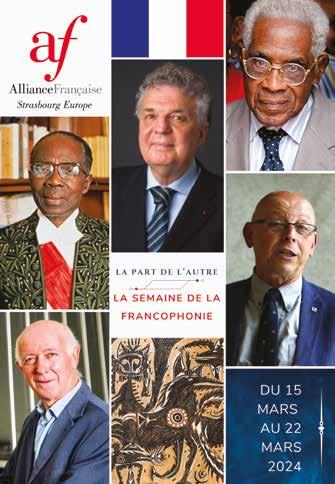
 Par Christophe Fourvel
Par Christophe Fourvel
OLGA TOKARCZUK
Olga Tokarczuk écrit sur Dieu, le temps, les hommes et les anges. Ce titre français 1 d’un des romans de l’autrice polonaise est probablement le meilleur résumé de son œuvre. Il est vrai que l’autrice, prix Nobel de littérature 2021, aime à se pencher sur des berceaux ordinaires, des contrées perdues et des années de plomb, là où souvent, Dieu, le temps, les hommes et les anges ont besoin d’un éclair de littérature pour illuminer le ciel.
On mesure alors à quel point son écriture est capable d’enchanter le monde des petites gens, des villages figés dans l’hiver polonais, des nondits et des non advenus qui érigent des barrières gelées entre les maisons et les générations. Des livres comme celui auquel je viens de faire deux fois référence, ou encore Maison de jour, maison de nuit, Les Pérégrins2 et le vrai-faux roman policier Sur les ossements des morts3 sont des récits choraux, des précipités à la réalité fragmentée, transcendés par une vision parfois magique, obstinément empathique et singulière de la réalité des vies. Les êtres y accomplissent leur modeste chemin pentu entre la naissance et la mort en succédant à d’autres et en précédant ceux qu’ils ont pris le temps et l’amour (ou pas) d’enfanter. Mais il arrive aussi que la tragi-comédie humaine suffise à emballer le récit.
C’est le cas du roman historique, Les Livres de Jakób4. Dans cet ouvrage de 1 000 pages consacré au messie autoproclamé Jakób Franck (tous le sont, assurément !), les hommes, Dieu et les anges ont assez de ressources pour assurer le spectacle, et l’autrice se plie à la discipline de l’historienne avec pas mal de simplicité, tirant les fils narratifs dans le sens chronologique, et avec un mouvement de bras presque régulier. Notons toutefois, dans les plis de ce récit au cordeau, la présence de la vieille Ienta, une âme récalcitrante échouée dans les limbes, le regard persistant dans les circonvolutions d’un temps bien plus long qu’une vie humaine. Mais le livre dit consciencieusement les soubresauts d’une histoire religieuse, l’incroyable mouvance et la perméabilité des vieilles frontières ; montre les ressorts d’un antisémitisme et d’un chaos éternel et exhibe à merveille les mouvements de panique de l’homo sapiens
1 – Éditions Robert Laffont
2 – Tous deux parus aux Éditions Noir sur Blanc
3 – Éditions Flammarion, collection Libretto
4 – Éditions Noir sur Blanc
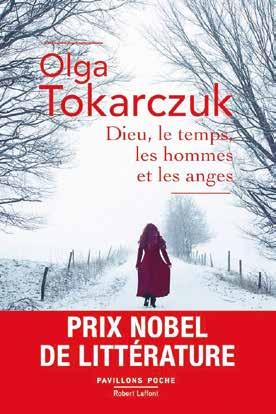
devant le mutisme de son créateur. Les Livres de Jakób confirme la beauté tour à tour tragique, pitoyable, dangereuse ou émouvante des foules d’hommes soumises aux élucubrations des plus illuminés et éloquents d’entre eux. Toutefois, Jakób Franck, s’il nous déroute ou nous révolte par ses caprices d’empereur, demeure dans ce roman un être parmi les autres, capable, certes, de dispenser sa propre lumière mais soumis lui-même au vaste tourbillon des forces historiques. C’est alors peutêtre cela qui place l’œuvre d’Olga Tokarczuk à une telle hauteur : cette ambition de nous rappeler ce tout auquel, quoi qu’on en dise, nous appartenons et qui nous anonymise autant qu’il nous consacre. Des chapitres courts comme des vies évoquent successivement des moments d’existences liés, que le temps a la fâcheuse manie d’enfouir et que la littérature, cette littérature majuscule qui ne renonce pas à dire Dieu, le temps, les hommes et les anges, s’obstine à exhumer.
N.B. : Vient de paraître Le Banquet des Empouses (roman d’épouvante naturopathique), aux Éditions Noir sur Blanc, 2024.
— DIEU, LE TEMPS, LES HOMMES ET LES ANGES, Olga Tokarczuk, Éditions Robert Laffont
NE
PAS OUBLIER DE LIRE…
122






LE TRILLE DU DIABLE
De Daniel Moyano — La dernière goutte
Né pour jouer du violon comme ses frères pour traire les vaches, Triclinio est contraint de quitter sa province pauvre, où nul n’a besoin de violoniste, pour Buenos Aires, où tout le monde semble l’être. La capitale argentine résonne alors de bruits de bottes, et le candide musicien, « la tête pleine de jolis sons qui le préservaient de la peur », se retrouve ballotté par les impulsions de l’histoire et de la vie. Il atterrit dans un bidonville peuplé de violonistes arthritiques qui le guideront à travers un monde violent et incompréhensible. Dans ce court roman plein de fantaisie et d’ironie, petite merveille de satire politique diablement entraînante, l’auteur, lui-même musicien et poussé à l’exil, révèle les forces insoupçonnées de la musique : elle n’apparaît plus seulement pour le personnage comme le moyen de fuir la réalité ou de retourner en enfance, mais comme celui d’accéder à une liberté nouvelle. (N.Q.)
SUZANNE
De Denis Belloc — Les éditions du Chemin de fer
La misère et la violence sont parmi les choses que la société s’efforce de ne pas voir, cela ne leur enlevant rien de leur existence et de leurs âpres réalités. C’est bien ce dont il est question dans ce roman initialement publié en 1988 et que Marguerite Duras qualifia de « grand et terrible roman politique ». Elle parlera aussi de « nuit sociale », celle de l’extrême pauvreté traversée par la mère de l’auteur, la Suz, qui reste debout face aux drames, à l’alcool, à la lâcheté, à la mort : « Les gens savaient mais ils ne disaient rien. » Dans une langue sèche et sans fioritures, une langue de pauvre, Denis Belloc pose une voix qu’il faut entendre pour la faire exister, une voix de cabossé, de minorité, d’invisible. (V.B.)


ROUSSE OU LES BEAUX HABITANTS DE L’UNIVERS
De Denis Infante — Tristram
Il y avait le goupil Renart, le rusé maître de la fable, l’ami bienveillant du Petit Prince, le Fantastique Maître Renard de Roald Dahl et, plus récemment, le courageux Pax de Sara Pennypacker ; il y aura désormais Rousse, « jeune renarde à robe flamboyante, […] libre et solitaire », la téméraire héroïne du roman de Denis Infante. Poussée à quitter sa forêt natale en proie à une terrible sécheresse, Rousse se lance dans une odyssée qui l’amènera à traverser des paysages fantastiques, à affronter toutes sortes de dangers, à se lier d’amitié avec d’autres animaux et, surtout, portée par une soif de découverte grandissante, à acquérir savoir et sagesse qu’elle pourra transmettre à son tour. Cette exploration d’un monde d’où les hommes ont disparu est rendue sublime par une langue qui s’attache à transcrire les sensations de l’animal que l’on suit et qui donne à ce conte environnemental un souffle intemporel. (N.Q.)
BORDER LA BÊTE
De Lune Vuillemin — La Contre Allée
Lune Vuillemin publie un deuxième roman poétique impressionnant qui nous plonge au cœur d’un territoire peuplé d’humains, d’animaux, mais aussi d’arbres, de plantes, de lichen, de rivières, de lacs… Sa narratrice, dont on ne sait pas grand-chose, va rencontrer Arden et Jeff qui s’occupent d’un refuge pour la faune sauvage, prendre la place d’une orignale qu’ils n’ont pas réussi à sauver et réussir peu à peu à apprivoiser ses agitations intérieures. En fusionnant véritablement avec la nature, en posant des mots magnifiques sur des sons auxquels nous ne prêtons pas attention, des silences qui nous échappent, des musiques… et en imaginant ce qui se passe quand les humains ne sont pas là, la jeune romancière réveille nos sens. On referme le livre avec l’envie de s’enfoncer dans la forêt la plus proche à la recherche de l’atmosphère envoûtante qui se dégage de chacune de ses phrases. (P.S.)
lectures
124

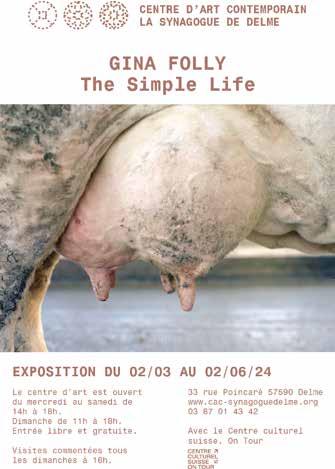






FUTURE ISLANDS
People Who Aren’t There Anymore / 4AD
Comme son titre l’indique, le nouvel album de Future Islands est placé sous le signe de la rupture, du manque et de l’absence, inéluctable. Bien loin de verser dans le mélodrame à outrance, le groupe de Baltimore nous sert ce qu’il sait faire de mieux : une synthpop solaire et des refrains surpuissants. L’attente de ce septième album, si elle a été très longue, en valait la peine à l’écoute de certains titres magistraux comme « The Tower » ou « Corner of My Eye ». Après 20 ans de loyaux services et des lives inoubliables, le niveau d’excellence de son chanteur Sam Herring n’est plus à prouver mais qu’on se le redise : Future Islands est un des groupes les plus solides et cohérents de notre époque. (C.J.)
GRAND MARCH
Back to the Wall / #14
Contrairement à ce que le titre de l’album pourrait suggérer, ces cinq-là sont loin d’être acculés ; les Strasbourgeois poussent toujours plus loin un indie blues électrique aux relents west coast pour aborder des thématiques d’aujourd’hui : le repli technologique, la guerre ou les migrants. Ils le font avec ce sens imparable de la mélodie et une maîtrise parfaite qui les hisse haut au niveau de certains de leurs modèles – PJ Harvey, parmi tant d’autres – avec un vrai sens du groove. La réalité incertaine des temps actuels doit-elle nous empêcher de sourire ou de danser ? Avec conviction, Grand March nous répond que non, et que nos murs sont tous faits pour être franchis. (E.A.)
MADI DIAZ
Weird Faith / ANTI-EPITATH
De prime abord, Madi Diaz ne paraît pas très accueillante. Visage fermé, mine renfrognée et regard accusateur, une attitude que l’on pourrait considérer comme une ultime carapace si on se laisse aller à de la psy de bas étage en écoutant sa musique. Car dans sa musique elle donne tout, dit tout de ses ressentis, même ceux qui dérangent, qu’on aimerait ignorer bien qu’on y soit tous passés. En 2021, elle signait History of a Feeling, un break-up album bouleversant qui lui ouvrait grande la porte de la scène indie folk. Elle revient deux ans après pour finir de régler ses comptes avec son ancien compagnon, mais aussi nous parler de ses nouvelles amours, histoire de rappeler que tout finit par passer. (C.J.)
AUBE
Révolution silencieuse / 3rdlab35
Rien ne semble arrêter Jeanne Barbieri. Alors qu’on ne s’était pas complètement remis de son opus enregistré avec Marie Schoenbock sous le nom de JeanneMarie, la chanteuse strasbourgeoise remet ça avec le producteur musicien Ena Eno, en duo. L’aventure de Aube n’est pas neuve cependant, elle résulte de rencontres sur divers projets autour de la poésie et du son, et un premier morceau qui a vu le jour dès 2020. On y retrouve tout ce qu’on aime chez Jeanne : cette danse des mots permanente, joliment soulignée ici par les environnements électro-acoustiques évocateurs d’Ena Eno. On se laisse bercer par une douce rêverie, sans pour autant occulter la gravité de l’instant. Unique. (E.A.)
sons
126




ÉPILOGUE
Par Philippe Schweyer

Pour finir en beauté, nous vous invitons à un petit retour en arrière. Il y a pile quinze ans, en mars 2009, paraissait le tout premier numéro de Novo. Quinze ans, le bel âge ? Un âge assurément inespéré pour un magazine gratuit qui n’a jamais touché un seul euro d’aide ou de subvention. Un âge étonnant alors que l’on ne cesse de nous prédire la fin de notre modèle, la fin du papier, la fin des haricots. Un âge déraisonnable, alors que nous nous entêtons contre toute logique économique à augmenter notre pagination (plus on nous conseille de faire court, plus on fait long). Un âge pas si vieux, mais déjà propice à une certaine mélancolie, quand on repense à ceux qui nous ont quittés ou se sont éloignés.
Pour ce numéro des quinze ans, nous aurions pu mettre en couverture quinze bougies plantées dans un gros gâteau plein de crème. Nous aurions aussi pu demander à quinze personnalités (des directeurs de théâtre, de festival ou de musée, des chanteurs, des écrivains, des batteurs, des artistes, des commissaires d’expo, des danseurs…) ce qu’ils
attendent du ministère de la Culture en 2024, ce qu’ils demandent comme soutien pour continuer à monter des spectacles, à écrire, à chanter, à faire des films… On aurait enfin pu demander à quinze lecteurs ce qu’ils ressentent en ouvrant Novo. Parce que le climat n’est pas vraiment à la fête sur notre petite planète, parce qu’après quinze ans l’avenir est plus que jamais incertain, nous avons choisi de faire… comme d’habitude. C’est-à-dire de faire de notre mieux pour vous surprendre, d’ouvrir grand nos yeux et de partager nos découvertes, de parier sur votre intelligence, votre curiosité, votre ouverture d’esprit. Merci à nos fidèles annonceurs, à nos abonnés de plus en plus nombreux, à notre imprimeur, notre directrice artistique, notre secrétaire de rédaction, notre relectrice, à tous les rédacteurs, photographes et illustrateurs et bienvenue aux jeunes qui nous rejoignent. C’est grâce à leur talent que Novo fête ses quinze ans sans les fêter, que ce tout petit miracle est possible. Quant à l’avenir ? Restons punks jusqu’au bout : No Future!
128
Nicolas, fidèle lecteur de Novo









www.novomag.fr 26/02/2024 19:20 NOVO 69 COUVERTURE Dos mm.indd 1 26/02/2024 19:23 NOVO 67 COUVERTURE Dos 8 mm.indd 26/02/2024 19:22








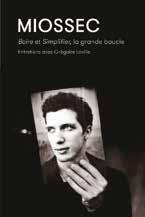








www.mediapop-editions.fr www.mediapop-records.fr
CLUB MÉDIAPOP / ADHÉSION 2024 1 ABONNEMENT À NOVO + 4 DISQUES MÉDIAPOP RECORDS * OU 4 LIVRES MÉDIAPOP ÉDITIONS * OU 2 DISQUES + 2 LIVRES * = 100 € BIENVENUE AU CLUB ! Rendez-vous sur club.mediapop.fr pour adhérer au Club Médiapop. Vous pouvez également adhérer au Club Médiapop en envoyant un chèque à Médiapop, 12 quai d’Isly, 68100 Mulhouse Novo est diffusé gratuitement dans les musées, centres d’art, galeries, théâtres, salles de spectacles, salles de concerts, cinémas d’art et essai et librairies des principales villes du Grand Est. Cadeau Bonus : Médiapop vous offre un livre ou un disque au choix si vous parrainez un ami ! * Dans la limite des stocks disponibles et pour une valeur de 100 € maximum.
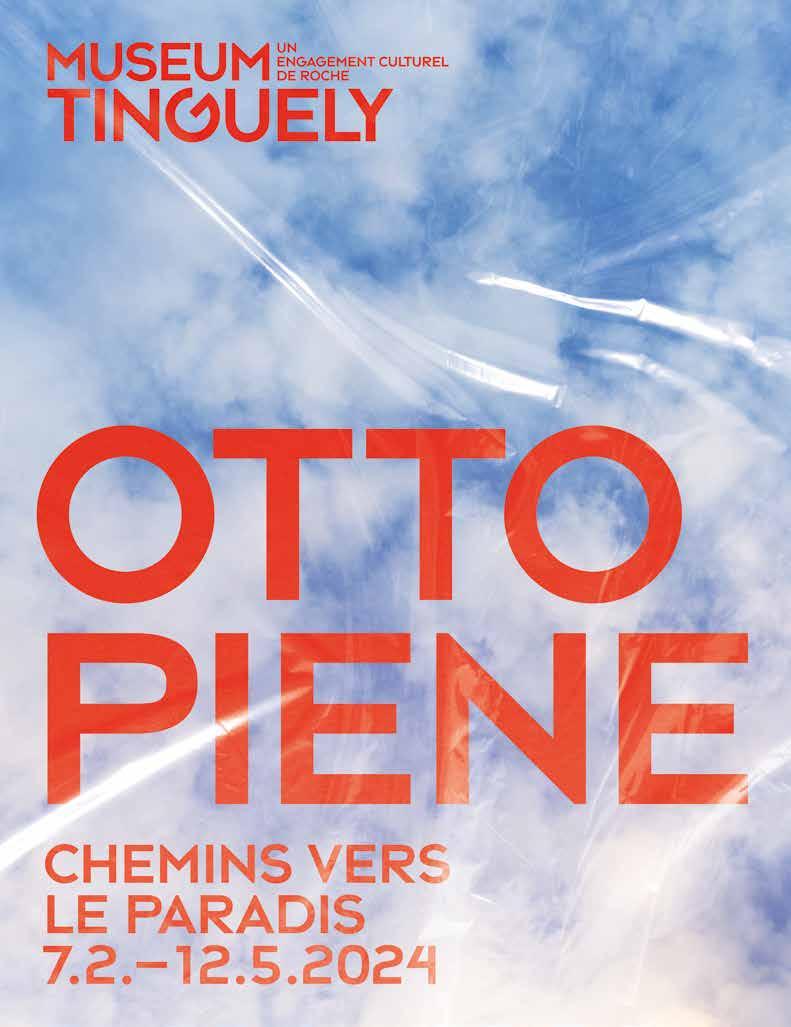



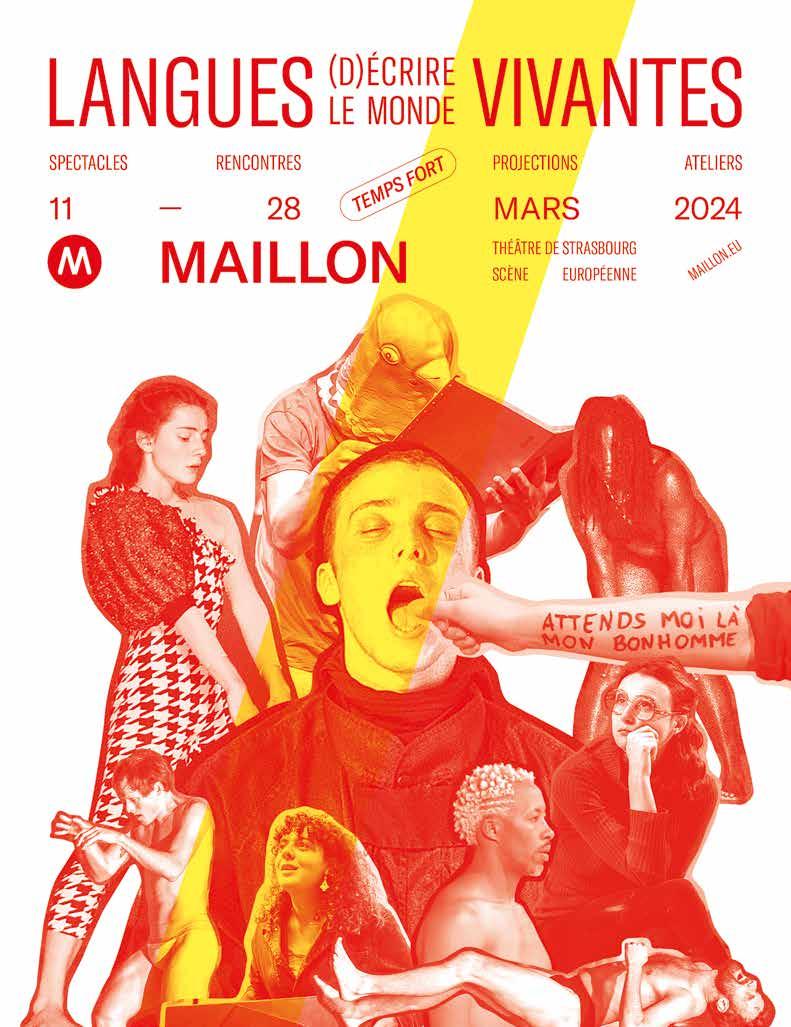



















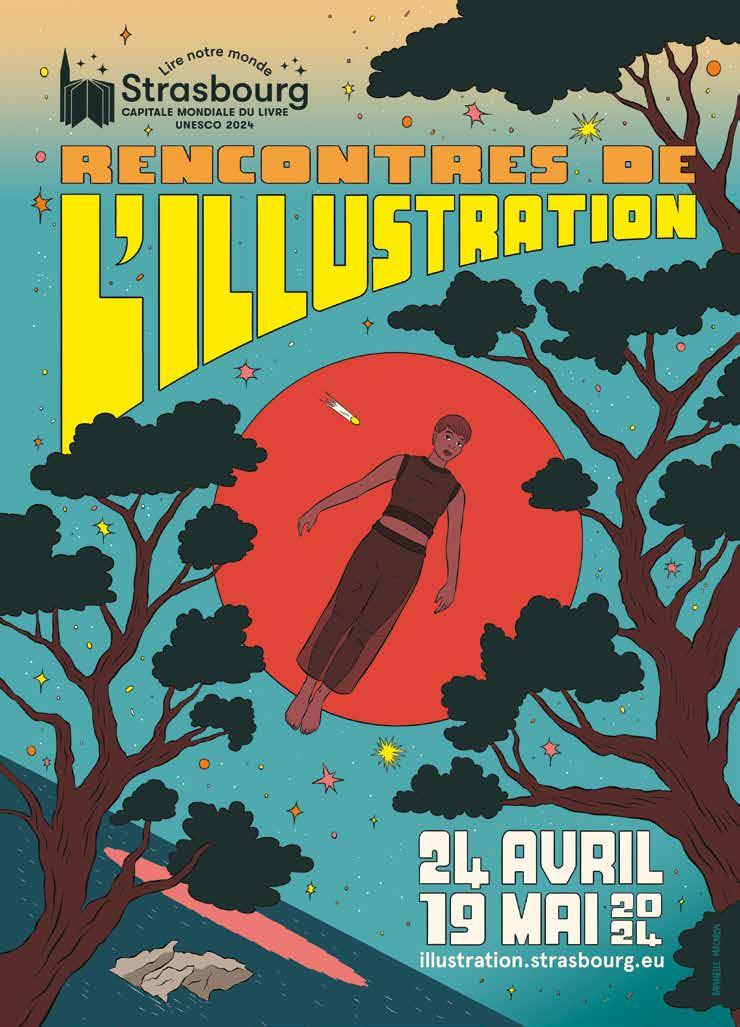























































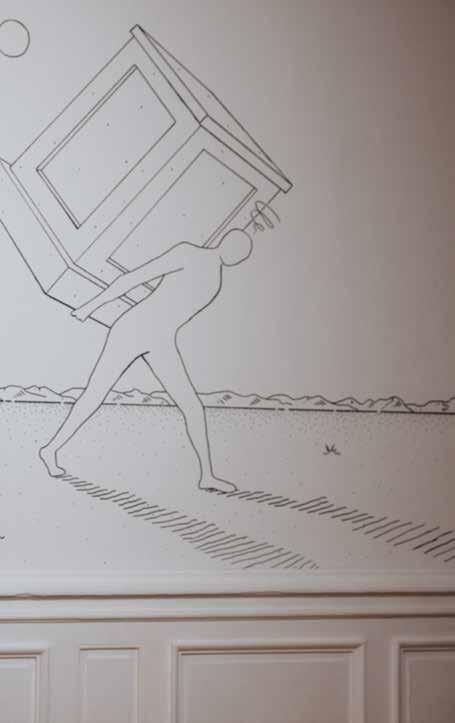






















 Marc Camille Chaimowicz, Festivity, 1987. Collection Consortium Museum, Dijon. Vues des œuvres de la collection du Consortium Museum dans les salles du musée des Beaux-Arts de Dijon. Photo : Musées de Dijon.
Marc Camille Chaimowicz, Festivity, 1987. Collection Consortium Museum, Dijon. Vues des œuvres de la collection du Consortium Museum dans les salles du musée des Beaux-Arts de Dijon. Photo : Musées de Dijon.







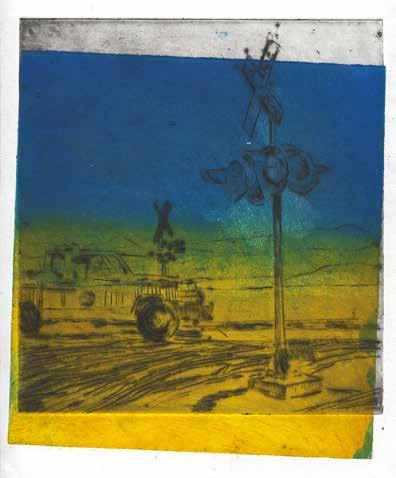







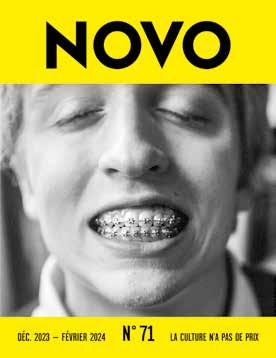

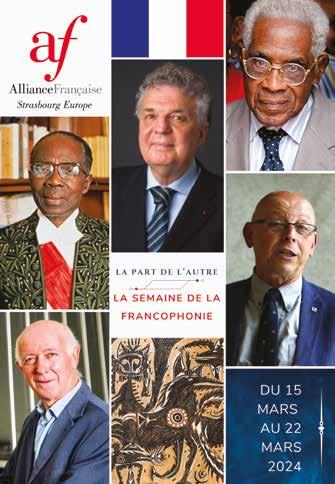
 Par Christophe Fourvel
Par Christophe Fourvel