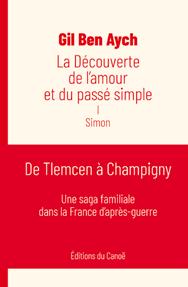Virgil Gheorghiu

Genre : roman
Format : 13 x 21 cm
Pages : 336
Préface de Thierry Gillyboeuf
Prix : 23 €
ISBN : 978-2-490251-73-5


Un seul livre, La 25e heure, paru en 1948, aura suffi à faire la célébrité de Virgil Gheorghiu. Né le 9 septembre 1916 à Războieni, dans le judeţ de Neamţ, Virgil Gheorghiu est l’aîné de six enfants d’un pope. À douze ans, ne pouvant aller au séminaire faute d’argent, il entre au lycée militaire de Chişinău, où il fait ses premières armes de poète, puis à la Faculté de Lettres et de Philosophie de Bucarest. Il publie plusieurs recueils de poésie, avant de devenir reporter de guerre à partir de 1941. Après l’invasion de la Roumanie par les troupes soviétiques, il choisit l’exil avec sa femme. Arrêté « automatiquement » par les autorités américaines, le couple est balloté de camp en camp pendant près de deux ans. Libérés « automatiquement », ils entrent clandestinement en France, avec le manuscrit de La 25e heure. Dès sa sortie, le livre rencontre un immense succès public et critique qui propulse Gheorghiu au premier rang des écrivains de l’immédiat après-guerre. Mais en 1952, une violente campagne est lancée contre lui par les Lettres françaises qui entachera durablement sa réputation, et nuira à la suite de sa carrière littéraire. Auteur d’une quarantaine d’ouvrages, dont une grande partie de romans, ainsi que quelques essais spirituels, Virgil Gheorghiu est ordonné prêtre de l’église orthodoxe roumaine à Paris, en 1963. En 1986, il entreprend la publication de ses Mémoires, qui devaient compter sept volumes. Après la chute du Mur de Berlin, il s’engage activement dans le combat qui mènera à la chute des Ceauşescu. Il meurt à Paris le 22 juin 1992.
Écrit en 1982, Dracula dans les Carpates est le dernier roman de Virgil Gheorghiu. Inédit en français, le manuscrit en a été retrouvé quinze ans après sa mort. Renouant avec la veine de ses grandes œuvres (La 25e heure, La Seconde Chance, Les Sacrifiés du Danube, La Cravache, etc.), Gheorghiu confronte une fois de plus la Roumanie de son enfance, une Roumanie à la fois traditionnelle et éternelle de petites gens, paysans pour la plupart, avec la violence de l’Histoire incarnée par le dernier envahisseur, l’empire soviétique. Avec un sens aigu de l’absurde kafkaïen de ce nouveau maître, Gheorghiu revient sur cette date fatidique de l’invasion russe qui fait suite à tant d’autres invasions depuis 2000 ans. Sans pour autant donner quitus aux empires concurrents, le Britannique notamment, incarné par cet Irlandais, Baldin Brendan, diplômé en vampirologie, venu dans les Carpates rechercher les traces de Dracula, Gheorghiu démonte, dans ce roman haletant et grinçant, la mécanique du totalitarisme avec sa bêtise mauvaise qu’appliquent subalternes et exécutants zélés, face aux valeurs ancestrales d’un peuple tétanisé, attaché à ses traditions, et face aux brigands, aux hors-la-loi, les haïdouks gardiens du sens, qui résistent ouvertement depuis leurs refuges montagnards. L’arbitraire règne, la rationalité n’a plus cours, la guerre des logiques contradictoires fait rage dans un climat de cocasserie et d’effroi. Avec ce roman d’une grande virtuosité, construit comme une tragédie grecque, Gheorghiu semble avoir plongé les haïdouks de son compatriote Panaït Istrati dans l’univers grotesque et inquiétant des grands romans d’Ismaïl Kadaré.

7 avril
Copyright : tous droits réservés.
Contact et libraires : colette.lambrichs@gmail.com Téléphone : 06 60 40 19 16 Diffusion et distribution : Paon diffusion.Serendip Éditions du Canoë 2023
LE MUSÉE DU CRIME
« Regardez bien l’horloge de la tour, dit Ionel Nimic. Il est huit heures moins dix minutes. Quand l’horloge sonnera les huit coups, l’action sera déclenchée. Deux minutes après, vous serez libre. Vous pourrez utiliser à fond votre liberté et chercher Dracula et les vampires des Carpates. »
L’Irlandais Baldwin Brendan se trouve dans le palais Caroubia. Près du lit du roi de Roumanie, le lit à baldaquin avec des draps de soie dans lequel il a passé la nuit. À présent, il est à la fenêtre. À côté de lui se trouve Ionel Nimic, le brigand qui lui tient compagnie depuis trois heures. Les grandes fenêtres de la chambre du roi sont ouvertes vers l’intérieur, les volets en bois sont fermés. Par les fentes des volets pénètre la lumière qui dessine des raies comme celles des zèbres sur le tapis blanc. Ionel Nimic a passé le canon de son fusil à travers une fente des volets. Le canon de son fusil est pointé sur le sous-officier Taky Robur qui continue à vociférer sur l’estrade, au milieu de la place à côté du pieu au bout duquel se trouve la tête du supplicié.
3 – 8 –
« Vous allez commettre un grand massacre ? » demande l’Irlandais. Il est effrayé. Ionel Nimic et les autres brigands qui l’ont enlevé hier au début de l’aprèsmidi à Bogaz, l’ont promené plusieurs heures, sous leur escorte, dans la ville, et qui l’ont amené dans ce palais, ne lui ont jamais rien dit de précis. L’Irlandais a passé la nuit dans le noir. On lui a apporté à manger et à boire. Mais les brigands n’ont jamais allumé ne serait-ce qu’une bougie. C’est le matin, quand la lumière a pénétré à travers les volets que l’Irlandais a réalisé qu’il a bel et bien dormi dans le lit du roi. Qu’il se trouvait dans un palais. On lui a dit que le matin, les brigands allaient récupérer la tête de leur camarade supplicié, tête qui sera exposée sur la place. À présent, l’Irlandais voit la tête du supplicié au bout du pieu. Il a vu des images pareilles à celle-ci dans le livre racontant l’histoire de Vlad l’empaleur1. Quand les ambassadeurs de la Sublime Porte ottomane vinrent au palais de Vlad réclamer le tribut pour le sultan, Vlad leur trancha la tête et les exposa au bout des lances et des pieux sur la place. C’est le même spectacle que l’Irlandais a devant ses yeux.
« À huit heures précises, après le dernier coup de l’horloge de la tour, nous ouvrirons le feu. Je tirerai d’ici. Je viderai mon chargeur. Une vingtaine de mes camarades embusqués sur les toits de la préfecture, de l’hôtel de ville, du palais Caroubia, du palais de justice
1 Vlad III Basarab (1431/1436-1476) dit l’Empaleur (Tepeş en roumain), prince de Valachie, réputé pour sa cruauté. Surnommé Drăculea, fils du dragon en roumain, il inspira à Bram Stoker le nom de son personnage.
et de tous les immeubles qui entourent la place feront feu en même temps que moi. Je vous dis cela afin que vous sachiez à quoi vous en tenir. Afin que vous ne perdiez pas une miette du spectacle. Je procède comme le présentateur d’un film à suspens au cinéma. Ils disent : “Faites attention à la scène qui va se dérouler. Elle ne durera que quelques secondes, pas plus.” Je vous préviens de la même façon, car la scène sera très brève. Au huitième gong de l’horloge, les rafales croisées seront tirées de partout. Taky Robur, la hyène aux dents d’or, sautera de l’estrade et tombera le nez dans la poussière, couché par terre, de peur de perdre sa sinistre vie. Tous les gendarmes se jetteront à terre. Ils seront paralysés par la frayeur. Novalis, notre capitaine qui se trouve près de l’estrade en ce moment même, quoique vous ne puissiez pas le voir, car il est caché, au moment de la fusillade sautera sur l’échafaud, attrapera la tête de Fraga, comme on attrape une balle au vol sur le terrain de rugby, la cachera sous son suman et disparaîtra. La tête de notre camarade Fraga sera récupérée. Quand Robur et la dizaine de gendarmes qui se trouvent sur la place lèveront la tête et tâcheront de riposter, ils en seront empêchés par nos permanents. Nous avons plus de deux cents supplétifs, de paisibles jeunes paysans qui nous prêteront main forte. Ils sont sur la place autour de l’estrade. Quand les gendarmes essayeront de riposter, ils seront entourés, bousculés et plaqués au sol. Comme dans une mêlée de rugby. Dès que l’un d’eux se relèvera, on lui fera un croc-en-jambe, on le bousculera
4 5
violemment de tous côtés et il se retrouvera de nouveau à terre. C’est un spectacle à ne pas manquer. Il durera quelques minutes. Entre-temps, nos camarades embusqués sur les toits, aux fenêtres et ceux qui se trouvent mêlés aux gens paisibles sur la place disparaîtront. Nous nous retrouverons plus tard, autour de la tête sauvée de notre camarade. Et ce soir, nous irons l’enterrer dans le cimetière des haïdouks. Vous, de votre côté, vous n’avez qu’à descendre dans la rue et demander au premier agent où vous pouvez rencontrer Dracula. Car c’est pour trouver Dracula que vous êtes venu de si loin, n’est-ce pas ?
Ce n’est pas le moment de vous moquer de moi, dit l’Irlandais. Il ajoute : Il n’y aura pas de morts ?
La voix de Taky Robur résonne, grinçante et menaçante au-dessus de la place.
« Venez voir la tête du célèbre assassin Lucian Fraga, tête que j’ai moi-même tranchée, exploit pour lequel Sa Majesté m’a donné en prime vingt pièces d’or. Venez écouter comment j’ai capturé et abattu le brigand. »
C’est la dixième fois que le sous-officier hurle ce slogan.
« Voilà Novalis, dit Ionel Nimic. Regardez-le. Il est derrière Robur. Par la fente du volet de la chambre du roi, du palais Caroubia, Ionel Nimic identifie ses camarades Titus Opinca, Frounza et Nica qui se tiennent prêts à récupérer la tête du supplicié.
—
J’espère que non. Nous ne tuons jamais. Ou presque. Si nous faisons bon marché de notre vie sur terre, nous tenons à ne pas perdre notre vie éternelle. Cela ne veut pas dire que, dans quelques minutes, il n’y aura pas de sang versé et de morts devant sur la place. Théoriquement, tout est réglé. Théoriquement. En pratique, cela peut se passer autrement. On joue la vie sur le cadran de l’horloge, comme on joue des fortunes sur le tapis vert des casinos. Toute action est un ludere alea, un jeu de hasard. Le premier qui joue sa vie, c’est notre capitaine Novalis. C’est lui qui récupère la tête. Si quelqu’un est tué dans les minutes qui viennent, c’est Novalis. Les actions les plus dangereuses, c’est lui seul qui les accomplit. Sa devise est : “On n’a le droit d’être cruel
Encore quatre minutes et le gong de l’horloge donnera le signal. Quatre minutes.
Tout le monde connaît le visage de Novalis et des autres haïdouks, dit l’Irlandais. Pourquoi sortir à découvert ? Ils pouvaient au moins s’habiller autrement. Ils vont se faire repérer et tuer.
Les soldats sont habillés avec l’uniforme du roi. Nous sommes habillés avec l’uniforme du peuple. Comme le peuple. À chacun son uniforme.
En procédant ainsi, vous vous faites tuer bêtement.
Ça ne fait rien de se faire tuer. Chaque fois que l’un de nous meurt, une dizaine de braves nous remplacent. C’est ainsi dans la montagne. Nous sommes comme le blé. On met un grain dans la terre, il en ressort un épi, avec une poignée de grains. Ils se multiplient.
6 7
».
qu’envers soi-même”
Notre mort est une manière de recruter, une augmentation des effectifs. Encore quatre minutes et c’est le signal.
Qu’est-ce que c’est ? demande l’Irlandais. Regardez. »
Une femme avec un fichu noir, sur la tête, une couronne de pain dans laquelle est enfoncé un cierge allumé avance au milieu de la place, vers la catasta, vers l’estrade où se trouve la tête du supplicié et le brigadier. Les gens s’écartent et font place à la femme. Elle porte un gilet de bure noire, une catrinţă, une jupe portefeuille, des bottes noires. Elle est droite. Elle avance d’un pas mesuré. Ferme. Elle ne regarde ni à gauche ni à droite. Uniquement devant elle. Elle ne regarde même pas l’estrade, ni la tête du supplicié, ni les gendarmes, ni les centaines de gens amassés sur la place. Elle avance avec son pain porté à la hauteur de la poitrine et avec le cierge allumé. Elle est comme une vestale qui porte une offrande. La statue vivante d’une vestale antique. Elle a la dignité des bourgeois de Calais qui avancent vers l’ennemi, vers les Anglais, avec la corde au cou, sans regarder autour d’eux. Ils regardaient au loin, dans le royaume de la mort et de l’éternité vers lequel ils se dirigeaient. C’est une démarche qui s’effectue sur terre, mais qui finit dans l’éternité, car elle ne va pas vers un but terrestre, vers un objet ou un être, mais vers une chose qui se situe au-delà. La femme ne voit même pas la tête du supplicié, mais la personne réelle du supplicié, celle qui a quitté la terre et qui se trouve maintenant dans le chœur des créatures angéliques, dans la
neuvième hiérarchie céleste. Là où les suppliciés voient Dieu face à face. Ici bas, on ne voit pas Dieu face à face. Seuls les morts ont ce privilège. Et c’est ce mort que la femme va honorer.
Ionel Nimic est pétrifié. Il jette un coup d’œil, sans bouger, vers Novalis qui se trouve près de l’estrade. Le capitaine est figé. Il regarde sans voir. Il ne sait plus quoi faire.
« Cette femme gâche tout, dit Ionel Nimic. Il ajoute : Cette femme va se faire tuer. Dans un instant les gendarmes la cribleront de balles. Ils piétineront son corps avec leurs bottes. Ils se jetteront sur elle comme sur une bête de proie. Elle sera écrasée, déchirée en morceaux. Qui est cette femme ?
C’est la mère du supplicié, dit Baldwin. Seule une mère peut braver les fusils. Prendre de tels risques. C’est sûrement la mère du supplicié.
Lucian Fraga n’a pas de mère, dit Ionel Nimic. C’est un orphelin.
C’est sa femme ou sa fiancée, dit l’Irlandais. Il n’était pas marié. Je le connais Il n’avait pas de fiancée non plus.
Qui est cette femme alors ?
Une étrangère. »
La porteuse d’offrandes pour le supplicié est proche de l’estrade. Elle fait le signe de croix. Elle dépose la couronne de pain et le cierge dans la poussière au pied de la plateforme. Elle se redresse et elle fait à nouveau le signe de croix. Prête à partir. Sa mission est accomplie.
8 9
Le sous-officier Taky Robur s’arrête brusquement. Il a vu la femme. Il est surpris. Il la regarde. Il pense d’abord qu’elle est venue lui rendre hommage. À lui, le maître tout-puissant qui se trouve sur l’estrade et qui fait trembler toute la foule. Lui qui peut tuer qui il veut, quand il veut et où il veut. C’est sa première pensée : la femme lui rend hommage. À lui, le séducteur, le maître qui dispose de la vie de ses semblables, à qui Sa Majesté a accordé le droit de supprimer la vie. Il est habitué à recevoir des hommages, surtout des hommages de femmes. Dans toutes les tavernes qu’il fréquente, toutes les femmes sont à ses pieds. Pour le moment, il est perplexe. Une couronne de pain et un cierge pour lui ? Aucune femme ne lui a rendu encore cet hommage. Mais les temps sont peut-être venus d’être honoré comme le roi. Au roi on apporte du pain en hommage et on le dépose à ses pieds. Pourquoi pas à lui ? Tout tyran, si petit soit-il, se croit le maître du monde. Taky Robur regarde la femme avec bienveillance. Il ne bouge pas. Il attend. Il a cessé de crier. Mais quand il voit que la femme droite se signe, il se rend compte que l’offrande n’est pas pour lui. C’est pour le mort. Pour celui dont il a coupé la tête. La tête aux dents d’or de Taky Robur devient violette. Il saute de l’estrade. Il veut empoigner la femme. Rendre hommage à celui qu’il a tué ? C’est une chose qu’il ne peut pas tolérer. Taky Robur croit fermement à ce qu’il dit. Il expose ses exploits, raconte comment il a tué la bête féroce. En racontant cela, il se voit sur le même plan
que saint Georges qui a tué le dragon. Il est l’égal des archanges qui tuent les méchants. Il le croit fermement.
Il n’a jamais eu de doute. Le roi l’a récompensé avec vingt pièces d’or. Il les a dépensées. Il s’est fait faire des dents en or. Sa bouche d’or est la preuve que ses exploits égalent ceux de saint Georges. Il est saint Jean Bouche d’Or. Ses dents le prouvent. Il a reçu un galon de plus sur ses épaulettes. Il est assimilé aux aspirants. S’il accomplit d’autres exploits, il sera officier. En plus, il sait parler aux foules. Les gens l’écoutent en tremblant. N’est-ce pas une preuve de son héroïsme, de sa puissance, de sa grandeur ? Les élèves de toutes les écoles sont venus avec leurs professeurs et leurs moniteurs pour défiler devant lui, Taky Robur. Ni le capitaine, ni le colonel n’ont eu le droit à voir toute la ville défiler à leurs pieds comme lui, Taky Robur, aspirant officier qui a tué le dragon et lui a coupé la tête pour l’exposer à la population. Il a sauvé la montagne. Il est dans l’ordre des choses qu’une femme vienne lui apporter, comme aux conquérants, aux héros et aux autres sauveurs de l’histoire, l’offrande du pain. Mais cette ivresse n’a duré que quelques instants. Quand il voit la femme faire le signe de croix sans le regarder, lui, Taky Robur, il comprend que l’offrande n’est pas pour lui, mais pour la bête qu’il a tuée. Sa fureur est à sonc comble. En sautant de l’estrade pour écraser la femme qui a commis cet acte de démence, Taky Robur, tombe. Il est allongé au sol. Les autres militaires sont sur le qui-vive. Pour lui porter secours. À cet instant, bien que le gong de l’horloge n’ait
10 11
pas sonné les huit coups, Ionel Nimic ouvre le feu. Sans en avoir reçu le signal. Tous les brigands embusqués sur les toits et derrière les fenêtres ouvrent le feu. Ce n’était pas le signal de l’horloge. Les choses se sont passées autrement que prévu. Un décalage de trois minutes. Sur la place, on entend des cris. On se bouscule. On essaie de fuir. On s’allonge par terre. On est piétiné. Les gendarmes essaient de se lever et de reprendre la situation en mains, mais ils sont bousculés, renversés, plaqués au sol chaque fois qu’ils se relèvent. Cela ne dure pas longtemps. La fusillade cesse.
« Regarde, dit Nimic. Novalis a récupéré la tête. La tête de Fraga n’est plus au bout du pieu. Descendez et débrouillez-vous. Nos chemins se séparent. Vale, Hibernia. Que les anges vous aident à rencontrer Dracula. Vale. »
L’Irlandais est abandonné dans la chambre royale du palais de Caroubia. Il veut dire quelque chose au brigand, mais Ionel Nimic a disparu. Sur la place, le vacarme continue. Plus grand que pendant la fusillade. Des soldats arrivent de tous les côtés et bousculent la foule. L’horloge de la tour du prince Étienne sonne huit coups. La tête du supplicié Lucian Fraga a été récupérée deux minutes plus tôt que prévu.
12
Gil Ben Aych

Genre : saga
Troisième tome de La Découverte de l’amour et du passé simple

Format : 12 x 18,5 cm
Pages : 360
Prix : 18 €
ISBN : 978-2-490251-74-2


Né en 1948 à Tlemcen en Algérie, Gil Ben Aych arrive en France à l’âge de sept ans. Après quelques années passées à Paris, il s’installe en banlieue parisienne, à Champigny. Devenu professeur de philosophie, on lui doit notamment Le Chant des êtres (Gallimard), Le Livre d’Étoile (Seuil), Le Voyage de Mémé (École des Loisirs).
Son œuvre, largement autobiographique, poursuit le pari ambitieux et admirablement tenu de transformer en littérature la culture essentiellement orale du pays dont il est issu. Il a publié en avril 2021 le premier volume de La Découverte de l’amour et du passé simple : Simon et en avril 2022 le deuxième volume, Simon et Bärble, aux Éditions du Canoë.
Nous sommes en 1965, Simon a 16 ans. Il est en classe de seconde au lycée de Champigny. Son univers familial est endeuillé par la mort de son grandpère. Au fil du récit qui se déploie jusqu’à la fin 1967, le lecteur est immergé dans la vie lycéenne de l’époque, avec les portraits savoureux des profs d’Histoire et de français, d’élèves tels Chettard, actif et excellent organisateur, mais ne supportant pas de perdre, avec les démarcations entre les élèves du lycée technique et ceux du lycée général. Le lecteur y retrouve l’apprentissage de la vie, du jugement qui se fait à travers les rencontres – celui du juif azkhénaze, Itzkovitch, celui du séfarade, JeanMarc Benhamou, à travers les lectures, les engagements politiques de profs admirés qui amènent Simon à adhérer au grand dam de son père au Parti communiste, les débats intellectuels du moment incarnés par Foucault, Althusser, Garaudy… Bref, une adolescence passionnée qui découvre aussi l’amour, chastement, maladroitement, d’une façon si éloignée de la précocité actuelle. Un merveilleux tableau de la France de la fin des années soixante, juste avant le coup de tonnerre de 1968.
Avril
Contact et libraires : colette.lambrichs@gmail.com Téléphone : 06 60 40 19 16 Diffusion et distribution : Paon diffusion.Serendip Éditions du Canoë 2023
LE TERRAIN VAGUE
Par les baies vitrées du deuxième étage du huit de l’avenue de la République, on pouvait voir facilement toute la partie ouest de Champigny, l’appartement tout entier étant orienté plein-ouest, et un œil exercé, par beau temps, aurait pu aussi bien très nettement distinguer les constructions joinvillaises des vincennoises, voire des parisiennes, tant la vue s’étendait.
Mais ces baies n’étaient honorées que de rideaux de tissus en tergal blanc, par lesquels on protège son chez-soi et qui évitaient aux vis-à-vis situés légèrement à droite de l’appartement d’y avoir accès. Ces «cités blanches », c’était l’expression consacrée dans le quartier, frontales du huit de l’avenue mais décalées donc sur la droite, étaient des H.L.M. qui donnaient par derrière sur une sorte de terrain vague où les jeunes d’alentour pouvaient, savaient, aimaient se retrouver, le plus souvent autour d’un ballon. Des équipes étaient vite organisées et tout un rituel présidait au jeu, avec cette spontanéité incomparable que déploient les enfants quand ils s’amusent vraiment.
3
On ne dira alors jamais assez les trésors d’ingéniosité déployés par ces jeunes pour rendre vivable un paysage « urbain » où aucun équipement collectif n’était construit (bien que toujours prévu) pour leurs activités ludiques. On était là au début de l’ère immobilière gaullienne et pompidolienne, et si aujourd’hui cet ex-terrain vague est devenu une patinoire municipale, il faut savoir qu’à l’époque on cassait des branches d’arbres qu’on taillait pour figurer les montants verticaux des buts, on volait chez soi un kilo de farine pour tracer les limites du terrain (et on se disputait sur la distance réelle entre le point de penalty et la ligne du gardien), on essayait tant bien que mal de se trouver des vêtements de mêmes couleurs mais aux tons fatalement disparates pour faire mine d’équipement uni (« faire équipe » était le problème), on se cotisait habilement pour acheter les balles (qu’il fallait souvent renouveler parce que perdues, volées ou abîmées), on se prêtait la seule vraie paire de chaussures de football (une seule pour onze joueurs !) qu’un grand frère avait bien voulu céder au lieu de la jeter (et les autres traçaient sur leurs tennis de faux crampons avec un bouchon noirci au feu, comme on se fait des moustaches), bref on « bricolait » ainsi son football, son terrain, sa balle et ses chaussures, mais on jouait. On jouait au football – comme on doit le faire encore dans plus d’une banlieue… « bricolante » ! (Et la passion du « foot » était telle chez Simon que la première fois qu’il entendit l’expression « enfant de la balle », il crut qu’il s’agissait d’une métaphore usuelle du footballeur, quand
simplement on interviewait à la télévision une trapéziste qui apparaissait dans La piste aux étoiles, l’une de ses émissions favorites, entre autres pour les numéros comiques du clown-Auguste Achille Zavata).
Sur ce terrain vague on allait aussi parce qu’après le jeu et juste avant de rentrer on savait pouvoir faire un tour dans les caves avec celle qui accepterait, vivant dans ces cités et venant « regarder » les joueurs, de se faire toucher les seins et d’être embrassée sur la bouche à condition que ce soit à tour de rôle. Jocelyne était particulièrement friande de ces séances (mais elle n’était pas la seule), et, adossée à une porte en bois qu’elle choisissait (pourquoi ?) différente tous les jours, faisant autoritairement défiler les garçons (elle avait dix centimètres de plus que tous), elle disait au gré de son humeur (et cette surprise était excitante) : « toi oui ! » ou « toi non ! », c’était selon, et l’on touchait ses seins et baisait ses lèvres ou l’on s’en allait penaud, refusé aujourd’hui, mais obéissant toujours. Les injustices dans les tours et les protestations n’étaient pas admises, c’était la règle, et c’était cette règle injuste qui plaisait ; et, quand quelqu’un voulait recommencer, elle vous repoussait en disant : « non, une seule fois ! », la victoire entre sélectionnés étant d’avoir pu deux fois ! De temps en temps, la troupe s’égayait comme une volée de moineaux, à cause d’un bruit jugé inhabituel et parce que le guetteur, vrai ou faux, à tort ou à raison, sérieusement ou pour faire une farce, avait dit « P », signe de danger, d’une présence d’adultes. Si c’était vrai, on ne se revoyait que le lendemain en racontant ses frayeurs
4 5
(fuite à travers les couloirs des caves), et si c’était faux, « il », le guetteur, recevait une fessée déculottée donnée par Jocelyne en personne et devant tout le monde. (En donnant ses coups, elle prononçait alors des phrases comme en disent les parents à leurs enfants, pour les « corriger », comme « tu-vas-me-faire-le-plaisir-d’êtreplus-sérieux-à-l’avenir », martelant ses gestes au rythme de ses paroles, et faisant rire l’entourage pour la vérité de l’imitation ou le faisant taire, grave, sérieux, parce que l’imitation était trop bien réussie ou qu’elle avait fait réellement mal, qu’elle avait raté l’effet comique voulu.)
Or, il fallait bien donner des doubles rideaux à ces baies vitrées, celles du séjour. Aussi Joseph proposat-il à Jeannette d’abord, qui accepta, et à l’un de ses clients bruxellois, décorateur de son métier ensuite, de venir jusqu’à Champigny afin de concevoir lesdits rideaux, les fabriquer et les installer. L’opération dura bien quinze jours. Le décorateur en question se nommait Tsvi Markus, ce prénom avait attiré l’attention de Simon (dans une colonie de vacances juive, plus jeune, un moniteur s’appelait Tsvi – et il avait appris sa mort accidentelle par la suite), et Monsieur Markus en expliqua l’origine hébraïque à table, lors d’un repas algérien qu’il avait commandé à Jeannette, entre deux prises de mesures et autres installations de tringles. La maison, dans ces conditions, était devenue un véritable chantier parce que le décorateur avait pensé un agencement qui nécessitait un travail considérable.
Après la pose des tringles, il était passé à la constitution du coffrage proprement dit, son travail vraiment, et il devait pour ce faire confectionner d’un bois très souple des sortes de lattes disposées d’un bout à l’autre du mur, pièces qui recouvriraient les tringles. Ces lattes étaient elles-mêmes capitonnées de velours rouge-carmin en une première surface, surmontée d’une autre épaisseur de bois en sa moitié, festonnée, recouverte du même velours et faisant effet de volant, mais agrémenté à son extrémité d’un ruban d’or brodé de motifs d’amour.
Le tout était, on s’en doute, long à produire et fort délicat à préparer, car une fois le velours coupé (et il devait l’être aux bonnes mesures d’emblée), il fallait encore savoir le coller savamment. Belle difficulté dont Simon n’avait pas idée, mais il apprit de la bouche de Tsvi le principe de la colle rapide, avec le plaisir qu’éprouvent les enfants quand ils sont enseignés ni par un parent ni par un professeur mais à l’improviste, par un inconnu. Simon suivait ses gestes et buvait ses paroles, conquis.
Aussi bien les trois pièces, la salle à manger, le salon et la cuisine, étaient maintenant occupées par cette activité, révolutionnant l’ordre journalier, quotidien de la maison, et l’on avait transformé tout l’appartement en un véritable petit atelier, avec sa hiérarchie et ses petites mains. Jeannette cousait les rideaux et fixait les rivets permettant de les accrocher aux tringles. Le décorateur coupait et collait le velours et les rubans sur les coffrages. Joseph, qui ordonnait la maisonnée et faisait les courses, achetant notamment ce que le décorateur
6 7
n’avait pu apporter de Belgique par commodité, s’occupait du reste. Et les enfants, qu’on sollicitait un peu, essayaient pendant ce temps de ne pas oublier leurs devoirs scolaires en s’abstenant d’assister en spectateurs désemparés à ces authentiques séances de « tournage » décoratif, à ces projections de « cinéma » technologique, où l’intrigue était connue et décevante et les acteurs moyens, trop attendus. (Mais on aime regarder, même quand on sait ce qui va se passer, surtout les enfants.)
Au cours des interminables repas qui interrompaient le travail et où Tsvi se plaignait parfois, protestation amusée, parce qu’il mangeait et buvait trop bien, Simon fut fort intéressé de l’entendre retracer l’histoire de sa famille telle qu’il avait pu la reconstituer et telle que son père, en fait, la lui avait retransmise.
La famille Markus, tchèque si l’on remonte au début du xixe siècle, s’était déplacée en Allemagne d’abord, en Pologne ensuite, et en Russie finalement au début de notre siècle. Lui-même, Tsvi, appartenait, selon son père, à la branche polonaise, parentèle qui exerçait la profession de décorateur de père en fils depuis longtemps, pour toutes sortes de clients, y compris certaines cours européennes (Tsvi soulignant qu’il avait encore dans ses cartons des certificats de monarques attestant que ses ancêtres avaient agencé telles ou telles demeures aujourd’hui célèbres).
Mais bien que Simon eût ainsi l’impression d’être en face d’un personnage historique, mais dont les livres ne parleraient jamais parce que trop secondaire, pourtant
et malgré cette aura, une fois le travail fini, Simon contempla la chose, perplexe, et réprima son effroi pour éviter de blesser ses parents : il n’aimait pas mais pas du tout, il détestait le « coffrage » (ce mot, répété cent fois, l’exaspérait) qu’avait produit Monsieur Markus. Mais cette réaction, tout épidermique, n’avait pas pour origine l’aspect précisément esthétique de l’œuvre ; non, Simon, Simon lui-même n’aimait pas, sans parvenir encore à formuler consciemment les raisons de son exaspération, car cet attirail de broderie dorée et de velours rouge, et tout ce décor « capitonné » (autre mot détesté viscéralement) lui apparaissait comme mortuaire. Non, Simon refusait cela, d’un refus troublé et troublant, parce que simplement tout cet attirail faisait un peu deuil, « cas-d’obsèques », enterrement même, et qu’il refusait, et pour cause, ce système décoratif thanatocratique infligé à ses parents, avec leur consentement, voire leur fierté.
Le jour où Tsvi s’en alla, Simon fut courtois et le salua (et celui-ci n’avait d’ailleurs que faire de l’avis du fils aîné de son client), et s’assit, songeur, sur l’un des fauteuils du salon, rouge aussi mais d’un ton tout autre que celui des rideaux. Sachant encore que dans la chambre des parents, le même système avait été adopté, à cette différence près (heureusement) que le velours ici au lieu d’être rouge-sang était bleu-roi : et Simon s’interrogeait fébrilement sur la transformation des lieux subie par le passage du décorateur, et ces envies parentales de décorations « capitonnées ».
8 9
Où était-il désormais ? Chez lui ou chez lui ? Simon était-il encore chez Simon ? Et le huit ne lui semblait plus être sa véritable demeure, pire encore Simon eut le désagréable pressentiment, alors qu’on s’installait heureusement dans un nouveau lieu, que quelqu’un, un décorateur, un importun était venu y mettre non pas sa « merde » comme on dit familièrement aujourd’hui, mais sa mort. On va voir pourquoi. (Comme si un ashkénaze était venu dire à des sépharades : « prenez votre part de mort vous aussi ! »).
Effectivement, et effectivement, pendant un des autres repas pris en commun (et Tsvi avait vécu là quinze jours), Monsieur Markus avait signalé, un soir de confidences, au moment du pousse-café (et discrètement parce que la remémoration, on le conçoit, lui en était pénible), Monsieur Markus avait donc raconté sobrement comment une partie non négligeable de sa famille avait été éliminée dans les camps d’extermination par les nazis.
Bien que succinct, presque abrégé, ce récit avait drôlement travaillé Simon et il était maintenant tout empêtré, embarrassé, envoûté dans le halo de mort qui entourait la personne du décorateur-récitant, surtout depuis cette narration intime et éprouvante. (En dépit de cette tête et de cette dignité superbe, intelligente, que n’avait pas quittée l’ami de son père.)
Simon se tenait là, assis, devisant dans le vague, persuadé que ce monsieur, en transformant son univers par un « coffrage », et en ayant laissé cette « histoire-de-mort »
avant de disparaître, avait aussi accroché cette mort ici, la mort en personne, aux tringles de la demeure familiale, tout en en confectionnant ces rideaux, ces objets, ces rideaux qui permettent de fabriquer sa propre intimité, jusqu’à la plus secrète. Et les coffrages des rideaux devenaient des cercueils suspendus, au grand désarroi de Simon, comme des êtres fantomatiques, des personnages d’une pièce où il n’avait pas envie que ses parents jouent. Rideaux, rideaux fermés.
Simon en était là de ses pérégrinations mélancoliques quand il se produisit un fait qui doit survenir deux-trois fois maximum dans une vie et que l’on pourrait qualifier de télescopage morbide. Le téléphone retentit. C’était Michel, propriétaire du « p’tit club », et il annonçait que Claude, son meilleur ami, venait de mourir d’une leucémie foudroyante. Penser la mort, par « rideaux » interposés, quand on vous annonce la mort d’une connaissance, cette coïncidence l’intrigua, mais l’intriguait seulement, probablement parce qu’à l’époque Simon n’avait pas pensé au rapprochement possible entre la mort et un rideau fermé. Simon s’interrogeait certes, mais les questions alors étaient plus nombreuses que les réponses.
Le décorateur, le coffrage et la mort de Claude se mélangèrent dans la tête de Simon et formèrent un salmigondis d’images se heurtant les unes contre les autres. Après un long moment d’hébétude passé sur le fauteuil du salon, Simon s’en alla dans sa chambre où il resta, debout, devant la fenêtre : il vit des voisins dans le
10 11
pavillon mitoyen fêter quelque chose comme un anniversaire, du moins le pensa-t-il à cause des bougies qui brûlaient sur un gâteau, se prit la tête entre les mains et essaya, comme par pression violente, d’en exprimer les visions cauchemardesques qui le harcelaient. Il ouvrit la fenêtre, stationna sur le balcon, et murmura en luimême : « Je ne veux pas que mes parents meurent, ne me faites pas ça ! » D’autres scènes envahirent son imagination, puis il entra de nouveau dans sa chambre, referma la porte, et se mit au lit. Un proverbe arabe dit que lorsqu’on pense à la mort elle vient toujours frapper quelque part, c’était vrai ici pour cet ami. Plus encore, puisque pris d’insomnie, Simon essayait d’imaginer ses réactions dans le cas où on lui aurait annoncé la mort de Peggy. Il s’imaginait seul, marchant infiniment dans un couloir de béton lui-même infini, puis, commençant néanmoins de fermer les yeux, il cria très fort en luimême (au point qu’il crut qu’on l’entendrait, alors qu’il n’avait proféré aucun son) : « Peggy ! », insistant longuement sur le « g » final . Un « Peggy »-muet !
12
Gil Ben Aych
Genre : récit
Format : 12 x 18,5 cm
Pages : 320
Prix : 18 €
ISBN : 978-2-490251-60-5


Né en 1948 à Tlemcen en Algérie, Gil Ben Aych arrive en France à l’âge de sept ans. Après quelques années passées à Paris, il s’installe en banlieue parisienne, à Champigny. Devenu professeur de philosophie, on lui doit notamment Le Chant des êtres (Gallimard), Le Livre d’Étoile (Seuil), Le Voyage de Mémé (École des Loisirs). Son œuvre, largement autobiographique, poursuit le pari ambitieux et admirablement tenu de transformer en littérature la culture essentiellement orale du pays dont il est issu. Il a publié en avril 2021 le premier volume de La Découverte de l’amour et du passé simple : Simon, aux Éditions du Canoë.

Dans ce deuxième volume, le héros, Simon, a 13 ans. Il observe la famille au sens large, cousins, cousines proches ou éloignées, leurs parents, avec humour et tendresse. C’est la découverte des filles, des différences sociales. Petit-bourgeois de banlieue populaire, il observe, déchiffre les prises de position des uns et des autres, compare, mesure, s’initie à la politique, au théâtre, découvre le sionisme dans un camp de vacances à Hyères, le travail dans un grand magasin au rayon tissus, et après dans une usine où l’on fabrique des boulons au cours d’un voyage en Allemagne pour des vacances avec son frère Abram. C’est le temps de l’apprentissage, de la rencontre avec Bärble, des lectures, des timidités de l’amour naissant, des gaucheries, de toutes les inquiétudes, des doutes qui caractérisent l’âge incertain de l’adolescence.

Avril
Contact et libraires : colette.lambrichs@gmail.com Téléphone : 06 60 40 19 16 Diffusion et distribution : Paon diffusion.Serendip Éditions du Canoë 2022
Gil Ben Aych

Genre : récit
Format : 12 x 18,5 cm
Pages : 320
Prix : 18 €
ISBN : 978-2-490251-3-91
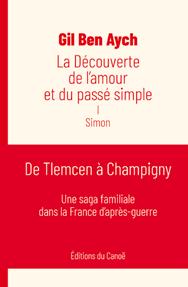


Né en 1948 à Tlemcen en Algérie, Gil Ben Aych arrive en France avec sa famille à l’âge de 7 ans. Après quelques années passées à Paris, ils s’installent en banlieue parisienne à Champigny. Toute son œuvre, abondante et très populaire, (Voyage de Mémé, L’Essuie-main des pieds, Le livre d’Étoile, Le Chant des Êtres, Au jour le jour ) raconte à travers son expérience et celle de ses proches, l’histoire d’une famille juive en France dans les quartiers tenus à l’époque par le parti communiste. Devenu professeur de philosophie, il poursuit dans le dernier volume de La Découverte de l’amour et du passé simple, intitulé Soixante-huit, le pari ambitieux et admirablement tenu de transformer en littérature, la culture essentiellement orale du pays dont il est issu.
La Découverte de l’amour et du passé simple est une saga en 4 volumes de l’histoire de l’émigration en 1956 d’une famille juive algérienne en France et de sa vie jusqu’à la fin des années soixante – Soixantehuit étant le sujet du dernier volume, à paraître en 2022. Le héros porte le nom de Simon. Il a, comme l’auteur, 7 ans lorsqu’il quitte Tlemcen pour habiter Paris, puis Champigny, la banlieue rouge, dans ces années-là, tenue par le parti communiste. Dans la culture orale dont Simon vient, l’écrit est réservé à Dieu. Dans son appropriation progressive de la culture française, il s’éloigne à mesure de son passé, de ses couleurs, de ses accents. Le premier livre, Simon, paru en 2002 aux Éditions Exils, dévoile un appartement de Champigny, son collège avec ses profs, les commerçants, la nourriture, le porc, la banlieue, ses parents exilés et la conscience encore embryonnaire qu’il pénètre dans un monde autre qu’il faudra faire sien s’il veut transgresser l’interdit implicite de sa culture : écrire. Dans les volumes prochains Simon et Bärble et Simon et Peggy, le lecteur retrouvera la famille au sens large. La série s’achève sur Soixante-huit à paraître ultérieurement qui clôt cette véritable fresque des années soixante qui nous plonge dans un monde disparu dont l’évocation à la fois drôle et tendre arrache souvent des larmes.
Contact et libraires : colette.lambrichs@gmail.com ; tel 06 60 40 19 16 Diffusion-distribution : Paon diffusion.Serendip
Éditions du Canoë 2021 9 avril