DÉCLINE-T-ON FORCÉMENT
EN VIEILLISSANT ?

DÉCLINE-T-ON FORCÉMENT
EN VIEILLISSANT ?
DOULEUR
QUELLES MOLÉCULES
POUR REMPLACER
LES OPIOÏDES ?
THÉRAPIE
COMMENT LE LSD RECONFIGURE
NOTRE CERVEAU
DÉMANGEAISONS
CHRONIQUES
COMMENT ARRÊTER
DE SE GRATTER ?











N° 170

p. 14-15
John Kounios
Professeur de psychologie à l’université Drexel, aux États-Unis, et coauteur du livre
The Eureka Factor (2015), ses recherches portent sur les mécanismes cérébraux liés la créativité.

p. 28-31
Petros Petridis
Psychiatre et professeur assistant au département de psychiatrie du Centre de médecine psychédélique NYU Langone, à New York, il étudie les e ets thérapeutiques des composés psychédéliques.

p. 46-51
Nathalie Rapoport-Hubschman
Médecin et psychothérapeute, elle dirige l’institut de médecine corps-esprit Henry-Benson, à Boston. Ses recherches illustrent comment le bien-être corporel soigne les maux de l’esprit, et vice versa.

p. 76-79
Lara Aknin
Professeuse de psychologie à l’université SimonFraser, au Canada, elle tente d’identifier les di érents facteurs qui influent sur notre bonheur.

Rédacteur en chef
Avec près de cinq heures par jour passées devant des écrans – hors temps de travail –, notre attention est largement tournée vers des stimuli extérieurs. Dans ces conditions, la perception que nous avons de notre corps devient fottante, voire évanescente. Les scientifques ont fait une découverte récente : quand le cerveau n’écoute plus le corps, il devient vulnérable à l’angoisse et à la dépression. La zone cérébrale qui recueille les infux nerveux en provenance du cœur et des viscères est muette chez les grands anxieux. À l’inverse, dès qu’on la remet en marche, les ruminations s’apaisent. Il y a mille moyens pour cela, qui mobilisent souvent le contact des mains avec la matière (jardiner, cuisiner, bricoler, tricoter…), ou la pleine présence à nos sensations (méditer, pratiquer le yoga…). Le succès sans précédent des cours de poterie ou de coloriage, dans un monde saturé d’écrans et de jeux vidéo, nous oblige à un constat : nous ne pouvons pas vivre comme des esprits spectateurs dans un monde de réalité virtuelle pendant que la planète vacille. Nous avons besoin de nous sentir ancrés à notre corps et ce corps a besoin d’être ancré dans la nature. Car notre système nerveux a évolué pendant des millions d’années dans un environnement naturel. Et il en a gardé la trace. On découvre ainsi que notre axe du stress est sensible aux chants des oiseaux ou au murmure des ruisseaux, qui ont sur lui l’effet d’un baume. C’est cette double imbrication – l’esprit dans le corps, le corps dans la nature – qui doit nous servir de guide pour mener une vie équilibrée.
Aujourd’hui, l’humanité enfante de nouveaux êtres dont le fonctionnement ressemble à celui de notre cerveau, comme on l’apprend en page 32 : les IA. Mais ces êtres n’ont pas de corps. Alors, sont-ils angoissés ? Voudraient-ils, eux aussi, qu’on leur propose des cours de poterie et de jardinage ? Je l’ignore. Ils n’ont pas évolué parmi les chants d’oiseaux. Peut-être sont-ils très heureux là où ils sont. Mais nous, nous devons faire attention. £
N° 170 NOVEMBRE 2024

p. 6-39
p. 6 ACTUALITÉS
Couple : quel est le meilleur moment pour rompre ?
La TCC remodèle le cerveau dépressif
Les femmes, plus performantes pendant leurs règles
L’âge cérébral, victime d’inégalités…
Dans l’os du crâne, une révolte immunitaire
Autisme : un cerveau embryonnaire trop gros ?
Quand l’astrocyte se métamorphose…
p. 14 FOCUS
Le « flow » observé dans le cerveau !
Les bases neuronales de cet état de fluidité mentale viennent d’être découvertes, livrant des clés pour mieux l’atteindre.
John Kounios et David Rosen
p. 16 DOULEUR CHRONIQUE
Vers une nouvelle génération d’antidouleurs
De nouveaux analgésiques stoppent les signaux nerveux de la douleur avant qu’ils n’atteignent le cerveau…
Marla Broadfoot
p. 41-55


p.
28 NEUROPSYCHIATRIE
Dissoudre le soi pour guérir les troubles psychiques
Le LSD ou la psilocybine désynchronisent les neurones et donnent l’impression que la frontière entre soi et l’univers disparaît…
Petros Petridis
p. 32 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
notre cerveau ?
ChatGPT, Google Translate, Siri : ces IA nous sont bien utiles au jour le jour. Mais elles pourraient surtout nous aider à comprendre comment fonctionnent notre propre intelligence et notre conscience.
George Musser
Ce numéro comporte un encart d’abonnement Cerveau & Psycho, broché en cahier intérieur, sur toute la di usion kiosque en France métropolitaine. Il comporte également un courrier de réabonnement, posé sur le magazine, sur une sélection d’abonnés. En couverture : © DDDART/Shutterstock
p. 42 NEUROSCIENCES SE RECONNECTER À SON CORPS POUR ÊTRE MIEUX DANS SA TÊTE
En réapprenant à diriger son attention vers ses sensations corporelles, on diminue les risques de dépression et d’anxiété.
Norman Farb et Zindel Segal
p. 46 MÉDECINE CORPS-ESPRIT CES GESTES QUI FONT DU BIEN
Tricot, coloriage, cuisine, jardinage… Ces activités manuelles enclencheraient un « reset » cérébral qui interrompt le cycle des ruminations.
Nathalie Rapoport-Hubschman
p. 52 NEUROPHYSIOLOGIE TROUVER L’ÉQUILIBRE
AVEC LE NERF VAGUE
Un nerf assure le dialogue permanent entre notre cerveau et nos organes. En le stimulant intelligemment, on peut restaurer un équilibre entre corps et esprit fragilisé.
Douglas Fields


p. 56-69


p. 70-93


p. 94-99

p. 56 SANTÉ MENTALE
L’étonnante santé cognitive des séniors
La moitié des personnes de plus de 70 ans auraient toutes leurs facultés mentales.
Lydia Denworth
p. 60 PSYCHOLOGIE SOCIALE
Ragot et potins : des bénéfices insoupçonnés
À l’encontre des idées reçues, les commérages seraient bénéfiques à la cohésion sociale.
Francine Russo
p. 64 L’ENVERS DU DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

YVES-ALEXANDRE THALMANN
L’autosuggestion fonctionne-t-elle ?
Pas vraiment. Mais se conditionner pour adopter les bons comportements, oui !
p. 68 RAISON ET DÉRAISON
La coureuse qui parlait comme Mickey Mouse
Pourquoi cette championne olympique parle-t-elle comme la souris de Disney ?
Nicolas Gauvrit
p. 70 BIEN-ÊTRE
Pour faire baisser la tension artérielle, les hormones du stress et l’anxiété, rien de mieux que d’écouter des chants d’oiseaux !
Anna Lorenzen
p. 76 PSYCHOLOGIE
Pour franchir le pas sans crainte de l’importuner, une méthode simple élaborée par des psychologues sociaux.
Lara Aknin et Gillian Sandstrom
p. 80 DERMATOLOGIE
Les victimes de démangeaisons chroniques vivent un calvaire. Des premières solutions commencent à voir le jour.
Frank Luerweg
p. 88 L’ÉCOLE DES CERVEAUX

JEAN-PHILIPPE LACHAUX
Cherchez la facilité, vous
Les problèmes complexes deviennent simples… quand on trouve une image mentale qui les résume.
p. 92 SÉLECTION DE LIVRES
Comment garder le bénéfice de ses vacances
Victoire sur les troubles alimentaires
Dans la tête d’une araignée
Psychologie positive des activités physiques et sportives
Le Pouvoir de l’amour
Petit Traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens
p. 94 NEUROSCIENCES ET LITTÉRATURE

SEBASTIAN DIEGUEZ
« Le Bavard » : Comment arrêter les moulins à paroles ?
Ils jacassent, papotent, pérorent sans fin… À côté des explications neuroscientifiques, le roman Le Bavard aide à mieux comprendre la psychologie des incorrigibles pipelettes.
Par la rédaction
PSYCHOLOGIE
Selon une récente étude, la rupture interviendrait quand le seuil de satisfaction entre les partenaires tombe en-dessous de 65 % de son niveau optimal.
J. L. Bühler et U. Orth, Journal of Personality and Social Psychology, 2024.
Avec votre partenaire ou conjoint, cela fait un moment que ce n’est plus comme avant. Vous sortez moins souvent, les moments d’intimité sont plus rares et moins passionnés… Vous avez plus de mal à raviver la flamme. Quand vous comparez avec le début de votre relation, il y a plusieurs années, il y a clairement une baisse de satisfaction et d’intérêt. Ce qui vous préoccupe surtout, ce sont les disputes. Depuis quelque temps, elles se répètent et vous n’arrivez plus à trouver l’élan pour vous réconcilier ou un terrain d’entente. À tel point que vous vous demandez parfois si ce couple ne serait pas devenu quelque chose qui vous gâche la vie, une situation qui vous apporte plus de tracas que de bonheur. Autrement dit : est-il temps de rompre ?
Une fois la question posée, y répondre n’est pas chose aisée. La perte d’intérêt dans le couple est généralement quelque chose de

X. Zhang et al., Science Translational Medecine, 2024.
graduel, comme viennent de le mesurer des psychologues de l’université de Berne, en Suisse. Mais ces travaux mettent aussi en lumière l’existence d’un « seuil de rupture », sorte de limite au-delà de laquelle les couples tendent à franchir le pas et à décider de mettre fin à leur histoire.
Au cours de cette étude, les chercheurs ont analysé les données de 2 268 personnes, hommes et femmes, suivies dans le cadre d’un projet de recherche sur plusieurs générations s’étendant des années 1970 au début des années 2000. Les données disponibles prenaient en compte di érents paramètres tels que le ressenti des individus, leurs choix de vie, les changements au sein de leur couple ou de leur famille à mesure que les années passaient. Janina Larissa Bühler et Ulrich Orth, auteurs de ces travaux, ont notamment observé les scores de satisfaction dans le couple, corrélés ou non à des événements de rupture, et la quête d’un nouveau partenaire.
Le premier fait marquant est que, en règle générale, la satisfaction tend à diminuer avec le temps. Cela n’exclut pas que dans certains cas elle se maintienne, voire augmente, mais la tendance dominante est à l’érosion. Toutefois, les couples qui finissent par se séparer se distinguent des autres : chez eux, la dégradation est
plus rapide. Ensuite, le niveau de satisfaction des individus connaît un rebond en cas de nouveau partenaire, et dans ce cas le bonheur des débuts est même en moyenne supérieur à celui du commencement de la précédente relation. Mais le déclin recommence, et plus clairement chez celles et ceux qui ont des enfants. Vient enfin la question du seuil de rupture, un peu comme la charge limite que peut supporter une poutre avant de céder… Pour l’estimer, les chercheurs ont noté l’évolution des scores de satisfaction dans le couple au fil des années, auprès de cet échantillon de participants. Quelles que soient les échelles utilisées, lorsque ce score descend au-dessous de 65 % de la valeur maximale possible, le couple se sépare généralement. Il existe plusieurs échelles de satisfaction que chacun peut passer, mais il faut toujours garder en tête que d’importantes variations peuvent exister, notamment en fonction de la personnalité des conjoints ou de leurs convictions. Et que les conditions socioéconomiques peuvent jouer. Ainsi, dans un contexte économiquement favorable, on se sépare plus facilement, alors qu’à l’inverse la précarité peut amener des partenaires à rester ensemble, sachant que la séparation entraîne en moyenne une importante baisse du niveau de vie. £
Sébastien Bohler
La dépression est une maladie aussi répandue que di cile à traiter, car multiforme. Comment savoir si une méthode thérapeutique sera e cace chez un patient donné ? Récemment, des chercheurs de l’école de médecine de l’université de Stanford ont découvert qu’en mesurant l’activité de certaines aires du cerveau au début d’une thérapie, il est possible de prédire en partie les chances de succès de cette dernière.
La thérapie concernée était une TCC, ou thérapie cognitivo-comportementale. Son principe consiste à reconfigurer certains schémas de pensée et comportements chez le patient pour l’aider à faire face à sa maladie. Notamment ce qu’on appelle le « contrôle cognitif », qui désigne la capacité à réguler ses propres pensées et actions pour atteindre un but. En e et, certains patients dépressifs chercheraient à contrôler trop de paramètres dans la conduite de leurs actions, ce qui mènerait à une surcharge mentale et un découragement.
Pour comprendre si, chez ces patients, la TCC avait la capacité d’atténuer l’activité du réseau cérébral associé à ce contrôle cognitif (comportant notamment des régions du cortex préfrontal et pariétal), les chercheurs l’ont enregistrée à di érents moments sur une période de deux ans : avant et pendant la thérapie, puis un an après sa fin. Verdict : la TCC réduit bien l’activité du circuit, et cette atténuation présage une amélioration des symptômes dépressifs sur le long terme… Un outil potentiellement utile pour adapter le traitement au cas par cas, sans attendre des années. £ Ilona Bouvard

sa conception, l’objectif de l’IA n’était pas de concurrencer un grand maître aux échecs, ni de produire des œuvres artistiques à foison. Le but véritable était de reproduire des caractéristiques de notre intelligence pour mieux en comprendre le fonctionnement. Et c’est toujours cet objectif que poursuivent les chercheurs qui tentent aujourd’hui de construire, non pas une IA, mais une IGA. C’està-dire intelligence générale artifcielle, en d’autres mots un système doté d’une adaptabilité et d’une créativité semblables à celles des humains. Un tel dispositif ne se limiterait pas à des tâches hyperspécifques et contextualisées, comme le fait ChatGPT.
Les modèles de langage (ou LLM, pour large language models) ont certes atteint des niveaux de performance remarquables, mais ils
ChatGPT, Google Translate, Siri : nous sommes habitués à utiliser ces IA au quotidien. Mais leur principal intérêt pourrait être ailleurs, en nous aidant à comprendre comment fonctionnent notre propre intelligence et notre conscience.
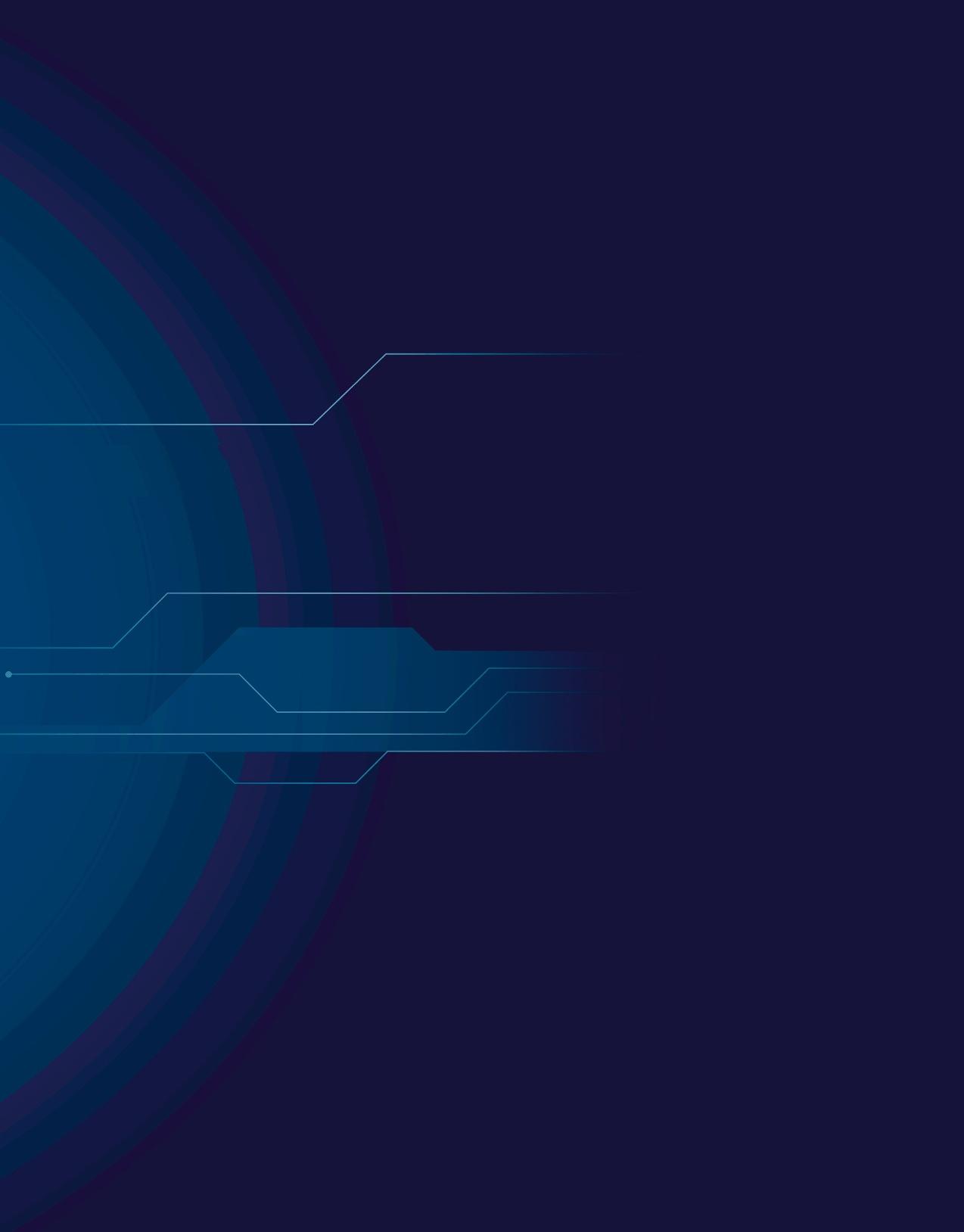
EN BREF
£ À la faveur des recherches sur l’IA, de nombreuses théories de la conscience ont émergé, dont celle de l’espace de travail global (GWT).
£ Celle-ci suppose que notre cerveau fonctionne grâce à di érents modules – di érentes aires cérébrales – qui transmettent leurs informations à un « centre de commande » – la conscience.
£ Autre découverte : pour développer une intelligence supérieure, les IA devraient être à même de sélectionner les informations à traiter sans s’attarder sur certains détails. Un principe commun à notre cerveau, qui choisirait les informations qui peuvent atteindre la conscience…
commettent toujours des erreurs grossières et ne sont pas encore en mesure d’apprendre sans limite fxée a priori ; une fois qu’ils ont été formés à partir de livres, de blogs et d’autres ressources, leur capacité de stockage reste fgée. Ils échouent ainsi à ce que Ben Goertzel, chercheur américain spécialiste en IA et fondateur de la société d’IA SingularityNET, appelle le « test de l’étudiant » : on ne pourrait pas les envoyer à l’université, car ils n’ont pas les facultés nécessaires pour suivre un cursus universitaire de manière autonome. Aujourd’hui, la seule caractéristique d’une IGA que les IA ont réussi à atteindre concerne le langage. Sur ce plan, elles possèdent ce que les experts nomment une « compétence formelle », c’est-à-dire acquise à la faveur d’un apprentissage méthodique. Elles peuvent alors analyser n’importe quelle phrase, même fragmentée ou écrite en argot, et répondre dans un français (ou un anglais) standardisé. En revanche, elles échouent dès qu’une réfexion est nécessaire. Ce qui concerne à peu près tout ce qui nous est utile dans notre vie quotidienne. « Nous ne devrions pas nous attendre à ce que les IA soient capables de penser », déclare ainsi la neuroscientifque Nancy Kanwisher, de l’institut de technologie de
DÉCOUVERTES Intelligence artificielle
L’IA POUR MIEUX COMPRENDRE NOTRE CERVEAU ?
Géorgie. « Ce sont des processeurs de langage. » Ils manipulent habilement les mots, mais n’ont accès à la réalité que par les textes qu’ils ont absorbés.
SUBDIVISER L’INTELLIGENCE EN MODULES
D’une certaine manière, les grands modèles de langage n’imitent que les aptitudes linguistiques du cerveau, et non l’ensemble de ses facultés mentales. Notre matière grise permet
Selon la théorie de l’espace de travail global (GWT), la conscience est au cerveau ce qu’une réunion du personnel est à une entreprise : un espace où les di érents composants du système partagent des informations et s’entraident.
réseaux neuronaux distincts, lesquels mettent en commun leurs informations pour répondre aux demandes du public… En décembre dernier, la société Mistral AI, établie à Paris, a publié une version en libre accès de cette architecture en modules associés qu’on appelle également « mélange d’experts ». Avec, à la clé, une effcacité informatique démultipliée. Car il est plus facile d’entraîner et de faire fonctionner seize petits réseaux qu’un grand réseau unique.
Cet article est traduit de la version américaine publiée dans Scientific American le 29 juillet 2024 : G. Musser, « The quest to build a truly intelligent machine helps us learn about our own intelligence ».
en effet d’orchestrer un grand nombre de fonctions cognitives qui œuvrent de concert. Mais chacune a une zone cérébrale associée. De sorte que les personnes qui ont subi un accident vasculaire cérébral dans l’une des zones du langage perdent parfois la capacité de parler, mais non d’additionner des nombres, d’imaginer des mélodies ou de jouer aux échecs. Les développeurs des IA intègrent maintenant cette modularité dans leurs systèmes, dans l’espoir de les rendre plus intelligents. Autrement dit, ils séparent un système en différents modules, pour que chacun puisse gérer une fonctionnalité propre de manière indépendante.
Depuis peu, ChatGPT offre à ses utilisateurs l’accès à de nombreux modules d’extension, moyennant paiement. Chaque composant fait appel à une banque externe d’informations relevant de sa spécialité. De cette façon, les abonnés de ChatGPT peuvent résoudre des problèmes mathématiques, accéder à des sources sur internet et traiter de nombreuses autres requêtes. Dans le même temps, le modèle de langage en version gratuite s’est aussi amélioré, et pour cause : même si OpenAI ne dévoile pas le fonctionnement de ChatGPT, les experts en IA estiment que ce système pourrait disposer de seize
Mais ce type de système doit faire face à un déf de taille : personne ne sait au juste comment les régions du cerveau fonctionnent ensemble pour créer un soi cohérent, et encore moins par quel tour de force une machine pourrait imiter cela. « Comment l’information passe-t-elle du système linguistique à ceux du raisonnement logique ou social ? », s’interroge la neuroscientifque Anna Ivanova, de l’institut de technologie du Massachusetts (MIT). Une hypothèse controversée propose que la conscience résulte d’un processus de centralisation et de traitement de toutes ces informations. Il s’agit de la théorie de l’espace de travail global, également appelée théorie GWT, pour Global workspace theory. Elle a été introduite il y a une quarantaine d’années par Bernard Baars, chercheur à l’institut des neurosciences de La Jolla, en Californie.
Selon cette idée, la conscience est au cerveau ce qu’une réunion du personnel est à une entreprise : un lieu où les différents modules partagent des informations et s’entraident. Cette théorie présente un intérêt particulier pour les chercheurs en IA : elle suppose que la conscience fait partie intégrante d’une intelligence avancée. Pour effectuer des tâches simples ou répétitives, le cerveau peut fonctionner en pilote automatique, mais les tâches nouvelles ou compliquées – celles qui dépassent la portée d’un seul module – exigent que nous soyons conscients de ce que nous faisons.
Ben Goertzel et d’autres chercheurs et ingénieurs en IA ont alors intégré un « espace de travail » dans leurs systèmes d’IA. « Je pense que les concepts fondamentaux du modèle de l’espace de travail global vont émerger sous de nombreuses formes différentes », affrme le spécialiste. En concevant des représentations électroniques de ce modèle, ces équipes ne souhaitent pas créer des machines conscientes, mais produire une intelligence semblable à celle de l’homme. Mais de là à engendrer un être doté d’intentions et de sentiments, il y a un pas que ne franchit pas Bernard
Baars lui-même : « L’existence de machines conscientes est une hypothèse dénuée de toute preuve », tranche-t-il. N’empêche qu’en parvenant à construire une IGA, les chercheurs pourraient découvrir des informations importantes sur la structure de l’intelligence elle-même.
En fait, la théorie GWT illustre l’infuence réciproque entre les recherches en neurosciences et en IA, un lien qui remonte initialement au modèle du Pandémonium, élaboré par l’informaticien Oliver Selfridge dans les années 1950. Ce dernier voulait expliquer le fonctionnement de notre vision : selon lui, nos perceptions seraient créées par une multitude de modules captant différents fragments d’une scène visuelle. Il comparait ces modules à des démons qui hurleraient pour attirer l’attention du grand chef de l’assemblée, le « hub centralisateur ». Résultat : notre attention se porterait sur l’objet de notre environnement dont le « démon » crierait plus fort que les autres (ce qui se passe quand on voit un carré de chocolat, par exemple). Ces idées ont ensuite été reprises par les psychologues cognitifs et c’est dans ce contexte que Bernard Baars, dans les années 1980, a présenté pour la première fois le GWT comme une théorie de la conscience
Le Pandémonium, en littérature, est un lieu imaginaire où les démons se réunissent et hurlent pour attirer l’attention de Satan. L ’informaticien Oliver Selfridge s’inspira de cette image pour expliquer que les di érents modules cérébraux traitant les informations visuelles cherchent aussi à « crier » plus fort que les autres pour obtenir l’attention d’un module centralisateur qui fera accéder leur information à la conscience.
humaine. Ce dernier a par la suite inspiré l’informaticien Stanley Franklin, de l’université de Memphis, lequel s’est lancé dans la création d’un ordinateur conscient. Et s’ils doutaient euxmêmes d’une telle prouesse, la machine a pourtant développé divers traits propres à la psychologie humaine. Par exemple, lorsque son attention était détournée d’une tâche vers une autre, elle omettait certaines informations, montrant que ses capacités en multitâche étaient limitées, tout comme celles des humains.
Dès les années 1990, les neuroscientifques Stanislas Dehaene et Jean-Pierre Changeux, du Collège de France, se sont intéressés de plus près aux mécanismes neuronaux de l’espace de travail. Selon eux, les modules cérébraux fonctionneraient la plupart du temps de manière indépendante, mais tous les dixièmes de seconde environ, ils auraient une de leurs « réunions de personnel ». C’est alors celui qui crie le plus fort qui capte l’attention de la conscience. Chaque module a des informations à offrir, et plus il est confant dans ces informations – plus un stimulus correspond à ses attentes, par exemple –, plus il crie fort. Une fois qu’un module l’emporte, les autres se calment un moment, et le gagnant place ses informations dans un ensemble de variables communes : l’espace de travail. Les autres modules

jugent ensuite par eux-mêmes si l’information est utile ou non. « Vous obtenez ce processus intéressant de coopération et de compétition entre sous-agents qui disposent chacun d’une part de la solution », déclare Bernard Baars.
Cet espace de travail permet non seulement aux modules de communiquer entre eux, mais fournit également un lieu où ils peuvent réféchir collectivement aux informations, même lorsque celles-ci ne sont plus associées au monde extérieur. Par exemple, explique Stanislas Dehaene, après avoir aperçu brièvement quelque chose ou ressenti un léger toucher, même si les informations ne sont plus directement perçues – on ne voit plus l’objet, on ne ressent plus de pression tactile sur notre peau – , elles résonnent toujours dans nos pensées, nous continuons à réféchir à ces informations. Cette capacité est essentielle pour résoudre des problèmes qui impliquent plusieurs étapes ou qui s’étendent dans le temps.
UN LANGAGE COMMUN ?
Un autre déf de taille que doit relever la théorie GWT est l’hyperspécialisation. En effet, les divers modules de notre cerveau développent des jargons inintelligibles les uns pour les autres : l’aire de la vision produit des images pour traiter les informations visuelles, le centre auditif génère des perceptions de sons associées aux vibrations de l’oreille interne. Mais comment ces deux régions cérébrales parviennent-elles à communiquer ? En adoptant un langage commun, ou ce qu’Aristote appelait le « sens commun » – la faculté d’interpréter les différentes informations sensorielles. Cette approche est particulièrement intéressante pour les réseaux multimodaux des grandes entreprises technologiques qui combinent textes, images et autres formes de communication.
Selon le modèle de Stanislas Dehaene et Jean-Pierre Changeux, les différentes régions du cerveau – les modules – sont reliées les unes aux autres par des neurones qui ajustent leurs synapses de manière à traduire dans leur jargon local les données reçues des aires voisines. « Ces neurones convertissent les données entrantes en leur propre code », explique Stanislas Dehaene. Mais les mécanismes sous-jacents restent mal compris et le scientifque espère que les spécialistes en IA pourront ouvrir des pistes intéressantes !
En 2021, Ryota Kanai, neuroscientifque et fondateur de la société d’IA Araya, et Rufn VanRullen, neuroscientifque aujourd’hui spécialiste en IA à l’université de Toulouse, ont proposé un moyen qui permettrait aux réseaux neuronaux artifciels d’effectuer la « traduction »

Person
des données brutes entrantes. Ils se sont inspirés des systèmes de traduction linguistique tels que Google Translate, qui constituent à ce jour l’une des réalisations les plus impressionnantes de l’IA. Ces systèmes accomplissent leur tâche sans qu’on leur indique explicitement, par exemple, que le mot « love » en anglais correspond au mot « amour » en français. Ils apprennent chaque langue de manière indépendante, puis, en maîtrisant chacune d’elles, ils sont capables de déterminer quel mot en français a le même sens que « love » en anglais.
Supposons que vous entraîniez deux réseaux neuronaux distincts, l’un pour la langue anglaise, l’autre pour la langue française. Chacun d’eux apprend la structure de sa propre langue, et développe une représentation interne, appelée « espace latent ». Cet espace est en quelque sorte un nuage de mots : une carte de toutes les associations existantes entre les mots de cette langue, construite en plaçant les termes de sens similaire à proximité les uns des autres et en éloignant ceux qui n’ont aucun lien sémantique évident. Si les nuages de mots des deux langues ont des formes distinctes, ils possèdent une structure analogue parce qu’ils se réfèrent fnalement au même monde. Il sufft de faire pivoter les nuages de mots anglais et français jusqu’à ce qu’ils s’alignent. Vous observerez alors que « love » se positionne en face d’« amour ». « Finalement, sans avoir de dictionnaire à disposition, il est possible d’obtenir la traduction d’un mot (voir la fgure
À gauche, des mots français sont disposés en fonction de leur proximité sémantique (leurs liens de sens), formant une constellation blanche. Des mots anglais sont représentés de façon équivalente en jaune. Ces deux constellations ne sont pas alignées : par exemple, le mot « amour » n’est pas situé à proximité du terme « love ».
Pour traduire des mots du français vers l’anglais, les IA comme ChatGPT cherchent à faire correspondre la forme globale des constellations (à droite), sans même chercher à comprendre le sens des mots. Ce jeu de puzzle amène naturellement les termes français à proximité de leurs équivalents anglais.

ci-dessus). Il sufft d’observer la constellation des espaces latents de chaque langue – chaque point désignant un mot – et d’exécuter la bonne rotation de ces constellations pour aligner les termes équivalents des deux langues », explicite Ryota Kanai. Cette méthode peut être appliquée à des mots isolés, mais également à des passages entiers, ce qui permet de traiter des nuances subtiles et des mots qui n’ont pas d’équivalent direct dans l’autre langue.
Pour Rufn VanRullen et Ryota Kanai, cette méthode va au-delà de la traduction linguistique et peut être utilisée pour faire correspondre différentes formes de données, comme des images avec des sons ou du texte. « On pourrait créer un tel système en entraînant séparément un modèle pour le traitement d’images et un autre pour le traitement du langage, puis les combiner en alignant leurs espaces latents respectifs », détaille Ryota Kanai. Comme pour le langage, la traduction d’images en texte est possible parce que les systèmes se réfèrent fondamentalement au même monde. C’est fnalement ce que Stanislas Dehaene souhaitait : une découverte menée par la recherche en IA qui permet de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. « Les neuroscientifques n’avaient encore jamais pensé à la possibilité d’aligner les espaces latents ! », s’enthousiasme Ryota Kanai.
En tout cas, ce principe est mis en pratique par Google DeepMind depuis 2021 à travers leur modèle Perceiver : ce système a été conçu pour fusionner du texte, des images, de l’audio et d’autres données dans un espace latent commun. En 2022, Google l’a intégré dans un programme capable de rédiger automatiquement des descriptions pour les courts métrages de YouTube. Des chercheurs de la société d’IA Araya ont analysé le fonctionnement de Perceiver et ont constaté que bien qu’il n’ait pas été délibérément conçu pour être un GWT, il en avait toutes les caractéristiques : des modules indépendants, un processus de sélection – le réseau de gating, ou routeur – et une mémoire de travail – l’espace de travail lui-même.
Autre application des concepts d’espace de travail : AI People. Ce nouveau jeu de simulation proche du célèbre jeu Sims, créé par la société d’IA Good-AI, s’appuie sur le modèle GPT pour animer des personnages, contrôler non seulement leurs dialogues, mais aussi leur comportement et leurs émotions. Le système identife ainsi si un des personnages est en colère, triste ou anxieux, et ajuste ses actions en conséquence. Ses développeurs y ont intégré plusieurs modules supplémentaires, notamment un GWT sous la forme d’une mémoire à court terme, donnant aux personnages une psychologie cohérente.
DU GÉNÉRATIF AU DISCRIMINATIF
Récemment, le chercheur français Yann Le Cun, qui offcie pour la société Meta, a présenté une avancée potentiellement révolutionnaire. Bien que ses travaux ne se réfèrent pas directement à la théorie GWT, il propose des idées similaires et critique la dominance des modèles génératifs comme ceux utilisés par GPT – G pour generative. « Je m’oppose à plusieurs tendances qui, malheureusement, sont extrêmement populaires en ce moment dans la communauté de l’IA et de l’apprentissage automatique, affrme le
« Le cerveau humain possède certaines capacités que l’ingénierie n’a pas encore réussi à maîtriser. »
Nikolaus Kriegeskorte,

Selon le modèle de Stanislas
Dehaene et Jean-Pierre
Changeux, les di érentes régions du cerveau communiquent grâce aux neurones qui, en modifiant la force de leurs connexions, convergent vers un langage commun compréhensible par toutes les aires cérébrales.
scientifque. Je recommande aux chercheurs de laisser de côté les modèles génératifs », ajoute-t-il. Les réseaux neuronaux génératifs sont ainsi nommés parce qu’ils génèrent de nouveaux textes et de nouvelles images en prenant comme base les données auxquelles ils ont été exposés. Pour ce faire, ils doivent être minutieux : ils savent comment épeler chaque mot d’une phrase et où placer chaque pixel d’une image. Or l’intelligence n’est autre que la capacité à négliger de manière sélective les détails. Yann Le Cun préconise donc aux chercheurs de revenir à une technologie
aujourd’hui démodée : les réseaux neuronaux « discriminants », appelés de cette manière car ils savent distinguer les différences entre les données d’entrée – comme des images de chiens et de chats. Contrairement aux modèles génératifs, ceux-ci ne créent pas de nouvelles images, mais se contentent d’analyser celles qui sont déjà existantes pour leur apposer des étiquettes. Yann Le Cun a élaboré un programme d’entraînement qui permet au réseau discriminant d’extraire les caractéristiques essentielles du texte, des images et d’autres données encore. Le système n’est peut-être pas en mesure de compléter automatiquement une phrase, mais il produit des représentations abstraites que le chercheur espère similaires à celles qui sont présentes dans notre esprit. Par exemple, si vous injectez dans le système une vidéo d’une voiture qui roule sur la route, la représentation qu’il en élabore devrait saisir la marque, le modèle, la couleur, la position et la vitesse du véhicule, tout en omettant les irrégularités du bitume, les ondulations des faques d’eau, les refets des brins d’herbe sur le bord de la route – tout ce que notre cerveau jugerait sans importance, à moins que nous ne nous concentrions spécifquement sur ces points.
« Tous ces détails non pertinents sont éliminés », expose le scientifque.
Ces représentations simplifées ne sont pas utiles en elles-mêmes, mais nécessaires aux nombreuses fonctions cognitives essentielles à l’IGA. Yann Le Cun intègre ainsi le réseau discriminant
comme un module à part entière dans un système plus complexe qui comprend des caractéristiques clés de GWT, telles qu’une mémoire à court terme et un « confgurateur » pour coordonner les modules et gérer le fux de travail. Le système a ainsi la capacité de planifer. « J’ai été très inspiré par certains principes fondamentaux en psychologie », confe le chercheur. De la même manière que le cerveau humain peut mener des expériences de pensée, en imaginant comment une personne réagirait dans diverses situations, le confgurateur fera fonctionner le réseau discriminant à plusieurs reprises. Il explorera différentes actions hypothétiques afn de déterminer celle qui produira le résultat désiré. Yann Le Cun propose ce qu’il appelle une « théorie populaire », selon laquelle la conscience correspond au fonctionnement du confgurateur. Dans son modèle, ce confgurateur joue un rôle similaire à celui de l’espace de travail dans la théorie de Bernard Baars – tous deux pouvant être considérés comme un « centre de commande ».
LA CONSCIENCE, LE PROPRE DE LA VIE ?
Si les chercheurs parvenaient à intégrer un véritable GWT dans les systèmes d’IA, deviendraient-ils conscients ? Selon Stanislas Dehaene, c’est envisageable dans la mesure où ces systèmes seraient dotés d’une capacité d’autosurveillance, c’est-à-dire à même de conscientiser leurs propres processus mentaux. Mais Bernard Baars reste sceptique, en partie parce qu’il n’est pas encore entièrement convaincu de sa propre théorie. « Je me questionne constamment sur la validité de la théorie de l’évolution du cerveau », déclare-t-il. Selon lui, la conscience est une faculté inhérente à notre nature biologique et ne peut être séparée de ce que nous sommes en tant qu’êtres vivants. Stanley Franklin partageait le même avis. Pour lui, le GWT représente une adaptation évolutive développée pour répondre aux exigences physiologiques du corps. La conscience permet au cerveau d’apprendre de ses expériences pour survivre. Il a ainsi suggéré que les aptitudes de ce dernier ne sont pas nécessaires pour résoudre les problèmes auxquels l’IA est généralement confrontée. « Pour disposer d’une conscience, une entité doit disposer d’une forme de vie – cela ne signife pas qu’il ne puisse s’agir d’un robot, mais il doit nécessairement avoir connu plusieurs stades de développement et d’apprentissage », m’a-t-il confé. Anil Seth, neuroscientifque à l’université du Sussex, en Angleterre, approuve ce point de vue. « La conscience n’est pas seulement une question d’intelligence, affrme-t-il. C’est également une question de vie. Aussi avancées
B. J. Baars, Global workspace theory of consciousness : Toward a cognitive neuroscience of human experience, Progress in Brain Research, 2005.
O. Selfridge, Mechanisation of thought processes, Symposium : National Physical Laboratory, 1958.
S. Dehaene et J. Changeux, Experimental and theoretical approaches to conscious processing, Neuron, 2011
L. Blum et M. Blum, A theory of consciousness from a theoretical computer science perspective : Insights from the Conscious Turing Machine, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2022
R. VanRullen et R. Kanai, Deep learning and the Global Workspace Theory, Trends in Neurosciences, 2021.
soient-elles, les IA ont peu de chances de développer une conscience si elles ne sont pas vivantes. » Plutôt que d’adhérer à la théorie GWT, le professeur défend une autre théorie de la conscience connue sous le nom de « traitement prédictif », selon laquelle un être conscient cherche à prédire ce qui va lui arriver afn d’être prêt à y faire face. « Pour comprendre la conscience de soi, il est d’abord essentiel de comprendre les modèles prédictifs qui permettent de réguler et de contrôler nos corps », explique-t-il. Anil Seth a également étudié la théorie de l’information intégrée, qui associe la conscience non plus au fonctionnement du cerveau, mais à sa structure, organisée en réseau. Selon cette théorie, la conscience ne serait pas un élément essentiel de l’intelligence, mais pourrait avoir émergé pour des raisons d’effcacité biologique. Le domaine de l’IA regorge actuellement de nouvelles idées, et les ingénieurs disposent déjà de nombreuses pistes à explorer sans avoir besoin d’en puiser davantage dans le champ des neurosciences. « Les neurosciences risquent d’entraver le progrès de la machine », observe Nikolaus Kriegeskorte, neuroscientifque à l’université Columbia, à New York. Mais le cerveau reste une référence fondamentale pour l’IGA et constitue pour l’instant le modèle le plus avancé dont bénéfcient les chercheurs en IA. « Le cerveau humain possède certaines aptitudes que l’ingénierie n’a pas encore réussi à maîtriser », ajoute-t-il.
La recherche sur l’IGA au cours des dernières décennies nous a beaucoup appris sur notre propre intelligence. Nous savons désormais que les tâches qui nous semblent simples, comme celles consistant à reconnaître des objets ou des visages, nécessitent en réalité un traitement complexe en matière de calcul, tandis que certaines tâches qui nous semblent diffciles, comme résoudre des problèmes mathématiques ou jouer aux échecs, sont très accessibles à des IA. De plus, nos cerveaux n’ont besoin que de très peu de connaissances innées ; ils apprennent par l’expérience. Et maintenant, avec l’avènement du concept de modularité, nous voyons se confrmer la vieille idée selon laquelle l’intelligence est multiple. Elle se compose d’une gamme variée de compétences, allant de la manipulation des abstractions à la perception des images et des sons. Comme le souligne Ben Goertzel, c’est cette combinaison de capacités qui permet à notre cerveau de résoudre des problèmes qui ne s’étaient encore jamais posés auparavant. Chaque jour, on invente de nouveaux genres musicaux et on résout de nouvelles énigmes scientifques que les générations précédentes pouvaient à peine formuler. £



En lien avec la Cité des bébés
En lien avec la Cité des bébés
Deux conférences pour explorer le développement des enfants en extérieur et comprendre toute l’importance des interactions avec les adultes et la nature.
Deux conférences pour explorer le développement des enfants à l’extérieur et comprendre toute l’importance des interactions avec les adultes et la nature.
Gratuit sur réservation
réservation
Retrouvez toute notre programmation ici :
Retrouvez toute programmation :

Mardi 12 novembre à 14h30
Mardi 12 novembre à 14h30
Le bébé, un animal social
Comment l’art, l’échange avec le monde des adultes, l’immersion dans la nature, participent au développement du bébé ?
Comment l’art, l’échange avec le monde des adultes, l’immersion dans la nature, participent au développement du bébé ?
Avec Céline Gauthier, chercheuse en danse ; Mélanie Perrier, chorégraphe.
Proposée par l’association des Chercheurs en Danse (aCD).
Avec Claire Grolleau, microbiologiste et présidente de l’association Label Vie ; Louise Bouché, chargée de mission chez Label Vie et Vincent Vergone, artiste plasticien, fondateur de la compagnie Les demains qui chantent.
Mardi 3 décembre à 14h30 Tous dehors !
Mardi 3 décembre à 14h30
Tous dehors !
Projection-débat autour du documentaire Tous dehors ! de Anne Jochum, 57 min, 2023.
Projection-débat autour du documentaire Tous dehors ! de Anne Jochum, 57 min, 2023.
Quels sont les impacts de la sédentarité sur les plus jeunes ?
Quels sont les impacts de la sédentarité sur les plus jeunes ?
Avec Élise Mareuil, éducatrice de jeunes enfants ; Anne Jochum, réalisatrice ; Jean Epstein, psychosociologue.
Avec Élise Mareuil, éducatrice de jeunes enfants ; Anne Jochum, réalisatrice ; Jean Epstein, psychosociologue.
p. 42
Se reconnecter à son corps pour être mieux dans sa tête
p. 46
Ces gestes qui font du bien
p. 52
Trouver l’équilibre grâce au nerf vague
Le contact d’une tasse de café dans le creux de nos mains, l’odeur du breuvage qui s’élève à nos narines. Le tic-tac régulier de la pendule. Le mouvement de l’air qui va et vient dans nos poumons. La texture molle de la terre qui s’écrase entre nos doigts, la caresse de hautes herbes sur nos jambes, le contact chaud du soleil couchant sur la peau. Les sensations sont partout. Oui, mais nous n’y prenons pas garde, occupés que nous sommes à regarder bouger des formes lumineuses sur des écrans.
Et c’est un problème. Car coupé de ses sensations, notre cerveau angoisse. Il a besoin de ces repères tactiles, auditifs, odorants. C’est pourquoi les activités manuelles, ou celles qui nous relient à notre corps et à nos sens, révèlent aujourd’hui un pouvoir thérapeutique. En prêtant attention à nos ressentis internes, que ce soit en pratiquant des activités comme le dessin, la poterie, le jardinage, le yoga ou la méditation, on reconnecte son corps et son cerveau, et on se recentre. On se met en relation avec soi-même et on fait taire les ruminations, le stress et l’anxiété. Les recherches les plus récentes sur ce thème vous sont présentées dans ces pages, ainsi que les moyens de restaurer ce lien fragilisé. Vous pouvez poser doucement vos mains sur votre tasse de café…
Sébastien Bohler

BREF
£ L’anxiété et la dépression se développent souvent quand on est trop centré sur ses routines quotidiennes, et pas assez sur ses sensations corporelles.
£ Prêter davantage attention à ces ressentis, par exemple au mouvement de l’air dans ses poumons, se traduit par une amélioration du bien-être.
£ Dans notre cerveau, l’activité des réseaux sensoriels viendrait contrer les réseaux associés aux ruminations et aux automatismes.
En réapprenant à diriger son attention vers ses sensations corporelles, on diminuerait par là même les risques de dépression et d’anxiété.
Par Norman Farb, professeur associé de psychologie à l’université de Toronto Mississauga, et Zindel Segal, professeur émérite de psychologie et des troubles de l’humeur à l’université de Toronto Scarborough.

our René Redzepi, aujourd’hui chef cuisinier de renommée mondiale à Copenhague, la passion des saveurs remonte aux étés de son enfance, passés en Macédoine. Une vie à la ferme, occupée à des cueillettes dans les bois environnants. Là-bas, pas de technologie, mais « la vie était vraiment riche et épanouissante. Nous étions heureux », se rappelle-t-il dans le média en ligne Haut de Gamme
Bien des années plus tard, il ouvrira son propre restaurant à Copenhague. Le Noma. Là, il explore les côtes et les forêts nordiques, en quête de feurs comestibles, d’argousier, d’algues, de coquillages et de baies de rosier qu’il ajoute à ses créations et qui viennent embellir le menu de sa table.
Certes, il rencontre quelques critiques, mais son pudding à l’oxalis (une petite plante herbacée aux feuilles ressemblant à celles du trèfe) fnit par faire l’unanimité. Le Noma sera classé en tête des cinquante meilleurs restaurants du monde cinq fois en douze ans. Un succès qui a contribué à un regain d’intérêt pour la cueillette.
Cueillir représente en effet un retour agréable à la nature. Une autre façon de s’alimenter. De rompre avec le quotidien des courses au supermarché. Dans un monde de plus en plus industrialisé, c’est une relation différente à l’environnement, et une chance de se reconnecter aux rythmes des plantes et des saisons.
Et ce changement peut séduire pour diverses raisons. Depuis la pandémie de Covid-19, le nombre de personnes atteintes d’anxiété ou de dépression dans le monde n’a jamais été aussi
élevé. Comme si l’on était coincé dans une routine quotidienne sans grand intérêt. Alors, oui : partir en forêt fait du bien. Mais il y a une solution plus simple encore pour se sentir bien. Cueillir nos propres sensations. Glaner les ressentis corporels, internes, et rediriger notre attention vers eux. Un moyen, pour les spécialistes de la science des sensations, d’appuyer sur le bouton « pause » de nos activités mentales. De ces préoccupations qui tournent en boucle, de ces ruminations qui nous gâchent la vie. D’une cueillette d’herbes ou de baies, passer à celle de nos sensations physiques. Pour explorer sa nature intérieure.
Et pour comprendre les bénéfices qui en découlent, il faut se pencher un instant sur le fonctionnement de notre cerveau. Un organe bien plus doué pour se forger des habitudes que pour les remettre en question. En effet, une grande partie de l’énergie de notre cerveau est consacrée à la création d’un ensemble d’habitudes qui nous permettent d’aborder les situations du quotidien en les classant par « modèles » familiers. Attendre à un carrefour, rencontrer un ami, avoir un besoin pressant : autant de scénarios bien rodés, de routines qui économisent de l’énergie et évitent de trop réféchir. À partir de ces modèles, nos actions possibles semblent émerger automatiquement, nous offrant ainsi un sentiment de contrôle dans la vie quotidienne. De plus, s’appuyer sur ces schémas de comportement automatique libère notre esprit pour apprendre de nouvelles choses et résoudre de nouveaux problèmes.
« L’INHIBITION SENSORIELLE »
AUGMENTERAIT LE RISQUE DE DÉPRESSION
Mais ces modèles peuvent dans certains cas se révéler inadaptés. Par exemple, consulter les réseaux sociaux pour se tenir au courant des actualités est peut-être utile, mais faire défler les pages sur son smartphone sans s’arrêter jusque tard dans la nuit (on dit doomscroller) peut être désastreux pour la journée de travail suivante. Alors, à moins de mettre à jour ses habitudes par défaut au fl du temps ou d’en créer de nouvelles, les choix qui ont pu être stimulants par le passé peuvent commencer à nous peser.
Comment sortir de ce mode en « pilote automatique » ? Comme le révèlent plusieurs études scientifques récentes, le réseau sensoriel du cerveau est capable d’injecter des perspectives inédites pour contrer le réseau cérébral qui soutient nos habitudes. De plus, ces deux réseaux sont connectés de telle façon qu’une attention accrue portée à l’un diminue l’activité de l’autre.
Dans l’une des plus vastes études sur le sujet, publiée en 2022, nous avons suivi l’activité

cérébrale de 85 personnes qui prenaient un traitement contre la dépression, pendant qu’elles visionnaient des extraits de flms tristes ou neutres. Comme attendu, les scènes négatives ont rendu les gens plus malheureux que les extraits neutres. En comparant leurs activités neuronales lors du visionnage des deux types de flms, nous avons alors pu modéliser comment les émotions négatives se déployaient dans leur cerveau. Puis nous avons proposé aux patients, durant huit semaines, deux interventions psychothérapeutiques classiques connues pour améliorer la santé mentale et les avons suivis durant deux ans.
Résultat : les personnes les plus à risque de rechute pendant cette période étaient celles dont les régions sensorielles du cerveau – impliquées dans le traitement des sensations – étaient les moins actives durant le visionnage des flms tristes. Et, de façon étonnante, les participants semblaient ne pas être conscients de ce phénomène.
Selon nos données, la « suppression sensorielle » multiplie par huit le risque de nouvel épisode dépressif. Des résultats qui viennent corroborer des recherches antérieures que nous avions menées sur un groupe d’individus non dépressifs. Soumis à un stress émotionnel, ceux qui présentaient une activité atténuée dans les zones sensorielles du cerveau faisaient état de plus de sentiments anxiodépressifs que ceux ayant une inhibition sensorielle moindre.

Les pieds qui reposent sur le sol, la chaleur du soleil sur notre peau… Quand on est stressé, prendre un moment pour ressentir
monde
nous
stimuler
Par ailleurs, nos conclusions semblent indiquer que toutes les sensations ne se valent pas : les diverses régions du cerveau sont associées à différents types de traitement sensoriel. Plus précisément, une diminution d’activité dans les aires sous-tendant la conscience corporelle – par opposition, par exemple, aux zones du cerveau liées aux sens externes, comme l’ouïe et la vue – apparaît comme le meilleur indicateur d’un risque de souffrir de symptômes anxiodépressifs.
LA CLÉ : DÉVELOPPER
SON INTÉROCEPTION
La capacité de percevoir ce qui se passe dans notre corps – une compétence nommée « intéroception » – varie d’une personne à l’autre. Mais la bonne nouvelle pour celles et ceux d’entre nous qui chercheraient à diminuer leurs ruminations et d’autres comportements problématiques, c’est qu’il existe de nombreuses preuves que l’intéroception peut être entraînée, avec des bénéfces pour notre santé mentale. Ainsi, en 2022, lors d’une autre étude, nous avons révélé que le fait de suivre plusieurs mois de cours de yoga axés sur la conscience intéroceptive améliorait l’attention de façon plus importante que des cours de yoga traditionnels. De plus, les participants qui avaient boosté leur attention étaient devenus des observateurs plus confants de leur « nature intérieure ».
Bien que différents types d’exercices soient susceptibles de modifer notre humeur, la faculté
de maintenir une conscience sensorielle pourrait être la clé pour atténuer l’emprise des habitudes. En 2023, nous avons suivi l’activité cérébrale de 22 personnes en bonne santé qui devaient se concentrer sur leur respiration. Plus précisément, elles étaient attentives soit à leur respiration (inspirations et expirations), soit aux « pulsations » d’un cercle sur un écran qui s’étendait et se contractait. Durant cette tâche, plusieurs changements notables se sont produits dans le cerveau, dont l’un fut une véritable surprise : se concentrer sur sa respiration – et non sur le cercle – semblait désactiver les fonctions corticales supérieures que les chercheurs associent aux actions, à la prise de décision, à la planifcation et à la résolution de problèmes. Devenir plus conscient de son corps diminuerait donc l’attention du cerveau pour d’autres stimuli.
Bibliographie
N. Farb et al., Interoceptive awareness of the breath preserves attention and language networks amidst widespread cortical deactivation : A within-participant neuroimaging study, eNeuro, 2023
N. Farb et al., Static and treatment-responsive brain biomarkers of depression relapse vulnerability following prophylactic psychotherapy : Evidence from a randomized control trial, Neuroimage Clin., 2022. C. L. Nord et S. N. Garfinkel, Interoceptive pathways to understand and treat mental health conditions, Trends Cogn. Sci., 2022.
Face au stress, nous avons tendance à diriger notre attention sur les causes de notre mal-être, développant ainsi l’habitude de « gérer la négativité » sans laisser de place à l’intuition ou à la nouveauté à chaque moment qui passe. Il serait préférable de nous engager dans une « cueillette sensorielle » : prendre le temps de prêter attention à nos diverses sensations physiques, y compris à quelque chose d’aussi simple que l’air qui affue et refue dans les poumons.
Rester concentré sur nos sensations malgré l’appel envoûtant des ruminations permet à la curiosité, à la nouveauté et à l’apprentissage de perturber nos routines préétablies. Cette capacité retrouvée de faire confance à ses sens serait l’une des raisons pour lesquelles les interventions cliniques qui visent notamment à rendre les patients plus attentifs à leurs sensations, telles que les thérapies reposant sur la pleine conscience, sont souvent effcaces pour lutter contre les symptômes dépressifs.
Comment y parvenir ? Pour récolter les bénéfces de la cueillette sensorielle, il sufft d’accorder plus de temps à nos sensations ! Nos pieds qui reposent sur le sol, la chaleur du soleil sur notre peau, notre pouls qui accélère en haut d’un toboggan aquatique… Lorsque nous sommes stressés, le fait de prendre un moment pour remarquer et ressentir le monde dynamique et vibrant qui nous entoure peut véritablement stimuler notre résilience, notre bienêtre, notre santé et notre créativité. Ensuite, à chacun de progresser selon ses moyens, ses envies et sa motivation ! £
Par Francine Russo, journaliste scientifique spécialiste des sciences sociales.
Quand un groupe de collègues murmure près de la machine à café, c’est plus fort que nous : on veut savoir. Cet instinct du commérage remplit une fonction essentielle en rapprochant les personnes – et en distillant, bon an mal an, des informations que chacun peut exploiter.
Les scientifiques étudient les ragots depuis des décennies. Et on les comprend, car le phénomène est pratiquement universel et traverse tous les groupes sociaux. Au travail, plus de 90 % des personnes s’adonneraient ainsi aux potins, racontant ou commentant des histoires sur une personne absente. Et ce aussi bien aux États-Unis qu’en Europe occidentale. Selon une étude, les sociétés modernes y consacrent environ une heure par jour. Mais les chercheurs abordent aujourd’hui cette composante de la vie sociale sous un nouvel angle.
Auparavant, explique Tianjun Sun, psychologue à l’université Rice, à Houston, on se concentrait principalement sur les dommages causés par les cancans, en étudiant soit la personne qui les propageait, soit celle qui en était la cible. Mais aujourd’hui, changement de cap : les spécialistes s’intéressent de plus en plus aux avantages des commérages et à la dynamique d’un réseau dit « en
£ Plus de 90 % des gens céderaient à la tentation des potins et autres commérages.
£ Selon les études scientifiques, le simple fait de parler d’une personne absente rapprocherait les gens les uns des autres !
£ Les potins se révéleraient parfois utiles pour observer les réactions des autres, choisir ses amis et alliés.
£ Pour la victime, ces rumeurs auraient parfois un intérêt en l’incitant à modifier des comportements problématiques.

trois parties » ou « triangle du ragot ». Il implique le sujet qui les produit, celui qui les écoute et celui qui est visé. À la clé : un éclairage sur la façon complexe dont se construit la perception de soi et des autres, en étudiant des facteurs tels que les informations échangées, la valorisation de l’ego et la ségrégation sociale au sein d’un groupe.
UN SENTIMENT DE CONNEXION ET D’APPARTENANCE
Alors, que pourrait-il donc y avoir de bon dans les potins et autres bruits de couloir ? Que ce soit positif, négatif ou neutre, chaque fois que quelqu’un vous confe quelque chose sur une personne que vous connaissez l’un et l’autre, cela a pour effet de vous rapprocher, en créant un lien entre vous. Selon une étude, les ragots augmenteraient même l’estime que vous portez à la personne qui les a diffusés. Ils vous aident à savoir à qui faire confance et au contraire qui il vaut mieux éviter. En somme, cela renforce les normes du groupe. Par exemple, les rumeurs au sujet d’un collègue qui jette des peaux de banane malodorantes dans la poubelle à papier sont susceptibles d’arriver à ses oreilles et de lui faire savoir que ce n’est vraiment pas une chose à faire au bureau.

La personne qui colporte les on-dit est le principal acteur de l’affaire. Il n’est donc pas surprenant qu’une grande partie des recherches en sciences sociales dans ce domaine se soient concentrées sur les raisons pour lesquelles les gens cancanent, sur ce qu’ils en retirent et, le cas échéant, sur les problèmes qu’ils encourent. Dans leur forme la plus édulcorée, les potins créent un sentiment de connexion et d’appartenance, explique Tianjun Sun. En revanche, si ce que vous faites circuler est préjudiciable à la personne visée, vous pouvez vous sentir coupable. Et même craindre des répercussions, voire des représailles. De plus, ceux auprès de qui vous médisez risquent de se faire une fâcheuse idée de vous.
UN MOYEN DE POINTER
LES BREBIS GALEUSES
Mais halte aux idées reçues. Depuis toujours, les commères ont mauvaise réputation, alors que, d’après les recherches menées sur le sujet, la plupart des informations qu’elles transmettent sont vraies. La sociologue Francesca Giardini, de l’université de Groningue, aux Pays-Bas, et ses collègues l’ont constaté lors d’une expérience en laboratoire réalisée avec des étudiants mis en situation dans des jeux d’argent. Ils avaient à leur disposition des contributions monétaires qu’ils pouvaient verser à un fonds commun à tous les joueurs (comportement altruiste) ; mais ils pouvaient aussi choisir de maximiser leurs gains personnels en agissant plutôt dans leur propre intérêt. Dans l’étude, quatre joueurs avaient la possibilité de gagner jusqu’à 21 euros de la part des expérimentateurs. S’ils choisissaient de renfouer leur compte privé, ils recevaient une somme d’argent correspondant à leur mise initiale, augmentée d’une part de la cagnotte du groupe. En revanche, si la totalité des participants décidaient de contribuer au pot commun, ils en tiraient un plus grand bénéfce, car la somme alors récoltée était multipliée par 1,5.
Au fl des parties, les étudiants ont appris à connaître les autres joueurs et ont eu l’occasion de s’avertir les uns les autres, de manière confdentielle, de la présence d’un mauvais payeur vis-à-vis du pot commun. En fin de compte, selon les observations des expérimentateurs, les joueurs qui y contribuaient le plus étaient, en moyenne, plus enclins à transmettre des potins, ici défnis comme des informations véridiques sur ceux qui jouaient plutôt « perso » et dans leur propre intérêt.
Selon une autre expérience de laboratoire, menée par le psychologue social Terence Dores Cruz, alors à l’université libre d’Amsterdam, les

pipelettes transmettent des informations véridiques lorsqu’elles n’ont pas de confit d’intérêts avec la cible de leurs commérages. Mais si une rivalité ou un confit les oppose à la personne visée, elles sont nettement plus enclines à diffuser des informations qui les arrangent ou qui sont carrément fausses. À l’instar du méchant dans un mélodrame, le colporteur peut faire tomber un rival, par exemple, en manipulant le ressenti que les gens ont à son sujet. Pour comprendre les motivations du ragoteur, il sufft de se poser la question : « Qui a quelque chose à gagner dans cette affaire ? », résume Terence Dores Cruz.
UNE SOURCE D’INFORMATION PRÉCIEUSE
Par ailleurs, le fait d’être ami avec un autre membre du « triangle du ragot » affecte la véracité de l’information, prévient le psychologue. Selon lui, un ami de la personne visée peut ainsi rechigner à transmettre une information négative. Tandis qu’il peut tout à fait en dire quelque chose de positif – mais de faux.
Malgré la complexité de leurs motivations, les êtres humains sont en moyenne assez doués pour évaluer les intentions des personnes avec lesquelles ils interagissent. Ils connaissent généralement chacune d’elles et sa place dans le réseau. Une étude montre que le facteur déterminant pour interpréter les potins est de savoir quelle intention on prête à l’individu qui les transmet : le fait-il pour en tirer un bénéfce personnel ou au contraire pour aider ? Dans ce dernier cas, les gens font davantage confance au colporteur.
L’intérêt le plus flagrant des ragots est qu’ils aident les gens à mieux comprendre le comportement des autres.
Les ragots peuvent être d’une importance cruciale pour ceux qui y tendent l’oreille. Apprendre qu’un collègue pourrait quitter son emploi, par exemple, peut en motiver un autre à accepter des missions diffciles, susceptibles de lui faire décrocher une promotion. Et pour un nouvel arrivant dans un groupe, cela peut s’avérer d’une valeur inestimable. Dans toute grande organisation, il y a toujours des groupes ou de petites cliques. Si vous êtes LGBTQI+, par exemple, les bruits de couloir sur la vie de l’entreprise ou les décisions que les gens ont soutenues ou combattues peuvent éclairer vos propres choix, « de sorte que vous puissiez choisir vos amis et vos alliés », commente Tianjun Sun.
Peu de recherches ont été menées sur l’impact des ragots sur les personnes appartenant à des minorités, mais au moins une étude suggère leur utilité dans certains cas. Entre 2015 et 2020, des chercheurs ont interrogé des habitants de Riace, une ville du sud de l’Italie qui accueille des réfugiés et des migrants depuis plus de vingt ans. Ils ont constaté qu’une grande partie des commérages circulaient entre des personnes appartenant à des groupes d’origines différentes et favorisaient en cela les relations entre les communautés. Une étude similaire réalisée en 2016 dans une université sud-africaine, historiquement blanche, a toutefois montré que les bruits de couloir sur les employés noirs, en leur absence lors de réunions, nuisaient aux performances professionnelles de ces derniers et à leur moral.
Être la cible de cancans est souvent considéré comme une mauvaise chose. Et pourtant… Avec ses collègues, la psychologue Elena Martinescu, alors à l’université de Groningue, a constaté que les cibles de potins favorables en retiraient des émotions positives telles que la ferté. Mieux : même les commérages – plutôt négatifs – se sont parfois avérés bénéfques, car ils incitaient à modifer des comportements problématiques. « Le bon côté des choses, explique Tianjun Sun, c’est que l’on prend davantage conscience de la façon dont on est perçu par les autres et que l’on peut alors adapter son comportement. » Reste que, bien entendu, « si les gens disent du mal de vous, ils peuvent nuire à votre réputation, à vos perspectives de carrière, à votre santé mentale », rappelle-t-elle.
UNE SAGESSE DES POTINS
La plupart des études concernent les potins qui circulent sur le lieu de travail, mais, en pratique, les travaux de recherche se font surtout en laboratoire ou à partir de données en ligne. Terence Dores Cruz a mené l’une des rares études sur le fonctionnement des ragots en situation réelle. Il a recruté plus de 300 personnes dans une commune des Pays-Bas et leur a demandé d’en citer quinze, avec lesquelles elles avaient des contacts fréquents. Quatre fois par jour pendant dix jours, les participants ont été invités à rapporter toute information qu’un membre de ce réseau leur avait communiquée – ou qu’ils avaient communiquée à quelqu’un – au sujet d’une tierce personne. Ils devaient évaluer toute une série de choses à propos de chaque individu ciblé par des commérages, telles que sa fabilité, ses compétences, ou le fait qu’il soit plutôt chaleureux ou distant. Résultat franc et massif : les ragots étaient jugés vrais. Les participants ont aussi réévalué leurs opinions sur la personne visée et ont adapté leur comportement à son égard.
L’intérêt le plus évident des cancans est qu’ils aident les gens à mieux comprendre le comportement des autres. Par exemple, selon Terence Dores Cruz, si quelqu’un se plaint d’un collègue, en retard tous les jours, mais apprend par des ragots que cette personne est en plein divorce ou que son jeune fls a un cancer, ses griefs vont rapidement cesser. Plus important encore, cela le poussera à sympathiser avec le collègue en question, voire à essayer de l’aider. Et, dans l’ensemble, le psychologue et ses collègues ont constaté que, dans la vie réelle, la plupart des potins n’étaient ni positifs ni négatifs, mais simplement des nouvelles : par exemple, untel est devenu grand-père, tel autre s’est fancé… £
Ce texte est une adaptation de l’article « The surprising benefits of gossip », publié par Scientific American le 6 septembre 2024.
Bibliographie
T. D. Dores Cruz, R. van der Lee et al., Nasty and noble notes : Interdependence structures drive self-serving gossip, Personality and Social Psychology Bulletin, 2023
M. Testori, T. D. Dores Cruz et al., Punishing or praising gossipers : How people interpret the motives driving negative gossip shapes its consequences, Social and Personality Psychology Compass, 2023
T. Sun, P. Schilpzand et al., Workplace gossip : An integrative review of its antecedents, functions, and consequences, Journal of Organizational Behavior, 2022
T. D. Dores Cruz, I. Thielmann et al., Gossip and reputation in everyday life, The Royal Society, 2021.
Par Lara Aknin et Gillian Sandstrom, chercheuses en psychologie, respectivement à l’université Simon-Fraser, au Canada, et à l’université de Sussex, au Royaume-Uni.
On a été proches d’eux, mais on ne leur a plus parlé depuis dix ou vingt ans... On aimerait savoir comment ils vont, peut-être les inviter à prendre un verre. Mais on n’ose pas. Heureusement, une méthode simple vient d’être découverte par des chercheurs en psychologie.
En 2021, les amis les plus célèbres du monde se retrouvent après dix-sept ans d’absence dans l’émission Friends : les retrouvailles.


COMMENT RECONTACTER UN VIEIL AMI ?
Faites l’expérience de faire défiler la liste de vos contacts sur votre téléphone. Combien, parmi eux, n’avez-vous plus appelés depuis dix ans ? Un ami d’enfance qui a eu un bébé, un collègue qui a changé de service, un voisin qui a déménagé : nous avons tous en tête le nom d’une personne qui compte pour nous dans le fond, mais avec qui nous n’avons plus d’échanges depuis longtemps.
Pourtant, les recherches en sciences sociales menées depuis des décennies révèlent l’importance des relations humaines pour notre santé mentale et physique. Pouvoir compter sur au moins une personne en cas de besoin est d’ailleurs considéré comme l’un des principaux indicateurs mondiaux de satisfaction de vie. Logiquement, on pourrait alors s’attendre à ce que les gens fassent tout leur possible pour maintenir leurs liens sociaux. Mais ce n’est pas le cas. Dans un article récemment publié dans Communications Psychology, nous avons comptabilisé le nombre d’individus ayant perdu tout contact avec un ami, et avons évalué dans quelle mesure ils étaient prêts à échanger à nouveau avec lui. Sur sept études au total, menées auprès de plus de 2 400 participants, nous sommes arrivées à la conclusion suivante : les gens sont étonnamment réticents à l’idée de recontacter leur vieil ami.
91 % DES PERSONNES AIMENT EN FAIT ÊTRE RECONTACTÉES
Dans une première étude, nous avons interrogé 441 étudiants canadiens, afn de savoir s’ils avaient perdu contact avec un ami et dans ce cas, s’ils étaient prêts à l’appeler, à lui envoyer un message ou un e-mail dans un avenir proche, et pourquoi pas maintenant. Premier constat : 91 % des sujets interrogés se trouvaient effectivement dans cette situation. Mais ils n’avaient pas de désir particulier de prendre des nouvelles de la personne dans l’avenir, et n’étaient en tout cas pas disposés à le faire tout de suite.
Nous avons alors questionné ces participants sur ce qui les retenait. La majorité craignait surtout que l’ami oublié ne soit pas intéressé par un tel échange, et qu’il s’ensuive une conversation gênante. Pour dire les choses clairement, ils avaient peur de l’importuner. Or, c’est une crainte infondée ; en effet, une récente étude publiée dans le Journal of Personality and Social
EN BREF
£ Le plus souvent, quand l’envie nous prend de contacter un ami de longue date, nous n’osons pas franchir le pas, de peur de le gêner.
£ Pourtant, les enquêtes psychologiques montrent que les intéressés sont très contents quand on le fait.
£ Pour dépasser ce paradoxe, des scientifiques ont mis au point un protocole simple pour nous aider à franchir le pas. Et tous les amis s’en félicitent…
Psychology a montré que les amis que l’on a perdus de vue apprécient que l’on reprenne contact avec eux, et ce bien plus que nous le pensons. De fait, quand les gens ne craignent plus de gêner leur interlocuteur, ils sont tout à fait disposés à raviver ces liens : nous avons demandé à 199 jeunes adultes s’ils préféraient recontacter un ami perdu de vue ou au contraire recevoir des nouvelles de lui sans avoir à faire le premier pas : résultat, ils optaient majoritairement pour le second choix.
Nous avons donc tenté de leur faciliter la tâche, pour voir s’ils étaient alors plus à même de renouer avec leurs anciens camarades. Nous avons demandé à plus de 1 000 personnes de penser à un ancien ami avec qui elles souhaitaient reprendre contact, et qui serait heureux de recevoir de leurs nouvelles. Après nous être assurés qu’elles avaient bien ses coordonnées, nous leur avons laissé quelques minutes pour rédiger un message à son attention. Or, malgré ces conditions favorables, moins d’un tiers encore des participants en ont envoyé un !
Nous avons alors essayé de leur rendre la chose encore plus facile : pour cela, nous avons proposé à une partie d’entre eux d’appuyer simplement sur un bouton « envoyer » sans prendre le temps de réféchir, tandis qu’à d’autres nous avons demandé d’adopter le point de vue de leur
La plupart d’entre nous ont peur d’importuner une personne après des années sans prendre de nouvelles. Mais dans les faits, les amis perdus de vue apprécient d’être recontactés, et ce beaucoup plus que nous le pensons.

ami et de s’imaginer combien il serait content de recevoir un message. Et puis, nous avons tenté de minimiser leur peur du rejet en leur conseillant de ne pas attendre de réponse et de se réjouir tout simplement d’avoir fait preuve de gentillesse. Las ! Aucune de ces démarches n’a été concluante… Les volontaires prêts à reprendre contact avec leur ami n’ont pas été plus nombreux que lors des premières expériences.
POUR NOTRE CERVEAU, L’ANCIENNE COPINE
EST L’ÉQUIVALENTE D’UNE INCONNUE
À ce stade, nous étions complètement déboussolés… C’est alors que nous avons remarqué un fait étonnant : une bonne partie des diffcultés mentionnées par les participants pour reprendre contact avec une vieille connaissance étaient du même type que celles que nous rencontrons pour aborder… un inconnu. Les vieux amis fniraient-ils par devenir, avec le temps, simplement des étrangers ?
Pour tester cette hypothèse, nous avons demandé à 288 individus dans quelle mesure ils auraient été disposés à prendre part à diverses activités quotidiennes, comme ramasser des déchets, prendre un rendez-vous chez le dentiste, écouter une des chansons préférées de leur enfance et, surtout, parler à un inconnu. Et de fait, cette expérience a permis de constater que les gens n’étaient pas plus enclins à recontacter un vieil ami qu’à réaliser diverses actions comme
ramasser des déchets ou engager la conversation avec un quidam dans la rue.
Une conclusion qui peut sembler peu encourageante à première vue, mais qui offre aussi un début de solution au problème, car quelque temps auparavant, un des membres de notre équipe (Gillian Sandstrom) avait élaboré un protocole pour réduire l’anxiété liée aux échanges avec des inconnus. Nous avons donc tenté d’adapter cette approche à notre champ d’étude : les sujets devaient accomplir une « tâche d’échauffement » pendant trois minutes, au cours de laquelle ils avaient pour consigne d’écrire à leurs connaissances et amis actuels. Pendant ce temps, les autres – notre groupe témoin – pouvaient librement naviguer sur les réseaux sociaux.
Puis, nous avons encouragé les deux groupes à contacter un vieil ami. Environ un tiers des personnes du groupe témoin l’ont fait – la même proportion que lors de nos expériences précédentes –contre près de la moitié des participants du « groupe d’échauffement ». Il est probable que répéter plusieurs fois ce comportement rappelle aux gens combien il est simple d’envoyer un message et à quel point il peut être plaisant de communiquer avec ses proches. Alors, parcourez le répertoire de votre téléphone, rédigez d’abord un message à l’attention de quelques amis avec qui vous échangez régulièrement, puis contactez une personne dont vous aimeriez prendre des nouvelles. £
Les études le montrent : nous préférons être recontactés par un ancien ami, plutôt que de faire nous-mêmes le premier pas.
Ce texte est une traduction de l’article « How to reconnect with old friends who have become strangers », publié par Scientific American, le 12 juillet 2024.
L. B. Aknin et G. M. Sandstrom, People are surprisingly hesitant to reach out to old friends, Communications Psychology, 2024.
P. J. Liu et al., The surprise of reaching out : Appreciated more than we think, Journal of Personality and Social Psychology, 2023
G. M. Sandstrom et al., Talking to strangers : A week-long intervention reduces psychological barriers to social connection, Journal of Experimental Social Psychology, 2022.


Docteur en neurosciences, auteur, enseignant et chercheur à l’université de Fribourg, en Suisse.
AIls jacassent, papotent, pérorent sans fin… Comment les réduire au silence ? À côté des explications neuroscientifiques, ce roman de Louis-René des Forêts aide à mieux comprendre la psychologie des incorrigibles pipelettes.
u cœur de la crise du Covid-19, au mois d’août 2020, le professeur Jose-Luis Jimenez, chimiste et spécialiste des maladies infectieuses à l’université de Boulder, au Colorado, s’est illustré par une proposition étonnante : on pourrait venir à bout de cette pandémie, disait-il, simplement… en se taisant. Une fois identifé le mode de transmission privilégié de ce nouveau virus – les gouttelettes d’aérosol émises par la respiration –, il semblait en effet que le respect collectif du silence réduirait ses capacités de contamination, en particulier en association avec le port de masques. Or cette solution, plutôt facile et bon marché, n’a jamais été avancée, ni même suggérée, par aucun gouvernement ni aucune institution sanitaire. On s’est sans doute avisé, à juste titre, des répercussions possibles sur le public, déjà à cran et fortement clivé sur le sujet, si on lui enjoignait de but en blanc à la boucler.
C’est un fait, notre espèce est non seulement douée de parole, mais elle en use amplement.
£ Un individu sur vingt serait un moulin à paroles, atteint de « communication compulsive ».
£ Les causes seraient multiples, du narcissisme conversationnel au défaut d’inhibition corticale. Le personnage du roman de Louis-René des Forêts, datant de 1947, les synthétise.
£ Face à ces individus, la meilleure solution semble être de ne pas leur servir de public.
Dans sa classifcation des fonctions du langage, le linguiste Roman Jakobson avait même avancé les fonctions phatique, poétique et métalinguistique : le langage servirait ainsi, entre autres choses, à parler pour ne rien dire, à jouer avec les mots et à discuter du langage lui-même. Autant dire que nous prenons grand plaisir à jacasser à tort et à travers !
À tel point qu’en 1771, l’abbé Dinouart, un ecclésiastique d’Amiens, publiait L’Art de se taire, jugeant que nombre de ses contemporains tireraient le plus grand bénéfce d’un précis pour apprendre à se tenir coi… Chacun possède dans son entourage certains individus qui, allant bien plus loin que la tendance générale, pourraient être qualifés de bavards impénitents. Ces pipelettes, curieusement, ont peu intéressé les psychologues, qui ont plutôt eu tendance à se soucier du phénomène inverse, les introvertis, taciturnes et timides qui limitent leurs épanchements, et préfèrent même éviter toute situation qui les forcerait à
communiquer. À ce titre, ce sont plutôt les innombrables Art de s’exprimer en public qui remplissent les rayons de librairie, les séminaires de formation et les cabinets de consultation, tant notre culture semble valoriser ceux qui savent prendre la parole, l’exploiter à leurs fns – et surtout, ne plus la lâcher.
UN
Pourtant, la verbosité excessive peut être source de problèmes, voire de souffrances. C’est ce qu’illustre un étonnant roman de Louis-René des Forêts, précisément intitulé Le Bavard. Publié en 1946, retouché par l’auteur en 1963, ce livre n’est rien d’autre que le discours, à la première personne, d’un narrateur qui, pris d’une « sensation d’ennui particulièrement déprimante », se promène seul dans les bois et se trouve soudain saisi par « une exaltation étrange qui se traduisit par un besoin éperdu de prononcer, sur-le-champ, un discours dont je ne m’inquiétais nullement de savoir s’il présenterait quelque cohérence et encore moins
quel en serait le thème ». Mais il est seul à ce moment, aussi cette « agitation » devra attendre, pour s’exprimer, une sortie avec des amis, où aidé par l’alcool il pourra enfn longuement tenir la jambe d’une femme qu’il abreuvera d’un fot ininterrompu de paroles.
Le bavard de des Forêts ne raconte, à vrai dire, rien : tout le texte est consacré à son besoin de bavarder, qu’il doit bien remplir de choses et d’autres. Puisqu’il reconnaît qu’il n’a « positivement rien à dire » et qu’il s’engage dans « un ridicule et futile monologue », sa solution pour épancher son besoin de parler et de se « soulager » est simple : « Je parlerais de mon besoin de parler. » Mais quelle est sa motivation ? Dans le roman, l’ambivalence domine. Le bavard semble avoir besoin d’être écouté, mais il affrme se contenter d’une simple présence. Cela ne l’empêche pas de s’en référer sans cesse aux réactions possibles de ses auditeurs, comme s’il discourait avec lui-même en répondant à ses propres questions.
Je présume qu’il est arrivé à la plupart d’entre vous de se trouver saisi au revers de la veste par un de ces bavards qui, avides de faire entendre le son de leur voix, recherchent un compagnon dont la seule fonction consistera à prêter l’oreille sans être pour autant contraint d’ouvrir la bouche ; et encore, il n’est pas sûr que cet importun exige qu’on l’écoute, il su t qu’on se donne un air intéressé soit en opinant de temps à autre d’un signe de tête ou d’un léger murmure que les romanciers appellent justement approbateur, soit en soutenant vaillamment le regard insistant de ce pauvre diable, malgré l’extrême fatigue que ne manquera pas de produire une telle tension musculaire. Examinons de près cet homme. Qu’il éprouve le besoin de parler et pourtant qu’il n’ait rien à dire, et plus encore, qu’il ne puisse assouvir ce besoin sans la complicité plus ou moins tacite d’un compagnon qu’il choisit, s’il en a la liberté, pour sa discrétion et son endurance, voilà qui mérite réflexion. Cet individu n’a strictement rien à dire et cependant il dit mille choses […]. Tout se passe comme s’il était atteint d’une a ection à laquelle il serait impuissant à apporter un remède […]. Eh bien, j’ose dire, sans préjudice de la défection instantanée et massive de lecteurs à laquelle cet aveu m’expose, que j’appartiens précisément à cette espèce de bavards.
Le Bavard, Louis-René des Forêts, 1947 (renouvelé en 1963), Gallimard (L’Imaginaire), pp. 11-12.
Bien que conscient que son volume de parole est excessif, et même pathologique, par moments il s’en défend et affrme que tout le monde fait pareil : « C’est entendu, je suis un bavard, un inoffensif et fâcheux bavard, comme vous l’êtes vousmêmes. » Jusqu’à demander à ses lecteurs : « Qui n’a pas eu, au moins une fois, envie d’élever la voix, non pas dans l’intention raisonnable de charmer un auditoire ou avec la prétention de l’instruire, mais plus simplement pour satisfaire son propre caprice ? »
Les psychologues parlent de « communication compulsive », de « verbosité hors cible » et même de talkaholism , manière d’assimiler la parlote à un type d’addiction. Et de fait, il est des pathologies qui amènent à parler sans arrêt. Ainsi, certaines épilepsies s’accompagnent d’un discours incessant focalisé sur des détails infmes. Des lésions du lobe frontal conduisent quant à elles à une volubilité familière, se manifestant par exemple par des jeux de mots et des blagues répétées. L’aphasie de Wernicke produit une loquacité excessive, mais sous la forme d’un jargon incompréhensible, dont le sens échappe aux patients eux-mêmes. Et naturellement, diverses substances, dont l’alcool, provoquent des intoxications cérébrales qui « libèrent » un peu trop la parole… Des processus neurocognitifs particuliers pourraient ainsi être associés au bavardage incontrôlé. Le bavard de des Forêts se présente luimême comme un cas relevant de la médecine. Au premier chef, on peut postuler un défcit d’inhibition, qui a fait l’objet de plusieurs études dans le cadre de la verbosité hors cible souvent attribuée aux personnes âgées. Il s’agit des péroraisons autocentrées et décousues qu’on qualife souvent de « radotage ». Pourtant, rien n’indique qu’il s’agisse là spécifiquement d’un signe de déclin
cognitif. Les personnes âgées particulièrement bavardes se distinguent plutôt par une personnalité extravertie de longue date, liée à l’anxiété de vieillir, ce qui les pousse à évoquer sans fn leur propre vie comme pour mieux maintenir la constance de leur identité. Les bavards plus jeunes, eux, s’épanchent à toute occasion sur n’importe quel sujet.
COMMUNICATION COMPULSIVE
C’est dans ce dernier registre qu’a été développé le concept de « communication compulsive », ou talkaholism Pour les chercheurs James McCroskey et Virginia Richmond, de l’université de Virginie-Occidentale, les « moulins à paroles » se caractérisent par le fait qu’ils ont conscience de leur bavardage excessif, mais ne peuvent s’en empêcher, même si ce comportement leur pose souvent de sérieux problèmes – moqueries, rejet, violence… Ils se trouvent plutôt doués pour cela, adorent débattre et partager leurs idées, mais toujours de la même façon en toutes circonstances. Ce qui les rend plutôt faciles à identifer. Une des premières études avait simplement demandé à des étudiants s’ils connaissaient quelqu’un qui « parle trop », et s’ils seraient d’accord pour donner ses coordonnées aux chercheurs. Ceux-ci aboutirent à une liste de 28 individus, dont il était immédiatement clair qu’ils étaient bien des parleurs compulsifs. En effet, dès la première prise de contact au téléphone, et ce alors qu’ils ignoraient pourquoi des chercheurs universitaires s’intéressaient à eux, ils « produisaient un fot continu de verbalisation » et ne voulaient pas raccrocher (prévus pour fxer un simple rendezvous au laboratoire, ces appels durèrent plus de trente minutes). Une fois sur place, après avoir rempli différents questionnaires, ces participants restèrent longuement dans les locaux à bavarder, y compris dans les couloirs et les escaliers.
On estime qu’une personne moyenne prononce environ 16 000 mots par jour, cette extrapolation étant obtenue en analysant
Pourquoi j’ai aimé ce livre

Encensé par ses collègues écrivains, Louis-René des Forêts (1916-2000) est resté méconnu du grand public. Rien d’étonnant pour un auteur discret et fasciné par le silence, au point de consacrer son œuvre la plus connue, Le Bavard, à l’inutilité du langage. Parole vaine, creuse, vide, entièrement centrée sur elle-même, génératrice de tourments et de malentendus… ce roman semble anticiper notre époque où règnent le bullshit, la propagande et même le langage artificiel. Réduit au silence après la mort tragique de sa fille, un drame dont il ne s’est jamais remis, des Forêts nous rappelle qu’il y a parfois du courage, et même de la grandeur, à se taire.
Sebastian Dieguez
Bibliographie
R. Bostrom et N. Harrington, An exploratory investigation of characteristics of compulsive talkers, Communication Education, 1999.
C. Leaper et M. Ayres, Personality and Social Psychology Review, 2007
J. McCroskey et V. Richmond, Identifying compulsive communicators : The talkaholic scale, Communication Research Reports, 1993.
A. Vangelisti et al., Conversational narcissism, Communication Monographs, 1990.
des enregistrements de 30 secondes espacés d’une douzaine de minutes obtenus auprès de volontaires qui portent un magnétophone automatisé et discret pendant quelques jours. Contrairement à un préjugé tenace, hommes et femmes sont logés à la même enseigne. Mais comment trouver le juste milieu ? D’un côté, on attend des gens qu’ils s’expriment et on valorise même ceux qui le font facilement (jusqu’à un certain point, les bavards sont considérés comme compétents, fables et infuents, et assimilés à des « meneurs ») ; et de l’autre, trop parler renvoie également une image négative. Les bavards sont perçus comme irritants, imbus de leur personne, trop sûrs d’eux et inattentifs aux besoins d’autrui. Au point qu’on fnit par les fuir.
QUEL MANQUE D’IMAGINATION ! « N’est-ce pas fou de risquer sa réputation, de s’exposer aux sarcasmes pour la seule volupté de bavarder ? », se demande avec lucidité le bavard de des Forêts. Cette « volupté », cette jouissance à « se vider », dit encore notre personnage, est évocatrice du « narcissisme conversationnel », étudié par la spécialiste en communication Anita Vangelisti. Chacun reconnaîtra ces situations où un interlocuteur ramène toujours la discussion à luimême, monopolise les tours de parole, interrompt ou ignore les propos d’autrui, dévoile des choses trop intimes et commence chaque phrase par « moi, je ». Parler pour ne rien dire, n’est-ce pas tenter de combler un vide au sein de sa propre identité ? Sur ce point, notre bavard est étrangement lucide : « Si j’avais quelque imagination, j’en serais réduit à parler de tout autre sujet que de moi-même… » De quoi inspirer un peu de clémence pour les insupportables moulins à paroles qu’il faut bien subir à un moment ou à un autre. Et c’est sans parler des graphomanes qui noircissent des pages sur des sujets d’un intérêt parfois limité. £
Les composés psychédéliques comme le LSD ou la psilocybine provoquent une désynchronisation des neurones qui dissout la frontière entre le monde et soi, ce qui se traduit généralement par une forte expérience de type mystique.
L’expérience du flow (se sentir totalement absorbé par ce qu’on fait, à la fois relâché et concentré) serait associée à une activité réduite des lobes frontaux qui contrôlent nos actions. Signe que le flow correspondrait à un état de lâcher-prise plutôt que d’hyperfocalisation.
Pour la spécialiste en communication Anita Vangelisti, la communication compulsive, tendance à parler sans arrêt au détriment de ses interlocuteurs, est une forme de narcissisme qui s’exprime par voie verbale. Le parleur compulsif ramène toujours la discussion à lui-même, monopolise les tours de parole, interrompt ou ignore les propos d’autrui, dévoile des choses trop intimes et commence chaque phrase par « moi, je »…
« Ça a duré des mois. J’ai pensé mettre fin à mes jours si personne ne venait rapidement à mon secours. » Simone, atteinte de démangeaisons chroniques
des gens conservent des facultés cognitives presque intactes après 77 ans (hors cas de démence ou de maladie neurodégénérative).
Entendre un gazouillis d’oiseau active le système nerveux parasympathique, qui ralentit les battements cardiaques, diminue la pression artérielle, les taux de cortisol et le stress. Ces sons entraînent une détente musculaire et apaisent le pouls plus e cacement que ne le fait la musique classique.
C’est la fréquence de la voix considérée comme la plus sexy chez une femme. Les voix plus aiguës sont de moins en moins attirantes à mesure qu’on monte vers les ultrasons. À l’inverse, plus la voix est grave, plus la personne est considérée comme dominante et apte à diriger…
des personnes aiment recevoir un appel d’un ami qu’elles n’ont plus vu depuis très longtemps. En revanche, elles ne seraient pas prêtes à faire le premier pas…













• Le magazine (11 numéros / an)


















Cet encart d’information est mis à disposition gratuitement au titre de l’article L. 541-10-18 du code de l’environnement. Cet encart est élaboré par CITEO.
