













De Facto, Selma Doborac
Retour du représenté, Patrick Holzapfel
Losing Faith, Martha Mechow p.18
Un anarchisme de vilain petit canard, Laura Staab p.20
Entretien avec Martha Mechow par Claire Lasolle p.24
La Force diagonale, Annik Leroy & Julie Morel p.36
La part de l’histoire tournée vers la terre, Patrick Holzapfel p.38 Documents p.41
Le Sentier des asphodèles, Maxime Martinot p.60
Le chemin qui mène, Mathilde Girard p.62
Histoire de la révolution, Maxime Martinot p.65 Documents p.66
MarÍa Aparicio : Las Calles, Sobre las nubes, Las cosas indefinidas p.74
Histoires de solitudes et de communauté, Louise Martin Papasian p.76
Entretien avec MarÍa Aparicio par Louise Martin Papasian p.80 Documents p.91

Man in Black / Process
Sur Man in Black de Wang Bing
Par Caroline Champetier
Soif de Reality
Sur Reality de Tina Satter
Par Adrian Martin
Quelque chose qui toujours se transforme
Sur Trenque Lauquen de Laura Citarella
Par James Lattimer
« T’as quel âge ? »
Sur Le Gang des Bois du Temple de Rabah Ameur-Zaimeche
Par Cyril Neyrat
L’Amour fou, ou le complot de l’actrice pour en finir avec son propre rôle, et le metteur en scène
Sur L’Amour fou de Jacques Rivette
Par Mathilde Girard
p.100

Comme ça me chante
Sur quelques films d’Ignacio Agüero
Par Cyril Neyrat
p.114
Légendes des documents
p.124
Biographies des auteurs
Crédits
p.130
p.140
Livret des textes en version originale
Hervorgeholtes vergegenwärtigt, Patrick Holzapfel
De Facto, Selma Doborac
Ugly Duckling Anarchism, Laura Staab
Losing Faith, Martha Mechow
Die erdzugewandte Seite der Geschichte, Patrick Holzapfel
La Force diagonale, Annik Leroy et Julie Morel
Reality Hunger, Adrian Martin
Reality, Tina Satter
Something That Becomes Different All the Time, James Lattimer
Trenque Lauquen, Laura Citarella
A Genre of Its Own, Giovanni Marchini Camia
The Temple Woods Gang, Rabah Ameur-Zaïmeche
p.144
p.172
p.174
p.176
p.177
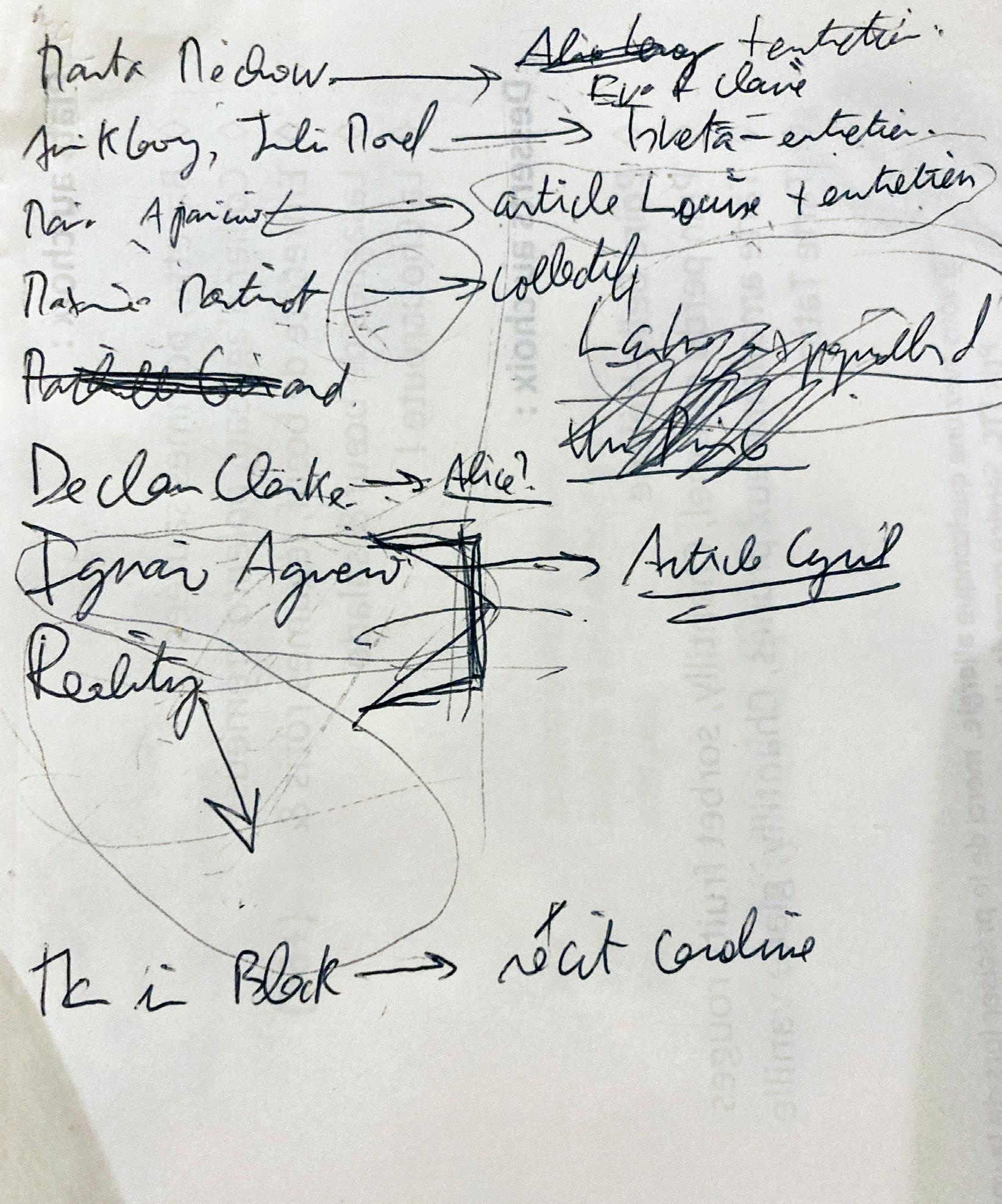
Fidback est une nouvelle revue de cinéma éditée par le FIDMarseille. Chaque année, elle dessinera une image-constellation du cinéma aimé et défendu par le festival.
Une image, parmi une multitude de possibles. Une constellation, car c’est au lecteur de faire l’image en tirant des traits à partir des échos entre les films, entre les textes.
Cette revue concrétise un parti pris premier du FIDMarseille : être un lieu et un acteur critique pour le cinéma qui vient. Critique, et non théorique, car il nous semble que le cinéma a aujourd’hui moins que jamais besoin de théorie, et plus que jamais de critique. Au sens d’une puissance d’élection et d’attention, d’un goût passionné pour la singularité des voix, des gestes, d’un engagement au côté des exceptions contre les règles. Au sens d’écritures portées par le souci d’éclairer et partager des singularités. C’est pourquoi la couverture de Fidback n’annonce que des noms, pas d’idées ni de tendances.
Trois retours composent le sommaire de chaque numéro :

Retour sur la dernière édition du festival, condensée en 5 films issus de la sélection officielle.

Retour sur la dernière année de cinéma, en 5 films choisis dans l’actualité mondiale, que nous voulons inscrire dans la même constellation.

Retour sur l’œuvre d’un ou d’une cinéaste dont le FID accompagne le travail, endehors de toute actualité.
Ce numéro zéro revient sur 2023 — l’édition du FID et l’année de cinéma. Les prochains numéros paraîtront au printemps de chaque année, dès 2025.
Quant aux auteurs, nous avons sollicité des critiques et écrivains français et internationaux, ainsi que des membres du comité de sélection du FID. Les cinéastes nous ont confié leur parole ainsi que des documents et matériaux inédits.
Les textes non-francophones sont disponibles en version originale à la fin de la revue. Un film fait l’objet de deux textes distincts : Le Gang des Bois du Temple, de Rabah AmeurZaïmeche.
Aux revers de la couverture figure un document : le montage, par Annik Leroy et Julie Morel, d’un texte écrit et prononcé par Hannah Arendt en 1955, « Le désert et les oasis ». Il est au cœur de La Force diagonale, film auquel nous consacrons un ensemble dans ce numéro. Arendt y affirme ceci : résister n’est pas s’adapter à un monde invivable mais faire usage de sa passion de vivre et de sa faculté de juger pour transformer le désert en un monde habitable. Programme plus que jamais d’actualité.







Patrick Holzapfel
A près avoir débité d’un souffle pendant plusieurs minutes des récits à la première personne des crimes les plus atroces, Christoph Bach, l’interprète, marque soudain une imperceptible pause pour déglutir. Tel est notre lot, à nous humains, nous n’y pouvons rien. Il nous faut déglutir. Son corps n’y tient plus, les réflexes musculaires de sa gorge sont plus impérieux que ce qu’il veut dire. La caméra, imperturbable, reste braquée sur lui. Nous le regardons parce que nous ne pouvons faire autrement, tout comme nous l’avons écouté, parce que nous sommes ses auditeurs. La déglutition ne dure qu’une seconde, un beat comme on dit au théâtre, à ceci près qu’ici il n’est pas question de rythme et qu’on attend rien moins qu’une réaction du public. Puis Bach continue d’aligner avec une froide clarté ce que l’on reconnaît être des extraits de récits de coupables, des témoignages ou des discussions philosophiques sur la violence. Il raconte les forfaits commis, classe, justifie, touche aux limites de la morale. Nous l’écoutons encore. On ne peut qu’écouter ou s’enfuir. Et Bach continue de parler. Son corps sert le texte, s’abandonne à la morne succession de mots glaçants et l’on en vient à se demander ce qui se passe dans un corps qui prononce ces mots, ce qui reste du langage sur une langue.
Il est assis dans un pavillon baigné de lumière dans le parc du château de Pötzleinsdorf, Vienne, 18e arrondissement. Sigmund Freud y passait ses vacances d’été, mais ça ne joue ici aucun rôle. La psychologie ne joue aucun rôle, du moins pas celui qu’elle a l’habitude de jouer quand le cinéma se confronte aux criminels de guerre et à leurs meurtres. Dans De Facto, Selma Doborac a autre chose en tête : son film est une étude cinématographique, si ce n’est théâtrale, physique, de la présentification, soit l’exact opposé du refoulement. Elle ose pousser la réflexion là où se sont arrêtés les grands cinéastes qui ont cherché à représenter l’irreprésentable. Et elle montre que, de fait, toutes les questions n’ont pas encore trouvé de réponse.
De Facto montre qu’on n’a cessé de contourner les pièges habituellement tendus par le traitement de l’inhumanité. Son film présuppose moins une compréhension (voire une identification) des coupables ou des événements qu’une pensée structurelle qui cherche à comprendre comment pensent et argumentent les coupables ou, pour le dire tout net, comment on pourrait penser le mal.
La présentification se déploie sur trois niveaux qui partagent une façon inconditionnelle de rendre présent :
A – au niveau du contenu et des textes par lesquels a lieu la confrontation avec les coupables et leurs crimes (remémoration)
B – au niveau des corps qui pratiquent ou représentent cette présentification
C – au niveau du travail cinématograhique sur le temps
Dans le pavillon, Bach n’est pas seul assis à la table en verre. Sur les sept plans du film, il apparaît trois fois. Face à lui (ou du moins à la même table, les perspectives ne permettent pas de l’affirmer avec certitude) est assis l’interprète Cornelius Obonya. Lui aussi parle trois fois. Tandis que les deux parlent, le jour passe, la lumière décline, le vent se lève. Ils ne se parlent pas vraiment, ne sont jamais dans le même plan. Tous deux sont là pour ne pas que l’on associe un visage ou une voix aux crimes. Ce ne sont que des corps, et même cela n’est pas certain. Le film fonctionne un peu comme un dialogue platonicien ou une pièce de Samuel Beckett : on parle dans le vide, mais ce vide est la réalité, le présent ; le vide, c’est nous qui écoutons. La notion ressassée de témoignage gagne en extension chez Doborac : non seulement ceux qui rapportent leur récit témoignent de quelque chose, mais nous attestons de ce qu’ils disent. À quelques exceptions près (comme la déglutition du début), cette forme de représentation échappe à la force tentatrice des images. Ici, pas de remords, pas de supériorité affichée, pas d’éléments physiques en
capacité de nous distraire, comme cela ne manque pas d’arriver avec par exemple les images du procès de Nuremberg. Ici, une réduction à l’os nous barre les habituels échappatoires.
Les textes viennent de documents plus ou moins connus que la cinéaste a condensés. Nous entendons des versions retravaillées de déclarations de criminels nazis à leur procès ou d’écrits de soldats. Ce qui intéresse Doborac, c’est moins une approche scientifique des sources qu’une vérité extraite du matériau de la langue, de ce qui traverse et relie les textes les plus divers, tirés d’époques et de contextes culturels variés. Dans le dernier plan, on voit le pavillon à une certaine distance, dans les herbes brun doré d’un parc, une musique bruitiste en fond. Est-ce une invitation à reprendre son souffle ou un basculement définitif dans l’horreur absolue ?
Sur le fond, la confrontation avec les coupables et leurs crimes se fait ici par une approche pour le moins audacieuse : Doborac empêche de déterminer clairement qui sont les auteurs de ces déclarations. Qu’il s’agisse de criminels nazis, d’Anders Breivik ou de soldats américains, le film laisse toutes les expériences que véhiculent ces textes et ces déclarations couler en une seule expérience, un courant dans lequel elle nous jette. Plutôt que de se livrer à l’exercice intellectuel traditionnel consistant à séparer nettement les différents événements historiques, elle cherche ce que toutes ces choses pourraient avoir en commun, quelque chose comme un langage universel des coupables. On pourrait imaginer pareille démarche chez une IA, mais dans De Facto, ce sont les années de recherche de Doborac qui rassemblent ce qui, séparément, pourrait continuer à être traité avec les mêmes formules dans un espace sous vide.
C’est une étape nécessaire pour le cinéma, car ce qui est dit et peut être dit se déplace avec le temps. À cela s’ajoutent les nouveaux anciens crimes. Le cinéma a besoin de voies
qui s’adaptent, pas de certitudes. La comparaison entre différents crimes, souvent utilisée dans les discours politiques, prend le risque de faire fausse route. Elle ne mène souvent à aucune connaissance, elle sert plutôt à stigmatiser, pour preuve les nombreuses comparaisons avec l’Holocauste. Ce sont des arguments massue qui tombent à plat, extirpent les véritables crimes de leur temporalité, pointent un degré de violence mais pas ce qui se passe réellement ni même comment on pourrait l’empêcher. Doborac entend ici faire l’inverse : non pas comparer mais penser ensemble. Pourrait-on parler d’un espoir utopique ? Si nous pouvions comprendre ce que tous ces coupables ont en commun, pourrions-nous, à l’avenir, les empêcher de commettre leurs forfaits ?
Or, il est strictement impossible de relier ces actes commis dans des contextes différents, car Doborac nous soumet à un tel flot de paroles et de pensées qu’elle ne donne jamais l’impression de créer des personnages qui représentent quelque chose. Aucun de ses interprètes ne livre le coupable ultime. Son protagoniste est plutôt le langage lui-même, ce qui est dit, qui ne permet plus ici de tirer de simples conclusions sur ce qui est dit. C’est donc à nous qu’incombe le travail sur le contenu. Le film nous mettant consciemment à l’épreuve, on se met à filtrer. On s’abandonne ou on se réfugie en soi-même, on reste attentif ou non.
Qu’entend-on ?
Des mutilations, des viols. Que peut-on supporter ? Le film interroge ainsi les mécanismes derrière le travail de mémoire exigé comme un mantra dans les cultures occidentales. Ce n’est pas le simple fait de se souvenir, de présentifier, qui est décisif, mais aussi la manière dont cela se produit. Quand la politique mémorielle historicise ses objets, elle devient obsolète. En ne dévoilant pas ses sources, en ne nous permettant donc jamais de savoir de quelles atrocités il est question, Doborac réintroduit une inquiétude foncière dans l’acte d’écouter. En général, un public
cultivé fait des associations aussitôt qu’il entend parler de l’Holocauste, de la guerre de Bosnie ou des Khmers rouges. Il interprète le dit à l’aune de connaissances préalables. Quand cette certitude s’évanouit, l’on doit faire face à ce que l’on entend et voit, et non à ce que l’on sait ou croit savoir. Il va sans dire qu’il ne s’agit pas d’une procédure standard à recommander pour le travail de mémoire, mais plutôt d’une approche authentiquement cinématographique pour rendre compréhensible quelque chose qui autrement se dérobe. Le court-circuit intellectuel est contourné, ne reste que l’aberrante complexité des êtres humains.
Mais Doborac ne montre pas d’êtres humains. Ils n’existent chez elle qu’en texte. Les interprètes sont autre chose, on pourrait les qualifier de corps textuels. Le corps de l’acteur est ici considéré comme un instrument de présentification. Les limites de la représentation ou de la non-représentation apparaissent à travers ces deux interprètes, que l’on n’a pas l’habitude de voir au cinéma ou à la télé sur des sujets aussi sérieux.
Car un corps humain est toujours un point de repère. Peu importe la vitesse, la monotonie et le détachement avec lequel on dit des textes, ils s’humanisent. La distance entre la réalité du tournage et les mots dits s’abolit. En ce sens, De Facto est aussi un document de non-interprétation, d’évitement absolu de ces émotions qui détournent de ce qui est dit. Ce document indique un possible échec, car la déglutition entre les phrases, le rajustement de l’assise, le petit geste de main, tout cela contrecarre la neutralité des textes, produit de la personnification sous nos yeux. Mais la contradiction n’est qu’apparente, car ici l’accent n’est pas mis sur celui qui parle mais sur notre rencontre avec lui. Dans le hors-champ se dissout le diktat de la représentation. Les frontières de l’indicible se fondent avec celles de l’irreprésentable. Si l’on pense aux fameuses représentations
de coupables au cinéma, comme Bruno Ganz en Adolf Hitler dans La Chute ou plus récemment Christian Friedel et Sandra Hüller dans les rôles du chef de camp de concentration et de son épouse dans La Zone d’intérêt , on constate que l’obsession de la ressemblance et de l’authenticité ne reflue pas. Mais qu’est-ce qui devient vraiment visible lorsque quelqu’un ressemble, roule la langue ou se peigne comme tel ou tel coupable ? Les personnes qui jouent ne disparaissent-elles pas derrière leurs personnages ? Ne voyons-nous pas toujours la même chose, à savoir que le bourreau est un être humain ? Les interprètes ne devraient-ils pas s’interposer entre les coupables et nous pour nous faire comprendre quelque chose de l’essence du crime ?
Dès que l’on croit être en présence d’un personnage dans De Facto, celui-ci s’évanouit. C’est dû au fait que la caméra statique et les longs plans fixes n’enregistrent pas une parfaite reconstitution, mais l’acte même de parler (y compris les bégaiements, les petites erreurs, etc.). Ce que l’on voit donc exclusivement, ce sont Christoph Bach et Cornelius Obonya, deux interprètes qui disent le texte au présent. Ce sont eux qui nous transmettent le texte. D’où la question de leurs corps, de ce qui leur arrive quand ils disent ce texte. Cette question peut sembler un peu naïve pour un acteur professionnel, mais c’est ce que les interprètes partagent ici avec nous : le vécu de ce texte. Et non l’interprétation d’un passé ou l’identification à une pensée.
Pendant que les interprètes monologuent, une journée passe. La lumière change. On entend régulièrement des bruits environnants, on aperçoit de petits mouvements en arrière-plan. C’est justement parce qu’un vent souffle à la cime des arbres, tandis que résonnent les paroles des coupables, que la présence et la simultanéité se révèlent être une force d’expression cinématographique. Ces récits de viols et de meurtres ainsi que leur catégorisation
philosophico-psychologique appartiennent à la même réalité que les nuages qui passent. Zéro chance de refouler, pas de pause pour respirer, de possibilité de s’évader ou d’astuces dramaturgiques pour rendre digeste ce qui devrait nous faire vomir. Juste une brève déglutition de l’interprète, une limite physique pour un abîme psychologique. Même la musique finale est du bruit. C’est un état qui est montré ici, pas une histoire. Pour le dire autrement : plus que d’enregistrer, de conserver la langue des crimes passés, il s’agit pour Doborac de rendre compte, dans un dispositif abstrait qui échange néanmoins avec la réalité, de ce que l’on ne peut pas archiver aussi facilement en tant qu’histoire. Ou plus simplement encore : ce film peut être apposé comme un pochoir sur des génocides, des crimes de guerre ou des discours de dictateurs. Il contient une vérité persistante. Le film travaille à l’appréhender. C’est à nous qu’il reviendrait d’y mettre un terme. Le fait que l’on ne fasse l’expérience de la temporalité évoquée par le film que si l’on s’abandonne à la durée complète (aussi bien d’un plan que du film entier) est presque un anachronisme à notre époque. Écouter est un anachronisme. Mais en même temps, c’est justement cet abandon qui rappelle la force singulière du médium. En écoutant, on fait soi-même l’expérience physique de ce que signifie prendre conscience de ce dont les êtres humains sont capables.
Et pourtant, se demande-t-on, à quoi bon tous ces mots, ce flot de violence remâchée ? Peut-être y a-t-il dans le silence qui succède au film une paix valant la peine d’être défendue.
Traduit de l’allemand par Christophe Lucchese




01:53:37,000 → 01:53:39,875 Il est remarquable que des idées folles soient populaires partout –
01:53:40,000 → 01:53:43,125 des idées dominantes intemporelles, partout, pas seulement chez les jeunes ;
01:53:43,625 → 01:53:45,625 pense simplement à la poésie, par exemple,
01:53:45,667 → 01:53:48,292 aux concepts poétiques et aux images de nouveauté,
01:53:48,375 → 01:53:50,542 pureté, liberté, particularité,
01:53:50,542 → 01:53:53,292 qui remontent à des millénaires et traversent toutes les cultures ;
01:53:54,042 → 01:53:56,542 la poésie a toujours joué un rôle prophétique, créatif,
01:53:56,542 → 01:53:59,167 et presque constitutif du monde ;
01:53:59,417 → 01:54:02,917 les poètes populaires ont toujours inventé des scénarios
01:54:03,042 → 01:54:06,667 fantaisistes qui sont traditionnellement toujours devenus réalité,
01:54:06,667 → 01:54:08,500 c’est comme ça que ça marche ;
01:54:08,625 → 01:54:11,792 il ne s’agit donc pas tant de poésie, que de vérité pure ;
01:54:11,917 → 01:54:15,042 ce n’est pas spécifique à ta culture, il en a toujours été ainsi,
01:54:15,125 → 01:54:17,417 dans chaque culture et de tout temps ;
01:54:17,417 → 01:54:22,625 ou pense aux innombrables histoires qui se produisent sur des places désertes,
01:54:22,750 → 01:54:24,542 ou aux chansons populaires sur les places
01:54:24,667 → 01:54:28,125 “et devant de magnifiques bâtiments dans des villes fantastiques imaginaires
01:54:28,167 → 01:54:31,042 (encore des chansons, tu dis : des chansons et de la poésie –
01:54:31,167 → 01:54:33,792 la poésie est le fondement de ce monde) ;
01:54:34,125 01:54:37,250 des places, des lieux, des terrains pas prévus pour les gens,
01:54:37,292 → 01:54:40,417 mais conçus comme des espaces fantastiques et des lieux de triomphe,
01:54:40,500 → 01:54:42,792 et comme de prétendues reliques de l’histoire ;
01:54:42,875 → 01:54:45,042 non pas voués à laisser les gens y vivre,
01:54:45,042 → 01:54:46,875 mais plutôt à les y laisser mourir,
01:54:46,917 → 01:54:50,042 pour créer une histoire qui n’a jamais existé –
01:54:50,542 → 01:54:51,875 regarde l’histoire ;
01:54:51,917 → 01:54:54,542 elle a été naturalisée au cours des millénaires,
01:54:54,625 → 01:54:57,375 c’est l’histoire de l’homme, de son accession à la culture,
01:54:57,417 → 01:54:59,167 à l’humanité, de son accomplissement ;
01:54:59,292 → 01:55:00,917 quiconque peut étudier ça partout ;
01:55:01,042 → 01:55:03,167 regarde, par exemple, les pays les plus pauvres aujourd’hui :
01:55:03,292 → 01:55:06,917 façades bas de gamme en polystyrène, plastique partout, pseudo-classicisme –
01:55:06,917 → 01:55:08,250 c’est grossier,
01:55:08,375 → 01:55:11,417 mais c’est exactement ça l’histoire et c’est ainsi qu’elle suit son cours ;
01:55:11,542 → 01:55:12,792 aujourd’hui comme hier,
01:55:12,917 → 01:55:15,417 sont érigées des maquettes monumentales, chargées de symboles,
01:55:15,542 → 01:55:18,792 dans les murs (façon de parler, car ce sont des couches
01:55:18,792 → 01:55:20,292 de sable et de polystyrène) desquelles
01:55:20,417 → 01:55:25,667 l’inédit, à savoir l’“histoire”, est ciselé et modelé à juste titre.
01:55:25,792 → 01:55:28,417 Et quand tu repenses à toutes les idées fictives
01:55:28,417 → 01:55:31,417 et aux constructions fictives que tes contemporains et toi
01:55:31,500 → 01:55:34,875 avez intellectuellement créées (oui, créées à partir de rien –
01:55:34,917 → 01:55:37,375 tu parles de poésie et de vérité),
01:55:37,417 → 01:55:40,042 tu t’inquiètes alors de l’ampleur de la folie,
01:55:40,042 → 01:55:41,917 de votre folie à tous ;
01:55:42,792 → 01:55:45,750 aujourd’hui, les événements se présentent à toi sous un jour très différent –
01:55:45,792 → 01:55:49,000 “Les événements apparaissent soudain sous un jour très différent” ;
01:55:49,792 → 01:55:51,167 tout se révèle à toi
01:55:51,292 → 01:55:54,000 comme si quelqu’un t’avait soudain dessillé les yeux
01:55:54,125 → 01:55:56,167 et que tes sens étaient descellés –
01:55:56,167 → 01:55:57,375 Acédie, adieu ;
01:55:57,417 → 01:55:59,917 tu vois clair –c’est ce que tu entends par là ;
01:56:00,167 → 01:56:02,917 naguère — oui, dis ça comme ça même si c’est un bien grand mot –
01:56:03,042 → 01:56:04,667 naguère, tu étais comme scellé,
01:56:04,792 → 01:56:07,167 tu n’étais pas libre de voir la folie fiévreuse
01:56:07,250 → 01:56:10,417 de ces idées tordues, encore moins de l’interpréter,
01:56:10,500 → 01:56:12,167 car ton cœur était paresseux ;
01:56:12,250 → 01:56:13,542 mais désormais tu es libre
01:56:13,542 → 01:56:16,375 et désormais, les interprétations fondent sur toi.
01:56:16,417 → 01:56:17,500 Et :
01:56:17,542 → 01:56:19,917 Qu’est-ce qui est resté ? –le langage
01:56:20,000 → 01:56:22,292 et un autre chapitre imbécile d’un rêve dévoyé
01:56:22,375 → 01:56:24,042 fait par des masses de gens,
01:56:24,125 → 01:56:26,292 qui doit être interprété encore et encore ;
01:56:26,375 → 01:56:28,250 par nature, celui-ci aussi,
01:56:28,292 → 01:56:30,667 n’aura jamais été que le travail d’un rêve et,
01:56:30,667 → 01:56:32,292 comme toutes les autres confusions,
01:56:32,292 → 01:56:34,792 il sera toujours resté l’imagination utopique
01:56:34,792 → 01:56:37,167 de quelques fous, c’est-à-dire de nous tous.





Mechow
Laura Staab
Je ne sais pas comment le désirer pleinement, mais j’ai hâte de voir ce qui viendra après la famille.
Sophie Lewis, Abolir la famille (2022)
Vous entendez parler d’une jeune cinéaste d’à peine trente ans qui vient de faire un film sur l’abolition de la famille. Martha Mechow, la nouvelle venue en question, est arrivée à la réalisation par le biais de l’écriture et de la mise en scène au sein de la Völksbuhne, une institution berlinoise connue pour avoir toujours rompu avec la tradition et proposé aux masses du théâtre d’avant-garde. Elle a fait ses débuts sous le nom de Martha von Mechow, mais la particule « von » (signe de ses origines nobles) a désormais disparu. À quoi ressemble un film de Martha Mechow sur l’abolition de la famille ? La réalisatrice ne peut qu’adh érer totalement à ce sujet radical, avec son geste séditieux et ses connotations gauchistes. Sûr de votre fait, vous vous dites que le film doit certainement rejeter la famille et autres liens hétéronormatifs : il doit appeler de ses vœux d’autres façons de vivre et d’aimer, et attendre avec enthousiasme l’avènement de cette ère nouvelle.
Losing Faith s’ouvre sur une nuit froide et sombre dans un appartement de Berlin. Des remerciements émanent de la télévision :
« … et ma mère, » s’exclame avec émotion une fille reconnaissante à l’accent américain.
« … tu as dû faire tant de sacrifices ! » Ce cri du cœur contraste avec ce que voit le spectateur. Si la gentille fille à la télévision était capable de prendre le pouls de son auditoire, elle comprendrait que le temps du sacrifice maternel et de la gratitude filiale est révolu. Face à l’écran, une mère est étendue sur le canapé, dans un état de profonde lassitude. Tandis qu’un tout-petit est apaisé par le va-et-vient de sa balancelle, sa grande sœur dessine sur une petite table.
« Maman, regarde », exhorte l’artiste en herbe.
« Maman, regarde, par ici, vite. Maintenant ! Maman ! Maman ! Maman ! » Mais maman ne regarde pas par ici, vite, maintenant. Au lieu de cela, elle marmonne quelque chose sur le sort enviable de la moquette inerte. Puis soudain elle disparaît, elle se volatilise, comme si le néant était préférable à sa condition.
Sophie Lewis, éminente théoricienne de l’abolition de la famille, dit avoir « hâte de voir ce qui succèdera à la famille 1 . » Le premier film de Mechow porte un regard sans naïveté sur la question : sans coordination, c’est le chaos qui succèdera à la famille. Dans la scène qui suit la disparition de la mère, les enfants livrés à eux-mêmes se rassemblent dans une frénésie de danse et de chant. Statique durant le prologue, la caméra s’agite. Portée à l’épaule, elle zigzague au cœur de cette troupe désordonnée qui grimace, grogne et gigotte sur un flot de paroles tourmentées : Ma mère ne m’aime pas / et je n’ai pas de chéri / alors pourquoi pas mourir ? Plus tard, pour s’assurer que ces bambins ne rêvent pas de retrouver leur mère, une femme enragée s’attaque à une statue de la Vierge à l’enfant avec une tronçonneuse. En séparant l’enfant du giron maternel d’un seul coup tranchant, cette hérétique — qui pousse un soupir de soulagement presque extatique — entérine une fois pour toutes la relation des mères et des enfants dans Losing Faith. Ils sont détachés les uns des autres. Ils sont libres.
Certains personnages célèbrent cette émancipation familiale et optent pour une cohabitation décomplexée au sein d’une communauté un peu bohème, ironiquement baptisée Centre de vacances Barranconi pour mères et enfants. Sympa ! Mais Flippa, notre protagoniste sceptique, s’indigne. « C’est quoi ce plan ? », s’interroge la trouble-fête. Le titre original de Losing Faith est Die Ängstliche Verkehrsteilnehmerin, soit « L’Usager de la route anxieux » en allemand. Flippa est à l’image de ces deux titres : sceptique, mais angoissée. Abandonnée par sa mère, puis par sa grande sœur, Flippa doit traverser la fin de son adolescence sans structure familiale. Personne ne lui a remis un foisonnant « Manifeste pour le soin et la libération » (le sous-titre du livre de Lewis) en guise de feuille de route avant de l’abandonner. Depuis, aucun substitut à la famille ne s’est matérialisé : aucune
autre forme de compagnie, de communauté ou de croyance. Mechow traite le personnage de Flippa et sa sidération sous l’angle de la comédie carnavalesque plutôt que de la tragédie grinçante ; en cela, elle se rapproche davantage d’Ulrike Ottinger que de Lars von Trier, bien que les deux comparaisons soient envisageables. Néanmoins, la réalisatrice prend aussi les tourments de son héroïne au sérieux. Flippa n’a personne pour lui montrer comment aimer ou vivre.
Pauvre Flippa. Rien que son prénom montre que sa mère n’avait aucune envie de s’occuper d’elle. Elle ne s’appelle pas Fi-lip-pa, mais sa version abrégée, Flip-pa, un homophone en allemand du flipper, le fameux jeu d’arcade, proche des verbes flippen et ausflippen, qui signifient « piquer sa crise » ou « péter les plombs ». Faut-il voir dans l’oubli du premier « i » un signe de l’indifférence de la mère envers son nouveau-né ? Ou bien a-t-il été sciemment tenu à l’écart de l’enfant et de ses petites mains qui agrippaient tout, pour que la mère puisse pleinement écrire ich, « je » ?
Dans le rôle de Flippa, Selma Schulte-Frohlinde incarne remarquablement bien l’absence de mère, avec un manque de raffinement typique des vilains petits canards. Par exemple, sa tête a tendance à basculer sur le côté, comme si personne ne l’avait soutenue dans sa prime enfance. Mechow, pour sa part, souligne les nombreux symptômes d’une adolescence négligée en multipliant les très gros plans. Ceux du visage de Flippa dévoilent acné, vilain mascara et ongles rongés. Les gros plans sur le sol de sa chambre s’attardent sur un bric-à-brac rose et crasseux, vestige d’instants passés à se pomponner sans grand enthousiasme ou à fumer. Dans ce désordre couleur bubble-gum, Flippa écrit sur les sentiments perdus, comme le font les adolescentes. Elle aimerait que quelqu’un vienne orner d’un petit cœur le « i » de son nom mutilé dans une lettre d’amour.
1 Sophie Lewis, Abolish the Family: A Manifesto for Care and Liberation (Londres et New York, Verso, 2022).
Pauvre Flippa. Elle n’a rien de la jeune fille profitant avec allégresse d’une indépendance prématurée. Alors que « perdre la foi » (losing faith) peut bien sûr être un évènement merveilleux — le début passionnant d’une ère meilleure ou nouvelle — l’adolescente est mécontente et exige des réponses. Il n’y a rien de merveilleux à être seule ainsi, semble-t-elle insister tout au long du film. Cette sensation de malaise est renforcée par le grain rugueux du Hi-8, un format aujourd’hui abandonné, associé à la télévision et à la vidéo amateur des années 1980 aux années 2000. Les couleurs fluos et les performances bizarres jaillissent avec éclat de ces images ; tout comme la désillusion amère d’une jeune fille délaissée.
Pour Flippa, le bonheur n’est qu’une couleur, ou ce visage souriant sur le sac qui ne la quitte jamais. D’ailleurs, elle ne tarde pas à l’emporter de Berlin jusqu’en Sardaigne, sur les traces de sa grande sœur, Furia. Une fois arrivée au Centre de vacances Barranconi pour mères et enfants, elle découvre un clan de femmes qui se méfient de la vérité, parce que celle-ci « décrit un monde qui a perdu toute légitimité ». On pourrait penser qu’un groupe de femmes ouvertement sceptiques serait idéal pour Flippa. Il n’en est rien. Flippa a besoin de réponses, pas de davantage de doutes.
N’aimant pas être prise pour une idiote, Flippa va directement exprimer sa frustration auprès de Rumpel, la responsable de Barranconi. Cet endroit n’a rien d’un « vrai sanatorium », s’emporte-t-elle. Ni d’un lieu de guérison. C’est une chose de se lancer dans des réflexions profanes sur le serpent du jardin d’Eden (plus intelligent qu’immoral) ou sur l’immaculée conception (pas très réjouissante), dans de petits moments d’amusement complice. Mais c’en est une autre de blaguer sur le fait de négliger l’éducation des enfants et d’en faire un peuple analphabète, une main d’œuvre impuissante, dans des bravades anticapitalistes et anti-pa-
triarcales. Qu’en est-il des soins et de l’attention ? Où sont les nouvelles visions de l’amour ? À défaut, Flippa préfère lire Jane Austen : peut-être qu’un classique comme Persuasion vaut mieux que tout cela.
Par l’intermédiaire de notre héroïne orpheline Flippa, Losing Faith pose un regard agnostique sur un anarchisme féministe naissant qui n’est que tronçonneuse, sans persuasion ni plan. Ainsi donc nous autres, mères biologiques, ne nous occuperons plus de ces enfants qui pensent que tout leur est dû — très bien, d’accord, comme vous voudrez. Mais qu’est-ce qui vient ensuite ? Aux yeux de Flippa, la solution de Barranconi, qui consiste à traîner sans réel but, est une piètre alternative, à tel point que la jeune fille retrouve le vieux nœud de l’hétérosexualité à la fin du film. Mais celui-ci se défait rapidement. Même « l’amour ne peut pas sauver » l’attachement hétérosexuel, en conclut Flippa. Et la voici donc seule à nouveau.
Un autre film, plus optimiste, aurait proposé une fin différente : Flippa se serait installée en Sardaigne, avec un peu de chance au sein d’une nouvelle communauté de femmes, avec ou sans Furia. Seulement Flippa n’est pas convaincue. Losing Faith s’achève sur ce geste ouvert, commun aux films d’apprentissage — la jeune fille marche vers l’horizon, sans savoir ce que l’avenir lui réserve — et cette image prend ici une double signification. Certes, le passage à l’âge adulte est difficile et ambigu, mais les affres du changement social le sont plus encore.
Traduit de l’anglais par Claire Habart


Entretien avec Martha Mechow
réalisé et traduit de l’allemand par Claire Lasolle
Quel était ton rapport initial au cinéma ? Quels étaient tes cinéastes préférés, tes films préférés ?
Peu après mon baccalauréat, j’ai accompagné une amie à Hambourg, où elle passait un entretien d’orientation à l’université. Le soir de notre arrivée, nous nous sommes promenées et nous sommes passées devant l’école d’art. Par curiosité, j’ai frappé à la seule porte entrouverte du bâtiment, d’où filtrait encore de la lumière. Celui qui allait devenir mon professeur m’a ouvert, j’ai demandé : « Excusez-moi, que puis-je apprendre ici ? » et il m’a répondu : « Le cinéma ! » Pur hasard qui, en fin de compte, a rendu possible la conversation que nous avons aujourd’hui.
Mais remontons le temps : je me souviens d’un document Word que mon père avait créé pour moi sur son ordinateur quand j’avais environ 12 ans. Il contenait une liste de ses films préférés. Des classiques, qui m’avaient laissé une telle impression qu’il ne manquait que cette rencontre pour que je m’inscrive à la HfbK1 Les soirées cinéma passées ensemble ont pris fin au début de ma puberté, certes, mais pas mon intérêt pour le cinéma. Il se manifestait simplement différemment, ou disons plutôt très moyennement. Comme toutes les consommatrices socialisées et connectées à Internet, j’enchainais et accumulais en mode “binge watching” des contenus que l’industrie culturelle avait conçus pour moi, tout en les dévalorisant. Ces comédies romantiques et love stories initiatiques des années 2000, dans la continuité des romans d’amour historiques et des magazines pour filles de mon enfance,
Hochschule für bildende Kunst (Haute école des arts plastiques), université scientifique et artistique située à Hambourg.
transmettent un savoir que j’ai essayé de rendre productif pour moi dans ce film.
Losing Faith est une explosion de couleurs, notamment grâce aux costumes. Que ces derniers te permettent-ils de faire ? Il t’arrive de dire «le costume fait la personne». De quelle manière ?
Pour répondre à cette question, je me dois de convoquer Céline et Julie vont en bateau de Jacques Rivette. Mon film préféré, qui, quand je l’ai découvert, m’a donné l’envie de faire un film moi-même et l’impression que je pouvais le faire. Je schématise brièvement la structure d’une scène importante pour cette discussion : Julie, la bibliothécaire, remarque que la magicienne, Céline, perd son écharpe à la sortie d’un parc parisien. Julie la ramasse et se met à suivre Céline dans les rues de Paris. Tandis que d’autres vêtements s’échappent du sac à main de la magicienne, Julie les ramasse l’un après l’autre, les enfile et se transforme…
Cette transformation, selon moi, est très queer et inhabituelle par rapport aux schémas narratifs que proposent les films. Dans la plupart des histoires que je connais, la transformation d’un personnage se fait de l’intérieur vers l’extérieur et trouve sa justification dans la psychologie. Alors qu’ici, une écharpe suffit à Julie pour devenir une autre. Ou devrais-je plutôt dire « pour être une autre » ?
Ma mère, qui a réalisé les costumes de Losing Faith, a une approche et une méthodologie similaires. Pour elle non plus, il n’y a pas besoin d’un
voyage héroïque caractérisé par une succession classique de situations et de personnages pour dire la mutation. Il suffit d’un bon changement de costume.


Elle me renvoie à l’idée de Deleuze et Guattari selon laquelle l’identité ne consiste pas en une racine unique, comme les cultures occidentales nous l’ont longtemps enseigné. Il s’agit plutôt d’un rhizome dont le tissage se fait dans la rencontre avec les autres. C’est pour cette raison que Julie devient Céline pour un temps. Jusqu’à ce que de nouvelles rencontres rendent d’autres transformations possibles pour elle.
Il en va de même dans une scène de mon film sur le plan de l’image ou du costume : c’est au moment de l’adieu

que Flippa et Furia se ressemblent le plus. Elles reconnaissent l’une en l’autre et y trouvent du réconfort, malgré la séparation.
Dans Reverse Cowgirl, McKenzie Wark cite à ce sujet l’auteur et professeur
Otto von Busch :
« La mode est sauvage, elle est de l’ordre de l’animalité. Même si les industries culturelles et les “techniques du moi” tentent de domestiquer, de contrôler et de marchandiser les puissances en jeu dans la mode, elle reste par essence vivante et garde en permanence le potentiel de se libérer de sa forme marchande. La mode ne peut se résumer à un attribut, elle n’est pas liée à des vêtements ou à des biens, mais c’est un endroit où l’on peut aller, un espace émotionnel dans lequel on entre à l’intérieur de soi et d’un autre. »
Dans quelle mesure ta pratique théâtrale t’a-t-elle aidée ?
J’aimerais aborder ici un thème central sur lequel je reviendrai plus tard de manière plus détaillée : mon rapport au christianisme. Lorsque j’ai commencé à aller
à la Volksbühne à l’âge de 15 ans, je fréquentais encore l’école évangélique. En tant que protestante, professer ma foi était essentiel à cette époque.
Très différemment des catholiques, qui disent : « Agenouille-toi, bouge tes lèvres en guise de prière, et tu croiras », j’ai compris, grâce à l’homme de théâtre René Pollesch, que « Ce n’est que dans ce que je fais que la réalité se manifeste ».
Ce que je décris ici, tout comme l’écharpe verte de Céline et Julie vont en bateau, a aussi quelque chose à voir avec le concept de matérialisme dialectique et avec mon manque d’intérêt pour l’authenticité.
Ce savoir, que m’a transmis René Pollesch, se fonde sur les pièces didactiques (Lehrstücken) de Bertolt Brecht : le théâtre sans spectateur. Le comédien ou la comédienne fait quelque chose dans l’espoir que cela agisse sur lui ou elle. Aucune vérité intérieure ne s’exprime, bien au contraire. Pour Brecht, il était important qu’un geste déterminé agisse sur la personne qui joue.
Le théâtre est donc ta première scène. Pourquoi faire un film ?
Pour moi, réaliser Losing Faith, c’était presque comme une soirée théâtrale sans public, comme mettre en scène une pièce didactique. Je ne connaissais rien des festivals et des possibilités de distribution. Mais surtout, je n’ai presque jamais regardé à travers l’objectif de la caméra, ce qui réduisait l’importance du processus de tournage pour les acteurs.
Ce n’est qu’au montage que j’ai compris qu’un film se structurait et gagnait en perspective en se résolvant. Cela vient aussi certainement du fait qu’au théâtre, au contraire, la frontalité prime — ce qui ne m’a jamais posé de problème.
Ce qui m’intéressait dans le cinéma, ce n’était pas la manière dont le médium s’exprime, mais tout simplement son potentiel social : soudain, des personnes dont les voix ne portaient pas dans les salles de théâtre, pouvaient agir en tant que comédiens et comédiennes.
Des personnes ayant des difficultés à mémoriser un texte, timides ou rencontrées par hasard sur un terrain de camping, pouvaient participer au processus.
Maintenant que le film est présenté dans les festivals, on me questionne souvent sur les acteurs « non-professionnels ».
Mais qu’est-ce que ça veut dire ? Un manque de compétences ? Je pense que les spectateurs s’aperçoivent que le jeu a lieu pour les acteurs, alors que ce sont eux qui paient pour le voir !
2 Le théâtre de jeunes de la Volksbühne.
On revendique pour nous-mêmes le bénéfice qui est censé revenir en premier lieu au public.
C’est ça, le problème.
Souvent, les spectateurs et spectatrices me demandent aussi « Pourquoi tes actrices en font trop ? » Ils pensent que c’est en lien avec mon passé théâtral. Pour moi, c’est plutôt le besoin de transformer toutes les capacités physiques en capacités de travail. Si les acteurs et actrices de mon film font avec leur visage plus que garantir la narration, c’en est tout de suite trop pour certains.
Pourquoi n’as-tu pas joué toi-même dedans ?
J’ai abandonné mon rêve d’enfant d’être actrice de théâtre, car j’ai développé un trac insurmontable après ma puberté. Le fait que l’équipe de Losing Faith ait pu jouer sans remplir les conditions de base et les prérequis de la profession était aussi pour moi une tentative d’expérimenter des méthodes de travail qui me permettraient un jour de porter à nouveau un costume.
Quels ont été les défis pour faire jouer les autres ?
D’abord, quand j’entends le mot « jouer », je pense inévitablement au « corps » et ensuite à Glitch Feminism : A Manifesto de Legacy Russell : « Nous réalisons que les corps ne sont pas des points fixes, des terminus. Les corps sont des voyages. Les corps (se) déplacent. Les corps sont abstraits. Nous réalisons que nous débutons
le voyage par l’abstraction et que nous arrivons ensuite au devenir. Pour dépasser les limites du corps, nous devons laisser derrière nous ce à quoi un corps doit ressembler, ce qu’il doit faire, comment il doit vivre. Nous nous autorisons à faire notre deuil dans ce processus de lâcher prise ; ce deuil fait partie de notre croissance. Nous célébrons le courage qu’il faut pour changer de forme, la joie et la douleur que peut représenter l’exploration de nouvelles identités et la force qui va de pair avec la découverte de ces identités. »
Ensuite, pour répondre à cette question, probablement la plus importante pour moi, je veux parler de la personne qui m’a donné envie de « jouer ». C’est l’enseignante de théâtre Vanessa Unzalu Troya. Lorsque j’ai rejoint le Jugendtheater P142, je voulais apprendre à « faire semblant », c’est comme ça que je pensais appréhender ce qu’on attendait de moi. Pour répondre, par exemple, aux exigences de la culture pop mentionnée en début de cet entretien. À cette époque, j’étais prête à tout pour retrouver l’attention et l’amour que j’avais expérimentés avant de devenir une « femme » et j’aspirais donc à la reconnaissance patriarcale.
Vanessa m’a appris que le théâtre peut permettre de renvoyer à l’abstraction ce qui a été imposé à ce matériau déterminé comme inaccessible : mon propre corps. J’ai donc commencé à jouer selon ma propre conception de la féminité et j’ai réalisé que j’étais plus que ce que je pensais être. Il y a cette photo de moi prise le jour de ma toute
première répétition à la Volksbühne qui expose, selon moi, tous ces conflits :

C’est agréable de repenser à cette période, car ces premières expériences m’ont réconciliée avec moi-même. Je pense que c’est grâce à la manière dont Vanessa nous regardait, mes amis et moi.
Un peu comme ce que chantait Nico dans I’ll Be Your Mirror.
I find it hard to believe you don’t know
The beauty you are
But if you don’t, let me be your eyes
A hand to your darkness so you won’t be afraid
When you think the night has seen your mind
That inside you’re twisted and unkind
Let me stand to show that you are blind
Please put down your hands
‘Cause I see you
J’estime les acteurs et actrices de mes films de la même manière et j’ai confiance en leurs forces. Car ces corps s’expriment par leur capacité à être touchés et à toucher, à se déplacer et à émouvoir. Une capacité à se transformer soi-même, les autres et le monde entier.
Ce qui m’évoque une autre œuvre d’art, de l’écrivaine et photographe Claude Cahun.

Elle et sa belle-sœur et grand amour, Marcel Moore, étaient des artistes pionnières du surréalisme et des résistantes antifascistes. Elles rédigeaient des lettres et des tracts en allemand. Afin de toucher directement les soldats, elles se déguisaient en hommes et assistaient à des défilés militaires sur l’île de Jersey.
Tu parles d’une aventure collective. Peux-tu expliquer le cheminement qui part d’une vision personnelle pour aboutir à ce collectif ?
La collaboration est née d’une nécessité que l’acteur Franz Beil formule ainsi : « Seul, je ne peux pas penser, seulement ressentir ». Ce problème ne lui est pas personnel, c’est un phénomène qui concerne la société dans son ensemble. Voilà pourquoi je n’ai pas recruté d’équipe de tournage, mais j’ai cherché à créer une communauté d’intérêts. Les seules personnes
que j’ai dû aller chercher étaient les actrices Selma Juana Schulte-Frohlinde, Inga Busch et Susanne Bredehöft.
Le reste, ce sont des amis qui ont aimé mon idée et des personnes qui ont répondu à une annonce que nous avons affichée dans les magasins pour enfants, les agences pour l’emploi et les centres commerciaux de Berlin.
Au groupe ainsi formé, j’ai dit ce qui allait plus tard devenir le texte du personnage de Rumpel : « Il n’y a pas de plan, mais des possibilités à essayer. C’est l’exclusion des possibilités qui écrit l’histoire, pas moi ».
Puis mon producteur Hans Broich et moi avons vendu des billets de cinéma pour Losing Faith, un film qui n’existait pas encore à l’époque et qui ne pouvait voir le jour que grâce à ces recettes.
Quand on regarde Losing Faith, on hésite un peu entre un film très écrit et une improvisation absolue, ouverte à la décision de l’instant. Comment es-tu parvenue à ce résultat ? Avais-tu un scénario ? Une feuille de route ?
Je suis dyslexique. Je dépends donc totalement du mot prononcé. Ce qui m’a amenée très tôt au théâtre. Aujourd’hui, ce trouble neuronal me limite moins dans la lecture et l’écriture. Malgré tout, ma façon d’aborder un texte n’a pas beaucoup changé. Pour Losing Faith, par exemple, il n’y a pas eu de scénario. Nous avons préféré nous raconter le déroulement de l’action, encore et encore. C’est ainsi que l’histoire est née : en passant de
bouche en bouche. Je connaissais donc le besoin de chacun de s’approprier l’histoire. De la rendre divertissante par sa propre profusion d’imagination et de délicatesse, et de marquer ainsi une présence sémantique : « J’étais ici. »
La nuit, après avoir discuté au dîner de ce que nous voulions tourner le lendemain, j’écrivais ou j’insérais mes propres textes, à prétention lyrique. La plupart du temps, les acteurs et actrices n’avaient pas le temps de les apprendre par cœur. Mais ce n’était pas grave. J’entends mieux quand quelqu’un s’arrête, cherche à se rappeler et réfléchit. Car cette lutte pour trouver les mots reflète mon propre rapport au langage.
Qu’est-ce que cela signifiait pour toi de monter un film ?
Les écritures égyptienne et chinoise se sont développées à partir de symboles figuratifs. Des pictogrammes qui, mis bout à bout, racontent une histoire. Au début du développement de l’écriture, il y a donc l’image. Monter revient à une forme d’écriture pour les dyslexiques.
Quel rôle ont joué la musique et le dessin dans ce processus ?
Ils m’ont permis d’envisager différemment l’autorialité de l’œuvre, en la partageant. En outre, ils sont l’expression d’une étroite collaboration et d’une profonde confiance. Les dessins proviennent par exemple du journal intime que Selma Juana Schulte-Frohlinde m’a confié.
Le théâtre ou la vie. On a vraiment l’impression que Losing Faith est le résultat radical d’un refus de choisir, d’une décision d’effacer le « ou ». Dans quelle mesure la réalisation du film est-elle une expérience de vie ? Comment les conditions de vie créent-elles les conditions pour le film ?
Tu fais ici allusion à l’ensemble de l’œuvre de Charlotte Salomon3, dans laquelle le point d’interrogation disparaît, entre le couverture et la dernière page.


Dans mon film, une phrase que l’on peut rapprocher de son travail justifie le jeu par le refus de la réalité : « Et quand ils parlent, ils mentent. Car la vérité ne fait que décrire un monde ayant perdu à leurs yeux toute validité depuis longtemps ».
Un plan est étonnant : celui où Ann Göbel s’éloigne littéralement comme une sorcière sur son balai. Dans ma réflexion sur le féminisme, la chasse aux sorcières, qui marque la transition entre le féodalisme et le capitalisme, est devenue un objet central de ma recherche. Mais pour la comprendre, il me fallait d’abord explorer les luttes du prolétariat
médiéval. Pendant longtemps, le motif principal de la lutte antiféodale était le servage. Les paysans et la totalité de leurs biens appartenaient en effet à la maison seigneuriale. Les révoltes du prolétariat ont permis de transformer les corvées en prestations rémunérées. Les paysans n’étaient alors plus en mesure de faire la différence entre le travail qu’ils effectuaient pour eux-mêmes et celui qu’ils effectuaient pour le seigneur. La recherche par le prolétariat médiéval d’une alternative tangible à ces nouvelles conditions féodales s’est exprimée dans l’hérésie populaire. Parmi les

3

exemples significatifs de rébellion anticléricale, citons l’essor, au XIIIe siècle, d’une nouvelle secte qui attribue une signification mystique à l’acte sexuel hétéro et homosexuel. Elle se nomme « les frères et sœurs de la pensée libre ». On pense que le peintre Jérôme Bosch en faisait partie. Si les idées et les aspirations émancipatrices de tous ces mouvements sociaux sont si peu connues aujourd’hui, c’est surtout parce que nombre de ces personnes, des femmes pour la plupart, ont été brûlées sur le bûcher. L’attitude de Rumpel et Furia dans cette scène est à mettre au crédit de ces « pionnières ».
La lutte antiféodale de ces personnes, dénoncées comme « sorcières », s’est dressée contre l’économie monétaire et la séparation nouvellement introduite entre la production de biens et la reproduction des forces de travail. Cette séparation a créé une asymétrie entre les sexes en isolant la reproduction et la domesticité
du travail rémunéré, séparant la maternité du reste des activités. C’est ce pouvoir sociologique de l’asymétrie qui rend les sexes aujourd’hui encore interdépendants et nous pousse vers le concept de « famille nucléaire ». Si j’ai choisi le thème de la reproduction, c’est parce que la maternité chez les femmes est l’un des rares éléments universels et persistants de cette division du travail.
J’aimerais revenir sur la première scène de Losing Faith, aussi surréaliste que vraie. Peux-tu nous expliquer comment elle a été conçue et en quoi elle illustre ta façon de travailler ?


Dans Losing Faith, il est beaucoup question du fait que les premières expériences d’un nourrisson se déroulent le plus souvent dans le contexte de la relation personnelle avec sa mère, précisément parce que la répartition spécifique des tâches ne permet pas de faire autrement.
Au cours du film, Flippa s’interroge sur les conséquences du fait que la première relation amoureuse de presque tous les êtres humains est une femme et sur les conséquences d’une association, quasiment automatique, du soin à la féminité. J’ai donc créé une image où une jeune femme, tuée par ses deux enfants, disparaît lentement dans la fente d’un canapé.
Lorsque j’ai montré la scène, dans une version beaucoup plus longue, à différentes personnes, elles n’ont pas vu la disparition de la mère. Le public considérait son amour comme une instance évidente dans la vie de ses enfants et ne la regardait pas. Cela m’a conforté dans mon idée !
Losing Faith associe un grand nombre de penseurs et d’artistes autour d’une colonne vertébrale proprement matérialiste. Peux-tu nous parler de tes références ?
Ma référence principale est la Bible de Luther, un ouvrage qui invite à dépasser les limites de l’expérience et du conscient d’ici-bas et qui est censé faire sens malgré tout. Même si pour moi ce n’est pas le cas.
En premier lieu, car le paradis ne peut pas être un lieu où l’on aspire à la liberté. La sortie d’Eve du jardin d’Eden n’est donc pas quelque chose qui me bouleverse. Mais les paroles de Dieu si, quand il dit à Eve :
“J’augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi.” Il la punit ainsi par la maternité ! Il ne s’agit pas ici seulement de la douleur qu’elle subit lors d’un accouchement, mais de la misère qu’elle doit endurer en prolongeant une vie ancienne, devenue trop dure pour elle, par une vie nouvelle.
Nancy Chodorow décrit ce processus dans The Reproduction Of Mothering comme un paradoxe selon lequel les mères doivent enseigner à leurs enfants les règles d’un monde qui les prive elles-mêmes de leurs droits. Cette dégradation d’Eve se poursuit dans le Nouveau Testament à travers la figure de Marie, la mère, qui pleure souvent dans les tableaux et sculptures. Qui peut croire qu’elle se soit réjouie de cette « immaculée » conception4 ?


Avec la phrase suivante, Saidiya Hartman me confirme la nécessité de fabuler de manière critique pour remettre en cause cette narration : « So much of the work of oppression is policing the imagination5 » J’ai donc commencé à chercher des récits alternatifs à ce récit des origines. Dans mes recherches sur les luttes antiféodales, j’ai découvert les premiers mouvements de femmes à visée démocratique dans l’histoire européenne.
Vers 1227 après J.-C., la jeune Mechtilde de Magdebourg a rejoint la secte hérétique des béguines au monastère d’Helfta, connu comme le centre de la mystique féminine allemande. Son aspiration à des relations égalitaires s’exprime dans la théologie de la libération. Dans des textes lyriques et dramatiques, elle a transposé des visions, mais aussi des dialogues amoureux et des discussions houleuses avec Dieu. Les lignes suivantes, tirées de
4 L’Immaculée Conception, dogme tardif de l’Église catholique (1854), signifie que Marie est libre du péché originel dès le moment de sa conception. Ici, Martha Mechow fait référence à la conception virginale de Jésus par Marie, présente dès le Nouveau Testament.
5 Une grande partie du travail d’oppression consiste à contrôler l’imagination.
La Lumière fluente de la divinité, ont été pour moi le point de départ de réflexions étendues sur la mise en récit et la contre-histoire :
« Quand la joie suprême de notre Père fut troublée par la chute d’Adam, et fit place à la colère, alors l’éternelle sagesse reçut avec moi et intercepta ce courroux du Tout-Puissant. […] Ainsi tout était ouvert et béant, à lui ses blessures, à elle son cœur. Les plaies coulaient et aussi son sein, d’où l’âme reprit la santé et la vie. […] C’était et c’est encore bien juste. Dieu est son vrai père, et elle est sa légitime épouse, elle lui ressemble dans tous ses traits. »
Selon l’historien de l’art Wilhelm Fraenger, cette révélation aurait également contribué à la création du Jardin des délices de Jérôme Bosch.
J’aime que le peintre ait laissé la verdure du Paradis, sur le panneau de gauche, proliférer jusqu’au panneau central. Certainement pour unir le premier couple humain avec ses enfants. Une prospérité que l’enfer

ne fait peut-être valoir que pour les cœurs sourds ? Si nous ne sommes pas insensibles aux messages secrets de ces plantes, nous entendrons peut-être les tubercules, les fleurs et les baies chuchoter : « Là où l’humanité et la nature s’unissent dans le culte énigmatique de l’amour, naît le vrai paradis ! » Mais quand ce Dieu-Nature voudra-t-il réconcilier l’esprit et l’instinct ? La question reste ouverte.
Le dernier mouvement du film se développe autour de la notion de “noeud hétérosexuel”.
Peux-tu retracer ton travail à ce sujet ?
Je collectionne depuis longtemps les définitions de l’amour. Parmi celles qui me plaisent particulièrement, il y a le discours d’Aristote dans Le Banquet de Platon. Il y relate une conversation qu’il a eue avec la prêtresse Diotima lui expliquant la nature d’Eros. Pour elle, comme il apparaît clairement au cours de la discussion,
il s’agit d’un démon. Lequel, en tant que fils de Poros, qui personnifie l’expédient, et de Pénia, déesse de la pauvreté, subit le sort suivant :
« D’abord il est toujours pauvre, et, loin d’être délicat et beau comme on se l’imagine généralement, il est dur, sec, sans souliers, sans domicile ; sans avoir jamais d’autre lit que la terre, sans couverture, il dort en plein air, près des portes et dans les rues ; il tient de sa mère, et l’indigence est son éternelle compagne. D’un autre côté, suivant le naturel de son père, il est toujours à la piste de ce qui est beau et bon ; il est brave, résolu, ardent, excellent chasseur, artisan de ruses toujours nouvelles, amateur de science, plein de ressources, passant sa vie à philosopher, habile sorcier, magicien et sophiste.
En 1964, Pasolini a présenté Comizi d’amore6 (Enquête sur la sexualité), un film documentaire que j’aurais pu également citer en réponse à ta première question. Il y parcourt l’Italie de mars à novembre 1963 et
interroge les gens sur leur conception de l’amour et leurs préférences sexuelles en posant cinq questions :
1 . Que pensent les Italiens du débat public autour de la sexualité ?
2 . Quel est votre positionnement face au divorce ?
3 . Que pensez-vous des anomalies sexuelles ?
4 . Qu’avez-vous à dire sur la récente loi de fermeture des maisons closes et l’augmentation de la prostitution de rue ?
5 . Que pensez-vous de l’égalité sexuelle et sociale entre les hommes et les femmes ?
C’était un moment charnière pour effectuer un tel sondage, car lorsque les femmes sont devenues de plus en plus actives, dans les années 1970, un changement drastique a commencé à s’opérer. Dans l’European Journal of Political Research, Ruth Dassonneville montre que « l’écart idéologique entre les genres » (Political Ideology Gender Gap) s’est inversé dans la plupart des pays européens à partir du milieu des années 1990. Alors que les hommes étaient considérés comme progressistes, les femmes basculent politiquement plus à gauche et votent aussi plus souvent pour les partis correspondants. Mais l’écart politique entre les genres n’a jamais été plus central que pour la génération Z.
Récemment, deux textes controversés parus dans le Business Insider et le Financial Times prétendent étayer ce diagnostic. Selon eux, depuis 2010 environ, les femmes qui, comme moi, ont entre 18 et 29 ans, se tournent de plus en plus vers le camp politique
6 En allemand, les titres du dialogue de Platon (Der Gastmahl) et celui du film de Pasolini (Gasthmal der Liebe) sont très proches. Ce qui invite à rapprocher les deux œuvres, comme le fait Martha Mechow.
progressiste aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Corée du Sud.
En revanche, les hommes de la même tranche d’âge ont plus que jamais tendance à dériver vers la droite conservatrice. Si l’on regarde par exemple la publicité de l’AfD7 en Allemagne, on constate qu’elle s’adresse en premier lieu aux jeunes hommes. Cette évolution renforcée des dynamiques politiques entre les « hommes » et les « femmes » m’a incitée, à l’instar de Pasolini dans Comizi d’amore, à interroger les gens sur le « nœud hétérosexuel ». Ce qui en est ressorti n’est pas visible dans Losing Faith, mais était nécessaire à la réalisation du film.
Mais pour en revenir à ta question initiale, l’essence de tous mes travaux précédents, celui-ci compris, est formulée par bell hooks dans À propos d’amour, par cette phrase : « Il ne peut pas y avoir d’amour sans justice. »
Un cinéaste, Rabah Ameur-Zaïmeche, dit que pour lui faire un film est une chose scientifique, une recherche empirique, expérimentale : « Nous faisons des essais et nous voyons ce qui se passe. La caméra est comme un microscope : on met les êtres devant, on observe leurs relations et on les expose. C’est la définition de l’observation scientifique. »
Partages-tu cette idée ?
En quelque sorte, oui. Bien que ma démarche ressemble davantage à celle de la surréaliste Leonora Carrington. Elle s’imposait l’exigence d’interroger le microscope avec l’œil
gauche, tout en regardant dans un télescope avec l’œil droit. C’est tout aussi délirant que scientifique et ça me correspond presque plus.
Losing Faith est ton premier film. Qu’as-tu abandonné avec lui et que retiens-tu pour l’avenir ?
Comment garder la candeur que l’intuition semble garantir ?
Puisque nous venons d’aborder la science, j’aimerais répondre ici avec une histoire du physicien amateur Otto von Guericke (1602-1686). Pour démontrer la force du vide, il a fait cette expérience : il a placé deux demi-coques d’environ 50 cm l’une contre l’autre pour qu’elles forment une sphère complète. Puis, à l’aide de la pompe qu’il a inventée, il a retiré l’air de la cavité.
La pression exercée sur les parois extérieures a maintenu les hémisphères ensemble si fermement que même 16 chevaux n’ont pas pu les séparer. Il a également été le premier à construire un grand animal préhistorique. Un assemblage de fossiles les plus divers, dont un narval, un rhinocéros laineux et un mammouth laineux, que nous appelons aujourd’hui affectueusement licorne.
En tant qu’artiste, je me sens très proche de lui, car tout ce qu’il a pu prouver n’est que le néant. Même les liens qu’il établit forment le squelette d’un fantasme.
Ce que j’ai donc abandonné, c’est ma peur des monstres. Et ce que j’ai gagné, c’est le “non” avant le “professionnel”.
7 Alternative für Deutschland, parti politique allemand d’extrême-droite.

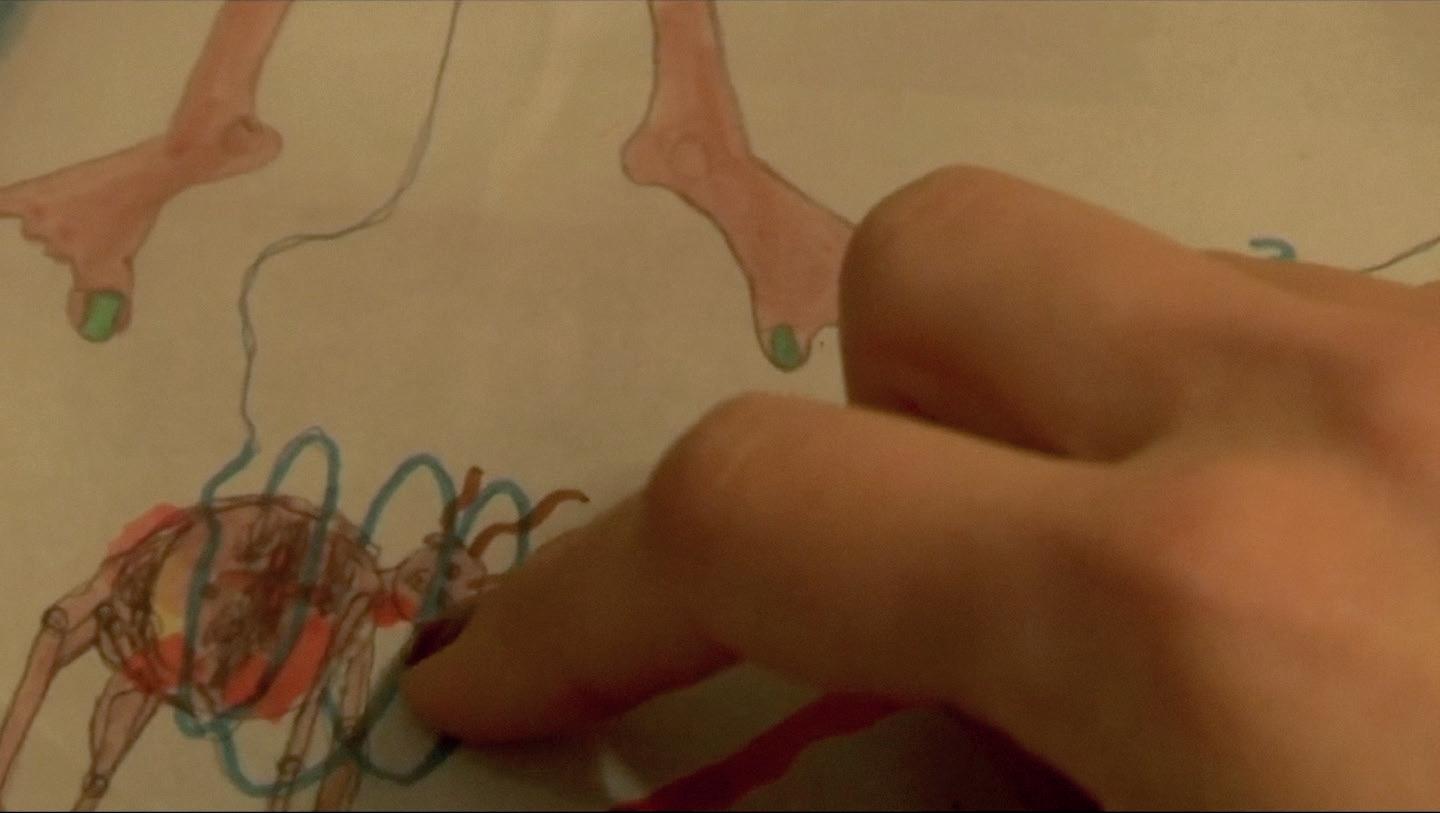
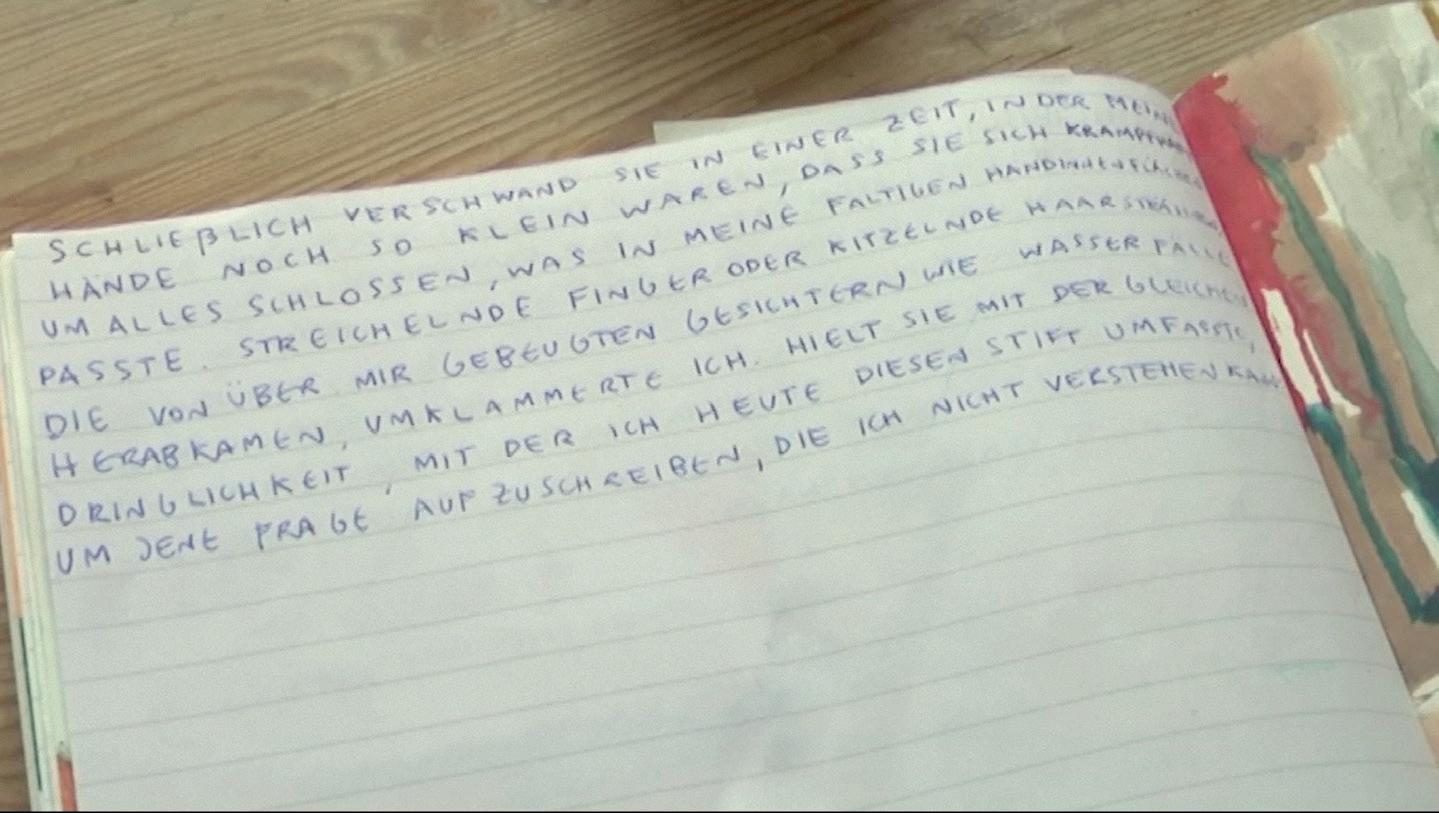



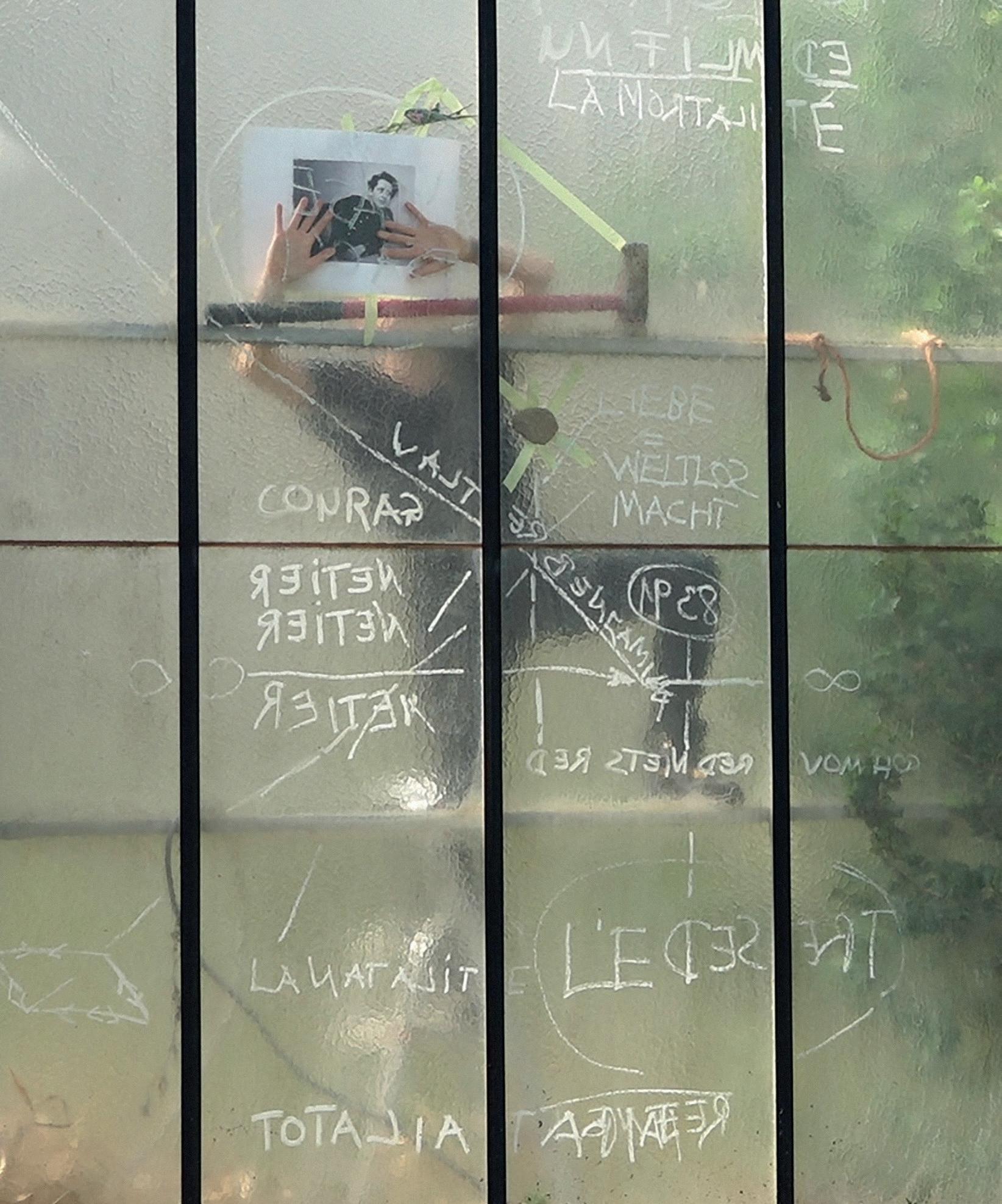

Annik Leroy & Julie Morel
Patrick Holzapfel
Je n’ai d’abord pas tout à fait compris pourquoi, dans leur Force diagonale, Annik Leroy et Julie Morel recherchaient si obstinément ce moment où la solitude léguée au monde par l’histoire se révèle dans les visages et les paysages. Pourquoi serait-il intéressant de diriger l’art du cinéma, enchaîné au présent, vers quelque chose qui s’élance du passé en direction de l’avenir ? Pourquoi filmer ce qu’on ne peut plus ou pas encore montrer ? Pourquoi ces images en noir et blanc d’un temps qui se dissout ? Puis j’ai commencé à comprendre. Un écho m’est parvenu depuis le film jusqu’au monde dans lequel je suis. Un écho de l’histoire européenne, fragmentée et perdue. Un écho venu d’indivi-dus contraints à changer. Un écho qui résonne aussi depuis le passé en direction de l’avenir.
J’ai écouté les personnes filmées raconter en voix off des moments où leur vie a basculé : des explosions, des rencontres, des intuitions. La conductrice d’un tram touché par une bombe à Sarajevo. Un homme qui a grandi en Belgique et devient ermite avec ses livres. Un immigré gay du Congo trouvant dans la musique une vraie patrie. Comme autant de parias ayant lutté pour retrouver une vie digne, autant d’exemples de changements de cap, de renaissances par-delà les aléas. J’ai scruté les gros plans sur leurs visages dirigés vers une incertitude (regardaient-ils vers le passé ou le futur, je l’ignore). Leurs rides sont comme des traces laissées dans le sable, mais le vent emporte les traces avec le sable.
J’ai écouté la voix éraillée et avide de précision d’Hannah Arendt, dont le concept de force diagonale est au cœur du film et lui donne son titre. Il s’agit d’une métaphore inspirée de Franz Kafka, qui relie ce qui a été à ce qui sera. Kafka décrit dans une nouvelle deux forces qui le rongent : l’une le tire vers l’arrière, l’autre le pousse vers l’avant. Il veut s’en libérer et aimerait que les deux forces, qui finissent par être concurrentes, s’élancent l’une sur l’autre tandis qu’il arbitrerait leur lutte. Arendt s’intéresse à ce qui émerge
de cette lutte intérieure, à ce qui nous amène à penser et à agir. J’ai assisté aux mouvements de Claire Vivianne Sobottke, à la fois ludiques et libérateurs et pourtant effacés, qui joue une idée d’Arendt, des approches qui se reconfigurent sans cesse pour re-présenter la philosophe allemande juive et son propre exil. Les mouvements performatifs de Sobottke mettent au jour la force qui est requise pour pouvoir penser. Elle ne joue pas Arendt, elle prête un corps à son esprit. Ce corps oscille entre ce qui peut être dit et ce qui reste ambigu. Un corps qui ne cesse de se recomposer et continue pourtant de se décomposer.
Je me suis perdu dans les courants disparates que le film emprunte avec l’envie de consigner, de suivre des traces. Il m’est arrivé d’être touché, voire bouleversé. Mais quelque chose m’est longtemps resté inaccessible. Je pense que cela a trait à un engourdissement interne dû à la futilité constante des efforts humains. On peut perdre le sens de l’histoire.
C’est un fait, qui se traduit par la répétition perpétuelle de crimes politiques et sociaux identiques. Il y a sans doute un vainqueur dans la lutte entre ceux qui veulent aller de l’avant et ceux qui regardent en arrière.
Walter Benjamin l’a découvert dans L’Angelus novus de Paul Klee, il ne reste qu’un tas de ruines dont on a depuis longtemps oublié ce qu’il recouvre. Je crains de ne pas être le seul à éprouver ce sentiment ou ce manque de sentiment, qu’on pourrait décrire comme une impuissance ou une perte de repères.
Natalia Ginzburg a écrit sur la nécessité apparue en elle de se détourner des événements mondiaux. Sa façon à elle de s’ouvrir au monde. Elle se sent très ambivalente à ce sujet, mais tout ce qui a de l’importance pour les autres lui paraît profondément superficiel et faux. Paul Valéry a écrit un jour que nous devrions recom-mencer à construire des tours d’ivoire. Quand bien même ces approches m’éclairent, elles ne correspondent pas au positionnement du film, qui s’appuie sur la pensée d’Arendt. Au lieu d’une fuite dans le moi, il s’agit pour les réalisatrices d’une
action collective. Plutôt qu’une tâche, c’est une action qui doit émerger grâce à des idées.
Ensuite, j’ai vu Roger et je l’ai vraiment compris. Roger est un homme en harmonie avec les pierres. Les réalisatrices le filment moins lui que les mouvements qu’il effectue dans un paysage rocheux. La caméra se perd presque dans la pierre, les proportions du corps et de la nature modifient le regard. J’ai compris que le film exigeait de moi que je regarde autrement, que je perçoive autrement. On me demandait de partager ce temps et cet espace avec Roger, avec le point de vue qu’a Roger sur les choses. Les réalisatrices montrent la main de Roger qui passe sur des pierres, s’y agrippe. Le regard parcourt un paysage façonné par le temps, de petits couloirs s’ouvrent et l’homme s’y faufile. Dans ce lieu rocailleux, une temporalité prend place qui n’a rien en commun avec ce que je peux imaginer du passé, du présent et du futur. Car l’érosion est un processus qui date de bien avant les époques perceptibles par les humains et qui perdurera bien au-delà. La perception du temps fréquemment désignée en contexte anglophone par deep time désigne les processus que l’activité humaine (en particulier une vie humaine isolée, minuscule) ne perçoit que comme une gouttelette d’eau effleurant la planète. Morel et Leroy se considèrent avec Roger comme des pétrologues ou des archéologues examinant des strates dissimulées. Ils mettent au jour l’amas de ruines. De ce qui a été, ils déduisent ce qui sera ou, du moins, ce qui pourrait être. L’image deleuzienne du temps est ainsi réinterprétée. La persévérance des pierres, la ténacité de leur lente dissolution, les compétences métamorphiques (ce n’est pas un hasard qu’Ovide ait souvent décrit des hommes transformés en pierres et des pierres façonnées en hommes) de ces non-êtres vivants d’après la définition officielle, m’ont fait comprendre qu’une force invisible était effectivement à l’œuvre et qu’elle déterminait la vie sur cette planète. Elle dépend en fin de compte d’une façon de voir les choses, et le film la présente avec tous les
moyens dont il dispose : ralentis, répétitions, silences, durée, proximité, éloignement. Seul celui qui voit autrement peut aussi penser autrement, agir autrement.
Ce qui relie les destins montrés est aussi cette force diagonale. Elle s’étend au-delà de l’individuel pour atteindre l’interpersonnel. De même qu’Arendt a tiré de son parcours personnel de Juive persécutée des questions plus vastes et plus générales, les différentes histoires de vie se mettent à correspondre. Apparaît alors l’image de quelque chose en commun par-delà la diversité. Cette force évoquée par le film rappelle les associations d’idées d’un W. G. Sebald, un écrivain qui partage cette sensibilité et a assisté sur le plan littéraire à l’effacement du continent européen, alimenté par le refoulement et l’oubli, vacillant tout au long de sa propre extinction. Mais, contrairement à l’auteur qui anticipe la fin de l’histoire, Leroy et Morel cherchent des stratégies pour la poursuivre, voire la modifier.
Ces stratégies naissent entre la caméra et la réalité enregistrée, elles défendent le cinéma comme le lieu d’une révolution continue qui s’érige contre ce qui semble inéluctable. Ce terme n’est pas choisi à la légère, c’est Arendt qui, dans son Essai sur la révolution, considère le potentiel de la révolution (consacrée à la liberté des hommes) comme déterminant pour l’avenir. Les révolutions dont il est question commencent à l’échelle de l’individu. Les quatre personnes dont on fait le portrait (avec Arendt, cela fait cinq comme les doigts d’une main, qui détermine l’action) trouvent leur dignité malgré un contexte hostile, dignité rendue palpable par les réalisatrices aussi parce qu’elles racontent moins qu’elles n’écoutent et ne regardent. La force vient toujours des personnes, jamais des moyens cinématographiques manipulateurs des formats documentaires s’intéressant à des personnages façonnés par le destin. De ce point de vue, La Force diagonale aspire lui-même à devenir une œuvre de pensée, respectueuse du temps et de l’espace, ou plutôt,
il invite à s’approcher des gens et des paysages en les ressentant et en les pensant. Au lieu de se comporter comme une pierre, on peut rencontrer toutes ces impressions laissées par des vies vécues et formant une image commune, comme on rencontrerait une pierre. La différence est minime sur le plan linguistique, mais elle change tout.
Dans un monde qui a oublié depuis longtemps que la condition préalable à tout processus intellectuel et donc révolutionnaire réside dans l’interruption (et non dans l’action exécutée à l’aveugle ou dans la constitution hâtive d’une opinion), le film pose la question du lieu et de la manière dont une telle interruption pourrait exister. Cela relève de l’utopie, mais c’est aussi la seule possibilité de faire émerger une voie diagonale y compris au cinéma. Avec Arendt, on pourrait dire que Leroy et Morel filment des oasis.
Ce n’est qu’en revoyant le film une seconde fois que j’ai remarqué que les réalisatrices elles aussi interrompent, ouvrent des espaces, accordent du temps et de l’attention à leurs protagonistes et nous donnent ainsi la possibilité d’en faire de même. Ce n’est pas la moindre des contradictions que de chercher à interrompre le médium temporel continu qu’est le cinéma, a fortiori dans un monde enivré d’images jusqu’à l’asphyxie. C’est peut-être ainsi que l’on pourrait comprendre la superposition rarement synchrone de l’image et du son dans le film : les voix des protagonistes arrêtent les images, les images interrompent les récits. Ce qui reste alors, c’est le mouvement que, selon Arendt, Franz Kafka n’aurait jamais pu trouver, car il serait mort avant d’épuisement. C’est le cliquetis du film dans la caméra et le projecteur, la force qu’il faut pour allumer la caméra ou simplement se lever, continuer à vivre et s’échapper de la structure du temps qui n’est prédéterminé qu’en apparence.
Traduit de l’allemand par Marie Hermann
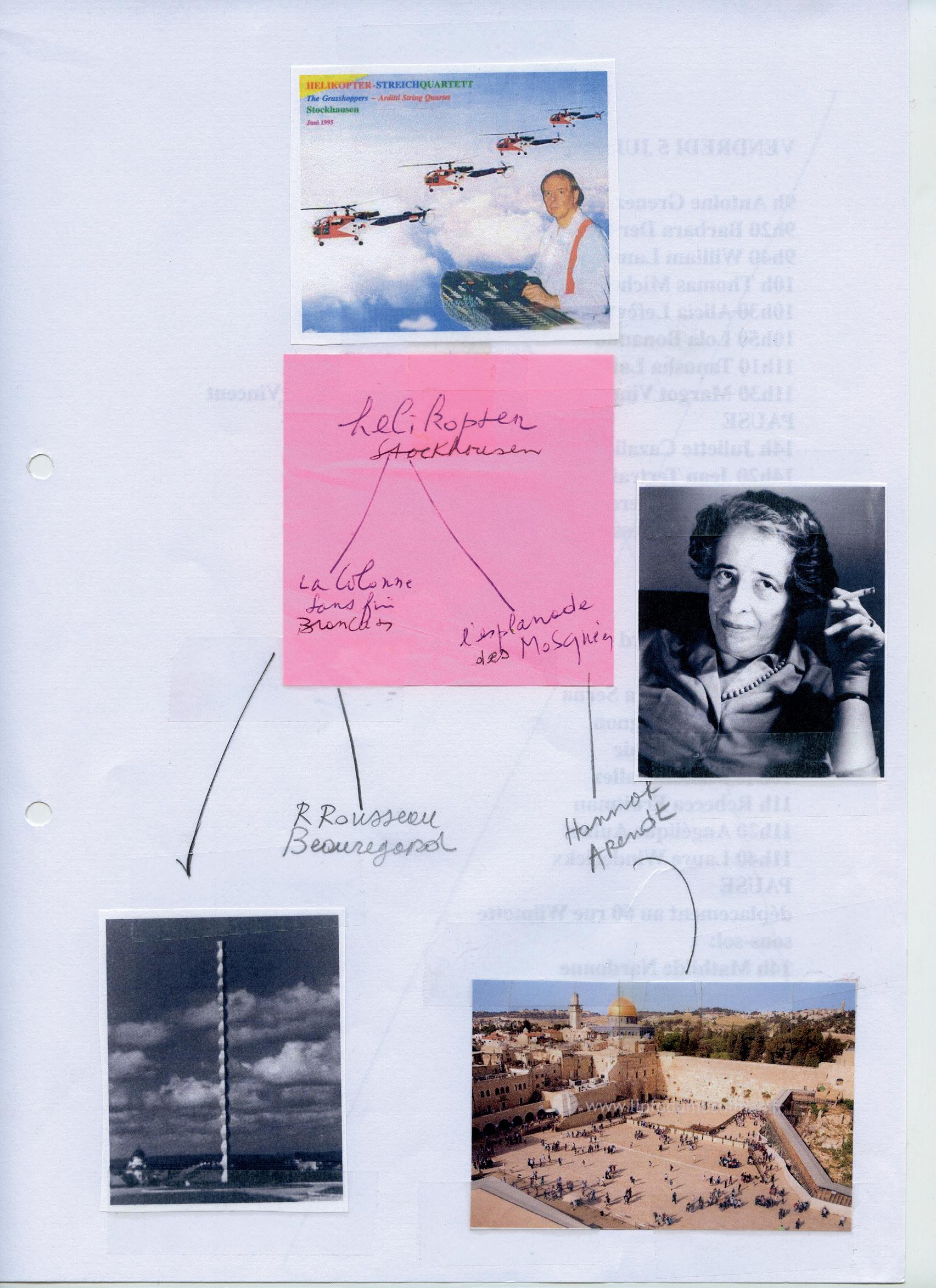
Charlotte Beradt
Das Dritte Reich des Traums — Rêver sous le IIIème Reich, 1963
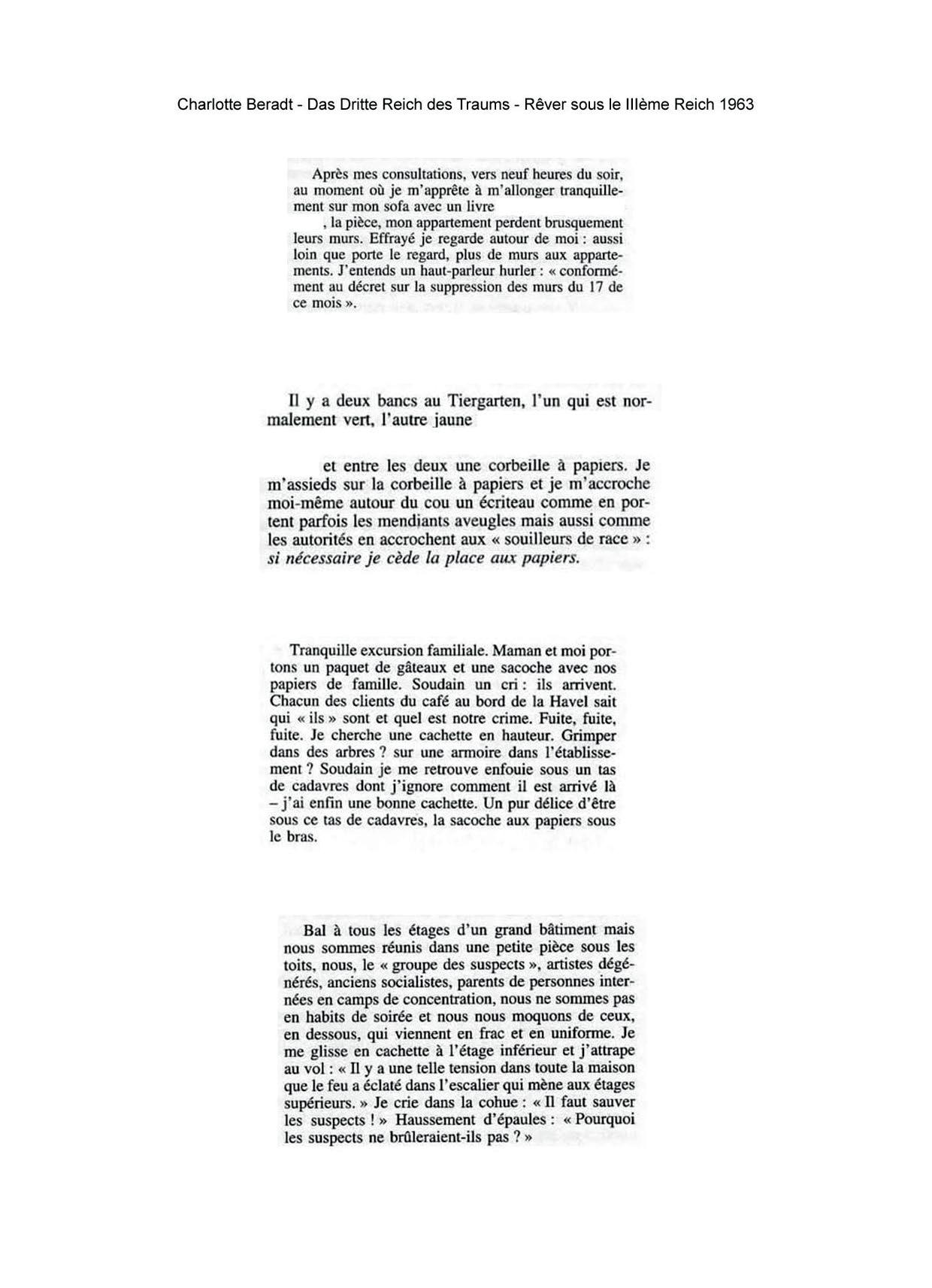

La petite photographie d’Annik a été prise à la fin des années 50 à Diksmuide sur le site dit «Le boyau de la mort» (guerre 1914-18).
Pour la séquence d’ouverture, nous avons enregistré une lecture d’extraits du livre de Charlotte Beradt par Imme Bode, dans une chambre anéchoïque ou «chambre sourde».
Charlotte Beradt — amie d’Arendt et traductrice des Origines du Totalitarisme de l’anglais vers l’allemand.

À Sarajevo, nous avons enregistré des passages de Idéologie et Terreur d’Hannah Arendt, diffusés dans l’espace public avec une enceinte portable (Gare de Sarajevo — carrefour de Skenderija).


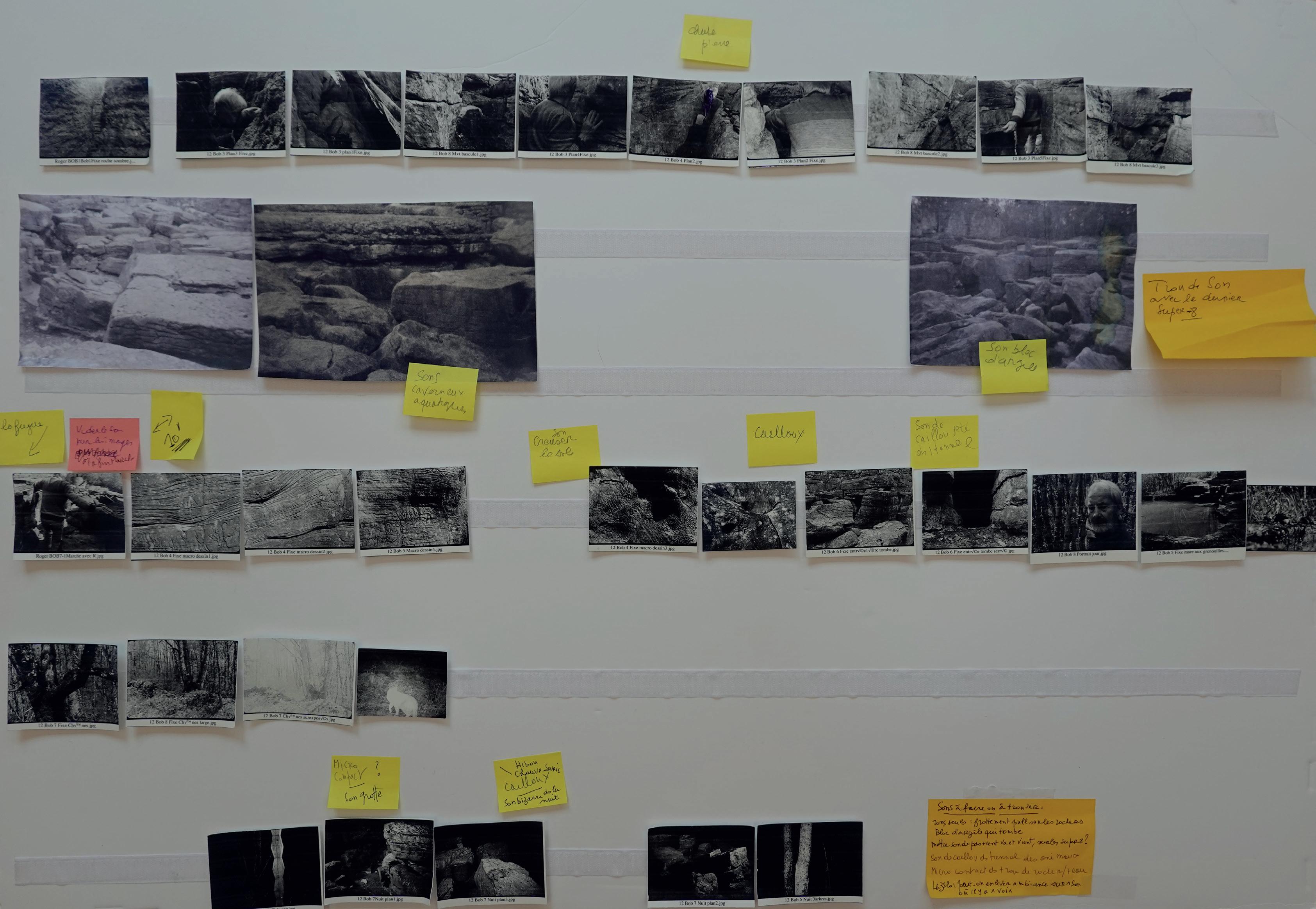
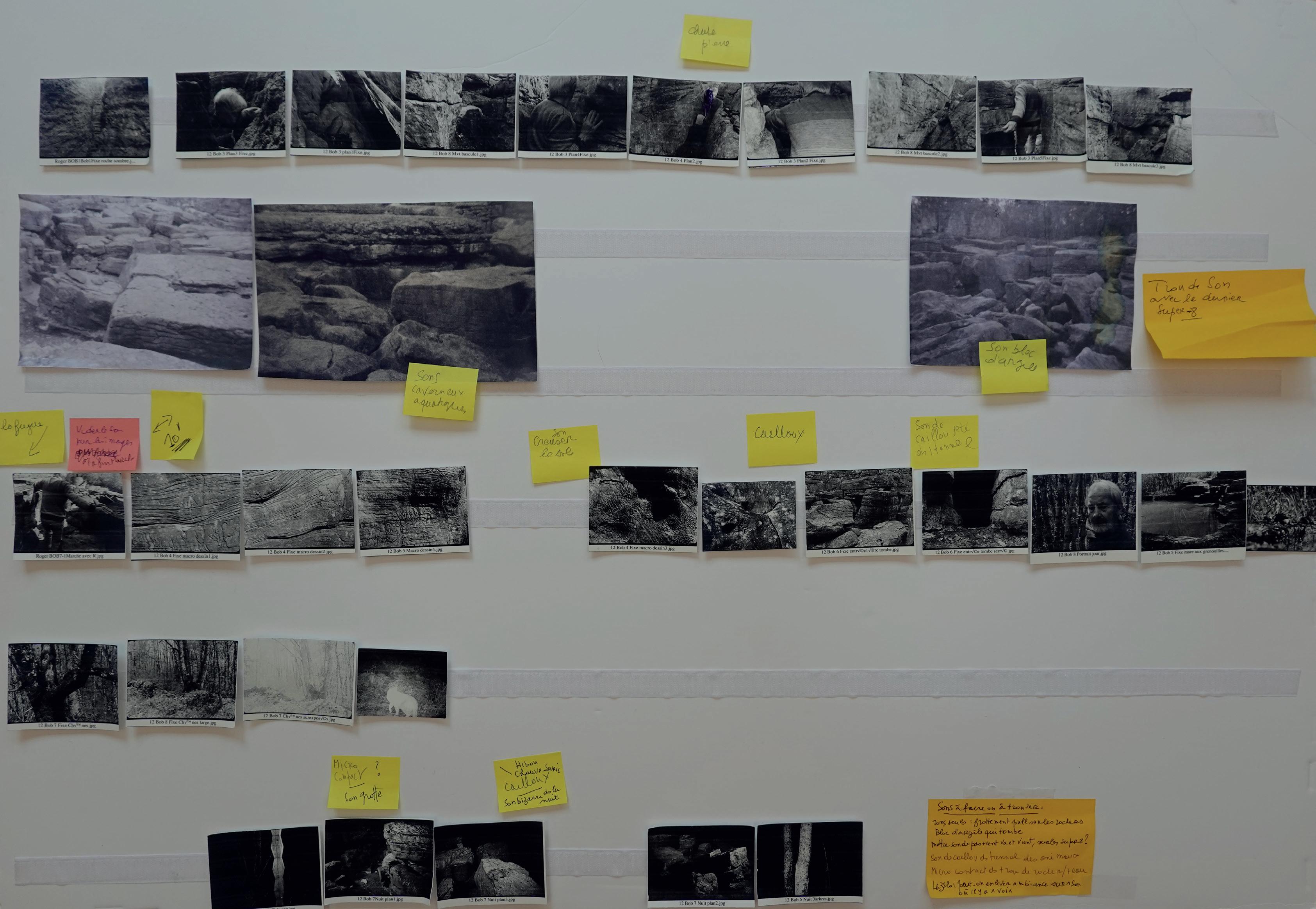
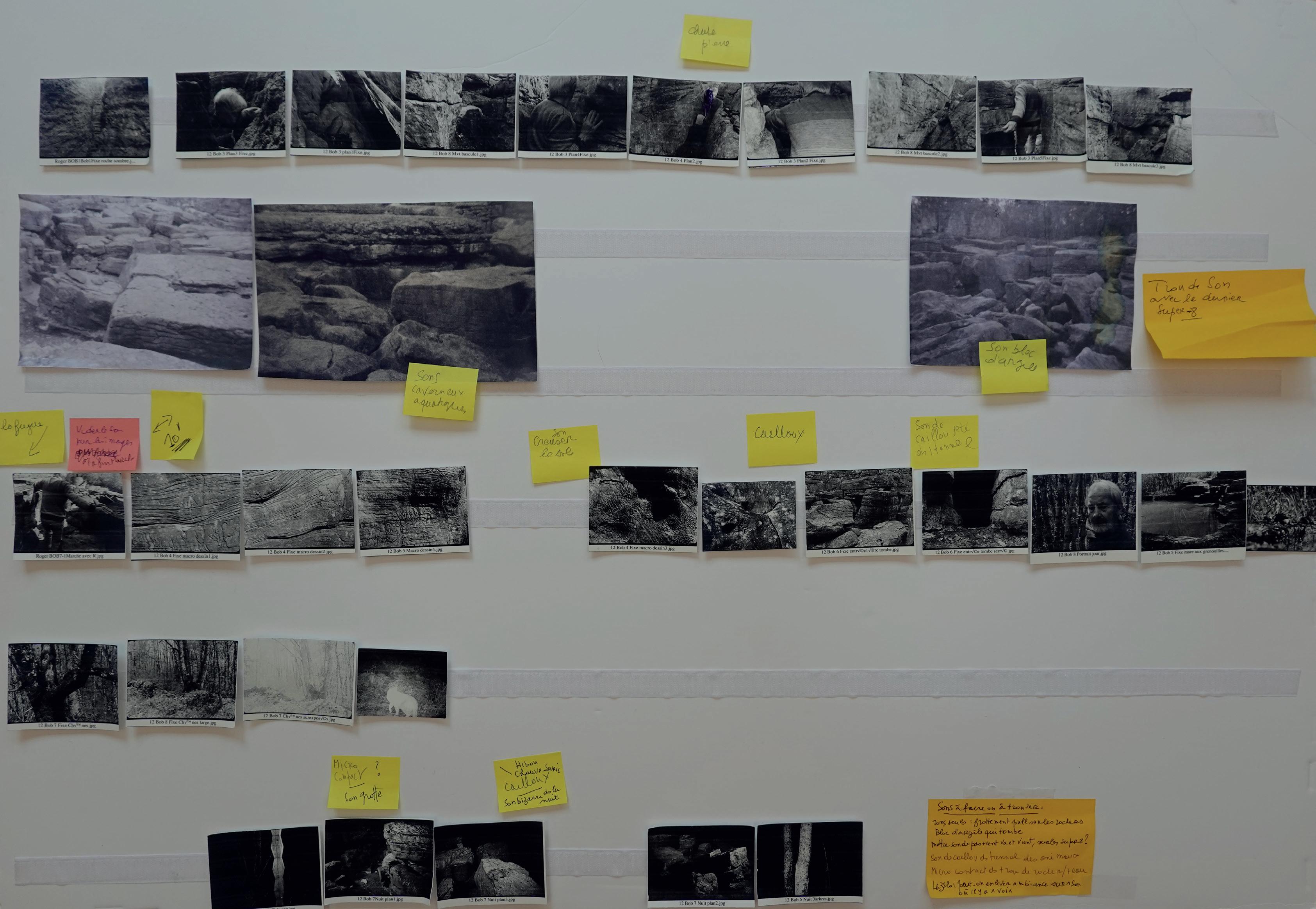

La séquence qui clôture le portrait de Ruben et ouvre la séquence autour d’Hannah Arendt a été tournée sur le site de l’aéroport de Zaventem près de Bruxelles, lequel jouxte un centre de détention pour personnes en attente d’être expulsées du territoire (Steenokkerzeel).
Refugee Blues a été écrit en 1939 par le poète britannique
W.H Auden, ami d’Arendt, laquelle avait pour lui une grande estime.
Le poème est lu par Lucy Grauman — chanteuse et cheffe de chœur qui nous a fait rencontrer Ruben.

Say this city has ten million souls, Some are living in mansions, some are living in holes: Yet there’s no place for us, my dear, yet there’s no place for us.
Once we had a country and we thought it fair, Look in the atlas and you’ll find it there: We cannot go there now, my dear, we cannot go there now.
In the village churchyard there grows an old yew, Every spring it blossoms anew: Old passports can’t do that, my dear, old passports can’t do that.
The consul banged the table and said, «If you’ve got no passport you’re officially dead»: But we are still alive, my dear, but we are still alive.
Went to a committee; they offered me a chair; Asked me politely to return next year: But where shall we go to-day, my dear, but where shall we go to-day?
Came to a public meeting; the speaker got up and said; «If we let them in, they will steal our daily bread»: He was talking of you and me, my dear, he was talking of you and me.
Thought I heard the thunder rumbling in the sky; It was Hitler over Europe, saying, «They must die»: O we were in his mind, my dear, O we were in his mind.
Saw a poodle in a jacket fastened with a pin, Saw a door opened and a cat let in:
But they weren’t German Jews, my dear, but they weren’t German Jews.
Went down the harbour and stood upon the quay, Saw the fish swimming as if they were free:
Only ten feet away, my dear, only ten feet away.
Walked through a wood, saw the birds in the trees; They had no politicians and sang at their ease: They weren’t the human race, my dear, they weren’t the human race.
Dreamed I saw a building with a thousand floors, A thousand windows and a thousand doors:
Not one of them was ours, my dear, not one of them was ours.
Stood on a great plain in the falling snow; Ten thousand soldiers marched to and fro:
Looking for you and me, my dear, looking for you and me.
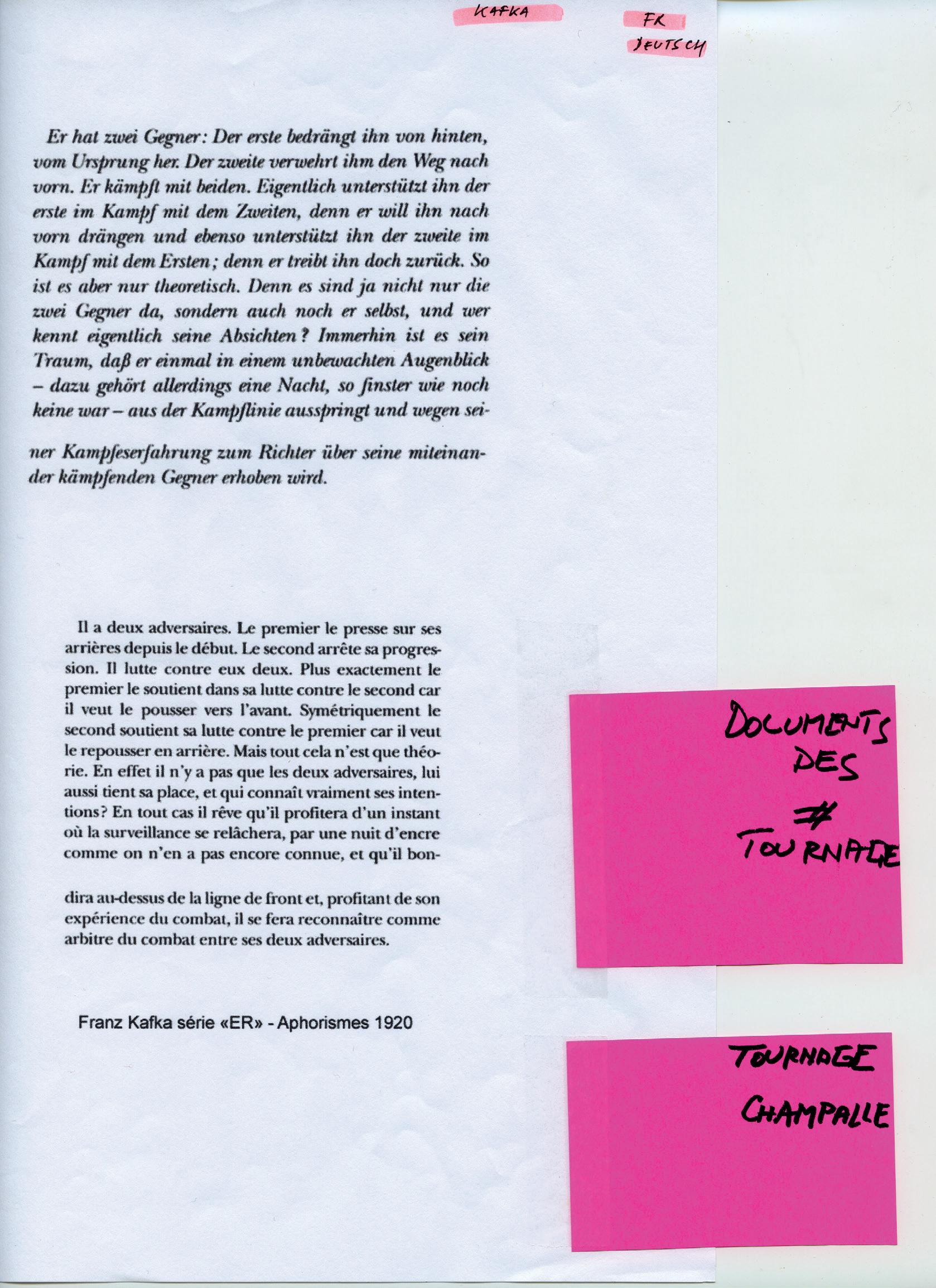
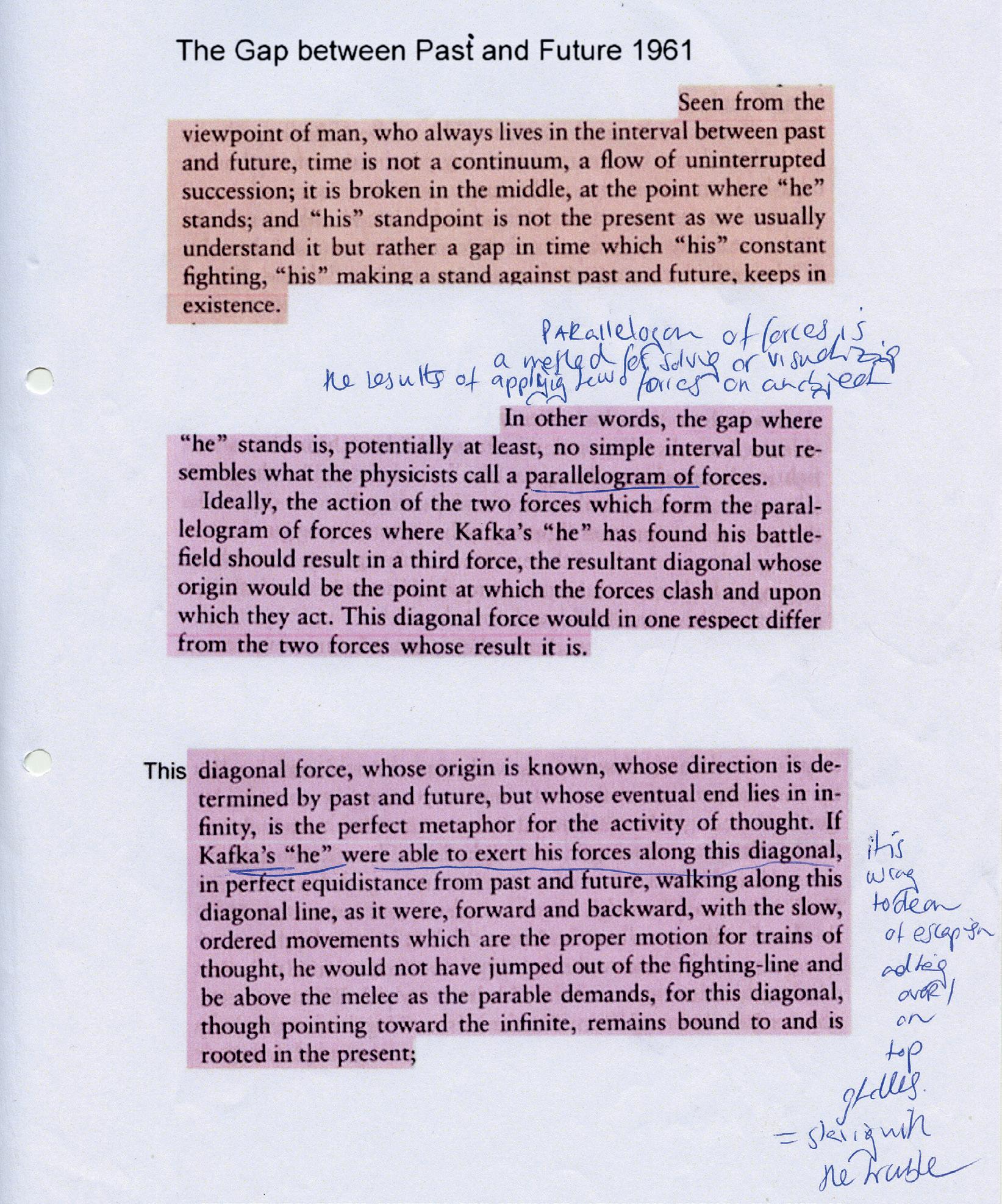
Lettre de Claire
3 janvier 2022

I find the the two energies and situations that you describe very helpful to think. On one side the restriction from movement, the inner turbulence of being kept, immobile, dependent , looked at, observed, restless - and on the other side the movement that almost explodes in the moment when Hannah leaves the camp de Gurs- which is also a form of turbulence , the energy and empowerment that arises from being able to make her decisions again, to move again - an energy that goes forwards , falls forwards, always unfolds towards the future.
When thinking about Gurs I wonder also about boredom and its relation to imprisonment . I think for many prisoners boredom can become a form of terrornext to fear and depression. I imagine that for Hannah boredom must have been something terrible -something that she was strongly against - I wonder if boredom is a sensation that was ever arising for her when she was at Camp de Gurs - what would be her strategies to fight against boredom.
I am also thinking about movement that loops , as there are only limited pathways one can take in a restricted space, about pathways that repeat every day, over and over , about the necessity to experience and feel change in a never changing environment.
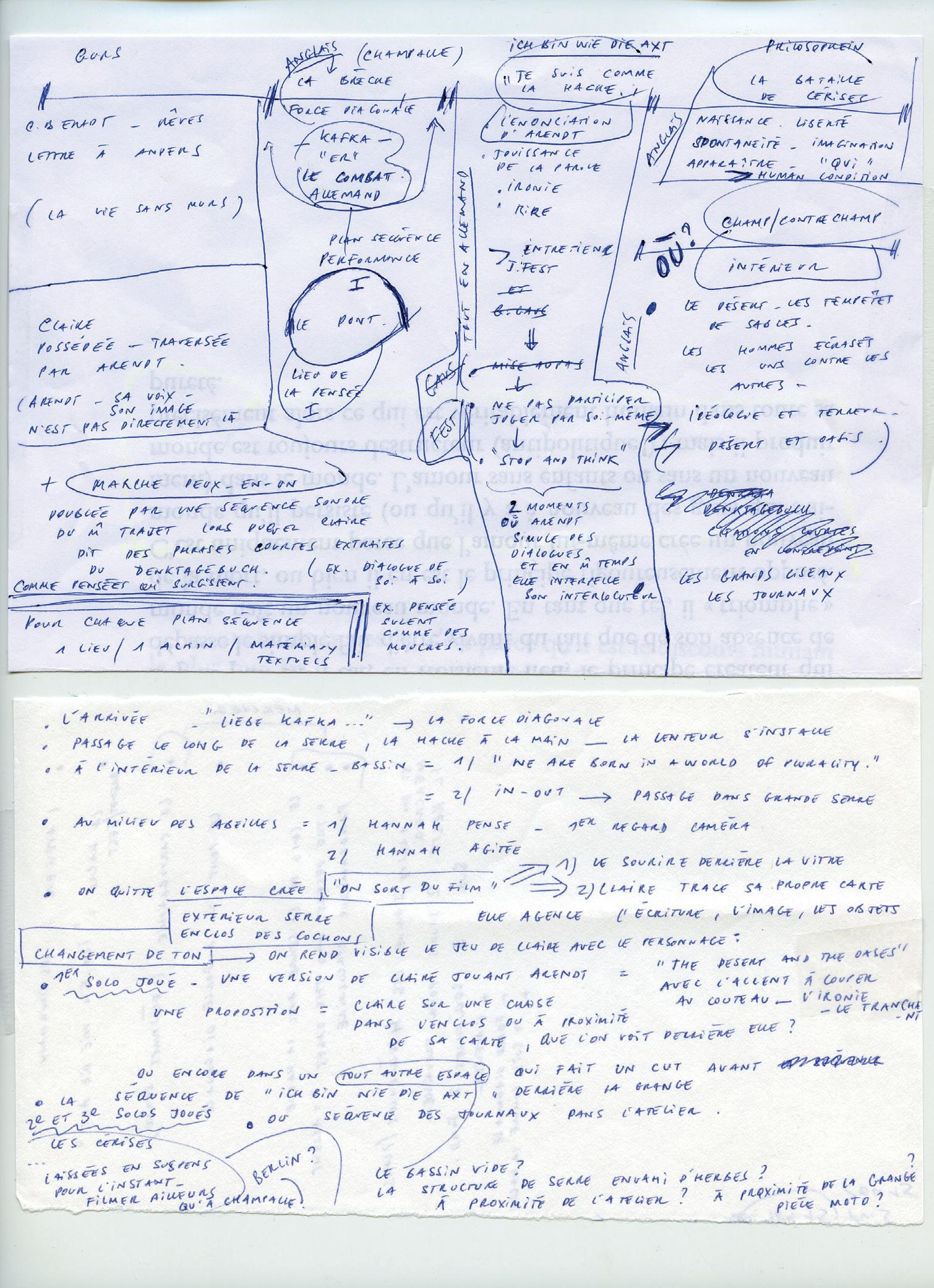
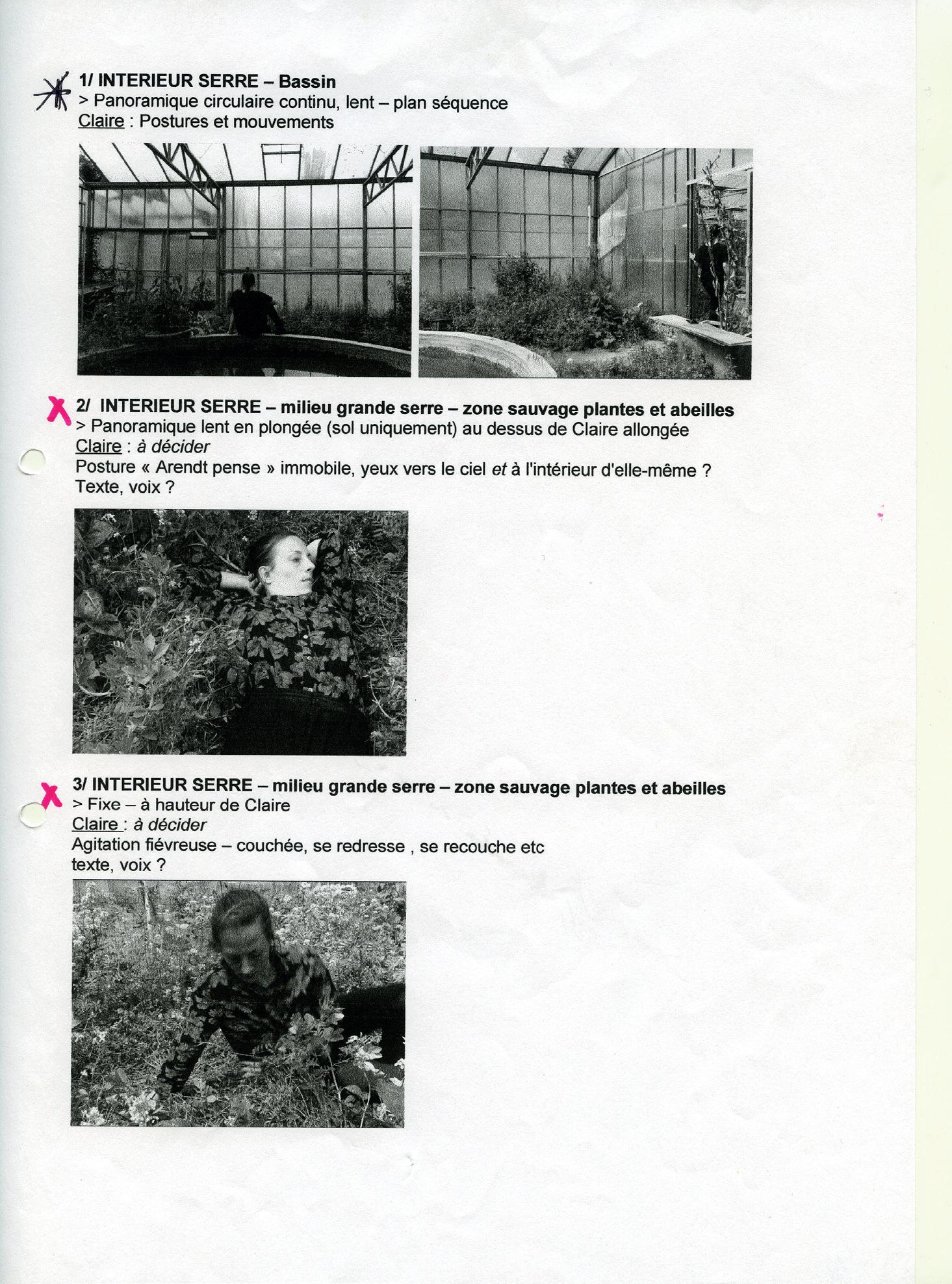

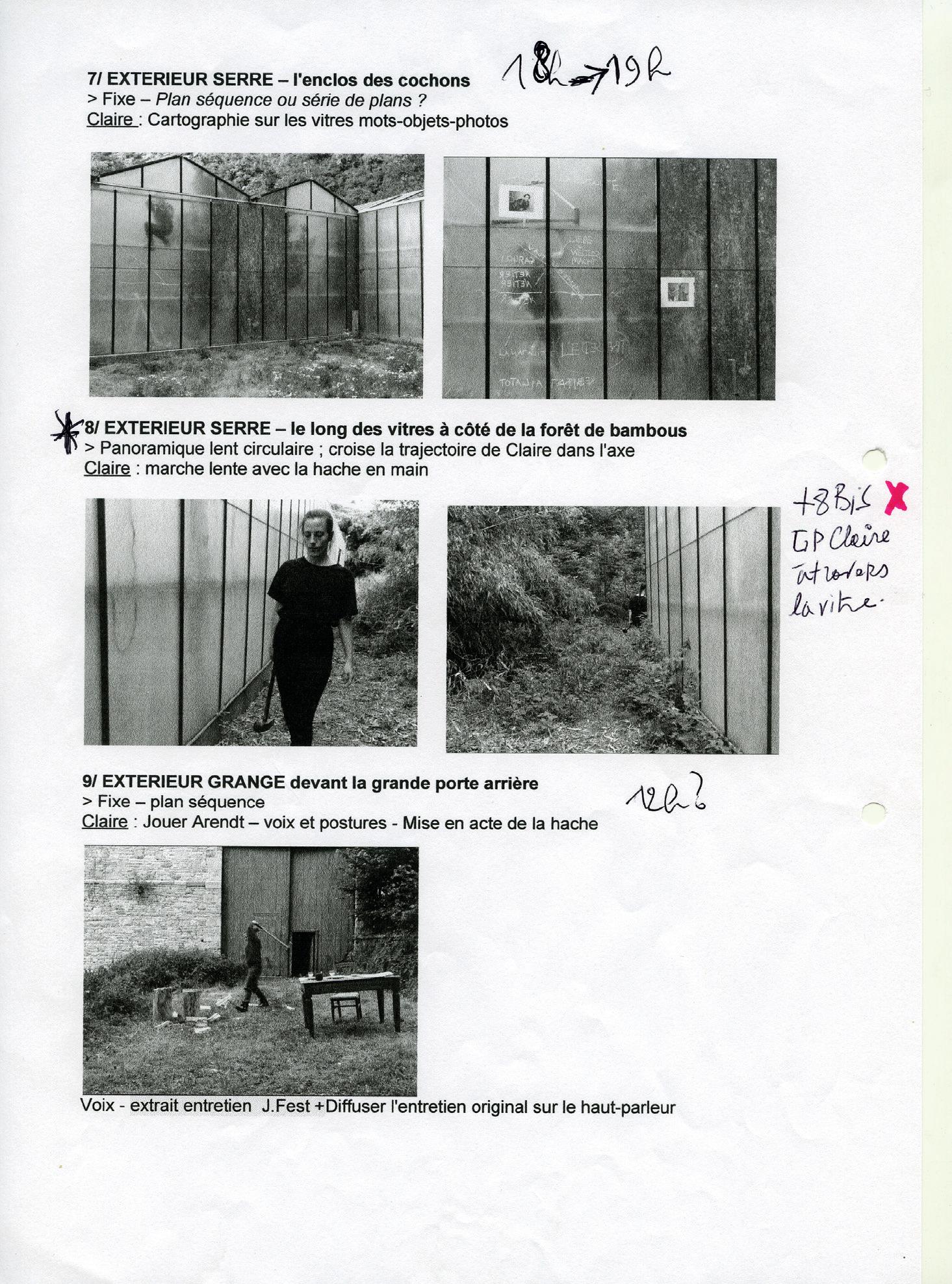
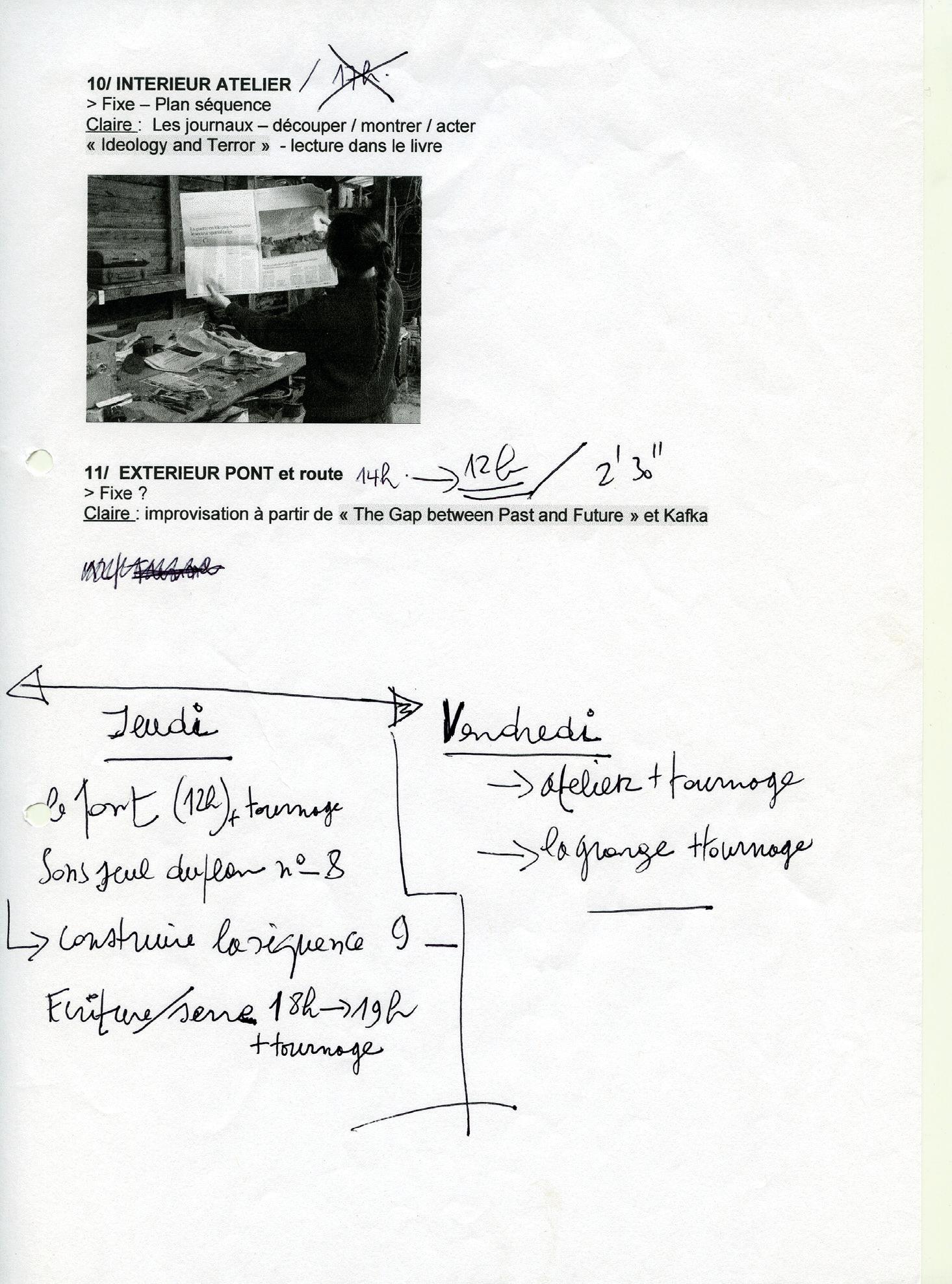





Maxime Martinot
Mathilde Girard
On a toujours l’impression qu’un chemin a raison par avance.
Je ne sais pas encore exactement ce que je veux dire, avec cette idée, mais je vais la suivre.
C’est peut-être à cause du titre que j’ai choisi, qui renvoie comme ça à celui d ’Heidegger (Chemins qui ne mènent nulle part) — et donc à un certain rapport entre un chemin et le retour à l’origine, la raison de l’origine, que j’ai voulu tronquer, faire bifurquer, pour que le chemin mène et ne retourne pas.
J’en ferais une sorte d’orientation, à la fois critique et écologique qui me vient de ce film : apprendre à considérer la raison d’un chemin ou d’un paysage, fût-il désolé ou disparu, à partir de son action, de sa puissance, de sa direction — et pas seulement dans le regret de ce qu’il était ou de sa mémoire.
Comment rendre active la résistance d’un chemin en train de disparaître de la carte ?
Un chemin a toujours raison parce qu’on est obligé de le suivre, parce qu’il nous mène d’un point à un autre, parce qu’il nous précède et qu’il en sait plus que nous sur ce que nous avons fait du paysage, et donc de nous-même. C’est une connaissance assez profonde, mais pas très facile à décrire.
La connaissance de notre rapport au chemin ou au sentier passe par la marche, par la pratique de la randonnée, par la connaissance du cadastre, par l’intérêt qu’on peut porter à un paysage. Mais sitôt dit cela, on sent bien qu’on ne dit pas tout, qu’il ne s’agit pas seulement de cadastre, de randonnée, mais aussi d’imprégnation et de pensée (Heidegger a raison un peu, mais pas jusqu’au bout) : c’est aussi une image de nous-même, à l’envers : le chemin où l’on s’est nous-même mené.
Le sentier est alors à l’image de l’histoire, de plusieurs histoires, et aussi mon destin momentané. C’est l’espace qui a été dessiné pour moi, pour les gens, avant nous, pour qu’on puisse se déplacer, depuis longtemps. Il garde la marque de cette transformation primordiale, à la fois primitive et déjà conqué-
rante, de la plus amoureuse à la plus destructrice, de l’action de l’homme sur le paysage.
C’est une randonnée qu’on peut faire. Il existe plusieurs sentiers des asphodèles en France.
La randonnée des asphodèles du Morbihan s ’affiche en premier sur Google : distance 9,3km, durée 2h20.
Mais ce n’est pas un film de randonnée, ni seulement l’histoire d’un chemin dont on a perdu la trace. C ’est aussi la fiction d ’ un personnage, Jean (Marius Loris), ce grand être que son frère Simon (Léo Richard) pousse dans une brouette, au tout début du film. Jean ne s’intéresse pas au chemin, il ne regarde pas autour de lui. Il le fait, il l’écoute, le ressent, le regard lancé à l ’horizon avec la même détermination invisible qu’on trouve dans le regard du chien. C’est d’ailleurs un agence-ment à proprement parler : Jean et le chien, l’un l’autre qui échangent leurs rôles quelquefois dans le geste cahotant de la caméra qui suit leur avancée sur le sentier.
Il y a donc le sentier, raconté par toutes les personnes que l’on rencontre, les amis qui marchent l’été, celles et ceux qui l’ont connu, qui l ’ont traversé et se souviennent — et le marcheur, Jean, mais qui ne marche pas vraiment, en tout cas pas fermement.
La raison du chemin réside dans toutes ces histoires que les gens racontent, des histoires de pays, de Bretagne, de guerre et de résistance paysanne. On avance alors comme on remonte le temps, comme on retrouve la mémoire, ou qu’on nous la transmet. On descend vers le Moulin, les indications sont claires. Les histoires qu ’ on écoute sont les fragments éclatés de la rencontre entre un paysage et les gens qui le défendent, et la logique de l’un et de l’autre.
En même temps, comme un ralentissement, il y a la marche de Jean qui suit le fil aléatoire de ses pensées. Il dit les mots du sentier pour les entendre, le vocabulaire qui le fait : le pas, le panneau, le parcours, le cadastre, le fil électrique... Il avance avec les mots du
chemin, il les découvre, c’est son poème, et le poème ne coïncide pas. C’est ça qui est bien. C’est le principe négatif du chemin, là où je suis dans mes pensées, là où les mots ne sont pas des descriptions du paysage, là d’où part une logique autonome à la raison du chemin.
Entre ces espaces — qui sont aussi marqués, dans le film, par l’usage de différentes caméras — se joue le paradoxe ou bien la dialectique (il faudrait réfléchir) de l’avancée de l’histoire et du piétinement, du souvenir et de l’oubli, de l’événement et de l’interruption. Dans le pas trébuché de l’homme, presque un idiot ici, un pur témoin, on pourrait reconnaître un Lenz (celui de Büchner) moins tragique, sur qui s’impriment les joies et les tourments du paysage, lequel se confond peu à peu à ses pé r égrinations intérieures, poétiques et muettes.
Si l’histoire et le chemin ont raison, et sont m ême h é ro ï ques, pétris de la mémoire collective — je pense à cet homme caché dans un fossé averti par une couleuvre que les Allemands allaient venir le trouver —, les hommes les femmes, chacun.e descend toujours aussi autrement dans son moulin : c ’est la moulinette des pensées, le jeu, l’aléatoire, l’incertitude, le trébuchement.
Il n’y a pas de morale à tirer, seulement ça construit une durée particulière et surtout un rythme propre à ce film qui réussit à faire les 9,3 km du sentier en passant par l ’immobilité de la pensée, qui avance à l’intérieur et à l’extérieur en même temps, en éprouvant le retour au même, le doute et la répétition.
Châ teau d ’ eau - Villeneuve - Moulin de Villeneuve - Guern Vihan - Saint UrloGuernléoret -Les Kaolins - Keriel - Petit Keriel - Lanzonnet - Kerminé
Au fil des histoires, des arrêts, des villages, le film approfondit la recherche de l’endroit où les gens pourraient se rappeler, et aller à cette connaissance du paysage qui est
équivalente à un savoir sur la résistance. Il y a des mots pour dire ça : le fossé, le talus. La transformation du paysage, que l’on voit et que l’on éprouve à la rencontre des récits et du moulin des pensées, donne forme à une mémoire qui ressemble plus à l ’intuition d’une action qu’à la nostalgie des asphodèles ou des fossés.
Le paysage ne parle pas, et le ciné ma a inventé plusieurs façons de renouveler sa potentialité résistante de façon à ce qu’elle serve, en quelque sorte, à la connaissance et à l ’action humaine, par-del à les époques, les destructions et les disparitions. Je pense à Trop tôt trop tard, de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, auquel Maxime Martinot avait emprunté un plan pour un film précédent, Histoire de la révolution, le travelling de la place de la Bastille. Marius Loris y faisait l’improvisation précipitée du cycle infernal des révolutions et des contre-révolutions.
Le Sentier des Asphodèles suit une autre piste, qui nous rapproche des questions actuelles de résistance et de paysage, mais cette fois la différence entre l’autrefois et l’aujourd’hui n’est plus remise à la dialectique des textes en off, des sons et des images, mais aux récits des gens du sentier, et au trébuchement poétique du personnage de Jean, lui-même sentier, chemin de traverse de toutes les voix rencontrées.
Si un film n’a pas besoin de s’inscrire dans son époque, ou dans l’époque d’une question qui peut prendre la forme d’une lutte, je ne peux pas m ’empêcher de réfléchir aux moyens que celui-ci nous donne de renouveler une façon de filmer politiquement le paysage, le paysage breton, le paysage partisan. À ce film qui raconte comment la résistance épouse l ’intelligence d ’un paysage, au point de les rendre indissociables, on pourrait associer les images que nous avons tous·tes vues de la grande scè ne de guerre sur le champ compl è tement nu des bassines à Sainte-Soline, en mars 2023, qui se donne comme vé rit é d éfinitive de la condition d ’exposition radicale de la nature érodée,
usée, et de l’homme sorti de la cachette du fossé. C’est la figuration d’une lutte, de son danger, quand tous les sentiers ont disparu.
Et je reviens à Jean, à ce personnage, et je me dis alors que son trébuchement est aussi autre chose que l’arrêt, l’immobilité, l’hésitation : le changement brusque, la possibilité du changement et de la décision, au contraire, dont dépend toute résistance, toute insurrection, à la mesure du sujet qui pense.
Maxime Martinot
Ce film joue sur des mots, eux-mêmes contradictoires : histoire désigne autant la liaison générale du cours des événements, que la particularité intrinsèque et fragmentaire de chacune des expériences ; révolution désigne autant le mouvement cyclique, que la rupture brutale d’un système établi.
Le propre du langage est sa capacité à se retourner en calembour (cette « fiente de l’esprit qui vole », selon Victor Hugo). Moins aisé est de prendre les images pour des calembours, réversibles ou « à tiroirs ». Audelà des mots, ce sont ici des imaginaires, des territoires et des signaux que charrient histoire et révolution qui sont montés ensemble, en chœur ou en éclat, collés ou explosés. À nous d’expérimenter la part du cinéma propre à produire ses contrepèteries. Humour et cinéma étant ces moyens qui poétisent la rage, ou enragent la poésie.
L’ironie n’est pas le sarcasme : par exemple dans la phrase entendue dans le film on gagne à chaque fois mais on perd, ce n’est pas là une abdication, une critique ou une façon cynique de dire que toute lutte est vaine ; non, c’est un constat même de la lutte, qui produit une force multiple, de la tension, du contradictoire, mais aussi des graines pour sa propre continuité. On pourrait très bien dire l’inverse : on perd à chaque fois, mais on gagne.
Mais il ne faudrait pas perdre de vue que le premier à tordre le sens des mots, et donc de l’histoire, plus que quiconque, c’est bien le pouvoir. Emmanuel Macron, lors de sa campagne présidentielle, a fait rimer révolution, titre de son livre de promotion, avec la
philosophie libérale qu’il a pu jusqu’ici appliquer, comme un programme naturel, un ordre républicain cyclique, même si éveillant au passage de nouveaux foyers contestataires se mêlant aux luttes pré-existantes.
Comment faire alors quand les termes des luttes sont systématiquement récupérés et digérés par ceux qui ont le pouvoir et maintiennent l’ordre ?
La contradiction étant un point commun entre histoire et révolution, le film fait de ce principe son ADN. Il dialectise l’actualité des événements et l’éternité des signes. Il mélange le pouvoir (dans un sens hypnotique) de la parole et la puissance physique du son. Comme la performance monologuée du poète et historien Marius Loris, qui « vomit » poétiquement l’accumulation des cours d’histoire et des dates que l’on apprend sans fin ni conséquence à l’école. Comme quelque chose qui s’est inscrit en nous, sans que l’on ait pu le comprendre, et rejaillit par la parole de manière effrénée, et inéluctable. Reste que cette parole omnisciente, dans le film, est invisible, non localisable. Nous sommes réveillés, mais toujours perdus, et nous avons besoin de repères neufs. Tout de suite après, survient la seule séquence où image et voix sont synchrones : c’est le présent, et les Gilets Jaunes de St-Nazaire qui réactivent, depuis un endroit et un instant précis, la nécessité de réhabiliter et occuper les espaces de luttes. Et se réaccaparer l’histoire et le temps, s’y insérer physiquement et poétiquement, en brisant et brûlant les jeux de mots du pouvoir, pour réchauffer nos propres calembours.
Histoire de la révolution est un film de Maxime Martinot, datant de 2019, d’une durée de 30 minutes. Il est visible sur le site dérives.tv : https://derives.tv/histoire-de-la-revolution/
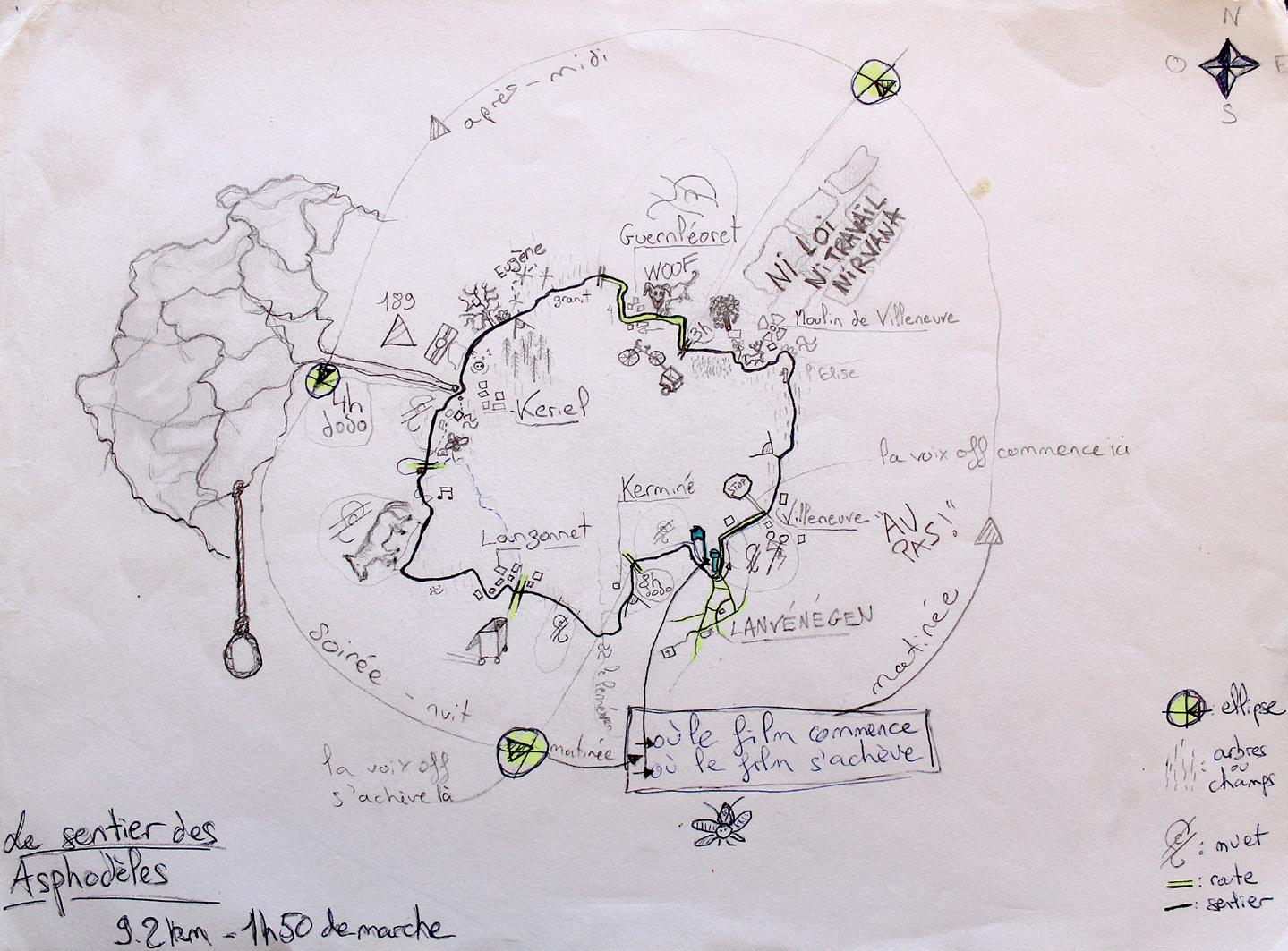
Le sentier des asphodèles est un circuit de randonnée. Cette carte a aidé à préparer, penser et tourner un film qui va vers où il vient. Elle a été faite en deux temps, entre le début de l’écriture (2016, ci-dessus) et le tournage (2021, à droite en haut), et a accompagné toute la post-production (2021-2023, à droite en bas). Cette carte nous a servi à la fois :
• de carte - scénario : pour défaire le scénario de sa linéarité présupposée ; et « pré-voir » le film dans sa globalité, tout en ciblant dans sa course circulaire quelques éclats de microhistoires du sentier.
• de carte - logistique : plutôt qu’un « plan de travail » classique de tournage, imaginer un établi imbriquant : la matière et l’outil, le film imaginé et l’équipe qui le fait ; indiquer la relation insécable entre le film et sa fabrication ; l’équipe était logée sur place (Keriel et le bourg), l’errance du personnage croise les chemins d’accès de l’équipe.
• de carte - storyboard : en chronométrant l’espace parcouru et en spatialisant le rythme, cette carte permet de synchroniser l’imaginaire pré-existant des repérages avec le travail futur du montage (montage préparé dans le présent du tournage).
Maxime Martinot & Léo Richard
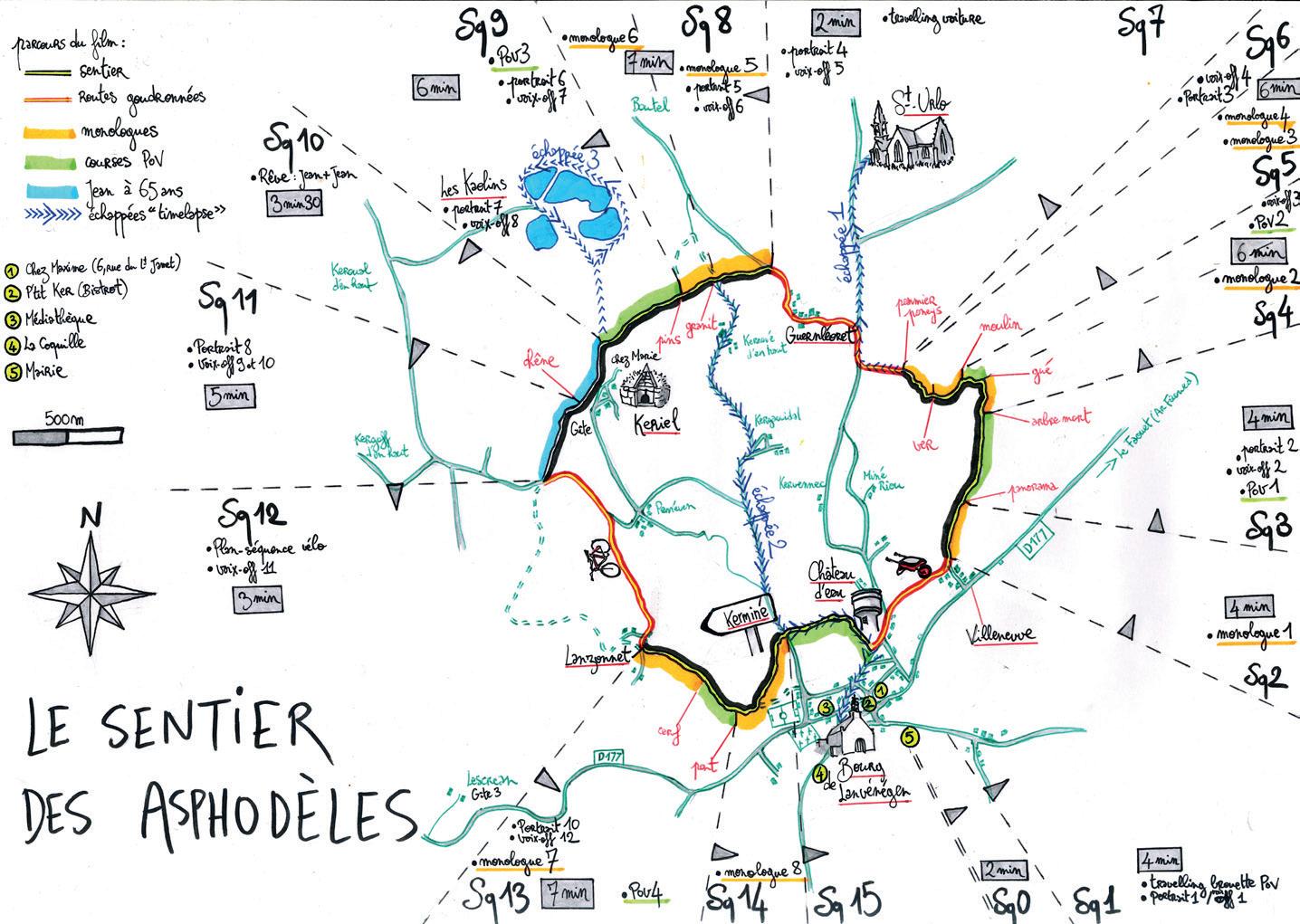

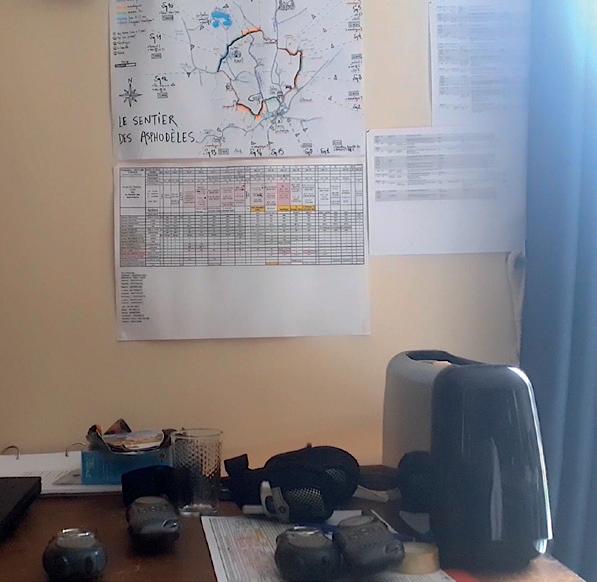
Fragments choisis d’un entretien avec Margarida Cordeiro et António Reis à propos de leur film Ana, par Yann Lardeau, Cahiers du cinéma n°350, août 1983.
A. Reis. (…) Si on considère une narration comme un tissu, alors notre film est narratif. Si on considère qu’il y a narration quand il y a une histoire entre des personnes, alors notre film n’est pas narratif. (…) Effectivement le film ne raconte que des choses succinctes. Dans ce sens-là, les couleurs, les arbres, la lumière, le temps du film, la durée sont des éléments narratifs comme ce que font les gens, leurs attitudes.
M. Cordeiro. Dans la vie réelle, je crois aussi que les événements ne s’impliquent pas linéairement, ne se produisent pas linéairement. Je crois qu’ils se chevauchent. Pour moi, c’est ainsi, et, pour simplifier, on résume une ligne parmi d’autres, et je crois que le cinéma a à voir avec la manière dont nous regardons la vie.
A. Reis. (…) Margarida et moi-même, nous essayons une dialectique entre le microcosmique et le macrocosmique dans le cinéma. C’est toujours comme ça. (…) Le temps pour nous n’est pas une question de chronologie, c’est une question d’énonciation.


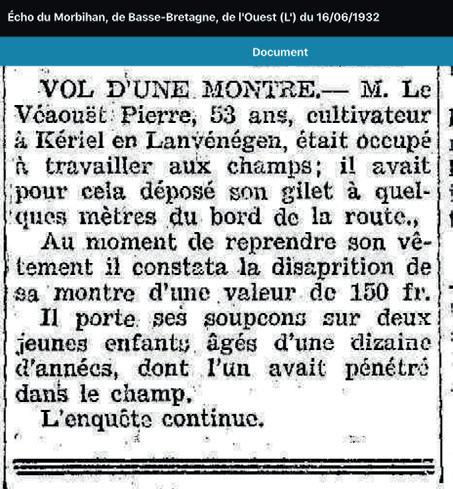

[extraits]
Le premier extrait est le début du monologue prononcé par le personnage dans le film. Le second n’a pas été retenu au montage.
Au pas ?
Faux
faux pas oh il faut pas il faut nos pas mais non il faut pas de faux pas non il faut non pas de pas pas de nom pas de panneau non il faut pas tomber dans le panneau pas tomber dans les pas de nos papas pas tomber en panne pas tomber dedans sur les dents il faut le pas court le cours de nos pas surnommé parcours parcours fait de pas qu’il faut pas nommer pas tomber dans le parcours de panneaux le parcours fait de noms qui mène au non oh non qui mène au fait au fait nommé du fait et nomme fait nommé phénomène phénomène qui fait qu’on nomme tout qu’un panneau phénomène qui parcourt les pas d’hommes pas d’hommes partis faire un tour pas d’hommes référés et repartis faire un tour qui mène au non le phénomène du non au référendum au nom des hommes partis refaire un tour et retombés dans le panneau et pas dans le ruisseau de Villeneuve (…)
(…)
ça aurait pu faire des milliers de livres d’histoire mais c’est quoi que ça trame les histoires ça trame des fils qui font pas des pulls mais des sillons dans la boue des alluvions qui roulent par allusions jusqu’à la mer la géo-graphie c’est bien ce que ça veut dire non on serait sans le savoir des échos graphiés cherchant le pouls de notre géo-histoire la mélodie qui perfore la terre l’éther l’atmosphère et patientant pour la venue du vent je me fais une image du vent dans mon garde-manger pour garder les images quelque part comme on garde les enfants à la garderie garnements imagés mais mes images de vent détalent dès lors que le souffle véritable qui sourd au dehors n’est plus une image le vent n’est pas uni le vent n’est pas une image le vent n’a pas de cou pas de couleur ni de lumière et pourtant le vent fait bouger lumière et couleur crée l’image du dehors sans avoir à exister autrement que par ce qu’il vente et je l’aime c’en est épuisant car le vent rentre dans le ventre et ressort par les puits par l’épuisement de toutes les semences soufflées (…)






« No es lo más interesante la teoría, sino que lo que nos interesa es lo irreductible, que son las personas. — Esas personas » 1 . Ces personnes, ce sont les aveugles du documentaire que monte Eva dans Las cosas indefinidas. Mais ce pourrait aussi être les habitant·es de Puerto Pirámides interrogé·es par les lycéen·nes de ce village côtier de Patagonie dans Las Calles. Ou encore Nora, Lucía, Hernán, Ramiro, que l’on suit au rythme de leur quotidien dans Sobre las nubes. Et d’autres personnages qui peuplent le cinéma de María Aparicio, dont cet échange pourrait être la matrice. Si la r éalisatrice y aborde de grands th è mes — l’histoire du territoire argentin, le travail des classes ouvrières, la transformation des moyens du cinéma, le deuil, la cécité —, l’intéresse moins de disserter sur ceux-ci que de montrer comment, incarnés dans des situations quotidiennes, ils traversent et s’expriment communément dans les corps des personnages. Et c’est précisément dans les liens, parfois ténus, qui unissent les vies ordinaires et sans éclat de ces personnes, qu’elles soient dites réelles ou acteur ices, que se logent la poétique et la politique de son cinéma. Un cinéma humain, c’est à-dire à la mesure des êtres qu ’elle dépeint, qui travaille l ’empathie et la compréhension mutuelle. Un cinéma de l’attention, qui s’écrit film après film depuis une observation aigüe du monde, en une déclinaison de l’inconnu au connu, de l’extérieur à l’intérieur, du bord au centre.
Las Calles (2016), premier long-métrage de María Aparicio, commence ainsi par une séquence de pêche sous-marine en pleine mer, avant de rejoindre la côte vue depuis Puerto Pirámides. C’est ici, dans cette localité de moins de 600 habitant es de la Péninsule de Valdés, qu’entre 2004 et 2010, une professeure d’histoire avait réalisé avec ses élèves un projet consistant à nommer les rues anonymes de leur village. À la suite d’entretiens
1 « Ce qui nous intéresse le plus n’est pas la théorie, mais l’irréductible, c’est-à-dire les personnes. — Ces personnes ».
menés aupr è s de la communauté pour déterminer une liste de noms candidats, une consultation populaire avait permis de nommer trente-cinq de ces rues. La réalisatrice revisite et recrée cette expérience accompagnée d’un acteur et de deux actrices, pour interpréter notamment le rôle de la professeure, Julia. Si la majorité des habitant es qui apparaissent dans le film ont participé à l ’enquête réelle, les adolescents, eux, se mettent dans la peau de leurs prédécesseurs lycéens tout en jouant leur propre rôle. Récits de migration et de résilience face à la dureté de l’économie marine émergent de cette interaction entre générations. Quand un des adolescents confie à Julia sa préoccupation pour la gêne que pourraient susciter leurs questions, c’est justement l’attention portée aux êtres, la précaution avec laquelle la réalisatrice filme ces échanges, qui sautent aux yeux. Caméra à l’épaule, toute entière dans ses personnages, elle cadre près, serré, les visages aux traits profonds de celles et ceux qui sont pour la plupart venu es dans les années 70 peupler cette bourgade du bout du monde. En y invitant une petite équipe de tournage, María Aparicio témoigne d’une préoccupation sérieuse pour l’histoire de son pays, l’Argentine, et pour le rapport au travail qu’implique son territoire. L’oralité rejouée — reposer les mêmes questions, redire, réentendre —, construite sur un système de parole et d’écoute entre élèves et habitant es, devient modalité d’écriture de cette histoire.
On retrouve cette inquiétude dans son court-métrage Buscar trabajo (2022), littéralement, chercher du travail, réalisé dans le cadre d’un film collectif à partir d’archives de films muets argentins (issues de la Collection de nitrates du Musée du cinéma Pablo Ducrós Hicken). La cinéaste met en écho des images de travailleur·ses avec le récit d’un homme observant les conditions de vie des classes
ouvrières en Argentine durant l’année 1903, inspiré du Rapport Bialet Massé 2, texte de référence qui jettera les bases de la loi nationale du travail. Devant cette courte pièce qui offre une perspective historique aux inégalités de l ’Argentine d’aujourd’hui, on songe à James Agee, aux photos de Walker Evans et à la poésie qui se dégage de leur peinture crue des conditions de vie des métayers du Sud des États-Unis.
Toujours depuis une observation de l’espace et de ses habitant es, la réalisatrice fabrique dans Sobre las nubes (2022) sa propre étude, fictionnelle, des visages de la classe moyenne du centre-ville de Córdoba. Le film dépeint le quotidien de quatre personnes, Ramiro, Nora, Hernán et Lucía, qui ne se connaissent ni ne se rencontrent jamais, mais ont en commun d’habiter la même ville. Dans l ’observation et le retrait, María Aparicio laisse ces présences solitaires évoluer en parallèle. La mise en scène, à la fois austère et élaborée, dépouillée de tout effet, est tout enti è re dévouée à ses personnages. Sans jamais hausser la voix, c’est dans la retenue et la mesure que le film se déploie. Sobre las nubes établit un rapport tendu et ténu entre les solitudes de ces quatre personnes, tous·tes assigné·es et renvoyé·es à leur place dans une société atomisée, et une discrète reconquête d’un lien social. La scène d’ouverture montre les quatre personnages, successivement soumis, plan après plan, à une enquête de recensement. En contrepoint de cette humiliation déguisée, une autre scène : cette fois-ci, les membres de l’atelier de théâtre auquel participe Nora, cadrés chacun en plan rapproché, prennent tour à tour la parole pour se présenter au reste du groupe. Répondre à une question venue du hors-champ n’est alors plus synonyme de rabaissement, mais d’une ouverture à l’autre, d’un déploiement. Le plan suivant les montre en cercle avec le professeur. Dans le cadre, ils et elles font groupe. L’art de
2 Informe sobre el estado de las clases obreras en el interior de la República Argentina, 1904
Las Calles, Sobre las nubes, Las cosas indefinidas, María
María Aparicio consiste à représenter les vies en une suite de vignettes, où elle dissémine pr écautionneusement de petites épiphanies. Faire un tour de magie, observer une éclipse, apprendre l’aïkido — art martial créé pour « ramener la paix et l’harmonie dans le monde » après le traumatisme d’Hiroshima et Nagasaki. Quand la communauté a disparu, que reste-t-il ? L’aspiration à la communauté dans un contexte de commune séparation et d ’esseulement. Si les personnages du film semblent dénués de tout sentiment d’identification ou d’appartenance, imposant chacun leur présence quelconque et singulière, c’est dans cet espace, où sensible et imaginaire se mêlent, que se loge la possibilité d ’un retour du lien : dans l ’observation et l ’attention — de la réalisatrice à ses personnages, de ceux-ci entre eux —, dans ces gestes qui élèvent le quotidien à l’insolite, la morosité à la fantaisie. Aussi insignifiants soient-ils, c ’est à travers eux que le film redonne voix à une société atone. La portée politique de Sobre las nubes n’est en ce sens pas fonction de son sujet — le travail — ni de son projet — dépeindre la classe moyenne dans sa relation au travail, ou à son manque — mais plutôt de cette constellation de gestes.
Las cosas indefinidas (2023) d éploie une variation de cette poétique, celle du soin et de l’attention. De sa propre expérience du deuil et d ’une préoccupation pour la survivance des images, María Aparicio tire un film à la fois grave et lumineux. À son propos, elle dit avoir trouvé un moyen de satisfaire son désir de réaliser un documentaire par le biais de la fiction. Centrée autour du personnage d’Eva, monteuse et professeure à l’université, qui vient de perdre un ami cinéaste, la narration avance au rythme de ses échanges avec son assistant Rami et de leur travail de montage d’u n documentaire sur la cécité. María Aparicio a filmé des entretiens avec des personnes aveugles avant de mettre en scène le récit principal. Sont questionnées différentes formes de disparitions, auxquelles
fait écho, tout au long du film, la présence éphémère des fleurs. La mort d’un proche, la mort des images : celles filmées par l ’ami perdu, fragilisées par leur support de stockage, comme celles d’une vision disparue à l’âge adulte. Dans de longs plans fixes, Eva et Rami s’arrêtent, regardent, écoutent, échangent.
Une discussion les conduit à renverser l’ordre dialectique du documentaire : plutôt que de partir de l ’idée de la cécité pour aller vers l ’expérience de ces personnes, il leur faut partir de ces personnes, c’est-à-dire de leur image, pour donner à leur parole tout l’espace nécessaire à son déploiement et toute sa force de convocation. Ainsi procède María Aparicio dans son film. En cadrant avec attention le si singulier visage d’Eva, en prenant le temps de s ’ y arrêter pour en saisir les moindres expressions, hésitations, mouvements, elle prend soin de ses mots. À de longues prises de parole, qui sonnent parfois comme des monologues intérieurs, succèdent des silences dans lesquels les mots, précieux, choisis, résonnent. Pour citer Bresson à nouveau — le titre, Las cosas indefinidas (les choses indéfinies), est tiré d’une phrase du réalisateur à propos de son film Les Dames du Bois de Boulogne — , « les dialogues, c’est où on ne parle pas ». On ne parle pas, mais on se laisse toucher par la grâce d’une rencontre fortuite, comme Eva croisant à un passage piéton, un bouquet de fleurs à la main, le couple d’aveugles qu’elle n’avait vu jusqu’alors que sur son écran d’ordinateur. On ne parle pas, mais on se regarde dans les yeux. Même si les larmes montent quand on entend Rami dire : « tout va finir par aller bien » . Et l’on continue, malgré la tristesse, d’imposer sa présence, timide et fragile, humble et digne, comme Eva et Rami, Nora, Luc ía et les autres, et comme María Aparicio, discrète et solide, dans le cinéma d’aujourd’hui

Entretien avec María Aparicio
réalisé et traduit de l’espagnol par Louise Martin Papasian
La 5ème Semaine mondiale de la cinéphilie vient de se terminer à Córdoba, avec un programme très éclectique de films rares. Pouvez-vous m’en dire un peu plus sur cet événement ? Comment est né ce projet et qui en est à l’origine ? Qui en assure la programmation ? Comment choisissez-vous les films ?
Mon implication dans la Semaine Mondiale de la Cinéphilie est assez périphérique, mais je suis très proche de l’épicentre de l’événement, qui est organisé par les personnes qui gèrent la revue La vida útil, ainsi que par l’Association des amis du Cineclub Municipal Hugo del Carril. L’un des membres de La vida útil est Ramiro Sonzini, mon compagnon (aussi acteur et monteur de Las cosas indefinidas) et les autres sont des personnes qui me sont très chères. D’une certaine manière, tout ce qui se passe à la Semaine est très proche de moi, mais j’ai la chance d’en faire l’expérience en tant que simple spectatrice car ce sont elleux qui font tout le travail. L’événement a commencé comme un jeu et s’est ensuite transformé en quelque chose de vraiment spécial C’est un festival de cinéma dont les protagonistes ne sont pas les cinéastes, mais les films et les spectateur ices La « sélection officielle » est programmée par trois personnes qui sont invitées à choisir des films selon un mot d’ordre assez large pour qu’elles puissent se l’approprier librement Cette année c’était « la fin et le début » ; et les résonances avec l’Argentine du moment étaient centrales. Il y a ensuite d’autres sections qui sont programmées par des membres de La vida útil, avec quelques collaborateurs comme le Musée
du Cinéma de Buenos Aires, ainsi que des discussions et des rencontres. C’est un petit événement, réalisé avec très peu de moyens, mais il grandit d’année en année et remplit les salles du Cineclub, ce qui est passionnant.
Pouvez-vous également me parler du Cineclub Municipal Hugo del Carril, où a été tournée une séquence de votre dernier film Las cosas indefinidas et qui semble être un lieu de référence pour les cinéastes et les cinéphiles de Córdoba ?
Il y a une grande vitalité autour du cinéma à Córdoba, principalement parce que l’université nationale admet environ 400 étudiants dans le pro-gramme d’études cinématographiques chaque année. Les politiques publiques permettent également depuis une quinzaine d’années d’avoir une certaine régularité dans la production de films, à différentes échelles. À cela s’ajoute une tradition cinéphile qui existe depuis de nombreuses années et qui génère des espaces de rencontre et de réflexion sur les films, comme le Cineclub, qui est un noyau fondamental pour l’ensemble de la communauté cinématographique. C’est un cinéma situé au centre de la ville, ouvert du lundi au lundi, avec quatre séances par jour, et qui est aussi un bar, une bibliothèque et une école.
Il est douloureux de penser que beaucoup de choses que je mentionne là risquent de ne plus exister à court terme : non pas le Cineclub ( jusqu’à présent) mais les universités et les politiques publiques qui accompagnent les secteurs culturels.
Vous avez évoqué la revue La vida útil comme faisant partie de l’organisation de cet événement, et j’aimerais vous interroger sur votre rapport à la critique cinématographique : est- ce que vous la lisez beaucoup ? Avez-vous déjà écrit, écrivez-vous dans cette revue ou dans d’autres ?
Pour moi, la critique n’est rien d’autre qu ’ une réflexion sur le cinéma, qui est à son tour une réflexion sur le monde. Comprise comme telle, c’est quelque chose qui m’intéresse et qui m ’ a beaucoup appris En général, je trouve les discussions et les idées sur le cinéma dans les secteurs de la critique ou de la programmation beaucoup plus vitales et intéressantes que celles que je trouve parmi les cinéastes En même temps, la question cinéphile court toujours le risque de se refermer sur elle -même et de perdre ce qui fait le sens du cinéma : le monde qui le contient J’essaie donc d’être un peu vigilante, de ne pas me laisser submerger par ce qu’est censée être la cinéphilie. Mais oui, je dois dire que pour moi, la lecture de Persévérance de Daney, les cours de Roger Koza ou les recherches sur l’histoire du cinéma ont été des choses fondamentales. Je me souviens que lors d’un de ses cours, Roger a dit quelque chose comme « la cinéphilie est une disposition à être modifié e ». C’est bien de cela qu’il s’agit. Sinon, j’ai collaboré à quelques textes de La vida útil mais ce n’est pas quelque chose que je fais souvent (écrire sur les films).
Vous enseignez le cinéma dans une université à Córdoba, diriez-vous que cela a une influence sur votre pratique cinématographique ? Je relie également cette question
au personnage principal de Las cosas indefinidas, Eva, qui est professeure de cinéma et monteuse. Dans un de ses cours, elle souligne la responsabilité des cinéastes face aux images (d’archives) qui, par la force du retour du passé, peuvent aussi « modifier l’ordre du monde ». J’aimerais revenir sur ces deux idées très fortes : l’importance de l’acte de sélection et d’élimination des images d’une part, et le pouvoir dialectique des images d’autre part.
Ma relation avec l’enseignement s’est intensifiée ces dernières années. D’une part, c’est une source de travail beaucoup plus attrayante — bien qu’elle soit beaucoup moins bien rémunérée, du moins en Argentine — que d’autres emplois que j’ai exercés dans le domaine de l’audiovisuel. J’aime les échanges avec les étudiant·es, en même temps ça m’aide à repenser à des idées qui me préoccupent, que je dois élaborer de façon à ce qu’elles puissent faire sens pour quelqu’un qui commence tout juste à approcher le monde du cinéma. C’est peut- être un truisme, mais je veux aussi être proche de ce que pensent les jeunes de vingt ans de cette époque, même si ce que je vois me préoccupe Aujourd’hui que le fascisme, sous des formes apparemment insignifiantes, pullule partout, même dans les écoles de cinéma, penser et enseigner devient d’autant plus exigeant et stimulant Et je pense que la deuxième partie de votre question est également liée à cela J’énonce un autre truisme : il est impossible de comprendre le renforcement de la droite mondiale en ce moment sans la présence des réseaux sociaux, où les images circulent et envahissent, sans discernement et violemment. La dialectique des images semble être saturée et en
même temps appauvrie comme jamais auparavant Le même instrument qui produit nos films est aussi celui qui génère cette saturation : la caméra, le montage, l’image en mouvement. Où est donc le cinéma, nul ne le sait, mais c’est là, dans l’inconfort de cette question, qu’il y a pour moi du sens à faire des films.
Le titre de Las cosas indefinidas vient d’une phrase de Robert Bresson à propos de son film Les Dames du bois de Boulogne, où il dit « tous ces personnages qui se dirigent dans les films vers des choses indéfinies ». Pouvez-vous la commenter ?
À quel moment cette phrase est- elle apparue comme titre du film ?
C’est un fragment que j’ai toujours trouvé très beau. Je pense que sa beauté est en partie liée au fait que les métaphores qu’il utilise ne pourraient pas exister s’il s’agissait d’un film numérique. Le fragment commence par dire : « Le film fera deux kilomètres et demi de long La distance qui sépare Villeneuve-surLot de la colline de Pujols, que je voyais de ma fenêtre dans mon enfance, où un pin chaque jour levait pour moi l’étendard de l’aube ». La pellicule de celluloïd sur laquelle est imprimée chacune des images peut être mesurée et touchée Si elle était étalée par terre, son étendue serait équivalente à la distance qui sépare deux points dans l’espace, ce qui est impossible si l’on pense à ce qui constitue le support numérique : des circuits électroniques, des 0 et des 1. Eh bien, je pensais à ces choses-là et soudain, dans ce fragment, il y avait tout cela condensé d’une manière si simple et si gracieuse Le fragment poursuit en disant :
Las Calles, Sobre las nubes, Las cosas indefinidas, María
« On peut compter les pas d’un film. Il avance, comme un homme sur un chemin ». Cela m ’ a fait penser directement à un film de mon ami Pablo (à qui Las cosas indefinidas est dédié), intitulé Los pasos de Antonio, dans lequel il filme son grand-père marchant le long d’un chemin qu’il empruntait tous les jours. Lorsque Pablo est mort et qu’il restait chez moi un disque dur contenant ses archives — comme cela arrive à Eva dans le film —, j’ai eu la sensation qu’il y avait un point où la discussion sur la transition analogiquenumérique des images pouvait rencontrer l’idée de la mort, parce que dans les deux cas il y a un abandon — ou une transformation, selon ce que l’on croit — du support matériel ; le corps, le celluloïd. Ensuite, le fragment parle des personnages du film de Bresson, et dit finalement : « Tous ces personnages qui, dans les films, se dirigent vers des choses indéfinies ». Et j’ai trouvé cela presque révélateur, car dans les films comme dans la vie, l’indéfini — le contradictoire, le douteux, le complexe — est inhérent à l’existence. En général, je pense que les personnages que j’aime, qui, lorsque je les vois dans les films, me font penser qu’ils sont porteurs de cinéma, ont immanquablement un trait indéfini.
J’ai donc pensé que ça pourrait être Eva, une femme qui aime le cinéma mais qui le rejette aussi, qui a consacré sa vie au montage mais qui en a un peu marre, qui veut être présente mais qui en même temps fuit les lieux, qui veut travailler sur
de nouveaux films mais qui ne trouve pas le moyen de s ’ y intéresser, jusqu’à ce que finalement quelque chose se passe, une étincelle apparaisse, un indice, un signe, une intuition, et que l’on passe à autre chose. Lors d’une projection, un ami m ’ a dit que la seule chose qui soit vraiment définitive est peut- être la certitude qu ’ un jour nous allons mourir Pour le reste, nous ne savons pas grand- chose. « Arte que también pasará Cinta de nubes que un soplo disipará »1
Je reviens à ma question sur l’enseignement : dans Las Calles, Eva Bianco jouait déjà une enseignante, non pas de cinéma mais d’histoire. Il me semble qu’il y a une ligne qui traverse vos films, qui est celle de la transmission, de la circulation du savoir, qui se matérialise par une forte présence du dialogue. Qu’est- ce qui vous intéresse dans le fait de filmer la parole — à la fois celleux qui parlent et celleux qui écoutent — ce que vous faites avec une attention toute particulière ?
Ce n’est pas très clair. Je crois que ce qui m’intéresse, ce sont les gens, avec leurs horreurs et leur grandeur, et les liens qui se tissent avec les espaces, avec les changements, avec le passé et avec l’avenir. C’est étrange parce que chaque film implique un dévouement très intense à ce qui est filmé, à ses personnages et à ce qui les entoure, et en même temps, du moins pour moi, il n ’ y a pas de vision à long terme, pas de spéculation ordonnée qui me permette d’avoir une idée claire de
1 « Art qui passera aussi. Un film de nuages qu’un souffle dissipera. »
ce qui va suivre. J’ai toujours essayé d’être cohérente avec ce qui me tenait à cœur et avec les gens avec qui nous avons fait chaque film, et de ne pas perdre de vue la générosité du cinéma à mon égard. Mais il est agréable de penser que les films laissent une trace qui, avec le recul, a un sens.
Je suis frappée par la trajectoire que vous avez suivie au cours de vos films : vous avez commencé à 23 ans en filmant une communauté à laquelle vous n’appartenez pas, dans la province de Chubut, très loin de chez vous (Las Calles), puis vous avez posé votre caméra dans le centre -ville de Córdoba où vous habitez (Sobre las nubes), jusqu’à transformer votre propre maison en décor, en faisant appel à des proches, dont Ramiro Sonzini, monteur et acteur, et en vous mettant en scène comme réalisatrice d’un documentaire à l’intérieur du film (Las cosas indefinidas). Comment voyez-vous ce mouvement ? Pourquoi êtes-vous partie de loin pour arriver à quelque chose d’aussi proche ?
Il y a un mouvement de l’extérieur vers l’intérieur, c’est certain. Je crois qu ’ avec Las Calles, j’ai voulu connaître le cinéma, je voulais savoir ce que cela signifiait d’être au milieu des plans, des personnages, des difficultés du travail, des décisions. Tout cela m’était jusqu’alors inconnu et difficile à imaginer C’était aussi une tentative de vérifier que le cinéma pouvait être différent de ce qui était enseigné à l’université et pratiqué sur les
Toutes les citations en rapport au du film de Bresson sont tirées du livre Autour des Dames du Bois de Boulogne, Journal d’un film de Paul Guth (1945).


tournages, avec beaucoup de techniciens et de grands décors, et qui me paraissait si loin. À ce moment-là, c’est la voie que j’ai trouvée : chercher à l’extérieur les préoccupations que j’avais à l’intérieur. Je pense aussi que faire des films comme ça — sans beaucoup de garanties — implique un engagement très personnel, presque existentiel, dirais-je Eh bien, j’avais besoin de regarder dehors, loin de chez moi, dans un endroit inconnu, pour me rapprocher de cette chose personnelle, de ce qui me permettait de commencer à comprendre comment je pouvais coexister avec le cinéma. Dès lors, chaque film est une exploration, et c’est ce qu’il y a de plus fascinant. Ce que l’on découvre modestement dans un film donne envie d’explorer autre chose et ainsi de suite. Cela ne veut pas dire que ce mouvement de l’extérieur vers l’intérieur est indéfectible, mais curieusement, c’est ainsi que cela s’est passé jusqu’ici.
Votre court-métrage Buscar trabajo (2022) traite de la situation des classes populaires argentines au début du XXe siècle, sur la base d’un texte écrit par Juan Bialet Massé en 1904, Informe sobre el estado de las clases obreras en el interior de la República Argentina2 . Sobre las nubes dépeint des personnes issues de la classe moyenne dans leur relation au travail D’où vient cet intérêt pour les classes moyennes et ouvrières ? Qu’est- ce que cela implique d’introduire la notion de travail dans votre propre travail de cinéaste ?
Cela vient peut-être du fait que j’ai grandi et vécu toute ma vie dans le centre d’une ville où il est impossible de détourner le regard. J’ai peut-être aussi hérité du regard de mes parents sur la rue, sur le travail, sur les autres, je ne sais pas. Dans les villes, à côté de toi, il y a quelqu’un qui n’a pas mangé, qui n’a pas de salle de bain, dont le lit est le meilleur carton qu’il a trouvé dans vos poubelles, qui ne parle à personne parce que tout le monde s’en fout. Tout le temps et de plus en plus. Je suppose que ma préoccupation pour le travail en tant que médiateur entre la pauvreté et la subsistance vient de là, de la tentative de comprendre ou de remettre modestement en question l’ordre hostile dans lequel nous vivons, et aussi de la croyance qu’au milieu de ces cruautés, quelque chose d’autre peut parfois aussi prospérer. Nous avons trop naturalisé la souffrance des autres. Le cinéma qui reproduit cette naturalisation ne m’intéresse pas et j’essaie de me positionner dans mes films contre cela.
Votre nouveau projet de film s’articule également autour du texte de Bialet. Pourquoi vous intéressez-vous à ce texte en particulier ?
J’ai découvert ce texte parce que j’avais une idée de film se déroulant en Argentine au début du XXème siècle, et je me suis rendue compte que je connaissais très peu l’histoire de mon pays à cette époque En cherchant des choses à lire, je suis tombée sur les rapports Bialet et je les ai trouvés absolument fascinants J’ai également réalisé que c’était le film à faire, le film des rapports, et non pas celui auquel
2 Rapport sur l’état des classes ouvrières à l’intérieur de la République d’Argentine.
j’avais pensé au départ. Il s’agit d’un long texte de près de mille pages que Bialet a écrit pour répondre à une mission qui lui a été confiée par le gouvernement argentin en 1904. Sa tâche consistait essentiellement à parcourir la plupart des provinces argentines pour voir dans quelles conditions se trouvaient les classes laborieuses et pour rédiger un rapport qui servirait plus tard à jeter les bases d’une législation du travail Ce qu’il écrit, c’est cela et bien plus encore, et la lecture de ces textes explique beaucoup de choses sur le présent de l’Argentine, ce qui rejoint d’une certaine manière ce que vous disiez dans votre question précédente. Pour moi, les textes de Bialet, avec toute la douleur et la beauté qu’ils contiennent et près de 120 ans plus tard, sont d’une extraordinaire actualité.
Pour en revenir à Bresson, je me souviens que vous l’aviez mentionné comme référence lors d’une de nos discussions sur Sobre las nubes, avec d’autres réalisateurs comme Ozu ou Kaurismaki. Ce sont tous des cinéastes qui ont une méthode de travail très rigoureuse au regard de la mise en scène, du jeu des acteurs et du montage. Quelles seraient les règles de votre méthode, si vous en avez une, et qu’est- ce qui serait fondamental dans celle - ci ?
Ce n’est peut- être pas tant une méthode qu ’ un chemin Lorsque je commence à penser qu’il pourrait y avoir un film, quand ce que je soupçonne grandit dans mon imagination, même si ça change
ensuite, j’essaie d’en faire une obsession, d’ y consacrer autant de temps et de travail que possible Ensuite, j’en parle à mes ami· e ·s, j’écoute ce qu’ils et elles pensent, surtout celles et ceux qui ne disent pas toujours ce que l’on veut entendre. En discutant, on commence à comprendre les limites, les angles morts, les problèmes, puis à nouveau du travail, du temps, du travail, du temps Dans ces conversations apparaissent les complices, les personnes avec lesquelles on aimerait façonner ce film, et c’est fondamental.
Rien de ce que j’ai fait n’aurait pu l’être si j’avais été seule Au fur et à mesure que les complices se joignent au projet, il devient plus difficile d’abandonner, les forces se multiplient À partir de là, il s’agit de s’entêter, d’essayer d’obtenir un peu d’argent pour pouvoir organiser le travail avec un peu de dignité.
Pendant que tout avance, les idées s’affinent et j’essaie de faire en sorte que tout le monde comprenne, écoute et prenne soin de ce film qui est en train d’apparaître À ce stade, il a ses propres besoins et il ne faut pas que nous les attaquions. Nous pouvons faire des erreurs, mais pas nous trahir Il n ’ y a jamais de point d’arrivée Dans chaque texte, chaque espace, chaque plan, chaque décision, une idée du monde est en jeu.
En d’autres termes, faire du cinéma est une chose très sérieuse
Il faut être cohérent avec cela. Un jour, le film est tourné, de manière classique ou plus aventureuse : il n ’ y a pas qu ’ une seule façon de faire. Encore une fois, j’ai besoin d’imaginer, de penser avec le cadre, avec les espaces, avec les visages de
ceux qui sont ou seront devant la caméra. Il n ’ y a rien d’insignifiant. Dans n’importe quel coin, dans n’importe quelle maison, place, supermarché, dans n’importe quelle rue sale, sombre, flétrie, il peut y avoir une scène La beauté n ’ a jamais été conventionnelle Si l’on a la chance de voir apparaître un peu de cette beauté, prenons- en soin comme d’une perle sacrée Puis continuer, et un jour terminer À nouveau, le travail solitaire, être face aux plans, aux dialogues, aux sons, essayer de comprendre ce film qui a des airs de ce que l’on a imaginé mais aussi tant d’autres choses, étranges, ratées, nouvelles À nouveau les complices Du temps et du travail, du temps et du travail. Essayer de trouver la meilleure version possible. Le montage final. Essayer d’obtenir un peu plus d’argent pour pouvoir écouter le film en studio, lui donner ce qu’il mérite, soigner les derniers détails. Enfin, un film. Nous ne savons pas quelle sera sa vie, si quelqu’un y trouvera quelque chose, si un public voudra le voir, s’il aura un avenir prospère ou plutôt limité. Mais c’est le film que nous avons fait et qui nous a rendu· es, en fin de compte et malgré tout, un peu plus heureux. Si ce n’était pas le cas, si la douleur était plus grande que la joie, quelque chose n’irait pas.
Je reviens à la question de la méthode. J’ai vu quelques pages du scénario de Las cosas indefinidas sur lesquelles des plans sont dessinés. Est- ce que vous avez l’habitude de tout dessiner ? Travaillez-vous avec un storyboard ?
Non, en fait j’imprime toujours les scripts de façon à avoir une page blanche à côté de chaque scène Lors de la dernière étape de l’écriture
du scénario, il m’est très utile d’avoir cette division des scènes afin de pouvoir calculer plus tard les temps et l’architecture du tournage. J’écris les scènes en imaginant déjà comment nous pourrons les filmer, presque toujours en pensant à un personnage spécifique, à qui l’interprétera, et dans un espace que j’imagine tel qu’il sera Pour Las cosas indefinidas, c’était très clair parce que la majeure partie du film a été tournée dans ma maison, et il s’agissait d’espaces connus Ensuite, lorsque le scénario est imprimé, on s’assoit et on réfléchit avec les techniciens, par exemple dans ce cas là avec Ezequiel Salinas, le directeur de la photographie et Flor (Florencia Nogue), qui était chargée de la direction artistique. Nous nous sommes assis tous les trois et nous nous passions le scénario. Mais je n’ai jamais fait de véritable storyboard, je fais juste de petites esquisses précaires. Par ailleurs, le dispositif de tournage est assez simple. Dans Las cosas indefinidas, il n ’ y a de mouvement de caméra qu ’ au début et à la fin du film et il y a seulement un panoramique lorsque Eva marche dans la rue. Presque tout est en plan fixe. Quand on commence à vouloir faire des mouvements de caméra plus élaborés, tout devient plus complexe. Dans notre cas, filmer dans des lieux qui ne sont pas des plateaux de tournage, c’est à dire dans nos maisons ou des endroits aménagés pour le tournage, est une façon très économique de travailler.
Est- ce pour cela qu’à plusieurs reprises, vous avez parlé de vos films comme étant « petits » ? Vous faisiez référence au système de production ?
Oui, je pense surtout au système de
Las Calles, Sobre las nubes, Las cosas indefinidas, María Aparicio


production. Si je devais le regarder de l’extérieur, je verrais un groupe d’amis qui se réunissent pour filmer, parfois avec des aides, de la structure, et parfois avec très peu. Je veux dire que nous travaillons dur et que nous essayons toujours de prendre soin du dévouement que chacun e met dans ce que nous faisons, mais nous sommes avant tout un groupe de personnes unies par l’affection et par une expérience partagée autour du cinéma Cela semble innocent et un peu naïf, mais pour moi, c’est plus politique que n’importe quoi d’autre d’inventer quelque chose là où il n ’ y avait rien de semblable, et de le faire avec ses propres règles Córdoba n’était pas prédestinée à être une ville de cinéma. Sans aller plus loin, le cinéma argentin est surtout issu de Buenos Aires. Et pourtant, nous sommes là, non pas à cause des profits ou de la reconnaissance, mais du fait de l’insistance de plusieurs générations, du travail de nombreuses personnes et de la conviction que le cinéma, avant toute autre chose, rend notre vie meilleure. Jusqu’à présent, l’INCAA a également permis à de nombreuses petites maisons de production indépendantes de trouver un moyen de financer leurs projets, afin que la réalisation d’un film ne soit pas synonyme d’asphyxie. Cela a été fondamental et c’est ce qui est complètement paralysé aujourd’hui.
Diriez-vous que ce sont ces limitations de production qui impliquent ce choix de mise en scène ou que ce choix esthétique génère un système de production plus simple ?
Pour moi, ce sont les deux choses : imaginer une manière possible de faire un film en sachant que ce sont nos possibilités et, sur la base des
règles dont nous disposons, trouver une esthétique. Ça va dans les deux sens. Il est peut- être difficile de savoir ce qui vient en premier. Pour Sobre las nubes, c’était la même chose : penser aux espaces dont nous disposions et tourner en plans fixes Pour mon prochain film, il m’arrive d’être enthousiaste à l’idée que si nous trouvons de l’argent, je pourrai imaginer des choses un peu plus élaborées Mais c’est un peu inopportun de penser à cela maintenant, dans le contexte actuel
Dans Sobre las nubes, il y un plan filmé en extérieur où une passante regarde la caméra. C’est sans doute lié au système de production qui ne permettait pas de bloquer toute la rue, mais vous auriez pu choisir de refaire le plan ou de ne pas inclure ce regard- caméra dans le montage, pourquoi l’avoir laissé ?
C’est dans l’espace public, dans la rue en particulier, que le système de production devient plus radical. Mais là, je peux dire qu’il s’agit d’une décision purement esthétique. Jamais, même lorsque l’on commençait à filmer et alors que je ne comprenais pas vraiment cette relation entre l’argent et le cinéma, l’idée ne m ’ a traversé l’esprit qu’il pourrait être plus intéressant de recréer une rue de Córdoba et d’essayer d’imiter son mouvement plutôt que de filmer dans la rue
Sans compter que c’est une véritable corvée pour la production de recréer une situation dans l’espace public de la ville, il m ’ a toujours semblé beaucoup plus cinématographique d’être là, de mettre la caméra dans la rue et d’y mêler les personnages ; il y a quelque chose de la matière
cinématographique elle -même qui est là, dans ces coins, dans cette zone de la ville, qui a à voir avec la vie. Et si, dans tout ce processus, des gens regardent la caméra, tant que ce n’est pas quelque chose de contre -productif et que ça ne nuit pas à la scène, ça ne me dérange pas D’ailleurs, quand on regarde des films de la Nouvelle Vague, quand on est dans la rue, il y a toujours quelqu’un qui regarde la caméra
C’est aussi une façon de donner des indices au spectateur sur la fabrication du film. De la même manière, dans le montage de Sobre las nubes, il y a des faux-raccords et des anachronismes, qui brouillent les pistes temporelles.
Tout est question de trouver le temps du film. Combien de temps passe à l’intérieur ? Deux jours, un mois, un an ? Il y a des films qui en ont besoin pour leur fonctionnement propre. Au contraire, dans Sobre las nubes, il fallait construire l’idée que les personnages, à travers leurs histoires, faisaient l’expérience du passage du temps, sans que l’on puisse tout à fait le mesurer. Combien de temps s’est écoulé ? Pourquoi tel personnage subit-il des variations ? En particulier, le personnage de Juana, qui ouvre et clôt le film, est celui qui varie le plus et pour lequel nous avons poussé cette idée au maximum : ses apparitions sont toujours fortuites, non expliquées J’aimais beaucoup ça, le fait qu ’ un personnage puisse varier et changer sans que son existence ne soit vraiment expliquée Et puis, c’est aussi lié à ce que nous disions tout à l’heure : le film a été tourné sur une longue période, avec des pauses, les acteur ices ont changé, c’était
Las Calles, Sobre las nubes, Las cosas indefinidas, María Aparicio
donc une façon d’incorporer cela à l’univers du film.
Il y a aussi ce moment où Eva se rend compte qu ’elle perd sa montre, le temps ne peut plus être mesuré.
Exactement, c’est ça.
Vous parlez du personnage de Juana, qui ponctue le film d’ une présence musicale, comme des notes d’ une partition. La musique, représentée de façon performative, est ponctuelle mais significative Quel est votre lien avec cette pratique ?
En fait, j’aurais aimé faire de la musique, faire des chansons, avoir un groupe. La musique pour moi était le début de tout. À l’adolescence, j’ai essayé de faire quelque chose avec ça, mais rapidement le cinéma est apparu et la musique a commencé à être un peu périphérique. Ensuite, j’ai toujours été fascinée par les cinéastes qui ont trouvé des moyens pour faire vivre la musique dans les films, ce qui n’est pas facile.
Kaurismäki, par exemple. D’ailleurs, comme beaucoup de ses films, il me semble que Sobre las nubes propose un lieu de refuge, fait de gestes et d’attentions des personnages entre eux.
Quelqu’un a parlé des films de Kaurismäki comme « de tragédies porteuses d’espoir ». Parler d’espoir est difficile aujourd’hui, mais il faut le faire. C’est comme la question de la liberté. Les gens qui nous gouvernent se sont emparés de l’idée que la liberté est ce que l’on peut faire de soi-même, que l’on a le pouvoir de prendre des
décisions individuelles, en oubliant que nous faisons partie de quelque chose de plus grand Le parti de Milei s’appelle « La liberté avance ». Comment repenser l’idée de liberté ? Et comment la contester ? Une autre idée complexe pour moi est celle de futur. C’est si difficile à imaginer pour nous. En Argentine, il n ’ y a pas de logique selon laquelle on pourrait prévoir les choses, penser à long terme ; nous nous sommes habitué es à vivre sans ça, sans l’idée de pouvoir anticiper. Tous ces mots et questions finissent par être politiques. J’ai entendu des critiques de Sobre las nubes dire que tous les personnages étaient bons et acceptaient passivement ce qui leur arrivait, qu’il y avait là une naïveté de la bonté, de la gentillesse. Bien sûr, il y a là quelque chose de vrai Mais en même temps, il me semble que la politique — et c’est aussi un autre mot qu’il est difficile de s’approprier — peut être discutée de différentes manières. Et je crois qu’il y a quelque chose de politique dans la façon dont un être humain traite un autre être humain. Eh bien, d’une certaine manière, cette « espérance tragique » que l’on trouve dans les films de Kaurismaki, m ’ a fait penser à cela, au politique qui se loge dans l’attention que les êtres se portent entre eux. Peut- être qu ’ en définitive, il y a toujours une idée du monde dans les films
Cette façon de montrer dans vos films des personnages traversé · es par des expériences plus ou moins douloureuses — le deuil, le chômage, le cinéma, l’amitié — et qui expriment leurs émotions, physiquement et à travers la parole, rappelle une tradition du cinéma classique. Quelle importance celui- ci a-t-il pour vous ?
Ça a commencé à devenir important il y a quelques années Je ne connaissais pas vraiment l’histoire du cinéma jusqu’à ce que je fasse mon premier film. Je ne la connais pas beaucoup plus maintenant, mais Las Calles m ’ a permis de me rapprocher d’un monde que jusque -là je vivais en solitaire, le monde de la cinéphilie. Et à Córdoba, je suis devenue très proche d’un groupe de gens qui aimaient Ford, Hawks, Ozu, Tourneur, Renoir J’ai beaucoup appris d’eux, de ce qu’ils voyaient dans les films, de ce que signifiait aimer les personnages, le mythe du grand cinéma, les acteurs, les studios, et surtout, une idée politique de l’émotion.
C’est-à- dire, qu’entendez-vous par cette idée politique de l’émotion ?
Je pense à cela dans le sens le plus populaire du cinéma. Sans perdre de vue l’énorme système de production dans lequel ils s’inséraient, ces films, à travers leur démarche narrative, ont réellement existé dans un lien très fort avec les spectateur·ices Cette origine du cinéma de masse, des stars, de l’identification, mais aussi de la construction du sens, est pour moi à la fois troublante et fascinante (il y a de cela dans l’idée d’André Bazin de « génie du système »), et elle renouvelle aussi toujours la question du cinéma et des spectateur·ices. Si l’on pense au politique, on en vient vite au réalisme, au cinéma de non-fiction, à la tradition du cinéma militant. Bien sûr il y a quelque chose à cet endroit Mais il me semble aussi essentiel, peut- être à cause de la complexité que cela implique, de réfléchir à l’aspect politique de la fiction, des formes narratives classiques, du cinéma qui
semble plus accessible au public. Si l’on considère le spectateur, non pas comme le simple récepteur d’un message, mais comme quelqu’un qui est convoqué à une expérience à travers le film, alors c’est là que quelque chose de ce qui se passe avec le cinéma classique, dans la relation narration-forme-émotion, devient intéressant pour moi
Le documentaire que montent
Rami et Eva dans Las cosas indefinidas traite des expériences de personnes aveugles qui ont perdu la vue à l’âge adulte, et ouvre une réflexion sur le visible et l’invisible. D’où est venue cette idée ? Dans quelle mesure l’appareil fictionnel, qui ouvre la porte au documentaire, vous a-t-il permis de travailler sur ces questions ? Et pourquoi avoir choisi la pellicule pour la matière de ce documentaire ?
Quelque chose que j’aimais dans le fait que le personnage principal soit une personne dédiée au montage était la possibilité de voir le matériel sur lequel elle travaillait, comme si ce dispositif de fiction était une porte d’entrée et de sortie pour un second film. Nous devions alors penser à deux films différents, d’une part celui dans lequel jouent Eva et Rami et d’autre part le film qu’Eva et Rami montent. Quand j’étais préoccupée par toutes ces questions relatives à la matérialité des images et à la numérisation, s’agissant d’une discussion qui ne considère que le visuel, j’ai pensé à la cécité comme un opposé absolu Ainsi est apparue l’idée que le film qu’Eva et Rami montent pourrait avoir à voir avec cela, avec des gens aveugles parlant de leurs vies, de leurs rêves, de leurs goûts, de ce qu’ils imaginent du monde Nous avons donc interviewé
plusieurs d’entre eux et sur la base de ces interviews, nous avons construit une sorte d’énumération d’images que nous avons ensuite tournées en Super 8. Et le choix de ce format était lié, peut-être trop simplement, à la recherche d’une forme visuelle permettant de différencier rapidement les deux films En même temps, comment représenter la diminution visuelle ? Comment construire une idée d’image qui s’éloigne de la netteté, de la définition, de la perception visuelle comprise comme normale ? Le Super 8 nous permettait peut-être de jouer avec cette idée
À un moment, Eva confie à Rami qu ’elle aimerait dire à Juan, son ami décédé, « Je te promets que nous allons prendre soin de tes films », mais plus tôt, elle dit que les copies (master et 35mm) d’ un autre film de Juan ont été perdues. J’aimerais que vous développiez cette préoccupation à propos de l’archive et savoir comment vous l’avez travaillée dans l’écriture du film
Je pense que cela a quelque chose à voir avec l’idée du temps, et à la façon dont les enregistrements que nous produisons, visuels, sonores, écrits, dialoguent avec l’histoire. C’est aussi croire que ce que les êtres humains reconstruisent de ce qui s’est passé est toujours fragile et dépend de beaucoup plus que notre propre volonté Rien ne garantit, avec la technologie numérique, que les films que nous voyons ou que nous faisons, que les photos, textes, vidéos, musiques, perdurent à long terme Tout doit-il durer ?
Peut-être pas, mais alors qu’est-ce qui reste ? Est-ce qu ’ on peut décider ou est-ce qu ’ on se laisse aller aux caprices de la technologie ?
Ce sont des questions complexes
qui m ’amènent toujours à penser où se trouve le cinéma, c’est pourquoi je les trouve fascinantes.
Lors d’ une discussion avec vous et Ramiro Sonzini à Marseille, vous me parliez de l’absence et du manque d’ une Cinémathèque nationale, alors même que l’Argentine est l’ un des pays d’Amérique latine avec la production cinématographique la plus prolifique. Aujourd’hui avec le gouvernement de Javier Milei, il semble difficile de continuer à imaginer un tel projet.
Comment voyez-vous la possibilité de préserver le cinéma en Argentine ?
Eh bien, tout ce que j’ai dit dans la réponse précédente prend un sens assez extrême en Argentine, parce qu ’ en l’absence d’une institution dédiée à la préservation du patrimoine cinématographique, une grande partie de l’histoire du cinéma argentin est perdue. Les films qui sont conservés risquent toujours de disparaître et il est en même temps très difficile de les voir aujourd’hui parce qu’il y a très peu de numérisations, ou ils existent très précairement. Et les films contemporains, hébergés sur nos disques durs ou dans des nuages virtuels, ne sont pas non plus totalement sécurisés. Si nous nous intéressons au tissu de l’Histoire, si nous croyons qu’il y a une valeur dans le passé, si nous nous préoccupons de la construction de la mémoire, la volonté individuelle ne suffit pas. Et tout cela, à ce jour, est beaucoup plus éloigné, presque impensable, dans le chaos institutionnel que le gouvernement de Javier Milei est en train de générer dans les politiques publiques du cinéma
Las Calles, Sobre las nubes, Las cosas indefinidas, María
Et l’avenir du cinéma ? Comment imaginez-vous continuer à en faire dans ce contexte ?
Ça n ’ a jamais été aussi dur pour moi d’imaginer l’avenir J’ai eu la chance de pouvoir faire quelques films, de travailler sur des films d’autres personnes, de connaître le métier du cinéma Que reste-t-il du grand nombre de jeunes qui essaient de comprendre comment faire des films et payer leur loyer ? En Argentine, à force de beaucoup de travail collectif, les politiques publiques nous ont permis de penser que les classes
moyennes pouvaient aussi faire des films. C’est ce qui va disparaître à court terme. Depuis que j’ai commencé à répondre à cet entretien, de nouvelles mesures ont été annoncées qui ne font qu ’ aggraver la situation. Et nous ne parlons ici que du cinéma, il y en a beaucoup plus dans tous les autres domaines. Je crois qu’il est possible de créer quelque chose de collectif qui soit significatif, quelque chose qui permette de freiner ce qui est en train de se passer, mais ce sera toujours à force de souffrance, parce que c’est
toujours le sang du peuple qui coule. D’un autre côté, il est trop tard pour que le mal ne nous affecte pas tous. Quand cela arrivera, il faudra beaucoup reconstruire Et les films : celles et ceux qui le peuvent chercheront l’argent ailleurs, nous devrons imaginer des films avec de très petits modèles de production, accepter plus de travail et filmer le week-end, faire confiance à ce qui nous unit au cinéma en dépit de tout Malheureusement, ne resteront que celles et ceux qui pourront soutenir cette force.
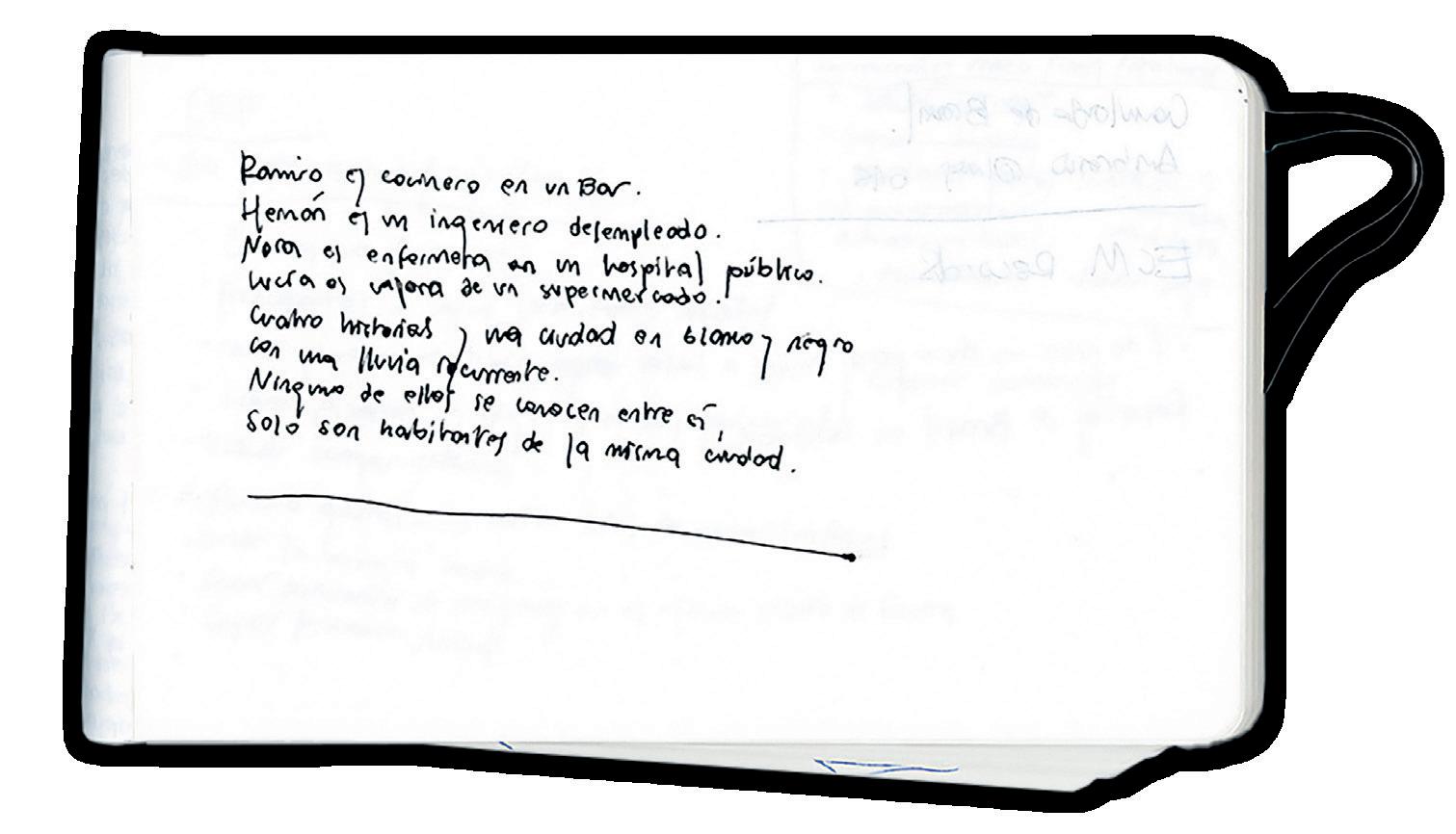
Ramiro est cuisinier dans un bar
Hernán est ingénieur au chômage
Nora est infirmière dans un hôpital public Lucia est vendeuse dans un supermarché
Quatre histoires, une ville en noir et blanc avec une pluie récurrente
Aucun d’eux ne se connaît
Ils sont seulement habitants de la même ville
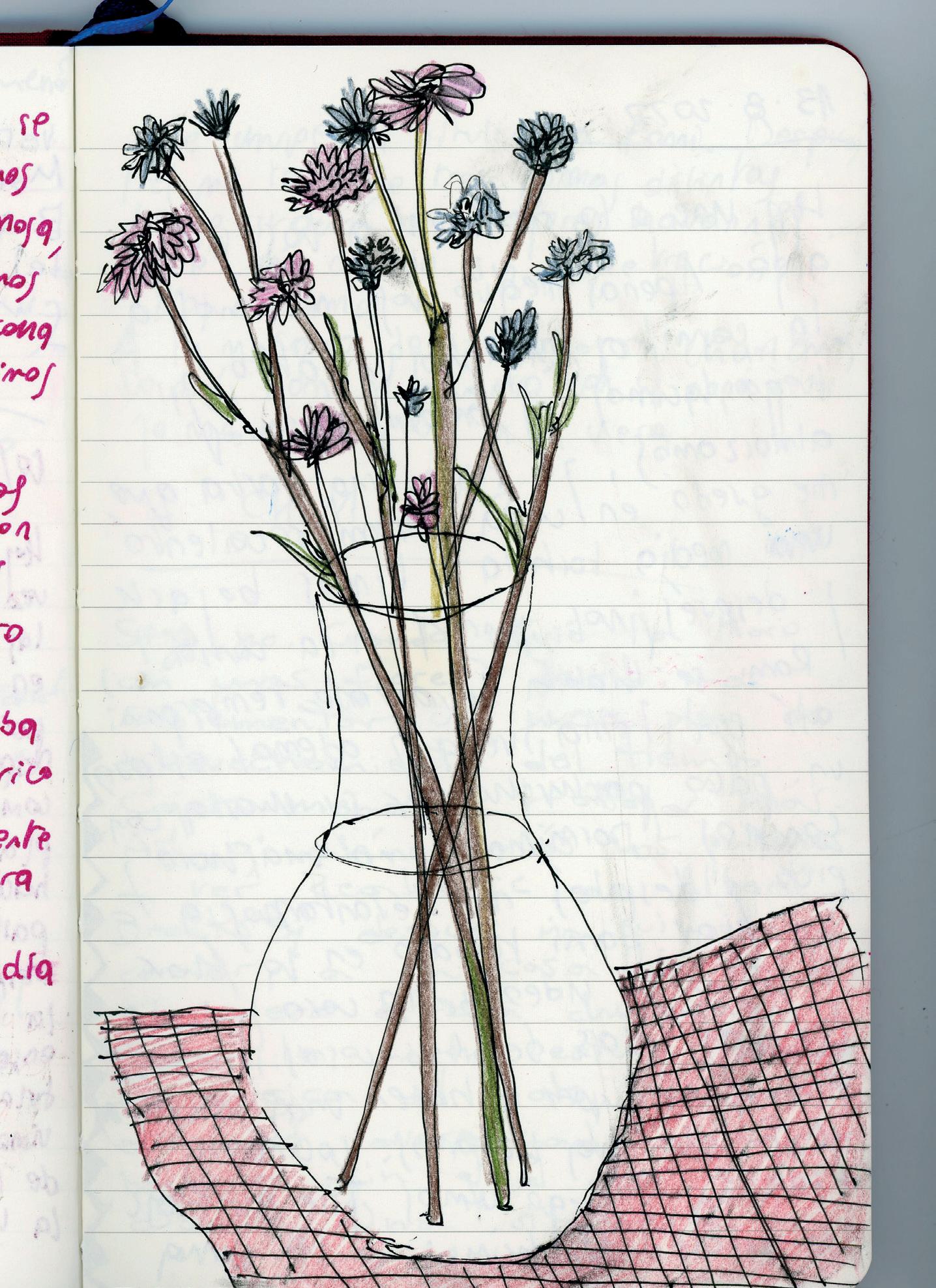




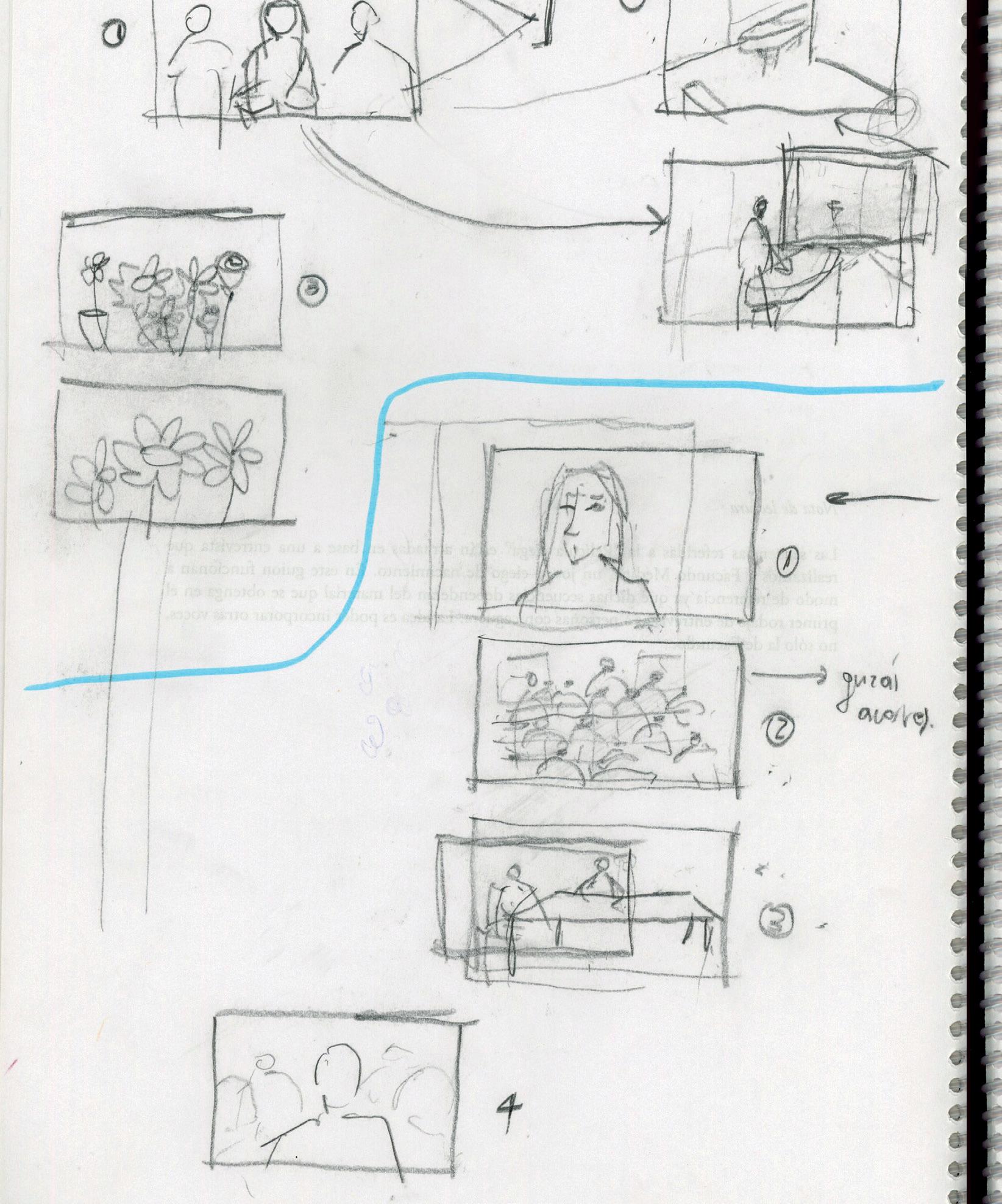
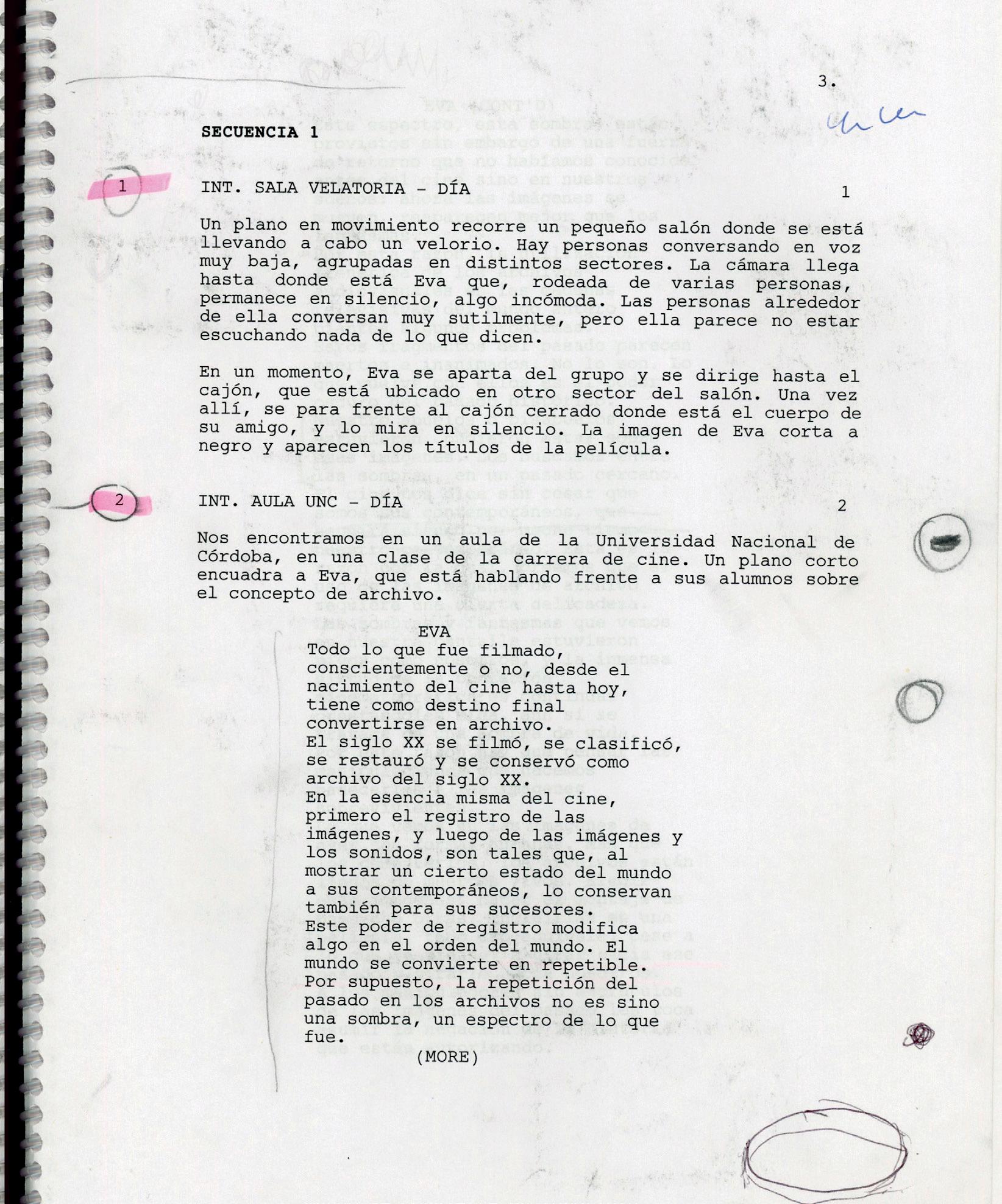
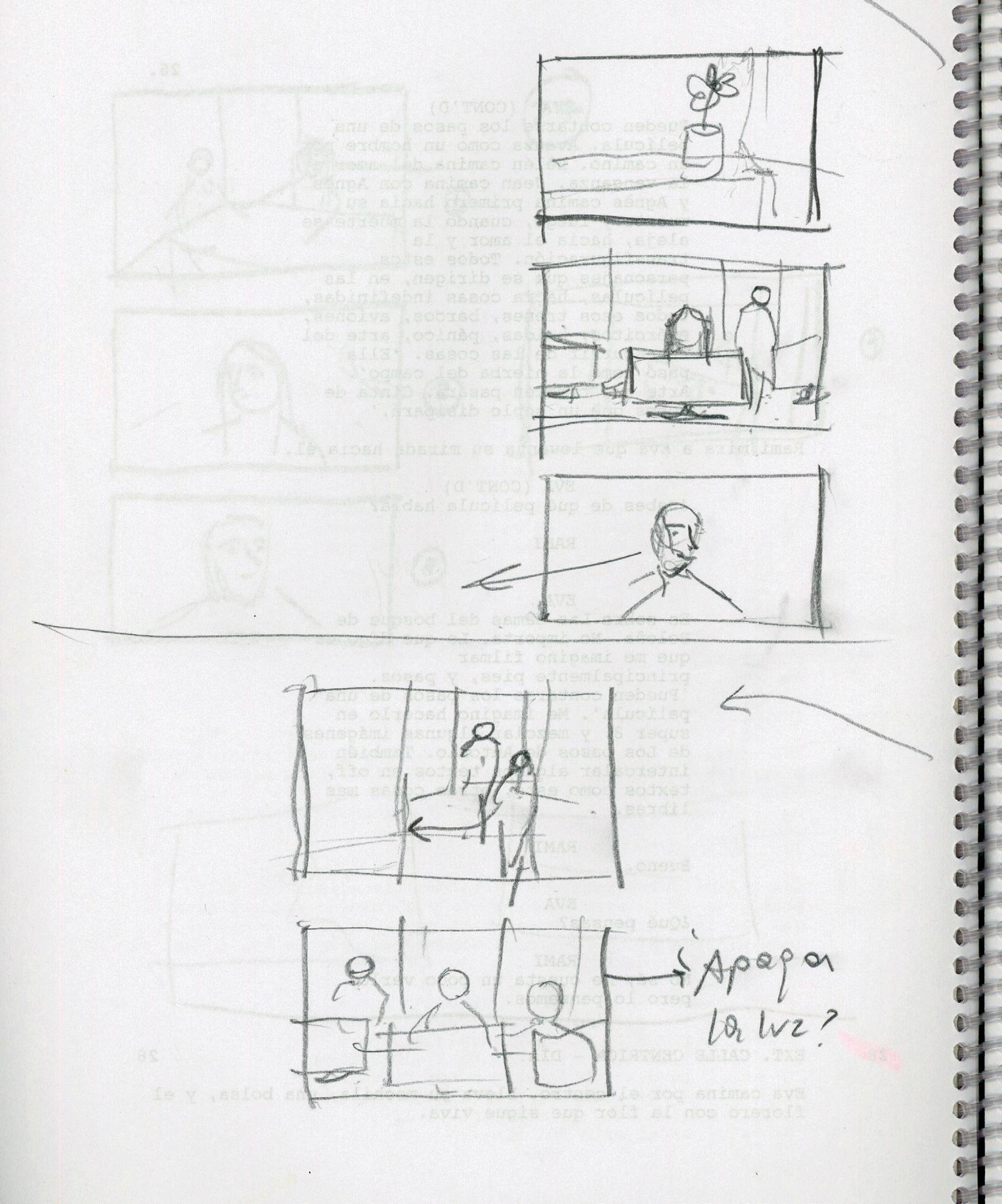
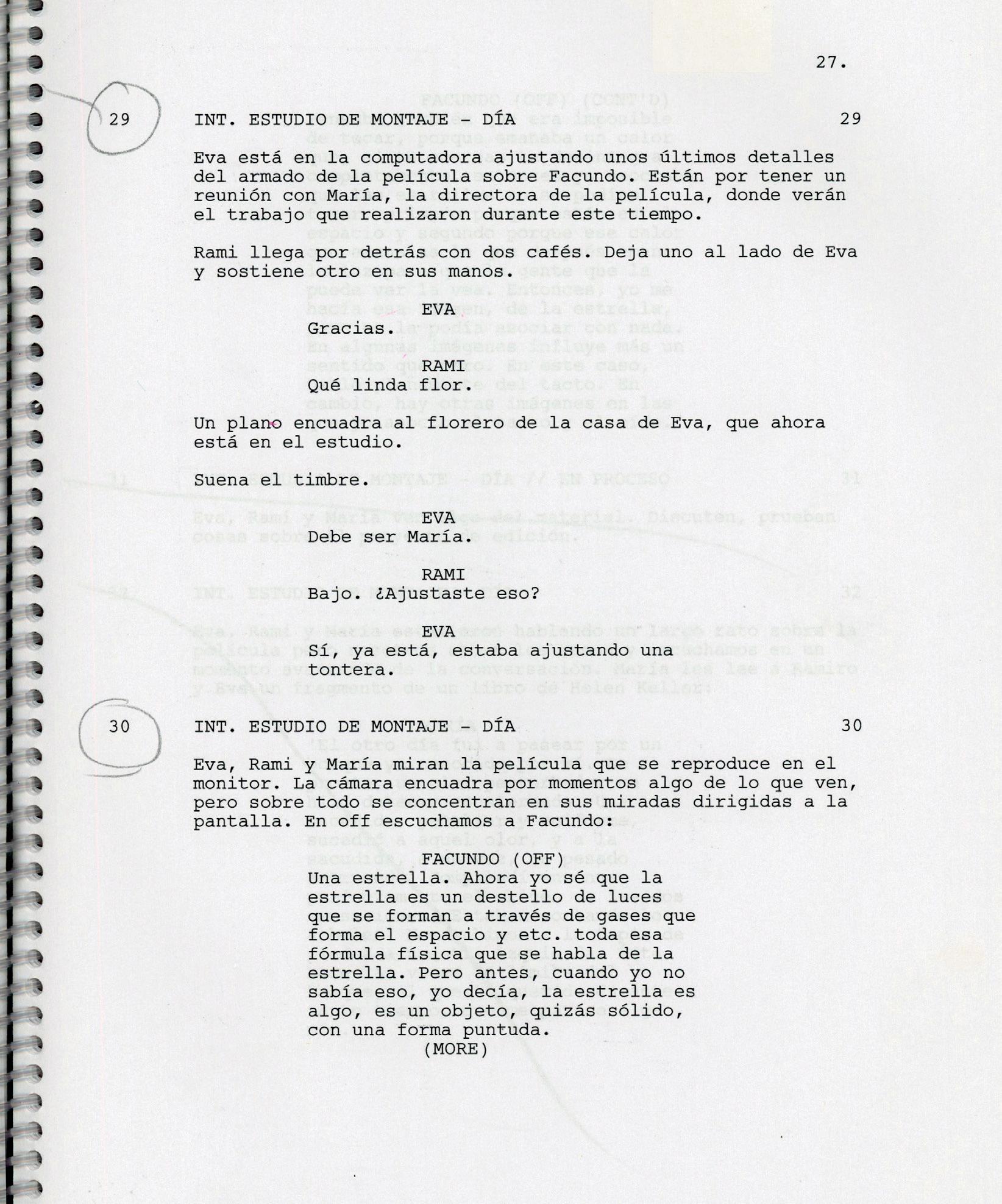
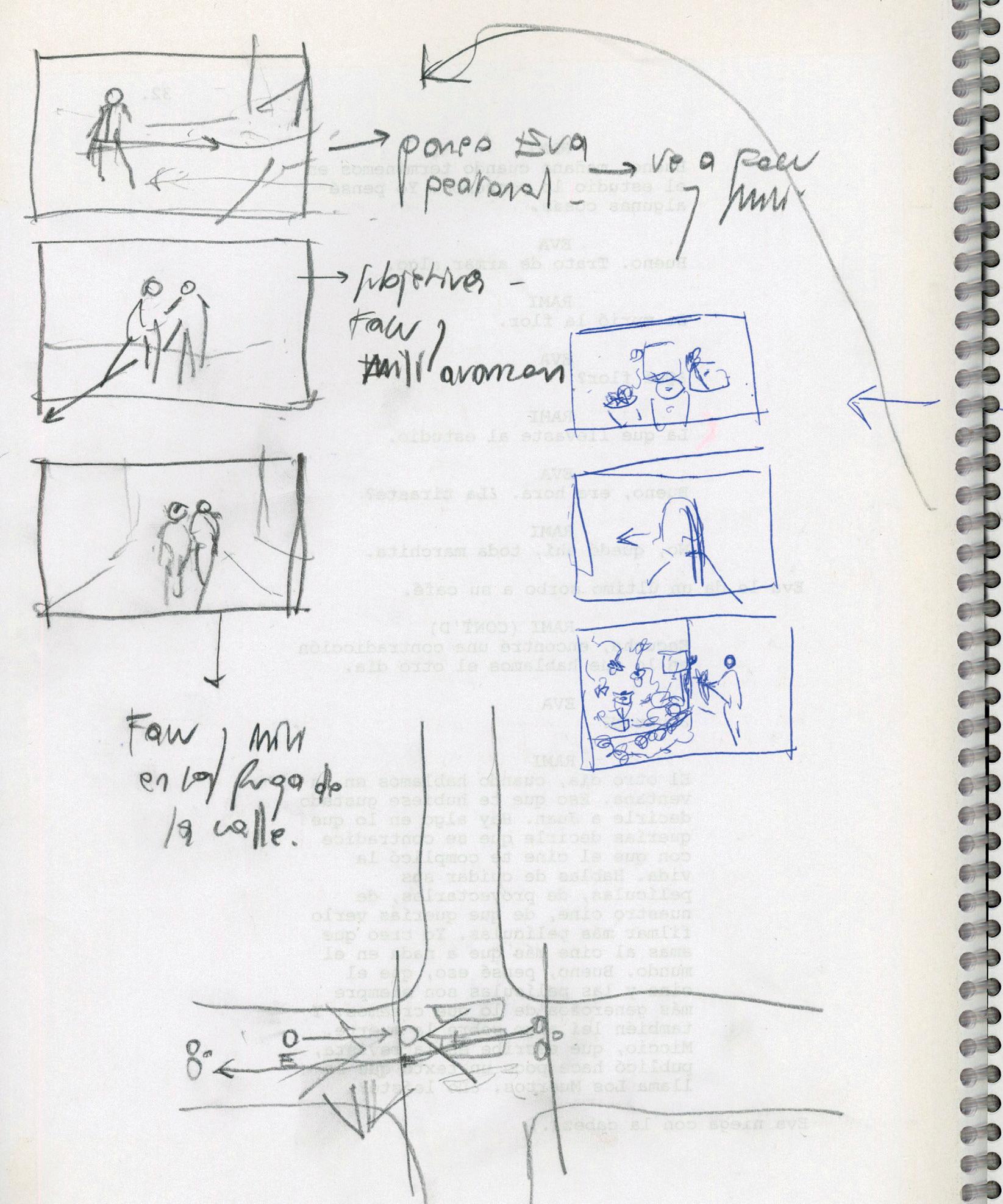
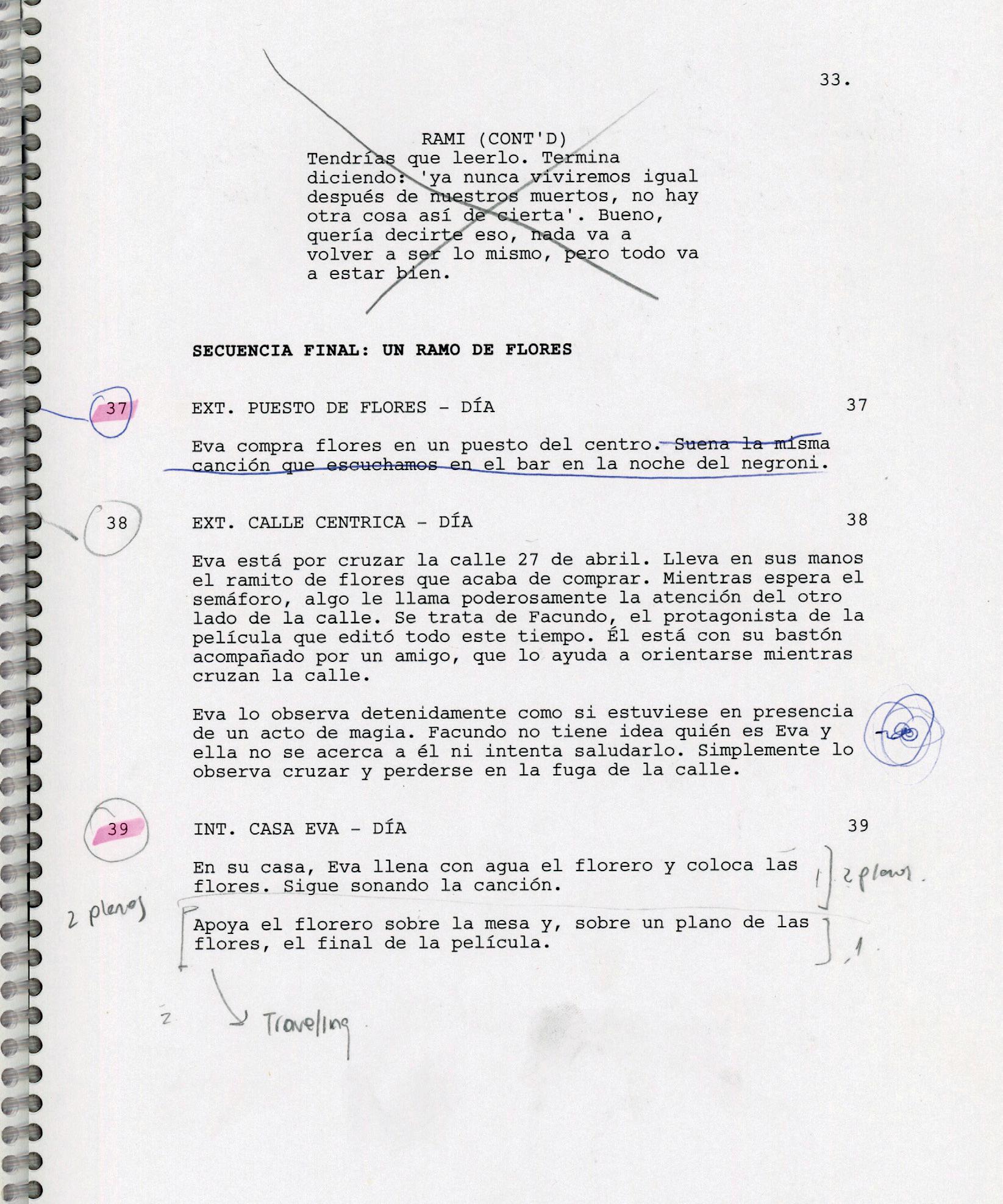

Ma rencontre avec Wang Bing s’est faite la même année que celle avec Jean-Pierre Beauviala, au début de l’été 2005. Je préparais un film à Paris et suis allée voir la première partie d’À l’ouest des rails, un soir au Reflet Médicis. J’y suis retournée les soirs suivants avec un sentiment de découverte rarement éprouvé. Quelqu’un s’emparait du cinéma d’une manière encore inconnue et m’entrainait dans son apprentissage, dans la compréhension de son motif et de son médium avec une humilité forcenée et une ambition tout aussi forcenée.
Je ne me souviens pas d’avoir tout de suite partagé ma sidération, j’avais besoin de rester seule avec ce choc, par la suite certains articles sont venus confirmer que je ne me trompais pas. J’ai eu besoin de comprendre le geste… et me suis vite renseignée sur la caméra qui accompagnait si fidèlement la solitude et la ténacité du cinéaste. Cette caméra Panasonic DVX 100* venait de sortir en France, je me la suis procurée, elle est rapidement devenue une alliée avec laquelle j’ai tourné pour Amos Gitai, pour Nobuhiro Suwa, pour Leos Carax, pour moi-même, et reste un des outils de prise de vue les plus intuitifs que j’aie utilisés, elle était encore en analogique 2/3 de pouce*. J’ai donc eu d’emblée avec Wang Bing, sans le connaitre, une sorte d’intimité technique que je n’avais eue qu’avec Jean-Luc Godard — à mon arrivée à Périphéria en 1985 je lui avais fait acheter une Arri BL* et une série Zeiss GO* pour tourner Soigne ta droite et les films suivants.
Quelques années plus tard j’ai rencontré Wang Bing, il m’a demandé de lui trouver un 16 et un 20mm, qui sont des optiques de documentariste parce qu’elles permettent d’être à la fois éloigné et proche du sujet. Plus tard encore il m’a demandé de réaliser un petit film qui devait introduire son travail pour une installation exposée à la Fondation EYE à Amsterdam. J’ai choisi de confronter des extraits de ses films à son regard de monteur. C’était à nouveau l’été, la journée je m’occupais de ma mère déjà affaiblie par la maladie, le soir et la nuit je revoyais tous les films de Wang Bing,
cherchant les séquences les plus incandescentes. Par la suite je l’ai filmé avec un Sony Alpha 7s* dans sa salle de montage, impasse Mousset, pour capter son attention devant ses écrans. J’étais contente de n’avoir fait aucune digression, il s’agissait de ses images, de son regard : la concentration sans complaisance du cinéaste devant son motif.
Je n’aurais évidement jamais imaginé qu’un jour il me demande de l’accompagner sur un projet. Son motif étant la Chine et sachant qu’il tournait à un rythme frénétique, participer à son regard me semblait absolument hors de portée. Cependant, fin 2019, il m’a appelée pour les rejoindre, lui et sa productrice Li Hong, aux Bouffes du Nord. Il souhaitait filmer un homme très âgé, nu dans cet espace. C’était un grand compositeur de musique chinois, Wang Xilin, qui avait été formé dans les écoles du parti puis, poursuivi pour dérive droitière, avait été interné et torturé.
Wang Bing ne parlant ni le français ni l’anglais et les échanges avec lui étant toujours traduits soit par Li Hong soit par Ruosong Huang, assistant sur le film, cela demandait de s’exprimer précisément, tant dans les questions à poser que les propositions. J’avais déjà expérimenté ce mode d’échange avec Nobuhiro Suwa, cela ne m’effrayait pas. Cependant, dès les repérages aux Bouffes du Nord, il y avait chez Wang Bing une tension, sans doute due au fait qu’il n’avait jamais délégué l’image de ses films. La plupart du temps c’est uniquement lui qui tient la caméra, certains de ses assistants peuvent aussi filmer parce que cela s’avère nécessaire d’avoir plusieurs caméras dans un lieu ou Wang Bing opère. Mais la proposition qu’il me faisait de filmer Wang Xilin le dépossédait de la caméra qu’il tient la plupart du temps. Il avait tout à fait conscience qu’il n’était pas familier de l’outil que nous allions utiliser, une caméra grand capteur et des optiques full frame* dont il souhaitait qu’elles soient des plus performantes. Ce grand capteur était déterminant pour lui, il y tenait, comme si la largeur et la résolution de l’image devaient traduire la stature « bigger than life » de son
modèle. Il me parlait beaucoup du corps de Wang Xilin, de sa peau, des cicatrices apparentes dont il fallait rendre compte. Je comprenais que nous allions devoir jouer d’une extrême proximité et de l’éloignement, donc nous approcher et nous distancer du sujet dans un même mouvement. Pour connaitre les films de Wang Bing, je savais aussi que la durée du plan est une constante de son travail, mais que la caméra à la main qui l’accompagne continu-ment ne serait pas le bon outil. À ce stade d’élaboration du projet, une durée de 20 ou 30 minutes était envisagée pour le film en entier, ainsi que le plan séquence, donc un seul plan séquence de 20-30 minutes, ce qui m’effrayait un peu. Il s’en est suivi pour moi une période d’interrogation technique assez solitaire, tant sur les outils de portage que sur la façon dont il faudrait éclairer le lieu mythique des Bouffes du Nord. La location étant onéreuse, Li Hong et moi avions recherché d’autres lieux en Europe qui puissent évoquer, comme les Bouffes, une grotte, un théâtre, un tombeau. Mais Wang Bing revenait régulièrement sur la hauteur du lieu, sa verticalité lui importait tout autant que son dénuement et que l’âge de ses murs.
Le film de Wang Bing que j’avais en référence était L’Homme sans nom, parce qu’il s’agissait d’un homme seul. Me revenaient en mémoire les photos de Wang Bing prises de nuit où l’« homme sans nom » est comme blessé par le faisceau d’une torche. J’imaginais que la caméra et la lumière pourraient fonctionner ensemble dans un mouvement commun et que le regard serait conduit vers les zones prises par la lumière de la torche, que Wang Bing pourrait peut-être tenir lui-même cette torche. J’ai fait des recherches de torches, un faisceau de lumière n’ayant pas la même intensité à 2 et à 10 mètres. L’idée était séduisante et paraissait simple mais l’exécution ne l’était pas : comment torche et caméra pourraient-elles être absolument synchrones, comment Wang Bing pourrait-il se tenir au plus près de la caméra ? C’est toute la difficulté des idées de lumière ou de cadre : si la mise en œuvre d’une idée devient trop laborieuse, l’évidence
intellectuelle ou esthétique se perd. Pour paraphraser, on pourrait dire « ce qui se conçoit bien s’exécute simplement ». Or il faut du temps et de la réflexion pour simplifier un geste, un mouvement de cadre ou de lumière.
Je suis revenue à des outils que je connais bien : une dolly compacte* avec roues gonflables capable d’être déplacée sans heurt sur le sol plutôt régulier du théâtre, que le chef machiniste est venu valider, une caméra Sony Venice 2 en 8 K* (la plus haute résolution possible), dont la capacité à traiter les noirs allait nous aider à rendre compte de l’obscurité du lieu, des optiques Zeiss Suprême Full Frame* et deux zooms Angénieux*. J’avais encore dans l’idée que les mouvements de la dolly pourraient être prolongés par ceux du zoom pour isoler une partie du corps nu et amener le regard au plus près des cicatrices. À ce moment-là, j’imaginais encore quelque chose de descriptif sur la peau de Wang Xilin, je n’avais pas pris toute la mesure du personnage et de son énergie propre. Il me semble que je le voyais au passé, pas au présent. Cependant tous les éléments étaient réunis, le lieu, le corps nu de Wang Xilin, le piano, l’appareil qui nous permettrait de nous en approcher. Manquait l’instant, la vie et l’organicité à laquelle nous accéderions plus tard, mais un élément essentiel me résistait, c’était la lumière. Au cours de nos discussions, j’avais compris que Wang Bing laisserait Wang Xilin libre de ses mouvements, que ce serait à nous, le machiniste, le pointeur et moi de nous adapter à ses déplacements. Wang Bing et moi souhaitions une obscurité relative de l’espace, certaines zones pourraient être plus éclairées que d’autres, celle du piano, une partie des gradins mais tout cela dans la pénombre d’un théâtre hors des représentations. Il y avait aussi les murs, ces murs somptueux d’un rouge tirant sur le carmin, une couleur presque chinoise dont je pense qu’elle a joué dans l’attirance de Wang Bing pour ce lieu. La mobilité de Wang Xilin nous entrainait vers de la lumière en mouvement mais un mouvement imperceptible, pour ne pas reproduire des poursuites de théâtre ou de cirque. La
lumière devait faire corps avec lui, émaner de lui. La chef électricienne et moi nous sommes orientées vers des projecteurs automatiques*, très employés au théâtre, qui arrivent depuis peu sur les plateaux de cinéma. De grosses sources, télécommandées, qui peuvent varier d’intensité et de couleur. Nous avons choisi d’en prendre deux afin de pouvoir constamment créer un contrejour et une face sur le personnage, élargir ou resserrer les faisceaux, faire que la peau ne soit pas éclairée mais lumineuse par elle-même. Pour les murs, nous souhaitions une pâleur froide et douce, très étale, qui ne produise pas d’ombre, un sentiment de lumière d’une autre nature que celle qui émanait du personnage.
La veille du tournage nous allions procéder à un pré-light* puis au réglage précis des sources, un pupitreur* serait à la manœuvre. La sophistication et la qualité des outils choisis, tant pour la lumière que pour l’image, nous engageait à une grande concentration et responsabilité, tous autant que nous étions dans l’équipe.
Tout en établissant la charte technique du tournage je continuais à échanger avec Wang Bing sur la façon dont il imaginait les déplacements de Wang Xilin dans le théâtre. Wang Bing se posait la question de le faire entrer dans le lieu, donc de filmer l’extérieur du théâtre, le boulevard de la Chapelle, le métro, il pensait que le personnage devait arriver dans cet espace. Je résistais à cette idée. Peut-être à tort, j’étais fixée sur le mot « tombeau » que Wang Bing avait prononcé lors d’une rencontre précédente. Il me semblait qu’il fallait échapper au temps, non pas dans le sens d’un intemporel, qu’on emploie souvent au cinéma, mais d’un éternel. Pour moi le personnage devait hanter le lieu, il y serait éternellement. Je me souviens d’une discussion traduite par Ruosong, l’assistant et traducteur de Wang Bing, quai du Louvre, dans une salle de montage de Wang Bing, où je défendais pied à pied ma vision. Je me demande encore comment j’ai osé et ce qui m’animait, car Wang Bing était infiniment plus pénétré que moi
de son personnage. Je ne le connaissais pas, ni sa musique, mais j’avais une sorte de conviction mythologique du lieu et la question d’y entrer n’existait pas pour moi, alors qu’elle semblait nécessaire à Wang Bing. Il a résolu le problème en filmant Wang Xilin en mouvement dès le début dans les hauteurs des gradins, ce qu’on appelle le « paradis », puis en le faisant descendre l’escalier intérieur avant qu’il n’arrive sur la scène. Le jour de cette discussion quai du Louvre, nous avons élaboré un découpage, en plusieurs plans et différentes places où Wang Xilin pourrait se trouver. Une sorte de dramaturgie émergeait. Il existe un croquis des propositions que nous nous sommes faites, les axes de caméra sont notés, huit moments sont décrits.
Un autre croquis esquisse ce que pourraient être les sous-espaces mis en lumière et les directions des faisceaux. La décision de recourir aux projecteurs automatiques le rend caduque mais on y trouve une logique qui existe dans le film : le centre qui peut être décentré du plateau, l’espace du piano, les premiers gradins, les murs au fond du théâtre.
J’ai regroupé une équipe assez solide, dont les éléments essentiels étaient un dolly grip et un pointeur expérimentés prêts à l’improvisation. Sans leur technicité et leur talent le film n’était pas possible. La lumière avait été anticipée mais les mouvements et les variations des automatiques ont aussi fait partie de l’adrénaline du tournage.
Le premier jour Wang Bing était extrêmement nerveux, tous ses repères habituels étaient modifiés. Quelqu’un d’autre que lui opérait une caméra beaucoup plus lourde et encombrante que celles auxquelles il était habitué, en fait trois personnes agrégées à la machine au lieu d’une. Nous lui avons remis un écran portable où il voyait l’image comme je la voyais dans le viseur. Je communiquais par gestes de la main au machiniste pour lui indiquer les mouvements de la dolly et dessinais ceux de la caméra qui révélait certaines parties du corps de Wang Xilin. Lentement Wang Bing s’est familiarisé avec ce triple mouvement et a pris
le contrôle du dispositif. Nous suivions Wang Xilin dans ses improvisations. Parfois Wang Bing le dirigeait. Son corps, ses mouvements, sa voix étaient devenus un motif qui nous aimantait, quelque chose d’absolument organique s’est imposé. Un fonctionnement, une danse, un combat qui nous a tous surpris et emportés.
par Caroline Champetier
Analogique • les caméras vidéo analogiques enregistraient encore l’image sur un support physique : des cassettes qui contenaient des bandes de différentes largeurs selon la quantité des informations.
2/3 de pouce • un capteur 2/3 de pouce a la même surface qu’une image super 8mm, il est 5 fois moins grand qu’une fenêtre super 35.
Arri BL • la ARRI BL 35mm était la caméra utilisée sur beaucoup de films d’auteur des années 80 : ergonomique, facile à charger et résistante.
Zeiss GO • Série d’optiques Zeiss très populaire à sa sortie dans les années 70. Ces optiques compactes et légères proposaient une Grande Ouverture du diaphragme (GO), ce qui permettait de tourner dans des conditions de faible luminosité. À grande ouverture, la profondeur de champ était réduite. Cette série revient à la mode, appréciée pour ses bokehs triangulaires et la douceur de son image.
Sony Alpha 7s III • Appareil hybride, à la fois appareil photo au format 24/36 et caméra de haute sensibilité.
Grand capteur • Surface du capteur égale à celle des appareils photo 24/36, donc presque deux fois plus grande qu’un photogramme 35mm.
Optique full frame • Optique dont la couverture permet l’utilisation d’un grand capteur 24×36.
Dolly compacte • Chariot sur roues sur lequel est fixée la caméra, possédant un bras articulé qui permet de se déplacer horizontalement sur rails ou plaque et verticalement jusqu’à 2m de hauteur.
Cher Wang Bing, Merci de m’associer à votre réflexion à propos du lieu où vous souhaitez tourner La Voix Brisée et surtout de me permettre de travailler à vos côtés. Nous retournons le 14 au théâtre des Bouffes du Nord, j’espère que sans le décor, donc vide, il vous apparaîtra possible d’y tourner En réfléchissant à la place de ce nouveau film dans votre travail et aux moyens techniques nouveaux que vous souhaitez utiliser : une caméra dont le rapport signal sur bruit est très performant et l’échantillonnage reconnu comme exceptionnel, des optiques très performantes elles aussi, de la machinerie qui permettra à la caméra de se déplacer avec rigueur et stabilité, je me suis demandée s’il n’était pas intéressant de casser ce luxe de fabrication pour la lumière et d’éclairer Wang Xilin avec une torche, qui serait peut être tenue par vous-même, et que je suive au cadre ce que vous nous montrez et désignez avec le faisceau de lumière. Le 14 je me permettrai de venir avec une torche, si cela vous paraît être une idée à considérer : cela n’est pas la raison de ma réflexion mais ce dispositif rendrait le travail de lumière beaucoup moins coûteux et moins lourd pour la production.
Caroline Champetier


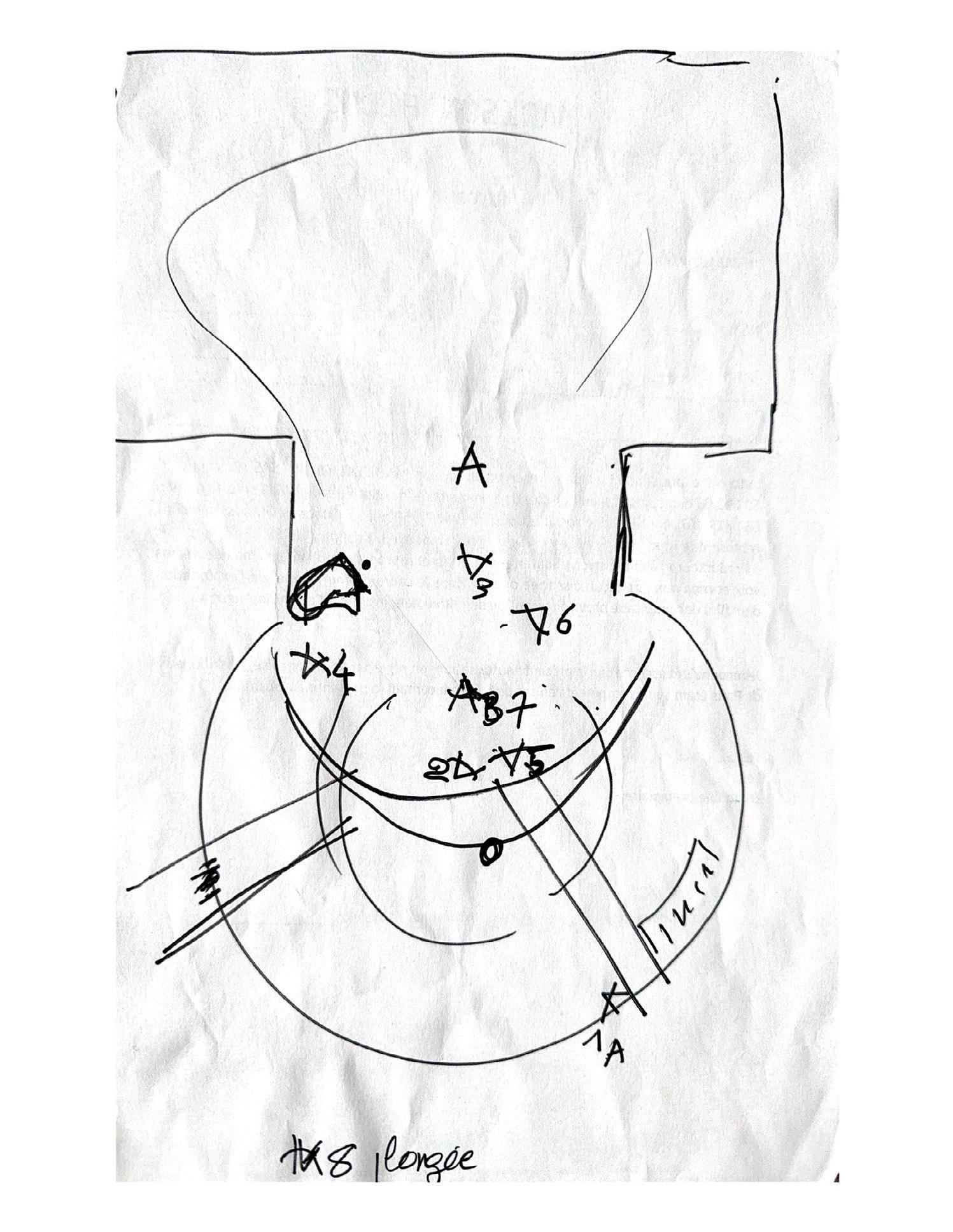






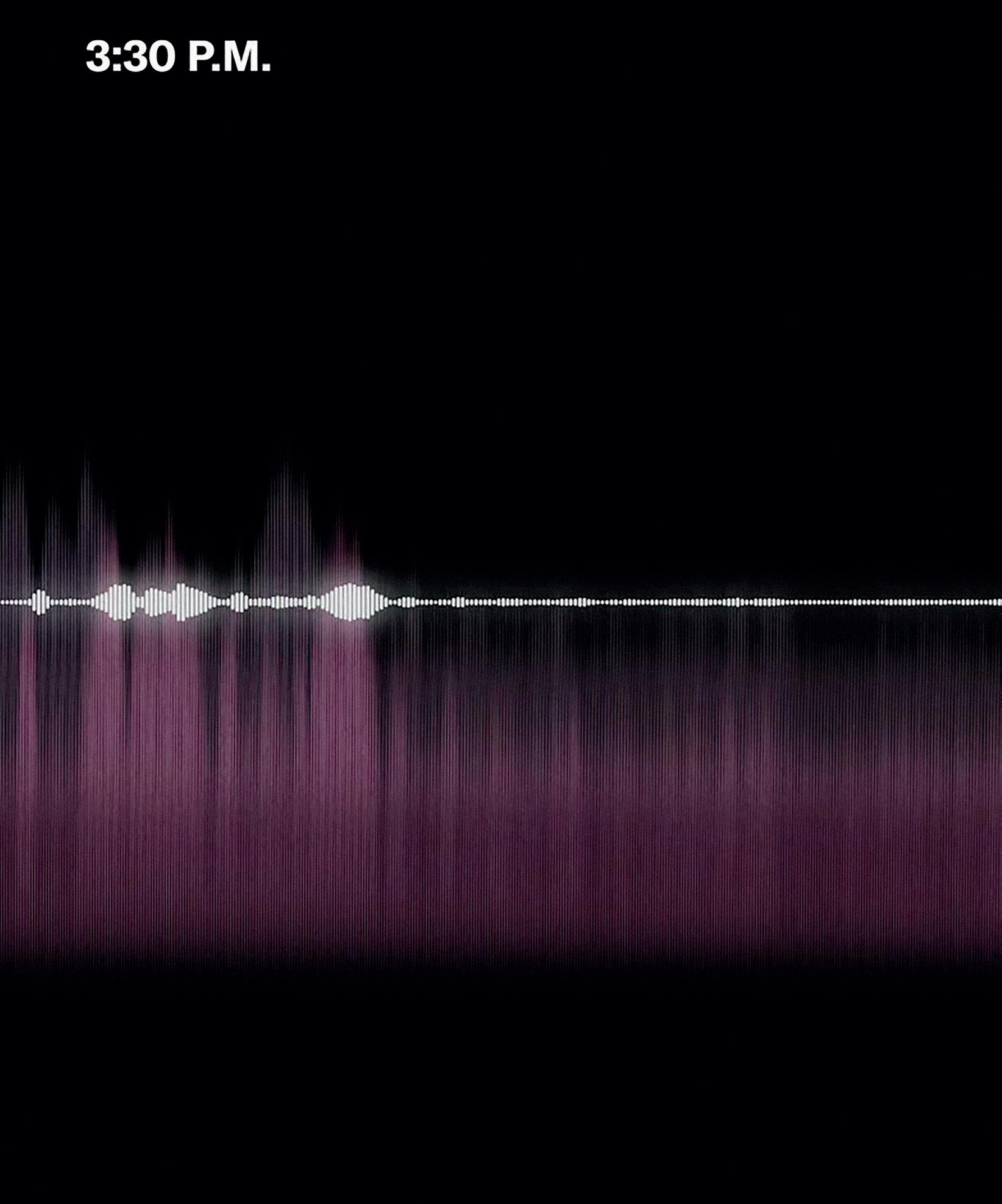
Adrian Martin
Une expression est devenue populaire parmi les critiques et les spécialistes de cinéma au milieu des années 1980 : la frontière entre documentaire et fiction . L ’idée étant que cette frontière s ’avère extrêmement difficile à tracer pour certains films, et impossible à définir de façon catégorique en tant que principe théorique général du cinéma. La ligne de démarcation n ’a de cesse de se déplacer de manière incontrôlable.
L ’origine de ce questionnement dans les années 1980 correspond à l’apparition notable d’un nouveau type de film-essai, associé notamment au travail de Jean-Pierre Gorin (Poto et Cabengo [1980], Routine, Pleasures [1986]) : des films très discursifs, naviguant entre le traitement stylisé de séquences documentaires et d’autres matériaux davantage mis en scène, comme l’utilisation fréquente d’extraits ou de citations d’autres films, le tout conduit par une narration en voix off pleine d’esprit et d’érudition, celle de Gorin lui-même.
Mais d’autres voies évidentes se sont dessinées dans la pratique des cinéastes et dans leur façon d’aborder cet espace fascinant entre documentaire et fiction. En Australie, les psychodrames expérimentaux radicaux de Peter Tammer — qu ’il s ’agisse de filmer patiemment un vieux soldat qui raconte (et revit) ses souvenirs de guerres (Journey to the End of Night, 1982), ou un acteur qui se perd dans un rôle (Fear of the Dark, 1985) — suivaient une intrigue fictionnelle intense et continue, alors même que le caractère artificiel du dispositif filmique était ouvertement mis en scène (ou « provoqué »).
David Shield a fait sensation dans le monde littéraire en 2010 avec son manifeste Reality Hunger, dans lequel il exhorte les auteurs à injecter des doses plus importantes et plus déroutantes de réalité « brute » — par exemple par le biais d’une appropriation pure et simple — dans des formes de prose hybrides. Au cinéma, à la télévision et dans l’art vidéo, cette soif de réalité s ’est traduite par un désir quelque peu différent : une quête de textures
réalistes — durée illimitée, prises non cadrées, traits comportementaux observés au microscope, improvisation et happenings imprévisibles — annihilant radicalement les priorités habituelles de la fiction (point final porté à l’intrigue, personnage central, identification émotionnelle aux personnages). Le vaste genre de la « téléréalité » a adopté, pour le meilleur et pour le pire, ce même désir d’ouverture, tout en le limitant à des formats télévisuels de plus en plus rigides et répétitifs.
Rien de tout cela n’était réellement nouveau, bien sûr. Les psychodrames de John Cassavetes, Norman Mailer ou Robert Kramer (à ses débuts) avaient déjà ostensiblement brouillé la frontière entre documentaire et fiction. Jean-Luc Godard, Agnès Varda, Chris Marker et Joris Ivens avaient ouvert la voie à des formes essayistiques sophistiquées (et continueraient à le faire jusqu’à leur mort). Frederick Wiseman avait affirmé qu’il voulait que ses documentaires soient tout aussi passionnants, structurés et stylisés que des films de fiction.
Un des moments les plus importants dans l’histoire de cette discussion, et de sa répercussion sur la pratique cinématographique, s’est cristallisé autour de la question de la reconstitution. De Peter Watkins imaginant des équipes de reportage télévisé en train de couvrir des évènements historiques de façon anachronique ( Edvard Munch [1974], La Commune [2000]) à l’œuvre d’Elisabeth Subrin (Shulie [1997], Maria Schneider, 1983 [2022]), la reconstitution a souvent ouvert un double référent : un événement réel est évoqué voire minutieusement recréé, mais, dans le même temps, il se voit noyé sous la recréation de matériaux d’époque, dans les moindres détails technologiques et matériels : objectifs de caméra, pellicule de film ou bande vidéo, enregistrement et mixage du son. Les films d’Errol Moris ou Oliver Stone (notamment JFK [1991]), et plus tard la plupart des programmes de non-fiction (en particulier le genre true crime) ont repris ce mode de représentation.
Récemment, Reality (2023) de Tina Satter a marqué l ’une des incursions les plus fascinantes du cinéma grand public à la frontière mouvante entre documentaire et fiction. De par son ambition et son aspect visuel, le film s’apparente à un « film indépendant américain » classique, mais il a bénéficié de la présence de l’actrice Sydney Sweeney dans le rôle principal, et d’une large diffusion dans les festivals, les salles de cinéma, ainsi que sur les plateformes de streaming (HBO).
Reality s ’est vu attribuer de nombreuses étiquettes, parfois contradictoires : thriller, film policier tiré de faits réels, essai politique, exercice de « surréalisme lynchien », reconstitution artistique conceptuelle, réitération du Procès de Kafka dans la vraie vie… Le film semble être parvenu à se faire une place et à se maintenir en é quilibre à la frontiè re entre de nombreux genres.

Reality recrée avec inventivité un jour fatidique dans la vie de Reality Winner, jeune femme de 26 ans employée par la NSA (National Security Agency), l ’agence de renseignement américaine, avec un haut niveau d’habilitation de sécurité. Le 3 juin 2017, alors qu’elle rentre chez elle en voiture, Reality est abordée devant son domicile à Augusta, en Géorgie, par deux agents du FBI, Garrick (Josh Hamilton) et Taylor (Marchánt Davis), bientôt rejoints par une équipe complète. Munis d’un mandat de perquisition, ils entreprennent une fouille approfondie du domicile, de la voiture, des appareils informatiques et des effets personnels de Reality. D ’abord évasifs, Garrick et Taylor finissent par révé ler qu ’ils disposent de
preuves irréfutables établissant que, le mois précédent, la jeune femme a divulgué un rapport confidentiel de la NSA concernant l ’ingérence de la Russie dans les élections américaines de 2016, en l ’envoyant par courrier à The Intercept, un média en ligne d’extrême gauche.



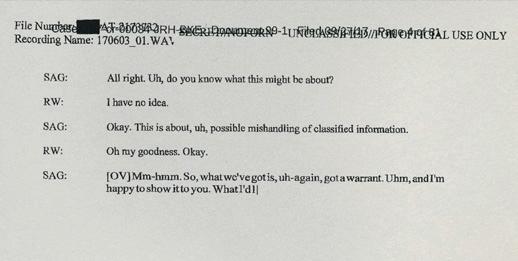
Tous les échanges, de ce premier contact à l’arrestation de Reality, sont enregistrés par les agents sur un support audio numérique. La partie la plus longue et la plus intense de cette véritable inquisition se déroule dans une pièce inoccupée de la maison. Suite à son arrestation, Reality se verra condamnée à une peine de cinq ans et trois mois dans une prison
fédérale. Dans la sphère publique, cette affaire sera au cœur de débats houleux entre ceux qui saluent la contribution nécessaire des lanceurs d’alerte, et ceux qui condamnent au contraire ces « traîtres » à la patrie.
En 2019, la réalisatrice et dramaturge Tina Satter monte le spectacle IS THIS A ROOM: Reality Winner Verbatim Transcription, sur la scène de The Kitchen à New York. La pièce repose enti è rement sur la transcription officielle par le FBI de l’enregistrement du 3 juin, interprété mot pour mot par des acteurs, sur la seule base des échanges et « indications scéniques » mentionnés dans ce rapport.
Satter a expliqué que trois choses l’avaient frappée lorsqu’elle a lu la transcription pour la première fois. Tout d’abord, elle a trouvé que le texte ne demandait qu’à être joué à voix haute, dans un ou plusieurs médias (théâtre, radio, cinéma). Ensuite, le texte lui a tout de suite fait penser à certains films de fiction bien connus. Enfin, les conventions de style employées par concision par le transcripteur (par exemple, le fait que tous les agents présents sur les lieux sans distinction, à l ’exception de Garrick et Taylor, soient désignés par l ’appellation « homme non identifié ») faisaient froid dans le dos, tant elles rendaient compte indirectement de la façon dont le pouvoir patriarcal était en train de s’abattre sur une jeune femme suspecte.
Sans oublier ce qui constitue peut-être la plus grande aubaine pour Satter, tellement évidente qu ’elle n’éprouve presque jamais le besoin de la mentionner en interview : le nom même de Reality Winner [« Réalité Gagnante » en français, ndt.]. Ce nom est tellement chargé de sens (dramatique, conceptuel, ironique) qu’il a servi non seulement de titre au film de Satter, mais aussi à un autre film biographique, plus grinçant, intitulé Winner (2024) et réalisé par Susanna Fogel.
Le projet pourrait donc sembler ancré dès le départ dans la réalité des faits, du moins, telle que documentée par le FBI, puis reprise dans de multiples reportages dans des médias
grand public (un sujet dans l’émission 60 Minutes , le documentaire Reality Winner [2023], des podcasts, etc.). Mais, à l ’image d ’Anna Broinowski dans son enquête haletante Forbidden Lie$ [2007], Tina Satter semble être une grande admiratrice de Vérités et Mensonges [F for Fake, 1974], en ce qu’elle a préféré exploiter l’ambiguïté, propre à une grande partie de la non-fiction, autour de laquelle Orson Welles a structuré son film-essai : faut-il vraiment croire les promesses d’« objectivité » (comme l’inscription « inspiré d’une histoire vraie », préambule si fréquent à la télévision) proclamées par l’auteur dans les premières images d’un film, pouvons-nous vraiment lui faire confiance ? Ainsi Reality va-t-il prendre par la suite (comme Welles) des libertés considérables avec son propre postulat de départ.
Cet écart est évident dès le premier plan du film, surtout si l’on prête une attention particulière à la façon dont il se termine, en une fraction de seconde. Tina Satter cadre de façon statique une journée de travail, à la manière de Chantal Akerman, Kitty Green ou Cindy Sherman dans Office Killer (1997) : une rangée de bureaux, chaque employé travaillant sur son ordinateur, Reality au centre de l’image… Mais le tout est accompagné du bourdonnement incessant des voix sur la chaîne Fox News (plus spécifiquement, un reportage sur le renvoi par Trump du directeur du FBI James Comey), diffusée sur des écrans omniprésents sur les murs du bureau, et dont le son précède les images. À lui seul, ce plan résume un thème central qui sera explicitement abordé plus tard par les personnages : le déferlement incessant d’inepties médiatiques qui a fini par pousser Reality à se muer en lanceuse d’alerte.
Mais là n’est pas la caractéristique la plus notable de ce prologue. Avant de passer à l’intertitre « 25 jours plus tard », l’image vacille ou tressaute l ’espace d ’un court instant dans un effet de « glitch », une sorte de bug ou d’altération visuelle, surimposé fugitivement, qui rappelle l’apparence familière des images
numériques dégradées avec le temps, ou un défaut de pixellisation. Ces imperfections, créées par le chef décorateur Tommy Love, vont peu à peu se propager dans tout le film.


Ce premier effet de brouillage n ’a pas de justification apparente en matière de récit ou de psychologie (ces connotations viendront plus tard) mais, conformément à une tendance répandue dans le cinéma contemporain, il introduit une érosion insidieuse de l’état de réalité qui s ’ op è re à plusieurs niveaux simultanément. À l’ère numérique des fake news et autres déformations ahurissantes de la vérité, le film entreprend de montrer un événement dont la réalité est instable pour tout le monde, aussi bien pour ceux qui y prennent part que pour ceux qui en consomment les représentations médiatiques.
J ’ignore si la pièce IS THIS A ROOM (qui emprunte son titre à une phrase prononcée par un des « hommes non identifiés » fouillant la maison de Reality) se déroulait rigoureusement en « temps réel », mais le film n’en retient que l’illusion ou la sensation. Tout en respectant (comme dans la pièce) la contrainte qu ’elle s ’est imposée de n ’utiliser que la transcription du FBI pour sa mise en scène, le scénario de Satter (co- écrit avec Paul Dallas) est constitué de blocs du texte de la
transcription, avec des ellipses à la fois entre et à l ’intérieur des sc ènes. La réalisatrice admet volontiers s’être emparée du côté « thriller » du texte, de sa capacité à empoigner le spectateur et à ne plus le lâcher, dès la première lecture. À cet effet, le film se concentre sur ce que Satter décrit comme le « craquage » émotionnel, l ’effondrement déchirant de Reality au fil de son interrogatoire, à mesure qu’elle réalise que son destin sera à jamais bouleversé par les évènements de cette journée.

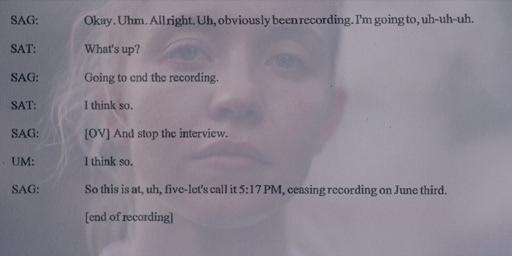
Ce traitement des faits et des images témoigne de ce qu ’Anna Kornbluh décrit comme la persistance du concept de « soif de réalité » de Shield dans la culture audiovisuelle actuelle. Dans son livre Immediacy : Or, the Style of Too Late Capitalism (2023), Kornbluh évoque de nombreux cas d ’immersion culturelle contemporaine : dans un flux télévisuel, dans une installation de réalité virtuelle, ou encore dans l’esthétique de l’immersion tête baissée ou du « spectateur embarqué » (son exemple clé étant Uncut Gems [2019] des frères Safdie). Satter, pour sa part, souhaite que nous, spectateurs, soyons dans la conscience même de Reality, que nous partagions son effondrement en temps réel. Comme la réalisatrice l’a confié au magazine Why Now : « Ce sont des parties du cœur de Reality qui s’offrent à notre regard, un aperçu de sa carte émo-
tionnelle »1. En cela, les bugs à l’écran fonctionnent comme une visualisation de la subjectivité de Reality.


Satter a également cherché à atteindre un équilibre particulier dans la texture du film. Au sujet de l ’insertion occasionnelle de véritables photos de Reality prises par le FBI ce jour-là, ainsi que de photos personnelles et de contenus issus de son compte Instagram, la réalisatrice explique : « Pour moi, il a toujours été important d’intégrer quelques touches de la véritable Reality, mais je n’ai jamais considéré pour autant le film comme un documentaire… C’est un long métrage de fiction avec des touches de réel, il n’y a pas de catégorie clairement définie ».2
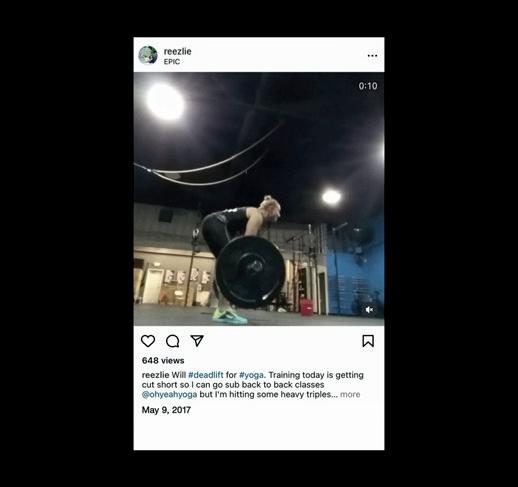


En plus d’être un « long métrage de fiction avec des touches de réel », Reality est aussi une reconstitution pleine de références fictionnelles et cinématographiques. La premiè re fois que nous voyons le groupe compact des six agents du FBI, il est difficile de ne pas penser aux plans tendus en caméra subjective dévoilant le point de vue de Clarice Starling dans Le Silence des agneaux (1991) de Jonathan Demme. Satter décrit son film comme un thriller inversé : pas d’arme à feu ni de fusillade, pas de poursuite ni de meurtre ; l’effroi est tout entier produit par l’interrogatoire lui-même, et par le confinement physique subtil de Reality.


Dans la mise en scène de cette impression de claustration, on retrouve l ’empreinte complexe de la stylistique utilisée par Welles dans la scène d’ouverture virtuose de son film
Le Procès (1962) : décor dépouillé, objectif grand angle qui crée une distorsion spatiale et une distension de l’espace, concentration extrême de la lumière, chorégraphie des corps coercitifs ou soumis, le tout complété par les intrusions soudaines et saugrenues d’agents apparaissant et disparaissant dans l’encablure d’une porte.3


À un autre niveau, Reality propose un commentaire réflexif sur la nature du jeu et de la performance de l’acteur. En tant que reconstitution, le film respecte scrupuleusement la transcription du FBI, mais en ajoutant bien sûr de nombreux éléments prêtant à interprétation : les regards, les gestes, les postures, la façon dont les personnages se tiennent et changent de position, le timing précis de leur prise de parole… Sans oublier tous les éléments générés par le découpage dans la phase du montage, ni l’apport généralement minimal de Nathan Micay en matière de tonalités musicales et effets sonores, dont la palette s’élargit uniquement dans le générique de fin.
De la même manière, nous avons rapidement l’impression que le comportement des agents du FBI ce jour-là relève de la performance
préparée à l ’avance, selon une procédure précise : chaque plaisanterie décontractée, chaque bafouillement ou trébuchement, chaque bavardage anodin sur les animaux de compagnie ou la santé, chaque geste de sollicitude envers Reality, tout cela fait partie d’un « scénario ». Dans le cadre de ses recherches pour faire le film, Satter a rencontré une femme, ancien agent du FBI, qui a confirmé : « Oui, ce genre de descentes, c’est à 100% de la comédie ». 4
Le dispositif mis en place dans Reality prend plusieurs tournures astucieuses. La transcription documentée devient la base d’une mise en scène reconstituée ; puis, dans une démarche surprenante qui peut sembler contre-intuitive de prime abord, cette fiction recréée va s’accompagner de preuves documentaires ponctuant les scènes, apparemment pour authentifier ce que nous voyons et entendons. C’est le cas en particulier de la visualisation constante d’un document audio au format WAV, sur lequel on n’entend pas le
« véritable » enregistrement du FBI (Satter affirme ne jamais l’avoir écouté), mais une version de moindre qualité sonore, interprétée par les acteurs professionnels.
L’« illusion audio » va jusqu’à couper une scène filmée sur un son ambiant particulier — des aboiements de chiens dans le voisinage — et faire continuer ce son dans le fichier WAV. Ces enjolivements « réalistes » sont un ajout de la réalisatrice, puisque le rapport du FBI ne fait nullement mention de ce genre de détails aléatoires et superflus. Il s’avère que toutes les images du fichier WAV sont des inventions du film.
Comme souvent au cinéma, c’est cet excès de détails qui garantit l’illusion de ce que Roland Barthes appelait « l’effet de réel ». Pourtant, à un autre niveau, Reality s’attache à attirer notre attention dès la première seconde sur la nature construite, ou plus exactement instable de cette illusion.
Un autre aspect du film joue sur ce rapport entre réalisme apparent et stylisation expres-
sive : il s’agit de la recréation du processus de révision ou de censure tel qu’il apparaît dans la transcription du FBI. Tout au long du film, on peut observer des procédés familiers (aujourd’hui devenus de véritables clichés télévisuels) destinés à « donner vie » à des documents statiques : l’usage d’une animation graphique pour montrer, pour ainsi dire en « temps réel », le processus de révision du document (des passages caviardés), ou la technique du « desktop documentary », qui montre les mots de la transcription à mesure qu ’ils sont tapés, lettre après lettre. Pour représenter des mots manquants ou barrés (je me demande comment ils apparaissaient dans la pièce de théâtre ?), Reality fait preuve d’une grande inventivité — et c ’est là que nous revenons à la question des distorsions ou défauts de l’image, à ce fameux effet de « glitch ».
Il existe une tradition subversive au cinéma qui joue en apparence le jeu de la censure, tout en faisant comprendre au spectateur que tel ou tel passage a été expurgé. Dans plusieurs de ses films, du milieu à la fin des années 1960, Jean-Luc Godard a par exemple « recouvert » des passages censurés, sensibles sur le plan politique, par un flot d’effets sonores grinçants. Luis Buñuel a fait de ce stratagème une plaisanterie récurrente dans Le Charme discret de la bourgeoisie (1972). La même logique opère dans Yackety Yack (1974), merveilleuse satire du cinéma militant, de style godardien, réalisée en Australie par le Canadien Dave (ou DB) Jones. Dans ce film, une discussion à bâtons rompus (inspirée de Maidstone [1970] de Norman Mailer), entre les acteurs se rebellant contre leur réalisateur autoritaire, se voit déchiquetée au montage par une série de coupes franches, le réalisateur (fictif) préférant faire disparaître les critiques à son encontre. Quant au film Redacted (2007) de Brian De Palma, qui se déroule en Irak, il repose sur un concept élaboré, centré sur la question de la censure et de sa dénonciation par le biais d’une reconstitution fictive.
Reality utilise le brouillage de l’image dans un but similaire. Cet effet spécial animé met en
évidence ce qui manque, laissant derrière lui de brefs trous ; telle est sa fonction narrative. Non seulement des paroles prononcées disparaissent, mais également le corps des acteurs, derrière un « nuage de parasites ». La première fois que cela se produit, après plus de 30 minutes, c’est un véritable choc pour le spectateur. Satter a révélé un élément presque invisible à l’écran : ces défauts de l’image ont en partie été fabriqués à partir d’images de Fox News — ce qui renvoie à l’omniprésence des écrans dans le tout premier plan. La réalisatrice qualifie ce procédé de « secret interne bizarre » du film.

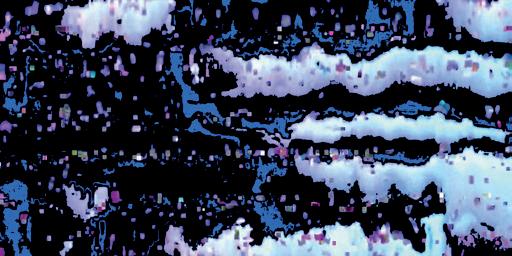

Impossible, enfin, de ne pas évoquer la couleur rose. L’esthétique générale du film est dotée d’un code couleur particulier, décliné selon un schéma logique et systématique qui ne se remarque pas forcément au premier visionnage. Celui-ci repose sur l ’association du personnage de Reality avec la couleur rose (et ses variations tonales). Certains petits détails la relient dès le début à cette couleur prétendument réservée aux filles, à travers des objets
à l’effigie d’Hello Kitty, du papier peint à fleurs, et ainsi de suite. Toutefois, 60 minutes plus tard survient un moment clé sur le plan stylistique, lorsque Reality émerge d ’ une brume semi-consciente et dissociée, pour se livrer face aux agents du FBI à une démonstration de force et d’affirmation de soi clairement fantastique et subjectivement imaginaire. Le point de bascule survient lors de l’apparition à l’écran d’une page du navigateur Tor, en violet. Dans les plans suivants apparaissent quelques pointes de rose. C’est durant cet intermède fantastique que Reality rompt le régime de censure simulé qui prévalait jusqu’alors, en prononçant le nom de The Intercept, auparavant masqué par les brouillages de l’image.
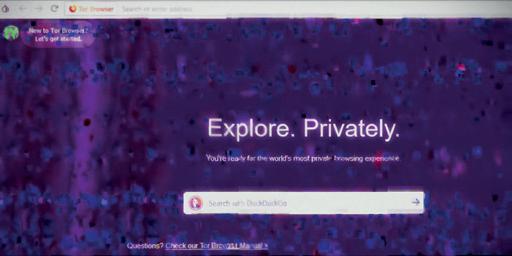



En revoyant le film, avant et après cette scène, on remarque alors des touches de rose vif disséminées un peu partout : par exemple, dans le document crucial de la NSA que lit Reality, ou dans les derniers intertitres, où la réalisatrice passe du traditionnel noir et blanc pour les faits « objectifs », journalistiques, au rose pour la déclaration de Reality. Juste après, les premiers et principaux crédits du générique de fin apparaissent également dans cette couleur, comme s’ils prenaient son parti
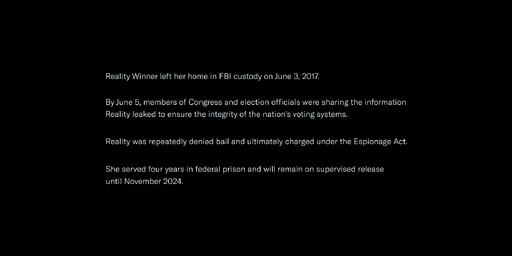
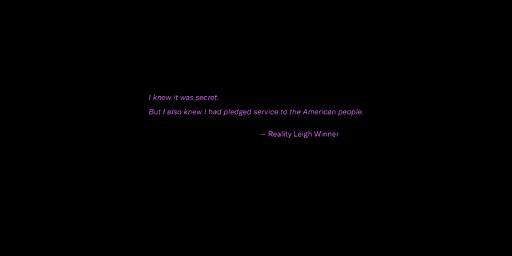

Notes
1 • Maria Lattila, “Tina Satter on Reality : ‘I could feel the tension in the transcript’”, Why Now website (UK), 2 June 2023, <https://whynow.co.uk/read/tina-satter-reality-interview>.
2 • Lattila, Ibid.
3 • Cristina Álvarez López et moi avons réalisé un essai audiovisuel intitulé Reality Trial (2024), qui recoupe des extraits des deux films. On peut le voir ici : <https://vimeo.com/880203224>.
4 • Scott Macauley, “Tina Satter”, Filmmaker, 2022, <https://filmmakermagazine.com/people/tina-satter/>.

Sur Trenque Lauquen (Laura Citarella, 2023)
Laura parle déjà depuis près d’une heure dans un studio de radio, à l’orée du jour ; elle enregistre un message pour sa collègue Juliana, afin qu’au moins une personne sache que c’est elle qui a choisi de disparaître. On la voit parler au micro cette nuit-là, mais on voit aussi Juliana faire écouter le message à Ezekiel, dit Chicho, au même endroit mais quelque temps plus tard, alors que Laura est bel et bien partie. Ces deux fils se mêlent à un troisième, car nous voyons aussi les choses qu’elle décrit, tous les évènements étranges dans lesquels elle s’est retrouvée impliquée ou qu’elle a elle-même déclenchés, c’est parfois difficile à dire. Elle est la narratrice, mais elle est aussi à la merci de l’histoire, une femme qui a des ennuis à cause de cela et de bien d’autres choses encore. Ses amis l’écoutent, nous l’écoutons, mais rien ne l’aide ; elle est seule.
Laura dit que c’est lorsqu’elle était dehors à surveiller la maison, dans le noir, à écouter ce son étrange et à observer cette lumière surnaturelle dans la chambre à l’étage, qu’elle a réalisé qu’il s’agissait là de la véritable histoire, l’histoire de ce qu’ils ont trouvé dans le lac. Il ne s’agissait pas des lettres ni des livres, ni de Chicho ou Rafael, dit-elle, mais on a déjà vu ces histoires à mesure qu’elle les racontait, ainsi que celles qui ont surgi en chemin, tandis que d’autres attendent encore en coulisse. Elles se nourrissent les unes des autres, et pourtant il s’agit de chapitres distincts, avec chacun sa propre ambiance, son propre genre, des sons et des images spécifiques, son propre narrateur, bien qu’ils regorgent de parallèles étranges, et que leur récit, dans un flot précis et constant, les ramène toujours à Laura, tourne autour d’elle, cette faille centrale que tout le monde cherche à combler, comme un lac. À en croire Laura, il vaudrait peut-être mieux ignorer tous ces récits connexes et se concentrer sur la « véritable » histoire, mais c’est plus facile à dire qu’à faire, tout est connecté, et pas seulement par Laura ; les narrateurs ne sont pas tous également fiables.
Laura pense que l’essentiel ne se résume donc pas, en fin de compte, à ce que font Rafael et Chicho, à leurs tentatives pour la retrouver par le biais des fleurs qu’elle cherchait à classer en allant d’un lieu automnal quelconque à un autre, dont seul le nom diffère : Fortin Olvarría, América, Trenque Lauquen, tout en lumière blafarde et tons verts délavés. C’est comme un road movie ou un film policier, mais à l’ambiance maussade et funèbre, appuyée par une section de cordes sur la bande originale — un exercice en cercles de plus en plus concentriques, loin de l’exaltation de la route. Le mot de Laura que Chicho trouve sous l’essuie-glace pourrait faire penser à cet appel des grands espaces, mais le froid de la plaine donne un tout autre sens à son message, faisant de « Adiós, Adiós, me voy, me voy » moins une fuite qu’un adieu. Rafael parle des différentes versions de Laura qui coexistent et il n’a pas tort, mais il semble surtout obsédé par celle qui selon lui est folle. Nous ne saurons que plus tard quelle version de la jeune femme a écrit ce mot.
La version de Laura que Chicho a rencontrée n’était pas folle mais plutôt déterminée, vivante, enthousiaste, en quête non pas de fleurs mais de livres, de lettres et d’une histoire d’amour, même si nous devrions nous rappeler que l’essentiel n’est pas là. Alors que Laura et Chicho traversent en voiture le paysage lumineux de la fin de l’été et se plongent dans la correspondance entre deux amants du passé cachée dans les livres de la bibliothèque de Trenque Lauquen, leur quête est comme une image en miroir des exploits précédents de Rafael et Chicho, la joie et l’espoir en plus. Ce road movie-là se déroule sous le soleil et, entre deux conversations autour d’une bière, la bande-son s’emplit d’accords nerveux au piano, sur lesquels les personnages chantent dans la voiture. Ils se sont lancés dans cette enquête non pas par nécessité mais par curiosité, et leurs recherches pour un reportage radio partent vite dans tous les sens, jusqu’à relier, en vrac, l’autobiographie d’Alexandra Kollontai, les abeilles de Maurice Maeterlinck, Cesare
Pavese, 1962, 1968, les villes italiennes, les anciens professeurs de Chicho, et autant de versions de Juana qu’il y en a de Laura, des femmes qui marquent l’histoire de différentes manières. Même quand tout est étalé sur la table dans la chambre de Laura, on a l’impression que c’est infini, illimité, étourdissant, et qu’on pourrait encore s’y perdre, comme dans les plaines.
Bientôt, l’histoire d’amour entre Carmen Zuna et Paolo Bertino n’est plus seulement racontée par Laura et Chicho, nous la voyons également à l’écran, comme lorsque Laura apparaît dans l’histoire qu’elle racontera plus tard dans la station de radio. Chicho joue le rôle de Paolo et Carmen est interprétée par une autre Laura, elle aussi habile conteuse. Cette Laura se met à errer dans la plaine, seule, sans but, et le couple n’est jamais réuni, bien qu’elle finisse au moins par atteindre l’océan, mais est-ce un happy end ? Alors qu’il repart sans personne à ses côtés sur le siège passager et que la chanson mélancolique passe à la radio pour la première de nombreuses fois, Chicho n’est pas heureux lui non plus. L’histoire d’amour a donné naissance à une autre histoire d’amour, mais celle-ci n’a nulle part où aller, et il ne reste plus d’elle qu’un baiser échangé autour d’une bière, une étreinte d’adieu d’une tendresse rare, et les souvenirs de ce qui a été, ce qui aurait pu être, alors qu’ils jouaient à un jeu de main enfantin sous les grands arbres au son des grillons, à la tombée du jour, et que leurs mains se touchaient plus longtemps que nécessaire. Laura a dit que l’essentiel n’était pas là, mais c’est quand même triste. Te dejo, te dejo, te planto, te planto, te mato, te mato, te entierro, te entierro, adiós, adiós, adiós. L’ambiance change à nouveau lorsque Rafael rencontre Norma en ville et qu’elle lui donne sa propre version de Laura : une Laura qui déraille, irresponsable, antipathique, différente de celle que nous connaissons, bien qu’il ne fasse aucun doute qu’il s’agit d’une femme. Norma est certainement l’un des narrateurs les moins fiables. Au départ, elle dit qu’elle emballe un cadeau pour son filleul, mais plus
tard, il est pour son neveu. Il y a quelque chose qui cloche dans tout cet échange. Norma conduit Rafael à la gare routière, et le même malaise s’installe, les arbres et les bâtiments sont filmés en contreplongée, comme si la caméra cherchait à discerner quelque chose dans le ciel, les modulations d’un thérémine flottent sur la bande-son et un château d’eau aux airs de soucoupe volante s’immisce dans le cadre. C’est là que l’on aperçoit pour la première fois le lac qui donne son nom à la fois à la ville et au film : Trenque Lauquen, « lac rond ». Norma mentionne également ce qu’on y a trouvé, et nous arrivons enfin à la véritable histoire, du moins d’après Laura. Norma explique qu’il s’agissait d’une sorte de créature, singe ou peut-être alligator, même si on a aussi parlé de science-fiction, il y a eu des milliers de théories, d’articles, de reportages télévisés, de débats à la radio, de conférences de presse sur le sujet, une histoire en chassant une autre ; le thérémine vibre et gémit.
Nous pouvons enfin retourner à cette nuit dans la station de radio et écouter Laura nous expliquer de quoi il retourne selon elle, même s’il n’est pas évident de savoir ce qu’on a réellement trouvé dans le lac. Un plan large de l’eau à l’aube s’attarde pendant trois bonnes minutes sur le bateau, les véhicules de police et l’ambulance, sans rien clarifier pour autant. De toute façon Laura ne faisait pas attention, elle était trop distraite par l’histoire d’amour du passé, par sa petite histoire d’amour du présent, et par l’autre histoire qui commençait à se dérouler en parallèle, celle d’une femme étrange et distante, surgie de nulle part pour lui demander des fleurs jaunes ; les bois et les cordes menaçantes de la musique donnent alors au film des allures d’histoire de fantômes. Cependant, cette apparition est liée à l’autre, celle du lac, car Elisa Esperanza se révèle être le médecin désigné pour s’occuper de la créature qu’ils ont trouvée, même si elle s’est retirée de l’affaire quand il a été établi qu’il ne s’agissait pas d’un être humain. Quand ils la décrivent aux informations, cela rappelle
la façon dont Norma parle de Laura, une femme rebelle, une femme « difficile », comme celles qui font l’histoire ; une femme qui a un but est souvent une femme qui a des ennuis.
C’était la maison d’Elisa que Laura observait de l’extérieur dans l’obscurité cette nuit-là, attentive à la lumière et aux bruits. Le lendemain, Laura frappe à la porte et peu après elle s’installe, aidant Elisa, enceinte, et sa femme Romina à ramasser les feuilles mortes, cueillir les bonnes herbes, filer la laine. Elisa lui parle de la créature à l’étage dès le premier jour, elle lui dit qu’elle n’est pas humaine, que c’est un mutant, une chose qui toujours se transforme, comme la musique, comme Laura, comme le film lui-même ; pour le moment, c’est une femelle. Par la suite, Elisa n’en parle plus, malgré les cris à l’étage, malgré les martèlements la nuit, malgré les fleurs jaunes qui poussent dans la plaine, qui poussent sous des lampes dans la remise, fleurs qui sont là pour être mangées. Laura a dit que c’est de cela qu’il s’agissait, mais d’une certaine façon, ce n’est pas du tout de cela qu’il s’agit non plus, la musique s’est adoucie, est devenue mélancolique, comme la bande originale d’une histoire d’amour, mais d’une histoire d’amour différente de toutes les précédentes, un amour sans peur, sans jugement, plein d’espoir. Nous voyons une autre Laura, la plus optimiste de toutes. Elle ne restera pas longtemps.
Nous ne savons pas exactement pourquoi on a demandé à Laura de quitter la maison, elle ne fait que le mentionner en passant, son récit touche à sa fin, la véritable histoire est terminée. Elle ne retourne sur les lieux qu’une dernière fois, après qu’Elisa et Romina se sont déjà enfuies avec la créature, ne laissant derrière elles que des traces et les images qu’elles ont inspirées. Une pataugeoire remplie d’eau saumâtre qui s’écoule d’un arrosoir, sur des troncs, des ventilateurs qui bourdonnent, de la végétation partout, même peinte sur les murs, les bruits de la jungle, différents de ceux des plaines. Dans le placard, il y a l’esquisse d’un corps qui ressemble à celui d’une femme enceinte ; il y a des empreintes
de pas dans la boue sur l’île au milieu du lac, un parfum persiste sur les fleurs jaunes. Plus tard, alors que Laura est assise en voiture, son récit déjà terminé, Elisa l’appelle pour la dernière fois. C’est fini, elles n’ont pas réussi, ce n’est plus la véritable histoire, mais c’est triste quand même. On aperçoit à peine le visage de Laura, de dos, difficile de voir si elle pleure. Mais on reconnaît facilement la version de Laura qui a écrit la note : une Laura anéantie, une Laura vidée, une Laura, comme toujours, seule. Y a-t-il quelque chose de plus triste que de réaliser qu’il n’y a plus rien à dire ?
Le compte-rendu a été fait, la véritable histoire est finie, mais le film se poursuit néanmoins. Laura abandonne la voiture et continue à pied, il n’y a pas de musique appropriée à l’ambiance, seulement les oiseaux qui piaillent, les grillons qui stridulent, les vaches qui meuglent et les poules qui gloussent, des gauchos qui chantent dans le bar comme dans un film en costumes, le clapotis de l’eau sous le pont ; la lumière a changé, la fraîcheur de l’automne s’est installée. Carmen a arpenté ces plaines, elle aussi, dans un temps qui n’a plus l’air si différent du présent ; cette Laura a atteint la mer, celle-ci n’y parviendra pas. Cette Laura n’a plus les mots, elle ne nous expliquera pas ce qui se passe ; en l’absence de narrateur, c’est peut-être à nous de raconter ?
Alors que tout devient calme, la plaine apparaît enfin, même si elle a toujours été là, enveloppant tout dans son étreinte, une grande étendue sans limite, aux éléments interchangeables — villes, haies, routes et arbres, villes, haies, routes et arbres. Est-ce de cela qu’il s’agit au fond ? Je me souviens avoir traversé ces plaines en voiture pendant des heures, je m’endormais, me réveillais, et rien n’avait changé. Un tel espace trouble l’esprit, il s’étend à perte de vue, sans jamais s’arrêter, sans jamais changer, une toile vierge infinie qui compte bien rester ainsi. C’est peut-être pour cette raison que ces histoires ont été racontées, c’est peut-être de cela
qu’il s’agissait vraiment : de la tentative joyeuse de remplir un espace qui ne peut l’être, de rassembler et de relier autant de signes, de sons et de formes que possible, tout en sachant qu’ils finiront par perdre toute signification, par se taire, engloutis par le silence. La lumière teinte en noir la rangée d’arbres à l’horizon, tandis que le ciel oscille entre le jaune et le bleu. La berge d’une rivière à l’aube, déserte.
Traduit de l’anglais par Claire Habart



« T’as quel âge ? »
Cyril Neyrat
Sur Le Gang des Bois du Temple (Rabah Ameur-Zaïmeche, 2023)
C’est le deuxième plan du film. M. Pons fume une cigarette sur son balcon. On entend des sirènes qui s’approchent. Une ambulance se gare au pied de la tour. Quelques plans et deux-trois mots plus tard, les ambulanciers emportent le corps de Mme Pons, sa mère morte pendant la nuit.
C’est la dernière séquence. M. Pons vient de tuer l’émir. Il fume une cigarette sur un balcon qui est à la fois le même et un autre, car le changement d’axe a modifié le paysage sur lequel se découpe sa silhouette. Il regarde vers le bas, au pied de la tour. Plus de parking de béton, mais une grande pelouse arborée. Plus de sirène ni d ’ambulance, mais deux enfants vêtus de rouge qui jouent sur le vert tandis qu’un homme, sans doute leur père, finit de nourrir les pigeons. M. Pons les regarde longuement, un sourire vient sur son visage, il fait un geste de la main dans leur direction. Le champ contrechamp se poursuit, sans un mot, juste la rumeur du quartier, très douce, gris bleuté des tours et du ciel contre vert profond de la pelouse.
Entre ce début et cette fin qui se répètent dans la différence, comme deux variantes d’une même séquence, ce n ’est pas seulement l’action observée qui a changé : transport d’un cadavre, jeu des enfants. C’est l’espace même où l’action a lieu : pelouse verte en lieu d’un parking gris. De l’écart entre ces deux séquences on peut déduire deux traits du ciné ma de RAZ . Ils sont d’autant plus manifestes dans Le Gang des Bois du Temple que les manières de son cinéma s’y expriment avec une souveraineté inédite.
Le premier trait concerne la nature du plan. C’est l’idée que l’espace ne préexiste pas à l ’action, qu ’il n ’y a pas d ’abord un espace contenant dans lequel divers contenus peuvent avoir lieu. Il y a la matière insécable du plan, sa réalité sensible, sensuelle, indivisible, qui est la matérialisation d ’ un espace-action. Parking gris , arriv ée de l’ambulance qui sirène. Pelouse verte, enfants rouges qui courent autour de leur père et dont la course croise le vol des pigeons qu ’il a
nourris. Ou encore, dans une séquence dont la violence sèche coupe le souffle : cour de la prison, course circulaire de Bébé, cris hostiles des détenus qui s’enroulent autour de son corps jusque’à ce que l’un d’eux vienne fendre le cercle et le tuer, sans qu’on ait vu aucun couteau, pas de sang non plus, comme si l’intrusion de l’homme dans la chair du plan suffisait à tuer le personnage.
La seconde propriété a trait au montage. Combien de films français d’aujourd’hui osent faire du champ contrechamp non pas l’instrument de reproduction du scénario dans un espace-temps naturaliste mais l’outil de production d’un espace-temps surnaturel ? Combien s’autorisent à jouer avec la grammaire la plus élémentaire du cinéma comme si sa puissance était redécouverte, son enfance retrouvée ? Rares sont les films dont on sort avec la sensation d’avoir assisté à la renaissance du langage de la fiction cinématographique. C’est d’autant plus rare et émouvant lorsque le langage n’y prétend à aucune nouveauté, aucune singularité. Car alors, ce n’est pas un autre cinéma, un cinéma différent, qui a l’air d’apprendre à marcher et parler sous nos yeux, c’est le cinéma, la fiction même que l’on retrouve.
avec eux comme le fait Régis Laroche, interprète de M. Pons, émerveillé d’improviser son jeu en miroir et réponse à leur vie immédiate. Un homme et deux enfants font des crêpes pour de vrai, et c’est un jeu. Ce geste de confier les commandes de la scène aux enfants, à leur vitalité imprévisible et non entravée, RAZ le déploie à l’échelle d’un film dont le seul véritable sujet serait l’enfance comme résistance. Filmer la vie enfantine, la vie de l’enfance, par delà le vrai et le faux, le juste et le pas juste : c’est ce qui donne sa chair à ce cinéma, quel que soit le squelette narratif. Ici, on imagine le scénario : M. Pons et les enfants font des crêpes. Le mouvement de caméra qui, suivant le regard de la petite fille soudain levé vers le hors champ, s’écarte d’elle pour aller trouver son grand-frère, appuyé contre la fenêtre, contem-plant le paysage de la cité au-dehors, ce mouvement ne se laisse pas imaginer. Il s’enfante devant nos yeux.
Pour occuper les enfants de Bébé pendant que leur mère rend visite à leur père en prison, M. Pons fait des crêpes. L’homme qui porte le deuil de sa propre mère apprend à des enfants à faire des crêpes. Cette séquence, à première vue une des plus simples et, au regard de l’intrigue, accessoires, est l’une des plus belles du film. Car elle fait entrevoir le secret de RAZ : l’extraordinaire souplesse d’un geste de mise en scène qui, confié à l’intuition, au sentiment (feeling), se laisse guider par l’énergie vitale qui circule entre les êtres. Ici, ce sont les enfants qui donnent le tempo et dirigent la scène de l’intérieur. La caméra, mobile, déduit ses stases et ses décadrages de leurs mots et gestes spontanés. Elle joue
Si le sentiment d’enfance est si vif, c’est aussi parce qu’il se fait sentir en contrepoint d’une atmosphère de deuil, que le récit installe au début du film et dont il ne se départ pas jusqu’à son terme. Au début une femme est morte pendant la nuit, son fils accueille les ambulanciers qui emportent le corps dans un sac en plastique, le sanglent sur un brancard et le descendent par l’ascenseur. Pas un mot, pas un regard de trop entre les hommes qui accomplissent leur travail avec tact et application et celui qui, sonné par la mort, fait ce qu’il peut pour le leur faciliter. Règnent la douleur et la pudeur qui retient tout devant elle. Pudeur et retenue de la mise en scène qui reste dans le couloir avec M. Pons, mais à distance, pendant que les ambulanciers font leur travail dans la chambre du fond. Pudeur et compassion : la mise en scène reste à ses côtés, le soutient. Bientôt le prêtre le prendra dans ses bras. Mais la cérémonie, si poignante, a commencé avant, dès la levée du corps dans l’appartement, avec ce lent zoom avant qui,
cadrant le fils au bord du couloir, a l’air de vouloir aller vers lui mais d’un mouvement retenu — mouvement du coeur, intérieur.
Un très beau raccord conduit le silence entre la sortie de champ de M. Pons, le corps de sa mère emporté, et l’entrée du cercueil de bois dans l’église ; ou plutôt entre l’espace vide laissé par le retrait du vivant et celui qui précède l’arrivée de la morte. Puis c’est la grande scène de déploration. Peu de fidèles ou de proches dans l’immense nef de l’église de la Trinité. Le silence donne tout l’espace au moindre bruit pour résonner: celui des chaînes de l’encensoir balancé par les mains du prêtre, celui du marteau contre le bénitier. Dans le silence, entre ces bruits, les vapeurs qui s’échappent de l’encensoir glissent le long du cercueil, en s’élevant elles font disparaître, l’un après l’autre, les visages des vivants. L’encensoir brille dans le faisceau de lumière comme brillaient les bijoux dans les mains des contrebandiers à la fin des Chants de Mandrin. Buste et visage gris, M. Pons est en larmes. En un geste de compassion bouleversant d’être sans manière, le prêtre prend dans ses mains la tête de l’endeuillé et l’appuie contre son chasuble. Du prêtre on ne verra rien d’autre que les mains et le chasuble, sans que cette découpe bressonienne de la figure ne réduise le personnage à sa fonction liturgique. Au contraire c’est son humanité, celle de ses mains, donc de son âme, que cette réduction exalte. Des mains du prêtre la caméra glisse vers un pied dont la pression sur la pédale d’un orgue émet une note qui rompt le silence : c’est le début de l’extraordinaire plan qui, passant du pied de l’organiste au visage de la chanteuse Annkrist, l’écoute et la regarde interpréter La Beauté du jour, la chanson qu’elle offre à la morte et aux vivants. On s’attend à un plan séquence, mais il s’interrompt avant la fin de la chanson pour passer du visage de la chanteuse à ceux des présents qui l’écoutent : figures de la douleur, associées au chant de déploration pour partager le deuil de M. Pons et le projeter au-delà de cette séquence, l’étendre à la totalité du monde créé par le récit.
Le Gang des Bois du Temple est un film endeuillé. Un voile de deuil recouvre le monde et fait écran. La vie s’y projette avec un éclat qui est celui de sa fragilité. La beauté que suivent les mouvements de la caméra est celle de la vie vue depuis le savoir douloureux de la mort.
De quoi le film porte-t-il le deuil ? De Mme Pons et, avec elle, de tout un âge du quartier qui est celui du cinéaste enfant. De l’enfance de son auteur, donc. Mais aussi de quelque chose de plus vaste, de moins définissable : manière de vivre ou forme de vie, qui serait à la fois à jamais perdue, car propre à l’enfance et mourant avec elle, mais aussi jamais perdue, car l’enfance n’a pas d’âge et attend toujours qu’on la retrouve au devant de soi. Jamais, à jamais : c’est l’étrange temporalité du film, qui est comme la surimpression permanente de deux temps : celui du deuil et celui du jeu, celui des adultes et celui des enfants, l’un s’imposant parfois à l’autre mais les deux toujours coexistant, rivalisant.
Le gang de la cité des Bois du Temple est une bande de gosses. L’émir qu’ils braquent sur une bretelle d’autoroute et dont la vengeance exige la mort de chacun d’eux : lui aussi est un gosse, d’une autre espèce, enfant pourri gâté du capitalisme, prisonnier d’un monde d’adultes sans joie. Ce monde, dans le film, se résume à trois personnages : le conseiller personnel de l’émir, qui parle un anglais à la perfection aseptisée, le détective privé payé pour retrouver le gang et organiser la vengeance, et le tueur qui l’exécute, interprété par le cinéaste en personne. Les enfants du Bois du Temple jouent aux gangsters avec un émir qui a perdu l’envie de jouer. Jouant ce jeu interdit, ils se condamnent à mort. Parce que ce savoir est son secret, et tout en s’émerveillant de les regarder jouer, le film porte leur deuil.
C’est là dès le premier plan, lent panoramique passant de la cité au centre-ville, reliant et opposant les allures de la ville. Dans le lointain,
du côté du centre, une grande roue, des manèges. Quiconque connaît Bordeaux la reconnaît tout de suite. C’est alors un autre jeu d’enfant : « on dirait que la cité de Grand Parc, à Bordeaux, serait les Bois du Temple ». RAZ a grandi cité des Bosquets, à Montfermeil, mais il y avait aux Bois du Temple, dans la ville voisine de Clichy-sous-Bois, une aire de jeu où lui et ses copains allaient souvent traîner. S’il a choisi la cité de Grand Parc pour évoquer celle de son enfance, c’est parce qu’elle est belle — condamnée à la destruction puis sauvée in extremis par son classement au patrimoine mondial de l’UNESCO — et parce que ses architectes y ont ménagé de grands espaces verts entre les bâtiments. Parfait pour jouer au cinéma. Et c’est la cité elle-même qui sera filmée, tout du long, à la fois comme un terrain de jeu et comme un cimetière. Une maquette, un décor pour des jeux d’enfant grandeur nature. Pour jouer entre les tombes.
Plus tard, en pleine nuit, quand les enfants du Bois du Temple, tout excités dans leur grosse cylindrée, sortent leurs kalachs pour braquer l’émir à l’entrée d’un tunnel, on lit « L’Estaque » sur un panneau de sortie d’autoroute. On est à Marseille, et si RAZ a voulu y tourner certaines séquences, c’est parce qu’il voulait filmer ses gangsters dans ces paysages, sur les voies rapides qui traversent la ville en s’enfonçant sous terre, montagnes à l’horizon.
Une cité bordelaise et des bouts de Marseille pour un souvenir de banlieue parisienne : fabriquer une ville imaginaire avec des morceaux d’autres villes. Ne surtout pas chercher à masquer l’artifice. Au contraire l’affirmer, à la fois s’en réjouir et s’en foutre complètement, avec le mélange d’insolence et d’innocence d’un enfant, avec sa puissance de fabulation.
*
Cette fabulation topologique est un renversement complet des habitudes du cinéma moderne. Il n’y pas d’abord le lieu, le milieu, puis l’histoire qui en émane ou qu’on y inscrit.
Ce n’est pas le documentaire (la ville) puis la fiction (ses habitants), comme l’énonce Godard dans Lettre à Freddy Buache . Au commencement il y a la chair des vivants, le sang des morts, la vie et la mort telles qu’elles sont façonnées non par l’environnement — idée courte qui justifie de raser et de reconstruire périodiquement les habitats populaires afin qu’aucune conscience collective ne prenne jamais forme —, mais par l’ordre social et la domination politique, planqués ou non derrière l’idée de progrès. La politique de RAZ, c’est l’affirmation de l’enfance et de sa puissance de fabulation comme la seule force qui reste, aujourd’hui, pour subvertir l’ordre et la domination. La fiction est première, elle déforme le monde pour y fabuler d’autres manières de l’habiter. On pourrait le dire autrement : il y a d’une part la tragédie, force d’airain qui gouverne le monde des adultes, d’autre part la comédie, souplesse subversive de la fabulation des enfants. Fabuler, c’est toujours prendre le parti de la comédie, des puissances du faux, du masque, de l’ombre, contre la tragédie et son plein jour pétrifiant.
RAZ est un grand fabulateur, amateur de légendes qui confondent les temps et les ordres de la nature. Il aime rappeler que les grands ensembles ont été construits sur d’anciennes forêts, de vieux marécages, et qu’ « il en reste des vestiges, avec beaucoup d’animaux sauvages : des oiseaux de proie, des belettes, etc. » Il dit aussi qu’il regarde peu de films, « sauf des documentaires animaliers, chez moi ». Prises ensemble, ces deux affirmations disent le secret de son cinéma. RAZ voit les êtres humains comme des animaux. Pas au sens de la science, de l’appartenance d’homo sapiens au règne animal, mais à celui, plus poétique, d’une vision fondamentalement métaphorique de la vie et de ses formes, quelque part entre les Fables de La Fontaine et le devenir-animal de Deleuze. L’animal cinématographique a fait du chemin depuis le ragondin égaré entre les palettes de Dernier Maquis. Les oiseaux de proie, belettes et autres survivances sauvages de temps anciens, ce sont les hommes
et les femmes d’aujourd’hui, peuple des cités, habitants des grands ensembles, tels que les fabule le cinéaste. Ou plutôt, ce sont les acteurs et actrices, de métier ou le devenant pour lui, qui reviennent de film en film et composent sa meute. On a l’impression que chacun a été choisi, lointaine ressemblance ou aptitude, pour sa capacité à être entraîné par le cinéma dans un devenir-animal singulier : loup, vautour, fouine, panthère, hyène, ours, etc. Les films de RAZ, et singulièrement ceux qui ont pour cadre les milieux de banlieue (Wesh Wesh qu’est-ce qui se passe, Dernier Maquis, Le Gang des Bois du temple), sont des fictions animalières, bien plus proches, dans leur style même, des documentaires animaliers de France 5 que de la fiction naturaliste à la française : prédilection pour les longues focales, pour le téléobjectif, observation lointaine précédant une approche lente et prudente, souplesse d’une mise en scène qui veille à ne pas effrayer la vie des comédiens, à la laisser évoluer à l’état sauvage. D’où le goût du cinéaste pour les improvisations collectives, qui donnent naissance aux séquences les plus caractéristiques de son cinéma — séquences qui fascinent et parfois inquiètent par leur manière d’avancer comme sur un fil menaçant à tout moment de se rompre. Cet art d’équilibriste s’épanouit dans la séquence du bar PMU, lorsque les braqueurs fêtent leur coup en jouant aux courses en compagnie de M. Pons. Celui-ci est d’abord seul au comptoir, vieux loup solitaire sirotant son pastis, puis le gang entre dans son dos, membre après membre. Le cadre se remplit, bientôt c’est une meute de jeunes loups qui s’amusent, s’excitent, cabriolent autour du patriarche. La séquence dure, le fil tient, les acrobates se soutiennent les uns les autres pour ne pas tomber, le public retient son souffle, toute la meute parvient de l’autre côté, applaudissements.
du chasseur. Les buts et les moyens sont opposés, mais pas les approches. Être à l’affût, piéger, pister : RAZ a toujours eu recours au vocabulaire de la chasse pour décrire sa méthode. Son écriture filmique (mise en scène, découpage, montage) déploie son génie propre dans une zone grise entre observation amoureuse de la beauté des êtres vivants dans leurs milieux, surveillance et chasse.
L’avant-dernière séquence est celle de l’assassinat de l’émir. M. Pons s’installe sur le toit d’un bâtiment, colle son oeil au viseur du fusil. Filmée de loin, au téléobjectif, la préparation du tir est accompagnée, imitée par un lent zoom avant sur le tireur couché. L’objectif de la caméra reflète l’oeil du tueur, que le viseur dissimule. Le mouvement intérieur à l’objectif traduit dans la matière même de l’image l’effort de concentration et de focalisation de M. Pons sur sa cible. Sniper aguerri, une balle lui suffit. Pas de contrechamp sur la victime. On reste sur le tueur, on perçoit dans son regard, soudain visible lorsqu’il décolle son oeil du viseur, un mélange de haine et de jouissance que l’on ne pensait pas trouver sur le visage du doux M. Pons. Ce regard est sa réponse, contrechamp retardé, à celui d’un autre tueur — celui qui, quelques jours plus tôt, avait beaucoup plus froidement assassiné ses « enfants ». Troublante reconnaissance d’une fraternité, par-delà bien et mal, entre l’ancien tueur d’élite de l’armée et le cinéaste masqué.
Mais l’éthos de l’éthologue et le regard du documentariste animalier voisinent avec ceux
Avant le coup de fusil de M. Pons, avant ceux du tueur interprété par RAZ, il y avait eu la traque du gang par le détective privé à la solde de l’émir, encore avant l’embuscade de ce dernier dans le tunnel. La trame du récit est faite d’une succession de scènes de chasse. De RAZ cinéaste, la fiction du Gang explicite le geste et l’instinct : ceux d’un chasseur — homme, loup, grand fauve — aux aguets du vivant, concentré sur son obsession : la saisie de la vie dans son jaillissement même. Or, le geste de l’image dont l’obsession est une telle saisie de la nature est toujours ambivalent : la capture, si aimante soit-elle, se double toujours d’une mise à mort. Godard le dit dans Histoire(s)
du cinéma en arrangeant une phrase de Thomas Bernhard : « … et ce terrible Dürer, précurseur du cinématographe, qui a mis la nature sur la toile et l’a tuée. » Il l’avait dit bien avant, dans Vivre sa vie, quand soudain sa propre voix résumait le Portrait ovale d’Edgar Poe : la vie du portrait se paie de la mort du modèle.
Parce qu’il est un cinéaste chasseur, RAZ sait cela plus qu’un autre. Ce savoir tragique détermine et fait la puissance affective de sa mise en scène, singulièrement dans ce dernier film : l’enfance qu’il magnifie parce qu’il sait la trouver en ses personnages, entre eux, dans leur relation à l’espace, l’enfance comme résistance, qu’il filme en un langage cinématographique qui est comme une nouvelle naissance de la fiction, ne se laisse pas saisir sans mourir devant la caméra. La vie ne se donne pas comme ça, sans perte. Il faut soutenir la mort qui advient par l’enregistrement de l’image et du son, au tournage, pour que de la vie ressuscite au montage.
L’enfance de l’art n’est pas son commencement, mais le secret retrouvé de sa naissance. C’est donc une renaissance. Elle est sans innocence, car elle vient d’un savoir de la mort qui précède toute résurrection. C’est bien RAZ, le cinéaste, qui, regard encore plus acéré d’être souligné par un masque, tue l’un après l’autre les grands enfants du Bois du temple. De quoi son film porte-t-il le deuil ? De tous ceux qui sont morts ou vont mourir en passant dans l’image, de tout ce qui doit mourir par le cinéma pour renaître dans un film.
Le coup de génie de RAZ est d’accorder ce savoir esthétique à une vision politique de la vie de et dans une cité comme les Bois du temple. Il y a une enfance de la cité et une enfance dans la cité, qui sont liées sans se confondre. La situation de cette double enfance est tragique, car elle est à la fois ce qui succombe et ce qui résiste à l’ordre du capital et de l’argent. Elle est à la fois la première victime — de l’esprit de calcul et de sérieux — et l’ultime possibilité de sauvetage. Elle n’a pas d’âge. On la croit morte et elle laisse traîner son possible entre les tours, entre les êtres, leurs gestes, leur regards, leurs
phrases, leurs silences. Rabah Ameur-Zaïmeche s’est porté à hauteur de ce tragique en réalisant un film dans lequel deuil infini et enfance perpétuelle sont la condition l’un de l’autre, un film dont le moindre plan vibre de leur tension. Pour cela, il faut une pratique du cinéma qui lui rende sa propre enfance. Il fallait qu’au gang de la fiction, devant la caméra, réponde celui de la fabrication, derrière. *
Pas de contrechamp, mais le crissement des pneus d’une voiture et un cri, au loin : la balle a atteint l’émir. M. Pons décolle son oeil du viseur, sort du champ, le zoom avant et son changement de focale ne permettent plus de discerner dans le fond de l’image le bâtiment qui, au début du plan, situait dans la cité le toit sur lequel il s’était installé pour faire justice. Fondu au noir, plan suivant, M. Pons sort d’un immeuble, l’étui de son fusil à la main. Dans la rue les sirènes hurlent, les gyrophares colorent les murs. À cinquante mètres la grande roue, sa rotation et ses lumières rouge et blanche. Au terme du panoramique qui ouvrait le film, elle apparaissait dans la profondeur, emblème d’un centre-ville à portée de regard mais au loin, très loin des Bois du temple. Là, dans cette séquence presque finale, on s’y perd : les distances, les espaces, rien ne va plus. La balle partie du fusil pour tuer l’émir a parcouru une distance improbable. D’un plan à l’autre, M. Pons a non seulement, depuis le toit d’une cité de banlieue, tué l’émir qui sortait d’une galerie d’art près de la grande roue, il s’est aussi téléporté de la banlieue au centreville. Que s’est-il passé ? Deux choses. Dans la fiction, un ancien sniper de l’armée, en deuil de sa mère, a vengé la mort des enfants qui n’avaient pas le droit de jouer aux gangsters. Sur le plan de sa fabrication, entre le panoramique d’ouverture et la fin du récit, d’autres enfants ont joué avec l’espace. L’ordre de l’espace, avec ses places désignées et ses distances imposées, a été destitué. Ça s’appelle le montage.
















L’Amour fou
ou le complot de l’actrice pour en finir avec son propre rôle, et le metteur en scène
Mathilde Girard
Je me souviens d ’une projection de L ’Amour fou , de Jacques Rivette. J ’aimerais en dire quelques mots, parce que j ’y repense dans ce moment o ù le cin éma, ses rôles et ses personnages, contribue aux révoltes que la vie peut opposer à la domination silencieuse de l ’ordre des choses.
Je raconte la sc è ne. Nous sommes à la Cinémathèque, le 14 septembre 2019. Dans la salle, pour la projection : Bulle Ogier, Jean-Pierre Kalfon, et Véronique Rivette, la dernière femme du réalisateur. Le Directeur de la Cinémath è que donne la parole à chacun.e. De quoi vous souvenez-vous ? Bulle Ogier se souvient qu ’ils avaient travaillé longtemps à la préparation, à l ’improvisation ; qu ’il a fallu refaire plusieurs fois la sc è ne o ù Sébastien lac è re ses vêtements.
Jean-Pierre Kalfon a tout oublié. Il dit qu ’il n ’a pas de mémoire et qu ’il ne devrait pas être acteur. Ils sont émus et amusés. Il y a trop de temps qui est passé sur le film et sur l’époque qu ’il évoque en chacun. Quelque chose est troublant dans cette reconstitution des personnages principaux : le film est là, ils l ’ont fabriqué avec Jacques Rivette, mais plus personne ne peut vraiment raconter ce qu ’il s ’est passé. Ça n ’est pas seulement une question de mémoire. C’est comme si le cœur de la chose, son mobile, son motif, était si déterminant que tous les détails, les anecdotes, devaient être oubliés. Ou alors, comme Véronique Rivette le rappelle, que la dimension collective de la mise en scène prévalait au point que la pensée de la fabrication déborde sur le sujet.
De quoi parle ce film dont on ne peut pas parler ?
Dans une époque, celle d ’aujourd ’hui, où les cartes sont complètement rebattues de ce qui constitue les rapports entre les hommes et les femmes, L ’Amour fou arrive depuis assez loin dans l ’histoire du cinéma pour nous dire qu ’un réalisateur au moins — même s ’il y en a eu d ’autres — a fait un jour
sur lui-même le travail que le cinéma devait faire : mettre en pièce la mise en scène et son directeur, et symétriquement délivrer l’objet privilégié de celui-ci, l ’actrice, qui s ’enfuit au début et à la fin du film (dans un même plan, qui l ’enserre) en prenant le train. Héritier de Renoir, Rivette laisse ses acteurs s ’emparer du matériau — et se mettre en scène par eux-mêmes. Le cinéma qui réfléchit sur lui-même n ’aura pas besoin d’être politique. Dans ces années-là — et j ’en parle justement parce que ça revient, parce que les hommes, les plus jeunes, se déguisent à nouveau, se mettent du vernis à ongles, refusent d’être seulement des hommes, s’atténuent et s’altèrent pour refuser d’incarner quelque autorité —, dans ces années-là les hommes et les femmes se remettaient en question dans leur identité, dans leur sexualité. On sait que la fraternité des hommes dans le combat des femmes n’était pas toujours sincère, et que les femmes entre elles ne devaient pas être si tendres. Enfin, les un .es et les autres essayaient. On ne voulait pas être soi, on ne voulait pas imposer, on ne voulait pas le pouvoir. Un film, un tournage a fortiori est par excellence l’espace d ’incarnation des formes de pouvoir et de domination les plus archaïques, où s’exercent cruellement les lois de la tragédie. Si le cinéma avait déjà commencé à travailler sur lui-même, Jacques Rivette a toujours eu une place à part dans la Nouvelle Vague, et dans ce qu ’on appelle le ciné ma d ’auteur. C ’est dans le film qu ’il fallait entrer en contrebande, dans le film qu ’il fallait conspirer contre sa loi, par une autre loi, d ’une autre sorte, la loi horizontale d ’une bande qui n ’aurait pas de chef, une Histoire des Treize qui garde le secret du secret de la fabrication, qui n ’a d ’autre mobile que de produire des fictions. Si Paris nous appartient avait déjà posé la trame de cette contre-histoire, de cette contre-filiation, L ’Amour fou prend la chose par un autre biais. Ce n ’est pas seulement le metteur en scène qu ’il faut libérer de son rô le, c ’est sa complice : l ’actrice, l’amoureuse, la femme terrassée par l’amour.
En construisant dans le film le documentaire (réalisé par A. S. Labarthe) du metteur en scène qui est l ’acteur principal, Rivette se représente, double sa figure (celle de tout metteur en scène) dans cet homme gâté par le théâtre, et que les femmes convoitent. Les femmes, avant d’être celles qu ’elles allaient devenir, bien vite, dans les films qui suivront, sont encore tenues ici dans le harem du plateau, entre le plateau et le domicile conjugal. Le documentaire essaie de pousser l ’enquête : Labarthe parfois indiscret cherche ce qui ne va pas, les raisons du départ de Claire (la femme de Sé bastien) — c ’est le making off et les entretiens avec l’équipe qui écrivent la véritable histoire, qui tiennent le scénario d’un film qui se lorgne dans deux miroirs : celui du plateau de théâtre, et celui de l ’actrice qui attend à la maison.
Il ne se passe rien. Après le départ de Claire, les répétitions continuent comme si de rien n’était, avec une autre actrice qui est l ’ancienne amoureuse de Sébastien. Claire reste à la maison, s’ennuie, et son imagination s ’affole. Elle vient assister aux répétitions, puis ne vient plus. Elle prend son rôle en charge d ’une autre façon, elle le détourne dans la fiction d ’un enregistrement quotidien. Il n ’y a donc pas seulement deux films en cours, mais au moins un troisième, que découvre Sébastien quand Claire est partie et qu ’il écoute toute l ’histoire enregistrée sur la bande. Avant d’être l ’intrigante, la farfelue, la rêveuse, la révoltée, la secrète, la femme qui échappe et qui n ’aura plus rien à faire avec les hommes, la femme rivettienne est amoureuse. Elle est comme toutes les femmes : la femme amoureuse qui souffre et qui attend et qui imagine. Claire est la première et la derni ère femme qui souffre dans le cinéma de Rivette. Le cinéma de la durée, alors, porte bien son nom, et se charge ici d ’une intensité qu ’on ne reverra plus, en effet, dans ses autres films. Intensité de la douleur, de l ’attente, qui vire peu à peu à la paranoïa, à la fabulation — par où ressuscite,
et s’échappe peu à peu la jeune femme. Pour devenir un metteur en sc ène féministe, le premier à l ’avoir été à ce point, Jacques Rivette aura donc parmi ses premiers films entrepris le portrait d ’un couple canonique du cinéma, le metteur en scène et l ’actrice, pour conjurer d ’emblée le péril et le pathos d ’une telle alliance, la maladie congénitale du film dans son rapport au pouvoir, à l ’amour et à la domination. Si Sébastien est un metteur en scène éclairé, moderne, qui utilise le tournage, les rushes des répétitions pour ne pas manipuler ses acteurs, pour ne pas être un metteur en scène dominant, il est rattrapé par la tyrannie dans l’espace du couple, o ù il passe de l’époux attentif à l ’amant délirant, à l ’homme buté qui tient son spectacle contre tous les événements de la vie. Si tous les films à venir sont déjà là, on est surpris de voir naître la malice, l ’ingé niosit é féminine, les mystè res et les tours de passe-passe d ’un simple délire de jalousie. Le complot, alors, et ce qui deviendra la situation très compliquée et aporétique d’Out One, ça n’est ici rien d’autre que la juste conséquence d’un sentiment d’abandon — ce qui se trame dans un film, comme dans la tête d ’une femme (Claire) qu’à priori tout oppose à l ’aliénation domestique.
L’amour est obscène, et il n’y aura plus jamais, apr è s L ’Amour fou , de femme amoureuse dans le cinéma de Jacques Rivette (ou alors — Touchez pas la hache — elle aimera toute seule). Comme s ’il savait qu ’il ne fallait plus filmer (qu ’il ne faudrait plus jamais représenter) cette femme-là, l ’Amoureuse, que le cinéma avait consacrée et peut-être massacrée — qu ’il fallait (qu ’il allait falloir) raconter l ’histoire contraire, celle de sa libération. Raconter comment une fille se débrouille pour ne pas tomber dans l’amour, pour ne pas se laisser mettre en scène par un homme. Partir de tout ce que l ’ amour produit entre les femmes qui sont mises en sc è ne par les hommes, et pourquoi elles choisissent finalement de se mettre en scène
elles-mêmes. La leçon, si on veut, est donnée à la fin à chacun des deux sexes : Sébastien et Claire s’aiment d’amour fou, à se tuer — et c’est donc l’amour, ressort et péril du cinéma, qu ’il faut traverser, pour le mettre en pièce.
Casser l’amour qui casse tout, et que chacun.e reparte de son côté, sinon guéri.e, au moins averti.e. Après, on ne gardera de l’ amour que les fictions qu ’il a produites, les mani ères, mais on n’y mettra plus ce cœur, ni ce pouvoir. Il n’y aura plus d’amoureuses ni d’amoureux, il y aura des personnes qui jouent et complotent contre l’amour fou, et ainsi pourront commencer à s ’aimer.
Ce texte a été publié dans une première version dans Lundimatin#417

Cyril Neyrat
Le cinéaste chilien Ignacio Agüero a réalisé à trente ans d’écart deux films portant le même titre : Como me da la gana (1985) et Como me da la gana II (2016). Seulement dix-huit ans séparent les deux Elle et lui de Leo McCarey : Love Affair (1939) et An Affair to Remember (1957). Le changement de titre original entre le film et son remake dit l’enjeu de la reprise : une affaire de souvenir, de retour. Refaire le film, c’est faire retour, se retourner pour prendre la mesure du temps passé, faire l’épreuve de ce qui a changé et de ce qui est resté le même, dix-huit ans plus tard.
La science, moi, je n’y connais rien. Je me contente d’explorer les environs. Le petit enfant qui sait tout juste tenir sa tête, a une façon franche et directe de regarder autour de lui, étonné de tout.
Il n’a pas la moindre idée du lieu où il se trouve, et tout ce qu’il veut, c’est apprendre à le connaître.
Une sorte de curieuse vanité apprise nous détourne de notre projet initial qui est d’explorer les environs, d’examiner le paysage, pour découvrir au moins en quel lieu nous avons été, de manière si surprenante, déposés, s’il ne nous est pas permis d’en connaître le pourquoi.
Annie Dillard, Pèlerinage à Tinker Creek
Et ce fait d’être engendré par sa propre manière est le seul bonheur possible pour les hommes.
Giorgio Agamben, La communauté qui vient
Le diptyque d’Agüero serait au cinéma moderne ce que celui de McCarey est au cinéma classique. Le même mouvement de retour les anime, le même regard en arrière. Mais le sujet du retour a changé. À l’âge classique, le cinéma se regarde et constate qu’il a changé, vieilli : il a pris des couleurs, il a ralenti. Le cinéaste, lui, se contente de refaire. Agüero, artiste moderne, dit ce qu’il fait. Il s’examine en train de refaire et fait de l’examen la matière d’un autoportrait dans le temps. Celui d’un cinéaste qui pratique son art sans modèle, comme ça lui chante. *
1982. Ses études achevées, contrairement à nombre de ses collègues exilés, Ignacio Agüero choisit de rester au Chili pour devenir cinéaste. Son premier film, No olvidar, se confronte sans détour aux horreurs de la dictature.
Le cinéma y est au service de la mémoire et de la justice : celle due aux paysans d’Isla de Maipo, près de Santiago, arrêtés par la police aux ordres de leur patron quelques jours après le coup d’État et dont les corps ont été retrouvés six ans plus tard, non loin de leur village, enterrés dans le four de la mine de chaux de Lonquén. Alors que l’État s’emploie à effacer les traces du massacre, le cinéaste, au côté des veuves et des orphelins, œuvre à les conserver. Ne pas oublier : vieille mission mémorielle du cinéma documentaire, accom-
plie ici avec une rigueur, une dignité et une sobriété peu ordinaires. Voix off, archives en banc-titre, rituels du souvenir et entretien avec le juge dont l’État entrave l’action : la grammaire est celle du genre auquel le film se soumet avec humilité. Le sujet est énoncé, il est traité en une articulation de phrases et de plans qui ne prétendent ni dire ni montrer autre chose que ce que ce qu’ils contiennent. Par prudence et hommage, Agüero signe No olvidar du nom d’un ami, Pedro Menedes, autre paysan assassiné par le régime. C’est un film à l’importance paradoxale pour l’œuvre à venir : à la fois sa fondation, le point de départ biographique et politique auquel il ne cessera de revenir, et le mode d’écriture dont il s’est, dès le film suivant, résolument écarté pour trouver sa propre voie. 1984. Après ce premier film réalisé et diffusé dans une semi-clandestinité, Ignacio Agüero sait ce qu’il ne veut pas : devenir un cinéaste militant. Mais que faire ? Au lieu de chercher une réponse, il fait de cette question un film en allant voir ce que font les autres cinéastes qui, comme lui, essaient d’exercer leur art dans le Chili de Pinochet. Tourné entre mai 1984 et décembre 1985, Como me da la gana se compose de sept séquences qui déclinent le même procédé : accompagné d’un cameraman et d’un preneur de son, Agüero s’invite sur un tournage et l’interrompt pour interroger le réalisateur ou la réalisatrice. Le film s’ouvre, s’achève et est scandé par de brèves vignettes qui brossent en contrepoint des tournages l’ordinaire du cinéma dans les salles du Chili de Pinochet : biopic sur Jackie Kennedy, Dynastie, soaps et soupe hollywoodiens ou leurs avatars sud-américains.
Les questions d’Agüero sont un peu toujours les mêmes : simples, directes, à la fois naïves et provocantes : « Pourquoi fais-tu ce film ? », « Qui va le voir ? », « Qui paie ? ». Aimables et volubiles, les cinéastes jouent le jeu, racontent, expliquent, se justifient. Une fois l’entretien entamé Agüero n’interrompt pas, ne contredit pas, n’argumente pas : il se contente de relancer, question après question, sans jamais se
départir de sa bonhomie souriante et impassible. Désarmante et cruelle bonhomie. À un cinéaste qui lui répond que, dans l’état de la distribution au Chili, personne n’ira voir son film, et qu’il est obligé de le financer lui-même en l’absence d’une loi encadrant la production cinématographique, il finit par demander : « Tu penses que tout ça a du sens ? ».
La manière dont Agüero interroge ses collègues sur la nécessité qui les anime produit un exercice de maïeutique à la fois direct et pervers, naïf et ironique. Quel que soit le genre ou le registre du film dont il interrompt le tournage — fiction naturaliste, reconstitution historique, documentaire, etc. —, l’impression produite par le discours du ou de la cinéaste est toujours à peu près la même, toujours ambivalente. On voit le travail, on comprend le sujet, le projet, on peut admirer l’effort, l’ambition de faire ce cinéma dans ce contexte, mais rien n’y fait, quelque chose sonne faux. On n’a aucune idée de ce que sera le film, s’il sera bon ou mauvais, réussi ou raté, on ne peut pas savoir, mais on est pris d’un doute quant à la nécessité. Trompeuse bonhomie : le sourire de chat d’Agüero est une grimace philosophique. Mutique, laissant l’autre parler et le cinéma agir, ce sourire est le signe et l’expression d’un profond scepticisme.
« Tu penses que tout ça a du sens ? » La question n’est posée qu’une fois, mais elle vaut pour tous les tournages — ou presque, on y reviendra. Ce que manifeste avant tout Agüero, en visitant ces tournages, c’est sa solidarité avec ces cinéastes qui font du cinéma malgré tout, malgré le désert répressif du Chili des années 80. Après tout, c’est aussi ce qu’il fait : il a financé Como me da la gana avec l’argent gagné en réalisant des pubs, et presque personne ne l’a vu à l’époque. Mais la question porte aussi à une autre profondeur. Ce qui est mis en doute, ce n’est pas tant la validité de tel ou tel discours, la nécessité de tel ou tel film ou projet, que l’idée même de discours ou de projet. L’idée même qu’un film ait sa nécessité dans un projet, un sujet, un contenu. À cette idée du
cinéma, de l’art en général, aussi bien de la vie, Agüero oppose le film qu’il est en train de faire et dont le titre formule la seule nécessité : Como me da la gana. Comme bon me semble, comme il me plaira. Comme ça me chante.
Como me da la gana : le film vole son titre à une chanson qu’on entend d’abord au générique de début, puis dans la deuxième séquence, lorsque Agüero vient interrompre le tournage du film Santiago Blues, de son ami Francisco Vargas. C’est une des deux séquences dont on sent qu’elle échappe à l’ironie d’Agüero. Un homme assez âgé est assis près d’un piano, entre une caméra et un preneur de son, une trompette appuyée sur son genou. Pendant la mise en place du plan, Francisco Vargas dit à l’homme à la trompette : « Luchito, essaie de sentir quand la lumière vient toucher ta trompette, essaie de trouver cette lumière. » Puis ça tourne, les musiciens jouent, Lucho Aranguiz chante quelques couplets de la chanson. « Je fais comme ça me chante, je suis comme ça. Qu’est-ce que ça peut te faire si je me saoule, si je bois du rhume, si je viens de Taco Taco, de Palmilla ou de Bolodron… »
Suit une conversation pour le moins détendue entre Agüero, Vargas et Aranguiz, au cours de laquelle l’auteur de Santiago Blues ne prend pas la peine de répondre aux questions de son collègue interrupteur. À la question
« Pourquoi fais-tu ce film ? », il répond « C’est notre film, à Lucho et moi. Viens, Lucho, que je te présente à mon ami Ignacio. » Il commence à raconter l’histoire de leur amitié, comme si c’était la seule réponse au « pourquoi ». « Et qui le verra, ce film ? », interrompt Agüero. « C’est notre film, répond Vargas. Qui le verra ? Qui sait… ». « Personne » ajoute Lucho dans un éclat de rire. Fin de la séquence. Est-ce là, en écoutant ce vieil homme chanter cette chanson et le cinéaste lui dire « essaie de sentir la lumière sur ta trompette » qu’Aguëro a trouvé, non seulement son titre, mais son film, sa manière ?
La joie, le plaisir, l’humour qui émanent de cette séquence font exception dans la suite des tournages interrompus. Le propos des cinéastes interrogés, est toujours caractérisé, à des degrés divers, par un certain esprit de sérieux. Expliquer, se justifier, théoriser : c’est toujours trop long. Ici trois phrases, un éclat de rire. Cette humeur sera celle du film d’Agüero, et d’une part importante de son cinéma à venir. C’est l’humeur souveraine de celui qui, en faisant, affirme : « Je fais ce qu’il me plaît, comme ça me chante ». Como me da la gana : après le devoir de mémoire (No olvidar), le droit au caprice. Dans le désert du cinéma chilien sous dictature, Ignacio Agüero affirme avec son deuxième film le caprice et sa souveraineté comme seule nécessité.
Musique ou cinéma, c’est un plaisir de jouer : avec ce qui se présente, comme ça se présente. Pour libérer ce plaisir, il faut mettre en jeu le cinéma contre la nécessité extérieure du sujet. Il faut libérer le film de tout sujet préalable à la mise en jeu du cinéma, de toute nécessité autre que la manière dont il est mis en jeu. Ce qui reste quand on liquide le sujet, c’est la manière. Autrement dit : le seul sujet, c’est la manière. Et la manière c’est, d’abord, l’interruption.
S’invitant sur les tournages de ses collègues, Agüero ne se contente pas de converser avec eux. De séquence en séquence, Como me da la gana décline les manières de se greffer sur les films des autres pour s’y réaliser. La décontraction d’Agüero est aussi l’aisance du parasite : en détournant la matière première d’un film pour en faire celle de ses propres plans, il fait son miel du travail des autres. Cette opération est le plus manifeste sur le tournage de Nemesio, premier long-métrage de fiction de Christian Lorca, ami et proche collaborateur d’Agüero. Après avoir fait l’image de No olvidar, Lorca est le principal chef opérateur de Como me da la gana
Pour cette séquence, puisque le tournage inter-rompu est le sien, il est passé devant la caméra. Il répond rapidement à deux ou trois questions d’Agüero mais avant tout il met en scène : il dirige les acteurs, règle les lumières, répète les mouvements de caméra. Et pendant qu’il modèle ainsi la matière, Agüero la filme à sa manière. Ça commence comme un making off : on voit l’équipe au travail, le cinéaste, en silhouette au premier plan, donner le signal de départ de l’action. Puis, à la faveur d’un zoom avant, le cadre se resserre sur l’action, sur les acteurs, et rejette hors-champ la réalité du tournage. Le plan est passé du documentaire à la fiction. Filmant par-dessus l’épaule de son ami cinéaste, Agüero le double, fait un plan dans son dos. On trouve une variante de cette manière de filmer dans le dos des autres à la fin de la séquence. Aguëro profite d’un temps de mise en place pour discuter avec le producteur de Nemesio. Celui-ci, de face au centre du plan, est éclairé par une lumière dont on comprend, lorsqu’elle augmente sur son visage jusqu’à l’éblouir, qu’elle est celle du prochain plan de Nemesio . Aguëro est installé face à lui, bord cadre, de trois quarts dos, le visage dans le noir, si bien qu’il est impossible de voir ses réactions aux propos de son volubile interlocuteur. Soudain quelque chose passe rapidement dans le dos du producteur : un acteur traverse le champ en courant, suivi par la caméra sur une dolly poussée par deux machinistes, eux-mêmes suivis par le cinéaste. On comprend à l’attitude du producteur qu’Agüero prêtait plus d’attention à la préparation du travelling qu’à son discours ; qu’il guettait derrière lui l’entrée de champ qui allait soudain donner consistance à son propre plan : celle du tournage en pleine action. Le plan suivant est à la fois la suite et une variante : tandis que le producteur continue de disserter sur les difficultés de la production chilienne, dans son dos le cinéaste tourne la deuxième prise de son travelling. Derrière son air de ne pas y toucher, Agüero avait bien calculé
son coup de maître : un geste de mise en scène d’autant plus élégant qu’il se donne l’air de ne pas avoir été prémédité. C’est d’une pierre deux coups : dans le même plan, le tournage et son commentaire, la réalité et sa réflexion, l’action et la pensée de l’action.
L’impertinence de cette manière, autrement dit la pertinence formelle de l’interruption, culmine dans la séquence suivante, située à l’opposé du spectre du cinéma et d’une humeur contraire : pas de décontraction amicale, ici, mais l’urgence politique de combats de rue d’une grande violence, entre des jeunes gens qui lancent des pierres et la police qui tire à balles réelles. On aperçoit des caméras dans la foule. Celle qui filme pour Agüero court avec les insurgés pour fuir la charge policière. Un groupe de jeunes se replie, emportant avec eux l’un des leurs, blessé. Un hélicoptère passe juste au-dessus. Agüero, son preneur de son à ses côtés, entame la conversation avec André Racz, réalisateur de ce qui deviendra le film Douce Patrie (1985).
« Qu’est-ce que tu fais ? Un reportage journalistique ?
— Un documentaire sur la situation du Chili. »
Après quelques questions usuelles et pratiques sur la production, l’équipe, Agüero change de registre :
« Et tu crois que c’est ça qu’il faut faire au Chili aujourd’hui ?
— Je crois que c’est une des choses qu’il faut faire aujourd’hui, que c’est important, tu le vois bien. Car personne ne filme ce qui se passe. Ça fait trop longtemps. Et finalement aujourd’hui on y arrive.
— Tu sais plus ou moins quel va être ton public ?
— Le plus large possible, j’espère… Les flics arrivent, attention…»
Sur ses gardes, le cinéaste fait signe au cameraman d’Agüero, qui ne coupe pas, ne
baisse pas sa caméra quand les policiers passent de part et d’autre du petit groupe, matraques à la main.
« On est ici au centre du problème, comme tu vois », reprend Racz. Calme et souriant au coeur de la mêlée, Agüero voit tout mais rien ne le détourne de sa routine :
« Et comment tu le finances ?
— Cette production… » Racz s’interrompt à l’arrivée de sa preneuse de son :
« Je suis inquiet pour Juan Kiko, notre cameraman, pour le moment on ne le trouve pas. »
Puis il reprend sa réponse :
« Avec de l’argent du Chili et de l’étranger, les deux. C’est une production modeste. » La question qu’improvise alors Agüero conduit l’entretien à son terme d’un trait de génie :
« Est-ce qu’on vous a trop interrompus ?
— Non… Mais maintenant on va continuer. Merci », dit Racz en s’écartant.
Ce qui sidère, dans cette séquence, c’est le contraste entre la violence de la situation et l’inébranlable détachement d’Agüero. « On ne vous a pas trop interrompus ? » : comme si tout n’était qu’un jeu. Comme si tout ça n’était que du cinéma. Comme si, précisément Car bien sûr tout le monde sait que ce n’est pas un jeu, qu’il s’agit d’autre chose que du seul cinéma. Agüero le premier. Au montage, il prendra soin de ne pas clore la séquence avec la fin de l’entretien, mais de la poursuivre au-delà, comme pour confirmer que celui-ci n’aura été qu’une interruption. Le montage de cette fin de séquence alterne entre deux registres : des plans de la violence policière et de ses effets (passage à tabac de manifestants, évacuation d’un blessé sur un brancard), et des plans montrant la petite équipe de Racz mêlée à la foule des manifestants, filmant ces violences. La séquence se boucle ainsi sur une double opération. D’une part elle documente le tournage que celui de
Como me da la gana est venu interrompre : tournage d’un film documentaire engagé, cinéaste, cameraman et preneur de son à portée de matraque. D’autre part, elle documente elle-même la situation, directement, exactement comme le fait l’équipe de Racz, qui devient lorsqu’elle apparaît dans le plan, par un effet de mise en abîme, une sorte de double ou de reflet de celle qui le réalise. Redoublant le travail de Racz, Agüero lui donne raison : oui, c’est ce qu’il faut faire aujourd’hui au Chili. Oui, il faut enregistrer les preuves de la violence d’ État, faire des images et du son au côté du peuple en révolte. Et deux équipes valent mieux qu’une pour faire ce travail. Mais il est possible de faire deux choses à la fois : l’enregistrement et sa réflexion, documenter et penser. Ce qu’il faut faire, aujourd’hui, en somme, c’est un film qui joue son rôle politique de témoin documentaire tout en refusant de jouer le jeu de l’idéologie de la transparence, qui si souvent conditionne une telle entreprise. Il faut enregistrer le « quoi » du présent d’une manière qui mette en jeu le « comment » du cinéma, faire de cette mise la raison profonde du film, et manifester ce « comment » comme son contenu même, la manière en lieu et place de tout vouloir-dire. Faire un cinéma à la fois engagé et dégagé, concerné et détaché. Pratiquer le cinéma comme un jeu sérieux, comme font les enfants.
En 1985, l’année où Agüero achève Como me da la gana , la cinéaste et chercheuse Alicia Vega organise son premier « atelier de cinéma » pour enfants de communautés pauvres du Chili. L’expérience durera trente ans, au cours desquels Vega donnera des dizaines d’ateliers, selon une « méthode particulière qui consiste à mettre le pouvoir des enfants en contact avec le pouvoir du cinéma, tant sur le plan technique qu’af-
fectif1 ». En 1987, Ignacio Agüero réalise Cent enfants qui attendent le train, documentaire qui accompagne le troisième atelier donné par Vega — dans la paroisse de San Roque de la commune de Lo Hermida, banlieue pauvre et reléguée de Santiago.
On est dans une chapelle, transformée pour chaque séance de l’atelier en salle de classe. Alicia Vega est à la place du prêtre devant un tableau noir, les enfants assis autour de grandes tables. L’atelier et le film commencent par une question : « qui d’entre vous est déjà allé au cinéma » ? Personne. Peu importe, dit Alicia, puisqu’à partir de maintenant, chaque samedi, vous verrez un film ici dans cette chapelle.
Les enfants viennent d’entrer. « Asseyezvous ! » Alicia écrit au tableau et dit d’une voix forte qui couvre l’agitation : « Aujourd’hui, nous allons apprendre le jeu du thaumatrope. “Thauma”, en grec, signifie “merveille”, et “trope” veut dire quelque chose qui tourne. » Après quelques plans sur les visages des enfants écoutant les explications d’Alicia, on les retrouve ciseaux en main, appliqués à découper du papier. Thaumatrope, zootrope : l’atelier d’Alicia commence par la fabrication de jouets par les enfants. Puis vient Edison et l’invention de la pellicule : chacun découpe son propre ruban de papier et assiste à son animation dans le kinétoscope. Le samedi, ce sont les films des frères Lumière, les premiers Chaplin, les premiers dessins animés. Telle est la pédagogie d’Alicia Vega : initier les enfants au cinéma en rejouant avec eux sa préhistoire, sa naissance et ses premiers pas. Agüero suit l’atelier en filmant les visages et les mains des enfants qui écoutent et regardent, fabriquent et jouent. Ce que le montage raconte, c’est d’abord la joie, l’émerveillement d’enfants qui jouent et assistent à la naissance
et à la petite enfance du cinéma. Ce que produit le film chez le spectateur, parce que le cinéaste l’a éprouvé, c’est le partage immédiat de cette joie et de cet émerveillement.
La chronique des étapes successives de l’atelier est ponctuée de fragments d’une conversation entre Agüero et Alicia Vega, mais surtout de brefs entretiens que mène le cinéaste avec les enfants et leurs parents. Sa manière de questionner est la même que dans Como me da la gana, mais elle produit une émotion autre, car les personnes interrogées ne sont pas des cinéastes habitués à discourir mais les habitants relégués d’une banlieue misérable, qui n’ont jamais vu de caméra de leur vie. Vie à laquelle personne d’autre que la police politique ne s’est sans doute jamais intéressé. Les questions simples et directes, posées par Agüero toujours hors champ, d’une voix basse et chaleureuse, suscitent des réponses également simples et directes, à la fois concises et généreuses, où les existences se disent en très peu de mots, à la fois dans et entre les mots. Les visages sont éclairés de l’intérieur, les yeux brillent d’une joie enfantine lorsque parents et enfants parlent au cinéaste.
On est dans l’atelier. Des enfants affairés à fabriquer chacun son zootrope, on passe à la vue extérieure d’une petite maison en bois. On entend off la voix d’un homme, il apparaît après quelques mots, une petite fille sur ses genoux, une autre assise à sa droite :
« D’abord il a rapporté un cheval, qui tourne dans une roue en courant. Ensuite un chameau. Et aujourd’hui il est rentré avec ça, une espèce de toréador. — Veronica, demande Agüero hors-champ, est-ce que César vous raconte ce qu’il fait dans l’atelier ? »
1 Catalina Donoso Pinto et Valeria de los Ríos Escobar, “Mirar como niños y niñas: Cine, juego y contra-pedagogía en los talleres de Alicia Vega”, [Voir comme des enfants : cinéma, jeu et contrepédagogie dans les ateliers d’Alicia Vega ], Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas 19(2), p. 146-159, 2024. https://doi 10.11144/javeriana.mavae19-2.mjav
La caméra panote sur la gauche pour cadrer le visage de Veronica et d’un garçon, un peu plus âgé, assis à sa droite.
« Un petit peu.
— Mais vous avez vu ce qu’il a fait ?
— Oui.
— Vous savez comment s’appellent ces jouets ? »
Le père, hors champ, intervient :
« Oui, quelque chose comme anthropo… Je ne sais plus les noms des autres mais ils ont leurs noms. »
L’opérateur a hésité à recadrer vers le père mais il est resté sur Veronica, qui sourit en écoutant son mari. Agüero reprend la parole :
« César, tu te souviens des noms ? »
La caméra panote très légèrement et zoome pour centrer le visage de César, les visages de sa mère et de sa petite sœur bord cadre de chaque côté.
« Thaumatrope, zootrope… » répond César, avec le sourire de l’élève à la fois timide et fier d’avoir retenu. « Je ne me souviens plus de l’autre. »
« Quel âge as-tu César ? demande Agüero. — Huit ans.
— Et qu’est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?
— Grand ? Militaire. »
Son sourire s’élargit. On entend la voix de Veronica, hors-champ : « Oh non… » Tout le monde se met à rire de la réponse de César, d’un rire un peu gêné.
Agüero coupe sur ces rires le plan qui, s’attardant sur les visages et les sourires, a suivi sans interruption les rebonds de la conversation. Ce qui a guidé sa conduite, c’est la joie, l’émerveillement qui, passant par les enfants, est devenu celui des parents. L’enfance des parents apprenant ce que c’est que le cinéma, comment ça marche, via leurs enfants. Mais ce que marque la coupe, c’est la remontée involontaire, dans la bouche de l’enfant César, du contexte politique, de la dictature militaire de Pinochet. La manière de questionner d’Agüero tient sa puissance de son innocence, réelle ou feinte : parce qu’elle a l’air de ne rien
aller chercher, elle recueille et révèle beaucoup.
Dans Como me da la gana, la séquence des combats de rue entre les manifestants et la police est suivie par son contraire : le tournage d’une reconstitution historique au bord d’un lac. Agüero accentue le contraste au montage par un effet de fausse continuité visuelle et sonore entre les canons à eau, qui dispersent les manifestants et l’équipe de tournage, et les vaguelettes déferlant sur la rive du lac où accostent les acteurs costumés. Après l’entretien usuel à propos du film en cours de réalisation, la séquence s’achève par une confession incongrue du réalisateur : « J’ai fait plusieurs documentaires, et pour moi c’était toujours un problème, parce que les gens ne disent jamais ce que je veux qu’ils disent. Jamais. Ils disent toujours plus que ce que je voudrais qu’ils disent. Toujours. »
Ce « problème » du vouloir-dire, de l’adéquation entre l’attente du documentariste et ce que veut bien donner le « réel », Agüero l’a réglé à sa manière : en n’attendant rien et en s’attendant à tout. En ne voulant rien dire au tournage, pour que tout puisse se dire, se penser plus tard, au montage. Dans Como me da la gana, ce primat du montage opère déjà : c’est par l’intelligence des coupes, l’agencement des images et des sons et l’articulation des séquences entre elles qu’Agüero produit non pas un discours dont la teneur ne serait que l’addition de celle des plans, mais une pensée dont l’origine est l’intervalle, la césure, la relation entre séquences, plans, images et sons. *
Exemple. Alicia écrit au tableau le sujet du jour : « Aujourd’hui, nous allons apprendre les genres cinématographiques. » Agüero demande à Alejandra, qui n’était jamais allée au cinéma, quel film elle a préféré parmi ceux
qui ont été projetés pendant l’atelier : « Celui avec le ballon, avec le garçon qui voulait le ballon. » Soit : sur la voix d’Alicia expliquant aux enfants en quoi consiste la fiction — les personnages ne sont pas habillés pareil dans le film et à la maison —, Agüero monte un extrait du Ballon rouge — le garçon dévalant une rue de Paris, son ballon à la main —, entrecoupé de deux plans issus de l’atelier : un gros plan sur le visage d’un enfant pendant une projection et un dessin inspiré à un autre enfant par le film de Lamorisse. L’extrait s’achève sur le garçon essayant en vain d’ouvrir la porte d’un immeuble. Cut sur la séquence de la manifestation de Como me da la gana, ou plutôt sur la projection de cette séquence pendant l’atelier, en alternance avec les visages des enfants. Leurs cris d’excitation se mêlent à ceux des manifestants. Cut sur un gamin arrivant en courant à l’atelier sous une pluie battante, grand sourire à la caméra en passant devant. Puis c’est un père qui, abrité sous un parapluie, dépose à l’entrée de la chapelle le garçon qu’il porte dans ses bras.
La voix d’Alicia, off, commente : « Les gens qui couraient, dans le documentaire qu’on vient de voir, étaient vraiment en train de manifester. Ils voulaient la démocratie. Et les policiers qui les frappaient étaient réels aussi, bien sûr. » Sa voix se mêle à la pluie, et lorsque gronde un coup de tonnerre, la conclusion de son propos est donnée par un insert sur une phrase écrite et signée par un enfant : « Le documentaire c’est ce qui est vraiment. »
La séquence qui suit documente une autre phase de l’atelier, dont on ne sait si elle a lieu avant ou après. Alicia en explique le principe : il s’agit de permettre aux enfants de percevoir physiquement qu’un film est fait de photogrammes. Comment ? En leur faisant réaliser chacun un photogramme géant avec du papier et des feutres, à partir d’un thème choisi ensemble le matin. Les enfants proposent plusieurs thèmes, Alicia les écrit au tableau : l’hiver, les vacances, les manifestations. Puis le thème est choisi par vote à main levée : « les manifestations » est choisi
à l’écrasante et enthousiaste majorité.
« Donc le sujet de notre film sera “Les manifestations”. » Les enfants dessinent leurs photogrammes et les commentent pour la caméra : « Les flics arrivent. Ils leur lancent des pierres pour les stopper. » « Là ils ont construit une barricade pour empêcher les flics de venir de ce côté ». « Arrive l’hélicoptère qui éclaire l’endroit où ils ont commencé à allumer des feux. » « C’est la manifestation, et c’est la femme morte dans la rue. » À leur manière, les enfants refont la séquence de Como me da la gana. Une fois dessi-nés, tous les photogrammes sont collés bout à bout sur un immense tissu de 25m de long, qui devient une chenille lorsque les enfants se glissent dessous. La chenille sort de l’atelier, le film de la manifestation défile dans les rues de la ville au rythme de la bande-son de Zéro de conduite. En associant à ces plans la musique de Maurice Jaubert, Agüero fait des apprentis cinéastes de la banlieue de Santiago les héritiers des collégiens du film de Vigo. En montant sur la suite de la même musique des inserts sur les détails d’un dessin, il esquisse, après et avec celui des enfants, son propre remake de la séquence de Como me da la gana. Il suggère d’autres filiations et solidarités : entre les enfants rebelles de 1933 et les manifestants chiliens de 1985, sans doute aussi entre le cinéma libertaire de Vigo et l’affirmation par Agüero de sa propre manière.
Cent enfants jouent à réinventer le cinéma et choisissent pour leur premier film le sujet le plus politique. Agüero est l’un de ces enfants. Car il ne se contente pas de documenter l’atelier de cinéma d’Alicia Vega. Il fabrique son film avec l’atelier, selon un langage cinématographique qui ne lui préexiste pas. L’atelier d’Alicia Vega n’est pas le sujet du film d’Agüero, il est sa matière même. S’y greffant comme s’il y participait lui aussi, Agüero y bricole le langage de son film, à partir de ce que font les enfants qui
découvrent le cinéma. Zéro de conduite : l’élève Agüero, décidément, n’écoute pas les adultes du documentaire. Il joue avec les enfants et fait comme il lui plaît.
Juste après la séquence du film-chenille, à Agüero qui lui demande ce qu’il voudra faire plus tard, Adam répond que s’il ne peut pas être menuisier comme son père, ni mécanicien, il sera soldat. Et il explique en détail au cinéaste comment, à la maison, il a fabriqué sa mitraillette avec du bois et du tissu.
du film, jusqu’à imposer le geste du retour, de se retourner, comme le mouvement propre de Como me da la gana II, qui l’anime et l’écarte du premier.
En 2015, lorsque Ignacio Agüero entreprend Como me da la gana II, il ne s’agit pas simplement de rejouer l’opération du premier film dans un nouveau contexte. Le geste d’interrompre les tournages pour interroger les cinéastes demeure présent, mais de manière sinon anecdotique, du moins beaucoup moins central, dans un film dont la matière est beaucoup plus diverse et la portée bien plus longue. La reprise du titre formule d’abord la persistance d’une nécessité : celle d’affirmer la singularité d’une pratique qui revendique la plus grande liberté à l’égard des habitudes génériques et langagières du cinéma. Affirmer par l’exemple la souveraineté du caprice et la dévaluation du sujet au profit de la manière, promue raison d’être du film.
D’une manière que l’on peut d’abord trouver attendue, le film commence par une introduction en forme de rappel par Agüero, en voix off, des épisodes précédents. Les premiers plans sont empruntés à No olvidar : marche des femmes vers la mine de Lonquén, bouquets de fleurs dans les bras. Après quoi, pour évoquer Como me da la gana et sa question — « je voulais savoir quels films on pouvait faire en dictature » —, il monte sans transition la séquence de la manifestation réprimée par la police. Ce retour aux commencements et au premier Como me da la gana serait banal s’il ne se répétait à plusieurs reprises au cours
La reprise de la séquence de la manifestation s’achève sur Racz disant à Agüero, alors que les flics viennent de passer à côté d’eux : « Tu vois, on est là au cœur du problème ». Cut sur le premier tournage interrompu par le cinéaste : celui du biopic sur Neruda de Pablo Larrain, star du cinéma chilien. Le contraste est saisissant entre la situation insurrectionnelle du tournage de Douce Patrie en 1984, caméra 16mm et Nagra embarqués dans la manifestation, et le confort de Larrain dans sa doudoune, appuyé contre le mur extérieur d’un immeuble, contrôlant le tournage d’un travelling les yeux rivés sur un moniteur dernier cri. À la fin de la prise, Agüero lui pose la question qui sera au cœur du film : « Pour toi, qu’est-ce qui est proprement cinématographique ? » Larrain répond sans hésiter « L’artifice. Que tout soit faux. Comme un magicien, créer une illusion à laquelle les gens croient alors que tout est faux. » Agüero a l’air dubitatif. Au montage il coupera alors que Larrain s’apprêtait à développer. Il coupe en revenant à une séquence du premier film, celle avec Lucho, le chanteur de Como me da la gana, précisément au moment où le cinéaste lui dit « Luchito, regarde, il y a un rayon de soleil sur la trompette ». En donnant au premier film le titre de la chanson, Agüero avouait son penchant pour cette manière de faire du cinéma. En reprenant cette séquence dans le deuxième film, il enfonce le clou et donne à sa propre question une réponse aux antipodes de celle de Larrain : ce qui est proprement cinématographique, ce n’est pas la puissance de l’artifice, c’est le toucher du soleil sur le cuivre de la trompette quand le musicien joue sa chanson. Au début de Como me da la gana II, la séquence Larrain, montée entre deux séquences du premier film, se retrouve coincée entre deux nécessités qui, chacune à sa manière, s’opposent à son faire et à son dire : d’un côté l’urgence politique de filmer ce qui se passe en dictature, de
l’autre le caprice esthétique, sans autre sujet que le plaisir de jouer avec la musique et la lumière.
Si les questions pratiques de 1985 ont été remplacées en 2015 par la question, plus théorique, du « cinématographique », c’est évidemment parce que la situation du cinéma chilien a changé, 25 ans après la fin de la dictature : mise en place d’un système de financement public, fin de la censure, développement d’une économie locale. Le cinéma est devenu une industrie culturelle au sein de laquelle chacun peut développer son projet, essayer de faire le cinéma qui lui chante. La question d’Agüero est toujours celle de la nécessité, mais elle s’est complètement reformulée. Il ne s’agit plus de savoir quels films faire, comment et pour qui, mais en quoi les films que l’on fait relèvent du cinéma comme art singulier, ce qu’ils ont de proprement cinématographique. Lorsque l’on peut tout dire et tout faire, la nécessité est devenue une question avant tout esthétique.
— Dans quel sens ?
— Pourquoi tu fais du cinéma ? »
Agüero prête une oreille distraite à la longue réponse de Rivas mais se garde de tout commentaire. Sa réponse, selon sa manière, vient avec le fragment qu’il monte juste après : un paysage de montagne filmé de l’intérieur d’une maison qu’on devine isolée, caméra vidéo à la main, les mains d’une femme qui coupent les ongles de pied d’un enfant, le visage de l’enfant, leurs voix et le bruit du coupe-ongles se mêlent à la Trauermusik d’Hindemith diffusée dans la pièce et à celui de la pluie qui tombe au-dehors. Scène de vie familiale, sans sujet, sans commentaire, sans raison autre que le plaisir de filmer cette intimité. La scène est prolongée par un très bref fragment en noir-et-blanc, qui la ponctue : une femme dans un canoë pagaie, son visage tourné en arrière vers la caméra, puis elle se retourne et s’éloigne.
C’est la deuxième occurrence dans le film d’un registre totalement absent du premier : l’archive personnelle, familiale. La première occurence arrivait très tôt, juste après la séquence où Lucho, après avoir chanté sa chanson, répondait hilare : « Qui va le voir ?
La plupart des séquences de Como me da la gana II consacrées aux tournages des autres cinéastes ne laissent guère place au doute quant à ce que pense Agüero du discours et de la pratique de ses collègues. Après la manière dont il coupe Pablo Larrain, exemplaire est son échange avec Marialy Rivas, seconde cinéaste dont il interrompt le tournage. Il commence par lui demander ce qui l’intéresse dans son film. C’est, répond-elle, la formation de l’identité féminine. Déterminer, du point de vue d’une femme homosexuelle comme elle, ce qui vient de l’intime et ce qui est imposé de l’extérieur.
« Tu vas continuer à explorer ça dans le prochain film ? », demande Agüero.
— Je l’espère, oui.
— C’est ce qui t’intéresse, traiter un sujet. Et qu’est-ce qui est cinématographique ?
On ne sait pas. » Cut sur le plan muet en noir-et-blanc d’un homme en costume militaire au côté d’une femme. Après quelques secondes, Agüero dit de la voix basse qui avait ouvert le film, presque un murmure : « Mon père. » Une femme en robe de mariée sort d’une voiture. Agüero encore : « Devine qui est cette femme, Sophie ». Au lieu de répondre, l’interlocutrice inconnue demande : « Tu vas continuer ? » Pas de réponse. Un homme plus âgé accompagne la mariée. Agüero : « Mon grand-père ». Puis on voit d’autres personnes qui attendent, se saluent devant l’église. « Et ça, qu’est-ce que ça a à voir ? », demande Sophie. « Dis-le-moi, toi. C’est toi la monteuse. C’est très cinématographique ». La séquence se poursuit, tout le monde se salue, s’embrasse, les femmes portent des chapeaux remarquables. Sophie demande :
« Pour toi, qu’est-ce qui est cinématographique ? — Les chapeaux. — Très drôle. »
Après quelques secondes, cut sur une image toujours en 4/3, mais sonore, en couleurs et d’une texture qui indique une vidéo analogique. Le raccord s’est fait sur le chapeau que porte une femme cadrée de profil dans la rue. Chapeau de fourrure, comme le col de son manteau. Les passants défilent dans le cadre, tous en vêtements d’hiver. Puis le plan fixe devient travelling, on comprend que c’est filmé depuis un tramway. On reconnaît peut-être, déjà, Saint-Pétersbourg. La vitesse augmentant, le travelling devient filé. Cut sur Agüero en intérieur, chapka sur la tête, caméra à la main, se filmant dans un grand miroir. Sur un rebord devant le miroir sont posées des photos d’enfants, filmées l’une après l’autre. Vapeur sur les eaux de la Volga. Retour à l’autoportrait au miroir, une voix russe hors champ. Pano vers un téléviseur mal réglé dans lequel on reconnaît Gorbatchev faisant un discours. Après un plan qui semble venir d’ailleurs, d’une autre intimité, une femme dénudant sa poitrine derrière une fenêtre en souriant à la caméra, la séquence se poursuit par une cérémonie dans la neige. « 1942 » gravé sur une plaque commémorative, des soldats au garde-à-vous l’encadrent, une gerbe a été déposée dessus. Les soldats puis la foule défilent le long du monument au son d’une musique grave à l’orgue, puis au rythme de tambours militaires. Cut sur un plan de No olvidar : deux femmes de dos, recueillies devant le monument qu’elles ont fabriqué et qu’elles sont venues fleurir en souvenir des hommes assassinés. Après quelques secondes, cut sur une autre croix, parmi les herbes folles d’un cimetière en bord de mer. Le format est redevenu le 1:1.85 du film de 2015. Le cri d’un oiseau fait passer à un homme assis au bord de l’eau, plan moyen frontal, le regard fixé dans la caméra. Après quelques secondes on entend la voix d’Agüero, hors champ : « Bonjour. » C’est le début d’une conversation, Agüero enchaîne les questions. L’homme s’appelle Pablo Sotomayor.
« Vous vous occupez de l’église ?
— Non, c’est un autre.
— Du cimetière ?
— Non.
— Qu’est-ce que vous faites ?
— Je suis assis, chez moi.
— Vous vous ennuyez ?
— Non.
— Vous aimez regarder la mer ?
— Oui. »
L’échange continue. On apprend qu’il vit là, à côté, avec ses parents, qu’il n’a pas d’enfants.
Il n’a pas de travail, il n’en cherche pas, pour avoir de quoi manger parfois il travaille dans le coin, à la lagune, mais parfois on lui donne.
Il ne va presque jamais à l’église, il a beaucoup de parents au cimetière, beaucoup de gens qui sont morts. Devant ce long plan, cette longue conversation, on pourrait demander, comme Sophie : « Et là, qu’est-ce qui est cinématographique ? » Ce pourrait être la simple présence de Pablo Sotomayor au premier plan, son phrasé, sa voix, ses réponses lapidaires qui disent une vie en tous points opposée à celle des cinéastes interrogés par Agüero. Ou l’arrière-plan dans son dos : le ponton à l’abandon derrière son épaule, qui s’enfonce d’un côté dans l’eau et de l’autre dans la profondeur de l’image, qui attire et emporte le regard, et le miroitement de l’eau autour. Ou le rapport des deux. Après la réplique sur le cimetière et les morts, un jump cut presque imperceptible fait tressaillir l’image. À la faveur de cette césure discrète, l’entretien s’achève sur un ton plus léger. Agüero siffle un chien qu’on imagine se promener quelque part hors champ.
« Ce chien est à vous ?
— Dans la cuisine depuis des années.
— Comment il s’appelle ?
— Ils l’ont ramené de là-bas. »
Fin de la conversation. Retour au cimetière qui surplombe la mer. Le plan dure. Au bout d’un moment, on entend l’autre voix d’Agüero, celle qui parle tout bas, depuis un ailleurs qui n’est ni off ni hors champ :
« Sophie, on s’est perdus. On est où ? »
Quand, devant les archives du mariage de ses parents, Agüero interpelle pour la première fois Sophie, on réalise que la voix basse entendue en ouverture n’était pas l’habituelle voix off du documentaire, celle de No olvidar par exemple, et que le monologue d’Agüero est en réalité un dialogue avec sa monteuse. Un dialogue qui a lieu devant les images, à l’endroit qui est celui du récit : la table de montage.
Comme ça me chante. Dans le premier film, le terrain de jeu est le tournage : celui de son film et ceux des films des autres, qu’il interrompt, parce qu’il est un jeune cinéaste qui se demande que faire avec le cinéma. Dans le deuxième film, le jeu se dédouble entre deux terrains : tournage et montage, le second prenant nettement le pas sur le premier. Ce saut en arrière, ou en hauteur, démultiplie les puissances de l’interruption en la faisant jouer à sa place la plus propre : au montage.
Dans un bref et grand texte de théorie du cinéma 2, Giorgio Agamben écrit que les conditions de possibilité du montage sont la répétition et l’arrêt, et que le montage étant le propre du cinéma, répétition et arrêt en sont les conditions de possibilité. La répétition, en ce qu’elle est le retour en possibilité de ce qui a été, fonde la proximité entre le cinéma et la mémoire. Tous deux ont cette capacité de « projeter la puissance et la possibilité vers ce qui est impossible par définition, vers le passé. » Tous deux rendent le passé à nouveau possible. L’arrêt, soit « le pouvoir d’interrompre », est ce qui différencie le cinéma de la prose narrative et le rapproche de la poésie, en ce qu’il produit une noncoïncidence entre l’image et le sens. « Il ne s’agit pas d’un arrêt au sens d’une pause, chronologique, écrit Agamben, c’est plutôt une puissance d’arrêt qui travaille l’image
elle-même, qui la soustrait au pouvoir narratif pour l’exposer en tant que telle ».
Agamben appuie sa pensée de la répétition et de l’arrêt comme propre du cinéma sur les exemples de Guy Debord (In girum imus nocte et consumimur igni) et Jean-Luc Godard (Histoire(s) du cinéma). Como me da la gana II serait un autre cas d’étude exemplaire. Un mouvement de recul invente la salle de montage comme le lieu d’où le film se projette — lieu à la fois réel, bien qu’invisible, et transcendantal en tant qu’il situe la possibilité même du film. Ce faisant, il institue le film comme œuvre de la mémoire et fait du retour sa forme et son mouvement premiers. Avec ce « passage du montage au premier plan », selon l’expression d’Agamben au sujet d’Histoire(s) du cinéma, c’est l’arrêt, le « pouvoir d’interrompre » qui, se montrant en tant que tel, voit sa puissance poétique décuplée. Dans Como me da la gana, c’est le présent qui était interrompu, celui des tournages en train de se faire. Dans Como me da la gana II, ce qu’interrompent le cinéaste et sa monteuse, c’est le retour des images du passé, ainsi que leur propre retournement sur ce passé.
*
« Sophie, on s’est perdus ». Il faut s’arrêter, interrompre, car on ne sait plus où on est. Dans l’élan de la chanson de Lucho, oubliant son projet, le cinéaste a fait comme ça lui chantait. Il a monté l’archive noir-et-blanc du mariage de ses parents, n’a pas écouté Sophie qui trouvait ça hors sujet, s’est émerveillé du défilé des chapeaux et, emporté par le mouvement du retour et grisé par la liberté poétique qu’accorde le montage, il est passé d’un chapeau à l’autre, de la préhistoire familiale à ses propres archives d’un voyage à Saint-Pétersbourg, d’où il est revenu à No
2 Giorgio Agamben, « Le cinéma de Guy Debord », in Image et mémoire, Hoëbeke, 1998, repris dans Image et mémoire. Écrits sur l’image, la danse et le cinéma, Desclée de Brouwer, 2004.
olvidar, passant de l’hommage aux morts soviétiques au recueillement des veuves de Lonquén, puis de ces croix ornées de fleurs à celles d’un cimetière au bord de la mer près duquel il a rencontré Pablo Sotomayor. On est loin, très loin de l’enquête sur le cinéma qui se fait au Chili en 2015. On s’est perdus en route. On a oublié le sujet, on s’est laissé emporter par le retour, par la possibilité, libérée par le montage, de faire revenir toutes sortes d’images. On ne sait pas où on est, mais quelle joie de réaliser que ça n’a aucune importance. Ceci dit, il est temps de s’arrêter, et de recommencer.
D’un film à l’autre, l’interruption est devenue l’opérateur du retour.
Retour sur sa vie de la part d’un cinéaste qui a désormais une œuvre, qui a parcouru un chemin mêlant les films réalisés et la vie vécue et filmée pour elle-même. Como me da la gana II est monté d’une manière qui, faisant revenir ces images, les projette dans un temps indécidable, par-delà la distinction du passé et du présent.
Retour de l’origine, aussi, et de deux manières. D’abord parce que le montage de cesse de faire revenir No olvidar, le premier film. Il revient comme une origine qui ne serait pas un point de départ situé sur une ligne chronologique mais, dans le fil d’une pensée moderne de l’origine, celle de Walter Benjamin reprise par Agamben, une potentialité faisant retour dans le présent pour en interrompre le cours et rouvrir le champ du possible. Le retour de No olvidar fait revenir et insister les motifs du souvenir, du deuil, et d’une fonction mémorielle du cinéma. Mais ce retour n’est pas commandé par un impératif moral ou idéologique. C’est le montage qui commande, ou plutôt invite : c’est la commémoration des héros de 1942 à Saint-Pétersbourg / Léningrad qui rappelle No olvidar, qui à son tour appelle le cimetière non loin duquel est assis Pablo Sotomayor.
Retour de l’origine, ensuite, parce que le film, tout en suivant son cours, recommence. Par
deux fois il s’interrompt, certes pour se relancer, mais en reprenant à zéro. « On est où ? » Le premier recommencement fait logiquement suite au constat de l’égarement. On s’est perdus, on arrête, on reprend tout depuis le début. Noir, et à nouveau le générique en deux cartons : « Como me da la gana II / Un documental de Ignacio Agüero. » Le nouveau départ diffère du premier : non plus le commencement de l’œuvre — au sens du premier film, No olvidar —, mais un enfant, aujourd’hui, en 2015, dans l’obscurité d’une salle de cinéma, le visage tendu vers l’écran, éclairé par intermittence par le faisceau de la projection. Avec ce plan, c’est un autre film d’Agüero qui fait retour, mais de manière encore spectrale, par l’esquisse de son remake trente ans plus tard : Cent enfants qui attendent le train, le film de 1987 dans lequel Agüero filmait l’émerveillement des enfants devant le cinéma et sa naissance. Puis c’est la séquence sur le tournage du film féministe de Marialy Rivas et la réponse de monteur qu’oppose Agüero à son obsession du sujet : l’archive familiale avec l’enfant qui se fait couper les ongles en musique. Puis le remake de Cent enfants semble se poursuivre : une petite fille n’arrive pas à décoller les yeux du kinétoscope où un flipbook rejoue pour elle la merveille de l’image animée. Le crépitement des pages du flipbook continue sur le début de la séquence suivante : deux adultes regardent vers le bas en souriant, trois adolescentes exécutent une chorégraphie devant le tableau d’une salle de classe. On devine que les adultes regardent un moniteur, le montage fabrique l’impression qu’ils y admirent l’image de la chorégraphie exécutée devant eux. Le bruit du flipbook sur ces plans muets fait de cette scène une déclinaison de la précédente : enfant ou adultes, pirouettes d’un magicien ou danse des jeunes filles, c’est le même émerveillement devant l’image en mouvement. Le même retour de l’origine. De l’enfance comme origine ou de l’origine comme enfance : non plus un état chronologique mais une manière d’être ou de conduire son art qui perpétue l’émerveillement devant sa puissance propre.
Qu’est-ce qui est cinématographique ? La mise en jeu du cinéma, c’est-à-dire le retour de son origine, de son enfance — pas ses débuts, mais le jaillissement du possible qui lui est propre.
Ces quelques secondes pendant lesquelles le cliquètement du flipbook déborde sur la séquence suivante laissent entendre sans le dévoiler le secret du film et de cette manière de faire du cinéma : l’origine, c’est l’émerveillement de l’enfant qui découvre, et la pratique du cinéma, c’est la quête, en toute chose, peu importe le sujet, peu importe qu’il y ait sujet ou pas, de cette enfance. Enfance qui, quand elle est là, rend le sujet dérisoire, le transcende ou le dissout.
L’adulte qui, dans la salle de classe, sourit comme un enfant en regardant son moniteur, c’est José Luis Torres Leiva, en plein tournage de El viento sabe que vuelvo a casa (2016). Agüero y joue le rôle principal d’un cinéaste préparant un film de fiction à partir d’un fait divers survenu sur l’île de Meulín, dans l’archipel de Chiloé. Si Agüero, selon le programme de son film, interrompt le tournage pour poser ses questions, c’est donc de l’intérieur d’un projet dont il est familier, et à un cinéaste dont il estime le travail. Sans surprise, cet entretien diffère des deux premiers par l’évidence d’une entente entre les deux amis. Les questions d’Agüero ne sont pas des pièges, plutôt des perches tendues au jeune cinéaste.
« Ce qui t’intéresse le plus, c’est de raconter une histoire ?
— Non, ça ne m’intéresse pas de raconter une histoire linéaire, ou que l’on comprenne où va l’histoire. Je m’intéresse à d’autres choses : le langage cinématographique, l’atmosphère […]. »
L’intimité des cinéastes autorise le mélange des films, comme lorsqu’Agüero, dans le Como
me da la gana de 1985, venait non seulement interrompre mais aussi parasiter, vampiriser le tournage de son chef opérateur Christian Lorca. Le casting se poursuit dans la salle de classe avec l’audition de deux jeunes filles venues chanter. Agüero, assis face à elles bord cadre, est à la fois l’acteur du film de Torres Leiva et le réalisateur du sien. Puis deux filles et un garçon se succèdent, seuls face à la caméra. La mise en scène change : plus d’amorce, l’adresse est frontale, comme si Agüero était passé derrière la caméra. Chacun se présente en se racontant, en parlant de sa vie. On est passé au-delà du casting, mais aussi de l’entretien, car même si on devine qu’une consigne leur a été donnée de répondre aux mêmes questions, aucune n’est montée et les trois monologues s’enchaînent sans transition. Chacun compose son autoportrait en quelques phrases : nostalgie de l’île d’origine, plaisir d’y retourner, crainte des changements qu’entraîne la modernisation, métiers qu’on voudrait faire plus tard et difficulté d’y parvenir quand on vient de là. C’est très simple, très direct, et très émouvant. Ce qui émeut, ce n’est pas seulement la candeur réfléchie avec laquelle ces adolescents disent leur vie dans ce coin reculé du Chili, c’est aussi la manière dont ces vies disent quelque chose de ce Chili de 2015, vingt-cinq ans après la fin de la dictature : le « progrès » et ses ambigüités, le changement qui fait peur, la destruction du passé pour un avenir qui inquiète. Ces filles et ce garçon rappellent ceux de Cent enfants qui attendent le train : comment quelques phrases simples et directes sur le quotidien qu’ils vivent et l’avenir qu’ils imaginent en disent plus sur leur monde, sur la situation de leur pays, que tout un documentaire dont ce serait le sujet.
S’il fallait une confirmation que quelque chose qui a trait à l’enfance se trame et se précise depuis le début du film, la séquence suivante la donne. Elle est issue de la même archive personnelle que celle du premier mouvement : la maison dans la montagne, une scène de vie de famille, le monde au-dehors, le plaisir de filmer ça, sans pourquoi. Ici un rock’n’roll
années 50 a remplacé Hindemith, la caméra DV passe du visage d’un enfant à l’autre, puis d’un oiseau à l’autre sur les fils électriques, puis elle revient aux enfants qui regardent les oiseaux par la fenêtre : « Les hirondelles, les hirondelles ». Images et sons du bonheur. La voix d’Agüero à la table de montage vient interrompre la rêverie, quelque peu briser la magie :
« Sophie ? — Quoi ? »
Les monteurs se sont encore perdus. Noir.
« Como me da la gana II », troisième générique. Pour la seconde fois, le film repart à zéro. Depuis la table de montage, Ignacio et Sophie assistent à la troisième naissance du film. Como me da la gana II est comme un enfant qui refuserait de grandir, de vieillir, de se développer. Qui préfèrerait repartir du noir, renaître, recommencer l’enfance. Pour se conduire, encore une fois, comme ça lui chante.
la joie et la mélancolie, ensemble. Trauermusik sur le visage d’un enfant.
Ce qui s’exprime là, c’est surtout un immense dégagement à l’égard des obligations morales, des pruderies pseudo-éthiques quant au mélange des genres, des prescriptions normatives quant au quoi et au comment du documentaire, qui plus est « politique ». Un dégagement et une souveraineté. Pas du tout une liquidation. C’est un mouvement d’ouverture qui n’oublie rien, ne renie rien, mais accueille et recueille tout ce qui lui plaît, comme ça lui chante, sans hiérarchie, sans souci du sujet.
Alors on recommence : No olvidar. Cette fois on commence même par le générique du premier film. Plan au banc-titre sur une photo des femmes qui manifestent en portant audessus de leurs têtes des portraits des martyres de Lonquén. Sur l’image d’une croix contre un mur de pierres, trois cartons : « Grupo Memoria / presenta / No olvidar. » C’est écrit : « ne pas oublier ». Oui, mais quoi ? Les drames collectifs, l’histoire politique du pays, oui, mais pas seulement. Aussi des joies très intimes, des instants de vie, les visages des enfants qui regardent les hirondelles. Le titre du premier film d’Agüero résonne de part et d’autre de l’interruption. Il faut l’entendre avec celui, qu’on vient de lire aussi, du film qui s’en souvient. « Ne pas oublier / Comme ça me chante ». Le cinéma est là aussi pour ne pas oublier la vie qui ne fait que passer. Pour d’un même élan, en la faisant revenir, rendre à la vie passée sa possibilité d’être et en porter le deuil. L’éclat et son voile,
Après la fin de la citation du générique de No olvidar, le film continue de reprendre à zéro, comme si de rien n’était. Agüero commence par répéter presque à l’identique ce qu’il a déjà dit il y a trente-cinq minutes, puis il ajoute une phrase qui enjambe le film de 1985 pour relancer le montage plus loin, jusqu’au film suivant : « Quand j’ai filmé No olvidar, en 1982, sur les crimes de Lonquén, la seule copie a été réquisitionnée par le Ministère de l’Intérieur. Je ne savais pas quel film je pouvais faire. Alors j’ai demandé à mes collègues cinéastes ce qu’ils faisaient, ce qu’on pouvait filmer en dictature. La réponse est venue de l’atelier pour enfants d’Alicia Vega, que j’ai filmé en 1987. »
Ce qu’il dit implicitement, c’est que la réponse n’est pas venue de ses collègues ou de l’enquête qu’il prétendait mener auprès d’eux. Ce qu’il reconnaît aussi, c’est qu’il ne cherchait pas de réponse, que l’enquête n’était que prétexte à faire un film comme ça lui chantait. Si la réponse est venue deux ans plus tard, dans l’atelier d’Alicia Vega, elle est donc à chercher dans Cent enfants qui attendent le train. Sans doute dans l’extrait qu’Agüero choisit de monter pour continuer ce recommencement : la séquence de la réalisation d’un film de papier par les enfants, depuis le choix du sujet — les manifestations — jusqu’aux inserts silencieux sur les détails d’un dessin — hélicoptère, jets de pierre, passage à tabac, femme morte dans la rue.
Il n’est donc pas tout à fait vrai que ce nouveau commencement enjambe le premier Como me da la gana. Il est bien là à nouveau, la même séquence que lors du premier départ, mais via son remake dessiné par les enfants de l’atelier dans le film suivant. Les trois premiers films d’Agüero ne cessent de revenir dans Como me da la gana II, pliés les uns dans les autres, jouant à varier les modes du retour.
Quelle est la réponse ? Agüero ne le dit pas. À nous de deviner, de déplier.
Ce qu’il fallait faire, c’était filmer la violence, la dictature en acte, au présent, dans la rue.
Ou bien : ce qu’il fallait faire, c’était filmer des enfants en train de découvrir ce qu’est le cinéma, comment ça se fait, et de dessiner sur un film de papier la dictature et sa violence.
Ce qu’il suffisait de faire, peut-être, c’était filmer des enfants.
C’était peut-être, encore plus simplement, faire découvrir le cinéma à des enfants, recommencer l’enfance du cinéma, avec et pour des enfants.
C’est pourquoi le film se poursuit par un hommage à Alicia Vega. L’année où Agüero réalise Como me da la gana II est l’année du dernier atelier de cinéma pour enfants, trente ans après le premier. Des fragments de dessins de 1987 on saute aux enfants de 2015 qui, à leur tour, dessinent une manifestation et sa répression.
« Comment on appelle le canon à eau ? — Guanaco. Char à canon à eau. »
Des enfants de 2015 refont le film de papier dessiné par ceux de 1987, qui refaisaient une séquence du film de 1985. Les images de la dictature n’en finissent pas de revenir, dans les films d’Agüero et dans ceux des enfants. No olvidar. Mais soudain, quand à la fin de son dernier atelier Alicia demande pour la
dernière fois aux enfants de rassembler leurs photogrammes, quelque chose se passe qui est au-delà du retour, de la mémoire. Le filmchenille de 1987 sort de la chapelle bleue. Celui de 2015 sort de l’école. Des enfants de 1933 se mettent à chanter. Les deux défilés alternent et se confondent au rythme de la bande-son de Zéro de conduite. Extatique, le montage suspend le temps, abolit le passage. Et ça continue : il rassemble les enfants de 2015 et ceux de 1987 devant la même projection de Padre Padrone : « Mon Dieu, faites que mon père meure. Si vous le faites mourir je vous obéirai toujours. » Des visages d’enfants regardent dans le noir les visages d’autres enfant implorant Dieu de leur porter secours, de faire justice. La musique du film des frères Taviani se fond dans la voix d’Alicia Riva, extraite de Cent enfants qui attendent le train et posée sur un paysage désertique qui défile en travelling latéral depuis une voiture. « Ce bateau avançait sur les canaux de Venise, sur la mer, et c’est le premier mouvement de caméra qu’on a fait. On appelle ce mouvement “un travelling” ». Juste avant, Alicia confiait à Ignacio qu’elle aimait collectionner les éditions du même livre. « J’ai toute une collection d’Alice au pays des merveilles » On imagine en face d’elle le cinéaste, son sourire de chat du Cheshire.
*
Toujours refaire le même film. Reprendre, recommencer. Comme Alicia qui, pendant trente ans, a recommencé tous les ans le même atelier de cinéma. Rester avec Alicia, ne pas quitter l’atelier. À l’intérieur du même film aussi, recommencer. Répéter, arrêter, répéter, arrêter, reprendre à zéro, à l’infini. Tenir ensemble le vieillissement et l’enfance toujours recommencée.
*
C’est la toute fin du film. Le dernier plan : un père sort de l’école où a eu lieu le dernier atelier de cinéma. Dans le noir, devant ce noir, Ignacio et Sophie jouent à un dernier jeu :
« Alors, c’est quoi le cinématographique ?
— Les chapeaux.
— Froid, froid.
— La victoire de l’instant.
— Froid, froid.
— La capture du hasard.
— Froid, froid, froid.
— Alors ça doit être ce que je pense.
— Exactement. »
Il ne fallait pas chercher le cinématographique dans l’image. Le cinéma n’a pas d’essence, il n’a que des manières. Il n’a lieu qu’entre les images. Dans le non-lieu du montage, c’est-à-dire de son enfance. Là où il se joue du temps.
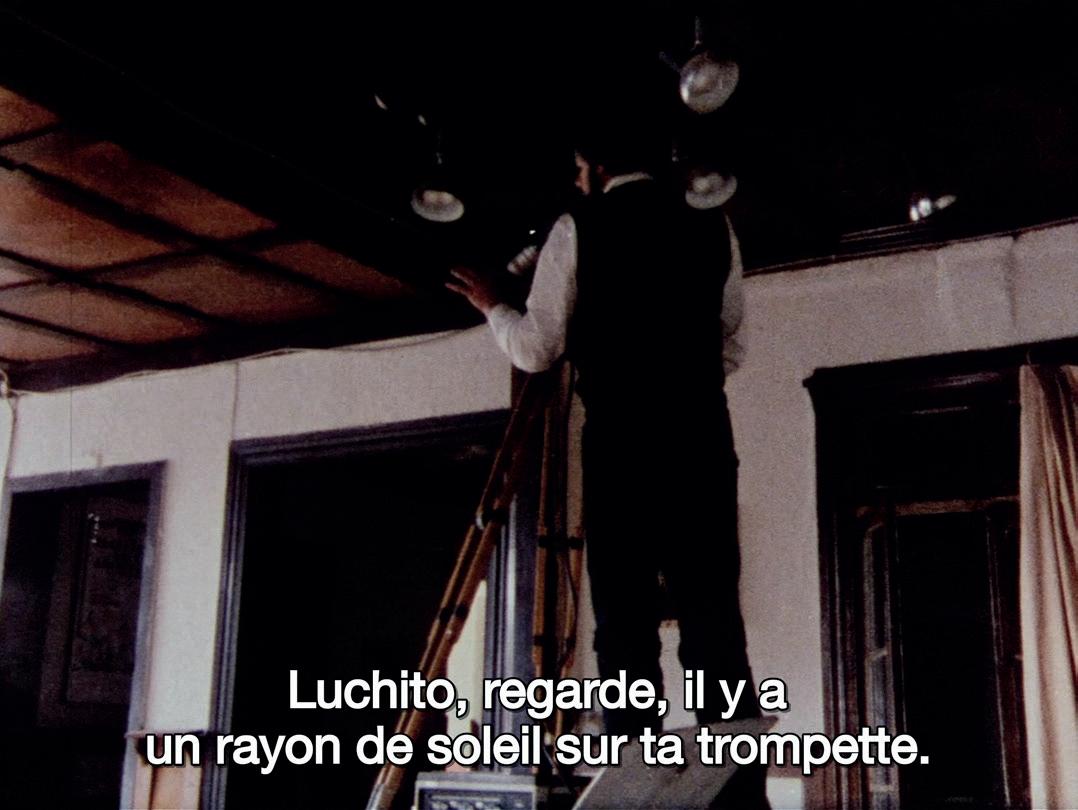






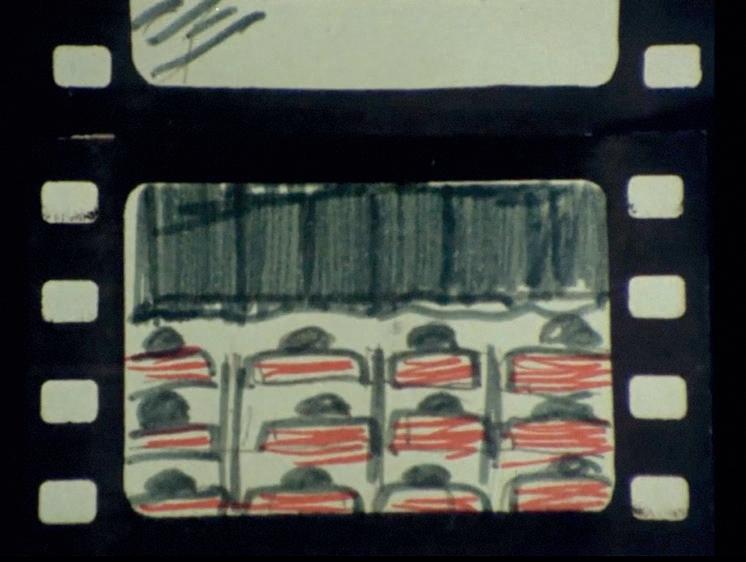







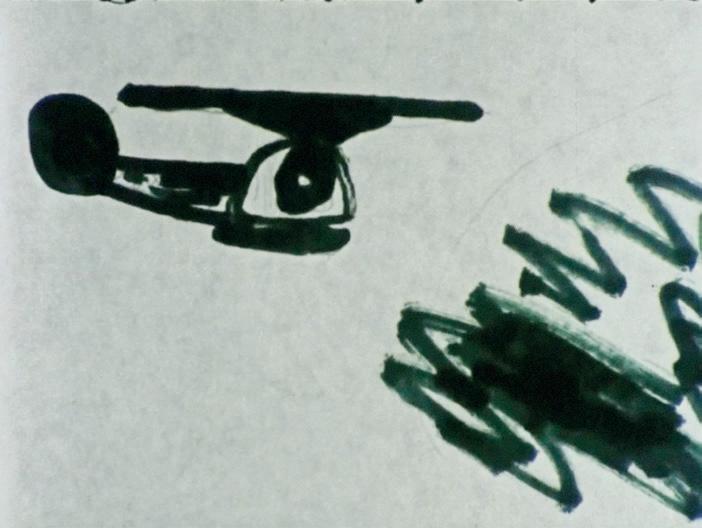
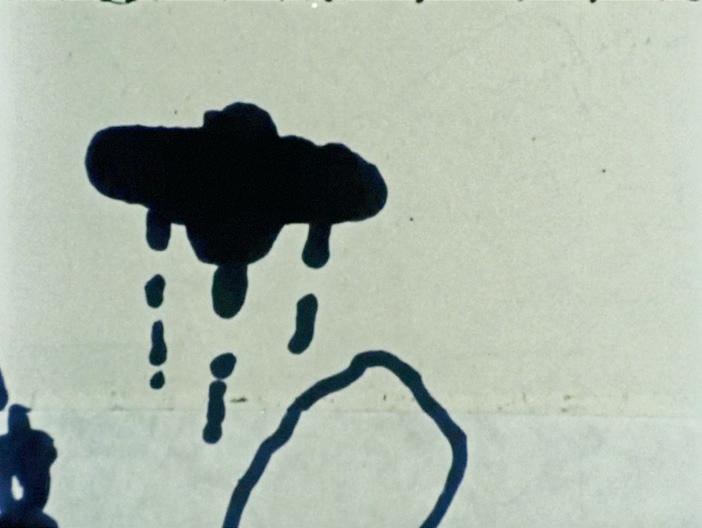
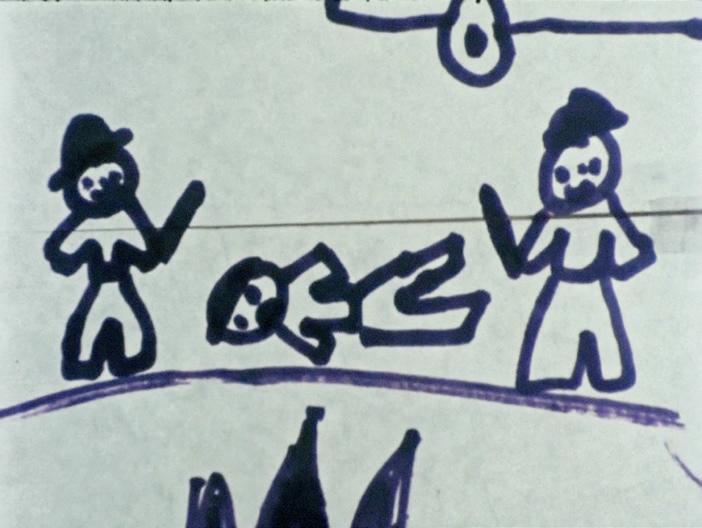
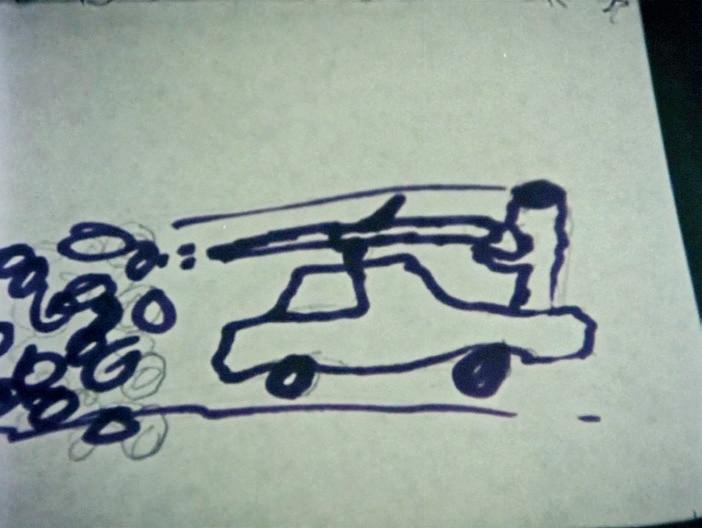
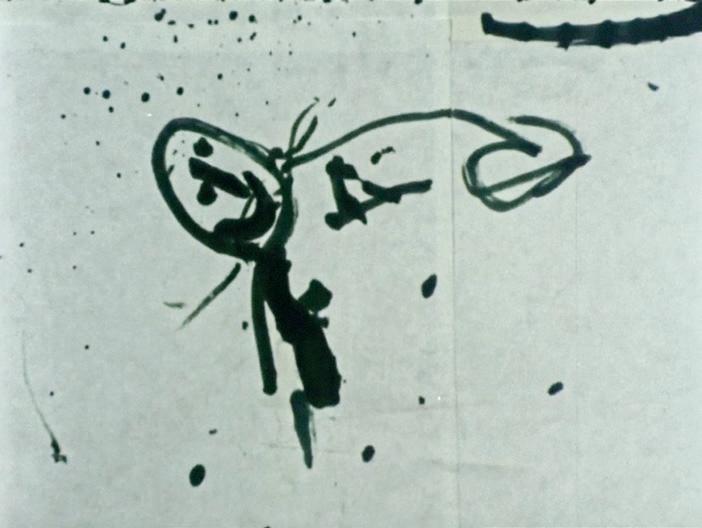







p.6 | Vidéogrammes : à gauche Christopher Bach (acteur 1) à droite, Cornelius Obonya (acteur 2)
p.12-13 | Photographies du décor : à gauche, photographies argentiques à droite, photographies numériques
p.13 | Acteur 2, acte 3 : fin du monologue, tel qu’il est donné à lire en sous-titres aux spectateurs francophones de De Facto
p.17 | Vidéogrammes : Acteur 2, acte 3
p.18 | « Ma main » : dessin de Selma Schulte-Frohlinde
p.21, 33-35 | Vidéogrammes extraits du film
p.25 | Juliet Berto dans Céline et Julie vont en bateau, Jacques Rivette
p.28 | Tournage de Losing Faith
p.29 | Dessin de Selma Schulte-Frohlinde
p.25-31 | Vidéogrammes extraits du film
p.32 ...............| Dessin de Martha Mechow
p.36 | Vidéogramme : Claire Vivianne Sobottke pendant la seconde phase de recherche pour la partie du film consacrée à Hannah Arendt. “Pour cette session, nous avons constitué un corpus de textes théoriques que nous avons proposés à Claire comme matériaux de départ. Comment traduire ces fragments de pensée dans la langue sensible des images et des sons ? Comment les incarner, leur donner forme et vie par le geste et la voix ? ” (Annik Leroy et Julie Morel)
p.41 | Premier collage réalisé par Annik Leroy pendant la genèse du film
p.44-45 .......| Photo de tournage : Annik Leroy (séquence “Roger”)
p.46-47 | Planche de montage de la séquence « Roger »
p.48 | Planche de montage de la séquence « Ruben »
p.50-51 | La « force diagonale » : fragment de Franz Kafka, et son commentaire par Hannah Arendt
p.52 | Lettre de Claire Vivanne Sobottke aux réalisatrices, pendant la phase de recherche pour son interprétation de Hannah Arendt
p.53 | Notes préparatoires d’Annik Leroy pour la partie du film consacrée à Hannah Arendt
p.54-57 | Plan de tournage
p.58-59 | Planche de montage “Hannah Arendt”
p.60 | Photo de repérages
p.69 | Photos de repérages et archive (coupure de presse) utilisée dans le film
p.70-71 | Vidéogrammes du Sentier des asphodèles
p.74, 91 | Dessins de María Aparicio
p.79 | Photographie argentique de María Aparicio
p.83 | Sobre las nubes, vidéogrammes
p.86 | Las cosas indefinidas, vidéogrammes
p.90 | Première esquisse pour Sobre las nubes
p.92-93 | Photographies argentiques, tournage de Las Calles
p.94-99 | Scénario et esquisse de découpage pour Las cosas indefinidas
p.100 | L’homme sans nom, Œuvre photographique © Wang Bing, 2014
p.106-107 | Croquis et notes de Caroline Champetier : découpage (axes de caméra, 8 « moments »)
p.108-109 | Photos de tournage © SUN Zhao
p.110-113 | Vidéogrammes de Man in Black
Toutes les images accompagnant les textes sur Reality, Trenque Lauquen, Le Gang des Bois du Temple ainsi que sur Ignacio Agüero sont des vidéogrammes extraits des films.
L’image accompagnant le texte sur L’Amour fou est une photographie de plateau.
Patrick Holzapfel est écrivain, critique de cinéma et programmateur. Son premier roman, Hermelin auf Bänken, a été publié en 2024. Il est le rédacteur en chef du site web et magazine de langue allemande Jugend ohne Film, un lieu de rencontre pour la critique cinématographique littéraire.
Laura Staab est rédactrice adjointe chez MUBI. Elle est titulaire d’un doctorat en études cinématographiques du King’s College de Londres et écrit régulièrement sur le cinéma pour Another Gaze, Notebook et Sight & Sound.
Claire Lasolle a cofondé Vidéodrome 2, structure de diffusion cinématographique expérimentale à Marseille. Elle en a assuré le développement et la coordination artistique jusqu’en 2024. Membre du comité de sélection du FID depuis 2020, elle s’investit dans différents champs de la critique, de la formation et de la programmation, avec un intérêt méthodologique pour les ciné-clubs.
Mathilde Girard est psychanalyste, cinéaste et écrivaine. Elle a publié plusieurs ouvrages de littérature et de philosophie (notamment Les indications pour le corps, éditions Isabelle Sauvage, 2023 ; La Séparation du monde, éditions Excès, 2022). Ses deux premiers films (Les Épisodes-printemps 2018 [2019] et Que quelque chose vienne [2023]) ont fait leur première au FIDMarseille, où ils ont été primés. Elle travaille par ailleurs comme scénariste aux côtés de Pierre Creton depuis 2016.
Louise Martin Papasian est cinéaste et programmatrice, diplômée du Master de Création de l’Elías Querejeta Zine Eskola (2023). Elle est membre du comité de sélection du FIDMarseille depuis 2021 et développe en parallèle plusieurs projets de films en Arménie, où elle a réalisé et produit son premier court-métrage, զորակոչիկ (Appelé), sélectionné dans plusieurs festivals en France et à l’étranger.
Caroline Champetier est directrice de la photographie et cinéaste. En tant que directrice de la photographie, elle a travaillé avec de nombreux cinéastes français et internationaux parmi lesquels Chantal Akerman, Jean-Luc Godard, Jacques Rivette, Philippe Garrel, Xavier Beauvois, Anne Fontaine, Leos Carax, Amos Gitaï, Nobuhiro Suwa, Wang Bing. Elle est vice-présidente du Conseil d’administration du FIDMarseille.
Adrian Martin est critique de cinéma et essayiste audiovisuel. Né en Australie, il est installé à Malgrat de Mar (Espagne). Il est l’auteur de onze livres, dont Mysteries of Cinema (2020), Filmmakers Thinking (2024) et, avec Cristina Álvarez López, Brian De Palma Pure and Impure (2025).
Son site web couvre 45 ans d’écriture : www.adrianmartinfilmcritic.com
James Lattimer est programmateur, critique et réalisateur de films. Membre du comité de sélection de Berlinale Forum depuis 2011, il est également consultant en programmation pour la Viennale. Il a coréalisé All Still Orbit avec Dane Komljen et coécrit Underwater, du même cinéaste. Ses écrits sur le cinéma ont été publiés dans Cinema Scope, Sight & Sound, The Brooklyn Rail, Film Comment et Fireflies, entre autres.
Cyril Neyrat est directeur artistique du FIDMarseille. Critique de cinéma et enseignant, il a publié ou dirigé des ouvrages sur différents cinéastes, notamment Pedro Costa, Pierre Creton, Miguel Gomes et Jean-Claude Rousseau. Ses articles ont été publiés dans de nombreux livres collectifs et revues français et internationaux.
Giovanni Marchini Camia est cofondateur de la maison d’édition Fireflies Press et programmateur au Locarno Film Festival. Ses écrits sur le cinéma ont été publiés dans Sight & Sound, Film Comment et Cinema Scope, entre autres.
Fidback est la revue du FIDMarseille, Festival International de cinéma de Marseille.
Direction de la publication : Tsveta Dobreva & Cyril Neyrat
Ont collaboré à ce numéro : Caroline Champetier, Mathilde Girard, Patrick Holzapfel, Claire Lasolle, James Lattimer, Louise Martin Papasian, Giovanni Marchini Camia, Adrian Martin, Laura Staab.
Conception graphique et maquette : UUS-Studio
Remerciements
Selma Doborac, Yohei Yamakado, Martha Mechow, Justine Coquel, Annik Leroy & Julie Morel, Maxime Martinot, Maria Aparicio, Caroline Champetier, Nicolas Rogister de la Mothe, Johanna Collard, Théophane Bérenger, Manuel Asín, Rabah Ameur-Zaïmeche & Sarah Sobol, Ignacio Agüero, Claudio Aguilar Frez, Marie Hermann
Crédits iconographiques
DR, sauf p. 6, 12, 13, 17 : Selma Doborac • p. 18, 27, 29, 32 : Martha Mechow p. 36 et 41-59 : Annik Leroy et Julie Morel • p. 60 et 66-73 : Maxime Martinot p. 74, 79, 83, 86, 90-99 : María Aparicio • p. 105 : Wang Bing • p. 106-107 : Caroline Champetier p. 108-109 : Sun Zhao
FIDMarseille
14, allée Léon Gambetta 13001 Marseille edition@fidmarseille.org
Achevé d’imprimer en septembre 2024, sur les presses de l’imprimerie PBtisk a.s., Pribram, République Tchèque
© FIDMarseille, 2024
Dépôt légal : septembre 2024 • isbn : 978-2-9595835-0-6
Hervorgeholtes vergegenwärtigt, Patrick Holzapfel
De Facto, Selma Doborac
Ugly Duckling Anarchism, Laura Staab
Losing Faith, Martha Mechow
Die erdzugewandte Seite der Geschichte, Patrick Holzapfel
The Diagonal Force, Annik Leroy et Julie Morel
Reality Hunger, Adrian Martin Reality, Tina Satter
Something That Becomes Different All the Time, James Lattimer
Trenque Lauquen, Laura Citarella
A Genre of Its Own, Giovanni Marchini Camia
The Temple Woods Gang, Rabah Ameur-Zaïmeche
De Facto
(Selma Doborac, 2023)
Patrick Holzapfel
Nachdem Darsteller Christoph Bach minutenlang in atemloser Geschwindigkeit subjektive Berichte grausamster Verbrechen herunterrasselt, hält er plötzlich für einen kaum merklichen Augenblick inne, um zu schlucken. Das widerfährt uns Menschen so, es ist unumgänglich. Wir müssen schlucken. Sein Körper kann nicht mehr, die Muskelreflexe im Rachen sind drängender als das, was er sagen will. Die Kamera, die sich ohnehin nicht rührt, bleibt unbeeindruckt auf ihn gerichtet. Wir sehen ihm zu, weil wir nicht anders können, so wie wir ihm zuvor zugehört haben, weil wir seine Zuhörer sind. Das Schlucken dauert nur eine Sekunde, einen Beat, wie man im Theater sagt, nur dass hier nicht rhythmisiert und erst recht auf keine Publikumsreaktion gewartet wird. Dann reiht Bach weiter in trockener Schärfe auf, was man als Passagen aus Täterberichten, Zeugenaussagen oder philosophischen Auseinandersetzungen mit Gewalt identifizieren kann. Er erzählt von begangenen Untaten, ordnet ein, rechtfertigt, kratzt an den Grenzen der Moral. Wir hören weiter zu. Wir können nur zuhören oder wegrennen. Und Bach spricht weiter. Sein Körper dient dem Text, gibt sich der stumpfen Abfolge kaum fassbarer Worte hin und man fragt sich, was passiert in einem Körper, der solche Worte sagt, was bleibt zurück von der Sprache auf einer Zunge?
Er sitzt in einem lichtdurchfluteten Pavillon im Pötzleinsdorfer Schlosspark im 18. Wiener Gemeindebezirk, Sigmund Freud hat hier seine Sommerfrische verbracht,
aber das spielt keine Rolle. Psychologie spielt keine Rolle, zumindest nicht die, die sie normal spielt in filmischen Auseinandersetzungen mit Kriegsverbrechern und Mördern. Selma Doborac führt in ihrem De Facto etwas anderes im Schilde: Ihr Film ist eine Studie des filmischen oder gar theatralen, körperlichen Hervorholens, das Gegenteil einer Verdrängung. Sie wagt, dort weiterzudenken, wo große Filmemacher, die sich mit der Repräsentation des Nicht-Repräsentierbaren beschäftigt haben, aufhörten. Und sie zeigt, dass tatsächlich noch nicht alle Fragen beantwortet wurden. De Facto zeigt ein unablässiges Umgehen der üblichen Fallstricke im Umgang mit Unmenschlichkeit. Ihr Film setzt weniger ein Verstehen (oder gar eine Identifikation) der Täter oder der Ereignisse voraus, als vielmehr ein strukturelles Denken, das versucht zu verstehen, wie Täter denken und argumentieren oder, um es größer zu formulieren, wie man über das Böse denken könnte.
Das Hervorholen entfaltet sich auf drei Ebenen, die alle eint, dass sie auf eine unbedingte Vergegenwärtigung zielen:
a - der inhaltlichen, textlichen Auseinandersetzung mit Tätern und deren Taten (Erinnerung)
b - den Körpern, die dieses Hervorholen praktizieren oder darstellen
c - der filmischen Arbeit an der Zeit
Bach sitzt nicht allein an einem verglasten Tisch im Pavillon. In den insgesamt sieben Einstellungen des Films sieht man ihn dreimal. Ihm gegenüber (oder zumindest am gleichen Tisch, die Perspektiven lassen einem hier im Unklaren) sitzt Darsteller Cornelius Obonya. Auch er spricht dreimal. Während die beiden sprechen, vergeht der Tag, das Licht schwindet, Wind kommt auf. Sie sprechen nicht wirklich miteinander, sind nie in der gleichen Einstellung zu sehen. Sie sind beide da, damit es nicht ein Gesicht,
eine Stimme ist, die man mit den Verbrechen assoziiert, zu denen man eine Beziehung aufbauen kann. Sie sind nur Körper und nicht mal das ist sicher. Ein wenig arbeitet der Film wie ein philosophischer Dialog der Antike oder wie ein Stück von Samuel Beckett: Es wird in ein Vakuum gesprochen, aber dieses Vakuum ist die Wirklichkeit, das Jetzt; das Vakuum sind wir, die zuhören. Der strapazierte Begriff der Zeugenschaft dehnt sich bei Doborac aus, denn nicht mehr nur die Berichtenden zeugen von etwas, sondern wir bezeugen das, was sie sagen. Mit wenigen Ausnahmen (etwa das eingangs geschilderte Schlucken) kommt diese Form der Repräsentation ohne die verführerische Kraft von Bildern aus. Hier gibt es keine Reue, keine ausgestellte Überlegenheit, keine körperlichen Elemente, die einen ablenken könnten, wie das durchaus vorkommt, wenn man sich die Aussagen der Angeklagten von beispielsweise den Nürnberger Prozessen ansieht. Hier gibt es nur eine Reduzierung, die uns die üblichen Fluchtwege verstellt. Die Texte sind eine von der Filmemacherin verfasste Verdichtung mehr oder weniger bekannter Dokumente. Wir hören bearbeitete Versionen dessen, was Naziverbrecher vor Gericht gesagt oder was Soldaten niedergeschrieben haben. Doboracs Umgang mit den Quellen ist nicht an Wissenschaftlichkeit interessiert sondern an einer Wahrheit, die aus dem Material der Sprache gewonnen wird, aus dem Übergreifenden und Gemeinsamen unterschiedlichster Texte aus verschiedenen Zeiten und kulturellen Zusammenhängen. In der letzten Einstellung zeigt der Film den Pavillon aus einer gewissen Distanz, braungoldene Gräser im Park und dazu lärmende Musik. Ist das eine Einladung zu atmen oder endgültiges Kippen in den blanken Horror?
Die inhaltliche Auseinandersetzung mit Tätern und deren Taten ist hier von einem geradezu wagemutigen Ansatz geprägt: Doborac lässt keinen eindeutigen Rückschluss darauf zu, wessen Aussagen hier
hervorgeholt werden. Ob Naziverbrecher, Anders Breivik oder US-amerikanische Soldaten, der Film lässt all diese in Texten und Aussagen kanalisierten Erfahrungen in eine einzige fließen, einen Strom, in den sie uns wirft. Statt in die herkömmliche intellektuelle Übung der sauberen Trennung zwischen verschiedenen geschichtlichen Ereignissen zu verfallen, sucht sie nach dem, was all diese Dinge womöglich gemeinsam haben, eine, wenn man so will, universale Sprache der Täter. Man könnte sich ein solches Vorgehen von einer KI vorstellen, aber in De Facto ist es Doboracs jahrelange Recherche, die das zusammenführt, was getrennt womöglich nur in einem luftleeren Raum weiter mit den immergleichen Slogans abgearbeitet wird. Das ist ein notwendiger Schritt für das Kino, denn das, was gesagt wird und gesagt werden darf, verschiebt sich mit der Zeit. Dazu kommen die neuen alten Verbrechen. Das Kino braucht sich anpassende Wege, keine Gewissheiten. Der in politischen Diskursen oft bemühte Vergleich zwischen verschiedenen Verbrechen droht ein Holzweg zu sein. Er führt oft zu keiner Erkenntnis, dient viel eher einer Stigmatisierung, man denke nur an die zahlreichen Holocaust-Vergleiche. Das sind sich abnutzende Totschlagargumente, die die eigentlichen Verbrechen aus ihrer Zeit nehmen, die einen Grad der Heftigkeit anzeigen, nicht aber das, was eigentlich passiert oder gar wie man es verhindern könnte. Doborac trachtet hier nach dem Gegenteil, sie zieht keine Vergleiche sondern denkt zusammen. Könnte man hier von einer utopischen Hoffnung sprechen? Wenn wir verstehen könnten, was all diese Täter gemeinsam haben, könnten wir ihre Taten in Zukunft verhindern?
Trotzdem ist das Zusammenführen dieser in verschiedenen Kontexten begangenen Taten strenggenommen unmöglich, einzig Doborac setzt uns einer derartig rastlosen Flut an Sprache und Gedanken aus, dass nie der Eindruck entsteht, sie würde hier Figuren erschaffen, die etwas repräsentieren.
Keiner ihrer Darsteller gibt den ultimativen Täter. Ihr Protagonist ist vielmehr die Sprache selbst, das Gesagte, das hier keine einfachen Rückschlüsse mehr zulässt auf das, was gesagt wird. Die inhaltliche Arbeit obliegt demnach uns. Da der Film eine bewusste Zumutung ist, beginnt man zu filtern. Man setzt sich aus oder flüchtet in sich selbst, bleibt aufmerksam oder nicht. Was kann man hören? Verstümmelung, Vergewaltigung. Was kann man ertragen?
Der Film hinterfragt so die Mechanismen hinter der gleich eines Mantras geforderten Erinnerungsarbeit in westlichen Kulturen. Nicht das bloße Erinnern, Hervorholen ist entscheidend, sondern auch die Art und Weise, in der das geschieht. Wenn Erinnerungspolitik ihre Gegenstände historisiert, wird sie obsolet. Indem Doborac ihre Quellen nicht offenlegt und man so nie weiß, von welchen Gräueltaten gerade berichtet wird, bringt sie eine so wichtige Verunsicherung zurück in den Akt des Zuhörens. Für gewöhnlich assoziiert ein gebildetes Publikum, sobald es hört, dass da gerade vom Holocaust oder vom Bosnienkrieg oder von den Roten Khmer gesprochen wird. Es interpretiert das Gesagt auf ein bestimmtes Vorwissen hin. Fällt diese Gewissheit weg, muss man sich zu dem verhalten, was man hört und sieht, nicht zu dem, was man weiß oder zu wissen glaubt. Das ist selbstredend kein zu empfehlendes Standardprozedere für Erinnerungsarbeit, vielmehr ist es ein genuin filmischer Ansatz, um etwas begreifbar zu machen, was sich sonst entzieht. Der intellektuelle Kurzschluss wird hintergegangen, stattdessen verbleibt die ganze abartige Komplexität von Menschen.
Doborac aber zeigt keine Menschen, Menschen existieren bei ihr nur im Text. Die Darsteller sind etwas anderes, Textkörper könnte man sie nennen. Der Körper des Schauspielers wird hier als Instrument des Hervorholens betrachtet. Anhand dieser beiden Darsteller, die man eigentlich nicht aus solch ernsten Stoffen auf der Leinwand
oder dem Bildschirm kennt, zeigen sich die Grenzen der Repräsentation oder NichtRepräsentation. Denn ein menschlicher Körper ist immer ein Bezugspunkt, egal wie schnell und monoton und abwesend die Texte gesprochen werden, sie werden menschlich. Der Abstand zwischen der Wirklichkeit der Aufnahme und den gesagten Wörtern fällt in sich zusammen. In dieser Hinsicht ist De Facto auch ein Dokument des Nicht-Spielens, des unbedingten Vermeidens jener Regungen, die vom Gesagten ablenken. Dieses Dokument zeigt ein mögliches Scheitern an, denn das Schlucken zwischen den Sätzen, das Umrücken der Sitzposition, die kleine Handbewegung, das alles lässt die Texte nicht neutral erscheinen, schafft doch einen individuellen Charakter vor unseren Augen. Aber der Widerspruch löst sich ein, denn der Fokus liegt hier nicht auf dem Sprechenden sondern auf unserer Begegnung mit ihm. Im Hors - champ löst sich das Diktat der Repräsentation auf. Die Grenzen des NichtSagbaren verschmelzen mit den Grenzen des Nicht-Darstellbaren. Denkt man an berühmte Täterdarstellung im Kino, etwa Bruno Ganz als Adolf Hitler in Der Untergang oder jüngst Christian Friedel und Sandra Hüller als KZ-Vorsteher und dessen Ehefrau in The Zone of Interest, zeigt sich, dass die Obsession mit der Ähnlichkeit, und dem sogenannten Authentischen nicht abebbt. Aber was wird wirklich sichtbar, wenn jemand ähnlich aussieht oder ähnlich die Zunge rollt oder sich die Haare ähnlich kämmt wie dieser oder jener Täter? Verschwinden dann nicht die Menschen, die spielen, hinter denen, die sie spielen? Sehen wir dann nicht immer das gleiche, nämlich das der Täter ein Mensch ist? Müssten die Darsteller nicht zwischen die Täter und uns treten, um uns etwas begreifen zu lassen über das Wesen der Tat?
Sobald man in De Facto glaubt, eine Figur vor sich zu haben, fällt sie in sich zusammen. Das liegt daran, dass die statische Kamera und die langen Einstellungen nicht eine
perfekte Wiedergabe aufzeichnen, sondern den Akt des Sprechens selbst (samt Stotterern, kleinen Fehlern und so weiter). Was man also ausschließlich sieht, sind Christoph Bach und Cornelius Obonya, zwei Darsteller, die den Text im Jetzt sprechen. Sie sind diejenigen, die uns den Text überliefern. Daher auch die Frage nach ihren Körpern, wie es ihnen ergeht, wenn sie diesen Text sprechen. Diese Frage mag ein bisschen naiv sein für einen professionellen Schauspieler, aber sie ist das, was die Darsteller hier mit uns teilen: Das Erleben dieses Textes. Nicht die Darstellung einer Vergangenheit oder die Identifikation mit einem Gedanken.
Während die Darsteller monologisieren, vergeht ein Tag. Das Licht wandert. Immer wieder hört man Geräusche aus der Umgebung, sieht kleine Bewegung im Hintergrund. Gerade weil ein Wind in den Baumwipfeln weht, während die Worte der Täter erschallen, zeigt sich die Gegenwärtigkeit und Gleichzeitigkeit als Kraft filmischen Ausdrucks. Diese Berichte von Vergewaltigungen und Morden sowie ihre philosophisch-psychologische Einordnung gehören der gleichen Wirklichkeit an wie vorbeiziehende Wolken. Keine Chance auf Verdrängung, nicht die üblichen Atempausen, Fluchtangebote oder dramaturgischen Kniffe, um verdaulich zu machen, was einen kotzen lassen sollte. Nur ein kurzes Schlucken des Darstellers, eine physische Grenze für einen psychologischen Abgrund. Selbst die Musik am Ende ist Lärm. Hier wird ein Zustand gezeigt, keine Geschichte. Anders formuliert: Mehr noch als die Sprache vergangener Verbrechen aufzuzeichnen, zu bewahren, geht es Doborac darum, in einem abstrakt-gebauten, aber mit der Wirklichkeit im Austausch stehenden Setting, von dem zu berichten, was man nicht so einfach als Geschichte abheften kann. Oder noch simpler: Dieser Film lässt sich wie eine Schablone auf Genozide, Kriegsverbrechen oder Reden von Diktatoren legen. Er beinhaltet eine gleichbleibende Wahrheit. Sie zu erkennen, ist die Arbeit des Films. Sie
zu unterbinden, läge an uns. Dass man diese vom Film evozierte Zeitlichkeit nur erlebt, wenn man sich die komplette Dauer (sowohl einer Einstellung als auch des gesamten Films) aussetzt, ist in der heutigen Zeit fast ein Anachronismus. Zuhören ist ein Anachronismus. Gleichzeitig aber erinnert genau dieses Ausgeliefertsein an die eigentümliche Kraft des Mediums. Man hört zu und erlebt so selbst körperlich, was es bedeutet, sich bewusst zu werden, zu was Menschen fähig sind.
Und doch fragt man sich, wozu all diese Worte, wozu dieser wiedergekaute Schwall der Gewalt? Vielleicht erkennt man in der dem Film folgenden Stille einen Frieden, den es zu verteidigen lohnt.
Mechow, 2023)
Laura Staab
I don’t know how to desire it fully, but I can’t wait to see what comes after the family.
Sophie Lewis, Abolish the Family (2022)
Someone tells you a debut filmmaker, only nearly thirty, has made a film about family abolition. Martha Mechow, the newcomer in question, has come to cinema from writing and directing for the Völksbuhne, a Berlin institution with histories of breaking from tradition to present avant-garde theatre to the masses. She has been credited before as Martha von Mechow, but now the ‘ von’ (an indicator of noble heritage) is missing What does a film about family abolition by Martha Mechow look like? Surely she embraces the radical project, with that seditious gesture and those leftist associations Yes, you think confidently to yourself, the film is likely antifamily and other heteronormative binds: hopeful for alternative ways of loving and living, excited about that future to come.
Losing Faith begins on a cold, dark night in an apartment in Berlin Thanks emanate from the television: “… and my mom,” gushes one grateful daughter in an American accent “… you sacrificed so much.” That heartfelt dedication clashes with what the spectator sees. Were that nice girl on television at all able to read the room, she would understand that the time of maternal sacrifice and filial gratitude is over. Before the screen , an enervated mother lies horizontal on the sofa. While a tiny tot is soothed by a baby rocker,
her older sister stands drawing at a small table “Mama, look,” urges the little artist “Mama, look here quick. Now! Mama! Mama! Mama!” Mama does not look here, now, quick — instead muttering something about the preferable existence of inanimate carpet. Then she disappears, dematerialises into nothingness, as if the void would be better than this.
Sophie Lewis, a prominent theorist of family abolition, “can’t wait to see what comes after the family.”1
Mechow ’ s first film is not naïve about it; without coordination, what comes after the family is chaos In the scene after Mama vanishes, abandoned children congregate in a deranged song and dance. Where the camera was static in the sapped prologue, now it is agitated . Handheld , it zigzags through a jumble of performers who grin, gurn, and gangle to tormented words: my mother doesn’t like me / and I don’t have a sweetheart / and why don’t I die? Lest these urchins dream of reunion with their mothers, a hacked- off woman later takes a chainsaw to a statue of the Madonna and Jesus Severing infant child from maternal bosom in one spiked swoop, the heretic – who exhales in almost ecstatic relief – makes definite the state of mothers and children in Losing Faith They are untethered from each other They are free.
Some characters celebrate this familial emancipation, throwing themselves into casual collective living in a bohemian commune, ironically named Barranconi Mother- Child Resort Fun! But Flippa, our sceptical protagonist, is indignant about it all. “ What kind of a plan”, the spoilsport asks, “ is this?” In German, Losing Faith takes the title Die Ängstliche Verkehrsteilnehmerin, ’The Anxious Road User‘ . Flippa is true to both the English and the German: a sceptic, but nervous. Abandoned by her mother, then later by her sister, Flippa must
navigate late adolescence without the structure of the family No one handed her any exuberant ‘manifesto for care and liberation’ (the subtitle of Lewis’s book) as a map to follow before they left. No substitute for the family has materialised since : no alternative companionship, community, or belief. While Mechow makes a carnivalesque comedy rather than a sardonic tragedy of flummoxed Flippa – aligning, here, with someone like Ulrike Ottinger more than someone like Lars von Trier, although both comparisons hold — the director also takes those stresses seriously Flippa has no direction for how to love or to live
Poor Flippa. That her mother never wanted to mother her is obvious just from her name Not Fi-lip -pa, but an abbreviated Flip -pa – homophone in German for Flipper, pinball, and proximate to flippen and ausflippen, to flip and freak out Was the first ‘i’ forgotten in indifference to the newborn child? Was it held back from the sprog, all grabbing hands, so that the mother could better write ‘ich’ for herself ?
In the role of Flippa, Selma Schulte-Frohlinde embodies motherlessness remarkably well, with ugly- duckling unsophistication; her head, for instance, often lolls to the side, as if no one propped it up in Flippa’s formative years Mechow, for her part, exposes so many symptoms of unkempt adolescence in extreme close -ups. Acne, bad mascara, and bitten nails in those of Flippa’s face. Scuzzy pink paraphernalia for half - hearted grooming and smoking in those of a bedroom floor. Among bubblegum- coloured mess, Flippa writes through the lost feelings, as teenage girls do What ’i ‘there is in her mangled name, she wants someone to dot it with a heart in a love letter
Poor Flippa. This is not a girl embracing premature independence with glee. While ’losing faith ‘ can of course be beautiful — the exciting beginning of the better or the new
1 Sophie Lewis, Abolish the Family: A Manifesto for Care and Liberation (London and New York, NY: Verso, 2022),
this teen is discontent, and demands answers Nothing is beautiful about being alone like this, she seems to insist throughout the film, which vivifies that unease with the scratchy astringency of Hi-8, a discontinued medium associated with television and amateur video from the 1980s to the 2000s. All of the neon colours and freaky performances pop candidly via its imagery; so too does the tetchy disillusionment of a forsaken girl
Happiness is just a colour for her, just the smiley face on the tote she carries around Before long she carries it from Berlin to Sardinia to find her older sister Furia. There, at Barranconi Mother-Child Resort, she finds a coven of women who are suspicious of truth, because it “describes a world that has lost its validity ”. You would think a nominal sisterhood of doubters would make a good match for Flippa. You would think wrong. Flippa craves answers, not more mistrust
Not one to be taken for a damn fool, Flippa confronts Rumpel, the woman in charge of Barranconi This is not “a real sanatorium,” an angry Flippa says. This is no place of healing Profane musings about the snake in Eden (more clever than sinful) and the immaculate conception ( joyless) — that is one thing, those are cute moments of conspiratorial amusement Joke provocations about neglecting to teach children, and in so doing nurturing an illiterate people, an impotent workforce – that is another thing, animated by anti - capitalist and antipatriarchal sentiment. But what about care? And what about new visions of love? Absent of that, Flippa would rather read Jane Austen: perhaps a classic novel called Persuasion will do better than this
Through our orphaned heroine Flippa , Losing Faith is agnostic about a fledgling feminist anarchism that is all chainsaw, no persuasion and no plan. So we won’t give care as biological mothers to entitled children — fine, good, whatever; what comes
after that? For Flippa, the Barranconi alternative of haphazard hanging around is a bad substitute, so much so that she is drawn back to old knotty heterosexuality come the end of the film And soon that unravels Even “love cannot save” heterosexual attachment, Flippa concludes. And so she is alone again.
Another film of optimistic tendencies would have had a different ending: Flippa settles in Sardinia, surrounded hopefully by a new sisterhood, with or without Furia. But Flippa is unpersuaded. Losing Faith closes with that open-ended gesture common to coming-ofage films — the girl walks into the horizon, without knowledge of what the future will hold – and it is an image with a double meaning here Growing up is awkward and ambiguous, sure, but the throes of social change are more awkward and ambiguous still
The Diagonal Force
(Annik Leroy, Julie Morel, 2023)
Patrick Holzapfel
Zunächst habe ich nicht ganz verstanden, warum Annik Leroy und Julie Morel in ihrem La force diagonale so penetrant nach jenem Moment suchen, in dem sich die von der Geschichte zurückgelassene Einsamkeit der Welt in Gesichtern und Landschaften zeigt. Warum sollte es interessant sein, die ans Gegenwärtige gefesselte Kunst des Films, auf etwas aus dem Vergangenen ins Zukünftige Ragendes zu richten? Warum das filmen, was man nicht mehr oder noch nicht zeigen kann? Warum diese schwarzweißen Bilder einer sich auflösenden Zeit? Dann habe ich langsam begriffen. Ein Echo drang aus dem Film zu mir, in die Welt, in der ich lebe. Das Echo europäischer Geschichte, fragmentiert und verloren. Das Echo von Individuen, die zur Veränderung gezwungen wurden. Ein Echo, das auch aus der Vergangenheit in die Zukunft schallt.
Ich habe den gefilmten Menschen gelauscht, die aus dem Off von jenen Augenblicken berichten, in denen sich ihr Leben veränderte: Explosionen, Begegnungen, Eingebungen. Eine Tramfahrerin aus Sarajevo, deren Straßenbahn von einer Bombe getroffen wurde. Ein in Belgien aufgewachsener Mann, der sich als Eremit und zwischen Büchern aus der Welt zurückzieht. Ein schwuler Immigrant aus dem Kongo, der in der Musik eine eigentliche Heimat findet. Sie alle sind Ausgestoßene, die sich wieder zurück in ein würdevolles Leben gekämpft haben, Beispiele für einen Kurswechsel, eine Neugeburt aus den Widrigkeiten. Ich habe die Nahaufnahmen ihrer in eine Unbes-
timmtheit (ob sie zurück oder nach vorne schauen vermag ich nicht zu sagen) blickenden Gesichter studiert. Ihre Falten sind Spuren im Sand, aber der Wind trägt die Spuren mit dem Sand weiter. Ich habe der kratzigen, nach Präzision lechzenden Stimme Hannah Arendts gelauscht, auf deren Konzept einer diagonalen Wirkkraft der Film und sein Titel basieren. Es ist eine von Franz Kafka inspirierte Metapher für das Verbindende zwischen dem, was war und dem, was sein wird. Kafka beschreibt in einer Geschichte zwei an ihm nagende Wirkkräfte, eine, die ihn zurückzieht und eine, die ihn nach vorne drängt. Er will sich befreien, sodass die beiden Kräfte, die sich letztlich auch gegenseitig bekämpfen, aufeinander losgingen, während er dem ganzen als Schiedsrichter beiwohnen könne. Arendt geht es um das aus diesem inneren Ringen Entstehende, was uns ins Denken und ins Handeln bringt. Ich habe den spielerischen, sich befreienden und doch verlorenen Bewegungen Claire Vivianne Sobottkes beigewohnt, die hier eine Idee von Arendt spielt, das heißt, sich immer wieder neu zusammensetzende Ansätze zu einer RePräsentation der deutschen Philosophin und deren eigener Fluchtgeschichte als Jüdin. In den performativen Bewegungen Sobottkes wird die Kraft sichtbar, die es braucht, um denken zu können. Sie spielt Arendt nicht, sie leiht ihrem Geist einen Körper. Dieser Körper changiert zwischen dem, was gesagt werden kann und dem, was uneindeutig bleibt. Ein Körper, der sich immer neu zusammensetzt und immer weiter zerfällt.
Ich habe mich in den disparate Strömungen, denen der Film mit der Lust am Festhalten, am Nachspüren folgt, verloren. Manchmal wurde ich berührt, manchmal aufgewühlt. Aber etwas blieb mir lange verborgen. Ich glaube, das dass mit einer inneren Abstumpfung gegen die allgegenwärtige Vergeblichkeit menschlichen Strebens zu tun hat. Das Geschichtsgefühl kann man
verlieren. Das ist eine Tatsache, die sich in der endlosen Wiederholung der gleichen politischen und gesellschaftlichen Verbrechen äußert. Es ist wohl so, dass es einen Sieger gibt im Kampf zwischen Vorwärtsstrebenden und Rückwärtsblickenden. Walter Benjamin hat ihn in Paul Klees Engel der Geschichte entdeckt, zurück bleibt ein Trümmerhaufen, bei dem man längst nicht mehr weiß, was unter den obersten Schichten liegt. Ich befürchte, dass ich mit diesem Gefühl oder fehlenden Gefühl, das man als Ohnmacht oder Orientierungslosigkeit beschreiben könnte, nicht allein bin. Natalia Ginzburg schrieb von einer in ihr entstandenen Notwendigkeit, sich vom Weltgeschehen abzuwenden. Das wäre ihre Art, sich der Welt zuzuwenden. Aber sie fühle sich sehr ambivalent damit. Nur scheine ihr alles, was den Menschen heute wichtig wäre, so oberflächlich und falsch. Paul Valéry schrieb einmal: “Wir müssen wieder mehr Elfenbeintürme errichten”. So sehr mir diese Ansätze einleuchten, sie entsprechen nicht der von Arendts Gedanken getragenen Haltung des Films. Statt der Flucht ins Ich, geht es den Filmemacherinnen um ein kollektives Handeln. Statt der Aufgabe, soll eine aus dem Denken entstehende Handlung regieren.
Dann habe ich Roger gesehen und wirklich verstanden. Roger ist ein Mann in Harmonie mit den Steinen. Die Filmemacherinnen filmen weniger ihn als seine Bewegungen durch eine Felsenlandschaft. Die Kamera verliert sich fast im Gestein, die Proportionen aus Körper und Natur verändern den Blick. Ich habe begriffen, dass der Film von mir verlangt, anders zu sehen, anders wahrzunehmen. Ich wurde aufgefordert, diese Zeit und diesen Raum mit Roger zu teilen, mit Rogers Sicht auf die Dinge. Die Filmemacherinnen zeigen Rogers Hand, die über Steine fährt, sich an ihnen festhält. Der Blick führt durch eine von Zeit geformte Landschaft, kleine Korridore öffnen sich, durch die sich der Mann zwängt. In diesem schroffen Gelände offenbarte sich eine
Zeitlichkeit, die nichts mit meiner Vorstellungskraft von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu tun hat. Denn die Erosion ist ein Prozess, der lange vor einer menschlich begreifbaren Zeit begonnen hat und weit über diese hinaus in die Zukunft fortdauern wird. Die im anglophonen Kontext oft als deep time beschriebene Form der Zeitwahrnehmung meint jene Prozesse, die das menschliche Wirken (und vor allem ein einzelnes, mickriges menschliches Leben) als kaum ins Gewicht fallendes Tröpfchen auf dem Planeten begreift. Morel und Leroy begreifen sich mit Roland als Petrologinnen oder als nach verborgenen Schichten grabenden Archäologinnen. Sie legen den Trümmerhaufen frei. Aus dem was war, schließen sie auf das, was wird oder zumindest kommen könnte. Das deleuzsche Zeitbild wird so nochmal anders gedacht. Der Trotz der Steine, die Beharrlichkeit ihrer langsamen Auflösung, die metamorphotischen Fähigkeiten (nicht umsonst schrieb Ovid oft von Menschen, die in Steine verwandelt und von Steinen, die zu Menschen geformt werden) dieser laut offizieller Definition Nicht-Lebewesen verdeutlichte mir, dass hier tatsächlich eine unsichtbare Kraft wirkt, die das Leben auf diesem Planeten bestimmt. Sie hängt letztlich an einer Art und Weise die Dinge zu betrachten und der Film führt diese mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln vor: Zeitlupen, Wiederholungen, Stille, Dauer, Nähe, Ferne. Nur wer anders sieht, kann auch anders denken, kann auch anders handeln.
Das, was die gezeigten Schicksale verbindet, ist auch eine solche diagonale Kraft. Sie greift nämlich über das Individuelle ins Zwischenmenschliche über. So wie Arendt auch aus ihrem persönlichen Lebensweg als verfolgte Jüdin auf größere, allgemeingültigere Fragen schloss, beginnen die unterschiedlichen Lebensgeschichten miteinander zu korrespondieren. Es formt sich das Bild eines Gemeinsamen im Verschiedenen. Diese vom Film evozierte Kraft
erinnert an die assoziativen Stränge eines W.G. Sebalds, ein mit der Sensibilität des Films verwandter Schriftsteller, der dem durch Verdrängung und Vergessen angefeuerten, entlang seiner eigenen Auslöschung torkelnden europäischen Kontinent literarisch beiwohnte. Aber im Gegensatz zum das Ende der Geschichte vorausahnenden Autor, suchen Leroy und Morel nach Strategien diese fortzuschreiben, gar zu verändern.
Diese Strategien entstehen zwischen Kamera und aufgenommener Wirklichkeit, sie verteidigen das Kino als Stätte einer sich gegen das scheinbar Unabwendbare richtenden, anhaltenden Revolution. Dieser Begriff ist nicht leichtfertig gewählt, war es doch Arendt, die in ihrem „Über die Revolution“ vom für die Zukunft entscheidenden Potenzial der Revolution (die der Freiheit der Menschen verpflichtet ist) geschrieben hat. Die gemeinten Revolutionen beginnen im Individuellen. Die vier porträtierten Menschen (mit Arendt sind es fünf wie die Finger einer Hand, die nicht umsonst mit der Handlung verwandt ist) finden trotz widriger Umstände ihre Würde, die die Filmemacherinnen auch deshalb greifbar machen, weil sie weniger erzählen, als das sie zuhören und zuschauen. Die Kraft kommt stets aus den Menschen, nie aus manipulativen filmischen Mitteln, die man aus Dokumentarformaten kennt, die sich sonst mit vom Schicksal gezeichneten Charakteren beschäftigen. In dieser Hinsicht strebt La force diagonale selbst danach, zu einem denkenden, Zeit und Raum respektierenden Werk zu werden, oder noch eher: Dazu einzuladen, den Menschen und Landschaften fühlend und denkend zu begegnen. Statt wie ein Stein kann man all diesen sich zu einem gemeinsamen Bild formierenden Eindrücken gelebter Leben begegnen, wie man einem Stein begegnen würde. Der Unterschied ist sprachlich gering, aber er ändert alles.
In einer Welt, die längst vergessen hat, dass die Grundbedingung jedes denkerischen und folglich auch revolutionären Prozesses im Innehalten zu finden ist (und nicht in der blind ausgeführten Handlung oder hastigen Meinungsbildung), fragt der Film, wo und wie ein solches Innehalten stattfinden könnte. Das ist utopisch, aber es ist auch die einzige Möglichkeit, den diagonalen Weg auch filmisch zu bestreiten. Mit Arendt könnte man sagen, dass Leroy und Morel Oasen filmen.
Als ich den Film ein zweites Mal gesehen habe, ist mir erst aufgefallen, wie auch die Filmemacherinnen innehalten, Räume öffnen, ihren Protagonisten Zeit und Aufmerksamkeit schenken und uns damit die Möglichkeit geben, das Gleiche zu tun. Es ist dabei kein zu unterschätzender Widerspruch, dass das Innehalten im fortlaufenden Zeitmedium Film, zumal in einer von Bildern bis zur Erstickung berauschten Welt, gesucht wird. Vielleicht könnte man das nur selten synchrone Zusammenspiel von Bild und Ton im Film auch so verstehen: Die Stimmen der Protagonisten halten die Bilder auf, die Bilder unterbrechen die Erzählungen. Was dann bleibt ist die Bewegung, die Franz Kafka laut Arendt nie finden hätte können, weil er vorher vor Erschöpfung gestorben wäre. Es ist das Rattern des Films in Kamera und Projektor, die Kraft, die es braucht, um die Kamera einzuschalten oder einfach aufzustehen, weiterzuleben und aus dem Gefüge der nur angeblich vorbestimmten Zeit auszubrechen.
Adrian Martin
A phrase became popular among film critics and scholars in the mid 1980’s: the line between documentary and fiction. The point of it being that this line often proves extremely difficult to draw within particular films — and impossible to rigidly define as a general, theoretical principle of cinema. The line keeps shifting, wildly, and has never ceased doing so.
The initial impetus for this probe in the 80’s came from the striking appearance of a new kind of essay-film associated with, to take a prime example, the work of Jean-Pierre Gorin (Poto and Cabengo [1980] and Routine Pleasures [1986]) — highly discursive films navigating between stylised treatments of documentary footage and other, more staged material, including a liberal use of clips/ quotations from other films, and all driven by a witty and erudite voice-over narration from Gorin himself.
But there were other paths evident in what filmmakers were doing, and how they were broaching this seductive space between documentary and fiction. In Australia, the experimental, unflinching psychodramas of Peter Tammer — patiently filming an old soldier recalling (and re-living) his wartime experiences (Journey to the End of Night, 1982), or an actor losing himself within a role (Fear of the Dark, 1985) — were filled with an intense, moment-to-moment fictional intrigue, even as the basic set-up revealed its staged (or ’prompted‘) artificiality.
In the literary world of 2010, David Shield’s manifesto Reality Hunger caused a stir by calling for greater and more disconcerting injections of “raw” reality — through, for
instance, the use of bald appropriation — into hybrid prose forms. In cinema, television, and video art, such reality hunger latched onto a somewhat different desire: a yearning for the textures of reality — openended time duration, unframed takes, microscopically observed behavioural traits, improvisation and unforeseeable happenings — in a way that radically dissolved the usual priorities of fiction (such as closure, focus on a central figure, and emotional identification with characters). The vast genre of ’Reality TV ‘adopted, for better and for worse, this same desire for openness — while circumscribing it within ever-more rigid and repetitive televisual formats.
None of this was entirely new, of course. The psychodramas of John Cassavetes, Norman Mailer, or (in his early phase) Robert Kramer had already jazzily blurred the line between documentary and fiction. Jean-Luc Godard, Agnès Varda, Chris Marker and Joris Ivens had pioneered sophisticated essayistic forms (and would continue to do so until their dying days). Frederick Wiseman declared that he intended his documentaries to be every bit as enthralling, structured and stylised as fictional films.
One of the most significant moments in the subsequent history of this entire discussion, and its reflection in filmmaking practice, coalesced around the notion of re-enactment. From Peter Watkins ’imagining of TV-style reportage crews anachronistically roaming the scenes of historic events (Edvard Munch [1974], La Commune [2000]) to the œuvre of Elisabeth Subrin (Shulie [1997], Maria Schneider, 1983 [2022]), re-enactment frequently opened up a double referent: a real event was alluded to and even minutely recreated but, at the same time, layered upon it was the recreation of a media artefact, in all its technological and material details: camera lenses, film stock or video tape, sound recording and mixing practices. Films by Errol Morris, Oliver Stone (particularly JFK [1991]), and subsequently much non-fiction
TV programming (especially in the “true crime ”genre), took up this mode of depiction.
In recent memory, Tina Satter ’ s Reality (2023) marks one of the most intriguing incursions of mainstream cinema onto the terrain of the shifting line between documentary and fiction. In its scope and texture it has the feel of a typical “American independent” production; but it received the support of actor Sydney Sweeney, who takes the leading role, and enjoyed a wide release that spanned film festivals, theatrical venues and TV streaming (HBO).
Reality has effortlessly attracted many different, even conflicting genre labels: thriller, true crime drama, political essay, an exercise in “Lynchian surrealism” conceptual art re-enactment, a real-life reiteration of Franz Kafka ’s novel The Trial Reality, it would seem, managed to successfully exist between many lines, and to maintain its equilibrium among them.
The film imaginatively recreates a fateful day in the life of then 26-year-old Reality Winner, employed, at a high level of security clearance, by the National Security Agency (NSA) of the United States. On 3 June 2017, Reality, arriving in her car, was greeted outside her house in Augusta, Georgia by two FBI agents, Garrick (Josh Hamilton) and Taylor (Marchánt Davis), who were soon joined by a team. Armed with an official warrant, the team undertook an extensive search of Reality’s home, car, devices and belongings. As it takes Garrick and Taylor a while to divulge, they have arrived with already compelling evidence that, during the previous month, Reality leaked (via oldfashioned postage) a confidential NSA report concerning Russian tampering in the 2016 US election to a left-wing online news outlet, The Intercept
The entire time, from the first moment of this encounter to eventual arrest of Reality, the agents recorded everything on digital audio. The longest and most intense section
of this veritable inquisition takes place in a bare “spare room”. Consequent to her arrest, Reality was sentenced to five years and three months in federal prison. Her case became, in the public sphere, a magnet for rampant debates about the necessity of civilian “whistleblowing” versus the evil of national “betrayal”.
In 2019, theatre artist Tina Satter premiered, at New York’s The Kitchen, her stage production known in full as IS THIS A ROOM: Reality Winner Verbatim Transcription. The performance was entirely derived from the official FBI transcription of the audio file from 3 June — “acted out” solely on the basis of whatever dialogue and “stage directions” were indicated in that text.
Satter has declared that three things struck her from the first moment she read the transcript: that it begged to be performed aloud in one or many media (theatre, radio, film); that it inescapably evoked in her mind some well-known fiction films; and that a stylised convention of condensation employed by the transcriber — identifying all other agents at the scene, apart from Garrick and Taylor, as a single, undifferentiated “unknown male” — was chilling in its offhand index of the patriarchal power bearing down upon a young woman under suspicion.
Let’s pause on the greatest godsend of all for Satter, so obvious that she almost never feels the need to mention it in interviews: the very name of Reality Winner! It is so pregnant with meanings (dramatic, conceptual, ironic) that it has served not only this film titled Reality , but another, more comically-inclined biopic named Winner (2024) directed by Susanna Fogel.
The project would thus appear, from the outset, to be anchored in true facts — or, at least, those facts as duly documented by the FBI and subsequently rehashed through multiple mass media reportage (a 60 Minutes segment, the documentary Reality Winner
[2023], podcasts, and so on). Satter — like Anna Broinowski in her lively exposé Forbidden Lie$ (2007) — is doubtless enough of a fan of F for Fake (1974), however, to have heeded the ambiguity at the heart of much non-fiction that Orson Welles centrally structured his film-essay upon: can we truly trust, should we really believe, the “objective”, authorial proclamations (such as TV ’ s favourite printed prologue: “based on a true story… ”) that a movie emblazons in its opening frames? For Reality will subsequently take (as Welles did) some remarkable liberties with its own premise.
This liberty is clear from the film’s very first shot — especially if we pay forensic attention to the split-second way it ends. Satter statically frames a working-day tableau in the manner of Chantal Akerman, Kitty Green, or Cindy Sherman in Office Killer (1997): a row of cubicles, each person working on their computer, Reality in the centre of the image … but with the droning voices of the Fox News channel (reporting specifically on Trump ’s firing of FBI Director James Comey), beamed on ubiquitous monitors on the office walls leading-in before the image. It’s a neat encapsulation of a central theme that will be explicitly discussed by the characters later: the ceaseless barrage of media garbage that pushed Reality to her whistleblowing action.
But that’s not the most notable aspect of this prologue. Before it switches to the intertitle “25 days later”, the image flickers or flashes for just a frame or two: a glitch effect has been fleetingly superimposed, giving it the familiar feeling of digital decay or pixel breakdown. These glitch animations — provided by the film’s production designer, Tommy Love — will come to pervade the film.
This initial appearance of glitch has no apparent “motivation” in narrative or psychological terms (it will pick up these connotations later), but, in line with a major tendency in contemporary cinema,
it introduces a subterranean corrosion of the status of reality that works on several levels simultaneously. In the digital era of fake news and other mindboggling distortions of the truth, the film sets out to show an event whose reality is unstable for everyone — both for those directly caught in its net, and all of us who subsequently consume it via media representations.
I don’t know whether IS THIS A ROOM (the title is from a line spoken by one of the “unknown males” as he pokes around Reality’s home) followed a rigorous “real time” concept, but the film retains only the illusion or “vibe” of real time. While (like the play) respecting the self-imposed constraint of using only what is in the FBI transcript for the basic mise en scè ne, Satter’s screenplay (co-written with James Paul Dallas) uses blocks of the transcript with ellipses both between and within scenes. Satter frankly admits she grasped the “thriller” potential of the material — its capacity to grab and hold the spectator — on first reading. To that end, the film focuses on what Satter describes as the agonising “crack up” or meltdown of Reality as she faces interrogation — and the gradual realisation that her destiny has been forever altered by the events of this day.
What Anna Kornbluh has recently diagnosed as audiovisual culture’s version of Shields‘ “reality hunger” concept is evident in this arrangement of the material. In her book Immediacy or, the Style of Too Late Capitalism (2023), Kornbluh evokes many varieties of contemporary cultural immersion — in a TV stream, in a virtual reality installation, in a headlong or “you are there” aesthetic (her key example is the Safdies’ Uncut Gems [2019]). Satter, for her part, wants us as spectators to be inside Reality ’ s consciousness, to share her real-time crack-up — as she said to Why Now magazine, “ we can see parts of Reality ’s heart and her emotional map visualised”.1 On this level, the glitches work as a visualisation of
Reality’s subjectivity.
Satter also aimed to achieve a particular balance in the texture of the work. Referring to the occasional insertion of real FBI photos of Reality from the day, as well as her personal photos and material from her Instagram, Satter explains: “For me, it was always important to get some of those edges of the real Reality in there, but I never thought about it necessarily as a documentary … It’s a narrative feature with these real edges, there’s no official category”2.
As well as being a “narrative with real edges” Reality serves also as a re-enactment with strong fictional and cinematic resonances. The first time we see a massed group of six FBI agents, it is hard not to recall the tense POV shots from Clarice Starling’s perspective of a similarly oppressive male grouping in Jonathan Demme’s The Silence of the Lambs (1991). Satter has spoken of her projected as an inverted thriller: no guns handled, no shooting, chasing or killing — all dread is contained within the acts of verbal interrogation and the subtle physical containment of Reality.
When it comes to the shifting mise en scène of this restriction, there is a more elaborate trace of the stylistics Welles used in the opening, virtuosic scene of The Trial (1962) — bare room, wide angle lens creating spatial distortion and distension of the space, intense concentration of light, a choreography of bodies coercive and submissive, complete with sudden, nutty intrusions from agents appearing and disappearing at doorways.3
There is another level on which Reality becomes a reflexive commentary on the nature of acting and performance. As a reenactment, Reality sticks to the FBI transcript but it also, of course, adds a great deal of interpretive material: looks, gestures, postures, the characters shifting their weight, the precise timing of vocal delivery … not to mention everything that is generated by
the découpage of the editing, and the addition of Nathan Micay ’s generally minimal set of musical tones and “booming” sound effects — a compositional palette that is only expanded during the end credits.
By the same token, however, we quickly come to suspect that what the principal FBI agents were doing on that day constituted a preplanned performance following a definite procedure: every relaxed joke, every stutter or stumble, every bit of everyday banter about pets or health, every solicitous gesture extended toward Reality, are part of a ’script‘.
A former female FBI agent whom Satter interviewed for background research commented: “These kinds of visits, yes, it’s 100 percent acting”.4
There are several artful turns in the dispositif set up by Reality. The documented transcript becomes the basis for a re-enacted mise en scène; and then — in a surprising move that can at first seem counter-intuitive — that recreated fiction then forms the basis for displayed pieces of documentary evidence that punctuate the scenes, seemingly to authenticate what we are seeing and hearing. This particularly occurs with the constant visualisation of a “wav” audio file — on which we hear not the original, “real” FBI recording (Satter claims she never listened to it), but an acoustically thinner version of the professional actors performing the scene.
The “audio illusion” goes so far here as to cut between the sound of dogs barking within the filmed scene to the same noise continued in the wav file — a piece of “realistic” embroidery entirely added by Satter, since the FBI transcript makes no mention of such random, extraneous details. All the images of the wav file itself are, as it turns out, inventions of the film.
As often happens in cinema, it is this level of excess detail that guarantees the illusion of what Roland Barthes called the “reality effect” (effet de réel). Yet, on another level, Reality is devoted to drawing our atten-
tion, from the very first second, to the constructed, or more exactly unstable, nature of that illusion.
Another level of the film that plays between seeming realism and expressive stylisation is its recreation of the process of redaction or censorship as displayed in the FBI transcript. We can note, throughout, familiar devices (now frequent TV clichés) that “bring alive” static documents: the use of graphic animation to show, in “real time” as it were, the act of redaction (passages being blacked out), or the “desktop documentary” technique of seeing the words of the transcript as they appear typed, letter by letter. When it comes to missing, barred words (I wonder how these were signalled in the stage production?), Reality gets particularly inventive — and here is where we return to the matter of glitch.
There is a subversive tradition in cinema that “plays along” with censorship while also declaring it, to the spectator, as having occurred in precise spots. Jean-Luc Godard “covered over” censored, politically sensitive material with grating sound effects in several of his works of the mid to late 1960s. Luis Bu ñ uel turned this same device into a running gag in The Discreet Charm of the Bourgeoisie (1972). In the marvellous, Godardian-style satire of militant cinema made by Canada’s Dave (or D.B.) Jones in Australia, Yackety Yack (1974), a freewheeling discussion (inspired by Norman Mailer’s Maidstone , 1970) among the cast members rebelling against their authoritarian director is shredded in the montage with jump cuts — indications that this (fictive) director has later edited out the criticisms against himself! Brian De Palma’s Iraq-set Redacted (2007) builds an elaborate conceit built around censorship and its unmasking through fictive re-enactment.
Reality uses the glitch to a similar end. This animated special effect declares what is missing, leaving brief holes — this becomes its narrative function. Not only do the spoken
words disappear, but also the bodies of the actors — in a “puff of glitch”. The first time that it happens, well over 30 minutes in, is quite a shock for the spectator. Something that is almost completely invisible on screen has been revealed by Satter: that the glitches are, in part, heavily processed from Fox News images — hence looping back to their prefiguration in the very first shot. Satter refers to this as the film’s “weird resident secret”.
Let ’s conclude on the colour pink. There is a special form of colour coding used in the film’s overall design, very logical and systematic in its pattern, that is easy to miss on a single viewing. It is based on the association of the character of Reality with the colour pink (and its “family variations”). Early details casually link her to this supposedly “girly” colour through “Hello Kitty”- style objects, flowery writing paper, and so on. At a key moment of stylistic switching 60 minutes in, however, Reality emerges from a semi-conscious, dissociated haze to a clearly fantastic, subjectively imaginary performance of tough self-assertion right in the faces of the FBI agents. The exact switchpoint comes with the inserted shot of a Tor browser page — in purple. Then there are, across the subsequent shots, a series of apparitions of pink. It is during this fantastical interlude that Reality breaks the censorship regime that has been simulated up to this point, by speaking the previously glitched-out name of The Intercept
When we rewatch the film backwards and forwards from this scene, we see splashes of “hot pink” everywhere: for instance, in the crucial NSA document that Reality reads, and in the final intertitles — where Satter passes from the usual white-on-black for “objective”, journalistic facts to Reality ’ s own statement rendered in pink — and the subsequent major credits also appear in this colour, as if to pledge support of her!
1 - Maria Lattila, “Tina Satter on Reality: “I could feel the tension in the transcript”, Why Now website (UK), 2 June 2023, <https://whynow.co.uk/read/ tina-satter-reality-interview>.
2 - Lattila, ibid.
3 - Cristina Álvarez López and I have made an audiovisual essay titled Reality Trial (2024) that intercuts moments from both films. View it here: <https://vimeo.com/880203224>.
4 - Scott Macauley, “Tina Satter”, Filmmaker, 2022, <https://filmmakermagazine.com/ people/tina-satter/>.
Trenque Lauquen
(Laura Citarella, 2023)
James Lattimer
Laura’s already been speaking for the best part of an hour, she’s in the studio at the radio station as dawn approaches, recording a message for her colleague Juliana so that at least one person will know that it was her choice to disappear. We see her talking into the microphone that night, but we also see Juliana playing the message for Ezekiel, or rather Chicho, in the same place what must be some time later, now that Laura is indeed gone. These two threads intertwine with a third, as we see the things she’s describing too, all the strange occurrences she became ensnared in or she herself triggered, it’s not always easy to tell the difference. She narrates but is also at the narration’s mercy, a woman in trouble because of that and more. Her friends are listening, we are listening, nothing helps; she’s alone.
Laura says it was when she was outside watching the house, in the dark, hearing that strange sound and seeing that unearthly light from the upstairs room, when she realised that this was the real story, the story of what they found in the lake. It wasn’t about the letters, it wasn’t about the books, it wasn’t about either Chicho or Rafael, she says, but we’ve already watched these stories being told, as well as the ones that sprang up beside them and there are others still waiting in the wings. They feed off one another, yet they are distinct, different chapters with their own moods, their own genres, their own specific sounds and images, their own narrators, albeit replete with strange
parallels, showing and telling always kept in careful flux, always circling back to Laura, circling around her, a gap at the centre that everyone tries to fill, like a lake. If we listen to Laura, maybe we need to ignore all these other stories and focus on the “real” one, but that’s easier said than done, everything is connected and not just by her; not all narrators are equally reliable.
So Laura would say that it’s not ultimately about what Rafeal and Chicho are doing, their attempts to track her down via the flowers she was seeking to classify, moving between nondescript, autumnal places only distinguishable from another by their names: Fortin Olvarría, América, Trenque Lauquen, all wan sunlight and washed-out greens. It’s like a road movie or even a detective story, but a taciturn, mournful one with a string section on the soundtrack to match, an exercise in ever decreasing circles rather than the joy of the open road. The note from Laura that Chicho finds under the wind-screen wiper could suggest the latter, but the chill of the plains change her words into something else, turning Adiós, Adiós, me voy, me voy, into less of an escape than a farewell. Rafael talks of the different versions of Laura that exist and he’s not wrong about that, he seems fixated on the crazy one inside his head. We’ll only find out later which version of her wrote the note.
The version of Laura that Chicho got to know wasn’t crazy but rather driven, animated, enthusiastic, not in search of flowers but rather books, letters and a love story, even if we must remember it’s not about that. As Laura and Chicho drive across the glowing landscape of late summer and probe deeper into the correspondence between two lovers from the past that lurks in the books at Trenque Lauquen library, it’s like a mirror image of Rafeal and Chicho’s previous exploits, only happier and more hopeful. This road movie unfolds in sunshine and between conversation over beers, excitable piano chords play on the soundtrack, they sing along
to the music in the car. Their detective work is born of curiosity not necessity, research for a radio column that spirals outwards in all directions, eventually linking together the autobiography of Alexandra Kollontai, Maurice Maeterlinck’s bees, Cesare Pavese, 1962, 1968, Italian cities, Chicho’s former teachers and as many Juanas as there are versions of Laura, women who make history in different ways; even when it’s all laid out on the table in Laura’s room, it still feels infinite, limitless, dizzying, like you could still get lost in it, just like the plains.
Soon the love story between Carmen Zuna and Paolo Bertino isn’t just being narrated by Laura and Chicho, we’re also seeing it on screen, like how Laura appears in the story she will narrate at the radio station later on. Chicho plays Paolo and Carmen is played by another Laura, a Laura who also knows a lot about narrating. This Laura starts to wander across the plains, alone, without a fixed goal, and the couple are never reunited, although she does at least reach the ocean, is this a happy end? As he drives back with the passenger seat empty beside him and the melancholy song plays on the radio for the first of several times, Chicho isn’t happy either. That love story has given birth to another, but there’s nowhere for it to go, all that remains is a kiss over beer, a farewell hug of unusual tenderness and the memories of what was, of what might have been, playing pat-a-cake under the tall trees as the crickets chirp, dusk approaches and hands clasp for longer than necessary. Laura said it wasn’t about this, but it’s sad all the same. Te dejo, te dejo, te planto, te planto, te mato, te mato, te entierro, te entierro, adiós, adiós, adiós
The mood shifts again once Rafael meets Norma at the municipality and she tells him about her own version of Laura, a Laura going off the tracks, irresponsible, unfriendly, unlike the Laura we’ve got to know, although now there’s no mistaking that she’s a woman. Perhaps Norma is one of the less reliable narrators, at first she says she’s wrapping
the present for her godson, but later it’s for her nephew, the whole exchange seems off. Norma drives Rafael to the bus station and there is the same creeping disquiet, the trees and buildings are shot from below as if the camera were trying to make something out in the sky, a theremin floats on to the soundtrack and the water tower which looks like a flying saucer looms into the frame. And there’s the first sight of the lake that gives its name to both the town and the film; Trenque Lauquen means round lake. Norma also mentions what they found there and now we’re finally arriving at the real story, at least according to Laura. Norma says it was some sort of creature, a monkey maybe or an alligator, although there was talk of science fiction too, there were thousands of theories, newspaper articles, television reports, radio discussions, press conferences, stories upon stories; the theremin quivers and wails.
Now we can finally circle back to that night at the radio station and listen to Laura tell us what she thinks it’s really about, although defining what exactly they found in the lake is no easy task. The wide shot of the water at dawn lingers on the boat, the police vehicles and the ambulance for a full three minutes, but nothing is clearer as a result. Laura wasn’t playing attention anyway, she was too distracted by the love story from the past, her own little love story from the present and the other story that has started to unfold in parallel, the story of the strange, distant woman who appeared from thin air to ask her for the yellow flowers; with the woodwind and ominous strings on the soundtrack, perhaps it’s closest to a ghost story. This apparition is linked to the other one in the lake though, Elisa Esperanza turns out to be the doctor allocated to deal with the creature they found, although she stepped back from the case once it became clear it wasn’t human. When they describe her on the news, it’s reminiscent of how Norma talks of Laura, a rebellious woman, a “difficult” woman, like the women who make history, a woman with a purpose is often a woman in trouble.
It was Elisa’s house that Laura was watching from the outside in the dark that night, seeing the light, hearing the noise. The next day Laura knocks on the door and soon afterwards she’s moved in, helping the pregnant Elisa and her wife Romina pile together the autumn leaves, find the right herbs, gather the yarn. Elisa tells her about the creature upstairs the very first day, she says it’s not human, it’s a mutant, something that becomes different all the time, like the music, like Laura, like the film; right now it’s female. Afterwards Elisa doesn’t mention it again, despite the cries from upstairs, despite the hammering sounds by night, despite the yellow flowers that grow on the plains, that grow in the illuminated cabinet in the outhouse, flowers that are eaten. Laura said this is what it was all about, but somehow it’s also not about this at all, the music has softened, turned wistful, like the soundtrack to a love story, but a different kind of love story to all the previous ones, a love free of fear, free of judgement, full of hope. We see another Laura and it’s the most optimistic Laura yet. She won’t be here for long.
We don’t find out exactly why Laura was asked to leave the house, she just narrates it in passing, her account is now coming to an end, the real story is over. She only returns there one final time, after Elisa and Romina have already fled with the creature, leaving behind just traces and the images conjured up by them. A paddling pool filled with brackish water that trickles from a watering can and over logs, fans that buzz as they rotate, greenery all around, also painted on the walls, the sounds of the jungle, which are not like the sounds of the plains. Inside the cupboard, there is the sketch of a body that resembles a pregnant woman; there are footprints in the mud on the island at the centre of the lake, a scent that lingers on the yellow flowers. When Laura is sitting in the car later, her account is already finished, Elisa calls her for the last time, it’s done, they didn’t make it, this is no longer the real story, but it’s sad all the same. We only see Laura’s face from
behind, it’s hard to see if there are tears. But the version of Laura that wrote the note is now clear, a Laura crushed, a Laura emptied out, a Laura, as always, alone. Is there anything sadder than realising there’s nothing else to say?
The account has been given, the real story is over, but the film continues nonetheless. Laura leaves the car behind to set out on foot and there is no fitting music to describe the mood, just birdsong, crickets, mooing cows and clucking chickens, gauchos singing in the bar dressed like in a costume drama, the lapping of water under the bridge, the light has changed, the chill of autumn is here. Carmen walked these plains too, and back then and today no longer look so different; that Laura reached the sea, this one won’t. This Laura has no more words, she not’s going to tell us what it’s about; in the absence of a narrator, perhaps we ourselves must narrate.
As everything becomes still, the plains finally come to the fore, although they’ve been there all along, holding everything in their embrace, a great limitless expanse, its features interchangeable, towns, hedges, roads and trees, towns, hedges, roads and trees. Is this what it’s really about? I remember being driven across those plains for hours, I would fall asleep and wake up again, and everything would still be the same. A space like this messes with the mind, it stretches ever further, it never stops, it never changes, an boundless blank canvas determined to stay as such. Maybe that’s why the stories were being told in the first place, maybe that’s what it was really about, about the joyous attempt to fill up a space that can’t be filled, about collecting and connecting as many signs, sounds and shapes as possible while knowing they will even-tually go quiet, swallowed up by silence. The light makes the line of trees on the horizon look black, as the sky hovers between yellow and blue. Now the river bank is empty.
Temple Woods Gang (Rabah Ameur-Zaïmeche, 2023)
Giovanni Marchini Camia
The cité has over the last three decades become one of French cinema’s primary exports, as recognisable and evocative as the Eiffel Tower. Like their counterparts in the US and United Kingdom — the projects of Spike Lee and The Wire, the estates of Ken Loach and Mike Leigh — these suburban, typically low-income residential complexes are by now inextricable from a set of generic referents. When Rabah Ameur-Zaïmeche’s
The Temple Woods Gang (2023) opens with a shot of a tall, white apartment block, which a slow pan then shows to be part of a group of identical buildings located on the outskirts of a city, we are automatically poised to expect a specific type of film. Namely, one employing heightened realism to tell a sensationalised account of socioeconomic hardship, racial tensions, youth criminality, police violence, drugs… In short, one reminiscent of Mathieu Kassovitz’s La Haine (1995).
This prejudice will be more prevalent among foreign viewers. Rabah Ameur-Zaïmeche, aka RAZ, is not well-known abroad but held in high esteem by French cinephiles, who are also likely better acquainted with the varied history of cité films that both predates La Haine and reaches far beyond its legacy. It’s a history in large part written by Maghrebi-French filmmakers and Ameur-Zaïmeche, whose background is Algerian, made a first contribution with his debut, Wesh Wesh, What’s Happening? (2001). With its hip hop soundtrack and conflicts between stairwell hash dealers and belligerent cops, Wesh Wesh shares many elements of the template set by the likes of Kassovitz and Jean-François
Richet (in fact, RAZ cites Richet’s 1995 debut Inner City as a direct influence). Shooting in DV in the cité des Bosquets, where he grew up in the Parisian banlieue of Seine-SaintDenis, Ameur-Zaïmeche reworked these tropes within a documentary aesthetic. The authenticity derived from the cast of family and friends and the unexpected narrative digressions, as when characters are observed walking through the woods or fishing in a pond, combine in an act of reclamation, a retelling of familiar stories by those who actually lived them.
RAZ’s later films departed from the cité, visiting locales as diverse and far-flung as a suburban palette factory (Dernier Maquis, 2008), the countryside of 18th century France (Smugglers’ Songs, 2011) and biblical Galilee (Story of Judas, 2015). He would only return with The Temple Woods Gang, his seventh feature. Again set in Seine-Saint-Denis, although filmed in Bordeaux and Marseille, it’s an even more radically unique portrait of its milieu than Wesh Wesh, all the while remaining in dialogue with the contemporary imaginary. In the current generation of highprofile films dealing with cités, such as Ladj Ly’s Les Misérables (2019) and Romain Gavras’s Athena (2022) — the latter’s ludicrous video-game fantasy representing the nadir of this cinematic strand — the banlieue criminals have grown more organized and their arsenals more significant. While this is also true of RAZ’s eponymous gang, his film’s first scenes, remarkable in their contemplation and silence, immediately set it apart from the clamorous excess of its aforementioned peers. The panoramic view of the apartment blocks and distant cityscape is revealed to be the POV of M. Pons (Régis Laroche), a secondary character for most of the story, looking out from his balcony as he waits for an ambulance to come pick up the body of his mother, who died during the night. Captured in placid compositions, the paramedics’ arrival and the subsequent funeral transpire without audible dialogue.
The first word is only spoken after some ten minutes, when a woman at the church, played by the singer Annkrist, intones a dirge whose explosive emotion is as striking as the quiet that preceded it.
By opening on this extended note of sorrow, RAZ structures the film as an elegy, setting the tone for what’s to follow. The death of M. Pons’s mother eventually comes to symbolise the demise of a certain idea of community. We discover that she was beloved among the men of the Temple Woods Gang, whom she used to regale with crêpes as children. They reminisce about her in a scene that begins with a downward tilt of the camera, from the top of an apartment tower to the pavement, where they are sitting in a row. This camera movement, repeated numerous times throughout the film, mirrors the gang’s trajectory after they pull off a lucrative highway robbery, presaging their inexorable fall.
Informed by a Marxist worldview, the films of Ameur-Zaïmeche represent a countercinema: besides defying conventions on the level of genre and narrative, they envision disenfranchised characters banding together in fragile utopias that are threatened from the outside by dominating forces. Here the antagonist is the Saudi prince robbed by the gang. (The inspiration comes from life, as an armed gang from Seine-Saint-Denis really did rob a Saudi prince on a highway in 2014.) His character is a spectral presence, taciturn and exuding malevolence, who at once functions as a representative of global capital and as the embodiment of its inhumanity. That the violence is enacted by Arabs against other Arabs elaborates a theme central to RAZ’s oeuvre, though this is arguably his most fatalistic work to date. The film’s philosophy is contained within its peculiar narrative momentum. While technically a heist movie, The Temple Woods Gang shows little interest in most of the genre’s staples.
The planning and preparation of the robbery, for instance: it takes little more than a short and wordless scene, showing a gang member working at a dealership of luxury sports cars, to establish how they got their intel. Most conventionally dramatic plot points are handled with equal economy. The deaths of all but one of the gang members in a climactic shoot-out are hardly underlined; it’s only when the film cuts to the character of Bébé (Philippe Petit) returning home, alone and afraid, that we comprehend he’s the sole survivor. The action is thus carried along in a flow that feels ineluctable.
By contrast, plenty of time is dedicated to observing the men engage in inconsequential banter, both before and after they’ve made off with the prince’s suitcases full of cash and confidential documents. (It’s not the money but the documents, whose contents are never revealed, that seal the gang’s fate.)
Born of improvisation and buoyed by a palpable camaraderie that extends beyond the screen, as many of the actors are nonprofessionals who have appeared in RAZ’s previous work, it’s these conversations that are the film’s beating heart. Whether one of the men is getting ribbed for planning to marry (“You make some dough and then get hitched? You got it all wrong!”) or another fantasises about replacing his cheap prosthetic with a bionic hand, the warmth and intimacy between them only emphasises the tragedy to come. It is accomplished after Bébé turns himself in to the police to elude the prince’s henchmen. The film’s most haunting scene shows him in an empty jail courtyard while unseen inmates shout threats and abuse at him from beyond the barred windows of the surrounding buildings. Framed in a desolate long shot, he runs in circles along the perimeter fence, a futile attempt at escaping his tormentors that doubles as an expression of his Sisyphean condition. A man appears out of nowhere and the voices crescendo from Greek chorus to jungle cacophony as he stabs Bébé, leaving him on the ground to die.
Once M. Pons sets out to avenge the gang, the film departs into noir territory, leaning more fully into the impressionism that had previously coloured certain moments. In a lengthy sequence that favours mood over logic, the former army sniper tracks the prince down at a horse racing track, follows him to a nightclub where the prince lets loose in a wild dance, evoking nothing less than a prancing devil, and finally shoots him outside of an art gallery. Numerous critics have compared M. Pons to one of Jean-Pierre Melville’s hardened professionals. While the similarities are certainly there (and Ameur-Zaïmeche has acknowledged the inspiration), it would be difficult to imagine Alain Delon’s samurai affectionately baby-sitting children and whipping up a batch of crêpes, as M. Pons does in an earlier scene when Bébé’s girlfriend leaves him their kids. M. Pons is a character anchored in a specific social reality; after the death of his mother and of the Temple Woods Gang, he kills the oppressor to keep the flame of revolution alive for the community. At film’s close he’s back on his balcony, once again looking down, except now the sun is shining and he isn’t watching a racing ambulance, but children playing on the grass.
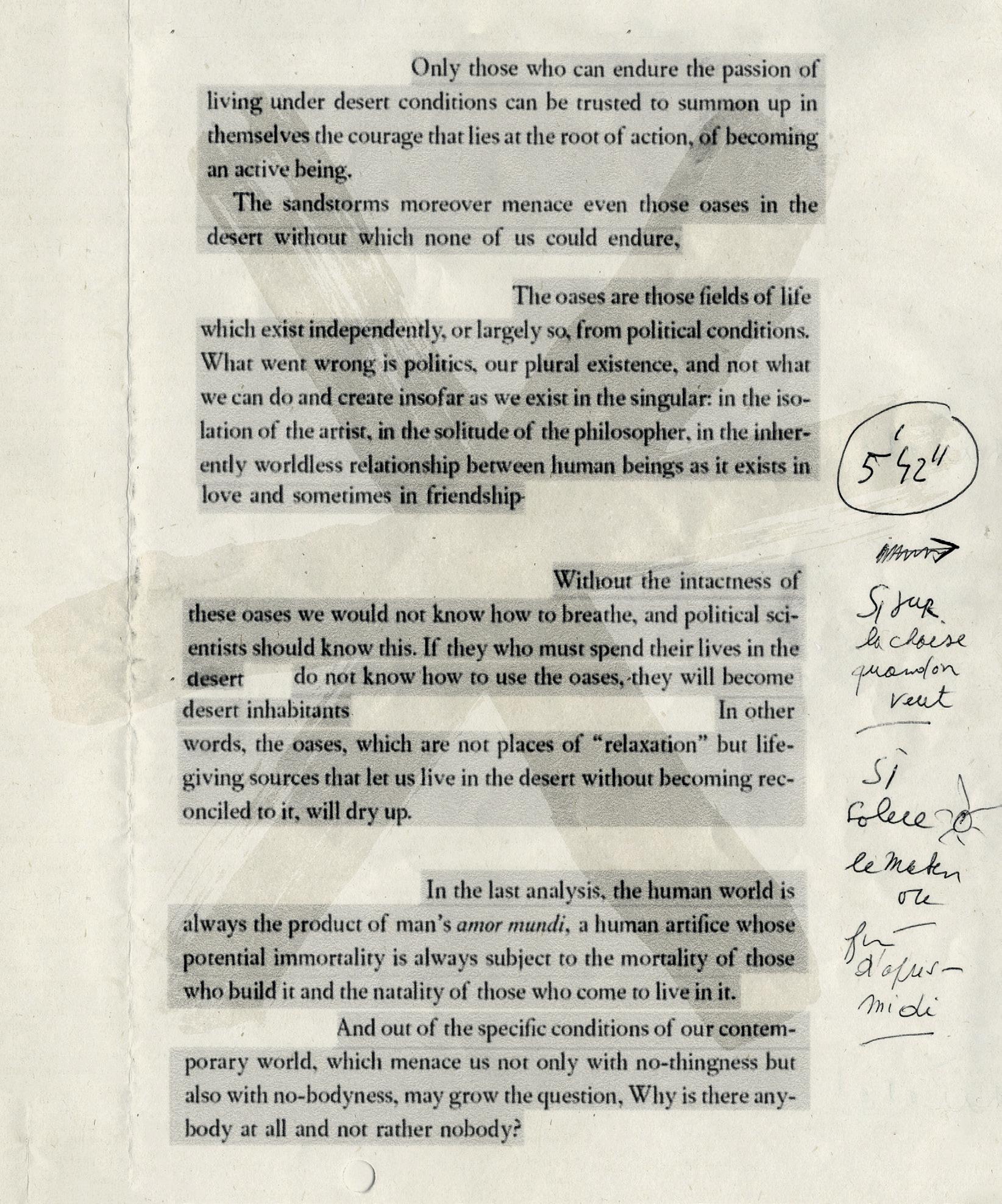

Prix : 22 euros
isbn : 978-2-9595835-0-6
