



























L’Agence canadienne de l’eau est enfin sur pied ! La gestion de l’eau en présence de cyanobactéries





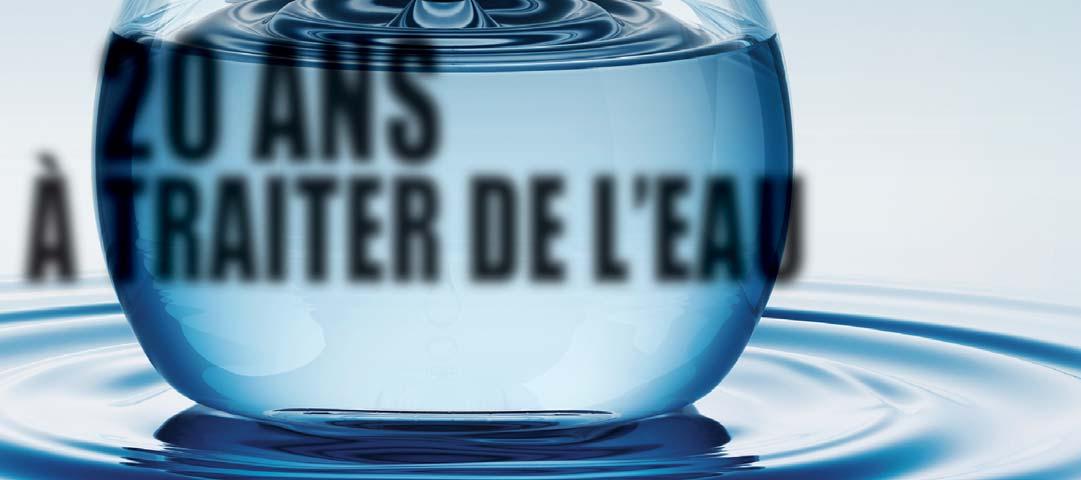




« Source donne une information de qualité et réussit à trouver l’équilibre entre le côté technique et la vulgarisation. C’est important que le magazine soit accessible. Saint-Eustache est une ville de taille moyenne, nous avons de l’expertise. Mais dans bien des petites municipalités au Québec, il n’y a pas de personnel technique : les employés portent plusieurs chapeaux et doivent comprendre les enjeux pointus qui touchent à l’eau. » — Yanick Fortier, directeur du Service des eaux de la Ville de Saint-Eustache


Éditeur et rédacteur en chef
André Dumouchel adumouchel@maya.cc
Coordonnatrice à la direction de l’édition Eve Matte coordination@maya.cc
Direction artistique MAYA
Designer graphique
Sylvain Malbeuf (SymaPub)
Journaliste et rédactrice
Martine Letarte
Chroniqueurs
Clément Cartier
Me Thibaud Daoust
Rafika Lassel
Photos de la page couverture et de l’entrevue
iStock by Getty Images
Danylo Bobyk
Luc Lavergne
Réviseures linguistiques
Emmie Garneau
Christine Paré
©Tous droits réservés. Droits d’auteur et droits de reproduction : toute demande de
figurant ci-dessus. Les opinions et les idées contenues dans les
ne signifie pas que le magazine SOURCE
toutecorrespondance
Le magazine SOURCE est publié trois fois l’an.


Espace publicitaire
André Dumouchel Téléphone : 450 508-1515 adumouchel@maya.cc
Abonnement et administration
MAYA communication et marketing 457, montée Lesage
Rosemère (Québec) J7A 4S2 Téléphone : 450 508-1515 info@magazinesource.cc www.magazinesource.cc
Impression Héon et Nadeau























C’est en suivant mon instinct que j’ai lancé le magazine Source sur la gestion de l’eau potable et le traitement des eaux usées en 2005. Il faut dire que j’avais déjà de bonnes antennes sur le terrain pour me guider. L’avenir m’a donné raison. Deux décennies plus tard, le magazine est encore bien vivant et plus pertinent que jamais.
Or, n’eût été le fait que le magazine répond à un besoin précis, l’histoire aurait pu être beaucoup plus courte. Le portrait médiatique québécois des dernières années fait état d’une tendance lourde. Dans l’étude Les médias québécoisd’information–Étatdeslieuxen2022 du Centre d’études des médias, on apprend notamment que les hebdomadaires régionaux sont passés de 200 à 113 entre 2012 et 2021. Et depuis, on a vu la fermeture d’autres médias, comme Métro, et de nombreuses suppressions d’emplois, notamment chez Québecor, qui a annoncé, en novembre 2023, l’abolition de 547 postes au Groupe TVA. L’étude précise d’ailleurs que la masse salariale des quotidiens, hebdomadaires et autres publications a diminué de presque 40 % entre 2016 et 2020.
Malgré l’hécatombe, Source perdure. Pourquoi ? Je crois que c’est en raison de son contenu à la fois pertinent, niché et produit par les gens du domaine. Nicolas Minel, président-directeur général de Brault Maxtech, le mentionne d’ailleurs dans le reportage : « Il y a plusieurs revues intéressantes dans le domaine

André Dumouchel
adumouchel@maya.cc
Avouons qu’il n’a pas tort. Lire sur le Web à propos d’une nouvelle technologie implantée dans le sud des États-Unis n’a pas le même impact que lire, en français, que votre collègue de Sept-Îles l’a installée dans son usine. En fait, trois fois par année, les expertes et les experts se donnent rendez-vous dans ce magazine pour partager leurs connaissances. C’est un magazine fait par et pour les spécialistes du domaine de l’eau du Québec, des gens que vous croiserez peut-être dans un colloque pour en discuter. La différence est claire : ce contexte enrichit l’intérêt et la pertinence de chaque article.
Le magazine est aussi privilégié de pouvoir compter sur des annonceurs fidèles, sans qui rien de tout cela ne serait possible, puisqu’il ne vit pas de subventions. D’ailleurs, l’état des lieux du Centre d’études des médias révèle qu’entre 2012 et 2020, les annonceurs ont dépensé environ 850 millions de dollars de moins dans les médias traditionnels, alors que les budgets publicitaires ont augmenté de 150 millions de dollars. Ce sont les géants du Web, comme Google, Facebook et YouTube, qui gobent la part du lion : ils se sont accaparés près de 60 % du marché publicitaire.
Si Source, tel un mini David, réussit à se tenir debout devant cet énorme Goliath, c’est parce que les différents acteurs de l’industrie achètent de la publicité pour faire connaître leurs produits et services, bien sûr, mais aussi pour soutenir le magazine et, de ce fait même, leur industrie. Nous tenons donc à les remercier chaleureusement et à souligner l’importance de leurs actions au service de la communauté. Parce qu’un magazine en santé est le reflet d’une industrie en santé. Source fait circuler l’information, dénonce des situations, souligne les bons coups et fait rayonner les acteurs de changement d’ici. C’est important pour la vitalité du secteur.
Toujours plus pertinent
Le Québec arrive d’ailleurs à une période charnière, avec les répercussions des changements climatiques, les inondations de plus en plus fréquentes et les bris d’équipements qui se multiplient. Sans parler du fait qu’il faut renouveler les différentes infrastructures en eau, et ça presse !
Or, peu d’argent y est accordé en ce moment. Investir dans le domaine de la gestion de l’eau potable et du traitement des eaux usées n’a jamais été ni sexy ni politiquement rentable. En même temps, il faut migrer vers de nouvelles technologies alors que nos standards de qualité s’élèvent.
Source est donc plus pertinent que jamais pour porter le message, et nous avons bien l’intention de poursuivre notre mission pour accompagner l’industrie dans cette période importante pour le Québec. n




























Le traitement des eaux usées génère des odeurs susceptibles de nuire à l’acceptabilité sociale de vos activités. Les principales zones génératrices d’odeurs sont les stations de pompage, de






ADAPTABLE À VOS INSTALLATIONS
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT









AUCUNE MAINTENANCE à la semaine ou au mois. Un service de gestion de crise est également disponible.
























Collaboration spéciale Martine Letarte


Le monde de la gestion de l’eau potable et du traitement des eaux usées est très technique. Mais depuis 20 ans, Source démocratise ces enjeux pour faire en sorte que tous puissent mieux les comprendre. Maintenant que les changements climatiques se font sentir et que la population comprend l’importance de bien gérer l’eau et ses infrastructures, le magazine se révèle plus pertinent que jamais.
Créer un guide d’achat de compteurs d’eau pour les municipalités : voici l’idée qu’a eue André Dumouchel, fondateur du magazine Source, en 2005. Pourquoi ? Parce qu’il y avait de nombreux imposteurs dans le domaine et on voulait éviter que les villes se fassent escroquer. Il a confié le mandat à Mathieu Laneuville, alors ingénieur au ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation. « André m’avait donné carte blanche, j’avais apprécié sa confiance et le résultat a été gagnant, se souvient-il. Nous avions rassemblé l’ensemble des joueurs, y compris le secteur privé, pour nous entendre sur les éléments importants. Nous avons réussi à faire un outil utile, et le gouvernement recommandait aux municipalités de consulter ce guide. »
Directeur du Service des eaux de la Ville de SaintEustache, Yanick Fortier avait collaboré à la réalisation du Guide d’achat de compteurs d’eau . Il est bien placé pour témoigner de l’importance du magazine pour les municipalités et de son impact concret. « Source donne une information de qualité et réussit à trouver l’équilibre entre le côté technique et la vulgarisation, explique-t-il. C’est
« Dans l’industrie, tout le monde est branché sur le magazine, tout le monde le connaît, il fait partie de notre environnement »
— Georges Szaraz, président-directeur général de Mabarex

important que le magazine soit accessible. SaintEustache est une ville de taille moyenne, nous avons de l’expertise. Mais dans bien de petites municipalités au Québec, il n’y a pas de personnel technique : les employés portent plusieurs chapeaux et doivent comprendre les enjeux pointus qui touchent à l’eau. »
Yanick Fortier constate également qu’au fil des ans, des reportages marquants ont secoué le secteur, mais aussi la population en général. Citons
par exemple celui paru il y a quelques années sur le manque d’eau à Saint-Lin–Laurentides.
« Cet article a changé la donne, parce qu’on ne parlait pas d’une ville obscure à l’autre bout du monde, raconte-t-il. Il n’y a pas si longtemps, bien des gens arrosaient leur asphalte au Québec. Aujourd’hui, s’ils le font, ils sont stigmatisés. De plus en plus, les gens se rendent compte que c’est possible qu’on manque d’eau. Le concept d’utilisateur-payeur commence à entrer dans les mœurs alors qu’avant, on ne pouvait même pas en parler. Source contribue à l’évolution de la société. »
Aux yeux de Grégory Pratte, vulgarisateur, chroniqueur et conférencier dans le domaine de l’environnement pour différentes tribunes, les différentes éditions du magazine au fil des 20 dernières années permettent de voir l’évolution de la société dans le domaine de l’eau.
« Les choses se sont améliorées en 20 ans, mais il y a des défis, dit-il. On fait face à une crise en ce moment. Nos infrastructures, on ne leur a pas donné d’amour. Il faut les moderniser. Puis, il faut mieux gérer l’eau de pluie. On réalise aussi qu’il y a des villages qui n’ont plus d’eau au Québec. Il y aura

« Source est très ancrée dans son territoire. C’est comme le trait d’union entre les entreprises québécoises du secteur de l’eau, les institutions et les villes. »
— Nicolas Minel, président-directeur général de Brault Maxtech
des décisions à prendre, et Source est un bel espace pour expliquer les enjeux et explorer différentes avenues. Le magazine peut influencer les décisions. »
Comme la gestion du secteur de l’eau dépend beaucoup des technologies, le magazine permet de découvrir les nouveautés en la matière. Par exemple, Clément Cartier, représentant technique de l’entreprise Brault Maxtech, rédige une chronique dans chaque édition de Source
« Comme on représente des manufacturiers des différents endroits dans le monde, nous avons une vision large de ce qui existe comme technologies, alors Clément présente dans Source de nouvelles solutions qui ne sont pas encore nécessairement présentes au Québec », indique Nicolas Minel, président-directeur général de Brault Maxtech. Par exemple, en ce moment, les boues d’épuration sont particulièrement d’intérêt. « Beaucoup de nouveaux équipements arrivent sur le marché pour récupérer de l’énergie à partir des boues d’épuration, explique l’expert. Le traitement de l’eau a aussi grandement évolué. Aujourd’hui, il se fait beaucoup de traitement biologique pour les polluants qu’on ne voit pas, comme les médicaments. »
Nicolas Minel est proche de Source depuis ses premières éditions alors qu’il travaillait dans une autre entreprise du secteur. « Le magazine a toujours été près des fournisseurs de technologies, il leur a toujours donné la parole, raconte-t-il. C’est important, parce que les gens des villes le lisent. Il y a plusieurs revues intéressantes dans le domaine de l’eau, mais Source est très ancrée dans son territoire. C’est comme le trait d’union entre les entreprises québécoises du secteur de l’eau, les institutions et les villes. »
Chez Nordikeau, qui accompagne plus de la moitié des 800 municipalités au Québec détenant un service public d’eau potable et d’assainissement, le président Jean-François Bergeron participe pour sa part régulièrement à des reportages dans le magazine, et ce, depuis ses débuts, il y a 20 ans. « Par exemple, récemment, nous avons parlé du problème de pertes d’eau sur les réseaux d’aqueducs municipaux, indique-t-il. C’est un enjeu important, parce que la performance des réseaux québécois est déplorable. Bien qu’il soit impossible d’atteindre l’étanchéité à 100 %, un objectif minimum devrait être d’atteindre 80 %, alors qu’on est plutôt entre 60 et 80 % au Québec. »
À ses yeux, Source présente bien les grands enjeux liés à l’eau au Québec. « C’est fait de façon accessible et c’est lu aussi, affirme-t-il. Lorsqu’on va dans les bureaux municipaux partout à travers la province, on voit le magazine dans le hall d’entrée. »
Le magazine permet aussi à des personnes qui ont des expertises pointues de prendre la parole au bénéfice de plusieurs acteurs du secteur. Par exemple, Hélène Lauzon, présidente-directrice générale du Conseil patronal de l’environnement du Québec (CPEQ), est avocate et a écrit une chronique juridique dans Source et dans 3Rve pendant plusieurs années. Elle poursuit cette collaboration par l’organisme qu’elle préside, notamment lorsqu’une nouvelle politique publique, une nouvelle loi ou un nouveau règlement est adopté : le CPEQ utilise alors sa tribune pour l’expliquer. « Par exemple, nous avons écrit un article l’an dernier sur l’augmentation des redevances sur l’eau, indique Me Lauzon. Nous expliquions quel était l’impact pour les entreprises. »
Le CPEQ a aussi écrit sur la responsabilité élargie des producteurs, obligeant les entreprises qui mettent les produits visés sur le marché (ex. : piles, téléphones, réfrigérateurs) à récupérer et à valoriser ces derniers. Si l’article est court dans le magazine, le travail derrière est toutefois de taille. « C’est lu par les entreprises et elles doivent pouvoir s’y fier, affirme Hélène Lauzon. Il faut donc faire de multiples vérifications pour s’assurer que tout est exact. »
Le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU) publie aussi sa chronique dans Source depuis plusieurs années. « Nous avons plusieurs personnes qui ont des expertises notamment en infrastructures souterraines ou de surface, et elles ont beaucoup d’information à partager avec le lectorat de Source », indique Danielle Globensky, conseillère en communication au CERIU. Selon elle, le magazine est une tribune importante pour promouvoir les bonnes pratiques dans le domaine des infrastructures urbaines en eau. « Nous avons par exemple des guides et des formations à faire connaître, indique-t-elle. Ce sont surtout les municipalités qui lisent le magazine, alors c’est intéressant pour nous. Nous voulons les aider à mieux gérer leurs actifs. Le magazine est aussi souvent lancé lors d’événements importants du secteur, alors c’est un incontournable. Il faut y être présent pour rayonner. »










« Lorsqu’on va dans les bureaux municipaux partout à travers la province, on voit le magazine dans le lobby. »
— Jean-François Bergeron, président de Nordikeau
Des vidéos marquantes
Lorsqu’ils ont pensé aux 20 ans de Source , plusieurs collaborateurs et collaboratrices du magazine ont mentionné la production de vidéos par MAYA communication et marketing (l’éditeur de 3Rve et de Source). Mathieu Laneuville se souvient notamment d’avoir eu à expliquer la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable en une minute. « La série de vidéos s’appelait Dans mon sous-sol et était tournée avec un sofa en velours vert, raconte-t-il en riant. On a eu beaucoup de plaisir à tourner ces capsules et elles étaient vues ! Cette capsule avait été regardée des milliers de fois. »
La centrale. C’est le mot qui vient en tête à Georges Szaraz, présidentdirecteur général de Mabarex, un manufacturier d’équipements de traitement des eaux, lorsqu’il souhaite décrire Source. « Dans l’industrie, tout le monde est branché sur le magazine, tout le monde le connaît, il fait partie de notre environnement », affirme-t-il.
Très niché, le magazine a sa pertinence aux yeux de M. Szaraz. « Si quelque chose d’important se passe dans l’industrie, Source va en parler. On n’est pas obligé de fouiller sur Internet pour trouver l’information. Je pense par exemple à un changement réglementaire, mais aussi aux avancées technologiques. Le magazine couvre bien tout ça et il vient clairement répondre à un besoin. »

magazinesource.cc info@magazinesource.cc

Source a commencé fort – très fort. En page couverture de la première édition, on trouvait nul autre que Thomas Mulcair, alors ministre de l’Environnement du Québec. « Je n’avais aucun lien avec lui ni avec le parti libéral, mais j’avais osé lui demander une entrevue et il avait accepté, se souvient André Dumouchel, fondateur du magazine. Généralement, les gens ne veulent pas prendre le risque d’embarquer dans quelque chose qui n’existe pas encore. C’était très cool qu’il accepte de se prêter au jeu. Je lui avais posé plein de questions sur son poste de ministre et sur les enjeux liés à l’eau. »
Cela n’a pas été sans impressionner l’ami du secondaire d’André Dumouchel, Grégory Pratte. « Il y avait plusieurs personnes importantes qui
contribuaient au magazine dès ses débuts », affirme celui qui s’est ainsi laissé convaincre de rejoindre l’équipe de MAYA communication et marketing.
André Dumouchel se souvient aussi de s’être rendu en France pour l’une des éditions du Salon Pollutec, et d’en avoir profité pour interviewer Hubert Reeves. « Il y avait eu une tempête de neige et même si le temps qui m’avait été alloué pour l’entrevue était épuisé, M. Reeves ne pouvait pas partir, donc son assistant nous a apporté deux coupes de vin et nous avons finalement parlé pendant deux heures, raconte-t-il. C’est complètement fou quand j’y repense. »
Il faut dire aussi que le domaine de l’eau intéresse grandement la communauté scientifique, et Source en profite. « Nous avons d’ailleurs poussé les travaux de beaucoup de chercheuses et de chercheurs, indique André Dumouchel. Par exemple, pendant la pandémie, nous avons fait une première page du magazine avec la mesure des indicateurs associés à la COVID-19 dans les
eaux usées comme indicateur précoce de la propagation du virus dans la population. Ça avait aidé à faire connaître l’initiative à tous les paliers de gouvernement. »
Le fondateur est aussi fier du reportage La toilette n’est pas une poubelle, publié l’hiver dernier. « Les personnes de l’industrie avaient besoin d’expliquer la réalité des usines de traitement des eaux usées, avec tout ce que les gens jettent dans leur toilette, explique-t-il. Ça avait fait réagir. C’est important de mettre de l’avant ces gens qui travaillent dans l’ombre. C’est un milieu difficile : ça pue dans ces usines ! Mais leur boulot est important. »
Maintenant, le magazine réussit à aller chercher des journalistes professionnels pour réaliser les reportages. Les textes peuvent aussi mieux briller, maintenant que le nouveau site Web a été créé. « Toute cette évolution ne serait pas possible dans le soutien fidèle des nombreux annonceurs actifs dans le domaine de l’eau, affirme André Dumouchel. Sans eux, il n’y a pas de magazine. » n




Rafika Lassel
M.A.
Directrice de l’Observatoire de la gestion intégrée de l’espace public urbain du Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU)
rafika.lassel@ceriu.qc.ca
Dans une conjoncture marquée par les changements climatiques et l’urbanisation croissante, la gestion des eaux pluviales est devenue un enjeu majeur pour les municipalités. Les infrastructures vertes (IV), telles que les noues végétalisées, les aires de biorétention et les pavages perméables, s’imposent comme une solution innovante et durable pour le contrôle à la source des eaux pluviales en milieu urbain. Or, de nombreuses questions subsistent en ce qui concerne les avantages procurés par ces infrastructures vertes par rapport à leurs coûts.
Dans ce contexte, un mandat de recherche a été confié à Marie-Ève Jean et Laura Milena Solarte Moncayo par l’Observatoire de la gestion intégrée de l’espace public urbain1 et ses partenaires. Il a été supervisé par Sophie Duchesne, professeure du Centre Eau Terre Environnement de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS). L’objectif principal de ce mandat était de réaliser une analyse coûts-avantages (ACA) de la mise en place d’infrastructures vertes pour le contrôle à la source des eaux pluviales dans les secteurs urbains drainés par des réseaux d’égouts unitaires. Un accent particulier a été mis sur l’évaluation des coûts et des avantages liés à l’entretien de ces infrastructures, qui demeuraient jusqu’à présent inconnus. Les travaux de recherche ont été effectués en trois phases : la première consistait à réaliser une revue d’expériences terrain de plusieurs villes dans le monde. La deuxième visait à effectuer une revue de la littérature au sujet des pratiques, des coûts et des avantages liés à l’entretien des infrastructures vertes de gestion des eaux pluviales (besoins, personnel requis, conséquences sur la performance, etc.). Enfin, la troisième phase consistait à réaliser une analyse coûts-avantages à partir de cas réels dans deux villes du Québec.
PHASE 1 – APERÇU DES PRATIQUES ACTUELLES
Une étude menée auprès de 13 municipalités québécoises, 6 municipalités canadiennes, 4 villes françaises et plusieurs entités de la grande région de Melbourne, en Australie, offre un aperçu des pratiques actuelles en matière d’implantation et d’entretien de ces infrastructures.
Les IV les plus couramment utilisées sont les noues végétalisées et les aires de biorétention. On trouve également des pavages perméables, des systèmes d’infiltration ou d’exfiltration sous chaussée, des toits verts, des fosses d’arbres et des systèmes de récupération d’eau de pluie. Les municipalités interrogées ont manifesté un intérêt particulier pour les ouvrages multifonctionnels, qui permettent de partager les bénéfices et les responsabilités de gestion avec les différentes parties prenantes.
L’implantation de ces infrastructures varie selon les municipalités, certaines adoptant une approche systématique, tandis que d’autres les intègrent au cas par cas dans leurs projets. La responsabilité de leur gestion est souvent répartie entre différents services municipaux, ce qui peut poser des défis en matière de coordination et d’efficacité.
L’entretien des IV se décline en quatre catégories : l’entretien horticole et esthétique, l’entretien hydraulique, les inspections et les réparations. Selon les données recueillies par les chercheuses lors de l’enquête auprès de plusieurs villes dans le monde, les coûts d’entretien annuels varient
considérablement, allant de 1 $ à 30 $/m² pour les systèmes de biorétention et les jardins de pluie, et de 1 $ à 3 $/m² pour les pavages perméables.
PHASE 2 – REVUE DE LA LITTÉRATURE
La revue de littérature a par la suite souligné les nombreux avantages offerts par les infrastructures vertes, allant de la gestion efficace des eaux pluviales à des bénéfices environnementaux plus larges. Ces avantages doivent être contrebalancés par les coûts d’investissement et d’entretien. L’étude soulève l’importance de quantifier économiquement les bénéfices environnementaux et socio-économiques de ces infrastructures, tout en reconnaissant les défis liés à leur mise en œuvre et à leur entretien. Les chercheuses présentent divers outils d’analyse économique, mais notent que leur application est souvent limitée à leur région d’origine.
Enfin, le rapport souligne l’importance d’une collaboration étroite entre les entités responsables, les concepteurs et les planificateurs pour une intégration réussie de ces infrastructures dans le tissu urbain.
Pour évaluer l’efficacité économique des IV, des analyses coûts-avantages ont été réalisées dans trois études de cas au Québec : deux à Montréal (bassin Mont-Royal et rue Gilford) et une à Laval (quartier des Abeilles). Ces études visaient à comparer les différentes solutions pour réduire les débordements des réseaux d’égouts unitaires, en se concentrant sur les jardins de pluie et les cellules de biorétention.
Les résultats de ces études de cas ont révélé que la mise en place d’IV pour la gestion des eaux pluviales est économiquement viable, avec un rapport avantages-coûts (RAC) supérieur à 1 dans la majorité des scénarios. Les jardins de pluie ont généralement présenté des RAC plus élevés que les systèmes de biorétention, mais ces derniers ont évité un volume de réservoir plus important.
En conclusion, les infrastructures vertes offrent une solution prometteuse et durable pour la gestion des eaux pluviales urbaines, avec des avantages hydrauliques, environnementaux et sociétaux. Leur mise en œuvre efficace requiert une planification minutieuse, un entretien adapté et une sensibilisation des parties prenantes, contribuant ainsi à la résilience urbaine face aux changements climatiques. n
L’Observatoire de la gestion intégrée de l’espace public urbain du CERIU tient à remercier Marie-Ève Jean, docteure en sciences de l’eau, et Laura Milena Solarte Moncayo, doctorante, pour les travaux de recherche de ce mandat.NousremercionségalementSophieDuchesne,professeureàl’INRS et titulaire de la Chaire de recherche municipale en gestion durable de l’eau, poursaprécieusecontributionaumandatderechercheetpoursasupervision éclairée des travaux et des livrables.

de biorétention (Ville de Vancouver, 2019)
1 Observatoire mis en place en 2020 par le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU)













Clément Cartier Ing., Ph. D. Directeur des ventes chez Brault Maxtech inc. clement.cartier@braultmaxtech.com
ous avons appris, plus tôt en septembre, que le gouvernement québécois souhaitait mettre en place un plan d’action incluant 500 millions de dollars afin de mieux protéger les sources d’eau potable et conserver les écosystèmes marins du territoire québécois. Cet investissement vient à point nommé, car les enjeux liés aux ressources en eau sont criants, aussi bien quant à la quantité de l’eau disponible qu’à la qualité de celle-ci. L’un des points cruciaux rattachés à la qualité de l’eau : la détérioration en lien avec les algues et les cyanobactéries.
Lorsqu’on discute avec les responsables des infrastructures en eau des municipalités, on se rend compte que la problématique de la ressource est souvent devenue un véritable casse-tête. En effet, plusieurs nappes phréatiques se tarissent, et les municipalités travaillant avec de l’eau de surface notent une diminution considérable de sa qualité sur plusieurs plans, à commencer par les cours d’eau. Ceux-ci sont parfois contaminés, entre autres par des rejets d’eaux usées mal traités, au point où les activités nautiques y sont impossibles. Notons également les lacs affectés par des rejets agricoles, municipaux et industriels, qui entraînent une accumulation de nutriments menant ensuite à une eutrophisation et à des conditions propices à la génération de cyanobactéries dans les lacs.
Les cyanobactéries sont des bactéries photosynthétiques. Elles sont souvent appelées « algues bleues » ou « algues bleu-vert », bien que dans les faits, ce ne sont pas des algues. Les cyanobactéries sont normalement présentes dans nos lacs et rivières en faible concentration. Elles contiennent des toxines, comme la microcystine, qui se libèrent lorsque les cellules se rompent ou meurent. Comme pour beaucoup d’autres enjeux du domaine de l’eau, tout n’est qu’une question de quantité.
Au Québec, plusieurs lacs ont été touchés dans les dernières années. Ce fut le cas cet été pour le lac Champlain, en Estrie, qui a vu une partie de ses prises d’eau situées dans la baie Missisquoi complètement contaminée pendant plusieurs semaines. Cela a posé un problème majeur pour la population, qui était dans l’impossibilité de consommer l’eau, mais également pour les industries situées sur le territoire. Cette problématique touche plusieurs autres points d’eau en Montérégie et dans le sud du Québec, mais aussi beaucoup plus au nord.
LES DIFFÉRENTS TRAITEMENTS
Pour traiter les cyanotoxines, plusieurs procédés peuvent être appliqués. Lorsque les cellules sont intactes, elles peuvent être éliminées physiquement par des méthodes de filtration traditionnelles ou membranaires. Les procédés de filtration précédés d’une décantation présentent toutefois certains risques de lyse cellulaire dans les décanteurs, ce qui peut augmenter la concentration de toxines dans l’eau traitée. La filtration directe membranaire est donc préférable.
L’utilisation d’oxydants chimiques, comme l’ozone ou le permanganate, permet de réduire la quantité totale de cyanotoxines, mais peut aussi accroître la concentration de toxines dissoutes, encore une fois à cause
de la lyse des cellules. Il est donc recommandé de procéder à l’oxydation chimique après avoir éliminé physiquement les cyanobactéries.
L’adsorption sur charbon actif est très efficace pour éliminer les toxines dissoutes comme les microcystines, mais elle ne traite pas les cellules intactes. Enfin, l’oxydation avancée (UV + peroxyde ou ozone + peroxyde) s’avère également une solution efficace contre les cyanotoxines qui sont logées dans les cellules de cyanobactéries. Des essais en laboratoire sont toutefois recommandés avant de mettre en place un procédé d’oxydation avancé pour un site particulier.
Il existe donc différents outils pour les municipalités et les industries qui font face à des enjeux de toxicité de l’eau liés aux cyanobactéries et aux cyanotoxines. Nous recommandons fortement aux producteurs d’eau ayant une source d’eau sensible à ces enjeux de mettre en place, de façon préventive, un plan d’action avec une combinaison de traitements préidentifiés et de solutions externes. Que ce soit pour gérer un problème de cyanobactéries ou d’autres enjeux de contamination ou de pénuries d’eau, de nombreuses municipalités doivent s’entendre, parfois en urgence, avec des municipalités voisines ou louer des systèmes de traitement temporaire pour avoir accès à de l’eau potable de qualité. En situation de crise, ce genre d’entente peut être particulièrement coûteux. Il est important de bien considérer l’eau pour ce qu’elle est : une ressource essentielle à notre confort et à notre survie, dont l’accès est non négociable pour la population.
Pour les collectivités, il est essentiel de travailler cet enjeu de façon globale, avec une gestion par bassin versant permettant une compréhension des rejets de polluants dans les points d’eau et une identification des situations critiques. Il va sans dire que les municipalités découvriront souvent que ces polluants viennent de rejets industriels, mais aussi municipaux, qui pourraient être contrôlés à la source de façon beaucoup plus efficace. Une stratégie de diagnostic et de traitements ciblés et une étape clef de la réduction des cyanobactéries. Cela peut vouloir dire un contrôle accru des rejets agricoles dans les cours d’eau tout comme la mise en place de traitements tertiaires adaptés pour la réduction du phosphore aux usines de traitement des eaux usées.
Nous recommandons fortement aux producteurs d’eau ayant une source d’eau sensible à ces enjeux de mettre en place, de façon préventive, un plan d’action avec une combinaison de traitements préidentifiés et de solutions externes.
Cela fait déjà six ans que je participe à la revue Source, et c’est toujours avec plaisir que je profite de l’occasion qui m’est donnée pour présenter des sujets chauds sur le traitement des eaux et des biosolides. Après 20 ans, on peut dire que Source est devenue un incontournable dans le domaine. Avec le vieillissement des infrastructures et l’ensemble des enjeux environnementaux auxquels nous faisons face, il ne fait aucun doute que le magazine aura encore sa place pour de nombreuses années ! n



LMe Thibaud Daoust Avocat associé, LL. B. Daigneault, avocats inc. thibaud.daoust@daigneaultinc.com
a création de l’Agence canadienne de l’eau est promise depuis 2019, au moment où le premier ministre du Canada a formellement demandé au ministre de l’Environnement et du Changement climatique d’en faire une priorité. Après s’être fait accorder un budget en 2023, l’Agence a été mise sur pied en tant qu’une des nombreuses directions d’Environnement et Changement climatique Canada. Sa loi constitutive, la Loi sur l’Agence canadienne de l’eau1, a été sanctionnée le 20 juin 2024, ce qui annonçait la fin du processus théorique de création de cette agence. C’est dans les faits le 16 octobre 2024 que l’Agence a finalement vu le jour à titre d’organisme autonome 2. Le présent texte brosse le portrait de cette organisation, en abordant le mandat et les responsabilités de ce nouvel acteur dans le domaine de la gestion et de la protection des ressources en eau douce.
Le mandat de l’Agence est d’améliorer la gestion de l’eau douce au Canada, principalement en jouant un rôle de coordonnatrice des projets qui impliquent différents organismes fédéraux, mais également à titre de partenaire de projets menés par les différents paliers de gouvernement, intervenants et peuples autochtones. L’Agence n’a donc pas pour rôle de faire appliquer la loi ou de mettre en place des régimes réglementaires liés à l’eau douce ; elle se contente de soutenir les efforts de gestion de l’eau douce, autant à travers les connaissances scientifiques qu’elle diffuse que le soutien matériel et financier qu’elle peut fournir. Cela étant, ses interventions restent assez variées, allant du suivi de l’état de l’eau douce à la coordination de stratégies pangouvernementales, en passant par la facilitation de l’accès aux données et outils fédéraux sur l’eau douce. Trois responsabilités se démarquent particulièrement.
L’une des responsabilités les plus importantes de l’Agence est la mise en œuvre du Plan d’action sur l’eau douce. Ce dernier a fixé plusieurs orientations d’importance visant l’amélioration de la qualité de l’eau douce ainsi que la restauration et la protection de huit plans d’eau d’importance nationale (soit les Grands Lacs, le lac Winnipeg, le lac des Bois, le lac Simcoe, le fleuve Saint-Laurent, la rivière Saint-Jean, le fleuve Fraser et le fleuve Mackenzie). À cet effet, l’Agence procède notamment à l’octroi de sommes d’argent pour des travaux de surveillance, d’évaluation et de restauration de ces plans d’eau d’importance nationale. Elle fournit également des fonds pour la diffusion de données scientifiques pertinentes à ceux-ci.
Un autre mandat d’importance de l’Agence est celui de la modernisation de la Loi sur les ressources en eau du Canada3. Cette loi, initialement adoptée en 1970 en vue de créer un cadre de gestion de la qualité des eaux fédérales ou d’intérêt national, doit être revue en profondeur par l’Agence. Celle-ci pourra soumettre ses recommandations de modification ou
1 Loi sur l’Agence canadienne de l’eau, L.C. (2024), ch. 15, art. 209.
d’amélioration de ce régime, pour lequel aucun règlement n'est actuellement en vigueur. L’Agence s’attardera notamment à l’adaptation de cette loi en tenant compte de l’évolution des droits des peuples autochtones et de la menace des changements climatiques. Une première vague de consultation pour les provinces et partenaires autochtones a eu lieu au courant de l’été 2024, et la consultation du grand public se déroulera au cours de l’année 2025.
Finalement, l’Agence aura aussi pour rôle d’élaborer la Stratégie nationale en matière de données sur l'eau douce. Cette stratégie aura pour objectif de déterminer les meilleures pratiques concernant l’organisation et le partage des données sur l’eau douce. Son but est ultimement d’améliorer, pour le grand public, l’accès à des banques de données diverses et complètes sur l’eau douce, en plus d’en améliorer l’intelligibilité. Un document de travail sur la création de cette stratégie a été publié à l’été 2024 afin d’obtenir des commentaires du public, après un atelier de consultation s’étant tenu en 2021. La finalisation et la publication de la version définitive de la stratégie peuvent donc être attendues à partir de 2025.
L’Agence de l’eau du Canada nous semble avoir un mandat intéressant et utile à plusieurs égards, particulièrement dans son rôle de coordonnatrice ou de facilitatrice dans la gestion de plans d’eau impliquant de nombreux intervenants, gouvernements ou peuples autochtones, de créatrice d’outils et de lignes directrices sur l’eau douce et de fournisseuse de fonds consacrés à la recherche et à la protection des plans d’eau. L’avenir nous dira si elle réussit à s’imposer comme un acteur incontournable de ce milieu. Par contre, de prime abord, il nous semble que l’Agence n’aura que peu de mordant pour faire valoir aux autres paliers gouvernementaux ses recommandations et opinions quant à la gestion des plans d’eau douce, car elle ne dispose d’aucun pouvoir réglementaire direct ou de manière de contrôler l’application des lois canadiennes sur l’eau douce. Il est donc à prévoir que sa sphère d’influence à titre d’agence de conseil et d’expertise se limitera, à tout le moins pour les premières années de son existence, aux organismes de l’ordre fédéral. n

2 Agence de l’eau du Canada. (2024). Lancement de l’Agence de l’eau du Canada à titre d'entité autonome. https://www.canada.ca/fr/agence-eau-canada/nouvelles/2024/10/lancement-de-lagence-de-leau-du-canada-a-titre-dentite-autonome.html
3 Loi sur les ressources en eau du Canada L.R.C. (1985), ch. 11.
Profitez des outils développés par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour sensibiliser votre population à l’économie d’eau potable, et la mobiliser à cet effet !
Votre eau, c’est notre eau à tous.

















Votre partenaire pour un futur plus durable, dès aujourd'hui.




Des formations adaptées aux réalités du marché du travail :





s n 2 E 0 s ha rat éri du at nviroFormations usée eaux autonome ement anisation tion d isation : u du réalités aux tions
Des formations adaptées aux réalités du marché du travail :
Assainissement autonome des eaux usées
Biométhanisation
Assainissement autonome des eaux usées
Biométhanisation
Restauration après-sinistre
Restauration après-sinistre
Caractérisation des sols et réhabilitation des sites
Caractérisation des sols et réhabilitation des sites









Ensemble, on va



Qu au et verte on pou manquer pas ne à ment
Un événement à ne pas manquer pour impulser la transition verte et numérique au Québec :
Cybersécurité : nouvelles tendances et meilleures pratiques
Cybersécurité
29 octobre 2024, en virtuel
29 octobre 2024, en virtuel
octob eilleu bersé mme nsiti vénem l Événement virtue en , re res e tendances nouvelles : curité num et verte transition la de t

Un événement à ne pas manquer pour impulser la transition verte et numérique au Québec :
Sommet de la transition verte et numérique de la main d’œuvre
30 janvier 2025, Maison Alcan, Montréal


Sommet de la transition verte et numérique de la main d’œuvre

As Bio Re Ca mar f Des u eaux des autonome ssainissement ométhanisation estauration réhabilitati et aractérisation : travail du ché réalités aux formations 3 n s e Diff site ion du r : M Mont Maison ,2025 30 travail de milieu d'apprentiss programmes férents
30 janvier 2025, Maison Alcan, Montréal

i s janv rent Montré Maison ,2025 ier n et d'apprentissa programmes

Différents programmes d'apprentissage en milieu de travail (PAMT) :
Des ressources pratiques pour accélérer la transformation durable de votre entreprise :
Portrait de la main-d'œuvre du secteur de l’environnement
Guides RH
Guides techniques
Guides techniques
Fiches métiers
Différents programmes d'apprentissage en milieu de travail (PAMT) :

Des ressources pratiques pour accélérer la transformation durable de votre entreprise :
Portrait de la main-d'œuvre du secteur de l’environnement
Fiches métiers
a urc nne de RH ec é :
votre de durable ion la accélérer pour ces ement de secteur du œuvremain-d' la e chniques ti






De nouvelles initiatives sont en route !
De nouvelles initiatives sont en route ! Restez à l’affût, les détails arrivent bientôt.
Restez à l’affût, les détails arrivent bientôt.

Technicien·ne en restauration après sinistre
Technicien·ne en restauration après sinistre
Technicien·ne en équilibrage de systèmes de ventilation et climatisation
Technicien·ne en équilibrage de systèmes de ventilation et climatisation
l e T 03 réa ag ftrans re Des l’en Por Gu Gu Fich rentrep votre de durable formation accélérer pour essources nvironnement secteur œuvre main-d rtrait RH ides ides hes T




Jeu interactif sur la promotion des métiers de l’eau
Jeu interactif sur la promotion des métiers de l’eau
Projets du Pôle d’expertise en transition verte
Études à venir
Études à venir
Projets du Pôle d’expertise en transition verte
Exemple : traitement de l’air intérieur


Opérateur·trice en nettoyage industriel
Opérateur·trice en nettoyage industriel
v T v T O
ilieu chnic ntilati chnic ntilati chnic érate : travail de pp g p s restauration en ne ien on systè de en ne ien on s de assainissement en ne ien industrie nettoyage en trice eur



s l i aprè restauration en ne Technicien et syst de en ne Technicien de assainissement en ne Technicien industr nettoyage en trice Opérateur e i sinistr de tèmes de riel eRest no De nbie arrivent détails les à ez ! route en sont ouvelles
Technicien·ne en assainissement de systèmes de ventilation
Technicien·ne en assainissement de systèmes de ventilation


p . op p La
Jeu Pro Exe Étu mé des la sur interactif u transition en Pôle du ojets de : emple venir à udes l’eau de tiers verte n
e
Exemple : traitement de l’air intérieur 2 m C l S t la Un l Événemen virtue en , meilleures tendances nouvelles : i j d’œuvre a num et verte transition la de Sommet Q au et verte ransition po manquer pas ne à événement t s 01 t e s de mérique : Québec ur
et verts secteurs les dans tés trouve pour référence de rme
Visibilité accrue et engagement concret des entreprises pour accélérer la transition verte
Accès à un réseau spécialisé
La plateforme de référence pour trouver des opportunités dans les secteurs verts et durables :
La plateforme de référence pour trouver des opportunités dans les secteurs verts et durables :
Visibilité accrue et engagement concret des entreprises pour accélérer la transition verte
Accès à un réseau spécialisé
Affichage illimité Prix compétitif

ix
Affichage illimité Prix compétitif
transitio la accélérer pour rises conc engagement et accrue é réseau un illimité ge mpétitif



verts secteurs les dans portunités trouv pour référence de transitio la accélérer pour con engagement et accrue Visibilité réseau un à Accès illimité Prix : s o durables t des ver verte on des cret
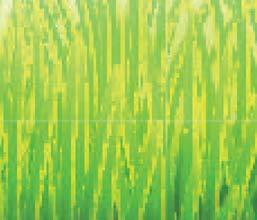
Faites le choix de l' l'engagement environnemental EnviroCompétences


Faites le choix de l'expertise et de environnemental
Le futur se construit dès maintenant.
Le futur se construit dès maintenant.
www.envirocompetences.org
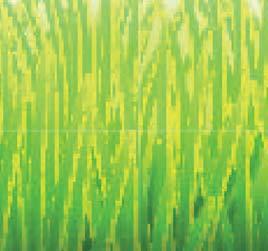





CONTACTEZ-NOUS 450-508-1515
Info@maya.cc
Pour la réalisation de toutes vos vidéos
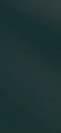




Compteur d’eau ultrasonique SONATATM
Daniel Langlois, ing. Directeur général Master Meter Canada dlanglois@mastermeter.com www.mastermeter.com











