






La Présidente de l’Unaf Marie-Andrée Blanc s’est rendue à Matignon pour célébrer le 120e anniversaire la loi du 1er juillet 1901 relative à la liberté d’association. L’Unaf était invitée aux côtés du Premier Ministre et de 120 associations nationales particulièrement mobilisées durant la crise sanitaire.


L’Unaf a participé au comité de pilo tage national des Points conseil budget qui a notamment permis de valider les modalités du 3e appel à manifes tation d’intérêt pour l’attribution de 100 nouveaux labels. Avec 180 Points conseil budget portés par les Udaf dans 89 départements, labellisés lors des deux premières vagues, notre réseau est le 1er réseau d’accompa gnement budgétaire. À la suite de cette 3e vague, ce chiffre monte à plus de 210 labels.
L’Unaf a signé, avec l’Etat et une trentaine d’acteurs, un nouveau protocole d’engagement pour prévenir les usages excessifs des écrans et faciliter l’accès des parents à une information fiable. Le site « Jeprotègemonenfant », initialement créé pour sensibiliser et outiller les parents face aux dangers de l’expo sition massive des enfants à la pornographie, sera progressivement élargi pour devenir un portail d’information unique sur la parentalité numérique.
L’Unaf, avec son réseau, est déjà très engagée sur ces probléma tiques, et anime deux portails dédiés : mon-enfant-et-les-écrans.fr et pédagojeux.fr
savoir +
Points conseil budget Udaf labellisés
Après 15 ans d’interruption, la Conférence des familles des 5 et 6 octobre, organisée par Adrien Taquet, secrétaire d’Etat en charge de l’Enfance et des familles, a réuni les différents acteurs concernés : usagers, opérateurs, ins titutions… pour échanger collectivement sur les orientations de l’action publique à destina tion des familles. L’Unaf, mobilisée de longue date sur les questions de conciliation vie familiale-vie professionnelle, a été largement associée à sa préparation, en organisant le recueil des besoins des parents à l’arrivée d’un enfant au travers d’une large démarche d’en quête (lire page 4). Elle a également participé aux tables-rondes autour des 1000 premiers jours de l'enfant et sur la conciliation. Cette Conférence des familles a permis de réunir tous les acteurs de la politique familiale et de démontrer qu’il y avait consensus sur les actions à mener dans les prochains mois pour améliorer la vie des familles.


Parmi les nombreux sujets de mobilisation pour les familles, cette rentrée a été particulièrement marquée par le retour de la Conférence des familles, organisée par Adrien Taquet.
Ce rendez-vous est un signe positif pour la politique fami liale et l’Unaf, en tant qu’experte des réalités de vie des familles, y a pris toute sa part. Nos efforts ont particuliè rement porté sur un large travail d’enquête pour recueillir les besoins des parents en matière de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, auquel le dossier de ce numéro de Défendre les familles est consacré.
Seuls
des parents considèrent qu’un mode de garde hors de la famille est préférable pour un enfant de 0 à 6 mois Source : Compte-rendu d’enquête quantitative sur le parcours de conciliation des parents de jeunes enfants, Unaf (septembre 2021)
Jusqu’à 7 pères sur 10 auraient modifié leur parcours si le congé parental était mieux indemnisé.
Cette Conférence a ainsi été l’occasion de relayer les attentes des parents et de porter nos propositions pour mieux répondre à leurs besoins. Nous avons pu rappeler qu’après l’échec de la réforme du congé parental en 2015, non seulement les pères n’ont pas mieux pris ce congé, mais le taux de chômage des mères a augmenté. La clef d’un congé parental qui réponde aux besoins des parents repose sur une meilleure indemnisation, plébiscitée par les premiers intéressés qui ne veulent sacrifier ni leurs revenus, ni leur emploi, ni leur carrière pour s’occuper de leur enfant.
L’allongement du congé paternité en 2021 a constitué un premier pas. En 2022, la Présidentielle d’avril, l’applica tion de la directive européenne « Work life balance » en août et la renégociation de la Convention d’objectifs et de gestion de la branche famille à l’automne, seront autant d’opportunités pour faire avancer la France en matière de conciliation.
Mobilisée de longue date sur les questions de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, l’Unaf a lancé une large démarche d’enquête sur les besoins des parents à l’arrivée d’un enfant dont les résultats qui ont été versés aux travaux de la mission Damon-Heydemann1, ont été publiés à l’occasion de la Conférence des Familles les 5 et 6 octobre.
des parents considèrent qu’ils sont eux-mêmes le meilleur mode de garde pour leur nouveau-né de moins de 6 mois.
Entre avril et juin 2021, l’Unaf, appuyée par le réseau des Udaf et des associations fami liales, a mené 3 études pour collecter l’avis et les témoignages de jeunes familles. Une étude qualitative approfondie auprès de 45 parents, une étude quantitative auprès de 2000 parents et la synthèse de 13 débats avec les parents organisés par des Udaf dans 12 régions de France et 1 DOM. Les témoi gnages collectés confirment qu’il n’y a pas de parcours type mais que tous les parents ont besoin de « lever le pied » à la naissance de leur bébé. La plupart sont obligés de jongler avec des moyens souvent informels pour pouvoir s’occuper de leur enfant.
chômage, congés, congés sans solde…
• Laisser son bébé, si petit, est culpabilisant : 86 % des parents considèrent qu’ils sont eux-mêmes le meilleur mode de garde pour leur nouveau-né de moins de 6 mois.
• Trouver un mode d’accueil reste un par cours difficile : 60 % des parents ont ren contré des difficultés dans leur recherche de mode de garde.
• Le retour en entreprise n’est pas facilité. Une mère témoigne : « L’employeur n’était pas conscient que j’avais un bébé, qu’il fal lait aménager un minimum mon temps de travail pour que je puisse le voir. Ce n’était pas une vie, mentalement c’était très com pliqué. »
1/ Mission sur la conci liation vie familiale-vie professionnelle confiée par Elisabeth Borne, ministre du Travail, et Adrien Taquet, secrétaire d’Etat à l’Enfance et aux familles, à Christel Heydemann, Présidente de Schneider Electrics et Julien Damon, directeur de l’EN3S.
Défendre
• L’arrivée de l’enfant bouleverse toute la vie des parents : 84 % des mères et la moi tié des pères déclarent que la naissance a eu une ou plusieurs conséquences sur leur vie professionnelle. Pour les mères : réduc tion des horaires de travail 33 %, change ment d’employeur 18 %, de poste 16 %, de métier 16 %, de lieu de travail 14 %, démis sion 7 %, rupture conventionnelle 5 %.
• Après la naissance, les parents ne se sentent plus suivis. Une mère témoigne : « Pendant la grossesse on est hyper bien entourée mais à partir de l’accouchement plus rien, on n’a plus de droit, personne ne nous suit. »
• La reprise du travail est trop rapide. 2/3 des mères utilisent une solution formelle ou informelle pour prolonger le congé maternité : congés payés, congé parental,
• Faire garder son bébé a un coût. Un père témoigne : « J’avais moins de 1000 euros, financièrement on ne pouvait pas faire garder notre fille, c’était trop juste. »
• Dans certains cas, les parents ont encore plus besoin de temps (gémellité, prématu rité, handicap). Une mère témoigne : « J’ai deux garçons qui sont nés prématurés. J’ai été obligée de prendre un congé parental : c’était soit les garçons soit le boulot. »
• La disponibilité des pères est compliquée. Une mère témoigne : « J’ai fait une dépres sion après l’accouchement, je me suis sen tie complètement seule avec mon bébé, mon conjoint travaillait. »
• Il y a un manque d’information sur les droits, notamment des pères. Un père témoigne : « Il y a plein de droits qu’on ne connaît pas. (…) J’aurais fait différemment si j’avais su. »
• Les mères et les pères plébiscitent le congé parental, s’il était mieux indem nisé : plus de 90 % des mères et 60 % des pères auraient modifié leurs parcours s’ils avaient pu bénéficier d’un congé parental mieux indemnisé. Les 5 bénéfices présu més d’un congé supplémentaire indem nisé ou d’un temps partiel sont : moins de stress, plus de bien-être pour l’enfant, une meilleure situation économique de la famille, moins de fatigue, meilleure santé, et un meilleur retour au travail.
1. Créer un congé parental, accessible à tous, mieux indemnisé (75 % du revenu) jusqu’au 1 an de l’enfant.
2. Améliorer l’information des mères et des pères sur leur droits, dès la grossesse.
3. Développer les ressources disponibles pour les parents en difficultés après l’accouchement et l’accompagnement à la parentalité dès les premiers mois de l’enfant, notamment en PMI.
4. Prévoir des solutions de reprise du travail en douceur.
5. Garantir une place d’accueil, notamment à l’issue du congé parental.

6. Quel que soit le mode de garde, réduire les restes à charge les plus élevés.
7. Permettre un congé parental indemnisé jusqu’aux 3 ans de l’enfant à temps partiel ou complet, notamment pour les parents dont les enfants requièrent une présence parentale renforcée (prématurité, nais sances multiples, pathologies, handicap, adoption).
8. Instituer un droit de demande d'aména gement horaire, de temps partiel ou de travail à distance, au moins jusqu'aux 8 ans de l'enfant, avec obligation de moti ver le refus.
Si l’allongement du congé paternité est un premier pas, l’élection Présidentielle en mai 2022, l’application en juillet 2022 de la directive européenne Work life balance et la renégociation de la Convention d’objec tifs et de gestion de la branche famille, sont autant d’opportunités pour faire avancer la France en matière de conciliation. L’Unaf milite pour que des mesures soient mises en œuvre afin de permettre aux parents d’avoir le temps de s’occuper de leur enfant sans sacrifier leurs revenus, leurs emplois, ni leurs carrières.
www.unaf.fr
Pour garantir le pouvoir d’achat des différentes prestations de Sécu rité sociale, leur montant ou leur modalité de calcul - comme les pla fonds de ressources qui conditionnent leur accès - sont revalorisés chaque année, en fonction de l’indice des prix. Ce principe figure à l’article L161-25 du Code de la Sécurité sociale : « La revalorisation annuelle des montants de prestations […] est effectuée sur la base d'un coefficient égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac […]. Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur. »
Mais ce principe a récemment été mis à mal : en 2018 et 2019, le Gouvernement est intervenu en proposant dans les projets de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) une revalorisation infé rieure à l’inflation. Ainsi, en 2019 puis en 2020, les prestations fami liales ont été sous-indexées, avec une revalorisation de seulement 0,3 %, bien en dessous de l’inflation.
La sous-indexation des prestations familiales est vivement dénoncée par l’Unaf. Le quasi-gel des montants occasionne en effet des pertes de pouvoir d’achat pour les familles. C’est encore pire si la prestation finance des services, comme le complément mode de garde (CMG) pour le recours à une assistante maternelle : la hausse des salaires étant souvent plus rapide que la hausse des prix, le reste à charge des familles augmente ainsi mécaniquement.
Éric Prost, Président de la CAF de l’Ain et Chef de file de la délégation de l’Udaf de l’Ain à la CAF, répond aux question sur la mise en place des CTG dans son département
Comment se passe la mise en place des CTG dans votre département ?
Éric Prost : Le déploiement des CTG est en bonne voie dans l’Ain. En effet, malgré la crise sanitaire nous pensons tenir l'objectif de 85 % de la population couverte par une CTG avant la fin de la COG1. Dès 2018, nous avons vu avec les services la méthode à mettre en place pour arriver à ce résultat : des objectifs de signature de CTG étaient fixés pour chaque année de la CPOG2.
Ces dernières années on observe un certain « déport » de missions d'animation territo riale antérieurement assurée par les services de l'État. Ces nouvelles missions désormais confiées aux CAF constituent un change ment important de positionnement qui a permis de revaloriser l'image de la CAF et de construire de véritables relations partena riales solides avec les élus locaux.
Dans l’Ain, nous avons notamment déve loppé des pactes de coopération territoriale autour des équipements d’animation de la vie sociale. Cet outil spécifique à notre département a été un véritable levier pour engager les travaux sur les CTG. Au-delà de cet outil, toutes les rencontres avec les élus, et notamment les inaugurations d’équipe
ment, sont des occasions pour promouvoir la démarche CTG. Une fois les élus convain cus par l’intérêt de ce travail, on fonctionne en plusieurs étapes : d'abord on s’accorde avec la collectivité sur la méthode de tra vail, ensuite on réalise un diagnostic par tagé, puis on détermine un plan d'action ; la démarche se conclut par la signature d’une CTG.
Quelle place ont les administrateurs de la CAF dans les CTG ? Nous avons organisé pour la mise en place de la CPOG, un séminaire des administra teurs. Ce travail avait été productif et appré cié. Nous avons envisagé l'organisation d'un séminaire de ce type sur les CTG afin de les former sur les enjeux, la méthode et le suivi de ces conventions. Malheureusement la crise sanitaire nous a contraints à l'annuler. Cependant, nous n'avons pas renoncé à impliquer les administrateurs dans les CTG. Dans notre CAF, les administrateurs sont déjà sectorisés sur des territoires particu liers. C'est pourquoi nous souhaitons mettre en place un binôme : administrateur / tech nicien afin d'assurer le suivi de la mise en œuvre des CTG.
Pour nous, il était essentiel de consolider les liens entre les administrateurs de la CAF et les acteurs de terrain. C'est d'ail leurs également dans cette optique, que nous nous efforçons au moins une fois par an, d'organiser un conseil d'administration
« décentralisé » soit auprès d'une collecti vité territoriale ou d'un partenaire ou dans un établissement financé par la CAF (centre social, crèche...). C'est l'occasion de rencon trer les élus et les professionnels et d'échan ger sur leurs projets ou leurs difficultés.
Des difficultés peuvent survenir avec des collectivités territoriales de taille impor tante, elles supposent un nombre d'inter locuteurs et d'élus plus élevé à concerter.
Les relations partenariales sont alors un peu plus complexes et peuvent entraîner des incompréhensions mutuelles qui peuvent retarder le travail d'élaboration. Il convient d'être particulièrement attentif au rôle et positionnement de chacun afin de préserver l'esprit de la CTG et la dynamique partena riale qui est un outil commun au service de tous : institutionnels et habitants.
Une autre difficulté porte sur les moyens déployés ; en effet, le travail d'animation territoriale implique des professionnels qua lifiés, parfois difficiles à trouver sur le mar ché du travail, et suffisamment nombreux.
Ces postes nécessitent de maîtriser les enjeux, négocier avec les élus et avoir une connaissance fine des différentes politiques portées par la CAF.
Il y a interaction entre les CTG et le Schéma. En effet les diagnostics partagés des CTG peuvent alimenter le schéma dans une logique ascendante et faire remonter les besoins et les projets locaux. Cela peut aider à la décision et à définir une stratégie. Les CTG constituent également l'outil opéra tionnel de déclinaison locale du schéma.
L'idée est aussi de se saisir des opportuni tés offertes par la Loi d'Accélération et de simplification de l'action publique (adoptée récemment) qui mettra en place les comités départementaux des services aux familles.

Nous devons rencontrer la Préfète très pro chainement afin de lui proposer de mettre en place des comités locaux où pourront siéger les administrateurs de la CAF avec les associations et partenaires en proximité au plus près des territoires d'intervention.
La Convention territoriale globale (CTG) est une convention de partenariat visant à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants d’un territoire. Elle se concrétise par la signature d’un accord entre la CAF et :

• soit le Conseil départemental à l’échelon du département ;
• soit une commune ou une communauté de communes.
Elle concerne tous les champs politiques de la branche famille (petite enfance, animation de la vie sociale, parentalité, inclusion numérique, lutte contre les inégalités, logement…).
Regarder la vidéo diffusée par la CAF du Maine-et-Loire www.youtube.com
Les CTG ont-ils été articulés avec le schéma départemental des services aux familles de votre département ?
Le rapport de la Commission des Comptes de la Sécurité Sociale (CCSS), publié chaque année en juin, analyse la situa tion financière de la Sécurité sociale, avec la présentation des résultats de l’exercice passé et des prévisions sur l’année à venir.
S’agissant de la branche famille, en 2020, « le solde de la CNAF s’est établi à -1,8 Md €, soit une dégradation de 3,3 Md € par rapport à 2019 sous l’effet de la crise de la Covid-19. Cette chute s’explique entièrement par le repli des recettes (-6,3 %) alors que les dépenses ont progressé très modérément (+0,2 %). »
Les prestations familiales sont restées stables en 2020 : la PAJE (lire encadré ci-contre) s’est repliée de 6,8 % en 2020 du fait des confinements du moindre recours au complément mode de garde et de l’alignement des plafonds de l’allocation de base sur ceux du complément familial. Inversement, les dépenses de prestations ont été portées par la revalorisation exception nelle de 100 € de l’Allocation de rentrée scolaire.
En 2021, les prévisions de la CCSS tablent sur un excédent de 0,5Md € sous l’effet de la reprise économique. L’année 2021, les prestations légales baisseraient fortement (-4 %) principalement du fait du transfert du financement de l’Allocation d’éducation de l’en fant handicapé (AEEH) à la nouvelle branche autonomie. À prévoir, également, une baisse des dépenses de l’Allocation de rentrée scolaire (ARS), revalorisée exceptionnellement en 2020. Les pres tations familiales seraient portées à la hausse par le retour à un niveau antérieur de la PAJE à la suite d’une baisse en 2020 du recours au complément mode de garde du fait des confinements.
A noter également qu’en 2021, la CCSS prévoit une augmenta tion de 2,1 % des transferts de charges de la branche famille, qui finance la prestation, vers la branche maladie, qui opère son versement, à la suite de l’allongement du congé paternité de 11 à 25 jours depuis le 1er juillet.
Dans un contexte de baisse des naissances, sans mesure nouvelle, la dépense de la branche famille s'oriente à la baisse, alors que ce décrochage devrait inciter les pou voirs publics à réinvestir dans la politique familiale. Les recettes de la branche famille ne doivent plus servir à financer d’autres politiques publiques alors que les besoins des familles sont loin d'être couverts.
La chute spectaculaire du nombre de béné ficiaires de la Prépare et les nombreux rapports sur le sujet doivent alerter le Gouver nement sur l’urgence de réformer.
L’Unaf insiste aussi sur la nécessité, au vu des risques inflationnistes (lire page 5), de respecter les règles de revalorisation des prestations familiales contrairement à ce qui a été fait dans le passé.
Les besoins des familles et les enjeux sont considérables en termes d’emploi, de démo graphie, d’égalité professionnelle. La poli tique familiale ne doit plus être vue comme un coût, mais comme un investissement.
La PAJE, ou Prestation d’accueil du jeune enfant, est un ensemble de prestations :
• Prime à la naissance / à l'adoption : allocation versée en 1 fois sous condition de ressource pour faire face aux premières dépenses liées à l’arrivée de l’enfant.
• Allocation de base : allocation mensuelle sous condition de ressource qui permet d’assurer les dépenses liées à l’entretien et à l’éducation des enfants de moins de 3 ans.
• Prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) : indemnité mensuelle en cas de suspension /réduction de l’activité professionnelle pour élever un jeune enfant
• Complément de libre choix du mode de garde (Cmg) : aide financière pour diminuer le reste à charge des familles qui font garder leur enfant de moins de 6 ans (assistant maternel, garde à domicile, association ou entreprise habilitée, micro-crèche)
La PAJE représente 10Md€, soit 33 % de l’ensemble des prestations légales financées par la CNAF en 2020.
Source : Rapport de la CCSS, 2020
Défendre les familles, le magazine des représentants familiaux« Je suis représentant familial au sein de 4 CCAS : Valognes (6 800 habitants), Fla manville (1 800 habitants), Saint-Vaastla-Hougue (1 700 habitants), et SainteMère-Eglise (3 000 habitants). Ces CCAS interviennent dans des domaines variés : aides financières directes, résidence services pour personnes âgées, voyages intergénérationnels, aides au permis de conduire, repas des aînés, colis de nour ritures et bons alimentaires, attribution de logement sociaux. J’y siège depuis 2020 mais j’avais déjà siégé en CCAS dans un autre département entre 2008 et 2016.
Pour moi, défendre les familles, c’est faire écho à leurs différents besoins dont on peut avoir connaissance pour notre implication en association familiale, évo quer et susciter des partenariats avec d'autres acteurs sociaux locaux, appor
ter une expérience aux élus parfois nou veaux qui ne connaissent pas toujours les dispositifs existants en complément du CCAS, apporter un regard extérieur pour aider à l'impartialité et la réflexion. La difficulté, mais qui est aussi un moteur, c'est justement la diversité des représentations et domaines d'interven tion, qui demandent de se former et se renseigner pour gagner en compétence et en pertinence dans cette défense des familles. Représenter les familles au sein des CCAS des communes où je ne réside pas (je vis à Valognes), est particulière ment intéressant car j’apporte un regard plus neutre. Dans les petites communes avec des élus de longue date, les per sonnes connaissent depuis longtemps les familles et certains a priori peuvent influencer le débat. »

« Je suis représentante familiale au sein du CCAS de Varennes sur Allier, commune de 3 500 habitants. Le CCAS intervient dans le domaine de l’aide à la personne : il informe et oriente le public dans le cadre de la prévention sociale ; instruit les demandes d’aides du Conseil Départemental et de la commune ; gère de nom breux services à destination des personnes âgées. Le CCAS a été mis en place en 2020 suite aux dernières élections municipales. Il s’agit de mon premier mandat. Défendre les familles, chacun peut le faire à son niveau au quotidien en étant simplement un relais ou un soutien. Défendre les familles, c’est d’abord s’assurer qu’elles puissent toutes avoir accès aux informations sur les aides et services qui peuvent leur être apportés. C’est aussi prendre en compte leurs besoins, essayer de proposer des solutions et surtout ne pas laisser des personnes sur le bord du chemin avec leurs interrogations. J’ai le sentiment de faire quelque chose d’utile pour ma commune car je participe à des projets et à des échanges qui peuvent concerner de nombreuses familles. Le CCAS est en train de finaliser son Ana lyse des Besoins Sociaux (ABS). J’y ai participé bien entendu. C’est vraiment un travail enrichissant car il permet d’établir une photographie de la commune sur différents champs : parentalité, santé, emploi, logement, etc. Cela permet aux membres du CCAS de se rendre compte de toute l’étendue du champ de compé tence de cette instance et de connaître les points forts et les points à améliorer dans la commune. Bien connaitre son territoire, c’est un premier pas pour aider les familles. C'est difficile de se dire qu’on ne pourra pas étudier et régler toutes leurs difficultés au cours de notre mandat. Mais si on peut ouvrir la voie et per mettre à l’équipe suivante de poursuivre le travail commencé, c’est déjà super.

Guillaume Paris, représentant familial en CCAS dans la Manche
Estelle Penay, représentante familiale en CCAS dans l’AllierAIDE À DOMICILE
En tant qu’adhérentes des Udaf, les associations ADMR comptent de nombreux bénévoles qui représentent les familles au sein des CCAS/CIAS.
Mais elles constituent aussi le 1er réseau associatif de services à la personne.
L’Union nationale ADMR nous en dit plus sur ces interventions dans les territoires.
Quels sont les domaines d’intervention de l’ADMR auprès des familles ?

Le réseau ADMR intervient auprès de toutes les familles, quelle que soit leur composition.
Les salariés des associations ADMR peuvent répondre à différents besoins, qui varient selon les moments de la vie et les situations individuelles : aide et soins pour les per sonnes âgées et pour les personnes en situa tion de handicap, garde d’enfants, entretien de la maison, réalisation de petits bricolages, portage de repas, aide aux aidants…
Si ces prestations sont principalement réa lisées au domicile des familles, le réseau ADMR dispose aussi de lieux d’accueil spé cifiques (crèches, haltes-garderies, habitats inclusifs, EHPAD, accueils de jour…). Ainsi, l’offre de services du réseau ADMR a été construite pour être très large, l’objectif étant de proposer une solution adaptée aux choix des personnes accompagnées ainsi qu’à leurs besoins.
Quels sont les modes de relation avec les CCAS et CIAS ?
L’ADMR intervient en partenariat avec les CCAS et les CIAS pour la gestion d’activités de service à la personne sur les territoires.
Par exemple, un CCAS peut participer finan cièrement à l’activité de portage de repas de l’ADMR, afin de limiter le reste à charge des bénéficiaires du service. Les fédérations du réseau ADMR peuvent aussi être amenées à reprendre les services d’un CCAS ou d’un CIAS ou à travailler en étroite collaboration pour couvrir des zones insuffisamment couvertes.
L’Union nationale ADMR salue le principe de ce tarif plancher qui permet de rompre avec les inégalités territoriales qui existaient. Il contribuera à une meilleure prise en charge des coûts de revient des services d’aide à domicile. Cette revalorisation universelle permettra un développement de l’offre et de la couverture des besoins sur tous les territoires.
Cette disposition peut-elle contri buer à améliorer l’attractivité des métiers de l’aide à domicile ?
Une avancée majeure peut d’ores et déjà être saluée grâce à l’agrément de l’avenant 43 de la convention collective de la branche de l’aide à domicile, qui a permis, depuis le 1er octobre 2021, une revalorisation signifi cative des salaires et l’accès à des parcours professionnels plus attractifs au sein de notre Branche.
Les dispositions du PLFSS 2022 n’auront qu’un impact modéré sur l’attractivité des métiers de l’aide à domicile. En effet, elles n’ont pas pour vocation première de financer des augmentations salariales. Néanmoins, la création des dotations qualité, qui seront versées aux structures sous conditions et après signature d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) avec le Conseil départemental, peut représenter un levier d’attractivité. En effet, ce financement
Défendre les familles, le magazine des représentants familiauxcomplémentaire pourra notamment soute nir les actions d’amélioration de la qualité de vie au travail pour les intervenants, qui sont indispensables au bien-être et à l’engage ment des collaborateurs.


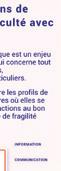
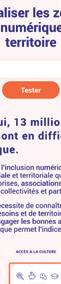
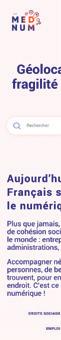
13 millions de Français sont en difficulté avec le numérique. Pour les personnes concernées, ces difficultés peuvent être de véritables entraves à l’insertion sociale et professionnelle et parfois à l’accès au droit. Les risques d’exclusion sont démultipliés depuis la crise sanitaire, qui a rendu le numérique encore plus indispensable.
Pour mieux mesurer et cibler ce phénomène, La Mednum1 a mis en place un outil en ligne qui permet d’identifier les fragilités numé riques d’un territoire donné : l’indice de fragilité numérique (IFN). En croisant différents critères et sources de données, cet indicateur a pour vocation d’identifier les profils de personnes, de besoins et de territoires où elles se trouvent via une cartographie hébergée sur une plateforme en ligne. Destiné aux associations, organismes de sécurité sociale et service des collectivités, comme les CCAS et les CIAS, il permet de repérer les publics à risque et d’orienter au mieux les actions de médiation numérique.
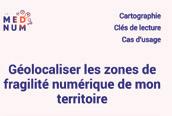
La mise à jour du portail de la fragilité numérique permet d’accéder à deux IFN : l’IFN « classique » et sa déclinaison « séniors », qui concerne les 50 ans et plus. L’IFN séniors permet une meilleure appréhension des difficultés particulières de ces populations, en y intégrant des variables spécifiques.

1. Rendez-vous sur fragilité-numérique.fr et saisir la commune dans la fenêtre de recherche.
2. Lecture : la teinte de la carte révèle le risque de fragilité numérique de la commune : du vert (signe d’un risque faible) au rouge (risque important).
3. Dans la colonne de gauche, il est possible de choisir l’IFN classique ou séniors, et pour chaque indice, d’inclure ou d’exclure certaines données de son calcul.
Augmentation de des volumes de denrées alimentaires distribuées par les associationss en 2020
Les volumes de denrées alimentaires distribuées par les associations ont augmenté de 10,6 % en 2020 par rapport en 2019, selon les premiers résultats d’un dispositif de suivi de l’aide alimentaire mis en place par la Drees et l’Insee. Les inscriptions ont quant à elle augmenté de 7,3 %.
Cette hausse de la demande d’aide alimentaire, bien plus marquée que les années précédentes, traduit à la fois un « afflux de nouveau bénéficiaire et un recours plus important pour les personnes inscrites de plus longue date », expliquent l’Insee et la Drees. Plus marquée au second semestre 2020, cette hausse serait liée à la crise sanitaire et se poursuit début 2021, selon ces résultats provisoires confirmés par le ressenti des responsables des sites de distributions, notamment des CCAS et CIAS, interrogés dans le cadre de l’enquête.
Parmi les publics reçus, ceux qui semblent augmenter le plus fortement sont les personnes seules, les familles monoparentales, et les travailleurs précaires. Une enquête est en cours auprès des bénéficiaires pour mieux connaître ces publics en situation de grande précarité et déterminer si le basculement dans l’aide alimentaire est du fait de la crise sanitaire. Les résultats seront publiés au printemps 2022.
1. La MedNum est une coopérative qui rassemble tout un réseau d’acteurs de la médiation numé rique, qui œuvrent pour les personnes éloignées du numérique.
Le Haut conseil pour l’avenir de l’Assurance maladie (HCAAM) a publié en 2021 un avis sur la régulation du système de santé présentant 19 propositions pour transformer le système de santé français. Retour sur les constats, objectifs et principales propositions.

1. Besoin d’investissements conséquents nécessaires pour garantir une réponse de qualité en santé et en maintenir l’excel lence. Ces investissements concernent notamment : l’innovation, la prévention et une restructuration de l’offre de soins.
2. La vision court-termiste du cadre de régu lation actuel du système de santé n’est pas compatible avec cet objectif. Les besoins nécessitent des réformes de moyen et long termes.
3. Besoin de développer la démocratie poli tique, sociale et sanitaire, avec plus de transparence et accessibilité.
Pour le HCAAM, une refonte de l’ONDAM permettrait d’intégrer la prise en charge les dépenses organisationnelles, des dépenses épidémiologiques – c’est-à-dire les patholo gies chroniques évitables – et des dépenses d’investissement (visant à réduire les autres dépenses dans le temps).
Pour répondre à cet objectif, le HCAAM pré conise : premièrement, doter le système de santé d’une trajectoire pluriannuelle – sur 5 ans – liant objectifs de santé, transformation du système des soins, et moyens humains, matériels et financiers ; deuxièmement, pour suivre la territorialisation des politiques de santé.
Plusieurs propositions semblent particulière ment intéressantes pour l’Unaf. En particu lier, une dizaine de propositions consistent à assurer un respect d’objectifs de santé (visant notamment à renforcer la structuration de l’offre de soins et à favoriser la prévention), au lieu de se limiter, comme c’est le cas aujourd’hui, au respect d’objectif financiers. Une telle mesure permettrait alors un arbi trage entre objectifs de santé, organisation des soins et objectif de respect des dépenses de santé. Le HCAAM souligne que pour facili ter cet arbitrage, il est néanmoins nécessaire d’améliorer la compréhension et la lisibilité du système de santé. 4 propositions visent ainsi à répondre à ce besoin.
Un autre ensemble de propositions vise à mettre en place une stratégie nationale en santé unifiée, afin de définir des priorités trans versales et de définir une stratégie sur long terme nécessaire à l’investissement, l’innova tion et la prévention, qui ne peut aujourd’hui être efficace du fait d’un vote annuel via la Loi de finance de la Sécurité sociale (LFSS).
Le HCAAM complétera cet avis avec un rap port sur les évolutions à proposer concernant l’articulation entre assurance maladie obliga toire et complémentaire.
En savoir + Avis du HCAAM sur la régulation du système de santé
Consulter l’avis du HCAAM sur la régulation du système de santé
86% des Français considèrent que l’Assurance maladie a joué un rôle pour réduire les conséquences négatives de la crise sanitaire.
Le 9 novembre, Thomas Fatome, Directeur Général de la Cnam et Marie-Andrée Blanc, Présidente de l’Unaf ont signé une convention nationale cadre, qui pourra être décliné au niveau départemental entre les Cpam-Carsat et les Udaf.

Les principaux objectifs de cette convention sont de favoriser l’accès aux droits et soins et de développer la prévention, en particulier pour 3 publics : les familles monoparentales, les personnes bénéficiant d’une mesure de protection et les aidants familiaux. Cette convention, en laissant une grande place aux initiatives locales, vise la promotion de nouvelles coopérations entre nos deux réseaux. Une déclinaison au niveau local permettra également d’améliorer la connaissance mutuelle entre Cpam-Carsat et Udaf, avec notamment la désignation d’un référent dans chaque organisme afin de faciliter les échanges, l’orientation des personnes et la résolution de problème.
Contact : Votre Udaf souhaite décliner la conven tion Cnam-Unaf sur son département ? N’hésitez pas à prendre contact avec Céline Bouillot, chargée de mission assurance maladie à l’Unaf : cbouillot@unaf.fr
Les bénéficiaires des prestations sociales et des minima sociaux qui se voit réclamer des indus peuvent, dans un délai de 20 jours à réception de la notification d’indu, demander à l’administration de rectifier les informations erronées à l’origine de cette procédure. En ce cas, le délai de saisine de la CRA est interrompu. Ce délai recommence à réception de la décision (acceptation ou refus) de la demande de rectification, ou après un délai d’un mois. En l’absence de réponse de l’administration, la demande de rectifi cation est réputée refusée. Le recouvrement des sommes indûment perçues ne peut alors intervenir qu’après un délai de 2 mois.
L’Unaf avait, à plusieurs reprises, alerté les pouvoirs publics de l’effet déstabilisant sur le budget des familles de la récupération des indus. C’est pourquoi l’Unaf se félicite de cette nouvelle disposition. En revanche elle a exprimé au sein du Conseil de la Cnam son désaccord à ce que l’absence de réponse vaille refus.
Ce rapport dresse un panorama des profes sionnels de santé de l’enfant qui se révèle préoccupant selon ses auteurs. Ces derniers soulignent ainsi que les différentes compo santes de la médecine ambulatoire de l’en fant sont en crise.

Ainsi, la pédiatrie libérale connaît un recul démographique important, particulièrement marqué pour les pédiatres de secteur 1.
Actuellement, 8 départements connaissent une densité inférieure à un pédiatre pour 100 000 habitants et l’âge moyen des pédiatres libéraux laisse présager une aggra vation de la situation puisque 44 % d’entre
eux ont plus de 60 ans. Cette situation pose une question majeure d’accès aux soins pédiatriques pour certaines populations. Cet enjeu est renforcé par la contraction des effectifs médicaux de la PMI et de la médecine scolaire, dont le rôle préventif est essentiel, en particulier auprès des plus précaires. L’Unaf, qui a été auditionnée par les membres de l’IGAS, avait d’ailleurs souli gné ces éléments concernant les difficultés d’accès à la pédiatrie.
Les rédacteurs reconnaissent que les méde cins généralistes jouent un rôle impor tant et croissant dans la prise en charge des enfants : ils assurent plus de 85 % des consultations de ville des enfants de moins de 16 ans. Néanmoins, leur formation à la
Un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) concernant la pédiatrie et l’organisation des soins de l’enfant en France vient d’être publié.
médecine de l’enfant, même si elle a été récemment renforcée, reste hétérogène et insuffisante au regard de ce rôle prépondé rant. Le rôle déclinant joué par la pédiatrie libérale dans le suivi de l’enfant contribue à sa crise identitaire. Les missions assumées par les pédiatres de ville sont aujourd’hui proches de celles des médecins généralistes et leurs positionnements respectifs appa raissent peu complémentaires. Les pédiatres assument un important rôle de suivi préven tif, sans spécialisation sur les enfants ayant des besoins particuliers, et jouent très peu de rôle de recours, que ce soit pour les professionnels du premier recours ou pour les établissements hospitaliers. Leurs mis sions apparaissent ainsi en décalage avec leur formation très spécialisée. De même, le domaine de la pédopsychiatrie est aussi dans une situation très difficile. Les auteurs indiquent cependant que la situation est plus favorable quant à la pédiatrie hospita lière et la chirurgie pédiatrique.
Les rapporteurs observent également, s’appuyant pour partie sur l’enquête flash menée par l’Unaf sur ce sujet, que le sys tème de santé des enfants souffre aussi d’un manque de lisibilité pour les parents, qui n’identifient pas clairement le rôle des acteurs et ne connaissent pas toujours les dispositifs de suivi, tels que les examens obligatoires. La méconnaissance de l’offre en santé pour les enfants constitue l’un des facteurs de recours aux urgences hospita lières. Par ailleurs, le système de santé ne prend pas toujours correctement en charge les problématiques spécifiques des enfants vulnérables et des enfants souffrant de cer taines pathologies. L’IGAS constate enfin que la coordination des acteurs de santé de l’enfant reste insuffisante, que ce soit entre établissements hospitaliers, entre profes sionnels de ville ou entre acteurs de ville et hôpital.
Face à ces situations, la mission menée par l’IGAS propose un nouveau modèle de prise en charge des enfants pour répondre à l’ensemble de leurs besoins de santé, valo riser et clarifier le rôle des acteurs de santé. En préconisant notamment de recentrer la pédiatrie hospitalière et la chirurgie pédia trique sur leur rôle de recours et valoriser l’exercice médical et paramédical. Faire évo luer la formation initiale et continue des professionnels. Développer et généraliser
les coopérations territoriales pour organiser les parcours de soins pédiatriques, favoriser la prise en charge des soins non program més et garantir le suivi de l’ensemble des enfants.
Source : « La pédiatrie et l’organisation des soins de l’enfant en France » Emilie FAUCHIER-MAGNAN et Pr. Bertrand FENOLL Membres de l’inspection générale des affaires sociales Avec le concours de la Pr Brigitte CHABROL. Mai 2021
En 2019,
lits d’hospitalisation complète ont été dénombrés dans les établissements de santé en France métropolitaine et des DROM, service de santé des armées (SSA) compris, soit une diminution de 76 000 lits d’hospitalisation depuis 2003. A contrario, les capacités en hospitalisation partielle se sont développées pour atteindre un total de 79 000 places en 2019, soit une hausse de 29 000 places au cours de la même période.
France Assos santé (FAS) vient de publier un nouveau guide pour les représentants des usagers siégeant en commission des usagers (CDU). Ce document, à la rédaction duquel l’Unaf a été associée, rappelle le rôle et les missions des RU en CDU, présente des exemples pratiques visant à faire vivre cette instance au quotidien, prodigue des conseils, et cite des références législatives ou réglementaires, donne des exemples des thèmes d’intervention de la CDU. Ce guide met également en miroir les autres productions de FAS afin que le représentant puisse avoir une vision globale des outils qui sont à sa disposition pour remplir a u mieux ce mandat. Ce document est disponible sur le site de FAS, mais également auprès de ses Unions régionales.
Contact : Nicolas Brun, coordonnateur Protection sociale, Santé Unaf nbrun@unaf.fr
assos-sante.org
La loi « Climat » du 28 août 2021 contient plusieurs dispositions en lien avec le logement : copropriétés, qualité de l’habitat, plan pluriannuel de travaux, diagnostic de performance énergétique, interdiction d’augmenter les loyers des logements énergivores, etc.
Le nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE) créé par la loi « Climat » est entré en vigueur au 1er juillet 2021. Il est désormais opposable et non plus seu lement informatif. L’obligation de le mettre en application s’applique progressivement pour la mise en location et la vente de loge ments. Pour rappel, le DPE indique au futur acquéreur ou locataire une estimation de la consommation énergétique d'un logement et son taux d'émission de gaz à effet de serre, notamment à travers les étiquettes énergie.
Les notations vont de A (meilleure note) à G. L’objectif est d’éradiquer les passoires thermiques et de progresser dans la rénova tion énergétique des logements. À noter, les nouveaux DPE ont été temporairement sus pendus pour les logements construits avant 1975 en raison de défaillances du logiciel de calcul constatées par les professionnels de l’immobilier. Leur reprise, avec une nouvelle méthode, a été annoncée au 1er novembre 2021 par le ministère du Logement, le temps que les corrections soient apportées aux logiciels utilisés par les diagnostiqueurs.
Un outil pour lutter contre la précarité énergétique : le chèque énergie
L’Unaf a été sollicitée par la Cour des Comptes pour apporter son point de vue et lui com muniquer sa position sur le chèque énergie dans le cadre d’une enquête menée sur ce dispositif. Le chèque énergie est une aide financière versée aux ménages modestes, en fonction des ressources et de la compo sition familiale, pour aider au paiement des factures d’énergie. A noter : face à la forte hausse des prix de l’électricité et du gaz, un chèque énergie exceptionnel de 100 € sera versé en décembre 2021 aux 5,8 millions de ménages bénéficiaires.
Si l’Unaf est satisfaite de l’élargissement de ce dispositif à d’autres combustibles que le gaz et l’électricité, comme le fioul ou le bois, force est de constater que son montant est trop faible pour aider vraiment les familles : le chèque énergie ne couvre qu’une petite partie des dépenses énergétiques. L’Unaf préconise de l’élargir au-delà des ménages situés sous le seuil de pauvreté, en faisant une analyse plus fine de la situation des familles. Elle demande la prise en compte de critères supplémentaires tels que le type de logement, sa situation géographique et le climat. Par ailleurs, l’Unaf demande une reva lorisation importante du forfait « charges » pris en compte dans le calcul des APL.
Contact : Valentine de La Morinerie,chargée de mission environnement-développement durable vdelamorinerie@unaf.fr
Défendre les familles, le magazine des représentants familiauxLa vente des logements HLM à leurs occupants a été intensifiée sous l’effet de la loi ELAN. Pour faciliter cette accession à la propriété, le groupe Action Logement a créé une structure, l’Opérateur National de Vente HLM (ONV), chargée d’acquérir des immeubles en blocs auprès des organismes HLM et de procéder ensuite à la vente des logements à l’unité. Pour mieux accompagner les locataires et accé dants dans les nouvelles copropriétés, l’ONV a élaboré un outil de formation digitale « Ma Copro, ON Vous donne les clés », pour l’en semble des résidents. Il s’adresse à la fois à ceux qui ont fait le choix de devenir copropriétaire et à ceux qui souhaitent rester locataire et apporte les informations utiles sur le fonctionnement et la vie en copropriété et aide à mieux comprendre ce qui change lorsqu’une résidence HLM passe en copropriété. Associées à cette démarche, l’Unaf et des Udaf ont apporté leur contribution à l’élaboration de « Ma Copro, ON Vous donne les clés ». Votre Udaf peut ainsi avoir accès à cette plateforme, sur demande auprès de Marilia Mendes (mmendes@unaf.fr)

L’Unaf a réuni les représentants des Udaf et des Uraf impliqués dans le domaine du logement, lors d’une visio-conférence le 4 juin dernier. Cette rencontre s’est inscrite dans le contexte de la crise sanitaire, qui a révélé des inégalités inédites face au logement et considéra blement aggravé les difficultés des plus précaires. De nombreuses mesures d’aides ont été rapidement mises en place (prolongements successifs de la trêve hivernale, mobilisation d’aides exceptionnelles, mesures de souplesse des bailleurs pour le paiement des loyers, etc.) qui ont permis aux familles d’éviter l’expulsion de leur logement. Cette rencontre a permis d’échanger sur ces évolutions au regard des réalités de terrain et de faire le point sur les réformes et dispo sitions récentes mises en œuvre en matière d’aides, de prévention, d’accompagnement social et de gouvernance du logement social. Le compte-rendu complet de la journée peut vous être envoyé sur demande auprès de (Patricia Chappe pchappe@unaf.fr ).
Au sommaire : la réforme des APL « en temps réel » ; l’accompagne ment vers et dans le logement, les impayés de loyers et la préven tion des expulsions locatives ; la réorganisation des offices publics de l’Habitat.
Entre la publication de la loi Elan, fin 2018, et septembre 2021, 118 offices public de l’habitat (OPH) ont rejoint une Société anonyme de coordination (SAC) et 42 ont disparu, du fait de fusions entre offices ou de changements de statut. Un document très utile pour s’y retrouver :
Pour vous aider dans vos prises de décision lors de la révision des loyers HLM au 1er janvier 2022, l’Unaf communique chaque année, des informa tions relatives à l’actualisation et réforme de l’Aide personnalisée au logement (APL) et aux mesures qui impactent le modèle économique et social des orga nismes d’HLM. La règle générale conseillée par l’Unaf a toujours été de ne pas voter des augmentations de loyers qui soient supérieures au niveau d’actualisation de l’APL, afin de ne pas augmenter le taux d’effort des ménages. Pour le vote des loyers au 1er janvier 2022, la règle serait de voter contre les augmentations de loyers HLM supérieures à 0,42%.

Le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (loi 3DS) avait prévu dans son article 38 le transfert de la tutelle des pupilles de l’Etat aux départements. L’ar ticle a finalement été supprimé, mais il pourrait être de nouveau pro posé par le biais d’un autre support législatif. L’abandon du statut de pupille par l’Etat avait suscité de vives inquié tudes. Avec une pluralité de regard, tuteur et conseil de famille exercent ensemble les responsabilités liées à l’autorité parentale pour ces enfants. Dissocier le suivi de la vie du pupille et les déci sions à prendre – fonction du tuteur et du conseil de famille – de leur mise en œuvre et du financement des structures (familles d'ac cueil, foyers, etc.) – fonction du département – permet d’éviter toute confusion entre les rôles de décideur et payeur. Cet équilibre serait rompu si la tutelle des pupilles était transférée aux départements : les attributions du conseil de famille seront certes conservées, mais tuteur et gardien ne seront plus qu’une seule et même personne, le président du conseil départemental.
Ce désengagement irait à l’encontre des préconisations de l’Inspec tion générale des affaires sociales (IGAS) pour une plus grande res ponsabilité de l’Etat pour lutter contre les inégalités territoriales en protection de l’enfance, mais aussi du projet de loi sur la protection des enfants adopté en première lecture à l’Assemblée nationale le 8 juillet dernier, qui entend là encore réaffirmer le rôle de l’Etat.
Le désengagement de l’Etat risque de dégrader la situation des 3 220 enfants pupilles de l’État. Attachée à la défense des intérêts des enfants, et en particulier à l’égard de ceux qui n’ont plus de famille, l’Unaf reste vigilante quant à la possible réintroduction de cette dispo sition dans un autre cadre, comme la loi sur la protection des enfants dont l’examen par le Sénat est prévu le 14 décembre prochain.
Préfigurés dès 2014, puis généralisés en 2015 pour renforcer la coordination des multiples acteurs qui interviennent dans ce champ, les schémas départementaux des services aux familles (SDSF) sont devenus la clé de voûte de la politique petite enfance et parentalité.
L’ordonnance du 19 mai 2021 renforce leur pilotage local, avec la création de comités départementaux des services aux familles (CDSF). Ce comité est une instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes les questions relatives à l’organisation, au fonctionnement et au développe ment des services d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité. Il concevra et suivra la mise en œuvre du SDSF. Un décret publié prochainement viendra préciser leur gouvernance. Présidé par le préfet et trois vice-présidents (conseil départemen tal, communes et intercommunalités, CAF), le CDSF sera composé de 36 membres dont le président de l'Udaf ou son représentant, qui devra également proposer au préfet la désignation de deux parents ou représentants légaux d’enfants.
Beaucoup de SDSF sont en cours de renégo ciations, pour une durée variable selon les territoires. Défendre les familles, promouvoir l’expertise, mais aussi les dispositifs de sou tien à la parentalité portés par notre réseau, agir aux côtés des partenaires locaux : s’im pliquer dans les SDSF est un enjeu important pour les Udaf, qui sont d’ores et déjà légi times à chaque étape de leur élaboration.
Contact : Mathilde Bourgerie, chargée de mission parentalité mbourgerie@unaf.fr
Vous souhaitez vous former à la mission de représentants, ou perfectionner vos compétences ? Vous pouvez bénéficier d’une formation par l’Unafor, notre centre partenaire qui, depuis plus de 20 ans, propose des formations de qualité à nos salariés et bénévoles. Interview de Fréderic Duriez, Chargé de mission à l’Unafor.
Pour être pertinent et écouté, le repré sentant des familles doit s'appuyer sur des connaissances et des compétences. Il lui faut connaître l'union qu'il représente, son organisation, ses positions et ses actions. Le représentant doit aussi se repérer dans la structure où il siège. Ses positions se fondent sur les principes défendus par l'Udaf ou l'Uraf qu'il représente et une éthique commune. Pour se sentir à l'aise dans son rôle, le repré sentant doit être accompagné, rencontrer d'autres représentants et disposer d'espaces où acquérir et mettre à jour des connais sances. Les formations proposées par l'Una for et l'Unaf offrent ces opportunités.
L'engagement dans la vie associative est souvent l'occasion de mobiliser de nou velles compétences. Vous prenez la parole, animez des réunions, formalisez des projets associatifs, participez à la gestion de votre association.
L'Unafor propose des formations pour déve lopper ces compétences. Elles sont orga nisées à la demande des unions (Udaf ou Uraf) pour des groupes de 15 participants.
Parmi ces formations, vous trouverez les thèmes suivants :
• prendre la parole et participer aux réunions
savoir argumenter
• animer et réussir une réunion
s'engager dans un projet associatif
communiquer avec un budget limité. www.unafor.fr
Notre proposition de formation s’établit sur plusieurs niveaux. Pour représenter une union d’association familiale, Udaf ou Uraf, il faut connaître l’institution familiale, son histoire, ses valeurs, et la diver sité des associations familiales. Nos formations abordent ses ques tions, ainsi que la légitimité du représentant, le cadre juridique, la connaissance des familles et du territoire et les liens avec l’Udaf. Nous proposons ensuite des formations plus précises qui concernent les espaces de représentation, comme les CCAS, les CPAM ou les CAF pour aider les représentants à comprendre les structures dans les quelles ils siègent, les enjeux et les positionnements.
Les représentants familiaux insistent souvent sur les compétences qu’ils ont pu développer à travers leur mandat. La connaissance des familles, des territoires et des dispositifs est une véritable richesse pour les associations d’origine. L’Unafor propose aussi des formations plus transversales, autour de la communication et de l’animation de réunions qui peuvent ensuite être réinvesties dans un environnement bénévole ou professionnel.
Nous avons proposé des formations à distance aux bénévoles engagés dans la représentation des Udaf. Certaines formations classiques ont été portées à distance, sur une journée avec des groupes d’une quin zaine de personnes, via un système de visioconférence. Nous avons souvent pu apprécier une participation plus grande de personnes éloi gnées des Udaf. L’Unafor a également expérimenté des formats différents : des ateliers ou des webinaires sur des durées plus réduites ont également rencontré un beau succès, avec par fois plus de 80 inscrits. Nous avons pu apprécier à quel point les repré sentants s’étaient eux-mêmes adap tés et avaient appris à utiliser les outils numériques.
« Quelle formation pour quelqu’un qui souhaite s’engager dans la représentation familiale ? »
Le contexte inédit, insécurisant de la crise sanitaire a durement mis à l’épreuve la santé mentale des Français et tout particulièrement celle des personnes les plus vulnérables. Le quotidien des familles comme des personnes isolées s’en est trouvé bouleversé.
A l’occasion des assises de la santé mentale des 27 et 28 septembre 2021, l’Unaf a élaboré une contribution dans laquelle elle partage ses observations du terrain et formule des propositions dans plusieurs domaines d’action du réseau UnafUdaf. Les Udaf détiennent, en effet, une longue expérience de terrain auprès de familles et de personnes confrontées à des problématiques de santé mentale.



« J'ai ressenti comme une agréable surprise l'arrivée de ce premier numéro de Défendre les familles. En effet (…) je n'étais pas préparé, en entrant au CA de l'Udaf du 44 à me repérer dans le monde foisonnant d'associations et de sigles regroupés dans les Udaf, Uraf et autre Unaf. Le format court et rare de cette nouvelle revue est encourageant à lire et donne de précieux repères. J'ai en particulier apprécié le premier et substantiel article appelant à une relance de la politique familiale pour que les couples aient le nombre d'enfants qu'ils désirent, soutenant ainsi une natalité sans laquelle l'avenir de la société est compromis. »
Jean Bourreau (44)« Je tiens à vous féliciter pour cette nouvelle revue très intéressante. Nul doute qu’elle sera appréciée par tous les représentants de l’Udaf dans les différentes structures qui ont vraiment besoin d’outils (entre autres) pour exercer leur mandat… »
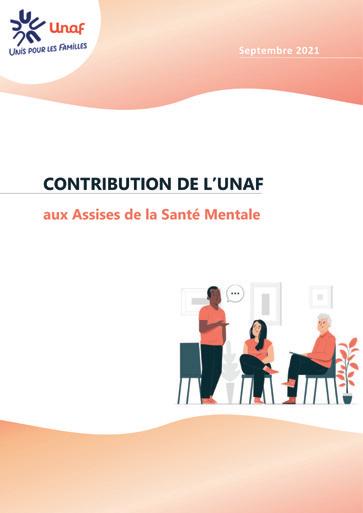
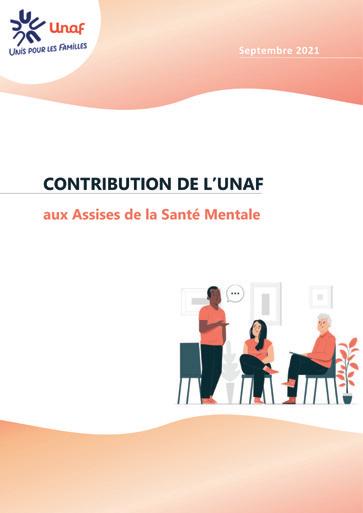
Claudie Ghesquière (59)
« Bonne surprise de trouver dans sa boîte aux lettres, un magazine à notre image : un titre avec lequel nous nous trouvons en phase au regard de notre mission de militant familial de terrain, un contenu à la fois diversifié, synthé tique et constructif, nous mettant en quelque sorte en appétit d'en savoir d'avan tage (…) Cette heureuse initiative mérite selon nous d'être soulignée comme fait majeur de l'information familiale en ce milieu d'année. »
Jean-Philippe Leriche (59)
Date (au choix, sous réserve) :
du 18 au 21 janvier 2022
du 26 au 28 janvier 2022
Paris (lieu exact à venir)
Inscription : Geneviève Martin (gmartin@unaf.fr)
Le catalogue de formations de l’Unafor propose d’autres formation dédiées aux représentants familiaux :
Pour en savoir plus, lire la page 19 et rendez-vous sur www.unafor.fr
Envie de partager votre expérience de représentant familial, besoin d’information, suggestion…
